
FRÉDÉRIC BASTIAT,
Œuvres Complètes. Deuxième Édition.
Tome Septième. Essais - Ébauches - Correspondance. (1864)
 |
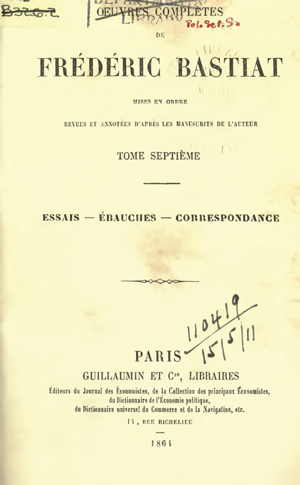 |
| Frédéric Bastiat (1801-1850) |
[Created: 3 May, 2021]
[Updated: 21 August, 2023 ] |
The Guillaumin Collection
 |
This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |
Source
, Œuvres Complètes de Frédéric Bastiat. Mises en Ordre, Revues et Annotées d’après les manuscrits de l’auteur. Deuxième Édition. Tome Septième. Essais - Ébauches - Correspondance. (Paris: Guillaumin et Cie Libraires, 1864).http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Bastiat/OeuvresCompletes/OC7-1864/index.html
Œuvres Complètes de Frédéric Bastiat. Mises en Ordre, Revues et Annotées d’après les manuscrits de l’auteur. Deuxième Édition. Tome Septième. Essais - Ébauches - Correspondance. (Paris: Guillaumin et Cie Libraires, 1864).
This title is also available in a facsimile PDF of the original and various eBook formats - HTML, PDF, and ePub.
This book is part of a collection of works by Frédéric Bastiat (1801-1850).
See also my edition (in French) of The Works of Frédéric Bastiat.
[VII-445]
TABLE DES MATIÈRES DU SEPTIÈME VOLUME.
Avertissement [P. Paillottet], p. v
ESSAIS.
- 1. — D’une pétition en faveur des réfugiés polonais, p. 1
- 2. — D’un nouveau collége à fonder, p. 4
- 3. — Compte rendu sur la question des duels, p. 10
- 4. — Liberté du commerce, p. 14
- 5. — Questions soumises aux Conseils généraux, en 1845, p. 20
- 6. — Projet de ligue anti-protectioniste, p. 30
- 7. — Même sujet, p. 34
- 8. — Même sujet, p. 38
- 9. — Association à Bordeaux, p. 43
- 10. — Au rédacteur du Journal de Lille, p. 47
- 11. — Théorie du bénéfice, p. 50
- 12. — Au rédacteur de l’Époque, p. 53
- 13. — Le libre-échange en action, p. 58
- 14. — Qu’est-ce que le commerce ?, p. 63
- 15. — À M. le Ministre du commerce, p. 66
- 16. — Au rédacteur du Courrier français, p. 71
- 17. — La réforme postale, p. 78
- 18. — Même sujet, p. 83
- 19. — La liberté commerciale, p. 91
- 20. — 1er lettre au Journal des Débats, p. 96
- 21. — 2e lettre, p. 99
- 22. — Du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne, p. 103
- 23. — Aux membres de l’Association, p. 108
- 24. — À M. Tanneguy-Duchâtel, p. 114
- 25. — La logique du Moniteur industriel, p. 118
- 26. — Toast, p. 122
- 27. — La loi des céréales et le salaire, p. 125
- 28. — Au Moniteur industriel, p. 128
- 29 à 31. — Aux négociants du Havre, p. 131
- 32 et 33. — Au rédacteur de la Presse, p. 143
- 34 et 35. — Au rédacteur du National, p. 152
- 36. — Le Roi libre-échangiste, p. 167
- 37. — Discours à la salle Duphot, p. 170
- 38. — Projet de discours à Bayonne, p. 178
- 39. — Aux membres du Conseil général de la Seine, p. 193
- 40. — Aux membres du Conseil général de la Nièvre, p. 199
- 41. — À M. Jobard, p. 207
- 42 à 55. — Courts articles dans la République française, du 27 février au 6 mars 1848, p. 210
- 56 à 63. — Courts articles dans le Jacques-Bonhomme, du 11 au 23 juin 1848, p. 235
- 64. — Le Capital, p. 248
- 65. — Profession de foi de 1849, p. 255
- 66. — Rapport au Conseil général des Landes, p. 263
ÉBAUCHES.
- 67. — Sophismes électoraux, p. 271
- 68. — Dialogue électoral, p. 280
- 69. — Fragment, p. 289
- 70. — Réforme parlementaire, p. 289
- 71. — Lettre à un candidat, p. 298
- 72. — Lettre à M. Dampierre, p. 300
- 73. — Projet de préface pour les Harmonies, p. 303
- 74. — Anglomanie, Anglophobie, p. 309
- 75. — Le profit de l’un est le dommage de l’autre, p. 327
- 76. — Individualisme et Fraternité, p. 328
- 77. — Barataria, p. 343
- 78. — Lettre à un ecclésiastique, p. 351
- 79. — Question religieuse, p. 355
- 80. — De la séparation du temporel et du spirituel, p. 357
- 81. — Pensée, p. 361
- 82. — Les trois conseils, p. 361
CORRESPONDANCE.
- Lettre à M. Laurence, p. 369
- Lettre à M. Dunoyer, p. 371
- Lettre à M. de Lamartine, p. 373
- Lettre à M. Paulton, p. 374
- Cinq lettres à M. Horace Say, p. 377
- Dix-sept lettres à M. Domenger, p. 385
- Lettre à M. George Wilson, p. 412
- Deux lettres à M. le comte Arrivabene, p. 416
- Onze lettres à M. et madame Schwabe, p. 420
- Cinq lettres à M. et madame Cheuvreux, p. 432
- Huit lettres à M. Paillottet, p. 436
[VII-v]
AVERTISSEMENT↩
Au commencement du tome Ier, j'ai expliqué par que1 motif je me décidais à réunir dans un volume final toutes les productions de Bastiat que l'édition présente ajoute à l'édition de 1855. Je vais dire maintenant comment je les ai classées dans ce tome VII, qui fait à lui seul toute la différence entre les deux éditions.
J'ai mis au premier rang les articles de journaux, en les rangeant suivant l'ordre chronologique, quand je n'avais pas de bonnes raisons pour m'en écarter un peu. Ces articles sont le fruit d'un travail rapide, mais definitif.
Ensuite viennent les ébauches, extraites des cahiers et des papiers de l'auteur. Ce n'est certes pas dans cet état qu'il eût consenti à les livrer au public ; mais, puisqu'il n'est plus là pour les finir, je ne me fais pas scrupule de les donner telles qu'elles sont, et j'espère que peu de lecteurs m'en sauront mauvais gré. Aux ébauchés,j'ai joint quelques lettres dont le sujet m'invitait à les y rattacher.
La correspondance termine le volume. Elle se compose de lettres dont les destinataires, à deux exceptions près, n'ont pas figuré, au tome Ier, parmi les correspondants [VII-vi] de Bastiat. La série la plus longue et la plus intéressante m'a été communiquée par M. Domenger.
Quand on fera plus tard une édition nouvelle, il con-viendra de classer les volumes autrement. Les tomes III, IV, V et VI de l'édition actuelle, qui contiennent les oeuvres dont Bastiat lui-même faire des livres, devront, si l'on m'en croit, commencer la série et prendre les numéros I, II, III, IV ; puis la matière en ordre et formant trois volumes posthumes, achèvera la série, sous les numéros V, VI, et VII.
P. PAILLOTTET.
MÉLANGES
[VII-1]
1. — D’UNE PÉTITION EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS POLONAIS [1] .↩
On signe en ce moment à Bayonne une pétition à la Chambre des députés pour demander que la loi du 21 avril 1832, relative aux réfugiés, ne soit pas renouvelée à l’époque de son expiration.
Nous apprenons avec plaisir que des hommes de toutes les opinions se proposent d’apposer leur signature à cette pétition. En effet, il ne s’agit point ici de demander à la Chambre un acte qui satisfasse telle ou telle coterie ; qui favorise la liberté aux dépens de l’ordre, ou l’ordre aux dépens de la liberté (si tant est que ces deux choses ne soient pas inséparables). Il s’agit de justice, d’humanité envers nos frères malheureux ; il s’agit de ne pas jeter de l’absinthe et du fiel dans la coupe de la proscription, déjà si amère.
Pendant la guerre de la Pologne, on pouvait remarquer en France divergence d’opinions, de projets, relativement à cette guerre : les uns auraient voulu que la France vînt au secours des Polonais par les armes, les autres par [VII-2] l’argent, les autres par la diplomatie ; d’autres enfin croyaient tous secours inutiles. Mais, s’il y avait des avis divers, il n’y avait qu’un vœu, qu’une sympathie, et elle était toute pour la Pologne.
Quand les restes de cette nation infortunée vinrent en France pour se soustraire à la haine des rois absolus, cette sympathie fut fidèle au courage malheureux.
Cependant, depuis deux ans, quel est le sort des Polonais en France ? On en jugera par la lecture de la loi qui les a placés sous le pouvoir discrétionnaire du Ministère et dont voici le texte :
Art. 1er. — Le Gouvernement est autorisé à réunir dans une ou plusieurs villes qu’il désignera les étrangers réfugiés qui résident en France.
Art. 2. — Le Gouvernement pourra les astreindre à se rendre dans celle de ces villes qu’il aura indiquée ; il pourra leur enjoindre de sortir du royaume, s’ils ne se rendent pas à cette destination ou s’il juge leur présence susceptible de troubler l’ordre et la tranquillité publique.
Art. 3. — La présente loi ne pourra être appliquée aux étrangers réfugiés qu’en vertu d’un ordre signé par un ministre.
Art. 4. — La présente loi ne sera en vigueur que pendant une année à compter du jour de sa promulgation.
Maintenant, nous demandons s’il ne serait pas indigne de la France de rendre une telle loi définitive ou, ce qui revient au même, de la proroger indéfiniment par des renouvellements successifs.
Le vœu le plus ardent que puisse former un proscrit, après celui de voir cesser son exil, est sans doute de se livrer à quelque travail, de se créer quelques ressources par l’industrie. Mais pour cela il faut pouvoir choisir le lieu de sa résidence ; il faut que ceux qui pourraient se rendre utiles dans des maisons de commerce résident dans des villes [VII-3] commerciales, que ceux qui ont une aptitude pour quelque industrie manufacturière puissent s’approcher des pays de fabrique, que ceux qui ont quelques talents habitent les villes où les beaux-arts sont encouragés. Il faut encore qu’ils ne puissent pas en être expulsés du soir au lendemain, et que le glaive de l’arbitraire ne soit pas constamment suspendu sur leur tête.
La loi du 21 avril est calculée de manière à ce que les Polonais qui ne peuvent recevoir de chez eux ni secours ni nouvelles, dont les familles sont opprimées, traînées en Sibérie, dont les compatriotes sont errants et dispersés sur le globe, ne puissent cependant rien faire pour adoucir leur sort. Ce ne sont plus des réfugiés, ce sont de véritables prisonniers de guerre, agglomérés par centaines dans des bourgades qui ne leur offrent aucune ressource, empêchés même par l’incertitude où on les laisse d’adopter plusieurs mesures qui pourraient diminuer leurs dépenses. Nous les avons vus recevoir à 9 heures l’ordre de quitter une ville à midi, etc.
Ce système de persécution se fonde sur la nécessité de conserver l’ordre et la tranquillité publique en France. Mais tous ceux qui ont eu occasion de connaître les Polonais savent qu’ils ne sont pas des fauteurs de troubles et de désordres ; qu’ils savent fort bien que les intérêts de la France doivent être débattus par des Français ; enfin s’il s’en trouvait quelqu’un qui n’eût pas l’intelligence de sa position et de ses devoirs, les tribunaux sont là, et il n’est nullement nécessaire qu’un ministre placé à deux cents lieues juge et condamne sans entendre et sans voir, sans même s’assurer, ou du moins sans être obligé de s’assurer qu’il ne commet pas une erreur de nom ou de personnes.
Il résulte de là qu’il suffit qu’un Polonais ait un ennemi personnel bien en cour pour qu’il soit jeté hors du [VII-4] territoire sans jugement, sans enquête et sans les garanties qu’obtiendrait en France le dernier des malfaiteurs.
Et d’ailleurs, est-ce de bonne foi qu’on craint que la présence des Polonais trouble la tranquillité publique ? Nous nions qu’ils veuillent troubler l’ordre ; et s’ils avaient une telle prétention, nous serions disposés à croire que ce sont les mesures acerbes employées contre eux qui ont irrité et égaré leurs esprits. Mais notre Gouvernement est-il si peu solide qu’il ait à redouter la présence de quelques centaines de proscrits ? Ne ferait-il pas sa propre satire en avançant qu’il ne peut répondre de l’ordre public si l’on ne l’arme pas envers eux de pouvoirs arbitraires ?
Il est donc bien évident que la pétition, qui se signe en ce moment, n’est pas et ne doit pas être l’œuvre d’un parti ; mais qu’elle doit être accueillie par tous les Bayonnais, sans distinction d’opinion politique, pourvu qu’ils aient dans l’âme quelque étincelle d’humanité et de justice.
References
[1] Il est probable, mais je n’en suis pas sûr, que cet article, extrait d’un cahier de Bastiat et écrit de sa main, a été inséré dans un journal de Bayonne, en 1834. (Note de l’éditeur.)
2. — D’UN NOUVEAU COLLÉGE À FONDER À BAYONNE [1] .↩
Il a été question au conseil municipal de doter Bayonne d’un collége. Mais que voulez-vous ? on ne saurait tout faire à la fois ; il fallait courir au plus pressé, et la ville s’est ruinée pour se donner un théâtre : le plaisir d’abord ; l’instruction attendra. D’ailleurs, le théâtre, n’est-ce point aussi une école, et une école de mœurs encore ? Demandez au vaudeville et au mélodrame.
Cependant, en matière de fiscalité, Bayonne se tient à la [VII-5] hauteur de la civilisation, et l’on peut espérer que la question financière ne l’arrêtera pas. Dans cette confiance je demande la permission de lui soumettre quelques idées sur l’instruction publique.
À la première nouvelle du projet municipal, je me suis demandé si un collége qui donnerait l’instruction scientifique et industrielle n’aurait pas quelques chances de succès. Il ne manque pas d’établissements autour de Bayonne qui enseignent, ou pour parler plus exactement, qui font semblant d’enseigner le grec, le latin, la rhétorique, voire même la philosophie. Larresole, Orthez, Oléron, Dax, Mont-de-Marsan, Saint-Sever, Aire, distribuent l’éducation classique. Là, la jeune génération qui doit nous succéder au comptoir et à l’atelier, au champ et à la vigne, au bivouac et au tillac, se prépare à remplir sa rude tâche en se morfondant sur la déclinaison et la conjugaison des langues qu’on parlait il y a quelque deux ou trois mille ans. Là, nos fils, en attendant qu’ils aient des machines à diriger, des ponts à construire, des landes à défricher, des vaisseaux à livrer aux quatre vents du ciel, une comptabilité sévère à tenir, apprennent à scander gentiment sur le bout de leurs doigts,… Tītўrĕ, tū pătŭlœ rĕcŭ, etc. — Soyons justes toutefois, avant de les lancer dans le monde, et vers les approches de leur majorité, on leur donnera une idée vague de la numération, peut-être même quelques aperçus d’histoire naturelle sous forme de commentaires de Phèdre et d’Ésope, le tout, bien entendu, pourvu qu’ils ne perdent pas un iota du Lexicon et du Gradus ad Parnassum.
Supposons que, par une singularité inouïe, Bayonne prît justement le contrepied de cette méthode, qu’il fît de la science, de la connaissance de ce qui est, de l’étude des causes et des effets, le principal, la base, et, de la lecture des poëtes anciens, l’accessoire, l’ornement de l’éducation, ne pensez-vous pas que cette idée, toute bouffonne qu’elle [VII-6] paraît au premier coup d’œil, pourrait sourire à beaucoup de pères de famille ?
Car enfin de quoi s’agit-il ? de composer ce bagage intellectuel qui nourrira ces enfants dans le rude voyage de la vie. Quelques-uns sont appelés à défendre, à éclairer, à moraliser, à représenter, à administrer le peuple, à développer, à perfectionner nos institutions et nos lois, le plus grand nombre, de beaucoup, devra chercher dans le travail et l’industrie les moyens de vivre et de faire vivre femme et enfants.
Et, dites-moi, est-ce dans Horace et dans Ovide qu’ils apprendront ces choses ? Pour être un bon agriculteur, faut-il passer dix ans à apprendre à lire les Georgiques ? Pour mériter les épaulettes, est-il nécessaire d’user sa jeunesse à déchiffrer Xénophon ? Pour devenir homme d’État, pour s’imprégner des mœurs, des idées et des nécessités de notre époque, faut-il se plonger pendant vingt ans dans la vie romaine, se faire les contemporains des Lucullus et des Messaline, respirer le même air que les Brutus et les Gracques ?
Non seulement ce long séjour de l’enfance dans le passé ne l’initie pas au présent, mais il l’en dégoûte ; il fausse son jugement, il ne prépare qu’une génération de rhéteurs, de factieux et d’oisifs.
Car qu’y a-t-il de commun entre la Rome antique et la France moderne ? Les Romains vivaient de rapine, et nous vivons d’industrie ; ils méprisaient et nous honorons le travail ; ils laissaient aux esclaves la tâche de produire, et c’est justement la tâche dont nous sommes chargés ; ils étaient organisés pour la guerre et nous pour la paix, eux pour la spoliation et nous pour le commerce ; ils aspiraient à la domination, et nous tendons à la fusion des peuples.
Et comment voulez-vous que ces jeunes hommes échappés de Sparte et de Rome ne troublent pas notre siècle de [VII-7] leurs idées, que, comme Platon, ils ne rêvent pas de chimériques républiques ; que, comme les Gracques, ils n’aient pas le regard fixé sur le mont Aventin ? que comme Brutus, ils ne méditent pas la gloire sanglante d’un sublime dévouement.
Je concevrais l’éducation littéraire si nous étions, comme les Athéniens, un peuple d’oisifs. Disserter à perte de vue sur la métaphysique, l’éloquence, la mythologie, les beaux-arts, la poésie, c’est, je crois, le meilleur usage que puisse faire de ses loisirs un peuple de patriciens qui se meut au-dessus d’une multitude d’esclaves.
Mais, à qui doit créer lui-même le nutritum, le vestitum et le tectum, que servent les subtilités de l’école et les rêvasseries des sept sages de la Grèce ? Si Charles doit être laboureur, il faut qu’il apprenne ce que sont en réalité l’eau, la terre et les plantes, et non ce qu’en ont dit Thalès et Épicure. Il lui faut la physique des faits et non la physique des poëtes, la science et non l’érudition. Notre siècle est comme Chrysale :
Il vit de bonne soupe, et non de beau langage.
J’entends d’ici Belise se récrier : Se peut-il rencontrer un homme aussi prosaïque, aussi vulgaire,
Un esprit composé d’atomes si bourgeois ?
Et n’est-il pas triste de voir, pour parler le jargon du jour (qui ressemble assez à celui de Belise), le Fait étouffer l’Idée ?
Je répondrai que l’Idée de l’âge héroïque, idée de domination, de rapine et d’esclavage, n’est ni plus grande ni même plus poétique que l’Idée de l’âge industriel, idée de travail, d’égalité et d’unité, et j’ai pour moi l’autorité de deux grands poëtes, Byron et Lamartine.
Quoi qu’il en soit, si l’homme ne vit pas seulement de pain, il vit encore moins d’ambroisie, et j’oserais dire (en priant d’excuser le jeu de mots) que dans notre système [VII-8] d’éducation, c’est l’idée, l’idée fausse, qui étouffe le fait. C’est elle qui pervertit notre jeunesse, qui lui ferme les avenues de la fortune, qui la pousse vers la carrière des places, ou vers une désespérante oisiveté.
Et dis-moi, ma ville natale, toi que des lois vicieuses (filles aussi d’une instruction erronée) ont dépouillée de ton commerce, toi qui explores de nouvelles routes, qui files la laine et le lin, qui coules le fer, qui arraches le Kaolin à tes entrailles et ne sais pas t’en servir, toi qui crées des navires, qui as ta ferme-modèle, toi enfin qui cherches la force dans un peu d’eau chauffée et la lumière dans un filet d’air, — s’il te faut des bras pour accomplir tes entreprises et des intelligences pour les diriger, n’es-tu pas forcée d’appeler à ton aide des enfants du Nord, pendant que tes fils, si pleins de courage et de sagacité, battent le pavé de tes rues faute d’avoir appris ce qu’aujourd’hui il est indispensable de savoir ?
Mais admettons que l’instruction classique soit réellement la plus utile. On conviendra du moins que c’est à la condition de mettre l’acheteur en possession de la marchandise qu’elle débite. Or ces langues mortes si généralement enseignées sont-elles généralement sues ? Vous qui me lisez, et qui étiez peut-être le lauréat de votre classe, vous arrive-t-il souvent de vous promener, aux bords de la Nive et de l’Adour, un Perse ou un Sophocle à la main ? Hélas ! dans notre âge mûr, à peine nous reste-t-il de tant d’études de quoi dénicher le sens d’une simple épigraphe. Je me souviens que, dans une société nombreuse, une dame s’avisa de demander ce que signifiait cette fameuse devise de Louis XIV : Nec pluribus impar. On fit la construction, puis le mot à mot, on disserta sur la force des deux négations, chacun fit sa version ;… il n’y en eut pas deux de semblables.
Voilà donc pour quel résultat vous fatiguez l’enfance, vous la saturez de syntaxe dix heures par jour et sept [VII-9] années durant ! — Vous l’étouffez sous la déclinaison et la conjugaison, vous l’affadissez, vous l’hébétez, vous lui donnez des nausées, et puis vous dites : Mon fils est charmant, il est plein d’intelligence, il comprend, il devine à demi-mot, mais il est léger, paresseux, il ne veut pas se captiver… Pauvre petit être ! que n’est-il assez sage pour répondre : Voyez, la nature m’a donné le goût et le besoin de la diversion ; elle m’a fait curieux et questionneur pour que j’apprenne toutes choses, et que deviennent en vos mains ces précieuses dispositions ? Vous enchaînez tous mes moments à une seule étude, à une étude ingrate et aride, qui ne m’explique rien, qui ne m’apprend rien, ni la cause de ce soleil qui tourne, de cette pluie qui tombe, de cette eau qui coule, de ce grain qui germe ; ni quelle force soutient le navire sur l’eau ou l’oiseau dans l’air ; ni d’où vient le pain qui me nourrit et l’habit qui me couvre. Aucun fait n’entre dans ma tête ; des mots, toujours des mots, heure après heure, jour après jour, et toujours et sans fin, d’un bout de ma jeunesse à l’autre. Vouloir que ma noble volonté se concentre tout entière sur ces tristes formules, vouloir que je ne regarde ni le papillon qui voltige, ni l’herbe qui verdit, ni le vaisseau qui marche sans rame et sans voile, vouloir que mes jeunes instincts ne cherchent pas à pénétrer ces phénomènes, aliment de mes sensations, substance de ma pensée, c’est exiger plus que je ne puis. Ô mon père, si vous en faisiez vous-même l’expérience, si vous vous imposiez seulement pendant un mois cette chemise de force, vous jugeriez qu’elle ne peut convenir aux remuantes allures de l’enfance.
Donc si Bayonne instituait un collége où le latin occupât une heure par jour, ainsi que doit faire un utile accessoire, où le reste du temps fût consacré aux mathématiques, à la physique, à la chimie, à l’histoire, aux langues vivantes, etc., je crois que Bayonne répondrait à un besoin [VII-10] social bien senti et que l’administration actuelle mériterait les bénédictions de la génération qui nous presse.
References
[1] J’ai à répéter sur cet article ce que je viens de dire sur le précédent. (Note de l’édit.)
3. — RÉFLEXIONS SUR LA QUESTION DES DUELS.↩
(Compte rendu) [1] .↩
La centralisation littéraire est portée de nos jours à un tel point en France, et la province y est si bien façonnée, qu’elle dédaigne d’avance tout ce qui ne s’imprime pas à [VII-11] Paris. Il semble que le talent, l’esprit, le bon sens, l’érudition, le génie ne puissent exister hors de l’enceinte de notre capitale. Aurait-on donc découvert depuis peu que le calme silencieux de nos retraites soit essentiellement nuisible à la méditation et aux travaux de l’intelligence ?
L’écrit que nous annonçons est à nos yeux une protestation éloquente contre cet aveugle préjugé. À son début, l’auteur, jeune homme ignoré et qui peut-être s’ignore lui-même, s’attaque à une de nos plus brillantes illustrations littéraires et politiques ; et cependant quiconque comparera avec impartialité le réquisitoire fameux de M. Dupin sur le duel, et les réflexions de M. Coudroy, trouvera, nous osons le dire, que sous le rapport de la saine philosophie, de la haute raison et de la chaleureuse éloquence, ce n’est point M. le procureur général qui est sorti victorieux de la lutte.
M. Coudroy examine d’abord le duel dans ses rapports avec la législation existante, et il nous semble qu’à cet égard sa réfutation de la doctrine de M. Dupin ne laisse rien à désirer. En appliquant au suicide l’argumentation par laquelle M. le procureur général a fait rentrer le duel sous l’empire de notre loi pénale, il montre d’une manière sensible que c’est une interprétation forcée, aussi antipathique au bon sens qu’à la conscience publique, qui a entraîné la Cour à assimiler le duel au meurtre volontaire et prémédité.
M. Coudroy recherche ensuite si cet arrêt ne porte point atteinte à notre constitution. Il nous semble difficile de n’être point frappé de la justesse de cet aperçu. Notre constitution, en effet, reconnaît que c’est l’opinion, par l’organe du pouvoir législatif et spécialement de la chambre élective, qui classe les actions dans la catégorie des crimes, délits et contraventions. Nul ne peut être puni pour un fait que ce pouvoir n’a pas soumis à une peine. Mais, si au lieu d’attendre que la peine s’étende à l’action, le pouvoir judiciaire [VII-12] peut faire plier l’action à la peine, en déclarant que cette action, jusque-là réputée innocente, n’est qu’une espèce comprise dans un genre déterminé par la loi, je ne vois pas comment on pourrait empêcher le magistrat de se substituer au législateur, et le fonctionnaire choisi par le pouvoir au mandataire élu par le peuple.
Après ces considérations, l’auteur aborde la question morale et philosophique ; et ici, il faut le dire, il comble l’immense lacune qui se laisse apercevoir dans le réquisitoire de M. Dupin. Dans son culte superstitieux pour la loi, tous les efforts de ce magistrat se bornent à prouver qu’elle entend assimiler le duel à l’assassinat. Mais quels sont les effets du duel sur la société ; quels sont les maux qu’il prévient et qu’il réprime ; quel autre remède à ces maux pourrait-on lui substituer ; quels changements faudrait-il introduire dans notre législation pour créer à l’honneur la sauvegarde des lois, à défaut de celle du courage ; comment arriverait-on à donner aux décisions juridiques la sanction de l’opinion, et à empêcher que l’octroi de dommages-intérêts ne fût pour l’offensé une seconde flétrissure ; quels résultats produirait l’affaiblissement de la sensibilité de tous les citoyens à l’honneur et à l’opinion de leurs semblables ? Ce sont autant de graves questions dont M. Dupin ne paraît point s’être mis en peine, et qui ont été traitées par notre compatriote avec une remarquable supériorité.
Parmi les considérations qui nous ont le plus frappé dans cette substantielle discussion, nous citerons le passage dans lequel l’auteur expose la raison de l’inefficacité des peines pour réprimer les atteintes à l’honneur. Dans les crimes et délits ordinaires, les tribunaux ne font que constater et punir des actions basses dont l’opinion flétrit la source impure ; la sanction judiciaire et la sanction populaire sont d’accord. Mais, en matière d’honneur, ces deux sanctions marchent en sens opposé ; et si le tribunal prononce une [VII-13] peine afflictive contre l’offenseur, l’opinion inflige, avec plus de rigueur encore, une peine infamante à l’offensé qui a recours à la force publique pour se faire respecter. Ces jugements de l’opinion sont si unanimes, qu’ils sont dans le cœur du magistrat lui-même, alors que sa bouche est forcée d’en prononcer de tout contraires. On sait l’histoire de ce juge, devant qui un officier se plaignait d’un soufflet reçu :
« Comment, Monsieur ! s’écriait-il avec indignation, vous avez reçu un soufflet, et vous venez… mais vous faites bien, vous obéissez aux lois. »
Nous signalerons encore cette belle réfutation d’un passage de Barbeyrac cité par M. Dupin, où l’auteur nous montre comment le cercle de la pénalité humaine s’étend en raison des progrès de la civilisation, sans qu’il puisse néanmoins franchir d’une manière permanente cette limite au delà de laquelle les inconvénients de la répression dépasseraient ceux du délit. La loi elle-même a reconnu cette limite, lorsque, par exemple, elle a défendu la recherche de la paternité. Elle n’a pas prétendu qu’en dehors de sa sphère d’activité il n’y eût des actions condamnées par la religion et la morale, dont cependant elle a cru devoir s’interdire la connaissance. C’est dans cette classe qu’il faut ranger les atteintes à l’honneur.
Mais il nous est impossible de suivre l’auteur dans la carrière qu’il a parcourue ; analyser une argumentation aussi nerveuse, ce serait en détruire la force et l’enchaînement. Nous renvoyons donc à la brochure elle-même, en prévenant toutefois qu’elle exige d’être lue, comme elle a été écrite, avec conscience et réflexion. C’est la matière d’un gros livre réduite à quelques pages. Elle diffère en cela de la plupart des écrits publiés de nos jours, que dans ceux-ci le nombre des feuilles semble s’accumuler en raison du vide des idées. M. Coudroy, au contraire, est prodigue de féconds aperçus et sobre de développements. Son écrit vaut [VII-14] mieux par les pensées qu’il suggère que par celles qu’il exprime. C’est le cachet du vrai mérite.
Peut-être même pourrait-on reprocher à l’auteur de s’être trop restreint. On sent en le lisant qu’il y a eu lutte constante entre ses idées, qui voulaient se faire jour, et sa volonté déterminée à ne les montrer qu’à demi. Mais tout le monde ne peut pas, comme Cuvier, reconstruire l’animal tout entier à la vue d’un fragment. Nous vivons dans un siècle où l’auteur doit dire au lecteur tout ce qu’il pense. — Un homme d’esprit écrivait : « Excusez la longueur de ma lettre ; je n’ai pas le temps d’être plus court. » La plupart des lecteurs ne pourraient-ils pas dire aussi : « Votre livre est trop court ; je n’ai pas le temps de le lire ? »
References
[1] La Chalosse, journal de l’arrondissement de Saint-Sever, no du 11 février 1838. À cette époque, Bastiat et son ami M. Félix Coudroy, l’auteur de la brochure sur le Duel, se croyaient l’un et l’autre voués à l’obscurité. Ce fut seulement sept ans après que le premier fut appelé à manifester les qualités de son esprit sur un vaste théâtre. Pour l’y suivre, s’associer à ses travaux et se révéler comme lui au monde civilisé, il n’a manqué qu’une chose à M. Coudroy, la santé. On a déjà pu voir l’opinion de Bastiat sur le mérite de son ami en lisant les lettres insérées au tome Ier. Voici une lettre de plus écrite en 1845 :
« Mon cher Félix,
« À cause de la difficulté de lire, je ne puis bien juger le style ; mais ma conviction sincère (tu sais que là-dessus je mets de côté toute modestie de convenance), c’est que nos styles ont des qualités et des défauts différents. Je crois que les qualités du tien sont celles qui, lorsqu’on s’exerce, amènent le vrai talent : je veux dire un style vif, animé, avec des idées générales et des aperçus lumineux. Copie toujours sur de petits feuillets ; s’il faut en modifier quelqu’un, ce sera peu de chose. En copiant, tu pourras peut-être polir ; mais, pour moi, je remarque que le premier jet est toujours plus rapide et plus à la portée des lecteurs de nos jours, qui n’approfondissent guère.
« N’as-tu pas le témoignage de M. Dunoyer ? »
(Note de l’édit.)
4. — LIBERTÉ DU COMMERCE [1] .↩
Dans la séance du 29 février dernier, M. Guizot a dit :
« On parle sans cesse de la faiblesse du Gouvernement du Roi vis-à-vis de l’Angleterre. Je ne peux pas laisser passer cette calomnie.
« En Espagne, personne ne peut dire que nous ayons concouru à maintenir ce que l’Angleterre maintenait, à renverser ce qu’elle renversait.
« On a parlé d’un traité de commerce qui serait imposé par l’Angleterre ; a-t-il été conclu ?
« N’avons-nous pas rendu ces ordonnances qui ont changé les rapports commerciaux de l’Angleterre et de la France sur les questions des fils et tissus de lin ? [VII-15] « M. le Président du Conseil n’a-t-il pas fait rendre sur les tarifs d’Algérie une ordonnance qui a blessé, sur plus d’un point, des intérêts anglais respectables ? »
De tout quoi il résulte que si le pouvoir n’est pas sous le joug de l’Angleterre, à coup sûr il est sous le joug du Monopole.
Quoi ! le public n’ouvrira-t-il pas enfin les yeux sur cette honteuse mystification dont il est dupe ?
Il y a quelques années, on aurait pu croire que le Régime Prohibitif n’avait que quelques années d’existence.
Le système de la Protection, ruiné en théorie, ne se glissa dans la législation que comme mesure transitoire. Le ministre qui lui donna le plus d’extension, M. de Saint-Cricq, ne cessait d’avertir que ces taxes mutuelles, que les travailleurs se payent les uns aux autres, sont injustes au fond ; qu’elles ne sont justifiables que comme moyen momentané d’encourager certaines industries naissantes ; et il est certain que le Privilége lui-même ne réclamait pas alors la Protection comme un droit, mais comme une faveur de nature essentiellement temporaire.
Les faits qui s’accomplissaient en Europe étaient de nature à accroître les espérances des amis de la liberté.
La Suisse avait ouvert ses frontières aux produits de toutes provenances, et elle s’en trouvait bien.
La Sardaigne était entrée dans cette voie et n’avait pas à s’en repentir.
L’Allemagne avait substitué à une multitude de barrières intérieures une seule ceinture de douanes fondée sur un tarif modéré.
En Angleterre, le plus vigoureux effort qu’aient jamais tenté les classes moyennes était sur le point de renverser un système de restrictions qui, dans ce pays, n’est qu’une ransformation de la puissance féodale.
L’Espagne même semblait comprendre que ses quinze [VII-16] provinces agricoles étaient injustement sacrifiées à une province manufacturière.
Enfin la France se préparait à entrer dans le régime de la liberté par la transition des traités de commerce et de l’union douanière avec la Belgique.
Ainsi le travail humain allait être affranchi. Sur quelque point du globe que le sort les eût fait naître, les hommes allaient reconquérir le droit naturel d’échanger entre eux le fruit de leurs sueurs, et nous touchions au moment de voir se réaliser la sainte alliance des peuples.
Comment la France s’est-elle laissé détourner de cette voie ? comment est-il arrivé que ses enfants, qui s’enorgueillissaient d’être les premiers de la civilisation, saisis tout à coup d’idées Napoléoniennes, aient embrassé la cause de l’isolement, de l’antagonisme des nations, de la spoliation des citoyens les uns par les autres, de la restriction au droit de propriété, en un mot de tout ce qu’il y a de barbarie au fond du Régime prohibitif ?
Pour chercher l’explication de ce triste phénomène, il faut que nous nous écartions un moment en apparence de notre sujet.
Si, au sein d’un conseil général, un membre parvenait à créer une majorité contre l’administration, il ne s’ensuivrait pas nécessairement que le Préfet fût destitué, et moins encore que le chef de l’opposition fût nommé Préfet à sa place. Aussi, bien que les conseillers généraux soient pétris du même limon que les députés, leur ambition ne trouve pas à se satisfaire par les manœuvres d’une opposition systématique, ce qui explique pourquoi on ne les voit pas se produire dans ces assemblées.
Il n’en est pas ainsi à la Chambre. C’est une maxime de notre droit public que si un Député est assez habile pour opposer une majorité au Ministère, il devient lui-même Ministre ipso facto, et livre l’administration en proie [VII-17] à ceux de ses collègues qui se sont associés à son entreprise.
Les conséquences de cette organisation sautent aux yeux. La Chambre n’est plus une assemblée de Gouvernés, qui viennent prendre connaissance des mesures projetées par les Gouvernants, pour admettre, modifier, ou rejeter ces mesures, selon l’intérêt public qu’ils représentent ; c’est une arène où l’on se dispute le Pouvoir qui est mis au concours et dépend d’un scrutin.
Donc, pour renverser le Ministère, il suffit de lui enlever la majorité ; pour lui enlever la majorité, il faut le déconsidérer, le dépopulariser, l’avilir. La Loi elle-même, combinée avec l’irrémédiable faiblesse du cœur humain, a arrangé les choses ainsi. M. Guizot aura beau s’écrier : « N’apprendrons-nous jamais à nous attaquer, à nous combattre, à nous renverser, sans nous imputer des motifs honteux ! » j’avoue que ces plaintes me semblent puériles. — Vous admettez que vos adversaires aspirent à vous remplacer, et vous avez la bonhomie de leur conseiller de négliger les moyens de réussir ! — À cet égard, M. Guizot, chef d’opposition, fera contre M. Thiers, Ministre, ce que M. Guizot, Ministre, reproche à M. Thiers, chef d’opposition.
Nous devons donc admettre que notre mécanisme représentatif est organisé de telle sorte que, l’opposition et toutes les oppositions réunies n’ont et ne peuvent avoir qu’un seul but : Avilir le ministère, quel qu’il soit, pour le renverser le remplacer.
Or le plus sûr moyen, en France, d’avilir le Pouvoir, c’est de le représenter comme traître, comme lâche, comme dévoué à l’étranger, comme oublieux de l’honneur national. Ce fut, contre M. Molé, la tactique de M. Guizot coalisé avec les légitimistes et les Républicains ; c’est, contre M. Guizot, la tactique de M. Thiers, coalisé avec les Républicains et les légitimistes. L’un se servait d’Ancône comme l’autre se sert de Taïti.
[VII-18]
Mais les oppositions ne se bornent pas à agir au sein des Chambres. Elles ont encore besoin d’entraîner à leurs vues l’opinion publique et le corps électoral. Les journaux de toutes les oppositions sont donc forcément amenés à travailler de concert, à exalter, à irriter, à égarer le sentiment national, à représenter la Patrie comme descendue, par l’œuvre du Ministère, au dernier degré d’avilissement et d’opprobre, et il faut avouer que notre susceptibilité nationale, les souvenirs de l’Empire, et l’Éducation toute Romaine qui a prévalu parmi nous, donnent à cette tactique parlementaire de grandes chances de succès.
Cet état de choses étant donné, il est aisé de prévoir tout le parti qu’ont dû en tirer les Industries Privilégiées.
Au moment où le Monopole allait être renversé et la libre communication des peuples graduellement fondée, que pouvait faire le Privilége ? Perdre son temps à ériger le système de la Protection en corps de doctrine et opposer la théorie de la Restriction à la théorie du libre échange ? C’eût été une vaine entreprise ; sur le terrain d’une libre et loyale discussion l’Erreur a peu de chances contre la Vérité.
Non, le Privilége a mieux vu ce qui pouvait prolonger son existence ; il a compris qu’il continuerait à puiser paisiblement dans les poches du public tant qu’une irritation factice préviendrait le rapprochement et la fusion des peuples. Dès lors, il a porté ses forces, son influence, ses richesses, son activité du côté des haines nationales ; il a, lui aussi, pris le masque du patriotisme ; il a soudoyé les journaux qui n’étaient pas encore enrôlés sous la bannière d’un faux honneur national ; et l’on peut dire que cette monstrueuse alliance a arrêté la marche de la civilisation.
Au milieu de ces étranges circonstances, la Presse Départementale, la Presse Méridionale surtout, eût pu rendre de grands services. Mais, soit qu’elle n’ait pas aperçu le mobile de ces machiavéliques intrigues, soit qu’elle ait cédé à la [VII-19] crainte de paraître faiblir devant l’étranger, toujours est-il qu’elle a niaisement uni sa voix à celle des journaux stipendiés par le Privilége, et aujourd’hui il peut se croiser les bras, en nous voyant, nous, hommes du Midi, nous hommes spoliés et exploités, faire son œuvre, comme il eût pu la faire lui-même et consacrer toutes les ressources de notre intelligence, toute l’énergie de nos sentiments à consolider les entraves, à perpétuer les extorsions qu’il nous inflige.
Cette faiblesse a porté ses fruits. Pour repousser les accusations dont on l’accable, le Gouvernement n’avait qu’une chose à faire, et il l’a faite : il nous a sacrifiés.
Les paroles de M. Guizot, que j’ai citées en commençant, n’équivalent-elles pas en effet à ceci :
« Vous dites que je soumets ma politique à la politique anglaise, mais voyez mes actes.
« Il était juste de rendre aux Français le droit d’échanger, confisqué par quelques privilégiés. Je voulais rentrer dans cette voie par des traités de commerce ; mais on a crié : à la trahison ! et j’ai rompu les négociations.
« Je pensais que s’il faut que les Français achètent au dehors des fils et tissus de lin, mieux vaut en obtenir plus que moins, pour un prix donné ; mais on a crié : à la trahison ! et j’ai créé les droits différentiels.
« Il était de l’intérêt de notre jeune colonie africaine d’être pourvue de toutes choses à bas prix, pour croître et prospérer. Mais on a crié : à la trahison ! et j’ai livré l’Algérie au Monopole.
« L’Espagne aspirait à secouer le joug d’une province. C’était son intérêt ; c’était le nôtre ; mais c’était aussi celui des Anglais ; on a crié : à la trahison ! et pour étouffer ce cri importun, j’ai maintenu ce que l’Angleterre voulait renverser : l’exploitation de l’Espagne par la Catalogne. »
Voilà donc où nous en sommes. La machine de guerre de tous les partis, c’est la haine de l’étranger. À gauche et à droite [VII-20] on s’en sert pour battre en brèche le Ministère ; au centre, on fait plus, on la traduit en actes pour faire preuve d’indépendance, et le Monopole s’empare de cette disposition des esprits pour se perpétuer en soufflant la discorde.
Où tout cela nous conduira-t-il ? Je l’ignore, mais je crois que ce jeu des partis recèle des dangers ; et je m’explique pourquoi, en pleine paix, la France entretient quatre cent mille hommes sous les armes, augmente sa marine militaire, fortifie sa capitale, et paye un milliard et demi d’impôts.
References
[1] Article inédit paraissant avoir été destiné à un journal du midi de la France. Il est de 1844. (Note de l’édit.)
5. — D’AUTRES QUESTIONS SOUMISES AUX CONSEILS GÉNÉRAUX DE L’AGRICULTURE, DES MANUFACTURES ET DU COMMERCE [1] .↩
Je me suis laissé entraîner par le premier sujet qui est tombé sous ma plume, et il me reste peu d’espace à donner aux autres questions posées par M. le Ministre. Je ne terminerai pas cependant sans en dire quelques mots.
Certes, je m’attends à ce que le développement illimité qu’on paraît vouloir donner à la Douane soit rétorqué contre l’École Économiste.
« Vous repoussez la mesure, dira-t-on, parce qu’elle accroît d’une manière exorbitante l’intervention du Pouvoir dans l’Industrie, et c’est précisément pour cela que nous l’appuyons. Ne fût-elle pas très bonne [VII-21] en elle-même, elle a au moins cette heureuse tendance d’agrandir le rôle de l’État, et vous savez bien que le Progrès, suivant la mode du jour, n’est autre chose que l’absorption successive de toutes les activités individuelles dans la grande activité collective ou gouvernementale. »
Je sais en effet que telle est la tendance irréfléchie de l’époque. Je sais qu’il faut observer pour comprendre l’organisation naturelle de la société et qu’il est plus court d’imaginer des organisations artificielles. Je sais qu’il n’est plus un jeune Rhétoricien, échappé aux étreintes de Salluste et de Tite-Live, qui n’ait inventé son ordre social, qui ne se croie de la force de Minos et de Lycurgue, et je comprends que, pour obliger les hommes à porter docilement le joug de la félicité publique, il faut bien qu’ils commencent par les dépouiller de toute liberté et de toute volonté. Une fois l’État maître de tout, il ne s’agira plus que de se rendre maître de l’État. Ce sera l’objet d’une lutte entre MM. les fourriéristes, communistes, saint-simoniens, humanitaires et fraternitaires. Quelle secte demeurera maîtresse du terrain ? Je l’ignore ; mais, n’importe laquelle, ce qu’il y a de sûr, c’est que nous lui devrons une organisation d’où la liberté sera soigneusement exclue, car toutes, malgré les abîmes qui les séparent, ont au moins en commun cette devise empruntée à notre grand chansonnier :
Mon cœur en belle haine
A pris la liberté.
Fi de la liberté !
À bas la liberté !
À force de bruit, ces écoles sont enfin parvenues à pousser leurs idées jusque dans les hautes régions administratives, comme le prouvent quelques-unes des questions adressées aux conseils par M. le Ministre du commerce.
« L’insuffisance du crédit agricole, dit la circulaire, et [VII-22] l’' absence d’institutions propres à en favoriser le développement méritent également toute l’attention des conseils comme elles excitent la sollicitude du Gouvernement. »
Proclamer l’insuffisance du crédit agricole, c’est avouer que les capitalistes ne recherchent pas cet emploi de leurs fonds ; et comme, en matière de placements, leur sagacité n’est pas douteuse, c’est de plus avouer que le prêt ne rencontre pas dans l’agriculture les avantages qu’il trouve ailleurs. Donc, de l’insuffisance du crédit agricole, ce à quoi il faut conclure ce n’est pas l’absence d’institutions propres à le favoriser, mais bien la présence d’institutions propres à le contrarier. Cela séduit moins les imaginations vives. Il est si doux d’inventer ! Le rôle d’Organisateur, de Père des nations a tant de charmes ! surtout quand il vous ouvre la chance de disposer un jour des capitaux et des capitalistes ! Mais que l’on y regarde de près ; on trouvera peut-être qu’il y a, en fait de crédit agricole, plus d’obstacles artificiels à détruire que d’institutions gouvernementales à fonder.
Car que le développement en ait été, sous beaucoup de rapports, législativement arrêté, c’est ce qu’on ne peut pas mettre en doute. — C’est d’abord l’impôt qui, par son exagération, empêche les capitaux de se former dans nos campagnes. — C’est ensuite le crédit public qui, après avoir attiré à lui les capitaux par l’appât de nombreux et injustes priviléges, les dissipe bien souvent aux antipodes ou par de là l’Atlas, sans qu’il en revienne autre chose au public qu’une rente perpétuelle à payer. — Il y a de plus les lois sur l’usure qui, agissant contre leur but intentionnel, font obstacle à l’égale diffusion et au nivellement de l’intérêt. — Il y a encore le régime hypothécaire imparfait, procédurier et dispendieux. — Il y a enfin le Système protecteur qui, on peut le dire sans exagération, a jeté la France hors de ses voies et substitué à sa vie naturelle une vie factice, précaire, qui ne se soutient que par le galvanisme des tarifs.
[VII-23]
Ce dernier sujet est très-vaste. Je ne puis le traiter ici ; mais on me pardonnera quelques courtes observations.
Les classes agricoles ne sont certainement pas les moins âpres et les moins exigeantes en fait de protection. Comment ne s’aperçoivent-elles pas que c’est la Protection qui les ruine ?
Si les capitaux, en France, eussent été abandonnés à leur tendance propre, les verrait-on se livrer, comme ils font, à l’imitation britannique ? Suffit-il que les capitaux anglais trouvent un emploi naturel dans des mines inépuisables, pour que les nôtres aillent s’engouffrer dans des mines dérisoires ? Parce que les Anglais exploitent avantageusement le fer et le feu dont les éléments abondent dans leur île, est-ce une raison pour que nous persistions à avoir chez nous, bon gré malgré, du fer et du feu, en négligeant la terre, l’eau et le soleil, qui sont les dons que la nature avait mis à notre portée ? Ce n’est pas leur gravitation qui pousse ainsi nos capitaux hors de leur voie, c’est l’action des tarifs ; car l’anglomanie peut bien envahir les esprits, mais non les capitaux. Pour les engager et les retenir dans cette carrière de stériles et ineptes singeries, où une perte évidente les attendait, il a fallu que la Loi, sous le nom de Tarifs, imposât au public des taxes suffisantes pour transformer ces pertes en bénéfices. — Sans cette funeste intervention de la Loi, il ne faudrait pas aujourd’hui demander à des institutions artificielles un crédit agricole qu’ont détruit d’autres institutions artificielles. La France serait la première nation agricole du monde. Pendant que les capitaux anglais auraient été chercher pour nous de la houille et du fer dans les entrailles de la terre, pendant que pour nous, ils auraient fait tourner des rouages et fumer les obélisques du Lancastre, les nôtres auraient distribué sur notre sol privilégié les eaux de nos magnifiques rivières. L’Océan n’engloutirait pas les richesses incalculables qui s’écoulent dans [VII-24] le lit de nos fleuves sans laisser à nos champs desséchés la moindre trace de leur passage. Le vigneron ne maudirait pas le soleil qui prépare sur nos coteaux une ruineuse abondance. Nous aurions moins de broches et de navettes en mouvement, mais plus de gras troupeaux sur de plus riches pâturages ; moins de prolétaires dans les faubourgs de nos villes, mais plus de robustes laboureurs dans nos campagnes. L’agriculture n’aurait pas à déplorer non-seulement que les capitaux lui soient soustraits pour recevoir, de par les tarifs, une autre destination, mais encore qu’ils ne puissent couvrir les pertes qu’ils subissent dans ces carrières privilégiées qu’au moyen d’une cherté factice qui lui est, toujours de par les tarifs, imposée à elle-même. Encore une fois, nous aurions laissé à nos frères d’outre-Manche le fer et le feu, puisque la nature l’a voulu ainsi, et gardé pour nous la terre, l’eau et le soleil, puisque la Providence nous en a gratifiés. Au lieu de nous exténuer dans une lutte insensée, ridicule même, dont l’issue doit nécessairement tourner à notre confusion, puisque l’invincible nature des choses est contre nous, nous adhérerions à l’heure qu’il est à l’Angleterre par la plus puissante des cohésions, la fusion des intérêts ; nous l’inonderions, pour son bien, de nos produits agricoles ; elle nous envahirait, pour notre avantage, par ces mêmes produits auxquels elle aurait donné, plus économiquement que nous, la façon manufacturière ; l’entente cordiale, non celle des ministres mais celle des peuples, serait fondée et scellée à jamais. Et pour cela que fallait-il ? Prévoir ? non, les capitaux ont leur prévoyance plus sûre que celle des hommes d’État ; régenter ? gouverner ? encore moins, mais laisser faire. Le mot n’est pas à la mode. Il est un peu collet monté. Mais les modes ont leur retour, et quoiqu’il soit téméraire de prophétiser, j’ose prédire qu’avant dix ans, il sera la devise et le cri de ralliement de tous les hommes intelligents de mon pays.
[VII-25]
Donc, qu’on cherche à faire revivre le crédit agricole en corrigeant les institutions qui l’ont détruit, rien de mieux. Mais qu’on le veuille fonder directement, par des institutions spéciales, c’est ce qui me paraît au moins chimérique.
Ces capitaux dont vous voulez gratifier l’agriculture, d’où les tirerez-vous ? Votre astrologie financière les fera-t-elle descendre de la lune ? ou les extrairez-vous par une moderne alchimie des votes du Parlement ? La Législation vous offre-t-elle aucun moyen d’ajouter une seule obole au capital que le travail actuel absorbe ? Non ; les cent volumes du Bulletin des lois suivis de mille autres encore ne peuvent vous investir tout au plus que du pouvoir de le détourner d’une voie pour le pousser dans une autre. Mais si celle où il est aujourd’hui engagé est la plus profitable, quel secret avez-vous de déterminer ses préférences pour la perte et ses répugnances pour le bénéfice ? Et si c’est la carrière où vous voulez l’attirer qui est la plus lucrative, qu’a-t-il besoin de votre intervention ?
Vraiment, il me tarde de voir ces institutions à l’œuvre. Après avoir forcé le capital, par l’artifice des tarifs, à déserter l’agriculture pour affluer vers les fabriques, avertis par l’état stationnaire ou rétrograde de nos champs, vous reconnaissez votre faute, et que proposez-vous ? De modifier les tarifs ? Pas le moins du monde. Mais de faire refluer le capital des fabriques vers l’agriculture par l’artifice des banques ; en sorte que ce génie organisateur qui se donne tant de mal aujourd’hui pour faire marcher cette pauvre société qui marcherait bien toute seule, se borne à la surcharger de deux institutions inutiles, d’un tarif agissant en sens inverse de la banque, et d’une banque neutralisant les effets du tarif !…
Mais allons plus loin. Supposons le problème résolu comme on dit à l’École. Voilà vos agents tout prêts, votre bureaucratie toute montée, votre caisse établie ; et le public [VII-26] bénévole y verse le capital à flots, heureux (il est bien de cette force) de vous livrer son argent sous forme d’impôts, dans l’espoir que vous le lui rendrez à titre de prêt. Voilà qui va bien ; fonctionnaires et public, tout le monde est content, l’opération va commencer. — Oui, mais voici une difficulté imprévue. Vous entendez veiller sans doute à ce que les fonds prêtés à l’agriculture reçoivent une destination raisonnable, qu’ils soient consacrés à des améliorations agricoles qui les reproduisent ; car si vous alliez les livrer à de petits propriétaires affamés qui en acquitteraient leurs douzièmes ou à des fermiers besoigneux pour payer leur fermage, ils seraient bientôt consommés sans retour. Si votre caisse avance des capitaux indistinctement et sans s’occuper de l’emploi qui en sera fait, votre belle institution de crédit courra grand risque de devenir une détestable institution d’aumône. Si au contraire L’État veut suivre dans toutes ses phases le capital distribué à des millions de paysans, afin de s’assurer qu’il est consacré à une consommation reproductive, il faudra un garnisaire comptable par chaque ferme, et voici reparaître, aux mains de je ne sais quelle administration nouvelle, cette puissance inquisitoriale qui est l’apanage des Droits réunis et menace de devenir bientôt celui de la Douane.
Ainsi, de tous côtés nous arrivons à ce triste résultat : ce qu’on nomme Organisation du travail ne cache trop souvent que l’Organisation de la Bureaucratie, végétation parasite, incommode, tenace, vivace, que l’industrie doit bien prendre garde de ne pas laisser attacher à ses flancs.
Après avoir manifesté sa sollicitude pour les agriculteurs, M. le Ministre se montre, avec grande raison, fort soucieux du sort des ouvriers. Qui ne rendrait justice au sentiment qui le guide ? Ah ! si les bonnes intentions y pouvaient quelque chose, certes, les classes laborieuses [VII-27] n’auraient plus rien à désirer. À Dieu ne plaise que nous songions à nous élever contre ces généreuses sympathies, contre cette ardente passion d’égalité qui est le trait caractéristique de la littérature moderne ! Et nous aussi, qu’on veuille le croire, nous appelons de tous nos vœux l’élévation de toutes les classes à un commun niveau de bien-être et de dignité. Ce ne sont pas les bonnes intentions qui nous manquent, c’est l’exécution qui nous préoccupe. Nous souhaitons, comme nos frères dissidents, que notre marine et notre commerce prospèrent, que nos laboureurs ne soient jamais arrêtés faute de capital, que nos ouvriers soient abondamment pourvus de toutes choses, du nécessaire, du confortable et même du superflu. Malheureusement, n’ayant en notre pouvoir ni une baguette magique ni une conception organisatrice qui nous permette de verser sur le monde un torrent de capitaux et de produits, nous sommes réduit à attendre toute amélioration dans la condition des hommes, non de nos bonnes intentions et de nos sentiments philanthropiques, mais de leurs propres efforts. Or nous ne pouvons concevoir aucun effort sans vue d’avenir, ni aucune vue d’avenir sans prévoyance. Toute institution qui tend à diminuer la prévoyance humaine ne nous semble conférer quelque bien au présent que pour accumuler des maux sans nombre dans l’avenir ; nous la jugeons antagonique au principe même de la civilisation ; et, pour trancher le mot, nous la croyons barbare. C’est donc avec une extrême surprise que nous avons vu dans la circulaire ministérielle la question relative au sort des ouvriers formulée de la manière suivante :
« Ainsi que l’agriculture, l’industrie a de graves intérêts en souffrance ; la situation des ouvriers hors d’état de travailler est souvent malheureuse : elle est toujours précaire. L’opinion publique s’en est préoccupée à juste titre, et le Gouvernement a cherché dans les plans proposés [VII-28] les moyens d’y porter remède. Malheureusement rien jusqu’à ce jour n’a paru pouvoir suppléer la prévoyance privée. Aucune question n’est plus digne de la sollicitude des conseils. Ils rechercheront quelles caisses de secours ou de retraite ou quelles institutions peuvent être fondées pour le soulagement des travailleurs invalides. »
Si l’on ne devait pas admettre que tout est sérieux dans un document de cette nature, on serait tenté de croire que M. le Ministre a voulu tout à la fois embarrasser les conseils, en les mettant en présence d’une impasse, et décocher une épigramme contre tous ces plans d’organisation sociale que chaque matin voit éclore.
Est-ce bien sérieusement que vous demandez l’amélioration des classes laborieuses à des institutions qui les dispensent de Prévoyance ? Est-ce bien sincèrement que vous déplorez le malheur de n’avoir pas encore imaginé de telles institutions ?
Suppléer la Prévoyance ! mais c’est suppléer l’épargne, l’aliment nécessaire du travail ; en même temps que renverser la seule barrière qui s’oppose à la multiplication indéfinie des travailleurs. C’est augmenter l’offre et diminuer la demande des bras, en d’autres termes combiner ensemble l’action des deux plus puissantes causes qu’on puisse assigner à la dépression des salaires !
Suppléer la Prévoyance ! mais c’est suppléer la modération, le discernement, l’empire sur les passions, la dignité, la moralité, la raison, la civilisation, l’homme même, car peut-elle porter le nom d’homme, la créature qui n’a plus rien à démêler avec son avenir ?
Sans la Prévoyance, peut-on concevoir la moralité qui n’est autre chose que le sacrifice du présent à l’avenir ?
Sans la Prévoyance, peut-on concevoir la civilisation ? Anéantissez par la pensée tout ce que la Prévoyance a préparé et accumulé sur le sol de la France, et dites-moi en [VII-29] quoi elle différera des forêts américaines, empire du buffle et du sauvage ?
Mais, dira-t-on, il n’est pas question de supprimer la Prévoyance, mais de la transporter de l’homme à l’institution. Je voudrais bien savoir comment les institutions peuvent être prévoyantes quand les hommes qui les conçoivent, les soutiennent, les appliquent et les subissent ne le sont pas.
Les institutions n’agissent pas toutes seules. Vous admettez du moins que cette noble faculté de prévoir devra se réfugier dans les hautes régions administratives. — Eh bien ! qu’aurez-vous ajouté à la dignité de la race humaine, en quoi aurez-vous augmenté ses chances de bonheur, qu’aurez-vous fait pour le rapprochement des conditions, pour l’avancement du principe de l’Égalité et de la Fraternité parmi les hommes, quand la Pensée sera dans le Gouvernement et l’abrutissement dans la multitude ?
Qu’on ne se méprenne pas à nos paroles. Nous ne blâmons pas M. le Ministre d’avoir saisi les conseils d’une question grave qui, comme il le dit, préoccupe avec raison l’opinion publique.
Seulement, nous croyons que c’est dans des institutions propres à développer la prévoyance privée, et non à la suppléer, que se trouve la solution rationnelle du problème.
Nous n’attachons pas plus d’importance qu’il ne faut à quelques expressions hétérodoxes, échappées sans doute à l’auteur de la circulaire, et qui très probablement ne répondent pas à sa pensée. Si cependant nous avons cru devoir les relever, c’est que, comme on a pu en juger par l’accueil qu’elles ont reçu de certains journaux, elles ont paru donner une sorte de consécration à cette voie déplorable où l’opinion n’a que trop de pente à s’engager.
References
[1] Lorsque Bastiat écrivait un article, une fois sa tâche faite et le manuscrit livré à l’éditeur, il n’y pensait guère et n’en parlait plus. Les lignes que nous allons reproduire devaient faire suite, dans le Journal des Économistes, à l’article intitulé : Une question soumise aux Conseils généraux, etc. (Voir Œuvres complètes,, t. Ier, p. 392 et suiv.) Mais, restées inédites par suite d’une omission contre laquelle l’auteur n’a pas réclamé, elles n’ont été remises dans mes mains que postérieurement à 1855. (Note de l’édit.)
[VII-30]
6. — PROJET DE LIGUE ANTI-PROTECTIONISTE [1] .↩
On assure que Bordeaux est en travail d’une association pour la liberté commerciale. Sera-t-il permis à l’auteur de cet article, quelque besoin qu’il ait d’avis en toute autre matière, d’exprimer le sien en celle-ci ? Il a étudié les travaux, l’esprit et les procédés de la Ligue anglaise ; il en connait les chefs ; il sait quels obstacles ils ont eu à vaincre, quels piéges à déjouer, quels écueils à éviter, quelles objections à résoudre ; à quelles qualités de l’esprit et du cœur ils doivent leurs glorieux succès ; il a vu, entendu, observé, approfondi. Il ne fallait pas moins pour qu’il eût la présomption d’élever la voix dans une ville où il y a tant de citoyens capables de mener à bien une grande entreprise, pour qu’il osât tracer une sorte de programme de la ligue française anti-protectioniste.
Si je m’adresse à Bordeaux, ce n’est pas que je désire voir cette ville s’emparer du rôle principal, et encore moins d’un rôle exclusif, dans le grand mouvement qui se prépare. Non ; l’abnégation individuelle est une des conditions du succès, et l’on doit en dire autant de l’abnégation locale ou départementale. Arrière toute pensée de prééminence et de fausse gloire ! Que chaque ville de France forme son comité ; que tous les comités se fondent dans la grande association dont le centre naturel est Paris ; et Bordeaux, renonçant à la gloire de Manchester, saura bien remettre les rênes là où elles peuvent être placées avec le plus d’avantage. Voulons-nous réussir ? ne voyons que le but de la lutte, sans nous laisser séduire par ce que la lutte elle-même peut donner de satisfactions à l’esprit d’égoïsme et de localité.
[VII-31]
Mais Bordeaux est déjà descendu bien des fois dans la lice ; les idées libérales, en matière de commerce, y sont très répandues ; il n’est pas de ville dont la protection ait plus froissé les intérêts ; elle est le centre de vastes et populeuses provinces qui étouffent sous la pression du régime restrictif ; elle est féconde en hommes ardents, dévoués, prêts à faire à une grande cause nationale de généreux sacrifices ; elle est le berceau de cette Union vinicole, qui a accompli tant de travaux si méritoires quoique si infructueux, et qui forme comme la pierre d’attente d’une organisation plus vaste. Il n’est donc pas surprenant que Bordeaux donne le signal de l’agitation, tout préparé qu’il est, j’en suis convaincu, à céder à Paris les rênes de la direction aussitôt que le bien de la cause exigera de lui ce sacrifice.
Voilà pourquoi j’adresse à Bordeaux cette première vue générale des conditions auxquelles il faut acheter la victoire ; elles sont dures, mais inflexibles.
1o D’abord la Ligue doit proclamer un principe et y adhérer indissolublement, dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, dans ses revers et dans ses triomphes, soit qu’il éveille ou non les échos de la presse et de la tribune, soit qu’il excite ou non les sympathies du Pouvoir et des Chambres. La Ligue ne doit point se faire le champion d’un intérêt spécial, d’un traité de commerce, d’une modification douanière ; sa mission est de proclamer et de faire triompher un principe absolu, un droit naturel, la liberté des échanges, l’abrogation de toute loi ayant pour objet d’influer sur le prix des produits, afin de régler les profits des producteurs. La Ligue doit réclamer pour tout Français le droit (qu’on peut s’étonner de ne pas voir écrit dans la Charte), le droit d’échanger ce qu’il a le droit de consommer. La loi nous laisse à tous la pleine liberté de vendre ; il faut qu’elle nous laisse aussi la pleine liberté d’acheter. [VII-32] Vendre et acheter, ce sont deux actes qui s’impliquent réciproquement, ou plutôt ce sont les deux termes d’un seul et même contrat. Là où l’un des termes manque, l’autre fait défaut par cela même ; et il est mathématiquement impossible que les ventes ne soient pas contrariées sur tous les points du globe, si sur tous les points du globe la loi contrarie les achats.
Au reste, il n’est pas question ici de prouver la doctrine. Il faut admettre qu’elle est la foi inébranlable des premiers ligueurs, et c’est pour la propager qu’ils se liguent. Eh bien ! je leur dis : En vous ralliant à un principe absolu, vous vous priverez, je le sais, du concours d’une multitude de personnes, car rien n’est plus commun que l’horreur d’un principe, l’amour de ce qu’on nomme une sage liberté, une protection modérée. Ce perfide concours, sachez vous en passer, il entraverait bientôt toutes vos opérations. Ne soyez que cent, ne soyez que cinquante, ne soyez que dix et moins encore, s’il le faut, mais soyez unis par une entière conformité de vues, par une parfaite identité de doctrine. Or un tel lien ne saurait être ailleurs que dans un principe. Réclamez, poursuivez, exigez jusqu’au bout la complète réalisation de la liberté des échanges ; n’admettez ni transactions, ni conditions, ni transitions, car où vous arrêteriez-vous ? Comment conserverez-vous l’unité de vos démarches si vous laissez pénétrer parmi vous l’idée d’une seule exception ? Chacun ne voudra-t-il pas placer son industrie dans cette exception ? L’un, à grand renfort de belliqueux patriotisme, voudra qu’un petit bout de protection reste à la marine marchande, et sa grande raison est qu’il est armateur. L’autre, la larme à l’œil, vous fera un tableau touchant de l’agriculture. Il la faut protéger, dira-t-il, c’est notre nourrice à tous ; et il ne manquera pas de vous rappeler que l’empereur de la Chine trace tous les ans un sillon. Un troisième, au contraire, vous demandera grâce pour les produits [VII-33] perfectionnés, vous abandonnant généreusement les matières premières, vierges de tout travail humain, à quoi il sera facile de reconnaître un fabricant. — Alors vous ne serez plus que la doublure du comité Mimerel, et ce que vous aurez de mieux à faire, ne pouvant vous entendre sur l’égalité dans la liberté, ce sera de tâcher au moins, comme lui, de vous entendre sur l’égalité dans le privilége.
2o La Ligue doit se hâter de proclamer encore qu’en demandant la liberté absolue des échanges, elle n’entend pas intervenir dans les droits du fisc. Elle ne réclame pas la destruction de la douane, mais l’abrogation d’une des fins à laquelle la douane a été injustement et impolitiquement détournée. Les ligueurs, en tant que tels, n’ont rien à démêler avec les dépenses publiques. Ils n’ont pas la prétention de s’accorder sur tous les points ; la quotité et le mode de perception des impôts est pour chacun d’eux une question réservée. Que la douane subsiste donc, s’il le faut, comme machine fiscale, comme octroi national, mais non comme moyen de protection. Ce qu’elle procure au trésor public n’est pas de notre compétence ; ce qu’elle confère au monopole, c’est là ce qui nous regarde et à quoi nous devons nous opposer. Si l’État a tellement besoin d’argent, qu’il faille taxer les marchandises qui passent à la frontière, à la bonne heure ; les sommes ainsi prélevées proviennent de tous et sont dépensées au profit de tous. Mais que les tarifs soient appliqués à enrichir une classe aux dépens de toutes les autres, à organiser au sein de la communauté un système de spoliation réciproque, c’est là un abus auquel il est grand temps que l’opinion publique mette un terme.
3o Une troisième condition de succès, non moins essentielle que les deux autres, c’est l’abjuration de tout esprit de parti…… Mais voilà assez de sujets de méditation pour un jour.
References
[1] Mémorial bordelais du 8 février 1846. (Note de l’édit.)
[VII-34]
7. — 2e ARTICLE [1] .↩
J’en suis resté à l’esprit de parti. Il semble assez inutile de s’en occuper déjà. Hélas ! notre Ligue est à naître ; à quoi sert de prévoir le temps où l’on recherchera son alliance ? Mais c’est avant d’élever l’édifice qu’il faut s’assurer de la qualité des matériaux. Les destinées de la Ligue se ressentiront toujours de l’esprit de ses fondateurs. Faible et chancelante, s’ils flottent au gré de toutes les doctrines économiques ; factieuse, isolée, n’ayant de puissance que pour le mal, s’ils rêvent d’avance autre chose que son principe avoué. — Ligue, triomphe, principe, liberté, vous n’êtes peut-être que les fantômes adorés d’une imagination trop facile à se laisser séduire à tout ce qui offre l’image du bien public ! Mais il n’est pas impossible, puisque cela s’est vu ailleurs, que ces fantômes se revêtent de réalité. Ce qui est impossible, tout à fait impossible, c’est que la Ligue puisse avoir force, vie, influence utile, si elle se laisse entamer par l’esprit de parti.
La Ligue ne doit être ni monarchique, ni républicaine, ni orthodoxe, ni dissidente ; elle n’intervient ni dans les hautes questions métaphysiques de légitimité, de souveraineté du peuple, ni dans la polémique dont le Texas, le Liban et le Maroc font les frais. Son royaume n’est pas de ce monde qu’on nomme politique ; c’est un terrain neutre où M. Guizot peut donner la main à M. Garnier Pagès, M. Berryer à M. Duchâtel, et l’Évêque de Chartres à M. Cousin. Elle ne provoque ni n’empêche les crises ministérielles, elle ne s’en mêle pas et ne s’y intéresse même pas. Elle n’a qu’un objet en vue : la liberté des échanges. Cette [VII-35] liberté, elle la demande à la droite, à la gauche et aux centres, mais sans rien promettre en retour, car elle n’a rien à donner ; et son influence, si jamais elle a une influence, appartient exclusivement à son principe. La force éphémère d’un parti, c’est un auxiliaire qu’elle dédaigne ; et, quant à elle, elle ne veut être l’instrument d’aucun parti. Elle n’est pas née, nul ne saurait dire ce qu’elle sera, mais j’ose prédire ce qu’elle ne sera jamais ; elle ne sera pas le piédestal d’un ministre en titre, ni le marchepied d’un ministre en expectative, car le jour où elle se laisserait absorber par un parti, ce jour-là on la chercherait en vain, elle se serait dissipée comme une fumée.
4o La plus grande difficulté, en apparence, que puisse rencontrer la formation d’une Ligue, c’est la question de personnes. Il n’est pas possible qu’un corps gigantesque, travaillant à une œuvre immense, à travers une multitude d’oppositions extérieures et peut-être de rivalités intestines, puisse se dispenser d’obéir à une impulsion unique et pour ainsi dire à une omnipotence volontairement déléguée. Mais qui sera le dépositaire de cette puissance morale ? On est justement effrayé quand on songe aux qualités éminentes et presque inconciliables que suppose un tel rôle. Tête froide, cœur de feu, main ferme, formes attachantes, connaissances étendues, coup d’œil sûr, talent oratoire, dévouement sans bornes, abnégation entière ; voilà ce qu’il faudrait trouver dans un seul homme, et de plus ce charme magnétique qui pétrifie l’envie et désarme les amours-propres.
Eh bien ! cette difficulté n’en est pas une. Si les temps sont mûrs en France pour l’agitation commerciale, l’homme de la Ligue surgira. Jamais grande cause n’a failli faute d’un homme. Pour qu’il se trouve, il suffit qu’on ne se préoccupe pas trop de le chercher. Y a-t-il quelqu’un que sa position seule place naturellement à notre tête et consent-il à être notre chef ? acceptons-le par acclamation et acceptons aussi [VII-36] avec joie le rôle, quelque humble qu’il soit, qu’il jugera utile de nous assigner. Amis de la liberté, unissons-nous d’abord, mettons avec confiance la main à l’œuvre, pensons toujours au succès de notre principe, jamais à nos propres succès, et laissons à la cause, dans sa marche progressive, le soin de nous porter en avant. Quand la lutte sera engagée, assez de résistances nous mettront à l’épreuve, pour que chacun déploie ses ressources ; et qui sait alors combien se révéleront de talents ignorés et de vertus assoupies ? L’agitation est un grand crible qui classe les individualités selon leur pesanteur spécifique. Elle manifestera un homme et plusieurs hommes ; et nous nous trouverons, sans nous en apercevoir, coordonnés dans une naturelle et volontaire hiérarchie.
Faut-il le dire ? Ce que je crains, ce n’est pas que l’homme de génie fasse défaut à la Ligue ; mais plutôt que la Ligue fasse défaut à l’homme de génie. Les vertus individuelles jaillissent de la vertu collective comme l’étincelle électrique de nuages saturés d’électricité. Si chacun de nous apporte à la Ligue un ample tribut de zèle, de conviction, d’efforts et d’enthousiasme, ah ! ne craignons pas que ces forces demeurent inertes, faute d’une main qui les dirige ! Mais si le corps entier est apathique, indifférent, dégoûté, inconstant et railleur, alors sans doute les hommes nous manqueront, — et qu’en ferions-nous ?
Ce qui a fait le succès de la Ligue, en Angleterre, c’est une chose, une seule chose, la foi dans une idée. Ils n’étaient que sept, mais ils ont cru ; et, parce qu’ils ont cru, ils ont voulu ; et, parce qu’ils ont voulu, ils ont soulevé des montagnes. La question pour moi n’est pas de savoir s’il y a des hommes à Bordeaux, mais s’il y a de la foi dans Israël.
5o Je voulais parler aujourd’hui de la question financière, mais le sujet est trop vaste pour l’espace qui me reste. Je le [VII-37] remplirai par quelques considérations générales. — D’après ce qui a pu me revenir, on se promet beaucoup d’une grande démonstration publique, d’un appel solennel fait au Gouvernement. Oh ! combien se trompent ceux qui pensent qu’à cela se réduisent les travaux d’une ligue ! Une ligue a pour mission de détruire successivement tous les obstacles qui s’opposent à la liberté commerciale. Et quels sont ces obstacles ? Nos erreurs, nos préjugés, l’égoïsme de quelques-uns, l’ignorance de presque tous. L’ignorance, c’est là le monstre qu’il faut étouffer ; et ce n’est pas l’affaire d’un jour ! Non, non, l’obstacle n’est pas au ministère, c’est tout au plus là qu’il se résume. Pour modifier la pensée ministérielle, il faut modifier la pensée parlementaire ; et pour changer la pensée parlementaire, il faut changer la pensée électorale ; et pour réformer la pensée électorale, il faut réformer l’opinion publique.
Croyez-vous que ce soit une petite entreprise que de renouveler les convictions de tout un peuple ? J’ignore quelles sont les doctrines économiques de M. Guizot ; mais fût-il M. Say, il ne pourrait rien pour nous, ou bien peu de chose. Son traité avec l’Angleterre n’a-t-il pas échoué ? Son union douanière avec la Belgique n’a-t-elle pas échoué ? La volonté du ministre a été surmontée par une volonté plus forte que la sienne, celle du parlement. Faut-il en être surpris ? Je ne sache pas que la liberté des échanges, comme principe, ait à la Chambre, je ne dis pas la majorité, mais même une minorité quelconque, et je ne lui connais pas un seul défenseur, je dis un seul, dans l’enceinte où se font les lois. Peut-être le principe y vit-il endormi au fond de quelque conscience. Mais que nous importe si, l’on n’ose l’avouer ? — Il est un député sur lequel on avait fondé quelques espérances. Entré à la Chambre jeune, sincère, plein de cœur, avec des facultés développées par l’étude et la pratique des affaires commerciales, les amis de la liberté avaient [VII-38] les yeux fixés sur lui. Mais un jour, jour funeste ! je ne sais quel mauvais génie fit briller à ses yeux la lointaine perspective d’un portefeuille ; et depuis ce jour il semble que la crainte de se rendre impossible fausse toutes ses déterminations et paralyse son énergie. Le moyen d’être ministre, si l’on affiche avant le temps cette dangereuse chose, un principe ! — Ami, cette page arrêtera peut-être un moment tes regards. Qu’elle soit pour toi le bouclier d’Ubalde ; qu’elle te reproche, mais ne dise qu’à toi ta molle oisiveté ; qu’elle t’arrache à de trompeuses illusions !
Natura
Del coraggio in tuo cuor la flamma accese…
Il tuo dover compisce e nostra speme [2] .
8. — 3e ARTICLE [1] .↩
Il suffit de dire le but de la Ligue, ou plutôt le moyen d’atteindre ce but, pour établir qu’il lui faut, — lâchons le grand mot, — de l’argent, et beaucoup d’argent. Répandre la vérité économique, et la répandre avec assez de profusion pour changer le cours de la volonté nationale, voilà sa mission. Or les communications intellectuelles ont besoin de véhicules matériels. Les livres, les brochures, les journaux, ne naîtront pas au souffle de la Ligue, comme les fleurs au souffle du zéphir. M. Conte (directeur des postes) ne lui a pas encore donné la franchise, ni même la taxe modérée ; et si l’usage des Quinconces est gratuit, elle ne saurait y établir sa comptabilité, ses bureaux, ses archives et ses [VII-39] séances. L’argent, ce n’est pas pour les ligueurs des dîners, des orgies, des habits somptueux, de brillants équipages : c’est du travail, de la locomotion, des lumières, de l’organisation, de l’ordre, de la persévérance, de l’énergie.
Personne ne nie cela. Tout le monde en convient et nul n’y contredit. Cependant, qui sait si la Ligue trouvera à Bordeaux cette assistance métallique que chacun reconnaît nécessaire ? Si Bordeaux était une ville besogneuse et lésineuse, cela s’expliquerait ; mais sa générosité, je dirai même sa prodigalité, est proverbiale. Si Bordeaux n’avait pas de convictions, cela s’expliquerait encore. On pourrait le plaindre de n’avoir pas de convictions, non le blâmer, n’en ayant pas, d’agir en conséquence. Mais Bordeaux est, de toutes les villes de France, celle qui a le sentiment le plus vif de ce qu’il y a d’injuste et d’impolitique dans le régime protecteur. Comment donc expliquer cette réserve pécuniaire, que beaucoup de gens semblent craindre ?
Il ne faut pas se le dissimuler, la question financière est en France l’écueil de toute association. Souscrire, contribuer pécuniairement à une œuvre, quelque grande qu’elle soit, cela semble nous imposer le rôle de dupes, et heurte cette prétention que nous avons tous de paraître clairvoyants et avisés. Il est difficile de concilier une telle défiance avec la loyauté, que nous nous plaisons à regarder comme le trait caractéristique de notre nation ; car justifier cette défiance en alléguant qu’elle est le triste fruit de trop fréquentes épreuves, ce serait reconnaître que la loyauté française a été trop souvent en défaut. Puisse la Ligue effacer les dernières traces de la triste disposition que je signale !
Il semble à beaucoup de gens que lorsqu’ils versent quelques fonds à une société qui a en vue un objet d’utilité publique, ils font un cadeau, un acte de pure libéralité ; j’ose dire qu’ils s’aveuglent, qu’ils font tout simplement un marché, et un excellent marché.
[VII-40]
Si nous avions pour voisin un peuple riche et industrieux, capable de beaucoup échanger avec nous, et si nous étions séparés de ce peuple par de grandes difficultés de terrain, assurément nous souscririons volontiers pour qu’un chemin de fer vînt unir son territoire au nôtre, et nous croirions faire, non de la générosité, mais de la spéculation. Eh bien ! nous sommes séparés de l’Espagne, de l’Italie, de l’Angleterre, de la Russie, des Amériques, du monde entier, par des obstacles, — artificiels, il est vrai, — mais qui, sous le rapport des communications, ont absolument les mêmes effets que les difficultés matérielles. Et c’est pour cela que Bordeaux, souffre, languit et décline ; et ces obstacles s’appuient sur des préjugés ; et ces préjugés ne peuvent être détruits que par un vaste et laborieux enseignement ; et cet enseignement ne peut être distribué que par une puissante association. Vous pouvez opter entre les inconvénients de la restriction et ceux de la souscription ; mais vous ne pouvez pas considérer la souscription comme un don gratuit, puisqu’elle aura pour résultat de briser les liens qui vous gênent.
Je dis encore que c’est une bonne spéculation, un marché beaucoup plus avantageux que ceux que vous avez coutume de faire. S’il s’agissait de détruire les obstacles naturels qui vous séparent des autres nations, il n’y a pas une parcelle de l’œuvre qu’il ne faudrait payer à beaux deniers, l’exécution comme la conception ; mais les triomphes de la Ligue seront dus en partie, en très grande partie, à de nobles efforts qui ne cherchent pas de récompense pécuniaire. Vous aurez des agents zélés, des orateurs, des écrivains qui ne s’enrichiront pas d’une obole, et qui, épris d’amour pour les biens qu’ils attendent de la libre communication des peuples, donneront à cette grande cause, sans compte et sans mesure, leur intelligence, leurs travaux, leurs sueurs et leurs veilles.
[VII-41]
Soyons justes toutefois, et reconnaissons que, dans la souscription volontaire, il y a un côté noble et généreux. Chacun pourrait se dire : « On fera bien sans moi ; et, quand la cause sera gagnée, elle le sera à mon profit, bien que je n’y aie pas concouru. » Voilà le calcul qu’on pourrait faire. Les Bordelais le repousseront avec dédain. Ce sera leur gloire, et ce n’est pas moi qui voudrai la méconnaître.
La souscription ne doit pas être envisagée exclusivement au point de vue matériel. Elle procure des jouissances morales dont je suis surpris qu’on ne tienne pas compte. N’est-ce rien que de s’affilier à un corps nombreux qui poursuit un grand résultat par d’honorables moyens ? Je me suis dit quelquefois que la civilisation et la diffusion des richesses amèneraient infailliblement le goût des associations philanthropiques. Lorsque le riche oisif a sitôt épuisé des jouissances matérielles, fort peu appréciables en elles-mêmes, et qui n’ont d’attrait que parce qu’elles le distinguent de la masse, quel plus satisfaisant usage pourrait-il faire de sa fortune que de s’associer à une utile entreprise ? C’est là qu’il trouvera un aliment à ses facultés, des relations agréables, du mouvement, de la vie, quelque chose qui fait circuler le sang et dilate la poitrine.
Il y avait, près de Manchester, un riche manufacturier retiré, qui vivait seul, ennuyé, et n’avait jamais voulu prendre part à aucune des nombreuses entreprises qui se font, dans cette ville, par souscription. La Ligue tenait à voir figurer son nom dans ses rôles ; car c’était le témoignage le plus frappant qu’elle pût donner de la sympathie qu’elle excitait dans le pays. Elle lui décocha M. Bright, le meilleur négociateur en ce genre qu’elle pût choisir ; car, selon lui, demander pour la Ligue, ce n’était pas demander. Après beaucoup d’objections, il obtint de l’avare quatre [VII-42] cents guinées [2] . Quand il annonça cette nouvelle à ses amis : « Vous avez dû lui faire faire une laide grimace ? » lui dirent-ils. — « Point du tout, répondit M. Bright ; — je crois sincèrement que cet homme me devra le bonheur du reste de sa vie. » Et en effet, depuis ce jour les ennuis de l’avare se sont dissipés, ses dégoûts se sont fondus ; il s’intéresse à la Ligue, il en suit les progrès avec anxiété, il la regarde comme son œuvre ; et ces sentiments nouveaux ont pour lui tant de charmes, qu’il n’est plus une institution charitable à laquelle il ne s’empresse de concourir.
Mais, pour que l’esprit d’association prévale, une condition est essentielle ; c’est que toute garantie soit donnée aux souscripteurs. Je le répète, ce n’est pas la perte de quelque argent qu’ils redoutent, c’est le ridicule qui, en ce genre, suit toujours la déception. Personne n’aime à montrer en public la face d’une dupe. On a donné 100 francs ; on en donnerait 1,000 pour les retirer.
Donc, si la Ligue française veut voir affluer dans ses caisses d’abondantes recettes, son premier soin doit être de forcer dans toutes les convictions une confiance absolue. Elle y parviendra par deux moyens : le choix le plus scrupuleux des membres du comité, et la publicité la plus explicite de ses comptes. Je voudrais que, de son premier argent, elle s’assurât du plus méticuleux teneur de livres de Bordeaux, et que le bureau de la comptabilité fût placé, si c’était possible, dans un édifice de verre. Je voudrais que les livres de la Ligue fussent constamment ouverts à l’œil des amis, et surtout des ennemis.
[VII-43]
9. — ASSOCIATION POUR LA LIBERTÉ DES ÉCHANGES [1] .↩
Au moment d’engager contre le monopole une lutte qui pourra être longue et acharnée, il peut se trouver, parmi vos lecteurs, des hommes qui, absorbés par la gestion de leurs affaires, n’ont pas le loisir de mesurer dans toute son étendue la grande question de la liberté commerciale. Ils me pardonneront, j’espère, d’attirer leur attention sur ce vaste sujet.
L’affranchissement du commerce est une question de prospérité, de justice, d’ordre et de paix.
C’est une question de prospérité. — J’entends de prospérité générale ; mais, puisque nous sommes à Bordeaux, parlons de Bordeaux. — Que veut dire restriction ? Cela veut dire certains échanges empêchés. Donc que signifie absence de restriction ou affranchissement du commerce ? Cela signifie plus d’échanges. Mais plus d’échanges, c’est plus de produits importés et exportés, plus de voitures mises en mouvement, plus de navires allant et venant, moins de temps à composer une cargaison, plus de courtages, d’emballages, de pilotages, de roulages, plus de commissions, de consignations, de constructions, de réparations ; en un mot, plus de travail pour tout le monde.
Échanger, c’est donner une chose que l’on fait facilement contre une autre chose que l’on ferait plus difficilement. — Donc échanger implique moins d’efforts pour une satisfaction égale, ou plus de satisfactions pour des efforts déterminés. Échange, c’est division mieux entendue du travail, c’est application plus lucrative des capitaux, c’est coopération plus efficace des forces de la nature ; et, en définitive, plus [VII-44] d’échanges, c’est non seulement plus de travail, mais encore un meilleur résultat de chaque portion donnée de travail, — c’est plus de richesses, de bien-être, de prospérité matérielle, d’instruction, de moralité, de grandeur et de dignité.
C’est une question de justice. — Il y a injustice évidente à dépouiller qui que ce soit de la faculté d’accomplir un échange qui ne blesse ni l’ordre public ni les bonnes mœurs. Le droit de propriété implique le droit d’échanger aussi bien que de consommer. Vainement dirait-on que, lorsque la législation douanière exproprie un citoyen ou une classe de ce droit sacré de propriété, elle guérit la blessure qu’elle fait au corps social par l’avantage qu’elle procure à un autre citoyen ou à une autre classe ; car c’est en cela même que consiste l’injustice.
Encore si la protection pouvait s’étendre à tous, elle serait une erreur, elle ne serait pas une iniquité. Mais l’activité nationale s’exerce dans une foule de carrières qui ne sont point susceptibles de protection douanière ; le commerce, dans ses innombrables ramifications, les fonctions publiques, le clergé, la magistrature, le barreau, la médecine, le professorat, les sciences, la littérature, les beaux-arts, la plupart des métiers ; voilà une masse immense du travail national qui subit les inconvénients du système protecteur, sans en pouvoir jamais partager les illusoires avantages.
C’est une question d’ordre. — Les hommes qui dirigent les affaires publiques savent dans quelle énorme proportion ils seraient soulagés du fardeau de leur responsabilité, si le préjugé national n’avait remis en leurs mains la laborieuse tâche de régler, équilibrer et pondérer les profits relatifs des diverses industries. Depuis cet instant funeste, il n’est pas de gênes, de souffrances, de misères et de calamités qui ne soient attribuées à l’État. Les citoyens ont appris à ne plus compter sur leur prudence, sur leur habileté, sur leur énergie, mais sur la protection. Chacun fait effort pour arracher à la législature [VII-45] un lambeau de monopole ; et, comme si ce n’était pas assez de la foule des solliciteurs que la soif des emplois pousse dans les avenues des ministères, le peuple en masse, le peuple des champs et des ateliers, s’est transformé tout entier en solliciteur. Il s’agite, il se soulève, il se plaint, il encombre les rouages administratifs ; et il serait difficile de citer un acte du Gouvernement, un traité, une négociation, que l’esprit du monopole ne soit parvenu à fausser, à entraver ou à empêcher d’aboutir.
C’est une question de paix. — Avec la liberté du commerce, les rivalités nationales ne peuvent être autre chose que de l’émulation industrielle ; et, par une admirable dispensation de la divine Providence, il arrive que, dans cette lutte pacifique, c’est le vaincu qui recueille les fruits de la victoire par l’abondance et le bon marché des produits auxquels il a eu la sagesse d’ouvrir ses ports et ses frontières. Cette vérité, universellement comprise, est destinée à briser le contrat colonial en ce qu’il a d’exclusif, à décréditer le prestige des conquêtes et l’erreur des guerres de débouchés, à étouffer l’antagonisme international, à délivrer les peuples du fardeau et du danger des grandes armées permanentes et des puissantes marines militaires, et à unir les hommes de tous les pays, de toutes les langues, de tous les climats et de toutes les races par les liens d’une bienveillance réciproque et d’une universelle fraternité.
C’est pour coopérer à cet avenir de bien-être, de justice et de paix que l’Association bordelaise a élevé le drapeau de la liberté des échanges.
Enfants de Bordeaux, puisqu’il vous a été donné de prendre l’initiative de ce grand mouvement, n’oubliez pas à quel prix la victoire s’achète : assez d’obstacles vous attendent au dehors, préservez-vous de tout obstacle intérieur, et que le moindre symptôme de division soit étouffé dans son germe par votre abnégation et votre zèle ; que le dissolvant de la [VII-46] critique ne s’attache pas à quelques négligences, à quelques tâtonnements inséparables d’une première et prompte organisation ; ne laissez pas dire que Bordeaux, qui a toujours les mains ouvertes à tous les actes de philanthropie isolée, a laissé mourir, faute d’aliments, une grande réforme sociale ; ne laissez pas dire que Bordeaux, cette ville si féconde en hommes éminents, et qui a jeté tant de lustre sur les cours de judicature, les assemblées législatives et les conseils de la Couronne, a néanmoins manqué de cette intelligence collective, de cet esprit de hiérarchie volontaire qui est le sceau de toute civilisation avancée et l’âme de toute grande entreprise ! Levez-vous comme un seul homme et prodiguez sans mesure le tribut de toutes vos facultés à votre sainte cause. Et, au jour du triomphe, lorsque Bordeaux se revêtira d’une splendeur nouvelle, lorsqu’une activité trop longtemps assoupie animera ses quais, ses chantiers, ses entrepôts et ses magasins ; lorsque le chant laborieux du matelot retentira sur toute la ligne de cette rade splendide, magnifique présent du ciel, si le monopole n’était parvenu à le couvrir de silence et de vide ; — alors, certains que votre prospérité n’est point achetée par les souffrances de vos frères et alimentée par d’injustes priviléges, mais qu’elle est, pour ainsi dire, une des ondulations de la prospérité générale, se communiquant du centre aux extrémités, et des extrémités au centre de l’empire ; — alors, dis-je, vous pourrez vous rendre le témoignage que vous ne vous êtes pas levés pour une cause solitaire et égoïste ; et, rompant vos rangs, comme une milice fidèle au retour de la paix, vous dissoudrez cette Association, avec la consolation de penser qu’elle aura ajouté une noble et glorieuse page aux annales de votre belle cité.
References
[1] Mémorial bordelais du 18 février 1846.(N. E.)
[VII-47]
10. — À M. LE RÉDACTEUR DU JOURNAL DE LILLE, ORGANE DES INTÉRÊTS DU NORD [1] .↩
Monsieur,
Vous vous occupez de l’Association pour la liberté des échanges, et cela, il faut le dire, en très bons termes. Cette modération est d’un trop bon augure pour que nous ne nous empressions pas de la reconnaître et de l’imiter.
Vous prenez acte d’abord de ce que l’association se donne pour mission de propager la vérité économique avec assez de profusion pour changer le cours de la volonté nationale. — Puis, vous vous demandez si une telle mission est opportune ; et, bien entendu, vous résolvez la question négativement. — Et pourquoi n’est-il pas opportun de répandre la vérité ? — C’est, dites-vous, parce que l’opinion n’est pas encore fixée.
« N’avons-nous pas, en France, des intérêts d’agriculture qui demandent la protection, et d’autres intérêts d’agriculture qui demandent la liberté des échanges ; des industries qui veulent être protégées, et des industries qui se plaignent du régime restrictif ? Dans nos ports de mer, telle branche de commerce vit de la protection, et telle autre proteste contre elle. Tout cela ne forme-t-il pas une mêlée confuse ? »
Eh ! sans doute, les uns sont pour et les autres contre. Mais, par le grand Dieu du ciel ! ils n’ont pas tous raison en même temps. On se trompe de part ou d’autre ; et, puisque les partisans du monopole, par leurs journaux, leurs comités, leurs souscriptions, répandent assez leurs idées pour qu’elles se traduisent en lois, pourquoi les amis de la liberté ne feraient-ils pas de même ? Y a-t-il quelque moyen, de faire cesser [VII-48] cette confusion dont vous parlez que de débattre à fond la question devant le public ? Ou bien les armes dont l’erreur fait usage sont-elles interdites à la vérité, et faut-il que les monopoleurs aient encore le monopole de la parole ?
« Quand les conflits auront peu à peu disparu par la force des choses, — dites-vous, — alors surgira pour nous, comme pour l’Angleterre, cette grande question de réforme, que l’Association bordelaise cherche en vain aujourd’hui à précipiter à contre-temps. »
Fort bien : quand tout le monde sera d’accord, vous nous permettrez de parler ; et quand la lumière se sera faite par la force des choses, vous ne verrez plus d’inconvénient à ce que nous en appelions à la force des raisons. — Trouvez bon que nous ne nous laissions pas renfermer dans ce cercle vicieux. Vraiment, vous vous faites la part trop belle, car votre proposition revient à ceci : Maintenant, il y a conflit d’opinions ; que les moyens d’information soient tous de notre côté, et si, malgré cela, la doctrine de la liberté triomphe par la seule force des choses, alors la réforme commerciale pourra surgir, non en fait, mais à l’état de question.
Ensuite, toujours pour prouver que notre principe est faux et qu’en tout cas il est inutile de chercher à le répandre, vous dites :
« Il y a vingt-six ans et plus que cette doctrine de la liberté s’agite en Angleterre. MM. Huskisson, Bowring et d’autres hommes éminents avaient formé école et poursuivaient avec un zèle infatigable la réalisation de leurs plans. Il a fallu cependant près d’un quart de siècle, dans un pays où les principes économiques sont admirablement étudiés et compris, il a fallu qu’à des doctrines nouvelles des faits vinssent, un à un, graduellement et par une sorte d’attraction, prêter toute l’autorité d’un problème résolu, avant qu’un homme d’État, abdiquant ses convictions passées, ses antécédents politiques, osât proclamer à la face de son pays qu’il était prêt à [VII-49] entreprendre une œuvre que jadis il eût combattue. Il s’est fait chez sir Robert Peel une révolution dans ses idées et dans son esprit. Pour qu’un tel homme fasse consciencieusement et sans sourciller un pareil aveu, ne faut-il pas que l’évidence l’ait étreint de toute part ? etc. »
Certes, si l’on voulait démontrer tout à la fois la vérité de la doctrine libérale et la nécessité de constants efforts pour la propager, on ne pourrait mieux dire.
Quoi ! malgré ce qu’a de spécieux la doctrine de la restriction, les faits sont venus un à un, comme par une sorte d’attraction, prêter à la doctrine opposée l’autorité d’un problème résolu ! Quoi ! malgré ses convictions et ses engagements protectionistes, sir Robert Peel a été étreint de toute part d’une évidence telle qu’elle l’a amené à confesser publiquement qu’une révolution s’était opérée dans ses idées et dans son esprit ! — Et vous ne voulez pas que nous tenions cette doctrine pour vraie !
D’un autre côté, il a fallu vingt-six ans à un peuple qui étudie et qui comprend ; il a fallu d’infatigables efforts à Huskisson, à Bowring et à leur école, avant que l’Angleterre ait pu mettre sa législation en harmonie avec cette vérité ; — et vous en concluez que les amis de la liberté, en France, n’ont qu’à garder le silence et laisser agir la force des choses ! — En vérité, je ne puis comprendre par quelle étrange liaison d’idées de telles prémisses vous ont conduit à de telles conclusions.
« C’est, — dites-vous, — la fameuse Ligue Cobden, moins Cobden, que Bordeaux vise à copier. »
Avez-vous voulu faire la satire de la France ? Certes, il n’est personne qui puisse refuser son admiration à l’homme éminent qui a conduit la nation anglaise à triompher des whigs, des tories, de l’aristocratie, du monopole, et, ce qui était plus difficile, de sa propre apathie et de ses préjugés. — Est-ce à dire qu’il n’y a dans notre pays ni intelligence ni [VII-50] dévouement ? Et la France est-elle tellement épuisée d’hommes de mérite, qu’il n’en puisse plus surgir pour répondre aux nécessités du temps et à ses espérances ?
Mais le système protecteur, ajoutez-vous, n’a pas le même caractère en France qu’en Angleterre, et l’Association de Bordeaux a tort de copier la Ligue de Manchester.
Eh ! qui vous dit qu’on veut copier la Ligue ? La Ligue a adopté la tactique qui lui était imposée par le caractère de la lutte qu’elle avait à souvenir ; l’Association fera de même.
References
[1] Mémorial bordelais du 19 février 1846. (N. E.)
11. — THÉORIE DU BÉNÉFICE [1] .↩
Lundi, en sortant de l’assemblée, un monsieur m’accoste et me dit : Je vous ai écouté avec attention, vous avez articulé ces paroles : « Il faut savoir enfin de quel côté est la vérité. Si nous nous trompons, qu’on pousse la protection jusqu’au bout. Si nous sommes dans le vrai, réclamons la liberté, etc., etc. » — Or, Monsieur, cela suppose que liberté et restriction sont incompatibles.
— Il me semble que cela résulte des termes eux-mêmes.
— Vous n’avez donc pas lu le Moniteur industriel ? Il prouve clairement que liberté, protection, prohibition, tout cela s’accommode fort bien ensemble, en vertu de la théorie du bénéfice.
— Quelle est donc cette théorie ?
— La voici en peu de mots. L’homme aspire à consommer. Pour consommer, il faut produire ; pour produire, il faut travailler ; et pour travailler il faut avoir en perspective un bénéfice probable, ou, mieux encore, assuré.
— Fort bien, et la conclusion ?
[VII-51]
— La conclusion, elle est bien simple : écoutez le Moniteur !
« À quelles mesures doit avoir recours un peuple qui veut tel produit, qui cherche à arriver à la plus grande production possible, afin d’arriver ainsi, par le plus court chemin possible, à une plus grande consommation, à un plus grand bien-être ? Évidemment il doit assurer des bénéfices à quiconque entreprend telle industrie. Il doit assurer des bénéfices aux producteurs. »
— Et le moyen ?
— Écoutez encore le Moniteur : « Pour développer le plus possible le travail, tantôt la prohibition est bonne, tantôt c’est la protection, et tantôt c’est la liberté. » Vous voyez que le Moniteur industriel n’est pas plus pour la prohibition, que pour la protection, que pour la liberté.
— En d’autres termes : il faut que toute industrie gagne, de manière ou d’autre. À celle qui donne un bénéfice naturel, liberté, concurrence ; à celle qui donne naturellement de la perte, le droit de convertir cette perte en profit par le pillage organisé. Il y aurait bien des choses à dire là-dessus. Mais vous me rappelez une scène dont j’ai été témoin ces jours-ci. Voulez-vous me permettre de la raconter ?
— J’écoute.
— J’étais chez M. le maire, lorsqu’est survenu un solliciteur industriel, et voici le dialogue que j’ai entendu.
L’Industriel. — monsieur le Maire, j’ai découvert dans mon jardin une terre rougeâtre qui m’a paru contenir du fer, et j’ai l’intention d’établir chez moi, au milieu de la ville, un haut fourneau.
Le Maire. — Vous vous ruinerez.
L’Industriel. — Pas du tout, je suis sûr de gagner.
Le Maire. — Comment cela ?
L’Industriel. — Tout simplement par le bénéfice.
Le Maire. — Où sera le bénéfice, si vous êtes forcé de vendre au cours, c’est-à-dire à 12 ou 15 francs, du fer [VII-52] qui vous reviendra peut-être à 100 francs, peut-être à 1,000 francs. ?
L’Industriel. — C’est pour cela que je viens vous trouver. Mettez-moi à même de rançonner vos administrés non seulement jusqu’à concurrence de mes pertes, mais encore au delà, et vous aurez assuré à mon industrie des bénéfices.
Le Maire. — Mon autorité ne va pas jusque-là.
L’Industriel. — Pardon, monsieur le Maire, n’avez-vous pas un octroi ?
Le Maire. — Oui ; et, par parenthèse, je voudrais bien qu’il fût possible d’asseoir les revenus de la ville sur un autre moyen.
L’Industriel. — Eh bien ! mettez l’octroi à mon service ; qu’il ne laisse pas une parcelle de fer passer la barrière. Les Bordelais seront bien forcés de venir acheter mon fer, et à mon prix.
Le Maire. — Tous les autres travailleurs jetteront de hauts cris.
L’Industriel. — Vous leur accorderez à tous les mêmes faveurs.
Le Maire. — Fort bien. En sorte que, comme vous aurez bien peu de fer à fournir, nous aurons aussi peu de pain, peu de vêtements, peu de toutes choses. Ce sera le régime de la moindre quantité.
L’Industriel. — Qu’importe, si nous réalisons tous des bénéfices, en nous pillant les uns les autres légalement et avec ordre ?
Le Maire. — Monsieur, votre plan est fort beau ; mais les Bordelais ne s’y soumettront pas.
L’Industriel. — Pourquoi pas ? Les Français s’y soumettent bien. Je ne demande à l’octroi que ce que d’autres demandent à la Douane.
Le Maire. — Eh bien ! puisqu’elle est si bénévole, adressez-vous à elle et ne me rompez plus la tête. L’octroi est [VII-53] chargé de prélever un impôt, et non de procurer des bénéfices aux industriels.
L’Industriel. — Monsieur le Maire, encore un mot. Supposez que ma requête ait prévalu il y a vingt ans ; vous auriez aujourd’hui un haut fourneau au milieu de la ville, qui ferait vivre au moins trente ouvriers.
Le Maire. — Oui, et Bordeaux serait réduit peut-être à deux mille âmes de population.
L’Industriel. — Vous comprenez que si, dans mon hypothèse, on voulait renverser l’octroi, mes trente ouvriers seraient sans ouvrage.
Le Maire. — Et Bordeaux tendrait à redevenir ce qu’il est, une splendide cité de cent mille habitants.
L’Industriel, en s’en allant. — Ce que c’est que d’avoir affaire à un théoricien ! Ne pas comprendre la théorie du bénéfice ! — Mais j’irai trouver le directeur des Douanes, et ma cause n’est pas perdue.
References
[1] Mémorial bordelais, du 26 février 1846. (N. E.)
12. — À M. LE RÉDACTEUR DE L’ÉPOQUE [1] .↩
Monsieur,
Permettez-moi de féliciter l’Association pour la liberté des échanges de l’attention qu’elle obtient de ses adversaires. C’est un premier succès, qui, j’espère, sera suivi de bien d’autres. Le temps n’est plus où le monopole accablait de ses mépris ou étouffait sous la conspiration du silence tout effort dans le sens de la liberté. Tout en nous prêchant la modération, vous nous en donnez l’exemple ; ce n’est pas nous qui refuserons de le suivre.
[VII-54]
Mais, Monsieur, il s’agit ici de modération dans la forme, car, quant au fond, en conscience, nous ne pouvons pas être modérés. Nous sommes convaincus que deux et deux font quatre, et nous le soutiendrons opiniâtrement, sauf à le faire avec toute la courtoisie que vous pouvez désirer.
Il y en a qui professent que deux et deux font tantôt trois, tantôt cinq, et là-dessus ils se vantent de n’avoir pas de principes absolus ; ils se donnent pour des hommes sérieux, modérés, prudents, pratiques ; ils nous accusent d’intolérance.
« Il y a de par le monde, dites-vous, des hommes qui s’arrogent le monopole de la science économique. » Qu’est-ce à dire ? Nous avons foi en la liberté comme vous en la protection. N’avons-nous pas le même droit que vous de faire des prosélytes ? Si nous employions la violence, votre reproche serait fondé. Singuliers monopoleurs, qui se bornent à réclamer la liberté pour les autres comme pour eux-mêmes ! Vous mettons-nous le pistolet sur la gorge pour vous forcer à échanger, quand cela ne vous convient pas ? Mais c’est bien par la force que les protectionistes nous empêchent d’échanger lorsque cela nous convient. Pourquoi ne font-ils pas comme nous ? pourquoi, si l’échange est aussi funeste qu’ils le disent, n’en détournent-ils pas leurs concitoyens par la persuasion ? Nous demandons la liberté, ils imposent la restriction ; et ils nous appellent monopoleurs !
Vous nous reprochez d’être des théoriciens, puis vous dites :
« Les restrictions de la douane, qui sont un obstacle au développement des nations peu avancées ou de celles qui sont à la tête de la civilisation, ont été reconnues un puissant moyen d’émulation pour celles qui ont encore quelques degrés à franchir. »
En économie sociale, je ne connais rien de plus systématique, si ce n’est les quatre âges de la vie des nations imaginés par M. de Girardin ; vous vous rappelez cette bouffonnerie.
[VII-55]
C’est dire, en d’autres termes :
L’échange a deux natures opposées. Au haut et au bas de l’échelle sociale, il est bon, il faut le laisser libre ; dans les degrés intermédiaires, il est mauvais, il faut le restreindre.
En d’autres termes encore :
Deux et deux font quelquefois trois, quelquefois cinq, quelque fois quatre. Eh bien ! Monsieur, que vous le vouliez ou non, c’est là une théorie, et, qui plus est, une théorie fort étrange ; si étrange, que vous devriez bien vous donner la peine de la démontrer. Car comment l’échange, utile à un peuple pauvre, devient-il nuisible à un peuple aisé, pour redevenir utile à un peuple riche ? Tracez-nous donc les limites exactes où s’opèrent, dans la nature intime du troc, ces étonnantes métamorphoses.
Voici le système de M. de Girardin :
Premier âge. — Importation. — (C’est le temps heureux où les peuples reçoivent sans donner.)
Second âge. — Protection. — (Alors on ne reçoit ni ne donne.)
Troisième âge. — Exportation. — (Devenu plus avisé, le peuple, pour s’enrichir, donne toujours, sans recevoir jamais.)
Quatrième âge. — Liberté. — (Chacun fait librement ses ventes et ses achats, détestable régime, dont M. de Girardin nous dégoûte, en ayant soin de nous prévenir qu’il ne convient qu’aux nations en décadence et en décrépitude, comme l’Angleterre.)
Votre système est plus simple, mais il repose sur la même idée, qui est celle-ci :
« Sous le régime de la liberté, les nations les plus avancées écraseraient les autres de leur supériorité. »
Mais cette supériorité, à quoi se réduit-elle ?
Les Anglais ont de la houille et du fer en abondance, des capitaux inépuisables, auxquels ils ne demandent que 2 1/2 [VII-56] pour 100, des ouvriers habiles, disposés à travailler seize heures par jour. — Fort bien ! à quoi cela aboutit-il ? À fournir à l’ouvrier, pour 50 centimes, le couteau ou le calicot qui, sans cela, lui coûteraient 3 francs. Quel est le vrai gagnant ?
— Les Polonais ont un sol fertile, qui ne coûte rien d’achat et presque rien de culture. Eux-mêmes se contentent d’une chétive rémunération, en sorte qu’ils peuvent inonder la France de blé à 8 francs l’hectolitre. — Je ne crois pas le fait, mais supposons-le vrai ; que faut-il en conclure ? Que le pain en France sera à bon marché. Or à qui profite le bon marché ? Est-ce au vendeur ou à l’acheteur ? Si c’est à l’acheteur, quelle n’est pas l’inconséquence de la loi française d’interdire à la population française l’achat du blé polonais, sur le fondement qu’il ne coûte presque rien !
On dit que le travail s’arrêterait, en France, faute d’aliment, si l’étranger était admis à pourvoir à tous nos besoins. — Oui, si les besoins et les désirs de l’homme n’étaient pas illimités. L’éternel cercle vicieux de nos adversaires est celui-ci : ils supposent que la production générale est une quantité invariable, et apercevant que, grâce à l’échange, elle sera obtenue avec une réduction de travail, ils se demandent ce que deviendra cette portion de travail surabondant.
Ce qu’il deviendra ? — Ce qu’est devenu le travail que la bonne nature a mis en disponibilité quand elle nous a donné gratuitement de l’air, de l’eau, de la lumière.
Ce qu’est devenu le travail que l’imprimerie a rendu inutile pour un nombre donné d’exemplaires d’un même livre, lorsqu’elle s’est substituée au procédé des copistes.
Ce que devient mon travail, quand le boulanger avec une heure de peine m’en épargne six ; ce que devient le vôtre, quand le tailleur vous fait, en un jour, l’habit qui vous prendrait un mois, si vous le faisiez vous-même.
[VII-57]
La somme des satisfactions [2] restant la même, tout travail rendu superflu par l’invention ou par l’échange est une conquête pour le genre humain, un moyen d’étendre le cercle de ses jouissances.
Vous ne sauriez croire, Monsieur, combien je suis douloureusement affecté quand je viens à songer qu’une nuance presque imperceptible sépare, au moins en doctrine, les amis de la liberté de ceux de la protection. Il suffirait, pour que nous nous accordions, que ces derniers, par une petite évolution, après avoir vu, comme aux Gobelins, le revers de la tapisserie, consentissent à aller contempler sur l’autre face l’effet définitif. — Essayez : placez-vous un moment au point de vue, non du producteur, mais du consommateur ; non du vendeur, que toute concurrence importune, mais de l’acheteur, à qui elle profite. Demandez-vous si les besoins des uns sont faits pour être exploités par les autres ; si les estomacs ont été créés et mis au monde pour l’avantage des propriétaires fonciers ; si nos membres nous ont été donnés pour que monsieur tel ou tel ait le privilége de les vêtir. Mettez-vous du côté de ceux qui ont faim et froid, qui sont dénués et ignorants, et vous serez bientôt rangé sous la bannière de l’abondance, d’où qu’elle vienne.
« Quelle que soit la magie du mot liberté, dites-vous, il y a une autre idée qui exerce plus d’empire sur les populations, c’est celle des droits du travail. »
Les droits du travail ! Vous voulez dire les droits des travailleurs ? Eh bien ! parmi ces droits, ainsi que l’a dit le digne président de l’Association bordelaise, en est-il un plus naturel, plus respectable, plus sacré, que celui de troquer ce que l’on a produit à la sueur de son front ? Voyez où vous [VII-58] vous jetez : le droit mis en opposition avec la liberté ! le droit placé dans la restriction !
Enfin, vous nous menacez d’une coalition de producteurs.
Nous ne la craignons pas. Elle n’est pas à naître ; elle agit, elle fonctionne, elle exploite la protection. Cette entente cordiale d’intérêts divergents est un vrai miracle au sein du pays. Après tout, le pis qui puisse nous arriver, c’est qu’elle persévère, et nous avons mille chances pour qu’elle s’évanouisse.
13. — LE LIBRE ÉCHANGE EN ACTION [1] .↩
Monsieur le Rédacteur,
Nous avons déjà fait bien de la théorie sur la liberté commerciale. Nous en ferons encore, je l’espère ; mais voici de la liberté pratique, vivante, en chair et en os. Il ne s’agit plus de livres, d’articles de journaux, de raisonnements ; il s’agit de deux millions d’hommes placés au centre de l’Europe, pratiquant le libre échange, dans le sens le plus rigoureux du mot, c’est-à-dire se soumettant volontairement à toutes les concurrences, sans se défendre législativement contre aucune. Je crois donc utile que vous admettiez dans vos colonnes des extraits un peu étendus d’un rapport fait à la Chambre des Communes, par l’honorable représentant de Kilmarnock, sur l’état du commerce et de l’industrie en Suisse.
[VII-59]
… « C’est une chose bien faite pour exciter l’attention de toute personne réfléchie que les manufactures suisses, presque inaperçues et entièrement privées de protection, soient graduellement parvenues à écouler leurs produits sur tous les marchés du monde, quelque éloignés et inaccessibles qu’ils parussent. Certes on ne peut attribuer un résultat aussi remarquable à la position géographique de la Suisse ; car, d’une part, elle ne produit pas les matières premières nécessaires à ses fabriques, de l’autre, elle n’a d’autres points d’expédition que ceux que les puissances voisines consentent à lui prêter, aux conditions qu’il leur plaît. Aucune de ses fabriques ne doit sa prospérité à la protection ou à l’intervention de la loi. Cependant il n’est pas moins vrai que, sans le concours des douanes pour amortir l’action de la rivalité extérieure, ses progrès sont sans exemple dans l’histoire des pays manufacturiers. Je m’attendais bien à trouver en Suisse un vivant et instructif exemple de la vérité des principes économiques réduits en pratique ; mais je ne pouvais soupçonner qu’ils avaient produit une si grande somme de contentement et de bonheur, et qu’ils eussent élevé une si grande proportion de la classe ouvrière à la dignité et au bien-être.
« S’il y a des défauts et des lacunes dans les détails que j’ai à soumettre à vos Seigneuries, j’espère qu’elles n’oublieront pas qu’il est fort difficile de recueillir les faits, dans un pays où la puissance publique n’intervient nullement dans l’industrie, où il n’existe ni douane, ni aucun système de taxes qui nécessitent des rapports officiels. »
« Dans de tels pays, les questions de consommation, d’entrée et de sortie échappent nécessairement à toute appréciation rigoureuse, quant à leur fluctuation et à leur progrès. Quoique j’aie rencontré tous les gouvernements suisses sans aucune exception, très disposés à me communiquer [VII-60] toutes les informations qui étaient en leur pouvoir, cependant il est toujours arrivé que les connaissances statistiques ne m’ont pas été accessibles. Mais il est impossible de se méprendre sur le mérite d’une politique dont le résultat éclate dans la satisfaction et la prospérité générales. Dans la plupart des cantons manufacturiers de la Suisse, le pouvoir législatif est, non pas indirectement, mais très directement aux mains des classes populaires. Si leur système commercial était opposé à l’intérêt commun, il ne pourrait pas subsister un seul jour ; mais il est sanctionné par l’universelle expérience et l’universelle approbation. Deux millions d’hommes, placés dans les conditions les plus désavantageuses, ont fait systématiquement l’épreuve de la liberté absolue du commerce. Les résultats incontestables sont de nature à détruire tous les doutes de l’observateur honnête et désintéressé. »
« La Suisse est très-éloignée de tout grand centre commercial ; le coton qu’elle fabrique doit y être transporté, pendant des centaines de milles, de la Méditerranée ou des rivages encore plus éloignés de l’Atlantique. Elle importe la soie de la France et de l’Italie, et la laine de l’Allemagne. »
« Lorsque ses produits cherchent un marché extérieur, ils rencontrent les mêmes droits, les mêmes risques et les mêmes frais d’un transit lent, difficile et dispendieux ; il faut qu’ils traversent les montagnes du Jura ou des Alpes. Cependant, malgré ces obstacles, on les trouve sur tous les grands marchés de l’univers, et la raison en est simple : en Suisse, l’industrie est abandonnée à elle-même ; la richesse n’a point été détournée par les lois de sa tendance naturelle ; on n’y a pas vu cette lutte stupide encouragée par le gouvernement entre les monopoles du petit nombre et les intérêts des masses. Le consommateur est resté libre d’acheter au meilleur marché, comme le [VII-61] producteur de vendre au marché le plus élevé, et la situation actuelle de l’industrie suisse, ainsi que son avenir, examiné dans ses détails, auront quelque influence sur les personnes auxquelles les principes de la liberté commerciale sont antipathiques.
« On aurait pu s’attendre à ce que le régime prohibitif, par lequel les États circonvoisins ont défendu leurs frontières, eût jeté l’alarme parmi les manufacturiers suisses et les eût entraînés à chercher des alliés commerciaux, en adoptant une législation semblable, faussement appelée protectrice ; mais telle n’a pas été la tendance de l’opinion, ni les enseignements de l’expérience en Suisse. Plusieurs des manufacturiers les plus éclairés m’ont assuré que quoiqu’ils aient été fort alarmés en 1814 par les grands changements politiques de cette époque, et fort désireux de contracter des arrangements avec d’autres puissances, basés sur la réciprocité, ils étaient maintenant convaincus que la politique du libre échange et du libre transit était la plus sage et la meilleure. Malgré les désavantages naturels des cantons suisses, à raison de leur position géographique, je suis persuadé qu’il n’existe pas dans le monde une industrie manufacturière plus saine, plus vigoureuse et plus élastique que celle de ce pays. Quoique, d’un côté, elle soit un objet de terreur pour les intérêts protégés des manufacturiers français, quoique les marchés d’Allemagne et d’Italie se resserrent de plus en plus pour elle, continuellement elle gagne du terrain et fait des progrès vers de nouvelles régions. La consommation qu’elle trouvait autrefois en Europe est maintenant dépassée de beaucoup par celle des États transatlantiques, et la Suisse, en persévérant courageusement dans sa politique intelligente, a établi ses manufactures sur la large et inébranlable base de la production à bon marché. En traversant les différents districts, j’ai constamment rencontré des marchands [VII-62] et des manufacturiers qui avaient noué des relations avec les contrées les plus éloignées du globe. Ils m’ont assuré qu’ils étaient maintenant dégagés des anxiétés que leur avaient fait éprouver les lignes de douane dont la France, l’Allemagne et l’Italie avaient entouré leurs frontières ; qu’en fait ils étaient indépendants de la politique étroite et égoïste qui avait créé les tarifs de tant de nations européennes ; que ces tarifs mêmes les avaient forcés d’explorer des champs plus vastes, et où leurs capitaux ainsi que tous leurs moyens de production trouvaient un emploi illimité. »
« En 1820, la Diète suisse, au sein de laquelle des réclamations énergiques s’étaient produites contre les mesures prohibitives du Gouvernement français, essaya, par voie de représailles, d’introduire le régime protecteur dans la législation du pays. En réalité, il n’eut que quelques mois d’existence, et les obstacles à la liberté des communications succombèrent graduellement sous la pression de l’opinion publique et l’instinct des intérêts bien entendus. Il n’est aucun sujet sur lequel j’aie trouvé une telle communauté de sentiments que celle qui existe à l’égard des bienfaits que la liberté commerciale a répandus sur le pays. Même parmi les industriels qui, en apparence, auraient été les plus intéressés à la protection et à la prohibition, plusieurs avouaient que leurs opinions étaient changées. Un certain nombre de fabricants, qui d’abord avaient été les ardents promoteurs des droits de douane sur les produits étrangers, et se considéraient comme ayant un droit exclusif à la consommation nationale, notamment quand les États voisins repoussaient leurs propres produits, étaient maintenant convaincus par l’expérience que leurs vues avaient été erronées, et que leurs établissements avaient acquis une force et une solidité qu’une législation prohibitive n’aurait jamais pu leur donner. L’un des principaux [VII-63] filateurs disait : Dans tous les magasins, dans toutes les boutiques du pays, les produits anglais et français sont étalés côte à côte avec les nôtres ; ils n’ont payé aucun droit ; les nôtres n’ont reçu aucune protection ; et quelque insignifiants qu’aient été nos premiers essais, quelque restreints qu’aient été nos débouchés, le Gouvernement crut devoir nous refuser une main secourable et nous forcer à aviser pour nous-mêmes. Cependant, en dépit de la terrible concurrence du capital britannique et du goût français, nous avons réussi. L’histoire du dernier siècle n’est pour nous que l’histoire de nos progrès. Malgré tous les obstacles, faibles comme nous sommes, sans aucun port d’expédition que ceux que nous tenons du bon plaisir de nos voisins, nos articles se sont fait jour et se débitent dans les quatre coins du monde. »
Les réflexions se présentent en foule à la lecture de ce rapport. On pourrait demander aux protectionistes : Où sont donc les invasions, les inondations de produits étrangers qui eussent dû tuer le travail national en Suisse ? On pourrait faire bien d’autres questions encore. J’aime mieux laisser à ce précieux document toute la force qu’il porte en lui-même.
References
[1] Mémorial bordelais, du 12 mars 1846. (N. E.)
14. — QU’EST-CE QUE LE COMMERCE [1] ?↩
L’argument qu’il est de mode aujourd’hui d’opposer à la liberté des échanges a été porté à la tribune nationale par M. Corne. C’est celui-ci :
« Attendons, afin de pouvoir lutter avec l’étranger à [VII-64] armes égales, que nous ayons autant que lui de capitaux, de fer, de houille, de routes, et alors nous affronterons les périls de la concurrence. »
Ceci implique que le bon marché auquel l’étranger peut nous livrer certains produits est justement le motif pour lequel on nous défend de les acheter.
Là-dessus je me demande : Qu’est-ce que le commerce ? Une chose est à meilleur marché dans tel pays étranger qu’en France ; est-ce une raison pour nous abstenir de commercer avec ce pays ? ou bien est-ce un motif de commercer avec lui le plus tôt possible ?
Si les monopoleurs ne s’en mêlaient pas, la question serait bientôt résolue. Non-seulement les négociants décideraient que c’est là un motif suffisant pour déterminer le commerce, mais encore que c’est le motif unique, qu’il n’y en a pas d’autre possible, ni même imaginable.
Mais ces messieurs raisonnent autrement, en fait de commerce, que les commerçants. Ils disent : Ce qui est plus cher au dehors qu’au dedans, laissons-le entrer librement ; et ce qui est à meilleur marché, repoussons-le de par la loi.
Il est possible que le principe absolu de la prohibition ne soit pas dans les actes de ces législateurs, mais il est très certainement dans leur exposé des motifs.
LIBERTÉ, ÉGALITÉ.
M. Corne a mis l’égalité en opposition avec la liberté.
Cela seul devrait l’avertir qu’il y a un vice radical dans sa doctrine. En tout cas, une chose m’étonne : comment ose-t-on prendre sur soi d’opter, quand on a le malheur de croire que la liberté et l’égalité sont incompatibles ?
M. Corne a opté, néanmoins ; et, réduit à sacrifier l’une ou l’autre, c’est la liberté qu’il immole.
La liberté ! mais c’est la justice !
[VII-65]
Pierre rencontre Paul, et lui dit : « Mon ami, je fais de la toile, et je vous en vendrai, pourvu que vous me permettiez de mettre la main dans votre poche et d’en retirer un prix qui me satisfasse. » — Paul répond : « Ne prenez pas cette peine, je sais quelqu’un qui me donnera de la toile à moitié prix. » — De quel côté est le bon droit ? — La loi tranche la question en mettant au service de Pierre la baïonnette du douanier.
Qu’y faire ? dites-vous : la justice et la liberté sont d’un côté ; l’égalité et la prospérité, de l’autre ; il faut choisir.
Triste alternative, ou plutôt dérisoire blasphème. Non, il n’est pas vrai qu’il y ait entre le juste et l’utile un irrémédiable conflit. Cette doctrine contredit les faits autant qu’elle choque la raison.
Car enfin qui protégez-vous ? Celui qui élève des bestiaux, aux dépens de ceux qui mangent de la viande ; celui qui a obtenu des concessions houillères ou qui possède des forêts, au détriment de ceux qui ont besoin de faire cuire leurs aliments ou de réchauffer leurs membres engourdis ; le petit nombre, au préjudice du grand nombre.
Vous parlez de la classe ouvrière. Et quel est le langage que tient le monopoleur au charpentier, au maçon, au cordonnier, à cette innombrable famille d’artisans auxquels la douane n’a aucune compensation à donner ? Le voici :
« Il vous faut du pain, du vin, des vêtements, du feu, du fer. Prenez une bêche, et si vous trouvez un coin de terre inoccupé, labourez-le ; semez-y du blé, du lin et du gland ; plantez-y de la vigne, cherchez-y du minerai, faites-y paître vos troupeaux, et rien ne vous manquera. »
« Hélas ! dit chaque ouvrier, votre conseil est excellent, mais je ne puis le suivre. Heureusement que j’ai des bras. Je puis tailler la pierre, ou manier la hache et pousser le rabot. On me payera, et avec mon salaire j’achèterai les objets nécessaires au maintien de mon existence. »
[VII-66]
Mais alors, dit à chacun le monopoleur :
« Pain, bois, viande, laine, je te forcerai de l’acheter à ma boutique, ainsi que ta truelle, ta hache et ton rabot. J’ai même fait une loi pour que tu n’en obtiennes que le moins possible en échange de ton labeur. »
Et puis il ajoute :
« Tu n’es pas libre, — mais que l’égalité te console ! »
References
[1] Courrier français du 1er avril 1846. (N. E.)
15. — À M. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU COMMERCE [1] ↩
Monsieur le Ministre,
Lorsque vous êtes monté à la tribune pour proclamer la politique commerciale du cabinet, nous nous attendions à ce que vous vous prononceriez sur cette question : En matière d’échanges, la restriction vaut-elle mieux que la liberté ?
Si, après avoir reconnu que la restriction est un mal, qu’elle implique nécessairement fausse application de travail humain et déperdition de services naturels, qu’elle équivaut, par conséquent, à une limitation de force, de richesse, de bien-être et de puissance, vous eussiez ajouté :
« Néanmoins, nous ne proposons pas l’abolition du régime restrictif, parce que l’opinion publique le soutient, et que, sous un gouvernement représentatif, la conviction ministérielle doit céder devant la volonté nationale, »
— nous comprendrions ce langage. Il nous ferait entrevoir que le ministère sympathise avec les associations qui se forment pour propager les saines doctrines économiques et pour [VII-67] contre-balancer l’influence, jusqu’ici prépondérante, des coalitions protectionistes.
Si vous aviez dit encore :
« Alors même que la majorité apercevrait la funeste déception qui est au fond du régime protecteur, de ce régime qui voit un profit national dans tout ce que les industries s’arrachent les unes aux autres, il n’en est pas moins vrai qu’il a créé un état de choses artificiel, que le Gouvernement ne peut détruire sans ménager la transition, sans préparer surtout des ressources aux ouvriers déclassés ou hors d’état d’entreprendre de nouvelles carrières, »
— nous vous comprendrions assurément, et nous nous féliciterions d’apprendre que le cabinet a un but vers lequel il est prêt à marcher.
Mais tel n’a point été votre langage, et nous vous avons entendu, avec regret, attaquer l’échange dans son principe.
Car vous avez dit formellement que la protection ne doit se relâcher qu’à mesure que l’industrie nationale peut lutter à armes égales contre l’industrie étrangère.
Ce qui équivaut à ceci : tant qu’une différence dans le prix de revient déterminerait l’échange international, il sera interdit. Nous le permettrons sitôt qu’il cessera d’être utile.
Or c’est bien là le condamner dans sa seule raison d’être.
« En Angleterre, dites-vous, le fer et la houille se trouvent en abondance, presque partout ; dans les mêmes localités, les moyens de transport vers l’intérieur et vers la mer, par les rivières, les canaux et les chemins de fer, sont multipliés et faciles, les ports et les rades sont en grand nombre, sûrs et dans le meilleur état… Les capitaux et les moyens de crédit surabondent, d’immenses établissements industriels ont presque tous racheté leur mise de fondation, etc. »
[VII-68]
Voilà certes bien des avantages naturels et acquis. Ne serions-nous pas heureux que les Anglais nous les cédassent gratuitement ?
Et c’est ce qui arriverait par la liberté des échanges. Car en quoi se résument ces avantages ? — En bon marché. — Et à qui profite le bon marché ? — À l’acheteur. — Donc laissez-nous acheter.
Si l’on cherche la cause de la modicité du prix auquel les Anglais livrent leur fer et leur houille, on trouve qu’elle provient de ce que les avantages que vous énumérez concourent gratuitement à la création de ces produits. Les Anglais, comme dit M. Lestiboudois, se contentent de retirer un intérêt fort abaissé de leurs capitaux ; leurs ouvriers livrent beaucoup de travail contre peu de salaire ; et quant à la sûreté des rades, la facilité des routes, l’abondance et la proximité du combustible et du minerai, tout cela ils le donnent par-dessus le marché. C’est une coopération très effective, qui pourtant n’entre pour rien dans le prix ; c’est un don gratuit fait au consommateur, si celui-ci n’avait pas la folie de le repousser.
Tel est le bénéfice de l’échange, non-seulement dans ce cas particulier, mais dans tous les cas imaginables. Il rend l’acheteur participant des avantages naturels dont le vendeur n’est qu’en possession apparente. Je dis plus, celui-ci n’en est que le dépositaire, le dispensateur ; et c’est celui-là qui en recueille tout le fruit. Par le bon marché du sucre, l’avantage de la haute température des tropiques est véritablement conféré aux Européens ; par le bon marché du pain, l’avantage d’une chute d’eau est réellement conféré à ceux qui le consomment.
Lors donc qu’avec MM. Corne et Lestiboudois vous avez dit : « Attendons, pour proclamer la liberté, de pouvoir lutter avec les Anglais, à armes égales, » — vous avez condamné radicalement les échanges, puisque votre [VII-69] proposition implique qu’ils doivent être interdits précisément par le motif même qui les détermine.
Vous dites que
« la marche suivie par l’Angleterre n’est pas un hommage rendu à la théorie absolue de la liberté commerciale ; que l’Angleterre retire la protection à celles de ses industries qui peuvent s’en passer ; qu’elle se fait enfin libérale là seulement où elle n’a rien à craindre du régime libéral. »
De telles assertions, répétées par un grand nombre d’orateurs et de journaux, ont lieu de nous surprendre. Elles seraient incontestables, si M. Peel se fût borné à réduire les droits sur la houille, le fer, les tissus de lin et de coton. Mais à quoi l’Angleterre a-t-elle ouvert ses ports ? Aux céréales, aux bestiaux, au beurre, aux fromages, aux laines. Or, dans des idées restrictives, n’avait-elle pas autant de motifs pour repousser ces choses que nous pouvons en avoir pour repousser la houille et le fer ?
Qu’invoquaient les propriétaires et les fermiers anglais pour demander le maintien de la protection ? L’élévation du prix des terres et de la main-d’œuvre, l’infertilité du sol, la pesanteur des taxes, l’impossibilité, par ces motifs, de soutenir la concurrence étrangère. — Et que leur a répondu le cabinet ? — Toutes ces circonstances se traduisent en cherté des aliments, et la cherté, qui arrange le producteur, mais qui nuit au consommateur, nous n’en voulons plus. — Et ce n’est point là un hommage rendu à la théorie du libre échange !
Qu’invoquent nos actionnaires de mines et de forges pour perpétuer la protection ? La difficulté des transports, la distance qui sépare le combustible du minerai, l’impossibilité par ces motifs de soutenir la concurrence étrangère.
Et que leur répondez-vous ? — Toutes ces circonstances se traduisent en cherté de la houille et du fer, et la cherté, qui nuit au consommateur, mais qui arrange le producteur, nous la maintiendrons.
[VII-70]
Vous pouvez bien croire que l’Angleterre se trompe, mais vous ne pouvez pas dire qu’elle agit selon votre principe.
Vous ajoutez, il est vrai, qu’elle a tiré du régime prohibitif tout le parti qu’on en peut tirer. — Ceci suppose que c’est un bon instrument de richesses, et même c’est sur lui que vous comptez pour porter notre marine, notre industrie et nos capitaux au niveau de ceux de nos voisins.
Mais c’est là la question. Il s’agit de savoir si capitaux, marine, industrie, ne grandiraient pas plus vite par le travail et l’échange libres que par le travail et l’échange contrariés.
Vous affirmez que la protection, qui, selon vous, a porté si haut la puissance anglaise, produit chez nous des effets aussi grands que rapides.
En ce cas, il n’y a rien à faire, si ce n’est de la renforcer ; et nous pourrions être surpris que vous annonciez un projet de loi qui adoucira nos tarifs.
Nous aimons mieux nous en féliciter et vous venir en aide dans la sphère où il nous est donné d’agir.
Vous méditez une réforme. Mais personne, assurément, n’est plus en mesure que vous de savoir combien vous rencontrerez de résistances, non seulement dans les intérêts alarmés, mais encore dans une opinion publique sincère, mais égarée. Voulez-vous un point d’appui ? Nous vous l’offrons. — Depuis longtemps, grâce à la puissance de l’association, l’école protectioniste se fait seule entendre en France. C’est aussi au moyen de l’association que nous voulons donner une voix à l’école libérale. Soyez neutre. Nous propagerons le principe de la liberté pendant que d’autres prêcheront le principe de la protection. La vérité jaillira du débat. Et si nous parvenons à faire prévaloir notre doctrine dans l’esprit public, quelle vaste perspective s’ouvre devant nous ! La douane, rendue à sa destination essentielle, versera certainement cent millions de plus au trésor ; la paix, [VII-71] solidement établie, vous permettra certainement aussi de retrancher cent millions au budget de la guerre. Avec un excédant de deux cents millions, que de grandes choses ne pouvez-vous pas entreprendre ! Que d’impôts onéreux ou impopulaires ne pouvez-vous pas dégréver ! Oui, si la liberté commerciale est en elle-même une grande et magnifique réforme, elle est le point de départ de réformes plus grandes et plus magnifiques encore, bien dignes d’éveiller une noble ambition dans le sein d’un cabinet auquel on reproche, avec quelque raison, une immobilité dont le pays s’étonne, et dont il commencera bientôt peut-être à se lasser.
References
[1] Mémorial bordelais, du 6 avril 1846. (N. E.)
16. — À MONSIEUR LE RÉDACTEUR DU COURRIER FRANÇAIS [1] .↩
J’aie toujours trouvé fort hardi, presque impertinent, l’usage d’attribuer le langage d’un journal au personnage qu’on suppose en être le patron, et de se servir de ces locutions : M. Guizot dit ; — M. Thiers affirme ; — M. de Metternich nous répond, — et cela à propos d’un premier Paris dont il est plus que probable que ces illustres patrons n’ont eu aucune connaissance. Ce n’est pas que j’aie la simplicité d’ignorer, tout villageois que je suis, les liens qui attachent certaines feuilles à certains hommes politiques ; mais, je le répète, la formule banale dont je parle me semble renfermer une double insulte ; elle dit au patron qu’on interpelle : Tu n’as pas le courage d’avouer tes paroles ! — et au client supposé : Tu n’es qu’un commis à gages !
Aussi je me garderai de faire remonter à M. Thiers la [VII-72] responsabilité de l’article qui a paru hier dans le Constitutionnel, sur ou contre la liberté des échanges. Et pourtant, quand on voit ce manifeste suivre de si près celui du Journal des Débats, et ces deux feuilles élever bannière contre bannière, ne peut-on pas supposer, sans sortir du domaine des conjectures permises, que M. Thiers et M. Guizot ont transporté leur lutte sur le terrain de la réforme commerciale ?
S’il en est ainsi, on ne peut pas féliciter M. Thiers du rôle qu’il a pris. — Se placer dans les idées rétrogrades, planter sa tente au milieu du camp des monopoles, chercher la force dans la sympathie des intérêts égoïstes, c’est assurément manquer de tact ; c’est engager la partie avec des chances, peut-être actuellement favorables, mais qui, de leur nature, doivent aller toujours s’amoindrissant ; c’est abandonner à son adversaire des auxiliaires puissants : la liberté, la vérité, la justice, l’intérêt général et le développement naturel de la raison publique.
Mais laissons là le champ des conjectures, et, sans nous occuper des ressorts plus ou moins problématiques qui agissent sur le journalisme, examinons en lui-même l’article du Constitutionnel.
La première erreur où tombe cette feuille, c’est de supposer que les associations qui se forment pour la défense de la liberté, en matière d’échanges, aspirent à supprimer la douane, et qu’elles attribuent cette portée à la réforme de sir Robert Peel.
« À lire la plupart des appréciations de la mesure de sir Robert Peel, et quand on ignore les conditions d’existence mercantile de la Grande-Bretagne, on est tenté de croire que, sous peu, il n’y aura plus chez nos voisins, ni taxes à l’entrée, ni douanes. C’est, il faut le dire, une illusion bien naïve ; car, malgré les réformes, le gouvernement anglais s’arrange de manière à retirer encore des douanes un revenu de 450 à 500 millions de francs. [VII-73] Malgré les réformes, il n’y aura pas un douanier de moins sur cette vaste étendue de côtes ; malgré les réformes, le métier de smuggler sera encore très lucratif ; malgré les réformes, enfin, le tabac, le thé, les eaux-de-vie, les vins continueront à être frappés de taxes tellement exorbitantes, qu’on chercherait en vain dans les tarifs des autres peuples des droits aussi élevés sur les mêmes articles. Si vous appelez cela de la liberté commerciale, il faut avouer que vous êtes faciles à contenter et que vous êtes d’excellente composition pour l’application des principes. »
Oui, nous sommes d’excellente composition avec le fisc, dont, en tant qu’association, nous ne nous occupons pas. Mais nous sommes moins faciles à l’égard de la protection, avec laquelle, je l’espère, nous ne transigerons jamais.
Au moment où beaucoup de bons esprits sentent la nécessité de s’unir pour la propagation des saines doctrines économiques, nous croyons utile d’insister sur cette distinction fondamentale et de fixer, de manière à ce qu’on ne puisse plus s’y méprendre, le vrai caractère des associations qui se forment. — Nous n’avons pas besoin de dire que nous n’exprimons ici que notre opinion personnelle.
Napoléon a dit : « La douane n’est pas seulement un instrument fiscal, elle doit être encore et surtout un moyen de protéger l’industrie. » Prenant le contre-pied de cette sentence, nous disons : « La douane ne doit pas être un moyen de protéger l’industrie et de restreindre les échanges ; mais elle peut être un moyen comme un autre de prélever l’impôt. » Là est toute la pensée de l’Association. Elle ne doit pas, elle ne peut pas être ailleurs.
Nous ferons encore connaître son esprit et sa portée par une autre opposition.
Sous le titre de Comité central pour la défense du travail national, une société s’est formée en France, et son objet avoué est d’exploiter l’institution des douanes, [VII-74] non-seulement au détriment du public consommateur, mais au détriment du fisc lui-même.
L’Association pour la liberté des échanges a pour mission de propager le principe directement opposé à celui du Comité central.
Elle réclame pour tout Français, en ce qui ne blesse ni d’ordre public ni les bonnes mœurs, la plénitude du droit de propriété, lequel implique la faculté d’opter entre la consommation et l’échange.
Elle demande que la liberté d’acheter au dehors soit reconnue et garantie aussi bien que la liberté de vendre au dehors, d’autant plus que ce qui restreint l’une limite nécessairement l’autre.
De ce que l’association réclame pour tous les produits le libre passage de la frontière, il ne s’ensuit pas qu’elle s’oppose à ce qu’une taxe fiscale les atteigne soit à l’entrée soit à la sortie. Sans renoncer à discuter accessoirement l’opportunité et la quotité de ces taxes, il suffit qu’elles soient calculées exclusivement dans un but de fiscalité, pour qu’elles sortent de la compétence de l’Association. Elle ne s’attaque pas au fisc, mais à la protection. Elle s’élève contre le système qui consiste à exagérer le droit, même au préjudice du trésor, dans le but avoué d’élever le prix d’une denrée, afin d’accroître, aux dépens du consommateur, la rémunération naturelle du producteur. Elle soutient que c’est là une violation de la propriété et une usurpation commise par la loi.
Ici se présente une difficulté que je crois devoir aborder ouvertement, car, d’un côté, sous peine d’introduire la dissension dans son sein, l’Association ne doit pas se laisser entraîner à poursuivre des réformes, quelque séduisantes qu’elles paraissent, qui ne sont pas dans son principe ; et d’une autre part, il importe qu’on sache bien au dehors où elle commence, où elle s’arrête, quelle est la sphère de son activité et le terme précis de ses prétentions.
[VII-75]
Nous l’avons déjà dit, un droit de douane peut être soit fiscal, soit protecteur. Malheureusement il peut être aussi, et il est presque toujours à la fois l’un et l’autre.
Il est fiscal quand la charge qu’il impose au public profite tout entière au trésor, c’est-à-dire au public lui-même. Tels sont les droits sur le thé et les autres denrées qui n’ont pas de similaires dans le pays. En ce cas, pas de difficulté, l’Association ne s’en mêle pas. De tels droits peuvent être fort différemment appréciés, et, à cet égard, l’opinion de chaque sociétaire est réservée. Mais enfin c’est une question d’impôt ; la protection n’y est pour rien, et l’Association non plus. Pour le dire en passant, on voit combien le Constitutionnel s’est mépris quand, pour prouver que la réforme anglaise est tout ce qu’il y a de plus vulgaire, il cite précisément les taxes qu’elle a laissées subsister sur les denrées de cette catégorie. Il ne voit pas que c’est en cela que consiste tout le libéralisme de la mesure.
Le droit est exclusivement protecteur quand il empêche l’importation de la marchandise étrangère, comme dans les cas de prohibition ou de droits prohibitifs. — Dans ce cas encore, pas de difficulté. C’est là l’abus contre lequel l’Association s’est formée ; sa tâche est de démontrer que d’une telle mesure, généralisée et réduite en système, résulte pour tout Français interdiction de tirer tout l’avantage possible de son travail, contrainte de s’adresser à un vendeur plus malhabile ou moins bien situé. Ici, l’acheteur n’acquitte pas une taxe au trésor, dont il profite comme citoyen ; il paye un excédant de prix qui ne lui reviendra sous aucune forme ; il subventionne une industrie privilégiée ; il est soumis à une extorsion ; il est dépouillé sans compensation d’une partie de sa propriété ; il travaille pour autrui et, dans une certaine mesure, sans rémunération ; il est esclave dans toute la rigueur du mot, car l’esclavage consiste non dans la forme, mais dans le fait d’une spoliation [VII-76] permanente et légale. — C’est ce régime que l’Association veut détruire.
Mais on nous dit : Vous admettez un droit fiscal. Or, chaque fois qu’un produit étranger a un similaire au dedans, est-il possible de le frapper d’un droit, même fiscal, qui n’élève le prix vénal de ce produit et n’agisse, par conséquent, comme droit protecteur ?
Voici, dans ce cas, comment il me semble que l’Association doit comprendre l’application de son principe.
Chaque fois qu’un droit est arrivé à cette limite inférieure, au-dessous de laquelle il ne pourrait descendre, sans compromettre d’une manière permanente le revenu qu’en tire le trésor, on peut dire qu’il est essentiellement fiscal et involontairement protecteur. C’est à cette limite que l’action de l’Association doit s’arrêter, parce que tout ce que l’on pourrait discuter au delà serait une question d’impôt.
Ainsi, par exemple, si l’on abaissait successivement le droit sur les fers à 20, 15 et 10 pour 100, cherchant, sans se préoccuper aucunement de nos forges, le point où il donne le plus gros revenu possible, c’est-à-dire où il entre le plus de fer possible sans nuire au trésor, — je dis qu’à cette limite le droit devrait être considéré comme fiscal et soustrait aux discussions de nos assemblées. Ce n’est pas à dire que cet impôt, comme impôt, fût à l’abri de toute objection. Il resterait à savoir s’il est d’une bonne administration de renchérir le prix du fer. Mais cette considération rentre dans les questions générales relatives à toute contribution publique. Elle se présente aussi bien à propos du sel et du port des lettres qu’au sujet des douanes. Elle sort de la compétence de l’Association, parce que l’Association ne discute pas les impôts, même mauvais ; elle n’a qu’un but : le renversement du système protecteur.
Il ne faut pas se le dissimuler, cette déclaration ouvre une brèche au monopole. À chaque abaissement du tarif, [VII-77] il s’écriera : « Arrêtez ! non dans mon intérêt, mais dans celui du trésor. »
C’est un inconvénient ; mais ce serait bien pis si l’Association ignorait ce qu’elle veut et à quoi elle tend. Quand une difficulté résulte de la nature des choses, il n’y a nul avantage à fermer les yeux pour se la dissimuler à soi-même.
Je sais que beaucoup de personnes ont de la peine à admettre cette distinction. Elles voient, dans toute restriction douanière, alors même qu’elle a un but fiscal, une atteinte à la liberté des échanges, et elles en concluent que l’Association désavouerait son propre titre, si elle se bornait à combattre le système protecteur.
Mais une taxe n’infirme pas plus le principe de la liberté commerciale, qu’un impôt n’infirme le principe de la propriété. Si l’Association voulait intervenir dans les questions que peuvent soulever, à propos de tous les cas particuliers, l’opportunité, la quotité, la forme, l’assiette ou la perception des contributions publiques, elle n’aurait aucune chance de durée, car les avis y seraient bientôt partagés ; — et à une institution de cette nature, ce n’est pas la majorité qu’il faut, c’est l’unanimité.
Entre associés, il n’y a qu’un lien possible : la communauté du principe. — Pas de protection ! Voilà notre mot de ralliement. — Que le législateur ramène le tarif à sa destination originaire, qui est de prélever sur tous une taxe qui profite à tous. Mais nous ne voulons pas de taxes qui, sans rentrer au trésor, pèsent sur le grand nombre pour profiter au petit nombre. Attachons-nous à ce principe, ne nous en laissons jamais séparer. C’est un rocher inébranlable qui repose sur deux bases éternelles : la justice et la vérité.
References
[1] Courrier français du 11 avril 1846. (N. E.)
[VII-78]
17. — RÉFORME POSTALE [1] .↩
Que sont devenues cette énergie française, cette audace, cette initiative qui frappaient le monde d’admiration ? Nous sommes-nous rapetissés à la taille des Lilliputiens ? L’intrépide géant s’est-il fait nain timide et trembleur ? Notre orgueil national se contente-t-il qu’on dise encore de nous : « Ce sont les premiers hommes du monde pour donner et recevoir des coups de sabre, » — et sommes-nous décidés à dédaigner la solide gloire de marcher résolument dans la voie des réformes fondées sur la justice et la vérité ?
On serait tenté de le croire, quand on lit ce rachitique projet émané de la commission de la Chambre, intitulé emphatiquement : Réforme postale.
L’État s’est emparé du transport et de la distribution des lettres. Je ne songe pas à lui disputer, au nom des droits de l’activité individuelle, ce délicat service, puisqu’il l’accomplit du consentement de tous.
Mais de ce que, par des motifs d’ordre et de sûreté, il s’est déterminé à dépouiller les citoyens de la faculté de se transmettre réciproquement leurs dépêches comme ils l’entendent, ne s’ensuit-il pas qu’il ne doit rien leur demander au delà du service rendu ?
Voyez les routes. Elles servent à la circulation des hommes et des choses, à quoi l’on a attaché tant de prix, que l’État, après avoir consacré des sommes énormes à leur confection, les livre, sans aucune rémunération, à l’usage des citoyens.
Eh quoi ! la circulation de la pensée, l’échange des sentiments, la transmission des nouvelles, les relations de père [VII-79] à fils, de frère à sœur, de mère à fille, seraient-elles à nos yeux moins précieuses ?
Cependant, non-seulement l’État se fait rembourser, pour le transport des lettres, le prix du service rendu, mais il le surcharge d’un impôt inégal et exorbitant.
Il faut des revenus au trésor, j’en conviens. Mais on conviendra aussi que les rapports des parents, les épanchements de l’amitié, l’anxiété des familles, devraient être la dernière des matières imposables.
Chose singulière ! Par une double inconséquence, on imprime à la poste un caractère fiscal qu’on refuse à la douane, les détournant ainsi l’une et l’autre de leur destination rationnelle.
Un citoyen a certainement le droit de dire à l’État : Vous ne pouvez, sans porter atteinte à mes plus chers priviléges, me dépouiller de la faculté de faire parvenir comme je l’entends une dépêche dont dépendent peut-être ma fortune, ma vie, mon honneur et le repos de mon existence. Tout ce que vous pouvez avec justice, c’est de me déterminer à avoir volontairement recours à vous, en m’offrant les moyens de correspondance les plus prompts, les plus sûrs et les plus économiques.
Que si on posait en principe (je demande grâce pour cette expression peu parlementaire) que l’État ne doit point bénéficier sur le transport des lettres, on arriverait avec une facilité merveilleuse à la solution de tous les problèmes que soulève la réforme postale. car je n’ai jamais entendu faire contre la taxe inférieure et uniforme qu’une seule objection : Le trésor perdrait tant de millions (perdre, en style administratif, c’est ne pas gagner).
Remboursement réel, remboursement uniforme, voilà les deux sujets sur lesquels j’essaierai d’appeler l’attention du lecteur.
Mais, avant tout, je crois devoir rendre un hommage [VII-80] éclatant à l’administration des postes. On dit qu’en Angleterre, c’est dans le post-office que s’organise la résistance à la réforme. En France, au contraire, elle est née dans les bureaux, s’il est vrai que la première publication qui ait traité ce sujet doive être attribuée à un haut fonctionnaire de la rue Jean-Jacques-Rousseau. Jamais je n’ai lu un ouvrage plus dégagé d’esprit bureaucratique et fiscal, plus empreint d’idées élevées, généreuses, philanthropiques, et qui respire plus, à chaque page, l’amour du progrès et du bien public.
Remboursement réel des frais. — Fidèle au principe que je posais tout à l’heure, je dois d’abord chercher quelle devrait être la taxe ou plutôt le prix de chaque lettre.
La circulation fut, en 1844, de 108 millions de lettres, et il est impossible qu’elle ne dépassât pas, avec la taxe réduite, 200 millions.
| Les dépenses se sont élevées à | fr. 30,000,000 | |
| À déduire : | ||
| Paquebots du Levant | fr. 5,200,000 | » 11,000,000 |
| Produit réalisé des places dans la malle-poste | » 2,300,000 | |
| Envois d’argent | » 1,100,000 | |
| Remboursement par les offices continentaux | » 400,000 | |
| Produit réalisé des journaux | » 2,000,000 | |
| Reste à la charge des lettres | fr. 19,000,000 | |
Encore les frais administratifs devraient-ils être imputés rigoureusement, dans la proportion d’un tiers, aux services accessoires.
Reste toujours que 200 millions de lettres à 10 centimes, produisant 20 millions, couvriraient et au delà leurs frais.
Remarquons qu’à ce prix les lettres payeraient encore un impôt de 5 centimes ou 100 p. 100, puisqu’elles défrayeraient [VII-81] le transport gratuit des dépêches administratives égales à leur propre poids.
Par cette dernière considération, je le dis ouvertement, si nous ne vivions dans un temps où il semble qu’on a horreur du bien quand il se présente sous une forme un peu absolue et dégagé d’une dose de mal qui le fasse accepter, je dirais que la lettre simple ne doit payer que 5 centimes ; et certes les avantages de la réforme seraient alors si complets, que peut-être ne devrait-on pas hésiter. — Mais admettons 10 centimes, moitié rémunération, moitié impôt.
Le premier avantage de cette modicité, je n’ai pas besoin de le dire, ce serait la juste satisfaction donnée au plus délicat, au plus respectable des besoins de l’homme, dans l’ordre moral.
Le second, d’accroître l’ensemble des transactions et des affaires, fort au delà probablement de ce qui serait nécessaire pour restituer par d’autres canaux, au trésor public, la perte du produit net actuel des postes.
Le troisième, de mettre la correspondance à la portée de tous.
La commission fixe à 10 centimes le prix des lettres adressées aux soldats. Elle oublie une chose, c’est que, sur 34 millions d’habitants, il y en a 8 millions qui sont des soldats aussi, les soldats de l’industrie, et qui, après avoir pourvu aux premières nécessités de la vie, n’ont pas toujours le sou de poche.
Enfin, un quatrième et précieux avantage, ce serait de restituer à tout Français la faculté de transporter des lettres et de ne pas faire arbitrairement une catégorie de délits artificiels.
Je suis surpris qu’on ne soit pas frappé du grave inconvénient qu’il y a toujours à classer législativement, parmi les délits et les crimes, des actions innocentes en elles-mêmes, [VII-82] et souvent louables. Et ici, voyez dans quelle série d’absurdités et d’immoralités on s’engage nécessairement quand on fonde la poste sur le principe de la fiscalité.
La taxe est fiscale ; donc elle doit dépasser de beaucoup le prix du service rendu ; donc les particuliers seront excités à faire la concurrence à l’État ; donc il faut leur ôter une liberté innocente, quelquefois précieuse ; donc il faut une sanction pénale.
Et quelle sanction ! Peut-on lire sans une insurmontable répugnance l’article 7 du projet de la Commission ? Un acte de simple obligeance puni comme un forfait ! Le port d’une lettre entraîner une amende qui peut aller à 6,000 francs ! Combien de crimes contre les propriétés, même contre les personnes, n’exposent point à une telle pénalité !
Avec la taxe à 10 centimes, — ou mieux à 5 centimes, — vous n’avez pas besoin de créer de délits. La nomenclature en est déjà assez longue. Vous pouvez rendre à chacun la liberté. On ne s’amusera pas à chercher des occasions incertaines, quand on aura sous la main la plus économique, la plus commode, la plus directe, la plus sûre et la plus prompte des occasions.
Puisque j’ai parlé de châtiments, je dois faire ressortir dans le projet de la Commission, un contraste dont je suis sûr que le sentiment public sera révolté.
Un homme se charge d’une lettre. En lui-même, l’acte n’est pas coupable. Ce n’est pas la nature des choses, c’est la loi, la loi seule, qui l’a fait tel. Cet homme peut être puni de 6,000 francs d’amende, et, qui plus est, par une autre fiction légale, le châtiment peut tomber sur un tiers qui n’a pas même eu connaissance du fait (art. 8).
Un fonctionnaire abuse du contre-seing. Il y a fraude aussi, et qui pis est fraude du plus mauvais caractère, fraude préméditée, calculée, intentionnelle. De plus, il y a faux, et [VII-83] faux commis par un homme public en écritures publiques ; il y a abus de confiance ; il y a violation de serments. — L’amende est de 25 francs ! Que dirai-je de l’article 10 : L’administration pourra transiger avant comme après jugement, etc. ? De telles dispositions portent avec elles-mêmes leur commentaire.
Ainsi, transactions gênées, sentiments froissés, liens de famille relâchés, affaires gênées, liberté restreinte, taxes inégales, crimes fictifs, châtiments arbitraires ; telles sont les conséquences nécessaires du principe de la fiscalité introduit dans la loi des postes.
Donc il faut recourir à cet autre principe, que la poste doit rendre le service auquel elle est destinée, au prix le plus bas possible, c’est-à-dire à un prix qui couvre ses frais.
Il me reste à parler de l’uniformité de la taxe, et aussi des moyens de combler le déficit du trésor. Ce sera l’objet d’un second article.
References
[1] Mémorial bordelais du 23 avril 1846.(Note de l’édit.)
18. — DEUXIÈME ARTICLE [1] .↩
L’uniformité de la taxe a des avantages si nombreux, si incontestables, si éclatants, que, pour ne pas les voir, il faut fermer volontairement les yeux.
On fait cette objection : « L’uniformité résiste au principe même que vous avez posé, celui du simple remboursement du service reçu, car il est juste de le payer d’autant plus qu’il est plus dispendieux.
« L’égalité apparente ne serait qu’une réelle inégalité. »
[VII-84]
Mais tous, tant que nous sommes, n’écrivons-nous pas tantôt à de grandes, tantôt à de petites distances ? L’égalité se rétablit donc par là, et rien n’empêche de faire de toutes les distances une moyenne que chaque lettre est censée avoir parcourue [2] .
Partout où, dans des cas analogues, l’uniformité est établie pour le port des journaux, pour les envois d’argent, il faut qu’on s’en trouve bien, car personne n’y contredit.
D’ailleurs, il est un point où, dans la pratique, tout est forcé de s’arrêter, même la justice rigoureuse ; c’est quand on arrive à des différences microscopiques, à des infiniment petits, à un fractionnement si minutieux, que l’exécution en devient onéreuse à tout le monde. Est-ce que le système de la Commission a la prétention de réaliser l’égalité mathématique ? Fait-il payer plus la lettre remise à huit heures que la lettre délivrée à neuf ? Observe-t-il la proportionnalité entre le destinataire placé à 39 ou à 40 kilomètres ?
Lors donc qu’on parle d’égalité, il faut entendre une égalité possible, praticable, qui n’exige pas, par exemple, qu’on prenne de la monnaie d’un centime.
Et c’est précisément ce qui arriverait dans le système de la taxe graduelle, s’il tenait compte de cette équité infinitésimale dont il se masque.
Car il est prouvé que les frais de locomotion, les frais qui affectent diversement les lettres, ne font varier la dépense, d’une zone à l’autre, que de 1/2 centime [3] .
Mais puisque c’est au nom de l’égalité et de l’équité que la Commission s’est décidée pour la taxe graduelle, examinons son système à ce point de vue.
[VII-85]
D’abord elle est partie de ce principe, que la poste devait être un instrument fiscal, et que, tandis que l’État épuise ses revenus pour faciliter la circulation des marchandises, il devait se faire une source de revenus de la circulation des sentiments, des affections et des pensées.
Il suit de là qu’il y a trois choses dans un port de lettre :
1o Un impôt ;
2o Le remboursement de frais communs à toutes les lettres ;
3o Le remboursement de frais variables selon les distances.
Il est clair que l’uniformité de la taxe devrait exister pour toutes les lettres, en ce qui concerne les deux premiers éléments, et que la gradualité ne peut résulter, avec justice, que du troisième.
Il est donc nécessaire d’en déterminer l’importance.
Les frais généraux communs à toutes les lettres, administration, inspection, surveillance, etc., s’élèvent à 12 millions que nous pouvons réduire à 10, parce qu’une partie de ces frais est absorbée par des services étrangers au sujet qui nous occupe, tels que le transport de cinquante mille voyageurs, les envois d’argent, les paquebots, etc.
Les frais de locomotion sont de 17,800,000 fr. qui se réduisent aussi à 10 millions, ainsi que nous l’avons vu dans l’article précédent, si l’on en déduit, comme on le doit, ceux qui ne concernent pas les dépêches.
Ces frais doivent se répartir sur :
| 875,000 | kilog. | de lettres représentant | 116 | millions de lettres simp. |
| 1,000,000 | — | journaux et imprimés | 133 | — |
| 1,000,000 | — | dépêches administratives | 133 | — |
| Total…… | 382 millions. | |||
Soit, en nombre rond, 400 millions de lettres simples.
[VII-86]
| Ainsi, 10 millions de frais fixes répartis sur 400 millions de lettres donnent pour chacune… | 2 c. 1/2 |
| 10 millions de frais graduels ajoutent en moyenne au prix de revient… | 2 c. 1/2 |
| Total… | 5 cent. |
Enfin, le coût moyen d’une lettre étant aujourd’hui de 12 c. 1/2, il s’ensuit que chacun des trois éléments y entre dans les proportions suivantes :
| cent. | |
| Frais fixes… | 2 1/2 |
| Frais graduels… | 2 1/2 |
| Impôt… | 37 1/2 |
| Total… | 42 c. 1/2 |
Si, comme le demandent les partisans de la réforme radicale, la partie purement fiscale était supprimée, le port serait fixé à 5 centimes, prix de revient. — En ce cas, l’État aurait à subventionner le port des dépêches administratives.
Ou, si l’on adoptait 10 centimes, les lettres des particuliers paieraient encore un impôt suffisant pour défrayer le service public.
Dans l’un et l’autre cas, l’uniformité est forcée, car les frais de locomotion, les seuls qui pussent justifier la gradualité, n’étant en moyenne que de 1/2 centime, il en résulte que la plus petite distance coûte 1 c. 1/2 et la plus grande 5 centimes.
Voici donc quel devrait être le tarif fondé sur ce principe.
| Frais fixes. | Frais graduels. | Total ou tarif. | ||
| 1re | zone | 2 1/2 | 1 1/4 | 3 3/4 |
| 2e | — | 2 1/2 | 1 6/8 | 4 3/8 |
| 3e | — | 2 1/2 | 2 1/2 | 5 |
| 4e | — | 2 1/2 | 3 3/4 | 6 1/4 |
| 5e | — | 2 1/2 | 5 | 7 1/2 |
Tarif évidemment inexécutable. Il ne le serait pas moins, [VII-87] si l’on y ajoute une taxe fiscale, puisqu’elle devrait être immuable, par exemple 20 centimes. — Et l’on aurait alors ce monstrueux tarif :
1re zone, 23 c. 1/2 ; — 2e, 24 c. 3/8 ; — 3e, 25 c., etc.
Or, qu’a fait la Commission sous le manteau de l’égalité ? Elle a inégalisé l’impôt, et son tarif décomposé donne les résultats suivants :
| Frais généraux. | Frais graduels. | Impôt. | Total de la taxe proposée. | ||
| 1re | zone | 2 1/2 | 1 1/4 | 6 1/4 | 10 |
| 2e | — | 2 1/2 | 1 6/8 | 15 5/8 | 20 |
| 3e | — | 2 1/2 | 2 1/2 | 25 | 30 |
| 4e | — | 2 1/2 | 5 1/4 | 33 3/4 | 40 |
| 5e | — | 2 1/2 | 5 | 42 1/2 | 50 |
N’avais-je pas raison de dire que le système de la Commission établissait un impôt aussi inégal qu’exorbitant, puisqu’il s’élève pour quelques-uns à deux fois, pour d’autres à dix fois le prix du service rendu.
Il n’y a donc de sérieuse égalité que dans l’uniformité. Mais une taxe uniforme implique une taxe modique, et, pour ainsi dire, réduite au minimum praticable.
On a beaucoup parlé de 20 centimes. — Mais à ce taux, il vous faut une catégorie de lettres à 10 centimes (celles qui circulent dans le rayon d’un bureau) ; de là la nécessité du tri, de la taxation ; de là, l’impossibilité d’arriver jamais à l’affranchissement obligatoire.
Je viens de prononcer le mot affranchissement obligatoire. Il n’est possible qu’avec une taxe de 10 ou mieux de 5 centimes, et les avantages en sont si évidents, qu’il y a lieu d’être surpris qu’on recule devant cette objection : la perte du trésor, — comme si le trésor n’était pas le public.
Qu’on se figure quel est le travail actuel de la poste, ce qu’il sera encore après la réforme telle que la Commission [VII-88] nous l’a faite. Cent lettres sont jetées à la poste. Chacune d’elles peut appartenir, pour la distance, à onze zones et pour le poids à neuf classes, ce qui élève le nombre des combinaisons à quatre-vingt-dix-neuf pour chaque lettre, et voilà M. le directeur, consultant tour à tour son tableau et sa balance, réduit à faire 9,900 recherches en quelques minutes. Après cela il constatera le poids sur un coin et la taxe au beau milieu des adresses.
Faut-il affranchir ? Il recevra l’argent, donnera la monnaie, inscrira l’adresse sur je ne sais combien de registres, enveloppera la lettre dans un bulletin qui relate, pour la troisième ou la quatrième fois, le nom du destinataire, le lieu du départ, le lieu de l’arrivée, le poids, la taxe, le numéro.
Puis vient la distribution ; autres comptes interminables entre le directeur et le facteur, le facteur et le destinataire, et toujours contrôle sur contrôle, paperasse sur paperasse.
Que dirai-je du travail qu’occasionnent les rebuts ; et les trop taxés, et les moins taxés, et cette comptabilité générale, chef-d’œuvre de complication, destinée, et il le faut bien, à s’assurer la fidélité des agents de tous grades ?
N’est-il pas singulier qu’on prodigue des millions pour faire gagner aux malles une heure de vitesse, et qu’on prodigue d’autres millions pour faire perdre cette heure aux distributeurs ?
Avec l’affranchissement obligatoire, toutes ces lenteurs, toutes ces complications, toutes ces paperasses, tous ces rebuts, les plus trouvés, les moins trouvés, les tris, les taxes, cette comptabilité prodigieuse en matière et en finances, tout cela disparaît tout à coup. La poste et l’enregistrement vendent des enveloppes et des timbres à 5 ou 10 centimes, et tout est dit.
On objectera qu’il y aurait de l’arbitraire à priver l’envoyeur de la faculté de faire partir une lettre non affranchie.
[VII-89]
On ne l’en prive pas. Rappelons-nous que, dans ce système, il est maître de faire parvenir ses lettres comme il le juge à propos, il n’a donc pas à se plaindre, si la poste, pour rendre le service aussi prompt et aussi économique que possible, veut rester maîtresse de ses moyens.
Disons les choses comme elles sont. Sous le rapport moral, au point de vue de la civilisation, des affaires, des affections, quant à la commodité, la simplicité et la célérité du service, enfin dans l’intérêt de la justice et de la vraie égalité, il n’y a pas d’objection possible contre la taxe uniforme et modérée.
La perte du revenu ! — Voilà le seul et unique obstacle.
La perte du revenu ! — Voilà pourquoi on frappe d’un impôt énorme et inégal les communications de la pensée, la transmission des nouvelles, les anxiétés du cœur et les tourments de l’absence ! Voilà pourquoi on grossit nos Codes de crimes fictifs et de châtiments réels. Voilà pourquoi on perd à la distribution des lettres le temps qu’on gagne sur la vitesse des malles. Voilà pourquoi on surcharge le service de complications inextricables ! Voilà pourquoi on l’assujettit à une comptabilité qui porte sur 40 millions divisés en somme de 40 centimes, dont chacune donne lieu au moins à une douzaine d’écritures !
Mais, en définitive, à combien se monte cette perte ?
Admettons qu’elle soit de 20 millions.
On accordera sans doute que cette somme, laissée à la disposition des contribuables, achètera du sucre, du tabac, du sel, par quoi la perte du trésor sera atténuée.
On accordera aussi que la fréquence et la facilité des relations, multipliant les affaires, réagiront favorablement sur tous les canaux des revenus publics.
Le nombre des lettres ne peut pas manquer non plus de s’accroître d’année en année.
Enfin le service, simplifié dans une proportion [VII-90] incalculable, permettra certainement de notables économies.
Toutes ces compensations faites, supposons encore la perte du revenu de 10 millions.
La question est de savoir si vous pouvez employer 10 millions d’une manière plus utile, et j’ose vous défier de me montrer dans le budget, tout gros qu’il est, une dépense mieux entendue.
Eh quoi ! c’est au moment où vous prodiguez 1 milliard pour faciliter la circulation des hommes et des choses, que vous hésitez à sacrifier 10 millions pour faciliter la circulation des idées !
Vous vous demandez s’il est sage de négliger une rentrée de 10 millions, quand il s’agit de conférer au public des avantages inappréciables ?
Car si le nombre des lettres vient seulement à doubler, qui osera assigner une valeur aux affaires engagées, aux affections satisfaites, aux anxiétés dissipées par ce surcroît de correspondance ?
Et n’est-ce rien que d’effacer de vos Codes des crimes chimériques, des châtiments arbitraires, et ces transactions immorales entre le caprice administratif et les arrêts de la justice ?
N’est-ce rien que de remettre à un pauvre manœuvre la lettre de son fils, si longtemps attendue, sans lui arracher, et presque tout pour l’impôt, le fruit de quinze heures de sueur ?
N’est-ce rien que de ne pas réduire une misérable veuve, afin d’amasser les 24 sous qu’on exige (dont 22 sont une pure contribution) à laisser séjourner quinze jours à la poste la lettre qui doit lui apprendre si sa fille vit encore ?
Aujourd’hui même je lisais dans le Moniteur que le chiffre des recettes publiques s’accroît de trimestre en trimestre.
Comment donc le moment n’arrive-t-il jamais où les réformes les plus urgentes ne sont pas ajournées ou gâtées par cette éternelle considération : la perte du revenu ?
[VII-91]
Mais enfin, vous faut-il absolument 10 millions ? Vous avez un moyen simple de vous les procurer. Rentrez, sous un double rapport, dans la vérité des choses. — En même temps que vous ôterez à la poste, rendez à la douane le caractère fiscal.
Diminuez seulement d’un quart les droits sur le fer, la houille, les bestiaux et le lin.
Le trésor et le public s’en trouveront bien. Chacune de ces réformes facilitera l’autre, vous aurez rendu hommage à deux principes d’éternelle justice, et vos prochaines professions de foi se baseront au moins sur quelque chose de plus substantiel que l’ordre avec la liberté et la paix avec l’honneur, lieux communs qui, s’ils n’engagent à rien, ne trompent non plus personne.
References
[1] Mémorial bordelais, 30 avril 1846.(Note de l’édit.)
[2] Recevez dans l’année 4 lettres à 3 décimes, 4 lettres à 2 décimes et 2 lettres à 1 franc ; n’est-ce point comme si vous aviez payé pour chaque lettre le taux fixe de 40 centimes qui est la moyenne du système actuel ?
[3] Nous renvoyons pour la démonstration à l’excellent rapport de M Chégaray (Séance du 5 juillet 1844, p. 10 et suiv.).
19. — LIBERTÉ COMMERCIALE [1] .↩
Comment trouvez-vous Philis ? — Belle, admirable, adorable. — N’est-ce pas qu’elle a de beaux yeux ? — Oui, mais ils louchent. — Et son teint ? — Il est un peu couperosé. — Et que dites-vous de son nez ? — Il fait honte à celui de la Sulamite que l’époux compare à la tour du mont Liban. — Oui dà ! mais en quoi donc trouvez-vous que Philis soit si belle ? — Elle est incomparable dans l’ensemble, mais elle ne supporte pas le détail.
C’est de cette façon qu’on traite aussi la liberté commerciale. Tant qu’elle reste théorie, on la salue, on la respecte, on la flatte ; il n’y a rien de plus beau sous le soleil. S’avise-t-elle de vouloir être réalisée ? montre-t-elle le pied, la main [VII-92] ou le visage ? c’est une horreur depuis les pieds jusqu’à la tête.
Le Constitutionnel, par exemple, se garderait bien de rien objecter, en principe, contre la liberté des échanges. Mais il soulève contre toutes ses applications l’armée entière des sophismes protectionistes.
Nous n’avons pas la prétention de les combattre tous. Bornons-nous à ceux qui sont le plus à la mode.
D’abord le Constitutionnel affirme que le monde entier se méprend sur les réformes de sir Robert Peel.
« Nous avons établi, dit-il, que les réformes anglaises laissent subsister, pour ainsi dire en entier, le régime commercial et douanier de la Grande-Bretagne et que la liberté des transactions, qu’on a cru découvrir dans les mesures de sir Robert Peel n’était qu’une pure illusion. Ainsi l’Association bordelaise, qui s’appuie sur l’exemple de l’Angleterre pour réclamer la liberté commerciale, commet tout simplement une grosse inconséquence. »
Plus bas il ajoute :
« L’Angleterre, tout en demandant aux autres nations la liberté commerciale, s’est bien gardée de leur donner un pareil exemple. »
C’est là une assertion qu’on a beaucoup répétée à la Chambre. Nous n’y répondrons pas. Nous prions seulement le Constitutionnel de vouloir bien dresser un petit tableau en deux colonnes, dont l’une aura pour titre : Tarif de 1840 ; — l’autre, tarif de 1846. Au-dessous figureront les droits, pour les deux époques, des articles suivants :
Froment, seigle, orge, avoine, maïs, bœufs, veaux, vaches, moutons, brebis, agneaux, viandes fraîches et salées, beurre, fromage, cuir, laine, coton, lin, soie, huile, bois, gants, bottes, souliers, tissus de laine, de coton, de lin, de soie.
Alors il nous sera possible de décider la question par le fait ; nous verrons bien si l’Angleterre s’est bien gardée d’entrer dans la voie de la liberté ; puis il restera au [VII-93] Constitutionnel à nous dire à quelle nation elle a demandé cette liberté comme condition des mesures qu’elle a cru devoir prendre.
Ensuite le Constitutionnel, exploitant habilement cette ancienne tactique qui consiste à mettre les intérêts aux prises et à les irriter en les touchant par le côté sensible, demande aux Bordelais s’ils sont préparés à une réforme du tarif en ce qui concerne les droits de navigation.
Je n’ai à me porter fort pour personne. Je sais que si l’on demande tour à tour à tous les privilégiés : Voulez-vous voir cesser votre privilége ? — on court grand risque qu’ils ne répondent : non ou au moins pas encore.
« Nous sommes tous de Lille en ce point… »
Et voilà pourquoi je comprends très bien cette stratégie de la part d’un protectioniste, car elle seconde merveilleusement ses desseins ; mais je ne la comprends pas de la part d’un homme qui cherche sincèrement le triomphe de la liberté et de la justice pour tous.
Mais entrons dans le fond de la question. Le Constitutionnel affirme « que les ports de mer se sont toujours élevés contre la réciprocité, en matière de navigation. »
C’est possible, mais en même temps les ports se plaignent que la marine marchande décline sans cesse.
Et à quoi conduit, en fait de navigation, la non-réciprocité ? Le voici :
Un armateur du Havre avait fait construire trois magnifiques bateaux à vapeur pour faire un service régulier entre cette ville et Saint-Pétersbourg. Il acquitta 300,000 francs de droits pour les machines qui étaient anglaises. Elles étaient servies par des mécaniciens français, comme les bateaux étaient montés par des marins français.
Ainsi l’honorable armateur, en organisant cette belle entreprise, avait servi les intérêts de notre marine aussi bien que ceux du commerce.
[VII-94]
Les choses en étaient là, quand la France augmenta les droits sur les graines oléagineuses et la surtaxe de celles qui arrivent par navires étrangers.
Voilà donc les navires russes exclus de nos ports.
La Russie a senti le coup, et par un ukase elle a élevé de 50 pour 100 les droits sur les produits arrivant en Russie sous pavillon français.
Et voilà nos navires exclus des ports russes.
Or, qu’arrive-t-il de là ?
C’est que dorénavant tout bâtiment, à laquelle des deux nations qu’il appartienne, doit faire deux voyages pour un fret.
Car, s’il est russe, il faut qu’il vienne à vide, chez nous, chercher des marchandises ; et s’il est français, force est qu’il aille à vide chercher des produits russes.
Ainsi la réciprocité s’est établie, mais c’est une réciprocité de gênes, d’entraves et de travail perdu.
Voilà-t-il pas un beau résultat ?
Mais écoutons la fin de l’histoire.
L’entreprise de l’armateur du Havre ne pouvant plus continuer, il est sur le point de vendre ses trois steamers à des Anglais. Et remarquez ceci : les Anglais ne lui rembourseront certainement pas les 300,000 francs de droits qu’ont acquittés les machines. Ils ne payeront pas non plus toute la valeur des steamers, dont le propriétaire n’a que faire. Ils pourront donc, au besoin, établir le fret au-dessous du taux normal, et se servir de nos capitaux pour nous battre chez nous.
Et tout cela parce qu’ils ont un traité de réciprocité avec la Russie et que nous n’en avons ni n’en voulons.
Un mot encore sur l’intérêt maritime.
Un constructeur de Marseille médisait : Le navire que je livre aux Italiens pour 70,000 francs, coûte aux Français 100,000 francs, à cause des droits.
Mettons d’abord le trésor hors de cause. Le[VII-95] Constitutionnel nous apprend que la douane lui vaut 160 millions,
« et il est plus que douteux, ajoute-t-il, qu’un accroissement dans les transactions et une augmentation d’impôts indirects, qui en seraient la conséquence, au dire des libres-échangistes, remplirait le vide causé par la suppression des douanes. »
Où le Constitutionnel a-t-il pris que les partisans du libre-échange invoquent une augmentation d’impôts indirects ? C’est là une insinuation dont la portée est facile à comprendre. Elle a sans doute pour but de jeter l’alarme dans le pays, de soulever contre nous l’opinion publique. Toujours de la stratégie ! mais encore faudrait-il qu’elle fût fondée sur quelque chose de spécieux. En quoi l’abrogation de la protection compromettrait-elle le trésor ? J’ai toujours compris qu’une marchandise qui n’entre pas ne paye pas de droits… au trésor s’entend, car elle fait peser sur le consommateur une taxe odieuse.
Je prie le Constitutionnel de nous dire combien le trésor retire des droits sur le fer. Pour lui éviter des recherches, je le lui dirai : c’est trois millions. — Au reste, si l’État veut affermer la douane à 160 millions, à la condition de n’élever aucuns droits et de les abaisser tous, j’ose dire qu’une compagnie sera prête avant la fin de l’année. Que le monopole ne parle donc plus du trésor qu’il opprime, comme il opprime le consommateur.
Mais voici la grande difficulté :
« Il est difficile d’arriver à une pondération exacte et rigoureuse de tous les intérêts. Un changement brusque de régime douanier, favorisant les uns, ruinerait évidemment les autres. »
Brusquerie à part, qui donc demande que le gouvernement pondère tous les intérêts ? Ce qu’on lui demande, c’est qu’il les laisse se pondérer entre eux par l’échange. — Et puis, n’y a-t-il aucune distinction à faire entre deux intérêts dont l’un demande à n’être pas opprimé par l’autre ?
[VII-96]
« Nous n’examinerons pas, dit le Constitutionnel, si le régime protecteur prend sa source dans une erreur des gouvernements ou dans la nécessité des industries qui se sont établies dans le pays. Il suffit qu’il existe et qu’il ait créé de nombreux intérêts pour qu’on n’y touche qu’avec prudence. »
Vous n’examinez pas !… Mais précisément c’est ce qu’il faut examiner. Il n’est pas indifférent que la protection douanière soit ou non une erreur, soit ou non une injustice. Cela change complétement la position des parties belligérantes. Les droits acquis, dont le monopole se fait un titre, perdent bien de leur force, s’ils sont mal acquis, s’ils sont acquis aux dépens d’autrui.
Quand le choléra régnait à Paris, il y favorisait certaines industries ; les médecins, les pharmaciens, les droguistes, les entrepreneurs de pompes funèbres, tendaient à se multiplier sous son influence. Si l’État eût trouvé un moyen de chasser ce fléau, qu’aurait-on pensé d’un publiciste qui serait venu dire : Je n’examine pas si le choléra est un bien ou un mal ; il suffit qu’il existe et qu’il ait créé de nombreux intérêts pour qu’on n’y touche qu’avec prudence ? —
References
[1] Mémorial bordelais du 2 mai 1846.(Note de l’édit.)
20. — PREMIÈRE LETTRE AU RÉDACTEUR DU JOURNAL DES DÉBATS [1] .↩
Monsieur,
Me permettrez-vous d’ajouter quelque chose aux judicieuses observations que vous faites, dans votre feuille du 28 avril, au sujet des modifications que l’Angleterre fait subir à ses tarifs ?
[VII-97]
Vous envisagez cette réforme au point de vue spécial de l’influence qu’elle pourra exercer sur notre commerce. Vous faites remarquer que nos ventes dans le Royaume-Uni devront nécessairement s’accroître, puisque les droits d’entrée y seront considérablement réduits, quelquefois abolis sur une foule d’articles, tels que céréales, bestiaux, beurre, fromage, eau-de-vie, vinaigre, soieries, tissus de laine et de lin, peaux ouvrées, savons, chapeaux, bottes, horlogerie, carrosserie, ouvrages en métaux, cuivre, bronze, plomb ou étain, papiers de tenture, etc., etc.
Vous pensez, avec raison, que cette grande mesure aura pour effet de développer considérablement les échanges de la Grande-Bretagne avec les États continentaux.
Assurément, il n’est pas possible de douter que la réforme anglaise n’ouvre de nouveaux débouchés aux produits des autres peuples.
Mais qui s’emparera de ces débouchés nouveaux ? Il me semble évident que ce sont les nations qui les premières réformeront leurs propres tarifs.
Tout négociant sait que ce qui favorise ou entrave les exportations, c’est le plus ou moins de facilité à opérer les retours. Vendre pour de l’argent, c’est une demi-opération qui supporte les frais d’une opération entière, et qui, par ce motif, sourit beaucoup moins aux négociants qu’aux théoriciens de cabinet.
Je me ferai comprendre par un exemple.
Vous avez cité le beurre parmi les articles dont notre exportation pourra s’accroître.
Je suppose que deux navires entrent dans la Tamise, l’un venant de France, l’autre de Hollande, tous les deux chargés de beurre. Je suppose encore que le prix de revient soit identique.
Ici on pourra m’arrêter et me dire que de telles suppositions ne se réalisent jamais ; mais comme je cherche [VII-98] l’influence de deux systèmes de douane différents sur deux opérations analogues, je dois bien raisonner comme les géomètres, sur cette formule : toutes choses égales d’ailleurs.
Ainsi admettons qu’en entrant en rivière le beurre normand et le beurre hollandais reviennent à 100 fr. les 100 kilogr. ; admettons encore que le fret ajoutera 5 fr. à ce prix, et que les spéculateurs veulent faire un bénéfice de 10 p. 100.
Voici le compte du négociant français :
| Prix de revient du beurre | 100 | fr. |
| Fret | 5 | |
| Retour à vide du navire | 5 | |
| Bénéfice | 10 | |
| Total | 120 | fr. |
Au-dessous de ce cours, il y aurait perte, tout au moins absence de bénéfice, et ce genre de commerce ne pourrait continuer.
Voici maintenant le compte du négociant hollandais :
| Prix de revient du beurre | 100 | fr. |
| Fret | 5 | |
| Retour du navire : néant, puisque les frais en seront supportés par la cargaison au retour | 0 | |
| Bénéfice, comme ci-dessus | 10 | |
| Total | 115 | fr. |
Par où l’on voit que le Hollandais pourra établir le cours à 115 fr., gagner encore et chasser le Français du marché.
Et il le fera même nécessairement sous l’aiguillon de la concurrence que lui feront ses compatriotes.
Je pourrais, monsieur le Rédacteur, tirer de là bien des conséquences ; faire voir que le beurre français n’attendra pas d’être chassé des marchés anglais ; que par cela seul qu’il ne pourra s’y vendre, il ne sera pas produit en Bretagne et en Normandie ; qu’il y aura donc dans ces provinces [VII-99] moins de prairies artificielles et naturelles, moins de bestiaux, moins d’engrais, moins de capitaux engagés dans l’agriculture, etc., etc.
On me dira sans doute que, d’un autre côté, par cela seul que le navire français n’a pu rapporter de la toile et des rails, ces mêmes capitaux payeront des fileurs et des mineurs.
Reste à savoir si cet emploi forcé est plus avantageux que l’autre. Je me garderai bien d’entrer ici dans cette discussion, et je terminerai en faisant observer que le beurre n’a été pris que comme exemple ; ce que j’en ai dit s’applique à l’ensemble de nos transactions.
Après avoir montré l’influence de la réforme anglaise sur celles de nos industries nationales qu’elle semble d’abord devoir développer, il serait utile de rechercher la condition qu’elle prépare à nos productions les plus protégées. Ce sera peut-être l’objet d’un second article.
Agréez, etc.
References
[1] Journal des Débats du 2 mai 1846.(Note de l’édit.)
21. — DEUXIÈME LETTRE AU JOURNAL DES DÉBATS [1] , INSÉRÉE DANS LE NUMÉRO DU 11.↩
Monsieur le Rédacteur,
J’ai essayé de montrer par un exemple, et en évitant la dissertation, comment l’immense débouché qui va s’ouvrir dans la Grande-Bretagne aux produits européens ne profiterait guère qu’aux nations qui, les premières, modifieront leurs tarifs. Il est aisé de comprendre que les autres, réduites par la difficulté des retours à mettre au compte d’une [VII-100] demi-opération les frais d’une opération, seront hors d’état de soutenir la lutte.
Il suit de là que nos industries nationales, celles dont notre climat et notre génie favorisent le développement, gagneront moins qu’on ne devait s’y attendre à la réforme anglaise.
Comment s’en trouveront nos industries protégées ?
Si quelque chose m’étonne, c’est qu’elles n’aient pas déjà jeté leur cri d’alarme, car je les crois de beaucoup les plus menacées. D’où leur vient cette sécurité ? Est-ce confiance en elles-mêmes, est-ce découragement ?
Notre tarif actuel est calculé pour un ordre de choses qui évidemment va cesser. La protection qu’il a en vue est corrélative au prix qu’ont les choses au dehors ; or, ce prix venant à baisser, la protection deviendra naturellement inefficace.
Quand un homme rencontre une barrière, il a deux moyens de la surmonter : le premier, c’est de l’abaisser ; le second, c’est d’exhausser le sol autour d’elle.
Les Anglais ont devant eux la barrière de nos tarifs ; ils ne peuvent rien sur notre législation, et par conséquent il ne dépend pas d’eux de diminuer la hauteur absolue de l’obstacle. Que font-ils ? Ils en diminuent la hauteur relative, en accumulant à ses pieds des produits et en les allégeant ainsi dire d’une partie de leur prix.
Voyons comment les choses vont se passer.
Nous fabriquons un produit X pour…………… 150 fr.
Les Anglais peuvent vendre, à l’entrepôt, X à 100 fr.
L’État qui, selon l’expression de M. de Saint-Cricq, dispose des consommateurs et les réserve aux producteurs, frappe le produit anglais d’un droit de 50 fr, et rétablit ainsi, aux dépens du public français, ce qu’on appelle l’égalité des conditions.
Mais, sous le régime actuel des tarifs anglais, plusieurs [VII-101] éléments entrent dans ce prix de 100 fr. du produit X, lesquels vont disparaître par la réforme.
1o La matière première ne payera plus de taxe, ce qui permettra une réduction de 10 fr. peut-être à la vente.
2o La vie à bon marché, donnée au peuple, entraînera une baisse égale.
3o La facilité des retours, qui n’existe pas maintenant et que la réforme va conférer aux Anglais, peut équivaloir à une diminution de 5 fr.
C’est donc à 75 fr. au lieu de 100 fr. que le produit X pourra être livré dans notre entrepôt. Ajoutez-y les 50 fr. de droits, et vous n’arrivez qu’à 125 fr., le produit français restant toujours à 150 fr.
S’il veut être fidèle au principe de la protection, l’État devra donc élever le droit de 50 à 75 fr. Or, le droit de 50 fr. sur une marchandise de 100 fr. équivalait à 50 pour 100 ; celui de 75 fr. sur un produit de 75 fr. sera de 100 pour 100.
Par où l’on voit que si le prix baisse d’un quart, il faut que le tarif s’élève du double.
Les industries privilégiées peuvent donc préparer leurs armes, leurs manœuvres secrètes, leurs requêtes et leurs doléances.
Et le ministère aussi peut s’attendre à une laborieuse campagne. Déjà il a bien du mal à maintenir la trêve entre ceux qui profitent et ceux qui souffrent du régime protecteur ; que sera-ce, quand il sera tiraillé dans les deux sens opposés avec une double intensité ? quand les monopoleurs apporteront d’excellentes raisons pour motiver l’exhaussement du tarif, précisément à l’instant où, pour le faire abaisser, les consommateurs donneront de meilleures raisons encore ?
Mais, puisque j’ai nommé le consommateur, permettez-moi une réflexion.
Au point de vue des hommes qui se disent socialistes, [VII-102] j’encourrai, je le sens, un grave reproche pour avoir dit que la vie à bon marché, fruit de la réforme anglaise, se traduira en baisse du produit fabriqué.
« Vous voyez bien, diront-ils, que c’est toujours la guerre du riche contre le pauvre, du capital contre le travail. Voilà la secrète pensée des manufacturiers, le machiavélisme britannique qui se dévoile. Ce qu’on veut, c’est abaisser le taux des salaires, c’est se mettre en mesure de sous-vendre (undersell) tous les rivaux. L’ouvrier, c’est une machine dont on cherche un emploi plus économique, etc., etc. »
J’ignore si les Anglais ont fait ce calcul ; mais s’ils l’ont fait, j’admire leur philanthropie ; car, quoi de plus généreux que d’appeler le monde entier au bénéfice de leur réforme ? Si, à mesure qu’ils abrogent les taxes sur les matières premières, ou qu’ils réduisent le taux de la main-d’œuvre, ou qu’ils se mettent à même de naviguer à meilleur compte, ils abaissent proportionnellement le prix du produit ; s’ils font à l’acheteur une remise de 10 francs à raison de la première circonstance, de 10 francs pour la seconde, de 5 francs pour la troisième, — je le demande, qui donc, en définitive, recueillera le fruit de la réforme, le plus clair et le plus net de ses avantages ? n’est-ce pas l’acheteur, le consommateur, le Français, le Russe, l’Italien, l’homme rouge, noir ou jaune, quiconque, en un mot, n’est pas assez fou pour s’interdire, par d’absurdes tarifs, toute participation aux bienfaits de cette grande mesure ?
Et voilà, messieurs les Socialistes, la vraie fraternité, non point la fraternité fouriériste, mais la fraternité providentielle : que les nations ne puissent rien accomplir de grand et de beau, même dans des vues égoïstes, qui ne profite aussitôt à l’humanité tout entière.
J’aimerais à aborder ce vaste sujet, mais je ne dois pas abuser de votre complaisance et de la patience du lecteur.
[VII-103]
Sans vouloir faire ici du prospectus, me sera-t-il permis de dire qu’il est traité d’une manière générale dans un article du Journal des Économistes emprunté à l’Encyclopédie du dix-neuvième siècle, intitulé : De la concurrence.
References
[1] Reproduite par le Mémorial bordelais du 14 mai 1846.
22. — DU CHEMIN DE FER DE BORDEAUX À BAYONNE [1] .↩
(Lettre adressée à une commission de la Chambre des députés.)
Messieurs,
Les partisans du tracé direct et ceux du tracé courbe ont beau s’évertuer, il n’y a de part et d’autre qu’un argument sérieux.
Les premiers disent : Notre ligne est plus courte de 29 kilomètres.
Les seconds répondent : La nôtre dessert une population quatre fois plus dense.
Ou, sous la forme agressive, les uns :
Votre tracé courbe renchérit les transports pour les points extrêmes ;
Les autres : Votre tracé direct passe dans le désert et sacrifie tous les intérêts du pays.
La question ainsi posée, on comprend quelle importance les partisans de la ligne directe devaient attacher à prouver, d’une part, que le désert n’est pas aussi désert qu’on le suppose ; de l’autre, que les vallées ne sont ni aussi riches ni aussi peuplées qu’on le dit.
C’est l’argumentation à laquelle a eu recours la commission d’enquête des Basses-Pyrénées, et, dans [VII-104] l’impartial exposé des motifs de M. le Ministre des travaux publics, on la voit reproduite en ces termes :
« Il convient de remarquer que, dans les cantons des grandes Landes, la population s’est constamment accrue, depuis quarante ans, dans une proportion moyenne de 50 pour 100 ; tandis que dans les vallées elle est demeurée stationnaire et même a décru sur quelques points. »
J’ai lieu de croire que le fait qu’on invoque a été puisé dans un mémoire que j’ai publié sur la répartition de l’impôt dans le département des Landes, mémoire qu’on ne manquera pas sans doute de faire passer sous vos yeux. Il doit donc m’être permis de protester contre l’usage étrange qu’on en prétend faire. Je n’ai pas la prétention de plaider pour ou contre une des deux lignes rivales, mais j’ai celle de m’opposer à ce que, pour éloigner le chemin de nos vallées, on fasse argument de tout, même de leurs souffrances.
Tout homme qui s’est occupé du vaste sujet de la population sait qu’elle croît plus rapidement, d’ordinaire, dans les pays où elle est rare que dans ceux où elle a atteint une grande densité. Dire que c’est là un motif pour accorder la préférence aux premiers, en fait de chemin de fer, c’est dire qu’ils sont plus utiles en Russie qu’en Angleterre, et dans les Landes que dans la Normandie.
Ensuite on a généralisé un fait local. Il n’est pas vrai que la population diminue dans la vallée de la Garonne, de la Midouze et de l’Adour. Elle y croît lentement, il est vrai, précisément parce qu’elle y est très pressée.
Ce qui est vrai, ce que je ne rétracte pas, c’est que, dans un petit pays, qu’on nomme la Chalosse, situé sur la rive gauche de l’Adour, et spécialement dans quatre à cinq cantons vinicoles de cette province, le nombre des décès surpasse régulièrement, depuis vingt ans, le nombre des naissances.
[VII-105]
C’est là une perturbation déplorable, un phénomène unique dans le siècle, et il ne se montre nulle part, pas même en Turquie. Pour savoir ce qu’on en doit conclure, relativement à la question qui nous occupe, il ne suffit pas de constater le fait, il faut encore le rattacher à sa cause.
La population a décru, disent les commissaires enquêteurs. Ce mot est bientôt prononcé. Ah ! ils ne savent pas tout ce qu’il implique ! Ils n’ont pas assisté à ce douloureux travail par lequel s’accomplit une telle révolution ! Ils ne savent pas ce qu’elle suppose de souffrances morales et physiques. Je vais le leur dire. C’est une funèbre histoire, mais elle est pleine d’enseignement.
La Chalosse est un des pays les plus fertiles de la France.
Autrefois, on y récoltait des vins qui descendaient l’Adour. Une partie se consommait aux environs de Bayonne ; l’autre s’exportait au nord de l’Europe. Ce commerce extérieur occupait à Bayonne l’activité et les capitaux de dix ou douze maisons honorables, dont un de vos collègues, M. Chégaray, pourrait au besoin citer les noms.
À cette époque les vins avaient une valeur soutenue. L’aisance s’était répandue dans le pays, et avec elle la population. L’étendue des métairies s’était naturellement restreinte ; elles ne comportaient pas plus de deux à trois hectares. Chacune de ces petites exploitations, travaillée comme un jardin, fournissait à une famille des moyens assurés d’existence. Les revenus des propriétaires et des métayers faisaient vivre une classe nombreuse d’artisans, et l’on conçoit à quel degré de densité la population avait dû parvenir sous ce régime.
Mais les choses ont bien changé !
La politique commerciale qui a prévalu parmi les peuples a fermé à la Chalosse ses débouchés extérieurs. L’exportation a été, je ne dirai pas réduite, mais détruite, complétement anéantie.
[VII-106]
D’un autre côté, le système des contributions indirectes a beaucoup restreint ses débouchés intérieurs. En affranchissant de l’impôt de consommation, en faveur du propriétaire, le vin récolté sur son fonds, il a altéré, en matière de viniculture, la division du travail. Il a agi comme ferait une loi qui porterait : « Le pain sera soumis à un impôt, excepté celui que chacun fera dans son ménage. » Évidemment une telle disposition tendrait à détruire la boulangerie.
Enfin, l’Adour cesse graduellement d’être navigable. Des documents authentiques constatent que les bateaux remontaient jusqu’à Aire. — Les vieillards du pays les ont vus aller à Grenade ; je les ai, moi-même, vus charger à Saint-Sever. Maintenant ils s’arrêtent à Mugron, et d’après les difficultés qu’on éprouve à les y conduire, il est aisé de prévoir que dans peu ils ne dépasseront pas le confluent de la Midouze.
Je n’ai point à raisonner sur les causes. Elles existent, c’est positif. Quels ont été les effets ?
D’abord de diminuer le revenu des propriétaires ; ensuite de rendre la part du métayer insuffisante pour son existence et celle de sa famille. Il a donc fallu que, sur ce qui lui restait de revenu, le propriétaire fît un fort prélèvement pour parfaire au métayer ce qui est rigoureusement nécessaire au maintien de la vie. L’un a été ruiné. Vainement il a lutté contre les séductions du luxe dont le siècle l’entoure de toute part ; vainement il s’est imposé les plus durs sacrifices, la parcimonie la plus minutieuse, il n’a pu échapper aux cuisantes douleurs qui accompagnent une dégradation inévitable.
Le métayer n’a plus été un métayer ; sa part colonne ne servant qu’à diminuer sa dette, il est devenu un journalier auquel on donne pour tout salaire une ration quotidienne de maïs.
En d’autres termes, on a reconnu que l’étendue des [VII-107] exploitations, bonne pour d’autres circonstances, était maintenant trop bornée ; et en ce moment il s’opère, dans la constitution agricole du pays, une révolution remarquable.
Les vins n’ayant plus de débouchés, deux hectares de vigne ne peuvent plus constituer un corps d’exploitation. Il y a tendance manifeste à organiser la propriété sur d’autres bases. De deux métairies de vigne, on en fait une qui renferme une juste proportion de labourables. On comprend que, sous l’empire des causes énumérées, ce n’est plus deux ou trois hectares qu’il faut, mais cinq ou six pour faire vivre une famille de métayers. Là aussi on fait des fusions, mais des fusions qui altèrent les sources de la vie.
Dans la commune que j’habite, trente maisons de métayers ont été démolies depuis le cadastre, et plus de cent cinquante dans le canton dont les intérêts judiciaires me sont confiés ; et remarquez ceci, ce sont autant de familles vouées à une complète destruction. Leur sort est de souffrir, décliner et disparaître.
Oui, la population a diminué dans une partie de la Chalosse, et j’ajouterai, dût-on retourner contre elle cet aveu, que cette dépopulation, si elle accuse notre détresse, est bien loin d’en donner la mesure. Si vous parcouriez mon malheureux pays, vous apprendriez combien les hommes peuvent souffrir sans mourir, et qu’une vie de moins sur vos froides statistiques est le symptôme d’incalculables tortures.
Et maintenant ce sont nos souffrances qu’on invoque contre nous ! Et pour nous refuser des débouchés, on nous parle des douleurs que le défaut des débouchés nous inflige ! — Encore une fois, je ne me prononce pas sur le tracé du chemin de fer. Je sais que les intérêts de la Chalosse pèseront bien peu dans la balance. Mais, si je ne m’attends pas à ce qu’ils soient un argument pour le tracé des vallées, je ne veux pas qu’on en fasse un argument contre, parce qu’un tel argument est [VII-108] aussi faux que cruel. N’est-ce point, en effet, une impitoyable cruauté que de venir nous dire : « Vous avez un beau ciel, un sol fécond, de fraîches vallées, des coteaux sur lesquels le travail de vos pères avait répandu l’aisance et le bonheur. Grâce à ces dons de la nature et de l’art, votre population était aussi pressée que dans nos plus riches provinces. Les débouchés vous ont fait défaut tout à coup, et la détresse a succédé à l’aisance, les larmes aux chants de joie. Or, pouvant disposer d’un immense débouché, nous ne savions encore si nous en doterions le désert ou si nous le mettrions à votre portée. Vos souffrances nous décident. Elles sont bien avérées ; le pouvoir lui-même les a constatées, par ces expressions laconiques : ce n’est rien, c’est la population qui diminue. Il n’y a rien à répliquer à cela ; et nous voilà bien décidés à rejeter le chemin dans la grande Lande. Cette détermination, en ruinant toutes vos villes, accélérera la dépopulation qui vous attriste ; mais la chance de peupler le désert ne vaut-elle pas bien la certitude de dépeupler les vallées ? »
Ah ! Messieurs, donnez au chemin la direction que, dans votre sagesse, vous jugerez la plus utile à l’intérêt général ; mais si vous en frustrez notre vallée, ne dites pas dans vos considérants, comme on vous y engage, que ce sont ses malheurs, et ses malheurs seuls, qui vous déterminent.
References
[1] Mémorial bordelais, du 19 mai 1846, reproduisant la Patrie.
23. — AUX MEMBRES DE L’ASSOCIATION POUR LA LIBERTÉ DES ÉCHANGES [1] .↩
Mes chers Collègues,
Quelques esprits ardents s’affligent de ce que l’Association parisienne a fait si peu de progrès. Je voudrais les [VII-109] convaincre qu’ils se pressent trop de désespérer. Paris offre tous les éléments de succès. Sans doute le travail de cohésion et d’organisation est lent ; il peut être souvent interrompu par les circonstances, comme il l’est maintenant par les élections générales, qui absorbent à bon droit l’attention publique ; mais l’œuvre sera reprise en temps opportun, et le triomphe en est assuré.
Eh quoi ! Une noble et belle cause peut-elle faillir quand elle rallie toutes les fortes intelligences d’une époque, toutes les illustrations, toutes les renommées, tous les titres que le génie élève au-dessus du siècle !
J’exposerai devant vous le dénombrement de nos forces, et vous verrez s’il y a lieu de désespérer.
Si l’on vous demandait quel est l’homme qui léguera à nos annales la renommée parlementaire la plus solide et la plus pure ; qui, par la hauteur de ses vues, la constance de ses convictions, plus encore que par l’éclat de son nom, s’est élevé au plus haut degré d’influence qu’on puisse acquérir en dehors du pouvoir, vous nommeriez l’illustre pair qui a consacré sa vie à l’abolition de l’esclavage ; mais vous ne seriez pas étonné d’apprendre qu’il n’est pas moins favorable à l’abolition du monopole ; car l’esclavage et le monopole reposent sur le même principe.
Si l’on vous demandait :
Quel est le poëte du sentiment, qui a fait vibrer dans nos cœurs les cordes les plus intimes et les plus mystérieuses ?
Quel est le poëte du peuple, dont les chants, aux jours de notre jeunesse, pénétraient comme un fluide puissant et rapide dans toutes les couches de la société ?
Quel est le prosateur inimitable, ou plutôt le poëte des idées, qui a su jeter sur le monde des abstractions le manteau d’un style à la fois simple, gracieux, touchant, énergique, expression d’une belle âme tourmentée par l’inquiétude du génie ?
[VII-110]
Quel est le savant qui, soumettant les élans de l’imagination aux lois du calcul, a sondé le plus avant la mystérieuse profondeur des harmonies célestes, pour venir ensuite distribuer la science aux profanes, sous les formes les plus accessibles ?
Quel est l’orateur, quelle que soit sa bannière, qui a fait revivre à notre tribune nationale les traditions des Foy et des Mirabeau ?
Quel est l’homme d’État, quelque opinion qu’on se fasse de sa pensée politique, qui, par l’éloquence et le caractère, a su la faire dominer sur un peuple encore tout frémissant des agitations et des espérances de Juillet ?
Quel est l’heureux du siècle à qui une habileté d’un autre ordre, qui a aussi son génie, a fait donner le nom de roi de la finance ?
Vous répondriez : C’est le duc de Broglie, c’est Lamartine, Béranger, Lamennais, Arago, Berryer, Guizot, Rothschild, qui tous, avec des vues diverses, souvent opposées, ont marché, chacun dans sa voie, jusqu’aux bornes qui semblent assignées au domaine intellectuel de notre époque.
Eh bien ! Messieurs, une cause est-elle perdue, quand elle a pour elle des autorités si imposantes, et auxquelles leur diversité même communique une force irrésistible ?
Je ne veux pas dire que tous ces personnages illustres prendront une part directe à notre association, mais je sais que tous adhèrent à son principe et nous entourent de leur sympathique assentiment [2] .
Que les monopoleurs, armés du télescope, cherchent donc [VII-111] dans tout l’horizon intellectuel une petite étoile pour faire équilibre à cette écrasante constellation.
On dit qu’ils ont pour eux M. Thiers. C’est beaucoup ; mais, en vérité, cela ne suffit pas.
À cette nomenclature assez rassurante, et que j’aurais pu allonger beaucoup, se joint un autre symptôme encore plus propre peut-être à vous inspirer de la confiance. Je veux parler du mouvement qui s’est opéré dans la presse française.
L’opinion des journaux fait-elle celle des abonnés, ou celle des abonnés fait-elle celle des journaux ? ou bien, ce qui est plus probable, exercent-elles l’une sur l’autre une action réciproque ? Quoi qu’il en soit, et dans toutes les hypothèses, un principe est bien près de son triomphe quand on voit tous les journaux venir l’un après l’autre se ranger sous son drapeau.
Vous avez vu l’attitude ferme et décidée qu’a prise le Journal des Débats, cette feuille qui, par ses relations, le public auquel elle s’adresse, le mérite de sa rédaction, est une des grandes forces du pays, presque un des pouvoirs de l’État, sinon défini par la Charte, du moins écrit dans les faits. — Le Journal des Débats est pour vous.
Le Courrier français, qui n’a d’engagements avec aucun parti, est pour vous. C’est une sentinelle avancée, courageuse et même un peu aventureuse, telle qu’il en faut à une doctrine qui sort de l’abstraction pour entrer dans la carrière militante.
La Patrie est pour vous. Les journaux qui se forment ou se reforment, comme le Commerce et l’Océan, cherchent un abri sous votre bannière.
La Réforme ne ment pas à son titre : elle est pour vous.
La Démocratie pacifique est pour vous. Sans doute la liberté d’échanger n’a qu’une importance secondaire à ses yeux auprès de la merveilleuse organisation qu’elle rêve et qui doit [VII-112] effacer tous les péchés du monde ainsi que toutes ses misères ; mais elle convient que, pour être maîtres de s’associer, les hommes doivent au moins s’appartenir à eux-mêmes ; d’où il suit que la lutte contre le monopole doit précéder le travail de l’organisation.
Il est un journal que je regrette de ne pas voir dans nos rangs et au premier rang, c’est le National. Quoique cette feuille soit l’organe d’un parti, elle est considérée dans tous, à cause du mérite transcendant de ses écrivains et de sa réputation bien établie d’indépendance et d’austérité politique. Je sais que le National est favorable à la liberté commerciale comme à toutes les libertés. S’il ne descend pas dans la lice, cela tient à ses vues sur la politique générale de l’Europe, qui lui font penser que le moment n’est pas venu où la France pourrait, sans péril, s’engager par les liens du commerce avec des puissances oligarchiques ou absolues, hostiles aux principes de notre révolution. Mais, quoi ! les nations les plus avancées en industrie ne sont-elles pas les plus éclairées en politique ? — Et le commerce libre, ce grand distributeur des produits, n’est-il pas aussi le grand propagateur des idées ?
Enfin, si je jette un coup d’œil sur la presse départementale, je n’y vois aucun motif de découragement. Les trois grands journaux de Bordeaux défendent énergiquement notre principe. Le Courrier de Marseille consacre à cette cause un talent de premier ordre. Le Sémaphore suit la même voie ; je ne connais qu’un journal à Lyon, et il est pour nous, ainsi que le Journal du Havre, qui a acquis en ces matières une grande autorité.
Tel est, dans la presse française, le dénombrement de nos forces. Quels sont nos adversaires ? La Presse et le Constitutionnel. Encore ces deux journaux s’accordent-ils à reconnaître la vérité et la justice de notre doctrine. Ils se bornent à en ajourner indéfiniment l’application. En principe, [VII-113] disent-ils, vous avez raison. Ah ! ils ne comprennent pas sans doute toute la portée d’une telle concession ! Nous avons raison en principe ! Et qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que la restriction est un système faux et oppressif ; — donc il faut le renverser. Cela veut dire que le monopole est une injustice, une spoliation, un déplacement forcé et violent de la richesse, transportée des uns aux autres sans compensation ; — donc il faut rétablir le règne de la justice et de l’intégrité du droit de propriété. Cela veut dire que la protection est une illusion, une déception, qu’elle opprime le travail en prétendant le favoriser ; que ses effets sont directement contraires à ses promesses ; qu’elle retranche au bien-être des masses et porte ainsi atteinte à leur dignité et à leur moralité.
Voilà ce qui est impliqué dans cet aveu : La liberté des échanges est vraie en principe ; car elle serait fausse en théorie comme en pratique, s’il était au pouvoir de la restriction de faire plus de bien que la liberté. Aussi les journaux auxquels je fais allusion ne pourront pas tenir longtemps la position qu’ils ont prise. Les principes ont d’autres exigences, et les abonnés aussi. Ce n’est pas impunément qu’on peut dire longtemps à un principe (c’est-à-dire à la vérité) : « Je te respecte et te salue, mais je te tourne le dos. » Il vient un moment où le lecteur voit une insulte dans ce langage [3] .
References
[1] Mémorial bordelais du 14 juin 1846.
[2] Aucun de ces personnages ne fit partie de l’association pour laquelle, dans des conversations particulières, ils n’avaient pas hésité à témoigner de la bienveillance. La plupart n’avaient pas assez étudié la question, et les plus compétents n’étaient pas assez convaincus pour embrasser ouvertement la cause du libre-échange, sans s’inquiéter des obstacles qui pouvaient en retarder le triomphe.(Note de l’édit.)
[3] On vient de voir l’auteur, s’adressant à ses collègues, manifester une ferme espérance. Dans la pièce suivante, no 24, il emprunte, pour s’adresser à un ministre, le fier langage d’Achille. Sa lettre à M. Duchâtel eut des résultats bien divers, sur lesquels les pages 73 et 74 du tome Ier fournissent des renseignements.(Note de l’édit.)
[VII-114]
24. — À M. TANNEGUY DUCHATEL, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR [1] .↩
Monsieur le Ministre,
Un bruit assez étrange est venu jusqu’à moi,
Seigneur ; je l’ai jugé trop peu digne de foi.
On dit, et sans horreur je ne puis le redire,
Que la Ligue aujourd’hui par vos ordres expire.
Serait-il vrai que vous vous efforciez d’anéantir l’Association pour la liberté des échanges, vous qui avez écrit ces lignes :
« Nous défendons, avec nos propres intérêts, ceux des consommateurs en général, et ceux de toutes les branches d’industrie auxquelles les prohibitions enlèvent de vastes débouchés. Entre tous ces intérêts doit se former une ligue puissante, dont les vœux n’appellent ni priviléges ni monopoles, mais se bornent à réclamer les bienfaits de la libre concurrence, le naturel développement de la prospérité générale. »
Mais non ; j’aime mieux croire qu’en entourant le berceau de la Ligue, — de votre ligue, — d’une feinte persécution, vous avez voulu lui donner un ingénieux témoignage de votre sympathie.
Que deviendrait-elle, en effet, sans cet adroit stimulant ? l’économie politique est une belle science, mais elle n’a rien de gai et de bien saisissant. Livrée à elle-même, notre agitation commerciale aurait conservé son caractère scientifique et se serait vue reléguée dans la région glacée de la dissertation. Chez nous, elle ne se mêle pas, comme en Angleterre, à l’éternelle lutte du peuple contre l’aristocratie. Là, le [VII-115] monopole est une des formes de l’oppression féodale, et la résistance qu’on lui oppose a quelque chose de cette ardeur fiévreuse qui, en 89, faisait battre le cœur de nos pères. Ici, il n’est qu’un faux système ; et qu’opposer à un faux système, si ce n’est la froide argumentation ? De l’autre côté du détroit, le privilége retranche directement sur la subsistance du peuple pour ajouter au faste des grands, semant dans les masses la misère, l’inanition, la mort et le crime. C’est donc une de ces questions de charité immédiate si propres à éveiller la sympathie du beau sexe, et les agitateurs anglais trouvaient, jusque dans le cœur des femmes, le plus puissant des encouragements et la plus douce des récompenses. Mais, chez nous, comment intéresser le peuple au syllogisme et les dames à la balance du commerce ?
Il est vrai qu’elles font, dans leur ménage, de l’économie politique, et de la plus orthodoxe encore. On leur entend dire souvent : Je renonce au tricot, parce que c’est une manière dispendieuse d’acheter des bas ; si je fais de la tapisserie, c’est que cela m’amuse, et je sais que j’y perds. — Hélas ! il est triste de penser qu’il nous faut, vous et moi et bien d’autres, accumuler des volumes pour démontrer aux savants ce que comprennent de simples femmes, et pour prouver que l’économie des nations est fondée sur le même principe que l’économie des ménages !
Il n’en reste pas moins que notre théorique association devait résolûment renoncer à ces ovations qui, d’ordinaire, accompagnent les réformateurs et soutiennent leur courage. Une seule porte pouvait laisser arriver jusqu’à nous la sympathie populaire, vous l’avez compris sans doute, et c’est pour cela que vous avez voulu l’ouvrir, — c’est la porte de la persécution. La persécution ! Ah ! l’apôtre qui se dévoue à un principe ne la recherche pas ; mais il ne la craint pas non plus. Peut-être la désire-t-il, dans le secret de son cœur, car il sait bien qu’elle est le précurseur et le gage du succès.
[VII-116]
Si c’est de la stratégie, de la diplomatie de vieil économiste, elle est fort adroite, sans doute ; mais n’offre-t-elle pas quelques dangers ?
Il y avait au fond de nos codes une loi si odieuse, si exorbitante, que vous n’osiez pas vous en servir. Vous craigniez qu’à sa première apparition, la réprobation publique n’en demandât le retrait ; et vous préfériez la laisser sommeiller, inerte, inefficace, la réservant pour ces cas rares où l’horreur du crime fait oublier le danger de la précaution. Cette loi, en voici le texte :
« Nulle association, etc., ne pourra se former qu’avec l’agrément du Gouvernement, et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer à la société. »
Ce qui veut bien dire : En fait d’association, il n’y a pas de loi, il n’y a que le bon plaisir du ministre.
Voilà où en est la grande nation de 89 et de 1830 ! Voilà le respect qu’obtient chez nous la dignité de l’homme !
Cependant l’Association parisienne pour la liberté des échanges avait déclaré qu’elle n’agirait jamais que par les voies légales. En conséquence, elle vous demanda l’autorisation et les conditions qu’il vous plairait de lui imposer. Beaucoup l’ont blâmée ; pour moi, je l’approuve, et cette ligne de conduite me semble toujours avantageuse ; car de deux choses l’une : ou l’on rencontre une loi juste et prudente, et alors quel motif de ne pas s’y soumettre ? ou l’on se heurte contre une mesure arbitraire, inique, dégradante, et, en ce cas encore, en exiger la stricte application, c’est le meilleur moyen d’en exposer au grand jour les inconvénients et de la frapper de l’animadversion publique.
Voyez en effet ce qui est arrivé. Je vous laisse à juger, monsieur le Ministre, si, après cette expérience, l’article 291 peut longtemps défigurer nos codes.
Il y a deux classes d’industriels en France : les uns prétendent que leur travail laisse naturellement de la perte, et [VII-117] ils veulent être autorisés à la combler par une taxe sur les consommateurs. (C’est vous qui l’avez dit : mémoire sur le système des douanes, page 6.) — Les autres demandent que chacun soit propriétaire de ses propres facultés et de leur produit. Ils soutiennent que la nation ne doit payer de taxes que pour faire face aux services publics.
La question ne pouvait être loyalement portée qu’au tribunal de l’opinion ; et vous, Monsieur, qui avez jadis provoqué l’existence de la Ligue, vous deviez au moins rester neutre.
Eh bien ! les monopoleurs s’associent en toute liberté. Ils s’organisent comme ils l’entendent ; ils se coalisent ; ils ont des réunions, des comités, des journaux, un système de contributions qui fonctionne aussi régulièrement que celui de votre collègue des finances. Grâce à ces ressources, au jour marqué, et quand ils le jugent utile à leurs intérêts, la foule de leurs délégués accourt de tous les points du territoire vers le centre du Gouvernement ; elle le circonvient, elle obsède l’administration, elle pèse d’un poids immense sur les résolutions des pouvoirs publics, et il n’y a pas de législature qui ne se voie contrainte de lui prodiguer les deniers des contribuables.
D’un autre côté, les amis de la liberté et de la justice demandent bénévolement à s’associer aussi. Ils n’aspirent qu’à discuter leurs droits, à répandre l’information, à éclairer les esprits. Que les deux systèmes soient admis à se faire écouter, disent-ils : si le nôtre est faux, il succombera ; s’il est vrai, n’est-il pas juste qu’il triomphe ?
Et vous nous refusez l’autorisation !… Ah ! monsieur le Ministre, prenez garde et voyez sur quel terrain vous transportez le débat. Entre vous et nous, il n’est pas question de liberté commerciale ; c’est une lutte que nous soutiendrons contre les monopoleurs et dont l’opinion sera juge. Ce que nous vous demandons, c’est de tenir la balance égale, [VII-118] de ne pas nous fermer la bouche, de ne pas nous accabler seuls sous les pouvoirs exorbitants que la législation ne vous a pas confiés à cette fin. Si, pour arriver à faire prévaloir nos droits de contribuables, nous sommes réduits à défendre d’abord nos droits de citoyens ; s’il nous faut préalablement discuter et renverser l’article 291 et sa lignée de septembre, nous sommes prêts. Odieuses en elles-mêmes, l’usage que vous faites de ces armes achèvera de les discréditer, et nous les briserons dans vos mains.
Mais, en même temps, nous ne méconnaîtrons pas le service que vous rendez à notre cause. Combien d’auxiliaires inattendus ne poussez-vous pas sous notre drapeau ! La presse opposante y accourra toute entière. Elle hésitait ; ses convictions économiques, à ce qu’il semble, sont encore douteuses. Ce combat d’avant-garde la fera arriver dans nos rangs, et elle y restera ; car elle apprendra qu’on y respire l’air de la justice et de la liberté.
Je suis, monsieur le Ministre, votre serviteur.
References
[1] Mémorial bordelais du 30 juin 1846. (Note de l’édit.)
25. LA LOGIQUE DU MONITEUR INDUSTRIEL [1] .↩
Le Moniteur industriel, toujours fidèle au monopole, commente aujourd’hui la déclaration de l’Association du libre-échange. Après avoir dit qu’elle tient compte de quelques idées générales dont il ne conteste pas la justesse, il ajoute qu’elle ne tient pas compte de la vie réelle ; d’où il suit, selon lui, qu’il y a incompatibilité entre la vie et les idées. Sous l’influence de cette pensée, le Moniteur affirme que la déclaration est bonne pour l’Académie des sciences [VII-119] morales, mais détestable pour le régime d’un peuple raisonnable ; d’où il suit encore qu’il y a incompatibilité entre l’Académie et la raison.
Le Moniteur résume ainsi sa théorie :
« Ce qui doit nous préoccuper, c’est de développer, c’est « de doubler, c’est de quadrupler, si nous le pouvons, toutes nos industries. Est-ce que, si nous parvenions à quadrupler toutes nos industries, nous ne serions pas dix fois plus riches ? »
Voilà donc le Moniteur fouriériste et entiché du quadruple produit, avec cette variante que, d’après lui, quatre fois plus de produits donnent dix fois plus de richesses ! — Et ces messieurs nous appellent utopistes ! Et ils nous reprochent de n’avoir pas mis de chiffres dans notre manifeste !
J’en pourrais, par malheur, faire d’aussi méchants,
Mais je me garderais de les montrer aux gens.
Cependant accordons au Moniteur qu’il serait bon de quadrupler toutes nos industries. Et qui en doute, alors même que nos richesses n’en seraient pas décuplées ? — Reste à savoir si le moyen proposé par le Moniteur est bon, et si les industries se peuvent quadrupler toutes à la fois, par la vertu du pillage qu’elles exercent les unes sur les autres.
Supposons vingt-quatre industries, autant que de lettres dans l’alphabet. Leurs profits sont divers : A gagne énormément, B beaucoup, C joliment, D moins, et ainsi de suite jusqu’à Y, qui joint à peine les deux bouts, et Z qui est en perte.
Dans cette situation, Z demande à prélever une petite somme sur les profits de chacune de ses sœurs, par une taxe directe, sous le nom de prime, ou par un impôt déguisé sous le nom de protection, de manière, non seulement à ne plus perdre, mais à quadrupler son importance.
[VII-120]
La plus grande des niaiseries imaginables serait de voir là un profit général, car l’importance de Z ne s’accroît qu’en diminuant celle de toutes les autres industries. Y, en particulier, qui était sur la limite de la perte, y entre de plein saut.
Y a la ressource de demander l’autorisation de piller ses vingt-trois sœurs, y compris Z.
C’est le tour de X de tomber dans le domaine de la perte. Nouveau recours au pillage, qui entraîne V, puis U, puis T, jusqu’à ce que toutes les sœurs se ruinent les unes par les autres.
Alors le système est complet, et on se flatte d’avoir quadruplé toutes les industries.
Messieurs du Moniteur, de grâce, prouvez-nous une fois pour toutes que par la restriction nous pillons l’étranger. Nous examinerons alors la question de justice nationale, mais nous nous avouerons battus sur celle du profit national.
Que si cette portion de bénéfice procuré par la protection à un Français est payée exclusivement par d’autres Français, cessez de nous le présenter comme un bénéfice net, clair, liquide, national. C’est là qu’est la déception, c’est là que nous vous ramènerons sans cesse.
Il y a, dans l’article du Moniteur, un autre sophisme qui est du reste fort répandu et que, par ce motif, nous relèverons ici. Il consiste à assimiler le commerce à la guerre et les échanges de produits aux échanges de coups de poing.
Après avoir rabaissé humblement la France et exalté la supériorité infinie de l’Angleterre, le Moniteur s’écrie :
« Voilà Goliath et David en présence. Eh bien ! pour égaliser leurs forces, on propose à David de laisser là sa fronde et d’aller se colleter avec Goliath. Quelle économie politique ! »
C’est le Moniteur qui fait cette exclamation à notre endroit, et non nous au sien.
[VII-121]
On pourrait aisément s’y tromper.
Eh ! qui parle à David de s’aller colleter avec Goliath ? Ce que nous disons à David, c’est ceci :
« Mets tes forces et ton temps à faire une chose, à moins que Goliath ne te la cède en échange d’une autre chose qui te coûtera moins de temps et de forces. »
Il s’agit de commerce, et non de pugilat.
« Est-ce que dans l’industrie, dit le Moniteur, les plus forts n’ont pas toujours tué les plus faibles ? »
Non pas que nous sachions. En guerre, les plus forts tuent les plus faibles. En industrie, ils les servent en leur épargnant une inutile déperdition de travail. — Je voudrais bien savoir si l’auteur de l’article auquel je réponds l’a lui-même imprimé. Non sans doute, et il n’en est pas mort. Pourquoi ? C’est qu’en fait d’imprimerie, auprès de lui, M. Lange est un Goliath ; et ce Goliath n’a pas tué David, il lui a au contraire rendu service. Messieurs, je vous en prie, ne commençons pas par confondre les échanges avec les coups, si nous ne sommes pas décidés à déraisonner tout du long.
Le Moniteur termine par un argument qui aspire à soulever contre nous les ouvriers ; et cet argument, chose singulière, il le ruine lui-même. Voici comment il s’exprime :
« L’autre jour, à Elbeuf, une machine qui pouvait faire le travail de vingt ouvriers, mais qui ne remplaçait pas vingt ouvriers, et qui devait au contraire augmenter le nombre des ouvriers dans l’atelier de M. Aroux, a provoqué une émeute ; et vous osez proposer des doctrines qui, réduites en lois, jetteraient sur le pavé et condamneraient à la faim et à la mort plus tard des milliers d’ouvriers ! »
À présent je reconnais que la lutte est sérieusement engagée entre le monopole et la liberté, puisque le monopole, faisant appel aux préventions de l’ignorance, nous place et se place lui-même sur le cratère enflammé de l’émeute. J’avais toujours pensé qu’il en viendrait là, que ce serait son [VII-122] suprême argument, et qu’après avoir abusé de la loi, il abuserait de la force brutale. Il le fait, il faut le dire, avec maladresse. Il parle d’une machine qui, faisant l’ouvrage de vingt ouvriers, doit néanmoins en augmenter le nombre, et cela dans l’atelier même où elle est employée. Nous n’allons pas aussi loin. Nous ne nions pas que les machines, comme la liberté, ne déplacent du travail. Nous disons seulement qu’en tenant compte des épargnes qu’elles procurent aux consommateurs, épargnes qui payent d’autre main-d’œuvre, dans l’ensemble, elles favorisent le travail plus qu’elles ne lui nuisent. — Autant en fait la liberté. — La thèse du Moniteur donne de l’à-propos à un article de M. Goudroy, inséré dans le Mémorial du 12 juin. Nous le recommandons à MM. les manufacturiers. Qu’ils sachent bien une chose : l’échange et les machines, pour le bien et pour le mal, opèrent exactement de même. Relativement aux ouvriers, l’étranger est une machine économique, comme la machine est un concurrent étranger. En soulevant contre nous la classe ouvrière, les fabricants la soulèvent donc, et plus immédiatement, contre eux-mêmes ; car elle est plus près des ateliers où fonctionnent les machines que du cabinet où s’élabore la pensée de l’économiste.
References
[1] Mémorial bordelais du 1er juillet 1846. (Note de l’édit.)
26. — TOAST PORTÉ AU BANQUET OFFERT À COBDEN PAR LES LIBRE-ÉCHANGISTES DE PARIS [1] .↩
Frédéric Bastiat : Aux défenseurs de la liberté commerciale dans les deux Chambres !
Messieurs, le grand principe de vérité et de justice, auquel cette réunion a pour but de rendre hommage, vient [VII-123] d’acquérir, par les dernières élections, de nouveaux et zélés défenseurs. Félicitons-les des circonstances favorables qui accompagnent leur entrée au parlement. Jamais, peut-être, un pareil avenir ne s’ouvrit à des cœurs animés d’une plus généreuse ambition. Ils arrivent avec des noms que je ne reproduirai point dans cette enceinte, parce qu’ils sont précédés d’une renommée européenne. Au dedans des Chambres, ils ne seront point accueillis avec cette froideur calculée et cet esprit de raillerie intéressé que rencontraient jusqu’ici les promoteurs de la moindre réforme économique. Au dehors, une association naissante s’apprête à créer autour d’eux l’appui d’une formidable opinion publique. L’Europe, l’Amérique, l’Asie même, travaillent à l’envi à accomplir cette grande révolution sociale qu’ils ont si souvent appelée de leurs vœux. Voilà les circonstances dans lesquelles la confiance du pays leur offre l’occasion d’aborder la tribune française, cette chaire du monde intellectuel, où il leur sera peut-être donné de consommer la grande œuvre dont ils jetèrent les bases dans leurs écrits. Mais, si la gloire les attend, une grande responsabilité leur incombe. La France et le monde exigent d’eux d’être, par leur zèle, leur courage, et, s’il le faut, par leur abnégation, au niveau de la mission qui leur est confiée. J’ai la confiance qu’ils ne tromperont aucune des espérances qui reposent sur leur tête.
Mais, en félicitant les nouveaux députés sur le bonheur des circonstances qui les entourent, n’oublions pas de payer un juste tribut d’admiration et de sympathie à ces vétérans du libre-échange, dont quelques-uns sont présents à cette assemblée, et qui, depuis bien des années, soutiennent dans les deux Chambres le poids d’une lutte inégale ; à ces hommes dont on peut dire, sans rien exagérer, qu’ils se sont faits volontairement les martyrs de leurs profondes et honnêtes convictions. Leur tâche, Messieurs, a été bien rude ! Réduits par l’indifférence ou l’hostilité de leur auditoire à [VII-124] faire entendre, par intervalles, quelques protestations impuissantes, abandonnés même par les intérêts dont ils étaient les défenseurs éclairés, mais soutenus par le témoignage de leur conscience, ils n’ont pas désespéré de la cause pour laquelle leurs efforts semblaient inutiles. Non, ils n’étaient pas inutiles, puisqu’ils nous ont légué un noble exemple. Mais enfin le jour de la rétribution est venu ; et, quoique bien des hivers et bien des travaux aient blanchi leur tête, j’espère qu’ils vivront assez pour voir la chute des barrières qui séparent les cœurs aussi bien que les intérêts des peuples.
Messieurs, je désire que ce toast soit aussi un témoignage de sympathie pour les députés sortants qui ont noblement succombé sur le champ de bataille électoral, en tenant haut et ferme le drapeau de la liberté des échanges. Par là, ils ont rendu un précieux service et maintenu, dans toute leur intégrité, ces règles de droiture et de dignité morale, dont il n’est pas permis de s’écarter, même sous le spécieux prétexte de l’utilité. Peut-être auraient-ils pu assurer leur élection en laissant leurs principes dans l’ombre ; ils ne l’ont pas voulu, et l’opinion publique doit leur en savoir gré. Il n’y a pas deux bases d’appréciation pour les actions humaines. Nous honorons le soldat qui meurt en s’enveloppant de son drapeau, et nous livrons au mépris public celui qui n’est toujours victorieux que parce qu’il se met toujours du côté du nombre. Transportons ce jugement dans la politique, en accordant notre cordiale sympathie à ceux qui, ne pouvant s’élever avec leur principe, ont voulu tomber avec lui.
Aux anciens et aux nouveaux défenseurs du libre-échange, à la Chambre des pairs et à la Chambre des députés !
References
[1] Courrier français du 19 août 1846. (Note de l’édit.)
[VII-125]
27. — LA LOI DES CÉRÉALES ET LE SALAIRE DES OUVRIERS [1] .↩
En Angleterre, les deux journaux protectionistes le Morning Herald et le Standard ont fait grand bruit d’une réduction de salaires qui a eu lieu dans quatre ou cinq fabriques. — Voyez-vous, ont-ils dit, les effets de la liberté des transactions ? Vive la restriction pour mettre les gens à l’aise ! — Et les journaux protectionistes de Paris de s’écrier : Voilà les effets de cette maudite liberté ! Il n’y a que le monopole pour enrichir le peuple.
D’abord ces bons amis du peuple se sont un peu trop hâtés, car enfin, si la loi anglaise a décrété la liberté, on sait qu’elle a donné, sous les rapports les plus importants, trois ans de répit au monopole. Comment donc pourrait-on imputer à ce bon marché du pain, qui n’existe pas encore, les calamités qu’on allègue ? La prétendue retenue de 5 pour 100 opérée sur les salaires par des manufacturiers, en vue du bon marché des aliments, serait donc par eux anticipée, ou, comme nous disons en Gascogne, antichipée !
Ensuite les partisans du libre-échange prédisent-ils que, sous le règne de leurs principes, il n’y aura plus aucune fluctuation dans les salaires ? Ce serait assurément se bercer d’espérances chimériques. Dites-moi, Messieurs, n’y a-t-il pas eu du haut et du bas, du bas surtout pour les ouvriers tant qu’a régné la protection ? Vraiment on croirait qu’en 1842 et en 1843, quand vous étiez les maîtres, quand vous mettiez en œuvre, selon votre bon plaisir, le mécanisme des restrictions, le pauvre peuple était sur des roses !
Mais le fait, direz-vous, le fait ! Rien n’est plus entêté qu’un [VII-126] fait ! Les salaires ont baissé de 5 pour 100 dans toute l’Angleterre, c’est le Morning Herald qui l’a dit, et lord Bentinck, le Darblay britannique, l’a répété. Récuserez-vous cette autorité ?
En fait de faits, je tiens surtout à l’exactitude, quoi qu’ils prouvent ou semblent prouver. Ne pouvant cependant vérifier par moi-même celui qu’on allègue, j’ai cru devoir au moins consulter les journaux du lieu où l’on dit qu’il se passe. Voici comment s’exprime le Manchester Times :
« Nos lecteurs connaissent sans doute la fable des Trois Corneilles, inventée pour montrer ce qu’on peut échafauder d’impostures sur un petit brin de vérité. Depuis quelques jours, certains journaux et certaines harangues nous donnent une version de la fable presque aussi instructive que la fable elle-même. Vendredi dernier, nous annoncions que quelques fabricants de rouleaux, dans les environs de Manchester, avaient manifesté l’intention de réduire de 5 pour 100 le salaire de leurs ouvriers, mais notre correspondant ne nous avait pas donné les détails de cette affaire. Il paraît qu’il y a quelques mois les ouvriers employés à la fabrication des rouleaux, quoiqu’ils gagnassent plus qu’ils n’avaient jamais fait, demandèrent une réduction d’une heure dans la journée de travail, sans une réduction correspondante de salaire. Après quelque hésitation, les fabricants accédèrent à la demande. Ils consentirent à payer aux ouvriers les mêmes salaires pour dix heures que pour onze heures de travail, et même ils élevèrent de 5 pour 100 le prix de l’ouvrage à la tâche, en les avertissant néanmoins que ce changement devait être considéré comme une expérience et que l’augmentation du salaire serait subordonnée à celle du prix des rouleaux. La dépression récente de l’industrie cotonnière ayant nui à la demande des machines, le prix des rouleaux s’en est ressenti, et les fabricants, en vertu de la réserve convenue, ont annoncé une réduction de 5 pour 100 [VII-127] sur les salaires de certaines classes d’ouvriers. Ces fabricants sont au nombre de cinq.
« Quel parti a-t-on tiré de ce fait dans les journaux de Londres et à la Chambre des communes ? La première amplification est due au Morning Herald qui s’exprime en ces termes :
« Les fabricants de rouleaux de Stockport, Park, Bridge, Oldham, Ashton-under-Lyne, Dunkenfield et autres lieux, ont annoncé à leurs ouvriers qu’ils allaient abaisser leurs salaires de 5 pour 100. Cet avis a naturellement créé une grande excitation parmi les ouvriers, qui attribuent avec amertume cette réduction au rappel des lois céréales. Ils demandent à leurs patrons pourquoi ils réduisent les salaires sitôt après la chute des monopoles, et les maîtres leur répondent : — Le pain est à présent à bon marché, vous n’avez plus besoin de gagner autant. »
« Voilà certes un récit bien enflé. Cependant le Standard a renchéri sur son confrère. Mais il appartenait à lord Georges Bentinck de porter l’hyperbole jusqu’à son paroxysme, en s’exprimant ainsi :
« La nouvelle loi céréale et le vote de la loi des sucres n’ont pas suffi pour assurer la prospérité des manufacturiers. À Oldham, Ashton, Stockport et autres villes du Yorkshire, les fabricants ont annoncé à leurs ouvriers une réduction de salaire de 5 pour 100, en leur disant que, puisque les aliments étaient à bas prix, ils pouvaient bien travailler à bon marché. »
« Comme les manufacturiers, particulièrement dans les endroits nommés par lord Georges Bentinck, n’ont opéré aucune réduction de salaire, il est clair que toutes ces déclamation reposent sur le simple fait que nous avons nous-mêmes rapporté, etc., etc. »
Telle est la version du Manchester Times. Je n’ai point à me prononcer entre ce journal et le Morning Herald. Je [VII-128] ferai seulement observer que la feuille de Manchester se rédige et s’imprime sur les lieux, qu’elle se distribue aux ouvriers, qu’elle ne peut pas songer à leur en imposer sur un fait qui les touche de si près. Enfin il est notoire que les ouvriers anglais font des meetings publics quands ils le veulent et pour des circonstances moins graves. Jusqu’à ce qu’ils se plaignent eux-mêmes, il nous est donc permis de mettre les exagérations de lord Bentinck et du Morning Herald sur le compte d’un dépit mal déguisé. Il est à regretter que les journaux français s’y soient laissé prendre.
References
[1] Courrier français du 24 août 1846.
28. — LETTRE AU MONITEUR INDUSTRIEL [1] .↩
Monsieur,
Nous avons toujours dit ceci : « La protection fait supporter au consommateur national des pertes hors de toute proportion avec les profits qu’elle procure au producteur national.
Dans votre numéro d’hier, vous nous en fournissiez une preuve aussi claire, ce me semble, que la lumière du jour.
Voici ce que vous dites :
« Le capital primitif de Decazeville était de 7 200 000 fr. — Or, depuis 1826 jusqu’en 1840, pendant quatorze années, il ne produisit aux actionnaires ni un décime de dividende ni un centime d’intérêt ! En tenant compte des intérêts, le capital s’élevait, en 1842, à 12 621 807 francs, soit 5 260 fr. par action. Alors il fut fait un emprunt d’un million, ce qui porta le capital engagé à 13 621 807 fr. Ce capital a été encore augmenté depuis par de nouveaux emprunts.
« Quoi qu’il en soit, voilà les chiffres du capital. Voici [VII-129] maintenant les immenses dividendes distribués aux actionnaires depuis les premiers jours de l’entreprise.
« De 1826 à 1840, pendant quatorze années, ni dividendes ni intérêts.
« Pour l’exercice de 1840-41, il a été distribué 90 francs par action au capital de 5,260 francs, soit 1 et 7/10 pour 100 d’intérêt, et pas un centime de dividende.
« Pour l’exercice de 1841-42, il a été distribué 270 francs par action, soit 5 pour 100 d’intérêt et 10 centimes de dividende pour 100 francs de capital. »
« Pour l’exercice de 1842-43, il a été distribué 300 francs par action, soit 5 pour 100 d’intérêt et 70 centimes de dividende pour 100 francs de capital.
« Idem pour les exercices de 1843-44 et 1844-45.
« Pour l’exercice de 1845-46, il a été distribué 360 francs par action, soit 5 pour 100 d’intérêt et 1 fr. 84 de dividende pour 100 francs de capital. »
Il résulte de là que les producteurs privilégiés de Decazeville ont placé leurs capitaux, pendant vingt ans, à 1/2 pour 100 en moyenne.
Tout autre placement leur eût donné 4 1/2 pour 100 ; ils ont donc perdu 3 pour 100 chaque année, ou en tout seize millions.
Recherchons maintenant combien le pays a perdu pour aider M. Decaze et ses associés à perdre 16 millions.
Voici ce que je lis dans un rapport de M. le ministre du commerce (1841) :
« Le prix moyen de la fonte française était de 18 fr. 64, et celui de la fonte anglaise de même nature ne revenait, dans nos entrepôts, qu’à 13 fr. 75. Il en résultait une surcharge de 4 fr. 89.
« De même le prix du fer était en France de 48 fr. 15, et le fer anglais, rendu dans nos ports, ne revenait qu’à 22 fr. 88. Il en résultait une surcharge de 25 fr. 30. »
[VII-130]
Dans un tableau no 4 A, annexé à ce rapport, nous voyons que la consommation de la fonte en France, pendant vingt ans, a été de 42 millions de quintaux métriques. La surcharge de 4 fr. 89 équivaut donc à 205 millions de francs.
Dans le tableau no 4 B, on voit que la consommation du fer, durant le même espace de temps, a été de 34 millions de quintaux. La surcharge de 25 fr. 30 a donc infligé au consommateur une perte de 860 millions.
Ces deux pertes réunies s’élèvent à plus d’un milliard !
Et cela pour décider les pauvres maîtres de forges, — que le bon Dieu les assiste ! — à placer à perte des capitaux que, sans la protection, ils eussent placés à profit.
Vous me direz sans doute, — je m’y attends, — que l’argent de M. Decaze, en allant s’engouffrer dans les mines, a fait vivre des ouvriers.
J’en conviens ; mais convenez aussi que s’il en eût fait un emploi un peu moins malencontreux, s’il en eût retiré, par exemple, 4 1/2 pour 100, comme font les simples paysans, ses treize millions, qui s’élèveraient aujourd’hui à trente, auraient fait vivre plus d’ouvriers encore.
Enfin, et c’est ceci qui importe, si le public n’eût pas perdu un milliard dans l’affaire, il se serait donné du bien-être et des satisfactions jusqu’à concurrence de cette somme, et toutes les industries en eussent été encouragées d’autant.
Croyez, Monsieur, que deux pertes ne font pas un profit, et agréez mes civilités.
References
[1] Courrier français du 29 août 1846. (Note de l’édit.)
[VII-131]
29. — AUX NÉGOCIANTS DU HAVRE.↩
Trois lettres en faveur du libre-échange, écrites et publiées au Havre, pendant le séjour de l’auteur.
I [1]
À l’aspect de cette ville où se concentre une grande partie du commerce français, où tant de puissantes facultés combinent des opérations lointaines et des entreprises dont la hardiesse nous étonne, je me disais : — Tout ce travail, toute cette activité, tout ce génie n’ont qu’un objet : accomplir les échanges de la nation française avec les autres nations, et je me demandais : — Ces échanges ne seraient-ils pas plus nombreux, s’ils étaient libres ? En d’autres termes, ces quais, ces magasins, ce port, ces bassins, ne seraient-ils pas bientôt trop étroits pour l’activité havraise s’exerçant en liberté ?
J’avoue que l’affirmative est si évidente à mes yeux, qu’elle ne me paraît pas susceptible de démonstration. Vous savez que les géomètres n’ont jamais pu prouver cet axiome sur lequel repose toute leur science : Le plus court chemin d’un point à un autre, c’est la ligne droite. De même, dire que les échanges seraient plus nombreux s’ils étaient libres, c’est énoncer une proposition plus claire que toutes celles qu’on pourrait faire servir à la démontrer.
Et, de plus, je croirais manquer à toutes les convenances, si je m’avisais de venir exposer devant les négociants du Havre les inconvénients du régime protecteur. Ils me diraient sans doute :
« Votre intervention est superflue ; l’expérience nous en apprend là-dessus plus que toutes les théories. [VII-132] Lisez les écrits émanés de notre Chambre de commerce ou de nos Commissions spéciales ; voyez l’esprit de nos journaux ; faites-vous raconter les efforts, les démarches de nos délégués auprès du Gouvernement et des Chambres, et vous resterez convaincu qu’ils ont toujours eu pour objet la liberté commerciale. »
Il ne s’agit donc point ici de dissertations économiques. Nous avons le même but ; tâchons de nous entendre sur les moyens de l’atteindre.
La première pensée qui se présente, c’est de laisser cette œuvre aux Chambres de commerce. Le législateur ne saurait, en effet, puiser à de meilleures sources les lumières dont il a besoin pour accomplir la réforme.
Cependant l’expérience a prouvé que l’action de ces corps est insuffisante. Il y a longtemps qu’ils réclament la modification du régime restrictif par les raisons les plus concluantes. Qu’ont-ils obtenu ? Rien. — Pourquoi ? Parce que des demandes en sens contraire émanent des classes agricole et manufacturière, qui, plus nombreuses, entraînent par leur poids les résolutions législatives.
L’obstacle, le véritable obstacle, est donc une opinion publique égarée, prévenue, voyant la liberté avec des terreurs chimériques, et fondant sur la restriction des espérances plus chimériques encore.
Il faut donc redresser l’opinion. C’est notre unique ressource. Le chemin est long, mais il n’y en a pas d’autre. Telle est la mission, pour ainsi dire préparatoire, de l’Association pour la liberté des échanges.
Habitants du Havre, nous venons vous demander de donner à cette entreprise, en vous y associant, l’autorité de votre influence morale, l’assistance de vos cotisations, le tribut de vos efforts, de votre expérience et de vos lumières.
Maintenant, qu’il me soit permis de répondre à quelques [VII-133] objections qu’on a élevées contre la portée, les vues et les procédés de cette Association.
On a dit :
« que nous nous tenions trop dans le domaine des généralités ;
« Que nous aurions dû concentrer nos efforts sur un seul monopole, et qu’en les attaquant tous nous effrayions trop d’intérêts ;
« Que, dans notre programme, nous avions gardé le silence sur l’intérêt maritime. »
Si l’on veut bien s’assurer où est l’obstacle à la liberté commerciale, la première objection disparaît.
Il est tout entier, en effet, dans la puissance d’une généralité très-populaire, et c’est celle-ci :
« Il ne faut rien tirer du dehors de ce qu’on peut faire au dedans ; un peuple ne doit pas se procurer par l’échange ce qu’il peut se procurer par la production. »
Ce principe (car c’en est un, seulement il est faux) tend à anéantir le commerce extérieur. Il a la prétention de favoriser le travail national et repose sur cette présomption que, lorsque nous consommons un produit étranger, ce produit n’est pas dû à notre travail. Je n’ai pas besoin de dire ici que c’est là une erreur. Sans doute le produit est étranger ; mais sa valeur est nationale, puisqu’on l’a acquise avec du travail national donné en échange. Elle est un peu comme ces sermons de l’abbé Roquette, dont on disait :
Moi qui sais qu’il les achète,
Je soutiens qu’ils sont à lui.
Ceci me rappelle que, visitant le palais de la reine d’Espagne, je m’extasiais sur la beauté des meubles, des tapis, des rideaux, et demandais à un grave concierge castillan si c’étaient des produits de l’industrie espagnole. Il me répondit fièrement : « Hombre, aqui todo es español… pues lo hemos pagado. »
[VII-134]
Ainsi l’obstacle qui est devant nous, c’est une théorie, une généralité. Que pouvons-nous faire que de lui opposer une autre généralité ? C’est le moyen d’extirper une erreur que de fonder la vérité contraire.
Dieu me préserve de repousser pour cela le concours des praticiens, des hommes instruits par l’expérience et le maniement des affaires. C’est leur collaboration surtout que nous recherchons, que nous sollicitons comme la plus précieuse et la plus efficace. Ce sont les négociants qui, ayant non seulement compris mais senti les inconvénients des restrictions douanières, avec lesquelles ils sont perpétuellement en lutte, peuvent les exposer dans ce langage simple, clair et précis, qui force la conviction. Enfin, quand l’opinion sera préparée et qu’il sera temps d’en venir à l’exécution, ce sont encore eux qui fourniront aux hommes d’État les indications les plus sûres.
Puisqu’on a pu dire de la vertu même : Pas trop n’en faut, permettez-moi de ne pas faire trop d’économie politique en un jour et de renvoyer à demain l’examen des deux autres objections.
30. — II [2] ↩
On nous reproche de n’avoir pas concentré tous nos efforts contre le monopole du fer. On a la bonté de supposer que, par cette adroite tactique, nous n’aurions pas alarmé l’ensemble des intérêts privilégiés ; et enfin on nous cite l’exemple de l’Angleterre.
D’abord nous avons attaqué le monopole du fer et nous [VII-135] l’attaquons tous les jours. Si même la réforme devait frapper isolément un produit (ce qui n’est pas mon avis), une foule de raisons nous justifieraient de réclamer, pour commencer, la libre entrée du fer et, par suite, l’abaissement du prix du combustible.
Mais croire que le camp de la protection en serait moins alarmé, c’est se faire illusion.
En effet, après avoir traité la question sociale et pratique, après avoir dit que la cherté du fer, et même le manque absolu du fer, paralyse toutes nos entreprises, suspend les travaux des chemins de fer, retarde notre navigation transatlantique, impose une taxe à toutes nos manufactures, à notre industrie agricole, à notre marine marchande, porte atteinte aux moyens déjà si bornés, qu’a le peuple français de se garantir du froid et de s’assurer des aliments ; après avoir dit tout cela et bien d’autres choses encore, que du reste on crie depuis vingt ans, pouvons-nous nous flatter que les maîtres de forges resteront la bouche close ? Non, ils se défendront, et eux aussi répéteront ce qu’ils disent depuis vingt ans. Ils diront qu’il vaut mieux produire chèrement au dedans que d’acheter à bon marché au dehors, qu’il faut protéger le travail national ; que plus il en coûte pour mettre un quintal de fer à la portée du consommateur, plus cela prouve que cette industrie distribue du travail et des salaires. En un mot, ils diront tout ce que pourraient dire les autres industries protégées. — Et ce sera à nous d’aborder aussi ces généralités. Vous voyez bien qu’il y faudra venir sous peine d’être battus. Il faudra soutenir la lutte sur le terrain des théories, et dès lors nous n’aurons pas réussi à mettre les protectionistes sur une fausse quête.
Il est donc plus simple et plus loyal de poser d’abord le principe de la liberté commerciale. Ce principe est vrai ou il est faux. S’il est faux, la discussion le montrera. S’il est vrai, il triomphera, j’en ai la certitude. Le nombre des [VII-136] adversaires n’y fait rien, au contraire ; plus ils seront, plus ils se contrediront entre eux. Notre principe triomphera, pourvu que nous y soyons fidèles, que nous le défendions avec une virile énergie, que nous n’abandonnions jamais notre position sur ce roc inébranlable : la vérité et la justice.
La justice !… À ce mot, je me demande si, alors que la protection est devenue un système, qu’elle s’est étendue à un grand nombre d’industries, alors que les charges qu’elle impose à chacune d’elles absorbent les profits qu’elle lui promettait (et c’est en cela qu’elle est une déception), je me demande s’il est juste de procéder ainsi isolément, et s’il ne serait pas plus juste et plus prudent d’adopter une mesure d’ensemble et une réduction uniforme.
Si par exemple on disait : En vue du revenu, il n’est pas possible de demander, sur un produit, plus du dixième de sa valeur ; si, partant de cette donnée, on ramenait tout le tarif à ce taux au maximum, et cela en cinq ans, par réduction annuelle d’un cinquième, il me semble que nul n’aurait à se plaindre. Ce qu’on perdrait d’un côté, on le gagnerait de l’autre, et même avec avantage, et la perturbation serait insensible, beaucoup plus insensible qu’on ne se le figure. — Je n’entends pas proposer un plan, nous n’en sommes pas là, je cherche à faire comprendre ma pensée.
Mais dire aux maîtres de forges : Nous allons réduire le prix du fer, sans réduire pour vos ouvriers le prix des aliments, des vêtements et du combustible, — cela ne me semble pas s’accorder avec notre principe, et j’avoue que j’aurais quelque peine à adopter cette marche, même comme procédé stratégique.
On nous cite l’exemple de la Ligue anglaise. J’admire autant qu’un autre, et plus qu’un autre, l’habileté des chefs de la Ligue. Mais il ne s’ensuit pas que je croie devoir imiter servilement cette partie de leur tactique, déterminée par des circonstances qui ne nous sont pas applicables.
[VII-137]
En Angleterre, il y avait deux classes : l’une se livrait au travail, l’autre possédait la terre ; celle-ci faisait aussi la loi. Tout en laissant pénétrer dans la loi quelques priviléges industriels, elle s’était servie du pouvoir législatif pour exclure les produits agricoles étrangers et constituer à son profit le plus incommensurable des monopoles, le monopole de l’alimentation du peuple.
Qu’ont fait les manufacturiers ? Ils ont dit : « Nous commençons par déclarer que nous ne voulons pas de protection, et nous attaquons celle que les législateurs se sont attribuée à eux-mêmes ; bien convaincus que si nous les forçons à lâcher prise, ils n’iront pas, eux qui font la loi, maintenir des priviléges industriels dont ils ne profitent pas, dont ils souffrent eux-mêmes, et qu’ils n’ont accordés que pour faire passer les leurs. » Aussi, quand on demandait à M. Cobden pourquoi il dissolvait la Ligue avant que toute protection fût retirée aux manufacturiers, il a pu répondre, et tout le monde a senti la force de cette réponse : The landlords will do that.
Je le demande, quelle analogie trouve-t-on entre cette position et la nôtre ? Les maîtres de forges ont-ils le privilége de faire la loi en France, par cela même qu’ils sont maîtres de forges, comme les landlords font la loi en Angleterre parce qu’ils sont landlords ? Toutes nos industries se réunissent-elles pour dire aux maîtres de forges législateurs : « Nous abandonnons notre monopole, abandonnez le vôtre ? » Rien de semblable. Ce qui, en Angleterre, soutenait le système, c’était la loi des céréales. Ce qui le soutient, en France, c’est l’erreur, l’erreur renfermée dans ce simple mot : travail national. Attaquons donc cette erreur. Réunissons contre elle toutes nos forces. C’est elle qui est notre législateur puisqu’elle a fait notre législation.
Combattons-la dans toutes ses formes, démasquons-la sous tous ses déguisements ; poursuivons-la au sein des [VII-138] Chambres, dans le corps électoral, dans le peuple, au ministère, dans la presse, dans les coteries, et ne nous préoccupons pas tant de pratique et d’exécution ; car, lorsqu’enfin nous l’aurons exposée toute nue aux yeux de l’intelligence nationale, nous serons tout étonnés de voir la grande réforme accomplir d’elle-même, aux applaudissements du Moniteur industriel.
Mais je m’aperçois que le fer a envahi ces colonnes et votre attention. Que voulez-vous ? Il est un peu enfant gâté, habitué aux préséances et même aux envahissements. Il faut donc que la navigation attende à demain. Elle reste dans son rôle.31
III [3] ↩
Me voici arrivé à une question difficile et brûlante, dit-on, celle de la situation qui serait faite, sous l’empire de la liberté du commerce, à notre marine marchande.
J’ose prédire, disent les uns, que les armateurs n’entreront dans le mouvement antiprotectioniste que sous la réserve des priviléges accordés au pavillon national.
J’oserais parier, disent les autres, que l’Association ne saura pas sortir de cette difficulté, forcée qu’elle est de renoncer à son principe, si elle cède aux armateurs ; ou de perdre leur puissant concours, bien plus, de les avoir pour adversaires, si elle leur résiste.
Et moi, je dis : Messieurs de la galerie, faites vos paris, engagez vos enjeux, vous ne perdrez ni les uns ni les autres ; [VII-139] car les armateurs maintiendront leurs prétentions, l’Association maintiendra son principe, et cependant ils seront d’accord et marcheront ensemble vers le grand dénouement qui s’approche, quoi qu’on en dise : la liberté du travail et de l’échange.
Je n’ai ni l’intention ni la prétention d’approfondir ici toutes les questions qui se rattachent à la marine marchande. Je n’aspire qu’à établir quelques principes qui, malgré la défaveur du mot, concilieront, je crois, toutes les convictions.
Sous le régime de liberté qui se prépare, l’industrie maritime, en tant qu’industrie, n’a droit à aucune faveur. Elle n’a droit qu’à la liberté, mais elle a droit à la liberté. Le service qu’elle rend est d’opérer les transports ; et si, par l’incapacité de ses agents, ou par quelque cause naturelle d’infériorité, elle ne peut le faire qu’avec perte, elle n’a pas droit de se couvrir de cette perte au moyen d’une taxe sur le public, de quelque façon que cette taxe soit déguisée. Si les armateurs élevaient une telle prétention, de quel front demanderaient-ils que la protection fût retirée au fer, au drap, au blé, etc. ? Que pourraient-ils dire ? Que leur industrie fait vivre des marins ? Mais les maîtres de forges disent aussi que la leur fait vivre des ouvriers.
En quoi les transports sont-ils par eux-mêmes plus intéressants que les produits ? Comment, si la nation est ridiculement dupe, quand elle comble par une taxe le déficit d’un producteur de blé, ne sera-t-elle pas dupe, si elle comble le déficit d’un voiturier de blé par terre ou par mer ? Tout ce qu’on peut dire pour ou contre le travail national subventionné, on peut le dire pour ou contre les transports nationaux subventionnés. La liberté n’admet pas ces distinctions qui ne reposent sur rien. Si l’on veut être juste, il faut laisser tous les services humains s’échanger entre eux sur le pied de la plus parfaite égalité et les protéger tous, aux [VII-140] dépens les uns des autres, — ce qui est absurde, — ou n’en protéger aucun.
Ainsi le principe de l’Association est absolu.
Mais ce principe est-il en collision avec cet autre principe : Celui qui cause un dommage doit le réparer ; celui qui reçoit un service doit le rendre ; celui qui exige un sacrifice doit un sacrifice ? Nullement ; quant à moi, je ne puis séparer dans ma pensée l’idée de liberté de celle de justice. C’est la même idée sous deux aspects.
Ainsi, s’il arrivait que les industries nationales, toutes parfaitement libres, exigeassent d’une d’entre elles, et dans leur intérêt, des sacrifices particuliers, ne seraient-elles pas tenues à offrir une compensation, et pourrait-on voir dans cette compensation une dérogation au principe de la liberté ? Je ne pense pas qu’il y ait un seul homme raisonnable qui ose soutenir l’affirmative. On peut différer d’avis sur la valeur du sacrifice, sur la valeur ou la forme de la compensation, mais non sur le principe que l’une est la juste conséquence de l’autre ; et j’irai même plus loin : Si l’on soutenait qu’il y a dans un tel arrangement violation de la liberté absolue, je dirais qu’elle n’est pas imputable à celui qui fait le sacrifice. Mais nous tomberions ici dans une dispute de mots.
Appliquons ces prémisses à l’industrie maritime.
Voilà toutes les industries, toutes les transactions libres. Nulle n’est protégée, mais nulle n’est entravée. Vendez, achetez au dedans, au dehors, l’État ne s’en mêle pas.
Mais l’État, c’est-à-dire la nation, c’est-à-dire encore l’ensemble des industries, veut se mettre à l’abri des agressions extérieures. Pour cela, il lui faut une marine ; pour créer cette marine de toutes pièces, il lui faut cent millions par an, charge à répartir entre tous les travailleurs. Cependant il aperçoit un moyen d’arriver au même résultat avec cinquante millions. Ce moyen, c’est d’imposer des charges et des entraves particulières à la marine marchande.
[VII-141]
L’État lui dira par exemple :
« Je te défends d’acheter au dehors ton outil principal, le navire, parce que je veux former des constructeurs !
« Je te défends d’emporter au dehors le capital, parce que je veux que le navire soit exclusivement français.
« Je te défends de louer des matelots au dehors, parce que j’entends avoir des marins qui tiennent au pays.
« Je te défends de faire toucher à ton navire par des charpentiers ou calfats autres que ceux que j’ai placés sous un régime exceptionnel, et qui, par conséquent, demandent des salaires exceptionnels.
« Je t’ordonne d’avoir à bord plus de matelots et d’officiers qu’il ne t’en faudrait, parce que j’en veux avoir une pépinière bien fournie.
« Je t’ordonne de les nourrir de telle façon, de les ramener de tout port où tu les auras congédiés.
« Et, pour l’exécution de ces conditions et de bien d’autres, je me fais l’intermédiaire entre toi et ton équipage. »
Je le demande, à la suite de ce discours, n’attend-on pas naturellement cette conclusion : « Et en compensation, etc. »
Je n’entre pas ici dans un calcul ; encore une fois, je discute le principe.
Et remarquez une chose : toutes ces mesures sont prises, non pas dans l’intérêt de l’armateur ni de la marine marchande, mais dans l’intérêt de la défense nationale, dans l’intérêt de toutes les industries.
Mais ce n’est pas tout : outre que la compensation est exigée par un motif de justice, elle est déterminée encore par une considération non moins grave, le succès. Car ne serait-il pas bien singulier que tant de mesures fussent prises pour aboutir à un désappointement complet, à l’absence totale des moyens de défense ?
[VII-142]
Or, en dehors de la compensation, c’est ce qui arriverait infailliblement.
Les dispositions analogues à celles que je viens de supposer ont toutes ce commun résultat d’exhausser, pour l’armateur, le prix de revient de ses moyens de transport. Si aucune indemnité ne lui est accordée, il cessera de naviguer en concurrence avec l’étranger, car toute la puissance du Gouvernement ne saurait le forcer à naviguer à perte. Nous voilà donc sans marins et sans défense. Certes mieux eût valu ne pas intervenir dans cette industrie, même avec la chance de la voir succomber. Le pire de tout, c’est de faire comme je ne sais quel philosophe : acheter fort cher un regret.
On m’a demandé ce que je déciderais dans ce cas.
Supposez la marine marchande entièrement libre, et que cependant elle ne puisse pas se soutenir.
Je n’aime guère à m’évertuer sur des problèmes imaginaires ; mais enfin je crois qu’on peut déduire de ce qui précède les solutions suivantes, dont aucune, ce me semble, n’est incompatible avec la justice ni avec la liberté.
La nation aurait à décider : d’abord si elle veut s’assurer des moyens de défense ; ensuite s’il n’y a aucun moyen plus économique et plus sûr que d’assister, de soudoyer la marine marchande ; enfin, s’il n’y en a pas de meilleur, qu’il faut s’y résoudre.
Mais ce que je voudrais qui fût bien entendu, pour l’honneur des théories (car j’avoue mon respect des théories), c’est ceci : que lorsque des considérations supérieures vous réduisent à soudoyer une industrie qui tomberait sans cela, il ne faut pas s’imaginer que cette industrie soit lucrative, que le travail et les capitaux qu’elle occupe reçoivent industriellement un bon emploi ; il faut savoir qu’on perd, il faut savoir qu’on fait un sacrifice à la sûreté nationale ; il ne faut pas surtout s’étayer de cet exemple pour appliquer à [VII-143] d’autres industries le même procédé, sans avoir le même motif.
J’aurais bien d’autres considérations à présenter, mais l’espace et le temps m’obligent à me résumer. Armateurs du Havre, de Bordeaux, de Marseille et de Nantes, si vous êtes partisans de la liberté du commerce, votre position particulière ne doit pas vous empêcher d’apporter à notre Association le tribut de vos lumières et de votre influence. Votre rôle vis-à-vis de la nation est tout tracé.
Demandez, pour vous comme pour tout le monde, le droit commun, c’est-à-dire la liberté. Qu’au grand air de la liberté vous puissiez ou non vous soutenir, demandez toujours la liberté, car vous n’avez pas le droit d’exiger que la nation y renonce pour votre avantage, et vous vous placeriez dans une position fausse et indigne de vous, si vous le demandiez. — Que si la nation, pour sa défense et dans l’intérêt commun, a besoin de votre concours, de vos sacrifices, stipulez des conditions dans lesquelles votre patriotisme ait une généreuse part ; mais surtout gardez-vous de laisser donner à l’indemnité qui vous sera offerte le nom de protection ou privilége, car les fausses dénominations font les fausses idées ; que votre cri soit : Liberté !… et compensation pour ceux qu’on en prive. — Nos adversaires ne viendront point alors vous jeter de prétendues contradictions à la face.
32. — À M. LE RÉDACTEUR EN CHEF DE LA PRESSE [1] .↩
Monsieur,
Que faut-il penser du nouveau tarif américain ? Les journaux anglais le vantent comme très libéral, se fondant sur [VII-144] ce qu’il a en vue le revenu public et non la protection. — C’est justement ce dont vous le blâmez, quand vous dites :
« Il faut qu’il soit bien entendu que les États-Unis, se plaçant sur le terrain étroit et égoïste de la fiscalité, n’ont pas eu la prétention de se poser en champions ou en adversaires de la liberté commerciale, » — « Difficile problème, ajoutez-vous ailleurs, que l’on cherche à agiter en France. »
Vous êtes donc d’accord avec les journaux anglais sur ce fait que le tarif américain a été combiné en vue du revenu public. C’est pour cela qu’ils le disent libéral, et c’est précisément pour cela que vous le proclamez étroit et égoïste.
Mais un droit de douane ne peut avoir qu’un de ces deux objets : le revenu ou la protection. Dire que la fiscalité, en matière de tarifs, est un terrain étroit et égoïste, c’est dire que la protection est un terrain large et philanthropique. Alors, Monsieur, faites-moi la grâce de m’expliquer sur quel fondement vous donnez si facilement raison, en principe, aux partisans de la liberté des échanges, lesquels ont déclaré hautement que ce qu’ils combattent dans nos tarifs, ce n’est pas le but fiscal, mais le but protecteur [2] .
Le tarif américain nous semble libéral par deux motifs. Le premier, c’est qu’il est fondé tout entier sur le système des droits ad valorem, le seul qui fasse justice au consommateur. Il se peut que l’application en soit difficile ; mais le droit à la pièce, au poids ou à la mesure est inique ; car quoi de plus inique que de frapper de la même taxe la veste de l’ouvrier et l’habit du dandy ? — Placés entre une difficulté et une iniquité, les Américains ont bravement accepté la difficulté ; et il est impossible de ne pas reconnaître que [VII-145] sous ce rapport du moins, ils se sont montrés vraiment libéraux.
Ils n’ont pas moins agi selon les règles du vrai libéralisme, lorsqu’ils ont refusé de faire de la douane un privilége pour certaines classes de citoyens. Il ne peut pas, ce me semble, tomber dans l’esprit d’un homme impartial qu’en soumettant les produits étrangers à une taxe, on puisse avoir une autre intention, dans un pays où tous les citoyens sont égaux devant la loi, que de créer des ressources au Trésor, ressources qui sont ou sont censées être dépensées au profit de tous. En ce cas, il est vrai que la taxe retombe sur les consommateurs. Mais sur qui donc voulez-vous qu’elle retombe ? N’est-ce point eux qui profitent des dépenses publiques ?
Vous dites :
« Croit-on, par exemple, qu’on ait eu le moindre souci des intérêts des consommateurs, lorsqu’on a frappé d’une taxe de 100 pour 100 les eaux-de-vie et les liqueurs, pour lesquelles on aurait pu aller jusqu’à la franchise, sans provoquer les plaintes d’une double industrie agricole et manufacturière qui n’existe pas aux États-Unis ? »
Eh ! ne voyez-vous pas que c’est là ce qui constitue le libéralisme du tarif américain ? Il frappe de forts droits les produits qui n’ont pas de similaires au dedans. — Nous faisons le contraire. Pourquoi ? parce qu’ils ont en vue le revenu public, et nous le monopole.
Le droit, il est vrai, est très élevé, même dans l’intérêt du trésor, et comme aucun autre intérêt n’a pu déterminer l’adoption d’un chiffre aussi exagéré, il faut qu’on ait eu un autre motif. Nous le trouverons dans l’exposé de M. J. R. Walker, secrétaire du Trésor, à qui l’Amérique doit la réforme.
« Les améliorations dans nos lois de finances sont fondées sur les principes suivants : »
[VII-146]
« 1o Qu’il ne soit rien prélevé au delà de ce qui est nécessaire pour les besoins du gouvernement économiquement administré ;
« 2o Qu’aucun droit ne soit imposé, sur aucun article, au-dessus du taux le plus bas où il donne le plus grand revenu ;
« 3o Que, selon l’utilité des produits, ce droit puisse être abaissé et même aboli ;
« 4o Que le maximum du droit soit prélevé sur les objets de luxe ;
« 5o Que tous minimums et droits spécifiques soient abolis pour être remplacés par des droits ad valorem. »
Voilà, Monsieur, ce qui explique la taxe énorme que l’Union a imposée à l’eau-de-vie. Elle l’a considérée comme un objet de luxe et peut-être comme un objet pernicieux.
Vous pouvez alléguer que c’est une faute, financièrement. Je serai de votre avis, car rien ne me semble plus monstrueux qu’une taxe qui égale la valeur de l’objet imposé. Vous pouvez dire que la douane est un mauvais moyen de moralisation. J’en tomberai d’accord, car je suis d’avis que ce n’est point à elle qu’il faut confier la réforme des mœurs [3] . Mais vous ne pouvez pas conclure de cette disposition exceptionnelle que le tarif américain ne soit pas combiné, dans son ensemble, selon les vrais principes de la liberté commerciale.
Au reste, avons-nous le droit de nous plaindre de la rigueur d’autrui, à l’égard des boissons, nous qui mettons sur nos alcools une taxe de 82 fr. 50 par hectolitre ?
Ce qui est certain, c’est que le tarif américain répudie le principe de la protection (nous n’en demandons pas davantage au nôtre), et je n’en veux pour preuve que ce que je trouve dans le Boston Atlas, organe des intérêts [VII-147] privilégiés. Voici ce curieux morceau d’éloquence que j’offre à l’imitation de nos monopoleurs :
« Le peuple, dont les vœux ont été méconnus, dont les pétitions ont été rejetées avec mépris, dont les droits ont été foulés aux pieds, n’a plus qu’une espérance. Renverser les auteurs de ces calamités est pour lui le seul moyen d’effectuer la restauration du tarif. Poussons ce cri de ralliement. Qu’il retentisse, sur les ailes du vent, dans les profondeurs de l’Est à l’Ouest. À bas les gouvernants qui nous ont ruinés au dedans et humiliés au dehors ! restauration du tarif de 1842 ! Que toute la Nouvelle-Angleterre au moins se lève comme un seul homme ! Tous, tant que nous sommes, quels que soient nos drapeaux, whigs, libéraux ou radicaux, nous tous qui voulons la protection en faveur du travail américain, nous tous qui voulons nous opposer à l’abaissement du salaire des ouvriers, quand le prix des aliments s’accroît ; nous enfin qui voulons rétablir le tarif de 1842, tel qu’il était avant qu’on nous eût frustrés de ses avantages ; — serrons nos rangs, marchons comme un seul homme pour le grand œuvre de la restauration. Un grand et glorieux objet nous unit. La patrie souffrante nous appelle ; un peuple outragé implore notre secours, etc. »
Ainsi, Monsieur, ce qui a suivi, comme ce qui a précédé l’adoption du tarif de 1846, montre que le principe de la protection y est entièrement abandonné. C’est tout ce que je voulais prouver.
Agréez, etc.
[VII-148]
33. — À M. LE RÉDACTEUR EN CHEF DE LA PRESSE [4] .↩
Monsieur,
Dans votre réponse à ma lettre sur le tarif américain, de graves erreurs se mêlent à des observations dont je ne contesterai pas la justesse ; car je ne cherche pas d’autre triomphe que celui de la vérité.
Ainsi, je reconnais que le nouveau tarif est encore fort élevé ; qu’il laisse subsister de grands obstacles aux relations de l’Europe, et, en particulier, de la France avec les États-Unis ; et que le commerce, qui se préoccupe plus de pratique que de théorie, et du présent que de l’avenir, ne sera guère porté à voir une compensation dans la pensée libérale et féconde qui a présidé à cette œuvre.
Cependant, monsieur, même sous le rapport des droits, le tableau que vous avez donné, dans votre numéro du 20 août, est de nature à induire le public en erreur.
Vous portez les vins à 12 et 9 pour 100 dans l’ancien tarif, tandis que c’est 12 et 9 cents le gallon. De même, vous n’attribuez à la soie qu’un droit de 15 et 16 pour 100, quand c’est 15 ou 16 cents par livre qu’il faudrait dire. En faisant les rectifications sur ces bases, vous verrez que les vins et les soies, surtout dans les qualités ordinaires, ont été plutôt dégrevés que surchargés. Il est fâcheux que ces erreurs concernent précisément nos deux principaux articles d’exportation.
Vous ne parlez pas non plus du mécanisme d’après lequel on prélevait jusqu’ici le prétendu droit ad valorem sur tous les tissus de coton. Le tarif faisait figurer, il est vrai, le [VII-149] modeste chiffre de 20 pour 100. Mais, par une ruse digne du génie du monopole, il avait supposé que tous les tissus de colon valaient au moins 30 cents le yard carré (shall be deemed to have cost 30 cents the square yard), en sorte que sur une étoffe de la valeur réelle de 6 cents, on prélevait cinq fois le droit, soit 100 pour 100. — Il en était de même de tous les articles à l’occasion desquels le monopole avait cru devoir se déguiser et faire, comme on dit, patte de velours.
Maintenant le droit est fixé à 25 pour 100 de la valeur réelle. Le privilége a donc perdu du terrain dans la proportion de 75 pour 100, au moins, à l’égard des étoffes les plus communes, c’est-à-dire les plus consommées.
Vous êtes surpris que nous nous félicitions de ces résultats, et vous nous demandez pourquoi nous en voulons tant aux droits protecteurs, puisque les droits fiscaux n’opposent pas de moindres obstacles à notre commerce. Je vais vous le dire.
Nous nous attaquons aux droits protecteurs, parce qu’une fois que le monopole, détournant les tarifs de leur destination, les a accordés à ses vues cupides, aucune réforme n’est plus possible qu’après une lutte acharnée entre le droit et le privilége. Et maintenant qu’aux États-Unis la protection a été vaincue, vous-même vous montrez avec quelle facilité on pourra désormais faire disparaître du tarif ce qu’il a de défectueux et d’exorbitant. Qu’on veuille diminuer le droit sur le vin, qu’est-ce qui s’y opposera ? Ce ne sera point le fisc, puisqu’il recouvrera plus avec un droit moindre. Ce ne sera pas l’industrie indigène, puisqu’elle ne fait pas de vin.
Qu’on dégrève le thé en France, nul ne contredira ; mais qu’on touche au fer, et vous verrez un beau tapage.
Nous nous attaquons aux droits protecteurs, parce qu’ils décuplent et centuplent le sacrifice du consommateur. Si [VII-150] la douane perçoit un million sur le thé, sans doute c’est un million mis à la charge du consommateur ; mais ce million lui est rendu sous forme de route et de sécurité, puisqu’il rentre tout entier au trésor. Mais quand la douane prélève un million sur le fer étranger, elle fait hausser de 5 ou 10 fr. par 100 kilos, non seulement le fer importé, mais encore tout celui qui se produit dans le pays, imposant ainsi au public une taxe incalculable qui n’entre pas au Trésor, et par conséquent n’en sort pas.
Nous nous attaquons aux droits protecteurs, parce qu’ils sont injustes, parce qu’ils violent la propriété ; et, pour mon compte, je suis surpris que l’évidence de cette vérité ne vous ait pas déjà rallié tout à fait à notre cause. Il n’y a pas bien longtemps que les monopoleurs anglais demandaient une transaction à sir Robert Peel. Il leur répondit :
« Je vous ai accordé un délai de trois ans, et je ne me rétracterai pas. Mais peut-être ai-je été trop loin. Je croyais alors que c’était une question de finances et d’économie politique, et sur de telles questions on peut transiger. Aujourd’hui je suis convaincu que c’est une question de justice ; il n’y a pas de transaction possible. »
Enfin nous attaquons le régime protecteur, parce que c’est la racine qui alimente chez les peuples l’esprit de domination et de conquête. Et voyez ce qui se passe. Tant qu’elle a obéi à ce système, l’Angleterre a été un fardeau pour le monde, qu’elle aspirait à envahir. Aujourd’hui elle affranchit commercialement ses colonies, qui lui ont coûté tant de sang et de trésors. Dans cinq ans, un Anglais n’y aura pas plus de priviléges qu’un Russe ou un Français ; et je demande quelle raison elle aura alors de retenir ou d’acquérir des colonies.
Voilà pourquoi, Monsieur, nous nous réjouissons de voir le système protecteur succomber sur quelque point du globe que ce soit. Voilà pourquoi nous avons accueilli avec joie [VII-151] le nouveau tarif américain, quoique nous le considérions comme très défectueux au point de vue fiscal.
À ce sujet, je ne crois pas, comme vous, que les Américains, en maintenant des droits monstrueux de 40 et de 100 pour 100, aient songé à réduire le chiffre total de leurs importations, de crainte qu’il ne surpassât celui des exportations. Ce serait les supposer encore encroûtés dans la balance du commerce, et ils ne méritent pas cette épigramme. Mais, direz-vous, si ce n’est ni l’intérêt de la protection ni celui du fisc qui les a décidés, comment expliquer ces droits absurdes sur le vin et l’eau-de-vie ? — Je les explique par le sentimentalisme. En Amérique, comme ailleurs, il est fort à la mode. On veut faire de la moralisation à coups d’impôts et de tarifs. Les sociétés de tempérance, les teetotallers ont voulu imposer leur doctrine au lieu de la prêcher, voilà tout. C’est un chapitre de plus à ajouter à l’histoire de l’intolérance à bonne intention ; mais, quel que soit l’intérêt du sujet, ce n’est pas ici le lieu de le traiter.
Me permettrez-vous, Monsieur, de vous faire remarquer que la dernière phrase de votre article cache le sophisme qui sert de prétexte à tous les priviléges ?
Vous dites :
« Si les manufactures américaines ne peuvent pas demeurer victorieuses sur leur propre marché, c’est qu’il y a en elles un germe incurable d’impuissance… »
Ce germe, c’est la cherté des capitaux et de la main-d’œuvre.
En d’autres termes, les Américains ne sont impuissants à filer le coton que parce qu’ils gagnent plus à faire autre chose. Les plaindre à ce sujet, c’est comme si l’on disait à M. de Rothschild :
« Il est vraiment fâcheux pour vous que votre état de banquier vous donne un million de rente ; cela vous met dans l’impuissance incurable de soutenir la concurrence avec les cordonniers, s’il vous prenait fantaisie de faire des souliers. »
[VII-152]
Si pourtant la loi s’en mêlait, je ne réponds pas qu’au moyen de certains priviléges, elle ne pût rendre le métier de cordonnier fort lucratif.
Agréez, etc. [5] .
References
[1] Courrier français du 22 août 1846. (Note de l’édit.)
[2] Voir la déclaration de l’Association pour la liberté des échanges, t. II, p. 1 et 2.(Note de l’édit.)
[3] Voir t. VI, p. 415 et suiv.(Note de l’édit.)
[4] Courrier français du 2 septembre 1846.
[5] La protection s’est relevée, en Amérique, du coup que lui avait porté le tarif de 1846. Il n’y a pas lieu de s’en étonner. Ce n’est pas d’une mesure gouvernementale, c’est de l’opinion publique que dépend le sort définitif d’un système. Or l’opinion publique, aux États-Unis, n’en est pas encore arrivée à reconnaître ce qu’a d’inique et de malfaisant le système protecteur. Bastiat l’avait crue plus avancée.(Note de l’éd.)
34. — À M. LE RÉDACTEUR EN CHEF DU NATIONAL [1] .↩
Monsieur,
Si j’ai bien compris la portée des nouvelles attaques que vous dirigez contre le libre-échange (National des 6 et 7 novembre), elles peuvent se résumer ainsi :
D’abord il va sans dire que le Principe du libre-échange est le vôtre. La liberté commerciale est fille de vos idées ; l’avenir que vous espérez, c’est l’alliance des peuples, et il serait absurde d’aspirer à cette alliance, à cette fraternité des nations, sans vouloir l’échange libre de leurs produits, qu’ils émanent de l’intelligence ou qu’ils soient les fruits de l’industrie et du travail.
Fort bien. Mais il se présente une petite difficulté. Cette liberté qu’il est absurde de ne pas vouloir quand on aspire à l’alliance des peuples, il se rencontre qu’elle doit être le résultat de cette alliance, ce qui fait que vous n’avez plus à vous occuper du principe fils de vos idées (si ce n’est pour le combattre), lequel se manifestera de lui-même, [VII-153] comme sanction de votre idéal politique, quand la carte de l’Europe sera refaite, etc.
La seconde objection est tirée de ce que nous payons de lourdes taxes mal réparties. Nous manquons d’institutions de crédit, la propriété est immobilisée, le capital monopolisé ; d’où il suit clairement que le droit d’échange n’a qu’à attendre que votre idéal financier, comme votre idéal politique, soit réalisé sur tout le globe. — C’est tout comme la Démocratie pacifique qui salue respectueusement le principe du libre-échange, mais qui demande qu’il soit ajourné seulement jusqu’à ce que l’univers se soit soumis à l’idéal fouriériste.
Enfin, quand il y aurait avantage matériel à ce que les échanges fussent libres, l’avantage matériel est chose vile et abjecte aux yeux des classes laborieuses ; l’aisance, l’indépendance, la sécurité, la dignité qui en sont la suite, doivent être sacrifiées, si elles nous ôtent la chance de nous brouiller avec l’Autriche et l’Angleterre.
Ces étranges opinions, que votre plume a su rendre spécieuses, je les discuterai dans cet ordre.
Le principe du libre-échange est le vôtre. — Monsieur, je crois pouvoir vous assurer que vous vous faites illusion. Tout votre article est là pour prouver que vous n’êtes pas fixé sur la question économique. Cela n’est pas surprenant, puisque vous n’y attachez qu’une importance très secondaire. — Vous avez écrit ceci :
« Quand ces mêmes résultats (de la liberté commerciale) seraient aussi certains qu’ils sont hypothétiques et faux, » et encore : « Au point de vue économique, la liberté des échanges est incontestablement utile aux peuples arrivés à l’apogée de l’industrie… Elle est utile encore aux peuples qui n’ont pas d’industrie… En est-il de même pour une nation comme la nôtre ? etc. »
Eh bien ! Monsieur, puisque vous croyez que la liberté [VII-154] d’opérer des échanges est funeste à tous les hommes, excepté à ceux qui sont les premiers et les derniers en industrie, j’ose dire que la nature de l’échange, du moins telle que nous la comprenons, vous est complétement étrangère, et je ne puis voir sur quel fondement vous vous en déclarez le partisan en principe. Vous êtes protectioniste, plus protectioniste que ne le furent jamais les Darblay, les Saint-Cricq, les Polignac ou les aristocrates britanniques.
Vous soulevez, Monsieur, une question pleine d’intérêt.
« L’alliance des peuples doit-elle être le résultat de la liberté commerciale, ou bien la liberté commerciale de l’alliance des peuples ? »
Pour traiter cette question sans trop de répugnance, il faudrait bien être fixé sur la valeur économique de l’échange ; car s’il est dans sa nature de ruiner ceux qui le font, il y a incompatibilité radicale entre l’union des peuples et leur bien-être. Que ce soit l’échange qui amène l’alliance ou l’alliance qui amène l’échange, le résultat sera toujours l’universelle misère. La seule différence qu’on puisse apercevoir entre les deux cas, c’est que, dans le premier, on se soumet à une chose mauvaise, à savoir l’échange, pour arriver à une bonne, à savoir l’alliance, tandis que dans le second on commence par la chose bonne, l’alliance, pour aboutir à la mauvaise, l’échange. Dans tous les cas, l’humanité est placée dans cette alternative d’être unie et ruinée, ou riche et désunie. J’avoue, Monsieur, que je ne me sens pas la force de choisir.
Si, au contraire, l’échange est d’une bonne nature économique, s’il ne s’exécute jamais qu’au profit des deux hommes ou des deux pays contractants, alors il peut être intéressant de s’assurer s’il est cause ou effet de l’alliance des peuples pour savoir à quoi il faut d’abord travailler ; mais quelque parti que nous prenions, nous aurons toujours la consolation de penser que nous travaillons à des résultats harmoniques ; [VII-155] et en vérité je ne comprendrais pas que vous poursuiviez de vos sarcasmes ceux qui veulent arriver à l’union politique par l’union commerciale, uniquement parce que vous préférez la marche inverse, alors que cette double union est le but de nos communs efforts.
Il serait donc aussi essentiel que logique de vider cette question préalable : Quelle est la vraie nature de l’échange ?
Pour cela il faudrait refaire un cours d’économie politique ; j’aime mieux m’en référer à ceux qui sont déjà faits, et je raisonnerai dans la supposition que cette nature est bonne de soi.
C’est d’ailleurs ce que vous avez fait vous-même, car vos objections viennent après cette hypothèse : « Supposez que la liberté des échanges procure aux consommateurs français trente, quarante, cinquante millions par an. »
Je ferai remarquer ici que vous affaiblissez considérablement, dans l’expression, les effets de l’échange supposé bon. Il ne s’agit pas de trente, de cinquante millions ; il s’agit de plus de pain pour ceux qui ont faim, de plus de vêtements pour ceux qui ont froid, de plus de loisirs pour ceux que la fatigue accable, de plus de ces joies domestiques que l’aisance introduit dans les familles, de plus d’instruction et de dignité personnelle, d’un avenir mieux assuré, etc. Voilà ce qu’il faut entendre par les biens matériels qui vous paraissent si secondaires.
Le libre-échange devant accroître ces biens, selon notre hypothèse, la question est de savoir s’il est nécessaire de les sacrifier à la communion des peuples dans les mêmes idées et les mêmes principes. — « S’ils doivent porter atteinte, dites-vous, à l’expansion de nos idées, à la mission de la France au sein de l’Europe, les hommes qui ont le moindre instinct soit du pouvoir, soit de la démocratie, n’y consentiront jamais. »
C’est une chose précieuse que l’expansion des idées, [VII-156] surtout quand elles sont bonnes. Cependant aux fouriéristes, communistes, démocrates, conservateurs et autres, je demanderai d’abord quel droit ils ont d’épancher au dehors leurs idées, en empêchant l’expansion de mes produits ; et, en second lieu, en quoi l’expansion de mes produits nuit à l’expansion de leurs idées ?
Est-ce sérieusement, monsieur, que vous représentez le commerce libre comme faisant obstacle à la grande mission que vous attribuez à la France ? La propagande ne se fait-elle qu’à la bayonnette ? Les principes qu’elle doit promulguer sont-ils d’une nature telle qu’on ne puisse les faire accepter que le sabre au poing ? Et la démocratie ne grandit-elle parmi nous que pour remettre en honneur le culte de la force brutale ? Vous craignez que si la France s’unit étroitement par le commerce à l’Autriche et à l’Angleterre, elle ne puisse plus se brouiller avec elles, et vous allez jusqu’à dire :
« La liberté commerciale serait grosse de tous les bienfaits qu’on lui attribue (ce que vous mettez toujours en doute) qu’il faudrait la sacrifier à ces intérêts suprêmes. » (Celui, entre autres, de la brouillerie.)
Vous avez emprunté l’idée et presque l’expression de l’Atelier. « Croyez-vous, m’écrivait-il, que la France veuille sacrifier au soin du râtelier ses causes d’animosité nationale ? »
L’Atelier et le National tiennent donc bien à guerroyer ! Ils y tiennent tellement qu’ils n’hésitent pas à sacrifier ce qu’ils appellent l’intérêt matériel à ce qu’ils nomment l’intérêt politique, c’est-à-dire, en bon français, l’aisance du peuple au maintien des brouilleries et des animosités nationales. Oublient-ils que c’est toujours le peuple qui paie de son sang et de sa bourse les frais de la guerre ? Et quel motif d’ailleurs ont les classes laborieuses françaises et russes de s’entr’égorger ? Est-ce parce que les malheureux russes sont encore soumis au régime du knout ? Faut-il les tuer pour leur apprendre à vivre ?
[VII-157]
Ce n’est pas aux travailleurs que nous en voulons, direz-vous. Ce n’est pas aux opprimés, mais aux oppresseurs, à l’autocrate russe, à l’oligarchie anglaise.
Et moi, je vous demanderai si vous avez foi dans vos idées démocratiques. Si vous y avez foi, ne parquez donc pas les peuples, laissez-les se voir, se connaître, se mêler, échanger leurs produits, qu’ils émanent de l’intelligence ou qu’ils soient les fruits de l’industrie et du travail. Laissez leurs intérêts s’entrelacer au point qu’il devienne impossible aux oligarques et aux diplomates d’embraser l’Europe, tantôt pour un lopin de désert en Syrie, tantôt pour un rocher dans le grand Océan, tantôt pour les épousailles d’un jeune prince avec une gracieuse infante. Laissez pénétrer dans les pays encore soumis au joug du despotisme nos idées, nos principes avec notre langue, notre littérature, nos arts, nos sciences, notre commerce et notre industrie. C’est là la vraie, l’efficace propagande, et non celle qui se fait à coups de canon.
Est-ce que d’ailleurs toutes les libertés ne se tiennent pas ? Ouvrez donc les yeux, et voyez ce qui se passe. Il y a six mois à peine, le monopole des céréales a été frappé en Angleterre, et déjà tous les monopoles sont ébranlés à Paris, Rome, Naples, Saint-Pétersbourg et Madrid ; déjà le système colonial s’écroule de toute part. L’Angleterre, cette orgueilleuse métropole de tant de possessions lointaines, leur rend le droit de régler leur commerce et la faculté de s’approvisionner où elles l’entendront, par quelque pavillon qu’il leur plaira de choisir. N’est-ce pas un fait immense ? Est-ce qu’il ne nous annonce pas que l’ère de la domination et de la conquête est finie pour toujours ? Je dis plus, il est aisé de voir que c’en est fait du règne funeste de l’aristocratie anglaise et de son action sur l’indépendance et les libertés du genre humain.
Car lorsque les colonies anglaises n’offriront plus à la [VII-158] métropole aucun privilége maritime, industriel et commercial, lorsque ces priviléges auront succombé non point devant un acte de philanthropie, on pourrait s’en méfier, mais devant un calcul, devant la démonstration évidente qu’ils coûtent plus qu’ils ne rapportent ; quand les ports de toutes ces dépendances seront ouverts aux échanges du monde entier ; croyez-vous que le peuple d’Angleterre ne se fatiguera pas bientôt d’entretenir seul, dans ces régions émancipées, des soldats, des flottes, des gouverneurs et des lords-commissaires ? Ainsi l’affranchissement du travail porte un double coup à l’aristocratie britannique ; car voilà qu’une seule campagne lui arrache ses injustes monopoles au dedans, et menace, au dehors, ses fiers cantonnements et ses grandes existences.
Au milieu de ces grands événements, les plus imposants, après la Révolution française, que l’Europe ait vus depuis des siècles, quelle attitude prend notre démocratie ? Il semble qu’elle veuille rester étrangère à tout ce qui se passe, et que cette chute de la plus forte aristocratie qui ait jamais pesé sur le monde, du système d’envahissement qu’elle a organisé, n’ouvre aucune chance devant nous. Que dis-je ? si sortant un moment de sa sceptique indifférence, notre démocratie daigne jeter les yeux sur ce grand mouvement social, c’est pour le nier ou en contester la portée. Par le plus étrange renversement d’idées, toutes ses sympathies sont pour les tyrans britanniques, tous ses sarcasmes, toutes ses défiances pour ces multitudes si longtemps opprimées, qui brisent le joug odieux qui pèse à la fois sur elles et sur le monde. Tantôt elle va fouiller dans les journaux torys pour y trouver un fait isolé, qu’elle exploite, pendant des mois entiers ; et ayant appris que, dans je ne sais quelle fabrique, il y avait eu une discussion entre le maitre et les ouvriers, elle se hâte de flétrir la réforme, de lui assigner pour but l’oppression des ouvriers, comme si les [VII-159] dominateurs du sol n’y avaient introduit le monopole que pour élever le taux des salaires. Tantôt, prenant un chiffre pour un autre, elle croit découvrir que l’abaissement des droits a restreint les importations, et, forte de cet argument contre la liberté, elle entonne un chant de triomphe et semble dire : Non, non, le temps des lourdes taxes, des fortifications, des arsenaux et de la conscription n’est pas près de finir !
Pour moi, j’appartiens de toutes les manières à la démocratie ; mais je ne la comprends qu’autant qu’elle inscrit sincèrement sur sa bannière : Paix et liberté. Si je voyais les hommes qui se posent comme les meneurs du parti populaire, comme les défenseurs exclusifs des classes laborieuses, si je les voyais, dis-je, repousser systématiquement tout ce qui tend à développer nos libertés et à faire régner la paix parmi les hommes, je ne me croirais pas tenu de les suivre ; mais au contraire de les avertir qu’ils s’égarent et qu’ils ont choisi un terrain qui manquera sous leurs pieds.
Il me reste à prouver que la pesanteur et la mauvaise répartition des taxes antérieures ne justifie pas le régime protecteur.
35. — À M. LE RÉDACTEUR EN CHEF DU NATIONAL [2] .↩
Monsieur,
J’ai essayé de combattre les raisons politiques que vous alléguez à l’appui du régime restrictif. Il me semble que ces raisons sont sans valeur, surtout au point de vue [VII-160] démocratique. Rejeter le bien-être des travailleurs de peur qu’il n’éloigne les chances de la guerre, repousser la liberté parce qu’elle est favorable à la paix, c’est un double machiavélisme dont la démocratie française devrait laisser l’odieux à l’aristocratie britannique. Il est étrange de voir deux éléments sociaux si divers fraterniser aujourd’hui au nom d’une si déplorable doctrine. Pour moi, quand je suis les événements du jour, quand je vois deux grandes nations prêtes à se précipiter, ou plutôt à être précipitées l’une sur l’autre par des intrigues de cour, quand je comprends que, dans ce moment même, notre sang et nos trésors dépendent d’une visite de lord Normanby, bien loin de dire :
« Arrière la liberté du commerce qui pourrait prévenir la guerre ! » je m’écrie de toutes mes forces : « Hommes de la classe laborieuse, travaillons plus que jamais à réaliser la liberté du commerce, la plus précieuse des libertés, puisqu’il est en sa puissance d’arracher le gouvernement du monde aux dangereuses mains de la diplomatie ! »
Mais pour être dévoué de cœur à la liberté des transactions internationales, il faut croire à son utilité économique, et ceci me conduit à examiner votre seconde objection, beaucoup plus spécieuse que la première. Je la reproduis textuellement :
« Prenez garde, partisans de la liberté au dehors, que vous n’ayez pas une ombre de liberté commerciale à l’intérieur. Voyez votre état social, l’assiette de vos impôts, la répartition inique des charges publiques, l’établissement de votre crédit, le mouvement de vos capitaux : tout pressure votre industrie, le travail est accablé de taxes énormes, toute denrée arrive avec des surcharges écrasantes au milieu de vos propres consommateurs… Quoi ! vous avez une organisation intérieure aussi fatale à l’industrie, des capitaux sans circulation, une propriété frappée d’immobilité, des impôts écrasant le travail et [VII-161] épargnant la rente, des octrois ajoutant au prix des subsistances et par conséquent à la main-d’œuvre ; et c’est le malheureux producteur, placé dans ces conditions détestables, que vous allez menacer de la concurrence étrangère ! »
Cette objection contre la liberté commerciale est assez spécieuse pour être présentée et accueillie de bonne foi, pour jeter du doute dans les esprits les plus sincères. J’ai le droit de réclamer pour la réponse que j’ai à y faire une sérieuse attention.
J’admets que, dans un pays donné, les impôts soient lourds et vexatoires. La question que je pose est celle-ci : Un tel état de choses justifie-t-il la protection ? Le poids des charges en est-il allégé ? Est-il sage de repousser la concurrence extérieure parce qu’elle arrive sur le marché affranchie de charges semblables ?
On voit que je n’élude ni n’affaiblis la difficulté. J’ajoute qu’elle ne se présente pas ici dans toute son étendue, et je veux mettre les choses au pire.
Il y a en effet deux sortes d’impôts, les bons et les mauvais.
J’appelle bon impôt celui en retour duquel le contribuable reçoit un service supérieur ou du moins équivalent à son sacrifice. Si l’État, par exemple, prend, en moyenne, 1 franc à chaque citoyen, et si, avec les 36 millions qui en proviennent, il fait un canal qui économise tous les ans à l’industrie 5 ou 6 millions de frais de transport, on ne peut pas dire que l’opération nous place dans une condition inférieure au peuple voisin, qui, cæteris paribus, ne paye pas les 36 millions, mais n’a pas non plus le canal. S’agit-il du fer ? Il est bien vrai qu’en raison de la taxe son prix de revient sera augmenté dans une proportion quelconque ; mais, en raison du canal, il sera diminué dans une proportion plus forte encore, en sorte que, si le maître de forges fait son compte, il [VII-162] trouvera que son fer lui coûte moins qu’avant la taxe. Or, il est évident qu’un impôt de cette nature (et tous devraient l’être) ne justifie pas une protection spéciale en faveur du fer. Il s’en passait avant la taxe, à fortiori, il peut s’en passer après.
J’appelle mauvais impôt celui qui ne confère pas au contribuable un avantage égal à son sacrifice. La taxe est détestable si le contribuable ne reçoit rien, et odieuse s’il reçoit en retour, comme cela s’est vu, une vexation. Il n’est pas sans exemple qu’un peuple ait payé pour être opprimé, et qu’on lui ait arraché son argent pour lui ravir sa liberté. Quelquefois la taxe est pour lui le châtiment d’anciennes folies. En ce moment, chaque Anglais paye 25 francs par an et chaque Français 6 francs, pour les frais d’une guerre acharnée, qui, à ce qu’il me semble, n’a pas fait grand’chose pour l’expansion des idées et la communion des principes. Il est permis de croire que vingt ans de paix y eussent servi davantage.
Eh bien ! j’admets que cette dernière nature d’impôts pèse sur le pays F, tandis que le pays A en est exempt. Je raisonne dans cette hypothèse par déférence pour la logique, car, en fait, on aurait de la peine à citer un pays où les classes laborieuses ne payent pas d’impôts ou n’en payent que de bons.
Voilà donc tous les citoyens de F, et particulièrement les travailleurs, chargés de lourdes contributions. Dans ce pays, que nous supposons commercialement libre, on m’accordera, j’espère, qu’il se produit quelque chose. Mettons que ce soit du fer et du blé, que chaque quintal de fer, comme chaque hectolitre de blé, revienne à 15 francs sans la taxe, et à 20 francs avec la taxe.
Dans ces circonstances, les maîtres de forges adressent cette pétition aux Députés :
« Messieurs, nous, nos fournisseurs et nos ouvriers, nous [VII-163] succombons sous le poids des impôts. Notre industrie en souffre, tandis qu’elle prospérerait à ravir si vous daigniez nous dégrever. Néanmoins, sachant que votre intention n’est pas de lâcher prise d’un centime, tout ce que nous vous demandons, c’est de décharger notre cote contributive et de charger d’autant celle de nos compatriotes qui ne font pas de fer, par exemple, les laboureurs. »
Ceux-ci ne seront-ils pas fondés à contre-pétitionner en ces termes :
« Honorables députés, les maîtres de forges se plaignent de payer beaucoup de taxes ; ils ont raison. Ils disent que cela nuit à leur industrie ; ils ont encore raison. Mais ils vous demandent que leur part du fardeau soit ajoutée à celle que nous portons comme eux ; en cela, ils ont tort. »
Les maîtres de forges ne se tiennent pas pour battus. Ne pouvant pas faire passer, sous une forme par trop naïve, une injustice aussi criante, ils imaginent une combinaison plus rusée et font aux députés cette nouvelle adresse :
« Messieurs, — nous reconnaissons que le moyen que nous avons indiqué pour nous dégrever de notre part d’impôt était inadmissible. Il avait le tort, non point d’être injuste, mais de laisser trop clairement apercevoir l’injustice. Les laboureurs l’ont aperçue et notre plan a échoué. Mieux avisés, nous venons vous en proposer un autre, tendant aux mêmes fins, et auquel, à ce que nous espérons, nos revêches co-contribuables ne verront que du feu. Ainsi que nous avons eu l’honneur de vous l’exposer, nous sommes, comme eux, accablés de taxes. Nous avons calculé que cela monte à 5 francs, par chaque quintal de fer, que la concurrence étrangère nous force à vendre à 20 francs, d’où il suit qu’il ne nous reste que 15 fr. — Chassez le fer étranger ; nous vendrons le nôtre 25 francs, peut-être 30. Ce sera comme si nous ne payions plus la taxe ; mais vous [VII-164] n’y perdrez rien, puisqu’elle se trouvera naturellement repassée sur le dos des acheteurs de fer, de ces bons laboureurs qui, sans s’en douter, payeront leur part et la nôtre. Nous aurons même la chance de réaliser, en fin de compte, si nous vendons au-dessus de 25 francs, un boni à leurs dépens. »
J’ai quelques raisons de penser que cette ruse pourrait avoir du succès à la Chambre. Qui sait si elle n’y exciterait pas une noble émulation et si le laboureur ne se coaliserait pas avec le maître de forges, pour s’emparer, lui aussi, de cet ingénieux moyen de se débarrasser de sa taxe en la rejetant sur d’autres, tels que armateurs, artisans, etc.
Mais, en supposant qu’ils veuillent rester sur la défensive, si ces braves laboureurs y voyaient plus loin que leur nez, ils devraient, ce me semble, s’empresser de répondre :
« Messieurs les Députés, — la nouvelle combinaison présentée par les maîtres de forges ne diffère en rien de la première. Que nous acquittions, à leur décharge, 5 francs au fisc, ou que nous leur payions le fer 5 francs de plus, cela revient absolument au même pour eux et pour nous. Si nous n’avions pas nous-mêmes à payer 5 francs de taxe par hectolitre de blé, la chose serait proposable ; mais ce que l’on veut, c’est ceci : que les laboureurs payent 10 francs, et les maîtres de forges rien du tout, — à quoi, si nous avons le moindre instinct de la justice et de notre dignité, nous ne consentirons jamais. »
Supposons maintenant que la Chambre passe outre et décrète la protection. Les impôts dont vous vous plaignez avec raison n’en seraient pas moins lourds ; seulement ils seraient autrement répartis ; une iniquité évidente serait consommée dans le pays, et le mal ne s’arrêterait pas là.
Ce vote désastreux changerait les conditions des deux industries métallurgique et agricole. L’une deviendrait lucrative relativement à l’autre. Le travail et les capitaux auraient [VII-165] une forte tendance à déserter celle-ci pour se porter vers celle-là. On ferait plus de fer et moins de blé ; et, veuillez remarquer ceci, les nouvelles usines s’établiraient dans des situations défavorables jusqu’à ce que le moment arrivât où, vendant le fer à 25 francs, elles ne gagneraient pas plus que les anciennes ne faisaient avec le prix de 20 francs. — C’est un très vaste point de vue, il va au cœur de la question et je le livre à votre sagacité.
Ne nous méprenons donc pas sur la nature et les effets de la protection. Les impôts directs et indirects étant répartis tant bien que mal, à quelque nombre de millions ou de milliards qu’ils s’élèvent, quel que soit l’emploi bon ou mauvais qu’on en fasse, la population n’est pas soulagée d’une obole par cela seul que les diverses industries se les repassent les unes aux autres. N’oublions pas d’ailleurs qu’il y a un nombre considérable de professions, et les plus démocratiques, qui sont par leur nature dans l’impossibilité radicale de prendre part à ce jeu, si ce n’est pour y perdre. Tel est, en première ligne, le travail manuel dont la rémunération est le salaire.
Si les taxes sont mal réparties, qu’on change la répartition ; rien de mieux. Si elles sont mal employées, qu’on les supprime ; d’accord. Mais tant qu’elles existent, tant qu’elles versent au trésor quinze cents millions, n’allons pas nous imaginer que c’est un prétexte raisonnable, encore moins une raison légitime, de diminuer la part de Jean en augmentant celle de Pierre ; et c’est là tout ce que fait et peut faire la protection. Que si Pierre obtient le même privilége, la taxe va toujours s’accumulant sur d’autres professions et particulièrement sur celles qui ne peuvent recevoir la protection douanière.
Un peuple surchargé d’impôt perd, j’en conviens, une partie de ses forces. Mais, sous l’empire du libre-échange, il a du moins la ressource de tirer le meilleur parti possible [VII-166] de celles qui lui restent. Ses taxes agissent comme tout autre obstacle naturel. Le pays F est faible relativement au pays A, comme si sa terre était moins féconde ou sa population moins vigoureuse. C’est un malheur, je le sais, mais un malheur sur lequel le régime restrictif agit comme aggravation, non comme compensation.
L’illusion à cet égard provient de ce que, comparant sans cesse le peuple taxé au peuple non taxé, on reconnaît à celui-ci des éléments de supériorité ; — et qui en doute ? Ce qu’il faut comparer, c’est le peuple taxé à lui-même sous les deux régimes, celui de la restriction et celui de la liberté.
Il y avait, aux environs de Paris, un hospice pour les aveugles. Ils travaillaient les uns pour les autres et ne faisaient des échanges qu’entre eux. Leur pitance était chétive, car ils étaient condamnés à exécuter des travaux bien difficiles et bien longs pour des aveugles. Le directeur de l’établissement leur donna enfin la liberté d’acheter et de vendre au dehors. Leur bien-être s’en augmenta progressivement, non pas jusqu’à égaler celui d’hommes clairvoyants, mais du moins jusqu’à dépasser de beaucoup ce qu’il était du temps de la restriction.
P. S. Le National dit aujourd’hui qu’il n’a pas trop su démêler à qui et à quoi je réponds. Me serais-je mépris sur le sens et la portée de son opposition au libre-échange ? Veut-il, comme nous, que l’entrelacement des intérêts unisse les classes laborieuses de tous les pays de manière à déjouer les calculs pervers ou imprudents de l’aristocratie ? Oh ! Dieu le veuille ! Je serais heureux de reconnaître mon erreur, et de voir avec nous, au moins sous ce rapport, un journal qui s’adresse à des hommes sincères et convaincus.
[VII-167]
36. — LE ROI LIBRE-ÉCHANGISTE [1] .↩
Déclamez donc contre les journaux ! Plaignez-vous de ce qu’ils sont aussi peu intéressants qu’instructifs ! quelle calomnie ! Pour nous, nous y trouvons à chaque instant des choses inattendues, surprenantes, merveilleuses.
Par exemple, l’Impartial de Rouen nous révèle qu’un haut personnage est libre-échangiste. Ce personnage, l’Impartial ne le nomme pas, car il craint la charte et les lois de septembre. Or, dire de quelqu’un qu’il est libre-échangiste, c’est, aux yeux de la feuille Normande, lui faire une mortelle injure.
Nous qui n’avons pas les mêmes raisons d’interpréter ainsi la charte, et qui pensons qu’on peut, sans se déshonorer, préférer, en fait de trocs, la liberté aux entraves, nous ne craignons pas de dire, à nos périls et risques, que le personnage dont il s’agit n’est autre que Louis-Philippe, roi des Français.
Le Roi est donc libre-échangiste. C’est de Rouen qu’en vient la nouvelle. Jusqu’ici rien ne nous l’avait fait soupçonner, et nous devons même confesser, peut-être à notre honte, que nous n’avons pas songé à nous en informer. Quelquefois, il est vrai, quand il a plu au caprice de ces rêves, que l’on nomme châteaux en Espagne, de placer sur notre tête la couronne de France, (car
Au moins quelques instants qui n’est roi dans ses rêves ?)
nous nous rappelions ce vers touchant :
Si j’étais roi, je voudrais être juste.
Et nous nous disions :
« Nos sujets disposeraient [VII-168] librement du fruit de leurs sueurs ; des restrictions ne seraient pas imposées au Midi pour l’avantage du Nord, ni au Nord pour l’avantage du Midi. Nous voudrions que chaque citoyen, pour améliorer son sort, comptât un peu plus sur lui-même et un peu moins sur la caisse publique. Nous voudrions que l’État fût déchargé de l’effrayante responsabilité qu’il assume en entreprenant de pondérer toutes les industries. Nous voudrions que la vie de notre peuple fût douce et facile ; qu’aucun obstacle ne s’interposât entre la source voisine et sa lèvre altérée. S’il ne lui était pas donné d’échapper à toutes les souffrances, nous voudrions du moins qu’il ne lui en fût infligé aucune par notre administration. Nous voudrions que la liberté des transactions fût pour lui le gage le plus assuré de la paix. Alors nous pourrions rendre à la ferme et à l’atelier ces jeunes hommes dont les familles pleurent l’absence. Alors nous pourrions supprimer toutes les taxes qui pèsent sur les malheureux… »
Ces idées nous venaient trop naturellement, à nous, roi chimérique, pour que nous n’admettions pas qu’elles puissent se présenter aussi à l’esprit des rois sérieux, comme on dit aujourd’hui. Si donc nous sommes resté dans l’indifférence à l’endroit des opinions économiques de l’auguste personnage, c’est que, selon nous, dans le siècle où nous sommes, le libre-échange, comme toutes les grandes choses, est un fruit qui mûrit dans les régions populaires de l’opinion publique et non dans les palais des rois.
Mais enfin il n’est pas indifférent d’avoir, même sans s’en douter, des monarques pour alliés. Aussi nous nous réjouirions de la nouvelle qui nous arrive de Rouen, si elle était fondée sur autre chose que sur une conjecture fort hasardée.
D’où l’Impartial l’a-t-il tirée ? Voici comment lui-même raconte la chose :
En 1789, Philippe-Égalité fut envoyé en mission à [VII-169] Londres. Selon quelques lambeaux de correspondance arrangés par l’Impartial avec toute l’impartialité que son titre lui impose, il paraîtrait que Pitt s’empressa de faire du prince un libre-échangiste, et lui montra en perspective la couronne des Pays-Bas, s’il obtenait la liberté absolue du commerce entre la France et l’Angleterre. Le prince écrivit donc à M. de Montémolin : « Je crois la liberté absolue avantageuse aux deux nations, mais je ne crois ni l’une ni l’autre assez éclairées pour adopter ces grands principes. » Cependant il offrait de travailler à un traité qui s’en rapprochait le plus possible.
Or, vous le savez, en langue protectioniste, rendre à deux nations la liberté de troquer, c’est vendre l’une à l’autre. Il est donc clair que Philippe-Égalité était un traître. Cet homme, dit l’Impartial, trahissait la France et méditait de livrer son commerce à l’Angleterre… » et cela pour être fait roi des Pays-Bas.
Comprenez-vous maintenant ? — Quoi donc ? — Comprenez-vous pourquoi Louis-Philippe ne peut être qu’un libre-échangiste ? — Pas le moins du monde. Est-ce que lord Palmerston a aussi promis au roi des Français la couronne des Pays-Bas contre la liberté absolue du commerce ? — L’Impartial ne le dit pas, mais il le faut bien, car, sans cette identité de motifs, comment la feuille rouennaise pourrait-elle conclure de la politique du père à la politique du fils ? — Morbleu ! parlez-moi de l’art de tirer habilement les conséquences des choses [2] !
References
[1] Libre-échange du 30 mai 1847. (Note de l’éd.)
[2] On a vu, dans un grand nombre des articles qui précèdent, et notamment aux numéros 10 à 12, 14 à 16, 19 à 21, 25, 27, 28, 32 à 36, les premiers efforts de l’auteur pour amener les journaux français à l’étude des vérités économiques, et au respect de la liberté, sous toutes ses formes. La continuation des mêmes efforts est présentée, au tome II, dans les numéros 16 à 29. (Note de l’édit.)
[VII-170]
37. — DISCOURS À LA SALLE DUPHOT [1] .↩
Messieurs,
Je regrette que, dans son excessive indulgence, notre digne président ait cru devoir m’introduire auprès de vous sous une forme qui vous fera peut-être attendre de moi un discours brillant. Mon intention est simplement de vous soumettre quelques réflexions à l’occasion des comptes qui viennent de vous être présentés, et qui me semblent féconds en utiles enseignements.
Dans une position analogue à celle où se trouvent le conseil et celui qui parle maintenant en son nom, il est de tradition de faire grand étalage des succès obtenus, et de montrer l’avenir sous les couleurs les plus flatteuses. Je ne saurais suivre cet exemple, et je parlerai avec une entière franchise de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire, de nos difficultés et de nos espérances. D’ailleurs, le seul fait que le conseil vient vous exposer un compte financier qui n’a rien de brillant, vous prouve qu’il est décidé à agir toujours avec la plus parfaite sincérité.
Vous l’avez vu, les recettes se sont élevées, pour Paris, à 25 000 francs. Pardonnez-moi ce trait de statistique ; sur une population d’un million d’habitants, c’est 2 c. 1/2 par personne. Certes, si nous venons à nous rappeler que nous sommes ici dans la ville la plus intéressée qu’il y ait au monde à la liberté commerciale, celle que le génie de ses habitants met au-dessus de toute rivalité étrangère, celle qui a tout à gagner en richesse et en influence intellectuelle à [VII-171] la libre communication des peuples, celle qui s’épuise en efforts inouïs pour jeter vers nos frontières des lignes de fer qui n’y doivent rencontrer que la barrière de la prohibition, la ville enfin qui a été, en Europe, le berceau de toutes les libertés, on peut s’étonner à bon droit que sa sympathie pour la liberté d’échanger ne se soit manifestée que par une coopération aussi modique.
Mais si la liste de nos souscripteurs n’est pas très-longue, elle présente des noms bien faits pour relever notre confiance. Elle vous a été lue. Je n’y reviendrai pas. Je dirai seulement que notre seconde liste, ouverte le 10 mai, présente déjà des adhésions nouvelles et importantes.
Le compte des dépenses n’est pas moins instructif. Elles s’élèvent en tout à 18,000 francs ; savoir : 9,000 pour le journal, et 9,000 pour tout le reste.
Le premier acte de toute œuvre de propagande est la fondation d’un journal. Un journal, c’est la vie, la pensée, le lien, l’organe de toute association. Quelle que fût l’importance des autres moyens que nous aurions désiré mettre en œuvre, nous devions les subordonner tous aux ressources qui nous resteraient après que l’existence de notre journal serait assurée. Or, vous le savez, Messieurs, le cautionnement, le timbre, la poste rendent ces entreprises difficiles. Rien n’est devenu plus hasardeux en France que la fondation d’un journal depuis l’invention de la presse à bon marché, depuis qu’elle est constituée sur ce singulier cercle vicieux : Voulez-vous des abonnés, ayez préalablement des annonces ; voulez-vous des annonces, ayez préalablement des abonnés. Aussi, même en y consacrant la moitié de nos ressources, nous n’aurions pu venir à bout de cette œuvre sans le concours efficace de Bordeaux, Marseille et Lyon.
C’est donc 9,000 francs qui nous sont restés pour faire face à tous nos autres moyens de propagande. De cette somme, veuillez déduire par la pensée les frais accessoires, achat de [VII-172] mobilier, loyer, appointements, frais de bureau, et si vous vous rappelez que nos travaux remontent au mois de mars 1846, vous reconnaîtrez que nous avons dû nous trouver bien limités dans notre action.
Aussi, Messieurs, nous avouons sincèrement que nous n’avons pas fait tout ce que les amis de la liberté commerciale pouvaient attendre de nous. Mais, en tenant compte de l’obstacle dont je viens de parler, et de bien d’autres encore qui se sont rencontrés sur notre route, est-il exact de dire que rien n’a été fait ?
Dans l’espace d’un an, une vaste association s’est fondée. Si elle ne s’est pas manifestée au dehors par une action aussi énergique qu’on aurait pu le désirer, elle a du moins achevé tout le travail de son organisation intérieure. Disséminée dans de grands centres de population fort éloignés les uns des autres, Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, elle a ramené toutes ces sociétés affiliées à une action uniforme et concentré en partie leurs ressources dans un but commun.
Nous nous sommes mis d’accord sur notre déclaration de principe. C’est par là qu’il fallait débuter, car une association ne vit que par son principe. Cette première manifestation n’avait rien de difficile.
Il l’était davantage de formuler l’application du principe à toutes les questions spéciales, car, en voulant, en définitive, la même chose, on diffère souvent sur la durée et le mode de la transition, l’ordre et la priorité des réformes. Nous nous sommes mis d’accord sur tous ces points délicats, et si cette discussion a absorbé une portion notable de notre temps, nous avons enfin un programme que nous pouvons montrer à nos amis et à nos ennemis.
Nous avons réussi à faire accueillir par la population l’exposition publique de nos doctrines. C’était un essai que beaucoup de personnes jugeaient hasardeux. Sept séances ont attiré de plus en plus d’auditeurs à la salle Montesquieu. [VII-173] Nous pouvons donc dire que cet important essai a complétement réussi. En m’exprimant ainsi, je ne fais pas allusion au mérite qui a pu se déployer sur l’estrade. Il ne m’appartient pas de le juger. Je veux parler de ce qui est bien plus important à mes yeux, de cette attention soutenue, de ce sentiment exquis des convenances qui se sont constamment manifestés dans l’auditoire, et qui font du public parisien le premier public du monde.
Cet exemple portera ses fruits en province ; et il est bien acquis maintenant que nous pourrons, sans compromettre le principe de l’association en France, continuer et développer ce moyen de propagande.
Enfin, nous avons établi un journal que les quatre associations sont résolues à maintenir.
Messieurs, fonder quatre associations, toutes pourvues d’une bonne organisation, toutes liées entre elles par le même principe et par une étroite sympathie, s’accorder sur l’exposition de la doctrine et sur la marche pratique des réformes à demander, faire une heureuse expérience de l’enseignement public, établir un journal hebdomadaire, n’est-ce rien pour une première année ?
On demande : Où sont les résultats ? Et quand nous n’aurions d’autres résultats à vous présenter que de nous être préparés à en recueillir, pourrions-nous être accusés d’avoir perdu notre temps ? Nous avons à faire une longue et difficile navigation. Le vaisseau est construit, appareillé, monté d’un bon équipage, il est prêt à faire voile ; il n’attend plus qu’un peu de brise ; elle ne lui manquera pas. (Bien ! bien !)
Mais je vais plus loin, et j’affirme que des résultats ont été déjà obtenus.
Le premier de tous a été de soulever l’opposition des intérêts qui exploitent ou s’imaginent exploiter la protection. Ces intérêts ont fait tout ce qu’ils pouvaient faire ; ils ont [VII-174] épuisé tous leurs sophismes, dépensé toutes leurs munitions. Associations, cotisations, pétitions, écrits, menaces, nos adversaires ont tout mis en œuvre, et à quoi ont-ils abouti ? Remarquez bien ceci : Il y a deux ans, ils dominaient le présent et se croyaient maîtres de l’avenir. Aujourd’hui ils sont partout sur la défensive. Alors, ils n’avaient que cette question à se faire : Quelle nouvelle restriction allons-nous imposer au public ? Maintenant ils se demandent : Quelle restriction pouvons-nous sauver du naufrage ?
N’est-ce rien, Messieurs, que d’avoir ainsi déplacé le terrain de la discussion ? d’avoir organisé la partie de telle sorte que ce n’est plus désormais une liberté, mais une restriction qui en fera l’enjeu.
Et permettez-moi de rappeler ce que je disais, il y a quinze mois, à Bordeaux, à une époque où des mesures récentes sur le sésame et les tissus de lin donnaient peut-être quelque valeur à la prédiction : on était au moment d’ouvrir la souscription qui devait décider du sort de l’Association.
« Dans deux heures, disais-je, nous saurons si le mouvement ascensionnel de la protection est arrêté ; si l’arbre du monopole a fini sa croissance. Oui, que Bordeaux fasse aujourd’hui son devoir, — et il le fera, — je défie tous les prohibitionistes, et tous leurs comités, et tous leurs journaux, de faire désormais hausser le chiffre des tarifs d’une obole ! »
Eh bien ! Messieurs, qu’est-il arrivé ? Comparez la loi de douanes actuellement soumise aux Chambres, toute timide, toute mesquine qu’elle est, aux mesures sanctionnées jusqu’ici par la législature. N’êtes-vous pas frappés de ce fait, que le régime protecteur non seulement n’avance plus, mais recule ? (C’est vrai !)
Un autre résultat que nous avons obtenu, et il est considérable, c’est qu’aujourd’hui on peut prononcer le mot Liberté du commerce. On oublie vite en France. [VII-175] Rappelons-nous néanmoins qu’il y a quelque temps ce mot aurait attiré sur le député, assez malheureux pour s’en servir, un torrent d’invectives. Les protectionistes, voulant dépopulariser la chose, avaient été assez habiles pour dépopulariser le nom. Un homme très haut placé, un pair de France, ancien ministre, sincère ami du libre-échange, me disait, il y a quelque temps :
« Je ne combats jamais le monopole de front, je lui emprunte ses arguments. Le seul moyen de mater un nouveau privilége, c’est de montrer qu’il compromet un privilége ancien. Invoquer la liberté par le temps qui court, c’est la compromettre ! »
Grâce au ciel, ces ruses ne sont pas aujourd’hui nécessaires, et l’on peut, avec un peu de courage, avoir raison sans rougir. J’avoue qu’il est assez triste d’avoir à présenter ce résultat comme un succès.
Nous en avons obtenu un autre bien propre à nous donner des espérances, c’est de fournir à une foule d’hommes éclairés, disséminés sur toute la surface du royaume, l’occasion de se faire connaître et d’entrer bravement dans la lutte. M. Duchevalard à Montbrison, M. Avril à Nevers, M. Godineau à la Rochelle, M. Duvergé à Limoges, M. Darthez à Pau, M. Dufrayer à Mont-de-Marsan, M. d’Haqueville à Lisieux, et bien d’autres encore, ont déjà exercé autour d’eux une influence qui est de bon augure. Ce sont là de précieux auxiliaires, et ils nous font pressentir qu’à la fin de cette campagne, l’Association, au lieu de quatre comités en province, en comptera douze.
Quelques personnes s’effrayent de l’espèce d’unanimité avec laquelle les sociétés d’agriculture, sur la provocation de nos adversaires, se sont prononcées contre nous ; mais qu’on veuille bien remarquer une chose : ce qu’elles paraissent redouter surtout, ce n’est pas la réforme, mais la réforme instantanée. Au fait, après s’être élevées contre la liberté du commerce, toutes concluent à des abaissements graduels du tarif.
[VII-176]
Enfin, Messieurs, nous pouvons affirmer, sans trop de présomption, que notre entreprise a éveillé quelque sympathie chez les nations voisines. Des sociétés de Libre-Échange se sont fondées en Espagne, en Italie, en Belgique, en Prusse. Sans doute, les idées favorables à la libre communication des peuples existaient dans ces pays ; mais peut-être notre exemple a-t-il contribué à les mettre en action. Nous savons bien que ce qui s’est passé en Angleterre a eu une grande influence, et cependant nous avons ici une preuve de plus que c’est toujours la France qui a le noble privilége de rendre les questions européennes, et nous avons lu dans un manifeste italien ces propres paroles : « La Ligue anglaise a soulevé une question anglaise ; elle a combattu un obstacle anglais, les encorn-laws. L’Association française aura la gloire d’avoir posé la question universelle, la question de principe, dans son titre même, le Libre-Échange. » (Applaudissements prolongés.)
Notre président vient de vous dire que l’Association belge a conçu la pensée de réunir, à Bruxelles, un congrès économique, où cette grande question sera traitée dans une assemblée composée d’hommes de toutes les nations.
Français, Anglais, Belge, Russe, Germain.
Oh ! ce sera un grand et magnifique spectacle que celui d’hommes venus de tous les points du globe pour discuter paisiblement l’utilité et l’opportunité de renverser, par la seule puissance de l’esprit public, les barrières qui les séparent. Et il me semble que ce qui doit sortir de là, c’est la réalisation de ce vœu national, exprimé, il y a déjà longtemps, par le grand interprète de la pensée française :
Peuples, formez une sainte alliance,
Et donnez-vous la main.
(Bravo.)
[VII-177]
Mais si quelque chose a été fait, il reste certainement beaucoup plus à faire.
Quand on entreprend de réaliser un grand changement dans une des branches de la législation du pays, non par la force, mais par la conviction publique, on se soumet à traverser quatre phases :
La première est celle de l’organisation. Il est indispensable de constituer d’abord l’Association qui doit donner le mouvement. Tel a été le travail de notre première campagne.
La seconde est celle de la propagande. Il faut bien former cette conviction publique dont on entend faire son seul instrument de succès. Et, dans cette période, tous les soins de l’Association doivent tendre à perfectionner et propager son organe. Son mot d’ordre doit être : Aux abonnements ! aux abonnements ! Il n’est pas un de nos collègues qui ne doive s’imposer le devoir de décider à s’abonner tous ceux de ses amis dont les opinions sont encore incertaines.
À mesure que la conviction se forme dans le pays, il faut l’amener à manifester ses progrès, en exerçant une pression de plus en plus forte sur la législature. Le mot d’ordre de cette période est : Aux pétitions ! aux pétitions !
Enfin, si la législature résiste, il faut se servir du changement de l’opinion publique pour changer par elle la législature elle-même, et alors le mot d’ordre est : Aux élections ! aux élections !
Et n’oublions pas que, si notre mot d’ordre peut varier à chaque période de notre agitation, il en est un qui doit toujours dominer, c’est celui-ci : Aux souscriptions ! aux souscriptions ! (Très bien !)
Sans doute. Messieurs, nous ne renonçons pas à user d’ores et déjà et simultanément de ces trois moyens d’action. Nous ferons des pétitions quand cela sera nécessaire, et nous interviendrons dans les élections toutes les fois que nous pourrons le faire avec avantage. (Adhésion.)
[VII-178]
Mais ne l’oublions pas, l’œuvre spéciale de la prochaine campagne, et peut-être de plusieurs années, c’est la propagande. Animer les convictions sympathiques, raffermir les convictions chancelantes, ramener les convictions hostiles, parler, écrire, discuter, donner une grande publicité à tous les travaux de mérite qui surgiront, soit dans la capitale, soit dans les provinces, spécialement à ceux qui se distingueront par la verve et la clarté, organiser des comités dans les départements, correspondre avec eux, les visiter ; telle est pendant longtemps notre laborieuse mission.
Associez-vous énergiquement à cette tâche, Messieurs, et soyons bien convaincus d’une chose, c’est que, s’il est un pays, une ville, appelés plus que tous autres à recueillir en bien-être, en influence morale et politique, les fruits de la libre circulation des produits et des idées, cette ville c’est Paris, ce pays c’est la France. (Applaudissements.)
References
[1] Libre-échange du 13 juin 1847.(Note de l’éd.)
38. — PROJET DE DISCOURS LIBRE-ÉCHANGISTE À PRONONCER À BAYONNE [1] .↩
Messieurs,
Mon intention est de soumettre à votre examen quelques vues générales sur la liberté du commerce. En cela, je m’écarterai des conseils que m’ont donnés mes amis. On m’a dit souvent :
« Partout où vous aurez occasion de parler, traitez la question au point de vue des intérêts de vos [VII-179] auditeurs. »
Pour moi, je me suis aperçu que ce qui préoccupe la plupart des hommes, dans l’opposition qu’ils font au libre-échange, ce n’est pas autant leurs intérêts privés que l’intérêt général. Cela est vrai surtout dans les villes de commerce. Là on comprend parfaitement que la liberté des échanges en multiplierait le nombre. Plus d’échanges, c’est plus de consignations, de commissions, de transports, de fret, de négociations, de courtages, de magasinages ; c’est plus d’affaires, plus de travail pour toutes les classes de la population. Si, malgré ces avantages évidents, les villes de commerce sont lentes à se rallier à notre cause, il faut bien qu’elles soient retenues par des considérations d’un autre ordre. Elles peuvent se tromper, je crois sincèrement qu’elles se trompent ; mais leur erreur même témoigne hautement qu’elles ne cèdent pas à un sentiment égoïste ainsi qu’on le répète sans cesse.
Si je voulais prendre mes démonstrations dans des circonstances locales, quelle ville pourrait m’en fournir de plus puissantes ? Ces jours-ci je considérais l’Océan de la pointe de Latalaye. Je voyais, à ma droite, la côte de France dans la direction de Bordeaux, et, à ma gauche, la côte d’Espagne jusqu’au cap Saint-Vincent. Je me disais : Est-il possible que cette économie politique soit la vraie qui nous enseigne que tous les échanges que Bayonne fait avec une de ces côtes sont d’une nature différente de ceux qu’elle fait avec l’autre ? Je voyais l’embouchure de la Bidassoa et je me disais : Quoi ! tous les hommes qui vivent sur la rive gauche de ce ruisseau ont avantage à échanger vers le couchant, et ils ne pourront échanger vers le levant sans se nuire à eux-mêmes ! Ce sera précisément le contraire pour ceux qui sont nés sur la rive droite ! Les uns et les autres devront s’estimer heureux que la loi soit venue détruire ces facilités de transactions que la rivière et la mer leur ont préparées ! Me tournant vers l’embouchure de l’Adour, je [VII-180] me disais : Pourquoi n’est-ce pas à cette limite, plutôt qu’à celles de la Bidassoa, que les échanges commencent à devenir funestes ! Quelle est donc cette économie politique qui, comme dit Pascal, est vérité au delà d’un fleuve, et mensonge en deçà ? L’échange n’a-t-il pas une nature qui lui soit propre ? Est-il possible qu’il soit utile ou funeste selon le caprice de ces délimitations arbitraires ? Non, un tel système ne peut être la vérité. L’intelligence humaine ne peut pas accepter à jamais de pareilles inepties.
Cependant, quelque absurde que soit au premier coup d’œil cette économie politique de la restriction, elle s’appuie sur des arguments spécieux, puisqu’enfin elle a prévalu dans les esprits et dans les lois. Je ne puis aujourd’hui réfuter tous ces arguments. Je m’attacherai à un de ceux qui m’ont paru faire le plus d’impression. C’est celui que l’on tire de la supériorité des capitaux anglais. Je choisis ce sujet, parce qu’il me conduira à examiner aussi les fondements de l’opposition que le parti démocratique paraît être décidé à faire à la liberté du commerce.
On dit : « Nous voulons bien lutter contre les autres peuples, mais à armes égales. S’ils nous sont supérieurs, soit par les dons de la nature, soit par l’abondance et le bon marché des capitaux, ils nous écraseront. Ce ne sera plus de la concurrence, ce sera du monopole en leur faveur contre nous. »
Dans ce raisonnement on oublie une chose. C’est l’intérêt du consommateur national. La supériorité de l’étranger, de quelque nature qu’elle soit, se traduit en bon marché du produit, et le bon marché du produit est tout au profit non du peuple vendeur, mais du peuple acheteur. Cela est vrai des capitaux. Si les Anglais se contentent de tirer 2 pour 100 des capitaux engagés dans leurs usines, ou même si ces capitaux sont amortis, ils chargent d’autant moins le prix du produit, circonstance qui profite exclusivement à celui [VII-181] qui l’achète. C’est une des plus belles et des plus fécondes harmonies de l’ordre naturel des sociétés, harmonie dont les protectionistes ne tiennent pas compte, parce qu’ils ne se préoccupent jamais du consommateur, mais seulement du producteur national.
Eh bien ! je veux me placer à leur point de vue et examiner aussi l’intérêt producteur.
À ce point de vue, la supériorité des capitaux étrangers est un désavantage pour nous.
Mais on m’accordera sans doute que ce serait un bien triste et bien absurde remède que celui qui se bornerait à paralyser dans nos mains le peu de capitaux qui s’y trouvent.
Or c’est là ce que fait le régime protecteur.
Nous nous plaignons que la somme de nos capitaux ou le capital national est faible. Et que fait ce régime ? Il nous astreint à en prélever, pour chaque entreprise déterminée, une portion plus grande que celle qui serait nécessaire sous le régime de la liberté.
Qu’un Anglais fonde en Angleterre une fabrique et qu’un Français veuille établir en France une usine parfaitement identique. En dégageant par la pensée ces opérations de toutes autres circonstances, et ne tenant compte que du régime protecteur, comme il faut le faire pour en apprécier les effets, n’est-il pas vrai que le Français sera obligé, à cause de ce régime, de se pourvoir d’un capital fixe plus considérable que celui de l’Anglais, puisqu’il ne peut pas, comme l’Anglais, aller chercher ses machines partout où elles sont à meilleur marché ? N’est-il pas vrai qu’il en sera de même du capital circulant, puisque ce régime a pour effet et même pour but d’élever le prix de toutes les matières premières ? Ainsi vous vous plaignez de ce que le Français éprouve déjà le désavantage de payer son capital à 5 pour 100 quand l’Anglais ne le paye que 3 pour 100 ; et que faites-vous pour compenser ce désavantage ? Vous obligez le Français à [VII-182] emprunter 400,000 francs pour faire ce que l’Anglais fait avec 300,000 !
Il en est de même en agriculture.
Ou ce qu’on appelle protection à l’agriculture n’a aucun effet, ou elle a pour effet d’élever le prix des produits agricoles. Cela posé, j’ai un champ qui me donne en moyenne 100 francs par an nets. Je puis le vendre pour 2,000 francs. Si, par l’effet du régime protecteur, j’en tire 150 francs, je le vendrai 3,000 francs. — Or voyez ici les conséquences du système. Une fois que j’ai vendu mon champ, ce n’est pas l’agriculture, c’est moi capitaliste qui recueille tout le profit. Le nouveau propriétaire n’est pas enrichi par le système ; car, s’il tire 150 francs au lieu de 100, il a payé 3,000 francs au lieu de 2,000. Le fermier n’est pas plus riche non plus, car, s’il vend le blé un peu plus cher, il paye un fermage de 150 au lieu de 400. Et, quant au manouvrier, il paye le pain plus cher, voilà tout. En définitive l’opération se résume ainsi : La loi fait un cadeau de 50 francs de rentes que le public paye sous forme de cherté du pain.
Et maintenant qu’il s’agisse de faire une entreprise agricole. Il est bien clair que l’entrepreneur aura besoin d’un capital plus fort. S’il achète la terre, il faut qu’il la paye 3,000 francs au lieu de 2,000. S’il la prend à bail, il faut qu’il paye 150 au lieu de 100. Il se refera sans doute en rançonnant à son tour le public par le prix du blé. Mais toujours est-il qu’une entreprise identique exige de lui un capital plus considérable. C’est ce que je voulais prouver.
Le commerce n’échappe pas à cette nécessité. J’en ai eu une preuve bien convaincante à Marseille. Un constructeur de navires à vapeur et en fer, qui a obtenu l’autorisation de travailler à l’entrepôt, c’est-à-dire avec des matériaux étrangers, à la charge de réexporter, avait fait un superbe bâtiment. Un acquéreur se présente. Combien voulez-vous de votre navire ? dit-il au constructeur. — De quel pays [VII-183] êtes-vous ? répond celui-ci. — Que vous importe, pourvu que je vous paye en monnaie française ? — Il m’importe que si vous êtes Français, le navire vous coûtera 300,000 francs, si vous êtes Génois, vous l’aurez pour 250,000. — Comment cela se peut-il ? dit l’acquéreur qui était Français. — Oh ! dit le vendeur, vous êtes protégé, c’est un avantage qu’il faut payer. — En conséquence, les Génois naviguent avec des navires de 250,000 francs, et les Français avec des navires de 300,000 francs, tous construits par des Français et en France.
Vous voyez, Messieurs, les résultats de ce système pour toutes nos industries. À supposer, comme on le dit, qu’elles soient dans un état d’infériorité, il ne fait qu’accroître cette infériorité. C’est certes le plus absurde remède qu’on puisse imaginer.
Mais voyons maintenant son effet sur l’ouvrier.
Puisque sur le capital national, il faut prélever une plus grande part pour chaque entreprise industrielle, agricole ou commerciale, le résultat définitif et nécessaire est une diminution dans le nombre des entreprises. Une foule d’entreprises ne se font pas parce qu’un capital national déterminé ne peut faire face à un même nombre d’entreprises, toutes plus dispendieuses, et aussi parce que souvent la convenance cesse. Telle opération qui pouvait présenter du bénéfice avec un capital de 300,000 francs, offre de la perte s’il faut un capital de 400,000 francs.
Or la réduction dans le nombre des entreprises, c’est la réduction dans la demande de la main-d’œuvre ou dans les salaires.
Ainsi ce système a pour les ouvriers deux conséquences aussi tristes l’une que l’autre. D’un côté, il grève d’une cherté factice leurs aliments, leurs vêtements, leurs outils et tous les objets de leur consommation. De l’autre, il répartit le capital national sur un moins grand nombre d’ [VII-184] entreprises, restreint la demande des bras, et déprime ainsi le taux des salaires.
Oui, je le dis et je le répète sans cesse, parce que c’est là ma conviction profonde, la classe ouvrière souffre doublement de ce régime, et c’est la seule à laquelle il n’offre et ne peut offrir aucune compensation.
Aussi un des phénomènes les plus étranges de notre époque, c’est de voir le parti démocratique se prononcer avec aigreur, avec passion, avec colère, avec haine contre la liberté du commerce.
Ce parti fait profession d’aimer la classe ouvrière, de défendre ses intérêts, de poursuivre le redressement des injustices dont elle peut être l’objet. Comment donc se fait-il qu’il soutienne un régime de restrictions et de monopole qui n’est envers les travailleurs, et surtout ceux qui n’ont que leurs bras, qu’un tissu d’iniquités ?
Pour moi, je le dis hautement, j’ai toujours appartenu au parti démocratique. Rien ne s’oppose à ce que je le déclare ici, car, par cela même que notre Association n’arbore aucune couleur politique, elle ne défend à personne d’avouer son drapeau. Si par le triomphe de la démocratie on entend la participation de tous aux charges et aux avantages sociaux, l’impartialité de la loi envers les petits comme envers les grands, envers les pauvres comme envers les riches, le libre jeu, le libre développement laissé aux tendances sociales vers l’égalité des conditions, je suis du parti démocratique. Et je me félicite de pouvoir le dire ici, devant mes compatriotes, dans cette ville où je suis né, où j’ai passé ma jeunesse, parce que s’il m’échappait une parole qui s’écartât de la vérité, cinquante voix s’élèveraient pour me démentir. Y a-t-il quelqu’un parmi vous qui puisse citer dans toute ma carrière un mot, un acte qui n’ait été inspiré par l’esprit de la démocratie, par le libéralisme le plus avancé ? S’il en est un, qu’il se lève et qu’il me confonde.
[VII-185]
Comment donc se fait-il que, lorsque je mets mes forces, tout insuffisantes qu’elles sont, au service d’une liberté, de la plus précieuse des libertés pour l’homme du peuple, de la liberté du travail et de l’échange, je rencontre sur mon chemin le parti démocratique ?
C’est que ce parti se trompe, et ceux qui le mènent le trompent.
Je dis que ceux qui le mènent le trompent, et je m’explique. Loin de moi la pensée que les hommes du parti démocratique manquent en cette circonstance de sincérité. Je ne crois pas qu’il y ait un homme sur la terre moins disposé que moi à imputer des motifs coupables. J’ai assez réfléchi sur les objets qui divisent les hommes pour savoir ce qu’il y a de spécieux dans les opinions les plus diverses ; et dès lors, quand on ne partage pas la mienne, je ne me permets pas de supposer d’autre motif qu’une conviction, selon moi égarée, mais sincère.
Mais lorsqu’un homme me déclare que j’ai raison en principe, et que néanmoins il fait à ce principe une guerre sourde et incessante, alors je me dis : Cet homme s’écarte de toutes les règles de logique et de moralité qui dirigent les actions humaines ; il va au-devant de toutes les interprétations ; il me donne le droit de rechercher le secret mobile qui détermine chez lui un tel excès d’inconséquence avouée.
Cette inconséquence, je l’ai entendu expliquer ainsi et j’avoue que tout mon être répugne à cette explication. On attribuait aux roués du parti démocratique ce calcul odieux :
« Le peuple souffre, et sous le régime restrictif, ses souffrances ne peuvent qu’augmenter. De plus, il ignore la cause de ses souffrances, et nous pouvons facilement tourner sa haine contre ce qui nous déplaît. Il est dans la condition la plus favorable pour devenir en nos mains un instrument de perturbation. Notre rôle est de l’aigrir, et non de l’éclairer. Au contraire, faisons la guerre à ceux [VII-186] qui lui montrent la vérité, la cause et le remède de ses souffrances ; car si elles venaient à s’adoucir, le peuple se rallierait à l’ordre social actuel, et ne se prêterait plus docilement à nos desseins. »
Une perversité aussi machiavélique ne peut germer que dans bien peu de têtes. J’aime mieux examiner l’explication que donnent les démocrates eux-mêmes de leur opposition au libre-échange, tout en reconnaissant que c’est un principe de vérité et de justice.
Quand je leur ai demandé les motifs de leur opposition, ils m’ont répondu : D’abord, le Gouvernement favorise votre entreprise. Ensuite, le libre-échange, par ses tendances pacifiques, interromprait la grande mission de la France qui est de propager en Europe l’idée démocratique, au besoin par les armes.
Quant au premier motif, je déclare de la manière la plus formelle que l’Association du libre-échange n’a eu avec le Gouvernement aucune communication, si ce n’est pour obtenir l’autorisation exigée par la loi. Pour ce qui me regarde, je n’ai jamais vu M. Guizot ni M. Duchatel. Un discours de M. Guizot me fait présumer qu’il a le sentiment confus qu’en matière d’échanges, la liberté vaut mieux que la restriction. M. Duchatel, avant d’être ministre, a fait une brochure où les vrais principes économiques sont exposés avec une grande clarté. Mais quoi ! sommes-nous tenus de repousser une liberté précieuse parce que M. Duchatel a écrit, dans sa jeunesse, une brochure en sa faveur ?
Et quand il serait vrai que les secrètes sympathies du Ministère fussent pour nous, quand il serait vrai que, fatigués des exigences, des obsessions des protectionistes, les Ministres songeassent à décharger le Gouvernement du joug que le système restrictif fait peser sur lui, devrions-nous pour cela défendre ce système ? Je sais bien que c’est ainsi que raisonnent les partis : Entravons la marche du [VII-187] Gouvernement, ruat cœlum. Jamais je ne m’associerai à cette tactique. Où est le vrai, l’honnête, le juste, le bien et le bon, c’est de ce côté que je me porte, sans examiner si le Gouvernement est pour ou contre. Ergoter contre la vérité uniquement parce que le Gouvernement s’est mis de son côté, c’est fausser sciemment l’esprit public ; et j’ai la confiance qu’un des bienfaits accessoires de notre Association sera de discréditer ce genre d’opposition immorale et dangereuse. Vous ne voulez pas du Ministère, c’est sans doute que vous le croyez mauvais. S’il est mauvais, il est vulnérable ; attaquez-le par là, soit. Mais le combattre sur le terrain de la justice et de la vérité, quand par hasard il s’est placé sur ce terrain, et cela en vous plaçant vous-même sur le terrain de l’injustice et du mensonge, ce n’est plus esprit d’opposition, c’est esprit de faction.
Le parti contre lequel je me défends ici se fonde encore sur ce que la France a pour mission de répandre l’idée démocratique par les armes. J’aime à croire que ce n’est pas là la pensée de la démocratie française, mais de quelques meneurs qui se sont faits ses infidèles organes.
Pour moi, je crois que la doctrine la plus consciencieuse n’a qu’un droit, celui de combattre par la parole, de vaincre par la persuasion, de se propager par l’exemple. L’infaillibilité elle-même aurait tort de recourir à la violence. Quand le christianisme voulut s’imposer aux consciences par le déploiement de la force brutale, se fondant sur ce que lui seul possédait la vérité, que lui disait la philosophie ? « Si vous possédez la vérité, prouvez-le. C’est une puissance assez grande pour que vous n’y ajoutiez pas celle des armes. » Faut-il maintenant tenir le même langage à la démocratie ? faut-il lui dire :
« Si vous avez la vérité, prouvez-le. Montrez-le au monde par votre exemple. Que la France soit le pays le mieux ordonné, le mieux gouverné, le plus éclairé, le plus moral, le plus heureux de la terre, et pour faire de [VII-188] la propagande, vous n’aurez qu’à ouvrir vos ports et vos frontières, afin que chacun vienne contempler parmi vous les miracles de la liberté. »
« Croyez-vous hâter le triomphe de la démocratie en vous montrant toujours prêt à fondre sur le monde, le cimeterre d’une main et votre Koran de l’autre ? Si les autres peuples sont dans l’erreur, l’erreur périt-elle sous le sabre et la baïonnette ? Ne craignez-vous pas qu’ils ne finissent par se dire : « Cette nation prétend avoir reçu du ciel la mission de convertir toutes les autres à la vraie foi politique, qui est la fraternité et voyez : elle transforme ses laboureurs en soldats, ses charrues en épées, ses navires marchands en vaisseaux de guerre ; elle hérisse le sol d’arsenaux, de casernes et de citadelles ; elle gémit sous le poids des taxes, elle a remis toutes ses forces vives entre les mains de quelques chefs d’armée, ah ! gardons-nous de l’imiter ! »
Puisque je suis sur ce sujet, je vous demanderai la permission de montrer l’intime connexité qu’il y a d’un côté entre le régime restrictif et l’esprit de guerre, de l’autre entre le libre-échange et l’esprit de paix. C’est le côté le plus important et peut-être le moins compris de notre belle cause. Je suis forcé de recourir à une dissertation économique, car ce n’est pas aux passions, ni même au sentiment que je m’adresse, mais à la conviction.
Deux systèmes économiques sont en présence.
L’un, celui qui domine dans les législations et dans les intelligences, fait consister le progrès dans l’excédant des ventes sur les achats, dans l’excédant des exportations sur les importations, en un mot dans ce qu’on a appelé la balance du commerce.
L’autre, celui que nous nous efforçons de propager, en est justement le contre-pied. Il ne voit dans ce qu’un peuple exporte que le payement de ce qu’il importe. À nos yeux, l’essentiel, c’est que chaque payement, le moindre possible, [VII-189] réponde à la plus grande somme possible d’importations ; et voilà pourquoi notre maxime est : Laissez à chacun la faculté d’aller acheter là où les produits sont à meilleur marché, et vendre là où ils sont le plus chers ; car évidemment c’est le moyen de donner le moins pour recevoir le plus possible.
C’est, du reste, sur ce dernier principe, que tous les hommes agissent naturellement et instinctivement, quand la loi ne vient pas les contrarier.
Je ne rechercherai pas lequel de ces deux systèmes diamétralement opposés est dans la vérité économique, je me bornerai à montrer leur relation avec l’esprit de guerre et l’esprit de paix, quel est celui qui renferme un levain d’universel antagonisme, et celui qui contient le germe de la fraternité humaine.
Le premier, ai-je dit, se résume ainsi : importer peu ; exporter beaucoup.
Pour atteindre l’un de ces résultats, importer peu, il a les lois restrictives. Il charge des corps armés, sous le nom de douaniers, de repousser les produits étrangers ; et si ce système est bon, nous ne pouvons pas trouver surprenant ni même mauvais que chaque nation en fasse autant.
Reste le complément du système : exporter beaucoup. La chose n’est pas facile. Puisque chaque peuple est occupé de repousser les importations, comment chacun parviendra-t-il à beaucoup exporter ? Il est bien clair que ce qui est exportation pour l’un est importation pour l’autre, et si personne ne veut acheter, il n’y a de vente possible pour personne.
Remarquez que c’est bien là de l’antagonisme, car ne faut-il pas donner ce nom à un ensemble d’efforts qui se font partout en même temps en sens opposé, chacun voyant un bien pour lui, dans la chose même que tous considèrent comme un mal pour eux ? Vous voyez qu’au fond de ce [VII-190] système, il y a cette fameuse et triste maxime : Le profit de l’un est le dommage de l’autre.
Cependant, il faut exporter, c’est la condition du progrès. Mais comment faire, puisque personne ne veut recevoir ? Il n’y a qu’un moyen, la force. Il ne s’agit que de conquérir des consommateurs. Ce système pousse donc logiquement à l’usurpation, à la conquête ; et remarquez qu’il y pousse tous les peuples à la fois.
En définitive, c’est le droit du plus fort ou du plus rusé. La politique des peuples est toute tracée. Emparons-nous d’une île, puis d’une seconde, puis d’une troisième, puis d’un continent, et, en même temps, forçons les habitants à consommer exclusivement nos produits.
Voila le monde, Messieurs, sous le régime prohibitif, si on le suppose conséquent avec lui-même, et il faut que j’aie le jugement bien faussé si ce système n’implique pas que la guerre est l’état naturel de l’homme.
On me dira sans doute : « Mais le monde est sous l’empire du régime restrictif, et cependant nous ne le voyons pas en proie à une guerre universelle. Il vient de traverser quarante années de paix. »
Oui ; mais pourquoi ? Parce que tous les peuples ne peuvent pas être à la fois les plus forts. Il y en a un à qui la prédominance reste. Celui-là s’empare de tout ce dont il peut s’emparer sans trop de danger ; il étend ses conquêtes en Asie, en Afrique, en Amérique, dans les archipels de la Méditerranée comme dans les archipels du grand Océan. Quant aux autres, qu’ils ne se fassent pas illusion, ce n’est pas l’envie qui leur manque, c’est la force. L’Espagne et le Portugal n’ont-ils pas étendu leur domination autant qu’ils l’ont pu ? La Hollande n’a-t-elle pas disputé à l’Angleterre l’Inde, Ceylan et le cap de Bonne-Espérance ? Nous-mêmes, est-ce volontairement que nous sommes réduits à la Martinique et à Bourbon ? que nous avons cédé le Canada, l’île [VII-191] de France et Calcutta ? que nous avons perdu Saint-Domingue ? N’envahissons-nous pas en ce moment le nord de l’Afrique ? Dans ce sens, chaque peuple fait tout ce qu’il peut, voilà la vérité ; s’il obéit à la pensée du régime restrictif, il est conquérant par nature, et s’il s’arrête, sa prétendue modération est de l’impuissance, pas autre chose.
Ainsi, Messieurs, vous voyez que le régime prohibitif, ce régime fondé sur la doctrine de la balance du commerce, ce régime qui voit le bien dans l’excédant des exportations, mène logiquement à l’abus de la force, à la violence, à l’usurpation, et à tout le machiavélisme diplomatique, qui est la ruse des nations mise au service de leur injustice. Prépondérance, prépotence, suprématie, voilà les grands mots sous lesquels chacun cache sa perversité ; et ce qu’il faut bien observer, c’est que si ce système est vrai, l’esprit de haine, de jalousie, d’antagonisme et de domination est indestructible, puisqu’il a sa racine dans la vérité même.
Mais que la doctrine opposée vienne à triompher dans les esprits, que chaque peuple, se considérant comme un être collectif, adopte le raisonnement de l’individu et se dise : Mon avantage est dans la quantité de ce que je reçois, et non dans la quantité de ce que je donne, en d’autres termes, mon avantage est d’acheter à bon marché et de vendre cher, en d’autres termes encore, mon avantage est de laisser faire mes négociants et d’affranchir les échanges ; à l’instant les conséquences changent du tout au tout, comme le principe change du tout au tout. À l’instant ce qui était considéré comme un mal, à savoir l’importation, est regardé comme un bien, et le payement que l’on prenait pour le beau côté n’est plus vu que comme le côté désavantageux de l’échange. L’effort de chaque peuple se fait en sens inverse, et au lieu de lutter pour imposer ses produits, il n’a plus d’autre émulation que celle d’ouvrir au plus tôt ses ports et ses frontières aux produits des autres peuples. — Et cela, [VII-192] sans s’inquiéter de l’exportation ou du payement, dont nos fournisseurs s’occuperont pour eux-mêmes. Il est clair que dans ce système l’usurpation, la domination, les colonies, et par suite la force brutale et la ruse diplomatique sont frappées d’inutilité. Il ne faut pas un si grand appareil pour importer. Mais si chaque peuple s’abstient de menacer les autres, non par générosité, mais pour obéir à son intérêt, quel immense changement est introduit dans le monde ! Je ne crains pas de dire que l’adhésion des peuples à notre doctrine sera la plus grande, la plus bienfaisante révolution dont le monde ait été témoin depuis dix-huit siècles.
C’est dans le mois où nous sommes et presque à pareil jour que Christophe Colomb découvrit le nouveau monde [2] , et c’est de cette découverte que datent le régime prohibitif ainsi que les guerres et les dissensions qui en ont été la suite ; car ce faux principe était comme enveloppé dans l’or de l’Amérique. Messieurs, signalons aux peuples, dans l’ordre moral, un monde nouveau, un monde de paix, d’harmonie, de bien-être et de fraternité.
Sachons toutefois que cette immense révolution ne sera pas le fruit du libre-échange seulement, mais aussi et surtout de l’esprit du libre-échange. — Le libre-échange pourrait être obtenu par surprise, par un engouement momentané de l’opinion publique, en dehors de convictions générales et bien arrêtées. Il pourrait aussi s’introduire dans la législation sous la pression de circonstances extraordinaires. Mais alors l’esprit du monopole survivrait au monopole. Le principe exclusif dominerait encore les intelligences et menacerait le monde d’autant de maux que s’il régnait encore dans nos lois. Je n’en veux pour preuve que ce qui se passe en Angleterre.
Vous le savez, la Ligue s’efforçait d’étendre dans les trois [VII-193] royaumes l’esprit du libre-échange, mais son œuvre était loin d’être achevée, lorsqu’une maladie mystérieuse, dans le règne végétal, anéantit une grande partie des subsistances du peuple. L’aristocratie cédant, non à la persuasion, mais à la nécessité, se décida à ouvrir les ports, ce qui arracha à Cobden cette réflexion juste et triste : « C’est une chose humiliante et bien propre à rabaisser l’orgueil de l’homme qu’une tache noire sur la plus humble des racines alimentaires ait plus fait pour la liberté du commerce que nos sept années d’efforts, de dévouement et de sacrifices. »
Aussi qu’est-il arrivé ? Une chose à laquelle on devait s’attendre : c’est que l’esprit du monopole qui, au Parlement, a cédé sur un point et sans conviction à l’empire de la nécessité, n’en dirige pas moins la politique de la Grande-Bretagne [3] .
References
[1] C’est au sortir de Marseille (voir t. II, p. 293 et suiv.) que l’auteur eut l’idée de visiter sa ville natale, et d’y prendre la parole en faveur de la liberté d’échanger. J’ignore pourquoi ce projet ne fut pas exécuté. (Note de l’édit.)
[2] Le 5 septembre 1492. (Note de l’édit.)
[3] Ici s’arrête le manuscrit du discours projeté. Quelques notes qui y sont jointes indiquent comment l’auteur entendait le terminer. Il devait exposer que l’esprit de liberté et l’esprit d’oppression se livreraient encore plus d’un combat au Parlement ; que le parti libéral y était devenu plus fort depuis les dernières élections ; que ce parti, d’après ses actes anciens et récents, méritait la confiance et la sympathie de la France. En d’autres termes, il devait développer devant le public de Bayonne la même idée qu’on trouve dans quelques-uns de ses écrits, notamment t. III, p. 459, et au présent volume, dans l’ébauche intitulée et anglomanie, anglophobie.(Note de l’édit.)
39. — À MM. LES MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE [1] .↩
Messieurs,
Pour vous décider à persister dans la réserve où vous avez cru devoir vous renfermer l’année dernière, l’Association qui ne veut pas que les échanges soient libres vous a [VII-194] présenté quelques considérations auxquelles nous espérons que vous nous permettrez de répondre.
Cette Association annonce avoir consulté un grand nombre d’assemblées, et elle a eu, dit-elle, la satisfaction de les voir presque toutes se prononcer en faveur du principe de la protection.
Est-ce une raison pour que vous vous prononciez dans le même sens ? Ce que vous êtes appelés à exprimer, ce n’est pas l’opinion d’autrui, mais la vôtre. Le résultat de semblables enquêtes serait bien illusoire, si chaque conseil général, renonçant à penser pour lui-même, se bornait à rechercher quel a été l’avis des autres conseils, afin d’y conformer le sien.
Or, Messieurs, quand nous voyons les énormes dépenses auxquelles notre pays se soumet pour faciliter ses échanges par les chemins de fer, nous ne pouvons pas croire que l’assemblée qui représente la capitale du monde civilisé consente à émettre un vote favorable au principe de la restriction des échanges.
Un vote contre les chemins de fer serait certainement plus conséquent à ce principe. Car si l’introduction de produits étrangers doit nuire à la richesse du pays, mieux vaut ne pas favoriser cette introduction que de lui créer d’abord de dispendieuses facilités pour lui opposer ensuite de dispendieux obstacles.
Messieurs, nous vous prions d’examiner surtout la question au point de vue de la justice. Est-il juste, par exemple, que les propriétaires français jouissent d’un privilége, dans quelque mesure que ce soit, pour la vente de leur blé ? Posséder le sol, c’est déjà pour eux un grand avantage, et ne devraient-ils pas s’en contenter ? Quand une rare population s’établit dans un pays où, comme aux États-Unis, la terre surabonde et n’a pas de valeur, chacun en prend autant qu’il en peut cultiver. Si quelques hommes exercent d’autres [VII-195] industries, ils ne peuvent pas être opprimés ; car, s’ils l’étaient, ils prendraient aussi de la terre. Mais quand tout le territoire est possédé et que la population continue à s’accroître, les nouveaux venus ne seront-ils pas les esclaves des propriétaires, si ceux-ci s’arrogent le droit exclusif de vendre du blé ? Est-ce qu’une telle prétention n’est pas inique et de nature à ébranler dans les esprits le principe même de la propriété ? Représentants de Paris, déciderez-vous qu’un Français, né après que tout le territoire est possédé, n’a pas le droit de tirer au moins parti de ses facultés, en échangeant son travail contre des aliments étrangers ? N’est-il pas évident d’ailleurs que cette liberté a pour conséquence de retenir la valeur des terres et de leurs produits dans des limites justes et naturelles, et de ne pas leur laisser acquérir une valeur exagérée, factice, précaire, et par là dangereuse pour le propriétaire lui-même ?
On vous dit que chacun est à la fois producteur et consommateur. C’est possible. Nous ne voulons pas discuter ici cette assertion. Mais ce qui est certain, c’est que, sous le régime restrictif, chacun est consommateur payant tribut à ce régime ; tandis que si chacun est producteur, chacun n’est pas du moins producteur protégé. Veuillez, Messieurs, faire le classement des habitants de Paris par métiers et professions ; nous osons affirmer que vous n’en trouverez pas un vingtième, peut-être un centième, parmi les participants aux faveurs de la douane.
Nos adversaires mettent beaucoup d’application à insinuer qu’il s’agit ici d’une question anglaise. Ce qui précède suffit pour montrer qu’elle est française et très française. La question est de savoir si la liberté et l’industrie d’un Français seront sacrifiées aux convenances d’un autre Français.
Après cela, nous ne craignons pas de les suivre sur le terrain étranger.
[VII-196]
Ils présentent la crise qui tourmente l’Angleterre comme un résultat de la liberté commerciale.
Quoi ! l’Angleterre souffre parce qu’elle paye moins de droits sur le café, le sucre, le blé et le coton ? C’est là un bien étrange paradoxe.
Mais l’Angleterre est un pays de publicité ; rien n’est plus aisé que de savoir ce qu’elle pense, et nous n’y voyons personne, sauf quelques lords désappointés, donner à la crise une si étrange explication.
Certes, les ouvriers qui manquent de travail et de pain, seraient bien excusables, dans le paroxysme des souffrances, de les attribuer à la réforme récente des tarifs. Cependant, nulle part on ne les voit réclamer le rétablissement des droits élevés.
Pourquoi ? parce qu’ils savent bien qu’en Angleterre, comme en France, la libre introduction du blé a été votée sous l’empire de la nécessité la plus absolue, et que si elle a été un remède insuffisant au mal, elle n’en a pas au moins été la cause.
Ils savent bien qu’une nation ne peut être aussi florissante quand la récolte a été emportée par un fléau que lorsqu’elle a réussi ; quand une partie considérable de substances alimentaires se détériore que lorsqu’elle se conserve.
Ils savent bien qu’ils ne peuvent pas filer et tisser autant de coton quand le coton manque que lorsqu’il ne manque pas.
Ils savent bien que lorsqu’on engage imprudemment plusieurs milliards dans des entreprises qu’on ne peut pas achever, ces milliards font défaut au travail et à l’industrie.
Ils savent bien, ou du moins ils commencent à apprendre que lorsqu’un peuple veut faire des conquêtes et exercer partout une injuste suprématie, lorsqu’il s’accable lui-même d’impôts et de dettes pour payer ses marins, ses soldats, ses diplomates, toute l’activité déployée pour satisfaire sa [VII-197] gloriole est perdue pour la satisfaction de ses justes et légitimes besoins.
Les ouvriers savent cela, et l’on demande au conseil général de Paris de proclamer qu’il l’ignore !
On vous dit encore que si l’année dernière nous avions modifié notre tarif, cette année l’Angleterre nous eût inondés.
Quoi ! c’est au moment où le coton lui manque qu’elle nous eût inondés de coton ? C’est au moment où les Anglais empruntent à 8 pour 100 pour payer leurs dettes les plus pressantes qu’ils auraient agrandi toutes leurs industries à la fois pour nous inonder ? — Mais il y a dans le monde des pays qui jouissent de quelque liberté. Ont-ils été inondés ? L’Union américaine, la Suisse, la Hollande et la Toscane ont-elles été inondées ?
On vous parle ensuite de l’industrie de Paris comme si elle ne s’occupait que de modes et de luxe. Vous savez mieux que personne que la ville que vous représentez a une bien autre importance industrielle. Vous savez aussi qu’elle est en possession d’un noble et légitime monopole, celui du goût ; et lorsqu’on voit quelle immense supériorité, sous le régime de la liberté, le goût, l’art et le génie donnent à Paris sur les provinces, il est permis de croire qu’ils donneraient cette même supériorité à la France sur l’étranger, surtout si, pour satisfaire d’injustes prétentions, l’on ne mettait pas hors de sa portée les matériaux, les instruments et les débouchés de son industrie.
Enfin, Messieurs, on vous fait observer que le Siècle, le National, la Revue nationale, l’Atelier, la presse démocratique, en un mot, repousse ce qu’on nomme notre théorie, c’est-à-dire le droit de disposer du fruit de son travail. Nous ne le nions pas, et c’est pour nous un sujet d’étonnement et d’affliction. Nous sommes profondément surpris et affligés de voir, nous ne dirons pas la démocratie française, mais les [VII-198] meneurs du parti démocratique se ranger, après quelques moments d’hésitation, du côté des restrictions et des priviléges. Quel est leur but ? quel est leur plan ? Nous l’ignorons ; mais ils en ont un, peu susceptible d’être avoué sans doute, puisqu’avant de nous attaquer avec acharnement, ils ont proclamé que nous avions raison en principe, c’est-à-dire que nous avons pour nous la justice et la vérité. Nous ne savons ce qui les a décidés à se tourner contre la justice et la vérité ; mais ce que nous savons, c’est que les démocrates de tous les pays et de tous les temps se lèvent pour les confondre. Aux États-Unis, le peuple vote, et il a repoussé le principe restrictif. En Suisse le peuple vote, et il a voulu la liberté absolue. La Hollande, aux traditions républicaines, a le tarif le plus modéré. L’Italie révolutionnaire aspire au régime commercial de la Toscane. En Angleterre, le combat contre la protection n’est qu’un effort de la démocratie contre l’aristocratie ; et ce qui parle plus haut encore au cœur des vrais démocrates, c’est l’exemple de nos pères. Aujourd’hui chacun fait à sa guise parler le peuple ; mais le peuple a parlé deux fois par lui-même, et deux fois il a fait de la douane un simple instrument de fiscalité, et non une machine à priviléges. La Chambre du double vote a rendu à nos tarifs le caractère aristocratique. 1791 et 1825, voilà deux dates plus significatives que tout ce que nous pourrions dire. Exhumez de vos archives, Messieurs, les deux tarifs qui s’y réfèrent et prononcez.
Et en prononçant, rappelez-vous que les délibérations du Conseil général de la Seine ne sont pas vouées à l’obscurité et à l’oubli. C’est une grave responsabilité que celle de parler au nom du foyer des lumières, des réformes et du progrès, et nous espérons bien qu’il ne sortira pas du sein de votre assemblée un vœu rétrograde qu’avant longtemps Paris aurait à désavouer.
Agréez, Messieurs, etc.
References
[1] Libre-échange du 14 novembre 1847.(Note de l’éd.)
[VII-199]
40. — CONSEIL GÉNÉRAL DE LA NIÈVRE [1] .↩
Voici d’abord le vote du conseil général de la Nièvre :
Le Conseil renouvelle le vœu qu’il a émis à la session ordinaire de 1846, dans les termes suivants :
« Le département de la Nièvre a répondu, depuis un demi-siècle, à l’appel des gouvernements qui se sont succédé dans cette grande époque. Il a mis successivement à profit les exigences de la guerre et les ressources de la paix pour développer ses anciennes industries et pour en créer de nouvelles. Il a conquis un des premiers rangs dans l’exercice des arts dont l’importance a le plus grandi, des arts qui procurent aux autres les moyens d’action et de travail.
« Notre département fournit à l’État des armes, des projectiles, des ancres et des câbles de fer ; il fournit à la capitale du chauffage et du bétail ; à la Bourgogne, des blés ; à la France entière des aciers, des fers, des fontes, des tôles, des cuivres étirés ou laminés, des papiers, des verres, des émaux, des produits à tous les degrés de finesse pour les besoins des diverses classes, et surtout des classes inférieures.
« Voilà les industries dont il entend conserver la vie et poursuivre le progrès.
« Le département de la Nièvre rougirait d’appeler liberté, soit pour ses fabriques, soit pour son agriculture, l’exemption des charges publiques exigibles comme contributions indirectes ou directes. Il respecte trop le nom sacré de liberté pour le prostituer au désir de ne pas partager les charges que tous les citoyens doivent supporter.
« Si le commerce prétend qu’il doit introduire en France les produits de l’étranger, en repoussant, comme une atteinte à sa part des droits de l’homme, toute contribution levée sur des [VII-200]produits étrangers similaires aux produits français, qui supportent, eux, de si lourdes charges, l’agriculture et les manufactures protesteront contre cet étrange abus de l’égoïsme et du langage.
« Si l’on invoque ici ce qu’on ose appeler la liberté, nous invoquerons, nous, l’égalité ! L’égalité, moins mensongère et plus puissante auprès des Français, parce qu’elle est essentiellement l’équité, qui passe avant l’immunité.
« Nous demanderons tous à ne plus rien payer pour nos champs, nos charrues, nos outils et nos ateliers, ni pour nos échanges de terres, si le commerce prétend ne rien payer pour ses échanges avec l’étranger ; privilége qu’il appelle habilement son droit et sa liberté.
« Nous exprimons le vœu que le Ministère se préoccupe avant tout, comme font ailleurs les gouvernements avisés et sages, de faciliter aux produits français de nouveaux débouchés, en empêchant que des puissances moins bruyantes, mais plus positives, ne se procurent des avantages à notre détriment auprès des tiers. Voilà la sollicitude que nous préférons à celle qui se propose, avant tout, de remplacer sur notre sol des produits français par des produits étrangers.
« Sur le marché national, nous ne réclamons, pour les produits de la terre et des ateliers, que des protections éclairées et modérées. Mais nous les réclamons suffisantes et surtout persévérantes, afin que les opérations à longs termes, celles qui conduisent aux grandes prospérités, puissent compter sur l’avenir, se fonder avec confiance et se développer en pleine sécurité.
« Nous espérons que le Ministère et les Chambres s’uniront pour procurer plus que jamais à l’industrie française cette indispensable sécurité.
« Nous réclamons, des pouvoirs représentatifs, la déclaration publique et solennelle qu’ils ont la ferme intention de conserver ces bienfaits à notre patrie ; de les conserver aujourd’hui surtout, que la propagande étrangère s’efforce d’égarer l’opinion publique, en fermant les yeux des classes ouvrières sur leurs propres intérêts. Ces intérêts, en effet, se trouveraient sacrifiés [VII-201] par des concurrences qu’une administration patriotique et sage maintiendra toujours en de prudentes limites, qui préviennent aussi bien la ruine des nations que celle des individus. »
Et maintenant voyons.
La Nièvre fournit à l’État des armes et des projectiles. Rien de mieux, si l’État en a besoin, et si la Nièvre ne les lui fait pas surpayer. Ce que nous reprochons au régime protecteur, c’est d’augmenter le besoin de ces choses et d’en rendre l’acquisition plus onéreuse.
La Nièvre fournit à la capitale du chauffage et du bétail. Soit. Mais la Nièvre a-t-elle droit à des mesures législatives qui renchérissent pour le peuple de Paris le combustible et la viande ? Le peuple de Paris n’a-t-il pas le droit de pourvoir, par les moyens les plus économiques possibles, aux besoins de se chauffer et de manger ? Ces besoins ont-ils été créés et mis au monde pour être législativement exploités par les habitants de la Nièvre ? Est-ce l’objet de la loi d’irriter les besoins des uns pour favoriser l’industrie des autres ?
Faute de liberté, un grand nombre de personnes souffriront du froid et de la faim cet hiver à Paris. Ce sera le fait, non de la nature, mais de la loi. Avec la liberté, le besoin qu’ont les Parisiens de combustible et de viande provoquerait la production de ces choses partout où il y a convenance à les échanger contre des produits de l’industrie parisienne. Il s’établirait un prix pour le combustible et le bétail ; et si ce prix convient aux habitants de la Nièvre, rien de plus juste qu’ils en profitent. C’est au prix naturel qu’ont les choses sur le marché à signaler aux producteurs la convenance qu’il y a pour eux à y amener ces choses, et non à la convenance des producteurs de déterminer législativement le prix du marché. Éloigner le combustible et le bétail du marché de Paris, afin que la population y souffre du froid et de la faim, et soit disposée à faire de plus grands [VII-202] sacrifices pour se soustraire à cette souffrance ; en d’autres termes, élever artificiellement le prix du chauffage et de la viande, afin d’augmenter la convenance dans la Nièvre à exploiter les mines et les prairies, c’est une police à rebours dont l’absurdité égale l’injustice.
M. Dupin (non point le député de la Nièvre, mais son frère, qui depuis… mais alors…), M. Ch. Dupin, dans son ouvrage sur les forces commerciales de la France, constate qu’un tiers de nos concitoyens ne mangent jamais de viande ; et récemment tous les journaux ont fait savoir que les arrivages de bétail à Paris avaient subi, le mois dernier, une diminution énorme. C’est la meilleure réponse aux prétentions du conseil général de la Nièvre.
« Le département de la Nièvre rougirait d’appeler liberté l’exemption des charges publiques. Il respecte trop le nom sacré de liberté pour le prostituer au désir de ne pas partager les charges que tous les citoyens doivent supporter. »
Sophistes ! Vous respectez le nom, mais vous ne respectez guère la chose. Qui parle de s’exempter de taxes ? Voulez-vous le savoir ? C’est vous, et de la manière la plus formelle ; voici comment :
Vous arguez de vos taxes pour faire hausser législativement le prix des choses dont vous êtes marchands. Par conséquent, vous demandez à être remboursés de votre part de taxes par vos acheteurs, qui payent leurs taxes aussi. Or, demander d’être remboursé de ses taxes, c’est demander de n’en pas payer ; et demander à en être remboursé aux dépens d’un tiers qui paye déjà les siennes, c’est demander que ce tiers paye deux fois, une fois pour lui et une fois pour vous.
Vous accusez le commerce de repousser les taxes sur les produits étrangers comme une atteinte à sa part des droits [VII-203] de l’homme, mots que vous soulignez pour les livrer, sans doute, à la dérision publique.
Quelle étrange confusion !
D’abord, quand le drap est prohibé, ce n’est pas le commerce qui paye une taxe, c’est le misérable qui a besoin de se garantir du froid et qui est forcé par la loi à surpayer le drap. Cet excédant de prix est une taxe qu’il paye, non au Trésor, mais au fabricant de drap. Et, de plus, le drap étranger, n’étant pas entré, n’a rien payé au Trésor. Le Trésor est vide d’autant. Il faut donc que le malheureux acheteur de drap paye encore une taxe sur son sel et ses ports de lettres, pour remplacer celle que le Trésor a refusé de percevoir sur le drap étranger.
Quant au négociant, il n’est pour rien là dedans, si ce n’est qu’il voit restreindre législativement le nombre de ses affaires. Mais où a-t-on vu qu’il refuse de payer des taxes directes ou indirectes ? Est-ce que le négociant ne paye pas sa patente et sa cote mobilière ? Est-ce que le négociant ne paye pas ses impôts indirects quand il boit du vin, fume du tabac, reçoit ses lettres, joue aux cartes, sucre son café et sale son beurre ? Si vous trouvez que la patente ne soit pas assez forte, élevez-la. Mais quel rapport ont les taxes publiques avec les taxes que la loi nous force à nous payer les uns aux autres, au moyen des restrictions ?
Quand nous demandons la liberté du commerce, ce n’est pas en faveur du négociant, mais du consommateur ; c’est pour que le peuple se chauffe et mange de la viande à meilleur marché que ne le lui permet le conseil général de la Nièvre.
« Si l’on invoque ici ce que l’on ose appeler la liberté, nous invoquerons, nous, l’égalité. »
Soit, l’égalité devant la loi, nous ne demandons pas autre chose. Si vous vous appartenez à vous-même, je demande à [VII-204] m’appartenir à moi-même ; voilà l’égalité dans la liberté. Ou si la loi vous donne le moyen de me rançonner, je demande qu’elle me donne le moyen de vous rançonner à mon tour ; voilà encore l’égalité dans l’oppression. Je demande l’une ou l’autre égalité. Je suis ouvrier ; si la loi n’élève pas le prix de mon salaire, je demande qu’elle n’élève pas le prix de votre viande, et si elle élève le prix de votre viande, je demande qu’elle élève le prix de mon salaire. — Et quand vous, propriétaire de bœufs et de prairies, vous électeur et député, vous législateur, faites une loi qui affranchit vos bœufs de la concurrence et abandonne nos bras à la concurrence, vous commettez l’iniquité ; et si, de plus, vous la commettez au nom de l’égalité, vous joignez à l’injustice le plus détestable des sarcasmes.
L’égalité, dit le conseil général de la Nièvre, est plus puissante que la liberté, parce qu’elle est essentiellement l’équité, qui passe avant l’immunité.
Voilà certes une dissertation en règle, digne des bancs de l’école. Ces messieurs cherchent l’égalité en dehors de la liberté, attendu, sans doute, que l’une exclut l’autre, comme le disait l’an dernier M. Corne. L’égalité, pour eux, consiste dans les priviléges que la Chambre du double vote conféra aux grands propriétaires. C’est cette égalité-là, repoussée par le peuple de 1791, qui est essentiellement l’équité. C’est par pure équité que l’éleveur de bœufs rançonne législativement son maçon, sans que le maçon puisse rançonner législativement l’éleveur de bœufs ; car nous défions tout le conseil général de la Nièvre, son président en tête, de nous dire comment la douane a pourvu à protéger le maçon et tous les artisans et tous les ouvriers de France. — Voilà le genre d’équité qui passe avant l’immunité, et c’est par haine de l’immunité que l’éleveur de bœufs adresse à la loi cette requête ; « Je paye des taxes, et mon maçon en paye aussi ; mais si vous êtes assez bonne pour élever le prix de [VII-205] la viande de deux sous par livre, il se trouvera que ma part de taxes sera repassée sur le dos du maçon, qui payera ainsi sa part et la mienne, et n’y verra que du feu. »
Et voilà les hommes qui nous accusent de réclamer l’immunité, de prostituer le nom sacré de liberté. Nous demandons, nous, s’ils ne prostituent pas hypocritement les noms d’équité et d’égalité.
« Nous exprimons le vœu que le Ministère se préoccupe avant tout, comme font ailleurs les gouvernements avisés et sages, de faciliter aux produits français de nouveaux débouchés, en empêchant que les puissances moins bruyantes, mais plus positives, ne se procurent des avantages à notre détriment auprès des tiers. Voilà la sollicitude que nous préférons à celle qui se propose avant tout de remplacer sur notre sol des produits français par des produits étrangers. »
Des débouchés ! Ah ! voilà le grand mot ! Mais soyez donc justes et logiques une fois dans la vie. Si vous trouvez votre système bon, pourquoi voulez-vous que les autres nations ne le trouvent pas bon aussi ? Si vous ne voulez pas que les produits espagnols remplacent sur notre sol les produits français, pourquoi voulez-vous que les Espagnols consentent à ce que les produits français remplacent sur leur sol les produits espagnols ? L’échange a deux termes, donner et recevoir ; supprimer l’un, c’est les supprimer tous les deux ; absolument comme supprimer le premier terme d’une équation, c’est supprimer l’équation tout entière.
Vous êtes affamés de débouchés. Et que faites-vous ? Non seulement vous fermez les débouchés du dehors, mais vous restreignez les débouchés du dedans ; car à ce même peuple que vous forcez de surpayer votre bétail et votre combustible, il reste d’autant moins de ressources pour se procurer d’autres satisfactions, et par conséquent encourager d’autres industries. Vous voulez des débouchés ; la Presse nous [VII-206] avertit aujourd’hui même qu’un des effets des réformes commerciales de l’Angleterre est de chasser nos soieries des marchés étrangers. Cela est-il surprenant, quand les ouvriers de Lyon sont forcés de payer outre leurs propres impôts, les impôts des éleveurs de bétail ?
Le conseil général de la Nièvre ne manque pas de donner à nos efforts le nom de propagande étrangère. Que, dans ce mouvement confus de la presse quotidienne, où chacun cache ses vues et ses passions sous le voile de l’anonyme, de pareilles imputations se fassent jour, cela n’a rien de bien surprenant ni de bien alarmant ; car, ainsi qu’on l’a dit, la presse, comme la lance d’Achille, guérit les blessures qu’elle fait. Mais nous ne pouvons nous empêcher d’éprouver un mouvement d’indignation quand nous voyons un corps officiel abaisser à ce degré de déloyauté la défense d’une mauvaise cause.
Enfin, le conseil général de la Nièvre, après s’être prononcé contre la concurrence étrangère qui ruine les nations, finit par s’élever contre la concurrence intérieure qui ruine les individus. C’est logique, mais ça mène loin. Le conseil aurait dû ajouter son plan communiste à tous ceux qui paraissent chaque jour. Nous disons communiste ; car sans concurrence, il n’y a pas libre disposition de sa propriété, il n’y a pas propriété. Nous recommandons au conseil général de la Nièvre de réparer cet oubli l’année prochaine.
References
[1] Libre-échange du 21 novembre 1847. (Note de l’éd.)
[VII-207]
41.↩
Paris, 22 janvier 1848 [1] .
Monsieur Jobard,
Vous me provoquez à exprimer mon opinion sur le grand problème de la propriété intellectuelle. Je n’ai pas à cet égard des idées assez arrêtées pour prétendre à ce qu’elles exercent la moindre influence sur les hommes qui peuvent, par leur position, réaliser vos vues.
Je vous ai dit, il est vrai, que si l’on faisait jamais passer la région intellectuelle dans le domaine de la propriété, cette grande Révolution étendrait le champ de l’économie politique, sans changer aucune de ses lois, aucune de ses notions fondamentales ; je persiste dans cette opinion.
Je crois que si un sauvage Joway faisait de l’économie politique, il arriverait aux mêmes notions que nous sur la nature de la richesse, de la valeur, du capital, de l’échange, etc., etc. Je crois que l’économie politique, comme science, est la même dans le département des Landes où il y a beaucoup de terres communales, et dans celui de la Seine où il n’y en a pas ; dans une ville où il y a une fontaine commune, et dans une autre où chaque maison a son puits ; au Maroc et en France, quoique la propriété foncière y soit constituée sur des bases différentes.
Mais si le sauvage Joway, après avoir été appelé à [VII-208] expliquer les lois économiques, était interrogé sur les effets qui résulteraient de l’appropriation personnelle du sol, il serait forcé de se livrer à des conjectures, ou, si vous voulez, à des déductions, ce phénomène n’étant jamais tombé sous l’épreuve de l’observation directe.
C’est à peu près la position où je me trouve à l’égard de la propriété des inventions.
Je me pose deux questions :
1o Y a-t-il dans l’invention, l’élément constitutif de la propriété ?
2o Dans cette hypothèse, est-il au pouvoir du gouvernement de garantir cette propriété ? En d’autres termes, avez-vous pour vous la vérité du principe, et la possibilité de l’application ?
Je reconnais que l’élément constitutif de la propriété me semble se manifester dans une invention. La propriété, selon moi, n’est que l’attribution de la satisfaction qui suit un effort, à celui qui a fait cet effort. Ici il y a travail, il y a jouissance, et il paraît naturel que la jouissance soit la rémunération de celui qui a fait le travail.
Mais celui qui a inventé et exécuté une charrue, a-t-il un droit exclusif, non seulement sur cette charrue, mais encore sur le modèle même de cette charrue, de sorte que nul n’en puisse construire une semblable ?
Si cela est, l’imitation est exclue de ce monde, et j’avoue que j’attache à l’imitation une très grande et très bienfaisante importance. Je ne puis exposer mes raisons dans une lettre, mais je les ai consignées dans un article du Journal des économistes, intitulé : De la concurrence.
Permettez-moi, Monsieur, de soumettre votre principe à une épreuve, celle de l’exagération. Il y a beaucoup de gens qui n’admettent pas cette méthode ; je la crois excellente. Quand un principe est bon, plus il agit sans obstacles, plus il répand de bienfaits. Sismondi s’élevant contre les [VII-209] machines, se demande que deviendrait l’humanité, si un roi pouvait tout produire en tournant une manivelle ? Je réponds : Que chaque homme ait une semblable manivelle, et nous serons tous infiniment riches, à moins de prétendre que Dieu est le plus misérable des êtres, parce qu’il n’a pas même besoin de manivelle et qu’un fiat lui suffit.
Cela posé, supposons qu’il existe encore un descendant de Triptolème, et que la propriété du droit de faire des charrues se soit conservée de père en fils jusqu’à lui. C’est la circonstance la plus favorable pour votre principe, s’il est bon. J’admets que cette famille ait temporairement délégué ce droit, pour en retirer tout le profit possible. Mais pensez-vous que l’humanité aurait retiré de la charrue tous les avantages que cet instrument a répandus ? D’une autre part, un tel droit n’aurait-il pas introduit dans le monde, le germe d’une inégalité sans limites ?
Et puis ce mot invention me paraît bien élastique. Parce que j’aurais été le premier à mettre des sabots, tous les hommes sur la surface de la terre, sont-ils tenus en droit d’aller pieds nus ?
Voilà mes doutes, Monsieur ; vous me direz que ce n’est pas un doute, mais une solution. Non, car, ainsi que je l’ai dit en commençant, je suis dans la position de l’Ioway. Il aurait pu être, et il aurait été probablement très-frappé des inconvénients de la propriété foncière, et la force de son intelligence n’aurait pas suffi à lui en révéler tous les avantages. Il me semble aussi que, dans l’appropriation du domaine intellectuel, il y a toute une révolution aussi imposante, peut-être aussi bienfaisante que celle qui a fait passer le sol de l’état commun à l’état de propriété privée. Ce que je crains, c’est l’abus. Ce que je n’aperçois pas clairement, c’est la limite entre ce qui constitue réellement l’invention et cette multitude de choses que nous inventons tous journellement. Je redoute l’accaparement des procédés les plus [VII-210] usuels [2] . Peut-être, absorbé par d’autres travaux, n’ai-je pas assez étudié vos ouvrages, au point de vue pratique. Ce que je puis dire, Monsieur, c’est qu’il y a dans votre pensée quelque chose de grand, de séduisant, de logique, qui ne contredit pas, comme les projets socialistes, les notions fondamentales de la science, et j’admire sincèrement le dévouement et la persévérance avec laquelle vous en poursuivez la réalisation.
Je suis, etc.
42. SOUS LA RÉPUBLIQUE [1] ↩
Paris, 26 février 1848 [2] .
Nul ne peut dire quel sera, en Europe, le contre-coup de la Révolution. Plaise au ciel que tous les peuples sachent se soustraire à la triste nécessité de se précipiter les uns sur les autres, au signal des aristocraties et des rois.
Mais supposons que les puissances absolues conservent encore, pendant quelque temps, leurs moyens d’action au dehors.
Nous posons ici deux faits qui nous paraissent incontestables et dont on va voir les conséquences :
[VII-211]
1o La France ne peut pas prendre l’initiative du désarmement.
2o Sans le désarmement, la Révolution ne peut remplir que très imparfaitement les espérances du peuple.
Ces deux faits, disons-nous, sont incontestables.
Quant au désarmement, le plus grand ennemi de la France ne pourrait le lui conseiller, tant que les puissances absolues sont armées. Il est inutile d’insister là-dessus.
Le second fait est aussi évident. Se tenir armée de manière à garantir l’indépendance nationale, c’est avoir trois ou quatre cent mille hommes sous les drapeaux ; c’est être dans l’impossibilité de faire, sur les dépenses publiques, aucun retranchement assez sérieux pour remanier immédiatement notre système d’impôts. Accordons que, par une taxe somptuaire, on puisse réformer l’impôt du sel et quelques autres contributions exorbitantes. Est-ce là une chose dont puisse se contenter le peuple français ?
On réduira, dit-on, la bureaucratie : soit. Mais, nous l’avons dit hier, la diminution probable des recettes compensera et au delà ces réformes partielles, et, ne l’oublions pas, le dernier budget a été réglé en déficit.
Or, si la Révolution est mise dans l’impossibilité de remanier un système d’impôts iniques, mal répartis, qui frappent le peuple et paralysent le travail, elle est compromise.
Mais la Révolution ne veut pas périr.
Voici, relativement aux étrangers, les conséquences nécessaires de cette situation. Certes, ce n’est pas nous qui conseillerons jamais des guerres d’agression. Mais la dernière chose qu’on puisse demander à un peuple, c’est de se suicider.
Si donc, même sans nous attaquer directement, l’étranger, par son attitude armée, nous forçait à tenir trois ou quatre cent mille hommes sur pied, c’est comme s’il nous demandait de nous suicider. [VII-212] Pour nous, il est de la dernière évidence que si la France est placée dans la situation que nous venons de décrire, qu’elle le veuille ou non, elle jettera sur l’Europe la lave révolutionnaire.
Ce sera le seul moyen de créer aux rois des embarras chez eux, qui nous permettent de respirer chez nous.
Que les étrangers le comprennent. Ils ne peuvent échapper au danger qu’en prenant avec loyauté l’initiative du désarmement. Le conseil leur paraîtra bien téméraire. Ils se hâteront de dire : « Ce serait une imprudence. » Et nous, nous disons : Ce serait de la prudence la plus consommée.
C’est ce que nous nous chargerons de démontrer.
43.↩
26 février 1848
Lorsqu’on parcourt les rues de Paris, à peine assez spacieuses pour contenir les flots de la population, et qu’on vient à se rappeler qu’il n’y a dans cette immense métropole, en ce moment, ni roi, ni cour, ni gardes municipaux, ni troupes, ni police autre que celle que les citoyens exercent eux-mêmes ; quand on songe que quelques hommes, sortis hier de nos rangs, s’occupent seuls des affaires publiques ; — à l’aspect de la joie, de la sécurité, de la confiance qui respire dans toutes les physionomies, le premier sentiment est celui de l’admiration et de la fierté.
Mais bientôt on fait un retour sur le passé, et l’on se dit : « Il n’est donc pas si difficile à un peuple de se gouverner qu’on voulait nous le persuader, et le gouvernement à bon marché n’est pas une utopie. »
Il ne faut pas se le dissimuler : en France on nous a [VII-213] habitués à être gouvernés outre mesure, à merci et miséricorde. Nous avions fini par croire que nous nous déchirerions tous les uns les autres, si nous jouissions de la moindre liberté, et si l’État ne réglait pas tous nos mouvements.
Voici une grande expérience qui démontre qu’il y a dans le cœur des hommes d’indestructibles principes d’ordre. L’ordre est un besoin et le premier des besoins, sinon pour tous, du moins pour l’immense majorité. Ayons donc confiance et tirons de là cette leçon que le grand et dispendieux appareil gouvernemental, que les intéressés nous représentaient comme indispensable, peut et doit être simplifié.
44.↩
27 février 1848 [3] .
Nous partageons cette pensée de la Presse :
« Ce qu’il faut demander à un gouvernement provisoire, à des hommes qui se dévouent au salut public au milieu d’incalculables difficultés, ce n’est pas de gouverner exactement selon toutes nos idées, mais de gouverner. Il faut lui prêter assistance, le soutenir, lui faciliter sa rude tâche et renvoyer à un autre temps la discussion des doctrines. Ce ne sera pas un des phénomènes les moins glorieux de notre révolution que l’accord de tous les journaux dans cette voie. »
Nous pouvons nous rendre le témoignage que nous payons autant qu’il est en nous ce tribut d’abnégation au salut de la cause commune.
[VII-214]
Dans quelques-uns des décrets qui se succèdent, nous voyons poindre l’application d’une doctrine qui n’est pas la nôtre. Nous l’avons combattue, nous la combattrons encore en temps opportun.
Deux systèmes sont en présence : tous deux émanent de convictions sincères, tous deux ont pour but le bien général. Mais, il faut le dire, ils procèdent de deux idées différentes, et, qui plus est, opposées.
Le premier, plus séduisant, plus populaire, consiste à prendre beaucoup au peuple, sous forme d’impôts, pour beaucoup répandre sur le peuple, sous forme d’institutions philanthropiques.
Le second veut que l’État prenne peu, donne peu, garantisse la sécurité, laisse un libre champ à l’exercice honnête de toutes les facultés : l’un consiste à étendre indéfiniment, l’autre à restreindre le plus possible les attributions du pouvoir.
Celui de ces deux systèmes auquel nous sommes attachés [4] par une entière conviction a peu d’organes dans la presse ; il ne pouvait avoir beaucoup de représentants au pouvoir.
Mais pleins de confiance dans la droiture des citoyens auxquels l’opinion publique a confié la mission de jeter un pont entre la monarchie déchue et la république régulière qui s’avance, nous ajournons volontiers la manifestation de notre doctrine et nous nous bornons à semer des idées d’ordre, de mutuelle confiance et de gratitude envers le gouvernement provisoire.
[VII-215]
45.↩
Paris, 27 février 1848.
Le National examine aujourd’hui notre situation à l’égard de l’étranger.
Il se demande : Serons-nous attaqués ? Et après avoir jetés un coup d’œil sur les difficultés de l’Autriche, de la Prusse et de la Russie, il se prononce pour la négative.
Nous partageons entièrement cet avis.
Ce que nous redoutons, ce n’est pas d’être attaqués, c’est que les puissances absolues, avec ou sans préméditation, et par le seul maintien du statu quo militaire, ne nous réduisent à chercher dans la propagande armée le salut de la révolution.
Nous n’hésitons pas à nous répéter afin d’être compris ici et ailleurs. Ce que nous disons avec une entière conviction, c’est ceci : nous ne pouvons pas prendre l’initiative du désarmement, et néanmoins le simple statu quo militaire nous met dans l’alternative de périr ou de nous battre ; c’est aux rois de l’Europe à calculer la portée de cette alternative fatale. Ils n’ont qu’un moyen de se sauver, c’est de désarmer les premiers et immédiatement.
Qu’on nous permette une fiction.
Supposez une petite île qui a été, pendant longues années, plutôt exploitée que gouvernée ; les impôts, les entraves, les abus y sont innombrables ; le peuple succombe sous le faix, et, en outre, pour se prémunir contre les menaces continuelles du dehors, il arrache au travail, tient sur pied, arme et nourrit une grande partie de sa population valide.
[VII-216]
Tout à coup il détruit son gouvernement oppresseur ; il aspire à se délivrer du poids des taxes et des abus.
Mais le gouvernement tombé lui laisse le fardeau d’une dette énorme.
Mais, au premier moment, toutes les dépenses s’accroissent.
Mais, dans les premiers temps, toutes les sources de revenus diminuent.
Mais il y a des taxes si odieuses qu’il est moralement et matériellement impossible de les maintenir, même provisoirement.
Dans cette situation, les chefs qui exploitent toutes les îles voisines tiennent à la République naissante ce langage :
« Nous te détestons, mais nous ne voulons pas t’attaquer, de peur que mal ne nous en arrive. Nous nous contenterons de t’entourer d’une ceinture de soldats et de canons. »
Dès lors la jeune République est forcée de lever aussi beaucoup de soldats et de canons.
Elle ne peut retrancher aucune taxe, même la plus impopulaire.
Elle ne peut tenir envers le peuple aucune de ses promesses.
Elle ne peut pas remplir les espérances de ses citoyens.
Elle se débat dans les difficultés financières ; elle multiplie les impôts avec leur cortège d’entraves. Elle ravit à la population, à mesure qu’il se forme, le capital qui est la source des salaires.
Dans cette situation extrême, rien au monde peut-il l’empêcher de répondre :
« Votre prétendue modération nous tue. Nous forcer à tenir sur pied de grandes armées, c’est nous pousser vers des convulsions sociales. Nous ne voulons pas périr, et, plutôt, nous irons soulever chez vous tous les éléments de désaffection que vous avez [VII-217] accumulés au sein de vos peuples, puisqu’aussi bien vous ne nous laissez pas d’autre planche de salut. »
Voilà bien notre position à l’égard des rois et des aristocraties de l’Europe.
Les rois, nous le craignons, ne le comprendront pas. Quand les a-t-on vus se sauver par la prudence et la justice ?
Nous ne devons pas moins le leur dire. Il ne leur reste qu’une ressource : être justes envers leurs peuples, les soulager du poids de l’oppression, et prendre-sur-le champ l’initiative du désarmement.
Hors de là, leur couronne est livrée au hasard d’une grande et suprême lutte. Ce n’est pas la fièvre révolutionnaire, ce sont les précédents et la nature même des choses qui l’ordonnent.
Les rois diront : N’est-ce pas notre droit de rester armés ?
Sans doute, c’est leur droit, à leurs risques et périls.
Ils diront encore : La simple prudence n’exige-t-elle pas que nous restions armés ?
La prudence veut qu’ils désarment de suite et plutôt aujourd’hui que demain.
Car tous les motifs qui pousseront la France au dehors, si on la force à armer, la retiendront au dedans, si on la met à même de réduire ses forces militaires.
Alors la République sera intéressée à supprimer en toute hâte les impôts les plus odieux ; à laisser respirer le peuple ; à laisser se développer le capital et le travail ; à abolir les gênes et les entraves inséparables des lourdes taxes.
Elle accueillera avec joie la possibilité de réaliser ce grand principe de fraternité qu’elle vient d’inscrire sur son drapeau.
[VII-218]
46.↩
27 février 1848.
Tout notre concours, toute notre faible part d’influence sont acquis au gouvernement provisoire.
Certains de la pureté de ses intentions, nous n’avons pas à discuter en détail toutes ses mesures. Ce serait être bien exigeants, et nous dirons même bien injustes, que de réclamer la perfection dans des travaux d’urgence dont le poids dépasse presque la limite des forces humaines.
Nous trouvons tout naturel que, dans ce moment où la municipalité a besoin de tant de ressources, l’octroi soit maintenu ; et c’est un devoir pour tous les citoyens de veiller à ce que ses recettes soient fructueuses.
Mais nous aurions désiré que le gouvernement provisoire ne se donnât pas l’apparence de préjuger une grande question par ces mots : Cet impôt doit être revisé ; il le sera prochainement ; il doit être modifié de manière à le rendre moins pesant pour les classes ouvrières.
Nous pensons qu’il ne faut pas chercher à modifier l’octroi, mais viser à le supprimer.
47.↩
Paris, 28 février 1848. [5]
Le bien général, la plus grande somme possible de bonheur pour tous, le soulagement immédiat des classes [VII-219] souffrantes, — c’est l’objet de tous les désirs, de tous les vœux, de toutes les préoccupations.
C’est aussi la plus grande garantie de l’ordre. Les hommes ne sont jamais mieux disposés à s’entr’aider que lorsqu’ils ne souffrent pas, ou du moins quand ils ne peuvent accuser personne, ni surtout le gouvernement, de ces souffrances inséparables de l’imperfection humaine.
La révolution a commencé au cri de Réforme. Alors ce mot s’appliquait seulement à une des dispositions de notre constitution. Aujourd’hui c’est encore la réforme que l’on veut, mais la réforme dans le fond des choses, dans l’organisation économique du pays.
Le peuple, rendu à toute sa liberté, va se gouverner lui-même. Est-ce à dire qu’il arrivera de plein saut à la réalisation de toutes ses espérances ? Ce serait une chimère que d’y compter. Le peuple choisira les mesures qui lui paraîtront les mieux coordonnées à son but, choisir implique la possibilité de se tromper. Mais le grand avantage du gouvernement de la nation par la nation, c’est qu’elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même du résultat de ses erreurs, et qu’elle est toujours en mesure de mettre à profit son expérience. Sa prudence maintenant doit consister à ne pas permettre que les faiseurs de systèmes fassent trop d’expérience sur elle et à ses dépens.
Ainsi que nous l’avons dit, deux systèmes longtemps débattus par les polémistes sont en présence.
L’un aspire à faire le bonheur du peuple par des mesures directes.
Il dit :
« Si quelqu’un souffre de quelque manière que ce soit, l’État se chargera de le soulager. Il donnera du pain, des vêtements, du travail, des soins, de l’instruction à tous ceux qui en auront besoin. Si ce système était possible, il faudrait être un monstre pour ne pas l’embrasser. Si l’État a quelque part, dans la lune par exemple, une source [VII-220] toujours accessible et inépuisable d’aliments, de vêtements et de remèdes, qui pourrait le blâmer d’y puiser à pleines mains, au profit de ceux qui sont pauvres et dénués ?
Mais si l’État ne possède par lui-même et ne produit aucune de ces choses ; si elles ne peuvent être créées que par le travail ; si tout ce que peut faire l’État, c’est de les prendre par l’impôt aux travailleurs qui les ont créées, pour les livrer à ceux qui ne les ont pas créées ; si le résultat naturel de cette opération doit être, loin d’augmenter la masse de ces choses, d’en décourager la production ; si, sur cette masse réduite, l’État en garde forcément une partie pour ses agents ; si ces agents chargés de l’opération sont eux-mêmes soustraits au travail utile ; si, en définitive, ce système, tout séduisant qu’il est au premier abord, doit engendrer beaucoup plus de misères qu’il n’en guérit, alors il est bien permis de concevoir des doutes et de rechercher si le bonheur des masses ne peut pas naître d’un autre procédé.
Celui que nous venons de décrire ne peut évidemment être mis en œuvre que par l’extension indéfinie de l’impôt. À moins de ressembler à ces enfants qui se dépitent de ce qu’on ne leur donne pas la lune à la première réquisition, il faut bien reconnaître que, si nous chargeons l’État de répandre partout l’abondance, il faut lui permettre d’étendre partout l’impôt : il ne peut rien donner qu’il ne l’ait pris.
Or de grands impôts impliquent toujours de grandes entraves. S’il ne s’agissait de demander à la France que cinq à six cents millions, on peut concevoir, pour les recueillir, un mécanisme financier extrêmement simple. Mais s’il faut lui arracher quinze à dix-huit cents millions, il faut avoir recours à toutes les ruses imaginables de la fiscalité. Il faut l’octroi, — l’impôt du sel, l’impôt des boissons, la taxe exorbitante des sucres ; il faut entraver la circulation, grever l’industrie, restreindre le consommateur ; il faut une [VII-221] armée de percepteurs ; il faut une bureaucratie innombrable ; il faut empiéter sur la liberté des citoyens ; — et tout cela entraîne les abus, la convoitise des fonctions publiques, la corruption, etc., etc.
On voit que si le système de l’abondance puisée par l’État dans le peuple, pour être par lui répandue sur le peuple, a un côté séduisant, c’est néanmoins aussi une médaille qui a son revers.
Nous sommes convaincus, nous, que ce système est mauvais et qu’il en est un autre pour faire le bien du peuple, ou plutôt pour que le peuple fasse son propre bien : celui-ci consiste à donner à l’État tout ce qu’il faut pour qu’il remplisse bien sa mission essentielle, qui est de garantir la sécurité extérieure et intérieure, le respect des personnes et des propriétés, le libre exercice des facultés, la répression des crimes, délits et fraudes, — et après avoir libéralement donné cela à l’État, à garder le reste pour soi.
Puisque enfin le peuple est appelé à exercer son droit, qui est de choisir entre ces deux systèmes, nous les comparerons souvent devant lui, sous tous leurs aspects politiques, moraux, financiers — et économiques.
48. — LES ROIS DOIVENT DÉSARMER [6] .↩
Si les rois de l’Europe étaient seulement prudents, que feraient-ils ?
L’Angleterre renoncerait spontanément au droit de visite ; elle reconnaîtrait spontanément l’Algérie comme française ; elle n’attendrait pas que ces questions brûlantes fussent [VII-222] soulevées, et licencierait la moitié de sa marine ; elle ferait tourner cette économie au profit du peuple, en dégrévant les droits sur le thé et le vin.
Le roi de Prusse libéraliserait l’informe constitution de son pays, et, donnant congé aux deux tiers de son armée, il s’assurerait l’attachement du peuple en le soulageant du poids des taxes et du service militaire.
L’empereur d’Autriche évacuerait en toute hâte la Lombardie, et se mettrait en mesure, par la réduction de l’armée, d’accroître la proverbiale puissance des Autrichiens.
L’empereur de Russie rendrait la Pologne aux Polonais.
Alors la France, tranquille pour son avenir, s’absorberait dans ses réformes intérieures et laisserait agir l’influence morale seule.
Mais les rois de l’Europe croiraient se perdre par cette conduite qui seule peut les sauver.
Ils feront tout le contraire ; ils voudront étouffer le libéralisme. Pour cela ils armeront ; les peuples armeront aussi. La Lombardie, la Pologne, peut-être la Prusse, deviendront le théâtre de la lutte. Cette alternative posée par Napoléon : L’Europe sera républicaine ou cosaque, devra se résoudre à coups de canon. La France, malgré son ardent amour pour la paix manifesté par l’unanimité des journaux, mais forcée par son intérêt évident, ne pourra s’empêcher de jeter son épée dans la balance, et… les rois périssent ; les peuples ne périssent pas.
[VII-223]
49. — LES SOUS-PRÉFECTURES [7] .↩
Qu’est-ce qu’une sous-préfecture ? Une boîte aux lettres. Le Préfet écrit : Monsieur le Sous-préfet, voici une dépêche pour le maire de … ; vous la lui adresserez sans retard et m’enverrez la réponse avec votre avis.
Le Sous-préfet répond : Monsieur le Préfet, j’ai reçu la dépêche pour le maire de … ; je vais la lui envoyer sans retard et vous adresserai la réponse avec mon avis.
Pour ce service, il y a dans chaque arrondissement un sous-préfet à 3,000 francs d’appointements, 3,000 francs de frais de bureau, un secrétaire, un loyer, etc., etc.
Nous nous trompons : les sous-préfets avaient encore une mission réelle, celle d’influencer et de corrompre les élections.
Combien de jours les sous-préfectures survivront-elles à la révolution de février ?
En général, on nous trouvera peu empressés à demander des changements de personnes, mais fort ardents à réclamer la suppression des places inutiles.
50.↩
Paris, 29 février 1848 [8] .
Un journal n’atteint pas à une immense circulation sans répondre à quelques idées dominantes dans le pays. Nous [VII-224] reconnaissons que la Presse a toujours su parler aux instincts du moment, et même qu’elle a souvent donné de bons conseils ; c’est ainsi qu’elle a pu semer, sur le sol de la patrie, avec le bon grain, beaucoup d’ivraie qu’il faudra bien du temps pour extirper.
Depuis la révolution, il faut le dire, son attitude est franche et décidée.
Nous adhérons complétement, pour notre compte, aux deux cris qu’elle fait entendre aujourd’hui : pas de diplomatie ! pas de curée de places !
Pas de diplomatie ! Qu’a affaire la république de cette institution, qui a fait tant de mal et qui n’a peut-être jamais fait de bien ; où la rouerie est tellement traditionnelle qu’on en met aux choses les plus simples ; où la sincérité est réputée niaiserie ? C’est par un diplomate et pour la diplomatie qu’a été dit ce mot : La parole a été donnée à l’homme pour déguiser sa pensée.
Un des plus purs démocrates anglais, M. Cobden, passant à Madrid, y reçut la visite de M. Bulwer. Il lui dit : « Monsieur l’ambassadeur, dans dix ans l’Europe n’aura plus besoin de vous. »
Quand il est de principe que les nations sont la propriété des rois, on conçoit la diplomatie et même la rouerie diplomatique. Il faut préparer de loin des événements, des alliances, des guerres, qui agrandissent le domaine du maître.
Mais un peuple qui s’appartient, qu’a-t-il à négocier ? Toute sa diplomatie se fait au grand jour des assemblées délibérantes : ses négociants sont ses négociateurs, diplomates d’union et de paix.
Il est vrai que, même pour les peuples libres, il y a une question territoriale de la plus haute importance, celle des frontières naturelles. Mais cete question exige-t-elle l’intervention de la diplomatie ?
Les nations savent bien qu’il est de l’intérêt commun, [VII-225] intérêt d’ordre et de paix, que chacune d’elles ait ses frontières. Elles savent que si la France rentrait dans ses limites, ce serait un gage de plus donné à la sécurité de l’Europe.
En outre, le principe que les peuples s’appartiennent à eux-mêmes garantit que, si la fusion doit se faire, elle se fera par le libre consentement des intéressés, et non par l’invasion armée. La république n’a qu’à proclamer hautement à cet égard ses droits, ses vœux et ses espérances. Il n’est pas besoin d’ambassadeurs ni de roueries pour cela.
Sans les ambassadeurs et les rois, nous n’aurions pas eu, dans ces derniers temps, la question des mariages espagnols. S’est-on jamais préoccupé du mariage d’un président des États-Unis ?
Quant à la curée des places, notre vœu est celui de la Presse. Nous voudrions bien que la France de février ne donnât pas au monde ce triste et dégoûtant spectacle. Mais nous ne l’espérons guère, car nous ne pouvons nous faire illusion sur les faiblesses du cœur humain. Le moyen de réduire la curée, c’est de réduire les places elles-mêmes. Il est puéril d’attendre que les solliciteurs se contiennent eux-mêmes ; c’est au public de les contenir.
C’est pour cela que nous répéterons sans cesse : Supprimez toutes les fonctions inutiles. On donne pour conseil aux enfants de tourner trois fois la langue dans la bouche avant de dire une chose hasardée. Et nous, nous disons au gouvernement : Brisez trente plumes avant de signer la création d’une place nouvelle.
Une sinécure supprimée contrarie le titulaire et ne l’irrite pas ; une sinécure passant de mains en mains exaspère le destitué, désappointe dix postulants et mécontente le public.
La partie la plus pénible de la tâche dévolue au gouvernement provisoire sera sans doute de résister au torrent des sollicitations.
D’autant que quelques écoles, fort en faveur aujourd’hui, [VII-226] aspirent à élargir indéfiniment les attributions du gouvernement et à tout faire faire par l’État, c’est-à-dire à coups de contributions.
D’autres disent : Il faut bien que l’État dépense beaucoup pour faire vivre beaucoup de monde.
Est-il donc si difficile de voir que, lorsque le gouvernement dépense l’argent des contribuables, les contribuables ne le dépensent pas ?
51. — LA PRESSE PARISIENNE [9] .↩
La presse parisienne n’offre pas un spectacle moins extraordinaire, moins imposant que la population des barricades.
Qu’est devenue cette ardente et souvent brutale polémique des derniers temps ?
Les vives discussions reviendront sans doute. Mais n’est-il pas bien consolant de voir qu’au moment du danger, quand la patrie a besoin avant tout de sécurité, d’ordre, de confiance, toutes les rancunes s’oublient, et que même les doctrines les plus excentriques s’efforcent de se présenter sous des formes rassurantes ?
Ainsi le Populaire, journal des communistes, s’écrie : Respect à la propriété ! M. Cabet rappelle à ses adhérents qu’ils ne doivent chercher le triomphe de leurs idées que dans la discussion et les convictions publiques.
La Fraternité, journal des ouvriers, publie un long programme que les économistes pourraient avouer tout entier, sauf peut-être une ou deux maximes plus illusoires que dangereuses.
[VII-227]
L’Atelier, autre journal rédigé par des ouvriers, conjure ses frères d’arrêter le mouvement irréfléchi qui les portait, dans le premier moment, à briser les machines.
Tous les journaux s’efforcent à l’envi de calmer et de flétrir un autre sentiment barbare que malheureusement l’esprit de parti avait travaillé pendant quinze ans à soulever ; nous voulons parler des préventions nationales. Il semble qu’un jour de révolution a fait disparaître, en la rendant inutile, cette machine de guerre de toutes les oppositions.
Paix extérieure, ordre intérieur, confiance, vigilance, fraternité, voilà les mots d’ordre de toute la presse [10] .
52. — PÉTITION D’UN ÉCONOMISTE [11] .↩
On signe en ce moment une pétition qui demande :
Un ministère du progrès ou de l’organisation du travail. À ce sujet la Démocratie pacifique s’exprime ainsi :
« Pour organiser le travail dans la société française, il faut savoir l’organiser dans l’atelier alvéolaire de la nation, dans la commune. Toute doctrine sérieuse de transformation sociale doit donc pouvoir se résoudre dans une organisation de l’atelier élémentaire, et s’expérimenter d’abord sur une lieue carrée de terrain. Que la république crée donc un ministère du progrès et de l’organisation du [VII-228] travail, dont la fonction sera d’étudier tous les plans proposés par les différentes doctrines socialistes, et d’en favoriser l’expérience locale, libre et volontaire sur l’unité territoriale, la lieue carrée. »
Si cette idée se réalise, nous demanderons qu’on nous donne aussi notre lieue carrée pour expérimenter notre système.
Car enfin pourquoi les différentes écoles socialistes auraient-elles seules le privilége d’avoir à leur disposition des lieues carrées, des ateliers alvéolaires, des éléments territoriaux, en un mot, des communes ?
On dit qu’il s’agit d’expériences libres et volontaires. Entend-on que les habitants de la commune qu’il s’agit de soumettre à l’expérimentation socialiste devront y consentir, et que, d’une autre part, l’État ne devra pas intervenir avec des contributions levées sur les autres communes ? Alors à quoi bon la pétition, et qui empêche les habitants des communes de faire librement, volontairement et à leurs frais, une expérience socialiste sur eux-mêmes ?
Ou bien veut-on que l’expérience soit forcée, ou tout au moins secondée par des fonds prélevés sur la communauté tout entière ?
Mais cela même rendra l’expérience fort peu concluante. Il est bien évident qu’avec toutes les ressources de la nation on peut verser une grande somme de bien-être sur une lieue carrée de terrain.
En tout cas, si chaque inventeur d’organisation sociale est appelé à faire son expérience, nous nous inscrivons et demandons formellement une commune à organiser.
Notre plan du reste est fort simple.
Nous percevrons sur chaque famille, et par l’impôt unique, une très petite part de son revenu, afin d’assurer le respect des personnes et des propriétés, la répression des fraudes, des délits et des crimes. Cela fait, nous [VII-229] observerons avec soin comment les hommes s’organisent d’eux-mêmes.
Les cultes, l’enseignement, le travail, l’échange y seront parfaitement libres. Nous espérons que sous ce régime de liberté et de sécurité, chaque habitant ayant la faculté, par la liberté des échanges, de créer, sous la forme qui lui conviendra, la plus grande somme de valeur possible, les capitaux se formeront avec une grande rapidité. Tout capital cherchant à s’employer, il y aura une grande concurrence parmi les capitalistes. Donc les salaires s’élèveront ; donc les ouvriers, s’ils sont prévoyants et économes, auront une grande facilité pour devenir capitalistes ; et alors il pourra se faire entre eux des combinaisons, des associations dont l’idée sera conçue et mûrie par eux-mêmes.
La taxe unique étant excessivement modérée, il y aura peu de fonctions publiques, peu de fonctionnaires, pas de forces perdues, peu d’hommes soustraits à la production.
L’État n’ayant que des attributions fort restreintes et bien définies, les habitants jouiront de toute liberté dans le choix de leurs travaux ; car il faut bien remarquer que toute fonction publique inutile n’est pas seulement une charge pour la communauté, mais une atteinte à la liberté des citoyens. Dans la fonction publique qui s’impose au public et ne se débat pas, il n’y a pas de milieu : elle est utile ou sinon essentiellement nuisible ; elle ne saurait être neutre. Quand un homme exerce avec autorité une action, non sur les choses, mais sur ses semblables, s’il ne leur fait pas de bien, il doit nécessairement leur faire du mal.
Les impôts ainsi réduits au minimum indispensable pour procurer à tous la sécurité, les solliciteurs, les abus, les priviléges, l’exploitation des lois dans des intérêts particuliers seront aussi réduits au minimum.
Les habitants de cette commune expérimentale ayant, [VII-230] par la liberté d’échanger, la faculté de produire le maximum de valeur avec le minimum de travail, la lieue carrée fournira autant de bien-être que l’état des connaissances, de l’activité, de l’ordre et de l’économie individuelle le permettra.
Ce bien-être tendra à se répartir d’une manière toujours plus égale ; car les services les plus rétribués étant les plus recherchés [12] , il sera impossible d’acquérir d’immenses fortunes ; d’autant que la modicité de l’impôt n’admettra ni grands marchés publics, ni emprunts, ni agiotage, sources des fortunes scandaleuses que nous voyons s’accumuler dans quelques mains.
Cette petite communauté étant intéressée à n’attaquer personne, et toutes les autres étant intéressées à ne pas l’attaquer, elle jouira de la paix la plus profonde.
Les citoyens s’attacheront au pays, parce qu’ils ne s’y sentiront jamais froissés et restreints par les agents du pouvoir ; et à ses lois, parce qu’ils reconnaîtront qu’elles sont fondées sur la justice.
Convaincu que ce système, qui a au moins le mérite d’être simple et de respecter la dignité humaine, est d’autant meilleur qu’il s’applique à un territoire plus étendu et à une population plus nombreuse, parce que c’est là qu’on obtient le plus de sécurité avec le moins d’impôts ; nous en concluons que s’il réussit sur une commune il réussira sur la nation.
[VII-231]
53. — LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT [13] .↩
Tous les actes du gouvernement provisoire relatifs à l’instruction publique sont conçus, nous sommes fâchés de le dire, dans un esprit qui suppose que la France a renoncé à la liberté de l’enseignement.
On a pu s’en convaincre par la circulaire du ministre aux recteurs.
Voici venir un décret qui crée une commission des études scientifiques et littéraires.
Sur vingt membres qui la composent, il y en a quinze, au moins, si nous ne nous trompons, qui appartiennent à l’Université.
En outre, le dernier article de l’arrêté dispose que cette commission s’adjoindra dix membres, choisis par elle, est-il dit, parmi les fonctionnaires de l’instruction primaire et secondaire.
Nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer ici que, de toutes les branches de l’activité nationale, celle peut-être qui a fait le moins de progrès, c’est l’enseignement. Il est encore à peu près ce qu’il était dans le moyen âge. Les idylles de Théocrite et les odes d’Horace sont encore la base de l’instruction qu’on donne à la jeunesse du dix-neuvième siècle. Cela semble indiquer qu’il n’y a rien de moins progressif et de plus immuable que ce qui se fait par le monopole gouvernemental.
Il y a en France une école nombreuse qui pense que, sauf répression légale de l’abus, tout citoyen doit être en possession du libre exercice de ses facultés. Non-seulement c’est le droit, mais c’est la condition du progrès. C’est ainsi qu’on [VII-232] comprend la liberté aux États-Unis, et cette expérience vaut bien celles qu’on a faites en Europe du monopole. Il est à remarquer qu’aucun des hommes qui appartiennent à cette école, connue sous le nom d’école économiste, n’a été appelé dans aucune des commissions qu’on vient d’organiser.
Qu’ils aient été tenus éloignés des fonctions publiques rétribuées, cela n’est pas surprenant. Ils s’en sont tenus éloignés eux-mêmes, et ils le devaient, puisque leur idéal est de réduire les places à ce qui est indispensable pour maintenir l’ordre, la sécurité intérieure et extérieure, le respect des personnes et des propriétés, et, tout au plus, la création de quelques travaux d’utilité nationale.
Mais que l’on dédaigne systématiquement leur témoignage dans de simples enquêtes, c’est un symptôme significatif ; il prouve que le torrent nous entraîne vers le développement illimité de l’action gouvernementale, vers la compression indéfinie de la vraie liberté.
54. — CURÉE DES PLACES [14] .↩
Tous les journaux, sans exception, s’élèvent contre la curée des places dont l’Hôtel de ville donne le triste spectacle. Cette rapacité effrénée nous indigne et nous dégoûte plus que personne.
Mais enfin il faut voir la cause du mal, et il serait puéril d’exiger que le cœur humain fût fait autrement qu’il n’a plu à la nature de le faire.
Dans un pays où, depuis un temps immémorial, le travail libre est partout gêné et comprimé, où l’éducation propose [VII-233] pour modèle à toute la jeunesse les mœurs de la Grèce et de Rome, où le commerce et l’industrie sont constamment exposés par la presse à la risée des citoyens sous les noms de mercantilisme, industrialisme, individualisme, où la carrière des places mène seule à la fortune, à la considération, à la puissance, où l’État fait tout et se mêle de tout par ses innombrables agents, — il est assez naturel que les fonctions publiques soient avidement convoitées.
Comment détourner l’ambition de cette direction funeste et refouler l’activité des classes éclairées vers les carrières productives ?
Évidemment en supprimant beaucoup de fonctions, en limitant l’action gouvernementale, en laissant un champ plus vaste, plus libre et plus honoré à l’activité privée, en diminuant le salaire des hautes positions publiques.
Que faut-il donc penser de ces systèmes, si en vogue de nos jours, qui aspirent à faire passer dans le domaine des fonctions rétribuées ce qui était encore resté dans la sphère de l’industrie ? La Démocratie pacifique veut que l’État fasse les assurances, le transport des voyageurs, le roulage, le commerce des blés, etc., etc., etc. ?
N’est-ce pas fournir de nouveaux aliments à cette funeste passion qui indigne tous les citoyens honnêtes ?
Nous ne voulons pas parler ici des autres inconvénients de ce système. Examinez l’une après l’autre toutes les industries exercées par l’État, et voyez si ce ne sont pas celles au moyen desquelles les citoyens sont le plus mal et le plus chèrement pourvus.
Voyez l’enseignement qui se borne obstinément à l’étude de deux langues mortes depuis deux mille ans.
Voyez quel tabac on vous donne et pour quel prix.
Comparez, sous le rapport de la régularité et du bon marché, la distribution des imprimés exécutée par l’administration publique de la rue Jean-Jacques-Rousseau, ou [VII-234] par les entreprises particulières de la rue de la Jussienne.
Mais, en mettant de côté ces considérations, n’est-il pas évident que la curée des places est et sera toujours en proportion de l’aliment offert à cette curée ?
N’est-il pas évident que faire exercer l’industrie par l’État, c’est soustraire du travail à l’activité honnête pour le livrer à l’intrigue paresseuse et nonchalante ?
N’est-il pas évident, enfin, que c’est rendre permanent et progressif ce désordre dont l’Hôtel de ville est témoin et qui attriste les membres du gouvernement provisoire ?
55. — ENTRAVES ET TAXES [15] .↩
Pendant qu’un mouvement peut-être irrésistible nous emporte vers l’extension indéfinie des attributions de l’État, vers la multiplication des taxes ainsi que des entraves et des vexations qui en sont le cortége inévitable, une évolution en sens contraire, très-prononcée, se manifeste en Angleterre et entraînera peut-être la chute du ministère.
Là, chaque expérience, chaque effort pour réaliser le bien par l’intervention de l’État, aboutit à une déception. Bientôt on s’aperçoit que le bien ne se réalise pas et que l’expérience ne laisse après elle qu’une chose : la taxe.
Ainsi, l’année dernière, on a fait une loi pour régler le travail des manufactures, et l’exécution de cette loi a exigé la création d’un corps de fonctionnaires. Aujourd’hui, entrepreneurs, ouvriers, inspecteurs et magistrats s’accordent pour reconnaître que la loi a lésé tous les intérêts dont elle s’est mêlée. Il n’en reste que deux choses : le désordre et la taxe.
[VII-235]
Il y a deux ans, la législature bâcla une constitution pour la Nouvelle-Zélande, et vota de grandes dépenses pour la mettre en vigueur. Or ladite constitution a fait une lourde chute. Mais il y a une chose qui n’est pas tombée, c’est la taxe.
Lord Palmerston a cru devoir intervenir dans les affaires du Portugal. Il a ainsi attiré sur le nom anglais la haine d’une nation alliée, et cela au prix de quinze millions de francs ou d’une forte taxe.
Lord Palmerston persiste à saisir les navires brésiliens engagés dans la traite. Pour cela il expose la vie d’un nombre considérable de marins anglais ; il appelle des avanies sur les sujets britanniques établis au Brésil ; il rend impossible un traité entre l’Angleterre et Rio-Janeiro ; et tous ces dommages s’achètent au prix de flottes et de tribunaux, c’est-à-dire de taxes.
Ainsi il se trouve que les Anglais payent, non pour recevoir des avantages, mais pour éprouver des dommages.
La conclusion que nos voisins paraissent vouloir tirer de ce phénomène est celle-ci : Que le peuple, après avoir payé à l’administration ce qui est nécessaire pour garantir sa sécurité, garde le reste pour lui.
C’est une pensée bien simple, mais elle fera le tour du monde.
References
[1] Dans le t. II, p. 459 à 465, figure le contingent fourni par Bastiat aux Petites affiches de Jacques Bonhomme. Grâce à l’obligeance de M. G. de Molinari, nous pouvons reproduire maintenant de courts articles qu’écrivit Bastiat pour deux autres des feuilles publiques, qui eurent une courte existence en 1848, la République française et Jacques Bonhomme.(Note de l’éd.)
[2] La République française, no du 27 février 1848. (Note de l’éd.)
[3] La République française, no du 28 février 1848.(Note de l’éd.)
[4] Ici et ailleurs, l’emploi du pluriel montre que Bastiat parlait au nom de ses collaborateurs comme au sien. À ce moment, il signait avec eux le journal, et acceptait la solidarité de leurs opinions.(Note de l’édit.)
[5] La République française, no du 29 février 1848.(Note de l’édit.)
[6] La République française, no du 29 février 1848.
[7] La République française, no du 29 février 1848.
[8] No du 1er mars 1848 de la République française.(Note de l’édit.)
[9] No du 1er mars 1848 de la République française.(Note de l’édit.)
[10] À partir du second numéro de la République française, celui du 27 février jusqu’au no 5, du 1er mars 1848, le nom de Bastiat figure à la dernière ligne du journal avec les noms de ses autres rédacteurs. Il n’en est plus ainsi dans les numéros suivants : Bastiat ne signe plus le journal ; il se borne à signer ses propres articles.(Note de l’édit.)
[11] No du 2 mars 1848 de la République française.(Note de l’édit.)
[12] En ce sens qu’ils attirent le plus la concurrence.(Note de l’éd.)
[13] No du 4 mars 1848 de la République française. (Note de l’éd.)
[14] No du 5 mars 1848 de la République française. (Note de l’éd.)
[15] No du 6 mars 1848 de la République française. (Note de l’éd.)
56. — LA LIBERTÉ [1] .↩
J’ai beaucoup vécu, beaucoup vu, observé, comparé, étudié, et je sais arrivé à cette conclusion :
[VII-236]
Nos pères avaient raison de vouloir être libres, et nous devons le vouloir aussi.
Ce n’est pas que la liberté n’ait des inconvénients ; tout en a. Arguer contre elle de ces inconvénients, c’est dire à un homme qui est dans le bourbier : N’en sortez pas, car vous ne le pouvez sans quelque effort.
Ainsi il serait à souhaiter qu’il n’y eût qu’une foi dans le monde, pourvu que ce fût la vraie. Mais où est l’autorité infaillible qui nous l’imposera ? En attendant qu’elle se montre, maintenons la liberté d’examen et de conscience.
Il serait heureux que le meilleur mode d’enseignement fût universellement adopté. Mais qui le possède, et où est son titre ? Réclamons donc la liberté d’enseignement.
On peut s’affliger de voir des écrivains se complaire à remuer toutes les mauvaises passions. Mais entraver la presse, c’est entraver la vérité aussi bien que le mensonge. Ne laissons donc jamais périr la liberté de la presse.
C’est une chose fâcheuse que l’homme soit réduit à gagner son pain à la sueur de son front. Il vaudrait mieux que l’État nourrît tout le monde ; mais c’est impossible. Ayons du moins la liberté du travail.
En s’associant, les hommes peuvent tirer un plus grand parti de leurs forces. Mais les formes de l’association sont infinies ; quelle est la meilleure ? Ne courons pas la chance que l’État nous impose la plus mauvaise, cherchons à tâtons la bonne et réclamons la liberté d’association.
Un peuple a deux manières de se procurer une chose : la première, c’est de la faire ; la seconde, c’est d’en faire une autre et de la troquer. Il vaut certainement mieux avoir l’option que de ne l’avoir pas. Exigeons donc la liberté de l’échange.
Je me mêle aux débats publics, je m’efforce de pénétrer dans la foule pour prêcher toutes les libertés dont l’ensemble forme la liberté.
[VII-237]
57. — LAISSEZ FAIRE [2] .↩
Laissez faire ! — Je commence par dire, pour prévenir toute équivoque, que laissez faire s’applique ici aux choses honnêtes, l’État étant institué précisément pour empêcher les choses déshonnêtes.
Cela posé, et quant aux choses innocentes par elles-mêmes, comme le travail, l’échange, l’enseignement, l’association, la banque, etc., il faut pourtant opter. Il faut que l’État laisse faire ou empêche de faire.
S’il laisse faire, nous serons libres et économiquement administrés, rien ne coûtant moins que de laisser faire.
S’il empêche de faire, malheur à notre liberté et à notre bourse. À notre liberté, puisqu’empêcher c’est lier les bras : à notre bourse, car pour empêcher, il faut des agents, et pour avoir des agents, il faut de l’argent.
À cela les socialistes disent : Laissez faire ! mais c’est une horreur ! — Et pourquoi, s’il vous plaît ? — Parce que, quand on les laisse faire, les hommes font mal et agissent contre leurs intérêts. Il est bon que l’État les dirige.
Voilà qui est plaisant. Quoi ! vous avez une telle foi dans la sagacité humaine que vous voulez le suffrage universel et le gouvernement de tous par tous ; et puis, ces mêmes hommes que vous jugez aptes à gouverner les autres, vous les proclamez inaptes à se gouverner eux-mêmes !
58. — L’ASSEMBLÉE NATIONALE [3] .↩
— Maître Jacques, que pensez-vous de l’Assemblée nationale ?
— Je la crois excellente, bien intentionnée, passionnée [VII-238] pour le bien. Elle est peuple, elle aime le peuple, elle le voudrait heureux et libre. Elle fait honneur au suffrage universel.
— Cependant que d’hésitation ! que de lenteurs ! que d’orages sans causes ! que de temps perdu ! Quels biens a-t-elle réalisés ? quels maux a-t-elle empêchés ? Le peuple souffre, l’industrie s’éteint, le travail s’arrête, le trésor se ruine, et l’Assemblée passe son temps à écouter d’ennuyeuses harangues.
— Que voulez-vous ? L’Assemblée ne peut changer la nature des choses. La nature des choses s’oppose à ce que neuf cents personnes gouvernent avec une volonté ferme, logique et rapide. Aussi voyez comme elle attend un pouvoir qui réfléchisse sa pensée, comme elle est prête à lui donner une majorité compacte de sept cents voix dans le sens des idées démocratiques. Mais ce pouvoir ne surgit pas, et ne peut guère surgir dans le provisoire où nous sommes.
— Que faut-il donc que fasse l’Assemblée ?
— Trois choses : pourvoir à l’urgence, faire la Constitution, et s’en aller.
59. — L’ÉTAT [4] .↩
Il y en a qui disent : C’est un homme de finances qui nous tirera de là, Thiers, Fould, Goudchaux, Girardin. Je crois qu’ils se trompent.
— Qui donc nous en tirera ?
— Le peuple.
— Quand ?
[VII-239]
— Quand il aura appris cette leçon : L’État, n’ayant rien qu’il ne l’ait pris au peuple, ne peut pas faire au peuple des largesses.
— Le peuple sait cela, car il ne cesse de demander des réductions de taxes.
— C’est vrai ; mais, en même temps, il ne cesse de demander à l’État, sous toutes les formes, des libéralités.
Il veut que l’État fonde des crèches, des salles d’asile et des écoles gratuites pour la jeunesse ; des ateliers nationaux pour l’âge mûr et des pensions de retraite pour la vieillesse.
Il veut que l’État aille guerroyer en Italie et en Pologne.
Il veut que l’État fonde des colonies agricoles.
Il veut que l’État fasse les chemins de fer.
Il veut que l’État défriche l’Algérie.
Il veut que l’État prête dix milliards aux propriétaires.
Il veut que l’État fournisse le capital aux travailleurs.
Il veut que l’État reboise les montagnes.
Il veut que l’État endigue les rivières.
Il veut que l’État paye des rentes sans en avoir.
Il veut que l’État fasse la loi à l’Europe.
Il veut que l’État favorise l’agriculture.
Il veut que l’État donne des primes à l’industrie.
Il veut que l’État protége le commerce.
Il veut que l’État ait une armée redoutable.
Il veut que l’État ait une marine imposante.
Il veut que l’État…
— Avez-vous tout dit ?
— J’en ai encore pour une bonne heure.
— Mais enfin, où en voulez-vous venir ?
— À ceci : tant que le peuple voudra tout cela, il faudra qu’il le paye. Il n’y a pas d’homme de finances qui fasse quelque chose avec rien.
Jacques Bonhomme fonde un prix de cinquante mille francs à décerner à celui qui donnera une bonne définition de ce [VII-240] mot, l’état ; car celui-là sera le sauveur des finances, de l’industrie, du commerce et du travail [5] .
60. — PRENDRE CINQ ET RENDRE QUATRE CE N’EST PAS DONNER [6] .↩
Là, soyons de bon compte, qu’est-ce que l’État ? N’est-ce pas la collection de tous les fonctionnaires publics ? Il y a donc dans le monde deux espèces d’hommes, savoir : les fonctionnaires de toute sorte qui forment l’État, et les travailleurs de tout genre qui composent la société. Cela posé, sont-ce les fonctionnaires qui font vivre les travailleurs, ou les travailleurs qui font vivre les fonctionnaires ? En d’autres termes, l’État fait-il vivre la société, ou la société fait-elle vivre l’État ?
Je ne suis pas un savant, mais un pauvre diable qui s’appelle Jacques Bonhomme, qui n’est et n’a jamais pu être que travailleur.
Or, en qualité de travailleur, payant l’impôt sur mon pain, sur mon vin, sur ma viande, sur mon sel, sur ma fenêtre, sur ma porte, sur le fer et l’acier de mes outils, sur mon tabac, etc., etc., j’attache une grande importance à cette question et je la répète :
Les fonctionnaires font-ils vivre les travailleurs, ou les travailleurs font-ils vivre les fonctionnaires ?
Vous me demanderez pourquoi j’attache de l’importance à cette question, le voici :
Depuis quelque temps, je remarque une disposition [VII-241] énorme chez tout le monde à demander à l’État des moyens d’existence.
Les agriculteurs lui disent : Donnez-nous des primes, de l’instruction, de meilleures charrues, de plus belles races de bestiaux, etc.
Les manufacturiers : Faites-nous gagner un peu plus sur nos draps, sur nos toiles, sur nos fers.
Les ouvriers : Donnez-nous de l’ouvrage, des salaires et des instruments de travail.
Je trouve ces demandes bien naturelles, et je voudrais bien que l’État pût donner tout ce qu’on exige de lui.
Mais, pour le donner, où le prend-il ? Hélas ! il prend un peu plus sur mon pain, un peu plus sur mon vin, un peu plus sur ma viande, un peu plus sur mon sel, un peu plus sur mon tabac, etc., etc.
En sorte que ce qu’il me donne, il me le prend et ne peut pas ne pas me le prendre. Ne vaudrait-il pas mieux qu’il me donnât moins et me prît moins ?
Car enfin, il ne me donne jamais tout ce qu’il me prend. Même pour prendre et donner, il a besoin d’agents qui gardent une partie de ce qui est pris.
Ne suis-je pas une grande dupe de faire avec l’État le marché suivant ? — J’ai besoin d’ouvrage. Pour m’en faire avoir tu retiendras cinq francs sur mon pain, cinq francs sur mon vin, cinq francs sur mon sel et cinq francs sur mon tabac. Cela fera vingt francs. Tu en garderas six pour vivre et tu me feras une demande d’ouvrage pour quatorze. Évidemment je serai un peu plus pauvre qu’avant ; j’en appellerai à toi pour rétablir mes affaires, et voici ce que tu feras. Tu récidiveras. Tu prélèveras autres cinq francs sur mon pain, autres cinq francs sur mon vin, autres cinq francs sur mon sel, autres cinq francs sur mon tabac ; ce qui fera autres vingt francs. Sur quoi tu mettras autres six francs dans ta poche et me feras gagner autres quatorze francs. Cela fait, je [VII-242] serai encore d’un degré plus misérable. J’aurai de nouveau recours à toi, etc.
Si maladia
Opiniatria
Non vult se guarire,
Quid illi facere ?
— Purgare, asignare, clysterisare,
epurgare, resaignare, reclysterisare.
Jacques Bonhomme ! Jacques Bonhomme ! J’ai peine à croire que tu aies été assez fou pour te soumettre à ce régime, parce qu’il a plu à quelques écrivailleurs de le baptiser : Organisation et Fraternité.
61. — UNE MYSTIFICATION [7] .↩
Ainsi que vous savez, j’ai beaucoup voyagé et j’ai beaucoup à raconter.
Parcourant un pays lointain, je fus frappé de la triste condition dans laquelle paraissait être le peuple, malgré son activité et la fertilité du territoire.
Pour avoir l’explication de ce phénomène, je m’adressai à un grand ministre, qui s’appelait Budget. Voici ce qu’il me dit :
« J’ai fait faire le dénombrement des ouvriers. Il y en a un million. Ils se plaignant de n’avoir pas assez de salaire, et j’ai dû m’occuper d’améliorer leur sort.
« D’abord j’imaginai de prélever deux sous sur le salaire quotidien de chaque travailleur. Cela faisait rentrer [VII-243] 100,000 fr. tous les matins dans mes coffres, soit trente millions par an.
« Sur ces trente millions, j’en retenais dix pour moi et mes agents.
« Ensuite je disais aux ouvriers : il me reste vingt millions, avec lesquels je ferai exécuter des travaux, et ce sera un grand avantage pour vous.
« En effet, pendant quelque temps ils furent émerveillés. Ce sont d’honnêtes créatures, qui n’ont pas beaucoup de temps à eux pour réfléchir. Ils étaient bien un peu contrariés de ce qu’on leur subtilisât deux sous par jour ; mais leurs yeux étaient beaucoup plus frappés des millions ostensiblement dépensés par l’État.
« Peu à peu, cependant, ils se ravisèrent. Les plus fins d’entre eux disaient : — Il faut avouer que nous sommes de grandes dupes. Le ministre Budget commence par prendre à chacun de nous trente francs par an, et gratis ; puis il nous rend vingt francs, non pas gratis, mais contre du travail. Tout compte fait, nous perdons dix francs et nos journées à cette manœuvre. »
— Il me semble, seigneur Budget, que ces ouvriers-là raisonnaient assez bien.
« — J’en jugeai de même, et je vis bien que je ne pouvais continuer à leur soutirer leurs gros sous d’une façon aussi naïve. Avec un peu plus de ruse, me dis-je, au lieu de deux j’en aurai quatre.
« C’est alors que j’inventai l’impôt indirect. Maintenant, chaque fois que l’ouvrier achète pour deux sous de vin, il y a un sou pour moi. Je prends sur le tabac, je prends sur le sel, je prends sur la viande, je prends sur le pain, je prends partout et toujours. Je réunis ainsi, aux dépens des travailleurs, non plus trente millions, mais cent. Je fais bombance dans de beaux hôtels, je me prélasse dans de beaux carrosses, je me fais servir par de beaux laquais, le [VII-244] tout jusqu’à concurrence de dix millions. J’en donne vingt à mes agents pour guetter le vin, le sel, le tabac, la viande, etc ; et, avec ce qui me reste de leur propre argent, je fais travailler les ouvriers. »
— Et ils ne s’aperçoivent pas de la mystification ?
— « Pas le moins du monde. La manière dont je les épuise est si subtile qu’elle leur échappe. Mais les grands travaux que je fais exécuter éblouissent leurs regards. Ils se disent entre eux : Morbleu ! voilà un bon moyen d’extirper la misère. Vive le citoyen Budget ! Que deviendrions-nous, s’il ne nous donnait de l’ouvrage ? »
— Est-ce qu’ils ne s’aperçoivent pas qu’en ce cas vous ne leur prendriez plus leurs gros sous, et que, les dépensant eux-mêmes, ils se procureraient de l’ouvrage les uns aux autres ?
— « Ils ne s’en doutent pas. Ils ne cessent de me crier : Grand homme d’État, fais-nous travailler un peu plus encore. Et ce cri me réjouit, car je l’interprète ainsi : Grand homme d’État, sur notre vin, sur notre sel, sur notre tabac, sur notre viande, prends-nous un plus grand nombre de sous encore. »
62. — FUNESTE GRADATION [8] .↩
Les dépenses ordinaires de l’État sont fixées, par le budget de 1848, à un milliard sept cents millions.
Même avec l’impôt des 45 centimes, on ne peut arracher au peuple plus de un milliard cinq cents millions.
Reste un déficit net de deux cents millions.
En outre l’État doit deux cent cinquante millions de bons [VII-245] du trésor, trois cents millions aux caisses d’Épargne, sommes actuellement exigibles.
Comment faire ? L’impôt est arrivé à sa dernière limite. Comment faire ? L’État a une idée : s’emparer des industries lucratives et les exploiter pour son compte. Il va commencer par les chemins de fer et les assurances ; puis viendront les mines, le roulage, les papeteries, les messageries, etc., etc.
Imposer, emprunter, usurper, funeste gradation !
L’État, je le crains bien, suit la route qui perdit le père Mathurin. J’allai le voir un jour, le père Mathurin. Eh bien ! lui dis-je, comment vont les affaires ?
— Mal, répondit-il ; j’ai peine à joindre les deux bouts. Mes dépenses débordent mes recettes.
— Il faut tâcher de gagner un peu plus.
— C’est impossible.
— Alors, il faut se résoudre à dépenser un peu moins.
— À d’autres ! Jacques Bonhomme, vous aimez à donner des conseils, et moi, je n’aime pas à en recevoir.
À quelque temps de là, je rencontrai le père Mathurin brillant et reluisant, en gants jaunes et bottes vernies. Il vint à moi sans rancune. Cela va admirablement ! s’écria-t-il. J’ai trouvé des prêteurs d’une complaisance charmante. Grâce à eux, mon budget, chaque année, s’équilibre avec une facilité délicieuse.
— Et, à part ces emprunts, avez-vous augmenté vos recettes ?
— Pas d’une obole.
— Avez-vous diminué vos dépenses ?
— Le ciel m’en préserve ! bien au contraire. Admirez cet habit, ce gilet, ce gibus ! Ah ! si vous voyiez mon hôtel, mes laquais, mes chevaux !
— Fort bien ; mais calculons. Si l’an passé vous ne pouviez joindre les deux bouts, comment les joindrez-vous, [VII-246] maintenant que, sans augmenter vos recettes, vous augmentez vos dépenses et avez des arrérages à payer ?
— Jacques Bonhomme, il n’y a pas de plaisir à causer avec vous. Je n’ai jamais vu un interlocuteur plus maussade.
Cependant ce qui devait arriver arriva. Mathurin mécontenta ses prêteurs, qui disparurent tous. Cruel embarras !
Il vint me trouver. Jacques, mon bon Jacques, me dit-il, je suis aux abois ; que faut-il faire ?
— Vous priver de tout superflu, travailler beaucoup, vivre de peu, payer au moins les intérêts de vos dettes, et intéresser ainsi à votre sort quelque juif charitable qui vous prêtera de quoi passer un an ou deux. Dans l’intervalle, vous renverrez vos commis inutiles, vous vous logerez modestement, vous vendrez vos équipages, et, peu à peu, vous rétablirez vos affaires.
— Maître Jacques, vous êtes toujours le même ; vous ne savez pas donner un conseil agréable et qui flatte le goût des gens. Adieu. Je ne prendrai conseil que de moi-même. J’ai épuisé mes ressources, j’ai épuisé les emprunts ; maintenant je vais me mettre à…
— N’achevez pas, je vous devine.
63. — AUX CITOYENS LAMARTINE ET LEDRU-ROLLIN [9] .↩
Dissolvez les ateliers nationaux. Dissolvez-les avec tous les ménagements que l’humanité commande, mais dissolvez-les.
Si vous voulez que la confiance renaisse, dissolvez les ateliers nationaux.
[VII-247]
Si vous voulez que l’industrie reprenne, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous voulez que les boutiques se vident et s’emplissent, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous voulez que les fabriques se rouvrent, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous voulez que la province se calme, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous voulez que la garde nationale se repose, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous voulez que le peuple vous bénisse, y compris cent mille travailleurs de ces ateliers sur cent trois mille, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous n’avez pas résolu que la stagnation des affaires, et puis celle du travail, et puis la misère, et puis l’inanition, et puis la guerre civile, et puis la désolation, deviennent le cortège de la république, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous n’avez pas résolu de ruiner les finances, d’écraser les provinces, d’exaspérer les paysans, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous ne voulez pas que la nation tout entière vous soupçonne de faire à dessein planer incessamment l’émeute sur l’Assemblée nationale, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous ne voulez pas affamer le peuple, après l’avoir démoralisé, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous ne voulez pas être accusés d’avoir imaginé un moyen d’oppression, d’épouvante, de terreur et de ruine qui dépasse tout ce que les plus grands tyrans avaient inventé, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous n’avez pas l’arrière-pensée de détruire la république en la faisant haïr, dissolvez les ateliers nationaux.
Si vous ne voulez pas être maudits dans le présent, si vous ne voulez pas que votre mémoire soit exécrée de génération en génération, dissolvez les ateliers nationaux.
[VII-248]
Si vous ne dissolvez pas les ateliers nationaux, vous attirerez sur la patrie tous les fléaux à la fois.
Si vous ne dissolvez pas les ateliers nationaux, que deviendront les ouvriers lorsque vous n’aurez plus de pain à leur donner et que l’industrie privée sera morte ?
Si vous conservez les ateliers nationaux dans des desseins sinistres, la postérité dira de vous : C’est sans doute par lâcheté qu’ils proclamaient la république, puisqu’ils l’ont tuée par trahison.
References
[1] 1er numéro du Jacques Bonhomme. du 11 au 15 juin 1848.(Note de l’édit.)
[2] Même numéro.
[3] Même numéro.
[4] Même numéro.
[5] On reconnaît, dans cet article et le suivant, l’esquisse du pamphlet l’État, publié trois mois après. Voir t. IV, p. 327.(Note de l’éd.)
[6] No 2 de Jacques Bonhomme, du 15 au 18 juin 1847.
[7] No 2 de Jacques Bonhomme, du 15 au 18 juin 1847.
[8] No 3 du Jacques Bonhomme, du 20 au 23 juin 1848.
[9] No 3 du Jacques Bonhomme, du 20 au 23 juin 1848.
64. — LE CAPITAL [1] .↩
Qui ne se rappelle le frisson d’épouvante qui fit tressaillir l’Europe stupéfaite, lorsque des voyageurs, revenant de pays lointains, jetèrent à ses oreilles cette nouvelle : « L’Inde a vomi sur le monde le choléra-morbus ! Il grandit, il s’étend, il s’avance, décimant les populations sur son passage, et notre civilisation ne l’arrêtera pas. »
Serait-il vrai que la civilisation à son tour, jalouse de la barbarie, eût enfanté un fléau mille fois plus terrible, un monstre dévorant, un cancer s’attaquant à ce qu’il y a de plus sacré, au travail, cet aliment de la vie des peuples, un tyran implacable toujours occupé à creuser entre les hommes le gouffre de l’inégalité, à appauvrir le pauvre pour enrichir le riche, à semer sur ses pas la misère, l’exténuation, la faim, l’envie, la rage et l’émeute, à remplir incessamment les bagnes, les prisons, les hospices et les tombeaux, fléau plus funeste dans son action continue et [VII-249] éternelle que le choléra et la peste, le capital, puisqu’il faut l’appeler par son nom !
En vérité, les hommes ne sont pas près de s’entendre, car ce même Capital que les uns peignent sous des couleurs si odieuses, d’autres, et je suis du nombre, en font le pain des pauvres, l’universel agent de l’égalité, l’instigateur du progrès, le libérateur des classes laborieuses et souffrantes.
Qui a tort, qui a raison ? Ce n’est pas une question de pure curiosité, car enfin, si le capital est un fléau destructeur, nous devons nous ranger dans les rangs nombreux de ceux qui lui font une guerre acharnée. Si, au contraire, il est le bienfaiteur de l’humanité, cette guerre insensée a cela d’étrange que les assaillants se portent à eux-mêmes tous les coups qu’ils dirigent contre lui.
Qu’est-ce donc que le capital ? Quelle est son origine ? Quelle est sa nature ? Quelle est sa mission ? Quels sont ses éléments ? Quels sont ses effets ?
Les uns disent : C’est le sol, cette source de toute richesse, qui a été accaparé par quelques-uns. D’autres disent : C’est l’argent, ce vil métal objet de tant de sales cupidités qui ensanglantent la terre depuis qu’elle est habitée.
Assistons à la naissance, à la première formation du capital ; c’est le moyen de nous en faire une idée juste.
Quand ce héros pacifique éternellement chéri de toutes les générations d’enfants, Robinson Crusoé, se trouva jeté par la tempête sur une île déserte, le besoin le plus impérieux de notre fragile nature le força à poursuivre, au jour le jour, la proie qui devait l’empêcher de mourir. Il aurait bien voulu construire une hutte, clore un jardin, réparer ses vêtements, fabriquer des armes ; mais il s’apercevait que, pour se livrer à ces travaux, il faut des matériaux, des instruments, et surtout des provisions, car nos besoins sont [VII-250] gradués de telle sorte qu’on ne peut travailler à satisfaire les uns que lorsqu’on a accumulé de quoi satisfaire les autres. Eût-il vécu pendant l’éternité tout entière, jamais Robinson n’aurait pu entreprendre la construction d’une hutte ou la confection d’un outil, s’il n’avait préalablement mis en réserve ou épargné du gibier ou du poisson.
C’est pourquoi il se disait souvent : Je suis le plus grand propriétaire du monde et le plus misérable des hommes. Le sol n’est pas pour moi un capital. J’aurais sauvé du naufrage un sac de louis que je n’en serais pas plus avancé, l’argent ne serait pas pour moi un capital. Mon travail unique et forcé, c’est la chasse. La seule chose qui pourrait me permettre de passer à d’autres occupations, ce serait de prendre chaque jour un peu plus de gibier qu’il ne m’en faut pour la journée, et d’avoir ainsi des provisions. Pendant que je vivrais sur ces provisions, je pourrais fabriquer des armes qui rendraient ma chasse plus productive, me permettraient d’augmenter mes provisions, et mettraient mon temps en disponibilité pour des travaux de plus longue haleine. Je vois bien que le premier des capitaux, ce sont les provisions, le second, les instruments.
Matériaux, instruments, provisions, voilà le capital de l’homme isolé, trois choses sans lesquelles il est enchaîné à la poursuite de la pure subsistance, trois choses sans lesquelles il n’y a pour lui ni travail ultérieur, ni par conséquent progrès possible, trois choses qui supposent que sa consommation a pu être moindre que sa production, qu’une réserve, une épargne a pu être réalisée.
Et voilà aussi, pour l’homme en société, la vraie définition du capital. Le capital d’une nation, c’est la totalité de ses matériaux, provisions et instruments.
Quand je parle des matériaux, je désigne ceux qui sont le fruit du travail et de l’épargne. Sans cette condition, ils n’appartiennent à personne. Sous cette condition, ils [VII-251] appartiennent naturellement à ceux qui les ont produits, et qui, pouvant les consommer, se sont abstenus.
Pour faire quoi que ce soit en ce monde, il faut dans une mesure quelconque une ou deux de ces choses ou les trois réunies. Comment pourrions-nous bâtir, construire, labourer, tisser, filer, forger, lire, étudier, si, par le travail et l’épargne, nous n’avions acquis des matériaux, des instruments et, en tout cas, quelques provisions ?
Quand, pendant son travail actuel, un homme consomme du capital qu’il a lui-même formé, on peut le considérer comme réunissant toutes les qualités de producteur, consommateur, prêteur, emprunteur, débiteur, créancier, capitaliste, ouvrier ; et, le phénomène économique s’accomplissant tout entier dans un seul individu, le mécanisme en est d’une simplicité extrême, ainsi que nous le montre l’exemple de Robinson.
Mais, si cet homme use des matériaux, instruments et provisions travaillés et épargnés par autrui, le phénomène se complique. Il ne les obtient qu’à la suite d’une transaction, et cette transaction stipule toujours une rémunération en faveur du prêteur. Celui qui emprunte ainsi, pour un an, par exemple, les trois choses sans lesquelles il ne pourrait rien faire et mourrait de faim, doit-il autre chose que la simple et intégrale restitution des objets empruntés ? L’affirmative me paraît incontestable, et elle a été telle pour tous les hommes depuis le commencement du monde jusqu’à Proudhon. En effet, si Robinson se prive aujourd’hui d’une partie de sa nourriture, s’il met du gibier de côté, afin de pouvoir se livrer demain à un travail plus profitable que la chasse, et si Vendredi lui emprunte ce gibier, il est clair qu’il ne pourra l’obtenir moyennant la simple restitution, à moins que, pour rendre service, Robinson ne veuille s’infliger à lui-même un dommage. La base de la transaction sera celle-ci :
[VII-252]
Robinson prêtera, s’il calcule que sa journée du lendemain employée à la chasse, plus la rétribution stipulée, lui vaudront mieux que le travail qu’il se proposait de faire.
Vendredi empruntera, s’il calcule que le travail auquel cet emprunt lui permet de se livrer, déduction faite de la rétribution stipulée, lui vaudra encore mieux que celui auquel il serait réduit sans cet emprunt.
Ainsi on peut affirmer qu’il y a dans le capital le principe d’une rémunération. Puisqu’il est avantageux à celui qui l’a formé, celui-ci ne peut être justement tenu de le céder sans compensation.
Cette compensation prend des noms fort divers selon la nature de l’objet prêté. Si c’est une maison, on l’appelle loyer ; si c’est une terre, fermage, etc.
Dans les sociétés compliquées, il est rare que le prêteur ait justement la chose dont l’emprunteur a besoin. C’est pourquoi le prêteur convertit son capital (matériaux, instruments et provisions) en numéraire, et il prête l’argent à l’emprunteur qui peut alors se procurer le genre de matériaux, instruments et provisions qui lui sont nécessaires. La rétribution du capital prêté sous cette forme s’appelle intérêt.
Comme la plupart des prêts exigent pour la commodité, cette double conversion préalable du capital en numéraire et du numéraire en capital, on a fini par confondre le capital avec le numéraire. C’est une des plus funestes erreurs en économie politique.
L’argent n’est qu’un moyen de faire passer les choses, les réalités, d’une main à l’autre. Aussi, souvent de simples billets, de simples revirements de comptes suffisent. Combien donc ne se fait-on pas illusion, quand on croit augmenter les matériaux, les instruments et les provisions du pays en augmentant l’argent et les billets !
Naturellement nous venons tous au monde sans capital, [VII-253] ce que l’on est trop porté à oublier. Les uns en reçoivent beaucoup de leur père, les autres un peu, d’autres pas du tout.
Ces derniers seraient comme Robinson dans son île, si personne avant eux et autour d’eux n’avait travaillé et épargné.
Ils sont donc forcés d’emprunter, ce qui, nous l’avons vu, signifie travailler sur des matériaux, avec des instruments, et en vivant de provisions que d’autres ont produites et épargnées, — et en payant pour cela une rétribution.
Cela posé, quel est leur intérêt ? C’est que cette rétribution leur soit aussi peu onéreuse que possible ; c’est-à-dire que la part à céder sur le travail pour l’usage du capital se restreigne dans des limites de plus en plus étroites. Plus sera réduite, en effet, cette part que le capitaliste prélève sur le prolétaire, plus celui-ci sera en mesure d’épargner à son tour, de former du capital.
Oui, que le prolétaire le sache et qu’il en reste bien convaincu, son intérêt, son intérêt dominant et fondamental, c’est que le capital abonde autour de lui, c’est que le pays regorge de matériaux, d’instruments et de provisions, car ces choses aussi se font concurrence entre elles. Plus il y en a dans le pays, moins on exige de rétribution de ceux à qui on les prête. Le prolétaire est intéressé à pouvoir mettre ses bras aux enchères, à pouvoir quitter un capitaliste exigeant pour un autre plus facile.
Quand les capitaux abondent, le salaire hausse : cela est aussi sûr qu’il est sûr que le plateau d’une balance baisse quand on y jette des poids.
Prolétaires, ne vous en laissez pas imposer. Rien n’est plus beau, plus doux que la fraternité. Elle peut guérir bien des maux partiels, jeter du baume sur bien des plaies. Mais ce qu’elle ne peut faire, c’est de hausser le taux général des salaires. Non, elle ne peut pas le faire, parce que [VII-254] ni les mots, ni les sentiments, ni les vœux ne peuvent faire qu’une quantité donnée d’instruments et de matériaux donne plus d’ouvrage, qu’une quantité donnée de provisions donne à chacun une part plus grande.
On vous dit que le capital tire à lui le plus clair des profits. Oui, quand il est rare ; non, quand il est abondant.
On vous dit que le capital fait concurrence au travail : c’est plus qu’une erreur, c’est une absurdité ridicule. L’abondance des instruments et des matériaux ne peut nuire au travail ; l’abondance des provisions ne peut irriter les besoins.
Les travailleurs se font concurrence entre eux ; le travail se fait concurrence à lui-même.
Les capitalistes se font concurrence entre eux ; le capital se fait concurrence à lui-même.
Voilà la vérité. Mais dire que le capital fait concurrence au travail, c’est dire que le pain fait concurrence à la faim, que la lumière fait obstacle à la vue.
Et s’il est vrai, prolétaires, que vous n’ayez qu’une planche de salut, qui est l’accroissement indéfini du capital, l’accumulation incessante des matériaux, instruments et provisions, que devez-vous désirer ?
C’est que la société soit dans les conditions les plus favorables à cet accroissement, à cette accumulation.
Quelles sont ces conditions ?
La première de toutes c’est la sécurité. Si les hommes ne sont pas sûrs de jouir du fruit de leur travail, ils ne travaillent pas, ils n’accumulent pas. Dans un régime d’incertitude et de frayeur, le capital ancien se cache, se dissipe ou déserte, le capital nouveau ne se forme pas. La masse des provisions s’ébrèche, la part de chacun diminue, à commencer par la vôtre. Demandez donc au gouvernement sécurité, et aidez-le à la fonder.
La seconde c’est la liberté. Quand on ne peut travailler [VII-255] librement, on travaille moins, la part de l’épargne est moindre, le capital ne s’accroît pas en proportion du nombre des bras, le salaire baisse et la misère vous décime. Alors, la charité elle-même est un vain remède, sinon pour quelques individus, au moins pour les masses ; car, si elle a des mérites immenses, elle n’a pas, comme le travail, celui de multiplier les pains.
La troisième c’est l’économie. Quand toutes les épargnes annuelles d’une nation sont dissipées par les folies de son gouvernement ou par le luxe des particuliers, le capital ne peut grossir.
Français, faut-il le dire ? notre chère patrie brille aux yeux des peuples par des qualités éminentes ; mais ce n’est pas parmi nous qu’il faut chercher ces trois conditions essentielles pour la formation des capitaux : sécurité, liberté, économie. C’est là, et là seulement, qu’est la cause du paupérisme.
References
[1] Almanach républicain pour 1849, 1 vol. in-32, Paris, Pagnerre.
1499.N’oublions pas qu’à cette époque des voix retentissantes prodiguaient au capital les épithètes d’infâme et d’infernal.(Note de l’édit.)
65. — PROFESSION DE FOI D’AVRIL 1849.↩
Mes chers Compatriotes,
Vous m’avez donné un mandat qui touche à son terme. Je l’ai rempli dans l’esprit qui me l’a fait donner.
Rappelez-vous les élections de 1848. Que vouliez-vous ?
Quelques-uns d’entre vous avaient salué avec transport l’avénement de la République ; d’autres ne l’avaient ni provoquée ni désirée ; d’autres encore la redoutaient. Mais, par un élan de bon sens admirable, vous vous unîtes tous dans cette double pensée :
1o Maintenir et essayer loyalement la République ;
[VII-256]
2o La faire rentrer dans la voie de l’ordre et de la sécurité.
L’histoire dira que l’Assemblée nationale, au milieu d’immenses périls, a été fidèle à ce programme. En se séparant elle laisse l’anarchie et la réaction vaincues ; la sécurité rétablie ; les utopies subversives frappées d’impuissance ; un gouvernement régulier ; une Constitution qui admet des perfectionnements ultérieurs ; la paix maintenue ; des finances échappées aux plus grands dangers. Oui, quoique souvent battue par l’orage, votre Assemblée a été l’expression de votre volonté. Elle m’apparaît comme un miracle inespéré du suffrage universel. La calomnier, c’est vous calomnier vous-mêmes.
Pour moi, je me suis toujours retrempé de l’esprit qui vous animait tous, en avril 1848. Bien souvent, quand, sous la pression de difficultés terribles, je voyais vaciller le flambeau qui devait me guider, j’ai évoqué le souvenir des nombreuses réunions où j’avais comparu devant vous, et je me suis dit :
« Il faut vouloir ce que mes commettants ont voulu : La République honnête. »
Compatriotes, je suis forcé de vous parler de moi, je me bornerai à des faits.
Au 23 février, je n’ai pas pris part à l’insurrection. Par hasard, je me suis trouvé à la fusillade de l’hôtel des Capucines. Pendant que la foule fuyait éperdue, je remontai le courant et, en face de ce bataillon dont les fusils étaient encore chauds, aidé de deux ouvriers, j’ai donné mes soins, pendant cette nuit funèbre, aux victimes mortellement frappées.
Dès le 25, j’ai pu prévoir le débordement des idées subversives dont le foyer devait se concentrer bientôt au Luxembourg. Pour les combattre, je fondai un journal. Voici le jugement qu’en porte une Revue qui me tombe sous la main et qui n’est pas suspecte, elle est intitulée : [VII-257] Bibliographie catholique, destinée aux prêtres, aux séminaires, aux écoles, etc.
« La République française, feuille qui a paru le lendemain de la Révolution ; écrite avec talent, modération et sagesse, en opposition au socialisme, au Luxembourg et aux circulaires. »
Survint ce qu’on a appelé avec raison la curée des places. Plusieurs de mes amis étaient tout-puissants, entre autres M. de Lamartine, qui m’avait écrit quelques jours avant : « Si jamais l’orage me porte au Pouvoir, vous m’aiderez à faire triompher nos idées. » Il m’était facile d’arriver à de hautes positions ; je n’y ai seulement pas pensé.
Élu par vous, à la presque unanimité, j’entrai à l’Assemblée le 5 mai. Le 15 nous fûmes envahis. Ce jour-là mon rôle s’est borné à rester à mon poste, comme tous mes collègues.
Nommé membre et vice-président du comité des Finances, il fut bientôt manifeste que nous aurions à résister à une opinion alors fort accréditée parce qu’elle est fort séduisante. Sous prétexte de donner satisfaction au peuple, on voulait investir d’une puissance exorbitante le Gouvernement révolutionnaire ; on voulait que l’État suspendît le remboursement des caisses d’Épargne et des Bons du Trésor ; qu’il s’emparât des chemins de fer, des assurances, des transports. Le ministère poussait dans cette voie, qui ne me semble autre chose que la spoliation régularisée par la loi et exécutée par l’impôt. J’ose dire que j’ai contribué à préserver mon pays d’une telle calamité.
Cependant une collision effroyable était menaçante. Le travail vrai des ateliers particuliers était remplacé par le travail mensonger des ateliers nationaux. Le peuple de Paris organisé et armé était le jouet d’utopistes ignorants et d’instigateurs de troubles. L’Assemblée, forcée de détruire une à une, par ses votes, ces illusions trompeuses, prévoyait le choc et n’avait guère, pour y résister, que la force morale [VII-258] qu’elle tenait de vous. Convaincu qu’il ne suffisait pas de voter, mais qu’il fallait éclairer les masses, je fondai un autre journal qui aspirait à parler le simple langage du bon sens, et que, par ce motif, j’intitulai Jacques Bonhomme. Il ne cessait de réclamer la dissolution, à tout prix, des forces insurrectionnelles. La veille même des Journées de Juin, il contenait un article de moi sur les ateliers nationaux [1] . Cet article, placardé sur tous les murs de Paris, fit quelque sensation. Pour répondre à certaines imputations, je le fis reproduire dans les journaux du Département.
La tempête éclata le 24 juin. Entré des premiers dans le faubourg Saint-Antoine, après l’enlèvement des formidables barricades qui en défendaient l’accès, j’y accomplis une double et pénible tâche : Sauver des malheureux qu’on allait fusiller sur des indices incertains ; pénétrer dans les quartiers les plus écartés pour y concourir au désarmement. Cette dernière partie de ma mission volontaire, accomplie au bruit de la fusillade, n’était pas sans danger. Chaque chambre pouvait cacher un piége ; chaque fenêtre, chaque soupirail pouvait masquer un fusil.
Après la victoire, j’ai prêté un concours loyal à l’administration du Général Cavaignac, que je tiens pour un des plus nobles caractères que la Révolution ait fait surgir. Néanmoins, j’ai résisté à tout ce qui m’a paru mesure arbitraire, car je sais que l’exagération dans le succès le compromet. L’empire sur soi-même, la modération en tous sens, telle a été ma règle, ou plutôt mon instinct. Au faubourg Saint-Antoine, d’une main je désarmais les insurgés, de l’autre je sauvais les prisonniers. C’est le symbole de ma conduite parlementaire.
Vers cette époque, j’ai été atteint d’une maladie de [VII-259] poitrine qui, se combinant avec l’immensité de l’enceinte de nos délibérations, m’a interdit la tribune. Je ne suis pas pour cela resté oisif. La vraie cause des maux et des dangers de la société résidait, selon moi, dans un certain nombre d’idées erronées, pour lesquelles ces classes qui ont pour elle le nombre et la force s’étaient malheureusement enthousiasmées. Il n’est pas une de ces erreurs que je n’aie combattues. Certes, je savais que l’action qu’on cherche à exercer sur les causes est toujours très lente, qu’elle ne suffit pas quand le danger fait explosion. Mais pourriez-vous me reprocher d’avoir travaillé pour l’avenir, après avoir fait pour le présent tout ce qu’il m’a été possible de faire ?
Aux doctrines de Louis Blanc, j’ai opposé un écrit intitulé : Individualisme et Fraternité [2] .
La Propriété est menacée dans son principe même ; on cherche à tourner contre elle la législation : je fais la brochure : Propriété et loi.
On attaque cette forme de Propriété particulière qui consiste dans l’appropriation individuelle du sol : je fais la brochure : Propriété et spoliation, laquelle, selon les économistes anglais et américains, a jeté quelque lumière sur la difficile question de la rente des terres.
On veut fonder la fraternité sur la contrainte légale ; je fais la brochure : Justice et Fraternité.
On ameute le travail contre le capital ; on berce le Peuple de la chimère de la Gratuité du crédit ; je fais la brochure : Capital et rente.
Le communisme nous déborde. Je l’attaque dans sa [VII-260] manifestation la plus pratique, par la brochure : Protectionisme et Communisme.
L’École purement révolutionnaire veut faire intervenir l’État en toutes choses et ramener ainsi l’accroissement indéfini des impôts ; je fais la brochure intitulée : l’État, spécialement dirigée contre le manifeste montagnard.
Il m’est démontré qu’une des causes de l’instabilité du Pouvoir et de l’envahissement désordonné de la fausse politique, c’est la guerre des Portefeuilles ; je fais la brochure : Incompatibilités parlementaires.
Il m’apparaît que presque toutes les erreurs économiques qui désolent ce pays proviennent d’une fausse notion sur les fonctions du numéraire ; je fais la brochure : Maudit argent.
Je vois qu’on va procéder à la réforme financière par des procédés illogiques et incomplets ; je fais la brochure : Paix et liberté, ou le Budget Républicain.
Ainsi, dans la rue par l’action, dans les esprits par la controverse, je n’ai pas laissé échapper une occasion, autant que ma santé me l’a permis, de combattre l’erreur, qu’elle vînt du Socialisme ou du Communisme, de la Montagne ou de la Plaine.
Voilà pourquoi j’ai dû voter quelquefois avec la gauche, quelquefois avec la droite ; avec la gauche quand elle défendait la liberté et la république, avec la droite quand elle défendait l’ordre et la sécurité.
Et si l’on me reproche cette prétendue double alliance, je répondrai : je n’ai fait alliance avec personne, je ne me suis affilié à aucune coterie, J’ai voté, dans chaque question, selon l’inspiration de ma conscience. Tous ceux qui ont bien voulu lire mes écrits, à quelque époque qu’ils aient été publiés, savent que j’ai toujours eu en horreur les majorités et les oppositions systématiques.
Est arrivée l’Élection du Président de la République. [VII-261] Nous étions encore en face de grands dangers, entre autres la guerre extérieure. Je ne savais ce qu’on pouvait attendre de Napoléon, je savais ce qu’on pouvait attendre de Cavaignac, qui s’était prononcé pour la Paix. J’ai eu mes préférences, je les ai loyalement exprimées. C’était mon droit, c’était même mon devoir, de dire ce que je faisais et pourquoi je le faisais. C’est à cela que je me suis borné. Le suffrage universel m’a donné tort. Je me suis rallié comme je le devais à sa volonté toute-puissante. Je défie qu’on me signale un vote d’opposition systématique à l’Élu du 20 décembre. Je me considérerais comme un factieux, si j’entravais, par une rancune ridicule, la grande et utile mission qu’il a reçue du Pays.
Comme membre du Comité des finances et plus tard de la commission du Budget, j’ai travaillé, autant que l’état de nos finances le permettait, aux réformes qui, vous le savez, ont toujours été le but de mes efforts. J’ai concouru à la réduction de l’impôt du sel et de la poste. Membre de la Commission des boissons, nous avions préparé une réforme radicale, que les moments comptés de l’Assemblée ajournent à un autre temps. J’ai fortement insisté pour la diminution de l’armée, et j’aurais voulu arriver à adoucir la dure loi du recrutement.
Sur la question de la dissolution de l’Assemblée, je n’ai jamais varié. Faire les lois organiques indispensables à la mise en œuvre de la constitution, rien de plus, rien de moins.
Compatriotes, voilà mes actes, je les livre à votre impartialité.
Si vous jugez à propos de me réélire, je vous déclare que je persévérerai dans la ligne que vous m’avez tracée, en avril 1848 : Maintenir la République ; fonder la sécurité.
Que si, sous l’influence des jours mauvais que vous avez traversés, vous avez conçu d’autres idées, d’autres [VII-262] espérances, si vous voulez poursuivre un but nouveau et tenter de nouvelles aventures, alors je ne puis plus être votre mandataire ; je ne renoncerai pas à l’œuvre que nous avons entreprise en commun, au moment de recueillir le fruit de nos efforts. La sécurité est sans doute le premier besoin de notre époque et le premier des biens en tous temps. Mais je ne puis croire qu’on la fonde d’une manière solide par l’abus du triomphe, par l’irritation, par la violence, par les emportements de la réaction. Celui que vous honorerez de vos suffrages n’est pas le représentant d’une classe mais de toutes. Il ne doit pas oublier qu’il y a de grandes souffrances, de profondes misères, de criantes injustices dans le pays. Comprimer, toujours comprimer, cela n’est ni juste, ni même prudent. Rechercher les causes de la souffrance, y apporter tous les remèdes compatibles avec la justice, c’est un devoir aussi sacré que celui de maintenir l’ordre. Sans doute il ne faut pas transiger avec la vérité ; il ne faut pas flatter les espérances chimériques, il ne faut pas céder aux préjugés populaires, et moins que jamais, quand ils se manifestent par l’insurrection. Mes actes et mes écrits sont là pour témoigner que, sous ce rapport, on n’a pas de reproche à me faire. Mais qu’on ne me demande pas non plus de m’abandonner à des mouvements de colère et de haine contre des frères malheureux et égarés, que leur ignorance expose trop souvent à de perfides suggestions. Le devoir d’une assemblée nationale, émanée du suffrage universel, est de les éclairer, de les ramener, d’écouter leurs vœux, de ne leur laisser aucun doute sur son ardente sympathie. Aimer, c’est toute la loi, a dit un grand apôtre. Nous sommes à une époque où cette maxime est aussi vraie en politique qu’en morale.
Je suis, chers compatriotes, votre dévoué
References
[1] Jacques Bonhomme, no du 20 au 23 juin ; au présent volume, p. 246. (Note de l’éd.)
[2] Je n’ai pas découvert qu’on ait jamais imprimé un travail de Bastiat sous le titre d’Individualisme et Fraternité. A-t-il, par mégarde, désigné l’ébauche reproduite ci-après (n° 76) comme un travail publié ? Aurait-il achevé cette ébauche pour quelque publication qui me soit restée inconnue ? Je ne sais à quelle conjecture m’arrêter.(Note de l’éd.)
[VII-263]
66. — RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL GÉNÉRAL DES LANDES, SESSION DE 1849, SUR LA QUESTION DES COMMUNAUX.↩
Messieurs,
Vous avez renvoyé à votre troisième Commission la question des communaux. Elle m’a chargé de vous faire son rapport. Qu’il me soit permis de regretter que ce travail n’ait pu être achevé par celui de vos collègues [1] , qui, l’année dernière, l’avait si bien commencé.
Deux idées diamétralement opposées ont toujours dominé dans cette question.
Les uns, frappés du spectacle de stérilité qu’offrent partout ces terres flétries du nom de vagues et vaines, sachant, d’ailleurs, que ce qui est à tous est bien exploité par tous, mais n’est soigné par personne, ont hâte de voir le domaine commun passer dans le domaine privé et invoquent, pour la réalisation de leur système, le secours de la loi.
D’autres font observer que l’agriculture et, par conséquent, tous les moyens d’existence de ce pays reposent sur le communal. Ils demandent ce que deviendrait le domaine privé sans les ressources du domaine commun. À moins qu’on ne trouve un assolement qui permette de se passer d’engrais (révolution agricole qui n’est pas près de s’accomplir) ils considèrent l’aliénation comme une calamité publique et, pour la prévenir, ils invoquent, eux aussi, le secours de la loi.
Il a semblé à votre Commission que ni l’une ni l’autre de ces conclusions ne tenaient assez compte d’un fait qui domine toute la matière, et simplifie beaucoup la tâche du [VII-264] législateur. Le fait, c’est la propriété devant laquelle le législateur lui-même doit s’incliner.
En effet, demander si la loi doit forcer, ou si elle doit empêcher les aliénations, n’est-ce pas commencer par donner aux communes le droit de propriété ?
Nous avons été frappés du peu de cas qu’on fait de ce droit, soit dans les questions posées par les Ministres, soit dans les réponses émanées du Conseil, antérieurement à la révolution de février.
Voici comment la circulaire ministérielle établissait le problème en 1846 :
« Quel est le meilleur emploi à faire des communaux ? Faut-il les laisser tels qu’ils sont aujourd’hui ? Ou les louer à court ou long bail ? Ou les partager, ou les vendre ? »
Est-ce là une question qu’on puisse faire quand il s’agit d’une propriété, à moins qu’on ne la nie ?
Et quelle a été la réponse du Conseil ?
Après avoir parlé en termes justificatifs, presque laudatifs des anciens moyens d’appropriation, tels que la perprise et l’usurpation, moyens qui n’existent plus aujourd’hui, il concluait à la nécessité d’aliéner, et ajoutait :
« Le consentement des Conseils municipaux qui, néanmoins, seront toujours consultés, ne serait pas absolument indispensable pour l’aliénation des communaux à l’état de landes ou vacants… »
Et plus loin :
« Le Conseil municipal serait consulté sur la nécessité d’aliéner, et, quel que fût son avis, la proposition communiquée au Conseil d’arrondissement, soumise au Conseil général, et par celui-ci approuvée, motiverait l’ordonnance qui autoriserait l’acte de vente ? »
Il faut avouer que ce dialogue entre le Ministre et le Conseil méconnaissait entièrement le droit de propriété. Or, il est dangereux de laisser croire que ce droit s’efface devant [VII-265] la volonté du législateur. Sans doute, on invoquait des raisons de bien public et de progrès ; mais n’invoquaient-ils pas aussi ces raisons, ceux qu’on a vus depuis faire si bon marché de la propriété privée ?
Et ici il était d’autant plus fâcheux que le droit de la commune fût perdu de vue, que c’est précisément dans ce droit que réside la solution des nombreuses difficultés qui se rattachent à la question des communaux.
Quelle est, en effet, la principale de ces difficultés ? C’est l’extrême différence que l’on observe entre les situations et les intérêts des localités diverses. On voudrait bien faire une loi générale ; mais quand on met la main à l’œuvre, on se heurte contre l’impossible et l’on commence à comprendre qu’il faudrait, pour satisfaire à toutes les nécessités, faire autant de lois qu’il y a de communes. Pourquoi ? Parce que chaque commune, selon ses antécédents, ses méthodes agricoles, ses besoins, ses usages, l’état de ses communications, la valeur vénale des terres, a, relativement à ses communaux, des intérêts différents.
La délibération du Conseil général de 1846 en convenait en ces termes :
« Le développement des considérations qui doivent décider à consulter, pour chaque département et chaque commune, la situation des intérêts particuliers, conduirait trop loin. On se contente d’énoncer, ici, que rien n’est possible si cette première loi n’est pas observée ; c’est surtout en cette matière que l’usage local doit tenir une grande place dans la loi, et que la loi elle-même, dans ses dispositions capitales, doit laisser une grande liberté et une grande autorité aux corps électifs chargés de représenter ou de protéger la commune. »
L’impossibilité de faire une loi générale ressort, à chaque page, du rapport que vous fit l’année dernière M. Lefranc.
[VII-266]
« Parmi les destinations que l’on peut donner à nos biens communaux, disait-il, il faut, dans chaque département, choisir celle qui permettra, ici le dessèchement et l’irrigation, là, les transports faciles et prompts ; dans les Landes, les semis et les plantations ; dans la Chalosse, le perfectionnement de l’agriculture, etc. »
En vérité, il me semble que cela veut dire : puisqu’il y a autant d’intérêts distincts que de communes, laissons chaque commune administrer son communal. En d’autres termes, ce qu’il y a à faire, ce n’est pas de violer la propriété communale, mais de la respecter.
Alors, celle qui n’a que les communaux indispensables à la dépaissance des troupeaux ou à la confection des engrais, les gardera.
Celle qui a plus de landes qu’il ne lui en faut, les vendra, les affermera, les mettra en valeur, suivant les circonstances et l’occasion.
N’est-il pas heureux que, dans cette occasion, comme dans bien d’autres, le respect du droit, en harmonie avec l’utilité publique, soit, en définitive, la meilleure solution.
Cette solution paraîtra bien simple ; trop simple peut-être. Nous sommes enclins, de nos jours, à vouloir faire des expériences sur les autres. Nous ne souffrons pas qu’ils décident pour eux-mêmes, et quand nous avons enfanté une théorie, nous cherchons à la faire prévaloir, pour aller plus vite, par mesure coercitive. Laisser les communes disposer de leurs communaux, cela paraîtra une folie aux partisans comme aux adversaires de l’amélioration. Les communes sont routinières, diront les premiers, elles ne voudront jamais vendre ; elles sont imprévoyantes, diront les autres, et ne sauront rien garder.
Ces deux craintes se détruisent l’une par l’autre. Rien d’ailleurs ne les justifie.
En premier lieu, le fait prouve que les communes ne font [VII-267] pas à l’aliénation une opposition absolue. Depuis dix ans, plus de quinze mille hectares ont passé dans le domaine privé, et l’on peut prévoir que le mouvement s’accélérera avec le perfectionnement de la viabilité, l’accroissement de la population et la hausse de la valeur vénale des terres.
Quant à la crainte de voir les communes s’empresser de se dépouiller, elle est plus chimérique encore. Toutes les fois que le zèle administratif s’est tourné vers les aliénations, n’a-t-il pas rencontré la résistance des communes ? N’est-ce pas cette résistance, dite routinière, qui provoque incessamment le législateur et toutes nos délibérations ? M. Lefranc ne vous rappelait-il pas, l’année dernière, que la Convention elle-même n’avait pu faire prévaloir dans ce pays un mode d’aliénation qui devait sembler bien séduisant aux communiers : le partage ! Je ne puis me refuser à citer ici les paroles de notre collègue :
« Pour qu’un législateur, aussi puissant dans son action, aussi radical dans sa volonté, que l’était le législateur de 1793, ait hésité à prescrire le partage d’une manière uniforme, et à violenter ce qu’il appelait les idées rétrogrades des provinces, il fallait qu’il eût le sentiment intime, invincible, d’un droit sacré, d’un intérêt puissant, d’une nécessité impérieuse, cachés sous la routine des traditions. Pour que des populations aussi violemment entraînées dans le courant révolutionnaire n’aient pas, d’une manière presque unanime, trouvé, dans leur sein, un tiers des voix amies de la nouveauté, désireuses d’une satisfaction immédiate et personnelle, oublieuses, à ce prix, de l’intérêt et du droit du communal, décidées à introduire, au milieu des résistances, le niveau d’une loi uniforme, il fallait que l’état de choses qu’on voulait détruire eût sa raison d’être ailleurs que dans la routine et dans l’ignorance. »
D’après ce qui précède, Messieurs, vous pressentez la [VII-268] conclusion : que la loi à intervenir se borne à reconnaître aux communes leur droit de propriété avec toutes ses conséquences.
Mais la propriété communale n’est pas placée sous la seule sauvegarde des Conseils municipaux. Ces Conseils se renouvellent fréquemment. Il peut se rencontrer dans l’un d’eux une majorité qui soit le produit d’une surprise momentanée, surtout sous l’empire d’une loi toute nouvelle, et qui est, pour ainsi dire, à l’état d’expérience. Il ne faut pas qu’une intrigue puisse entraîner pour la commune un dommage irrémédiable. Encore que les conseillers municipaux soient les administrateurs naturels des communaux, il a semblé à votre commission, qu’à l’égard des mesures importantes, comme serait l’aliénation par grandes masses, le Conseil général pouvait être armé d’un veto suspensif, sans que le droit de propriété fût compromis. Il aurait le droit d’ajourner l’exécution de la délibération du conseil municipal, jusqu’à ce qu’une élection eût mis les habitants de la commune à même de faire connaître leur opinion sur l’importance de la mesure.
Nous ne pouvons terminer ce rapport sans attirer votre attention sur l’opinion qui a été émise par M. le Préfet [2] , non que nous partagions en tout ses vues, mais parce qu’elles respirent les sentiments les plus généreux envers les classes pauvres, et témoignent de toute sa sollicitude pour le bien public.
M. le Préfet fonde de grandes espérances sur le communal, non comme moyen d’accroître la richesse du pays, car il convient que l’appropriation personnelle remplit mieux ce but, mais comme moyen de l’égaliser.
Il est difficile de comprendre, je l’avoue, comment il peut se faire que l’exploitation du commun, si elle donne [VII-269] moins de blé, moins de vin, moins de laine, moins de viande que l’appropriation personnelle, arrive néanmoins à ce résultat, de faire que tous, et même les pauvres, soient mieux pourvus de toutes choses.
Je ne veux pas discuter ici cette théorie, mais je dois faire remarquer ceci : la foi de M. le Préfet dans la puissance du communal est telle qu’il se prononce, non-seulement pour l’inaliénabilité absolue, mais encore pour la formation d’un communal là où il n’y en a plus. Quoi donc ! entrerons-nous maintenant dans la voie de faire passer le domaine privé dans le domaine commun, lorsque tant d’années ont été consacrées par l’Administration à faire passer le domaine commun dans le domaine privé ?
Rien n’est plus propre, ce me semble, à nous donner confiance en la solution que nous vous avons présentée : le respect de la propriété avec toutes ses conséquences. Il faut que la loi s’arrête là où elle rencontre le droit qu’elle est chargée de maintenir et non de détruire. Car enfin, si pendant une série d’années la loi force l’aliénation du communal, parce que cette idée prévaut : Que le communal est nuisible ; et si pendant une autre série d’années la loi force la reconstitution du communal, parce qu’on pense qu’il est utile ; que deviendront les pauvres habitants des campagnes ? Il faudra donc qu’ils soient poussés dans des directions opposées, par une force extérieure et selon la théorie du jour ?
Ceci vous avertit que la question est mal posée, quand on demande : Que faut-il faire du communal ? Ce n’est pas au législateur, mais au propriétaire, qu’il appartient d’en disposer.
Mais la commission s’associe pleinement aux vues de M. le Préfet, quand il parle de l’utilité qu’il y aurait, pour les communes, à mettre en valeur les terres vagues qui ne sont pas indispensables aux besoins de l’agriculture. Le [VII-270] conseil secondera, sans doute, ses efforts dans ce sens, et le pays le récompensera par sa reconnaissance.
Par ces motifs, la troisième commission me charge de vous soumettre le projet de délibération suivante :
Le Conseil général pense qu’une loi sur les communaux ne peut faire autre chose que de reconnaître ce genre de propriétés et de régler le mode de leur administration ;
Il estime que le Conseil municipal doit être naturellement chargé de cette administration, au nom des habitants de la commune ;
Il est d’avis que, dans le cas où le Conseil municipal aurait voté une aliénation, le Conseil général doit avoir le droit de suspendre, s’il le juge utile, l’effet de ce vote, jusqu’à ce qu’il soit confirmé par le Conseil municipal de l’élection suivante.
ÉBAUCHES.
[VII-271]
67. — SOPHISMES ÉLECTORAUX.↩
Je suis engagé.
Je ne nomme pas M. tel, parce qu’il ne m’a pas demandé mon suffrage.
Je vote pour M. tel, parce qu’il m’a rendu service.
Je vote pour M. tel, parce qu’il a rendu des services à la France.
Je vote pour M. tel, parce qu’il m’a promis un service.
Je vote pour M. tel, parce que je désire une place.
Je vote pour M. tel, parce que je crains pour ma place.
Je vote pour M. tel, parce qu’il est du Pays.
Je vote pour M. tel, parce qu’il n’est pas du Pays.
Je vote pour M. tel, parce qu’il parlera.
Je vote pour M. tel, parce que s’il n’est pas nommé, notre préfet ou notre sous-préfet seront destitués.
Chacun de ces sophismes a son caractère spécial, mais il y a aussi au fond de chacun d’eux quelque chose qui leur est commun et qu’il s’agit de démêler.
Tous reposent sur cette double donnée :
L’élection se fait dans l’intérêt du candidat.
L’électeur est propriétaire exclusif d’une chose, à savoir : son suffrage, dont il peut disposer à sa guise et en faveur de qui il l’entend.
La fausseté de cette doctrine et l’application qui en est faite journellement ressortiront de l’examen auquel nous allons nous livrer.
[VII-272]
I. — Je ne vote pas pour M. A., parce qu’il ne m’a pas réclamé mon suffrage.
Ce sophisme, comme tous les autres, repose sur un sentiment qui, en lui-même, n’est pas répréhensible, sur le sentiment de la dignité personnelle.
Il est rare en effet que les paradoxes par lesquels les hommes s’en imposent à eux-mêmes, pour s’encourager à une action mauvaise, soient complétement faux. C’est un tissu dans lequel on aperçoit toujours quelques fils de bon aloi. Il y a toujours en eux quelque chose de vrai, et c’est par ce côté qu’ils en imposent. S’ils étaient faux de tous points, ils ne feraient pas tant de dupes.
Celui que nous examinons revient à ceci :
« M. A. aspire à la députation. La députation est le chemin des honneurs et de la fortune. Il sait que mon suffrage peut concourir à sa nomination. C’est bien la moindre chose qu’il me le demande. S’il fait le fier, je ferai le fier à mon tour ; et quand je consens à disposer en faveur de quelqu’un d’une chose aussi précieuse que mon vote, j’entends qu’on m’en sache gré, qu’on ne dédaigne pas de venir chez moi, d’entrer en relation avec moi, de me serrer la main, etc., etc. »
Il est bien clair que l’Électeur qui raisonne ainsi tombe dans la double erreur que nous avons signalée.
1o Il croit que son vote est donné pour l’utilité du candidat.
2o Il pense, qu’en fait de services, il est le maître d’en rendre à qui il lui plaît.
En un mot, il fait abstraction des biens et des maux publics qui peuvent résulter de son choix.
Car s’il avait présent à l’esprit que le but de tout le [VII-273] mécanisme électoral est de faire arriver à la Chambre des Députés consciencieux et dévoués, il ferait probablement le raisonnement contraire et dirait :
« Je voterai pour M. A. par ce motif, entre autres, qu’il ne m’a pas demandé mon suffrage ! »
En effet, aux yeux de qui ne perd pas de vue l’objet de la députation, je ne crois pas qu’il puisse s’élever de plus forte présomption contre un candidat que son empressement à quêter des suffrages.
Car enfin, qui pousse cet homme à venir me tourmenter jusque chez moi, à s’efforcer de me prouver que je dois lui donner ma confiance ?
Lorsque je sais que tant de Députés, deux boules à la main, ont fait la loi aux ministres et se sont fait adjuger de bonnes places, ne dois-je pas craindre que ce candidat n’ait pas autre chose en vue, qui vient, quelquefois de l’autre extrémité du Royaume, implorer la confiance de gens qu’il ne connaît pas ?
On peut sans doute être trahi par le Député qu’on a spontanément choisi. Mais si nous, électeurs, allons chercher un homme dans sa retraite (et nous ne pouvons l’y aller chercher que parce que sa réputation d’intégrité est parfaitement établie), si nous l’arrachons à sa solitude pour l’investir d’un mandat qu’il ne demandait pas, ne mettrons-nous pas de notre côté toutes les chances possibles de déposer ce mandat en des mains pures et fidèles ?
Si cet homme eût voulu faire une affaire de la Députation, il l’aurait recherchée. Il ne l’a pas fait, donc il n’a point de funeste arrière-pensée.
D’ailleurs celui à qui la députation est spontanément déférée, comme le libre témoignage de la confiance générale et de l’estime universelle, celui-là doit se sentir tellement honoré, tellement reconnaissant envers sa propre renommée, qu’il se gardera de la ternir.
[VII-274]
Et, après tout, ne serait-il pas bien naturel que les choses se passassent ainsi ?
De quoi est-il question ? S’agit-il de rendre service à M. un tel, de le favoriser, de le mettre sur le chemin de la fortune ?
Non, il s’agit de nous donner un mandataire qui ait notre confiance. Ne serait-il pas bien simple que nous nous donnassions la peine de le chercher ?
Il s’agissait d’une importante tutelle. Un nombreux conseil de famille était réuni dans le prétoire. Un homme arrive hors d’haleine, couvert de sueur, après avoir crevé plusieurs chevaux. Nul ne le connaît personnellement. Tout ce que l’on en sait, c’est qu’il gère au loin les propriétés des mineurs et que bientôt il va avoir des comptes à rendre. Cet homme supplie qu’on le nomme tuteur. Il s’adresse aux parents paternels, et puis aux parents maternels. Il fait longuement son propre éloge ; il parle de sa probité, de sa fortune, de ses alliances ; il prie, il promet, il menace. On lit sur ses traits une anxiété profonde, un désir immodéré de réussir. Vainement lui objecte-t-on que la tutelle est très-chargée ; qu’elle prendra beaucoup sur le temps, sur la fortune, sur les affaires de celui à qui elle sera imposée. — Il lève toutes les difficultés. Son temps, il ne demande pas mieux que de le consacrer au service des pauvres orphelins ; — sa fortune, il est prêt à en faire le sacrifice, tant il se sent dans le cœur un désintéressement héroïque ; — ses affaires, il les verra péricliter d’un œil stoïque, pourvu que celles des mineurs prospèrent en ses mains. — Mais vous gérez leur fortune. — Raison de plus ; je me rendrai des comptes à moi-même, et qui est plus en mesure de les examiner que celui qui les a faits ?
Je le demande, le conseil de famille agirait-il d’une manière raisonnable en confiant à ce solliciteur empressé les fonctions qu’il demande ?
[VII-275]
N’agirait-il pas plus sagement d’en investir un parent connu par sa probité, son exactitude, surtout s’il se rencontrait que ce parent eût avec les mineurs des intérêts identiques, en sorte qu’il ne pût leur faire ni bien ni mal sans en recueillir sa part ?……
II. — Je vote pour M. A., parce qu’il m’a rendu un service.
« La reconnaissance, a-t-on dit, est la seule vertu dont on ne puisse pas abuser. » — C’est une erreur. Il y a un moyen fort usité d’en abuser, c’est d’acquitter, aux dépens d’autrui, la dette qu’elle nous impose.
Je ne disconviens pas qu’un électeur qui a reçu de fréquents témoignages de bienveillance de la part d’un candidat, dont il ne partage pas les opinions, se trouve dans une des positions les plus délicates et les plus pénibles, si ce candidat a l’impudeur de lui demander son suffrage. L’ingratitude est en elle-même une chose qui répugne ; aller jusqu’à en faire, pour ainsi dire, un étalage officiel, cela peut devenir un véritable supplice. — Vous aurez beau colorer cette défection par les motifs politiques les mieux déduits, il y a au fond de la conscience universelle un instinct qui vous condamnera. — C’est que les mœurs politiques n’ont pas fait ni pu faire les mêmes progrès que la morale privée. C’est que le public voit toujours dans votre suffrage une propriété dont vous pouvez disposer, et il vous blâmera de ne pas le laisser diriger par une vertu aussi populaire, aussi honorable que la reconnaissance.
Cependant examinons.
La question, telle qu’elle se pose en France, devant le corps électoral, est le plus souvent tellement complexe, qu’elle laisse, ce semble, une grande latitude à la conscience. Il y a deux candidats : l’un est pour le ministère, l’autre pour l’opposition. — Oui, mais si le ministère a fait [VII-276] bien des fautes, l’opposition a bien des torts aussi. D’ailleurs voyez les programmes des deux compétiteurs, l’un veut l’ordre et la liberté, — l’autre demande la liberté avec l’ordre. Il n’y a de différence qu’en ce que l’un met en seconde ligne ce que l’autre place au premier rang ; au fond, ils veulent la même chose. Il ne valait pas la peine, pour de telles nuances, de trahir les droits que des bienfaits reçus donnaient sur votre vote à l’un des candidats. Vous n’êtes donc pas excusable.
Mais supposons que la question posée devant les électeurs soit moins vague, et vous verrez s’affaiblir non seulement les droits, mais encore la popularité et même les prétentions de la reconnaissance.
En Angleterre, par exemple, une longue expérience du gouvernement représentatif a appris aux électeurs qu’il ne fallait pas poursuivre toutes les réformes à la fois, mais ne passer à la seconde que lorsqu’on aurait emporté la première, et ainsi de suite.
Il en résulte qu’il y a toujours devant le public une question principale, sur laquelle se concentrent tous les efforts de la Presse, des associations, et des électeurs.
Êtes-vous pour ou contre la réforme électorale ?
Êtes-vous pour ou contre l’émancipation catholique ?
Êtes-vous pour ou contre l’affranchissement des esclaves ?
En ce moment, la question est uniquement celle-ci :
Êtes-vous pour ou contre la liberté des échanges ?
Quand elle sera vidée, on posera sans doute cette autre :
Êtes-vous pour ou contre le système volontaire en matière de religion ?
Tant que dure l’agitation relative à une de ces questions, tout le monde y prend part, tout le monde cherche à s’éclairer, tout le monde s’engage dans un parti ou dans l’autre. Sans doute, les autres grandes réformes politiques, quoique mises dans l’ombre, ne sont pas entièrement [VII-277] négligées. Mais c’est un débat qui s’engage dans le sein de chaque parti, et non d’un parti à l’autre.
Ainsi aujourd’hui, quand les free-traders ont à opposer un candidat aux monopoleurs, ils ont des assemblées préparatoires, et là celui-là est proclamé candidat qui, indépendamment de la conformité de ses principes avec ceux des free-traders, en matière commerciale, convient mieux en outre à la majorité à raison de ses opinions sur l’Irlande, ou le Bill de Maynooth, etc., etc. — Mais au jour de la grande lutte on ne demande aux candidats que ceci :
Êtes-vous free-traders ? — Êtes-vous monopoleurs ?
Et, par conséquent, c’est sur cela seul que les électeurs ont à se prononcer.
Or il est aisé de comprendre qu’une question posée en des termes aussi simples, ne laisse s’insinuer au sein des partis aucun des sophismes que ce livre a pour objet de combattre, et notamment le sophisme de la reconnaissance.
J’aurai rendu dans la vie privée de grands services à un électeur. Mais je sais qu’il est pour la liberté commerciale, tandis que je me présente comme le candidat des partisans du régime protecteur. L’idée même ne me viendra pas d’exiger de lui, par reconnaissance, le sacrifice d’une cause à laquelle je sais qu’il a voué tous ses efforts, pour laquelle il a souscrit, en faveur de laquelle il s’est affilié à des associations puissantes. Que si je le faisais, la réponse serait claire et logique, et elle obtiendrait l’assentiment du public, non seulement dans son parti, mais encore dans le mien. Il me dirait : Je vous ai des obligations personnelles. Je suis prêt à m’acquitter personnellement. Je n’attendrai pas que vous me le demandiez et je saisirai toutes les occasions de vous prouver que je ne suis pas un ingrat. Il est pourtant un sacrifice que je ne puis vous faire, c’est celui de ma conscience. Vous savez que je suis engagé dans la cause de la liberté commerciale, [VII-278] que je crois conforme à l’intérêt public. Vous, au contraire, vous soutenez le principe opposé. Nous sommes ici réunis pour savoir lequel de ces deux principes a l’assentiment de la majorité. De mon vote, peut dépendre le triomphe ou la défaite du principe que je soutiens. En conscience, je ne puis pas lever la main pour vous.
Il est évident qu’à moins d’être un malhonnête homme le candidat ne pourrait pas insister pour prouver que l’électeur est lié par un bienfait reçu.
La même doctrine doit prévaloir parmi nous. Seulement les questions étant beaucoup plus compliquées, elles donnent ouverture à une contestation pénible entre le bienfaiteur et l’obligé. Le bienfaiteur dira : Mais pourquoi me refusez-vous votre suffrage ? est-ce parce que nous sommes séparés par quelques nuances d’opinions ? Mais pensez-vous exactement comme mon compétiteur ? Ne savez-vous pas que mes intentions sont pures ? Ne veux-je pas, ainsi que vous, l’ordre, la liberté, le bien public ? Vous craignez que je ne vote telle ou telle mesure que vous désapprouvez ; et qui sait si elle sera présentée aux Chambres dans cette session ? Vous voyez bien que vous n’avez pas de motifs suffisants pour oublier ce que j’ai fait pour vous. Vous ne cherchez qu’un prétexte pour vous dégager de toute reconnaissance.
Il me semble que la méthode anglaise, celle de ne poursuivre qu’une réforme à la fois, indépendamment de ses avantages propres, a encore l’avantage très-grand de classer invariablement les électeurs, de les mettre à l’abri des mauvaises influences, de ne laisser pas prise aux sophismes, en un mot de former de franches et fermes mœurs politiques. Aussi je voudrais qu’on l’adoptât en France. En ce cas il est quatre réformes qui se disputeraient la priorité.
1o La réforme électorale ;
2o La réforme parlementaire ;
3o La liberté d’enseignement ;
[VII-279]
4o La réforme commerciale.
Je ne sais à laquelle de ces questions mon pays donnerait le pas. — Si j’avais voix au chapitre à cet égard, je désignerais la réforme parlementaire, comme la plus importante, la plus urgente, celle à laquelle l’opinion est le mieux préparée, celle qui est la plus propre à favoriser le triomphe des trois autres.
C’est par ce motif que j’en dirai quelques mots à la fin de ce livre. . . . . .
III. — Je vote pour M. A., parce qu’il a rendu de grands services au pays.
À une certaine époque, on sollicitait la voix d’un électeur pour un général de mérite. — Qui donc, dans le pays, disait-on, a rendu plus de services à la patrie. Il a versé son sang sur de nombreux champs de bataille. Il doit tous ses grades à son courage et à ses talents militaires. — Il s’est fait lui-même et qui plus est il a élevé à des postes importants ses frères, ses neveux, ses cousins. — Notre arrondissement est-il menacé ? disait l’électeur, fait-on une levée en masse ? Est-il question de choisir un chef militaire ? Ma voix est acquise à l’honorable général, tout ce que vous m’en dites et ce que j’en sais lui donnent des titres irrécusables à ma confiance.
Non, dit le solliciteur, il s’agit de nommer un député, un législateur. — Quelles seront les fonctions ? — Faire des lois, réviser le code civil, le code de procédure, le code pénal, rétablir l’ordre dans les finances, surveiller, contenir, réprimer et au besoin accuser les ministres. — Et qu’ont de commun les grands coups d’épée qu’a distribués le général aux ennemis avec les fonctions législatives ? — Il ne s’agit pas de cela ; il est question de lui décerner, dans la députation, une récompense digne de ses services. — Mais si, par ignorance, il [VII-280] fait de mauvaises lois, s’il vote pour des plans financiers désastreux, qui devra en subir les conséquences ?
— Vous-même et le public.
— Et puis-je en conscience investir le général du droit de faire des lois s’il doit en faire de mauvaises ?
— Vous insultez un homme d’un grand talent et d’un noble caractère. Le supposez-vous ignorant ou mal intentionné ?
— Dieu m’en garde. Je suppose que s’étant occupé toute sa vie de l’école de peloton, il est fort savant en stratégie. Je ne doute pas qu’il ne passe admirablement une revue. Mais encore une fois qu’y a-t-il de commun entre ces connaissances et celles qui sont nécessaires à un représentant ou plutôt aux représentés ?
68. — LES ÉLECTIONS.↩
Dialogue entre un profond Publiciste et un Campagnard.
Le Publiciste.
Enfin vous allez jouir pour la première fois d’un des plus beaux résultats de la Révolution. Vous allez entrer en possession d’une portion de la souveraineté ; vous allez exercer un des plus beaux droits de l’homme.
Le Campagnard.
Je viens tout simplement donner ma procuration à celui que je croirai le plus capable de gérer cette portion de mes affaires qui sont communes à tous les Français.
[VII-281]
Le Publiciste.
Sans doute. Mais vous voyez la chose sous le point de vue le plus trivial. Peu importe. — Vous avez sans doute réfléchi à l’acte solennel que vous êtes venu accomplir.
Le Campagnard.
Il me paraît si simple que je n’ai pas cru devoir consacrer beaucoup de temps à le méditer.
Le Publiciste.
Y pensez-vous ? C’est une chose simple que de nommer un législateur ! Vous ne savez donc pas combien notre politique extérieure est compliquée, combien de fautes a commises notre ministère, combien de factions cherchent, en sens divers, à entraîner le pouvoir. Choisir parmi les candidats l’homme le plus propre à apprécier tant de combinaisons, à méditer tant de lois qui nous manquent, à distinguer entre tous les partis le plus patriote pour le faire triompher et abattre les autres, n’est pas une chose aussi simple que vous pouvez le croire.
Le Campagnard.
À la bonne heure. Mais je n’ai ni le temps ni la capacité nécessaires pour étudier tant de choses.
Le Publiciste.
En ce cas, rapportez-vous-en à ceux qui y ont réfléchi. Venez dîner avec moi, chez le général B., je vous dirai à qui il convient que vous donniez votre vote.
Le Campagnard.
Souffrez que je n’accepte ni vos offres ni vos conseils. [VII-282] J’ai ouï dire que le général B. se met sur les rangs ; je ne puis accepter son dîner, étant bien résolu à ne le point nommer.
Le Publiciste.
Vous me surprenez. Tenez, emportez cette notice biographique sur M. B. Vous verrez combien il a de titres à votre choix. Il est plébéien comme vous. Il ne doit sa fortune qu’à sa bravoure et à son épée. Il a rendu d’éclatants services à la France. C’est aux Français de le récompenser.
Le Campagnard.
Je ne m’y oppose pas. S’il a rendu des services réels à la France, que la France lui donne des croix ou même des pensions. Mais je ne vois pas que je doive lui donner mes pouvoirs pour des affaires auxquelles je le crois impropre.
Le Publiciste.
Le général impropre aux affaires, lui qui a commandé des corps d’armée, qui a gouverné des provinces, qui connaît à fond la politique de tous les cabinets, qui parle comme Démosthène !
Le Campagnard.
Raison de plus pour que je ne le nomme pas. Plus il aura de capacité, plus il sera redoutable pour moi, car je suis persuadé qu’il s’en servirait contre mes intérêts.
Le Publiciste.
Vos intérêts ne sont-ils pas ceux de votre patrie ?
Le Campagnard.
Sans doute. Mais ils ne sont pas ceux du général.
[VII-283]
Le Publiciste.
Expliquez-vous, je ne vous comprends nullement.
Le Campagnard.
Je ne vois aucun inconvénient à m’expliquer. Comme agriculteur, j’appartiens à la classe laborieuse et paisible, et je me propose de me faire représenter par un homme paisible et laborieux, et non par un homme que sa carrière et ses habitudes ont poussé vers le pouvoir et la guerre.
Le Publiciste.
Le général affirme qu’il défendra la cause de l’agriculture et de l’industrie.
Le Campagnard.
À la bonne heure, mais, quand je ne connais pas les gens, leur parole ne me suffit pas ; il me faut une garantie plus sûre.
Le Publiciste.
Laquelle ?
Le Campagnard.
Leur intérêt. Si je nomme un homme qui soit agriculteur et contribuable comme moi, j’ai la certitude qu’il défendra mes intérêts en défendant les siens.
Le Publiciste.
Le général est propriétaire comme vous. Pensez-vous qu’il sacrifie la propriété au pouvoir ?
Le Campagnard.
Un général est soldat avant tout. Ses intérêts comme [VII-284] payant ne peuvent être mis en balance avec ses intérêts comme payé.
Le Publiciste.
Et quand cela serait, son dévouement à la patrie n’est-il pas connu ? N’est-il pas enfant de la révolution ? Celui qui a versé son sang pour la France, la trahira-t-il pour un peu d’or ?
Le Campagnard.
J’admets que le général soit un parfait honnête homme. Mais je ne puis croire que l’homme qui n’a fait dans sa vie que commander et obéir, qui ne s’est élevé que par le pouvoir, qui ne s’est enrichi que par l’impôt, représente parfaitement celui qui paye l’impôt. Il me paraît absurde que, trouvant le pouvoir trop lourd, je nomme pour l’alléger un homme qui le partage ; que, trouvant les impôts trop onéreux, je confie le soin de les diminuer à un homme qui vit d’impôts. Le général peut avoir beaucoup de renoncement à lui-même, mais je n’en veux pas faire l’épreuve à mes risques, et, pour tout dire en un mot, vous sollicitez de moi une inconséquence que je ne suis pas disposé à commettre.
L’Électeur campagnard, un Curé.
Le Curé.
Eh bien, mon cher ami, vous m’avez procuré une vive satisfaction. On m’a assuré que vous aviez noblement refusé votre voix au candidat de la faction libérale ; en cela vous avez fait preuve de bon sens. Est-ce quand la monarchie est en péril, quand la religion éplorée tend vers vous ses mains suppliantes, que vous consentiriez à donner une force nouvelle aux ennemis de la Religion et du Roi ?
[VII-285]
Le Campagnard.
Pardonnez-moi, monsieur le Curé, si j’ai refusé ma voix à un général, ce n’est pas que je le croie ennemi de la Religion ni du Roi. C’est qu’au contraire, je suis convaincu que sa position ne lui permet pas de tenir entre les moyens des contribuables et les exigences du pouvoir une balance bien juste.
Le Curé.
N’importent vos motifs. Il est certain que vous avez raison de vous méfier de l’ambition de cet homme.
Le Campagnard.
Vous ne m’entendez pas, monsieur le Curé. Je ne porte aucun jugement sur le caractère du général. Je dis seulement qu’il me paraît imprudent de confier mes intérêts à un homme qui ne pourrait les défendre sans sacrifier les siens. C’est une chance qu’aucun homme raisonnable ne veut courir sans nécessité.
Le Curé.
Je vous répète que je ne scrute pas vos motifs. Vous venez de prouver votre dévouement au roi. Eh bien, achevez votre ouvrage. Vous éloignez un ennemi, c’est beaucoup ; mais ce n’est pas assez, donnez-lui un ami. Il vous l’a lui-même désigné ; nommez le digne président du collége.
Le Campagnard.
Je croirais commettre une absurdité plus grande encore. Le Roi a l’initiative et la sanction des lois, il nomme la Chambre des pairs. Les lois étant faites pour la nation, il a voulu qu’elle concourût à leur confection, et j’irais nommer ceux que le pouvoir désigne ? Mais le résultat serait une monarchie absolue avec des formes constitutionnelles.
[VII-286]
Le Curé.
Vous supposez donc que le Roi abuserait de ce pouvoir pour faire de mauvaises lois ?
Le Campagnard.
Écoutez, monsieur le Curé, disons les choses comme elles sont réellement. Le Roi ne connaît pas personnellement les quatre cent cinquante candidats qu’il désigne ; ce sont les ministres qui réellement les offrent à nos choix. Or l’intérêt du ministère est d’augmenter sa puissance et sa richesse. Mais il ne peut augmenter sa puissance qu’aux dépens de ma liberté, et sa richesse qu’aux dépens de ma bourse. Il faut donc, si je veux l’en empêcher, que je nomme un député contribuable comme moi, qui le surveille, et mette des bornes à ses empiétements.
Le Curé.
C’est-à-dire un député de l’opposition ?
Le Campagnard.
Sans doute. Entre celui qui vit d’impôts et celui qui les paye, l’opposition me paraît naturelle. Quand j’achète, je tâche de le faire à bon marché, mais quand je vends, je mets ma marchandise au plus haut prix. Entre l’acheteur et le vendeur un débat est infaillible. Si je voulais faire acheter une charrue en fabrique, donnerais-je procuration au fabricant pour en fixer le prix ?
Le Curé.
Voilà une politique bien triviale et bien intéressée. Il s’agit bien d’acheter et de vendre, de prix et de fabriques. Insensé ! il s’agit du Roi, de sa dynastie, de la paix des peuples, du maintien de notre sainte Religion.
[VII-287]
Le Campagnard.
Eh bien, selon moi encore, il s’agit de vente et de prix. Le pouvoir est composé d’hommes, le clergé est également composé d’hommes formant un corps. — Le pouvoir et le clergé sont deux corps composés d’hommes. Or, il est dans la nature de tous les corps de tendre à leur agrandissement. Les contribuables seraient absurdes s’ils ne formaient aussi un corps pour se défendre contre les agrandissements du pouvoir et du clergé.
Le Curé.
Malheureux ! et si ce dernier corps triomphe, vous détruiriez la Monarchie et la Religion. Où en sommes-nous, bon Dieu !
Le Campagnard.
Ne vous épouvantez pas, monsieur le Curé. Jamais le peuple ne détruira le pouvoir, car le pouvoir lui est nécessaire. Jamais, il ne renversera la Religion, car elle lui est indispensable. Seulement il contiendra celui-là et celle-ci dans les limites d’où ils ne peuvent sortir sans péril pour tout le monde.
De même que j’ai fait recouvrir ma maison d’un toit pour me mettre à l’abri du soleil et de la pluie, je veux payer des magistrats et des officiers de police, pour qu’ils me préservent des malfaiteurs. De même que je m’abonne volontairement à un médecin pour soigner mon corps, je m’abonnerai à un ministre de la Religion pour soigner mon âme. Mais de même aussi que je fais en sorte que mon toit se fasse aussi économiquement et aussi solidement que possible, de même que je débats avec mon médecin le prix de l’abonnement, je veux débattre avec le clergé et le pouvoir le prix de leurs services, puisque, grâce au ciel, j’en ai la faculté. Et comme je ne puis le faire moi-même, trouvez bon, monsieur le Curé, que j’en charge un homme qui ait les mêmes [VII-288] intérêts que moi, et non un homme qui appartienne directement ou indirectement au clergé ou au pouvoir.
L’Électeur campagnard, un Candidat constitutionnel.
Le Candidat.
Je ne crains pas d’arriver trop tard pour vous demander votre voix, Monsieur, bien convaincu que vous n’aurez pas cru devoir l’accorder à ceux qui m’ont précédé. J’ai deux concurrents dont je reconnais le talent, et dont j’honore le caractère personnel, mais qui, par leur position, me paraissent n’être point vos représentants naturels. Je suis contribuable comme vous, comme vous j’appartiens non à la classe qui exerce, mais à celle sur qui s’exerce le pouvoir. Je suis profondément convaincu que ce qui nuit actuellement à l’ordre, à la liberté et à la prospérité en France, ce sont les dimensions démesurées du gouvernement. Non-seulement mes opinions me font un devoir, mais encore mes intérêts me font un besoin de faire tous mes efforts pour mettre des bornes à cette effrayante étendue de l’action du pouvoir. Je pense donc que je me rends utile à la cause des contribuables en me mettant sur les rangs, et si vous partagez mes idées, j’espère que vous me donnerez votre voix.
Le Campagnard.
J’y suis bien résolu. Vos opinions sont les miennes, vos intérêts me garantissent que vous agirez selon vos opinions ; vous pouvez compter sur mon suffrage.
[VII-289]
69.↩
Me promenant, oisif, dans les rues d’une de nos grandes villes, je fis rencontre d’un mien ami qui me parut de mauvaise humeur. Qu’avez-vous, lui dis-je, que vous êtes plus pâle qu’un rentier, à l’aspect d’un arrêt qui retranche un quartier ? (Sous le Grand Roi on retranchait des quartiers de rentes.) Lors mon ami tirant de sa poche une liasse de paperasses : Je suis, me dit-il, moi millième, actionnaire dans l’entreprise d’un canal. Nous avons confié l’exécution de l’entreprise à un habile homme qui nous rend ses comptes tous les ans. Chaque année, il fait de nouveaux appels de fonds, il multiplie le nombre de ses agents, et l’œuvre n’avance pas. Je me rends à une assemblée où tous les actionnaires vont nommer une commission pour vérifier, contrôler, approuver ou rectifier les comptes de notre homme. Et sans doute, répliquai-je, vous allez composer cette commission des agents de votre entrepreneur et lui donner pour chef l’entrepreneur lui-même. Vous plaisantez, répondit-il, aucun homme sur la terre ne serait capable d’une telle ânerie. — Oh ! oh ! fis-je, ne décidez pas si vite ; en mon pays, elle se renouvelle plus de cent fois par an.
70. — RÉFORME PARLEMENTAIRE [1] .↩
La Révolution de Juillet a placé le sol de la patrie sous un drapeau où sont inscrits ces deux mots : Liberté, Ordre.
[VII-290]
Si l’on met de côté quelques systèmes complétement excentriques, apocalypses de nos illuminés modernes, ce qui fait le fond des désirs communs, de l’opinion générale, c’est l’aspiration vers la réalisation simultanée de ces deux biens : Liberté, Ordre. Ils comprennent en effet tout ce que les hommes ont à demander aux Gouvernements. — Les écoles excentriques dont je parlais tout à l’heure vont, il est vrai, beaucoup plus loin. Elles demandent aux Gouvernements la richesse pour tous, la moralité, l’instruction, le bien-être, le bonheur, que sais-je ? — Comme si le gouvernement était lui-même autre chose qu’un produit de la société, et comme si, loin de pouvoir lui donner la sagesse et l’instruction, il n’était pas lui-même plus ou moins sage et éclairé selon que la société a plus ou moins de vertus et de lumières.
Quoi qu’il en soit, le point sur lequel la généralité des hommes se rallie est celui-ci : admettre toute réforme qui étende la Liberté en même temps qu’elle consolide l’Ordre, — repousser toute innovation qui compromet l’un et l’autre de ces bienfaits.
Mais ce qui établit la plus grande séparation parmi les esprits, c’est la préférence ou plutôt la prééminence qu’ils accordent à la liberté ou à l’ordre. Je n’ai pas besoin de dire que je ne parle point ici des hommes qui se mettent derrière des doctrines pour satisfaire leur ambition. Ceux-là se font les apôtres de l’ordre ou de la liberté, selon qu’ils ont à gagner ou à perdre à une innovation quelconque. — Je n’ai en vue que les esprits calmes, impartiaux, qui font, après tout, l’opinion publique. — Je dis que ces esprits ont cela de commun que tous ils veulent la liberté et l’ordre ; mais ils diffèrent en ceci, que les uns se préoccupent davantage de la liberté, les autres prennent surtout souci de l’ordre.
De là dans les chambres le centre et les extrémités, de là [VII-291] les libéraux et les conservateurs, les progressistes et ce qu’on a nommé improprement les bornes.
Remarquons en passant qu’entre les hommes consciencieux qui fixent principalement leurs yeux sur un des mots de la devise de juillet, les accusations réciproques sont véritablement puériles. Parmis les amis de la liberté, il n’en est aucun qui admît un changement dans la loi, s’il lui était démontré que ce changement dût amener le désordre dans la société, surtout d’une manière permanente. D’une autre part, au sein du parti de l’ordre, il n’est pas un homme tellement borne qu’il n’accueillît une réforme favorable au développement de la liberté, s’il était complétement rassuré sur le maintien de l’ordre, et à plus forte raison s’il pensait qu’elle aurait encore pour effet de rendre le pouvoir plus fort, plus stable, plus capable de remplir sa mission et de garantir la sécurité des personnes et des propriétés.
Si donc, parmi les Réformes, dont l’esprit public se préoccupe depuis quelques années, il en était une qui dût satisfaire à la fois à cette double condition, dont le résultat évident fut, d’une part, de faire rentrer le pouvoir dans ses attributions réelles, en arrachant de ses mains tout ce qui s’y trouve par suite d’empiétements sur les libertés publiques, et, d’autre part, de rendre à ce pouvoir ainsi borné dans son œuvre, une stabilité, une permanence, une liberté d’action, une popularité, qu’il ne connaît pas aujourd’hui, cette réforme, j’ose le dire, pourrait bien être repoussée par ceux qui profitent de l’abus qu’il s’agit de ruiner, mais elle devrait être accueillie par les hommes consciencieux sur tous les bancs de la Chambre, et, dans le public, par toutes les opinions que ces hommes représentent.
Telle est, ce me semble, la réforme parlementaire.
Pour savoir ce que la liberté et l’ordre auraient à gagner ou à risquer de cette réforme, il faut rechercher comment ils sont affectés par l’état de choses actuel.
[VII-292]
Sous l’empire de la loi électorale qui nous régit, environ cent cinquante à deux cents fonctionnaires publics ont pénétré dans l’enceinte législative, et ce nombre peut s’augmenter encore. Nous rechercherons quelle influence il doit en résulter sur la liberté.
En outre, toujours sous l’empire de cette loi, les députés qui ne sont pas fonctionnaires et qui, à raison de leurs précédents ou de leurs engagements envers les électeurs, ne peuvent pas le devenir en s’alliant un Ministère, peuvent faire irruption dans la région du Pouvoir par une autre voie, par celle de l’opposition. — Nous rechercherons les résultats de cet état de choses par rapport à la stabilité du pouvoir, et à l’ordre social.
Nous examinerons les objections que l’on a faites contre le principe de l’incomptabilité.
Nous tâcherons enfin de proposer les bases d’une bonne loi, en tenant compte de celles de ces objections qui ont quelque chose de réel……
§ 1er. — De l’influence de l’admissibilité des députés aux fonctions publiques sur la liberté.
Aux yeux de la classe d’hommes qui se disent libéraux, qui sont bien loin de croire que tous les progrès de la société dans le sens de la liberté se font aux dépens de l’ordre public, qui sont au contraire convaincus que rien n’est plus propre à affermir la tranquillité, la sécurité, le respect de la propriété et des droits, que les lois qui sont conformes à la justice absolue, pour cette classe d’hommes, dis-je, la proposition que j’ai à démontrer ici semble si évidente qu’il paraît peu nécessaire d’insister beaucoup sur sa démonstration.
Quel est en effet le principe du gouvernement représentatif ? C’est que les hommes qui composent un peuple ne sont [VII-293] la propriété ni d’un prince, ni d’une famille, ni d’une caste, c’est qu’ils s’appartiennent à eux-mêmes ; c’est que l’administration doit se faire non point dans l’intérêt de ceux qui administrent, mais dans l’intérêt de ceux qui sont administrés ; c’est que l’argent des contribuables doit être dépensé pour l’avantage des contribuables et non pour l’avantage des agents entre qui cet argent se distribue ; c’est que les lois doivent être faites par la masse qui y est soumise et non par ceux qui les décrètent ou les appliquent.
Il suit de là que cette immense portion de la nation qui est gouvernée a le droit de surveiller la petite portion à qui le gouvernement est confié ; qu’elle a le droit de décider en quel sens, dans quelles limites, à quel prix elle veut être administrée ; d’arrêter le Pouvoir quand il usurpe des attributions qui ne sont pas de sa compétence, et cela soit directement en rejetant les lois qui organisent ces attributions, soit indirectement en refusant tout salaire aux agents par qui ces attributions malfaisantes sont exercées.
La nation en masse ne pouvant exercer ces droits, elle le fait par représentants ; elle choisit dans son sein des députés auxquels elle confie cette mission de contrôle et de surveillance.
Ne tombe-t-il pas sous le sens que ce contrôle risque de devenir complétement inefficace, si les électeurs nomment pour leurs députés les hommes mêmes qui administrent, qui gèrent, qui gouvernent, c’est-à-dire si le pouvoir et le contrôle sont livrés aux mêmes mains ?
Nos charges de toute nature dépassent 1 500 millions, et nous sommes 34 millions ; nous payons donc en moyenne chacun 45, ou par famille de cinq personnes 225 fr. Cela est certes exhorbitant. Comment en sommes-nous venus là, en temps de paix, et sous un régime, où nous sommes censés tenir les cordons de la bourse. Eh mon Dieu ! la raison en est simple ; c’est que si nous, contribuables, sommes censés [VII-294] tenir les cordons de la bourse, nous ne les tenons pas réellement ; nous les avons un moment entre nos doigts pour les dénouer bien bénignement, et, cela fait, nous les remettons aux mains de ceux qui y puisent. Ce qu’il y a de plaisant, c’est que nous nous étonnons ensuite de la sentir s’alléger de jour en jour. Ne ressemblons-nous pas à cette cuisinière qui, en sortant, disait au chat : Gardez bien les ortolans, et, si le chien vient, montrez-lui les griffes.
Ce que je dis de l’argent on peut le dire de la liberté ! à vrai dire, et quoique cela paraisse un peu prosaïque, argent, liberté, cela ne fait qu’un. — Développement de cette pensée……
Je me suppose roi ; je suppose qu’amené par les événements à octroyer une constitution à mon peuple, je désire cependant retenir autant d’influence et de pouvoir que possible, comment m’y prendrais-je ?
Je commencerais par dire : « On n’accordera aux députés aucune indemnité. » Et pour faire passer cet article, je ne manquerais pas de faire du sentimentalisme, de vanter la beauté morale de l’abnégation, du dévouement, du sacrifice. — Mais en réalité, je comprendrais parfaitement que les électeurs ne pourraient envoyer à la chambre que deux classes d’hommes : ceux qui possèdent une grande existence, comme dit M. Guizot, et ceux-là sont toujours disposés à se rallier à cour ; — et puis une foule de prétendants à la fortune, incapables de résister aux entraînements de la vie parisienne, aux éblouissements de la richesse, placés entre leur ruine infaillible et celle de leur famille et un essor assuré vers les hautes régions de la fortune et de la prépondérance. Je saurais bien que quelques natures privilégiées sortiraient triomphantes de l’épreuve, mais enfin, une telle disposition me permettrait d’espérer au moins une grande influence sur la formation des majorités.
Mais comment séduire ces députés ? Faudra-t-il leur offrir [VII-295] de l’argent ? Mais d’abord, il faut le reconnaître à l’honneur de notre pays, la corruption sous cette forme est impraticable au moins sur une échelle un peu vaste ; d’ailleurs, ma liste civile n’y suffirait pas ; il est bien plus habile et plus divertissant de faire payer la corruption par ceux-là mêmes qui en souffrent, et de prendre dans la poche du public de quoi solder l’apostasie de ses défenseurs. Il suffira donc qu’une constitution porte ces deux dispositions :
Le roi nomme à toutes les places ;
Les députés peuvent arriver à toutes les places.
Il faudrait que je fusse bien malhabile ou la nature humaine bien perfectionnée si, avec ces deux bouts de charte, je n’étais pas maître du parlement.
Remarquez, en effet, combien le pas est glissant pour le député. Il ne s’agit pas ici d’une corruption abjecte, de votes formellement achetés et vendus. — Vous êtes habile, M. le député, vos discours déploient de grandes connaissances en diplomatie ; la France sera trop heureuse que vous la représentiez à Rome ou à Vienne. — Sire, je n’ai pas d’ambition ; j’aime par-dessus tout la retraite, le repos, l’indépendance. — Monsieur, on se doit à son pays. — Sire, vous m’imposez le plus rude des sacrifices. — Tout le public vous en sera reconnaissant.
Un autre est simple juge de paix de son endroit et s’en contente.
— Vraiment, monsieur, votre position n’est guère en harmonie avec le mandat législatif. Le procureur du roi qui vous fait la cour aujourd’hui peut vous gronder demain. — Sire, je tiens à ma modeste place ; elle faisait toute l’ambition du grand Napoléon. — Il faut pourtant la quitter : vous devez être conseiller de cour royale. — Sire, mes intérêts en souffriront ; puis les déplacements, les dépenses… — Il faut savoir faire des sacrifices, etc.
On a beau vouloir faire du sentimentalisme ; il faut [VII-296] n’avoir aucune connaissance du cœur humain, ne s’être jamais étudié sincèrement, n’avoir jamais suivi le conseil de l’oracle : Nosce te ipsum, et ignorer la subtilité des passions pour s’imaginer que les députés, qui sont appelés à faire une certaine figure dans le monde, sur qui l’on a les yeux ouverts, dont on exige une libéralité exceptionnelle, repousseront constamment les moyens de se donner de l’aisance, de la fortune, de l’influence, d’élever et de placer leurs fils, et cela par une voie qu’on a soin de leur présenter comme honorable, méritoire. Est-il besoin de reproduire ici la secrète argumentation qui, dans le fond du cœur, déterminera leur chute ?
On dit : il faut bien avoir confiance en ceux qui gouvernent. — L’objection est puérile. Si la défiance n’est pas admissible à quoi bon le gouvernement représentatif ? Des publicistes d’un grand talent, et entre autres M. de Lamartine, ont repoussé la réforme parlementaire et la loi des incompatibilités, sous le prétexte que la France est la patrie de l’honneur, de la générosité, du désintéressement ; qu’on ne peut pas supposer qu’un député, en tant que tel, élargisse le pouvoir dont il est investi en tant que fonctionnaire, ou en grossisse les émoluments ; que ce là serait une nouvelle loi des suspects, etc.
Eh mon Dieu ! y a-t-il dans nos sept codes une seule loi qui ne soit une loi de méfiance ? Qu’est-ce que la Charte, si ce n’est tout un système de barrières et d’obstacles aux empiétements possibles du roi, de la pairie, des ministres ? La loi de l’inamovibilité a-t-elle été faite pour la commodité des juges ou en vue des conséquences funestes que pourrait avoir leur position dépendante ?
Je ne puis souffrir, je l’avoue, qu’au lieu d’examiner scrupuleusement une mesure, on la répousse avec de grands mots, des phrases sonores, qui sont du reste en contradiction flagrante avec toute la série des actes qui constituent notre vie privée. Je voudrais bien savoir ce que M. de Lamartine dirait [VII-297] à son régisseur, si celui-ci iui tenait ce langage :
« Je vous apporte les comptes de ma gestion, mais la mauvaise foi ne se présume pas. En conséquence, j’espère que vous me laisserez le soin de les vérifier moi-même et de les faire vérifier par mon fils. »
Il faut véritablement fermer volontairement les yeux à la lumière, ne pas consentir à voir le cœur humain et les mobiles de nos actions, tels qu’ils sont, pour dire que l’honneur, la délicatesse, la vertu devant toujours se présumer, il est indifférent de remettre le contrôle du pouvoir au pouvoir lui-même. Il serait bien plus simple de supprimer le contrôle. Si vous êtes si confiants, poussez donc la confiance jusqu’au bout. Ce serait encore un bon calcul ; car, je le dis en toute sincérité, nous serons certainement moins trompés par des hommes qui auront la pleine responsabilité de leurs actes que s’ils peuvent nous dire :
« Vous aviez le droit de m’arrêter et vous m’avez laissé aller ; je ne suis pas le vrai coupable. »…
Maintenant, je le demande, une fois que la majorité sera acquise au pouvoir, non point par le concours libre, par l’assentiment raisonné des députés, mais parce que ceux-ci seront successivement enrôlés dans les rangs des gouvernants, pourra-t-on dire que nous sommes encore dans les conditions sincères du gouvernement représentatif ?
Voilà une loi. Elle froisse les intérêts et les idées de ceux qu’elle est destinée à régir. — Ils sont appelés à déclarer par l’organe de leurs représentants s’ils l’admettent ou la repoussent. — Évidemment, ils la rejetteront si ces représentants représentent en effet ceux que la loi est destinée à régir. — Mais s’ils représentent ceux qui la proposent, la soutiennent et sont appelés à l’exécuter, elle sera admise sans difficulté. Est-ce là le gouvernement représentatif ?…
References
[1] Cette esquisse, c’est ainsi que l’auteur la désigne en marge, restée à l’état de fragment, est postérieure à 1840. (Note de l’éditeur.)
[VII-298]
71. — LETTRE À M. ***, EN RÉPONSE À LA SIENNE DU 12 JANVIER [1] .↩
Monsieur,
J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, en date du 12 de ce mois, dans le but, selon vos expressions, de solliciter mon suffrage et celui de mes amis.
Je ne puis rien vous dire, monsieur, sur les intentions de mes amis ; je ne leur cache pas mon vote, mais je ne cherche pas à influencer le leur.
Quant au mien, il ne m’appartient pas au point de l’engager. L’intérêt public le détermine, et, jusqu’à l’instant où il tombe dans l’urne, je n’ai d’engagement qu’envers le public et ma conscience.
La notoriété publique attribue au général Durrieux, votre concurrent, des opinions favorables au ministère actuel, et, par conséquent défavorables, selon moi, aux intérêts de la France et spécialement de la France méridionale. Aucun acte de sa part n’est venu m’autoriser à regarder comme mal fondée l’opinion publique à cet égard ; bien, au contraire, sa position personnelle me le fait regarder comme un très mauvais représentant de nos intérêts, soit généraux, soit vinicoles. C’est vous dire que je ne lui donnerai pas mon suffrage.
[VII-299]
Mais, par la même raison, je ne puis la donner à un candidat qui, il y a à peine un an, appelait de tous ses vœux la candidature du général Durrieux, et encore moins si ce même homme affiche maintenant des opinions différentes ; car, ou il n’était pas sincère alors, ou il ne l’est pas aujourd’hui.
Vous me dites, monsieur, que les voix du Gouvernement vous échapperont. Vous les avez sans doute laissé échapper ; vous les sollicitiez l’année dernière avec tant d’instance, que vous ne répugniez pas à faire agir sur les fonctionnaires ces deux grands ressorts, la crainte des destitutions et l’espérance de l’avancement. J’ai sous les yeux une lettre dans laquelle vous sollicitiez le suffrage d’un fonctionnaire, sous les auspices de son chef (ce qui équivaut à une menace) et où vous lui parliez de votre influence à Paris (ce qui équivaut à une promesse). Aujourd’hui, c’est aux hommes indépendants que vos promesses s’adressent ; ou celles d’aujourd’hui, ou celles d’alors ne sont pas sincères.
Et puis, que nous promettez-vous ? Des faveurs. Les faveurs ne s’accordent pas au public, mais aux dépens du public, sans quoi ce ne serait pas des faveurs.
Ensuite, pour obliger des favoris, il faut au moins le désirer, et vous dites que vous ne désirerez rien des ministres.
Enfin, monsieur, depuis quelques jours que les électeurs se communiquent réciproquement les lettres dont vous les favorisez, on en voit d’adressées aux ministériels et aux patriotes, aux nobles et aux roturiers, aux carlistes, aux philippistes, etc. Dans toutes, vous sollicitez l’obligeance des électeurs, vous demandez des votes comme on demande des services ; il est permis d’en conclure, qu’en vous nommant, on rendrait service au candidat plutôt qu’au public.
References
[1] Cette lettre, préparée sur un cahier, il y a trente ans à peu près, fut-elle mise au net et envoyée au destinataire, dont je supprime le nom ? Je l’ignore. Mais je crois utile de la reproduire, ne fût-ce que pour montrer une fois de plus combien Bastiat prenait au sérieux le gouvernement représentatif, et aimait à conformer ses actes à ses théories. Je la fais suivre d’une lettre qui fut adressée quelques années plus tard à M. Dampierre. (Note de l’éditeur.)
[VII-300]
72.↩
3 Juillet 1846.
Monsieur Dampierre,
Comme vous, je regrette de ne m’être pas trouvé chez moi quand vous m’avez fait l’honneur de venir me voir, et je le regrette encore plus, depuis que j’ai reçu votre bienveillante lettre du 30 juin. Je ne m’arrêterai pas à vous remercier de tout ce qu’elle contient d’obligeant ; je crains bien qu’on ne vous ait fort exagéré les efforts que j’ai pu consacrer quelquefois à ce qui m’a paru le bien du pays. Je me bornerai à répondre à ce que vous me dites, touchant les prochaines élections, et je le ferai avec toute la franchise que je dois au ton de sincérité qui respire dans toute votre lettre.
Je suis décidé à émettre ma déclaration de principes ; dès que la chambre sera dissoute, et abandonner le reste aux électeurs que cela regarde. C’est vous dire que, ne sollicitant pas leurs suffrages pour moi-même, je ne puis les engager dans la combinaison dont vous m’entretenez. Quant à ma conduite personnelle, j’espère que vous en trouverez la raison dans la brochure que je vous envoie par ce courrier [1] . Permettez-moi d’ajouter ici quelques explications : Une alliance entre votre opinion et la mienne est une chose grave, que je ne puis admettre ou rejeter, sans vous exposer, un peu longuement peut-être, les motifs qui me déterminent.
Vous êtes légitimiste, monsieur, vous le dites [VII-301] franchement dans votre profession de foi, et, par conséquent, je suis plus loin de vous que des vrais conservateurs.
Ainsi, si nous avions aux prochaines élections un candidat conservateur, par opinion, mais indépendant par position, tels que MM. Basquiat, Poydenot, etc., etc., je ne pourrais pas songer un moment, en cas d’échec de mon parti, à me rallier au vôtre. La perspective de déterminer une crise ministérielle ne me déciderait pas ; et j’aimerais mieux voir triompher l’opinion, dont je ne diffère que par des nuances, que celle dont je suis séparé par les principes.
Je dois vous avouer, d’ailleurs, que ces coalitions des partis extrêmes me paraissent des duperies artificieusement arrangées par des ambitieux et à leur profit. Je me place exclusivement au point de vue du contribuable, de l’administré, du public, et je me demande ce qu’il peut gagner à des combinaisons qui n’ont pour but que de faire passer le pouvoir d’une main dans une autre. En admettant le succès d’une alliance entre les deux opinions, à quoi cela peut-il mener ? Évidemment, elles ne s’entendent un moment qu’en laissant sommeiller les points par lesquels elles diffèrent, et s’abandonnant au seul désir qui leur soit commun : Renverser le cabinet. — Mais après ? — Lorsque M. Thiers, ou tout autre, sera aux affaires, que fera-t-il avec une minorité de gauche, qui n’aura été majorité un instant que par l’appoint des légitimistes ; appoint qui lui sera désormais refusé ? Je vois d’ici une coalition nouvelle se former entre la droite et M. Guizot. Au bout de tout cela, j’aperçois bien confusion, crises ministérielles, embarras administratifs, ambitions satisfaites, mais je ne vois rien pour le public.
Ainsi, monsieur, je n’hésite pas à vous dire : je ne pourrais, dans aucun cas, aller à vous, si c’était réellement l’opinion conservatrice qui se présentât aux prochaines élections.
[VII-302]
Mais il n’en est pas ainsi, je vois dans un secrétaire des commandements, le représentant, non d’une opinion politique, mais d’une pensée individuelle, et de cette pensée même à laquelle le droit électoral doit servir de barrière. Une telle candidature nous jette hors du régime représentatif, elle en est plus que la déviation, elle en est la dérision ; et il semble qu’en la proposant, le pouvoir ait résolu d’expérimenter jusqu’où peut aller la simplicité du corps électoral [2] . Sans avoir d’objection personnelle contre M. Larnac, j’en ai une si grave contre sa position, que je ne le nommerai pas, quoi qu’il arrive ; et, de plus, si besoin est, je nommerai son adversaire, fût-ce un légitimiste. — Quelle que puisse être la pensée secrète des partisans de la branche ainée, je la redoute moins que les desseins du pouvoir actuel, manifestés par l’appui qu’il prête à une telle candidature. Je hais les révolutions ; mais elles prennent des formes diverses, et je considère, comme une révolution de la pire espèce, ce systématique envahissement de la représentation nationale par les agents du pouvoir, et, qui pis est, du pouvoir irresponsable. Si donc je me trouve dans la cruelle alternative d’opter entre un secrétaire des commandements et un légitimiste, mon parti est pris, je nommerai le légitimiste. Si l’arrière-pensée qu’on prête à ce parti, a quelque réalité, je la déplore ; mais je ne la redoute pas, convaincu que le principe de la souveraineté nationale a assez de vie, en France, pour triompher encore une fois de ses adversaires. Mais, avec une Chambre peuplée de créatures du pouvoir, le pays, sa fortune et sa liberté, sont sans défense ; et c’est là qu’est le germe d’une révolution [VII-303] plus dangereuse que celle que votre parti peut méditer.
En résumé, monsieur, comme candidat, je me bornerai à publier une profession de foi, et à assister aux réunions publiques, si j’y suis appelé ; comme électeur, je voterai d’abord pour un homme de la gauche, à défaut, pour un conservateur indépendant, et, à défaut encore, pour un légitimiste franc et loyal, tel que vous, plutôt que pour un secrétaire des commandements de M. le duc de Nemours.
Veuillez, etc…
References
[1] Aux électeurs de l’arrondissement de Saint-Sever. T. Ier, p. 461.(Note de l’éditeur.)
[2] Il est facile d’inférer de ce passage et de plusieurs autres, que Bastiat eut porté deux jugements sur ce qu’on nomme aujourd’hui les candidatures officielles. 1o Il y aurait vu une dérision du régime représentatif ; 2o cette dérision lui eut semblé plus triste que nouvelle. (Note de l’éditeur.)
73. — PROJET DE PRÉFACE POUR LES HARMONIES [1] .↩
Mon cher Frédéric,
C’en est donc fait : tu as quitté notre village. Tu as abandonné les champs que tu aimais, ce toit paternel où tu jouissais d’une si complète indépendance, tes vieux livres tout étonnés de dormir négligemment sur leurs poudreux rayons, ce jardin où dans nos longues promenades nous causions à perte de vue de omni re scibili et quibusdam aliis, ce coin de terre dernier asile de tant d’êtres que nous chérissions, où nous allions chercher des larmes si douces et de si chères espérances. Te souvient-il comme la racine de la foi reverdissait dans nos âmes à l’aspect de ces tombes chéries ? Avec quelle abondances les idées affluaient dans notre esprit sous l’inspiration de ces cyprès ? À peine pouvions-nous leur donner passage tant elles se pressaient sur nos lèvres. Mais rien n’a pu te retenir. Ni ces bons justiciables de la campagne accoutumés à chercher des décisions dans tes honnêtes instincts plus que dans la loi ; ni notre cercle si fertile en [VII-304] bons mots que deux langues n’y suffisaient pas, et où la douce familiarité, la longue intimité remplaçaient bien les belles manières ; ni ta basse qui semblait renouveler sans cesse la source de tes idées ; ni mon amitié ; ni cet empire absolu sur tes actions, tes heures, tes études, le plus précieux des biens peut-être. Tu as quitté le village et te voilà à Paris, dans ce tourbillon où comme dit Hugo :
Frédéric, nous sommes accoutumés à nous parler à cœur ouvert ; eh bien ! je dois te le dire, ta résolution m’étonne, je dis plus, je ne saurais l’approuver. Tu t’es laissé séduire par l’amour de la renommée, je ne veux pas dire de la gloire, et tu sais bien pourquoi. Combien de fois n’avons-nous pas dit que désormais la gloire ne serait plus le prix que d’intelligences d’une immense supériorité ! Il ne suffit plus d’écrire avec pureté, avec grâce, avec chaleur ; dix mille personnes en France écrivent ainsi. Il ne suffit pas d’avoir de l’esprit ; l’esprit court les rues. Ne te souvient-il pas qu’en lisant les moindres feuilletons, souvent si dépourvus de bon sens et de logique, mais presque toujours si étincelants de verve, si riches d’imagination, nous nous disions : bien écrire va devenir une faculté commune à l’espèce, comme bien marcher et bien s’asseoir. Comment songer à la gloire avec le spectacle que tu as sous les yeux ? Qui pense aujourd’hui à Benjamin Constant, à Manuel ? Que sont devenues ces renommées qui semblaient ne devoir jamais périr ?
À de si grands esprits te crois-tu comparable ?
As-tu fait leurs études ? Possèdes-tu leurs vastes facultés ? As-tu passé comme eux toute ta vie au milieu de la société la plus spirituelle ? As-tu les mêmes occasions de te faire connaître, la même tribune ; es-tu entouré au besoin de la même camaraderie ? Tu me diras peut-être que si tu ne parviens à briller par tes écrits tu te distingueras par tes [VII-305] actions. — Eh bien ! vois où en est la renommée de Lafayette. Feras-tu comme lui retentir ton nom dans les deux mondes et pendant trois quarts de siècle ? Traverseras-tu des temps aussi fertiles en événements ? Seras-tu la figure la plus saillante dans trois grandes révolutions ? Te sera-t-il donné de faire et défaire des rois ? Te verra-t-on martyr à Olmultz et demi-Dieu à l’Hôtel de ville ? Seras-tu commandant-général de toutes les Gardes nationales du royaume ? Et quand ces hautes destinées te seraient réservées, vois où elles aboutissent : à jeter au milieu des nations un nom sans tache, que dans leur indifférence elles ne daignent pas ramasser ; à les accabler de nobles exemples et de grands services qu’elles s’empressent d’oublier.
Mais non, je ne puis croire que l’orgueil t’ait monté à la tête à ce point de te faire sacrifier le bonheur réel à une renommée qui, tu le sais bien, n’est pas faite pour toi, et qui, en tout cas, ne serait que bien éphémère. Ce n’est pas toi qui aspireras jamais à devenir :
Dans les journaux du jour le grand homme du mois.
Tu démentirais tout ton passé. Si ce genre de vanité t’avait séduit, tu aurais commencé par rechercher la députation. Je t’ai vu plusieurs fois candidat, et toujours dédaignant ce qu’il faut faire pour réussir. Tu disais sans cesse : Voici le temps où l’on s’occupe un peu des affaires publiques, où on lit et parle de ce qu’on a lu. J’en profiterai pour distribuer sous le manteau de la candidature quelques vérités utiles, — et au delà tu ne faisais aucune démarche sérieuse.
Ce n’est donc pas l’éperon de l’amour-propre qui a dirigé ta course vers Paris. Mais alors à quelle inspiration as-tu cédé ? Est-ce au désir de contribuer en quelque chose au bien de l’humanité ? Sous ce rapport encore j’ai bien des observations à te faire.
Comme toi j’aime toutes les libertés et, parmi elles, la [VII-306] plus universellement utile à tous les hommes, celle dont on jouit à chaque instant du jour et dans toutes les circonstances de la vie, — la liberté du travail et de l’échange. Je sais que l’appropriation est le pivot de la société et même de la vie humaine. Je sais que l’échange est impliqué dans la propriété ; que restreindre l’un, c’est ébranler les fondements de l’autre. Je t’approuve de te dévouer à la défense de cette liberté, dont le triomphe doit amener le règne de la justice internationale et, par suite, l’extinction des haines, des préventions de peuple à peuple et des guerres qui en sont la suite.
Mais, en vérité, te présentes-tu dans la lice avec des armes qui conviennent et à la renommée, si tant est que tu y songes, et au succès même de ta cause ? De quoi es-tu occupé, exclusivement occupé ? D’une démonstration, d’un calcul, de la solution d’un problème unique, savoir : La restriction ajoute-t-elle à la colonne des profits ou à la colonne des pertes dans le livre de comptes d’une nation ? Voilà sur quel sujet tu épuises toute ton intelligence ! voilà les bornes où tu as circonscrit cette grande question ! Pamphlets, livres, brochures, articles de journaux, discours, tout est consacré à dégager cette inconnue : La nation, par le fait de la liberté, aura-t-elle cent mille francs de plus ou cent mille francs de moins ? Il semble que tu t’attaches à mettre sous le boisseau toute clarté qui ne jette sur ce théorème qu’un jour indirect. Il semble que tu t’appliques à refouler dans ton cœur toutes ces flammes sacrées que l’amour de l’humanité y avait allumées.
Ne crains-tu pas que ton esprit se sèche et se rétrécisse à cette œuvre analytique, à cette éternelle contention toujours concentrée sur un calcul algébrique ?
Rappelle-toi ce que nous avons dit bien souvent : à moins qu’on n’ait la prétention de faire faire un progrès à une branche isolée des connaissances humaines, ou plutôt, à [VII-307] moins qu’on n’ait reçu de la nature un crâne qui ne se distingue que par une protubérance dominatrice ; il vaut mieux, surtout quand on n’est comme nous qu’amateurs philosophes, laisser errer sa pensée dans tout le domaine de l’intelligence, que de l’asservir à la solution d’un problème. Il vaut mieux chercher le rapport des sciences entre elles et l’harmonie des lois sociales, que de s’épuiser à éclairer un point douteux, au risque de perdre jusqu’au sentiment de ce qu’il y a de grandeur et de majesté dans l’ensemble.
C’est pour cela que nos lectures étaient si capricieuses, et que nous mettions tant de soin à secouer le joug des jugements de convention. Tantôt nous lisions Platon, non pour admirer sur la foi des siècles, mais pour nous assurer de l’extrême infériorité de la société antique ; et nous disions : Puisque c’est là la hauteur où s’est élevé le plus beau génie de l’ancien monde, rassurons-nous, l’homme est perfectible et la foi dans ses destinées n’est pas trompeuse. Tantôt nous nous faisions suivre dans nos longues promenades de Bacon, de Lamartine, de Bossuet, de Fox, de Lamennais, et même de Fourrier. L’économie politique n’était qu’une pierre de l’édifice social que nous cherchions à construire dans notre esprit, et nous disions :
« Il est utile, il est heureux que des génies patients et infatigables se soient attachés comme Say à observer, classer, et exposer dans un ordre méthodique tous les faits qui composent cette belle science. Désormais, l’intelligence peut poser le pied sur cette base inébranlable pour s’élever à de nouveaux horizons. »
Aussi combien nous admirions les travaux de Dunoyer et de Comte qui, sans jamais dévier de la ligne rigoureusement scientifique tracée par M. Say, transportent avec tant de bonheur ces vérités acquises dans le domaine de la morale et de la législation. Je ne te le dissimulerai pas ; quelquefois, en t’écoutant, il me semblait que [VII-308] tu pouvais à ton tour prendre ce même flambeau, des mains de tes devanciers, et en projeter la lumière dans quelques recoins obscurs des sciences sociales, et dans ceux surtout que de folles doctrines ont récemment plongé dans l’obscurité.
Au lieu de cela, te voilà tout occupé d’éclaircir un seul des problèmes économiques que Smith et Say ont déjà démontré cent fois mieux que tu ne pourras le faire. Te voilà analysant, définissant, calculant, distinguant. Te voilà, le scalpel à la main, cherchant ce qu’il y a au juste au fond de ces mots prix, valeur, utilité, cherté, bon marché, importations, exportations.
Mais, enfin, si ce n’est pour toi, si tu ne crains pas de t’hébéter à l’œuvre, crois-tu avoir choisi, dans l’intérêt de la cause, le meilleur plan qu’il y ait à suivre ? Les peuples ne sont pas gouvernés par des X, mais par des instincts généreux, par des sentiments, par des sympathies. Il fallait leur présenter la chute successive de ces barrières qui parquent les hommes en communes ennemies, en provinces jalouses, en nations guerroyantes. Il fallait leur montrer la fusion des races, des intérêts, des langues, des idées, la vérité triomphant de l’erreur dans le choc des intelligences, les institutions progressives remplaçant le régime du despotisme absolu et des castes héréditaires, les guerres extirpées, les armées dissoutes, la puissance morale remplaçant la force physique, et le genre humain se préparant par l’unité aux destinées qui lui sont réservées. Voilà ce qui eût passionné les masses, et non point tes sèches démonstrations.
Et puis, pourquoi te limiter ? pourquoi emprisonner ta pensée ? Il me semble que tu l’as mise au régime cellulaire avec l’uniforme croûte de pain sec pour tout aliment, car te voilà rongeant soir et matin une question d’argent. J’aime autant que toi la liberté commerciale. Mais tous les progrès [VII-309] humains sont-ils renfermés dans cette liberté ? Autrefois, ton cœur battait pour l’affranchissement de la pensée et de la parole, encore enchaînées par les entraves universitaires et les lois contre l’association. Tu t’enflammais pour la réforme parlementaire et la séparation radicale de la souveraineté qui délègue et contrôle, de la puissance exécutive dans toutes ces branches. Toutes les libertés se tiennent. Toutes les idées forment un tout systématique et harmonieux ; il n’en est pas une dont la démonstration n’eût servi à démontrer les autres. Mais tu fais comme un mécanicien qui s’évertue à expliquer, sans en rien omettre, tout ce qu’il y a de minutieux détails dans une pièce isolée de la machine. On est tenté de lui crier : Montrez-moi les autres pièces ; faites-les mouvoir ensemble ; elles s’expliquent les unes par les autres…
References
[1] Ce projet, en forme de lettre adressée à l’auteur, fut ébauché par lui vers la fin de 1847.(Note de l’éditeur.)
74. — ANGLOMANIE, ANGLOPHOBIE [1] .↩
Ces deux sentiments sont en présence, et il n’est guères possible, chez nous, de juger l’Angleterre avec impartialité, sans être accusé par les anglomanes d’être anglophobe et par les anglophobes d’être anglomane. Il semble que l’opinion publique exagérant, en France, une ancienne loi de Sparte, nous frappe de mort morale si nous ne nous jetons pas dans une de ces deux extrémités.
Pourtant ces deux sentiments subsistent, ils ont déjà une date ancienne. Donc ils ont leur raison d’être ; car dans le [VII-310] monde des sympathies et des antipathies, comme dans le monde matériel, il n’est pas d’effet sans cause.
Il est facile de se rendre compte de la coexistence de ces deux sentiments. La grande lutte entre la démocratie et l’aristocratie, entre le droit commun et le privilége, se poursuit, sourde ou déclarée, avec plus ou moins d’ardeur, avec plus ou moins de chance, sur tous les points du globe. Mais nulle part, pas même en France, elle n’a autant de retentissement qu’en Angleterre.
Je dis pas même en France. Chez nous, en effet, le privilége, comme principe social, était éteint avant notre révolution. En tous cas, il reçut le coup de grâce dans la nuit du 4 août. Le partage égal de la propriété sape incessamment l’existence de toute classe oisive. L’oisiveté est un accident, le lot éphémère de quelques individus ; et quoi que l’on puisse penser de notre organisation politique, toujours est-il que la démocratie fait le fonds de notre ordre social. Sans doute le cœur humain ne change pas ; ceux qui arrivent à la puissance législative cherchent bien à se créer une petite féodalité administrative, électorale ou industrielle ; mais rien de tout cela n’a de racine. D’une session à l’autre, le souffle du moindre amendement peut renverser le fragile édifice, supprimer toute une curée de places, effacer la protection, ou charger les circonscriptions électorales.
Si nous jetons les yeux sur d’autres grandes nations, comme l’Autriche et la Russie, nous voyons une situation bien différente. Là, le Privilège, appuyé sur la force brutale, règne en maître absolu. C’est à peine si nous pouvons distinguer le sourd bruissement de la démocratie faisant son œuvre souterraine, comme un germe s’enfle et se développe loin de tout regard humain.
En Angleterre, au contraire, les deux puissances sont pleines de force et de vigueur. Je ne dirai rien de la monarchie, espèce d’idole à laquelle les deux armées sont [VII-311] convenues d’imposer une sorte de neutralité. Mais considérons un peu les éléments de force et la trempe des armes avec lesquelles l’aristocratie et la démocratie se livrent combat.
L’aristocratie a pour elle la puissance législative. Elle seule peut entrer à la Chambre des lords, et elle s’est emparée de la Chambre des communes, sans qu’on puisse dire quand et comment elle pourra en être délogée.
Elle a pour elle l’Église établie, dont tous les postes sont envahis par les cadets de famille, institution purement anglaise ou anglicane, comme son nom le dit, et purement politique, dont le monarque est le chef.
Elle a pour elle la propriété héréditaire du sol et les substitutions, garantie contre le morcellement des terres. Par là elle est assurée que sa puissance, concentrée en un petit nombre de mains, ne sera point disséminée et ne perdra pas ce qui la caractérise.
Par la puissance législative, elle a la disposition des taxes ; et ses efforts tendent naturellement à en rejeter le fardeau sur la démocratie, tout en s’en réservant le profit.
Aussi la voit-on commander l’armée et la marine, c’est-à-dire être encore maîtresse de la force brutale ; et la manière dont se recrutent ces corps garantit qu’ils ne passeront pas du côté de la cause populaire. On peut remarquer de plus qu’il y a dans la discipline militaire quelque chose à la fois d’énergique et de dégradant, qui aspire à effacer, dans l’âme de l’armée, toute participation aux sentiments communs de l’humanité.
Avec les trésors et les forces du pays, l’aristocratie anglaise a pu procéder successivement à la conquête de tous les points du globe qu’elles a jugés utiles à sa sécurité et à sa politique. Dans cette œuvre, elle a été merveilleusement secondée par le préjugé populaire, l’orgueil national et le sophisme économique, qui rattachent tant de folles espérances au système colonial.
[VII-312]
Enfin toute la diplomatie britannique est concentrée aux mains de l’aristocratie ; et comme il y a toujours un lien sympathique entre tous les priviléges et toutes les aristocraties de la terre, comme elles sont fondées sur le même principe, que ce qui menace l’une menace l’autre, il en résulte que tous les éléments de la vaste puissance que je viens de décrire sont en opposition perpétuelle avec le développement de la démocratie, non seulement en Angleterre, mais dans le monde entier.
Ainsi s’expliquent la guerre contre l’indépendance des États-Unis et la guerre plus acharnée encore contre la Révolution française ; guerre poursuivie non seulement avec le fer, mais encore et surtout avec l’or, soit qu’il servît à soudoyer des coalitions, soit qu’il fût répandu pour entraîner notre démocratie à l’exagération, au désordre, à la guerre civile.
Il n’est pas nécessaire d’entrer en plus de détails, d’indiquer l’intérêt qu’a pu avoir l’aristocratie anglaise à étouffer partout, en même temps que le principe démocratique, tout élément de force, de puissance et de richesse ; il n’est pas nécessaire d’exposer historiquement l’action qu’elle a exercée dans ce sens sur les peuples, — action qui a reçu la dénomination de système de bascule, — pour montrer que l’anglophobie n’est pas un sentiment tout à fait aveugle, et qu’il a, comme je le disais en commençant, sa raison d’être.
Quant à l’anglomanie, si on l’explique par un sentiment puéril, par l’espèce de fascination qu’exerce toujours sur les esprits légers le spectacle de la richesse, de la puissance, de l’énergie, de la persévérance et du succès, ce n’est pas de celle-là que je m’occupe. Je veux parler des causes sérieuses de sympathie que l’Angleterre peut, à bon droit, exciter dans d’autres pays.
Je viens d’énumérer les forces de l’oligarchie anglaise : propriété du sol, chambre des lords, chambre des [VII-313] communes, taxes, église, armée, marine, colonies, diplomatie.
Les forces de la démocratie n’ont rien d’aussi déterminé.
Celle-ci a pour elle la parole, la presse, l’association, le travail, l’économie, la richesse croissante, l’opinion, le bon droit et la vérité.
Il me semble que le progrès de la démocratie est sensible. Voyez quelles larges brèches elle a faites dans le camp opposé.
L’oligarchie anglaise, ai-je dit, avait la possession du sol. Elle l’a encore ; mais ce qu’elle n’a plus, c’est un privilége enté sur ce privilége, la loi céréale.
Elle avait la Chambre des communes. Elle l’a encore ; mais la démocratie est entrée au Parlement par la brèche du Reform-Bill, brèche qui s’élargira sans cesse.
Elle avait l’Église établie. Elle l’a encore ; mais dépouillée de son ascendant exclusif par la multiplication et la popularité des Églises dissidentes et le bill de l’émancipation catholique.
Elle avait les taxes. Elle en dispose encore ; mais, depuis 1815, tous les ministres, whigs ou torys, se sont vus forcés de marcher de réforme en réforme, et, à la première difficulté financière, l’incom-tax provisoire sera converti en impôt foncier permanent.
Elle avait l’armée. Elle l’a encore, mais chacun sait avec quel soin jaloux le peuple anglais veut qu’on lui épargne la vue des habits rouges.
Elle avait les colonies, c’était sa plus grande puissance morale ; car c’est par les promesses illusoires du régime colonial qu’elle s’attachait un peuple enorgueilli et égaré. — Et le peuple brise ce lien, en reconnaissant la chimère du système colonial.
Enfin, je dois mentionner ici une autre conquête populaire, et la plus grande sans doute. Par cela même que les armes du peuple sont l’opinion, le bon droit et la vérité, par [VII-314] cela encore qu’il possède dans toute sa plénitude le droit de défendre sa cause par la presse, la parole et l’association, le peuple ne pouvait manquer d’attirer, et il a en effet attiré sous son drapeau les hommes les plus intelligents et les plus honnêtes de l’aristocratie. Car il ne faut pas croire que l’aristocratie anglaise forme un ensemble compacte et déterminé. Nous la voyons, au contraire, se partager dans toutes les grandes circonstances ; et, soit frayeur, habileté, ou philanthropie, ce sont d’illustres privilégiés qui viennent sacrifier aux exigences démocratiques une partie de leurs propres priviléges.
Si l’on veut appeler anglomanes ceux qui prennent intérêt aux péripéties de cette grande lutte et aux progrès de la cause populaire sur le sol britannique, je le déclare, je suis anglomane.
Il me semble qu’il n’y a qu’une vérité, qu’il n’y a qu’une justice, que l’égalité prend partout la même forme, que la liberté a partout les mêmes résultats, et qu’un lien fraternel et sympathique doit unir les faibles et les opprimés de tous les pays.
Je ne puis pas ne pas voir qu’il y a deux Angleterre ; puisqu’il y a, en Angleterre, deux sentiments, deux principes, deux causes éternellement en lutte [2] .
Je ne puis pas oublier que si le principe aristocratique voulut, en 1776, courber sous son joug l’indépendance américaine, il trouva dans quelques démocrates anglais une résistance telle, qu’il lui fallut suspendre la liberté de la presse, l’habeas corpus, et fausser le jury.
Je ne puis pas oublier que si le principe aristocratique voulut, en 1791, étouffer notre glorieuse révolution, il lui fallut commencer par lancer chez lui sa soldatesque sur les [VII-315] hommes du peuple, qui s’opposaient à la perpétration de ce crime contre l’humanité.
J’appelle anglomane celui qui admire indistinctement les faits et gestes des deux partis. J’appelle anglophobe celui qui les enveloppe tous deux dans une réprobation aveugle et insensée.
Au risque d’attirer sur ce pauvre petit volume la lourde massue de l’impopularité, oui, je l’avoue, ce grand, cet éternel, ce gigantesque effort de la démocratie pour se dégager des liens de l’oppression et rentrer dans la plénitude de ses droits, offre à mes yeux, en Angleterre, des circonstances particulièrement intéressantes, qui ne se présentent pas dans les autres pays, au moins au même degré.
En France, l’aristocratie est tombée en 89, avant que la démocratie fut préparée à se gouverner elle-même. Celle-ci n’avait pu développer et perfectionner dans tous les sens ces qualités, ces puissances, ces vertus politiques, qui seules pouvaient conserver le pouvoir dans ses mains et lui en faire faire un prudent et utile usage. Il en est résulté que chaque parti, chaque homme même, a cru pouvoir hériter de l’aristocratie ; et la lutte s’est établie entre le peuple et M. Decaze, le peuple et M. de Villèle, le peuple et M. de Polignac, le peuple et M. Guizot. Dans cette lutte, aux proportions mesquines, nous faisons notre éducation constitutionnelle, et le jour où nous serons assez avancés, rien ne nous empêchera de prendre possession de la direction de nos affaires ; car la chute de notre grand antagoniste, l’aristocratie, a précédé notre éducation politique.
Le peuple anglais, au contraire, grandit, se perfectionne, et s’éclaire par la lutte elle-même. Des circonstances historiques, inutiles à rappeler ici, ont paralysé dans ses mains l’emploi de la force physique. Il a dû recourir à la puissance seule de l’opinion ; et la première condition pour que l’opinion fût une puissance, c’était que le peuple lui-même [VII-316] s’éclairât sur chaque question particulière jusqu’à l’unanimité. L’opinion n’aura pas à se faire après la lutte, elle s’est faite et se fait pendant, pour et par la lutte même. C’est toujours dans le parlement que se gagne la victoire, et l’aristocratie est forcée de la sanctionner. Nos philosophes et nos poëtes ont brillé avant notre révolution qu’ils ont préparée ; mais, en Angleterre, c’est pendant la lutte que la philosophie et la poésie font leur œuvre. Du sein du parti populaire surgissent de grands écrivains, de puissants orateurs, de nobles poëtes, qui nous sont entièrement inconnus. Nous nous imaginons ici que Milton, Shakespeare, Young, Thompson, Byron forment toute la littérature anglaise. Nous ne nous apercevons pas que, parce que la lutte se poursuit toujours, la chaîne des grands poëtes n’est pas interrompue ; et le feu sacré anime les Burn, les Campbell, les Moore, les Akenside et mille autres, qui travaillent sans cesse à renforcer la démocratie en l’éclairant.
Il résulte encore de cet état de choses que l’aristocratie et la démocratie se retrouvent en présence à propos de toutes les questions. Rien n’est plus propre à les animer, à les grandir. Ce qui ailleurs n’est qu’un débat administratif ou financier est là une guerre sociale. À peine une question a surgi qu’on s’aperçoit, de part et d’autre, que les deux grands principes sont engagés. Dès lors, de part et d’autre, on fait des efforts immenses, on se coalise, on pétitionne, on propage par d’abondantes souscriptions d’innombrables écrits, bien moins pour la question elle-même qu’à cause du principe toujours présent, toujours vivant qui y est engagé. Cela s’est vu non seulement à l’occasion des lois céréales, mais de toute loi qui touche aux taxes, à l’Église, à l’armée, à l’ordre politique, à l’éducation, aux affaires extérieures, etc.
Il est aisé de comprendre que le peuple anglais a dû s’habituer ainsi à remonter, à propos de toute mesure, jusqu’aux principes primordiaux, et à poser la discussion sur [VII-317] cette large base. Aussi, en général, les deux partis sont extrêmes et exclusifs. On veut tout ou rien, parce qu’on sent, des deux côtés, que concéder quelque chose, si peu que ce soit, c’est concéder le principe. Sans doute, dans le vote, il y a quelquefois transaction. On est bien forcé d’accommoder les réformes au temps et aux circonstances ; mais dans les débats on ne transige pas, et la règle invariable de la démocratie est celle-ci : Prendre tout ce qu’on lui accorde et continuer à demander le reste. — Et même elle a eu l’occasion d’apprendre que le plus sûr pour elle est d’exiger tout, pendant cinquante ans s’il le faut, plutôt que de se contenter d’un peu, au bout de quelques sessions.
Aussi les anglophobes les plus prononcés ne peuvent pas se dissimuler que les réformes, en Angleterre, portent un cachet de radicalisme, et par là de grandeur, qui étonne et subjugue l’esprit.
L’abolition de l’esclavage a été emportée tout d’une pièce. À un jour marqué, à une minute déterminée, les fers sont tombés des bras des pauvres noirs dans toutes les possessions de la Grande-Bretagne. On raconte que, dans la nuit du 31 juillet 1838, les esclaves s’étaient rassemblés dans les églises de la Jamaïque. Leur pensée, leur cœur, leur vie tout entière semblaient attachés à l’aiguille de l’horloge. Vainement le prêtre s’efforçait de fixer leur attention sur les plus imposants sujets qui puissent captiver l’intelligence humaine. Vainement il leur parlait de la bonté de Dieu et de leurs futures destinées. Il n’y avait qu’une seule âme dans l’auditoire, et cette âme était dans une fiévreuse attente. Lorsque le marteau fit retentir le premier coup de minuit, un cri de joie, comme jamais oreille humaine n’en avait entendu, ébranla les voûtes du temple. La parole et le geste manquaient à ces pauvres créatures pour donner passage à l’exubérance de leur bonheur. Ils se précipitaient en pleurant dans les bras les uns des autres, jusqu’à ce que, ce [VII-318] paroxysme calmé, on les vit se jeter à genoux, élever vers le ciel leurs bras reconnaissants, puis confondre dans leurs bénédictions et la nation qui les délivrait, et les grands hommes, les Clarkson, les Wilberforce qui avaient embrassé leur cause, et la Providence qui avait fait descendre dans le cœur d’un grand peuple un rayon de justice et d’humanité.
S’il a fallu cinquante ans pour réaliser d’une manière absolue la liberté personnelle, on est arrivé plus vite, mais seulement à une transaction, à une trêve, sur les libertés politique et religieuse. Le reform-bill et le bill de l’émancipation catholique, d’abord soutenus comme principes, ont été livrés à l’expédient. Aussi l’Angleterre a encore deux grandes agitations à traverser : la charte du peuple et le renversement de l’Église établie comme religion officielle.
La campagne contre le régime protecteur est une de celles qui ont été conduites par les chefs sous la sauvegarde et l’autorité du principe. Le principe de la liberté des transactions est vrai ou faux, il devait triompher ou succomber tout entier. Transiger, c’eût été avouer que la propriété et la liberté ne sont pas des droits, mais, selon le temps et le lieu, des circonstances accessoires, utiles ou funestes. Accepter le débat sur ce terrain, c’eût été se priver volontairement de tout ce qui fait l’autorité et la force ; c’eût été renoncer à mettre de son côté le sentiment de justice qui vit dans tous les cœurs. — Le principe de la liberté commerciale a triomphé ; il a été appliqué aux objets nécessaires à la vie, et il le sera promptement à tout ce qui peut faire l’objet des transactions internationales.
Ce culte de l’absolu a été transporté dans des questions d’un ordre inférieur. Quand il s’est agi de la réforme postale, on s’est demandé si les communications individuelles de la pensée, les épanchements de l’amitié, de l’amour maternel, de la piété filiale, étaient une matière imposable. L’opinion a répondu par la négative ; et dès lors on a poursuivi la [VII-319] réforme radicale, absolue, sans s’inquiéter de quelque embarras ou de quelque déficit au Trésor. On a réduit le port de la lettre au taux de la plus petite monnaie anglaise, parce que cela suffisait pour payer à l’État le service rendu et lui rembourser ses frais. Et comme la poste laisse encore un profit, il ne faut pas douter qu’on réduisit encore le port des lettres, s’il y avait en Angleterre une monnaie au-dessous du penny.
J’avoue qu’il y a dans cette audace et cette vigueur quelque chose de grand, qui me fait suivre avec intérêt les débats du parlement anglais et plus encore les débats populaires qui ont lieu dans les associations et les meetings. C’est là que l’avenir s’élabore, c’est là que de longues discussions dégagent au préalable cette inconnue : un principe est-il engagé dans la question ? — Et si la réponse est affirmative, on peut ignorer le jour du triomphe, mais on peut être sûr que le triomphe est assuré.
Avant de revenir au sujet de ce chapitre, l’anglomanie et l’anglophobie, je dois prémunir le lecteur contre une fausse interprétation qui pourrait se glisser dans son esprit. Bien que la lutte entre l’aristocratie et la démocratie, toujours présente et palpitante au fond de chaque question, donne certainement de la chaleur et de la vie aux débats ; bien qu’en retardant et éloignant la solution, elle contribue à mûrir les idées et former les mœurs politiques du peuple ; il ne faut pas conclure de là que je considère comme un désavantage absolu pour mon pays de n’avoir pas le même obstacle à vaincre, et conséquemment de ne pas sentir le même aiguillon, de n’avoir pas les mêmes éléments de vie et d’ardeur.
Les principes ne sont pas moins engagés chez nous qu’en Angleterre. Seulement les débats devraient être, chez nous, beaucoup plus généraux, beaucoup plus humanitaires (puisque le mot est consacré), comme, chez nos voisins, ils doivent être plus nationaux. L’obstacle aristocratique, pour [VII-320] eux, est chez eux. Pour nous, il est dans le monde entier. Rien, certes, ne nous empêcherait de prendre les principes à une hauteur que l’Angleterre ne peut encore atteindre. Nous ne le faisons pas, et cela dépend uniquement du degré insuffisant de respect, de dévouement pour les principes, auquel nous sommes parvenus.
Si l’anglophobie n’était chez nous qu’une naturelle réaction contre l’oligarchie anglaise, dont la politique est si dangereuse pour les nations et en particulier pour la France, ce ne serait plus de l’anglophobie, mais, qu’on me pardonne ce mot barbare (et qui n’en est que plus juste, puisqu’il réunit deux idées barbares), de l’oligarcophobie.
Malheureusement il n’en est pas ainsi ; et l’occupation la plus constante de nos grands journaux est d’irriter le sentiment national contre la démocratie britannique, contre ces classes laborieuses qui demandent au travail, à l’industrie, à la richesse, au développement de leurs facultés, les forces qui doivent les affranchir. C’est précisément l’accroissement de ces forces démocratiques, la perfection du travail, la supériorité industrielle, l’extension des machines, l’aptitude commerciale, l’accumulation des capitaux, c’est précisément, dis-je, l’accroissement de ces forces qu’on nous représente comme dangereux, comme opposé à nos propres progrès, comme impliquant de toute nécessité un décroissement proportionnel dans les forces analogues de notre pays.
C’est là le sophisme économique que j’ai à combattre, c’est par là que se rattache à l’esprit de ce livre le sujet que je viens de traiter, et qui a pu paraître jusqu’ici une oiseuse digression.
D’abord, si ce que j’appelle ici un sophisme était une vérité, combien elle serait triste et décourageante ! Si le mouvement progressif, qui se manifeste sur un point du globe, occasionnait un mouvement rétrograde sur un autre point, si l’accroissement des richesses d’un pays ne se faisait qu’au [VII-321] moyen d’une perte correspondante répartie sur tous les autres, il n’y aurait évidemment, dans l’ensemble, pas de progrès possible ; et, de plus, toutes les jalousies nationales seraient justifiées. Des idées vagues d’humanité, de fraternité, ne suffiraient certes pas pour déterminer une nation à se réjouir des progrès faits ailleurs, puisqu’ils se seraient faits à ses dépens. Les fraternitaires ne changeront jamais à ce point le cœur humain, et, dans l’hypothèse que j’envisage, cela n’est pas même désirable. Qu’y aurait-il d’honnête, de délicat à me réjouir de ce qu’un peuple s’élève vers le superflu, s’il en doit résulter qu’un autre peuple descende au-dessous du nécessaire ? Non, je ne suis tenu ni moralement ni religieusement à faire, fût-ce au nom de ma patrie, cet acte d’abnégation.
Ce n’est pas tout. Si cette espèce de bascule, était la loi des nations, elle serait aussi la loi des provinces, des communes, des familles. Le progrès national n’est pas d’une autre nature que le progrès individuel ; par où l’on voit que si l’axiome, dont je m’occupe, était une vérité au lieu d’être un sophisme, il n’y a pas un homme sur la terre qui ne dût perpétuellement s’efforcer d’étouffer le progrès de tous les autres, sauf à rencontrer chez tous le même effort contre lui-même. Ce conflit général serait l’état naturel de la société, et la Providence, en décrétant que le profit de l’un est le dommage de l’autre, aurait condamné l’homme à une guerre sans terme, et l’humanité à, un niveau primitif invariable.
Il n’y a donc pas dans les sciences sociales de proposition qu’il soit plus important d’éclaircir. C’est la clef de voûte de tout l’édifice. Il faut absolument connaître la nature propre du progrès, et l’influence que la condition progressive d’un peuple exerce sur la condition des autres peuples. S’il est démontré que le progrès, dans une circonscription donnée, a pour cause ou pour effet une dépression proportionnelle [VII-322] dans le reste de la race humaine, il ne nous reste plus qu’à brûler nos livres, renoncer à toute espérance du bien général, et entrer dans l’universel conflit, avec la ferme volonté d’être le moins possible écrasés en écrasant le plus possible les autres. Ce n’est pas là de l’exagération, c’est de la logique la plus rigoureuse, de la logique trop souvent appliquée. Une mesure politique qui se rattache si bien à l’axiome — le profit de l’un est le dommage de l’autre, — parce qu’elle en est comme l’incarnation, l’acte de navigation de la Grande-Bretagne fut placé ouvertement sous l’invocation de ces paroles célèbres de son préambule : Il faut que l’Angleterre écrase la Hollande ou qu’elle en soit écrasée. Et nous avons vu la Presse invoquer les mêmes paroles pour faire adopter en France la même mesure. Rien de plus simple, dès qu’il n’est pas d’autre alternative pour les peuples, comme pour les individus, que d’écraser ou d’être écrasés. — Par où l’on voit le point où l’erreur et l’atrocité viennent se confondre.
Mais la triste maxime que je mentionne mérite bien d’être combattue dans un chapitre spécial. Il ne s’agit point en effet de lui opposer de vagues déclamations sur l’humanité, la charité, la fraternité, l’abnégation. Il faut la détruire par une démonstration pour ainsi dire mathématique. En me réservant de consacrer quelques pages à cette tâche, je poursuis ce que j’ai à dire sur l’anglophobie.
J’ai dit que ce sentiment, en tant qu’il s’attache à cette politique machiavélique que l’oligarchie anglaise a fait peser si longtemps sur l’Europe, était un sentiment justifiable, qui avait sa raison d’être et ne devait même pas s’appeler anglophobie.
Il ne mérite ce nom que lorsqu’il enveloppe dans la même haine et l’aristocratie et cette portion de la société anglaise qui a souffert autant et plus que nous de la prépondérance oligarchique, et lui a fait résistance, cette classe laborieuse, [VII-323] faible et impuissante d’abord, mais qui a grandi en richesse, en force, en influence assez pour entraîner de son côté une partie de l’aristocratie et tenir l’autre en échec ; classe à laquelle nous devrions tendre la main, dont nous devrions partager les sentiments et les espérances, si nous n’étions retenus par cette funeste et décourageante pensée que les progrès qu’elle doit au travail, à l’industrie et au commerce menacent notre prospérité et notre indépendance ; les menacent sous une autre forme, mais autant que pouvait le faire la politique des Walpole, des Pitt, etc., etc.
C’est ainsi que l’anglophobie s’est généralisée, et j’avoue que je ne puis voir qu’avec dégoût les moyens qui ont été employés pour l’entretenir et l’irriter. Premier moyen bien simple et non moins odieux ; il consiste à tirer parti de la diversité des langues. On a profité de ce que la langue anglaise était peu connue en France pour nous persuader que toute la littérature et le journalisme anglais n’étaient qu’outrages, insultes et calomnies perpétuellement vomis contre la France ; d’où elle ne pouvait manquer de conclure qu’elle était, de l’autre côté du détroit, l’objet d’une haine générale et inextinguible.
En cela on était merveilleusement servi par la liberté illimitée de la presse et de la parole qui existe chez nos voisins. En Angleterre, comme en France, il n’y a pas de question sur laquelle les avis ne se partagent ; en sorte qu’il est toujours possible, dans chaque occasion, de dénicher un orateur ou un journal qui a pris la question du côté qui nous blesse. L’odieuse tactique de nos journaux a été d’aller extraire, de ces discours et ces écrits, les passages les plus propres à humilier notre orgueil national, et de les donner comme l’expression de l’opinion publique en Angleterre, en ayant bien soin de tenir dans l’ombre tout ce qui s’était dit ou écrit dans le sens opposé, même par les journaux les plus influents et les orateurs les plus populaires. Le résultat a [VII-324] été ce qu’il serait, en Espagne, si la presse de ce pays tout entière s’entendait pour puiser toute citation de nos journaux dans la Quotidienne.
Un autre moyen, qui a été employé avec beaucoup de succès, c’est le silence. Chaque fois qu’une grande question s’est agitée, en Angleterre, et qu’elle a été de nature à révéler ce qu’il y avait dans ce pays de vie, de lumière, de chaleur et de sincérité, on peut être sûr que nos journaux se sont attachés à empêcher, par le silence, que le fait ne vînt à la connaissance du public français ; et, s’il l’a fallu, ils se sont imposé dix ans de mutisme. Quelque extraordinaire que cela paraisse, l’agitation anglaise contre le régime protecteur en fait foi.
Enfin, une autre fraude patriotique dont on a usé amplement, ce sont les fausses traductions, les additions, suppressions et substitutions de mots. En altérant ainsi le sens et l’esprit des discours, il n’est pas d’indignation qu’on n’ait pu soulever dans l’âme de nos compatriotes. Il suffisait, par exemple, quand on trouvait gallant French qui veut dire braves français (gallant, c’est le mot vaillant qui a été transporté en Angleterre et qui n’a subi d’autre changement que celui du v initial en g, à l’inverse de ce qui s’est fait pour les mots : garant, warrant, guêpe, wasp, guerre, war), de traduire ainsi : nation efféminée, galante, corrompue. Quelquefois on allait jusqu’à substituer le mot haine au mot amitié, et ainsi de suite [3] .
[VII-325]
À ce propos, qu’il me soit permis de raconter l’origine du livre que je publiai, en 1845, sous le titre de Cobden et la Ligue.
J’habitais un village, au fond des Landes. Dans ce village, il y a un cercle, et j’étonnerais probablement beaucoup les membres du Jockey-club, si je transcrivais ici le budget de notre modeste association. Pourtant j’ose croire qu’il y règne une franche gaieté et une verve qui ne déshonorerait pas les somptueux salons du boulevard des Italiens. Quoi qu’il en soit, dans notre cercle on ne rit pas seulement, on politique aussi (ce qui est bien différent) ; car sachez qu’on y reçoit deux journaux. C’est dire que nous étions patriotes renforcés et anglophobes de premier numéro. — Pour moi, aussi versé dans la littérature anglaise qu’on peut l’être au village, je me doutais bien que nos gazettes exagéraient quelque peu la haine que, selon elles, le nom français inspirait à nos voisins, et il m’arrivait parfois d’exprimer des doutes à cet égard. Je ne puis comprendre, disais-je, pour quoi l’esprit qui règne dans le journalisme de la Grande-Bretagne ne règne pas dans ses livres. Mais j’étais toujours battu, pièces en main.
Un jour, le plus anglophobe de mes collègues, la fureur dans les yeux, me présente le journal et me dit : « Lisez et jugez. » Je lus en effet que le premier ministre d’Angleterre terminait ainsi un discours : « Nous n’adopterons pas cette mesure ; si nous l’adoptions, nous tomberions, comme la France, au dernier rang des nations. » — Le rouge du patriotisme me monta aussi au visage.
Cependant, à la réflexion, je me disais : il semble bien extraordinaire qu’un ministre, un chef de cabinet, un homme qui, par position, doit mettre tant de réserve et de mesure dans son langage, se permette envers nous une injure gratuite, que rien ne motive, ne provoque ni ne justifie. M. Peel ne pense pas que la France soit tombée au dernier rang [VII-326] des nations, et, le pensât-il, il ne le dirait pas en plein Parlement.
Je voulus en avoir le cœur net. J’écrivis le jour même à Paris pour qu’on m’abonnât à un journal anglais, en priant qu’on fît remonter l’abonnement à un mois.
Quelques jours après, je reçus une trentaine de numéros du Globe [4] . Je cherchai avec empressement la malencontreuse phrase de M. Peel, et je vis qu’elle disait : « Nous ne pourrions adopter cette mesure sans descendre au dernier rang des nations. » — Les mots comme la France n’y étaient pas.
Ceci me mit sur la voie, et je pus constater depuis lors bien d’autres pieuses fraudes dans la manière de traduire de nos journalistes.
Mais ce n’est pas là tout ce que m’apprit le Globe. Je pus y suivre, pendant deux ans, la marche et les progrès de la Ligue.
À cette époque, j’aimais ardemment, comme aujourd’hui, la cause de la liberté commerciale ; mais je la croyais perdue pour des siècles ; car on n’en parle pas plus chez nous qu’on n’en parlait probablement, en Chine, dans le siècle dernier. Quelles furent ma surprise et ma joie, quand j’appris que cette grande question agitait, d’un bout à l’autre, l’Angleterre et l’Écosse ; quand je vis cette succession non interrompue d’immenses meetings, et l’énergie, la persévérance, les lumières des chefs de cette admirable association !…
Mais ce qui me surprenait bien davantage, c’était de voir que la Ligue s’étendait, grandissait, versait sur l’Angleterre des flots de lumière, absorbait toutes les préoccupations des ministres et du Parlement, sans que nos journaux nous en dissent jamais un mot !…
[VII-327]
Naturellement je me doutai qu’il y avait quelque corrélation entre ce silence absolu sur un fait aussi grave, et le système des fraudes pieuses en matière de traduction.
Pensant naïvement qu’il suffisait que ce silence fût rompu une fois pour qu’on n’y pût persister plus longtemps, je me décidai, en tremblant, à me faire écrivain ; et j’envoyai, sur la Ligue, quelques articles à la Sentinelle de Bayonne. Mais les journaux de Paris n’y firent aucune attention. — Je me mis à traduire quelques discours de Cobden, de Bright et de Fox, et les envoyai aux journaux de Paris eux-mêmes ; ils ne les insérèrent pas. — Il n’est pas possible, me dis-je, que le jour où la liberté commerciale sera proclamée en Angleterre nous surprenne dans cette ignorance. Je n’ai qu’une ressource, c’est de faire un livre……
References
[1] Cette ébauche est de 1847. L’auteur voulait en faire un chapitre pour la seconde série des Sophismes économiques, qui parut à la fin de l’année.
[2] Voir l’article intitulé Deux Angleterre, t. III, p. 459. (Note de l’éditeur.)
[3] On pourrait plaider, en faveur des journaux, français, une circonstance atténuante. Il y eut, ce me semble, de leur part, ignorance spéciale, prévention, inadvertance plutôt que calcul, dans la plupart des méfaits que Bastiat leur reproche. Qu’on examine, par exemple, les lettres qu’il dut adresser, en septembre et en novembre 1846, à deux des coryphées du journalisme parisien, les rédacteurs en chef de la Presse et du National, et l’on se convaincra que ces deux feuilles, n’entrevoyaient ni la marche ni l’importance du débat sur les Corn-Laws, en Angleterre. — Voir pages 148 à 166. (Note de l’édit.)
[4] Globe and Traveller.
75. — LE PROFIT DE L’UN EST LE DOMMAGE DE L’AUTRE [1] .↩
Sophisme type, sophisme souche, d’où sortent des multitudes de sophismes, sophisme polype, qu’on ne peut couper en mille que pour donner naissance à mille sophismes, sophisme anti humain, anti-chrétien, anti-logique ; boîte de Pandore d’où sont sortis tous les maux de l’humanité, haines, défiances, jalousies, guerres, conquêtes, oppressions ; mais d’où ne pouvait sortir l’espérance.
Hercule ! qui étranglas Cacus, Thésée ! qui assommas le Minotaure, Apollon ! qui tuas le serpent Python, que chacun de vous me prête sa force, sa massue, ses flèches pour détruire [VII-328] le monstre qui, depuis six mille ans, arme les hommes les uns contre les autres.
Mais, hélas ! il n’est pas de massue qui puisse écraser un sophisme. Il n’est donné à la flèche ni même à la baïonnette de percer une proposition. Tous les canons de l’Europe réunis à Waterloo n’ont pu effacer du cœur des peuples un principe ; et ils n’effaceraient pas davantage une erreur. Cela n’est réservé qu’à la moins matérielle de toutes les armes, à ce symbole de légèreté, la plume.
Donc ce ne sont ni les dieux ni les demi-dieux de l’antiquité qu’il faut invoquer.
Si je voulais parler au cœur, je m’inspirerais du fondateur de la religion chrétienne. — Puisque c’est à l’esprit que je m’adresse et qu’il s’agit d’essayer une démonstration, je me place sous l’invocation d’Euclide et de Bezout, tout en appelant à mon aide les Turgot, les Say, les Tracy, les Ch. Comte. On dira « c’est bien froid ». Qu’importe, pourvu que la démonstration se fasse……
References
[1] Ébauche de 1847. L’auteur s’en est tenu à ce court préambule du chapitre qu’il promettait dans l’ébauche précédente. Il s’aperçut bien vite que, pour la réfutation projetée, un chapitre ne suffisait pas. C’était un livre qu’il fallait ; et il écrivit les Harmonies.(Note de l’édit.)
76. — INDIVIDUALISME ET FRATERNITÉ.↩
Une vue systématique de l’histoire et de la destinée de l’homme s’est récemment produite qui me semble aussi fausse que dangereuse.
Selon ce système, trois principes se partagent le monde : l’Autorité, l’Individualisme et la Fraternité.
L’autorité répond aux âges aristocratiques ; l’Individualisme au règne de la bourgeoisie ; la Fraternité au triomphe du peuple.
Le premier de ces principes s’est surtout incarné dans le Pape. Il mène à l’oppression par l’étouffement de la personnalité.
[VII-329]
Le second, inauguré par Luther, mène à l’oppression par l’anarchie.
Le troisième, annoncé par les penseurs de la Montagne, enfante la vraie liberté, en enveloppant les hommes dans les liens d’une harmonieuse association.
Le peuple n’ayant été le maître que dans un pays, la France, et dans une courte période, celle de 93, nous ne connaissons encore la valeur théorique et les charmes pratiques de la fraternité que par l’essai qui en fut fait tumultueusement à cette époque. Malheureusement l’union et l’amour, personnifiés dans Robespierre, ne purent étouffer qu’à demi l’Individualisme, qui reparut le lendemain du 9 thermidor. Il règne encore.
Qu’est-ce donc que l’Individualisme ? L’auteur de l’ouvrage auquel nous faisons allusion le définit ainsi :
« Le principe d’individualisme est celui qui, prenant l’homme en dehors de la société, le rend seul juge de ce qui l’entoure et de lui-même, lui donne un sentiment exalté de ses droits sans lui indiquer ses devoirs, l’abandonne à ses propres forces, et, pour tout gouvernement, proclame le laisser-faire [1] . »
Ce n’est pas tout. L’Individualisme, ce mobile de la bourgeoisie, devait envahir les trois grandes branches de l’activité humaine, la religion, la politique et l’industrie. De là trois grandes écoles individualistes : l’école philosophique, dont Voltaire fut le chef, en demandant la liberté de penser, nous a amenés à une profonde anarchie morale ; l’école politique, fondée par Montesquieu, au lieu de la liberté politique, nous a valu une oligarchie de censitaires ; et l’école économiste, représentée par Turgot, au lieu de la liberté de l’industrie, nous a légué la concurrence du riche et du pauvre, au profit du riche [2] .
[VII-330]
On voit que l’humanité a été bien mal inspirée jusqu’ici, et qu’elle s’est trompée dans toutes les directions. Ce n’a pourtant pas été faute d’avertissements, car le principe de la fraternité a toujours fait ses protestations et ses réserves par la voix de Jean Huss, de Morelli, de Mably, de Rousseau et par les efforts de Robespierre.
Mais qu’est-ce que la fraternité ?
« Le principe de la fraternité est celui qui, regardant comme solidaires les membres de la grande famille, tend à organiser un jour les sociétés, œuvre de l’homme, sur le modèle du corps humain, œuvre de Dieu, et fonde la puissance de gouverner sur la persuasion, sur le volontaire assentiment du cœur [3] . »
Tel est le système de M. Blanc. Ce qui le rend dangereux, à mes yeux, outre le talent avec lequel il est exposé, c’est que le vrai et le faux s’y mêlent en proportions qu’il est difficile d’apprécier. Je n’ai pas l’intention de l’examiner dans toutes ses branches symétriques. Pour me conformer aux exigences de ce recueil, je le considérerai principalement au point de vue de l’économie politique.
J’avoue que lorsqu’il s’agit d’énoncer le principe qui, à une époque donnée, anime le corps social, je voudrais qu’il fût exprimé par des mots moins vagues que ceux d’individualisme et fraternité.
L’individualisme est un mot nouveau simplement substitué au mot égoïsme. C’est l’exagération du sentiment de la personnalité.
[VII-331]
L’homme est un être essentiellement sympathique. Plus sa puissance de sympathie se concentre sur lui-même, plus il est égoïste. Plus elle se répand sur ses semblables, plus il est philanthrope.
L’égoïsme est donc comme tous les autres vices, comme toutes les autres déviations de nos qualités morales, c’est-à-dire aussi ancien que l’homme même. On en peut dire autant de la philanthropie. À toutes les époques, sous tous les régimes, dans toutes les classes, il y a eu des hommes durs, froids, personnels, rapportant tout à eux-mêmes, et d’autres bons, généreux, humains, dévoués. Il ne me semble pas qu’on puisse faire d’une de ces dispositions de l’âme, pas plus que de la colère ou de la douceur, de l’énergie ou de la faiblesse, le principe sur lequel repose la société.
Il est donc impossible d’admettre qu’à partir d’une date déterminée dans l’histoire, par exemple à partir de Luther, tous les efforts de l’humanité aient été, systématiquement et pour ainsi dire providentiellement, consacrés au triomphe de l’individualisme.
Sur quel fondement pourrait-on prétendre que l’exagération du sentiment de la personnalité est née dans les temps modernes ? Est ce que les peuples anciens, quand ils pillaient et ravageaient le monde, quand ils réduisaient les vaincus en esclavage, n’agissaient pas sous l’influence d’un égoïsme porté au plus haut degré ? Si, pour s’assurer la victoire, pour vaincre la résistance, pour échapper au sort affreux qu’elles réservaient à ceux qu’elles appelaient barbares, ces associations guerrières sentaient le besoin de l’union, si même l’individu était disposé à y faire de véritables sacrifices, l’égoïsme, pour être collectif, en était-il moins de l’égoïsme ?
J’en dirai autant de la domination par l’autorité théologique. Que, pour asservir les hommes, on emploie la force ou la ruse, qu’on exploite leur faiblesse ou leur crédulité, le fait même d’une domination injuste ne révèle-t-il pas dans [VII-332] le dominateur le sentiment de l’égoïsme ? Le prêtre égyptien, qui imposait de fausses croyances à ses semblables pour se rendre maître de leurs actions et même de leurs pensées, ne recherchait-il pas son avantage personnel par les moyens les plus immoraux ?
À mesure que les peuples sont devenus forts, ils ont repoussé la spoliation réalisée par la force. — Ils se sont avancés vers la propriété du travail et la liberté de l’industrie ; et voilà que vous découvrez dans la liberté de l’industrie une première manifestation de l’individualisme !
Mais vous qui ne voulez pas que le travail soit libre, vous voulez donc qu’il soit contraint, car il n’y a pas de terme moyen. Il y en a un, dites-vous, l’association. — C’est une confusion de mots, car si l’association est volontaire, le travail ne cesse pas d’être libre. Ce n’est pas aliéner sa liberté que de former avec ses semblables des conventions, des associations volontaires.
À mesure que les hommes se sont éclairés, ils ont réagi contre les superstitions, les fausses croyances, les opinions imposées. Et voilà que vous découvrez dans le libre examen une seconde manifestation de l’Individualisme !
Mais vous qui n’admettez ni l’autorité ni le libre examen, que mettez vous donc à la place ? La fraternité, dites-vous. La fraternité mettra-t-elle dans mon intelligence des idées qui ne soient ni reçues par elle toutes faites, ni élaborées par son propre exercice ?
Vous ne voulez pas que l’homme examine les opinions ! Je conçois cette intolérance dans les théologiens. Ils sont conséquents. Ils disent : cherchez la vérité en toutes choses, traditus est mundus disputotionibus eorum, quand Dieu ne l’a pas révélée. Là où il a dit : voilà la vérité, il serait absurde que vous voulussiez examiner.
Mais les modernes socialistes, de quel droit nous refusent-ils le libre examen dont ils usent si amplement ? Ils n’ont [VII-333] qu’un moyen de courber nos esprits ; c’est de se prétendre inspirés. Quelques-uns l’ont essayé, mais jusqu’ici ils n’ont pas montré leurs titres de prophètes.
Sans accuser les intentions, je dis qu’il y a au fond de ces doctrines le plus irrationnel de tous les despotismes, et, par conséquent, de tous les individualismes. Quoi de plus tyrannique que de vouloir régenter notre travail et notre intelligence, abstraction faite de toute autorité surnaturelle qu’on n’invoque même pas ? Il n’est pas surprenant qu’on aboutisse avoir le type, le héros, l’apôtre de la fraternité ainsi comprise dans Robespierre.
Si l’individualisme n’est pas le mobile exclusif d’une période prise dans l’histoire moderne, il n’est pas davantage le principe qui dirige une classe à l’exclusion de toutes les autres.
Dans les sciences morales, une certaine symétrie d’exposition se prend souvent pour la vérité. Méfions-nous de cette superficielle apparence.
C’est ainsi que s’est accréditée cette opinion que les nations modernes se composent de trois classes : aristocratie, bourgeoisie, peuple. De là on conclut qu’il y a le même antagonisme entre les deux dernières classes qu’entre les deux premières. La bourgeoisie, dit-on, a renversé l’aristocratie et s’est mise à sa place. À l’égard du peuple, elle constitue une autre aristocratie et sera à son tour renversée par lui.
Pour moi, je ne vois dans la société que deux classes. Des conquérants qui fondant sur un pays, s’emparent des terres, des richesses, de la puissance législative et judiciaire ; et un peuple vaincu, qui souffre, travaille, grandit, brise ses chaînes, reconquiert ses droits, se gouverne tant bien que mal, fort mal pendant longtemps, est dupe de beaucoup de charlatans, est souvent trahi par les siens, s’éclaire par l’expérience et arrive progressivement à l’égalité par la liberté, et à la fraternité par l’égalité.
[VII-334]
Chacune de ces deux classes obéit au sentiment indestructible de la personnalité. Mais si ce sentiment mérite le nom d’individualisme, c’est certainement dans la classe conquérante et dominatrice.
Il est vrai qu’au sein du peuple, il y a des hommes plus ou moins riches à des degrés infinis. Mais la différence de richesses ne suffit pas pour constituer deux classes. Tant qu’un homme du peuple ne se retourne pas contre le peuple lui-même pour l’exploiter, tant qu’il ne doit sa fortune qu’au travail, à l’ordre, à l’économie, quelques richesses qu’il acquière, quelque influence que lui donnent les richesses, il reste peuple ; et c’est un abus de mots que de prétendre qu’il entre dans une autre classe, dans une classe aristocratique.
S’il en était ainsi, voyez quelles seraient les conséquences. L’artisan honnête, laborieux, prévoyant, qui s’impose de dures privations, qui accroît sa clientèle par la confiance qu’il inspire, qui donne à son fils une éducation un peu plus complète que celle qu’il a reçue lui-même, cet artisan serai sur le chemin de la bourgeoisie. C’est un homme dont il faut se méfier, c’est un aristocrate en herbe, c’est un individualiste.
S’il est, au contraire, paresseux, dissipé, imprévoyant, s’il manque tout à fait de cette énergie si nécessaire pour accumuler quelques épargnes, alors on sera sûr qu’il restera peuple. Il appartiendra au principe de la fraternité.
Et maintenant, tous ces hommes retenus dans les rangs les plus infimes de la société par l’imprévoyance, le vice, et trop souvent, j’en conviens, par le malheur, comment entendront-ils le principe de l’égalité et de la fraternité ? Qui sera leur défenseur, leur idole, leur apôtre ? ai-je besoin de le nommer ?…
Abandonnant le terrain de la polémique, j’essayerai, autant que mes forces et le temps me le permettent, de [VII-335] considérer la personnalité et la fraternité au point de vue de l’économie politique.
Je commencerai par le déclarer très franchement : le sentiment de la personnalité, l’amour du moi, l’instinct de la conservation, le désir indestructible que l’homme porte en lui-même de se développer, d’accroître la sphère de son action, d’augmenter son influence, l’aspiration vers le bonheur, en un mot, l’individualité me semble être le point de départ, le mobile, le ressort universel auquel la Providence a confié le progrès de l’humanité. C’est bien vainement que ce principe soulèverait l’animadversion des socialistes modernes. Hélas ! qu’ils rentrent en eux-mêmes, qu’ils descendent au fond de leur conscience, et ils y retrouveront ce principe, comme on trouve la gravitation dans toutes les molécules de la matière. Ils peuvent reprocher à la Providence d’avoir fait l’homme tel qu’il est ; rechercher, par passe-temps, ce qu’il adviendrait de la société, si la Divinité, les admettant dans son conseil, modifiait sa créature sur un autre plan. Ce sont des rêveries qui peuvent amuser l’imagination ; mais ce n’est pas sur elles qu’on fondera les sciences sociales.
Il n’est aucun sentiment qui exerce dans l’homme une action aussi constante, aussi énergique que le sentiment de la personnalité.
Nous pouvons différer sur la manière de comprendre le bonheur, le chercher dans la richesse, dans la puissance, dans la gloire, dans la terreur que nous inspirons, dans la sympathie de nos semblables, dans les satisfactions de la vanité, dans la couronne des élus ; mais nous le cherchons toujours et nous ne pouvons pas ne pas le chercher.
De là il faut conclure que l’individualisme, qui est le sentiment de la personnalité pris dans un mauvais sens, est aussi ancien que ce sentiment lui-même, car il n’est pas une de ses qualités, surtout la plus inhérente à sa nature, dont [VII-336] l’homme ne puisse abuser, et n’ait abusé à toutes les époques. Prétendre que le sentiment de la personnalité a toujours été contenu dans de justes bornes, excepté depuis le temps de Luther et parmi les bourgeois, cela ne peut être considéré que comme un jeu d’esprit.
Je pense qu’on pourrait avec plus de raison soutenir la thèse contraire, en tous cas plus consolante, et voici mes raisons.
C’est une vérité triste, mais d’expérience, que les hommes en général donnent pleine carrière au sentiment de la personnalité, et par conséquent en abusent, jusqu’au point où ils le peuvent faire avec impunité. Je dis en général, parce que je suis loin de prétendre que les inspirations de la conscience, la bienveillance naturelle, les prescriptions religieuses n’aient pas suffi souvent pour empêcher la personnalité de dégénérer en égoïsme. Mais on peut affirmer que l’obstacle général au développement exagéré, à l’abus de la personnalité n’est pas en nous, mais hors de nous. Il est dans les autres personnalités dont nous sommes entourés et qui réagissent, quand nous les froissons, au point de nous tenir en échec, qu’on me pardonne cette expression.
Cela posé, plus une agglomération d’hommes s’est trouvée environnée d’êtres faibles ou crédules, moins elle a rencontré d’obstacles en eux, plus en elle le sentiment de la personnalité a dû acquérir d’énergie, et franchir les limites conciliables avec le bien général.
Aussi, nous voyons les peuples de l’antiquité désolés par la guerre, l’esclavage, la superstition et le despotisme, toutes manifestations de l’égoïsme chez les hommes plus forts ou plus éclairés que leurs semblables. Ce n’est jamais par son action sur lui-même, pour obéir aux lois de la morale, que le sentiment de la personnalité est rentré dans ses justes limites. Pour l’y réduire, il a fallu que la force et la lumière devinssent l’héritage commun des masses ; et alors il a bien fallu que, manifesté par la force, l’individualisme [VII-337] s’arrêtât devant une force supérieure, et que, manifesté par la ruse, il pérît faute d’être alimenté par la crédulité publique.
On trouvera peut-être que représenter les personnalités comme dans un état d’antagonisme toujours virtuellement existant, et qui ne peut être contenu que par l’équilibre des forces et des lumières, c’est une doctrine bien triste. Il s’ensuivrait que, dès que cet équilibre est rompu, dès qu’un peuple ou une classe se reconnaissent doués d’une force irrésistible, ou d’une supériorité intellectuelle propre à leur asservir les autres peuples ou les autres classes, le sentiment de la personnalité est toujours prêt à franchir ses limites et à dégénérer en égoïsme, en oppression.
Il ne s’agit pas de savoir si cette doctrine est triste, mais si elle est vraie, et si la constitution de l’homme n’est pas telle qu’il doive conquérir son indépendance, sa sécurité par le développement de ses forces et de son intelligence. La vie est un combat. Cela a été vrai jusqu’ici, et nous n’avons aucune raison de croire que cela cessera de l’être jamais, tant que l’homme portera dans son cœur ce sentiment de la personnalité, toujours si disposé à sortir de ses bornes.
Les écoles socialistes s’efforcent de remplir le monde d’espérances que nous ne pouvons nous empêcher de considérer comme chimériques, précisément parce qu’elles ne tiennent aucun compte, dans leurs vaines théories, de ce sentiment indélébile et de la pente irrésistible qui le pousse, s’il n’est contenu, vers sa propre exagération.
Nous avons beau chercher, dans leurs systèmes de séries, d’harmonies, l’obstacle à l’abus de la personnalité, nous ne le trouvons jamais. Les socialistes nous paraissent tourner sans cesse dans ce cercle vicieux : si tous les hommes voulaient être dévoués, nous avons trouvé des formes sociales qui maintiendront entre eux la fraternité et l’harmonie.
Aussi, quand ils arrivent à proposer quelque chose qui ressemble à de la pratique, on les voit toujours diviser [VII-338] l’humanité en deux parts. D’un côté l’État, le pouvoir dirigeant, qu’ils supposent infaillible, impeccable, dénué de tout sentiment de personnalité ; de l’autre le peuple, n’ayant plus besoin de prévoyance ni de garanties.
Pour réaliser leurs plans, ils sont réduits à confier la direction du monde à une puissance prise, pour ainsi dire, en dehors de l’humanité. Ils inventent un mot : l’État. Ils supposent que l’État est un être existant par lui-même, possédant des richesses inépuisables, indépendantes de celles de la société ; qu’au moyen de ces richesses, l’État peut fournir du travail à tous, assurer l’existence de tous. Ils ne prennent pas garde que l’État ne peut jamais que rendre à la société des biens qu’il a commencé par lui prendre ; qu’il ne peut même lui en rendre qu’une partie ; que de plus l’État est composé d’hommes, et que ces hommes portent aussi en eux-mêmes le sentiment de la personnalité, enclin chez eux, comme chez les gouvernés, à dégénérer en abus ; qu’une des plus grandes tentations pour que la personnalité d’un homme froisse celle de ses semblables, c’est que cet homme soit puissant, en mesure de vaincre les résistances. Les socialistes, à la vérité, espèrent sans doute, quoiqu’ils ne s’expliquent guère à ce sujet, que l’État sera soutenu par des institutions, par les lumières, la prévoyance, la surveillance assidue et sévère des masses. Mais, s’il en est ainsi, il faut que ces masses soient éclairées et prévoyantes ; et le système que j’examine tend précisément à détruire la prévoyance dans les masses, puisqu’il charge l’État de pourvoir à toutes les nécessités, de combattre tous les obstacles, de prévoir pour tout le monde.
Mais, dira-t-on, si le sentiment de la personnalité est indestructible, s’il a une pente funeste à dégénérer en abus, si la force qui le réprime n’est pas en nous, mais hors de nous, s’il n’est contenu dans de justes bornes que par la résistance et la réaction des autres personnalités, si les [VII-339] hommes qui exercent le pouvoir n’échappent pas plus à cette loi que les hommes sur qui le pouvoir s’exerce, alors la société ne peut se maintenir dans le bon ordre que par une vigilance incessante de tous ses membres à l’égard les uns des autres, et spécialement des gouvernés à l’égard des gouvernants, un antagonisme radical est irrémédiable ; nous n’avons d’autres garanties contre l’oppression qu’une sorte d’équilibre entre tous les individualismes repoussés les uns par les autres, et la fraternité, ce principe si consolant, dont le seul nom touche et attire les cœurs, qui pourrait réaliser les espérances de tous les hommes de bien, unir les hommes par les liens de la sympathie, ce principe proclamé, il y a dix-huit siècles, par une voix que l’humanité presque tout entière a tenue pour divine, serait à jamais banni du monde.
À Dieu ne plaise que telle soit notre pensée. Nous avons constaté que le sentiment de l’individualité était la loi générale de l’homme, et nous croyons ce fait hors de doute.
Il s’agit maintenant de savoir si l’intérêt bien entendu et permanent d’un homme, d’une classe, d’une nation est radicalement opposé à l’intérêt d’un autre homme, d’une autre classe, d’une autre nation. S’il en est ainsi, il faut le déclarer avec douleur, mais avec vérité : la fraternité n’est qu’un rêve ; car il ne faut pas s’attendre à ce que chacun se sacrifie aux autres ; et cela fût-il, on ne voit pas ce que l’humanité y gagnerait, puisque le sacrifice de chacun équivaudrait au sacrifice de l’humanité entière : ce serait le malheur universel.
Mais si, au contraire, en étudiant l’action que les hommes exercent les uns sur les autres, nous découvrons que leurs intérêts généraux concordent, que le progrès, la moralité, la richesse de tous sont la condition du progrès, de la moralité, de la richesse de chacun, alors nous comprendrons comment [VII-340] le sentiment de l’individualité se réconcilie avec celui de la fraternité.
À une condition cependant : c’est que cet accord ne consiste pas en une vaine déclamation ; c’est qu’il soit clairement, rigoureusement, scientifiquement démontré.
Alors, à mesure que cette démonstration sera mieux comprise, qu’elle pénétrera dans un plus grand nombre d’intelligences, c’est-à-dire à mesure du progrès des lumières et de la science morale, le principe de la fraternité s’étendra de plus en plus sur l’humanité.
Or c’est cette démonstration consolante que nous nous croyons en mesure de faire.
Et d’abord que faut-il entendre par le mot fraternité ?
Faut-il prendre ce mot, comme on dit, au pied de la lettre ? et implique t-il que nous devons aimer tous les hommes actuellement vivants sur la surface du globe comme nous aimons le frère qui a été conçu dans les mêmes entrailles, nouri du même lait, dont nous avons partagé le berceau, les jeux, les émotions, les souffrances et les joies ? Évidemment ce n’est pas dans ce sens qu’il faut comprendre ce mot. Il n’est pas un homme qui pût exister quelques minutes, si chaque douleur, chaque revers, chaque décès qui survient dans le monde devait exciter en lui la même émotion que s’il s’agissait de son frère ; et si MM. les socialistes sont exigeants à ce point (et ils le sont beaucoup… pour les autres), il faut leur dire que la nature a été moins exigeante. Nous aurions beau nous battre les flancs, tomber dans l’affectation, si commune de nos jours, en paroles, nous ne pourrions jamais, et fort heureusement, exalter notre sensibilité à ce degré. Si la nature s’y oppose, la morale nous le défend aussi. Nous avons tous des devoirs à remplir envers nous-mêmes, envers nos proches, nos amis, nos collègues, les personnes dont l’existence dépend de nous. Nous nous devons aussi à la profession, aux fonctions qui nous sont [VII-341] dévolues. Pour la plupart d’entre nous, ces devoirs absorbent toute notre activité ; et il est impossible que nous puissions avoir toujours à la pensée et pour but immédiat l’intérêt général de l’humanité. La question est de savoir si la force des choses, telle qu’elle résulte de l’organisation de l’homme et de sa perfectibilité, ne fait pas que l’intérêt de chacun se confond de plus en plus avec l’intérêt de tous, si nous ne sommes pas graduellement amenés par l’observation, et au besoin par l’expérience, à désirer le bien général, et, par conséquent, à y contribuer ; auquel cas, le principe de la fraternité naîtrait du sentiment même de la personnalité avec lequel il semble, au premier coup d’œil, en opposition.
Ici j’ai besoin de revenir sur une idée fondamentale, que j’ai déjà exposée dans ce recueil, aux articles intitulés : concurrence, population.
À l’exception des relations de parenté et des actes de pure bienveillance et d’abnégation, je crois qu’on peut dire que toute l’économie de la société repose sur un échange volontaire de services.
Mais, pour prévenir toute fausse interprétation, je dois dire un mot de l’abnégation, qui est le sacrifice volontaire du sentiment de la personnalité.
On accuse les économistes de ne pas tenir compte de l’abnégation, peut-être de la dédaigner. À Dieu ne plaise que nous voulions méconnaître ce qu’il y a de puissance et de grandeur dans l’abnégation. Rien de grand, rien de généreux, rien de ce qui excite la sympathie et l’admiration des hommes ne s’est accompli que par le dévouement. L’homme n’est pas seulement une intelligence, il n’est pas seulement calculateur. Il a une âme, dans cette âme il y a un germe sympathique, et ce germe peut être développé jusqu’à l’amour universel, jusqu’au sacrifice le plus absolu, jusqu’à produire ces actions généreuses dont le simple récit appelle les larmes à nos paupières.
[VII-342]
Mais les économistes ne pensent pas que le train ordinaire de la vie, les actes journaliers, continus, par lesquels les hommes pourvoient à leur conservation, à leur subsistance et à leur développement, puissent être fondés sur le principe de l’abnégation. Or ce sont ces actes, ces transactions librement débattues qui font l’objet de l’économie politique. Le domaine en est assez vaste pour constituer une science. Les actions des hommes ressortent de plusieurs sciences : en tant qu’elles donnent lieu à la contestation, elles appartiennent à la science du droit ; en tant qu’elles sont soumises à l’influence directe du pouvoir établi, elles appartiennent à la politique ; en tant qu’elles exigent cet effort qu’on nomme vertu, elles ressortent de la morale ou de la religion.
Aucune de ces sciences ne peut se passer des autres, encore moins les contredire. Mais il ne faut pas exiger qu’une seule les embrasse toutes complétement. Et quoique les économistes parlent peu d’abnégation, parce que ce n’est pas leur sujet, nous osons affirmer que leur biographie, sous ce rapport, peut soutenir le parallèle avec celle des écrivains qui ont embrassé d’autres doctrines. De même le prêtre qui parle peu de valeur, de concurrence, parce que ces choses ne rentrent que bien indirectement dans la sphère de ses prédications, exécute ses achats et ses ventes absolument comme le vulgaire. On en peut dire autant des socialistes.
Disons donc que, dans les actions humaines, celles qui font le sujet de la science économique consistent en échange de services.
Peut-être trouvera-t-on que c’est ravaler la science ; mais je crois sincèrement qu’elle est considérable, quoique plus simple qu’on ne le suppose, et qu’elle repose tout entière sur ces vulgarités : donne-moi ceci, et je te donnerai cela ; fais ceci pour moi, et je ferai cela pour toi. Je ne puis pas [VII-343] concevoir d’autres formes aux transactions humaines. L’intervention de la monnaie, des négociants, des intermédiaires, peut compliquer cette forme élémentaire, et nous en obscurcir la vue. Elle n’en est pas moins le type de tous les faits économiques……
References
[1] Histoire de la Révolution française, par Louis Blanc, t. Ier, p. 9.
[2] Louis Blanc, Histoire de la Révolution, t. Ier, p. 360.
[3] Bastiat n’ayant pas achevé de copier de sa main, sur son manuscrit, le passage du livre dont il s’occupe, j’ai dû combler cette lacune et donner la phrase entière. À propos des derniers mots, je me permets de dire qu’ils impliquent contradiction avec la pensée de réaliser un système social quelconque par l’intervention de l’État, c’est-à-dire par la force. Ceux qui proposent des systèmes sociaux de leur invention ne bornent, pas plus que Robespierre, leur prétention à persuader, à obtenir le volontaire assentiment des cœurs, et ne sont pas mieux fondés que lui à se placer sous le drapeau de la liberté. (Note de l’éditeur.)
1945.
77. — BARATARIA [1] .↩
Il n’est rien de tel que les eaux des Pyrénées. On y rencontre des hommes de tout pays, gens qui ont beaucoup vu et beaucoup retenu, prêts d’ailleurs à beaucoup raconter. Ce qui n’est pas moins précieux, on y trouve aussi en grand nombre, surtout aux Eaux-Bonnes, d’autres hommes disposés à beaucoup écouter, et pour cause.
Depuis plusieurs jours, nous, vrais malades, malades sérieux, comme on dit aujourd’hui (ce qui ne nous empêche pas d’être gais), nous faisons cercle autour d’un hidalgo valencian, qui a visité en détail l’île de Barataria, et nous en conte des choses merveilleuses. On sait que cette île a eu pour législateur le grand Sancho Pança, qui crut devoir s’écarter, dans ses institutions, des données classiques de Minos, Lycurgue, Solon, Numa et Platon. À Barataria, le principe du gouvernement est de laisser les gouvernés juger et décider pour eux-mêmes en toutes matières, et de [VII-344] n’exiger rien d’eux que le respect de la justice. Le gouvernement ne promet rien non plus ; il ne se charge de rien et ne répond de rien que de la sécurité universelle.
Une autre fois je vous raconterai les effets de ce système, au dire de don Juan Jose. Pour aujourd’hui, je me borne à transcrire ici quelques lettres qui furent échangées entre don Quichotte et Sancho, pendant le règne du célèbre laboureur Manchego, lettres qu’on conserve précieusement dans la bibliothèque de Barataria.
Malheureusement le chevalier de la Triste-Figure, non plus que son écuyer, n’ont eu soin de dater leur correspondance. On suppose qu’elle n’a dû avoir lieu que plusieurs mois après que Sancho eut pris possession de son île. Cela se reconnaît au style. Il dénote chez don Quichotte la perte du peu de bon sens qui lui restait, et, chez Sancho, une moindre dose d’aimable naïveté. Quoi qu’il en soit, tout ce qui vient de ces deux héros est trop précieux pour n’être pas conservé.
don quichotte à sancho.
Ami Sancho, je ne puis me rappeler combien est difficile le gouvernement des hommes, sans éprouver quelques remords de t’avoir préposé à gouverner l’île de Barataria, mission pour laquelle ta tête et ton cœur n’avaient pas été peut-être assez préparés. C’est pourquoi je prends la résolution de te donner désormais de fréquents avis, que tu suivras, j’espère, avec cette docilité qui est imposée aux écuyers par les lois de la chevalerie.
Combien tu dois maintenant déplorer la grossière existence que tu as menée jusqu’au jour où tu t’associas, avec ton âne, à mes glorieuses entreprises, à mes nobles destinées. Les hauts faits dont tu as été témoin et auxquels tu n’as pas laissé, à l’occasion, que de prendre part, auront [VII-345] arraché ton âme aux préoccupations vulgaires du village. Mais a-t-elle eu le temps de s’élever à toute la hauteur que doit atteindre l’âme d’un législateur ?
Je crains, ami Sancho, qu’appelé à jouer sur la scène du monde le rôle d’un Minos, d’un Lycurgue, d’un Solon, d’un Numa, tu ne te sois pas encore assez identifié avec la pensée et le but de ces grands hommes. Comme eux, tu es plus que prince, tu es législateur ; et sais-tu ce que c’est qu’un législateur ?
« Celui qui ose entreprendre d’instituer un peuple doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine, de transformer chaque individu, qui par lui-même est un tout parfait et solitaire, en partie d’un plus grand tout dont cet individu reçoive, en quelque sorte, sa vie et son être ; d’altérer la constitution de l’homme pour la renforcer ; de substituer une existence partielle et morale à l’existence physique et indépendante que nous avons tous reçue de la nature. Il faut, en un mot, qu’il ôte à l’homme ses propres forces pour lui en donner qui lui soient étrangères, et dont il ne puisse faire usage sans le secours d’autrui [2] . »
Ami Sancho, tu as à être l’inventeur d’abord, puis le mécanicien d’une machine, dont les Baratariens seront les matériaux et les ressorts. N’oublie pas que, dans cette machine tout doit être combiné, non pour la gloire de l’inventeur ou le bonheur du mécanicien, mais pour le bonheur et la gloire de la machine elle-même.
[VII-346]
La première difficulté que tu vas rencontrer sera de faire accepter tes lois. Il ne serait pas mal que tu puisses persuader aux Baratariens que tu es en commerce secret avec quelque déesse. Tu proclamerais ta législation un jour d’orage, au milieu du tonnerre et des éclairs. Elle s’imprimerait ainsi dans leur âme avec le sentiment d’une salutaire terreur. Ton code ne serait pas seulement un code, il serait une religion ; violer la loi serait commettre un sacrilège, et encourir non seulement des châtiments humains, mais encore le courroux des dieux. C’est de cette manière que tu donneras de la stabilité à ta ville, et que tu forceras les citoyens à porter docilement le joug de la félicité publique.
Une telle imposture serait, il est vrai, odieuse chez tout autre, mais elle est très-permise à un législateur. Tous s’en sont servis, depuis Lycurgue jusqu’à Mahomet, et de nos jours encore, si tu lis les écrits des publicistes qui aspirent à refaire la société, tu y remarqueras un ton de mysticisme qui prouve qu’ils ne seraient pas fâchés de passer pour des inspirés et des prophètes. Ceux qui ont recours à ces supercheries sont plus qu’excusables, ils sont méritoires puisqu’ils honorent les dieux de leur propre sagesse.
Tu auras ensuite à résoudre cette question importante : établiras-tu ou non l’esclavage ?
Il y a beaucoup de pour et de contre.
Si, comme nous gens éclairés, tu avais passé toute ta jeunesse avec les Grecs et les Romains, tu saurais que la vertu est incompatible avec le travail ; qu’il n’y a de noble que le métier des armes, de grand que la guerre, et que nos mains ne sauraient dignement s’exercer qu’aux arts qui servent à la domination ou à la destruction ; ceux qui nous font exister étant essentiellement bas, honteux et serviles.
Il suit de là que, pour faire fleurir la vertu dans ton île, il faut en bannir le travail. Mais en bannir le travail, ce serait en bannir la vie.
[VII-347]
Voici comment tu pourrais résoudre la difficulté.
Tu partagerais les Baratariens en deux classes.
Les uns (à peu près 95 sur 100) seraient voués, sous le nom d’esclaves, aux travaux serviles. On les marquerait au front pour les reconnaître ; on les enchaînerait au cou pour prévenir les révoltes.
Les autres vivraient alors noblement. Ils s’exerceraient à la lutte, au pugilat ; ils se perfectionneraient dans l’art de tuer, en un mot, leur seule occupation serait la vertu. C’est ainsi que tu réaliseras la liberté. — Quoi donc ! me diras-tu, la liberté ne peut-elle fleurir qu’à l’aide de la servitude ? — Peut-être.
Médite ces paroles, ami Sancho, et réponds-moi sans retard.
réponse de sancho.
Je me suis fait lire votre lettre par mon secrétaire, et, quoique j’y comprenne fort peu de chose, je m’empresse d’y répondre. À vous dire vrai, je ne m’aperçois pas que j’aie rien appris de bien utile à mon gouvernement pendant le cours de nos aventures ; et même il y a cela d’étrange que la plupart de vos discours me sont sortis de la tête, tandis que les sentences de notre curé, les proverbes de Carasco et surtout les maximes de Thérèse Pança me sont aujourd’hui d’un grand secours. Quant aux exploits dont vous parlez et auxquels vous avez la bonté de dire que j’ai pris ma part, je ne me les rappelle pas non plus, ne pouvant guère considérer comme tels vos singulières luttes contre des moulins ou des moutons, dont d’ailleurs je suis resté le témoin inactif. Mais, au contraire, je me rappelle fort bien les coups de bâton qui m’ont rompu les os, dans le bois où nous avons combattu vingt muletiers.
[VII-348]
Enfin me voici, comme vous dites, législateur, prince et gouverneur.
Je prends note d’abord qu’à votre avis la Société baratarienne doit être une machine dont les Baratariens seront les matériaux et dont je dois être l’inventeur, l’exécuteur et le mécanicien. Je me suis fait relire trois fois ce passage de votre honorée lettre, sans jamais pouvoir en comprendre le premier mot.
Les Baratariens, que vous n’avez peut-être jamais vus, sont faits comme vous et moi, ou approchant, car il n’y en a guère qui atteignent à votre maigreur ou à ma rotondité. À cela près, ils nous ressemblent beaucoup. Ils ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et leur tête, si je ne me trompe, contient une cervelle. Ils se meuvent, pensent, parlent et paraissent tous fort occupés des arrangements qu’ils ont à prendre pour être heureux. À vrai dire, ils ne s’occupent jamais d’autre chose, et je ne comprends pas que vous les ayez pris pour des matériaux.
J’ai remarqué aussi que les Baratariens ont un autre trait de ressemblance avec les habitants de mon village, en ce que chacun d’eux est si avide de bonheur qu’il le recherche quelquefois aux dépens d’autrui. Pendant plusieurs semaines, mon secrétaire n’a fait que me lire des pétitions étonnantes sous ce rapport. Toutes, soit qu’elles émanent d’individus ou de communautés, peuvent se résumer en ces deux mots : — Ne nous prenez pas d’argent, donnez-nous de l’argent. — Cela m’a fait beaucoup réfléchir.
J’ai envoyé quérir mon ministre de la hacienda, et je lui ai demandé s’il connaissait un moyen de donner toujours de l’argent aux Baratariens sans jamais leur en prendre. — Le ministre m’a affirmé que ce moyen lui était inconnu. — Je lui ai demandé si je ne pourrais pas au moins donner aux Baratariens un peu plus d’argent que je ne leur en prendrais. [VII-349] — Il m’a répondu que c’était tout le contraire, et qu’il était de totale impossibilité de donner dix à mes sujets sans leur prendre au moins douze, à cause des frais.
Alors je me suis fait ce raisonnement : si je donne à chaque Baratarien ce que je lui ai pris, sauf les frais, l’opération est ridicule. Si je donne plus aux uns, c’est que je donnerai moins aux autres ; et l’opération sera injuste.
Tout bien considéré, je me suis décidé à agir d’une autre manière et selon ce qui m’a paru être juste et raisonnable.
J’ai donc convoqué une grande assemblée de Baratariens et je leur ai parlé ainsi :
Baratariens !
« En examinant comment vous êtes faits et comment je suis fait moi-même, j’ai trouvé qu’il y avait beaucoup de ressemblance. Dès lors j’en ai conclu qu’il ne m’était pas plus possible qu’il ne le serait au premier venu d’entre vous de faire votre bonheur à tous ; et je viens vous dire que j’y renonce. N’avez-vous pas des bras, des jambes et une volonté pour les diriger ? Faites donc votre bonheur vous-mêmes.
« Dieu vous a donné des terres ; cultivez-les, façonnez-en les produits. Échangez les uns avec les autres. Que ceux-ci labourent, que ceux-là tissent, que d’autres enseignent, plaident, guérissent, que chacun travaille selon son goût.
« Pour moi, mon devoir est de garantir à chacun ces deux choses : la liberté d’action, — la libre disposition des fruits de son travail.
« Je m’appliquerai constamment à réprimer, où qu’il se manifeste, le funeste penchant à vous dépouiller les uns les autres. Je vous donnerai à tous une entière sécurité. Chargez-vous du reste.
[VII-350]
« N’est-ce pas une chose absurde que vous me demandiez autre chose ? Que signifient ces monceaux de pétitions ? Si je les en croyais, tout le monde volerait tout le monde, à Barataria, — et cela par mon intermédiaire !… Je crois, au contraire, avoir pour mission d’empêcher que personne ne vole personne.
« Baratariens, il y a bien de la différence entre ces deux systèmes. Si je dois être, suivant vous, l’instrument au moyen duquel tout le monde vole tout le monde, c’est comme si vous disiez que toutes vos propriétés m’appartiennent, que j’en puis disposer ainsi que de votre liberté. Vous n’êtes plus des hommes, vous êtes des brutes.
« Si je dois être l’instrument au moyen duquel il n’y ait personne de volé, ma mission sera d’autant plus restreinte que vous serez plus justes. Alors je ne vous demanderai qu’un très-petit impôt ; alors vous ne pourrez vous en prendre qu’à vous-mêmes de tout ce qui vous arrivera ; en tout cas, vous ne pourrez pas avec justice vous en prendre à moi. Ma responsabilité en sera bien réduite, et ma stabilité d’autant mieux assurée.
« Baratariens, voici donc nos conventions :
« Faites comme vous l’entendrez ; levez-vous tard ou de bonne heure, — travaillez ou vous reposez, — faites ripaille ou maigre chère, — dépensez ou économisez, — agissez isolément ou en commun, entendez-vous ou ne vous entendez pas. Je vous tiens trop pour des hommes, je vous respecte trop pour intervenir dans ces choses-là. Elles ne me sont certes pas indifférentes. J’aimerais mieux vous voir actifs que paresseux, économes que prodigues, sobres qu’intempérants, charitables qu’impitoyables ; mais je n’ai pas le droit, et, en tout cas, je n’ai pas la puissance de vous jeter dans le moule qui me convient. Je m’en fie à vous-mêmes et à cette loi de responsabilité à laquelle Dieu a soumis l’homme.
[VII-351]
« Tout ce que je ferai de la force publique qui m’est confiée, c’est de l’appliquer à ce que chacun se contente de sa liberté, de sa propriété, et soit contenu dans les bornes de la justice. »
Voilà ce que j’ai dit, mon cher maître. Vous ayant fait connaître ainsi mes paroles, faits et gestes, je désire savoir ce que vous en pensez avant de répondre au surplus de votre lettre. J’ai d’ailleurs grand besoin de me reposer, car je n’avais encore rien dicté d’aussi long.
References
[1] En publiant ce court fragment d’une brochure projetée, il est de mon devoir de rapporter une réflexion de l’auteur. Je parlais avec regret, devant lui, peu de jours avant sa mort, de ce projet deux fois formé et deux fois abandonné. Il s’empressa de dire qu’il avait bien fait de laisser là ce sujet, et que, dans l’opinion des masses, l’économie politique n’était que trop entachée de positivisme et d’égoïsme. C’eût été, ajouta-t-il, alimenter ce préjugé défavorable que de placer le langage du bon sens, de la vérité économique dans la bouche de Sancho Pança, et le langage du socialisme, de l’utopie dans la bouche de Don Quichotte. (Note de l’éditeur.)
[2] Nous avions quelque peine à comprendre comment Don Quichotte avait pu citer Rousseau, et il nous est naturellement venu à la pensée que ce pouvait bien être Rousseau qui avait fait des emprunts à Don Quichotte. Mais considérant que l’antiquité est le seul sujet d’étude et d’admiration des modernes, nous préférons croire à une simple coïncidence, qui n’a rien de surprenant.(Note de l’auteur.)
Tous les passages placés entre guillemets ou écrits en italique, sont tirés du Contrat social. (Note de l’éditeur.)
78. — LETTRE À UN ECCLÉSIASTIQUE [1] .↩
Mugron, 28 mars 1848.
Monsieur et honoré compatriote,
En arrivant de Bayonne, j’ai trouvé votre lettre du 22, par laquelle vous me faites savoir que vous subordonnez votre suffrage en ma faveur à une question que vous m’adressez. En même temps, on me met à la même épreuve dans le Maransin.
Je serais un singulier représentant si j’entrais à l’Assemblée nationale après et pour avoir renié la liberté commerciale et la liberté religieuse. Il ne me manquerait plus que d’abandonner aussi la liberté d’enseignement pour me concilier certains votes. En tout cas, mon cher monsieur, je vous remercie d’avoir cru à la sincérité de ma réponse. Vous désirez connaître mon opinion sur le traitement alloué [VII-352] au clergé ; je ne dois pas déguiser ma pensée même pour m’attirer des suffrages dont je pourrais à bon droit m’honorer.
Il est vrai que j’ai écrit que chacun devrait concourir librement à soutenir le culte qu’il professe ; cette opinion, je l’ai exprimée et je la soutiendrai comme publiciste et comme législateur, sans entêtement cependant, et jusqu’à ce que de bonnes raisons me fassent changer. Ainsi que je l’ai dit dans ma profession de foi [2] , mon idéal c’est la justice universelle. Les rapports de l’Église et de l’État ne me semblent pas fondés actuellement sur la justice : d’une part on force les catholiques à salarier les cultes protestant et judaïque, avant peu vous payerez peut-être l’abbé Châtel, — cela peut froisser quelques consciences ; d’un autre côté, l’État se prévaut de ce qu’il dispose de votre budget pour intervenir dans les affaires du clergé ou pour y exercer une influence que je n’admets pas. Il est pour quelque chose dans la nomination des évêques, des chanoines, des curés de canton ; et certes la république peut prendre une direction telle, que ce joug ne vous plaira plus. Cela me paraît contraire à la liberté et multiplie entre la puissance temporelle et la puissance spirituelle de dangereux points de contact.
En outre, j’ai foi dans une fusion future entre toutes les religions chrétiennes, ou, si vous voulez, dans l’absorption des sectes dissidentes par le catholicisme. Mais pour cela il ne faut pas que les Églises soient des institutions politiques. Vous ne pouvez nier que le rôle attribué à Victoria, dans la religion anglicane, et à Nicolas, dans la religion russe, ne soit un grand obstacle à la réunion de tout le troupeau sous un même pasteur.
Quant à l’objection tirée de la situation où placerait trente [VII-353] mille prêtres une mesure telle que la suppression de leur traitement par l’État, vous raisonnez, je crois, dans l’hypothèse où elle serait prise violemment et non dans un esprit de charité. Dans ma pensée, elle implique l’indépendance absolue du clergé ; et, en outre, en la décrétant, on devrait tenir compte du traité intervenu en 89, et que vous rappelez.
Il me faudrait un volume pour développer ma thèse ; mais après avoir aussi franchement exprimé ma manière de voir et réservé toute mon indépendance comme législateur et comme publiciste, j’espère que vous ne révoquerez pas en doute la sincérité de ce qu’il me reste à vous dire.
Je crois que la réforme dont je vous entretiens doit être et sera, pendant bien des années encore, peut-être pendant bien des générations, matière à discussion plutôt que matière à législation. La prochaine Assemblée nationale aura simplement pour mission de concilier les esprits, de rassurer les consciences ; et je ne pense pas qu’elle veuille soulever, et encore moins résoudre, dans un sens contraire à l’opinion des masses, la question que vous me soumettez.
Considérez, en effet, qu’alors même que mon opinion serait la vérité, elle n’est professée que par un bien petit nombre d’hommes ; si elle triomphait maintenant dans l’enceinte législative, ce ne pourrait être sans alarmer et jeter dans l’opposition la presque totalité de la nation. C’est donc, pour ceux qui pensent comme moi, une croyance à défendre et propager, non une mesure de réalisation immédiate.
Je diffère de bien d’autres en ceci que je ne me crois pas infaillible ; je suis tellement frappé de l’infirmité native de la raison individuelle que je ne cherche ni ne chercherai jamais à imposer mes systèmes. Je les expose, les développe, et, pour la réalisation, j’attends que la raison publique se prononce. S’ils sont justes, ce temps arrivera certainement ; s’ils sont erronés, ils mourront avant moi. J’ai [VII-354] toujours pensé qu’aucune réforme ne pouvait être considérée comme mûre, ayant de profondes racines, en un mot, comme utile, que lorsqu’un long débat lui avait concilié l’opinion des masses.
C’est sur ce principe que j’ai agi relativement à la liberté commerciale. Je ne me suis pas adressé au pouvoir, mais au public et me suis efforcé de le ramener à mon avis. Je considérerais la liberté commerciale comme un présent funeste si elle était décrétée avant que la raison publique la réclame. Je vous jure sur mon honneur que si j’étais sorti des barricades membre du gouvernement provisoire, avec une dictature illimitée, je n’en aurais pas profité, à l’exemple de Louis Blanc, pour imposer à mes concitoyens mes vues personnelles. La raison en est simple : c’est qu’à mes yeux une réforme ainsi introduite par surprise n’a aucun fondement solide et succombe à la première occasion. Il en est de même de la question que vous me proposez. Cela dépendrait de moi que je n’accomplirais pas violemment la séparation de l’Église et de l’État ; non que cette séparation ne me paraisse bonne en soi, mais parce que l’opinion publique, qui est la reine du monde, selon Pascal, la repousse encore. C’est cette opinion qu’il faut conquérir. Sur cette question et sur quelques autres, il ne m’en coûtera pas de rester toute ma vie peut-être dans une imperceptible minorité. Un jour viendra, je le crois, où le clergé lui-même sentira le besoin, par une nouvelle transaction avec l’État, de reconquérir son indépendance.
En attendant, j’espère que mon opinion, qu’on peut considérer comme purement spéculative, et qui, en tout cas, est bien loin d’être hostile à la religion, ne me fera pas perdre l’honneur de votre suffrage. Si cependant vous croyez devoir me le retirer, je ne regretterai pas pour cela de vous avoir répondu sincèrement.
Votre dévoué compatriote, etc.
[VII-355]
79 [1] .↩
J’ai toujours pensé que la question religieuse remuerait encore le monde. Les religions positives actuelles retiennent trop d’esprit et de moyens d’exploitation pour se concilier avec l’inévitable progrès des lumières. D’un autre côté, l’abus religieux fera une longue et terrible résistance, parce qu’il est fondu et confondu avec la morale religieuse qui est le plus grand besoin de l’humanité.
Il semble donc que l’humanité n’en a pas fini avec cette triste oscillation qui a rempli les pages de l’histoire : d’une part, on attaque les abus religieux et, dans l’ardeur de la lutte, on est entraîné à ébranler la religion elle-même. De l’autre, on se pose comme le champion de la religion, et, dans le zèle de la défense, on innocente les abus.
Ce long déchirement a été décidé le jour où un homme s’est servi de Dieu pour faire d’un autre homme son esclave intellectuel, le jour où un homme a dit à un autre : « Je suis le ministre de Dieu, il m’a donné tout pouvoir sur toi, sur ton esprit, sur ton corps, sur ton cœur. »
Mais, laissant de côté ces réflexions générales, je veux attirer votre attention sur deux faits dont les journaux d’aujourd’hui font mention, et qui prouvent combien sont loin d’être résolus les problèmes relatifs à l’accord ou la séparation du spirituel et du temporel.
On dit que c’est cette complète séparation qui résoudra toutes les difficultés. Ceux qui avancent cette assertion devraient commencer par prouver que le spirituel et le temporel peuvent suivre des destinées indépendantes, et que le maître du spirituel n’est pas maître de tout.
Quoi qu’il en soit, voici les deux faits, ou le fait.
[VII-356]
Monseigneur l’évêque de Langres, ayant été choisi par les électeurs du département de …… pour les représenter, n’a pas cru devoir tenir cette élection comme suffisante, ni même s’en remettre à sa propre décision. Il a un chef qui n’est ni Français, ni en France, et, il faut bien le dire, qui est en même temps roi étranger. C’est à ce chef que Mgr l’évêque de Langres s’adresse. Il lui dit : « Je vous promets une entière et douce obéissance ; ferai-je bien d’accepter ? » Le chef spirituel (en même temps roi temporel) répond : « L’état de la religion et de l’Église est si alarmant que vos services peuvent être plus utiles sur la scène politique que parmi votre troupeau. »
Là-dessus, Mgr de Langres fait savoir à ses électeurs qu’il accepte leur mandat ; comme évêque, il est forcé de les quitter, mais ils recevront en compensation la bénédiction apostolique. Ainsi tout s’arrange.
Maintenant, je le demande, est-ce pour défendre des dogmes religieux que le Pape confirme l’élection de… ? Mgr de Langres va-t-il à la Chambre pour combattre des hérésies ? Non, il y va pour faire des lois civiles, pour s’y occuper exclusivement d’objets temporels.
Ce que je veux faire remarquer ici, c’est que nous avons en France cinquante mille personnes, toutes très influentes par leur caractère, qui ont juré une entière et douce obéissance à leur chef spirituel qui est en même temps roi étranger, et que le spirituel et le temporel se mêlent tellement, que ces cinquante mille hommes ne peuvent rien faire, même comme citoyens, sans consulter le souverain étranger, dont les décisions sont indiscutables.
Nous frémirions, si on nous disait : On va investir un roi, Louis-Philippe, Henri V, Bonaparte, Léopold, de la puissance spirituelle. Nous penserions que c’est fonder un despotisme sans limites. Cependant qu’on ajoute la puissance spirituelle à la temporelle, ou qu’on superpose celle-ci à celle-là, [VII-357] n’est-ce pas la même chose ? Comment se fait-il que nous ne pensions pas sans horreur à l’usurpation du gouvernement des âmes par l’autorité civile, et que nous trouvions si naturelle l’usurpation de la puissance civile par l’autorité sacerdotale ?
Après tout, S. S. Pie IX n’est pas le seul homme en Europe revêtu de cette double autorité. Nicolas est empereur et pape ; Victoria est reine et papesse.
Supposons qu’un Français professant la religion anglicane soit nommé représentant. Supposons qu’il écrive et fasse publier dans les journaux une lettre ainsi conçue :
Gracieuse souveraine,
Je ne vous dois rien comme reine ; mais, placée à la tête de ma religion, je vous dois mon entière et douce obéissance. Veuillez me faire savoir, après avoir consulté votre gouvernement, s’il est dans les intérêts de l’État et de l’Église d’Angleterre que je sois législateur en France.
Supposez que Victoria fasse et publie cette réponse :
« Mon gouvernement est d’avis que vous acceptiez la députation. Par là vous pourrez rendre de grands services directement à ma puissance spirituelle et, par suite, indirectement à ma puissance temporelle ; car il est bien clair que chacune d’elles sert à l’autre. »
Je le demande, cet homme pourrait-il être considéré comme un loyal et sincère représentant de la France ?…
References
[1] Ce projet d’article indique sa date lui-même. (Note de l’édit.)
80. — DE LA SÉPARATION DU TEMPOREL ET DU SPIRITUEL
2027.(Ébauche inédite) [1] .↩
Les affaires de Rome ont-elles une solution possible ? — Oui. — Laquelle ? — Qu’il se rencontre un pape qui dise : [VII-358] « Mon royaume n’est pas de ce monde. » — Vous croyez que ce serait la solution de la question romaine ? — Oui, et de la question catholique et de la question religieuse.
Si, en 1847, quelqu’un eût proposé d’anéantir la Charte et d’investir Louis-Philippe du pouvoir absolu, c’eût été contre une telle proposition une clameur générale.
Si, de plus, on eût proposé de remettre à Louis-Philippe, outre le pouvoir temporel, la puissance spirituelle, la proposition n’eût pas succombé sous les clameurs, mais sous le dédain.
Pourquoi cela ? Parce que nous trouvons que le droit de gouverner les actes est déjà bien grand, et qu’il n’y faut pas joindre encore celui de régenter les consciences.
Mais quoi ! à celui qui a le pouvoir temporel donner la puissance spirituelle, ou bien à celui qui est le chef spirituel accorder le pouvoir temporel, est-ce donc bien différent ? et le résultat n’est-il pas absolument le même ?
Nous nous ferions hacher plutôt que de nous laisser imposer une telle combinaison ; et nous l’imposons aux autres !
Dialogue.
— Mais, enfin, cet ordre de choses que vous critiquez a prévalu pendant des siècles.
— C’est vrai ; mais il a fini par révolter les Romains.
— Ne me parlez pas des Romains. Ce sont des brigands, des assassins, des hommes dégénérés, sans courage, sans vertu, sans bonne foi, sans lumières ; et je ne puis comprendre que vous preniez leur parti contre le Saint-Père.
— Et moi, je ne puis comprendre que vous preniez le parti d’une institution qui a fait un peuple tel que vous le décrivez.
Le monde est plein d’honnêtes gens qui voudraient être [VII-359] catholiques et ne le peuvent pas. Hélas ! c’est à peine s’ils osent le paraître.
Et ne pouvant pas être catholiques, ils ne sont rien. Ils ont au cœur une racine de foi ; mais ils n’ont pas de foi. Ils soupirent après une religion, et n’ont pas de religion.
Ce qu’il y a de pire, c’est que cette désertion s’accroît tous les jours ; elle pousse tous les hommes hors de l’Église, à commencer par les plus éclairés.
Ainsi la foi s’éteint sans que rien la remplace ; et ceux mêmes qui, par politique, ou effrayés de l’avenir, défendent la religion, n’ont pas de religion. — À tout homme que j’entends déclamer en faveur du catholicisme, j’adresse cette question : « Vous confessez-vous ? » — Et il baisse la tête.
Certes, c’est là un état de choses qui n’est pas naturel.
Quelle en est la cause ?
Je le dirai franchement : selon moi, elle est tout-entière dans l’union des deux puissances sur la même tête.
Dès le moment que le clergé a le pouvoir politique, la religion devient pour lui un instrument politique. Le clergé ne sert plus la religion ; c’est la religion qui sert le clergé.
Et bientôt le pays est couvert d’institutions dont le but, religieux en apparence, est intéressé en fait.
Et la religion est profanée.
Et nul ne veut jouer ce rôle ridicule de laisser exploiter jusqu’à sa conscience.
Et le peuple repousse ce qu’il y a en elle de vrai avec ce qui s’y est mêlé de faux.
Et alors le temps est venu où le prêtre a beau crier : « Soyez dévots, » on ne veut pas même être pieux.
Supposons que les deux puissances fussent séparées.
Alors la religion ne pourrait procurer aucun avantage politique.
Alors le clergé n’aurait pas besoin de la surcharger d’une foule de rites, de cérémonies propres à étouffer la raison.
[VII-360]
Et chacun sentirait reverdir au fond de son cœur cette racine de foi qui ne se dessèche jamais entièrement.
Et les formes religieuses n’ayant plus rien de dégradant, le prêtre n’aurait plus à lutter contre le respect humain.
Et la fusion de toutes les sectes chrétiennes en une communion ne rencontrerait plus d’obstacles.
Et l’histoire de l’humanité ne présenterait pas une plus belle révolution.
Mais le sacerdoce serait l’instrument de la religion, la religion ne serait pas l’instrument du sacerdoce.
Tout est là.
Un des plus grands besoins de l’homme, c’est celui de la morale. Comme père, comme époux, comme maître, comme citoyen, l’homme sent qu’il n’a aucune garantie, si la morale n’est un frein pour ses semblables.
Ce besoin généralement senti, il se trouve toujours des gens disposés à le satisfaire.
À l’origine des sociétés, la morale est renfermée dans une religion. La raison en est simple. La morale proprement dite serait obligée de raisonner ; on a droit de mettre ses maximes en quarantaine. En attendant le monde…… [2] . La religion va au plus pressé. Elle parle avec autorité. Elle ne conseille pas, elle impose. « Tu ne tueras pas. Tu ne prendras pas. » — Pourquoi ? — « J’ai le droit de le dire, répond la religion, et j’ai celui de ne pas le dire, parce que je parle au nom de Dieu, qui ne trompe ni ne se trompe. »
La religion a donc pour base la morale. De plus elle a des dogmes, des faits, une histoire, des cérémonies, enfin des ministres.
Au sein d’un peuple, les ministres de la religion sont des [VII-361] hommes très-influents. Indépendamment du respect qu’ils s’attirent comme interprètes de la volonté de Dieu, ils sont encore les distributeurs d’une des choses dont les hommes ont le plus besoin, la morale……
81. — Pensée↩
N’en est-il pas en religion comme en économie politique ? et n’a-t-on point le tort de chercher la solution dans une unité factice, imposée, intolérante, persécutrice, socialiste, incapable d’ailleurs de fournir ses titres à la domination et ses preuves de vérité ?
L’unité, en toutes choses, est la consommation suprême, le point vers lequel gravite et gravitera éternellement, sans jamais l’atteindre, l’esprit humain. Si elle devait se réaliser dans l’humanité, ce ne serait qu’à la fin de toutes les libres évolutions sociales.
C’est la variété, la diversité qui sont au commencement, à l’origine, au point de départ de l’humanité, car la diversité des opinions doit être d’autant plus grande que le trésor des vérités acquises est plus petit et que l’esprit des hommes s’est mis d’accord, par la science, sur un moins grand nombre de points……
82. — LES TROIS CONSEILS [1] .↩
« Quand la patrie est en danger, chacun lui doit le tribut de ce qu’il peut avoir acquis de lumière et d’expérience. »
[VII-362]
C’est ainsi que débute tout donneur d’avis. L’impôt du conseil ! En est-il de plus abondant et de plus volontaire ?
Je veux aussi payer cet impôt, ainsi que tous les autres, afin de n’être en reste, sous aucun rapport, envers mon pays.
Quoique les millions et les millions de conseils qu’il reçoit diffèrent entre eux, ils ont cependant un point de ressemblance. Tous ont la prétention de sauver la société ; et ceux qui les donnent se bornent à dire : voici mon système, les choses iraient merveilleusement si tout le monde voulait penser comme moi. Cela revient à ceci : si nous étions d’accord, nous nous accorderions.
Mettons-nous tous en phalanstère, dit l’un, et toutes nos disputes cesseront. — C’est fort bien ; mais les 9999/10000 des Français ont horreur du phalanstère. — Organisons, d’un consentement unanime, l’atelier social, dit l’autre, et la société marchera comme sur des roulettes. — Sans doute ; mais ceux à qui on s’adresse aimeraient autant le bagne. — Inclinons-nous tous devant la Constitution, s’écrie un troisième ; fût-elle mauvaise, si chacun l’exécute, elle sera bonne. — Rien n’est plus vrai, et je crois que c’est le plus sage et le plus plausible. Mais comment y amener ceux qui, détestant la Constitution, s’y soumettent quand l’anarchie les menace, et la menacent dès que l’ordre leur donne du cœur ?
Il y en a qui disent : Le mal provient de ce que toute foi est éteinte. Soyons bons catholiques, et les plaies sociales seront cicatrisées. — Vous parlez ainsi parce que vous êtes catholique vous-même… et encore. Mais comment faire pour que ceux qui ne le sont pas le soient ?
D’autres, selon leurs prédilections, vous répètent :
« Unissons-nous tous à la république ! » — « Rallions-nous tous à la monarchie ! » — « Remontons d’un commun accord vers le passé ! » — « Élançons-nous avec courage vers l’avenir ! »
[VII-363]
Enfin chacun consulte son opinion personnelle, rien de plus naturel, — et proclame que le monde est sauvé si elle prévaut, — rien de plus sûr.
Mais aucune ne prévaut ni ne peut prévaloir, car tous ces efforts se neutralisent et chacun reste ce qu’il est.
Parmi ces myriades de doctrines, il en est une seule, — je n’ai pas besoin de dire que c’est la mienne, — qui aurait le droit de réunir l’assentiment commun. Pourquoi aurait-elle seule ce privilége ? Parce que c’est la doctrine de la Liberté, parce qu’elle est tolérante et juste pour toutes les autres. Fondez un phalanstère, si cela vous plaît ; — réunissez-vous en atelier social, si tel est votre bon plaisir ; discutez la Constitution tant qu’il vous plaira ; manifestez ouvertement vos préférences pour la république ou la monarchie ; allez à confesse, si le cœur vous y porte ; en un mot, usez de tous les droits de l’individu : pourvu que vous respectiez ces mêmes droits en autrui, je me tiens pour satisfait ; et, telle est ma conviction, la société, pour être juste, ordonnée et progressive, n’a pas autre chose à vous demander.
Mais je n’ai pas la prétention aujourd’hui de développer ce système, qui devrait, ce me semble, être aussitôt adopté qu’exposé. Est-il rien de plus raisonnable ? Nous ne pouvons nous accorder sur les doctrines : eh bien ! conservons, propageons chacun la nôtre, et convenons de bannir d’entre nous toute oppression, toute violence.
Me plaçant au point de vue des faits tels qu’ils sont, de la situation telle que les événements l’ont faite, supposant, comme je le dois, que je m’adresse à des personnes qui, avant tout, veulent le repos et le bonheur de la France, je voudrais donner trois conseils pratiques, — l’un à M. le président de la République, l’autre à la majorité de la Chambre, le troisième à la minorité.
Je voudrais que M. le président de la République se [VII-364] présentât solennellement devant l’Assemblée nationale et y fît l’allocution suivante :
Citoyens représentants,
Le plus grand fléau de ce temps et de notre pays, c’est l’incertitude de l’avenir. En tant que cette incertitude peut se rattacher à mes projets et à mes vues, mon devoir est de la faire cesser ; c’est aussi ma volonté.
On se demande : Qu’arrivera-t-il dans deux ans ? À la face de mon pays, sous l’œil de Dieu, par le nom que je porte, je jure que le … mai 1852, je descendrai du fauteuil de la présidence.
J’ai reçu du peuple un mandat en vertu de la Constitution. Je remettrai au peuple ce mandat conformément a la Constitution.
Il y en a qui disent : Mais si le peuple vous renomme ? À quoi je réponds : Le peuple ne me fera pas l’injure de me renommer malgré moi ; et si quelques citoyens oublient à ce point leurs devoirs, je tiens d’avance pour nuls et non avenus les bulletins qui, aux prochaines élections, porteraient mon nom.
D’autres, se croyant beaucoup plus sages, pensent qu’on peut prolonger ma présidence en modifiant la Constitution d’après les formes qu’elle a elle-même établies.
Il ne m’appartient pas d’imposer des limites à l’exercice légal des droits de l’Assemblée. Mais, si elle est maîtresse de ses résolutions régulières, je suis maître des miennes ; et je déclare formellement que, la Constitution fût-elle modifiée, ma première présidence ne sera pas immédiatement suivie d’une seconde.
J’y ai réfléchi, et voici sur quoi je me fonde :
Notre règle d’action est contenue dans ces mots : La France avant tout. De quoi souffre la France ? De l’incertitude. [VII-365] S’il en est ainsi, citoyens, est-ce le moyen de faire cesser l’incertitude que de remettre tout en question ? Quoi ! la Constitution n’a qu’un an d’existence, et déjà vous jetteriez au milieu de vous cette question brûlante : Faut-il faire une autre Constitution ? Si votre réponse est négative, les passions du dehors en seront-elles calmées ? — Si elle est affirmative, il faudra donc convoquer une nouvelle Constituante, remuer de nouveau tous les fondements de notre existence nationale, nous élancer vers un autre inconnu, et procéder, dans quelques mois, à trois élections générales.
Ce parti extrême me semble le comble de l’imprudence. Je n’ai pas le droit de m’y opposer autrement qu’en déclarant de la manière la plus expresse qu’il n’avancerait en rien mes partisans ; car, je le répète, je n’accepterai pas la présidence, sous quelque forme et de quelque manière qu’elle m’arrive.
Telle est ma première résolution. Je l’ai prise par devoir ; je la proclame avec joie, parce qu’elle peut contribuer au repos de notre patrie. Je serai assez récompensé si elle me donne pour successeur un républicain honnête, qui n’apporte à la première fonction de l’État, ni rancune, ni utopie, ni engagement envers les partis.
J’ai maintenant une seconde résolution à vous communiquer. Par la volonté du peuple, je dois exercer le pouvoir exécutif pendant deux ans encore.
Je comprends le sens de ce mot pouvoir exécutif et je suis résolu à m’y renfermer d’une manière absolue.
La nation adonné deux délégations. À ses représentants, elle a conféré le droit de faire des lois. À moi, elle m’a confié la mission de les faire exécuter.
Représentants, faites les lois que vous croirez les meilleures, les plus justes, les plus utiles au pays. Quelles qu’elles soient, je les exécuterai à la lettre.
[VII-366]
Si elles sont bonnes, leur exécution le prouvera ; si elles sont mauvaises, l’exécution en révélera les défauts, et vous les réformerez. Je n’ai pas le droit et je n’accepte pas la responsabilité de les juger.
Tout ceci, sous la réserve de la faculté qui m’est attribuée par l’article … de la Constitution.
J’exécuterai donc vos décrets sans distinction. Il en est cependant auxquels je me crois tenu, par le vœu national, de donner une attention toute spéciale. Ce sont ceux qui concernent la répression des délits et des crimes, l’ordre dans les rues, le respect dû aux personnes et aux propriétés, prenant ce mot propriété dans l’acception la plus large, qui comprend aussi bien le libre exercice des facultés et des bras que la paisible jouissance de la richesse acquise.
Ainsi, représentants, faites des lois. Que les citoyens discutent toutes les questions politiques et sociales dans leurs réunions et dans leurs journaux. Mais que nul ne trouble l’ordre de la cité, la paix des familles, la sécurité de l’industrie. Au premier signal de révolte ou d’émeute, je serai là. J’y serai avec tous les bons citoyens, avec les vrais républicains ; j’y serai avec la brave garde nationale, j’y serai avec notre admirable armée.
Il y en a qui disent : Peut-on compter sur le zèle de la garde nationale, sur la fidélité de l’armée ?
Oui, dans la ligne que je viens de tracer, on peut y compter. J’y compte comme sur moi-même, et nul n’a le droit de faire à notre force armée l’injure de croire qu’elle prendrait parti pour les perturbateurs du repos public.
Je veux, — j’ai le droit de vouloir, puisque le peuple m’a donné cette mission expresse, et que ma volonté en ceci c’est la sienne, — je veux que l’ordre et la sécurité soient partout respectés. Je le veux, et cela sera. Je suis entouré de soldats fidèles, d’officiers éprouvés ; j’ai pour moi la force, le droit, le bon sens public ; et si je ne craignais de blesser [VII-367] par l’apparence d’un doute les justes susceptibilités de ceux dont le concours m’est assuré, je dirais que les défections même ne me feraient pas fléchir. L’ordre légal régnera, dussé-je y laisser la présidence et la vie.
Telle est, citoyens, ma seconde résolution. Voici la troisième.
Je me demande quelle est la cause de ces luttes incessantes et passionnées entre la Nation et le Gouvernement qu’elle-même s’est donné.
Il faut peut-être l’attribuer à des habitudes invétérées d’opposition. Combattre le pouvoir, c’est se donner un rôle qu’on croit héroïque, parce qu’en effet cela a pu être glorieux et dangereux autrefois. À cela je ne sais d’autre remède que le temps.
Mais, comme ces luttes perpétuelles, le langage haineux et exagéré qu’elles suscitent, sont un des grands fléaux de notre République, j’ai dû rechercher si elles n’avaient pas d’autres causes que des traditions irrationnelles, afin de faire cesser celles de ces causes sur lesquelles je puis avoir quelque action.
Je crois sincèrement que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif mêlent et confondent trop leurs rôles.
Je suis résolu à me renfermer dans le mien, qui est de faire exécuter les lois quand vous les aurez votées. De la sorte, aux yeux même des plus susceptibles, je n’aurai qu’une responsabilité restreinte. Si la nation est mal gouvernée, pourvu que j’exécute les lois, elle ne pourra pas s’en prendre à moi. Le gouvernement et moi nous serons hors de cause dans les débats de la tribune et de la presse.
Je prendrai mes ministres hors de l’Assemblée. Par là s’accomplira une séparation logique entre les deux pouvoirs. Par là avorteront au sein de la Chambre les coalitions et les guerres de portefeuilles, si funestes au pays.
[VII-368]
Mes ministres seront mes agents directs. Ils ne se rendront à l’Assemblée que lorsqu’ils y seront appelés, pour répondre à des questions posées d’avance par la voie de messages réguliers.
Ainsi vous serez parfaitement libres et dans des conditions parfaites d’impartialité pour la confection des lois. Mon gouvernement n’exercera sur vous, à cet égard, aucune influence. De votre côté, vous n’en aurez aucune sur l’exécution. Le contrôle vous appartient sans doute, mais l’exécution proprement dite est à moi.
Et alors, citoyens, est-il possible de concevoir une collision ? Est-ce que vous n’aurez pas le plus grand intérêt à ce qu’il ne sorte de vos délibérations que de bonnes lois ? Est-ce que je pourrais en avoir un autre que leur bonne exécution ?
Dans deux ans, la nation sera appelée à nommer un autre président. Son choix, sans doute, se portera sur le plus digne, et nous n’aurons à redouter de lui aucun attentat contre la liberté et les lois. En tout cas, j’aurai la satisfaction de lui léguer des précédents qui l’enchaîneront. Quand la présidence ne se sera pas fixée sur le nom de Napoléon, sur l’élu de sept millions de suffrages, est-il quelqu’un en France qui puisse rêver pour lui-même un coup d’État et aspirer à l’empire ?
Bannissons donc de vaines terreurs. Nous traverserons, sans danger, une première, une seconde, une troisième présidence…
References
[1] Ébauche publiée par l’Économiste belge, no du 3 juin 1860. (Note de l’éditeur.)
CORRESPONDANCE.
[VII-369]
À M. LAURENCE.↩
Mugron, le 9 novembre 1844.
Monsieur et cher collègue,
Je vous remercie de ce que vous me dites de bienveillant dans la lettre que vous avez bien voulu m’écrire, au sujet de mon opuscule sur la répartition de l’impôt [1] . — Je regrette sincèrement qu’il n’ait pas agi avec plus d’efficacité sur votre conviction, car je reconnais que, dans les contestations auxquelles donnent lieu quelquefois les rivalités d’arrondissement, votre esprit élevé vous met au-dessus de cette partialité mesquine dont d’autres ne savent pas se dégager. Pour moi, je puis affirmer que si quelque erreur ou quelque exagération s’est glissée dans mon écrit, c’est tout à fait à mon insu. — Je suis loin de porter envie pour mon pays à la prospérité du vôtre ; bien au contraire ; et c’est ma ferme conviction que l’un des deux ne saurait prospérer sans que l’autre en profite. Je pense même que cette solidarité embrasse les peuples. C’est pourquoi je déplore [VII-370] amèrement ces jalousies nationales qui sont le thème favori du journalisme. Si j’avais, comme vous le pensez, raisonné sur cette fausse donnée que toute la surface des pignadas est également productive, je me rétracterais sur-le-champ. Mais il n’y a rien dans mon écrit qui puisse justifier cette allégation. Je n’ai pas parlé non plus des grêles, gelées, incendies. Ce sont là des circonstances dont on a dû tenir compte quand on a appliqué aux diverses cultures l’impôt actuel. — C’est cet impôt, tel qu’il est, qui est mon point de départ. Je ne crois pas non plus avoir attribué la détresse des pays de vignobles à la mauvaise répartition de l’impôt. Mais j’ai dit que la répartition de l’impôt devait se modifier en conséquence de cette détresse, puisqu’il est de principe que l’impôt se prélève sur les revenus. — Si le revenu d’un canton diminue d’une manière permanente, il faut que sa contribution diminue aussi, et que, par suite, celle des autres cantons augmente. C’est aussi une preuve de plus de la solidarité de toutes les portions du territoire ; et la Grande-Lande se blessait elle-même lorsque, par l’organe de notre collègue, M. Castagnède, elle s’opposait à ce que la société d’agriculture se fît, vis-à-vis du pouvoir, l’organe de nos doléances.
Vous dites qu’à Villeneuve l’agriculture a progressé sans que la population ait augmenté. Cela veut dire sans doute que chaque individu, chaque famille a vu s’accroître son aisance. Si cette aisance n’a pas favorisé les mariages, les naissances, et prolongé la durée moyenne de la vie, Villeneuve est, par une cause que je ne puis deviner, en dehors de toutes les lois naturelles qui gouvernent les phénomènes de la population.
Enfin, Monsieur et cher collègue, vous me renvoyez aux tables de recrutement. Elles attestent, dites-vous, que les races les plus belles, les hommes les plus forts, appartiennent à la région des labourables et des vignes. — Mais [VII-371] prenez garde qu’il n’entre pas dans mon sujet de comparer la population de la Lande à celle de la Chalosse, mais seulement chacune de ces populations à elle-même, à deux époques différentes. La question pour moi n’est pas de savoir si la population de la Lande égale en vigueur et en densité celle de la Chalosse, mais si, depuis quarante ans, l’une a progressé, l’autre a rétrogradé sous ces deux rapports. Cette vérification m’était facile quant au nombre. Pour ce qui est de la beauté des races, je serais bien aise de consulter les tables du recrutement, si elles existent à la préfecture.
Vous voyez que, comme tous les auteurs possibles, je ne conviens pas facilement d’avoir tort. Je dois pourtant dire que je n’ai pas suffisamment expliqué la portée du passage où j’ai résumé en chiffres (6,32) les considérations diverses disséminées dans mon écrit. Je sais bien que le mouvement de la population ne peut pas être une bonne base de répartition ; mon seul but a été de rendre mes conclusions sensibles par des chiffres, et je crois sincèrement que les recherches directes de l’administration donneront des résultats qui ne s’éloigneront pas de beaucoup de ceux auxquels je suis arrivé, parce qu’il y a selon moi un rapport sinon rigoureux, du moins très-approximatif entre le progrès de la population et celui du revenu.
References
[1] De la répartition de la contribution foncière dans le département des Landes, t. Ier, p. 283. (Note de l’éditeur.)
À M. CH. DUNOYER, MEMBRE DE L’INSTITUT.↩
Mugron, le 7 mars 1846.
Monsieur,
De tous les témoignages que je pourrais ambitionner, celui que je viens de recevoir de vous m’est certainement le plus [VII-372] précieux. Même en faisant la part de la bienveillance dans les expressions si flatteuses pour moi que porte la première page de votre livre, je ne puis m’empêcher d’avoir la certitude que votre suffrage m’est acquis, sachant combien vous avez l’habitude de mettre d’accord votre langage avec votre pensée.
Dans mon extrême jeunesse, Monsieur, un heureux hasard mit dans mes mains le Censeur européen ; et je dois à cette circonstance la direction de mes études et de mon esprit. À la distance qui nous sépare de cette époque, je ne saurais plus distinguer ce qui est le fruit de mes propres méditations de ce que je dois à vos ouvrages, tant il me semble que l’assimilation a été complète. Mais n’eussiez-vous fait que me montrer dans la société et ses vertus, ses vues, ses idées, ses préjugés, ses circonstances extérieures, les vrais éléments des biens dont elle jouit et des maux qu’elle endure ; quand vous ne m’auriez appris qu’à ne voir dans les gouvernements et leurs formes que des résultats de l’état physique et moral de la société elle-même ; il n’en serait pas moins juste, quelques connaissances accessoires que j’aie pu acquérir depuis, d’en rapporter à vous et à vos collaborateurs la direction et le principe. C’est assez vous dire, Monsieur, que rien ne pouvait me faire éprouver une satisfaction plus vraie que l’accueil que vous avez fait à mes deux articles du Journal des économistes, et la manière délicate dont vous avez bien voulu me l’exprimer. Votre livre va devenir l’objet de mes études sérieuses, et c’est avec bonheur que j’y suivrai le développement de la distinction fondamentale à laquelle je faisais tout à l’heure allusion.
[VII-373]
M. AL. DE LAMARTINE [1] .↩
Mugron, le 7 mars 1845.
Monsieur,
Une absence m’a empêché de venir vous exprimer plus tôt la profonde gratitude que m’a fait éprouver l’accueil que vous avez daigné faire à la lettre que je me suis permis de vous adresser par la voie du Journal des économistes. Celle que vous avez bien voulu m’écrire m’est bien précieuse, et je la conserverai toujours, non seulement à cause de ce charme inimitable que vous avez su y répandre, mais encore et surtout comme un témoignage de la bienveillante condescendance avec laquelle vous encouragez les premiers essais d’un novice qui n’a pas craint de signaler dans vos admirables écrits quelques propositions qu’il considère comme des erreurs échappées à votre génie.
Peut-être ai-je été trop loin en réclamant de vous cette rigueur d’analyse, cette exactitude de dissection qui explore le champ des découvertes, mais ne saurait l’agrandir. Toutes les facultés humaines ont leur mission ; c’est au génie de s’élever à de nouveaux horizons et de les signaler à la foule. Ces horizons sont vagues d’abord, la réalité et l’illusion s’y confondent ; et le rôle des analystes est de venir après coup mesurer, peser, distinguer. C’est ainsi que Colomb révèle un monde. S’informe-t-on s’il en a relevé toutes les côtes et tracé tous les contours ? Qu’importe même qu’il ait cru aborder au Cathay ?… D’autres sont venus ; ouvriers patients [VII-374] et exacts, ils ont rectifié, complété l’œuvre ; leurs noms sont ignorés, tandis que celui de Colomb retentit de siècle en siècle. — Mais, Monsieur, le génie n’est-il pas le roi de l’avenir plutôt que du présent ? Peut-il prétendre à une influence immédiate et pratique ? ses puissants élans vers des régions inconnues sont-ils bien compatibles avec le maniement des hommes du siècle et des affaires ? C’est un doute que je propose ; votre avenir le résoudra.
Vous voulez bien reconnaître, Monsieur, que j’ai parcouru le domaine de la Liberté, et vous me conviez à m’élever jusqu’à l’Égalité, et puis encore jusqu’à la Fraternité. Comment n’essayerai-je point, à votre voix, de nouveaux pas dans cette noble carrière ? Je n’atteindrai pas, sans doute, les hauteurs où vous planez, car les habitudes de mon esprit ne me permettent plus d’emprunter les ailes de l’imagination. Mais je m’efforcerai du moins de porter le flambeau de l’analyse sur quelques coins du vaste sujet que vous proposez à mes études.
Permettez-moi de vous dire en terminant, Monsieur, que quelques dissidences accidentelles ne m’empêchent pas d’être le plus sincère et le plus passionné de vos admirateurs, comme j’espère être un jour le plus fervent de vos disciples.
References
[1] La lettre à laquelle Bastiat répond lui avait été adressée à propos de l’article du Journal des Économistes, intitulé : Un économiste à M. de Lamartine. (Voir t. Ier, p. 406. (Note de l’éditeur.)
À M. PAULTON [1] .↩
Paris, 29 juillet 1845.
Mon cher Monsieur, ainsi que je vous l’ai annoncé, je vous envoie quatre exemplaires de ma traduction, que je vous prie de remettre aux éditeurs du Times, du [VII-375] Morning-Chronicle etc., etc. Je m’estimerais heureux que la presse anglaise accueillît avec faveur un travail que je crois utile. Cela me dédommagerait de l’indifférence avec laquelle il a été reçu en France. Tous ceux à qui je l’ai donné ne cessent de manifester leur surprise à l’égard des faits graves qui y sont révélés ; mais personne ne l’achète, et cela n’est pas surprenant, puisqu’on ne sait pas de quoi il traite. Nos journaux d’ailleurs paraissent décidés à ensevelir la question dans le silence. Il m’en coûtera cher pour avoir tenté d’ouvrir les yeux à mon pays ; mais le pis est de n’avoir pas réussi [2] .
En arrivant ici, j’ai trouvé une lettre de sir Robert Peel. Comme il l’a écrite avant d’avoir lu le livre, il n’a pas eu à donner son opinion. Il a aussi évité de citer le litre (Cobden et la Ligue). — Si c’est de la diplomatie, il faut qu’elle soit bien dans les habitudes de votre premier ministre pour qu’il en fasse usage dans une aussi mince occasion. Au reste, voici le texte de ce billet.
Wite-Hall, 24 July.
Sir Robert Peel presents his compliments to M. Bastiat, and is most obliged to M. Bastiat’s attention in transmitting for the acceptance of sir Robert Peel a copy of his recent publication. Sir Robert hopes to be enabled to profit by it when he shall have leisure from the present severe pressure of parliamentary business.
Cette lettre n’est pas signée. J’aurais été curieux de savoir si elle est écrite de la main même de sir Robert.
J’ai trouvé encore d’autres lettres, dont deux ne manquent pas d’importance. Une de M. Passy, pair de France, [VII-376] ex-ministre du commerce. Il donne son approbation sans restriction aux principes contenus soit dans l’introduction, soit dans vos travaux.
L’autre lettre est de M. de Langsdorf, notre chargé d’affaires dans le Grand-Duché de Bade. Il m’annonce qu’il a lu le livre avec ardeur, et appris, pour la première fois, ce qui se passe en Angleterre. Il y a en ce moment, à Carlsruhe, une réunion de commissaires de tout le Zollverein décidés à boucher les plus petites voies par lesquelles le commerce étranger viendrait à s’infiltrer sur le grand marché national. Ce qu’il me dit à cet égard vient à l’appui de l’idée qu’avait M. Cobden de faire traduire en allemand un historique de la Ligue et un choix de vos discours. L’Angleterre, qui a fait traduire la Bible en trois ou quatre cents langues, ne pourrait-elle pas faire traduire aussi cet excellent cours d’économie politique pratique, au moins en allemand et en espagnol ? Je sais les raisons qui vous empêchent de chercher, dès à présent, à agir au dehors. Mais de simples traductions prépareraient les esprits, sans qu’on pût vous accuser de faire de la propagande.
Si, plus tard, la Ligue peut sans inconvénient faire l’acquisition de quelques exemplaires de ma traduction, voici l’usage qui m’en paraît le plus utile. C’est de prendre autant de villes, dans l’ordre de leur importance commerciale, et d’envoyer un exemplaire dans chacune, adressé au cercle littéraire ou à la chambre de commerce.
Je n’essayerai pas, Monsieur, de vous exprimer toute ma reconnaissance pour l’accueil fraternel que j’ai reçu parmi vous. Je désire seulement que l’occasion se présente de vous la témoigner en fait, et mon bonheur serait de rencontrer des Ligueurs en France. J’ai déjà été deux fois chez M. Taylor sans le trouver.
J’oubliais de vous dire que, la lettre de M. de Langsdorf étant confidentielle et émanée d’un homme public, il est [VII-377] bien entendu que son nom ne peut figurer dans aucun journal [3] .
Agréez, mon cher Monsieur, l’assurance de ma sincère amitié, et veuillez me rappeler au souvenir de tous nos frères en travaux et en espérances.
References
[1] L’un des lecturers de l’Anti-corn-laws League. (Note de l’édit.)
[2] Voyez ci-dessus, p. 325, la fin de l’ébauche intitulée : Anglomanie, Anglophobie. (Note de l’éditeur.)
[3] Il me semble que je ne dois me faire aucun scrupule de livrer aujourd’hui à la publicité le nom de M. de Langsdorf. Quel blâme pourrait-il encourir, à raison des secrètes sympathies témoignées à la cause de la liberté commerciale, il y a dix-neuf ans ? (Note de l’édit.)
À M. HORACE SAY.↩
Mugron, le 24 novembre 1844.
Monsieur,
Permettez-moi de venir vous exprimer le sentiment de profonde satisfaction que m’a fait éprouver la lecture de votre bienveillante lettre du 19 de ce mois. Sans des témoignages tels que ceux que renferme cette lettre précieuse, comment pourrions-nous savoir, nous, hommes de solitude, privés des utiles avertissements qu’on reçoit au contact du monde, si nous ne sommes pas un de ces rêveurs trop communs en province qui se laissent dominer par une idée exclusive ? — Ne dites pas, Monsieur, que votre approbation ne peut avoir que peu de prix à mes yeux. Depuis que la France et l’humanité ont perdu votre illustre père, que je vénère aussi comme mon père intellectuel, quel témoignage peut m’être plus précieux que le vôtre, surtout quand vos propres écrits et les marques de confiance dont vous [VII-378] entoure la population parisienne, donnent tant d’autorité à vos jugements ?
Parmi les écrivains de l’école de votre père que la mort a respectés, il en est un surtout dont l’assentiment a pour moi une valeur inappréciable, quoique je n’eusse pas osé le provoquer. Je veux parler de M. Ch. Dunoyer. Ses deux premiers articles du Censeur européen (De l’équilibre des nations) ainsi que ceux de M. Comte qui les précèdent, décidèrent, il y a déjà bien longtemps, de la direction de mes idées et même de ma conduite politique. Depuis, l’école économiste paraît s’être effacée devant ces nombreuses sectes socialistes, qui cherchent la réalisation du bien universel, non dans les lois de la nature humaine, mais dans des organisations artificielles, produit de leur imagination : erreur funeste que M. Dunoyer a longtemps combattue avec une persévérance, pour ainsi dire, prophétique. Je n’ai donc pu m’empêcher de ressentir un mouvement, je dirai presque d’orgueil, quand j’ai appris, par votre lettre, que M. Dunoyer avait approuvé l’esprit de l’écrit que vous avez bien voulu admettre dans votre estimable recueil.
Vous avez l’obligeance, Monsieur, de m’encourager à vous adresser un autre travail. Je consacre maintenant le peu de temps dont je puis disposer à une œuvre de patience, dont l’utilité me semble incontestable quoiqu’il ne s’agisse que de simples traductions. Il y a, en Angleterre, un grand mouvement en faveur de la liberté commerciale : ce mouvement est tenu soigneusement caché par nos journaux ; et si, de loin en loin, ils sont forcés d’en dire un mot, c’est pour en dénaturer l’esprit et la portée. Je voudrais mettre les pièces sous les yeux du public français ; lui montrer qu’il y a de l’autre côté du détroit un parti nombreux, puissant, honnête, judicieux, prêt à devenir le parti national, prêt à diriger la politique de l’Angleterre, et que c’est à ce parti que nous devons donner la main. Le public serait [VII-379] ainsi à même de juger s’il est raisonnable d’embrasser toute l’Angleterre dans cette haine sauvage, que le journalisme s’efforce d’exciter avec tant d’opiniâtreté et de succès.
J’attends d’autres avantages de cette publication. On y verra l’esprit de parti attaqué dans sa racine ; les haines nationales sapées dans leur base ; la théorie des débouchés exposée non point méthodiquement, mais sous des formes populaires et saisissantes : enfin, on y verra en action, cette énergie, cette tactique d’agitation, qui fait qu’aujourd’hui en Angleterre, lorsqu’on attaque un abus réel, on peut prédire le jour de sa chute, à peu près comme nos officiers du génie annoncent l’heure où les assiégeants s’empareront d’une citadelle.
Je compte me rendre à Paris au mois d’avril prochain pour surveiller l’impression de cette publication ; et si j’avais pu hésiter, vos offres bienveillantes, le désir de faire votre connaissance et celle des hommes distingués qui vous entourent suffiraient pour me déterminer.
Votre collègue, M. Dupérier, a bien voulu m’écrire aussi à l’occasion de mon article. C’est bon en théorie, dit-il ; j’ai envie de lui répondre par cette boutade de M. votre père : « Morbleu ! ce qui n’est pas bon pour la pratique n’est bon à rien. » — M. Dupérier et moi suivons en politique des routes bien différentes. Je n’en ai que plus d’estime pour son caractère et la franchise de sa lettre. Par le temps qui court les candidats sont rares qui disent à leurs adversaires ce qu’ils pensent.
J’oubliais de dire que si le temps et ma santé me le permettent, sur votre encourageante invitation, j’enverrai un autre article au Journal des économistes.
Veuillez, Monsieur, être mon interprète auprès de MM. Dussard, Fix, Blanqui, les remercier de leur bienveillance et les assurer que je m’associe de grand cœur à leurs nobles et utiles travaux.
[VII-380]
P. S. Je prends la liberté de vous envoyer un écrit publié en 1842, à l’occasion des élections, par un de mes amis, M. Félix Coudroy. Vous y verrez que les doctrines de MM. Say, Comte, Dunoyer ont germé quelque part sur notre aride sol des Landes. J’ai pensé qu’il vous serait agréable d’apprendre que le feu sacré n’est pas tout à fait éteint. Tant qu’une étincelle brille encore, il ne faut pas désespérer.
Mugron, lundi, octobre 1847.
…Notre pays a bien besoin de recevoir l’instruction économique. L’ignorance à cet égard est telle, que j’en suis épouvanté pour l’avenir. Je crains que les gouvernements n’aient un jour à se repentir amèrement d’avoir mis la lumière sous le boisseau. L’expérience que je viens de faire dans ce voyage me démontre que nos livres et nos journaux ne suffisent pas à répandre nos idées. Outre qu’ils ont bien peu d’abonnés, la plupart de ces abonnés ne les lisent pas. J’ai vu le Journal des économistes encore aussi vierge que le jour où il est sorti de chez notre bon Guillaumin, et le Libre-échange empilé sur les comptoirs, revêtu de sa bande. N’est-ce pas décourageant ? Je pense que l’enseignement oral doit venir en aide à l’enseignement écrit. Parmi les personnes qui assistent à une séance, il y en a toujours quelques-unes qui conçoivent le désir d’étudier la question. Il faudrait organiser des comités dans les villes et ensuite faire constamment voyager des professeurs. Mais combien en avons-nous qui puissent se dévouer à cette œuvre ? Pour moi, je le ferais volontiers, si je pouvais arriver à l’improvisation complète. Je suis tenté d’en faire l’expérience à Bordeaux. Sans cela, on ne peut que bien peu de chose…
[VII-381]
Mugron, 12 avril 1848.
Mon cher ami, je cherche toujours votre nom dans les journaux, mais ils ne s’occupent pas encore d’élections. Il est probable que les clubs leur taillent trop de besogne. Je ne puis m’expliquer que comme cela le silence de la presse parisienne. Peut-être le théâtre de Paris est-il trop agité pour vos habitudes et votre caractère. Je regrette maintenant que vous n’ayez pas songé à aller vous installer dans quelque département. Les folies socialistes y ont excité une telle frayeur qu’à cause de vos précédents bien connus, vous auriez eu là de belles chances. Votre candidature a l’avantage de vous fournir l’occasion de répandre les saines idées. C’est beaucoup, mais ce n’est pas assez pour notre cause. Tentez donc un effort suprême, mettez de côté pour quelques jours votre réserve habituelle, faites de l’agitation, enfin ne négligez rien pour arriver à l’Assemblée constituante. Le salut du pays, je le crois sincèrement, tient à ce que nos principes aient la majorité.
S’il n’y a pas de changement dans l’état de l’opinion ici, mon élection est assurée. Je crois même que j’aurai l’universalité des suffrages, sauf ceux de quelques marchands de résine, effrayés par la liberté du commerce.
Tous les comités cantonaux me portent.
Dimanche prochain, nous avons une réunion générale et centrale. Il faudrait que je fisse un fiasco bien complet pour changer les dispositions des électeurs à mon égard.
Un fait bien étrange, c’est l’ignorance où l’on est dans ce pays, sur les doctrines socialistes. On a horreur du communisme. Mais on ne voit dans le communisme que le partage des terres. Dimanche dernier, dans une nombreuse assemblée publique, pour avoir dit que ce n’était pas sous cette forme [VII-382] que le communisme nous menaçait, on commençait à murmurer. On avait l’air de conclure de ces paroles que je n’étais que fort tièdement opposé à ce communisme-là. La suite de mon discours a effacé cette impression. Vraiment c’est bien dangereux de parler devant un public si peu au courant. On risque de n’être pas compris…
Je vous avoue que l’avenir m’inquiète beaucoup. Comment l’industrie pourra-t-elle reprendre, quand il est admis en principe que le domaine des décrets est illimité ? Quand chaque minute, un décret sur les salaires, sur les heures de travail, sur le prix des choses, etc., peut déranger toutes les combinaisons ?
Adieu, mon cher M. Say, veuillez me rappeler au souvenir de madame Say et de M. Léon.
P. S. La réunion centrale des délégués a eu lieu hier : je ne sais pourquoi elle a été avancée. Après avoir répondu aux questions, je me suis retiré, et ce matin j’apprends que j’ai eu tous les suffrages moins deux. Ayant oublié de jeter ma lettre à la poste avant de partir, je la rouvre pour vous faire part de ce résultat qui peut vous être agréable. Tentez un suprême effort, mon cher ami, pour que l’économie politique, morte au collége de France [1] , soit représentée à la chambre par M. Say. Honte au pays, s’il exclut un tel nom aussi dignement porté !
Mugron, 16 septembre 1849.
Voici nos vacances qui, à peine commencées, vont finir, si même on ne nous les abrège. Va-t-on nous rappeler pour [VII-383] terminer le gâchis catholique ? Hélas ! il est à craindre que nous ne fassions que le gâcher encore un peu plus. Nous voilà dans une impasse sans issue. La République, par la volonté du ministère et au mépris de l’assemblée nationale, s’est mise au service de l’inquisition. Il faut maintenant de deux choses l’une : ou qu’elle aille jusqu’au bout, se faisant plus jésuite que le jésuitisme, ou qu’elle revienne sur ses pas, donnant raison à la Constituante, brisant le ministère et la majorité actuelle, courant la chance du désordre intérieur et de la guerre universelle. Les principes sont, de même que l’honneur,
…comme une île escarpée et sans bords ;
On n’y peut plus rentrer dès qu’on en est dehors.
Et encore les difficultés politiques sont ce qui m’effraye le moins. Ce qu’il y a de désolant pour ce pays, c’est de voir tous les hommes en évidence sacrifier l’un après l’autre toute dignité morale et tout esprit de consistance. Il résulte de là que toute foi se perd dans la population, et qu’elle cède au plus irrémédiable des dissolvants, le scepticisme.
C’est pourquoi je voudrais que la solution du problème social, telle que la donne l’économie politique la plus sévère, c’est-à-dire le self-government, eût un organe spécial. Il faut soumettre cette idée au public : que l’État garantisse à chacun sa sécurité et qu’il ne se mêle pas d’autre chose. Une publication mensuelle qui aurait ce but et se distriburait, comme celles de L. Blanc et Lamartine, à six francs par an pourrait être un tirailleur utile auprès du Journal des économistes. Nous en causerons bientôt, car je compte partir de Bordeaux le 28, si j’ai place au courrier…
[VII-384]
Mugron, 3 juin 1850.
Mon cher ami,
Pourquoi avez-vous renfermé dans des limites si étroites l’excellente lettre que vous avez envoyée au dernier numéro du Journal des économistes ? En ce qui concerne les faits et les causes, elle est pleine de sagacité et décèle une expérience des affaires dont on nous reproche souvent, et avec quelque raison, de manquer. De tels articles satisfont toujours les lecteurs, et avancent les principes sans en parler. Vous devriez développer la pensée que vous ne faites qu’indiquer à la fin de votre lettre. Oui, par l’absence de spéculation, les céréales sont à un prix plus bas qu’elles ne devraient être, et il est infaillible qu’elles ne dépassent bientôt le taux normal. C’est la loi générale de l’action et de la réaction. La spéculation aurait rapproché les deux extrêmes d’une moyenne. Bien plus, elle aurait abaissé la moyenne elle-même, car elle aurait prévenu des gaspillages et des exportations imprudentes. Un travail de vous sur ce sujet serait fort utile tant au point de vue pratique qu’au point de vue scientifique. Sous ce dernier rapport, il dissiperait le funeste préjugé contre les intermédiaires et l’accaparement. Mettez-vous donc à l’œuvre.
Quoique je m’occupe peu de politique, j’ai pu me convaincre, avec douleur, que nos grands hommes d’État n’ont que trop bien réussi dans la première partie de leur plan de campagne qui est de semer l’alarme pour l’exploiter. Partout où j’ai passé, j’ai vu régner une terreur vraiment maladive. Il semble que la loi agraire nous menace. On croit Paris sur un volcan. On va jusqu’à invoquer la lutte [VII-385] immédiate ou l’invasion étrangère, non par des sentiments pervers, mais par peur de pis. On maudit la République, les républicains et même les résignés ; on blesse les classes inférieures par un luxe d’épithètes outrageantes. Bref, il me semble qu’on oublie tout, même la prudence. Dieu veuille que ce paroxysme passe vite ! où nous mènerait-il ?…
References
[1] La chaire de M. Michel Chevalier avait été supprimée et n’était pas encore rétablie. (Note de l’éditeur.)
À M. DOMENGER À MUGRON.↩
Paris, le 4 mars 1848.
Mon cher Domenger,
Vous avez bien raison de conserver votre calme. Outre que nous en aurons tous besoin, il faudrait que la tempête fût bien furieuse pour qu’elle se fît ressentir à Mugron. Jusqu’ici Paris jouit de la tranquillité la plus parfaite, et ce spectacle est, à mes yeux, bien autrement imposant que celui du courage dans la lutte. Nous venons d’assister à la cérémonie funèbre. Il me semble que tout l’univers était sur les boulevards. Je n’ai jamais vu tant de monde. Je dois dire que la population m’a paru sympathique mais froide. On ne peut lui arracher des cris d’enthousiasme. Cela vaut peut-être mieux, et semble prouver que le temps et l’expérience nous ont mûris. Les manifestations emportées ne sont-elles pas plutôt un obstacle à la bonne direction des affaires ?
Le côté politique de l’avenir occupe peu les esprits. Il semble que le suffrage universel et les autres droits populaires sont tellement dans le consentement unanime qu’on n’y pense pas. Mais ce qui assombrit notre perspective, ce sont les questions économiques. À cet égard l’ignorance est si profonde et si générale que l’on a à redouter de rudes [VII-386] expériences. L’idée qu’il y a une combinaison encore inconnue, mais facile à trouver, qui doit assurer le bien-être de tous en diminuant le travail, voilà ce qui domine. Comme elle est décorée des beaux noms de fraternité, de générosité, etc., personne n’ose attaquer ces folles illusions. D’ailleurs, on ne le saurait pas. On a bien instinctivement la crainte des conséquences que peuvent entraîner les espérances exagérées de la classe laborieuse ; mais de là à être en état de formuler la vérité, il y a bien loin. Pour moi, je persiste à penser que le sort des ouvriers dépend de la rapidité avec laquelle le capital se forme. Tout ce qui, directement ou indirectement, porte atteinte à la propriété, ébranle la confiance, nuit à la sécurité, est un obstacle à la formation du capital et retombe sur la classe ouvrière. Il en est de même de toutes taxes, entraves et vexations gouvernementales. Que faut-il donc penser des systèmes en vogue aujourd’hui, qui ont tous ces inconvénients à la fois ? Comme écrivain, ou dans une autre situation, si mes concitoyens m’y appellent, je défendrai jusqu’au dernier moment mes principes. La révolution actuelle n’y change rien, non plus qu’à ma ligne de conduite.
Ne parlons plus du propos attribué à F…. C’est bien loin derrière nous. Franchement, ce système factice ne pouvait se soutenir. J’espère qu’on sera satisfait des choix faits dans notre département. Lefranc est un brave et honnête républicain, incapable de tourmenter qui que ce soit, à moins de graves et justes motifs.
3 septembre 1848.
Demain nous commençons à discuter la Constitution. Mais, quoiqu’on en dise, cette œuvre portera toujours au [VII-387] cœur un chancre dévorant, puisqu’elle sera discutée sous le régime de l’état de siége et en l’absence de la liberté de la presse. Quant à nous représentants, nous nous sentons parfaitement libres, mais cela ne suffit pas. Les partis exploiteront ce qu’il y a d’anormal dans notre situation pour miner et décréditer la constitution. Aussi j’ai voté hier contre l’état de siége. Je crois que Cavaignac fait la faute vulgaire et bien naturelle de sacrifier l’avenir au présent. Tout disposé que je suis à prêter de la force à ce gouvernement honnête et bien intentionné que nous avons érigé, je ne puis aller jusque-là. Me voilà donc votant encore avec la république rouge, mais ce n’est pas ma faute. Il ne faut pas regarder avec qui, mais pourquoi l’on vote.
Je présume qu’un nouvel effort sera tenté en faveur de la liberté de la presse. Je m’y associerai, avant tout je veux que la constitution soit respectée. S’il y a à Paris des ferments de désordre tels qu’on ne puisse maintenir l’empire des lois, eh bien, j’aime mieux que la lutte recommence, et que le pays apprenne à se défendre lui-même.
Il n’est bruit que de conspirations légitimistes. Je ne puis pas y croire. Quoi ! les légitimistes, impuissants en 89, espéreraient être forts en 1848 ! Ah ! Dieu les préserve de réveiller le lion révolutionnaire ! Si vous avez occasion de les voir, dites-leur bien qu’il ne faut pas qu’ils se fassent illusion. Ils ont contre eux tous les ouvriers, tous les socialistes, tous les républicains, tout le peuple, avec des chefs capables de pousser les choses jusqu’à la dernière extrémité. Que le clergé surtout soit circonspect. Les hommes à principes qui, comme moi, ont foi dans la puissance de la vérité, ne demandent que la libre discussion et acceptent d’avance le triomphe de l’opinion, quand même (sauf à la faire changer), ces hommes sont en petit nombre. Ceux qui acceptent la lutte ailleurs, sur le champ du combat, sont innombrables, décidés à pousser les choses jusqu’au bout. Que les [VII-388] légitimistes et le clergé ne donnent pas le signal de l’action ; ils seraient écrasés. Le légitimisme sait bien que son principe a fait son temps, et quant au clergé, s’il n’est pas tout à fait aveugle, il ne peut ignorer son côté vulnérable. Qu’une certaine irritation populaire provenant de la crise industrielle et des embarras financiers ne leur inspire pas de dangereuses et folles espérances, à moins qu’ils ne veuillent une bonne fois jouer leur va tout.
Employez votre influence à préserver notre cher département des suites d’une lutte affreuse. À Dieu ne plaise que je veuille priver qui que ce soit du droit d’exprimer et de faire valoir ses idées ! Mais qu’on évite avec soin tout ce qui pourrait ressembler à la conspiration.
18 janvier 1849.
Nous sommes à peu près tous d’accord ici sur la nécessité de nous dissoudre. Cependant un très grand nombre (et sans la crainte des élections ce serait la totalité) ne voudraient pas céder à une pression violente et factice. Beaucoup craignent aussi pour l’existence même de la République. S’il n’y avait qu’un prétendant, ce serait l’affaire d’une révolution (dont Dieu nous préserve) ; mais comme il y en a plusieurs, c’est une question de guerre civile. Il est bien permis d’hésiter.
3 février 1849.
Je vais m’occuper de la ferme du Peyrat et du canal. C’est pourquoi je remets à une autre fois de vous en parler.
[VII-389]
Le mauvais état de ma santé coïncide avec le coup de feu du travail. Tenant ou croyant tenir une pensée financière, je l’ai exposée à mon bureau. Elle a fait fortune, puisqu’il m’a nommé de la commission du Budget à la presque unanimité. Devant cette commission je voulais renouveler l’épreuve mais sous prétexte de gagner du temps, elle a interdit la discussion générale. Il a donc fallu aborder d’emblée les détails, ce qui interdit à toute vue d’ensemble de se produire. Que dites-vous d’un tel procédé en face d’une situation financière désespérée et qui ne peut être sauvée que par une grande pensée, s’il s’en présente ? Alors j’ai cru devoir en appeler à l’Assemblée et au public par une brochure dont je me suis occupé hier et ce matin.
Je ne me dissimule pas que tout cela ne peut guère aboutir. Les grandes assemblées n’ont pas d’initiative. Les vues y sont trop diverses, et rien de bien ne se fait si le cabinet est inerte. Or le nôtre est systématiquement inerte : je crois sincèrement que c’est une calamité publique. Le ministère actuel pouvait faire du bien. J’y compte plusieurs amis, et je sais qu’ils sont capables. Malheureusement, il est arrivé au pouvoir avec l’idée préconçue qu’il n’aurait pas le concours de l’Assemblée et qu’il fallait manœuvrer pour la renvoyer. J’ai la certitude absolue qu’il s’est trompé ; et, en tout cas, n’était-ce pas son devoir d’essayer ? S’il était venu dire à la chambre :
« L’élection du 10 décembre clôt la période révolutionnaire ; maintenant occupons-nous de concert du bien du peuple et de réformes administratives et financières, » la chambre l’aurait suivi avec passion, car elle a la passion du bien et n’a besoin que d’être guidée. Au lieu de cela, le ministère a commencé par bouder. Il a conjecturé le désaccord, en se fondant sur ce que l’assemblée s’était montrée sympathique à Cavaignac. Mais il y a une chose que l’Assemblée met mille fois au-dessus de Cavaignac, c’est la volonté du peuple, manifestée par le suffrage [VII-390] universel. Pour montrer sa parfaite soumission, elle eût prodigué son concours au chef du pouvoir exécutif. Que de bien pouvait en résulter ! Au lieu de cela le ministère s’est renfermé dans l’inertie et la taquinerie. Il ne propose rien ou ne propose que l’inacceptable. Sa tactique est de prolonger la stagnation des affaires par l’inertie, bien certain que la nation s’en prendra à l’Assemblée. Le pays a perdu une magnifique occasion de marcher, et il ne la trouvera plus, car je crains bien que d’autres orages n’attendent la prochaine assemblée.
Lettre sans date.
Mon malencontreux rhume m’ôtant la possibilité de me servir de la tribune, j’ai quelquefois recours à la plume. Je vous envoie deux brochures. L’une n’a guère d’intérêt pour la province. Elle est intitulée Capital et rente. Mon but est de combattre un préjugé qui a fait de grands ravages parmi les ouvriers et même parmi les jeunes gens des écoles. Ce préjugé consiste à penser que l’intérêt d’un capital est un vol. J’ai donc cherché à exposer la nature intime et la raison d’être de l’intérêt. J’aurais pu rendre cette brochure piquante, le sujet y prêtait. J’ai cru devoir m’en abstenir pour ne pas irriter ceux que je voulais convaincre. Il en est résulté que je suis tombé dans la pesanteur et la monotonie. Si jamais je fais une seconde édition, je refondrai tout cela.
L’autre brochure est un projet de budget, ou plutôt la pensée fondamentale qui, selon moi, doit présider à la réforme graduelle de notre système financier. Elle se ressent de la rapidité de l’exécution. Il y a des longueurs, des omissions, etc. Quoi qu’il en soit, l’idée dominante y est assez en relief.
[VII-391]
Je ne me suis pas borné à écrire ces idées, je les ai exposées dans les bureaux et devant la commission du Budget dont je fais partie. Ce qui me semble de la prudence la plus vulgaire, y passe pour de la témérité insensée. D’ailleurs, le ministère étant résolu à demeurer dans l’inertie, il est impossible que la commission fasse rien de bon. Une réunion nombreuse d’hommes, privés des ressources que fournit l’administration, ne peut poursuivre un plan systématique. Les projets s’y heurtent. Les idées générales sont repoussées comme perte de temps, et l’on finit par ne s’occuper que des détails. Notre Budget de 1849 sera un fiasco. Je crois que l’histoire en rejettera la responsabilité sur le cabinet.
Les élections approchent : j’ignore ce que l’Assemblée décidera relativement aux congés. Pourrai-je aller vous voir ? Je le désire sous plusieurs rapports. D’abord pour respirer l’air du pays et serrer la main à mes amis ; ensuite pour combattre quelques préventions qui ont pu s’attacher à ma conduite parlementaire ; enfin, pour dire aux électeurs dans quel esprit il me semble qu’ils doivent faire leurs choix. Selon moi, ils ne sauraient mieux faire que de rester fidèles à l’esprit qui les dirigea en avril 1848. Ils ne croient pas avoir fait une bonne assemblée. J’affirme le contraire. Elle s’est un peu altérée par les élections partielles qui nous ont envoyé d’un côté plusieurs révolutionnaires, de l’autre beaucoup d’intrigants. Dieu préserve mon pays de recourir ainsi aux extrêmes exagérations des deux partis ! Il en résulterait un choc violent. Sans doute le pays ne peut nommer que d’après ses impressions et ses opinions actuelles. S’il est réactionnaire, il nommera des réactionnaires. Mais qu’il choisisse au moins des hommes nouveaux. S’il envoie d’anciens députés, au cœur plein de rancunes, rompus aux intrigues parlementaires, décidés à tout renverser, à tendre des piéges aux institutions nouvelles, à faire saillir le plus tôt possible les défauts qui peuvent entacher notre [VII-392] Constitution, tout est perdu ! Nous en avons bien la preuve. Notre Constitution met en présence deux pouvoirs égaux sans moyen de résoudre les conflits possibles. C’est un grand vice. Et qu’est-il arrivé ? Au lieu d’attendre au moins que ce vice se révélât et que le temps amenât le conflit, le ministère s’est hâté de le faire surgir sans nécessité. — C’est la pensée d’un homme qui a hâte de faire sortir des faits la critique de nos institutions. Et pourquoi cet homme a-t-il agi ainsi ? Est-ce nécessité ? Non. Mais il est un de ceux que la révolution a cruellement froissés, et, sans s’en rendre compte, il prend plaisir à se venger aux dépens du pays.
Quant à mon sort personnel, j’ignore ce qu’il sera. Le pays pourra me reprocher d’avoir peu travaillé ! En vérité, ma santé a été un obstacle invincible. Elle a paralysé mes forces physiques et morales. J’ai ainsi trompé l’attente de mes amis. Mais est-ce ma faute ? Quoi qu’il en soit, si le mandat m’est retiré, je reprendrai, sans trop d’amertume, mes chères habitudes solitaires. Adieu.
Sans date.
Votre lettre m’arrive accolée à celle de M. Dup… M. le ministre du commerce m’avait d’abord fait des promesses. Plus tard j’ai su que Duv… insistait avec l’acharnement que vous lui connaissez. Hier soir, je me suis rendu chez Buffet, emmenant avec moi Turpin. Comme celui-ci a assisté au Conseil général, il pouvait attester ce qui s’y est passé, et il l’a fait en termes très formels. Nous y avons rencontré Dampierre, qui nous a aidés. Malgré tout cela, j’ai vu que le ministre était mal à l’aise ; il faut que les obsessions de [VII-393] Duv… lui fassent peur. Il nous a dit : Si je refuse à Duv… sa ferme, il en mourra.
J’avais déjà écrit à Buffet une lettre très motivée, j’en vais faire une autre que je terminerai ainsi : La France désire la décentralisation administrative. Si M. le ministre, quand il s’agit de savoir où sera établie une ferme, croit pouvoir dédaigner les vœux de tous les organes réguliers du département pour ne faire que sa propre volonté, il peut certes supprimer l’institution des Conseils généraux, ils ne sont qu’une mystification.
Je vous prie, mon cher D., de vouloir m’excuser auprès de M. Dup., si je ne lui réponds pas aujourd’hui. Je le ferai quand je saurai quelque chose. Vous voyez combien la loi des clubs agite Paris. Le ministre a été bien imprudent de soulever cette question. Mais sa malheureuse tactique est de déconsidérer l’Assemblée ; et je crois qu’il voulait se faire refuser la loi pour jeter sur elle toute la responsabilité de l’avenir.
Jamais vote ne m’a plus coûté que celui que j’ai émis hier. Vous savez que j’ai été toujours pour la liberté sauf la répression des abus. J’avoue qu’en face des clubs ce principe m’a paru devoir fléchir. Quand je considère la frayeur qu’ils inspirent à tous les gens tranquilles, les souvenirs qu’ils réveillent, etc., etc., je me dis que ceux qui aiment sincèrement la République devraient comprendre qu’il faut la faire aimer. C’est la compromettre que de vouloir imposer forcément au pays une institution ou même une liberté qui l’épouvante. — J’ai donc voté pour la suppression des clubs.
En agissant ainsi je ne me suis pas dissimulé les inconvénients personnels d’une telle conduite. Pour réussir en politique, il faut s’attacher à un parti, et si l’on peut, au parti le plus fort. — Voter consciencieusement tantôt avec la droite, tantôt avec la gauche, c’est s’exposer à être abandonné de tous deux. — Mais avant d’arriver ici j’avais pris [VII-394] la résolution de ne consulter jamais que mon jugement et ma conscience et de ne pas émettre un vote de parti. Cela se rattache à la proposition que j’ai faite. Ces majorités et minorités systématiques sont la mort du gouvernement représentatif.
Je crois que notre gouvernement fera de grands efforts pour éviter la guerre. Autrefois on aurait pu craindre qu’il ne fût entraîné par les sympathies populaires en faveur de l’Italie ; mais les choses sont bien changées. Les désordres de la Péninsule ont calmé ces sympathies. Il est probable que Ch. Albert sera battu, sans qu’on ait le temps de délibérer sur l’opportunité de ce qu’il y a à faire. Mais une fois les Autrichiens à Turin, tout ne sera pas fini, il s’en faut. Je ne sais même si ce n’est pas alors que les difficultés sérieuses commenceront. Oh ! comme les hommes ont de la peine à s’entendre, quand ce serait si facile !
25 mars 1849.
La dernière fois que je vous ai écrit, je l’ai fait fort à la hâte et ai oublié, je crois, de vous parler élections. Le moment approche, et puisque vous êtes déterminé à me placer sur votre liste, je vous serai bien obligé de me faire savoir de temps en temps ce qui se dit et ce qui se fait. Je me doute qu’il y a dans le pays beaucoup de préventions contre moi, et qu’elles sont entretenues, peut-être envenimées par les aspirants ou quelqu’un d’entre eux. Je sens combien une explication avec mes commettants serait utile, et cependant je ne puis quitter l’Assemblée nationale qu’au moment où elle prononcera sa dissolution. C’est pourquoi j’enverrai bientôt un compte rendu.
[VII-395]
Je me doute que j’aurai peu d’appui là où il me serait le plus nécessaire, c’est-à-dire à Saint-Sever. S’il s’opère un arrangement entre les trois arrondissements, et que chacun présente deux candidats, je ne serai sans doute pas sur la liste de Saint-Sever ; et alors même que les deux autres arrondissements en auraient quelques regrets, ces regrets n’iront pas jusqu’à rompre la transaction. Je serai donc, comme on dit, entre trois selles etc.
Ayant la conscience que j’ai fait mon devoir, l’échec pourra m’être sensible au premier moment. Je m’en consolerai bientôt, je l’espère. Je ne manque pas d’autres travaux à faire, en dehors de la législature.
Mais, au point de vue politique, je regarderai comme un grand malheur que les élections donnent un résultat fort différent de celles de 1848. Si on voulait y réfléchir avec quelque impartialité, on reconnaîtrait que l’Assemblée a rempli sa mission, qu’elle a surmonté les plus grandes difficultés matérielles et morales, qu’elle a fini par ramener l’ordre dans les faits et le calme dans les esprits, que les utopies les plus dangereuses sont venues se briser devant elle, quoiqu’elle-même, à l’origine, fût fort imbue de chimériques espérances. Cette assemblée est dans la bonne voie. Elle aurait accompli en finances, si elle en eût eu le temps, tout ce qu’il est possible de faire. Est-ce le moment de la chasser, de la remplacer par d’autres hommes, imbus d’un autre esprit, le cœur plein de rancune ? Je puis vous dire que le ministère est fort inquiet de l’avenir à cet égard. Ne cesserons-nous jamais de courir les aventures ? Il me semble donc que ce qu’il y aurait de mieux à faire, ce serait de persévérer dans l’esprit électoral de 1848, sauf à éliminer les hommes, en petit nombre, qui se sont montrés, à droite et à gauche, animés d’un mauvais esprit de turbulence.
Dans notre département on ne peut guère adresser ce reproche aux représentants. Un seul a produit, de bonne [VII-396] foi sans doute, un système dangereux, l’impôt progressif, l’accaparement par l’État de plusieurs industries privées. Maintenir la République honnête, telle a été la devise de la députation. La question devrait donc se poser ainsi : renverra-t-on les mêmes représentants, ou fera-t-on de nouveaux choix dans de nouvelles vues ?
Ce sera, l’expérience me le prouve, une chose bien petite que la lutte des arrondissements, si elle éclate. Je puis vous assurer que l’arrondissement de Saint-Sever est celui qui me donne le moins d’affaires. Je ne me rappelle pas d’avoir reçu une seule lettre des chefs-lieux, de Hagermau, d’Amon, de Geaune, d’Aire. Mugron même m’en a envoyé seulement trois pour des choses qui ne sont pas incompatibles avec le mandat de député. Dax et le Saint-Esprit m’en ont fourni davantage. Au total, je suis édifié de voir combien l’esprit de sollicitation s’est épuisé.
8 avril 1849.
Vos lettres me sont toujours précieuses, c’est une consolation pour moi de penser que des amis impartiaux et éclairés ne se laissent pas entamer par les préventions dont je suis l’objet.
J’ai en effet parlé de nouveau à Buffet. Je lui ai lâché l’argument le plus propre à faire effet. Je lui ai dit : Si, quand il s’agit d’une question de pure localité, de savoir où une ferme modèle peut rendre le plus de services, le vœu unanime de trente conseillers généraux est mis de côté, ne nous parlez plus de décentralisation. — Il m’a répondu : Je suis décidé, dans les questions semblables, à céder aux vœux du pays. — Malgré cela sa résolution n’est pas prise, il [VII-397] redoute notre persévérant et obstiné adversaire. On m’assure que celui-ci se répand contre moi en invectives. C’est un libéral d’une singulière espèce.
J’ai reçu une lettre de M. Dup… Il me demande d’adresser une note au Ministre. Je lui ai déjà adressé un mémoire. Comptez que nous ne négligerons rien pour faire triompher la note du Conseil général.
Mon ami, je voudrais vous parler élections et politique. Mais, en vérité, il y a tant à dire que je n’ose l’entreprendre. Le besoin d’ordre, de sécurité, de confiance, est ce qui domine dans le pays. C’est bien naturel. Mais je suis convaincu qu’il égare en ce moment les populations sur les rapports du ministère et de l’Assemblée. Je voudrais bien pouvoir aller dans le département pour rectifier de funestes malentendus. L’Assemblée devrait se dissoudre et permettre ainsi aux représentants d’aller s’expliquer, non dans leur intérêt, mais dans un intérêt d’avenir. Car il importe que les élections ne s’accomplissent pas sous l’influence de fausses préoccupations.
Les ministres actuels sont honnêtes, bien intentionnés, et décidés à maintenir l’ordre. Ce sont mes amis personnels, et je crois qu’ils comprennent la vraie liberté. Malheureusement ils sont entrés au pouvoir avec l’idée préconçue que l’Assemblée qui s’était montrée pour Cavaignac, devait nécessairement faire de l’opposition à Bonaparte. En mon âme et conscience, c’était une fausse appréciation ; et elle a eu les conséquences les plus funestes. Les ministres n’ont plus songé qu’à renvoyer l’Assemblée et, pour cela, qu’à la déconsidérer. Ils affectent de ne faire aucun cas de ses votes, même quand elle réclame l’exécution des lois. Ils s’abstiennent de toute initiative. Ils nous laissent la bride sur le cou. Ils assistent aux délibérations comme les étrangers des tribunes. Se sentant soutenus par le vent de l’opinion, ils animent la lutte, parce qu’ils pensent qu’elle tournera à leur [VII-398] avantage aux yeux du pays. Ils l’habituent ainsi à placer fort bas le premier pouvoir de tout gouvernement représentatif. Ils font plus, ils présentent des lois inadmissibles pour en provoquer le rejet. C’est ce qui arrive pour les Clubs. Vous me dites que mon vote sur cette loi m’a réconcilié quelque peu avec les électeurs. Eh bien ! je dois vous annoncer que ce vote est le seul que j’aie sur la conscience, car il est contraire à tous mes principes ; et si j’avais eu quelques minutes de réflexion calme, je ne l’aurais certes pas émis. Ce qui me détermina, c’est ceci. Je disais à mes voisins : Si nous voulons que la République se maintienne, il faut la faire aimer, il ne faut pas la rendre redoutable. Le pays a peur des clubs, il en a horreur ; sachons les sacrifier. — La suite de la loi a prouvé qu’il eût mieux valu adhérer aux principes, accorder tous les moyens de répression possibles, mais ne pas supprimer la liberté. Cette loi ne fait autre chose qu’organiser les sociétés secrètes.
Depuis j’ai voté trois fois, et toujours à regret, contre le Ministère. On m’en voudra dans le pays, et cependant ces votes sont consciencieux.
1o Affaire d’Italie. — Comme la montagne, j’ai repoussé l’ordre du jour qui pousse à une invasion dans le Piémont, mais par un motif opposé. La Montagne ne trouvait pas cet ordre du jour assez belliqueux ; je le trouvais trop. Vous savez que je suis contre l’intervention : cela explique mon vote. D’ailleurs, je n’approuve pas la diplomatie faite en parlement. On prend des engagements téméraires qui embarrassent plus tard. Je préférais l’ordre du jour pur et simple pour lequel j’ai voté.
2o L’affaire des préfets. — Si le Ministère eût fait un aveu franc, j’aurais passé par dessus. Mais il a voulu soutenir que quarante préfets s’étaient trouvés infirmes le même jour. Ce sont de ces subtilités qui révoltent le sens commun.
3o L’affaire Changarnier. — Même raison. Si le Ministère [VII-399] eût demandé la prolongation d’un état de choses contraire aux lois en se fondant sur les nécessités de l’ordre, on eût accordé. Mais il vient dire : Nous demandons l’arbitraire, et l’Assemblée nationale n’est pas juge du temps que cet arbitraire doit durer ! Le plus grand despote du monde ne peut pas demander autre chose. Je ne pouvais acquiescer.
Quant aux élections, elles seront ce que le bon Dieu voudra. Si je dois succomber, j’en ai pris mon parti d’avance ; car j’ai bien des travaux à faire en dehors du Parlement. J’ai un ouvrage dans la tête dont je crains de ne pouvoir accoucher. Si les électeurs me font des loisirs, je m’en consolerai en travaillant à ce livre, qui est ma chimère. Je désire seulement qu’ils ne me remplacent pas d’une manière trop indigne. Il est tel nom qui, mis à ma place, ne ferait pas honneur au département.
29 avril 1849.
J’ai bien tardé de répondre à votre lettre du 14, que voulez-vous ? La nature m’a pétri de bizarrerie ; et il semble que je deviens plus inerte au moment où j’aurais besoin de plus d’activité. Ainsi depuis qu’il est question d’élections, je me suis mis en tête un travail de pure théorie qui m’attache, m’absorbe et me prend tous les moments dont je puis disposer.
Les nouvelles fort rares qui me parviennent ne me laissent guère de doutes sur le résultat du vote en ce qui me concerne ; j’ai perdu la confiance du pays. Je me l’explique : mon tort, et ce n’en est un qu’au point de vue personnel, a été de voir les deux exagérations opposées et de ne m’associer à aucune. Mon ami, elles nous conduisent à [VII-400] la guerre civile, à la guerre du pauvre contre le riche. Le pauvre demande plus que ce qui est juste ; le riche ne veut pas accorder même ce qui est juste. Voilà le danger. On a repoussé l’impôt progressif avec la richesse, et l’on a eu raison ; mais on maintient l’impôt progressif avec la misère, et par là on fournit de bons arguments au peuple. Personne ne sait mieux que moi combien il fait de réclamations absurdes, mais je sais aussi qu’il a des griefs fondés. La simple prudence, à défaut d’équité, me traçait donc la conduite à suivre. Combattre les exigences chimériques du peuple, faire droit à ses requêtes fondées. Mais, hélas ! la notion de justice est faussée dans l’esprit des pauvres, et le sentiment de justice est éteint dans le cœur du riche. J’ai donc dû m’aliéner les deux classes. Il ne me reste qu’à me résigner.
Puissé-je être un faux prophète ! Avant février, je disais [1] :
« Une résistance toujours croissante dans le Ministère, un mouvement toujours plus actif dans l’opposition, cela ne peut finir que par un déchirement. Cherchons le point où est la justice, il nous sauvera. »
Je ne me suis pas trompé. Les deux partis ont persisté, et la révolution s’est faite.
Aujourd’hui je dis : Le pauvre demande trop, le riche n’accorde pas assez, cherchons la justice ; c’est là qu’est la conciliation et la sécurité ! — Mais les partis persistent, et nous aurons la guerre sociale.
Nous l’aurons, je le crains bien, dans des conditions fâcheuses, car plus on refuse au peuple ce qui est équitable, plus ou donne de force morale et matérielle à sa cause. Aussi elle fait des progrès effrayants. Ces progrès sont masqués par une réaction momentanée et déterminée par le besoin général de sécurité ; mais ils sont réels. L’explosion sera retardée, mais elle éclatera.
J’en étais là de ma lettre, quand j’en ai reçu une de nos [VII-401] amis de Mugron. Je vous ai quitté pour leur répondre, et naturellement, j’ai répété ce qui précède ; car je ne puis dire que ce dont mon cœur est plein. On me presse d’aller au pays, mais qu’y ferais-je ? Est-on disposé à former de grandes réunions ? Sans cela comment pourrais-je entrer en relation avec un si grand nombre d’électeurs ?
Je reçois, 30 avril, votre lettre du 27. Je vais aller tout à l’heure à l’Assemblée, et je verrai si je puis, sans inconvénient, obtenir un congé. Je répugnerais beaucoup à le demander au moment où l’on va discuter le budget de la guerre. J’ai concouru à le préparer, et je serai peut-être appelé à le défendre.
Tout le monde veut l’économie en général. Mais tout le monde combat chaque économie en particulier.
Sans date.
Mon élection, que j’appris il y a deux jours, va me donner plus d’affaires après qu’avant : car, si j’ai pu la négliger un peu, je ne dois pas au moins oublier d’exprimer à mes amis toute ma reconnaissance, non pas du service qu’ils m’ont rendu, mais de l’attachement et de la confiance qu’ils m’ont témoignés. Vous êtes en première ligne, et je suis profondément touché du zèle que vous y avez mis, d’autant que cela a dû beaucoup vous coûter. Je sais que vous répugnez à cette agitation électorale et que depuis longtemps vous aspirez à n’y prendre qu’une part toute personnelle. D’un autre côté, vous avez dû vous mettre en opposition avec beaucoup de vos amis. Croyez que toutes ces circonstances me font d’autant plus apprécier votre dévouement.
Quelle sera la destinée de la nouvelle assemblée ? On fonde [VII-402] sur elle de grandes espérances. Dieu veuille que ce ne soient pas de grandes illusions. Elle ne sera certainement pas mieux intentionnée que celle qui vient de mourir. Mais que font les intentions ? Je pense comme la Presse ; la meilleure assemblée ne vaut rien que pour empêcher le mal. Pour faire le bien, il faut l’initiative d’un pouvoir plus concentré ; nous en avons la preuve depuis cinq mois. Le ministère a borné son rôle à susciter et soutenir un conflit, et la chambre avec ses bonnes intentions n’a pu rien faire.
Ce qui rend l’avenir redoutable, c’est l’ignorance. La classe pauvre s’enrégimente et marche comme un seul homme à une guerre insensée, sans se douter qu’elle se suicide elle-même, car quand elle aura détruit le capital et le mobile même qui le forme, quel sera son sort ?
Au fond, il ne devrait y avoir entre les deux classes qu’une question d’impôts. Arriver à l’impôt proportionnel, c’est tout ce que la justice exige ; au delà il n’y a qu’injustice, oppression et malheur pour tous. Mais comment le faire comprendre à des hommes qui s’en prennent au principe même de la propriété ?
Je vous dirai que j’ai dans la tête une pensée qui m’absorbe, me détourne de mes devoirs et me fait négliger mes amis. C’est une explication nouvelle de ces deux mots : Propriété, Communauté. Je crois pouvoir démontrer de la manière la plus évidente que l’ordre naturel des sociétés fonde, sur la propriété même, la plus belle, la plus large et la plus progressive communauté. Cela vous paraîtra paradoxal, mais j’ai dans l’esprit certitude complète. Il me tarde de pouvoir jeter cette pensée dans le public, car il me semble qu’elle réconciliera les hommes sincères de toutes les écoles. Elle ne ramènera pas sans doute les chefs de sectes. Mais elle empêchera la jeunesse des écoles d’aller s’enrôler sous les drapeaux du communisme. Suis-je sous l’empire d’une illusion ? — C’est possible, mais le fait est [VII-403] que je sèche du désir de publier mon idée. Je crains toujours de n’avoir pas le temps, et lorsque le choléra décimait l’Assemblée, je disais à Dieu : Ne me retirez pas de ce monde avant que je n’aie accompli ma mission.
Mardi, 13.(Été de 1849.)
Vous me demandez de vous donner des nouvelles. Savez-vous que je pourrais en demander ? Depuis quelques jours je me suis fait ermite, et ce qui m’arrive tient du rêve. J’étais fatigué, indisposé ; bref je me décidai à demander un congé, et je le passe au pavillon du Butard. Qu’est-ce que le Butard ? Le voici :
Connaissez-vous la contrée qui s’étend de Versailles à Saint-Germain, embrassant Bougival, La Celle-Saint-Cloud, Vaucresson, Marly, etc. ? C’est le pays le plus délicieux, le plus accidenté et certes le plus boisé, après les forêts d’Amérique, qu’il y ait au monde. C’est pourquoi Louis XIV, n’ayant pas assez de vue à Versailles, fit bâtir le château de Marly ; aussitôt les Montespan, Maintenon et plus tard Dubarry, firent construire les délicieuses villas de Luciennes, Malmaison, Lajonchère, Beauregard, etc.
Aujourd’hui tout cela est habité par des personnes de ma connaissance. Vers le centre, au milieu d’une forêt épaisse, isolé comme un nid d’aigle, s’élève le pavillon du Butard, que le Roi avait placé au point convergent de mille avenues comme rendez-vous de chasse. Il tire son nom de sa position élevée.
Or, un réactionnaire, qui a su que depuis longtemps je désirais goûter de ce pittoresque et sauvage séjour, et que je méditais quelque chose sur la Propriété, m’a laissé [VII-404] camper dans son Butard, qu’il a loué de l’État avec les chasses environnantes. Me voici donc tout seul, et je me plais tellement à cette vie qu’à l’expiration de mon congé, je me propose d’aller à la chambre et de revenir ici tous les jours. Je lis, je me promène, je joue de la basse, j’écris, et le soir j’enfile une des avenues, qui me conduit chez un ami. C’est ainsi que j’ai appris hier la mort de Bugeaud. C’est un homme à regretter. Sa franchise militaire inspirait la confiance ; et il est telle situation donnée (fort possible) où il nous aurait été bien utile.
Je suis venu à Paris. J’y trouve les affaires dans un bien triste état. La stupide audace de ********* passe toute croyance… Ces hommes s’amusent à fouler aux pieds toutes les règles du gouvernement représentatif, Constitution, Lois, Décrets ; ils ne s’aperçoivent pas qu’ils rendent impossible même cette monarchie qu’ils rêvent ! En outre, ils se jouent de l’honneur, de la parole et même de la sécurité de la France ; ils compromettent son propre principe, et noient la justice dans le sang. C’est plus que du délire.
Dans de telles circonstances, je vais être forcé de quitter mon Butard, ou, du moins, de passer une partie des journées sur les grands chemins. Je devrai aussi interrompre l’ouvrage que j’avais commencé à ébaucher, et que j’étais décidé à faire paraître même à l’état informe.
13 novembre 1849.
La Haute-Cour de Versailles vient de prononcer son verdict. On ne le connaît pas encore dans tous ses détails, on sait seulement que onze prévenus, dont un représentant, ont été acquittés. Tous les autres représentants sont [VII-405] condamnés à la déportation, ainsi que Guinard. Je n’ai pas assez suivi les débats pour avoir une opinion. Je m’incline devant la justice et regrette seulement que la défense ait été circonscrite dans ses moyens. C’est toujours un fâcheux précédent. — L’autorité de la cause jugée n’y gagne pas.
Vous avez sans doute appris mon rapide voyage en Angleterre. Parti le lundi soir après la séance, j’étais de retour le samedi matin ; et pendant quatre jours je n’ai vu que grandes choses et grands hommes, du moins selon mon jugement.
En arrivant, j’ai reçu une sorte de cartel fort courtois des socialistes. Il s’agit de discuter à fond devant le public ouvrier, et contre Proudhon, la question de savoir si l’intérêt des capitaux est légitime : question plus difficile et plus dangereuse que celle de la propriété, en ce qu’elle est plus générale. J’ai cru pouvoir faire quelque bien en acceptant la lutte.
À ce propos, je vous dirai, mon cher Domenger, que les électeurs landais pourront bien se lasser de mon inaction apparente. Il est vrai que j’ai le travail capricieux ; il faut me prendre avec mes défauts. Mais je crois sincèrement que le danger actuel n’est ni au pouvoir ni à l’Assemblée ; il est dans les égarements de l’opinion populaire. C’est aussi de ce côté que je porte mes faibles efforts. Je souhaite que le bon sens de nos compatriotes leur fasse comprendre que chacun a sa mission en ce monde et que je remplis la mienne.
25 décembre 1849.
Je ne puis vous écrire que quelques mots, car mon rhume m’a mis sur le flanc. Je vous assure qu’il me rend l’existence pénible.
[VII-406]
L’affaire de l’hospice est de celles pour lesquelles je me décide à aller m’égarer dans le labyrinthe des bureaux. Hier je me suis assuré que l’approbation de l’échange ne rencontrerait aucune difficulté, et le décret qui l’autorise a été rédigé sous mes yeux. Mais il ne peut être porté à l’Élysée pour la signature que sur l’avis du Conseil d’État. Un de mes amis m’a promis de faire expédier cette affaire le plus tôt possible.
Quant à la subvention, vous aurez quelque chose, mais non 1 000 francs. Le fonds à ce destiné n’est que de 300 000 francs pour toute la France, et les besoins sont illimités, de telle sorte que chaque année dévore d’avance l’allocation de l’année suivante : — je persiste à croire qu’il vaudrait mieux que le gouvernement ne se mêlât pas de cela, puisque aussi bien il met une foule d’employés en mouvement pour aboutir à une mystification.
Et n’est-ce pas une chose bien ridicule que Mugron et M. Lafaurie ne puissent échanger leurs maisons sans l’avis du Conseil d’État et la permission du prisonnier de Ham ? Vraiment la France se crée des embarras et des entraves pour avoir le plaisir d’en faire les frais.
Il m’est impossible de vous envoyer ma polémique avec Proudhon, car je n’ai pas conservé les numéros de la Voix du Peuple où sont nos lettres ; mais on m’assure qu’elles vont être recueillies en un volume que je vous ferai adresser. C’est du reste assez ennuyeux.
18 février 1850.
L’avenir politique est toujours bien sombre. Aux griefs réels se mêlent malheureusement beaucoup de passions et de soupçons factices : c’est toujours ainsi en révolution. Moi [VII-407] qui vois des hommes de tous les partis, je puis pour ainsi dire mesurer ce qu’il y a de faux dans leurs accusations réciproques. Mais la haine, fondée ou non, produit les mêmes effets. Je crois que la majorité comprend que ce qu’il y a de plus prudent c’est de rester en république. Son tort est de ne pas en prendre assez résolûment son parti. À quoi bon dénigrer et menacer sans cesse ce qu’on ne veut pas changer ? De son côté, la minorité cherche à ressaisir le pouvoir par des moyens qui lui en rendraient le fardeau bien lourd. Elle excite des espérances qu’elle ne pourrait satisfaire.
Cependant je ne désespère pas, la discussion éclairant bien des questions. Le tout est de gagner du temps.
Paris, le 22 mars 1850.
J’ai lieu de croire que le décret qui autorise l’échange d’immeubles de l’hospice de Mugron arrivera à la préfecture des Landes le jour où cette lettre vous parviendra. Je me suis assuré que le Président de la République l’a signé ; que le secrétariat du ministère de l’Intérieur en a fait donner l’ampliation, et que le bureau des hospices se tient prêt. — Le reste vous regarde.
Il y a déjà deux ou trois jours que j’ai donné l’ordre à mon éditeur de vous expédier trois exemplaires de ma discussion avec Proudhon, et trois de mon discours sur l’enseignement, dégénéré en brochure ; car mon rhume est devenu extinction de voix. — Ce n’est certes pas que je veuille vous faire avaler trois fois ces élucubrations ; mais je vous prie de donner de ma part un exemplaire de chaque à Félix et à Justin.
Les journaux me dispensent de vous parler politique. Je crois que l’aveuglement réactionnaire est dans ce moment [VII-408] notre plus grand danger : on nous mène à une catastrophe. Quel moment choisit-on pour faire de telles expériences ? Celui où le peuple paraît se discipliner et renoncer aux moyens illégaux. Le grand parti dit de l’ordre a rencontré cent trente mille adversaires aux élections et n’y a mené que cent vingt-cinq mille adhérents. Quel va être le résultat des lois proposées ? Ce sera de faire passer immédiatement quarante ou cinquante mille individus de droite à gauche, de donner ainsi à la gauche plus de force et le sentiment du droit, et de concentrer cette force sur un moins grand nombre de journaux, ce qui revient à lui communiquer plus d’homogénéité, de suite et de stratégie : cela me semble de la folie. Je l’avais prévu du jour où Bordeaux nous envoya les Thiers et les Molé, c’est dire des ennemis de la République. Aujourd’hui nous sommes comme à la veille de 1830 et de 1848 : même pente, même char et mêmes cochers. Mais alors l’esprit pouvait saisir le contenu d’une révolution ; aujourd’hui qui peut dire ce qui succédera à la République ?
Pise, le 8 octobre 1850.
Qui nous aurait dit, la dernière fois que j’eus le plaisir de vous voir, que ma première lettre serait datée d’Italie ? J’y suis venu par les prescriptions formelles de la faculté. Je ne doute pas en effet, s’il est encore temps que ma gorge soit modifiée par quelque chose, que ce ne soit par l’air pur et chaud de Pise. Malheureusement, ce n’est qu’un côté de la question. Le plus beau climat du monde n’empêche pas que lorsqu’on ne peut parler, ni écrire, ni lire, ni travailler, il ne soit bien triste d’être seul dans un pays étranger. Cela me fait regretter Mugron, et je crois que j’aimerais [VII-409] mieux grelotter en Chalosse que de me réchauffer en Toscane. J’éprouve ici toute espèce de déceptions. Par exemple, il me serait facile d’avoir des relations avec tous les hommes distingués de ce pays-ci. La raison en est que, l’économie politique entrant dans l’étude du droit, cette science est cultivée par presque tous les hommes instruits. En voulez-vous une preuve singulière ? à Turin, quoiqu’on y parle principalement italien, il s’est vendu plus de mes Harmonies (édition française [2] ) qu’à Marseille, Bordeaux, Lyon, Rouen, Lille réunis, et il en est de même de tous les ouvrages économiques. Vous voyez, mon cher, dans quelle illusion nous vivons en France, quand nous croyons être à la tête de la civilisation intellectuelle. — Ainsi, je me trouvais avoir accès auprès de toutes les notabilités et personnages, j’étais parfaitement placé pour étudier ce pays à fond. — Eh bien, ma préoccupation constante est de ne voir personne, d’éviter les connaissances. Bien plus, des amis intimes vont m’arriver de Paris ; ils visiteront Florence et Rome en vrais connaisseurs, car ils apprécient les arts et y sont fort initiés. Quelle bonne fortune en toute autre circonstance ou avec une tout autre maladie ! Mais le mutisme est un abîme qui isole, et je serai forcé de les fuir. Oh ! je vous assure que j’apprends bien la patience.
Parlons des dames X… J’ai toujours remarqué que la dévotion habituelle ne changeait rien à la manière d’agir des hommes, et je doute beaucoup qu’il y ait plus de probité, plus de douceur, plus de respects et d’égards les uns pour les autres, parmi nos très-dévotes populations du Midi, que parmi les populations indifférentes du Nord. De jeunes et aimables personnes assisteront tous les jours au sacrifice sanglant de leur Rédempteur, et lui promettront beaucoup [VII-410] plus que la simple équité ; tous les soirs elles pareront de fleurs les autels de Marie ; elles répéteront à chaque instant : Préservez-nous du mal, ne nous laissez pas succomber ; le bien d’autrui tu ne prendras ni retiendras, etc., etc. — Et puis, que l’occasion se présente, elles prendront le plus possible dans l’héritage paternel aux dépens de leurs frères, juste comme feraient des mécréants. Pourquoi pas ? n’en est-on pas quitte avec un acte de contrition et un autre de ferme propos ? On fait de bonnes œuvres, on donne un liard aux pauvres, moyennant quoi on a l’absolution. Et alors qu’a-t-on à craindre ? qu’a-t-on à se reprocher, puisqu’on a réussi à se donner le ministre de Dieu et Dieu lui-même pour complices ?
Il me semble que Mme D… avait quelque idée de faire la semaine sainte à Rome. Si ce projet se réalisait, je ferais peut-être mes dévotions auprès d’elle : sa présence et par conséquent la vôtre me seraient bien agréables, du moins si je puis articuler quelques mots. Autrement, à ne considérer que moi, j’aime autant que vous restiez où vous êtes, car vous savoir près de moi et être réduit à vous éviter serait un supplice de plus.
Rome, le … novembre 1850 [3] .
Je suis bien heureux d’être venu à Rome où j’ai trouvé des soins et quelques ressources, je ne sais comment je m’en serais tiré à Pise. La gorge est devenue si douloureuse que [VII-411] c’est pour moi une grande affaire que de manger et de boire. Il faut qu’on me fasse des préparations spéciales, et sous ce rapport mes amis m’ont été bien utiles. — Je ne puis vous dire si je suis mieux. D’un jour à l’autre je n’aperçois pas de changement ; mais si je me compare à moi-même de mois en mois, je ne puis m’empêcher de reconnaître un affaiblissement progressif assez prononcé. Puissé-je, mon cher D…, avoir la force, au mois de février, de regagner Mugron ! On a beau célébrer les vertus du climat, il ne remplace pas le chez soi. D’ailleurs j’envisage ma maladie dans les deux hypothèses de la guérison et de la grande conclusion. Si je dois succomber, je voudrais être couché dans le dortoir où dorment mes amis et mes parents. Je voudrais que nos amis du cercle m’accompagnassent à cette dernière demeure et que ce fût notre excellent curé de Mugron qui prononçât pour moi ce vœu sublime : Lux perpetua luceat ei ! etc., etc. — Aussi, si je le puis, je me propose de profiter des beaux jours de février pour aller à Marseille, où Justin pourra me venir chercher.
Si jamais je rentre au gîte, ce sera pour moi un grand crève-cœur d’avoir passé plusieurs mois à Rome et de n’y avoir rien vu. Je n’ai visité que Saint-Pierre, à cause de l’immuabilité de sa température. Je me borne à aller tous les jours m’exposer au soleil sur le mont Pincio, où je ne puis rester longtemps, puisqu’il n’y a pas de bancs. Je n’aurai donc vu Rome qu’à vol d’oiseau. Malgré cela, quelques connaissances vous arrivent toujours par la lecture, la conversation, l’atmosphère. Ce qui me frappe le plus, c’est la solidité de la tradition chrétienne et l’abondance des témoignages irrécusables.
Mon ami, le récent dénouement politique me fait bien plaisir, puisqu’il donne du répit à notre France. Il me semble justifier complétement ma ligne de conduite. Lors des premières élections je promis d’essayer loyalement la République [VII-412] honnête, et je suis sûr que c’était le vœu général. Par un motif ou par un autre, prêtres, nobles, plébéiens s’accordaient là-dessus, quoique avec des espérances diverses. Légitimistes et Orléanistes s’effacèrent complétement en tant que tels. Mais qu’est-il arrivé ? dès qu’ils l’ont pu ils se sont mis à décrier, fausser, calomnier, embarrasser la République au profit du légitimisme, de l’orléanisme, du bonapartisme. Tout cela échoue. Et maintenant ils font ce qu’ils avaient promis de faire, ce que j’ai fait et ce dont ils se sont écartés pendant deux ans. Ils ont agité la France inutilement.
J’ai eu très grand tort, je l’avoue, de vous parler comme je l’ai fait des dames X… j’étais sous l’empire de cette idée que la dévotion, quand elle se charge de pratiques minutieuses, oublie la vraie morale, et j’en avais sous les yeux de frappants exemples. Mais il est certain que cela n’avait rien de commun avec ces dames.
References
[1] Ceci nous donne la date de la profession de foi en forme de lettre à MM. Tonnelier, Degon, Bergeron etc. Fin du tome Ier. (Note de l’édit.)
[2] Deux mois plus tard, je rencontrai, à Livourne, la contrefaçon belge qui s’y vendait fort bien.(Note de l’éditeur.)
[3] Ici la date précise importe, à cause des appréciations politiques qui suivent, et Bastiat a laissé le quantième en blanc ; mais la suscription offre très net le timbre de la Sardaigne du 1er décembre, d’où il suit que la lettre fut probablement écrite et jetée à la poste à Rome le 28 novembre. (Note de l’éditeur.)
À M. GEORGE WILSON, PRÉSIDENT DE L’ANTI-CORN LAWS LEAGUE [1] ↩
Paris, 15 janvier 1849.
Monsieur,
Veuillez exprimer à votre Comité toute ma reconnaissance pour l’invitation flatteuse que vous m’adressez en son nom. [VII-413] Il m’eût été bien doux de m’y rendre : car, monsieur, je le dis hautement, il ne s’est rien accompli de plus grand dans le monde, à mon avis, que cette réforme que vous vous apprêtez à célébrer. J’éprouve l’admiration la plus profonde pour les hommes que j’eusse rencontrés à ce banquet, pour les George Wilson, les Villiers, les Bright, les Cobden, les Thompson et tant d’autres qui ont réalisé le triomphe de la liberté commerciale, ou plutôt, donné à cette grande cause une première et décisive impulsion. Je ne sais ce que j’admire le plus de la grandeur du but que vous avez poursuivi ou de la moralité des moyens que vous avez mis en œuvre. Mon esprit hésite quand il compare le bien direct que vous avez fait au bien indirect que vous avez préparé ; quand il cherche à apprécier, d’un côté, la réforme même que vous avez opérée, et, de l’autre, l’art de poursuivre légalement et pacifiquement toutes les réformes, art précieux dont vous avez donné la théorie et le modèle.
Autant que qui que ce soit au monde, j’apprécie les bienfaits de la liberté commerciale, et cependant je ne puis borner à ce point de vue les espérances que l’humanité doit fonder sur le triomphe de votre agitation.
Vous n’avez pu démontrer le droit d’échanger sans discuter et consolider, chemin faisant, le droit de propriété. Et peut-être l’Angleterre doit-elle à votre propagande de n’être pas, à l’heure qu’il est, infestée, comme le continent, de ces fausses doctrines communistes qui ne sont, ainsi que le
[VII-414] protectionisme, que des négations, sous formes diverses, du droit de propriété.
Vous n’avez pu démontrer le droit d’échanger, sans éclairer d’une vive lumière les légitimes attributions du gouvernement et les limites naturelles de la loi. Or une fois ces attributions comprises, ces limites fixées, les gouvernés n’attendront plus des gouvernements prospérité, bien-être, bonheur absolu, mais justice égale pour tous. Dès lors les gouvernements, circonscrits dans leur action simple, ne comprimant plus les énergies individuelles, ne dissipant plus la richesse publique à mesure qu’elle se forme, seront eux-mêmes dégagés de l’immense responsabilité que les espérances chimériques des peuples font peser sur eux. On ne les culbutera pas à chaque déception inévitable, et la principale cause des révolutions violentes sera détruite.
Vous n’avez pu démontrer, au point de vue économique, la doctrine du libre échange, sans ruiner à jamais dans les esprits ce triste et funeste aphorisme : Le bien de l’un c’est le dommage de l’autre. Tant que cette odieuse maxime a été la foi du monde, il y avait incompatibilité radicale entre la prospérité simultanée et la paix des nations. Prouver l’harmonie des intérêts, c’était donc préparer la voie à l’universelle fraternité.
Dans ses aspects plus immédiatement pratiques, je suis convaincu que votre réforme commerciale n’est que le premier chaînon d’une longue série de réformes plus précieuses encore. Peut-elle manquer, par exemple, de faire sortir la Grande-Bretagne de cette situation violente, anormale, antipathique aux autres peuples, et par conséquent pleine de dangers, où le régime protecteur l’avait entraînée ? L’idée d’accaparer les consommateurs vous avait conduits à poursuivre la domination sur tout le globe. Eh bien ! je ne puis plus douter que votre système colonial ne soit sur le point de subir la plus heureuse transformation. Je n’oserai [VII-415] prédire, bien que ce soit ma pensée, que vous serez amenés, par la loi de votre intérêt, à vous séparer volontairement de vos colonies ; mais alors même que vous les retiendriez, elles s’ouvriront au commerce du monde, et ne pourront plus être raisonnablement un objet de jalousie et de convoitise pour personne.
Dès lors que deviendra ce célèbre argument en cercle vicieux : « Il faut une marine pour avoir des colonies, il faut des colonies pour avoir une marine. » Le peuple anglais se fatiguera de payer seul les frais de ses nombreuses possessions dans lesquelles il n’aura pas plus de priviléges qu’il n’en a aux États-Unis. Vous diminuerez vos armées et vos flottes ; car il serait absurde, après avoir anéanti le danger, de retenir les précautions onéreuses que ce danger seul pouvait justifier. Il y a encore là un double et solide gage pour la paix du monde.
Je m’arrête : ma lettre prendrait des proportions inconvenantes, si je voulais y signaler tous les fruits dont le libre échange est le germe.
Convaincu de la fécondité de cette grande cause, j’aurais voulu y travailler activement dans mon pays. Nulle part les intelligences ne sont plus vives ; nulle part les cœurs ne sont plus embrasés de l’amour de la justice universelle, du bien absolu, de la perfection idéale. La France se fût passionnée pour la grandeur, la moralité, la simplicité, la vérité du libre-échange. Il ne s’agissait que de vaincre un préjugé purement économique, d’établir pour ainsi dire un compte commercial, et de prouver que l’échange, loin de nuire au travail national, s’étend toujours tant qu’il fait du bien, et s’arrête, par sa nature, en vertu de sa propre loi, quand il commencerait à faire du mal : d’où il suit qu’il n’a pas besoin d’obstacles artificiels et législatifs. L’occasion était belle, au milieu du choc des doctrines qui se sont heurtées dans ce pays, pour y élever le drapeau de la liberté. Il eût [VII-416] certainement rallié à lui toutes les espérances et toutes les convictions. C’est dans ce moment qu’il a plu à la Providence, dont je ne bénis pas moins les décrets, de me retirer ce qu’elle m’avait accordé de force et de santé. Ce sera donc à un autre d’accomplir l’œuvre que j’avais rêvée ; et puisse-t-il se lever bientôt !
C’est ce motif de santé, ainsi que mes devoirs parlementaires, qui me forcent de m’abstenir de paraître à la démocratique solennité à laquelle vous me conviez. Je le regrette profondément, c’eût été un bel épisode de ma vie et un précieux souvenir pour le reste de mes jours. Veuillez faire agréer mes excuses au Comité, et permettez-moi, en terminant, de m’associer de cœur à votre fête par ce toast :
À la liberté commerciale des peuples ! à la libre circulation des hommes, des choses et des idées ! au libre échange universel et à toutes ses conséquences économiques, politiques et morales !
Je suis, Monsieur, votre très-dévoué.
References
[↑] Voici le texte de l’invitation à laquelle Bastiat répond : (Note de l’éditeur.)
BANQUET TO CELEBRATE THE FINAL REPEAL OF THE CORN LAWS.
Newall’s Buildings, Manchester, January 9, 1849.
My dear Sir,
The Act for the Repeal of our Corn Laws will corne into operation on the 1st February next, and it has been resolved to celebrate the event by a banquet in the Free Trade Hall in this City, on the 31st January.
The prominent part you have taken in your own country, in the adversary of the principles of Commercial Freedom, and the warm sympathy you have always manifested in our movement, has induced the Committee to direct me respectfully to invite you to be present as a Guest.
In conveying this invitation, permit me to hope that you may be able to make it convenient to make one among us at our festival.
Believe me, dear Sir,
Your faithful and obedient servant,
George Wilson, Chairman.
À M. LE COMTE ARRIVABENE [1] .↩
Paris, 21 décembre 1848.
Mon cher Monsieur,
Le doute que vous m’exprimez est bien naturel. Il est possible que, forçant un peu les termes, je sois allé au delà de ma pensée. Les mots : par anticipation insérés dans le [VII-417] passage que vous rapportez vous annoncent que j’ai l’intention de traiter la question à fond. Dans un prochain article je parlerai de l’échange, ensuite j’exposerai ce que j’ai la hardiesse d’appeler ma théorie de la valeur. Je vous prie de vouloir bien suspendre jusqu’alors votre jugement. Vous ne devez pas douter qu’après cela j’accueillerai vos observations avec reconnaissance, car elles me mettront à même ou de mieux expliquer ou de rectifier, selon l’occasion.
Vous reconnaîtrez, j’espère, que ce qui paraît nous diviser n’est pas très sérieux. Je crois que la valeur est dans les services échangés et non dans les choses. Matériaux et forces matérielles sont fournis gratuitement par la nature, et passent gratuitement de main en main. Mais je ne dis pas que deux travaux, considérés comme égaux en intensité et durée, soient également rémunérés. Celui qui est placé de manière à rendre un service plus précieux à cause des matériaux ou des forces dont il dispose, se fait mieux rétribuer ; son travail est plus intelligent, plus heureux si vous voulez, mais la valeur est dans ce travail et non dans les choses. La preuve en est que le même phénomène se montre, alors même qu’aucun objet matériel ne se présente pour nous faire illusion et paraître revêtir la valeur. Ainsi, si j’éprouve le désir d’entendre la plus belle voix du monde, si je suis disposé pour cela à faire de grands sacrifices, je m’adresserai à Jenny Lind. Comme elle est la seule au monde qui puisse me rendre ce service, elle y mettra le prix qu’elle voudra. Son travail sera plus rétribué qu’un autre, il aura plus de valeur ; mais cette valeur est dans le service.
Je crois qu’il en est de même quand un objet matériel intervient ; et si nous lui attribuons la valeur, c’est par pure métonymie. Prenons un de vos exemples. Un homme écrase son blé entre deux pierres. Plus tard il profite de ce qu’il est placé sur une hauteur visitée par les vents et établit un moulin. Je réclame de lui le service de moudre mon blé. [VII-418] Beaucoup d’autres personnes en font autant, et comme il dispose d’une grande force, il peut rendre beaucoup de services semblables. Il est fortement rétribué. Qu’est-ce que cela prouve ? que son intelligence est récompensée, que son travail est heureux, mais non que la valeur soit dans le vent. La nature ne reçoit jamais aucune rétribution ; je ne la donne qu’à un homme, et je ne la lui donne que parce qu’il me rend un service. Ce service, je l’apprécie par ce qu’il m’en coûterait pour me le rendre à moi-même ou pour le réclamer à d’autres. Donc la valeur est dans l’appréciation comparée des divers services échangés.
Cela est si vrai que, si la concurrence s’en mêle, le meunier baissera son prix ; son service plus offert aura moins de valeur, quoique l’action du vent reste la même et conserve toute son utilité. C’est moi, consommateur, qui profiterai gratuitement de cette baisse. Ce n’est pas l’utilité du vent qui a changé, c’est la valeur du service.
Vous voyez qu’au fond c’est une dispute de mots. Qu’importe, me direz-vous, que la valeur soit dans une force naturelle ou dans le service que me rend, par l’intermédiaire de cette force, celui qui s’en est emparé ? le résultat est le même pour moi.
Je ne puis dire ici les conséquences, selon moi très-importantes, qui découlent de cette distinction. Je crois sincèrement que si je parviens à faire prévaloir ma thèse, j’aurai brisé tous les arguments socialistes, communistes, etc. tout comme j’aurai redressé beaucoup d’erreurs échappées aux économistes relativement à la propriété, à la rente, au crédit, etc. C’est peut-être une illusion d’auteur, mais j’avoue qu’elle s’est emparée de tout mon être, et je regrette de n’avoir que quelques instants à consacrer à cette étude.
Veuillez recevoir, mon cher Monsieur, l’assurance de mon respectueux attachement.
[VII-419]
Pise, le 28 octobre 1850.
J’ai été profondément touché, mon cher Monsieur, de la marque si spontanée et si délicate d’intérêt que vous me donnez en m’envoyant une lettre d’introduction auprès de madame Primi. Vous avez bien deviné ce qui va à ma position et surtout à mon caractère, et je vous avoue que non seulement la Toscane, mais encore le Paradis lui-même auraient pour moi peu de charmes si je n’y rencontrais un cœur sympathique. Jugez donc avec quel empressement j’aurais fait la connaissance de madame Primi. Malheureusement elle est en villégiature ; et je crains bien de n’avoir plus l’occasion de lui rendre mes devoirs, car je me dispose à transporter mes pénates à Rome pour cet hiver. C’est justement le besoin de quelques relations affectueuses qui me détermine. À Rome je trouverai un de mes parents, excellent prêtre, et le beau-frère de M. Say avec sa famille. Ne pouvant aller en société et, ce qui est bien pire, ne pouvant travailler, je n’aurais en face de moi qu’un isolement forcé, désœuvré, insupportable, si quelques amis ne voulaient bien me supporter, moi et mes misères.
Tout ce que vous me dites de madame Primi et de sa sœur me fait vivement regretter de manquer cette occasion de faire leur connaissance. Si je suis mieux au printemps, il est probable que je traverserai de nouveau la Toscane en revenant en France : car on ne peut guère, quand on a fait tant que de venir ici, se dispenser d’étudier un pays aussi curieux par ses institutions et son histoire. En ce cas, je me dédommagerai de la privation que mon départ subit m’impose aujourd’hui.
Je me suis rappelé qu’à notre dernière entrevue à Paris, vous m’aviez parlé de M. Gioberti. Je suis allé le voir et je [VII-420] lui dois d’excellentes recommandations pour lesquelles ma reconnaissance remonte jusqu’à vous.
Adieu, mon cher Monsieur, votre dévoué.
References
[1] La lettre de M. le comte Arrivabene, à laquelle Bastiat répond, était relative à un passage du chapitre III des Harmonies, publié en décembre 1848 dans le Journal des Économistes. Ce passage se trouve pages 73 et 74 du tome VI. (Note de l’éditeur.)
À MADAME SCHWABE.↩
17 janvier 1848.
Madame,
J’apprends avec bien du plaisir que M. Schwabe a fait un heureux voyage et qu’il a trouvé la situation de l’Angleterre en voie d’amélioration.
Je vous remercie d’avoir songé à m’envoyer le Punch. J’y trouverai peut-être quelque chose pour le Libre-Échange, après quoi je le ferai passer à M. Anisson, ou vous le reporterai moi-même.
Voici cinq numéros du dernier Libre-Échange. J’ai fait le premier article sur les armements, dans l’espoir qu’il peut exercer quelque influence en Angleterre. Il m’est donc bien agréable d’apprendre que vous vous chargez de l’y faire parvenir.
27 janvier 1848.
Je vous prie d’agréer l’hommage d’un petit volume que je viens de faire paraître. C’est bien peu de chose ; il ne contient que la reproduction de quelques plaisanteries déjà publiées dans les journaux. On m’assure que cette forme [VII-421] superficielle a son genre d’utilité. C’est ce qui m’a décidé à persister dans cette voie qui n’est nullement de mon goût [1] .
16 février 1848.
Je suis bien reconnaissant de toutes les bontés dont vous m’accablez. J’ai reçu vos excellents sirops qui achèveront ma guérison. J’espère aussi aller ce soir au concert, mais un peu tard, car je dîne chez M. de Lamartine, et vous comprenez qu’il en coûte de quitter la musique de sa parole même pour celle de Chopin. Cependant, comme le concert commence tard, je m’arracherai au charme de la conversation de notre grand poëte.
Paris, 17 mai 1848.
Vous devez me trouver bien peu Français de tarder autant à vous remercier, ainsi que votre mari, de tant de témoignages d’affection que vous m’avez prodigués tous les deux pendant votre séjour à Paris. Ce n’est certainement pas que je les oublie, le souvenir ne s’en effacera jamais de mon cœur ; mais vous savez que je suis allé dans mes chères Pyrénées. D’un autre côté, je ne savais où adresser mes lettres ; celle-ci va suivre l’impulsion du hasard.
L’Assemblée nationale est réunie. Que sortira-t-il de cette fournaise ardente ? la paix ou la guerre ? le bonheur ou le [VII-422] malheur de l’humanité ? Jusqu’à présent elle est comme un enfant qui bégaye avant de parler. Figurez-vous une enceinte vaste comme la place de la Concorde. Là, neuf cents membres délibérants et trois mille spectateurs. Pour avoir la chance de se faire entendre et comprendre, il faut pousser des cris aigus accompagnés de gestes télégraphiques, ce qui ne tarde pas à déterminer, chez l’orateur, une explosion de colère sans motif. Voilà comment nous procédons à notre organisation intérieure. Cela absorbe beaucoup de temps, et le public n’a pas le bon sens de comprendre que cette perte de temps est inévitable.
Les journaux vous ont appris les événements du 15. L’Assemblée a été envahie par les masses populaires. Une manifestation en faveur de la Pologne a été le prétexte. Pendant quatre heures, elles ont essayé de nous arracher les votes les plus subversifs. L’Assemblée a supporté cette tempête avec calme, et, pour rendre justice à notre population et à notre siècle, je dois dire que nous n’avons pas à nous plaindre de violence personnelle. Cet attentat a eu pour résultat de faire connaître les vœux du pays tout entier. Il permet au pouvoir exécutif de prendre des mesures de prudence auxquelles il ne pouvait avoir recours en l’absence de toute provocation. Il est fort heureux que les choses aient été poussées aussi loin. Sans cela les projets des factieux n’auraient jamais été bien constatés. Leur hypocrisie leur faisait des partisans. Ils n’en ont plus ; ils se sont démasqués ; encore une fois le doigt de la Providence s’est montré. Il y avait dix mille chances pour que les choses ne tournassent pas aussi bien.
Je présume que vous voyez madame Cobden. Je vous prie de lui exprimer les sentiments d’admiration que j’ai conçus pour elle, d’après tout ce que vous m’en avez dit.
Adieu, Madame, ne me donnerez-vous pas quelque espoir que nous nous reverrons encore ? Vos enfants ne savent pas [VII-423] assez de français, et l’une d’entre elles est citoyenne et républicaine [2] . Il faudra bien lui faire respirer l’air de la patrie.
Je serre bien affectueusement la main à M. Schwabe.
À M. SCHWABE.↩
Paris, 1er juillet 1848.
Mon cher Monsieur,
Je vous remercie de l’intérêt affectueux qui vous a fait penser à moi, à l’occasion des terribles événements qui ont affligé cette capitale. Grâce au ciel, la cause de l’ordre et de la civilisation l’a emporté. Nos excellents amis MM. Say et Anisson étaient à la campagne, l’un à Versailles, l’autre en Normandie. Leurs fils ont pris part à la lutte et en sont sortis avec honneur, mais sans blessure.
Ce sont les fausses idées socialistes qui ont mis les armes à la main à nos frères. Il faut dire aussi que la misère y a beaucoup contribué ; mais cette misère elle-même peut être attribuée à la même cause, car depuis qu’on a voulu faire de la fraternité une prescription légale, les capitaux n’osent plus se montrer.
Voici un moment bien favorable pour prêcher la vérité. Pendant tous ces jours de troubles, il m’est arrivé de parcourir les rangs de la garde nationale, essayant de montrer que chacun devait demander à sa propre énergie les moyens d’existence et n’attendre de l’État que justice et sécurité. Je [VII-424] vous assure que cette doctrine a été pour la première fois bien accueillie, et quelques amis m’ont facilité les moyens de la développer en public, ce que je commencerai lundi.
Vous me demanderez peut-être pourquoi je ne remplis pas cette mission au sein de l’Assemblée nationale, dont la tribune est si retentissante. C’est que l’enceinte est si vaste et l’auditoire si impatient que toute démonstration y est impossible.
C’est bien malheureux, car je ne crois pas qu’il y ait jamais eu, en aucun pays, une assemblée mieux intentionnée, plus démocratique, plus sincère amie du bien, plus dévouée. Elle fait honneur au suffrage universel, mais il faut avouer qu’elle partage les préjugés dominants.
Si vous jetez un coup d’œil sur la carte de Paris, vous vous convaincrez que l’insurrection a été plus forte que vous ne paraissez le croire. Quand elle a éclaté, Paris n’avait pas plus de huit mille hommes de troupes, qu’en bonne tactique il fallait concentrer, puisque c’était insuffisant pour opérer. Aussi l’émeute s’est bientôt rendue maîtresse de tous les faubourgs, et il ne s’en est pas fallu de deux heures qu’elle n’envahît notre rue. D’un autre côté elle attaquait l’Hôtel de ville, et, par le Gros-Caillou, menaçait l’Assemblée nationale, au point que nous avons été réduits, nous aussi, à la ressource des barricades. Mais, au bout de deux jours, les renforts nous sont arrivés de province.
Vous me demandez si cette insurrection sera la dernière. J’ose l’espérer. Nous avons maintenant de la fermeté et de l’unité dans le pouvoir. La chambre est animée d’un esprit d’ordre et de justice, mais non de vengeance. Aujourd’hui notre plus grand ennemi, c’est la misère, le manque de travail. Si le gouvernement rétablit la sécurité, les affaires reprendront, et ce sera notre salut.
Vous ne devez pas douter, mon cher Monsieur, de l’empressement avec lequel je me rendrais à votre bonne [VII-425] invitation et à celle de madame Schwabe, si je le pouvais. Quinze jours passés auprès de vous, à causer, promener, faire de la musique, caresser vos beaux enfants, ce serait pour moi le bonheur. Mais, selon toute apparence, je serai obligé de me le refuser. Je crains bien que notre session ne dure longtemps. Soyez sûr, du moins, que si je puis m’échapper, je n’y manquerai pas.
Douvres, 7 octobre 1848.
Je ne veux pas quitter le sol d’Angleterre, mon cher Monsieur, sans vous exprimer le sentiment de reconnaissance que j’emporte, et aussi sans vous demander un peu pardon pour tous les embarras que vous a occasionnés mon séjour auprès de vous. Vous serez peut-être surpris de voir la date de cette lettre. Pendant que je cherchais M. Faulkner à Folkestone, le bateau à vapeur m’a fait l’impolitesse de prendre le large, me laissant sur le quai, indécis si je sauterais à bord. Il y a vingt ans je l’aurais essayé. Mais je me suis contenté de le regarder, et ayant appris qu’un autre steamer part ce soir de Douvres, je suis venu ici, et je ne regrette pas l’accident, car Douvres vaut bien la peine de rester un jour de plus en Angleterre. C’est même ce que je ferais, si je n’étais dépourvu de tous mes effets. Enfin j’ai pu faire votre commission à M. Faulkner tout à mon aise.
…Les deux jours que j’ai passés avec M. Cobden ont été bien agréables. Son impopularité momentanée n’a pas altéré la gaieté et l’égalité de son humeur. Il dit, et je crois avec raison, qu’il est plus près du désarmement aujourd’hui qu’il n’était près du free-trade quand il fonda la ligue. C’est un grand homme ; et je le reconnais à ceci : que son intérêt, sa [VII-426] réputation, sa gloire ne sont jamais mis par lui en balance avec l’intérêt de la justice et de l’humanité.
Veuillez, etc.
Paris, 25 octobre 1848.
Je vous remercie de vos offres obligeantes. On ne quitte jamais d’aussi bons amis sans projeter de les revoir. Il serait trop cruel de ne pas nourrir cette espérance. Mais hélas ! elle n’est souvent qu’une illusion, car la vie est bien courte et Manchester est bien loin. Peut-être me sera-t-il donné de vous faire les honneurs de mes chères Pyrénées. Je rêve souvent que votre famille, celle de Cobden, celle de Say et moi, nous nous trouverons un jour tous réunis dans une de mes fraîches vallées. Ce sont là des plans que les hommes exécuteraient certainement s’ils savaient vivre.
Paris continue à être tranquille. Les boulevards sont gais et brillants, les spectacles attirent la foule, le caractère français se montre dans toute sa légère insouciance. Ceci vaut encore cent fois mieux que Londres, et pour peu que les révolutions d’Allemagne continuent, je ne désespère pas de voir notre Paris devenir l’asile de ceux qui fuiront les tempêtes politiques. Que nous manque-t-il pour être la plus heureuse des nations ? Un grain de bon sens. Il semble que c’est bien peu de chose.
Je conçois que le choléra vous effraye, vous qui êtes entouré d’une aussi aimable et nombreuse famille. Plus nous sommes heureux par nos affections, plus aussi nous courons de dangers. Celui qui est seul n’est vulnérable que par le point le moins sensible, qui est lui-même. Heureusement [VII-427] que ce redoutable fléau semble tout confus de son impuissance, comme un tigre sans dents et sans griffes. Je me réjouis, à cause de mes amis de l’autre côté du détroit, de voir par les journaux que le choléra n’a de redoutable que le nom, et qu’au fait, il fait moins de ravage que le rhume de cerveau.
Adieu, etc.
À MADAME SCHWABE.↩
14 novembre 1848.
Madame,
Si ma pensée, guidée par le souvenir d’une bonne et cordiale hospitalité, prend souvent la direction de Crumpsall-house et de Manchester, elle y a été portée avec plus de force encore hier au soir : car on jouait la Sonnambula aux Italiens, et je n’ai pu m’empêcher de violer l’ordonnance des médecins pour aller revoir cette pièce. Chaque morceau, chaque motif me transportait en Angleterre ; et soit attendrissement soit faiblesse de constitution, je sentais toujours mes yeux prêts à déborder. Qui pourrait expliquer ce qu’il y a d’intime dans la musique ! Pendant que j’entendais le duo si touchant et le beau finale du premier acte, il me semblait que plusieurs mois s’étaient anéantis, et que, les deux représentations se confondant ensemble, je n’éprouvais qu’une même sensation. Cependant, je dois le dire, sans vouloir critiquer vos chanteurs, la pièce est infiniment mieux exécutée ici, et si votre premier ténor égale le nôtre, il est certain que madame Persiani surpasse infiniment votre prima donna. — Et puis cette langue italienne a été inventée et faite exprès [VII-428] pour la musique. Quand j’ai entendu, dans le récitatif, madame Persiani s’écrier : Sono innocente, je n’ai pu m’empêcher de me rappeler le singulier effet que produit cette traduction rhythmée de la même manière : I am not guilty. — Que voulez-vous ? La langue des affaires, de la mer et de l’économie politique ne peut pas être celle de la musique.
28 décembre 1848.
Je reconnais votre bonté et celle de M. Schwabe à l’insistance que vous mettez à m’attirer une seconde fois sous le toit hospitalier de Crumpsall-house. Croyez que je n’ai pas besoin d’autres excitations que celles de mon cœur, alors même que vous ne m’offririez pas en perspective le bonheur de serrer la main à Cobden et d’entendre la grande artiste Jenny Lind. Mais vraiment Manchester est trop loin. Ceci n’est peut-être pas très galant pour un Français ; mais à mon âge on peut bien parler raison. Acceptez au moins l’expression de ma vive reconnaissance.
Est-ce que mademoiselle Jenny Lind a conçu de la haine pour ma chère patrie ? D’après ce que vous me dites, son cœur doit être étranger à ce vilain sentiment. Oh ! qu’elle vienne donc à Paris ! Elle y sera environnée d’hommages et d’enthousiasme. Qu’elle vienne jeter un rayon de joie sur cette ville désolée, si passionnée pour tout ce qui est généreux et beau ! Je suis sûr que Jenny Lind nous fera oublier nos discordes civiles. Si j’osais dire toute ma pensée, j’entrevois pour elle la plus belle palme à cueillir. Elle pourrait arranger les choses de manière à rapporter, sinon beaucoup d’argent, au moins le plus doux souvenir de sa vie. Ne paraître à Paris que dans deux concerts et choisir [VII-429] elle-même les bienfaits à répandre. Quelle pure gloire et quelle noble manière de se venger, s’il est vrai, comme on le dit, qu’elle y a été méconnue ! Voyez, bonne madame Schwabe, à prendre la grande cantatrice par cette corde du cœur. Je réponds du succès sur ma tête.
Nous touchons à une nouvelle année. Je fais des vœux pour qu’elle répande la joie et la prospérité sur vous et sur tout ce qui vous entoure.
11 mars 1849.
Je suis en effet d’une négligence horrible ; horrible, c’est le mot, car elle approche de l’ingratitude. Comment pourrais-je l’excuser, après toutes les bontés dont j’ai été comblé à Crumpsall-house ?
Mais il est certain que mes occupations sont au-dessus de mes forces. J’en serai peut-être débarrassé bientôt. D’après les avis que je reçois de mon pays, je ne serai pas returned. On m’avait envoyé pour maintenir la République. Maintenant on me reproche d’avoir été fidèle à ma mission. Ce sera une blessure pour mon cœur, car je n’ai pas mérité cet abandon ; et en outre, il faut gémir sur un pays qui décourage jusqu’à l’honnêteté. Mais ce qui me console, c’est que je pourrai reprendre mes relations d’amitié et les chers travaux de la solitude.
…C’est avec surprise et satisfaction que j’apprends votre prochain passage à Paris. Je n’ai pas besoin de vous dire avec quel plaisir je vous serrerai la main ainsi qu’à M. Schwabe. Seulement je crains que cette date ne coïncide précisément avec celle de nos élections. En ce cas, je serai à deux cents lieues, si du moins je me décide à [VII-430] courir les chances du scrutin. Mon esprit n’est pas encore fixé là-dessus.
Comme vous pensez bien, je suis avec le plus vif intérêt les efforts de notre ami Cobden. J’en fais même ici la contre-partie. Hier, nous avons eu de la commission du budget un retranchement de deux cent mille hommes sur notre effectif militaire. Il n’est pas probable que l’Assemblée et le ministère acceptent un changement aussi complet ; mais n’est-ce pas un bon symptôme que ce succès auprès d’une commission nommée par l’Assemblée elle-même ?
… Adieu, Madame, je me propose de vous écrire plus régulièrement bientôt. Aujourd’hui je suis absorbé par un débat important que j’ai soulevé dans l’Assemblée et qui me force à quelques recherches.
14 octobre 1849.
Ne craignez pas, Madame, que vos conseils m’importunent. Est-ce qu’ils ne prennent pas leur source dans l’amitié ? Est-ce qu’ils n’en sont pas le plus sûr témoignage ?…
C’est en vain que vous présentez l’avenir à mes yeux comme renfermant des chances d’un tardif bonheur. Il n’en est plus pour moi, même dans la poursuite, même dans le triomphe d’une idée utile à l’humanité ; car ma santé me condamne à détester le combat. Chère dame, je n’ai versé dans votre cœur qu’une goutte de ce calice d’amertume qui remplit le mien. Voyez, par exemple, quelle est ma pénible position politique, et vous jugerez si je puis accepter la perspective que vous m’offrez.
De tout temps j’ai eu une pensée politique simple, vraie, intelligible pour tous et pourtant méconnue. Que me [VII-431] manquait-il ? Un théâtre où je pusse l’exposer. La révolution de février est venue. Elle me donne un auditoire de neuf cents personnes, l’élite de la nation déléguée par le suffrage universel, ayant autorité pour la réalisation de mes vues — Ces neuf cents personnes sont animées des meilleures intentions. L’avenir les effraye. Elles attendent, elles cherchent une idée de salut. Elles font silence dans l’espoir qu’une voix va s’élever ; elles sont prêtes à s’y rallier. Je suis là ; c’est mon droit et mon devoir de parler. J’ai la conscience que mes paroles seront accueillies par l’Assemblée et retentiront dans les masses. Je sens l’idée fermenter dans ma tête et dans mon cœur… et je suis forcé de me taire. Connaissez-vous une torture plus grande ? Je suis forcé de me taire, parce que c’est dans ce moment même qu’il a plu à Dieu de m’ôter toute force ; et quand d’immenses révolutions se sont accomplies pour m’élever une tribune, je ne puis y monter. Je me sens hors d’état non seulement de parler, mais même d’écrire. Quelle amère déception ! quelle cruelle ironie !
Depuis mon retour, pour avoir voulu seulement faire un article de journal, me voilà confiné dans ma chambre.
Ce n’est pas tout, un espoir me restait. C’était, avant de disparaître de ce monde, de jeter cette pensée sur le papier, afin qu’elle ne pérît pas avec moi. Je sais bien que c’est une triste ressource, car on ne lit guère aujourd’hui que les auteurs à grande renommée. Un froid volume ne peut certes pas remplacer la prédication sur le premier théâtre politique du monde. Mais enfin l’idée qui me tourmente m’aurait survécu. Eh bien ! la force d’écrire, de mettre en ordre un système tout entier, je ne l’ai plus. Il me semble que l’intelligence se paralyse dans ma tête. N’est-ce pas une affliction bien poignante ?
Mais de quoi vais-je vous entretenir ? Il faut que je compte bien sur votre indulgence. C’est que j’ai si longtemps [VII-432] renfermé mes peines en moi-même, qu’en présence d’un bon cœur je sens toutes mes confidences prêtes à s’échapper.
Je voudrais envoyer à vos chers enfants un petit ouvrage français plein d’âme et de vérité, qui a fait le charme de presque toutes les jeunes générations françaises. Il fut mon compagnon d’enfance ; plus tard, il n’y a pas bien longtemps encore, dans les soirées d’hiver, une femme, ses deux enfants et moi nous mêlions nos larmes à cette lecture. — Malheureusement M. Héron est parti ; je ne sais plus comment m’y prendre. J’essaierai de le faire parvenir à M. Faulkner de Folkestone.
Adieu, chère dame, je suis forcé de vous quitter. Quoique souffrant, il faut que j’aille défendre la cause des Noirs dans un de nos comités, sauf à regagner ensuite mon seul ami, l’oreiller.
À M. ET À MADAME CHEUVREUX (Extrait).↩
Bruxelles, hôtel de Bellevue, 1849.
… Pour moi, j’en suis réduit à aimer une abstraction, à me passionner pour l’humanité, pour la science. D’autres portent leurs aspirations vers Dieu. Ce n’est pas trop des deux.
C’est ce que je pensais tout à l’heure en sortant d’une salle d’asile dirigée par des religieuses qui se vouent à soigner des enfants malades, idiots, rachitiques, scrofuleux. Quel dévouement ! quelle abnégation ! Et après tout, cette vie de sacrifices ne doit pas être douloureuse, puisqu’elle laisse sur la physionomie de telles empreintes de sérénité. Quelques économistes nient le bien que font ces [VII-433] saintes femmes. Mais ce dont on ne peut douter, c’est la sympathique influence d’un tel spectacle. Il touche, il attendrit, il élève ; on se sent meilleur, on se sent capable d’une lointaine imitation à l’aspect d’une vertu si sublime et si modeste. — Je me disais : Je ne puis me faire moine, mais j’aimerai la science et je ferai passer tout mon cœur dans ma tête
Paris, 11 avril 1850.
…Nous autres souffreteux, nous avons, comme les enfants, besoin d’indulgence ; car plus le corps est faible, plus l’âme s’amollit, et il semble que la vie à son premier comme à son dernier crépuscule souffle au cœur le besoin de chercher partout des attaches. Ces attendrissements involontaires sont l’effet de tous les déclins ; fin du jour, fin de l’année, demi-jour des basiliques, etc. Je l’éprouvais hier sous les sombres allées des Tuileries… Ne vous alarmez cependant pas de ce diapason élégiaque. Je ne suis pas Millevoye, et les feuilles, qui s’ouvrent à peine, ne sont pas près de tomber. Bref, je ne me trouve pas plus mal, au contraire, mais seulement plus faible ; et je ne puis plus guère reculer devant la demande d’un congé. C’est en perspective une solitude encore plus solitaire. Autrefois je l’aimais ; je savais la peupler de lectures, de travaux capricieux, de rêves politiques avec intermèdes de violoncelle. Maintenant tous ces vieux amis me délaissent, même cette fidèle compagne de l’isolement, la méditation. Ce n’est pas que ma pensée sommeille. Elle n’a jamais été plus active ; à chaque instant elle saisit de nouvelles harmonies, et il semble que le livre de l’humanité [VII-434] s’ouvre devant elle. Mais c’est un tourment de plus, puisque je ne puis transcrire aucune page de ce livre mystérieux sur un livre plus palpable édité par Guillaumin. Aussi je chasse ces chers fantômes, et comme le tambour-major grognard qui disait : Je donne ma démission et que le gouvernement s’arrange comme il pourra ; — moi aussi, je donne ma démission d’économiste et que la postérité s’en tire, si elle peut…
Mugron, juin 1850.
…Je m’étais fait un peu d’illusion sur l’influence de l’air natal. Quoique la toux soit moins fréquente, les forces ne reviennent pas. Cela tient à ce que j’ai, toutes les nuits, un peu de fièvre. Mais la fièvre et les Eaux-Bonnes n’ont jamais pu compatir ensemble. Aussi dans quatre jours je serai guéri. Je voudrais bien guérir aussi d’un noir dans l’âme que je ne puis m’expliquer. D’où vient-il ? Est-ce des lugubres changements que Mugron a subis depuis quelques années ? Est-ce de ce que les idées me fuient sans que j’aie la force de les fixer sur le papier, au grand dommage de la postérité ? Est-ce… est-ce… ? mais si je le savais, cette tristesse aurait une cause, et elle n’en a pas. — Je m’arrête tout court, de peur d’entonner la fade jérémiade des spleenétiques, des incompris, des blasés, des génies méconnus, des âmes qui cherchent une âme, — race maudite, vaniteuse et fastidieuse, que je déteste de tout mon cœur, et à laquelle je ne veux pas me mêler. J’aime mieux qu’on me dise tout simplement comme à Basile : C’est la fièvre ; buona sera…
[VII-435]
Mugron, juillet 1850.
… Vous veniez de perdre une amie d’enfance. Dans ces circonstances, le premier sentiment est celui du regret ; ensuite on jette un regard troublé autour de soi, et on finit par faire un retour sur soi-même. L’esprit interroge le grand inconnu, et, ne recevant aucune réponse, il s’épouvante. C’est qu’il y a là un mystère qui n’est pas accessible à l’esprit, mais au cœur. — Peut-on douter sur un tombeau ?…
Mugron, 14 juillet 1850.
… Vous êtes bien bon, mon cher Monsieur, de m’encourager à reprendre ces insaisissables Harmonies. Je sens aussi que j’ai le devoir de les terminer, et je tâcherai de prendre sur moi d’y consacrer ces vacances. Le champ est si vaste qu’il m’effraye. En disant que les lois de l’économie politique sont harmoniques, je n’ai pu entendre seulement qu’elles sont harmoniques entre elles, mais encore avec les lois de la politique, de la morale et même de la religion (en faisant abstraction des formes particulières à chaque culte). S’il n’en était pas ainsi, à quoi servirait qu’un ensemble d’idées présentât de l’harmonie, s’il était en discordance avec des groupes d’idées non moins essentielles ? — Je ne sais si je me fais illusion, mais il me semble que c’est par là, et par là seulement, que renaîtront au sein de l’humanité ces vives et fécondes croyances dont M… déplore la perte. — Les croyances éteintes ne se ranimeront plus, et les efforts qu’on fait, dans un moment de frayeur et de danger, pour [VII-436] donner cette ancre à la société, sont plus méritoires qu’efficaces. Je crois qu’une épreuve inévitable attend le catholicisme. Un acquiescement de pure apparence, que chacun exige des autres et dont chacun se dispense pour lui-même, ce ne peut être un état permanent.
Le plan que j’avais conçu exigeait que l’économie politique d’abord fût ramenée à la certitude rigoureuse, puisque c’est la base. Cette certitude, il paraît que je l’ai mal établie, puisqu’elle n’a frappé personne, pas même les économistes de profession. Peut-être le second volume donnera-t-il plus de consistance au premier…
À M. PAILLOTTET.↩
Paris, 14 juillet 1849.
Mon cher Paillottet, je vous suis bien reconnaissant de vous être souvenu de moi dans nos Pyrénées, et en même temps je suis fier de l’impression qu’elles ont faite sur vous. Que j’aurais été heureux de vous suivre dans vos courses ! Nous aurions peut-être refroidi et vulgarisé ces beaux paysages, en y mêlant de l’économie politique. Mais non ; les lois sociales ont leurs harmonies comme les lois du monde physique. C’est ce que je m’efforce de démontrer dans le livre que j’ai en ce moment sur le métier. — Je dois avouer que je ne suis pas content de ce qu’il est. J’avais un magnifique sujet, je l’ai manqué et ne suis plus à temps de refaire, parce que les premières feuilles sont sous presse. Peut-être ce fiasco n’est-il pas de ma faute. C’est une chose difficile sinon impossible de parler dignement des harmonies sociales à un public qui ignore ou conteste les notions les plus [VII-437] élémentaires. Il faut tout prouver jusqu’à la légitimité de l’intérêt, etc. — C’est comme si Arago voulait montrer l’harmonie des mouvements planétaires à des gens qui ne sauraient pas la numération.
En outre, je suis mal disposé et ne sais à quoi l’attribuer, car ma santé est bonne. J’habite le Butard, où je croyais trouver des inspirations ; au lieu de cela, elles se sont envolées.
On assure que l’Assemblée va se proroger du 15 août au 1er octobre. Dieu le veuille ! J’essayerai de me relever dans mon second volume, où je tirerai les conséquences du premier par rapport à notre situation actuelle. Problème social. — Problème français…
L’économie politique vous doit beaucoup et moi aussi pour votre zèle à nous recommander. Continuez, je vous prie. Un converti en fait d’autres. Le pays a bien besoin de cette science qui le sauvera.
Adieu ! Votre bien dévoué.
Mugron, 19 mai 1850.
Mon cher Paillottet, je vous remercie de l’intérêt que vous prenez à ma santé et à mon voyage. Celui-ci s’est fait très heureusement et plus régulièrement que vous ne l’aviez prévu. Il n’y a pas eu de malentendu entre ma place et moi. En route, de Tours à Bordeaux, j’ai rencontré de fervents adeptes de l’économie politique, ce qui m’a fait plaisir, mais m’a forcé de parler un peu trop. À Bordeaux, je n’ai pu éviter quelque chose de pis que la simple causerie, car la réaction y est arrivée à un tel excès qu’il faudrait être de [VII-438] marbre pour écouter froidement ses blasphèmes. — Tout cela fait que mon larynx est arrivé ici un peu fatigué, et les épanchements de l’amitié, quelque délicieux qu’ils soient, ne sont pas propres à le délasser. Pourtant, considérant les choses en gros, je me trouve un peu mieux ; j’ai plus de force de corps et de tête. Voilà certes un long bulletin de ma santé ; votre amitié me l’a demandé, prenez-vous-en à elle.
Je reçus hier le Journal des économistes, en même temps que votre lettre ; j’ai lu mon article. Je ne sais comment vous vous y êtes pris, mais il m’a été impossible d’y reconnaître les reprises, tant elles se confondent avec le tissu. L’idée dominante de cet article n’y est peut-être pas mise assez en saillie. Malgré cela, elle devrait frapper les bons esprits ; et si j’avais été à Paris, j’aurais fait tirer à part 500 copies pour les distribuer à l’Assemblée. L’article n’étant pas long, il me semble que la Voix du peuple devrait le reproduire dans un de ses lundis. Si vous en entendez parler, faites-moi savoir ce qu’on en dit.
…Vous voilà chargé de mes affaires publiques et privées. En tout cas, n’y consacrez, je vous prie, que vos moments perdus. Vous voudriez beaucoup faire une renommée à mes pauvres Harmonies. Cela vous sera difficile. Le temps seul y réussira, si elles valent la peine que le temps s’occupe d’elles. — J’ai obtenu tout ce que je pouvais raisonnablement désirer, savoir : que quelques jeunes hommes de bonne volonté étudient le livre. Cela suffit pour qu’il ne tombe pas, s’il mérite de se tenir debout. M. de Fontenay aura beaucoup fait pour moi, s’il réussit à obtenir l’insertion d’un compte rendu dans la Revue des deux mondes. Il fera plus encore à l’avenir par les développements qu’il saura donner à l’idée principale. C’est tout un continent à défricher. Je ne suis qu’un pionnier, commençant avec des instruments fort imparfaits. La culture perfectionnée viendra plus tard, et je ne saurais trop encourager de Fontenay à s’y [VII-439] préparer. En attendant, tâchez, par notre ami Michel Chevalier, de nous rendre M. Buloz favorable.
J’oublie probablement bien des choses, mais cela se retrouvera ; car j’espère que vous voudrez bien m’écrire le plus souvent possible, et quant à moi, je vous donnerai souvent de mon écriture à débrouiller.
Mugron, 2 juin 1850.
…Mon cousin est parti avant-hier pour Paris. Il y arrivera à peu près en même temps que cette lettre et vous remettra une bonne moitié de l’article que je fais pour compléter la brochure [1] . Mais cet article a pris un tel développement que nous ne pouvons lui faire suivre cette destination. Il y aura près de cinquante pages de mon écriture, c’est-à-dire de quoi faire un nouveau pamphlet, s’il en vaut la peine. C’est un essai. Vous savez que j’ai toujours eu l’idée de savoir ce qu’il adviendrait si je m’abstenais de refaire. Ceci a été écrit à peu près par improvisation. Aussi je crains que cela ne manque de la précision nécessaire au genre pamphlet. Dans quelques jours, je vous enverrai la suite. Quand vous aurez l’ensemble, vous déciderez.
[VII-440]
Eaux-Bonnes, 23 juin 1850.
…Me voici à la prétendue source de la santé. Je fais les choses en conscience ; c’est vous dire que je travaille très peu. N’ayant pas envie de me mettre à continuer les Harmonies, j’achève le pamphlet Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, et je serai probablement en mesure de vous l’envoyer d’ici à quelques jours.
Je vous remercie de l’article que vous avez inséré dans l’Ordre. Il vient d’être reproduit dans les journaux de mon département. C’est probablement tout ce qu’on y saura jamais de mon livre.
Un autre compte rendu a paru dans le Journal des Économistes. Je ne puis comprendre comment M. Clément a jugé à propos de critiquer mon chapitre futur sur la Population. Ce qui a paru offre bien assez de prise, sans aller s’en prendre d’avance à ce qui n’a pas paru. J’ai annoncé, il est vrai, que j’essayerai de démontrer cette thèse : La densité de la population équivaut à une facilité croissante de production. — Il faudra bien que M. Clément en convienne, ou qu’il nie la vertu de l’échange et de la division du travail.
La critique qu’il fait du chapitre Propriété foncière me fait penser qu’il serait peut-être utile de réimprimer en brochure les quatre ou cinq articles qui ont paru dans les Débats sous le titre de Propriété et Spoliation [2] . Ce sera d’ailleurs un anneau de notre propagande, nécessaire à ceux qui n’ont pas la patience de lire les Harmonies.
Ne m’oubliez pas auprès de MM. Quijano et de Fontenay.
[VII-441]
Eaux-Bonnes, 28 juin 1850.
…Voici la première partie de l’article Loi [3] . Je n’ai rien ajouté. Je suppose l’autre partie en route. — C’est bien sérieux pour un pamphlet. Mais l’expérience m’a appris que ce sur quoi l’on compte le moins réussit quelquefois le mieux, et que l’esprit est nuisible à l’idée.
Je voulais vous envoyer Ce quon voit ; mais je ne le trouve pas réussi. Là j’aurais dû reprendre la plaisanterie, au lieu de tourner au sérieux, et qui pis est au genre géométrique [4] .
C’est avec plaisir que je recevrai l’ouvrage de Michel Chevalier. S’il me fait l’honneur de m’emprunter quelques points de vue, en revanche il me donne beaucoup de faits et d’exemples : c’est du libre Échange. Notre propagande a bon besoin de sa plume.
Eaux-Bonnes, 2 juillet 1850.
…Votre observation sur la Loi est juste. Je n’ai pas prouvé comment l’égoïsme qui pervertit la loi est inintelligent. Mais maintenant il n’est plus temps. Cette preuve, d’ailleurs, résulte de l’ensemble des brochures précédentes et résultera mieux encore des suivantes. On verra que la main sévère de la justice providentielle s’appesantit tôt ou tard cruellement sur ces égoïsmes. Je crains bien que la classe moyenne [VII-442] de notre époque n’en fasse l’expérience. C’est une leçon qui n’a pas manqué aux rois, aux prêtres, aux aristocraties, aux Romains, aux Conventionnels, à Napoléon.
J’écrirais à M. de Fontenay pour le remercier de sa bonne lettre, s’il ne m’annonçait son départ pour la campagne. — Il y a de l’étoffe chez ce collègue. D’ailleurs, les jeunes gens de notre temps ont une souplesse de style au moyen de laquelle ils nous dépasseront. Ainsi va et doit aller le monde. Je m’en félicite. À quoi servirait qu’un auteur fit une découverte, si d’autres ne venaient la féconder, la rectifier au besoin, et surtout la propager ?
Mon intention est de partir d’ici le 8 et d’arriver à Paris vers le 20. Je mettrai ma santé sous votre direction.
Lyon, 14 septembre 1850.
Je ne veux pas me lancer dans la seconde moitié de mon voyage, sans vous dire que tout s’est assez bien passé jusqu’ici. Je n’ai été un peu éprouvé que dans le trajet de Tonnerre à Dijon ; mais cela était presque inévitable. Je crois que le mieux eût été de sacrifier une nuit et de prendre le courrier. C’est toujours le meilleur système. Coucher en route vous assujettit à prendre des pataches, des coucous, à être jeté sur l’impériale au milieu d’hommes ivres, etc. ; et vous arrivez dans un mauvais cabaret pour recommencer le lendemain.
Je ne vous ai pas dit, mon ami, combien j’ai été sensible à l’idée qui vous a un moment traversé l’esprit de m’accompagner jusqu’en Italie. Je vous suis tout aussi reconnaissant que si vous eussiez exécuté ce projet. Mais je ne l’aurais pas souffert. C’eût été priver madame Paillottet de l’occasion de [VII-443] voir un jour ce beau pays, ou du moins c’eût été diminuer ses chances. D’ailleurs, ne pouvant pas causer, tout le charme de voyager ensemble eût été perdu. Ou nous aurions souvent violé la consigne, ce qui nous eût causé des remords ; ou nous l’aurions observée, et ce n’eût pas été sans une lutte pénible et perpétuelle. Quoiqu’il en soit, je vous remercie du fond du cœur ; et si madame Paillottet en a le courage, venez me chercher ce printemps, quand je ne serai plus muet.
Rappelez à de Fontenay mon conseil, je dis plus, ma pressante invitation de faire imprimer son Capital.
Pise, 11 octobre 1850.
…J’ignore combien durera la législation actuelle sur la presse et la signature obligatoire. En attendant voilà, pour nos amis, une bonne occasion de se faire dans la presse une honorable renommée. J’ai remarqué avec plaisir des articles de Garnier, bien traités, bien soignés, et où l’on voit qu’il ne veut pas compromettre l’honneur du professorat. Je l’engage à continuer. Sous tous les rapports, le moment est favorable. Il peut se faire une belle position en répandant une doctrine pour laquelle les sympathies publiques sont prêtes à s’éveiller. — Dites-lui de ma part que, si l’occasion s’en présente, il ne permette ni à M. de Saint-Chamans ni à qui que ce soit d’assimiler ma position à celle de M. Benoist d’Azy dans la question des tarifs. — Il y a ces trois différences essentielles :
1o D’abord, quand il serait vrai que je suis poussé par l’amour de ma province, cela n’est pas la même chose que d’être poussé par l’amour de l’argent.
[VII-444]
2o Tout mon patrimoine, tout ce que j’ai au monde est protégé par nos tarifs. Plus donc M. de Saint-Chamans me suppose intéressé, plus il doit me croire sincère quand je dis que la protection est un fléau.
3o Mais ce qui ne permet, en aucune façon, d’assimiler le rôle à la Chambre des protectionistes et des libre-échangistes, c’est l’abîme qui sépare leur requête. Ce que M. Benoist d’Azy demande à la loi, c’est qu’elle me dépouille à son profit. Ce que je demande à la loi, c’est qu’elle soit neutre entre nous et qu’elle garantisse ma propriété comme celle du maître de forges.
Molinari est chargé, à ce qu’il paraît, dans la Patrie, d’une partie plus vive et plus saillante. De grâce, qu’il ne la traite pas à la légère. Que de bien il peut faire en montrant combien sont infectées de socialisme les feuilles qui s’en doutent le moins ! Comment a-t-il laissé passer l’article du National sur le livre de Ledru-Rollin et cette phrase :
« En Angleterre, il y a dix monopoles entés les uns sur les autres ; donc c’est la libre concurrence qui fait tout le mal.
L’Angleterre ne jouit que d’une prospérité précaire parce qu’elle repose sur l’injustice. Voilà pourquoi, si l’Angleterre rentre dans les voies de la justice, comme le propose Cobden, sa décadence est inévitable. »
Et c’est pour avoir fait ces découvertes que le National décerne à Ledru-Rollin le titre de grand homme d’État !…
Adieu, je suis fatigué.
References
[1] Ce travail, au lieu de servir de complément au pamphlet Spoliation et loi, devint un pamphlet séparé, sous ce titre : La loi. — Voir t. IV, p. 342, et t. V, p. 1. (Note de l’éditeur.)
[2] Voir t. IV, p. 394. (Note de l’éditeur.)
[3] Non plus en manuscrit, mais en épreuve imprimée. (Note de l’éditeur.)
[4] Voir au tome V la note de la page 336. (Note de l’éditeur.)