
CHARLES COMTE,
Traité de la Propriété (1834)
2 volumes in 1.
 |
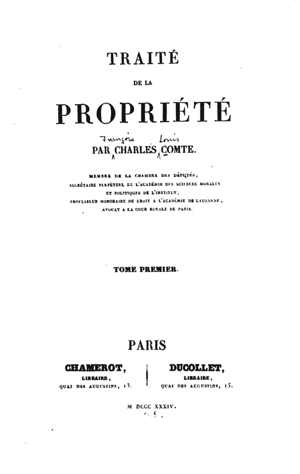 |
| Charles Comte (1782-1837) |
[Created: 31 October, 2023]
[Updated: 31 October, 2023 ] |
The Guillaumin Collection
 |
This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |
Source
Charles Comte, Traité de la Propriété (Paris: Chamerot, 1834). 2 Volumes. 5/18/2025. <http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Comte/TraitePropriete/1834-ParisEdition/Comte_TP-1834ed-2volsin1.html>
Charles Comte, Traité de la Propriété. Par Charles Comte. Membre de la Chambre des Députes, Secrétaire perpétuel de l' Académie des Sciences Morales et Politiques de l'Institut, Professeur honoraire de Droit a l'Académie de Lausanne, Avocat a la Cour Royale de Paris (Paris: Chamerot, Libraire quai des Augustins, 13; Ducollet, Libraire, Quai des Augustins, 15. M DCCC XXXIV (1834)). 2 Volumes.
This title is also available in a facsimile PDF of the original and various eBook formats - HTML, PDF, and ePub.
This book is part of a collection of works by Charles Comte (1782-1837)
TABLE DES CHAPITRES CONTENUS DANS LE PREMIER VOLUME.
- PRÉFACE. p. i
- CHAPITRE I. De l'influence des doctrines des peuples possesseurs d'esclaves sur les idées des nations civilées. p. 1
- Chap. II. De la liberté considérée comme une condition de l'exercice de tous les droits , et de l'accomplissement de tous les devoirs. p. 10
- Chap. III. De ce qui constitue la liberté. p. 19
- Chap. IV. De l'occupation des choses. p. 29
- Chap. V. De l'appropriation des choses en général. p. 49
- Chap. VI. Des choses communes à tous les hommes. p. 63
- Chap. VII. Du territoire propre à chaque nation. p. 68
- Chap. VIII. Des limites naturelles du territoire propre à chaque nation, et à chacune des principales fractions entre lesquelles elle se divise. p. 89
- Chap. IX. De l'utilité et de la valeur primitives des fonds de terre. p. 117
- Chap. X. De la conversion du territoire national en propriétés privées. p. 139
- Chap. XI. Des obstacles que présente l'appropriation individuelle des fonds de terre. p. 162
- Chap. XII. Des parties du territoire national qui restent communes, et particulièrement des fleuves et des rivières. p. 181
- Chap. XIII. Influence du déboisement des montagnes sur les fleuves et les rivières. p. 195
- Chap. XIV. De la dégradation des rivières en France, par le déboisement et le défrichement des montagnes. p. 209
- Chap. XV. Des lois destinées à prévenir le déboisement des montagnes. p. 227
- Chap. XVI. Des anciennes lois sur la jouissance et la conservation des fleuves et des rivières. p. 257
- Chap. XVII. Des lois rendues depuis la révolution sur la propriété, l'entretien et l'usage des cours d'eau.- Des dispositions des lois anglaises et des lois anglo-américaines sur le même sujet. p. 283
- Chap. XVIII. Des modifications que la nature des choses a fait subir aux lois relatives à la propriété et à la jouissance des cours d'eau. p. 323
- Chap. XIX. De la propriété et de l'usage des rivages de la mer. p. 353
- Chap. XX. De la propriété, de l'usage et de l'entretien des chemins publics. p. 373
- Chap. XXI. Suite du précédent. De la propriété des chemins publics et des droits qui en résultent. p. 388
- Chap. XXII. De la propriété des richesses minérales et des limites qui en résultent pour les propriétés de la surface. p. 408
- Chap. XXIII. De la valeur donnée à des propriétés particulières, communales ou départementales, par des travaux exécutés aux frais de l'État. --- Du paiement de cette valeur. p. 431
- Chap. XXIV. De la dépréciation causée à des propriétés particulières par des travaux exécutés dans un intérêt public. p. 447
- Chap. XXV. De la loi sur le desséchement des marais qui appartiennent à des particuliers ou à des communes. p. 455
- Chap. XXVI, Des limites qu'imposent à chaque propriété les propriétés dont elle est environnée. p. 467
- Notes
FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES DU PREMIER VOLUME.
TABLE DES CHAPITRES CONTENUS DANS LE DEUXIÈME VOLUME.
- CHAP. XXVII. De la création et de la distribution des propriétés mobilières. p. 1
- CHAP. XXVIII. De quelques espèces de propriétés commerciales. p. 16
- CHAP. XXIX. De la propriété des inventions ou des procédés industriels. p. 28
- CHAP. XXX. Des lois relatives à la propriété des inventions industrielles. p. 58
- CHAP. XXXI. Des fondemens et de la nature de la propriété littéraire. p. 88
- CHAP. XXXII. Des causes qui ont privé les compositions littéraires des garanties accordées aux autres propriétés. p. 111
- CHAP. XXXIII. Des lois relatives à la propriété des compositions littéraires. p. 131
- CHAP. XXXIV. De la tendance des lois relatives à la propriété littéraire. p. 160
- CHAP. XXXV. Distinction entre la propriété littéraire et le monopole. p. 172
- CHAP. XXXVI. Application des principes établis dans les chapitres précédens à quelques questions de propriété littéraire. p. 188
- CHAP. XXXVII. De la propriété des rentes sur des particuliers ou sur l'Etat. p. 219
- CHAP. XXXVIII. De la faculté de jouir et de disposer d'une propriété. p. 230
- CHAP. XXXIX. De quelques lois particulières sur la jouissance et la disposition des propriétés, et sur la liberté d'industrie. p. 247
- CHAP. XL. De la garantie des propriétés en général, et particulièrement contre les atteintes de l'extérieur. p. 259
- CHAP. XLI. De quelques lois destinées à garantir les propriétés contre les atteintes de l'extérieur. p. 274
- CHAP. XLII. De la garantie des propriétés de tous les genres, contre les atteintes du gouvernement et de ses agens. p. 290
- CHAP. XLIII. De la garantie des propriétés de tous les genres contre les atteintes des particuliers. p. 303
- CHAP. XLIV. De la garantie donnée aux possesseurs de biens acquis par usurpation, et des causes de cette garantie. p. 315
- CHAP. XLV. De l'influence des garanties légales sur l'accroissement, la conservation et la valeur des propriétés. p. 326
- CHAP. CHAP. XLVI. Des rapports qui existent entre l'accroissement des propriétés et l'accroissement de diverses classes de la population. p. 341
- CHAP. XLVII. Des opinions des jurisconsultes sur l'origine et la nature de la propriété. p. 352
- CHAP. XLVIII. Des définitions de la propriété par la puissance législative. p. 367
- CHAP. XLIX. Examen critique des dispositions du Code civil sur la nature de la propriété. p. 376
- CHAP. L. Du mélange des propriétés mobilières appartenant à différens maîtres. p. 395
- CHAP. LI. Des diverses manières dont une propriété peut être partagée. p. 405
- CHAP. LII. Du démembrement d'une propriété pour le service ou l'utilité d'une autre propriété. p. 428
- CHAP. LIII. De la classification des propriétés, ou de la distinction des biens. p. 443
- CHAP. LIV. Des idées rétrogrades contre la propriété. - Conclusion. p. 470
- Notes
TABLE DES MATIÈRES. p. 490
CHARLES COMTE,
Traité de la Propriété (1834)
Volume 1.
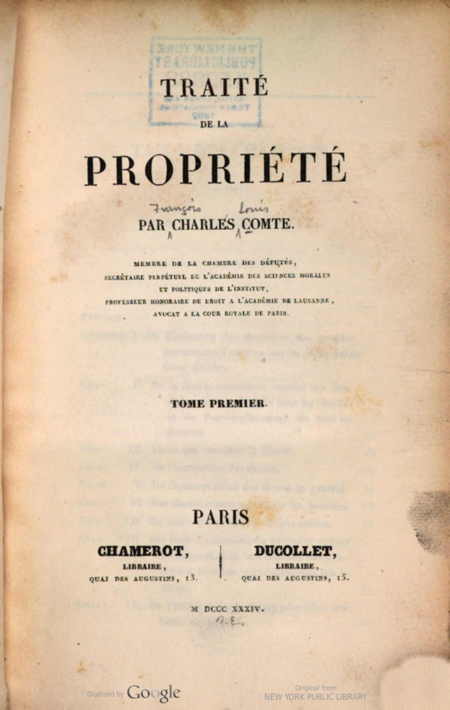
[I-i]
PRÉFACE↩
Si l'ouvrage que je publie aujourd'hui avait été mis au jour il y a quatre ou cinq ans, époque à laquelle je comptais le faire paraître, je n'aurais pas eu besoin, avant que d'entrer en matière, de m'adresser directement aux lecteurs pour leur faire observer qu'il était la continuation d'un autre traité que j'ai publié en 1826 et 1827; en le lisant, ils s'en seraient aperçus, sans avoir eu besoin d'en être avertis ; ils auraient vu que j'avais appliqué la même méthode à l'observation de phénomènes de même genre, et que j'avais suivi l'ordre naturel des idées, autant du moins qu'il avait dépendu de moi.
Mais, lorsque la publication de deux ouvrages qui se lient l'un à l'autre, est séparée par un intervalle de près de sept années; lorsque, dans cet intervalle, une révolution politique a plongé dans l'oubli la plupart des questions qui agitaient les esprits, et [I-ii] qu'elle a fait surgir une foule de questions nouvelles, il n'est pas possible de se faire illusion au point de croire que les personnes qui ont lu le premier, en aient conservé le souvenir, et qu'elles puissent, à une si grande distance, apercevoir les rapports qui l'unissent au second; un grand nombre de ceux qui liront celui-ci n'auront conservé de celui-là que des idées confuses, ou même ne l'auront jamais lu.
Je suis donc obligé d'avertir les personnes qui liront ce traité, qu'il leur sera difficile de le bien juger, si elles n'ont aucune connaissance ou aucun souvenir de celui que j'ai publié il y a près de sept années. Si des objections se présentaient à leur esprit, soit sur la méthode que j'ai suivie, soit sur la manière dont j'envisage les lois, je ne saurais y répondre autrement qu'en les priant d'en chercher la solution dans l'ouvrage dont celui-ci n'est que la suite.
Lorsqu'en 1826 je fis paraître le premier volume de mon Traité de législation, j'avais le dessein d'exposer dans un seul corps d'ouvrage tous les principes de cette vaste science; mais lorsque, l'année suivante, je voulus publier les trois volumes qui en formaient la suite, les [I-iii] éditeurs firent de graves objections contre l'exécution de ce projet. Ils me représentèrent que beaucoup de personnes attendraient, pour faire l'acquisition des volumes publiés, que l'ouvrage fût terminé; que les libraires surtout ne voudraient pas envoyer à leurs correspondans étrangers les premiers volumes d'un traité dont la continuation ne serait pas assurée, et dont ils ne pourraient pas annoncer la fin pour une époque déterminée.
Je cédai, quoiqu'à regret, à ces considérations, en publiant, en 1827, trois nouveaux volumes; je me résignai à présenter comme terminé, un ouvrage dont les parties les plus intéressantes n'étaient pas encore rédigées; je me réservai de le compléter en traitant séparément chacune des branches de la législation, sans prendre toutefois aucun engagement à cet égard envers le public.
Cette détermination eut le résultat qu'elle devait naturellement avoir : les meilleurs esprits trouvèrent que le titre de mon ouvrage était peu en rapport avec les matières que j'avais exposées. Les sujets que je n'avais pas traités, étaient, en effet, si nombreux et si étendus, comparativement à ceux [I-iv] dont je m'étais occupé; la plupart des faits que j'avais exposés étaient d'ailleurs si éloignés de l'état actuel des nations les plus civilisées, qu'il était impossible de considérer mon ouvrage autrement que comme les prolégomènes d'une science qui restait à faire; de là résultèrent quelques critiques, dont je reconnais toute la justesse, et dont j'avais d'autant moins à me plaindre qu'elles furent généralement accompagnées de beaucoup de bienveillance.
J'aurais pu porter remède à un inconvénient qu'il ne m'avait pas été possible d'éviter, en me hâtant de publier les premiers volumes qui devraient faire suite au Traité de Législation; mais les événemens politiques ne m'en laissèrent pas le temps, et m'obligèrent à m'occuper de sujets plus urgens.
Quelques-uns des ministres de Louis XVIII et de Charles X avaient tellement abusé du pouvoir que la charte donnait au roi de nommer les juges; ils avaient montré, dans quelques-uns de leurs choix, tant de partialité en faveur des hommes les plus disposés à être les instrumens de leurs passions politiques, qu'ils avaient fait sentir à beaucoup de personnes la nécessité d'une [I-v] organisation judiciaire moins propre que celle de l'empire à seconder les vues ou à servir les passions des agens du pouvoir exécutif.
En 1817, j'avais publié une traduction d'un ouvrage anglais sur l'institution du jury, et je l'avais fait précéder d'un examen critique de notre système judiciaire. En 1825, le gouvernement anglais ayant réuni en un seul corps les nombreux statuts qui existaient sur le jury, et ayant fait subir à cette institution les réformes que les hommes les plus recommandables par leurs lumières et par leur amour pour la justice avaient sollicitées, je crus qu'il ne serait pas inutile au progrès de nos institutions de traduire, dans notre langue, l'acte du parlement anglais. Je publiai donc une seconde édition de la traduction que j'avais fait paraître en 1817, et je remplaçai les statuts qui venaient d'être abrogés, par la loi générale qui en avait reproduit et modifié les dispositions. En même temps je soumis à un nouvel examen nos institutions judiciaires, et en les comparant à celle qui existent chez tous les peuples libres, je fis voir combien sont faibles les garanties qu'elles offrent contre les intérêts et les passions politiques du pouvoir exécutif et de ses agens. Cet ouvrage parut en 1828.
[I-vi]
La réaction de l'année suivante, qui amena la dissolution de la garde nationale parisienne, et qui se termina par les célèbres ordonnances du 25 juillet, suspendit encore le cours régulier de mes travaux; je fis voir, en publiant, en 1829, l'Histoire de la garde nationale de Paris, et en rappelant la participation que la population parisienne avait prise aux principaux événemens de la révolution française depuis 1789, que les attaques contre l'institution de la garde nationale avaient toujours été immédiatement suivies du renversement de la liberté, et que cette institution avait constamment reparu après la chute du despotisme.
Après la révolution de 1830, ayant été appelé à diverses fonctions publiques, et m'étant imaginé qu'il ne me serait pas impossible d'être de quelque utilité pour le public dans la pratique des affaires, j'ai encore suspendu l'exécution du projet que j'avais formé de compléter, par des traités séparés, l'ouvrage dont j'avais publié quatre volumes en 1826 et 1827. L'expérience a bientôt dissipé l'illusion que je m'étais faite; elle m'a convaincu qu'il est des époques facheuses où tout homme qui prétend faire usage [I-vii] de sa raison et conserver la liberté de sa conscience, doit savoir se résigner à ne pas prendre part à des affaires de gouvernement. Je suis alors revenu à l'exécution de mon ancien projet; les deux volumes que je publie aujourd'hui sont le résultat de cette résolution.
Les hommes qui n'ont pas fait une étude spéciale des divers états par lesquels les nations civilisées ont passé pour arriver au point auquel elles sont parvenues, ne sauraient se faire une idée exacte de l'empire qu'exercent sur chaque peuple les passions, les institutions, les préjugés des temps passés. Toute nation qui a fait quelques progrès, est placée sous une double influence; elle est dominée par les idées ou les préjugés d'un état qui n'existe plus, et elle est entraînée, d'un autre côté, par les sentimens ou par les besoins de sa position nouvelle. Cette lutte, entre des préjugés et des passions contraires est une des principales causes des désordres dont nous sommes témoins.
Ayant acquis la conviction qu'on ne saurait suivre une marche régulière et sûre dans le perfectionnement de nos institutions sociales, tant qu'on se laissera subjuguer par les préjugés, les passions, les institutions des temps qui ne sont plus, j'ai [I-viii] tenté de décrire, dans mon premier traité, les principaux états par lesquels tous les peuples semblent avoir passé, et d'en exposer les causes et les effets divers; j'ai tenté surtout de faire voir que les idées et les mœurs qui sont des résultats nécessaires d'une position donnée, doivent disparaître quand cette position a complétement changé.
Il n'est rien qui intéresse les hommes d'une manière plus profonde et plus constante, et qui agisse plus fortement sur eux, que les divers modes suivant lesquels ils pourvoient à leur existence; c'est de là que viennent leurs dissentions, leurs guerres, leurs alliances, leurs traités, leurs lois civiles et pénales, leurs institutions politiques bonnes et mauvaises ; c'est de là que naissent la plupart des actions humaines, celles que nous jugeons les plus criminelles et que nous aspirons sans cesse à réprimer, comme celles qui nous semblent les plus honorables, et que nous encourageons de nos applaudissemens.
Or, des hommes peuvent pourvoir à leur existence par une multitude de moyens divers; et la diversité des moyens en produit toujours une dans les mœurs, dans les idées, dans les institutions, dans l'accroissement des richesses, dans le nombre [I-ix] de la population, dans les relations de famille, enfin, dans l'existence entière d'une nation.
Les principales positions dans lesquelles des hommes peuvent se trouver relativement à leurs moyens d'existence, sont au nombre de six.
II peut arriver que, dans une peuplade, chaque individu n'ait, pour défendre sa subsistance contre les attaques des autres individus, que ses forces particulières et celles des membres de sa famille. Cet état est celui des hordes les plus barbares, celui qu'un grand nombre d'écrivains ont nommé l'état de nature par excellence. Dans une position pareille, nul ne cherche à obtenir de ses travaux que ce qu'il peut immédiatement consommer.
La population, au lieu d'être ainsi dépourvue de toute organisation et de toute police, peut être divisée en deux grandes classes. Il peut arriver qu'une partie, privée de toute organisation, exécute tous les travaux qu'exige l'existence de la nation tout entière, et que l'autre partie, fortement organisée, se fasse livrer par la première, sous le nom de tributs ou d'impôts, toutes les choses dont elle a besoin pour vivre dans l'aisance et dans l'oisiveté. Quand une partie de la population est ainsi exploitée en masse par une autre partie qui se [I-x] partage les produits de ses travaux, celle des deux qui jouit héréditairement du monopole du pouvoir et des richesses, prend le nom d'aristocratie.
La population laborieuse, au lieu d'être exploitée en commun par une aristocratie, peut être divisée, de manière que chacun de ceux qui vivent du produit de ses travaux, possède un nombre plus ou moins grand de travailleurs, et dispose d'eux comme il juge convenable. Cet état est celui qui existait dans les républiques formées dans l'enfance de la civilisation, en Italie, en Grèce, dans les Gaules; c'est celui qui existe encore dans la plupart des colonies formées par les modernes, et même dans plusieurs des États de la fédération américaine. Quand la population laborieuse est ainsi possédée, elle est mise au rang des choses; ceux qui la possèdent ne lui reconnaissent ni droits ni devoirs : c'est le degré le plus élevé du système aristocratique.
Il arrive quelquefois qu'une nation entière est possédée par un seul homme ou par sa famille, qui l'exploite ou la gouverne au moyen d'une armée, et qui prend, dans les revenus de ses sujets, la part qu'il juge convenable, soit pour lui-même, soit pour les agens de son exploitation on donne le nom de despotique au gouvernement qui peut [I-xi] disposer ainsi de la personne et des biens de chacun.
Il est une position moins commune et surtout moins durable que les précédentes, mais qui cependant a existé à diverses époques et dans divers pays: c'est celle d'une société qui, pour faire régner l'égalité entre les membres dont elle se compose, établit que tous les travaux se feront en commun, et que chacun aura une part égale dans les produits. Cet état paraît avoir été celui de tous les peuples qui passaient de l'état de chasseurs à la vie agricole; il a été aussi adopté par quelques sectes religieuses, et particulièrement par les Jésuites du Paraguay.
Enfin, il est une dernière position qui paraît n'avoir jamais été connue par les peuples de l'antiquité, et vers laquelle semblent tendre, chez les nations modernes, toutes les classes laborieuses : c'est celle d'une nation qui admet, en principe et en fait, que tout homme est maître de lui-même et des produits de ses travaux, et qui garantit à chacun des membres de la société la jouissance et la disposition des biens qui lui appartiennent.
Dans le Traité de Législation, j'ai fait connaître la nature, les causes et les conséquences des cinq premiers modes d'existence; le dernier [I-xii] livre traite particulièrement de la nature de l'esclavage domestique, et de l'influence qu'il exerce sur les facultés physiques, sur l'intelligence et les mœurs des diverses classes de population, sur la production et la distribution des richesses, sur l'indépendance nationale, et enfin sur l'existence tout entière des nations qui l'ont mis en pratique.
Pour suivre l'ordre naturel des idées, il me restait à traiter du sixième mode d'existence, de celui d'un peuple qui ne veut pas admettre qu'un homme puisse être la propriété d'un autre; qui proclame, au contraire, que nul ne peut être dépouillé, par ses semblables, des produits de ses travaux, ou des biens qu'il a régulièrement acquis; qui garantit, en un mot, les propriétés, de quelque nature qu'elles soient, contre toute espèce d'atteintes.
Cet ouvrage a pour objet de faire connaître la nature de ce dernier mode d'existence, d'en observer les développemens et les effets. Déterminé à ne jamais abandonner la méthode d'observation que j'ai suivie jusqu'ici, et à me tenir constamment dans l'étude des faits, je n'ai pas séparé la théorie de la pratique. Il ne m'aurait pas été [I-xiii] possible, en effet, d'observer les phénomènes sociaux, et de ne pas m'occuper de la réalité des choses. Je n'ignore pas toutefois qu'en procédant ainsi, je me suis exposé à deux reproches : les praticiens m'accuseront d'avoir donné trop de place à la théorie; les philosophes, de m'être beaucoup trop occupé des détails de la législation.
Dans l'ouvrage dont ce traité forme la suite, je me suis principalement occupé des rapports que la violence a souvent établis entre les hommes ; j'en ai exposé les causes, la nature, les effets. Désormais je n'aurai plus à m'occuper que des rapports qui s'établissent naturellement, soit entre les hommes et les choses à l'aide desquelles ils existent, soit entre les individus et les agrégations d'individus dont chaque nation se compose.
Dans le Traité de la propriété, je n'ai eu à exposer que les rapports qui existent ou s'établissent naturellement entre les hommes et les choses au moyen desquelles ils peuvent exister; et par ce mot rapport, j'entends les besoins qui sont dans les hommes, et les qualités qui sont dans les choses, et qui sont destinées à satisfaire ces mêmes besoins, dans l'ordre naturel et régulier de la production et de la transmission.
[I-xiv]
Les allusions aux circonstances présentes m'ont toujours paru fort déplacées dans un ouvrage de science; elles rendent la vérité suspecte, parce qu'elles mettent en doute l'impartialité de l'écrivain. Je m'en suis donc entièrement abstenu; et cependant, en lisant quelques passages de ce traité, des personnes inattentives pourraient penser le contraire. Je dois donc m'expliquer ici clairement pour prévenir toute fausse application de mes pensées.
Dans le troisième chapitre de cet ouvrage, en exposant quelles sont les institutions qui caractérisent l'esclavage, et celles qui appartiennent à la liberté, je fais observer que partout les possesseurs d'esclaves empêchent, autant qu'ils le peuvent, qu'il ne se forme aucune sorte d'association entre les hommes asservis; qu'ils supposent, non sans raison, que si les hommes possédés pouvaient s'entendre entre eux, tous leurs efforts tendraient vers la destruction de l'esclavage; que des hommes libres, au contraire, s'associent toutes les fois que leur intérêt l'exige, sans en demander la permission à personne ; qu'ils délibèrent sur leurs intérêts communs aussi souvent qu'ils le jugent convenable, et que nul ne les trouble dans leurs réunions, [I-xv] tant qu'ils ne portent pas atteinte aux bonnes mœurs ou aux droits d'autrui [1].
En lisant ce passage, il est bien [I-xv] peu de personnes qui ne soient tentées de croire que l'auteur a voulu faire allusion à la loi contre les associations, qui vient d'être discutée dans le sein de la Chambre des députés. On se tromperait, cependant, si l'on avait une telle pensée; ces observations, sur le droit d'association, écrites depuis plusieurs années, étaient imprimées plusieurs mois avant la présentation du projet auquel elles semblent faire allusion. En les livrant à l'impression j'étais loin de prévoir que bientôt j'aurais à les expliquer, de peur d'en voir tirer de fausses conséquences. Aujourd'hui, comme au moment où elles furent écrites, j'ai la conviction que la faculté d'association est inhérente à notre nature, comme la faculté de manifester nos opinions, comme celle de nous livrer au travail; je crois qu'on ne saurait, sans oppression et sans injustice, en empêcher l'exercice, tant qu'il n'en résulte aucun dommage pour des particuliers ou pour le public.
Mais tout en reconnaissant le droit d'association [I-xvi] il me semble que ce droit peut être admis sans danger, que sous deux conditions : l'une que l'exercice en soit réglé par les lois, de telle manière que la sécurité de la société générale, c'est-à-dire de la nation, ne soit pas sans cesse troublée par des associations particulières; l'autre que les écarts auxquels des associations peuvent se livrer, soit contre le public, soit contre des particuliers, puissent être réprimés par le pouvoir chargé de la répression de tous les genres de désordres.
Si le projet présenté par le gouvernement m'a paru vicieux, et si, comme tel, j'en ai voté le rejet, c'est qu'à mes yeux il ne satisfait ni aux conditions de l'ordre, ni à celles de la liberté; il ne me semble propre qu'à donner au désordre plus d'intensité, et à fournir des armes à l'arbitraire.
Suivant ce projet, qui probablement sera bientôt une loi, toute association de plus de vingt personnes est, en effet, criminelle, si le gouvernement ne l'a pas autorisée, quel qu'en soit d'ailleurs l'objet ; elle ne peut exister qu'en se soumettant à toutes les conditions qu'il plaît à la police de lui imposer, et elle peut toujours être arbitrairement dissoute. Mais aussi toute association de moins de vingt-une personnes, quels que soient son [I-xvii] but et ses moyens, est de plein droit irréprochable, et n'est soumise à aucune règle.
Il suit de là qu'une association illégale de vingt-un individus, qui se proposerait de porter le trouble dans la société, deviendrait légitime, en expulsant de son sein celui de ses membres qui serait le plus raisonnable; et qu'une association de vingt personnes, innocente suivant la loi, quoique animée des plus mauvais desseins, deviendrait criminelle, si elle recevait parmi ses membres un homme doué d'assez de bon sens la faire renoncer à ses projets.
Ce qui constitue, en effet, l'innocence ou la culpabilité d'une association, ce ne sont ni les intentions, ni le but, ni les moyens, c'est le nombre, et rien que le nombre; pour discerner le crime de l'innocence en pareille matière, il suffira de savoir compter le nombre de ses doigts: jusqu'à vingt, tout est innocent; au-delà, tout est criminel.
Si les associations dont on semble avoir tant de peur, et auxquelles on attribue les plus sinistres desseins, se dissolvent quand la loi nouvelle sera promulguée, et si, de leurs débris, il se forme une multitude d'associations ayant le même [I-xviii] but, et agissant par les mêmes moyens, mais comptant chacune moins de vingt-un membres, on n'aura rien à leur dire, quelle que soit l'action qu'elles exercent sur la société, pourvu qu'il n'existe pas d'affiliation entre elles.
Il est vrai que les affiliations ne leur seront pas fort nécessaires, si les membres peuvent converser entre eux, et se raconter mutuellement ce qui se passe dans leurs réunions; pour que la loi ne reste pas inefficace, il faudra considérer comme affilié à une association, tout homme qui sera convaincu d'avoir fait la conversation avec un des membres dont elle se compose.
Ces dispositions, que des hommes qui ne sont pas dépourvus d'esprit, semblent avoir mis au rang des plus belles conceptions du génie législatif de notre âge, si l'on en juge du moins par la chaleur et par l'enthousiasme qu'ils ont mis à les défendre, me paraissent aussi peu favorables à la sécurité et à l'ordre public, qu'elles sont contraires à la liberté.
Je n'admets pas qu'il soit au pouvoir d'un ou de plusieurs hommes, même quand ils s'appellent des législateurs, de changer la nature des choses, de transformer en délit ce qui, de sa nature, est [I-xix] innocent, et de rendre innocent ce qui, de sa nature, est funeste à la société.
Une mesure qui déclare punissable l'exercice innocent ou honorable de quelqu'une de nos facultés, est un acte de tyrannie, quels qu'en soient les auteurs; une mesure qui assure l'impunité à des actes ou à des actions propres à porter atteinte à la sécurité publique ou à troubler la société, est un acte non moins condamnable: sous l'un et l'autre de ces deux rapports, le projet de loi contre les associations méritait d'être repoussé.
Il n'est pas possible d'admettre que toute association composée de moins de vingt-une personnes, soit nécessairement innocente; qu'elle doive être affranchie de toute règle, et placée hors de la surveillance des magistrats et de l'atteinte des lois; une multitude d'associations, dont aucune n'aurait pas plus de vingt membres, pourraient certainement porter atteinte à la sécurité publique et causer de graves désordres, si elles avaient de mauvais desseins et des moyens suffisans pour les exécuter.
Tout ce qui peut être conçu et mis à exécution par une association de vingt-cinq personnes, peut être conçu, accompli, par une association de [I-xx] dix-huit ou de vingt, si elle a des moyens suffisans; il y a même plus de concert et d'activité dans une société peu nombreuse qui dispose de grands moyens, que dans celle qui compte un grand nombre de membres, mais qui ne dispose de rien.
Il est également impossible d'admettre, d'un autre côté, que toute association devienne criminelle du moment qu'elle compte plus de vingt membres, et qu'il soit impossible de garantir la sécurité publique, sans livrer à l'arbitraire de la police toute association qui excède ce nombre; il serait impossible de soutenir un tel système, sans reproduire tous les sophismes qu'on a faits, sous la restauration, pour prouver que la censure préalable et arbitraire était le seul moyen d'empêcher les abus de la presse.
Suivant la loi présentée par le ministère, les associations sont divisées en deux classes, et soumises à deux régimes opposés. Celles de plus de vingt personnes n'ont pas d'autres règles que les volontés de la police; elles sont livrées à l'arbitraire du gouvernement, qui peut les dissoudre, sans rendre compte de ses motifs. Celles qui se composent de moins de vingt-un membres, sont affranchies de toute règle et de toute surveillance; [I-xxi] nul magistrat ne peut leur demander compte, ni du but qu'elles se proposent, ni des moyens qu'elles emploient pour y arriver. Ainsi, au-dessus de vingt, licence sans frein du pouvoir arbitraire contre les associations les plus inoffensives, les plus utiles, les plus honorables; au-dessous de vingt, licence entière des associations même les plus malfaisantes, contre l'ordre public ou contre les citoyens.
Cette absence, pour les unes comme pour les autres, de toute règle, de toute loi ; cet assemblage de despotisme ministériel et de dispositions anarchiques; ce double désordre, en un mot, s'appelle, dans le langage des hommes qui nous gouvernent, régime légal, ordre public! A la bonne heure! ne disputons pas sur les mots, puisque nous ne saurions nous entendre sur les choses; mais on doit convenir au moins que les hommes qui ne veulent d'aucun genre de désordre, de quelque côté qu'il se présente; qui demandent que tout ce qu'il y a de bon et d'honorable soit placé sous la protection des lois, et que toute espèce de licence soit réprimée, ont d'assez bonnes raisons de ne pas être satisfaits d'un pareil régime.
La loi contre les associations est moins funeste [I-xxii] aux progrès de la civilisation, par les atteintes directes qu'elle porte à la liberté, que par les excitations qu'elle donne à l'esprit de désordre et d'anarchie, par les habitudes de fraude, de dissimulation, de conspiration, qu'elle tend à faire contracter. Les coups portés à la liberté, dans la vue d'atteindre la licence, sont de mauvais moyens de faire respecter l'ordre public; l'article du Code pénal, qu'on a prétendu renforcer, et qui a mis obstacle à la formation de tant d'associations utiles, n'a jamais atteint d'autres associations ennemies du gouvernement, que celles qui sont venues se dénoncer elles-mêmes à la justice.
Qu'on me pardonne cette longue digression; elle est fort étrangère, je le sais, au fond de cet ouvrage; mais j'avais besoin d'expliquer une pensée qu'on aurait pu mal interpréter dans les circonstances présentes. Ayant admis le droit de former des associations comme une des conditions essentielles de la liberté, je n'aurais pas voulu qu'on pût croire que, dans ma pensée, l'exercice de ce droit ne devait être soumis à aucune règle, et que, dans aucun cas, il n'était permis d'en réprimer les abus. Je suis, au contraire, convaincu que la sécurité publique ne pourra régner qu'autant [I-xxiii] que toutes les associations, quel que soit le nombre de membres dont elles se composent, seront soumises à certaines règles, et que l'autorité publique aura le moyen de réprimer leurs écarts, non par l'arbitraire de la police, mais par l'application régulière des lois.
Dans les pays soumis au despotisme, on supplée par l'arbitraire, à l'imprévoyance ou à l'insuffisance des lois; mais on ne peut recourir à un tel moyen chez un peuple libre, sans s'exposer aux plus graves dangers. Il suit de là que plus il y a de liberté chez une nation, plus il importe que l'exercice de tous les droits soit bien réglé, et que l'autorité publique possède tous les moyens nécessaires pour réprimer régulièrement les délits qui peuvent être commis. Il ne faut pas que le gouvernement puisse jamais être placé dans l'alternative, ou de tolérer un désordre, ou de le réprimer par la violence et l'arbitraire. C'est cependant la position dans laquelle il se trouvera, tant que le droit d'association n'aura pas été régularisé, et qu'il n'y aura pas de moyen légal d'en réprimer les abus.
En terminant cette préface, déjà beaucoup trop longue, je dois ajouter une réflexion. Je m'étais [I-xxiv] proposé, non-seulement de faire connaître la nature des divers genres de propriétés, mais encore d'en expliquer la formation. Or, il n'était pas possible d'en donner l'explication, sans rappeler un grand nombre de vérités qui appartiennent à la science de l'économie politique. Les hommes qui s'occupent de cette science, trouveront donc, dans ce traité, beaucoup d'observations que je n'ai pas la prétention de donner comme des découvertes. Je ne les ai rappelées, que parce que j'en avais besoin pour expliquer des phénomènes dont on ne trouve pas l'explication dans les ouvrages de jurisprudence. Ces faits, qui sont, pour ainsi dire, des vérités triviales pour tous les hommes qui se livrent à l'étude de l'économie politique, sont d'ailleurs rarement observés, du moins en France, par les hommes qui se destinent à la pratique du droit. Tels sont les motifs qui m'ont déterminé à présenter des considérations dont j'aurais pu me dispenser, si, dans nos écoles, l'étude du droit était un peu plus philosophique.
Paris, le 30 mars 1834.
[I-1]
TRAITÉ DE LA PRPORIÉTÉ
CHAPITRE PREMIER.
De l'influence des doctrines des peuples possesseurs d'esclaves sur les idées des nations civilisées.↩
LORSQUE les ténèbres du moyen-âge ont commencé à se dissiper, les hommes studieux n'ont pas eu la pensée hardie d'acquérir des lumières, en observant les phénomènes qui s'offraient à leurs regards; ils ont étudié les ouvrages dans lesquels les écrivains grecs ou romains avaient déposé leurs systèmes et les résultats de leurs observations; ils ont cherché, non à se faire des idées exactes de la nature des choses, mais à se pénétrer des pensées des hommes qui les avaient précédés.
Cette manière de s'instruire a été abandonnée par les hommes qui s'occupent de sciences physiques : c'est par l'observation des faits, et non par [I-2] l'étude des livres, qu'ils acquièrent des connaissances. Les ouvrages des savans ne sont plus considérés par les personnes qui possèdent une véritable instruction, que comme des guides, dont la mission est de diriger ceux qui veulent se livrer à l'étude des choses. Ils font, dans les mains des gens qui aspirent à s'instruire, l'office que font, entre les mains d'un voyageur, des itinéraires ou des cartes de géographie. L'homme qui prétendrait combattre le résultat d'une observation scientifique par l'autorité d'Aristote ou de Pline, se rendrait ridicule aux yeux des gens les moins éclairés.
A la renaissance des sciences morales, on a procédé, pour acquérir de l'instruction, comme on procédait pour les sciences physiques : ce n'est point par l'étude des phénomènes de la nature qu'on s'est instruit, c'est par la lecture des livres des premiers moralistes et des premiers métaphysiciens, ou par l'étude des lois des premiers peuples dont on a possédé l'histoire; les institutions des peuples grecs et romains, et celles des peuples du moyen-âge ont été, pour ainsi dire, les patrons sur lesquels les savans ont tenté de former les idées et les mœurs des nations.
Mais la révolution qui s'est opérée dans l'étude des sciences physiques ne s'est pas encore étendue à l'étude de toutes les branches des sciences morales: le professeur qui, de nos jours, enseignerait [I-5] comme des vérités les doctrines des premiers physiciens, se rendrait ridicule; il n'en serait pas de même de celui qui enseignerait les systèmes philosophiques des écrivains grecs. On craindrait de s'égarer si l'on suivait aveuglément les doctrines d'Aristote on n'éprouve pas cette crainte en étudiant les opinions de Papinien. Dans les sciences physiques, celui qui s'aviserait de substituer l'autorité des livres à l'autorité des faits, serait considéré comme un esprit étroit et faux; mais dans la science du droit ou de la morale, celui qui s'aviserait de substituer l'autorité des faits à l'autorité des livres, ne serait peut-être pas compris par beaucoup de gens qui se prétendent instruits.
Les idées que nous avons sur les lois et sur la morale n'étant pas, en général, des résultats de nos propres observations sur la nature des choses, il nous importe de remarquer au moins quelles sont les sources auxquelles nous allons les puiser. Nous les puisons généralement dans les institutions des premiers peuples de la Grèce et de l'Italie, dans les décisions des jurisconsultes romains, ou dans les rescrits des empereurs, et dans les lois ou les institutions du moyen-âge. Nous formerons ainsi notre entendement sur celui des peuples qui sortaient à peine de la barbarie, et qui avaient tous les préjugés et toutes les passions qu'enfantent la servitude et l'état sauvage. Il est bien clair qu'il [I-4] n'est ici question que de ceux d'entre nous qui étudient la morale et les lois comme sciences: ceux qui n'ont pas la prétention d'être ou de devenir des savans, ont toujours un certain nombre d'idées qu'ils ne doivent qu'à leurs propres observations et à leur bon sens naturel.
Il n'existe cependant presque aucune analogie entre l'état social au milieu duquel nous vivons, et l'état social des peuples dont nous empruntons les idées pour former nos sciences. Notre tendance naturelle nous porte à agir immédiatement sur les choses pour les approprier à nos besoins, et à nous soustraire à l'action violente que nos semblables voudraient exercer sur nous, pour nous contraindre à devenir les instrumens de leurs plaisirs ou de leurs caprices. Les hommes dont nous empruntons les idées n'agissaient sur les choses, au contraire, que par l'intermédiaire d'autres hommes qu'ils s'étaient appropriés, et dont ils faisaient les instrumens de leurs travaux. Chez les peuples civilisés de notre âge, l'homme lutte sans cesse avec la nature physique, pour en diriger les forces dans le sens de ses intérêts. Cette lutte existait aussi dans les temps anciens; mais il y avait de plus une lutte continuelle d'homme à homme.
Les législateurs ou les philosophes, dont les opinions ou les principes servent à former les nôtres, étaient tous, en effet, des possesseurs d'esclaves. [I-5] Aristote, Platon, Cicéron, Papinien, Paul, Ulpien, possédaient, à titre de propriétaires, un nombre plus ou moins considérable d'hommes, d'enfans et de femmes. Ils ne doutaient pas que cette espèce de propriété ne fût très-légitime, et ils auraient regardé comme un mauvais citoyen celui qui aurait attaqué les institutions propres à garantir la durée de l'esclavage. Les empereurs romains et ceux de Constantinople, dont les décrets sont descendus jusqu'à nous, ne possédaient pas seulement quelques hommes, ils possédaient des nations entières, et croyaient en avoir la propriété. Enfin, sous le régime féodal, l'esclavage existait comme chez les Romains: le cultivateur était considéré comme faisant partie du champ auquel il était attaché. Plus tard, les nations ont été considérées comme des propriétés de famille, dont on a disposé par des traités ou par testament, comme nous disposons de nos troupeaux [2].
Ainsi, tandis que nous sommes portés, par la nature de notre état social, à faire disparaître les derniers vestiges de la servitude, nous nous pénétrons des doctrines de l'esclavage domestique, de la servitude féodale, du despotisme militaire, et [I-6] de l'état sauvage. La domination qu'exerçaient les patriciens romains sur leurs esclaves, a cessé d'exis ter depuis des siècles; les diverses races de barbares qui avaient attaché les cultivateurs à la glèbe, se sont éteintes ou ont perdu une grande partie de leur puissance: mais les doctrines des uns et des autres sont encore pleines de vie; nous en formons une partie essentielle de l'enseignement des lois et de la morale; nous les apprenons dès notre enfance dans nos écoles; nous les invoquons dans nos cours de justice.
Cependant toutes leurs lois n'étaient pas vicieu ses, toutes leurs doctrines n'étaient pas des erreurs; on trouve, au contraire, dans leurs codes des décisions pleines de justesse, et dans leurs livres des maximes pleines de vérité. Mais l'ordre de choses au milieu duquel ils étaient placés, ne leur permettait pas de remonter aux véritables principes des lois et de la morale, et d'en suivre les conséquences. Ils n'auraient pu fonder les droits et les devoirs de chaque individu sur la nature même de l'homme, sans mettre leurs doctrines en opposition avec leurs pratiques, et sans proclamer l'illegitimité de l'esclavage. Ils étaient ainsi dans la nécessité d'admettre certains principes dont ils faisaient le fondement de leurs droits, et dont ils n'auraient pu démontrer la vérité.
Comment, par exemple, des hommes qui [I-7] considéraient la partie la plus considérable de leurs semblables comme des choses dont ils pouvaient user et abuser sans violer aucun droit, auraient-ils pu, dans la pratique, admettre qu'il existait des droits et des devoirs inhérens à la nature humaine? Comment auraient – ils admettre pu que les devoirs d'une femme envers son mari, ou d'un mari envers sa femme, résultaient de leur propre nature, quand ils proclamaient que des hommes ou des femmes que la force avait asservis, n'avaient ni devoirs à remplir, ni droits à exercer? Comment auraient-ils pu, sans se mettre en contradiction avec eux-mêmes, reconnaître les devoirs d'une mère envers ses enfans, ceux des enfans envers leur mère, quand ils proclamaient qu'il n'existait aucun devoir de famille pour les êtres humains nés ou tombés dans la servitude?
Aux yeux de tous les hommes qui ont attentivement observé comment les peuples se développent, il est évident, ainsi qu'on le verra plus loin, que la propriété naît du travail. Si l'on n'admet pas qu'un homme ne peut légitimement avoir d'autre maître que lui-même, et que chacun est le propriétaire du fruit de ses travaux, tant qu'il ne l'a pas volontairement aliéné, il est impossible de trouver un fondement solide à la propriété. Il faut la faire reposer exclusivement sur les actes des gouvernemens, auxquels on donne le nom de lois; mais [I-8] sur quelle base fera-t-on reposer ces actes, et à quel signe en reconnaîtra - top la justice? Il est bien évident cependant que les peuples dont les lois et les maximes sont parvenues jusqu'à nous, n'admettaient pas, et ne pouvaient même pas admettre que, suivant les lois de notre nature, chacun est maître du produit de ses travaux. Ils n'existaient, au contraire, qu'au moyen des travaux des hommes qu'ils avaient faits esclaves; et cette manière de vivre n'avait rien d'illégitime à leurs yeux.
Pour découvrir les lois suivant lesquelles les nations prospèrent ou dépérissent, et les droits et les devoirs qui sont inhérens à notre nature, il était donc nécessaire d'observer les divers états par lesquels les nations ont passé, avant que d'arriver au point où nous les voyons, et de substituer ainsi l'observation des faits à l'étude des doctrines, ou des systèmes imaginés pour les justifier. En suivant cette méthode, j'ai fait voir qu'il n'y a ni progrès ni prospérité possibles, soit dans l'état que quelques écrivains ont appelé de nature, soit dans l'état d'esclavage domestique ou politique; j'ai démontré de plus qu'un état dans lequel les hommes tenteraient de mettre en commun les biens qui résultent de leurs travaux, ne différerait que de peu de l'esclavage proprement dit. Il me reste maintenant à observer ce qui arrive quand chacun n'a d'autre maître que soi-même, et que nul ne peut [I-9] s'approprier impunément les fruits du travail d'autrui. Comme il est impossible de découvrir les lois auxquelles la nature humaine est assujétie, autrement que par une exacte observation des faits, et comme la liberté est une condition essentielle de l'exercice de nos droits et de l'accomplissement de nos devoirs, il importe de bien nous convaincre qu'il n'y a rien de plus contraire à notre nature que la servitude, et de nous faire des idées bien exactes de ce qui constitue la liberté. Qu'il me soit donc permis de rappeler, dans le chapitre suivant, les effets qui sont la suite inévitable des divers genres d'esclavage auquel les hommes peuvent être assujétis. Si ces effets étaient contestés, il n'y aurait pas moyen d'avancer dans la recherche des lois auxquelles nous sommes soumis par notre nature; il n'y aurait pas moyen surtout de trouver les véritables fondemens de la propriété.
[I-10]
CHAPITRE II.
De la liberté considérée comme une condition de l'exercice de tous les droits, et de l'accomplissement de tous les devoirs.↩
EN observant les effets que produisent, sur les diverses classes de la population, l'esclavage politique et l'esclavage domestique, j'ai constaté plusieurs vérités importantes que je dois rappeler ici, parce qu'elles me serviront de point de départ pour me livrer à des observations nouvelles.
Sous l'un et l'autre de ces deux régimes, les facultés physiques des esclaves se dégradent ou ne se développent que d'une manière imparfaite; les facultés physiques des maîtres ne s'exercent généralement que pour assurer la durée de la servitude, ou pour faire de nouveaux esclaves.
Chez les maîtres, les passions violentes et cruelles se développent en même temps que l'amour des plaisirs sensuels; chez les esclaves, ce sont les passions viles; chez les uns et chez les autres, les affections bienveillantes restent engourdies, ou ne s'étendent que sur un petit nombre de personnes.
Les hommes asservis exercent leurs facultés intellectuelles dans l'art de tromper leurs maîtres [I-11] et de se soustraire à leur violence; ceux-ci exercent surtout les leurs dans l'art d'affermir leur domination, ou de l'étendre sur un plus grand nombre de personnes.
Les premiers, chargés de l'exécution de tous les travaux nécessaires à l'existence de l'homme, vivent dans une profonde misère, et n'ont aucun moyen d'en sortir; les seconds vivent dans l'oisiveté, consomment ou dissipent presque tout ce que les premiers ont produit.
L'industrie ne pouvant se développer, ni les richesses s'accroître, le nombre de la population reste stationnaire; souvent elle décroît dans la même proportion que les moyens d'existence.
Les esclaves n'ayant pas de plus cruels ennemis que leurs maîtres, sont les alliés naturels de tous ceux qui leur font espérer leur affranchissement ou le relâchement des liens de la servitude: ils sont donc toujours disposés à devenir les instrumens des ambitieux de l'intérieur ou des ennemis étrangers.
Enfin, le voisinage d'un peuple qui se divise en maîtres et en esclaves suffit pour corrompre les peuples chez lesquels tous les hommes sont libres, et pour compromettre leur indépendance et leur liberté.
De ces faits et de la tendance du genre humain vers son développement et son bien-être, j'ai tiré la conséquence que la servitude est un état contre [I-12] nature; qu'elle est en opposition directe avec les lois qui portent les nations vers leur développement et leur prospérité, et qu'un homme, et à plus forte raison un peuple, ne peuvent jamais être placés légitimement au rang des propriétés.
Si l'infraction de ces lois est toujours suivie de peines graves pour ceux qui s'en rendent coupables, et pour ceux qui la souffrent, et si c'est un devoir pour les hommes de se conformer aux lois de leur nature, il s'ensuit que chacun est tenu de respecter et de faire respecter la liberté de tous, et que tous sont tenus de faire respecter la liberté de chacun.
L'existence d'un devoir suppose un droit correspondant: si les lois auxquelles les hommes sont soumis par leur nature me font un devoir de respecter la liberté de mes semblables, chacun a le droit de me contraindre à respecter la sienne, et le droit qui appartient à chacun appartient à tous.
Un homme ne peut pas, disons-nous, en traiter un autre comme sa propriété, sans violer les lois de sa propre nature; mais il ne peut pas non plus, sans violer les mêmes lois, et sans se rendre complice des vices et des crimes qu'enfante la servitude, permettre qu'on le fasse esclave, c'est-à-dire qu'on le mette au rang des choses.
Se reconnaître esclave, ce n'est pas seulement abdiquer ses droits, c'est renoncer de plus à [I-13] l'accomplissement de ses devoirs; c'est reconnaître qu'on n'est tenu à rien, ni envers soi-même, ni envers les autres; c'est proclamer une contradiction: car si, par sa nature, l'homme n'est tenu à rien, ni envers lui-même, ni envers autrui, comment pourrait-il être tenu à quelque chose envers un maître?
On ne serait pas plus avancé si, refusant de reconnaître les devoirs auxquels l'homme est soumis par sa nature, on prétendait que l'esclave est lié envers son maître par une convention expresse ou tacite ; car, en supposant l'existence d'un tel engagement, sur quoi fonderait-on le devoir général de l'exécuter, s'il n'existait aucun devoir supérieur à toute sorte de conventions?
Repousser la servitude, soit qu'elle pèse sur soi-même, soit qu'elle pèse sur autrui, ce n'est donc pas seulement exercer un droit, c'est remplir le premier et le plus sacré des devoirs. L'abdication de la liberté, fût-elle un acte entièrement volontaire, ne saurait être obligatoire pour personne; il y aurait contradiction à s'imposer le devoir de ne reconnaître aucun devoir. Les lois auxquelles l'homme est soumis par sa nature ne sauraient rendre obligatoire l'engagement d'enfreindre ces mêmes lois.
Nous ne pouvons donc pas admettre que, suivant les lois de sa nature, un homme a des devoirs [I-14] à remplir envers lui-même, envers ses parens, envers sa femme, envers ses enfans, enfin envers l'humanité, sans admettre en même temps que les mêmes lois l'appellent à être libre; que, dans aucun cas, il ne peut légitimement être réduit en esclavage, c'est-à-dire être traité comme une propriété, et que sa liberté ne peut être restreinte qu'autant que cela est indispensable pour assurer la liberté d'autrui.
L'idée de devoir est, en effet, inséparable de l'idée de liberté, puisqu'il est impossible de concevoir, / d'une part, l'existence d'un devoir à remplir, et, d'un autre côté, le droit d'en empêcher l'accomplissement ou d'en commander la violation Or, si l'on n'admet pas ce droit dans l'individu qu'on appelle un maître, il n'y a plus d'obligation envers lui dans celui qu'on nomme un esclave; c'est-à-dire que l'esclavage se réduit à rien.
Si l'on prétendait que, par leur nature, les hommes ne sont soumis à aucune loi, et que, par conséquent, il n'existe entre eux aucun devoir réciproque, il serait encore impossible d'admettre qu'un homme puisse être la propriété d'un autre homme. On ne saurait nier l'existence de tous les devoirs, sans nier par cela même l'existence de tous les droits, car les premiers supposent nécessairement les seconds: or, quand on nie les droits, il n'y a plus moyen de soutenir l'existence de la [I-15] propriété, ni par conséquent la légitime possession d'un homme par un autre.
Les devoirs et les droits d'une personne, soit envers elle-même, soit envers les autres, sont inhérens à sa nature, et ne résultent pas de conces sions faites par quelqu'un de ses semblables. Si un père a des devoirs à remplir envers son fils, un fils envers son père, un mari envers sa femme, ou une femme envers son mari, ces devoirs dérivent de certaines relations ou d'un certain ordre de faits; ils ne sont pas, comme on l'a déjà vu, et comme on le verra mieux encore par la suite, les produits de la puissance d'un gouvernement; les lois qui les engendrent ont une existence aussi indépendante des volontés de l'autorité publique, que les lois du monde physique.
Les mêmes lois qui s'opposent à ce qu'un être humain soit mis au rang des choses et traité comme une propriété, s'opposent, à plus forte raison, à ce qu'un peuple soit considéré comme la propriété d'un individu, d'une famille ou d'une caste. L'observation des effets de l'esclavage politique nous a convaincus, en effet, que, suivant les lois de sa nature, une nation a des devoirs à remplir envers elle-même, envers les divers membres dont elle se compose, et envers les autres nations, et qu'elle a par conséquent des droits à exercer. Ces droits et ces devoirs réciproques d'une nation envers chacun [I-16] de ses membres ou envers d'autres peuples, ne sont pas moins indépendans des volontés humaines, que ceux qui existent entre les membres d'une famille. Ils ne peuvent pas plus être détruits par la force ou par une abdication volontaire que ceux d'une seule personne; on peut dire pour une nation ce que nous avons dit pour un individu, que l'engagement de ne pas remplir ses devoirs ne saurait engendrer aucun devoir. Tout obstacle mis à la liberté d'une nation est donc illégitime; c'est un devoir pour chacun de contribuer à le faire disparaître.
J'ai fait observer ailleurs que, quelle que soit la marche qu'on se propose de suivre dans l'abolition de l'esclavage domestique, il est un principe qu'il faut d'abord admettre sans restriction, parce qu'entre l'erreur et la vérité il n'y a pas d'intermédiaire.
« Il ne faut point, ai-je dit, partir du fait mensonger qu'un être humain est une chose, ou un quart de chose, ou un huitième de chose; il faut reconnaître franchement ce qui est, c'est-àdire qu'il est une personne ayant, suivant les lois de sa nature, des devoirs à remplir envers lui-même, envers son père, sa mère, sa femme, ses enfans et l'humanité tout entière. »
Or, ce que j'ai dit ailleurs de la personne qu'on appelle un esclave, en le comparant à une autre personne qu'on appelle un maître, je dois le dire de ces collections de [I-17] auxquelles on donne le nom de peuples ou de nations, en les comparant aux individus ou aux familles qui prétendent les posséder comme on possède des terres ou des troupeaux. Quelle que soit la marche qu'on se propose de suivre pour tirer un peuple d'un état dans lequel il est considéré comme une propriété, il est une vérité qu'il faut d'abord reconnaître : c'est qu'une nation, comme un individu, est soumise à des lois qu'elle ne peut pas impunément laisser enfreindre, et qu'elle a par conséquent des devoirs à remplir et des droits à exercer. Cette vérité reconnue, il ne s'agit plus que de découvrir quels sont ces droits et ces devoirs; et s'ils sont une fois établis et respectés, l'esclavage politique est aboli.
La liberté civile et la liberté politique sont donc des conditions essentielles de l'exercice de tous les devoirs, et par conséquent de tous les droits; la servitude domestique et la servitude politique en sont, au contraire, la négation et la ruine. On a vu la démonstration indirecte de ces deux vérités dans l'exposition que j'ai faite des effets des divers genres d'esclavage; on en verra la démonstration directe, en observant les rapports naturels qui existent, soit entre les personnes et les choses, soit entre les divers individus dont le genre humain se compose. Si nous observons exactement en quoi consistent les droits et les devoirs de toute personne et de [I-18] toute agrégation de personnes, nous saurons ce qui constitue la liberté civile et politique; en observant les divers élémens qui constituent la liberté, nous arriverons également à la découverte des devoirs et des droits qui sont inhérens à notre nature.
L'observation des divers effets de l'esclavage politique et de l'esclavage civil nous a fait voir comment les peuples restent stationnaires ou se dégradent; en observant les élémens divers qui constituent la liberté, et les conséquences qu'elle produit, nous verrons, au contraire, comment les nations se développent et prospèrent. Il faudra cependant ne jamais perdre de vue que les hommes ne sont pas soumis à la seule influence de l'esclavage où de la liberté : j'ai fait voir ailleurs qu'ils sont placés sous l'influence d'une multitude de causes. Il est des positions et des circonstances où une nation ne saurait prospérer même quand elle jouirait de toute la liberté imaginable; il en est d'autres où un peuple jouit d'une certaine prospérité, quoiqu'il ne soit pas libre. Dans ce dernier cas, ce n'est pas à cause de la servitude à laquelle il est soumis, qu'il jouit de quelque bien-être, c'est malgré elle; dans le premier, c'est malgré la liberté, et non à cause d'elle, qu'il est misérable [3].
[I-19]
CHAPITRE III.
De ce qui constitue la liberté↩
A MOINS de nous mettre en contradiction avec nous-mêmes, nous ne pouvons pas admettre qu'il existe des droits et des devoirs inhérens à notre nature, sans considérer en même temps comme illégitimes tous les élémens qui constituent l'esclavage civil et politique. Nous devons donc, avant d'aller plus loin, nous faire des idées bien nettes de l'état auquel nous donnons le nom de liberté; car, pour nous, la liberté est la condition essentielle de l'exercice de tout droit, et de l'accomplissement de tout devoir.
Les philosophes et les jurisconsultes ont défini la liberté de diverses manières : dans cet ouvrage, ce mot désigne simplement l'état d'une personne qui ne rencontre, dans ses semblables, aucun obstacle, soit au développement régulier de son être, soit à l'exercice innocent de ses facultés. Si cette définition présentait quelque obscurité, il suffirait, pour la faire disparaître, de se rappeler ce que j'ai dit ailleurs sur le perfectionnement des diverses facultés de l'homme.
[I-20]
La liberté ne peut donc se définir d'une manière exacte et complète que par des négations: pour dire clairement ce qu'elle est, il faut savoir quels sont les élémens dont la présence suffit pour rendre une personne ou une nation esclave, et supposer ensuite que ces élémens ont successivement disparu. Cette manière de la définir peut ne paraître d'abord qu'une vérité triviale; cependant, si la définition était complète, il pourrait se trouver, parmi ceux qui l'auraient condamnée comme une vérité trop vulgaire, des gens qui ne l'admettraient pas sans restriction. On voudrait bien ne pas mettre des êtres humains au rang des propriétés, parce qu'on ne peut pas considérer la nature et les effets de l'esclavage, sans être convaincu qu'il fait descendre l'homme au-dessous de la brute; mais on voudrait bien aussi ne pas en proscrire tous les élémens, parce qu'on a peur de la liberté, et qu'on est encore dominé par les idées et les habitudes de la servitude [4].
Il y a deux choses à considérer dans l'esclavage: la fin et les moyens. La fin est de donner à un homme qu'on appelle un maître, la faculté de [I-21] vivre gratuitement sur les produits des travaux d'un ou de plusieurs autres qu'on nomme des esclaves, et de faire servir leurs personnes à la satisfaction de ses plaisirs. Les moyens, qui sont nombreux et variés, consistent à agir sur les hommes asservis, de manière qu'ils soient obligés de produire ce que leurs possesseurs désirent, et qu'ils ne puissent ni se défendre, ni se sauver par la fuite.
L'abolition de l'esclavage exige donc deux choses: la première, qu'il soit reconnu, en principe, qu'un être humain n'est jamais la propriété d'un autre, et que chacun est le maître des produits de son travail; la seconde, que les moyens à l'aide desquels un ou plusieurs hommes peuvent s'emparer, dans leur intérêt, des produits des travaux d'un ou de plusieurs autres, ou de leurs personnes, soient complétement abolis.
Le principe de l'esclavage, disons-nous, est qu'un homme peut en posséder légitimement un autre, s'emparer du produit de ses travaux, et faire servir sa personne à ses plaisirs ou à ses caprices : le principe de la liberté est, au contraire, qu'un homme ne peut jamais être légitimement possédé [I-22] par un autre, et que les produits de ses travaux n'appartiennent qu'à lui, tant qu'il ne les a pas librement aliénés.
Dans l'état d'esclavage, l'homme qui s'appelle un maître, et qui n'a pas assez de force pour dépouiller ceux qu'il nomme ses esclaves, ou pour disposer d'eux selon ses plaisirs, trouve un appui chez les personnes investies de l'autorité publique: dans l'état de liberté, l'homme qui n'a point par lui-même assez de puissance pour se mettre à l'abri des violences ou des extorsions, est protégé par les forces réunies de la société.
Sous le régime de la servitude, les hommes qui se disent des maîtres, se constituent les directeurs des travaux de ceux qui sont appelés des esclaves : sous le régime de la liberté, chacun choisit les occupations qui lui conviennent; chacun travaille ou se repose sans consulter d'autres règles que ses besoins et ses intérêts.
Sous le régime de la servitude, les rapports entre les membres d'une famille, entre la femme et le mari, les parens et les enfans, sont réglés, pour les esclaves, par les volontés ou les caprices des maîtres : sous le régime de la liberté, les mêmes rapports sont réglés, pour toutes les classes de la population, par les lois inhérentes à la nature de l'homme, par ce qui convient à la prospérité et au bonheur de tous.
[I-23]
Dans l'état de servitude, les maîtres façonnent à leur gré l'intelligence et les mœurs des esclaves; ils leur donnent, dès l'enfance, les idées et les habitudes les plus propres à perpétuer l'esclavage: dans l'état de liberté, chacun développe son intelligence et celle de ses enfans comme il convient à leur bienêtre commun; chacun enseigne cu apprend ce que son intérêt et celui de ses semblables lui commandent d'apprendre ou d'enseigner.
Partout où l'esclavage existe, les maîtres, pour garantir leur sûreté et la durée de leur domination, interdisent aux hommes asservis tout exercice propre à développer leur adresse et leurs forces physiques; ils interdisent au plus grand nombre l'usage et la possession des armes, ne les permettant qu'à ceux dont le dévouement leur est assuré, et qu'ils emploient à contenir les autres : sous le régime de la liberté, tout homme exerce et développe ses forces selon que son intérêt et celui de ses concitoyens l'exigent; chacun possède les armes qu'il croit nécessaires à sa sûreté ou à son amusement, s'il est assez riche pour se se les procurer.
Dans les pays où l'esclavage existe, les maîtres assignent à chaque esclave un espace d'où.il lui est interdit de sortir, à moins d'une permission spéciale qui indique le lieu où il doit se rendre; l'esclave qui sort de l'espace dans lequel il est circonscrit, ou qui s'écarte de la route qui lui est tracée, est [I-24] ramené à son maître par la force publique : partout où la liberté existe, chacun se transporte dans les lieux où ses intérêts l'appellent, sans avoir besoin d'en demander la permission; nul n'est arrêté, si ce n'est sur l'accusation d'un crime, ou pour l'acquittement d'une obligation légalement contractée [5].
Les possesseurs d'esclaves empêchent, autant qu'ils le peuvent, qu'il ne se forme aucune sorte d'association entre les hommes asservis ; ils supposent, non sans raison, que s'ils pouvaient s'entendre entre eux, tous leurs efforts tendraient vers la destruction de l'esclavage: des hommes libres s'associent toutes les fois que leur intérêt l'exige, sans en demander la permission à personne : ils délibèrent sur leurs intérêts communs aussi souvent qu'ils le jugent convenable, et tant qu'ils ne portent pas atteinte aux bonnes mœurs ou aux droits d'autrui, nul ne les trouble dans leurs réunions.
Des maîtres ne permettent pas à leurs esclaves de développer à leur gré l'intelligence de leurs [I-25] enfans, ou de former leurs mœurs; ce sont eux-mêmes, au contraire, qui déterminent cé que doivent savoir ou ignorer, aimer ou haïr les enfans des hommes possédés : des hommes libres considèrent comme un de leurs droits les plus précieux, comme un des devoirs les plus sacrés, celui de former les mœurs et de diriger l'éducation de leurs enfans.
Les maîtres ne laissent à leurs esclaves aucune influence sur le choix des agens à l'autorité desquels ils les soumettent; l'exploitation étant toute dans leur intérêt, ils ne la confient qu'à des gens bien déterminés à faire de cet intérêt la règle de leur conduite : des hommes libres ne s'en remettent jamais qu'à eux-mêmes du choix des agens auxquels ils confient une partie de leurs intérêts; s'ils ne les nomment pas directement, ils en donnent du moins le choix à des hommes qu'ils ont investis de leur confiance.
Dans le système de l'esclavage, un maître ne rend aux hommes qu'il possède aucun compte de la manière dont il exerce ou fait exercer son pouvoir sur eux; ses agens sont responsables envers lui de la manière dont ils remplissent leur mandat; mais ils ne sont soumis à aucune responsabilité relativement à la population asservie: sous le régime de la liberté, tout homme qui exerce un pouvoir quelconque sur ses semblables, est responsable envers [I-26] eux de l'usage qu'il en fait; il ne peut porter aucune atteinte à leurs intérêts ou à leurs droits, sans être tenu de réparer le dommage qu'il leur a causé.
Dans le système de l'esclavage, le pouvoir ou l'autorité que le maître exerce sur ses esclaves est une propriété qui se transmet de père en fils comme un meuble ou une terre sous le régime de la liberté, l'autorité qu'un homme exerce sur ses semblables ne peut être ni vendue, ni léguée, ni transmise, comme propriété, à titre de succession: elle n'est dans ses mains qu'à titre de dépôt.
Sous le régime de l'esclavage, le mérite et le démérite des actions des hommes asservis, se mesurent, ou par les avantages que le maître et les membres de sa famille retirent de ces actions, ou par le préjudice qu'elles leur causent: sous le régime de la liberté, les actions des hommes sont jugées suivant leur nature; elles sont approuvées ou condamnées selon le principe qui les produit, et les conséquences bonnes ou mauvaises qui en résultent pour l'humanité.
On pourrait pousser plus loin ce parallèle; mais on trouverait toujours que la liberté consiste dans la destruction des principes et des moyens qui constituent la servitude: on verrait qu'elle s'établit et se conserve par des moyens directement [I-27] opposés à ceux qui constituent et conservent l'esclavage.
Il ne faut pas, au reste, pour juger du degré d'esclavage ou de liberté qui existe dans un pays, s'arrêter aux dénominations données aux hommes ou aux institutions. Il n'est pas nécessaire qu'un individu s'appelle un maître, un planteur ou un sultan, pour être un possesseur d'hommes, et pour en avoir les mœurs ou les idées. Il n'est pas nécessaire non plus qu'un homme s'appelle un serf, un esclave ou un fellah, pour être possédé, et pour éprouver tous les effets de l'esclavage. Il suffit, pour que la servitude existe dans un pays, qu'il y ait des hommes qui exercent sur leurs semblables les pouvoirs qu'un propriétaire exerce sur sa propriété.
La servitude peut être plus ou moins étendue : quand un des élémens dont elle se forme vient à disparaître, la faculté dont l'homme possédé recouvre l'exercice, se nomme une liberté; on dit qu'il possède des libertés, quand l'exercice innocent de plusieurs de ses facultés lui a été rendu; on dit qu'il est libre ou qu'il possède sa liberté, quand tous les élémens dont l'ensemble constitue la servitude, ont complétement disparu : il est aisé de comprendre maintenant comment la plupart des peuples ont des libertés, et comment il en est si peu qui jouissent de la liberté.
[I-28]
Ayant exposé la nature et les effets de l'esclavage; ayant démontré qu'un tel état est la négation de toute espèce de droits et de devoirs ; ayant ensuite fait voir que l'état auquel nous donnons le nom de liberté, est celui dans lequel les hommes sont dégagés de tous les liens de la servitude, il me reste à rechercher quels sont les développemens que prennent les nations quand elles sont libres.
C'est en observant les phénomènes qui constituent la liberté, et ceux qui sont les conséquences naturelles d'un tel état, que nous apprendrons comment les nations prospèrent, et que nous parviendrons à connaître quels sont les droits et les devoirs de chaque personne, et des diverses agrégations de personnes, dont l'ensemble compose le genre humain.
Dans ces recherches, nous aurons à observer alternativement les rapports qui existent entre les hommes, et les choses au milieu desquelles ils sont placés, et entre les hommes et leurs semblables.
[I-29]
CHAPITRE IV.
De l'occupation des choses.↩
Le fait de s'emparer d'une chose qui n'a point de maîtres, avec l'intention de se l'approprier, a été considéré de tout temps par les jurisconsultes, comme un des principaux moyens d'acquérir la propriété [6]. Cependant, lorsqu'on observe comment se forme le patrimoine de chaque famille, on est rarement frappé des acquisitions qui se font par le simple fait de l'occupation. Chez une nation qui prospère, beaucoup de personnes acquièrent des propriétés par le travail et l'économie; mais [I-30] on n'en voit aucune qui s'enrichisse en s'emparant de biens qui sont toujours restés sans maîtres. Si l'occupation seule n'enrichit personne, cela ne tient pas à ce que depuis long-temps toutes les terres sont appropriées; car il existe encore des contrées immenses qui sont incultes, où les terres sont presque sans valeur, et où cependant peu de gens sont tentés d'aller chercher fortune. Les hommes qui se sont laissé séduire par l'espérance de s'enrichir ou seulement d'acquérir quelque aisance, en s'appropriant des terres qu'on leur donnait pour rien dans des pays inhabités, ont presque toujours expié par d'amers repentirs leur aveugle confiance.
Si l'on ne remarque jamais que le seul fait de s'emparer d'une chose qui n'a point de maîtres, avec l'intention de se la rendre propre, exerce sur les fortunes privées une influence considérable, on a quelque peine à comprendre, d'un autre côté, pourquoi, même aux yeux des peuples les moins éclairés, un tel acte suffit pour attribuer à une personne la disposition absolue de certaines choses, d'un espace de terre, par exemple. Comment tous les hommes peuvent-ils se croire à jamais privés de la faculté de jouir et de disposer d'un terrain par le seul fait qu'un homme ou une famille en ont déjà pris possession? N'aurait - il pas été plus raisonnable d'admettre avec Rousseau, que les fruits de la [I-31] terre appartiennent à tous; mais que le sol n'appartient à personne?
On conçoit qu'une nation admette en principe que le premier homme qui s'empare, sur le territoire national, d'une chose qui n'a point de maîtres, acquière par cela même le droit d'en jouir et d'en disposer, à l'exception de tous les autres hommes dont elle se compose. Une nation, quand elle a proclamé, les principes qu'elle juge utiles à ses intérêts, peut contraindre à les observer ceux de ses membres qui s'en écartent. La partie la moins éclairée ou la moins morale de la population peut être dirigée par la partie la plus morale et la plus instruite.
Mais les décrets d'un peuple ne sont obligatoires que pour ses membres, et pour les personnes qui se soumettent à ses lois, en s'établissant sur son territoire. Il n'existe au-dessus des nations aucun gouvernement commun pour proclamer les régles de la justice, et leur en commander l'observation, Toutes cependant admettent, non-seulement dans leur régime intérieur, mais dans leurs rapports mutuels, que le fait de l'occupation d'une chose qui n'appartient à personne, suffit pour rendre cette chose propre à celui qui s'en empare. Les conséquences qui dérivent de ce fait viennent donc de la nature des choses, des sentimens et des besoins généraux des hommes, et non [I-32] des déclarations ou de la volonté de tel ou tel gouvernement. On peut d'autant moins les attribuer aux déclarations d'un gouvernement ou d'un peuple quelconque, qu'elles sont certainement antérieures à la formation de tout gouvernement régulier.
Les choses qui assurent aux hommes des moyens d'existence, et que nous désignons sous le nom de propriétés, tirent de l'industrie humaine, secondée par les forces de la nature, presque toutes les qualités qui les rendent précieuses à nos yeux. On trouvera la démonstration de ce fait dans les chapitres suivans; elle est d'ailleurs peu nécessaire pour les hommes qui ont observé comment se forment les richesses. Mais, si l'industrie humaine donne aux choses dont nous avons besoin, et que nous mettons au rang des propriétés, les qualités qui les rendent précieuses à nos yeux, elle ne crée pas les élémens divers dont elles sont composées. Or, comment les nations ou les particuliers acquièrent-ils ces élémens, dont leurs propriétés sont formées? En s'en emparant les premiers, et avec l'intention de se les approprier, c'est-à-dire, par l'occupation.
L'importance d'une propriété ne s'évalue, ni par l'étendue, ni par le poids, ni par le volume; elle s'estime par les avantages qu'elle procure, par les services qu'on en attend. Les terres qui forment [I-33] aujourd'hui le territoire des Etats-Unis, n'étaient, il y a deux siècles et demi, qu'une vaste forêt parcourue par quelques tribus sauvages. L'industrie qui a transformé des choses sans valeur, et qui n'auraient pu servir à rien si elles étaient restées dans leur état primitif, en une multitude de propriétés précieuses, telles que des maisons, des manufactures, des fermes, des troupeaux et une infinité d'objets mobiliers, n'a pas créé un seul atome de matière. Elle s'est emparée des élémens divers que la nature lui offrait; elle les a combinés ou modifiés de diverses manières, et c'est de ces combinaisons ou de ces modifications, secondées par les forces de la nature, que sont nées toutes les propriétés sur lesquelles repose aujourd'hui l'existence de cette nation. Or, il est évident que, si l'occupation de ces divers élémens n'en avait pas assuré la jouissance et la disposition exclusives aux premiers occupans, il n'y aurait pas eu de progrès possible. Les propriétés qui existent n'auraient pas été formées, ni par conséquent le peuple qui vit au moyen de ces propriétés. On peut, au reste, faire sur tous les peuples la même observation que je viens de faire sur les Anglo-Américains; entre les uns et les autres, il n'y a de différence que le plus ou moins de rapidité dans le développement.
L'occupation d'une chose qui n'a point de maîtres [I-34] peut être considérée dans les rapports de nation à nation; dans les rapports d'un particulier avec la nation dont il fait partie, et dans les rapports d'une personne avec une autre.
Une nation ne saurait avoir de meilleurs titres à la place qu'elle occupe sur la surface du globe, que de s'en être emparée la première, de l'avoir mise en culture, d'avoir créé les richesses qui y sont répandues, et de s'y être développée. Il serait difficile de trouver des titres plus anciens, plus respectables et plus universellement respectés; le peuple qui les contesterait, ne saurait en trouver d'autres que la force. Aussi, n'arrive-t-il jamais qu'une nation conteste à une autre la propriété du territoire qu'elle a toujours possédé, qu'elle a mis en état de culture, et sur lequel elle s'est développée.
On a vu, sans doute, des peuples plus ou moins barbares en dépouiller d'autres d'une partie de leur territoire; mais jamais ces spoliations n'ont eu lieu, parce que le principe de l'occupation n'était pas reconnu elles ont été exécutées, tantôt comme une réparation des dommages causés par la guerre, tantôt pour mettre en culture des terres dont les possesseurs ne savaient pas tirer parti, tantôt pour se procurer des moyens d'existence et échapper ainsi à la destruction.
Les événemens de ce genre sont devenus d'ailleurs [I-35] de plus en plus rares, à mesure que la terre a été mieux cultivée, et que les peuples se sont civilisés : il est douteux qu'ils se renouvellent à l'avenir. Des peuples peuvent encore être asservis par les armées d'un gouvernement étranger; mais on ne verra plus des populations expulsées de leur territoire, et condamnées à périr ou à chercher au loin des terres pour s'établir. İl ne faut pas oublier d'ailleurs que la violation d'une loi de notre nature, ne prouve rien contre l'existence de cette même loi.
Les jurisconsultes qui ont voulu expliquer comment le simple fait de s'emparer le premier d'une chose qui n'a point de maître, suffit pour en attribuer à celui qui s'en saisit, la jouissance et la disposition exclusives, au préjudice de tous les autres hommes, ont été fort embarrassés. Ils ont prétendu qu'avant la division de la terre en propriétés nationales ou privées, chacun avait à tout un droit égal à celui des autres hommes. Ils ont ensuite supposé une convention entre tous les peuples et tous les individus dont le genre humain se compose, par laquelle chacun avait renoncé à son droit universel surtout, pour 'acquérir un droit exclusif sur certaines choses. Dans ce système, chaque nation et chaque personne aurait dit à toutes les autres : je renonce aux droits que j'ai sur la terre entière, à condition que chacun de vous [I-36] renonce, de son côté, aux choses dont je me serai emparée la première [7].
Cette supposition d'un droit universel de chaque peuple et de chaque personne, sur toutes choses, est une véritable chimère ; les hommes qui l'auraient adoptée, et qui auraient voulu la respecter, se seraient condamnés à périr. Ils se seraient mis, en effet, dans la nécessité de réunir le genre humain en congrès, pour obtenir de lui l'autorisation de s'emparer du fruit ou de l'animal nécesşaire à leur subsistance. Par quel raisonnement serait on parvenu à démontrer à un habitant, du Pérou qu'il ne pouvait cueillir le fruit qui croissait sous sa main, sans porter atteinte aux droits des habitans de la Sibérie? Comment aurait-on fait comprendre à un habitant du Kamtschatka qu'il ne pouvait se vêtir de la peau d'un animal, sans blesser les droits des Arabes? Comment s'y serait-on pris pour faire voir aux Gaulois qu'ils ne pouvaient, en conscience, mettre en culture les plaines de l'Auvergne, sans en avoir obtenu la permission des habitans du Thibet?
[I-37]
La convention par laquelle chaque peuple ou chaque personne aurait renoncé à son droit sur toutes choses, pour obtenir la jouissance et la disposition exclusives de certains objets particuliers, n'est pas moins chimérique que ce prétendu droit universel. Cette supposition mensongère, à l'aide de laquelle des juristes ont tenté d'expliquer un phénomène dont ils ne pouvaient rendre raison, est beaucoup plus inexplicable, plus dificile à concevoir que les faits même qu'il s'agissait de faire comprendre. Une convention entre tous les individus dont le genre humain se compose, est, en effet, une chose impossible, inintelligible. Après en avoir supposé l'existence, il faudrait, d'ailleurs, supposer qu'elle se renouvelle toutes les fois qu'une personnne vient au monde, ou arrive à l'àge de raison. Enfin, il serait absurde de croire que, si des nations sont placées sous les plus durs climats, et si des millions d'hommes naissent, vivent et meurent dans la misère, c'est par suite d'une convention qu'ils ont volontairement faite ou acceptée, et par laquelle ils ont renoncé, pour rien, au droit qu'ils avaient sur toutes choses.
On n'a supposé une convention entre tous les hommes pour déterminer les conséquences du fait de l'occupation, que parce qu'on a pensé qu'il existait des motifs puissans pour faire une telle convention, et pour faire respecter ces conséquences. [I-38] Or, si l'on avait cherché et découvert ces motifs, on n'aurait pas eu besoin de recourir à une fausse supposition. Il aurait suffi de les exposer, pour faire connaître les causes qui déterminent les hommes à considérer l'occupation comme un des premiers moyens d'acquérir la propriété. On aurait vu que ces motifs agissent avec plus ou moins de force sur tous les hommes qui possèdent ou qui ont l'espérance d'acquérir quelques propriétés, tandis qu'une supposition de convention n'agit sur personne. Chaque peuple comprend, sans effort, que son existence repose sur la conservation du territoire sur lequel il s'est développé; mais quels sont les hommes qui s'avisent de prendre au sérieux une prétendue convention par laquelle la terre aurait été divisée, non-seule ment entre les nations, mais encore entre les individus dont chacune d'elles se compose?
J'ai fait voir ailleurs qu'il n'y a point de progrès possible pour le genre humain, tant que la terre reste abandonnée à sa fertilité naturelle, et que les hommes n'ont pas d'autres moyens d'existence que les produits bruts de la nature. Dans une telle position, la population réduite à quelques faibles peuplades qui errent sur des territoires d'une vaste étendue, demeure stationnaire; elle vit dans un état toujours voisin de la famine, et a tous les vices qui sont la suite ordinaire d'une excessive misère et [I-39] d'une profonde ignorance [8]. J'ai démontré, d'un autre côté, qu'un peuple, même quand il est peu nombreux, qui admet en pratique la communauté des travaux et des biens, se condamne par cela même à la plupart des vices et des privations qui résultent de l'esclavage [9]. Cette communauté, si funeste aux populations peu nombreuses qui l'ont adoptée sans pouvoir la réaliser complétement, serait inexécutable pour une nation de grandeur moyenne, et l'imagination ne saurait la concevoir entre plusieurs nations.
Mais s'il est vrai, d'un côté, que les hommes ne peuvent, ni se multiplier, ni se perfectionner, tant qu'ils laissent la terre dans un état inculte et sauvage; s'il est démontré, d'un autre côté, qu'ils ne peuvent faire aucun progrès dans l'état de communauté de travaux et de biens, il s'ensuit que l'appropriation, par des nations, des familles et des individus, des choses diverses sur lesquelles peut s'exercer l'industrie humaine, est une nécessité de notre nature; il s'ensuit que l'occupation et les faits qui en dérivent, sont au nombre des lois auxquelles tous les hommes sont soumis.
Il ne faut, pour donner à chaque chose les qualités qui peuvent nous la rendre utile, que les efforts d'un [I-40] nombre d'hommes déterminé. Une nation ne saurait travailler tout entière à la culture d'un champ, ou se mettre à la poursuite d'une pièce de gibier. D'un autre côté, une chose qui a reçu de l'industrie humaine les qualités que nous désirons y trouver, ne peut satisfaire qu'un nombre donné de besoins; on pourrait en diviser la valeur en fractions tellement petites, qu'elle ne serait réellement profitable à personne. Il est une multitude d'objets qui n'ont une véritable valeur qu'autant qu'ils peuvent être appliqués à satisfaire les besoins d'une personne ou d'une famille: les diviser, ce serait les déprécier ou les détruire. Il faut donc que chacun de ces objets reste la propriété exclusive d'une personne.
Mais quand une chose n'a jamais eu de maître, et qu'elle peut cependant satisfaire les besoins d'une personne, à qui doit-on en garantir la jouissance et la disposition exclusive? Au premier qui s'en empare, avec intention de se l'approprier; car il est probable qu'elle lui convient mieux qu'à toute autre personne, puisqu'avant tout autre, il s'en est emparé. Le fait de l'occupation exige toujours qu'on se livre à certains travaux, et ces travaux, quelque légers qu'ils soient, n'auraient pas lieu, s'ils devaient être improfitables. Celui qui prend possession d'une chose qui n'a point de maîtres, ne dépouille aucun homme de ses moyens d'existence, [I-41] ne porte atteinte aux espérances de personne. Si l'on privait un homme de la chose dont il s'est emparé, dans l'intention de se l'approprier, on tromperait son attente, en même temps qu'on diminuerait ses moyens d'exister. En considérant l'occupation des choses non encore appropriées, comme un des premiers moyens d'acquérir la propriété, les nations ont donc obéi à une loi de leur nature. Elles ont pris le seul parti qui pouvait don ner à chaque chose la plus grande utilité qu'elle pouvait avoir, en faisant le moins de mal possible.
Toute chose qui peut satisfaire un besoin, ou procurer une jouissance, et qui peut être exclusivement possédée, est susceptible d'être acquise par occupation; peu importe qu'elle soit animée ou inanimée, qu'elle soit mobilière ou immobilière.
On a, depuis long-temps, élevé la question de savoir si une nation qui découvre une mer, ne peut pas s'en emparer, et en acquérir la propriété, comme d'une île déserte, ou de toute autre terre non encore appropriée. Dans le seizième siècle, les Portugais, qui avaient fait la découverte d'un passage aux Indes par le cap de Bonne-Espérance, prétendaient avoir acquis la propriété de ce passage, et avoir, en conséquence, le privilége de commerce avec les Indiens par cette voie. Les [I-42] Hollandais refusèrent de reconnaître la légitimité de cette prétention, et réclamèrent la liberté des mers, sinon pour toutes les nations, au moins pour eux-mêmes. Grotius intervint dans cette querelle, et, dans un traité qu'il dédia à tous les princes et à tous les peuples libres de la terre chrétienne, il démontra que le principe de l'occupation n'était pas applicable aux mers [10].
Les mers, considérées sous le rapport de la navigation, ne sont qu'un moyen de communication entre divers points du globe, et ce moyen est le seul dont le commerce puisse faire usage. Un passage d'un point à un autre n'est, pour ainsi dire, qu'une vaste route qui n'exige aucune sorte d'entretien, et que toutes les nations peuvent parcourir en même temps, sans se gêner mutuellement. Comme il n'est au pouvoir de personne ni de la rendre meilleure, ni de la dégrader, une nation, quelque fréquent que soit l'usage qu'elle en fait, ne nuit en rien aux jouissances des autres. On ne rencontre donc ici aucune des circonstances qui font considérer l'occupation comme un moyen d'acquérir la propriété.
S'il s'était rencontré une terre qui, après avoir, sans culture, fourni des subsistances à une famille, [I-43] aurait fourni à l'infini et sans travail, à tous ceux qui auraient voulu en prendre, jamais les hommes n'auraient consenti à la soumettre au principe de l'occupation. Ce principe n'a pas eu d'autre objet, en effet, que de donner à toutes les choses auxquelles on l'applique, la plus grande utilité qu'elles peuvent avoir. En faire l'application aux mers qui servent aux nations de moyens de communication et de commerce, ce ne serait pas leur donner une utilité plus grande; ce serait, au contraire, en restreindre l'utilité dans un cercle infiniment petit. L'occupation, qui est un des élémens essentiels de toute propriété, et qui sert ainsi de base à l'existence de toutes les nations, aurait été funeste à l'espèce humaine, si elle avait été un obstacle aux communications des peuples entre eux.
Les mers, considérées comme moyens de transport, ne sont donc pas plus susceptibles d'être acquises par occupation, que les vents ou que la lumière du soleil; mais il ne faut pas conclure de là que les peuples ne peuvent s'en approprier aucune partie, pour pourvoir à leur sûreté ou à leur existence. On verra, au contraire, lorsque nous nous occuperons du territoire propre à chaque nation, que tous les peuples maritimes considèrent comme une propriété nationale une certaine étendue des mers qui les environnent; qu'ils s'en attribuent [I-44] exclusivement la pêche, et qu'ils déterminent les conditions sous lesquelles il est permis aux autres d'y naviguer.
Dans tous les pays, le principe de l'occupation a été admis en pratique long-temps avant que d'avoir été consacré par aucune disposition législative. La raison en est sensible : les peuples ne commencent à écrire leurs lois que lorsqu'ils ont fait quelques progrès dans la civilisation, et établi des gouvernemens plus ou moins réguliers. Avant que d'arriver là, il faut qu'ils aient des terres cultivées, des habitations, des vêtemens, en un mot, des propriétés au moyen desquelles ils puissent exister.
L'occupation la plus importante, celle qui a servi de base à la formation de toutes les propriétés privées, est celle du territoire sur lequel chaque nation s'est développée. Celle-là n'a jamais été ni pu être consacrée par des dispositions de lois écrites, puisqu'il n'existe pas de gouvernement qui serve de lien à tous les peuples, qui détermine leurs rapports 'mutuels, et s'interpose dans leurs querelles. Elle se règle donc, non par les déclarations spéciales de chaque peuple, mais par les principes qui fixent les rapports des nations les unes à l'égard des autres, et qu'on désigne sous le nom de droit international. Quant aux choses dont s'emparent des particuliers pour en faire des propriétés [I-45] privées, il faut distinguer celles qui ne se trouvent sur le territoire d'aucun peuple, de celles qui se trouvent sur le territoire qu'une nation s'est déjà approprié. L'occupation des premiers est réglée par les principes du droit international; l'occupation des secondes, par les lois particulières à chaque peuple.
Il ne paraît pas que les Romains aient cru nécessaire de consacrer le principe de l'occupation par des dispositions législatives, avant les compilations faites par quelques-uns de leurs empereurs. Les jurisconsultes avaient reconnu l'existence de ce principe, et en avaient fait l'application à quelques cas particuliers, et leurs décisions furent recueillies dans la compilation faite par les ordres de Justinien. Ces décisions sont, au reste, des applications si simples et si naturelles du principe, qu'elles n'en sont que la consécration. Les unes s'appliquent à la capture de certains animaux sauvages, les autres, à l'occupation de certains fonds de terre. Les jurisconsultes romains admettent que tout animal sauvage devient la propriété de celui qui s'en empare le premier, quel que soit d'ailleurs le fonds sur lequel il est pris. Ils admettent également que toute perle, toute pierre précieuse, ou tout autre objet, trouvé sur le rivage de la mer, est la propriété du premier occupant. Enfin, ils déclarent que toute île qui se forme au milieu de la mer [I-46] devient la propriété du premier qui s'en met en possession : nullius enim esse creditur [11].
Le Code civil, en déclarant que tous les biens vacans et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public [12], semble avoir exclu la possibilité de toute occupation nouvelle par des particuliers, au moins sur le territoire national. Cependant on acquiert toujours par ce moyen les animaux sauvages qu'on prend à la chasse, et les poissons qu'on prend dans la mer ou dans les fleuves; nous suivons, à cet égard, les mêmes pratiques que les Romains. On peut même mettre raisonnablement en doute si un agent du domaine public serait admis à revendiquer, comme appartenant à l'État, une perle ou une pierre précieuse qu'un particulier aurait trouvée sur le rivage de la mer, et dont il se serait emparé. Si le principe de l'occupation n'était pas admis dans un pareil cas ou dans des cas analogues, il arriverait peut-être que quelques personnes seraient privées de quelques petits avantages; mais l'État n'en serait pas plus riche.
Les Anglais et les Anglo-Américains ont admis [I-47] le principe proclamé par les jurisconsultes romains, quoiqu'ils n'en aient pas fait l'application aux mêmes cas [13].
Il ne faut pas confondre, au reste, une chose dont le propriétaire n'est pas connu, avec une chose qui n'appartient à personne. Il n'est pas rare qu'un homme perde un objet mobilier d'une valeur plus ou moins considérable, ou qu'un animal domestique s'égare, de manière que le propriétaire ne sache plus où le trouver. L'occupation de tels objets ne confère pas à l'occupant le droit d'en jouir ou d'en disposer : elle lui impose l'obligation d'en chercher le propriétaire et de les lui rendre, ou de les déposer entre les mains de l'autorité publique.
Il faut se garder aussi de confondre l'occupation avec la possession. L'occupation dont il est question dans ce chapitre, n'a lieu que pour les choses qui n'appartiennent à personne : la possession peut avoir lieu, non-seulement pour les choses qui n'ont point de maîtres, mais aussi pour celles qui sont déjà appropriées. Par l'occupation, on n'acquiert que les choses qui ne sont la propriété de personne; mais aussi on l'acquiert par le seul [I-48] accomplissement du fait : par la possession, on peut acquérir même les choses qui sont la propriété d'autrui; mais aussi elle n'est efficace qu'autant qu'elle a une certaine durée de temps, et qu'elle est accompagnée de certaines circonstances. Ce sera lorsque je m'occuperai de la transmission des propriétés, que je pourrai traiter de la possession.
[I-49]
CHAPITRE V.
De l'appropriation des choses en général.↩
Il n'est point d'être organisé qui ait une existence indépendante de toutes choses, ou qui puisse vivre et se reproduire dans l'isolement. Une plante ne vit et ne se multiplie qu'au moyen de la terre sur laquelle elle végète, de l'eau qui la rafraîchit, de la lumière qui la colore, de l'air qui l'environne, de la chaleur qui la pénètre, et de la plante de même espèce qui la féconde. On ne saurait l'isoler complétement d'une de ces choses, sans la faire périr, ou du moins sans l'empêcher de se reproduire.
Tout animal dépend également, pour sa conservation, son accroissement et sa reproduction, des choses au milieu desquelles la nature l'a placé. De même que la plante, il a besoin de l'air dans lequel il est plongé, de l'eau qu'il boit, ou qui se mêle à ses alimens, de la lumière qui l'éclaire, de la chaleur qui lui donne la vie, et d'un animal de même espèce auquel il s'unit. Il ne tire pas immédiatement sa subsistance de la terre, comme [I-60] les végétaux; mais il l'en tire d'une manière médiate, en se nourrissant des objets qu'elle lui prépare: Sous quelques rapports, il paraît dans une plus grande dépendance des choses, puisqu'il ne peut, sans périr, en être séparé aussi long-temps; mais, d'un autre côté, il est doué de la faculté d'aller à la recherche de celles qui lui sont nécessaires.
Les hommes, considérés sous des rapports purement physiques, sont soumis aux mêmes lois; comme tous les autres animaux, ils ont besoin, pour se conserver et se reproduire, d'air, de lumière, de chaleur, d'alimens, et de l'union des sexes; ils ont besoin, de plus, de vêtemens et d'abri. Si les végétaux tirent immédiatement leur subsistance de la terre et si la plupart des animaux l'en tirent d'une manière médiate en se nourrissant de végétaux, l'homme tire la sienne de la même source, en se nourrissant des uns et des autres. Les animaux ayant besoin, pour se conserver, de substances plus élaborées et plus variées que celles que demandent les plantes, ont la faculté de se déplacer pour aller les chercher. De même les hommes, ayant des besoins plus nombreux et plus variés qu'aucun autre genre d'animaux, ont la faculté de diriger les productions. végétales et animales de manière qu'elles soient propres à les satisfaire.
[I-51]
L'action d'un être organisé qui unit à sa propre substance les choses au moyen desquelles il croît, se fortifie et se reproduit, est ce que nous nommons appropriation. Par cette action, en effet, il se les approprie, il les transforme en une partie de lui-même; de telle sorte qu'on ne pourrait les séparer de lui sans le détruire. Il serait également impossible de diminuer d'une manière considérable la quantité de choses qu'un homme consomme habituellement dans un temps donné, sans l'affaiblir ou le détruire, ou sans lui causer des souffrances plus ou moins vives. Arrêter ou suspendre la multiplication des choses au moyen desquelles les nations existent, c'est arrêter ou suspendre la multiplication même des hommes; de même, multiplier ces choses, c'est donner aux hommes les moyens de s'accroître dans les mêmes. proportions.
Un homme qui serait privé d'air atmosphérique pendant quelques minutes, cesserait d'exister, et une privation partielle lui causerait de vives souffrances; une privation partielle ou complète d'alimens produirait sur lui des effets analogues, quoique moins prompts; il en serait de même, du moins dans certains climats, de la privation de toute espèce de vêtemens ou d'abri; enfin, l'isolement dans lequel un individu serait placé relativement à des individus de son espèce, s'il ne [I-52] causait pas sa destruction', l'empêcherait du moins de se reproduire.
Pour se conserver et se reproduire, l'homme a donc besoin de s'approprier incessamment des choses de diverses espèces; mais ces choses n'existent pas dans les mêmes proportions: quelques-unes, telles que la lumière des astres, l'air atmosphérique, l'eau renfermée dans le bassin des mers, existent en si grande quantité, que les hommes ne peuvent leur faire éprouver aucune augmentation ou aucune diminution sensibles; chacun peut s'en approprier autant que ses besoins en demandent, sans nuire en rien aux jouissances des autres, sans leur causer le moindre préjudice. Les choses de cette classe sont, en quelque sorte, la propriété commune du genre humain; le seul devoir qui soit imposé à chacun à leur égard, est de ne troubler en rien la jouissance des autres.
Il est d'autres choses qui, sans exister en aussi grande quantité que celles que nous appelons communes, peuvent satisfaire quelques-uns des besoins d'une nombreuse agrégation d'hommes; de ce nombre sont les fleuves qui parcourent le territoire d'une nation, les grandes routes qui le coupent en divers sens, les ports de mer qui en font partie, et d'autres objets destinés à un usage commun. Ces choses étant propres à satisfaire les besoins généraux d'une nation, sont dites [I-53] propriétés nationales; considérées relativement aux membres de l'État, elles sont des propriétés communes.; elles sont particulières, quand on les considère dans les rapports qui existent de nation à nation.
Ces grandes agrégations auxquelles on donne le nom de nations ou de peuples, sont formées d'autres agrégations moins considérables qu'on désigne sous diverses dénominations. Celles-ci prennent les noms de provinces, d'états, de villes, de cantons, de communes, ou autres, selon les langues et les institutions de chaque pays. Ces agrégations inférieures ont aussi certaines choses particulièrement destinées à l'usage commun des membres dont elles se composent. On désigne ces choses sous le nom de propriétés communales, cantonales, départementales ou provinciales, parce que la fraction de population par laquelle elles sont possédées, s'en approprie en commun la jouissance.
Enfin, il est des choses qui ne sont destinées qu'à satisfaire les besoins de ces petites agrégations qu'on désigne sous le nom de familles, ou des besoins purement individuels: telles sont les choses qui nous servent d'alimens, de vêtemens, d'abri. Celles-ci sont dites propriétés privées ou particulières, , parce qu'elles sont partagées entre les particuliers qui ne se conservent qu'en les appliquant à la satisfaction de leurs besoins.
[I-54]
Les choses que les jurisconsultes désignent sous le nom de communes et qui forment pour ainsi dire la propriété du genre humain, existant en trop grande quantité pour que l'usage que les hommes en font, puisse en diminuer la masse d'une manière sensible, il est peu nécessaire de s'en occuper dans la législation. Comme il n'arrive guère qu'on s'en dispute la jouissance, il suffit d'un petit nombre de lois de police pour en assurer à chacun le libre usage. Les hommes n'ont rien à faire pour les produire, pour les conserver, ou pour en régler la transmission d'une génération à l'autre.
Les choses dont la quantité est bornée, et qui sont destinées à satisfaire des besoins individuels ou de famille, n'existent généralement que par le moyen d'un travail humain et par le concours des forces de la nature. Chacun ne peut en consommer qu'une certaine quantité, et il est impossible d'en détruire inutilement une partie sans causer quelque mal, ou sans faire disparaître la cause de quelques jouissances. L'augmentation ou la diminution des choses de cette nature est suivie d'une augmentation ou d'une diminution proportionnelle de population ou de bien-être.
Nous avons donné le nom d'appropriation à l'action par laquelle une personne unit à sa propre substance, ou emploie à la satisfaction de ses besoins, les choses qui-servent à sa conservation ou [I-55] à la multiplication de son espèce. Nous désignons par le même nom l'action par laquelle une personne s'empare, dans la vue d'en jouir et d'en disposer selon sa volonté, d'une chose susceptible de produire médiatement ou immédiatement certaines jouissances.
Nous désignons par le nom de propriétés, les choses qui sont destinées à satisfaire immédiatement nos besoins, lorsque nous les considérons comme devant être consommées dans l'ordre naturel de la production; nous dirons donc que le blé obtenu par un cultivateur d'une terre qu'il a mise en état de culture, et qu'il n'a ravie à personne, le fruit cueilli sur un arbre qu'il a planté et soigné, sont des propriétés ; nous dirons la même chose du drap qu'un homme aura fabriqué, du tableau qu'un peintre aura fait, enfin de tout ce que l'industrie humaine aura produit, sans rien enlever à personne.
Ce n'est pas seulement aux choses qui sont destinées à satisfaire immédiatement nos besoins dans l'ordre naturel de la production, qu'on donne le nom de propriétés, comme sont celles qui nous servent de vêtemens ou d'alimens; on le donne aussi aux choses qui servent à les produire. Ainsi, les outils d'un ouvrier, les machines et les ateliers d'un fabricant, sont des propriétés, parce qu'ils concourent à produire des choses propres à satisfaire [I-56] nos besoins, qu'ils sont eux-mêmes les produits d'un travail ancien, et qu'ils sont spécialement destinés à pourvoir à l'existence ou au bien-être de certaines personnes déterminées. Nous donnons le même nom à des terres ou à des maisons, parce qu'elles ont également pour objet d'assurer l'existence de ceux à qui elles appartiennent. Nous verrons plus loin comment on forme des propriétés de cette espèce, non-seulement sans rien ravir à autrui, mais en contribuant au bien-être de ses semblables.
Nous ne pouvons appliquer certaines choses à la satisfaction de nos, besoins sans les altérer ou les détruire. Non-seulement nous détruisons par l'usage les objets qui nous servent d'alimens ou de vêtemens, mais nous détruisons aussi les choses au moyen desquelles nous les produisons. Les outils d'un artisan, les machines d'un fabricant, les maisons que nous habitons, périssent avec le temps. Les terres elles-mêmes deviendraient improductives, du moins dans beaucoup de pays, si, à mesure qu'elles produisent des récoltes, on n'avait pas soin de leur rendre en engrais ce qu'elles donnent en subsistances. Le genre humain, en un mot, ne peut se conserver et se multiplier qu'au moyen d'une destruction continuelle de ces choses auxquelles nous donnons le nom de propriétés.
Nous disons cependant que la quantité de ces [I-57] choses est limitée; comment est-il donc possible d'en détruire sans cesse, sans les épuiser? Ce que nous détruisons dans les propriétés que nous employons à la satisfaction de nos besoins, ce n'est pas la matière, ce sont les qualités qui la rendent propre à nos usages. Il n'est au pouvoir de personne de réduire quelque chose à rien, ou de faire de rien quelque chose; notre jouissance sur la nature se borne à modifier de diverses manières les objets qu'elle nous présente, à combiner diversement les élémens qu'elle a mis à notre disposition, ou à détruire les combinaisons qu'elle a faites.
Chacune des petites parcelles dont un habit est formé existe lorsqu'il est complétement usé, comme au jour où on le met pour la première fois, mais elles ne se trouvent plus dans les mêmes rapports; chacun des élémens dont la réunion forme un fruit, existent après qu'on s'en est nourri, comme au moment où il a été recueilli, mais ils sont différemment combinés; les élémens dont l'ensemble compose une maison, existent le jour où elle tombe de vétusté, comme au jour où elle commença d'être habitée, mais ils ne sont plus disposés de la même manière.
La matière ne périt donc point par l'usage que nous faisons des choses auxquelles nous donnons le nom de propriétés : ce sont les qualités qui nous [I-58] les rendent propres. Or, ces qualités sont des produits de l'industrie humaine, secondée par les forces de la nature; nous les recomposons à mesure qu'elles se détruisent, et ce sont elles qui forment un des principaux élémens des choses auxquelles nous donnons le nom de propriétés. Nous ne donnerions pas ce nom à des choses qui ne pourraient satisfaire aucun besoin, procurer aucune jouissance: un objet complétement dépourvu d'utilité serait abandonné de tout le monde.
Nous devons remarquer ici que nous estimons les choses auxquelles nous donnons le nom de propriétés, en raison des services qu'elles peuvent nous rendre; et non en raison de la quantité de matière dont elles sont formées. La matière, considérée en elle-même, et abstraction faite de toute utilité, n'est pour nous d'aucune valeur : personne ne cherche à se l'approprier. Si nous augmentons l'utilité d'une chose, si nous lui donnons des qualités qui la rendent propre à satisfaire plus de besoins, la propriété deviendra plus considérable. Si nous en diminuons l'utilité, si nous lui faisons perdre quelques-unes des qualités qui la rendaient propre à procurer certaines jouissances, à satisfaire, certains besoins, la propriété décroît dans la même proportion. Enfin, la propriété s'évanouit, si l'utilité de la chose disparaît complétement: elle est abandonnée.
[I-59]
Ces observations, qui sont incontestables pour les choses mobilières, ne le sont pas moins pour les terres, les maisons, ou pour d'autres choses immobilières. Une terre qui produit dix mille fr. de revenu, est une propriété aussi considérable qu'une autre terre qui a le double d'étendue, et qui ne peut pas produire un revenu plus grand. Faire subir à un champ une modification qui augmente le revenu d'un dixième, ou y ajouter un dixième en étendue d'une égale fertilité, c'est accroître la propriété exactement dans la même proportion. De même, ôter un dixième de l'étendue au propriétaire, ou modifier la totalité, de manière qu'elle produise un dixième de moins, c'est diminuer la propriété de la même valeur.
Il suit de là qu'on pourrait priver complétement une personne d'une propriété considérable, sans lui ravir un atome de matière: il suffirait d'en détruire l'utilité ; c'est ce qui arriverait, si l'on mettait en pièces une statue, si l'on réduisait en cendres une bibliothèque. Il suit également de là qu'en donnant à une matière quelconque une utilité dont elle était privée; en la rendant propre à satisfaire un besoin, on crée une propriété, ou l'on accroît l'importance d'une propriété déjà formée. C'est là le résultat de l'industrie humaine : c'est de là que sont venues presque toutes les propriétés que les hommes possèdent.
[I-60]
Les qualités qui rendent les choses propres à satisfaire nos besoins, ou à nous procurer certaines jouissances, étant au nombre des élémens qui constituent une propriété, et ces qualités étant le résultat de l'industrie humaine, combinée avec les moyens que la nature fournit à tous les hommes, il s'ensuit que, pour trouver les véritables fondemens de la propriété, il faut admettre, premièrement, qu'un homme est un être libre par les lois de sa nature; que ses facultés n'appartiennent qu'à lui, et que les valeurs qu'il crée par elles, et sans rien ravir à personne, ne peuvent être qu'à lui; en second lieu, que l'importance d'une propriété se mesure, non par le plus ou moins de matière, mais par les qualités propres à satisfaire nos besoins, par l'utilité dont elle est pour les hommes; enfin, que les choses que les jurisconsultes désignent sous le nom de communes, appartiennent également à tout le monde, et que chacun peut s'en approprier autant que ses besoins en demandent.
Admettant que tout homme est maître de lui-même, qu'il ne peut se conserver et se reproduire qu'en consommant sans cesse l'utilité qui se trouve dans certaines choses, et que toute valeur à laquelle il donne l'existence est à lui, il s'ensuit que la propriété n'est qu'une conséquence de la nature de l'homme, et qu'on ne peut l'attaquer sans attaquer l'espèce humaine elle-même; il s'ensuit que [I-61] les moyens les plus légitimes d'obtenir une propriété, c'est de la produire, ou de la recevoir, par l'effet d'une libre transmission, des mains de ceux qui l'ont produite ou reçue des producteurs.
Le travail est donc le principe qui donne naissance aux propriétés; presque toutes viennent de cette source, ainsi qu'on le verra plus loin. Mais le travail est une peine, et les hommes ne s'imposent volontairement des peines qu'autant qu'ils espèrent d'en recueillir les fruits. Si donc les valeurs par eux produites leur étaient ravies, à mesure qu'ils leur donneraient l'existence, ils cesseraient de travailler. Ils cesseraient également de conserver les propriétés déjà existantes, s'ils n'avaient pas la certitude d'en jouir et d'en disposer à leur volonté. Il ne peut donc y avoir de prospérité pour une nation que là où la liberté de l'industrie est assurée, et où chacun est maître du produit de ses travaux.
Nous désignons ici, par le mot propriétés, certaines choses considérées dans les rapports qu'elles ont avec certaines personnes, et placées sous certaines circonstances. Les jurisconsultes et quelques philosophes ont pris ce mot dans un autre sens : ils s'en sont servis pour désigner certains droits, et non des choses. Lorsque nous aurons clairement déterminé les élémens divers qui constituent ce que nous désignons par le mot de propriétés, nous [I-62] examinerons ce qu'ils désignent par le même mot.
J'ai fait voir ailleurs que les sciences morales, comme les sciences physiques, ne peuvent se former que par l'observation exacte d'un certain ordre de faits ou de choses. Je dois, par conséquent, dans mes recherches sur la propriété, porter mes observations sur des choses ou sur des faits; je ne saurais procéder autrement, sans renoncer à la méthode que j'ai suivie jusqu'ici. Pour connaître les phénomènes de l'esclavage politique et de l'esclavage domestique, je n'ai pas commencé par examiner si l'état de servitude est ou n'est pas contraire au droit ; j'ai simplement observé quelles en sont la nature, les causes et les conséquences. La connaissance du droit est sortie de l'examen des faits, avec une évidence qu'on n'aurait pas obtenue d'un autre procédé. Je suivrai la même méthode pour la propriété : l'observation des phénomènes de la nature nous conduira à la connaissance du droit.
[I-63]
CHAPITRE VI.
Des choses communes à tous les hommes.↩
PARMI les choses nécessaires à notre conservation, il en est un certain nombre qui existent en si grande quantité qu'elles sont inépuisables, et que tout le monde peut en user sans leur faire éprouver aucune diminution sensible; il en est d'autres qui existent en quantité moins considérable, et qui ne peuvent satisfaire les besoins que d'un certain nombre de personnes : les unes sont dites communes, les autres particulières.
Les premières, au nombre desquelles il faut mettre l'air, la lumière des astres, les mers, l'eau qui coule dans les fleuves, sont communes à tous les hommes, parce que tous en ont également besoin, et que chacun peut en faire usage sans nuire à la jouissance des autres.
Le premier droit que chacun de nous tient de sa nature est, en effet, celui d'employer à sa conservation et à son bien-être les choses au milieu desquelles la nature l'a placé, et dont il peut jouir sans nuire en aucune manière à la conservation ou [I-64] au bien-être de ses semblables. Si ce droit, qui n'est qu'une conséquence des lois de notre nature et de l'égalité qui existe entre les hommes, n'était pas admis, il n'en est aucun dont il fût possible d'établir l'existence.
Les choses qui existent en si grande quantité, que chacun peut en faire usage sans nuire en rien aux jouissances d'autrui, ne devraient jamais, à ce qu'il semble, donner lieu à des contestations entre les hommes. Il y aurait, en effet, une sorte de folie à disputer à son voisin l'air dont il a besoin, non-seulement pour sa respiration, mais encore pour une multitude d'autres usages. Quel est celui qui se permettrait de contester sérieusement à un homme le droit, par exemple, d'employer l'air à entretenir une forge, à faire tourner un moulin, ou à pousser un navire sur les vagues de la mer? Quel est celui qui oserait réclamer à cet égard un droit que tous ne posséderaient pas ?
Cependant, quoique les hommes ne se disputent pas la possession exclusive du bien le plus indispensable à la vie, quoiqu'aucun d'eux ne réclame à cet égard aucun privilége sur ses semblables, il arrive souvent que les uns troublent les autres dans la jouissance de ce bien. Il est clair, par exemple, que celui qui infecte l'air qu'on respire dans son voisinage, au moyen de certaines matières animales, végétales ou minérales, en y laissant [I-65] assembler des eaux marécageuses, en s'y livrant à certaines fabrications, altère par cela même une chose qui appartient également à tous; il porte à ses voisins un dommage analogue à celui qu'il leur causerait, s'il mêlait à leurs alimens ou à l'eau nécessaire à leur breuvage, des matières insalubres ou empoisonnées.
Aussi, ce qui distingue un pays policé d'un pays qui ne l'est pas, c'est surtout le soin qu'on met à empêcher qu'une personne, en jouissant d'une chose commune, ne nuise à la jouissance des autres. Une nation qui souffre que chacun de ses membres altère ou dégrade les choses qui sont nécessaires à l'existence ou au bien-être de tous, n'est pas encore sortie complétement de la barbarie; elle ne sait pas garantir tous les genres de propriété. Il ne suffit pas à un peuple, pour assurer à chacun la libre jouissance des choses communes, de défendre de les altérer ou d'en abuser; il faut qu'il laisse de plus à toute personne lésée dans sa jouissance, la faculté de poursuivre la réparation des dommages qui lui sont causés. Les propriétés individuelles ne seraient pas garanties, ou le seraient mal, si les propriétaires n'avaient pas la faculté de traduire en justice les hommes qui y portent atteinte; comment serait-il donc possible de croire à la garantie des propriétés communes, là où les personnes lésées dans la jouissance de ces propriétés, n'auraient [I-66] aucune action contre les auteurs de la lésion qu'elles auraient éprouvée ?
Les mers tiennent, parmi les choses communes à tous les peuples, une place fort considérable; elles leur sont utiles comme moyens de transport, et comme renfermant des matières alimentaires. Considérées sous le premier point de vue, l'utilité dont elles sont pour les nations, n'est l'ouvrage d'aucune d'elles; et l'usage.que chacune en fait, quelque étendu qu'on le suppose, ne peut diminuer en rien la jouissance des autres. Ce sont des routes naturelles assez larges pour ne pas être sujettes à encombrement, et assez bien construites pour n'avoir jamais besoin de réparations. Comme il n'est au pouvoir de personne, ni de les dégrader, ni de les rendre meilleures, et qu'elles ne doivent rien à l'industrie humaine, nul ne peut prétendre à un droit qui n'appartiendrait pas à tous.
Si l'on considère les mers comme de vastes magasins de subsistances, elles sont assez spacieuses pour que chacun puisse s'y livrer à la pêche sans gêner personne. Les poissons qu'elles renferment ne sont pas le produit d'un travail humain; personne ne peut donc les réclamer comme étant des résultats de son industrie. Il n'y a pas d'autres moyens de se les approprier que de les prendre, et celui qui s'en empare le premier, a un titre auquel aucun autre ne peut être opposé.
[I-67]
Il est cependant des peuples qui ont eu la prétention d'être propriétaires de certaines mers: les Portugais, par exemple, se disaient jadis propriétaires des mers de Guinée et des Indes-Orientales; mais ces prétentions, combattues par Grotius, n'ont jamais été admises par les autres nations.
On conçoit, au reste, que l'usage des mers doit être réglé par les traités de nation à nation, et par les principes du droit international; mais qu'il ne pourrait l'être par les lois d'aucun peuple en particulier, à moins que ce peuple ne fût le souverain de tous les autres; je n'ai donc pas à m'en occuper ici d'une manière spéciale.
On verra cependant plus loin que tous les peuples maritimes modernes considèrent comme une partie de leur domaine national les eaux de la mer qui baignent leur territoire. En parlant de ce genre de propriété, j'indiquerai quelle est l'étendue que l'usage lui a donnée.
[I-68]
CHAPITRE VII.
Du territoire propre à chaque nation.↩
LORSQUE nous parlons des divers objets sur lesquels nous pouvons étendre nos observations ou exercer notre puissance, par opposition à des êtres de notre espèce, nous les désignons sous le nom général de choses; et quand nous parlons des hommes par opposition aux divers objets au milieu desquels la nature les a placés, nous les désignons par le nom de personnes.
Si, au lieu de considérer les objets qui nous environnent, par opposition aux individus qui appartiennent au genre humain, nous les considérons dans les rapports qu'ils ont avec les hommes, ou les agrégations d'hommes dont ils doivent particulièrement satisfaire les besoins, nous les désignons sous le nom de propriétés; nous désignons les hommes par le nom de propriétaires, quand nous les considérons relativement aux choses dont ils peuvent exclusivement et légitimement disposer pour satisfaire leurs besoins [14].
[I-69]
Le mot choses a un sens beaucoup plus étendu. que le mot propriétés, car il embrasse une multitude d'objets qui n'ont jamais été appropriés, ou qui ne peuvent satisfaire aucun besoin. Toute chose n'est donc pas une propriété; mais toute propriété est généralement une chose. Nous n'avons à nous occuper des choses qu'autant qu'elles sont ou qu'elles deviennent des propriétés.
On peut classer les propriétés de deux manières, selon qu'on les considère dans leur nature, et abstraction faite des hommes dont elles doivent satisfaire les besoins, ou selon qu'on les considère dans les rapports qu'elles ont avec les hommes auxquels elles appartiennent, et abstraction faite de leur nature. Quand on les considère dans leur nature, on en trouve une multitude d'espèces différentes; mais on n'a besoin de les classer en genres ou en espèces, qu'autant que les différences qui les distinguent doivent influer sur l'ensemble de la législation. Lorsqu'on les considère relativement aux hommes dont elles doivent satisfaire les besoins et assurer l'existence, la division la plus naturelle est celle [I-70] qui correspond aux diverses fractions entre lesquelles le genre humain se partage naturellement.
Après les choses auxquelles les jurisconsultes ont donné le nom de communes, et qui sont en quelque sorte le patrimoine du genre humain, la propriété la plus élevée par son étendue et son importance, est le territoire qui appartient à chaque nation. C'est dans cette propriété que se trouvent enclavées les propriétés des provinces, des communes, des villes, des familles, des individus. Si la première n'était pas admise, il serait fort difficile de reconnaître l'existence des autres, et celles-ci seraient fort mal défendues, si celle-là n'était pas efficacement protégée. On conçoit bien que les propriétés individuelles, communales ou provinciales, ne soient pas toujours respectées, même quand le territoire national est à l'abri des agressions extérieures; on ne concevrait pas également qu'elles ne fussent pas violées, si le territoire national n'était pas à l'abri des invasions. Nous devons donc commencer par déterminer ce qui constitue le territoire et les propriétés d'une nation : nous verrons ensuite comment les autres se forment.
La violence a de tout temps exercé sur la destinée des nations une influence si étendue, que, si l'on reconnaissait comme légitime l'ordre de choses établi par elle, il faudrait renoncer à tout principe de justice, et substituer à l'étude des lois de notre [I-71] nature, l'étude de la ruse et de la force. Les traités qui consacrent les résultats que la violence a produits, n'en changent pas la nature, et ne les rendent pas moralement obligatoires. La prudence peut conseiller de s'y soumettre, tant que le danger de les violer est plus grand que les maux qui résultent de la soumission; mais on peut légitimement s'y soustraire, le jour où l'on peut les briser avec impunité. Les traités diplomatiques, comme toutes les conventions, ne sont réellement obligatoires qu'autant qu'ils sont sanctionnés par les lois auxquelles les peuples comme les individus sont soumis par leur nature. Si, au lieu d'être l'expression de ce qui est juste en soi, ils ne sont qu'une violation de la justice, nul n'est tenu de s'y conformer s'il a la force de s'y soustraire. Sous ce rapport, une nation est dans la même position qu'une famille esclave: elle a des devoirs à remplir envers elle-même, envers chacun des membres dont elle se compose, avant d'en avoir à remplir envers ceux qui l'ont subjuguée.
Il est bon sans doute d'étudier l'état des nations auxquelles la violence a fait éprouver des divisions ou des unions contre nature, comme il est bon d'observer les causes et les effets de l'esclavage. Les connaissances qu'on acquiert par une telle étude, peuvent nous donner les moyens de tracer d'une manière plus précise les limites que la nature elle-même [I-72] assigne à chaque nation. Mais il ne faut jamais perdre de vue que les traités qui déterminent le territoire de chaque peuple, et qui divisent le genre humain en grandes fractions, n'ont de valeur qu'autant qu'ils sont conformes à la nature des choses, et que tous les droits sont également respectés. Il en est des conventions diplomatiques, il ne faut jamais l'oublier, comme de toutes les conventions humaines : elles ne sont respectables que lorsqu'elles sont l'expression de la justice et de la vérité [15].
Il n'est pas impossible qu'une union ou une séparation de peuples, qui n'a été d'abord opérée que par la violence, finisse par le par se maintenir consentement libre de toutes les parties. Une longue soumission au même pouvoir, le mélange des familles et des intérêts, une communauté de senti- . mens, d'idées, de langage, de lois, et l'habitude de commercer ensemble, peuvent confondre, en quelque sorte, en une seule nation des populations qui jadis formaient autant de peuples séparés. C'est ainsi que cette multitude de peuplades indépendantes [I-73] qui, du temps de César, couvraient les Gaules, et qui furent successivement subjuguées par les Romains et par les Francs, ont fini par former une grande nation qu'on appelle France. Mais, quoique soumises aux mêmes lois et au même gouvernement, quoique désignées par une seule dénomination, et unies par certains intérêts généraux, plusieurs ont conservé des intérêts particuliers, un idiome distinct. Les différences que la nature des choses avaient produites, ont résisté jusqu'à ce jour aux causes nombreuses et puissantes qui tendaient à les faire disparaître.
Sans nous arrêter aux divisions ou aux réunions artificielles produites par l'ambition ou les calculs des gouvernemens, nous devons observer comment le genre humain se divise naturellement en plusieurs fractions; comment chacune de ces fractions, quel que soit le nom sous lequel on la désigne, a un territoire qui lui est propre, et quelles sont les limites naturelles de ce territoire. Nous verrons ensuite comment ces diverses fractions s'unis sent ou se confédèrent entre elles, soit pour leur défense commune, soit pour la gestion de leurs intérêts généraux. Nous observer ons enfin les effets qui résultent des réunions ou des séparations contre nature, opérées par la violence.
On verra plus loin que rien n'est plus facile que d'observer comment se forment la plupart des [I-74] propriétés privées; mais il n'est pas également aisé d'observer comment les nations ont acquis le territoire propre à chacune d'elles : les faits à cet égard ont précédé les monumens historiques. L'histoire nous a bien conservé le souvenir de plusieurs usurpations mémorables; elle nous montre souvent des armées conquérantes dépouillant des peuples vaincus d'une partie de leurs possessions; mais jamais elle ne nous fait voir des peuples inoffensifs s'emparant d'un territoire inoccupé. Quoique le genre humain ne soit pas, dit-on, fort ancien, on a toujours vu des hommes partout où des hommes ont pu vivre; et partout où l'on a trouvé des hommes, on a pu voir qu'ils considéraient comme leur propriété la terre qui leur fournissait des moyens d'existence.
Nous ne connaissons aucune partie de l'Europe qui ait été complétement inoccupée à une époque quelconque. Lorsque les Romains s'y répandirent de tous côtés, ils eurent sans cesse des combats à livrer: nulle part ils ne trouvèrent un coin de terre qui n'eût un propriétaire. Ils ne purent former des établissemens hors de leur pays, sans dépouiller quelque peuple d'une partie du territoire dont nul autre que lui ne croyait avoir la propriété. Leurs historiens n'en citent du moins aucun exemple.
En Asie, on trouve des hommes dans tous les lieux où il est possible de prendre du poisson ou [I-75] du gibier, de faire paître des troupeaux ou de cultiver la terre. Depuis le Kamtschatka jusqu'aux îles de la Sonde, et depuis les rives de la Léna jusqu'aux mers de la Chine, on ne connaît aucune terre qui, dans une saison ou dans l'autre, ne soit parcourue par des hommes qui y cherchent des moyens d'existence. Chaque nation ou chaque peuplade a son territoire particulier, qu'elle ne peut dépasser sans s'exposer à la guerre; chacune est en possession du sol qui la nourrit, depuis un temps dont personne ne saurait assigner le commencement.
L'Afrique présente le même phénomène ; il n'est aucun lieu connu, susceptible d'offrir à des hommes des moyens d'existence, quelque chétifs qu'ils soient d'ailleurs, qui ne soit considéré comme la propriété d'une peuplade qui l'habite ou le parcourt depuis un temps dont l'origine est inconnue.
L'Amérique, quoique couverte d'immenses forêts au moment où elle fut découverte, était occupée par une multitude de peuplades. Chacune d'elles avait son territoire particulier, et ce territoire était limité presque avec la même précision que celui des états les plus civilisés. Les vastes plaines de la partie méridionale furent habitées par des peuples pasteurs, comme le centre de l'Asie, aussitôt qu'on eut introduit dans ce pays les animaux qui font une partie de leurs richesses.
[I-76]
Enfin, les îles innombrables du grand Océan, qu'on désigne aujourd'hui sous le nom d'Océanique ou de Polinésie, et que l'on considère comme une cinquième partie de notre globe, étaient habitées au moment où elles ont été découvertes; une seule a paru déserte aux voyageurs qui l'ont observée; mais elle était inabordable et privée d'eau douce.
L'occupation de toutes les parties de notre globe est donc un fait que les historiens et les voyageurs ont constaté, mais que personne n'a jamais expliqué d'une manière satisfaisante. L'on a bien fait des conjectures sur l'émigration et sur la filiation de quelques peuples; mais ces conjectures, toujours fort vagues, n'expliquent rien relativement à l'occupation primitive et successive des diverses parties de la terre.
Les hommes qu'on a rencontrés dans les contrées les plus barbares, ne vivaient pas dans l'isolement comme des bêtes de proie; partout on a observé l'union permanente des sexes pour l'éducation des enfans. Ce phénomène, produit par des causes inhérentes à notre nature, ainsi que je le ferai voir ailleurs, n'a souffert d'exception nulle part. On verra même plus loin que l'association permanente de l'homme et de la femme, pour la conservation de leur espèce, est encore plus nécessaire, s'il est possible, dans l'état de barbarie que dans [I-77] l'état de civilisation. La famille a donc été, dans tous les temps et dans tous les pays, la première et la plus naturelle des associations.
On a trouvé en Europe, il est vrai, deux enfans qui vivaient isolés dans les forêts, et qui avaient pris quelques-unes des habitudes des bêtes sauvages: l'un a été pris dans le Hanovre, l'autre dans le département de l'Aveyron.
Ces deux individus, sur lesquels Montesquieu et Rousseau ont bâti des systèmes, étaient de véritables idiots que leurs parens avaient abandonnés probablement dans l'impossibilité d'en tirer aucun parti ; quand on les a observés de près, et pendant assez de temps pour bien les juger, le merveilleux a complétement disparu [16].
Non-seulement on a observé que partout les individus dont le genre humain se compose étaient groupés en familles, mais on a vu que, dans toutes les contrées, les familles se groupaient les unes près des autres. Les voyageurs qui ont visité les pays les plus sauvages, les plus stériles, ceux dans lesquels il est le plus difficile à l'homme de se procurer des moyens d'existence, n'ont jamais découvert une famille vivant dans un complet isolement. Les hordes les moins nombreuses qu'on ait [I-78] rencontrées dans les pays les plus arides, tels que l'Australasie et la Terre de Feu, étaient composées au moins de quatre ou cinq familles.
Les hordes qui sont réduites à vivre des produits de la pêche, de la chasse, ou du laitage de leurs troupeaux, ne se permettent pas de parcourir tous les pays dans lesquels elles pourraient trouver des pâturages, du poisson ou du gibier. Chacune d'elles a, comme on vient de le voir, ses forêts, ses lacs, ses rivières; chacune d'elles est circonscrite dans un espace qu'elle considère comme sa propriété, et d'où elle sait qu'elle ne peut sortir impunément. Les pays qui semblent le moins susceptibles d'appropriation, tels que les déserts du centre de l'Asie et de l'Arabie, sont cependant appropriés. Ils sont divisés entre diverses hordes de pasteurs, chacune desquelles parcourt successivement la partie que la nature semble lui avoir assignée [17].
Les violations de territoire produisent chez les sauvages et chez les peuples barbares, des guerres bien plus violentes que celles qui sont produites par la même cause chez les nations policées. Chacun d'eux se montre d'autant plus jaloux de faire [I-79] respecter le sol qui l'a vu naître et qui le fait vivre, que, quelle que soit l'étendue de ses possessions, il est toujours assiégé par la misère. Violer le territoire d'une horde de sauvages ou de pasteurs pour y prendre du poisson ou du gibier, ou pour y faire paître des troupeaux, ce n'est pas seulement lui faire injure, c'est attaquer ses moyens d'existence, c'est préparer sa destruction [18].
Les guerres fréquentes qu'amènent chez les peuples barbares les violations de territoire, se terminent par des traités, comme les guerres des nations policées; par ces traités, les limites de chaque territoire sont déterminées, reconnues. Une horde de sauvages vend une partie des terres qu'elle [I-80] occupe, comme nous vendons les choses qui nous appartiennent; et quand la vente en est faite et le prix payé, elle n'y prétend plus rien [19].
Si donc nous considérons, sous un point de vue général, l'aspect sous lequel se présente le genre humain, nous voyons que, depuis les temps les plus reculés, toutes les parties de la terre qui peuvent fournir aux hommes des moyens d'existence, sont occupées par des nations plus ou moins policées, ou par des hordes plus ou moins barbares; qu'à tous les degrés de civilisation ou de barbarie, les individus dont le genre humain se compose, sont réunis en familles ; que les familles se groupent les unes près des autres, pour former des hordes ou des peuplades; que chaque nation, ou chaque peuplade, est renfermée dans un espace limité de toutes parts, et qu'elle considère comme sa propriété le territoire dans lequel elle est renfermée.
Nous devons remarquer que plus une nation se [I-81] développe par la multiplication des individus dont elle se compose, par les lumières et les richesses qu'elle acquiert, plus le territoire qu'elle occupe devient pour elle une propriété incontestable et incontestée. On a pu disputer à des hordes sauvages une partie du territoire qu'elles occupaient, parce qu'on ne voyait pas clairement comment elles s'étaient formées au moyen de ce territoire. On ne contesterait pas à une nation civilisée les terres sur lesquelles elle s'est développée, et desquelles elle tire ses moyens d'existence : on prendrait pour un fou, celui qui prétendrait que le territoire de la Grande - Bretagne, appartient à un peuple autre que celui qui le possède. Contester à une nation le territoire sur lequel elle s'est formée, c'est en réalité lui contester la vie, par la raison qu'on ne saurait l'en expulser sans la détruire presque entièrement.
Quand on considère le possesseur d'un vaste domaine, relativement à d'autres personnes de la même nation, on peut bien prétendre qu'il a usurpé sur eux les terres qu'il possède; mais il n'arrive jamais qu'on le considère comme un usurpateur relativement à des étrangers. Ainsi, les ancêtres des lords anglais, ceux des grands possesseurs de terres d'Irlande, peuvent être accusés d'usurpation relativement aux habitans de ces pays, qui n'ont aucune propriété. Personne ne s'aviserait de dire [I-82] qu'ils furent des usurpateurs relativement aux paysans français, aux serfs de la Pologne ou de la Russie. La raison en est qu'un peuple ne conteste jamais à un autre la propriété de son territoire, à moins qu'il n'ait pris la résolution de l'exterminer.
Les partisans les plus outrés de l'égalité, ceux qui auraient voulu que toutes les fortunes fussent égales, et qui ont tenté d'introduire la communauté de travaux et de biens en divers pays, n'ont jamais réclamé l'égalité qu'entre les membres de la même nation ou de la même société. Ils n'ont pas revendiqué leur part des biens qu'ils voyaient chez d'autres peuples, et dont ils étaient eux-mêmes privés; ils n'ont pas appelé à prendre part à leurs richesses, les personnes même les plus pauvres qu'ils ont vues en dehors de leurs sociétés. Cependant, quand on croit qu'il est juste que tous les membres d'une nation aient une part égale dans la répartition des biens et des maux, il est difficile de voir pourquoi l'égalité ne régnerait pas entre les peuples comme entre les membres d'une nation; pourquoi certains peuples jouiraient éternellement d'un sol fertile et d'un climat heureux, tandis que d'autres seraient éternellement relégués sous un ciel âpre, ou sur un sol ingrat. Ne faudrait-il pas, pour établir l'égalité entre les nations, comme on veut l'établir entre les individus, que chacune d'elles eût alternativement [I-83] la jouissance d'un bon et d'un mauvais territoire? Qu'ont fait les habitans de l'Italie pour être mieux traités par la nature, que les habitans de la Norwège? Comment la justice peut-elle tolérer l'inégalité de partage qui existe entre les uns et les autres ?
Il est des gens qui trouvent contraire aux lois de notre nature, qu'un fils recueille la succession de son père; ils voudraient que les terres et même les propriétés mobilières fussent transmises à l'État, qui en confierait l'exploitation aux plus capables; à leurs yeux, la transmission héréditaire des biens du père à ses enfans, est un privilége exorbitant que rien ne saurait justifier. L'on voit bien encore ici que la propriété n'est pas reconnue, quand on compare une famille à une autre famille de la même nation; mais elle l'est complètement quand on compare un peuple à un autre peuple. Dans le système qui tend à répartir les fortunes en raison de la capacité de chacun, ce ne seront pas les fils qui succéderont à leurs pères; mais une génération succédera toujours à l'autre, dans la même nation; ce seront des Anglais qui succéderont toujours à des Anglais, des Français à des Français. Cependant, si l'on n'admettait aucune propriété, si les terres, qu'on appelle des instrumens de travail, devaient toujours passer aux mains des plus capables de les faire valoir, pourquoi ne ferait - on pas [I-84] succéder une génération d'Anglais à une génération de Russes?
Les hommes qui forment les systèmes les plus bizarres, ceux qui n'admettent pas l'existence de la propriété privée; ceux qui s'imaginent qu'il est au pouvoir des. hommes de répartir d'une manière égale, entre les membres de la même communauté, les biens et les maux que la nature nous a réservés; ceux enfin qui se flattent de répartir ces biens et ces maux entre les personnes dont une nation se compose, de manière que chacune soit traitée en raison de son mérite, ne peuvent donc contester ni la séparation que la nature a mise-entre les peuples, ni la propriété du territoire que chacun d'eux possède exclusivement.
En disant que chaque peuple a un territoire qui lui est propre, je n'entends pas dire que cette propriété, à laquelle nous donnons le nom de nationale, n'a jamais été violée. Rien n'est plus commun, au contraire, que de voir, soit dans l'histoire ancienne, soit dans l'histoire moderne, des nations qui ont détruit ou asservi d'autres nations pour s'emparer de leur territoire. Les Romains ne s'agrandirent que par des usurpations de cette nature; et la plupart des colonies que les modernes ont établies en Amérique ou en d'autres pays, n'ont été fondées que sur la ruine des populations dont elles ont pris la place. Les attentats de ce genre, qui [I-85] deviennent de jour en jour plus rares, ne prouvent rien contre l'existence du phénomène que nous venons d'observer. Tous les jours les magistrats ont à punir des atteintes portées aux propriétés privées; ces atteintes ne sont pas une preuve que la propriété n'existe pas ou qu'elle n'est pas reconnue ; la seule conséquence qu'on puisse en tirer, c'est qu'il est impossible d'empêcher toute espèce de désordre, même dans les sociétés les mieux policées.
Il est rare qu'une nation qui envahit le territoire d'une autre, l'en dépouille complétement, à moins qu'elle ne prenne le parti de la détruire. En général, les conquérans s'emparent des meilleures terres, et les font cultiver par les vaincus, qui leur en livrent les fruits. C'est ainsi que les Romains se rendirent maîtres d'une partie de l'Europe, et qu'ils furent ensuite remplacés par des Barbares venus du Nord; c'est également ainsi que les Tartares se sont établis en Chine. Mais, tôt ou tard la force des choses rend la puissance à la population vaincue, et fait disparaître la race des vainqueurs. Que sont devenus, parmi nous, les descendans des Francs qui envahirent les Gaules au cinquième siècle? On trouverait à peine deux ou trois familles dont l'origine plébéienne ne soit pas démontrée. Le nombre des familles qui sont descendues des conquérans romains n'est peut-être pas beaucoup plus considérable.
[I-86]
De notre temps, il se fait encore des invasions; mais ce ne sont pas des peuples qui en dépouillent d'autres, comme au temps de la république romaine, ou au temps des invasions des Barbares; ce sont des rois qui, par le moyen de leurs armées, étendent leur domination et augmentent le nombre de leurs sujets, c'est-à-dire de leurs tributaires; telle était la domination des Turcs sur les Grecs, et telle est encore la domination de l'Autriche sur une partie de l'Italie, de la Russie sur la Pologne. Les attentats de ce genre deviendront de plus en plus rares; les peuples qui jouissent de leur indépendance et de leur liberté, finiront par comprendre que ce sont des crimes qu'ils ne peuvent laisser consommer impunément, sans compromettre leur propre existence.
Ayant établi comme un fait incontestable, reconnu par l'universalité des hommes, que chaque peuple, considéré en masse, a un territoire qu'il possède exclusivement, et qui forme sa propriété; ayant démontré que ce fait n'est pas seulement reconnu, mais qu'il est généralement indestructible, puisqu'à l'exception de quelques pauvres sauvages, il est impossible de dépouiller une nation de son territoire, diverses questions se présentent à résoudre: on peut demander quels sont le fondement et la garantie de cette propriété, quelles en sont les limites naturelles, quelle est la [I-87] manière d'en jouir, et comment se forment au milieu d'elle les autres espèces de propriété. Je répondrai en peu de mots à la première de ces questions; les autres seront examinées dans les chapitres suivans.
Quelques écrivains ont attribué, sans beaucoup de raison, l'origine des propriétés privées aux lois civiles, c'est-à-dire aux actes des gouvernemens. On ne peut pas, avec quelque apparence de raison, donner la même origine aux propriétés des diverses nations. Il n'est pas de gouvernement qui ait distribué la surface de la terre aux peuples qui la possèdent, et qui garantisse à chacun la part dont il est en possession. Il serait difficile de dire pourquoi les uns possèdent un territoire fertile, placé sous un beau climat, tandis que d'autres sont relégués sur des terres arides et sous un ciel rigoureux.
Mais, s'il est impossible de rendre raison de la distribution des peuples sur la surface du globe, rien n'est plus aisé que de voir la force qui les retient dans les lieux où ils sont placés : c'est la nécessité. Celui qui voudrait abandonner son propre territoire pour, s'en approprier un meilleur, rencontrerait des obstacles qu'il ne parviendrait jamais à vaincre. S'il était nombreux, il lui serait impossible de se déplacer en masse; s'il ne l'était pas, il s'exposerait à être exterminé. Il n'aurait [I-88] pas seulement à vaincre et à détruire la nation dont il voudrait usurper la place: il aurait à vaincre, en même temps, les nations qui prendraient sa défense. Une tentative de cette nature serait si menaçante pour tous les peuples, que celui qui la formerait les aurait tous pour ennemis.
Chaque peuple trouve donc la garantie de son territoire, non dans un gouvernement chargé de faire régner la justice entre les nations, mais dans la nécessité de le défendre pour se conserver; dans les mers ou les montagnes qui le protégent contre les invasions; dans l'appui des peuples qui ont un intérêt semblable au sien; enfin, dans les obstacles de toute nature qu'il faudrait vaincre pour l'en dépouiller ce sont toutes ces forces réunies qu'on appele la loi des nations.
[I-89]
CHAPITRE VIII.
Des limites naturelles du territoire propre à chaque nation, et à chacune des principales fractions entre lesquelles elle se divise.↩
EN passant graduellement de l'état de barbarie à l'état de civilisation, les hommes donnent à quelques-unes de leurs facultés plus de développement; mais ils ne changent pas de nature. Le temps de la gestation, la durée de l'enfance, la faiblesse et les infirmités qui l'accompagnent, sont les mêmes chez une horde de sauvages, que chez une nation civilisée. Il ne faut donc pas être surpris, si, dans le plus bas échelon de l'état social, l'espèce humaine se groupe en familles comme au terme le plus élevé de la civilisation.
Des besoins analogues à ceux qui président à la formation et à la conservation de chaque famille, réunissent diverses familles en peuplades. Cette seconde espèce d'association n'est pas moins nécessaire à la conservation et au développement des familles qui la forment, ainsi qu'on le verra plus loin, que l'union permanente de l'homme et de [I-90] la femme à la conservation de leurs enfans. Aussi les voyageurs n'ont ils jamais rencontré, même dans les pays les plus barbares, des familles vivant dans un état complet d'isolement les unes à l'égard des autres.
Indépendamment des sentimens de sympathie qui tendent à rapprocher les êtres de même espèce, les familles tiennent les unes aux autres par les alliances qu'elles contractent, par les services mutuels qu'elles se rendent, par des habitudes et une langue communes, par la ressemblance de leurs idées ou de leurs préjugés, et surtout par la jouissance en commun de choses qui sont nécessaires à leur existence, et qui ne sont pas susceptibles d'être partagées.
J'ai fait observer, dans le chapitre précédent, que partout où la nature a présenté des moyens d'existence à l'espèce humaine, on a trouvé des hommes qui se les étaient appropriés; je dois ajouter maintenant que, toutes les fois que des obstacles physiques interrompent les communications entre des terres également habitées, chaque peuplade trouve les limites de son territoire aux points où les communications sont interrompues. Il ne peut, en effet, y avoir association entre des familles qui ne jouissent de rien en commun, qui ne peuvent faire aucun échange de services, qui ne s'allient point entre elles, et qui, par suite de [I-91] l'état de séparation où elles se trouvent, ne peuvent exprimer exactement leurs idées par les mêmes signes.
Les obstacles qui interrompent les communications entre des terres habitées, sont de diverse nature : ce sont des montagnes, des mers, des marais impraticables. Les cours d'eau sont des obstacles au rapprochement des familles, ou des moyens de communication, selon qu'ils sont plus ou moins considérables, et que les peuples ont fait plus ou moins de progrès dans les arts. Des fleuves qui ressemblent à des bras de mer, comme quelques-uns de ceux du continent américain, sont évidemment des obstacles à toute communication pour des nations peu civilisées. Quand les arts auront fait des progrès, ces obstacles seront encore assez grands pour empêcher des communications nombreuses et fréquentes.
Il résulte de ceci que, moins la civilisation est avancée, plus les fractions entre lesquelles le genre humain se divise, sont nombreuses et isolées les unes des autres. Un des résultats les plus incontestables de l'accroissement de la population et du perfectionnement des arts, est, en effet, de faire disparaître graduellement les obstacles qui empêchent les hommes de traiter ensemble. Tel fleuve qui diviserait en deux hordes ennemies des hommes complétement barbares, devient, pour les [I-92] peuples qui en possèdent les rives, le moyen d'une active communication, du moment qu'ils ont trouvé l'art de construire des ponts et des bateaux, et qu'ils sont assez industrieux pour effectuer des échanges. Les obstacles que présentent les montagnes à la communication des peuples qui en occupent les versans opposés, sont plus aisément vaincus par des nations civilisées que par des peuplades encore incultes : les arts et les richesses nous ont fourni les moyens de tracer des routes à travers les monts les plus escarpés.
Il faut observer cependant que ce qui divise le genre humain en grandes fractions, c'est bien moins la difficulté de gravir l'escarpement des montagnes, que la distance à laquelle sont contraintes de se tenir, par la nature des choses, les grandes masses de population. En général, les hommes se multiplient dans chaque lieu en raison des subsistances qu'ils peuvent y faire croître, ou que le commerce et l'industrie peuvent y amener à peu de frais. Il suit de là que les populations les plus nombreuses sont répandues dans les par+ ties les plus spacieuses et les plus fertiles des bassins formés par les montagnes. A mesure qu'on s'élève vers la source des fleuves ou des rivières, les vallées se rétrécissent graduellement, la terre est moins susceptible de produire des subsistances, et par conséquent les hommes y deviennent de plus en [I-93] plus rares. Souvent les flancs escarpés des montagnes restent incultes ou ne sont cultivés que jusqu'à une certaine hauteur; les cultivateurs n'y restent que le temps nécessaire pour la culture ou la récolte, et redescendent dans les vallées. La population s'arrête au point où la culture et les pâturages finissent; ce qui est au-delà forme quelquefois des espaces très-étendus et plus ou moins difficiles à franchir.
Il n'est pas nécessaire que des montagnes soient très-élevées pour partager en deux fractions bien distinctes les familles qui en possèdent les versans opposés; il suffit qu'elles le soient assez pour empêcher des communications journalières et habituelles. Les populations que des montagnes divisent, quand elles ne sont pas complétement séparées, ne se touchent que par un petit nombre de points. Dans les lieux où elles se touchent, les familles sont peu nombreuses, et de chaque côté elles se portent naturellement vers le versant auquel elles appartiennent, à moins qu'elles n'en soient détournées par de grands intérêts [20].
[I-94]
Les mers, qui sont pour le commerce des moyens si puissans de communication, s'opposent cependant à ce que les peuples entre lesquels elles se trouvent, se réunissent pour ne former qu'une nation: la masse de la population est retenue sur chaque rive par les dangers et surtout par les frais des voyages. Les communications maritimes, outre qu'elles sont dispendieuses, et qu'elles ne sont pas sans danger, exigent trop de temps pour qu'elles puissent être fréquentes et habituelles pour un grand nombre de personnes. Une mer, quand elle a une grande étendue, est, relativement aux peuples qui en habitent les rivages, une séparation presque aussi efficace que le serait un vaste désert.
Les progrès des arts et l'accroissement de la population tendent sans cesse à faire disparaître les causes qui divisent le genre humain en une multitude de fractions étrangères les unes aux autres et souvent ennemies. A mesure que les arts se développent, les marais se dessèchent, les forêts sont percées d'une multitude de routes, ou se transforment en campagnes fertiles, les fleuves se couvrent de ponts et de bateaux, les montagnes sont [I-95] sillonnées de routes spacieuses et commodes. Lorsque la civilisation change ainsi l'aspect d'une vaste contrée, les diverses fractions de la population prennent d'autres noms; mais tout conserve cependant l'empreinte de la division primitive. Ce qui formait une peuplade indépendante ne forme plus qu'une ville ou un village; une association de petits peuples ne forme plus qu'une province ou un état. La configuration du sol restant la même, les limites qui divisaient deux peuplades, ne séparent plus que deux villes ou deux communes.
Les pays qui ont su le mieux défendre leur indépendance et leur liberté, sont, en général, ceux où la population est divisée de la manière la plus conforme à la nature des choses. C'est en observant les limites qu'ont acceptées ou que se sont données les nations indépendantes, qu'on aperçoit nettement le territoire qui forme la propriété de chaque peuple. Il suffira d'un petit nombre d'exemples pour bien faire comprendre comment ce territoire se trouve déterminé par la configuration du sol et par la nature même de l'homme.
Presque tous les peuples du continent européen ont été soumis à des princes qui les considéraient comme des propriétés de famille; ils ont été donnés par testament ou par contrat de mariage, vendus ou échangés comme des troupeaux. Les rois, quand ils n'ont pu les acquérir par des alliances, [I-96] se les sont disputés comme une proie que la Providence avait réservée au plus adroit ou au plus fort, et dans les divers partages qu'ils en ont faits, ils n'ont guère pris conseil que de leur ambition et de leur cupidité. On risquerait donc beaucoup de s'égarer, si, pour trouver les limites naturelles du territoire de chaque nation, et celles qui divisent un peuple en diverses fractions, on allait consulter les traités diplomatiques et les décrets par lesquels les princes ont réglé l'administration de leurs états. Il peut arriver, sans doute, que ces traités ou ces décrets reconnaissent les véritables limites du territoire d'un peuple ou d'une province; mais, quand cela se rencontre, ce n'est, en général, qu'un effet du hasard, ou parce qu'on est entraîné par la force invincible des choses [21].
Il est, au milieu des grands états du continent européen, une petite contrée qui, depuis plusieurs siècles, a cessé d'être considérée comme le domaine [I-97] d'une famille, et qui, à travers toutes les révolutions, a trouvé le moyen de conserver son indépendance et sa liberté. Divisée en vingt-deux petits états, qui s'appellent des cantons, cette contrée est le pays de l'Europe où le territoire de chaque fraction de la population est limité de la manière la plus naturelle. Ce n'est pas un gouvernement qui, la règle et le compas à la main, a divisé le sol en parties à peu près égales, pour les distribuer à des gouverneurs investis d'une part égale de pouvoir. Les peuples se sont soumis à la division que la nature du sol et la forme des montagnes leur avaient tracée. Il est, sans doute, même dans ce pays, quelques anomalies qui sont des résultats de la guerre et de la conquête; mais elles y sont moins nombreuses que dans les autres parties du continent européen.
Si l'on jette les yeux sur une carte de la Suisse, et si l'on observe les contours des grandes montagnes, on verra que ce pays est formé de la partie supérieure de trois grands bassins; de la partie la plus élevée du bassin du Rhin, de celle du Rhône et de celle du Tessin [22]. La partie qui appartient au bassin du Rhin, et qui forme la portion la plus considérable du territoire helvétique, renferme [I-98] plusieurs bassins secondaires. Lorsque ces bassins de second ordre ont une certaine étendue, ils forment des états distincts, et chacun de ces états a généralement pour limites les bords du bassin dans lequel il est renfermé. Les montagnes qui forment ces bords', se rapprochent souvent au point par lequel les eaux s'échappent: c'est à la partie la plus étroite de l'étranglement, que se trouve la limite de ce côté.
Les limites naturelles du canton des Grisons, par exemple, sont si bien marquées qu'on les aperçoit au premier coup d'œil, et qu'on distingue également au premier aspect les petites portions de territoire que les habitans ont conquises sur l'Italie et dans la partie supérieure de la vallée de l'Inn. La population renfermée dans le bassin dont ce canton est formé, est elle-même divisée en diverses fractions, non par les courans d'eau qui traversent le sol, mais par les petites montagnes inférieures qui séparent les petites vallées au fond desquelles coulent les eaux qui descendent des montagnes les plus élevées.
Nous observons les mêmes phénomènes dans les cantons placés au centre de la Suisse, tels que Glaris, Uri, Schwitz, Unter-Walden. Chacun d'eux se trouve limité par une chaîne de montagnes plus ou moins élevées; et il est ensuite divisé en un certain nombre de vallées, chacune [I-99] desquelles renferme une petite population distincte.
Le canton du Valais présente un exemple encore plus remarquable que celui des Grisons, de la manière dont les peuples sont divisés par la nature même des choses. Il est formé d'un grand bassin qu'environnent de tous côtés de très-hautes montagnes, et qui ne laisse échapper les eaux qui l'arrosent, que par une étroite issue. En considérant ce bassin, on peut croire qu'il a formé jadis un grand lac, et que les eaux ont fait irruption dans le Léman, en brisant l'obstacle que leur opposait la jonction des montagnes. Les deux grandes chaînes qui forment les limites du canton, projettent dans l'intérieur du bassin une multitude de branches qui se dirigent, en s'abaissant, vers le centre. Ces branches des deux grandes chaînes limitent le territoire des diverses fractions de la population répandues dans les vallées latérales.
Nous verrons ailleurs que, lorsque plusieurs vallées ou bassins inférieurs versent leurs eaux dans la même rivière ou dans le même fleuve, le tronc principal qui les porte à la mer, est naturellement la propriété commune de toutes les peuplades auxquelles ces vallées ou ces bassins appartiennent; nous verrons aussi que ces peuplades, quand elles ne forment pas une nation soumise au même gouvernement, sont naturellement portées à se confédérer entre elles.
[I-100]
Lorsque les hommes qui habitent une contrée déterminée, jouissent tous de leur indépendance et de leur liberté, ils se divisent donc en diverses fractions, comme les terres qui leur fournissent des moyens d'existence. Il résulte de là que la force de chaque état, ou le nombre des familles qui le composent, est généralement limité, soit par l'étendue et la fertilité du territoire sur lequel il est placé, soit par l'industrie qu'il est possible d'y développer. Il en résulte de plus que la petitesse ou la grandeur des nations est déterminée par la nature des choses, et qu'on ne peut les agrandir ou les diminuer sans exercer, sur un nombre d'hommes plus ou moins considérable, une véritable tyrannie. Il en résulte enfin que les efforts que font les gouvernemens d'Europe pour maintenir ce qu'ils appellent l'équilibre des nations, en fractionnant arbitrairement les territoires, sont une véritable lutte contre la nature humaine. Ces divisions arbitraires, loin d'être des garanties de paix, ne sont, au traire, que des causes de trouble et de guerre.
La Suisse, qui nous a déjà fourni des exemples des limites données par la nature au territoire de chaque nation, nous fournit aussi des exemples remarquables de la difference qui existe entre la force naturelle des divers états. Il est tels cantons qui ne comptent que treize ou quatorze mille habitans; il en est d'autres qui n'en ont que vingt-cinq [I-101] ou trente mille; il en est dont la population s'élève à cinquante ou soixante mille; dans quelques-uns, elle s'élève jusqu'à cent cinquante ou deux cent mille. Un politique géomètre qui diviserait ce pays avec la règle et le compas, pour en faire des fractions à peu près égales, soit en étendue, soit en population, n'en accroîtrait certainement ni le bien-être ni la puissance. Il produirait, au contraire, beaucoup de maux particuliers, et des déchiremens qui seraient vivement sentis.
Si nous faisons sur la France les mêmes observations que nous avons faites sur la Suisse, nous remarquerons les mêmes phénomènes; nous trouverons les limites qui séparent les diverses fractions du territoire susceptibles d'être cultivées, moins fortement prononcées : le territoire y sera divisé en fractions plus considérables; mais nous arriverons, en définitive, ́aux mêmes résultats.
Le territoire qui forme aujourd'hui la France ne renferme en entier que trois grands bassins : celui de la Seine, celui de la Loire et celui de la Gironde. Il comprend de plus une partie du bassin du Rhin, une partie de celui de la Meuse, et la portion la plus considérable de celui du Rhône. Il comprend enfin quatorze petits bassins entiers qui versent directement leurs eaux dans l'Océan ou dans la Méditerranée, et une petite partie du bassin de l'Escaut.
[I-102]
Les versans des montagnes qui envoient une partie de leurs eaux dans le Rhône, et qui limitent les territoires de divers états, présentent un phénomène particulier : ils forment trois bassins très-distincts, et qui ne communiquent entre eux que par des passages très-resserrés. Le premier de ces bassins, qui commence à la source même du Rhône, et qui se termine à Saint-Maurice, entre deux immenses rochers (la dent de Morcles et la dent du Midi), forme le canton du Valais. Le second, qui commence au point où le premier finit, s'ouvre rapidement, et embrasse le canton de Vaud, le canton de Genève, le pays de Gex et la Savoie ; il finit au point où le fleuve disparaît dans les rochers, près du fort de l'Écluse. Le troisième commence au point où la Saône prend sa source dans les monts Fauciles, et se termine à la Méditerranée. Quoique celui-ci reçoive toutes les eaux des deux premiers, il peut être considéré comme un bassin complet, puisque la perte du fleuve intercepte réellement toute communication avec les deux autres.
Les diverses chaînes de montagnes qui divisent la France en plusieurs bassins, et qui partagent ainsi la population en fractions plus ou moins grandes, sont loin d'avoir la même élévation que celles de la Suisse et de la Savoie. La chaîne des Pyrénées qui forme, du côté du sud, le vaste bassin [I-102] de la Gironde, celui de l'Adour et celui de la Tet, et la partie de la chaîne des Alpes qui forme à l'est le bassin du Rhône, sont les seules qui s'élèvent à une grande hauteur. Les autres ne sont pas assez élevées pour être complétement stériles : à l'exception d'un certain nombre de points, elles sont propres à servir de pâturages ou sont couvertes de bois. Quoiqu'elles soient assez considérables pour tenir à une certaine distance les unes des autres les masses de population répandues dans les bassins, elles ne sont pas suffisantes pour mettre obstacle aux communications.
Si l'on compare, par exemple, les montagnes qui forment le bassin supérieur du Rhône à celles qui forment le bassin de la Seine, on trouvera qu'il existe entre les unes et les autres une différence immense. Les premières sont tellement élevées, que, du côté du nord, elles ne peuvent être franchies que sur un seul point et avec difficulté. Du côté du sud et du sud-est, il n'a existé, jusqu'au commencement de ce siècle, qu'un petit nombre de sentiers praticables seulement pour des mulets ou des gens à pied. Il a fallu le génie audacieux de Napoléon, secondé par une grande puissance par d'immenses richesses et par les arts, pour ouvrir à travers ces montagnes une route dont l'existence seule excite l'admiration. Les montagnes qui forment le bassin de la Seine non-seulement peuvent [I-104] être aisément franchies sur un grand nombre de points, mais elles sont coupées par des routes faciles, et même par des canaux.
Les différences qui existent dans les habitans des deux pays correspondent à celles des lieux. La population qui occupe la longue vallée que le Rhône parcourt, depuis le point où il prend naissance jusqu'à Saint-Maurice, est séparée par de hautes montagnes, excepté sur un seul point, de toutes les populations qui l'environnent. Elle ne parle ni n'entend leur langage; elle parle français, tandis que les peuples dont elle est environnée presque de tous côtés, parlent italien ou allemand. Elle touche cependant par un point à un peuple qui parle la même langue qu'elle; et ce point est l'étroite et seule ouverture par laquelle on a pu, de tout temps, pénétrer dans le bassin qu'elle occupe. La population que renferme le bassin de la Seine a toujours pu, au contraire, communiquer plus ou moins facilement avec les diverses populations qui occupent les versans extérieurs des montagnes par lesquelles ce grand bassin est formé. Aussi, ne trouvons-nous pas entre elle et les peuples répandus dans les bassins dont elle est environnée, des différences aussi prononcées que celles qui existent entre les habitans du Valais et les peuples au milieu desquels ils sont placés.
Les limites naturelles qui divisent en diverses fractions [I-105] le sol d'où les hommes tirent leurs moyens d'existence, peuvent être rangées en plusieurs classes. Quelques-unes sont fortement prononcées, et ne permettent aux peuples qu'elles séparent, que des communications difficiles, dispendieuses, et par conséquent peu nombreuses : de ce nombre sont les mers et les hautes chaînes de montagnes, telles telles que les Pyrénées et les Alpes. Les limites de cette espèce, quels que soient d'ailleurs les progrès de la civilisation, diviseront toujours le genre humain en grandes masses; elles les partageront en nations.
Les limites naturelles qui viennent ensuite, sont les montagnes qui forment les bassins des fleuves, mais qui n'ont pas assez d'élévation pour empêcher qu'il n'y ait des communications nombreuses entre les populations qu'elles séparent. Nous pouvons mettre dans cette classe les montagnes de l'intérieur de la France, qui forment les bassins de la Seine et de la Loire, et une partie des bassins de la Gironde, du Rhône et du Rhin. Nous devons mettre sur la même ligne la chaîne de montagnes qui court d'un bout de l'Italie jusqu'à l'autre, de même que celles de l'intérieur de l'Angleterre. Les limites de cette classe peuvent partager une grande nation en divers états confédérés, comme ceux de la Suisse ou de l'Amérique septentrionale, ou bien en grandes provinces ayant chacune ses assemblées [I-106] particulières. Si la France, par exemple, avait une organisation politique analogue à celle des États-Unis ou de la Suisse, elle compterait cinq grands états et quatorze ou quinze petits. Il y aurait entre la population de chacun de ces divers états à peu près les mêmes différences que nous avons observées entre la population des divers cantons de la Suisse [23].
En observant la manière dont la population de quelques cantons suisses est subdivisée, nous avons remarqué qu'en général la chaîne de montagnes, qui sert de limites à plusieurs cantons, projette, dans l'intérieur de chaque bassin, plusieurs branches qui se dirigent plus ou moins vers le centre, en s'abaissant graduellement. Ces branches, qui séparent les vallées entre lesquelles les bassins se partagent, forment une troisième espèce de limites. Les populations qu'elles séparent, sont généralement fort homogènes, soit parce qu'elles ont une origine commune, soit parce qu'elles communiquent aisément entre elles.
La longueur et l'écartement de ces branches dépendent moins de l'élévation de la chaîne d'où elles partent, que de l'étendue du bassin dans lequel elles se projettent. Les branches qui divisent [I-107] en plusieurs vallées le canton des Grisons ou celui du Valais, par exemple, partent des montagnes les plus élevées de l'Europe; cependant elles sont très-courtes, et s'abaissent par conséquent d'une manière très-rapide. Celles qui se projettent dans l'intérieur du bassin de la Seine, appartiennent au contraire à une chaîne peu élevée; mais elles sont fort étendues, et présentent des écartemens considérables. Souvent les longues branches qui se détachent d'une grande chaîne, et qui se dirigent dans l'intérieur d'un bassin, se divisent, et multiplient le nombre des limites; mais il est inutile de suivre plus loin ces divisions.
Nous avons vu que ce qui sépare surtout les nations les unes des autres, ce sont principalement les mers, ou les ou les montagnes assez élevées pour rendre les communications longues, difficiles et dispendieuses. Il suit de là que la ligne qui sépare deux nations, se trouve naturellement dans la partie la plus élevée de la chaîne placée entre elles, au point où les eaux se partagent. Chacune d'elles a la propriété du versant qui se trouve de son côté; et aucune ne peut s'emparer du versant qui lui est opposé, sans usurpation et sans tyrannie. Ainsi, par exemple, le versant des Alpes sur lequel coulent les eaux du Var, de la Rotta et de l'Impéro, forme évidemment une partie de la France. Le traité qui [I-108] l'en a détaché pour en former le comté de Nice et le joindre au Piémont, n'a pas eu d'autre objet que de ménager à quelques puissances une entrée sur le territoire français. Par la même raison, la partie du versant septentrional des Pyrénées, qui porte ses eaux dans la Bidassoa, ne forme pas une partie naturelle de l'Espagne. Les rivières, surtout quand elles sont d'une navigation facile, sont des moyens de communication, des causes d'association. On fait un contre-sens quand on les considère comme des barrières qu'il n'est pas permis de franchir.
On peut observer, dans la plupart des états de l'Europe, un grand nombre de divisions contraires à la nature des choses; mais il n'en est aucune qui soit plus frappante, et qui ait eu, pour les populations qui l'ont soufferte, de plus funestes effets que celle qui partage la Péninsule ibérique en deux états indépendans l'un de l'autre. Ce pays est admirablement disposé pour former plusieurs états provinciaux, unis par un lien commun; les populations renfermées dans les bassins des rivières sont séparées les unes des autres par de hautes montagnes. Mais, tant que les habitans de cette contrée verront une cause de séparation dans ce que la nature a fait pour les unir, et des causes d'union dans ce qui les sépare réellement, il est impossible [I-109] qu'ils ne soient pas continuellement dans un état de gêne, de misère et de désordre [24].
Les montagnes forment, disons-nous, les limites qui séparent les nations les unes des autres, et qui partagent le même peuple en fractions plus ou moins considérables; mais il ne faudrait pas s'imaginer qu'entre deux nations distinctes, on trouve, sur tous les points, une mer ou de hautes montagnes. Deux fleuves qui suivent à peu près la même direction, sont souvent séparés, pendant une grande partie de leur cours, par une chaîne de montagnes plus ou moins élevées; mais toutes les montagnes s'abaissent plus ou moins rapidement à mesure qu'elles avancent vers la mer. Il résulte de là que les populations situées entre l'embouchure de deux fleuves, ne sont souvent séparées par aucune limite très-prononcée, et qu'elles se confondent les unes avec les autres. Le même phénomène se fait remarquer d'une manière encore plus frappante dans les vallées parallèles qui portent leurs eaux dans le même fleuve. Les branches [I-110] de montagnes qui les séparent, s'abaissent d'abord graduellement, et souvent elles s'effacent tout-à-fait avant que d'arriver au fleuve. En reconnaissant les limites naturelles du territoire de chaque nation ou de chaque fraction d'un même peuple, il ne faudrait donc pas s'imaginer qu'elles sont partout également prononcées, et former un système qui se trouverait démenti par les faits.
Les mers sont, pour les nations, des limites qui peuvent être difficilement méconnues : aussi, quoiqu'il arrive souvent qu'un peuple, ou, pour parler d'une manière plus exacte, son gouvernement, porte sa domination sur un versant qui fait partie du territoire d'un autre peuple, il est extrêmement rare qu'une limite formée par la mer soit un objet de discussion. La nation qui tenterait d'usurper, sur une autre, une telle limite, en retirerait de si faibles avantages, et aurait tant de peine à la conserver, qu'elle se verrait bientôt contrainte de l'abandonner, à moins qu'elle n'établît en même temps sa domination sur tout le pays.
Les peuples dont le territoire va jusqu'à la mer, n'admettent pas que leur domination finisse exactement au point où la mer commence. Tous, sans exception, considèrent une certaine étendue de la mer comme faisant partie de leur territoire : c'est ce qu'ils appellent leurs eaux. La raison en est que chaque nation considère comme sa propriété la [I-111] chose par laquelle elle subsiste, et que c'est en pêchant sur leurs rivages, que les peuples maritimes se procurent des moyens d'existence. Il faut ajouter aussi qu'un peuple ne pourrait pas veiller à sa sûreté, s'il n'était pas admis qu'il est propriétaire d'une certaine étendue des eaux de la mer qui forment ses limites[25].
Les diverses fractions de population, qui se trouvent répandues dans le bassin d'un fleuve, sont naturellement associées les unes aux autres, et forment une nation unique, ou une confédération de divers états, lorsque chacune d'elles jouit d'une entière indépendance. Il arrive rarement qu'une de ces fractions se sépare volontairement des autres pour s'associer à des populations répandues dans des bassins différens, et dont elle est par conséquent éloignée par des limites naturelles. La raison en est dans les avantages qui résultent de toute association naturelle, et dans les inconvéniens qui sont la suite ordinaire des associations contre nature. C'est en traitant de l'organisation politique, que je ferai voir quels sont ces inconvéniens et ces avantages.
Cependant il se rencontre quelquefois des circonstances où les avantages d'une association [I-112] naturelle disparaissent presque entièrement, tandis que les inconvéniens d'une association contraire à la nature des choses, sont peu sentis. Il serait, par exemple, dans la nature des choses, que les peuples qui habitent les trois grandes fractions qui composent le bassin du Rhône fussent unis entre eux, soit en formant une seule nation, soit en formant divers états unis par un lien fédéral. Ces peuples parlent tous la même langue, peuvent aisément traiter ensemble, et sont enveloppés par les mêmes chaînes de montagnes. Cependant, si l'on voulait unir à la France ceux d'entre eux qui sont alliés à des cantons allemands et à un canton italien, il faudrait leur faire une forte violence. Il faudrait également faire violence aux habitans du Tessin pour les unir à l'Italie, et les séparer de leurs alliés Allemands ou Français.
La raison de ceci n'est pas difficile à voir. L'alliance formée entre les habitans des parties supérieures des bassins du Rhône, du Rhin, du Tessin et de l'Inn, fait peser peu de charges sur les associés. Chaque population, ou chaque fraction de population, reste souveraine sur son territoire, pour tout ce qui concerne ses affaires intérieures. Le gouvernement fédéral n'envoie pas dans les cantons français, des juges, des administrateurs ou des commandans allemands; il n'envoie pas, dans les cantons allemands, des administrateurs ou des [I-113] magistrats français. Il a besoin d'impôts et de troupes, parce qu'autrement il ne saurait veiller à la sûreté commune; mais il laisse à chaque état le soin d'établir des contributions comme il juge convenable, et de faire les levées d'hommes comme il l'entend. Les habitans des montagnes des Grisons ou de l'Oberland, n'ont pas la prétention de soumettre à l'exercice des agens du fisc les vignerons du Valais ou du pays de Vaud. Ceux-ci, de leur côté, ne s'avisent pas de voter des impôts sur les fromages ou sur les troupeaux des habitans des montagnes. Le lien fédéral tire donc la plus grande partie de sa force de l'indépendance dont jouit chaque population dans le bassin où elle s'est développée.
Si les habitans du Tessin étaient séparés de la confédération, et réunis à leurs associés naturels de l'Italie, non-seulement ils perdraient leur indépendance comme nation, mais ils auraient à supporter tous les maux que fait peser sur ce pays la domination du gouvernement autrichien; les avantages de cette association nouvelle seraient presque nuls; les charges en seraient insupportables. De même, si les populations du Valais, du pays de Vaud et du canton de Genève, étaient séparés des cantons situés dans le bassin du Rhin, et réunis aux autres habitans du bassin du Rhône, ils perdraient les avantages qui résultent de leur indépendance et d'une administration peu dispendieuse, [I-114] et auraient à souffrir tous les inconvéniens d'un gouvernement qui ne peut subsister que par de lourds impôts. Ils pourraient, il est vrai, répandre les produits de leur industrie sur un plus grand théâtre; ils auraient plus de force et d'indépendance comme membres d'une grande nation. Mais ces avantages seraient achetés par tant de charges et par la perte de tant de droits, qu'il est bien peu de gens qui voulussent consentir à l'échange. Nous pouvons faire sur les habitans de la rive gauche du Rhin le même raisonnement que sur les peuples qui occupent les parties supérieures du grand bassin du Rhône. Leurs associés naturels seraient les peuples répandus dans le bassin qu'ils habitent eux-mêmes; mais ces peuples, qui devraient ne former qu'une fédération, sont tellement divisés entre eux; ils sont soumis à des régimes si différens, et à des influences étrangères si ennemies; ils jouissent de si peu d'indépendance et de liberté, qu'il leur est plus avantageux d'être unis au reste de la France. Sous plusieurs rapports, ils ont plus d'indépendance et de liberté, et leur industrie profite des avantages qu'offre toujours le commerce libre d'une grande nation. Il faut ajouter que les canaux, en unissant de grands bassins, unissent aussi les populations qui les habitent.
Il ne faut donc jamais perdre de vue que, lorsqu'il est question des associations naturelles ou des [I-115] associations contraires à la nature des choses, il est toujours entendu que des circonstances accidentelles ne détruisent pas les avantages des unes et les inconvéniens des autres. Le génie des hommes abaisse quelquefois les barrières qui tenaient des peuples divisés; mais quelquefois aussi leurs erreurs et leurs vices transforment en obstacles les moyens de communication que la nature leur avait donnés [26].
Il résulte de ce qui précède, que les terres propres à fournir aux hommes des moyens d'existence, sont naturellement divisées en fractions plus ou moins considérables, par des mers, des des montagnes, des lacs, ou par des fleuves qui sont assez larges pour rendre les communications difficiles, dispendieuses et par conséquent peu nombreuses ; que les hautes chaînes de montagnes, qui forment les bassins des grands fleuves, limitent naturellement le territoire des nations qui en occupent les versans opposés ; que les chaînes moins élevées qui forment de [I-116] grands bassins, sans mettre de puissans obstacles aux communications, servent également de limites aux populations qui en occupent les versans contraires, mais ne les empêchent pas de s'associer pour leurs intérêts généraux; que les branches projetées par les chaînes de montagnes dans l'intérieur des bassins des fleuves, divisent le territoire, et par conséquent la population de chaque bassin, en diverses fractions, sans détruire l'homogénéité de cette population; enfin, que la grandeur des nations, et celle des diverses fractions dont elles se composent, est naturellement déterminée par la configuration du sol.
Ayant exposé comment se partage, entre les hommes, le sol qui leur fournit des moyens d'existence; ayant fait voir de plus que chaque peuple, vu en masse, se considère comme propriétaire du sol sur lequel il s'est développé et sans lequel il ne saurait vivre; enfin, ayant établi que cette propriété d'un territoire national n'est jamais contestée par les partisans les plus zélés de l'égalité, ni même par ceux qui mettent en question l'existence de la propriété privée, il reste à faire voir comment se forment, au milieu du territoire national, les propriétés des individus et des familles.
[I-117]
CHAPITRE IX.
De l'utilité et de la valeur primitives des fonds de terre [27]↩
IL y a trois manières principales d'acquérir des propriétés la première est de les créer par son travail; la seconde, de les recevoir de ceux qui les ont formées et qui consentent à nous les transmettre ; la troisième, de les ravir par force ou par adresse à ceux qui les possèdent.
[I-118]
Il existe chez tous les peuples un certain nombre de fortunes privées, acquises par la violence ou par la fraude; il en existe un nombre infiniment plus grand, que les possesseurs ont reçues de ceux qui les avaient créées ou usurpées: mais ce n'est pas des propriétés acquises par transmissions volontaires, ou par usurpation, que je me propose de traiter dans ce moment; ces moyens d'acquérir des propriétés n'en expliquent pas la formation.
Des familles ou des nations n'ont pu s'enrichir par la violence ou par la fraude, qu'autant que d'autres familles ou d'autres nations avaient acquis des richesses par d'autres moyens : la violence et la fraude déplacent les richesses, mais ne les créent Il a fallu de même, pour pas. s'enrichir par des transmissions volontaires, que des propriétés eussent été déjà formées par le travail; car il n'y aurait pas eu de transmission possible, s'il n'y avait pas eu de création.
Les choses auxquelles nous donnons le nom de propriétés, n'ayant de l'importance qu'en raison des services que nous en tirons, et des travaux
auxquels nous sommes obligés de nous livrer pour les obtenir, il est aisé de comprendre de quelle manière se forment la plupart des propriétés mobilières; comme il s'en crée tous les jours sous nos yeux, il suffit d'observer les procédés de l'industrie et du commerce, pour savoir d'où leur viennent [I-119] les qualités qui les rendent propres à satisfaire nos besoins.
On ne voit pas aussi clairement comment se forment les propriétés immobilières, et particulièrement celles qui consistent en fonds de terre. Dans les pays dont la civilisation est ancienne, les terres qui sont dans le patrimoine des familles, sont au rang des propriétés privées depuis des temps fort reculés. On n'a donc que rarement l'occasion d'observer comment les hommes parviennent à créer, par le travail et par des valeurs cumulées, des propriétés de ce genre, sans rien ravir à personne. Pour en observer la formation, il faudrait assister aux premiers développemens de la société, au moment où les hommes passent de la vie nomade à la vie agricole. Il faudrait observer de plus l'influence de l'accroissement des propriétés sur la population, et l'influence de l'accroissement de la population sur la valeur des propriétés.
Mais, s'il nous est impossible d'observer parmi nous et parmi les nations qui sont depuis longtemps policées, comment se forment les propriétés individuelles qui consistent en fonds de terre, rien ne nous est plus facile que d'en observer la création, soit chez les peuples qui sortent de la barbarie, soit dans les contrées sauvages où des hommes civilisés vont former des établissemens. Nous verrons d'ailleurs, par les monumens de notre histoire, [I-120] et par ce qui se passe journellement sous nos yeux, que toutes les propriétés, quelle qu'en soit la nature, se forment de la même manière.
Dans les contrées les plus florissantes et les plus peuplées, il n'est pas une maison, pas un monument, dont tous les matériaux n'aient été tirés des entrailles de la terre ou du milieu des forêts; il n'est pas un champ qui n'ait été inculte, à une époque plus ou moins reculée, et qui n'ait commencé à être mis en culture une première fois; il n'est pas une clôture qui n'ait été formée par la main d'un homme; il n'est pas un arbre propre à donner des fruits, qui soit venu sans le secours de l'industrie; enfin, il n'est pas un moyen de communication facile, pas un canal, pas une route, pas un sentier qui n'ait été tracé par des hommes.
Avant que les choses auxquelles l'industrie humaine a fait subir les modifications qui les rendent propres à satisfaire nos besoins, eussent éprouvé aucun changement par les mains des hommes, où se trouvaient donc ces populations nombreuses qui n'existent que par elles? Elles n'étaient nulle part; les terres qu'elles que de occupent n'étaient vastes déserts, parcourus par quelques tribus errantes. Dans tous les pays, la population a donc suivi les mêmes développemens que les propriétés ; et si les choses retournaient dans l'état où elles [I-121] étaient avant que la main des hommes les eût façonnées, la population disparaîtrait avec elles.
Dans les derniers temps de la république romaine, une grande partie de l'Europe était encore inculte et sauvage. Paris n'était qu'une misérable bourgade renfermée dans une île de la Seine, et protégée par des marais impraticables [28]. Les îles que forme le Rhin à son embouchure, n'étaient occupées que par de vrais sauvages, qui vivaient de poissons et d'œufs d'oiseaux [29]. Une partie considérable des Gaules était couverte d'immenses forêts, et ne pouvait, par conséquent, être utile aux hommes que par le gibier qu'elle leur fournissait [30]. La Germanie était aussi couverte de forêts immenses; les peuplades qui l'occupaient, ignoraient, pour la plupart, l'art de cultiver la terre, et étaient séparées les unes des autres par de vastes déserts [31]. Enfin, les indigènes des îles britanniques étaient encore plus étrangers à la culture que les Germains; ils n'étaient vêtus que de peaux de bêtes, et se tatouaient comme les sauvages des archipels du grand Océan [32]. Dans quelques [I-122] parties de ces îles, l'usage du pain était inconnu vers la milieu du treizième siècle [33].
Si les Romains, au temps où ils portaient la guerre dans ces contrées à demi sauvages, avaient pu, comme nous, consulter des historiens antérieurs à eux de plusieurs siècles, ils nous auraient probablement appris que ces peuples avaient passé par un état analogue à celui où se trouvaient les indigènes du nord de l'Amérique à l'époque de la découverte de ce continent. Il est impossible, en effet, quand on observe la marche graduelle de la civilisation, de ne pas rester convaincu que, dans tous les pays, les hommes sont partis à peu près du même degré de barbarie pour arriver au point où nous les voyons.
Admettant que les nations européennes sont sorties graduellement de l'état de barbarie, il faudrait se livrer à deux opérations pour connaître exactement quelles sont les propriétés auxquelles l'industrie humaine a donné naissance. Il faudrait déterminer, d'un côté, la valeur qu'avaient, dans les temps les plus reculés, les propriétés d'un territoire déterminé, du bassin de la Seine, par exemple; et voir, d'un autre côté, quelle est aujourd'hui la valeur des propriétés renfermées dans le même espace. En comparant les premières aux secondes, [I-123] on trouverait, dans la différence, les richesses ou les propriétés formées par la main des hommes.
On pourrait, sans remonter à un temps très-reculé, se demander, par exemple, ce que valaient, au temps de César, les marais qui environnaient la petite bourgade qui portait le nom de Lutèce, et comparer cette valeur à celle de toutes les propriétés mobilières ou immobilières qui occupent aujourd'hui la place de ces mêmes marais. Il n'y aurait pas d'exagération à dire qu'un hôtel, d'une grandeur moyenne, situé dans un des bons quartiers de Paris, est une propriété plus considérable, c'est-à-dire qu'il a plus de valeur à nos yeux, que n'en avaient aux yeux des contemporains de César, les terres sur lesquelles repose la capitale de la France. On peut faire, sur la plupart des villes et des villages, les mêmes observations que nous faisons sur les terres qui environnent l'île de Lutèce.
Les terres cultivées ou susceptibles de culture, ont éprouvé un accroissement de valeur analogue à celui qu'ont subi les lieux sur lesquels des villes ou des villages ont été bâtis. Au temps où Paris n'était qu'une petite bourgade, et où les autres villes du bassin de la Seine n'existaient pas, ou n'étaient que des hameaux, les terres ne produisaient que les subsistances nécessaires pour faire exister cette chétive population. Les hommes auxquels elles donnaient les moyens de vivre, étaient [I-124] plus mal vêtus, plus mal nourris, et surtout plus mal logés que ne le sont les hommes de notre temps; car moins l'industrie a fait de progrès, plus les hommes sont misérables. Les propriétés qui consistent en fonds de terre, se sont donc accrues de tout ce qu'elles produisent de notre temps, au-delà de ce qu'elles produisaient, quand elles fournissaient à quelques petites peuplades de faibles moyens d'existence. Nous avons vu précédemment, en effet, que les propriétés, quelle qu'en soit la nature, s'évaluent, non par le volume ou par l'étendue, mais par les avantages que les hommes savent en retirer. Un hectare de terre de telle qualité, ou situé dans un tel lieu, est souvent une propriété plus considérable que dix hectares situés dans un autre lieu, ou d'une qualité différente.
Il y aurait donc un moyen tout simple de déterminer, du moins approximativement, l'accroissement qu'ont éprouvé les propriétés territoriales d'une nation dans un temps donné ce serait de comparer le nombre d'hommes auxquels elles fournissent des moyens d'existence à une certaine époque, au nombre de ceux qu'elles font subsister dans une autre, en tenant compte de la différence de bien-être qui existe entre les deux. Si le bassin de la Seine, par exemple, ne fournissait des moyens d'existence qu'à cinq cent mille personnes, au temps où ce pays fut envahi par les [I-125] Romains; s'il en fournissait aujourd'hui à six millions, et si les hommes de notre temps étaient, en général, deux fois mieux pourvus que ne l'étaient les premiers, il serait évident que les propriétés territoriales seraient aujourd'hui vingt-quatre fois plus considérables en valeur qu'elles ne l'étaient alors. La différence de valeur entre les deux époques, serait le résultat de l'industrie humaine, secondée par les agens de la nature.
On entrevoit déjà, par cet exposé, comment le travail de l'homme donne, même aux fonds de terre, une partie considérable de la valeur qu'ils ont à nos yeux; mais on verra mieux encore comment les propriétés territoriales sont créées par l'industrie humaine, si l'on observe les secours que la terre fournit à l'homme dans l'état le plus barbare, et les travaux auxquels il a fallu se livrer pour en mettre une partie en état de culture. On se convaincra, par ces observations, que les individus qui les premiers se sont approprié des terres, en se livrant à la culture, non-seulement n'ont rien enlevé à leurs semblables, mais leur ont rendu d'immenses services [34].
[I-126]
Avant de rechercher quels sont les services qu'on peut tirer de la terre dans les contrées où l'industrie n'a fait aucun progrès, et où les hommes vivent de ce que leur présente la nature inculte et sauvage; avant d'examiner d'où lui vient l'utilité qu'elle a dans les pays où la civilisation a fait de grands progrès, il est bon de comparer quelle est l'étendue qu'il en faut, en divers pays, pour faire vivre un nombre d'hommes déterminé. On verra, par cette comparaison, comment, à mesure qu'on recule vers des temps ou des pays peu civilisés, la terre perd de plus en plus de sa valeur, ou comment, pour faire vivre un certain nombre d'hommes, il en faut une étendue de plus en plus considérable. Cela fera comprendre aussi comment, pour faire subsister une famille de sauvages, dans, un état presque habituel de détresse, il faut plus de terres qu'il n'en faut chez un peuple civilisé pour faire vivre à l'aise une ville de cinq ou six mille habitans.
En prenant un terme moyen, il faut, en France, pour faire exister une population d'environ douze [I-127] cents individus, une lieue carrée de terrain; en Prusse, la même étendue de terre ne fournit des moyens d'existence qu'à huit cents personnes environ; en Danemarck, le même espace fait vivre un peu plus de six cents personnes; en Portugal, il en fait vivre près de quatre cent cinquante; en Turquie, un peu plus de trois cents; en Russie, il en fait vivre un peu moins de deux cents, et quatre-vingt-deux seulement en Suède et en Norwège.
En admettant que, dans ces divers pays, on jouit à peu près de la même somme de bien-être, il s'ensuit qu'un hectare de terre, en France, est une propriété égale à un hectare et demi en Prusse, à deux hectares en Danemarck, à peu près de trois en Portugal, à quatre dans l'empire turc, à un peu plus de six dans l'empire russe, et à plus de douze en Norwège et en Suède [35].
L'ancien royaume du Mexique nous présente un exemple bien plus frappant encore des différences qui existent entre les diverses provinces de cette partie de l'Amérique, relativement au nombre d'hommes que fait vivre une étendue donnée de terre. Voici quelles étaient, en 1803, au rapport [I-128] de M. Alexandre de Humboldt, l'étendue et la population de chacune des intendances entre lesquelles ce royaume était divisé [36].
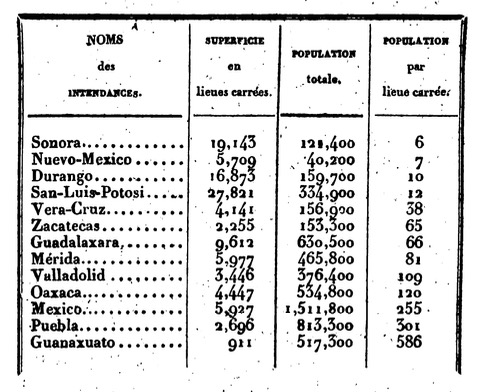
On voit, par ce tableau, que le nombre de personnes auxquelles une lieue carrée de terrain fournit des moyens d'existence, s'élève graduellement de 6 à 586. En Amérique, comme dans tous les pays, le bien-être des habitans est généralement en raison des progrès de la civilisation. Je supposerai cependant, pour simplifier le calcul, que [I-129] dans les contrées du Mexique où la terre ne fournit des moyens d'existence qu'à six ou sept personnes par lieue carrée, on est aussi bien pourvu de tout que dans celles où l'industrie a déjà fait des progrès. Dans cette supposition, et en admettant toujours que l'importance d'une propriété se mesure par les ressources qu'elle présente aux hommes, et non par l'étendue ou par la quantité de matière dont elle est composée, nous trouverons que la valeur des terres s'accroît, d'une intendance à une autre, dans la progression suivante : 6, 7, 10, 12, 38, 65, 66, 81, 109, 120, 255, 301, 586. L'étendue de terre qui ne vaudrait que six francs dans l'ancienne intendance de la Sonora, en vaudrait deux cent cinquante-cinq dans celle de Mexico, et cinq cent quatre-vingt-six dans celle de Guanaxuato. Elle en vaudrait près de douze cents en France, et plus de quatorze cents en Angleterre. Il suit de là qu'un hectare de terre, dans un pays tel que la France, est une propriété aussi considérable que deux cents hectares dans un pays tel que certains états du Mexique [37].
Mais ne perdons pas de vue que, dans les vastes provinces où une lieue carrée de terrain ne fournit [I-130] des moyens d'existence qu'à une famille, c'est-à-dire à six où sept personnes, le sol n'est pas complètement abandonné à sa fertilité naturelle; il a déjà reçu des habitans une certaine valeur. Quelques parties sont cultivées, d'autres servent à faire paître des troupeaux, et la population, toute faible qu'elle est, a déjà subi un accroissement proportionné aux progrès de la culture. Quelle serait donc l'étendue de terre qu'il faudrait à chaque individu, dans un pays où l'industrie humaine se bornerait à recueillir ce que présente la nature inculte et sauvage? Quelle serait, dans un tel pays, la valeur de la terre, comparativement à ce qu'elle vaut chez une nation civilisée ?
On pourrait déterminer de deux manières l'étendue de terre qui est nécessaire pour fournir des moyens d'existence à une personne dans l'état sauvage : l'un serait de calculer le nombre d'hommes dont une horde de sauvages se compose, et l'étendue du territoire qui lui est propre; l'autre serait d'examiner ce que la terre produit quand elle est abandonnée à sa fertilité naturelle, et de comparer les besoins d'un certain nombre d'individus aux ressources que la terre inculte leur présente.
Le premier moyen peut être difficilement employé, parce que les voyageurs n'ont jamais pu déterminer, d'une manière bien exacte, soit le [I-131] nombre de personnes dont se composaient les hordes sauvages qu'ils ont visitées, soit l'étendue du territoire qu'elles occupaient. Un voyageur philosophe a tenté cependant de faire ce calcul; Volney a pensé que, dans le nord de l'Amérique, il fallait pour faire exister un homme dans l'état sauvage un peu plus d'une lieue carrée de terrain [38]. Cette évaluation, loin d'être exagérée, me paraît, au contraire, au-dessous de la vérité; d'abord parce que les sauvages dont parle ce voyageur, n'étaient pas complètement dénués d'industrie; et en second lieu, parce qu'ils trouvaient des moyens d'existence dans les lacs et dans les fleuves. Si, dans certaines parties fort étendues du Mexique, une lieue carrée de terrain ne fait vivre que six personnes qui ne sont pas tout à fait étrangères à la culture, il est difficile de croire que, dans un pays entièrement inculte, le même espace suffise à l'existence d'une seule. Dans les parties les plus reculées du nord de l'Europe, en Laponie, il faut une lieue carrée de terre pour faire vivre un homme, et cependant l'on y jouit de quelques-uns des avantages de la civilisation. Comment n'en faudrait-il pas un espace plus étendu dans des contrées complètement barbares?
[I-132]
L'homme n'est pas organisé, comme certains animaux; pour se nourrir de la plupart des végétaux que la nature inculte lui présente. Pendant près de sept mois de l'année, depuis le mois de juin jusqu'au mois d'octobre, sous des climats tempérés, la terre ne produit rien qui puisse immédiatement lui servir d'alimens. Pendant quatre ou cinq mois, elle donne des grains, des fruits, des légumes; mais, à l'exception de quelques baies, ces végétaux ne croissent avec quelque abondance que sur la terre cultivée. Les voyageurs se sont convaincus, par expérience, qu'il ne fallait pas aller chercher, dans les contrées sauvages, des plantes ou des fruits propres à les nourrir. S'il arrive par hasard que la terre inculte produise quelques fruits ou quelques grains, ils tombent et périssent du moment qu'ils sont parvenus à leur maturité. Nous ne connaissons, chez nous, aucune substance propre à nous servir d'alimens, qui se conserve quand elle est abandonnée sur le sol : tout ce qui n'est pas mis à l'abri de l'humidité ou de la dent des animaux, a péri même avant le temps des gelées. Les terres placées entre les tropiques sont un peu plus que les autres favorisées par la nature; cependant elles ne donnent presque rien qui puisse nous servir d'aliment, quand elles ne sont pas cultivées.
Que reste-t-il donc à l'homme pour se nourrir? [I-133] du poisson et du gibier; et c'est, en effet, de la pêche et de la chasse que les peuples sauvages tirent leurs moyens d'existence. La pêche n'est une ressource que pour les peuplades qui vivent sur les bords des fleuves, des lacs, des mers. Les alimens qu'elle leur fournit, ne viennent pas, au moins immédiatement, de la terre; nous pouvons ne pas nous en occuper. Nous n'avons à rechercher ici que les ressources que le sol nous présente pour nous nourrir, nous vêtir, nous loger.
Dans la mauvaise saison, la terre abandonnée à elle-même n'offre donc que des graminées, qu'il faut souvent aller chercher sous la neige, du moins sur une grande partie du globe. Les hommes ne peuvent en faire leurs alimens; mais des animaux s'en nourrissent, et ces animaux deviennent ensuite la proie des hommes. Mais quelle est la quantité de gibier dont chacun d'eux a besoin pour subsister? Supposons qu'un individu en consomme une pièce tous les deux jours, l'un portant l'autre, gros et petits. Dans cette supposition, il lui en faut cent quatre-vingt-deux pièces dans le cours de l'année. Pour en consommer annuellement un pareil nombre, il faut que l'espèce se perpétue, et qu'il en existe toujours, par conséquent, un nombre double au-delà de ce qui lui est nécessaire pour sa consommation. Ainsi, voilà déjà près de cinq cent [I-134] cinquante animaux nécessaires à l'existence d'un seul homme, pendant le cours de chaque année.
Mais l'homme sauvage n'est pas le seul animal qui vive de proie. Il en est, au contraire, un très-grand nombre d'autres qui ne vivent que par ce moyen, qui lui disputent continuellement sa subsistance, et dont il ne peut cependant par lui-même se nourrir. En supposant que tous ces animaux réunis ne fassent qu'une consommation égale à la sienne, il faudra doubler le nombre de pièces de gibier. En voilà donc onze cents pièces, sans compter celles qui périssent par accident, et qui ne servent d'aliment ni à l'homme, ni à d'autres animaux [39].
Il faut maintenant se demander quelle est l'étendue de terrain nécessaire pour faire exister, pendant tout le cours de l'année, un si grand nombre d'animaux propres à servir à d'autres de [I-135] pâture. Le nombre de ceux qui peuvent vivre dans un pays inculte, est toujours déterminé par la quantité d'alimens que la terre leur présente dans la saison la plus rigoureuse. S'il en naissait un nombre plus considérable au temps où le sol leur offre des alimens en abondance, une partie périrait de faim dès que le mauvais temps serait venu. Il est aisé de voir qu'une lieue carrée de terrain ne saurait suffire pour faire exister pendant l'hiver, quand la terre est couverte de neige, un si grand nombre d'animaux. Admettons toute fois qu'une lieue carrée soit suffisante, dans cette supposition, il faudra, pour faire vivre une famille de six personnes, un territoire de six lieues carrées. Quelque grande que soit cette étendue, on trouvera qu'elle est loin d'être exagérée, si l'on n'oublie pas qu'une lieue carrée de terrain ne nourrit que six ou sept personnes dans de vastes contrées où la culture a déjà pénétré, et qu'une partie de cette faible population est souvent emportée par la famine.
Il n'est pas de vérité mieux démontrée que l'état de misère et de détresse dans lequel vivent habituellement les peuplades qui tirent tous leurs moyens d'existence de la pêche, de la chasse, ou des objets que leur présente la nature inculte. Une lieue carrée de terrain fournit à un sauvage moins de ressources, que n'en trouve chez nous un ouvrier dans l'exercice du plus commun des métiers. [I-136] Nous pouvons supposer cependant que, dans l'état de la plus profonde barbarie, les hommes sont aussi bien pourvus de tout ce qui leur est nécessaire pour satisfaire leurs besoins, que dans un état de civilisation semblable à celui de la France. Dans cette supposition, un hectare de terre en France sera une propriété parfaitement égale à douze cents hectares dans une contrée tout-à-fait sauvage; la première fournira les mêmes ressources que la seconde. Par la même raison, un hectare de terre qui vaudrait douze cents francs parmi nous, ne vaudrait qu'un franc chez des peuples qui n'auraient fait aucun progrès dans la culture.
Lorsque la terre est abandonnée à sa fertilité naturelle, il en faut donc une lieue carrée au moins pour fournir des moyens d'existence à un seul homme; mais il ne faut pas s'imaginer que, même dans cet état, elle donne gratuitement les alimens qu'elle présente ; un sauvage, pour s'emparer de sa proie, a besoin de se livrer, presque tous les jours, à des courses longues et fatigantes. Le genre d'industrie auquel il se livre, et les privations auxquelles il est condamné, ne seraient pas moins insupportables pour un homme civilisé, que ne le seraient pour lui les travaux auxquels se livrent les habitans de nos campagnes. Dans toutes les positions, c'est donc par son travail que l'homme s'approprie [I-137] les choses dont il a besoin pour exister.
Il suit des observations qui précèdent, que la plus grande partie de la valeur qu'ont les terres chez les nations civilisées, est le résultat de l'action que les hommes ont exercée sur elles, et des progrès de la population. Si une lieue carrée de terre fournit, parmi nous, des moyens d'existence à douze cents personnes, par exemple, onze cents parties de la valeur qu'elle a, sont des produits de l'industrie humaine. Le douze centième qui reste, représente la valeur qu'avait la terre, lorsqu'abandonnée à sa fertilité naturelle, elle servait de retraite aux animaux nécessaires à l'existence d'un seul homme.
Cette différence, entre la valeur primitive du sol et la valeur que lui donnent l'industrie humaine et l'accroissement de la population qui en est la şuite naturelle, est tellement considérable que, pour y croire, il faut en quelque sorte faire violence à son esprit. Cependant, c'est une vérité dont l'évidence ne peut être contestée, quand on observe quelle est la valeur des terres dans les contrées où la civilisation n'a jamais pénétré, et qu'on étudie l'histoire des établissemens formés par des Européens sur des terres qui n'étaient habitées que par des sauvages.
Si ce qui précède ne suffisait pas pour démontrer que les hommes qui, les premiers, ont mis la [I-138] terre en culture, dans quelque pays que ce soit, et qui se la sont ainsi appropriée, n'ont rien ravi à leurs semblables, les chapitres suivans suffiront pour donner à cette vérité le caractère de l'évidence.
[I-139]
CHAPITRE X.
De la conversion du territoire national en propriétés privées.↩
La terre est la source féconde qui produit toutes les choses dont nous avons besoin pour nous alimenter, nous vêtir ou nous abriter; mais tant qu'elle reste abandonnée à elle-même, elle ne montre, dans ses productions, aucune préférence particulière pour l'homme. Bien loin de laisser voir pour nous aucune prédilection, la terre inculte ne produit, au contraire, avec une grande abondance, que des végétaux qui ne sauraient immédiatement nous servir d'alimens. Il semble qu'elle est, à notre égard, d'autant plus avare de subsistances, qu'à certaines époques de l'année, elle en est plus prodigue pour la plupart des autres animaux.
Les hommes dont une peuplade est formée, sont donc condamnés à vivre de proie, aussi long-temps que la terre qu'ils occupent, reste sans culture, et qu'ils n'ont pas réduit à l'état de domesticité des animaux propres à les nourrir. Dans une telle situation, [I-140] les seules propriétés individuelles qui existent, sont des instrumens de guerre, de chasse ou de pêche, des dépouilles d'animaux, des cabanes et de petites provisions d'alimens. La terre et les rivières du bassin dans lequel chaque peuplade est renfermée, forment son territoire national, et tant qu'il reste inculte, il n'est pas susceptible d'être divisé.
Il est impossible, en effet, de circonscrire le poisson ou les animaux sauvages dans des propriétés individuelles ou dans les fractions d'un grand bassin; il n'y a pas d'autres moyens de les atteindre que de les poursuivre aussi loin qu'ils peuvent aller. Les limites dans lesquelles le poisson d'eau douce est renfermé, sont nettement déterminées par la nature, et ne sauraient être franchies; pour cette classe d'animaux, il n'y a pas de communication d'un bassin à un autre. Les animaux terrestres se meuvent dans un espace plus étendu; ils peuvent; sans rencontrer d'obstacles, parcourir toute la superficie d'un immense bassin, ou même passer dans un autre. Cependant, comme ils ont leurs habitudes de même que les hommes, et comme ils sont sans cesse ramenés par leurs besoins dans les vallées qui leur offrent des alimens et des abris, les montagnes qui séparent les nations les unes des autres, servent aussi de limite à la plupart des animaux.
[I-141]
Si l'on veut bien concevoir comment une peuplade, même quand elle n'est pas sortie de l'état sauvage, se trouve, en quelque sorte, attachée sur la surface d'un bassin formé par une grande chaîne de montagnes, il faut se représenter le fleuve qui parcourt ce bassin comme un arbre immense dont le tronc repose sur la mer, et dont les branches s'étendent dans les vallées latérales formées par les ramifications des montagnes. Le poisson se place habituellement dans le tronc et dans les branches principales; jamais il ne s'élève jusqu'à l'extrémité des rameaux. Le gros gibier, le seul qui puisse fournir à un certain nombre de familles des alimens suffisans pour subsister, se place dans les vallées, parce que ce n'est que là qu'il trouve d'abondans pâturages, et dé l'eau pour se désaltérer. Les hommes se fixent là où la nature a attaché leurs subsistances.
Tant que la terre est abandonnée à sa fertilité naturelle, et qu'elle n'est utile aux hommes que par les alimens qu'elle fournit à certains animaux, il ne peut donc se former aucune propriété territoriale individuelle. L'espace dont chaque famille a besoin pour subsister, est tellement étendu, qu'on ne saurait le clorre de manière à prévenir la fuite des animaux qui s'y trouveraient renfermés; et par conséquent, la jouissance du territoire entier reste commune à toutes les familles dont la horde ou la peuplade se compose. Non-seulement la jouissance [I-142] en est commune, mais les individus ne parviennent à se procurer des subsistances qu'autant qu'ils vont ensemble à la poursuite du gibier. S'ils ne se réunissaient pas pour le cerner, le poursuivre, ou l'engager dans d'étroits défilés, jamais ils ne parviendraient à s'en rendre maîtres. Même dans l'état le plus barbare, les hommes ne peuvent se conserver qu'au moyen d'associations, dans lesquelles ils mettent en commun leurs forces, leur adresse et leur intelligence [40].
On a vu, par ce qui précède, que, dans l'état de barbarie, il faut à un homme pour subsister un peu plus d'une lieue carrée de terrain, et qu'il en faut, par conséquent, à une peuplade un peu nombreuse une étendue immense; que chaque peuplade s'arrête naturellement devant les barrières qui servent de limites à ses subsistances, et qu'elle parcourt tout le bassin dans lequel elle s'est développée ; que ; que la terre reste une propriété commune à toutes les familles auxquels elle fournit des moyens d'existence, et ne peut être partagée que par la culture; enfin, , que les hommes qui vivent dans le même bassin, sont obligés de s'associer entre eux pour se rendre maîtres des animaux dont ils peuvent se nourrir.
[I-143]
Il reste maintenant à observer comment des fractions du territoire national en sont détachées pour être converties en propriétés privées; il reste surtout à démontrer comment les hommes qui renoncent à vivre de proie pour s'attacher à la culture, peuvent s'approprier une certaine étendue de terre sans rien ravir à personne, et même en rendant de grands services à leurs semblables.
Si des hommes policés qui sont armés de tous les moyens que peut fournir une civilisation avancée; qui sont pourvus d'instrumens puissans pour abattre des arbres ou défricher la terre; qui possèdent des semences de toute espèce et des provisions pour plus d'une année, rencontrent des difficultés sans nombre, et sont obligés de se livrer à des travaux fatigans, quand ils veulent mettre en culture des terres marécageuses ou couvertes d'arbres et de broussailles, comment des sauvages, qui n'avaient pour instrumens de culture que leurs mains, des pierres et des branches d'arbres, et qui, pour vivre, étaient obligés de poursuivre leur proie dans les forêts, ont-ils pu mettre la terre en état de culture? comment ont-ils pu garantir leurs premières récoltes de l'invasion des animaux et du pillage de leurs semblables?
Je ne me suis pas proposé de donner ici l'histoire particulière des peuples qui les premiers se sont avancés dans la carrière de la civilisation; je [I-144] n'ai point par conséquent à rechercher quels ont été les premiers instrumens à l'aide desquels les hommes sont sortis de la barbarie, ni à décrire les travaux et les souffrances des premiers cultivateurs. Des recherches de cette nature ne nous donneraient, sur un grand nombre de points, que des résultats fort incomplets, fort vagues, et, par conséquent, peu satisfaisans. Ce que nous avons à observer ici, ce sont les obstacles qui résultent de la nature des choses, les moyens naturels que les hommes ont eus pour les vaincre, et les résultats qu'ont produits leurs efforts.
Partout où il a été possible d'observer des peuples au moment où ils commençaient à sortir de la barbarie, on a vu que les hommes se livraient en commun à la culture de la terre; que les produits en étaient déposés dans des magasins publics, et que chaque famille en recevait ensuite à raison de ses besoins. Cette communauté de travaux et de biens fut observée par les Romains chez plusieurs peuples germaniques; elle le fut également chez les peuplades du nord de l'Amérique par les premiers voyageurs qui les visitèrent; les Anglais qui fondèrent l'état de Virginie, furent obligés de recourir au même moyen, pour mettre la terre en état de culture, et c'est probablement ainsi que l'appropriation individuelle de la terre a commencé dans tous les pays.
[I-145]
Dans l'état de barbarie, les individus qui appartiennent à la même peuplade ne diffèrent guère les uns des autres que par l'âge et le sexe, ou par un peu plus ou un peu moins de force ou de beauté. Obligés de s'associer pour se procurer les alimens que la nature leur présente, et nul ne pouvant en faire une grande provision sans le secours de ses semblables, ils éprouvent tous la même disette, ou jouissent de la même abondance. Il est donc impossible qu'un homme possède une grande quantité de subsistances, tandis que d'autres sont condamnés par le besoin à se livrer à des occupations fatigantes. Dans un tel état, nul n'est assez riche pour acheter le travail d'un autre, et tous sont assez pauvres pour être obligés de se livrer au travail pour se procurer leur subsistance.
D'un autre côté, un homme qui agirait seul pour arracher des arbres et défricher la terre, serait si faible; il lui serait si difficile de se procurer les subsistances dont il a chaque jour besoin, et de se livrer en même temps à un travail qui ne doit lui fournir des alimens qu'au bout d'une année; enfin, en supposant qu'il lui fût possible de mettre un petit espace de terre en culture, il lui serait si difficile de mettre sa récolte à l'abri des animaux ou même de ses semblables, qu'il est impossible de concevoir qu'au milieu d'une peuplade barbare, un individu se livre seul à la [I-146] culture; il faut que tous les hommes réunissent leurs efforts pour cultiver un champ comme pour cerner une troupe d'animaux, et c'est, en effet, ce qu'on a observé dans les pays qui commençaient à sortir de la barbarie.
Toutes les fois qu'une industrie ne procure pas immédiatement des moyens d'existence aux personnes qui s'y livrent, elle ne peut être exercée que par les hommes qui possédent assez de provisions pour vivre jusqu'à ce que les produits de leur travail soient terminés. Jamais les Européens ne seraient parvenus à fonder des colonies dans des contrées incultes, si les hommes qu'ils y envoyaient n'avaient eu pour exister et pour se livrer à la culture, que les ressources qui leur étaient offertes par le sol dont ils allaient s'emparer. Parmi nous, un fermier ne parvient à obtenir une récolte de sa ferme, qu'en fournissant aux personnes qu'il emploie, des semences, des engrais, des instrumens d'agriculture, et des moyens de se vêtir, de se loger, de se nourrir. Chacun de ses ouvriers ou de ses domestiques a, dans la récolte qu'il contribue à faire croître, une part proportionnée aux services qu'il rend; mais cette part lui est payée en très-grande partie par anticipation: c'est le chef de l'entreprise qui lui en fait l'avance.
Il faut de même qu'une peuplade qui veut mettre en culture une partie du territoire qu'elle [I-147] occupe, ait des provisions pour subsister pendant le travail. Elle est obligée de faire deux parts de son temps; elle doit en consacrer une à s'emparer des subsistances que lui présente la nature inculte; elle doit consacrer l'autre à rendre la terre fertile, ou pour mieux dire, à la diriger dans ses produits. Dans les contrées où la civilisation commence à se développer, ce sont les hommes qui donnent à la terre sa première préparation; ce sont eux qui en font disparaître les arbres, les broussailles et tout ce qui peut nuire au développement des plantes qu'ils se proposent de multiplier. Quand ils ont exécuté ces travaux, qui sont toujours les plus pénibles, ils abandonnent à leurs femmes les soins ordinaires de la culture, et retournent à la poursuite du gibier ou de leurs ennemis.
Nous avons vu que toute nation, qu'elle soit barbare ou civilisée, a un territoire sur lequel elle s'est développée, et qui forme sa propriété nationale; nous avons vu que cette propriété est un fait reconnu, et qu'il devient d'autant plus incontestable que la civilisation fait plus de progrès. Nous avons observé, d'un autre côté, que, suivant les lois de notre nature, un homme ne peut être la propriété d'un autre; que sa personne n'appartient qu'à lui-même, et que toute valeur qu'il crée n'appartient également qu'à lui, [I-148] s'il ne l'a point aliénée. Ces faits étant reconnus, rien n'est plus facile que de concevoir comment se forment les propriétés individuelles qui consistent en fonds de terres.
Supposons qu'un certain nombre d'hommes, à force d'économies, de soins et de fatigues, parviennent à mettre en culture une certaine étendue de terre; qu'ils l'environnent de haies ou de fossés; qu'ils y construisent des magasins ou des habitations; qu'ils y sèment des grains ou des légumes; qu'ils y fassent croître des arbres à fruits; qu'ils y élèvent des animaux; enfin qu'ils la rendent assez fertile pour qu'elle assure à eux et à leurs familles des moyens suffisans d'existence.
Il est évident qu'en agissant ainsi, ils ne ravissent rien aux hommes étrangers à leur nation, puisque nous admettons l'existence d'un territoire national. Ravissent-ils quelque chose à leurs compatriotes? Au contraire, ils leur abandonnent la plus grande partie des terres qui leur était auparavant nécessaires pour exister. Quand ils étaient réduits à vivre de poisson ou de gibier, il fallait à chacun d'eux, pour subsister, plus d'une lieue carrée de terrain. Si, par leur travail, ils obtiennent de la millième partie de cette étendue, plus de subsistance que ne pouvait en produire la totalité, il est évident qu'ils abandonnent neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parties de leur propriété primitive. [I-149] L'appropriation de la terre par la culture, bien loin d'être une usurpation sur la propriété d'autrui, a donc pour résultat de réduire l'homme qui passe à l'état d'agriculteur, à un espace infiniment plus étroit, et d'augmenter ainsi l'espace réservé aux autres, de tout ce qu'il abandonne. L'étendue qui suffisait à peine pour faire vivre dix hommes dans un état habituel de détresse, donnera des moyens d'existence à dix mille cultivateurs intelligens.
Un espace de terre déterminé ne peut produire des alimens que pour la consommation d'un homme pendant une journée. Si le possesseur, par son travail, trouve le moyen de lui en faire produire pour deux jours, il en double la valeur. Cette valeur nouvelle est son ouvrage, sa création; elle n'est ravie à personne : c'est sa propriété. Si, au lieu de la doubler, il la décuple, s'il la rend mille fois plus grande, elle n'en sera pas moins une chose qui lui sera propre. Donner à un arpent de terre la puissance de produire comme cent, ou en centupler l'étendue sans en accroître la fertilité, c'est à peu près la même chose. La première opé ration serait même plus avantageuse que la seconde; car elle donnerait plus de facilité de faire la récolte et d'en prendre soin. Les hommes qui, par les capitaux qu'ils ont cumulés et par leur industrie, rendent la terre plus fertile, ne sont donc pas [I-150] moins utiles à leurs semblables que s'ils en créaient une nouvelle étendue. S'ils parviennent à fertiliser une terre qui ne produisait absolument rien, ou qui même était funeste, comme certains marais, ils créent par cela même la propriété tout entière[41].
Ce qui rend si difficile l'appropriation de la terre par la culture, dans les contrées entièrement sauvages, ce ne sont pas seulement les obstacles que présentent les arbres qu'il faut abattre, les broussailles qu'il faut détruire, la terre qu'il faut défricher; c'est surtout la difficulté d'avoir des subsistances pendant le travail, et jusqu'au mo ment où la terre cultivée nourrisse elle-même le cultivateur. Aussi, du moment qu'un certain espace de terre a été mis en état de culture, et qu'il fournit aux travailleurs des alimens suffisans pour vivre d'une récolte à l'autre, les terres voisines acquièrent par ce seul fait une certaine valeur; elles peuvent être plus aisément cultivées. Ce [I-151] phénomène est surtout frappant aux États-Unis; à mesure que la culture avance vers les terres non cultivées, ces terres augmentent graduellement de prix, quoique aucun travail n'y soit exécuté.
Il résulte de là une conséquence qui mérite d'être remarquée. J'ai fait voir que l'homme qui passe de la vie sauvage à la vie agricole, et qui convertit par la culture une fraction du territoire national en propriété privée, loin de commettre une usurpation, renonce à la partie la plus considérable de sa propriété primitive. Je dois maintenant ajouter qu'en mettant en culture une fraction de cette propriété primitive, il accroît la valeur de toutes les terres qui environnent la sienne, et qu'il augmente ainsi les richesses de ses concitoyens, sans qu'ils se donnent aucune peine. Cet accroissement de la valeur d'un fonds de terre, qui résulte de l'augmentation de valeur donnée par l'industrie aux terres environnantes, est quelquefois tellement considérable, qu'on refuserait d'y croire, si l'on n'était pas convaincu par l'évidence des faits.
Dans certains quartiers de Paris, par exemple, dix mètres carrés de terrain sur lesquels il n'existe aucune construction, valent environ cinq ou six mille francs, tandis que dans d'autres ils ne valent que deux ou trois cents francs, et qu'à quelque distance de la ville, la même étendue de terrain, prise dans les champs, ne vaudrait pas plus de sept [I-152] ou huit francs. D'où vient cette différence de valeur entre des terrains égaux en étendue? d'une seule circonstance, de ce que les terrains qui environnent le premier, sont devenus des propriétés considérables par les constructions dont ils ont été couverts. Chaque maison qui a été bâtie sur un terrain, a augmenté de quelque chose la valeur du terrain voisin; et c'est ainsi que de proche en proche, un fonds qui n'avait qu'une petite valeur, quand il était environné de champs ou de prairies, est devenu une propriété considérable, du moment qu'il s'est trouvé au milieu d'une ville populeuse.
Mais puisqu'un fonds de terre peut acquérir une grande valeur, par suite de la valeur donnée aux terres voisines, les hommes qui, par leur industrie, créent celle-ci, ne seraient-ils pas fondés à revendiquer l'accroissement que subit celle-là? Il y a toujours action et réaction dans cet accroissement de valeurs ou de propriétés; si mon voisin augmente la valeur du sol qui m'appartient, quand il construit une maison sur le sien; j'augmente à mon tour la valeur de sa maison en en construisant une sur le mien. Il serait d'ailleurs impossible, ou du moins excessivement difficile de constater l'accroissement qu'un homme fait éprouver aux terres qui environnent la sienne, quand il y ajoute quelque valeur.
[I-155]
Chez toutes les nations, même chez les plus civilisées, il existe toujours une certaine étendue de terres qui restent la propriété indivise des habitans d'une commune, d'une province ou de l'état. Ces propriétés sont généralement administrées par des délégués qui en perçoivent les revenus pour la masse des propriétaires, et qui les emploient dans son intérêt. Si, sans éprouver aucune modification, ces propriétés augmentent de valeur, par suite de l'accroissement que l'industrie fait éprouver aux propriétés individuelles, il est évident que l'augmentation de la première tourne au profit de tous ceux qui en sont les auteurs. Aux États-Unis, quand la culture approche d'un territoire occupé par des sauvages, le Gouvernement achète une partie de ce territoire et le revend ensuite à des particuliers. La valeur que ces terres ont, ou qu'elles acquièrent avant que d'être cultivées, résulte évidemment des progrès faits par les citoyens des États-Unis. Aussi, c'est au profit de ceux qui ont contribué à leur donner cette valeur que le prix de la revente est employé.
Dans une contrée entièrement sauvage, le nombre des animaux que la terre peut supporter, est réglé par la quantité de subsistances qu'elle leur offre pendant la saison la plus rigoureuse de l'année, et le nombre des hommes, par la quantité d'animaux que la terre leur fournit annuellement. [I-154] Du moment que ce terme est atteint, la population cesse de s'accroître, puisque ses moyens d'existence ne peuvent pas augmenter; mais aussitôt que les subsistances se multiplient par la culture, la population augmente dans la même proportion. Si la terre qui fournissait des alimens à une famille de chasseurs, par exemple, est graduellement mise en culture, la population qui n'était que de cinq ou six individus, pourra se multiplier jusqu'au nombre de cinq ou six mille. Or, lorsqu'une population s'est ainsi développée par la culture d'une certaine étendue de terre, elle considère ces terres comme ses propriétés, de la même manière qu'une nation considère comme son territoire national le bassin dans lequel elle s'est formée. Elle périrait en fort peu de temps, si elle était repoussée sur des terres incultes, ou si ces champs étaient ravagés à mesure qu'elle cherche à les rendre fertiles.
Dans l'enfance de la civilisation, nul n'ayant sur les autres de grands avantages de fortune, les hommes sont obligés de mettre en commun leur intelligence, leur force, leur adresse, pour cultiver la terre, et ils en partagent ensuite les produits. Dans les pays où le travail et l'économie ont déjà cumulé des richesses plus ou moins considérables entre les mains d'un certain nombre de personnes, les choses semblent se passer différemment; cependant, quand on les observe de près, [I-155] les différences sont plus dans les apparences que dans la réalité. Toutes les fois qu'il y a liberté, il y a échange de travaux et de services, quel que soit d'ailleurs l'état de la civilisation; un exemple suffira pour le faire voir, en même temps qu'il démontrera comment des propriétés foncières se forment au sein même des nations les plus civilisées.
La France, considérée comme nation, a un territoire qui lui est propre. Il existe, au milieu de ce teritoire, des espaces de terre fort étendus, qui n'ont pas été convertis en propriétés individuelles. Ces terres, qui consistent généralement en forêts, appartiennent à la masse de la population, et le gouvernement, qui en perçoit les revenus, les emploie ou doit les employer dans l'intérêt commun. Qu'elles soient mises en vente, et qu'un homme industrieux en achète une partie, un vaste marais, par exemple; il n'y aura point ici d'usurpation, puisque le public auquel la terre appartenait incontestablement, en reçoit la valeur exacte par les mains de son gouvernement, et qu'il est aussi riche après la vente qu'il l'était auparavant.
Des ouvriers sont employés à dessécher ce marais, à en arracher les arbres et les broussailles, en un mot à nettoyer le sol; ils en accroissent la valeur, ils en font une propriété plus considérable. La valeur qu'ils y ajoutent leur est payée par les [I-156] alimens qui leur sont donnés et par le prix de leurs journées : elle devient la propriété du capitaliste.
D'autres ouvriers sont employés à construire des bâtimens; les uns tirent la pierre de la carrière, les autres la transportent, d'autres la taillent, d'autres la mettent en place. Chacun d'eux ajoute à la matière qui lui passe entre les mains, une certaine valeur, et cette valeur, produit de son travail, est sa propriété. Il la vend, à mesure qu'il la forme, au propriétaire du fonds, qui lui en paie le prix en alimens ou en salaires.
Des opérations semblables se répètent pour la charpente, pour les ferrures, enfin pour tous les objets nécessaires à une maison : chaque classe d'ouvriers prend certaines matières dans un état où elles ont peu ou point de valeur, et leur donne une certaine utilité dont il reçoit le prix.
La pierre avant d'être tirée de la carrière, le fer avant d'être extrait de la mine, le bois avant d'être enlevé de la forêt, étaient, en effet, des propriétés infiniment petites. Si l'industrie en fait une belle maison et des bâtimens propres à l'exploitation d'une ferme, elles deviennent une propriété considérable; mais la valeur en est distribuée à chacun de ceux qui concourent à la créer.
Après avoir fait nettoyer le sol et construire des bâtimens, le propriétaire du fonds achète des instrumens d'agriculture, des semences, des fourrages, [I-157] des animaux pour l'exploitation. Ce sont des propriétés nouvelles qu'il acquiert; mais il ne les obtient qu'en donnant en échange des valeurs égales, c'est-à-dire en livrant des propriétés équivalentes. Il n'y a point d'usurpation de sa part; personne n'a rien perdu.
Si, quand l'opération est terminée, le capitaliste a dépensé une somme de deux cent mille francs, et s'il a obtenu une propriété qui lui donne huit mille francs de rente, il est exactement dans la même position que s'il avait acheté une terre qui lui aurait donné quatre pour cent de son capital; mais le résultat n'est pas le même relativement aux diverses classes de la société ; il est infiniment plus avantageux pour un grand nombre de personnes.
Il est évident d'abord que, par la transformation d'un marais en une terre fertile, aucun membre de la société n'a rien perdu, et que ceux qui, par leur industrie, ont concouru à la produire, non-seulement ont vécu pendant l'opération, mais ont pu faire quelques économies; or, il n'est personne qui ne sache que la plupart des hommes ne peuvent vivre qu'en échangeant leur travail contre leur subsistance.
En second lieu, quand une terre inculte est convertie une ferme, il se forme sur le champ une famille de fermiers, et comme il faut à cette [I-158] famille des domestiques ou des ouvriers qui l'aident dans son travail, cette classe de la population s'accroît dans la mesure des moyens d'existence qui lui sont offerts [42].
En troisième lieu, les hommes qui sont employés à la culture d'une ferme, ne consomment pas tous les alimens qu'elle produit; ils ont besoin de vêtemens, de linge, d'instrumens d'agriculture; et ils obtiennent ces divers objets au moyen d'une partie de leurs propres produits : une terre mise en culture est donc un débouché ouvert pour l'industrie manufacturière et pour le commerce; il suit de là que la population industrieuse des villes s'accroît par la culture, en même temps que celle des campagnes.
Il faut ajouter à ces divers avantages qui résultent de la création d'une propriété foncière, ceux qui en résultent pour le propriétaire et pour sa famille. Ceux-ci ne consistent pas seulement dans la jouissance du revenu que la terre produit; ils consistent, en outre, dans la considération qui [I-159] s'attache à ce genre de propriété, dans l'influence qu'elle donne, et surtout dans la sécurité qu'elle produit pour les familles, relativement à leurs moyens d'existence.
Si donc nous admettons comme un principe incontestable, que toute valeur appartient à celui qui l'a crée, il s'en suivra que les hommes qui, par la culture, ont converti en propriétés individuelles une partie du territoire national sur lequel ils s'étaient formés, n'ont rien ravi à personne, et que loin de commettre une usurpation, ils ont puissamment contribué au bien-être de leurs semblables.
Quand on jette un regard superficiel sur la société même la mieux organisée, et qu'on voit à côté d'un grand nombre d'hommes qui vivent du produit de leurs terres, un nombre plus grand encore qui n'ont pour vivre que les produits de leur travail de chaque jour, on est tenté de considérer les premiers comme d'adroits usurpateurs, et les seconds comme des dupes ou des victimes; on demanderait volontiers que les parts fussent faites de nouveau, afin que chacun eût la sienne.
Cette injustice apparente s'évanouit, au moins en grande partie, lorsqu'on admet en principe que tout homme est le propriétaire des valeurs qu'il a créées; lorsqu'on observe la manière dont les propriétés se forment, et la marche que suivent [I-160] les diverses classes de la population dans leur accroissement. Les fortunes nées de la fraude ou de la violence sont les seules que la morale et la justice puissent condamner [43].
On a vu, par ce qui précède, comment ont été formées les propriétés individuelles qui consistent en fonds de terre ou en bâtimens; mais on n'a pu voir quels sont les travaux, les fatigues, les dangers auxquels il faut se livrer, pour mettre en état de culture des contrées désertes et sauvages. Les voyageurs qui ont le mieux observé les mœurs des peuples les moins éloignés de la barbarie, n'ont pas su ou n'ont pas voulu nous apprendre par quels moyens et à quel prix ces peuples parvenaient à cultiver la terre. Nous pourrons nous en former une idée, en observant comment plusieurs peuples d'Europe sont parvenus à fonder [I-161] des colonies dans des contrées où la civilisation n'avait jamais pénétré. On verra, par cette exposition, que, si l'homme crée la valeur des terres qu'il s'approprie, ce n'est qu'en se livrant à des soins, à des fatigues, et souvent même à des dangers très-grands.
[I-162]
CHAPITRE XI.
Des obstacles que présente l'appropriation individuelle des fonds de terre.↩
VERS la fin du quinzième siècle, un monde nouveau s'ouvrit tout à coup aux yeux des peuples d'Europe, par une suite naturelle des progrès de la navigation.. Ces peuples ne reconnaissaient des droits qu'aux chrétiens; ils considéraient les hommes qui se trouvaient en dehors du christianisme, comme des ennemis de leur culte, dévoués à la destruction ou à la servitude. Ceux d'entre eux qui étaient les plus habiles dans les arts de la navigation et de la guerre, se précipitèrent donc sur les nations les plus opulentes qui n'étaient pas chrétiennes, pour les asservir, et les dépouiller de leurs richesses. Les autres s'emparèrent du territoire de quelques peuplades qui commençaient à peine à sortir de l'état sauvage, et qui vivaient, en grande partie, des animaux qu'ils prenaient dans les forêts.
Je n'ai pas à m'occuper ici des richesses ou des propriétés acquises à cette époque par l'asservissement et la spoliation de peuples qui, par leur industrie, étaient déjà parvenus à un certain [I-163] degré de prospérité; ce fut un immense déplacement de richesses, et non une formation nouvelle de propriétés. Les terres occupées par des peuplades de sauvages étaient sans doute aussi leurs propriétés, puisque ce n'est que par elles que les hommes auxquels elles fournissaient des moyens d'existence s'étaient formés et pouvaient continuer de vivre; mais ces propriétés qui formaient leur territoire national, n'avaient reçu de l'industrie humaine aucun accroissement de valeur. Elles peuvent donc nous donner le moyen d'apprécier le genre de services que la terre rend à l'homme, dans les contrées où l'industrie humaine ne lui a point donné d'utilité, et les obstacles qu'il faut vaincre pour la mettre en culture.
Lorsque l'Amérique eut été découverte, les navigateurs de toutes les nations se dirigèrent vers cette partie du monde, et y trouvèrent des territoires d'une immense étendue, qui leur parurent entièrement inoccupés. La terre était à leurs yeux une chose aussi commune que l'eau de la mer; chacun pouvait, à ses risques et sans nuire à autrui, aller en cultiver autant que ses besoins en demandaient. Personne cependant ne se hâta d'aller faire sa fortune en établissant de vastes domaines dans des pays où la civilisation n'avait jamais pénétré. Il semble que tout le monde prévoyait que des contrées désertes ne pouvaient être mises en état [I-164] de culture par des efforts individuels, et sans le secours d'immenses richesses.
En 1663, le gouvernement français séduit par l'étendue et la fertilité de ces terres, prit la résolution d'établir dans la Guiane une puissante colonie. Il fit préparer des vaisseaux; il les remplit de provisions, de semences de toute espèce, d'instrumens d'agriculture, et de tentes pour abriter les travailleurs. Douze mille hommes vigoureux, habitués à la fatigue et à la sobriété, furent embarqués, et, après une navigation heureuse, arrivèrent au lieu de leur destination.
Placés en présence d'un territoire immense que personne ne leur disputait, pourvus de vivres et d'instrumens d'agriculture, ils n'avaient qu'à se partager la terre pour se former de vastes domaines. Cependant qu'arriva-t-il? En peu de temps, la pluie, la fatigue, et surtout l'insalubrité de l'air, eurent fait périr dix mille hommes dans les horreurs du désespoir. Les deux mille qui restaient, découragés par les travaux excessifs auxquels il fallait se livrer pour donner à la terre quelque valeur, s'estimèrent heureux d'être ramenés en France. Ils Pensèrent qu'il était plus avantageux pour eux de faire le métier de manoeuvre au sein d'une nation civilisée, que de s'approprier une grande étendue de terre dans une contrée sauvage.
On sacrifia, dans cette expédition, en vivres, en [I-165] semences, en instrumens d'agriculture, une somme de vingt-six millions de livres tournois, qui représente une valeur de plus de cinquante millions de francs au temps où nous vivons; dix mille hommes y perdirent la vie, et, après ces énormes sacrifices, il ne resta pas, en fonds de terre, une valeur suffisante pour tenter des hommes qui n'avaient que leurs bras pour toute fortune [44].
Les Anglais avaient déjà fait, à cette époque, des expériences analogues. Ayant découvert, en 1584, cette partie de l'Amérique qui compose aujourd'hui l'état de Virginie, ils voulurent y former un établissement. Plusieurs personnes puissantes par leur crédit et par leurs richesses, y envoyèrent, sous la direction de Ralegh, sept petits navires et cent quatre-vingts hommes, pour cultiver la terre dont ils allaient prendre possession. Après un séjour de neuf mois, tous allaient être emportés par la famine, lorsqu'un navire arriva d'Angleterre, et leur porta des vivres. Ils furent ramenés dans leur pays natal: parmi eux, il ne se trouva pas ún homme qui fût séduit par l'espérance de devenir propriétaire d'un riche domaine.
Quelques années plus tard, le même projet fut repris. On expédia trois navires avec une colonie [I-166] plus forte que la première. Les colons furent pourvus d'armes, de vivres, de semences, d'instrumens d'agriculture, enfin de tous les objets nécessaires à leur établissement. Lorsqu'ils virent les travaux auxquels ils avaient à se livrer pour arracher à la terre des produits propres à leur servir d'alimens, ils craignirent de manquer de vivres, et ils supplièrent leur commandant de retourner en Angleterre pour leur en apporter. Il partit ; mais avant son retour, la famine, les maladies et les sauvages les avaient tous détruits.
Vingt années s'écoulèrent sans qu'il se rencontrât personne qui voulût former une tentative nouvelle. En 1607, une troisième expédition fut envoyée sur la même terre; et comme les précédentes, elle se pourvut de tout ce qu'elle jugea nécessaire à l'établissement d'une colonie. Arrivés sur le continent américain, les colons se mirent à l'ouvrage; mais, avant que la terre eût rien produit, les vivres commencèrent à devenir rares. Les exhalaisons d'une terre nouvellement cultivée, la chaleur et l'humidité du climat, et le défaut de subsistances, amenèrent des maladies. Avant le commencement de septembre, la moitié de la colonie avait péri; l'autre moitié n'avait plus ni force ni courage.
Le chef des colons, nommé Smith, parvint cependant à leur rendre l'espérance; mais ayant [I-167] été pris par les sauvages, la colonie fut presque entièrement ruinée pendant son absence. A son retour, elle ne consistait plus qu'en trente – huit personnes qui voulaient retourner en Angleterre. Cependant, par ses prières, ses caresses, ses menaces, il parvint à les retenir jusqu'à l'arrivée d'un vaisseau qui leur apporta des provisions, et leur amena un renfort de nouveaux colons.
L'espérance revint avec les forces on se remit au travail. Les colons ayant fait la paix avec les sauvages, les déterminèrent à leur vendre une partie de leurs subsistances; car les sauvages se livraient à la culture avant l'arrivée des Européens. La désunion se mit de nouveau entre les indigènes et les colons: ceux-ci cessèrent de recevoir des secours des premiers, et la famine ne tarda pas à se manifester. Les colons tuèrent d'abord les animaux qu'ils avaient amenés dans le dessein de les multiplier: cette ressource épuisée, ils se nourrirent de racines nauséabondes. Enfin, ils furent réduits à manger les cadavres des Indiens qu'ils parvenaient à tuer, et ceux même de leurs compatriotes que la famine ou les maladies avaient emportés. La colonie, qui était de cinq cents personnes, fut en peu de temps réduite à soixante, qui n'avaient plus que quelques jours à vivre, lorsque de nouveaux secours arrivèrent d'Europe. Les navigateurs qui les leur apportaient, et qui croyaient trouver une colonie florissante, [I-168] en voyant le teint livide, les corps décharnés de ce petit nombre d'individus, les prirent pour des spectres ou des cadavres ambulans. Cependant, depuis la prise de possession, deux années s'étaient écoulées.
Enfin, les colons parvinrent à tirer du sol les alimens qui leur étaient rigoureusement nécessaires pour vivre; mais ce ne fut qu'en 1612, c'est-à-dire cinq années après leur établissement. Jusque-là, ce fut la mère-patrie qui leur fournit des moyens d'existence. Pour mettre la terre en état de culture ils ne commencèrent point par se la partager; chacun d'eux ne cultiva point un champ en particulier. Ils mirent leurs forces et leur intelligence en commun, et les produits de la terre furent enfermés dans un grenier public. S'ils s'étaient divisé la terre, et si chacun avait voulu ne travailler que pour lui, jamais ils ne seraient parvenus à rendre le sol fertile.
La compagnie qui fonda cet établissement, dépensa, dans un espace de seize années, une somme de cent cinquante mille livres sterling, et y envoya neuf mille personnes. Au bout de ce temps, en 1624, la colonie n'était composée que de deux mille individus; et, après avoir prélevé sa subsistance, elle n'exportait que pour vingt mille livres sterling de ses produits. Ainsi, pour obtenir les alimens nécessaires à deux mille personnes, et la valeur de [I-169] vingt mille livres sterling d'exportation, il avait fallu sacrifier un capital énorme, et la vie de sept mille hommes.
Si maintenant l'on veut connaître la valeur primitive de la terre dont les premiers colons s'emparèrent, il faut mettre d'un côté le capital employé à la culture, les intérêts de ce capital, et le prix de la main-d'oeuvre des travailleurs; il faut mettre de l'autre côté la valeur des subsistances consommées et celle des exportations, ou pour mieux dire, un capital dont les intérêts seraient égaux aux valeurs exportées; il faut voir ensuite de combien la seconde somme excède la première. Si ce calcul était fait avec soin, on trouverait que la valeur de la terre était excessivement petite [45].
Les persécutions religieuses dont l'Angleterre fut le théâtre, poussèrent dans la partie septentrionale de l'Amérique, un grand nombre d'hommes énergiques et industrieux, qui possédaient tous quelques richesses, et dont quelques-uns avaient même de grandes fortunes. La force qu'il trouvèrent dans l'enthousiasme religieux, et les nombreuses ressources qu'ils emportèrent de leur pays natal, furent pour eux des moyens puissans de vaincre les obstacles que leur présentait la nature. [I-170] Cependant, les difficultés qu'ils trouvèrent à mettre le sol en état de culture, furent si grandes, que beaucoup d'entre eux succombèrent sans les avoir vaincus. Dans le premier hiver, la moitié des colons qui avaient passé dans la Nouvelle-Angleterre, périrent de fatigue, de misère, ou par suite des rigueurs du climat [46].
Quand le gouvernement anglais voulut, en 1788," fonder une colonie dans cette partie du monde qu'on appelait alors la Nouvelle- Hollande, et qu'on nomme aujourd'hui l'Australe-Asie, il fournit en abondance aux colons des instrumens d'agriculture, des semences, des subsistances et des animaux domestiques de toute espèce. La première année, les colons furent nourris aux frais de la métropole; ils reçurent ensuite une demi-ration pendant dix-huit mois; enfin, ce ne fut que la septième année après leur établissement, qu'ils purent pourvoir par eux-mêmes à leurs besoins. Les hommes que le gouvernement avait envoyés la première année dans cette contrée, étaient, pour la plupart, des gens endurcis au travail et habitués aux privations. Néanmoins, quoique le climat fût très-doux, [I-171] ils furent obligés de se livrer à des travaux excessifs, pour donner à la terre quelque valeur [47].
Les Hollandais ne parvinrent à fonder une colonie au cap de Bonne-Espérance qu'en faisant des sacrifices immenses. Non-seulement ils offrirent gratuitement de la terre aux hommes qui voudraient aller s'y fixer, ils donnèrent à ceux qui acceptèrent leurs offres, des instrumens d'agriculture, des semences, des subsistances pendant un certain temps. Comme leurs propositions ne pouvaient être acceptées que par des hommes qui n'avaient aucun moyen d'existence, ils leur donnèrent [I-172] pour compagnes des femmes tirées des maisons de travail. Enfin, ils prirent envers eux l'engagement de les ramener dans leur patrie, si, au bout de trois ans, ils jugeaient à propos d'y retourner; et, dans ce cas, chacun devait avoir la faculté de disposer de la propriété qu'il aurait formée. Il est prouvé, dit un historien, que, pour fonder cette colonie, quarante-six millions furent dépensés dans l'espace de vingt ans [48].
Une compagnie française, ayant obtenu du gouvernement la concession de la Guadeloupe, de Mari-Galante et de Sainte-Lucie, forma quelques établissemens dans ces îles. Elle ne tarda pas à s'apercevoir que la possession lui en était plus onéreuse que profitable. En 1649, elle les vendit à un nommé Boissent pour la somme de 75,000 livres. L'année suivante, la Martinique, Sainte-Lucie et la Grenade furent vendues à Duparquet pour la somme de 60,000 livres. Les îles de Saint-Christophe, Saint-Martin, Saint-Barthélemi, SainteCroix et la Tortue furent vendues, en 1651, pour le prix de 120,000 livres. Les acquéreurs de ces îles devaient y jouir de l'autorité la plus étendue; non-seulement ils avaient la disposition du terrain, mais ils en avaient la souveraineté. Ils nommaient [I-175] à tous les emplois civils et militaires; ils pouvaient faire grâce à ceux que leurs délégués avaient condamnés à mort [49].
Pour se faire des idées exactes de la valeur que les terres avaient dans ces îles, vers le milieu du dix-septième siècle, une simple opération suffit: il ne faut que comparer l'étendue des terres vendues au prix pour lequel elles furent livrées. Les trois îles de la Martinique, de Sainte-Lucie et de la Grenade, furent données pour 60,000 livres. L'étendue de la première est de 127,285 hectares suivant Malte-Brun. En comptant pour rien la Grenade, et Sainte-Lucie qui a cependant près de cinquante lieues carrées, on donnait un hectare de terre pour quelques sous.
Le gouvernement portugais a toujours été fort libéral de terres dans le Brésil; les colons qui ont voulu en obtenir, n'ont pas eu d'autres frais à faire que de les demander; jamais on ne les leur a vendues [50]. Le gouvernement français a tenu la même conduite au Canada, aussi long-temps que cette contrée est restée sous sa domination. La seule condition qu'il ait mise aux concessions qu'il a faites, a été d'exiger que les terres concédées fussent mises en état de culture dans un temps donné; [I-174] mais jamais il n'a tenu à l'accomplissement de cette condition [51].
Cependant le gouvernement des États-Unis vend les terres que les indigènes lui ont cédées. Ces terres ne sont quelquefois vendues qu'à raison d'un centième de dollar par acre (un peu plus d'un sou [52]). Quelquefois aussi elles sont vendues un peu plus ou un peu moins d'un dollar l'acre, selon qu'elles sont plus ou moins éloignées des pays cultivés. Cette valeur est, en grande partie, le résultat des travaux exécutés sur les terres voisines. On a déjà vu, dans le chapitre précédent, en effet, que les terres incultes augmentent de valeur à mesure que des populations civilisées s'étendent vers elles. La raison en est que la culture en devient moins difficile, et qu'on trouve plus aisément à échanger les produits qu'on en retire, contre d'autres produits.
Toutes ces terres, qui n'avaient presque point de valeur, quand elles n'étaient parcourues que par des tribus sauvages, sont devenues des propriétés précieuses, à mesure que l'industrie humaine les a fertilisées. La Martinique, vendue en 1650 pour une somme de trente ou quarante mille francs, exportait en 1775 pour près de dix-neuf millions de ses produits Des terres, qui n'auraient coûté [I-175] que quelques centimes il y a un siècle et demi, ou qui même n'auraient pas trouvé d'acquéreurs, parce qu'on jugeait qu'elles n'avaient aucune valeur, vaudraient aujourd'hui plusieurs millions. Ce phénomène, que des hommes qui vivent encore ont observé sur une grande partie de l'Amérique et dans quelques autres parties du monde, s'est manifesté de la même manière chez tous les peuples civilisés. Il s'est développé un peu moins rapidement dans les états européens, et les progrès en ont été moins bien observés, par la raison qu'on est toujours moins frappé de ce qui se passe autour de soi, que de ce qui arrive au loin; mais, dans tous les pays, l'espèce humaine a suivi les mêmes lois dans son développement. Le sol sur lequel Paris repose et les divers matériaux dont cette ville est construite, furent, dans un temps, des objets aussi dépourvus de valeur que l'étaient, il y a deux siècles, la terre sur laquelle repose Philadelphie, et les matières qui composent ses richesses.
Quand les Européens se sont transportés en Amérique, en Afrique ou dans l'Australe-Asie, et qu'ils se sont emparés, par la force, de terres occupées par des sauvages, ils ont évidemment usurpé des propriétés; ils ont dépouillé les possesseurs de leurs moyens d'existence, Il faut cependant prendre garde de s'exagérer l'importance de ces [I-176] usurpations on doit les apprécier par le nombre d'hommes que faisaient vivre les terres usurpées et par les moyens qu'elles leur fournissaient. On commettrait une erreur grave, si on les jugeait par la valeur que ces terres ont acquise depuis qu'elles ont été mises en état de culture. Il est évident, par exemple, que, si l'étendue de terre qui vaut aujourd'hui mille francs, ne valait que cinq centimes quand elle fut usurpée, il n'y a réellement eu que la valeur de cinq centimes de ravie. Une lieue carrée de terre suffisait à peine pour faire vivre un sauvage dans la détresse; elle assure aujourd'hui des moyens d'existence à mille personnes. Il y a neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parties qui sont la propriété légitime des possesseurs; il n'y a eu d'usurpation que pour un millième de la valeur; le surplus a été créé par l'industrie [53].
On vient de voir comment, à l'aide de capitaux cumulés, des Européens sont parvenus à former des propriétés en fonds de terre, sur des territoires dont ils s'étaient emparés par la force, ou dont ils avaient obtenu la concession des possesseurs. [I-177] Ici se présente un problème difficile à résoudre. Comment des hommes ont-ils pu passer de la vie sauvage à la vie agricole? Comment ont-ils pu transformer des fractions de leur territoire national en propriétés individuelles? Si les Européens, avec tous les moyens que l'industrie leur fournit, et avec d'immenses capitaux, ont eu tant de peine à convertir des terres incultes en propriétés individuelles, comment des hommes dépourvus de tout sont-ils arrivés au même résultat? Si des capitaux sont nécessaires pour mettre des terres en culture, et si tous les capitaux viennent primitivement de la terre, par quels moyens les premiers cultivateurs sont-ils parvenus à rendre la terre fertile?
En toutes choses, les difficultés les plus grandes qui se présentent, sont dans les commencemens. Une montre, une machine à vapeur, sont des inventions merveilleuses; mais, pour les exécuter, il a fallu moins de temps, de patience, et peut-être de génie, qu'il n'en fallut jadis pour fabriquer le premier marteau et la première enclume. Les premières difficultés vaincues, les premiers instrumens des arts étant produits, il était plus aisé de se livrer à des travaux de tout genre.
Nous pouvons dire, pour la culture de la terre, ce que nous disons pour les autres arts: les produits du premier arpent cultivé donnent les moyens de cultiver celui qui suit, et plus la culture avance, [I-178] moins elle devient difficile. Cela nous explique les rapides progrès qu'ont faits les États-Unis, malgré les obstacles sans nombre qu'il a fallu vaincre quand les premiers colons ont commencé à mettre la terre en état de culture.
Mais ici plusieurs questions se présentent. Est-il bon que toutes les parties d'un vaste territoire soient mises en état de culture? Toutes peuvent-elles être converties en propriétés privées, ou convient-il que quelques-unes continuent d'appartenir en commun à la masse de la population? Les fleuves et les rivières, par exemple, qui sont, pour une nation civilisée, d'une si grande utilité, peuvent-ils tomber dans le domaine des particuliers? Si, par leur nature, ils appartiennent au domaine public, comment comment convient-il d'en régler l'usage, dans l'intérêt des propriétaires riverains et de la masse de la population?
Il est, dans tous les pays, des terres qui ne sont jamais cultivées, soit parce qu'elles ne sont pas susceptibles de culture, soit pour d'autres causes que j'exposerai plus loin; dans tous, on n'a pas adopté les mêmes principes relativement à la propriété des rivières; on verra cependant que la force des choses a fini par introduire presque partout les mêmes pratiques.
La terre n'est pas utile aux hommes seulement par les végétaux qu'elle nourrit; elle leur fournit [I-179] de plus une grande variété de matières qu'elle recèle dans son sein. En devenant propriétaire de la superficie, c'est-à-dire de la partie végétale, et de la matière qui la supporte, un homme acquiert-il la propriété de toutes les richesses qu'elle renferme dans son sein, et à la formation desquelles il n'a point contribué? La propriété du dessus emporte-t-elle la propriété du dessous, à l'infini, aussi loin qu'il est possible de descendre? Emporte-t-elle de plus la propriété de l'espace qui est situé au-dessus, aussi haut qu'il est possible de s'élever? Quelles sont enfin les limites naturelles d'une propriété territoriale, soit en profondeur, soit en élévation?
Les lois françaises, conformes, sous ce rapport, à celles des autres peuples, déclarent, en général, que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous; que le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies relativement aux servitudes ou services fonciers, et qu'il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il juge à propos, et tirer de ces fouilles toutes les productions qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et réglemens relatifs aux mines, et des lois et réglemens de police [54].
[I-180]
Les lois et réglemens de police qui limitent la propriété n'ont généralement pour objet que d'empêcher qu'on n'en abuse pour nuire à autrui; mais les lois et réglemens relatifs aux mines reconnaissent une espèce de propriété distincte de la propriété du sol; et c'est de celles-là dont il conviendra d'examiner la nature et l'étendue.
[I-181]
CHAPITRE XII.
Des parties du territoire national qui restent communes, et particulièrement des fleuves et des rivières.↩
Il n'arrive jamais que toutes les parties dont un grand bassin se compose soient converties en propriétés privées. Il en est plusieurs qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de division, ou dont le partage détruirait presque entièrement l'utilité. Il en est d'autres qu'on est obligé de consacrer aux communications, et qui doivent, par conséquent, rester communes à tous les membres de la société. Les rivières et les fleuves, par exemple, appartiennent, par leur nature, à la masse de la population, et ne peuvent être transformés en propriétés privées [55]. Il en est de même des chemins publics, sans lesquels les diverses fractions entre lesquelles une nation se partage, ne pourraient ni communiquer les unes avec les autres, ni effectuer les échanges nécessaires à [I-182] leur existence, ni même cultiver leurs propriétés. Les ports de mer, les hâvres demeurent, comme les fleuves et les chemins publics, dans le domaine national, et sont consacrés au commerce ou à la défense de l'état. Enfin, il arrive souvent que certaines parties du territoire, telles que des forêts ou des pâturages, restent dans le domaine public, ou appartiennent à des communes, parce que le partage entre particuliers détruirait en partie l'utilité dont elles sont pour la population entière.
Quoique les biens de ce genre ne doivent pas, en général, à l'industrie humaine toute l'utilité que nous y trouvons, ils rendent d'immenses services aux nations qui les possèdent; ils donnent à tous les autres biens une partie considérable de leur valeur, et sont une condition de l'existence des populations qui en jouissent. Il importe donc de se faire des idées bien exactes de la nature de ces biens, des services. qu'ils rendent ou peuvent rendre, et des causes qui peuvent les détruire ou en assurer la durée. Les cours d'eau étant la plus importante des propriétés dont les membres d'une nation jouissent en commun, c'est par eux qu'il importe de commencer.
En observant les lois suivant lesquelles les peuples se forment et se développent, j'ai fait voir ailleurs que les familles se portent d'abord vers les [I-183] lieux qui leur fournissent, avec le moins de difficultés, des moyens d'existence. Les baies, les bords des fleuves, les confluens des rivières sont les premiers lieux occupés, parce que les subsistances y sont moins rares, les communications plus aisées, et la terre plus fertile. Il est évident, en effet, qu'entre des terres de qualités différentes, celles qui fournissent le plus de subsistances avec le moins de travail, sont toujours les premières que les hommes cultivent. Si, pour obtenir un hectolitre de froment sur des terres d'une certaine qualité, il ne faut que la moitié du travail qu'exigeraient des terres d'une qualité différente pour en produire une quantité semblable, il est clair qu'on ne cultivera celles-ci que lorsque toutes les autres auront été appropriées et mises en état de culture [56].
Les parties inférieures des bassins des fleuves et des rivières étant, en général, plus productives et d'une culture moins difficile que les flancs escarpés des montagnes, ou que les plateaux les plus [I-184] élevés, renferment toujours les populations les plus nombreuses et les plus industrieuses. Les terres les moins fertiles, celles qui exigent le plus de travail et de capitaux, pour donner le moins de subsistances, ne sont pas seulement les dernières qui sont cultivées; ce sont celles aussi sur lesquelles se trouve la partie la plus misérable de la population. Quant à celles qui ne sont propres qu'à servir de pâturage, ou à produire du bois de charpente ou de chauffage, elles restent souvent propriétés communes, parce que l'industrie humaine ne peut presque rien y ajouter, et qu'elles perdraient une grande partie de leur valeur si elles étaient partagées [57].
C'est donc au fond des bassins, et particulièrement sur les bords des fleuves ou au confluent des [I-185] rivières, que se forment les grandes masses de population; c'est là que s'établissent et se développent tous les genres d'industrie et de commerce, l'agriculture, les manufactures, les usines, les arts, et en un mot tout ce qui multiplie les richesses d'un peuple; les rivières ou les fleuves qui parcourent ces bassins, et qui sont les agens les plus actifs de la civilisation, restent la propriété commune des populations qu'ils ont contribué à former, parce qu'ils sont nécessaires à l'existence de tous, et qu'ils n'ont été produits par aucun en particulier [58].
Les services que rendent à une population les fleuves, les rivières, en un mot tous les cours [I-186] d'eau qui traversent son territoire, consistent principalement à recevoir et à faire écouler les eaux qui se déchargent, soit des propriétés publiques, soit des propriétés privées, à alimenter des aqueducs ou des canaux, à arroser les terres riveraines, à mettre des usines en mouvement, à transporter des denrées, des marchandises ou des objets nécessaires à la culture, à abreuver les hommes et les animaux, à préparer leurs alimens, et à une foule d'autres usages qu'il est inutile d'énumérer [59].
Il en est des rivières, relativement aux populations dont elles sont la propriété, comme des choses qui appartiennent à tous les peuples, telles que l'air, la lumière, les eaux des mers; chacun peut en faire usage pour ses besoins particuliers, mais c'est sous la condition de ne pas gêner l'usage des autres. Le soin que prend une administration de garantir à chacun la libre jouissance de ce genre de biens, et d'empêcher, par conséquent, qu'ils ne soient détériorés au préjudice du public, est ce qui distingue principalement une nation policée d'une [I-187] nation qui ne l'est pas. Dans les pays où aucune institution ne garantit les intérêts de tous, des attentats exécutés au profit de quelques-uns, comme étaient tous les états de l'Europe sous le régime féodal, et comme sont encore les pays soumis à la domination des Turcs, les propriétés publiques sont toujours les premières qui sont envahies ou qui périssent faute d'entretien. Les propriétés de ce genre sont, au contraire, aussi bien garanties que celles qui appartiennent à des particuliers, chez tous les peuples qui sont soumis à une bonne police administrative [60].
Il est des fleuves et des rivières dont les bassins appartiennent à différens états, indépendans les' uns des autres: tels sont le Pô, le Rhin, le Mein, le Keckar, l'Ems, et quelques autres. Lorsque de pareilles divisions territoriales se rencontrent, on est tôt ou tard obligé, par la force des choses, de reconnaître que l'usage des fleuves est un droit commun à toutes les populations qui en occupent le bassin. Chacune d'elles a le droit de s'en servir, soit pour faire écouler les eaux qui tombent sur son territoire, soit pour faire descendre jusqu'à la mer, les produits de son agriculture ou de ses manufactures, soit pour faire arriver chez elles les produits du territoire et de l'industrie des autres [I-188] nations. C'est ainsi que, par le traité de Paris du 30 mai 1814 et par l'acte du congrès de Vienne du 9 juin 1815, les principales puissances de l'Europe ont proclamé le principe de la libre navigation des fleuves et des rivières qui traversent le territoire de plusieurs nations, depuis la mer jusqu'au point où elles cessent d'être navigables [61].
Du fait que les fleuves et les rivières appartiennent aux diverses populations qui se sont développées dans leurs bassins, il résulte qu'il ne peut être permis à personne d'en affaiblir, d'en ralentir ou d'en accélérer le cours, de manière à nuire à la navigation ou aux propriétés riveraines, d'y 'faire des ouvrages ou constructions, ou d'y déposer des matières qui en rendraient la navigation plus difficile, qui en corrompraient les eaux ou qui en feraient périr le poisson.
[I-189]
Les cours d'eau ont donné naissance à une multitude de questions d'intérêt privé; et les difficultés qui s'élèvent entre deux particuliers, peuvent s'élever entre deux communes, entre deux villes, entre deux nations. Suivant les principes du droit romain, si un propriétaire faisait sur son héritage un ouvrage par suite duquel les voisins recevaient ou étaient exposés à recevoir quelque dommage des eaux pluviales, il pouvait être condamné à rétablir les choses dans leur état primitif. Si, par exemple, il faisait refluer les eaux sur les terres voisines, s'il leur donnait un cours différent de leur cours naturel, s'il les rendait plus considérables, plus rapides, plus violentes, les propriétaires lésés avaient le droit de demander la réparation du dommage causé, et la destruction des ouvrages qui l'avaient produit. Il n'était même pas nécessaire que le mal fût consommé pour intenter une action : il suffisait que le danger fût devenu imminent [62].
Ces règles ne sont que des applications d'un principe plus général, de celui qui garantit à chacun le sien, et qui oblige toute personne à réparer le dommage qu'elle a causé. Si elles sont justes quand [I-190] il s'agit de déterminer des rapports de particulier à particulier, elles ne peuvent pas ne pas l'être quand il s'agit de fixer les rapports qui doivent exister entre les diverses fractions dont un peuple se compose. Les habitans d'une ville qui, pour leur avantage particulier, formeraient des barrages sur une rivière, et feraient ainsi refluer l'eau sur les terres supérieures, donneraient certainement aux propriétaires de ces terres de justes sujets de plaintes. De même, si les propriétaires des fonds supérieurs mettaient presqu'à sec une rivière navigable, ou lui donnaient une force inaccoutumée; si, par leurs travaux, ils lui faisaient prendre les caractères d'un torrent, n'ayant presque point d'eau à certaines époques, et ayant une violence indomptable dans d'autres temps, il est clair que les populations inférieures se plaindraient justement de pareilles entreprises.
Ce qui est vrai pour un particulier à l'égard d'un autre, et pour une fraction d'un peuple relativement aux autres fractions, l'est, à plus forte raison, pour une nation à l'égard des autres. La France, par exemple, ne serait pas plus fondée à faire sur le Rhin des barrages qui inonderaient une partie du canton de Bâle ou du grand-duché de Bade, que le propriétaire d'un champ à inonder le champ supérieur, en refusant un passage aux eaux qui en découlent. L'obligation de laisser librement couler [I-191] les eaux qui descendent des lieux élevés, est une loi que la nature elle-même a établie, et qu'on ne saurait violer sans injustice; mais aussi c'est une loi pour les propriétaires des lieux élevés, de ne rien faire sur leurs terres qui puisse porter atteinte à l'existence des populations placées au-dessous d'eux.
Il y a quelques années, le gouvernement du canton de Vaud prétendit que les habitans de Genève, en établissant sur le Rhône des moulins ou d'autres usines, avaient fait refluer les eaux du lac Léman sur le territoire vaudois. L'effet attribué aux ouvrages faits sur le fleuve, fut contesté; mais aucune difficulté ne s'éleva sur le point de droit. Personne ne prétendit que le canton inférieur avait le droit d'inonder le territoire du canton supérieur [63].
Toutes les fois que la population qui s'est développée dans un grand bassin, ne forme qu'une seule puissance, ou que, si elle est divisée par plusieurs fractions, ces fractions sont unies par un lien fédéral, il est facile d'établir et de faire observer des règles conformes à l'intérêt général; mais quand un bassin est partagé entre des populations [I-192] soumises à des gouvernemens indépendans les uns des autres, et dont les intérêts sont opposés, rien n'est plus difficile que de faire respecter les droits des diverses parties de la population.
Le Rhin, par exemple, est la propriété commune de plusieurs cantons de la Suisse, de la France, du grand-duché de Bade, de la Bavière, du grand-duché de Hesse, du duché de Nassau, de la Prusse, de la Belgique et de la Hollande. Tous ces peuples doivent donc jouir de la faculté d'y naviguer, depuis le point où il se décharge dans la mer, jusqu'au point où il cesse d'être navigable; et cette faculté leur est formellement reconnue par la convention faite le 31 mars 1831, entre la plupart de ces puissances. Mais ce n'est qu'après des difficultés infinies qu'on est parvenu à s'entendre, et à poser quelques règles auxquelles tous ces états se sont soumis. La pratique fera naître tôt ou tard des difficultés nouvelles, et il est douteux qu'elles soient résolues à la satisfaction de toutes les puissances, par les autorités qu'on a constituées ou reconnues par le traité.
S'il est difficile d'établir des lignes de douanes sûres, entre des peuples qui sont séparés par des montagnes, à combien plus forte raison il sera difficile d'en établir sur les rives d'un fleuve parcouru par des bateaux chargés de marchandises qui cherchent des acquéreurs, et qui passent à [I-193] travers de populations qui ne demandent qu'à les acheter! C'est ordinairement dans les gorges des montagnes et dans des passages difficiles à éviter, qu'on place les bureaux de douanes; mais, quand un fleuve est divisé entre plusieurs nations, on est obligé de les établir sur le bord de la route que parcourent les marchandises auxquelles on interdit l'entrée du territoire.
Le mal devient beaucoup plus grave si la mésintelligence s'établit entre quelques-unes des puissances qui tiennent sous leur domination diverses parties du fleuve; les questions de droit qui devraient être résolues par des cours de justice, suivant les règles ordinaires de la jurisprudence, deviennent des causes de et les guerres, en pareil cas, guerre; ont la plupart des effets des guerres civiles.
Quoique les habitans du bassin du Rhône forment plusieurs peuples indépendans les uns des autres, la propriété de ce fleuve ne fait pas naître des questions aussi graves et aussi nombreuses que celles auxquelles donne naissance la propriété du Rhin. La perte du premier de ces fleuves, au fort de l'Écluse, et la rapidité qu'il a, en sortant du Léman, sont de trop grands obstacles à la navigation, pour qu'il puisse donner lieu à des difficultés sérieuses. Depuis le point où il se jette dans la mer jusqu'au point où il cesse d'être navigable, le territoire qu'il parcourt appartient exclusivement à la France, et [I-194] il ne peut donner lieu, par conséquent, à de grands débats. Cependant, une partie des montagnes qui y versent leurs eaux est placée sous la domination d'un gouvernement italien, et c'est un mal pour les habitans de ces montagnes et pour la France.
Les fleuves des autres parties du continent européen ne sont pas, en général, mieux divisés ; quelques-uns même le sont encore plus mal, surtout en Espagne, en Italie et en Allemagne; et il est probable que cet état de choses durera tant que les nations seront considérées comme le patrimoine des familles qui les gouvernent.
[I-195]
CHAPITRE XIII.
Influence du déboisement des montagnes sur les fleuves et les rivières.↩
ON reconnaîtra sans peine que tout fleuve est la propriété commune des diverses populations qui en occupent le bassin; que les propriétaires des fonds inférieurs ne peuvent y faire aucun ouvrage pour en ralentir le cours, de manière à nuire aux propriétaires des fonds supérieurs ; et que ceux-ci peuvent s'en servir, soit pour faire écouler les eaux qui tombent sur leurs terres, soit pour exporter leurs denrées, soit pour faire arriver chez eux les choses dont ils ont besoin, et qu'ils ne peuvent tirer que de l'étranger.
Mais reconnaîtra-t-on aussi que les populations formées dans les parties inférieures du bassin, dans celles qui les premières ont été converties en propriétés privées, et qui sont les mieux cultivées, les plus riches, les plus peuplées, sont de même propriétaires par indivis du fleuve sur le bord duquel leur agriculture, leur industrie, leur commerce, se sont développés, et que les populations [I-196] par lesquelles les plateaux et les versans des montagnes sont occupés, ne peuvent le détériorer, en modifiant les terres qui y versent leurs eaux?
Cette question est beaucoup plus importante que celle qui a été traitée dans le chapitre précédent; les travaux que peuvent exécuter les habitans d'une ville sur le fleuve qui la traverse, ne peuvent jamais causer un grand dommage aux propriétés situées au-dessus d'eux, si d'ailleurs ils ne sont pas un obstacle à la navigation; mais les propriétaires des terres les plus élevées, ceux qui possèdent les plateaux et les versans des montagnes, peuvent, par la manière dont ils disposent de ces terres, causer des dommages considérables aux propriétés inférieures et aux populations qui occupent le fond du bassin.
L'eau dont un fleuve est formé, n'est l'eau que de pluie ou de neige, qui tombe annuellement dans son bassin, qui s'infiltre lentement dans les terres, et qui, par les obstacles qu'elle rencontre, est obligée de reparaître sur la surface des fonds inférieurs; dans les lieux très-élevés où la chaleur ne dure jamais assez long-temps pour fondre complètement les neiges ou les glaces qui s'y amassent pendant une partie de l'année, on trouve, il est vrai, des eaux courantes qui ne proviennent pas d'infiltrations; mais ce n'est pas de celles-là que nous avons à nous occuper ici; l'industrie [I-197] humaine ne peut ni en accroître, ni en diminuer sensiblement la quantité.
Si l'eau de pluie s'évaporait à mesure qu'elle tombe, il n'y aurait plus d'infiltration, et par conséquent les sources et les rivières tariraient. Si, au lieu de s'évaporer, elle tombait sur des pentes rapides, dépouillées de végétaux et de toute matière propre à la retenir, elle se précipiterait avec force dans les vallées, et les rivières ne seraient que des torrens. Il faut donc, pour que les rivières ou les fleuves aient un cours égal et régulier, et qu'ils soient véritablement utiles, que l'eau qui résulte de la chute des neiges ou des pluies, s'infiltre dans la terre d'une manière très-lente. Dans un pays qui compterait, par exemple, dans le cours d'une année, quatre-vingts jours de pluie et deux cent soixante-quatorze de sécheresse, il faudrait pour que les rivières fussent toujours en bon état, que le temps nécessaire à l'infiltration eût trois ou quatre fois plus de durée que la saison pluvieuse.
On comprend maintenant comment les populations qui possèdent les plateaux et les versans des montagnes, peuvent, en agissant sur les terres dont elles sont en possession, causer de grands dommages aux propriétés situées dans les parties les plus inférieures des bassins; il leur suffit, pour faire évaporer l'eau destinée à alimenter les rivières, ou pour la convertir en torrens, de détruire [I-198] les arbres et les végétaux qui empêchent l'évaporation, ou qui retiennent les terres sur le penchant des montagnes.
Il est facile de concevoir, au reste, que les dangers de ce genre sont plus ou moins grands, selon qu'on se trouve placé sous un ciel plus ou moins ardent, et selon que les montagnes qui forment les bords des bassins, sont plus ou moins étendues, plus ou moins escarpées; l'évaporation se fait d'une manière plus rapide sur les terres placées entre les tropiques, que dans les îles de la Grande-Bretagne ou dans le Danemarck; et la pluie forme plus. aisément des torrens dans les montagnes de la Suisse, de quelques parties de l'Italie et de la France, que dans des pays où les terres ont peu de pente.
Ces observations ne sont pas seulement le résultat d'une induction tirée de la nature des choses; elles sont le produit des expériences faites en · divers temps et en divers pays; et plus on réfléchira sur les causes de la décadence ou de la prospérité des peuples, plus on trouvera qu'elles ont de l'importance. Les effets désastreux du déboisement des montagnes se sont manifestés dans tous les pays; mais c'est particulièrement sous les climats chauds qu'on s'en est promptement apperçu.
Dans l'île de la Trinité, l'on a remarqué que les pluies diminuaient à mesure que les défrichemens [I-199] faisaient des progrès, c'est-à-dire à mesure que les forêts disparaissaient. Dans un espace de quinze ou seize ans, on a vu quelquefois décroître d'une manière sensible l'eau des rivières dont les bassins étaient dépouillés d'arbres; tandis que les bassins du voisinage, dont les arbres étaient conservés, continuaient d'être arrosés par la même quantité d'eau [64].
Le même phénomène a été remarqué à la Martinique : les montagnes ont été dépouillées de leurs forêts, et, depuis ce temps, les bassins dont ces forêts faisaient partie, sont privés de brises, de pluies, de fontaines, d'abondantes rosées [65].
A Saint-Domingue, les mêmes causes ont produit de semblables effets: les colons ont dégarni les montagnes des forêts qui les couronnaient, principalement au vent de l'île; et depuis ce temps la sécheresse a tout dévoré.
« Ces bois, dit un voyageur, arrêtaient les nues, aspiraient les vapeurs, entretenaient la fraîcheur et l'humidité sous leur ombre, alimentaient les sources qui jaillissaient des pieds de leurs mornes; mais, depuis que ces mornes ont été dépouillés de leurs utiles végétaux, les vapeurs fécondantes ont cessé de s'y [I-200] arrêter. Les vapeurs y sont devenues rares; ainsi la sécheresse et l'aridité des mornes a tari les sources de la fécondité des plaines environnantes. Les nues retombant sous le vent ne s'arrêtent plus que vers ces hauts pitons, voisins de Saint-Pierre, où elles se dissolvent en pluies répétées et abondantes [66]. »
Le déboisement a produit à l'île de France (aujourd'hui l'île Maurice), les mêmes effets que dans les îles de la Trinité et de Saint-Domingue.
« Quelque abondantes que les pluies soient encore à l'Ile-de-France, dit Péron, c'est une opinion généralement établie, dans tout le pays, qu'elles ont beaucoup diminué depuis vingt-cinq ou trente ans, et tout le monde en accuse les défrichemens considérables, qui, dans ces derniers temps surtout, ont été faits d'une manière trop indiscrète. Ce sentiment est partagé par tous les cultivateurs les plus éclairés et les plus anciens; tous prétendent que les rivières roulent aujourd'hui sensiblement moins d'eau qu'autrefois; que plusieurs sources ont tari; que la végétation n'est plus aussi active; et ce dernier effet, ils l'attribuent bien moins à l'épuisement du sol qu'au défaut d'humidité habituelle. Certes, il n'est pas impossible.que l'abattage indiscret des forêts ait effectivement contribué beaucoup à diminuer la [I-201] quantité absolue des pluies, mais il est bien possible aussi que cette quantité restant la même, elle ne soit cependant plus suffisante au besoin de la végétation, parce que le premier effet de la dénudation du sol est de rendre l'évaporation plus prompte, et surtout plus considérable [67] ».
L'effet produit aux Antilles par le déboisement des montagnes, a été ressenti dans les parties du continent américain, où les montagnes ont été dépouillées des bois qui les couvraient. Aux ÉtatsUnis, on a depuis long-temps observé que la coupe des forêts, particulièrement sur les hauteurs, diminue généralement la masse des pluies, et des fontaines qui en résultent, en empêchant que les nuages ne se fixent et ne se distillent sur les lieux. élevés.
« Le Kentuky lui-même, dit Volney, en offre la preuve, ainsi que tous les autres états de l'Amérique, puisque l'on y cite déjà une multitude de ruisseaux qui ne tarissaient pas il y a quinze ans, et qui maintenant manquent d'eau ; d'autres ont totalement disparu, et plusieurs moulins, dans le New-Jersey, ont été abandonnés pour cette cause [68]. »
Un naturaliste célèbre; M. Alexandre de [I-202] Humboldt, a fait, sur les effets que produit le déboisement des montagnes, des observations semblables à celles de Volney. Son témoignage est ici d'un si grand poids, qu'on me pardonnera de le rapporter en entier.
» En abattant les arbres qui couvrent la cîme et le flanc des montagnes, dit-il, les hommes, sous tous les climats, préparent aux générations futures deux calamités à la fois, un manque de combustible et un manque d'eau.
» Les arbres, par la nature de leur transpiration et le rayonnement de leurs feuilles vers un ciel sans nuages, s'enveloppent d'une atmosphère constamment fraîche et brumeuse : ils agissent sur l'abondance des sources, non comme on l'a cru si long-temps, par une attraction particulière pour les vapeurs qui sont répandues dans l'air, mais parce qu'en abritant le sol contre l'action directe du soleil, ils diminuent l'évaporation des eaux pluviales.
» Lorsqu'on détruit les forêts comme les colons européens le font partout en Amérique avec une imprudente précipitation, les sources tarissent entièrement ou deviennent moins abondantes. Les lits des rivières restent à sec pendant une partie de l'année, se convertissent en torrens chaque fois que de grandes averses tombent sur les hauteurs.
» Comme avec les broussailles, on voit [I-203] disparaître le gazon et la mousse sur la croupe des montagnes, les eaux pluviales ne sont plus retenues dans leurs cours au lieu d'augmenter lentement le niveau des rivières par des filtrations progressives, elles sillonnent, à l'époque des grandes ondées, le flanc des collines, entraînent les terres éboulées, et forment ces crues subites qui dévastent les campagnes.
» Il résulte de là que la destruction des forêts, le manque de sources permanentes et l'existence des torrens, sont trois phénomènes étroitement liés entre eux. Des pays qui se trouvent situés dans des hémisphères opposés, la Lombardie, bordée par la chaîne des Alpes, et le bas Pérou, resserré entre l'Océan Pacifique et la Cordillière des Andes, offrent des preuves frappantes de la justesse de cette observation [69]. »
Les îles qui ont été complètement dépouillées d'arbres, comme l'île de Pâques, ont été reduites à n'avoir ni ravins, ni ruisseaux, ni sources; une sécheresse horrible a détruit les plantes et les arbustes, et elles sont devenues presqu'inhabitables [70].
La destruction des bois et la disparition des sources et des rivières ont produit, dans quelques [I-204] parties du monde ancien, des effets plus funestes encore; quelques parties de la Perse et de la Haute-Egypte ont été transformés en déserts arides; les hommes et les animaux en ont disparu avec la végétation [71].
Les changemens qu'a éprouvés le sol des divers états de l'Europe, remontent à des temps trop reculés et trop barbares, pour qu'il ait été possible d'observer et de constater les effets qu'ils ont produits sur les sources, sur les rivières, sur les fleuves et sur les terres susceptibles de culture. On ne peut guère douter cependant que ces effets n'aient été analogues à ceux qu'on a remarqués en Amérique et dans d'autres parties du monde, et que les rivières n'aient diminué et ne soient devenues plus irrégulières, à mesure que les bois ont disparu des plateaux et des versans des montagnes.
Dans les derniers temps de la république romaine, la Gaule et la Germanie étaient couvertes d'immenses forêts qui ont été détruites en grande partie [72]. Si ce fait n'était pas constaté par les écrivains romains, il le serait par les nombreux monumens des druides qui existent encore sur des plateaux complètement dépouillés d'arbres, et qui se [I-205] trouvaient jadis au milieu des forêts. Or il est impossible que ces forêts, situées sur les plateaux ou sur la croupe des montagnes, en aient disparu, sans qu'il en soit résulté aucun effet sur les sources que produisaient les eaux de neige ou de pluie. Ces sources sont certainement devenues moins abondantes, plus rares, plus irrégulières; quelques-unes ont probablement été remplacées par des torrens.
Plusieurs historiens de l'ancienne province de Franche-Comté ont pensé que les rivières qui descendent du Jura, étaient jadis plus considérables qu'elles ne le sont de notre temps; ils ont cru que le Doubs, par exemple, était navigable à un point où il ne l'est pas aujourd'hui; et il existe encore, près du village de Mandeure [73], à une lieue et demie du Pont-de-Roide, des vestiges d'un pont, qui appuient cette opinion [74].
Les terres incultes qui existent dans le département de l'Indre et dont l'étendue est de 204,746 arpens, étaient jadis d'antiques forêts que des incendies ont dévorées ou que les mains des hommes [I-206] ont détruites [75]. Dans quelques parties du département des Deux-Sèvres, de vastes étendues de forêts ont également disparu, et les sources qu'elles alimentaient ont tari [76].
Il est des départemens dans lesquels la destruction des forêts qui couvraient les montagnes, et dont les eaux alimentaient les rivières et portaient la fertilité dans les plaines, ne date pas d'une époque très-reculée. Lorsque, dans les années 1787, 1788 et 1789, Arthur Young fit un voyage en France, pour en observer l'agriculture et les diverses ressources, il fut témoin de dévastations qu'il n'aurait pas crues possibles, s'il ne les avait pas vues de ses propres yeux. Il mérite d'autant plus de confiance, dans son témoignage à cet égard, qu'à son avis le prix du bois était encore trop bas à cette époque, et qu'il croyait utile de convertir des forêts en terres labourables, jusqu'au moment où le produit d'un arpent en bois, serait égal au produit d'un arpent en céréales ou en fourrages. Les dévastations dont il fut témoin et qu'il déplorait amèrement, avaient lieu dans les Pyrénées.
« Une grande partie de ces montagnes, dit-il, est couverte de bois, et une beaucoup plus grande l'a [I-207] été; car la destruction qui s'en fait tous les jours, n'est pas croyable pour ceux qui ne l'ont pas vue. Je passais fréquemment à travers plusieurs bois près Bagnères de Luchon, dans lesquels des hommes étaient à l'ouvrage, coupant et fendant de jeunes bouleaux, pour faire des cercles de tonneaux. Je fus choqué de voir la consommation qu'ils en faisaient, et qui n'aurait pas été plus dévastatrice et plus prodigue au milieu d'une forêt américaine.... Cette belle et noble forêt de Lartigues a éprouvé une dévastation si générale, qu'elle est presqu'entièrement détruite; il n'y a point de jeunes pousses pour remplacer les arbres qui ont disparu, et, dans dix ou douze ans, ce ne sera plus qu'une montagne nue, avec quelques misérables arbustes broutés par des chèvres ou par d'autres animaux.
« Dans certaines parties que je visitai, à quelques lieues de distance, vers les terres parcourues par les troupeaux espagnols, il y a des forêts détruites d'une manière si honteuse, que cela est incroyable pour le citoyen d'un pays dans lequel le bois a quelque valeur. Plusieurs vingtaines d'acres étaient si complètement ruinées qu'il ne restait pas un seul arbre debout; et cependant c'était encore une forêt entière de troncs de trois, quatre et six pieds de haut, triste et choquant spectacle à voir! De tous côtés, les torrens entraînent autant de bois que de pierres, et présentent des ruines semblables; [I-208] les routes sont formées avec des fragmens d'arbres, et sont garanties contre les précipices par des arbres entiers qu'on y pose et qu'on laisse pourrir. On n'avance pas de quelques pas sans enfoncer sa canne dans des troncs d'arbres qui se pourrissent ou qui sont déjà pourris. Tout est ruine, dévastation, désolation; c'est l'aspect d'une forêt où une armée ennemie, dans un accès de licence et de méchanceté, aurait tout détruit » [77].
En déplorant ces dévastations, Arthur Young n'y voyait que la perte qui en résultait immédiatement, celle du bois ; il ne paraissait pas se douter des effets qui devaient en être la suite pour les sources et les rivières, ni des dommages qui pourraient en résulter pour les terres les plus fertiles.
[I-209]
CHAPITRE XIV.
De la dégradation des rivières en France, par le déboisement et le défrichement des montagnes.↩
Au commencement de sa révolution, la France a fait une expérience qui a répandu sur la question qu'il s'agit ici de résoudre, une grande lumière. Dans ce pays, comme chez toutes les nations civilisées, le sol avait été consacré, dès les temps les plus reculés, à différens usages. Les parties les plus fertiles, celles qui se trouvent au fond des bassins, ou dans les enfoncemens situés sur les plateaux des montagnes, étaient livrées à la culture. Celles qui étaient les moins propres à être cultivées, et qui se trouvaient sur les parties les plus élevées, ou sur les versans les plus escarpés, servaient de pâturages ou étaient couvertes de forêts. Les premières avaient été converties, depuis des temps fort éloignés, en propriétés privées; les secondes étaient restées indivises, et étaient employées à satisfaire une partie des besoins des communes.
En voyant, d'un côté, une partie de la population qui ne possédait aucune propriété, et, d'un autre côté, des terres d'une vaste étendue qui [I-210] restaient incultes, quelques membres des assemblées nationales s'imaginèrent qu'ils rendraient un immense service aux classes les moins aisées, s'ils livraient ces terres à la culture, et s'ils rendaient propriétaires les hommes qui n'avaient que leurs bras pour exister; ils proposèrent, en conséquence, de partager, entre tous les habitans de chaque commune, les terres qui jusqu'alors étaient restées indivises; et leur proposition fut favorablement accueillie.
Une loi du 28 août 1792 avait mis les communes en possession de tous les biens qui leur avaient ou qu'on supposait leur avoir été ravis par la puissance féodale depuis 1669, et qui étaient ainsi tombés dans les mains des seigneurs. Une seconde loi, rendue le 10 juin de l'année suivante, décréta que tous les biens appartenant aux communes, de quelque nature qu'ils fussent, pourraient être partagés, s'ils étaient susceptibles de partage; il n'y avait d'exceptés que les bois, les places, promenades, voies publiques et édifices à l'usage des communes. L'exception établie à l'égard des bois cessait même d'exister, lorsqu'il était reconnu, d'après les visites et procès-verbaux des agens de l'administration forestière, que ces bois n'étaient pas d'un produit suffisant pour être conservés.
Le partage devait être fait par tête d'habitant [I-211] domicilié, de tout âge et de tout sexe, absent ou présent. Les propriétaires non habitans en étaient exclus; mais toute personne domiciliée dans la commune, depuis une année avant la promulgation de la loi, était comptée au nombre des habitans. Les fermiers, métayers, valets de fermes, domestiques, et généralement toutes les personnes ayant une année de résidence dans la commune, furent donc appelés à la distribution des biens communaux. La part des enfans âgés de moins de quatorze ans, devait être délivrée à leurs pères, qui en jouissaient jusqu'à ce que les propriétaires eussent acquis leur quatorzième année.
Du moment que cette loi eut été promulguée, elle fut mise à exécution avec une incroyable activité; plus les populations étaient misérables, et plus elles se précipitaient avec ardeur sur des terres dont l'imagination avait décuplé la valeur. Les montagnes, qui jusqu'alors n'avaient paru propres qu'à servir de pâturages ou à fournir du bois à brûler, furent dépouillées de leur verdure; les arbres furent abattus, les souches furent arrachées, le gazon fut retourné et brûlé pour servir d'engrais [78].
Celles de ces terres qui se trouvaient situées sur [I-212] des plateaux, donnèrent d'abord quelques récoltés; mais comme elles ne recevaient aucun engrais, et que les nouveaux propriétaires ignoraient l'art de varier la culture, elles ne tardèrent pas à être épuisées; la plus grande partie se trouva bientôt frappée d'une complète stérilité, ou ne donna qu'une chétive récolte d'orge ou d'avoine tous les dix ou douze ans [79].
Les terres qui se trouvaient situées sur les penchans escarpés des montagnes, furent moins profitables encore à ceux qui, après les avoir dépouillées d'arbres, les défrichèrent; les premières pluies d'orage qu'elles reçurent, les entraînèrent avec violence dans les vallées et les rivières, et ne laissèrent à la place que des roches nues.
J'ai vu, dans ces temps de grandeur et de folie, de ces torrens formés par des orages tombés sur des montagnes nouvellement défrichées, entraîner, avec un fracas horrible, non-seulement les terres, mais les arbres, les rochers, les maisons qui se trouvaient sur leur passage, et porter l'épouvante parmi les populations des vallées, qui, frappées par [I-213] ces désastres inouis, s'imaginaient que l'enfer avait été déchaîné pour punir les impiétés de la révolution [80].
Des réclamations vives et nombreuses s'élevèrent contre ces deux lois, Par une autre loi', du 21 prairial an IV (9 juin 1796), l'exécution en fut provisoirement suspendue: on lit dans les considérans de cette dernière loi, que « il est instant d'arrêter les funestes effets de l'exécution littérale de la loi du 10 juin 1793, dont plusieurs inconvéniens majeurs se sont déjà fait sentir. »
La suspension provisoire, ordonnée par cette seconde loi, fut rendue définitive par la loi des 9 et 19 ventôse an XII (29 février 1804), et par le [I-214] décret du 9 brumaire suivant (31 octobre 1804 ). L'article 1er de la loi de ventôse ordonna l'exécution des partages déjà effectués, et dont il avait été dressé acte. Les partages dont aucun acte n'avait été dressé, ne furent translatifs de propriété, suivant l'article 3, que pour ceux qui avaient déjà défriché ou planté, ou clos de murs, de fossés ou de haies vives, le lot qui leur était échu, et qui, après avoir fait la déclaration du terrain qu'ils occupaient, se soumettaient à payer à la commune une redevance annuelle fixée par estimation. Il fut ordonné, par l'article 5, que tous les biens communaux possédés à l'époque de la promulgation de la loi, sans acte de partage, et dont les possesseurs n'auraient pas rempli les conditions prescrites par l'article 5, rentreraient entre les mains des communautés d'habitans.
Ces dispositions paraissaient faites pour arrêter les partages des biens communaux, mais elles n'en interdisaient pas le défrichement; elles n'arrêtaient pas la destruction des bois. Le décret du 9 brumaire pourvut à cette omission: il déclara que les communautés d'habitans qui, n'ayant pas profité de la loi du 10 juin 1793, relative au partage des biens communaux, avaient conservé, après la publication de cette loi, le mode de jouissance de leurs biens communaux, continueraient d'en jouir de la même manière, et que ce mode [I-215] ne pourrait être changé qu'avec l'autorisation du gouvernement. Les partages déjà faits furent maintenus comme ils l'avaient été par la loi du 24 prairial an IV.
La loi du 9 floréal an XI (29 avril 1803) mit quelques nouveaux obstacles au déboisement, en appliquant aux bois des particuliers les mêmes dispositions qu'aux bois des communes. L'article 1er déclara que, pendant vingt-cinq ans, aucun bois ne pourrait être arraché et défriché que six mois après la déclaration qui en aurait été faite par le propriétaire devant le conservateur forestier de l'arrondissement où le bois serait situé. L'administration forestière fut autorisée, par l'article 2, à faire mettre, sans délai, opposition au défrichement du bois, à la charge d'en référer, avant l'expiration des six mois, au ministre des finances, sur le rapport duquel le gouvernement statuerait définitivement dans le même délai. Suivant l'article 3, en cas de contravention aux dispositions de l'article précédent, le propriétaire devait être condamné, sur la réquisition du conservateur de l'arrondissement, à remettre une égale quantité de terrain en nature de bois, et à une amende qui ne pouvait être au-dessous du cinquantième ni au¬ dessus du vingtième de la valeur du bois arraché. Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis, dans le délai fixé par le jugement de [I-216] condamnation, il devait, suivant l'article 4 de la loi, y être pourvu à ses frais par l'administration forestière. Enfin, l'article 5 exceptait de ces dispositions les bois non clos, d'une étendue moindre de deux hectares, lorsqu'ils n'étaient pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, et les parcs ou jardins clos de murs, de haies ou fossés, attenant à l'habitation principale [81].
La loi qui autorisait le partage et le défrichemens des biens communaux, ne fut en vigueur que pendant trois années environ, depuis le 10 juin 1793 jusqu'au 9 juin 1796; mais, dans cet intervalle, elle produisit les effets les plus désastreux, surtout dans les vallées situées au bas des montagnes les plus escarpées. L'eau des pluies et des neiges, au lieu de s'infiltrer dans la terre et d'alimenter les sources, descendit en torrens, remplit de gravier le lit des rivières, se répandit sur les propriétés privées, et les dévasta.
« Les nombreux défrichemens qui ont eu lieu depuis la révolution, et principalement depuis la loi du 10 juin 1793, disait, en 1804, le préfet du département du Doubs, ne paraissent point étrangers à la cause des débordemens extraordinaires et fréquens qui occasionnent, depuis quelques années, tant de ravages dans le département.
[I-217]
» Les longues chaînes de montagnes mises en culture, et qui n'offrent plus aujourd'hui que des rochers arides, étaient, avant cette époque, couvertes de forêts qui s'entretenaient sur une couche plus ou moins profonde de terre légère et végétale.
» Ces forêts maintenaient sur les neiges une fraîcheur qui les garantissaient de l'ardeur des premiers rayons du soleil, et des vents chauds qui en opèrent aujourd'hui la fonte subite; et la terre, en se saturant de la neige fondue, diminuait le volume de celles qui s'écoulaient par les ruisseaux et par les rivières.
» Aujourd'hui, à la première fonte des neiges ou après les grandes pluies, toutes ces montagnes de viennent la source de torrens dévastateurs qui inondent les vallées et les plaines, en charriant avec eux des sables et des pierres, qui, en exhaussant successivement le lit des ruisseaux et des rivières, préparent, pour la suite, des inondations plus considérables, dont l'effet sera indubitablement de changer toutes les terres riveraines en marécages [82]. »
On a pu faire, sur toutes les parties de la France, [I-218] et particulièrement dans les vallées situées au pied des montagnes, les mêmes observations que dans les vallées du Jura: partout le déboisement et le défrichement des parties supérieures des bassins a multiplié les torrens et les inondations, et diminué, par conséquent, le nombre et l'abondance des sources régulières et permanentes.
Les rivières ont participé, jusqu'à un certain degré, de la nature des cours d'eau qui les alimentent: à certaines époques de l'année, dans le temps des pluies et de la fonte des neiges, elles deviennent subitement violentes, rapides, dévastatrices comme des torrens; dans d'autres temps, elles n'ont pas assez d'eau pour la navigation ou pour les autres besoins de l'industrie.
Des fleuves et des rivières qui n'éprouvent que de faibles variations, qui ont toujours une quantité d'eau suffisante pour les besoins de l'agriculture, de la navigation et de toutes les branches d'industrie, mais qui n'ont jamais assez de violence pour être dangereux, donnent aux terres qu'ils traversent une immense valeur; ils sont les agens les plus actifs de la prospérité et de l'accroissement des populations qui en possèdent les bords.
[I-219]
Des modifications faites au sol, dont le résultat est de les rendre irrégulières, de les mettre presque à sec dans certaines saisons de l'année, et de les convertir, à d'autres époques, en torrens dévastateurs, sont de véritables atteintes portées à la propriété, au commerce, à l'industrie, à l'existence, en un mot, de toutes les populations qui se sont développées sous la salutaire influence de leurs eaux.
Or, si les populations qui occupent les vallées et les plaines situées dans le bassin d'un fleuve, ont, ainsi qu'on l'a déjà vu, la propriété de ce fleuve, il s'en suit nécessairement qu'elles sont fondées à exiger que les plateaux et les versans les plus élevés des montagnes qui y portent leurs eaux, ne subissent aucun changement qui puisse les priver de leur propriété ou la dégrader.
Ces plateaux et ces versans, qui forment les bords des bassins des rivières et des fleuves, n'ont, en général, que peu de valeur par eux-mêmes; c'est là qu'on trouve de vastes espaces de terres incultes, qui ne sont propres qu'à produire du bois ou à servir de pâturages.
Mais ces mêmes terres dont l'agriculture ne peut tirer immédiatement presque aucun produit, sont d'une immense utilité, par les eaux qu'elles reçoivent et qu'elles portent, au moyen d'infiltrations graduelles, dans le fond des bassins où se trouvent [I-220] les terres les plus fertiles et les grandes masses de populations.
Un des premiers et des plus grands intérêts d'un peuple est donc de veiller à ce que le sol sur lequel tombent les eaux qui alimentent ses sources et forment ses rivières, ne soit pas dénaturé; car c'est de là que dépendent, en grande partie, et ses richesses et sa durée; et il est bien évident qu'il ne peut exercer cette surveillance et agir dans l'intérêt de la conservation de tous ses membres, qu'autant qu'il est uni en corps de nation, et que les diverses fractions dont il se compose, sont soumises à une loi commune.
L'action qu'un gouvernement exerce pour la conservation des sources et de rivières, n'est pas une atteinte aux propriétés des personnes qui possèdent les plateaux et les versans de montagnes; elle est, au contraire, une garantie pour les propriétés, infiniment plus précieuses, qui se trouvent au fond des bassins, et pour les populations qui s'y sont développées.
Les terres les plus fertiles, celles qui donnent les récoltes les plus abondantes, et qui exigent le moins de travaux, étant mises en état de culture, et transformées en propriétés individuelles longtemps avant qu'on songe à s'approprier et à cultiver celles qui demandent de grands travaux, pour ne donner que de faibles produits, ainsi qu'on [I-221] l'a déjà vu; et les vallées et les plaines situées dans les bassins des fleuves et des rivières étant, par conséquent, cultivées et peuplées avant les plateaux et les versans les plus élevés des montagnes, il s'en suit que les changemens opérés dans le sol de ces plateaux et de ces pentes, s'ils ont pour effet de tarir les sources ou de former des torrens, frappent, dans leurs moyens d'existence, les populations formées dans les vallées et les plaines inférieures ; tandis que l'interdiction de dépouiller de bois ou de défricher les terres les plus élevées, afin de conserver ces mêmes populations, ne condamne personne à la destruction, ni même à ce genre de misère qui résulte nécessairement d'une suppression de moyens d'existence.
Il est rare que le déboisement et le défrichement du sommet et des pentes les plus rapides des montagnes, au lieu d'en accroître la valeur, ne la détruisent pas; mais, dans les cas même où ils l'augmenteraient, l'accroissement serait infiniment petit; les terres placées sur des lieux très-élevés, et d'une culture difficile, ne sont jamais très-productives; il en faut une vaste étendue pour jouir d'un très-médiocre revenu [83].
[I-222]
Dans les vallées ou dans les plaines traversées par des rivières ou par des fleuves, la culture donne, au contraire, aux terres une grande valeur; là, souvent il suffit d'un petit espace pour faire vivre un grand nombre de personnes dans l'abondance; des capitaux considérables qui fournissent des moyens d'existence à des milliers d'ouvriers [I-223] sont réunis sur un petit nombre de points; une usine qui ne tient pas, sur les bords d'une rivière, l'espace qui serait nécessaire sur une montagne pour assurer, pendant tout le cours de l'année, du fourrage au moins dispendieux de nos animaux, suffit quelquefois pour faire vivre à l'aise plusieurs centaines de familles.
Compromettre les nombreuses propriétés que renferment les vallées et les plaines traversées par des courans d'eau, dans l'espérance de créer quelques chétifs moyens d'existence sur le sommet ou sur la pente des montagnes, est donc tout à la fois le plus faux et le plus mauvais des calculs.
Quel est l'intérêt des hommes qui ne peuvent vivre qu'au moyen de leur travail? C'est d'avoir la plus grande part possible aux biens qui sont annuellement produits et consommés chez la nation à laquelle ils appartiennent. Or, il est incontestable que ceux qui sont obligés d'arracher leur subsistance à des terres ingrates, se donnent plus de peine et sont plus mal partagés que ceux qui concourent à la production sur des terres fertiles. Il n'y a pas un ouvrier, dans une bonne ferme, qui voulût être logé, vêtu, nourri comme le sont les gens qui cultivent, à leur profit, les terres les plus pauvres de nos montagnes. Quand le titre de propriétaire ne produit pas d'autre avantage pour celui qui le porte, que de le condamner à un [I-224] travail fort dur, et à vivre d'un peu de lait et de pain d'avoine, il est acheté trop cher [84].
Il résulte de ce qui précède que les choses, comme les personnes, ont entre elles des rapports de dépendance qu'on ne brise pas impunément; il existe entre elles un enchaînement d'effets et de causes qu'il n'est pas possible de négliger, sans s'exposer à tomber dans les plus déplorables erreurs. La force et les ressources d'une nation dépendent de son agriculture, de ses manufactures, de son commerce; son agriculture, ses manufactures, son commerce, dépendent, en grande partie, des fleuves et des rivières qui traversent son territoire; ses fleuves et ses rivières dépendent des sources qui les alimentent, et les sources dépendent de la nature et de la disposition du sol qui reçoit les eaux de pluie ou de neige.
Nous dépensons, en France, des sommes énormes pour faire des canaux, et pour rendre navigables, en toute saison, nos fleuves et nos rivières, et jusqu'ici nos efforts n'ont pas produit de grands résultats. Si l'on s'avisait enfin d'agir sur le sol qui [I-225] reçoit les eaux dont nos rivières sont formées, pour l'obliger à les mieux retenir, et à les distribuer d'une manière moins irrégulière, on obtiendrait des résultats plus avantageux. En même temps qu'on améliorerait d'une manière permanente tous les cours d'eau, et qu'on donnerait ainsi un stimulant à tous les genres d'industrie, on éviterait le danger de manquer de combustible.
Après avoir démontré qu'un fleuve et les rivières qui le forment, sont la propriété commune des populations qui en occupent les bassins, il est presque inutile d'ajouter que les ports de mer sont aussi des propriétés nationales : c'est une vérité que tous les peuples se sont accordés à reconnaître, et qui a peu besoin d'être développée.
Les rivages, lais et relais de la mer sont mis aussi au rang des propriétés publiques, ainsi que je le ferai voir plus loin; aussi, lorsque des communes ont voulu s'emparer des biens de cette nature, comme faisant partie de leurs propriétés communales, leurs tentatives ont été réprimées [85].
Il est d'autres parties du territoire national qui restent dans le domaine public; on y laisse souvent de vastes forêts ou d'autres terres.
[I-226]
Ayant exposé dans les chapitres précédens quelle est la nature de certaines proprietés nationales, il reste à faire connaître, comment on peut en régler la jouissance de la manière la plus avantageuse pour le public et pour les particuliers; mais je dois faire connaître auparavant les mesures qu'on a prises, à diverses époques, pour arrêter ou prévenir le déboisement des montagnes.
[I-227]
CHAPITRE XV.
Des lois destinées à prévenir le déboisement des montagnes.↩
TOUTES les fois qu'on observe, avec un peu de soin, les effets qui résultent des changemens subis par les diverses parties du territoire d'un peuple, on ne tarde pas à s'apercevoir que les modifications éprouvées par les unes, exercent sur les autres une influence qui leur est, tantôt avantageuse, et tantôt funeste, selon la nature de ces modifications; une terre marécageuse dont on épuise les eaux, et sur laquelle s'élève un riant village, donne de la valeur à toutes les terres des environs, et cette valeur s'accroît si le village se transforme en une ville; des campagnes que les abus long-temps prolongés d'une mauvaise administration, transforment en marais mal sains, comme les campagnes des environs de Rome, dégradent et déprécient au contraire toutes les propriétés au milieu desquelles elle sont placées; les travaux qui rendent un fleuve navigable, et qui facilitent les communications entre les diverses parties du territoire qu'il arrose, accroissent [I-228] la valeur de toutes les terres auxquelles ils ouvrent des débouchés; les dégradations qu'éprouvent les parties les plus élevées du bassin d'un fleuve, exercent, au contraire, sur tous les cours d'eau qui sillonnent ce bassin, une influence plus ou moins funeste, et nuisent ainsi à toutes les autres parties du territoire.
Un peuple ne peut donc atteindre le degré de bien-être et de puissance que comporte sa nature, qu'autant que chacune des parties du sol qui le nourrit, reçoit la destination la plus conforme à l'intérêt général. Pour donner à ses richesses un grand développement, il faudrait, s'il était possible, qu'une volonté unique, et surtout éclairée, présidât à la disposition de chacune des parties de son territoire, et la fit concourir à la prospérité de toutes les autres. Mais l'existence d'une telle volonté, en la supposant possible, ne saurait se concilier avec la division du sol en propriétés privées, communales, provinciales, nationales, et avec la faculté garantie à chacun de disposer de ses biens d'une manière à peu près absolue. On peut bien donner à la partie qui reste commune au corps entier de la nation, la destination la plus favorable à la prospérité publique; mais on ne peut pas contraindre chacune des fractions entre lesquelles la population se partage, à disposer de la part qui lui est dévolue, dans l'intérêt de toutes les autres. Si [I-229] les possesseurs de terres étaient tous des hommes éclairés, et s'ils ne pouvaient être entraînés par aucune passion vicieuse, on pourrait compter, pour les bien diriger, sur la puissance de l'intérêt privé, dans tous les cas où cet intérêt serait d'accord avec l'intérêt général; mais, outre qu'il n'est pas permis de compter sur une nation d'hommes éclairés et exempts de vices, cette concordance, entre tous les intérêts privés et l'intérêt général, n'existe pas toujours, quoiqu'elle ait lieu dans le plus grand nombre de cas.
Lorsque l'agronome Arthur Young visita la France pour en étudier les ressources, il fut frappé tout à la fois, et des dévastations qui se commettaient dans les forêts, et des plaintes qui s'élevaient de toutes parts sur la cherté du bois, et du bas prix auquel il se vendait comparativement aux autres produits du sol. En mettant en parallèle les revenus que donnait une certaine étendue de terre en nature de bois, avec les revenus que donnait une égale étendue de terre de même qualité, consacrée à produire des céréales ou à engraisser des animaux, il trouvait qu'il y avait encore en France beaucoup trop de forêts. Il assurait que, s'il possédait des bois dans ce pays, il les ferait abattre et mettrait la terre en culture, bien sûr de faire une bonne spéculation.
« La rente des terres de labours, abstraction [I-230] faite des parties qui restent incultes, disait-il, est de 15 schelings six pences par acre [86]; la rente des bois est seulement de 12 schelings [87]. Comment le sens commun peut-il donc permettre de se plaindre du haut prix du bois, puisque ce prix, au lieu d'être, au taux actuel, un dommage pour les consommateurs, en est, au contraire, un très-réel pour les propriétaires, qui ne retirent pas de leurs terres les revenus qu'elles leur donneraient s'ils les faisaient défricher et les mettaient en culture. Je suis si persuadé de cela, que si j'étais possesseur de bois en France, je ferais arracher jusqu'au dernier acre qui serait praticable pour la charrue, et je le mettrais en culture, et j'ai la ferme conviction que cette spéculation me serait profitable. Si l'agriculture fait des progrès, et elle en fera certainement, pourvu qu'elle soit affranchie des dimes et de l'inégalité des impôts, il faudra que le prix du bois augmente considérablement, pour empêcher que les propriétaires qui entendent leurs intérêts, ne convertissent leurs forêts en terres labourables. »
« Il est une autre preuve non moins incontestable, que le prix du bois est trop bas en France; c'est que les mines de charbon qu'on trouve dans [I-231] presque toutes les parties du territoire, ne sont pas exploitées, et que le peuple brûle du bois dans le voisinage immédiat de ces mines; j'en ai fait moi-même l'expérience dans toutes les auberges, où l'on m'a toujours donné du bois pour mon chauffage, même près des mines qui étaient en état d'exploitation, telles que celles de Valenciennes, du Mont-Cenis, de Lyon, d'Auvergne, du Languedoc, de Normandie, de Bretagne et d'Anjou. Est-il possible de croire que cela arriverait, si le prix du bois était monté au niveau du prix de toutes les autres productions? »
« La conclusion qu'il faut tirer de ces faits ajoutait Arthur Young, est assez claire: c'est que la législature ne doit prendre aucune mesure quelconque, pour encourager la production du bois; qu'elle doit en laisser le prix s'élever jusqu'au point où la demande le portera naturellement, et que les sociétés et les académies d'agriculture, généralement composées de consommateurs non intéressés dans la production, doivent mettre un 'terme à leurs injustes et impertinentes clameurs contre le prix d'un produit qui est beaucoup trop bas [88]. »
Ces observations seraient justes, si l'on devait [I-232] ne considérer les bois que comme la plupart des autres productions; c'est-à-dire dans l'intérêt immédiat des producteurs et des consommateurs. En ne le considérant que sous ce point de vue, il est clair qu'il faut laisser le propriétaire, maître de tirer de son fonds le genre de produits qui lui assurent le plus gros revenu. Si le public consent à payer le blé que donne une certaine étendue de terre, plus cher qu'il ne voudrait payer le bois qui serait produit par une égale étendue de terre de même qualité, il est évident que le besoin de bois se fait sentir moins vivement que le besoin de blé. En employant sa terre à produire des céréales, le propriétaire suit les conseils que lui dictent ses intérêts, en même temps qu'il se conforme aux vœux des consommateurs [89].
Mais les forêts ne sont pas utiles seulement par le bois qu'elles fournissent toutes les années aux possesseurs de terres, et que ceux-ci livrent aux consommateurs; elles sont utiles surtout par les eaux qu'elles distribuent aux populations répandues dans les vallées, au-dessus desquelles elles sont situées. En les détruisant et en les [I-233] convertissant en terres labourables, les propriétaires augmenteront peut-être leurs revenus de quelque chose; l'étendue de terre qui ne leur donnait que quinze francs, pourra leur en donner dix-huit ou dix-neuf. Mais les effets de ce changement ne se feront pas sentir seulement par ceux qui les auront produits; ils ne se borneront pas à augmenter ou à diminuer leurs revenus, selon que l'entreprise aura été bien ou mal conçue; ils s'étendront sur des populations nombreuses, et pourront les affecter, d'une manière fâcheuse, dans leurs propriétés et dans toutes les branches de leur industrie. Le défrichement aura probablement pour résultat de tarir les sources qui portaient la fertilité dans les plaines, de transformer les rivières en torrens, de rendre les communications difficiles ou impossibles, parce que les rivières seront trop basses dans les temps de sécheresse, et qu'elles déborderont dans la saison des pluies.
Les propriétaires ne peuvent se faire payer les services que rendent leurs forêts aux populations · répandues dans les bassins des fleuves par l'influence qu'elles exercent sur la distribution des eaux;" ils n'ont de bénéfices à attendre que de la vente du bois, et il est naturel qu'ils comparent sans cesse le revenu qu'ils en retirent, à celui que les mêmes terres leur donneraient si elles étaient défrichées et employées à produire des céréales ou à élever des [I-234] troupeaux. De leur côté, les populations qui se sont développées dans les bassins des rivières', et dont la prospérité est fondée sur les eaux qui fécondent leur agriculture et donnent la vie à leur industrie ou à leur commerce, ne peuvent rien payer pour les services que leur rendent les forêts. Le bois qui vient au marché, s'estime par les services qu'il peut rendre à celui qui l'achète pour le consommer, et non par ceux qu'il a rendus au public avant que d'être abattu.
Les forêts ou les bois, surtout dans certaines positions, rendent donc à une nation des services qui ne produisent aucun avantage particulier pour ceux qui en sont propriétaires, services dont tout le monde jouit, sans que personne ait la volonté ni la puissance de les payer, afin d'en perpétuer la durée. Les intérêts des propriétaires n'étant pas une garantie pour les intérêts du public, puisque ces deux genres d'intérêts, loin d'être toujours d'accord, sont souvent opposés; on a pensé que la puissance législative devait intervenir pour empêcher que l'intérêt général ne fût sacrifié à l'intérêt privé. Il faut dire même que lorsque les gouvernemens ont interposé leur autorité pour la conservation des bois et des forêts, ils ont été généralement conduits, moins par une raison éclairée que par une sorte d'instinct, et quelquefois même par de mauvaises passions.
[I-235]
Depuis le commencement du quatorzième siècle jusque vers la fin du dix-septième, les rois de France se sont beaucoup occupés de la conservation des forêts: si l'on s'en rapportait aux titres de leurs ordonnances, on serait même tenté de croire qu'ils ont considéré les propriétés de ce genre, dans leurs vrais rapports avec la prospérité publique; tous ces titres, en effet, annoncent qu'on va traiter des eaux en même temps que des forêts, comme si, par la conservation de celles-ci, on avait eu principalement en vue de veiller à la conservation de celles-là; mais ce n'est qu'une trompeuse apparence; la liaison qui est dans les mots, ne se trouve ni dans les idées ni dans les mesures [90].
Il aurait fallu, pour soumettre les bois et les forêts à une bonne police, que les causes qui en recommandaient la conservation, fussent bien connues, et que la puissance du gouvernement fût incontestée sur toutes les parties du territoire national; mais ce n'était pas dans les ténèbres du moyen âge, et au milieu de l'anarchie produite par le régime féodal, qu'il était possible de concevoir [I-236] et de prendre des mesures générales pour faire concourir chacune des parties du territoire à la prospérité de l'ensemble; tout ce qu'il était possible de faire alors était de veiller, autant que possible, à la conservation ou à la bonne administration de chaque partie, sans s'occuper des rapports qu'elle pouvait avoir avec les autres.
Les ordonnances rendues depuis le commencement du quatorzième siècle jusqu'en 1669, sur les eaux et forêts, n'avaient eu généralement pour objet que la conservation des revenus de la couronne. On n'avait vu, dans les forêts, que les produits immédiats qu'elles donnaient annuellement, et le gibier auquel elles offraient des refuges; on n'avait vu, dans les fleuves et les rivières, que le poisson qu'on pouvait y prendre. La chasse et la pêche étaient dans ces temps des affaires plus importantes pour le monarque et sa maison, que l'agriculture et le commerce.
Louis XIV et ses conseillers furent dominés par les mêmes idées et par les mêmes passions; cependant ils portèrent leurs vues un peu plus loin. Après avoir pris les mesures que les lumières ou les besoins du temps pouvaient leur suggérer, pour conserver les forêts de l'état et assurer le service de la marine, ils s'occupèrent des bois des particuliers. L'ordonnance du mois d'août 1669 enjoignit à toutes personnes, sans exception ni [I-237] différence, de régler la coupe de leurs bois taillis au moins à dix années, avec réserve de seize baliveaux dont ils pourraient disposer après l'âge de quarante ans. Elle leur ordonna d'en réserver dix dans les ventes ordinaires de haute futaie, en leur laissant toutefois la faculté d'en disposer à leur profit, après l'âge de cent vingt ans. Il leur fut enjoint de plus d'observer, dans l'exploitation de leurs bois ou forêts, ce qui était prescrit pour l'usance des forêts de la couronne, sous les peines portées par les ordonnances.
Les grands maîtres et autres officiers des eaux et forêts furent autorisés à visiter ou inspecter les bois des particuliers, pour assurer l'observation de ces dispositions et réprimer les contraventions [91].
Les particuliers étant tenus de se conformer, dans l'exploitation de leurs bois, aux règles prescrites pour les forêts de l'état, il s'ensuivait qu'il leur était interdit de les arracher pour les convertir en terres labourables. C'est, en effet, ce qui fut décidé par deux arrêts du conseil, l'un du 9 décembre 1705, l'autre du 16 mai 1724. Les bois étaient soumis aux règles du droit public, quant à l'exploitation, et aux règles du droit privé, quant à la transmission.
Les mêmes motifs qui avaient porté le gouvernement [I-238] à interdire aux particuliers la destruction de leurs bois, et à leur imposer des règles pour l'exploitation, le déterminèrent à leur défendre d'y établir, sans une autorisation particulière, des forges, fourneaux et verreries [92]; on craignait que la consommation de bois qui serait faite par ces usines, quelque profitable qu'elle fût pour les propriétaires, ne fût nuisible à l'intérêt public.
L'ordonnance de 1669 n'avait pas suffi pour mettre les bois à l'abri des dévastations; il résulte, au contraire, du témoignage d'Arthur Young, cité dans le chapitre précédent, que même avant la révolution, ils étaient impunément ravagés, au moins dans quelques parties de la France. Quand la révolution éclata, les anciennes lois sur les eaux et forêts ne furent pas immédiatement abolies, mais elles eurent encore moins de force qu'elles n'en avaient auparavant. Cette faiblesse des lois eut des conséquences d'autant plus étendues que l'aliénation des domaines nationaux donna aux acquéreurs le moyen de disposer, sans contrôle, des bois dont ils avaient fait l'acquisition. L'assemblée nationale, par son instruction du 12 août 1790, essaya de faire respecter les anciennes règles par les administrations locales et par les citoyens; mais, comme aux yeux de beaucoup de [I-239] personnes, la liberté n'était que l'affranchissement de toute règle et de tout devoir, ses exhortations ne produisirent que peu d'effet.
« L'assemblée nationale, est-il dit dans cette instruction, n'a pu s'occuper encore des réformes que peut exiger l'administration des domaines et bois; elle a décreté seulement la vente des biens nationaux. Ainsi, par rapport à la régie de ces biens et à la perception de leurs revenus, les choses doivent rester, quant à présent, sur l'ancien pied, et les municipalités, ainsi que les administrations, ne peuvent y prendre part.
» Il en est de même de la juridiction des eaux et forêts, qui subsiste toujours, et qui n'ayant encore perdu que la seule attribution des délits de chasse, doit continuer de connaître, comme par le passé, de toutes les autres matières que les anciennes lois ont soumises à sa compétence, jusqu'à ce qu'un décret formel de l'assemblée nationale ait prononcé sa suppression.
« Nombre de municipalités cependant égarées par une fausse interprétation des décrets des 11 décembre et 18 mars derniers, se sont permis des entreprises dont la durée et la multiplication auraient les suites les plus funestes. L'assemblée nationale a mis sous la sauvegarde des assemblées administratives et municipales les forêts, les bois et les arbres, et elle leur en a recommandé la [I-240] conservation. De là plusieurs municipalités ont conclu que l'administration des bois leur était attribuée.......
« Cette erreur a déjà produit beaucoup de mal. Les gardes des maîtrises ont, dans plusieurs endroits, été expulsés des forêts et exposés à des violences. Les officiers des maîtrises eux-mêmes n'ont pas été respectés; ils sont, dans certaines provinces, réduits à l'impuissance de faire leurs fonctions..... Des dégâts considérables ont été commis dans les bois, sous les yeux des municipalités qui devaient les empêcher et les prévenir, et qui n'ontpas eu la force de s'y opposer......
« C'est aux assemblées administratives et spécialement à leurs directoires, qu'il appartient d'arrêter le cours d'un désordre véritablement effrayant; c'est à elles qu'il est réservé de surveiller la conduite des municipalités, de les contenir dans les bornes précises de leur pouvoir.... Elles mêmes sont chargées de veiller à la conservation des bois, et ce n'est pas seulement contre les délits des particuliers, c'est aussi contre les erreurs et les entreprises des municipalités, qu'elles doivent défendre cette propriété précieuse [93] ».
[I-241]
La loi du 14 août 1791 supprima l'ancienne administration forestière et en organisa une nouvelle; elle soumit à cette administration et au régime établi par l'ordonnance de 1669, 1° les forêts et bois qui appartenaient à l'État; 2° les bois tenus du ci-devant domaine de la couronne, à titre de concession, engagement et usufruit ou autre titre révocable; 3° les bois possédés en gruerie, grairie, segrairie, tiers et dangers, ou indivis entre la nation et des communautés; 4° les bois appartenant aux communautés d'habitans; 5° enfin, ceux qui étaient possédés par des maisons d'éducation et de charité; mais les bois appartenant à des particuliers furent affranchis du régime forestier et des règles auxquelles l'ordonnance de 1669 et les arrêts du conseil les avaient soumis : chacun eut donc la liberté d'administrer les siens et d'en disposer comme de toute autre espèce de propriété.
Les nombreux défrichemens qui suivirent la promulgation de cette loi, firent craindre que la France ne manquât de bois. Le 9 floréal an xr (29 avril 1803), une loi nouvelle déclara que, [I-242] pendant vingt-cinq ans, aucun bois ne pourrait être arraché et défriché que six mois après la déclaration qui en aurait été faite par le propriétaire devant la conservation forestière de l'arrondissement où le bois serait situé. L'administration forestière fut autorisée à faire mettre, dans ce délai, opposition au défrichement, à la charge d'en référer, avant l'expiration de six mois, au ministre des finances, sur le rapport duquel le gouvernement statuerait dans le même délai. En cas de contravention à ces dispositions, le propriétaire devait être condamné à remettre une égale quantité de terrain en nature de bois, et à une amende qui ne pouvait être au-dessous du cinquantième, ni au-dessus du vingtième de la valeur du bois arraché. Si le propriétaire n'effectuait pas la plantation ou le semis dans le délai fixé par le jugement de condamnation, il devait y être pourvu à ses frais par l'administration forestière.
La même loi déclara que le martelage pour le service de la marine aurait lieu dans les bois des particuliers, taillis, futaies, avenues, lisières, parcs, et même sur les arbres épars, et soumit la coupe des arbres marqués aux règles observées pour les bois nationaux. Les propriétaires de futaies furent tenus, hors les cas d'une urgente nécessité, de faire, six mois d'avance, devant le conservateur forestier de l'arrondissement, la déclaration des coupes [I-243] qu'ils avaient l'intention de faire, et des lieux où leurs bois étaient situés. Le conservateur devait en prévenir le préfet maritime dans l'arrondissement duquel sa conservation était située, pour qu'il fit procéder à la marque, en la forme accoutumée.
La loi du 15 août 1791 et celle du 9 floréal an x1 ( 29 avril 1803) ont été remplacées par le code forestier du 21 mai 1827. Le premier article de ce code a soumis au régime forestier, 1° les bois et forêts qui font partie du domaine de l'État; 2° ceux qui font partie du domaine de la couronne; 3° ceux qui sont possédés à titre d'apanage et de majorats, reversibles à l'État; 4° ceux des communes et des sections de communes; 5° ceux des établissemens publics; 6° enfin, ceux dans lesquels l'État, la couronne, les communes ou les établissemens publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers.
L'article 2 rétablit les particuliers, relativement à leurs bois, dans l'exercice de tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions spécifiées dans les autres articles de la même loi. Il paraît abroger ainsi les dispositions de la loi du 9 floréal an xi, qui interdisaient aux particuliers, pendant vingt-cinq ans, d'arracher et de défricher leurs bois; mais cette abrogation n'est qu'apparente, puisque les défenses faites par cette dernière loi sont reproduites dans le dernier titre du code forestier.
[I-244]
Les bois des particuliers sont donc soumis, sous le rapport des droits de propriété, à deux exceptions transitoires : l'une a pour objet d'assurer le service de la marine; l'autre la conservation des bois existans. Celle-ci consiste dans la défense faite à toute personne, pendant vingt ans, d'arracher ou de défricher ses bois sans en avoir fait préalablement la déclaration à la sous-préfecture, au moins six mois d'avance, et dans la faculté donnée à l'administration de s'opposer au défrichement. Le propriétaire qui, nonobstant cette opposition, fait procéder au défrichement de ses bois, encourt une amende de cinq cents francs au moins et de quinze cent francs au plus par hectare de bois défriché. Il doit être, en outre, condamné à rétablir les lieux en nature de bois, dans un délai déterminé par le jugement de condamnation; et s'il n'obéit pas au jugement, le semis ou la plantation sont effectués à ses frais.
Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux jeunes bois, pendant les premières vingt années après leur semis ou plantation; aux parcs ou jardins clos et attenant aux habitations; aux bois non clos, d'une étendue au-dessous de quatre hectares, lorsqu'ils ne font point partie d'un autre bois qui compléterait cette contenance, ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou sur la pente d'une montagne.
[I-245]
L'exception établie dans l'intérêt de la navigation consiste dans la faculté donnée pour dix ans, à compter de la promulgation de la loi, au département de la marine, de choix et de martelage sur les bois des particuliers, futaies, arbres de réserve, avenues, lisières et arbres épars. Ce droit ne peut toutefois être exercé que sur les arbres en essence de chêne, qui sont destinés à être coupés, et dont la circonférence, mesurée à un mètre du sol, est de quinze décimètres au moins. Il ne peut l'être, dans aucun cas, sur les arbres qui existent dans les lieux clos attenant aux habitations, et qui ne sont point aménagés en coupes réglées.
Afin de faciliter au département de la marine l'exercice de ce droit, la loi soumet tous les propriétaires, hors le cas de besoins personnels, pour réparations et constructions, à l'obligation de faire six mois d'avance, à la sous-préfecture, la déclaration des arbres qu'ils ont l'intention d'abattre, et des lieux où ils sont situés, sous peine d'une amende de dix-huit francs par mètre de tour pour chaque arbre déclaré; si, dans les six mois, à compter du jour de l'enregistrement de cette déclaration, la marine n'a pas fait marquer, pour son service, les arbres déclarés, les propriétaires peuvent en disposer librement [94].
[I-246]
Les adjudicataires des bois soumis au régime forestier, les maires des communes, les particuliers, ainsi que les établissemens publics, pour les exploitations faites sans adjudication, traitent de gré à gré avec la marine, du prix des bois qu'elle a marqués pour son service; s'ils ne peuvent s'entendre avec elle, ce prix est réglé par des experts, à frais communs. Si, dans les trois mois de la notification de l'abattage, faite à la sous-préfecture, la marine n'a pas pris livraison de la totalité des arbres marqués appartenant au même propriétaire, et si elle n'en a pas acquitté le prix, les personnes auxquelles ils appartiennent peuvent, en disposer librement. Jusqu'à l'abattage, la marine a la faculté d'annuler les martelages opérés pour son service; mais elle ne peut l'annuler pour une partie seulement des arbres marqués.
Les obligations imposées aux propriétaires de bois, dans l'intérêt de la marine, ne devant avoir que dix ans de durée, à compter de la promulgation du code forestier, cesseront le 31 juillet 1837. L'interdiction d'arracher et de défricher les bois ayant été limitée à vingt années, les propriétaires pourront en disposer de la manière la plus absolue, à compter du 31 juillet 1847. A partir de cette [I-247] époque, les bois qui sont situés sur le sommet ou sur le penchant des montagnes, pourront être arrachés et défrichés, comme ceux qui se trouveront situés au fond des vallées les plus profondes. Les propriétaires jouiront alors de la liberté qu'ils avaient sous l'empire de la loi du 15 août 1791.
Il n'est pas difficile de voir les motifs qui devaient faire interdire la destruction et le défrichement des bois, surtout de ceux qui étaient situés sur les plateaux et sur le penchant des montagnes ; mais il serait difficile de trouver les raisons qui ont fait donner une limite à la durée de l'interdiction. En 1847, il ne se sera sans doute opéré aucune révolution, ni dans la nature de notre globe, ni dans la nature humaine. Les eaux qui tomberont sur des montagnes escarpées, dont on aura détruit le bois et remué le sol, se formeront en torrens, et entraîneront le gravier dans les vallées, comme de notre temps. Celles qui tomberont sur un sol dépouillé de végétaux, échauffé par les rayons du soleil, ou balayé par les vents, se dissipera en vapeurs, comme de nos jours, et ne pourra, par conséquent, s'infiltrer dans la terre pour reparaître sous forme de sources. Les habitans des montagnes ne se croiront pas alors plus intéressés que de nos jours, à laisser le sol dans un état qui est plus profitable pour les habitans des vallées que pour eux-mêmes.
[I-248]
Si, dans l'intervalle de temps qui doit s'écouler entre le jour où l'interdiction a été prononcée et le jour où elle doit cesser, des mesures devaient être prises pour changer la destination d'une partie du sol, ou les mœurs des habitans; si les plateaux et les penchans des montagnes devaient être convertis en propriétés nationales ou communales, et couverts de bois, ou si les populations répandues dans les bassins des rivières et des fleuves devaient en faire l'acquisition, pour leur donner la destination la plus favorable à leurs intérêts, on comprendrait qu'à partir d'une certaine époque, on n'eût mit aucune limite au droit des particuliers de convertir leurs bois en pâturages ou en terres de labour; mais aucune mesure n'étant prescrite par les lois, il est impossible de voir quels sont les faits nouveaux qui, dans quinze ans, rendront innocens les défrichemens qu'on juge aujourd'hui dommageables.
Le dernier article du code forestier déclare, il est vrai, que les semis et plantations de bois, sur le sommet et le penchant des montagnes et sur les dunes, seront exempts de tout impôt pendant vingt ans; mais, si les propriétaires ont jugé qu'il était de leur intérêt de détruire les bois situés sur ces terres, il est douteux que l'exemption qui leur est accordée soit suffisante pour les déterminer à les rétablir. A l'expiration des vingt années d'exemption, [I-249] ils se trouveront d'ailleurs dans la position où ils étaient avant que ces bois eussent été arrachés; les motifs qui les déterminèrent pourront encore agir sur eux pour leur faire prendre la même résolution. Quelle sera donc la cause qui pourra les obliger à conserver un genre de propriété qu'ils ont trouvé convenable de détruire, ou qui du moins n'avait pas assez de valeur à leurs yeux pour payer les frais que la conservation aurait exigés ?
Si les bois situés sur les sommets, les plateaux et les penchans des montagnes, ne sont pas moins utiles aux populations répandues dans les bassins des rivières et des fleuves, qu'aux particuliers ou aux communes à qui ils appartiennent; si l'intérêt de ces populations est qu'ils soient conservés, tandis que l'intérêt des propriétaires les pousse, au contraire, à les détruire, il n'y a pas d'autre moyen d'en assurer la conservation que de mettre tous les intérêts en harmonie, ou d'employer la force pour en prévenir la destruction. Le moyen le plus simple d'intéresser les populations auxquelles appartiennent les plateaux ou le penchant des montagnes, à laisser ou à mettre leurs terres en nature de bois, serait d'accorder à ceux qui feraient un tel emploi de leurs propriétés, une exemption d'impôts assez considérable pour les dédommager des pertes qui pourraient en résulter [I-250] pour eux. Il ne suffirait pas de leur accorder une exemption temporaire pour agir efficacement sur leur esprit; il faudrait une exemption perpétuelle et proportionnée aux sacrifices qu'on exigerait d'eux.
Quant à l'emploi de la force, qui est le moyen habituel des gouvernemens despotiques, il est rare qu'il produise l'effet qu'on s'en promet, et qu'il n'en produise pas beaucoup d'autres auxquels on ne s'attendait pas. Louis XIV y eut recours, et l'on a vu, par les exemples cités par Arthur Young, que ce moyen n'empêchait pas la dévastation des plus belles forêts. Napoléon, par la loi du 9 floréal an xi, et les auteurs du code forestier de 1827, ont voulu prévenir la destruction des bois par l'emploi temporaire du même moyen; mais on peut prédire, sans crainte d'être démenti par les résultats, que ce ne sera ni par des prohibitions, ni par la crainte des amendes, qu'on assurera la prospérité de la France. Il ne suffit pas, pour faire prospérer une nation, de mettre des obstacles à de mauvaises mesures;; il faut savoir déterminer les volontés à en prendre de bonnes: un peuple ne fait pas de progrès par l'inaction.
Le régime auquel le code forestier soumet les bois et forêts de l'État, ceux du domaine de la couronne, des communes et des établissemens publics, a principalement pour objet d'en assurer la [I-251] bonne administration, et d'en prévenir la destruction et le défrichement. Les motifs pour lesquels on a veillé à leur conservation n'ont peut-être pas été toujours ceux qu'on aurait dû consulter dans l'intérêt général; mais ces motifs, quelle qu'en ait été la nature, ont influé sur le résultat des mesures qu'ils ont fait prendre. Il n'entre pas dans le plan de ce livre d'examiner les moyens d'administration qu'on a établis à diverses époques, pour veiller à la conservation des bois; il suffit d'en faire remarquer la tendance.
On conçoit que toutes les forêts n'ont pas la même importance pour une nation; la conservation des bois situés au fond des vallées importe moins que celle des bois situés sur les plateaux et sur le penchant des montagnes. Des bois placés auprès de l'embouchure d'un fleuve sont, en général, moins précieux pour le pays que ceux qui sont situés dans les parties élevées du bassin de ce même fleuve. Toutes les règles qu'on peut établir sur cette matière sont donc subordonnées aux circonstances physiques au milieu desquelles chaque population est placée.
Les ordonnances ou les lois qu'on a faites pour la conservation des forêts, n'ont presque jamais pris en considération la situation qu'occupaient les bois dont on se proposait de prévenir la destruction. On aurait pu craindre qu'il ne résultat [I-252] de cette apparente imprévoyance, de graves inconvéniens, et cependant aucune inconséquence fâcheuse ne paraît en avoir été la suite. La raison en est que, dans tous les pays, les meilleurs terrains ont presque toujours été les premiers mis en culture. Les bois que l'intérêt privé portait à détruire les derniers, étaient ceux dont l'intérêt général sollicitait particulièrement la conservation.
Toutes les fois qu'il est question de soumettre à des règles particulières les propriétés de ce genre; il y a trois sortes d'intérêts qu'il ne faut jamais perdre de vue, et qu'il importe de concilier autant que possible : l'intérêt de la population entière, l'intérêt des propriétaires de bois ou de terres qui devraient être consacrés à ce genre de produits, et l'intérêt des consommateurs.
Je n'ai point parlé, dans ces considérations, des intérêts ou des besoins de la marine; et cependant c'est principalement en vue de ces intérêts que les bois ont été soumis à un régime particulier. La légitimité de cet intérêt a été mise en question, même en Angleterre, où il s'est trouvé des économistes qui ont soutenu qu'une puissante marine n'était un bien, ni pour le peuple qui la possédait, ni pour l'humanité en général, et qu'il valait mieux d'ailleurs acheter du bois dans les pays où il était produit à bon marché, que de le produire soi-même à grands frais. Un écrivain dont on n'a mis [I-253] en question, ni les connaissances, ni le patriotisme, a publié à ce sujet une opinion que je crois devoir rapporter ici.
« Je serais fâché, dit-il, d'ajouter à mes raisons deux mots sur l'argument le plus commun, sur celui qu'on fonde sur la prétendue nécessité d'une marine royale; car je considère toute idée d'une grande force navale comme étant fondée sur des théories fort douteuses. Une marine puissante est dommageable aux autres nations par son objet, lequel est de porter, jusque sur les parties les plus éloignées du globe, les funestes effets de l'ambition, et toutes les horreurs qui suivent l'esprit de conquête, quand il dérive d'un esprit plus malfaisant encore, celui du commerce étranger. Et cependant quelle que soit la nécessité commerciale fondée sur les plus mauvais principes qu'on allègue pour la soutenir, la dépense en est si considérable, qu'aucune nation ne peut être formidable en même temps sur mer et sur terre, sans faire des efforts qui, par le moyen des emprunts, font tomber nos charges sur notre innocente postérité. M. Hume a observé que la flotte anglaise, au plus fort de la guerre de 1740, coûtait à la nation plus que ne coûtait tout l'état militaire de l'empire romain sous Auguste, quand tout ce qui était alors digne d'être appelé le monde, était placé sous le sceptre de ce prince. Dans notre dernière guerre, la dépense de [I-254] notre flotte a été le double de celle qui avait attiré l'attention de cet habile et profond écrivain; car la dépense navale de 1781 s'est élevée jusqu'à 8,603,884 livres sterling.
« L'ambition des hommes d'état est toujours disposée à fonder, sur l'existence d'un grand commerce, la nécessité d'une grande marine pour le protéger; et l'on suppose ensuite la nécessité d'un grand commerce pour soutenir une grande marine: de fort beaux systèmes d'économie politique ont été la conséquence de cette malfaisante combinaison. Le rêve trompeur des colonies a été une branche de cette curieuse politique, qui a coûté à la nation anglaise, comme sir John Sinclair l'a démontré, deux cent quatre-vingts millions sterling [95]. Plutôt que de se mettre dans la nécessité de faire cette énorme dépense, à laquelle notre puissante marine nous a obligés, n'aurait-il pas mieux valu que la nation fût sans commerce, sans colonies et sans marine? La même folie a gagné le cabinet de France: là, une grande marine est nécessaire, parce qu'on a, dans Saint-Domingue, une grande colonie! Ainsi, une cause de dommage en engendre toujours une autre. Ce siècle a été l'époque du pouvoir maritime; ce pouvoir cessera dans le siècle suivant, et alors on le considérera comme [I-255] un système fondé sur l'esprit de rapine commerciale.
« Mais quelle que puisse être la nécessité des marines, il n'y en a aucune pour cultiver des chênes pour les construire; il en coûte infiniment moins de les acheter que de les cultiver. On ne peut pas prévoir l'époque où l'on aura épuisé le chêne du Nord, de la Bohême, de la Sibérie, de la Pologne, de la Hongrie et des terres qui bordent l'Adriatique. Le prix s'en élevera à mesure que le.transport en sera plus coûteux, mais ces pays en fourniront pendant des siècles. Jusqu'au commencement du siècle dernier, la rareté du chêne nous a contraints de faire usage du pin ; et cependant, malgré la grande consommation qui en a été faite, les pays d'où nous l'avons tiré, pourraient nous en fournir encore pendant cinq cents ans » [96].
La nécessité de veiller à la conservation des bois, n'est pas la même pour toutes les nations; une multitude de circonstances physiques, telles que l'élévation et l'étendue des montagnes, la chaleur ou la fraîcheur du climat, la nature et la disposition du sol, peuvent faire varier les besoins des hommes. Le déboisement d'une île située sous un climat humide et froid, ne peut pas avoir pour les habitans les mêmes effets que le déboisement d'un pays tel que la Perse.
[I-256]
Quelque sages que puissent être, au reste, les mesures d'un gouvernement, elles ne sauraient jamais produire de grands résultats, si elles n'étaient pas secondées par les mœurs de la population. C'est donc sur les esprits qu'il faut surtout agir; il faut montrer aux hommes leurs véritables intérêts. Lorsqu'ils verront clairement le but vers lequel il leur importe de se diriger, ils Ꭹ tendront sans qu'on ait besoin de les presser.
[I-257]
CHAPITRE XVI.
Des anciennes lois sur la jouissance et la conservation des fleuves et des rivières.↩
IL existe, ainsi qu'on l'a vu, des rapports intimes entre l'état du sol des parties supérieures d'un grand bassin, et les cours d'eau qui le parcourent. Ces rapports auraient dû servir de base aux mesures prises en divers temps et en divers lieux pour la conservation des grands cours d'eau, et cependant ils ont été sans influence sur les actes de la plupart des gouvernemens. Nous ne devons pas en être étonnés : ils n'étaient pas connus, il n'y a pas très long-temps, même par les hommes qui s'occupaient des sciences avec le plus de succès. Il aurait été difficile, d'ailleurs, qu'on les prît pour règles à des époques de troubles et de guerres, quand les peuples étaient divisés de la manière la plus arbitraire; quand l'industrie et le commerce étaient des objets de mépris, et que les nations, comme leurs gouvernemens, étaient plongées dans une profonde ignorance [97].
[I-258]
Il aurait fallu, pour oser concevoir, et surtout pour mettre en pratique dans chaque grand bassin, un système propre à en développer toutes les ressources agricoles, industrielles et commerciales, que les divisions politiques des divers pays fussent en harmonie avec les divisions territoriales formées par la nature elle-même, et que l'autorité publique se trouvât entre les mains d'hommes assez éclairés, assez puissans, et surtout assez intègres pour subordonner aux intérêts généraux tous les intérêts individuels qui s'y trouvaient opposés; dans les temps où nous vivons, il y a peu de nations qui puissent se vanter d'être parvenues à ce degré de perfection; et aucune n'y était arrivée dans les temps qui nous ont précédés; nous ne devons donc pas espérer de trouver, dans les lois des anciens peuples, un ensemble de mesures propres à tenir les grands cours d'eau toujours en bon état.
Les rivières, ainsi qu'on l'a vu précédemment, ont, pour les nations qui savent en faire usage, [I-259] divers genres d'utilité: elles ne servent pas seulement à leur fournir l'eau qui leur est nécessaire pour leur breuvage, pour la préparation de leurs alimens, et pour leur propreté, ou à nourrir le poisson qui fait une partie de leur subsistance; dans beaucoup de lieux, elles portent la fertilité sur un sol qui serait stérile ou du moins peu productif, s'il n'était arrosé que par les eaux du ciel ; comme forces motrices, elles transportent dans un lieu les denrées ou les marchandises qui y manquent, et qui abondent dans un autre; elles donnent le mouvement à des machines puissantes, et contribuent ainsi au développement et à la perfection des arts; la force de la vapeur qui produit aujourd'hui tant de merveilles, ne saurait remplacer toujours la puissance d'un cours d'eau, et elle est plus dispendieuse.
Quand on considère un fleuve dans toutes les parties qui concourent à le former, on peut, ainsi que je l'ai fait voir, le comparer à un arbre immense dont le tronc repose sur la mer, et dont les branches et les rameaux s'étendent sur la surface d'un grand bassin. Les diverses parties dont il se compose peuvent être divisées et traitées séparément dans un écrit ; des administrateurs ou des écrivains peuvent s'occuper alternativement de la tige, des branches principales ou secondaires, et des plus petits rameaux; mais de quelque manière qu'ils le divisent, [I-260] il n'est pas en leur puissance de faire que, dans la nature, il ne forme pas un vaste ensemble dont toutes les parties sont liées entre elles. Le tronc ne saurait, en effet, exister indépendamment des branches, les branches indépendamment des rameaux, les rameaux indépendamment des infiltrations qui leur donnent naissance. La conservation des parties principales est donc subordonnée à la conservation des plus petites.
Il ne paraît pas que les Romains aient jamais songé à tenir les plateaux et les versans les plus élevés, dans l'état le plus favorable à la conservation et à la bonne distribution des eaux; mais du moins ils avaient assez de bon sens et de logique pour voir que les cours d'eau qui se trouvaient dans chaque bassin, ne formaient qu'un tout, et qu'il n'y avait pas moyen de conserver les rivières navigables, s'ils ne veillaient pas à la conservation de celles qui ne l'étaient pas.
Les Romains reconnaissaient en principe que toutes les rivières, navigables ou non navigables, ainsi que les lits qu'elles parcouraient, étaient publics; ils admettaient aussi que l'usage des rives était public, quoique la propriété en appartînt aux propriétaires riverains [98]. Ayant divisé les [I-261] cours d'eau en deux classes, les rivières qui coulent dans toutes les saisons de l'année, et les torrens qui ne coulent qu'à certaines époques, ils avaient déclaré que ces derniers appartenaient seuls au domaine privé [99]. Ils ne confondaient pas cependant les rivières publiques avec les simples ruisseaux; ce qui distinguait les unes des autres à leurs yeux, était un plus grand volume d'eau, ou, en cas de doute, l'opinion des habitans du voisinage [100].
Une source qui se trouvait dans une propriété privée, pouvait être employée, soit aux usages de l'agriculture, soit à l'établissement d'une [I-262] manufacture; mais le propriétaire qui s'en servait, ne pouvait ni réunir l'eau pour la faire couler en grand volume sur les propriétés inférieures, ni la leur envoyer après l'avoir salie [101].
De ce que toutes les rivières étaient publiques, les Romains ne tiraient pas la conséquence qu'aucun particulier ne pouvait, ni s'y livrer à la pêche, ni en tirer aucune sorte de matériaux, ni y faire aucun ouvrage, sans la permission de l'autorité publique; ils en concluaient, au contraire, que toute personne avait le droit d'en faire usage, sous la condition de respecter les droits d'autrui, ou de ne causer aucun dommage, soit à la navigation, soit aux propriétés riveraines [102].
Chacun avait donc le droit de naviguer sur une rivière, un lac, un canal, un étang publics, d'y prendre du poisson, de charger ou décharger ses bateaux sur la rive, ou de les amarrer aux arbres qui s'y trouvaient placés [103].
[I-263]
Le droit de navigation dans une rivière étant commun à tous les citoyens, il s'ensuivait que nul ne pouvait, même avec l'autorisation du préteur, y placer des corps, y faire des ouvrages, ou y pratiquer des prises d'eau, qui pussent nuire à la navigation ou causer à autrui quelque dommage [104]; mais aussi les entreprises nuisibles, soit à la navigation, soit aux propriétés riveraines, étaient les seules qui fussent interdites, soit dans les rivières navigables, soit dans celles qui en rendaient d'autres navigables [105].
Il était donc interdit, soit d'élargir, soit de rétrécir le lit d'une rivière ou d'y pratiquer des prises d'eau, toutes les fois que ces ouvrages devaient avoir pour résultat de rendre la navigation plus difficile; les travaux et les prises d'eau dans une rivière non navigable qui alimentait une rivière navigable, étaient également interdits, s'ils devaient nuire à la navigation [106].
Quant aux prises d'eau, qui ne pouvaient pas avoir pour résultat de rendre la navigation plus difficile, elles étaient formellement autorisées pour [I-264] toutes les rivières qui n'étaient pas consacrées à un service public: la prohibition n'avait lieu, comme on vient de le voir, dans les rivières navigables ou non navigables, que dans les cas où la navigation en avait souffert [107].
Le lit d'une rivière publique, c'est-à-dire, de toute rivière dont le cours était perpétuel, était nécessairement public, de même que l'usage de ses rives. Si donc il arrivait qu'une rivière se formât un cours nouveau, ou qu'elle fût détournée artificiellement de son ancien cours, le lit qu'elle se traçait, ou celui dans lequel on la faisait entrer, devenaient publics. Le lit ancien était, de plein droit, acquis aux propriétaires riverains, ou au premier occupant, s'il n'y avait aucune propriété privée qui arrivât jusqu'au lit abandonné [108].
Tout citoyen ayant droit d'user d'une chose publique, et la violation d'un droit donnant toujours [I-265] naissance à une action au profit de la personne lésée, il s'ensuivait que toute personne dont les intérêts étaient blessés par une entreprise faite sur un cours d'eau, pouvait s'opposer à ce qu'elle fût exécutée, et demander la destruction des travaux accomplis ou commencés [109]; l'intérêt individuel devenait ainsi le gardien de l'intérêt public.
Un citoyen n'avait pas seulement le droit de s'opposer à l'exécution de tout ouvrage nuisible à la navigation ou à ses propriétés, ou de demander la destruction des ouvrages déjà exécutés; il pouvait de plus exiger que toute personne qui se proposait de faire une entreprise sur le lit ou sur les rives d'une rivière, fût tenue de répondre, par une caution, des dommages que cette entreprise pourrait causer pendant dix ans; cette caution pouvait être exigée même de celui qui se bornait à fortifier les rives pour la conservation de ses propriétés [110].
La rive était définie « ce qui contient la rivière quand elle est dans son état ordinaire: » Id quod flumen continet naturalem rigorem cursus sui tenens [111]. Cependant, on considérait comme faisant [I-266] partie de la rive, les lieux qui la confinent; mais l'espace qui était ainsi considéré comme public, était très-mal déterminé [112].
Quoique l'usage des rives fût public comme les rivières, et que chacun eût le droit, soit d'y charger ou décharger ses bateaux, soit d'y attacher les cordes nécessaires au service de la navigation, elles appartenaient, ainsi que les arbres qui s'y trouvaient placés, aux propriétaires riverains [113]. Les droits du public n'existaient que comme servitude.
Une île qui se formait dans une rivière appartenait au premier occupant, si les propriétés voisines n'aboutissaient pas à la rivière, ou bien au propriétaire dont les fonds étaient contigus, ou aux propriétaires des deux rives, si elle était située au milieu de la rivière [114].
Presque toutes ces dispositions des lois romaines ne sont que des conséquences d'un grand principe; elles dérivent de ce fait, qu'une rivière, navigable ou non navigable, appartient à la population qui s'est développée dans le bassin qu'elle parcourt. Ce principe étant admis, il s'ensuit, en effet, que chacun peut en jouir, sous la condition de respecter le même droit dans les autres, et de ne pas en [I-267] faire un usage dommageable pour les membres de la société. Chacun peut retirer d'un cours d'eau tous les avantages qu'il est susceptible de produire, en respectant l'égalité des droits et les intérêts du corps entier de la nation. Toutes les mesures préventives se réduisent à répondre, pendant un temps déterminé, des conséquences fâcheuses que. pourront avoir les travaux qu'on se propose d'exécuter.
Les premières ordonnances rendues par les rois de France sur les cours d'eau, ne remontent pas plus haut que le treizième siècle; elles n'eurent d'abord pour objet que la pêche. Les établissemens de Louis IX, de 1270, ne permettaient à un gentilhomme qui avait eau courante dans ses terres, d'y défendre la pêche, qu'avec le consentement du baron et du vavasseur [115]. Les barons et les vavasseurs pouvaient donc, à cette époque, empêcher qu'on ne pêchât dans les eaux qui traversaient les terres soumises à leur domination.
Par une ordonnance de 1292, Philippe IV régla la pêche de toutes rivières, grandes et petites; il prohiba certains instrumens de pêche; il défendit de prendre certaines espèces de poissons, tant qu'ils n'auraient pas atteint une longueur déterminée, ou acquis une certaine valeur; mais il ne [I-268] reconnut ni ne créa aucun privilége; il n'établit aucune distinction entre les cours d'eau ; ce qui pourrait faire penser que les principes du droit romain, sur cette matière, régissaient alors la France.
Au milieu du quatorzième siècle, le 29 mai 1346, Philippe VI rendit une ordonnance sur les eaux et forêts. Ce titre fastueux pourrait donner à croire que déjà le gouvernement apercevait quelques rapports entre l'état des eaux d'un pays, et l'état des parties les plus élevées du sol; mais, si on le pensait, il suffirait, pour se désabuser, de lire quelques-unes des dispositions de l'ordonnance. Philippe VI ne s'occupe que de sa table et de celle de sa famille; il ordonne aux maîtres des eaux et forêts de faire peupler ses étangs, et de les faire pêcher en temps convenable. Il veut qu'ils envoient à Bertaut Bardilly, son intendant, les poissons qui seront profitables pour sa maison, et pour les hostiex de sa très-chière compaigne la royne, et de ses enfans, et que tous les autres soient vendus pour lui acheter du poisson de mer. Quant aux rivières, il ne s'en occupe que pour recommander l'observation des ordonnances précédentes. Ces ordonnances, en effet, ne s'exécutaient que petitement, comme le déclare Charles V dans celle qu'il rendit dans le mois de juillet 1576 (article, 52).
Au commencement du siècle suivant, les seigneurs, qui avaient dépeuplé les campagnes de [I-269] cultivateurs pour les peupler de bêtes sauvages, ainsi que le prouve l'ordonnance du 25 mai 1413, se rendirent maîtres des rivières et des fleuves; ils s'établirent sur tous les passages, et levèrent, dit la même ordonnance, de grands et excessifs acquits et péages sur les denrées et marchandises passant par les détroits desdites terrés et rivières. La Seine, la Loire, le Rhône, furent ainsi envahis comme les rivières les moins importantes [116].
[I-270]
En même temps que les seigneurs s'emparaient des rivières pour y établir arbitrairement des péages et rançonner le commerce, ils y formaient des barrages pour faire arriver l'eau dans leurs propriétés ; ils y établissaient des gords pour la pêche, ou y formaient des îles; ils arrêtaient ainsi le poisson au passage et rendaient la navigation dangereuse et presque impossible; et, dans les crues d'eau, ils inondaient les terres de leurs voisins, de telle manière, dit l'ordonnance : « que quand il est grande abondance d'eaux, les pays voisins et labourages d'iceux, en sont du tout perdus et gastez, au très-grant préjudice du bien public de nostre royaume et des sujets des pays voisins [117]. »
Il résultait des mêmes désordres que le lit des rivières et les fossés pratiqués pour faciliter l'écoulement des eaux, n'étaient point entretenus, et que, faute de curage, l'eau se répandait dans les campagnes, et les transformait en marais; les chemins et les chaussées étaient tellement dégradés qu'on ne pouvait y passer sans danger [118].
Charles VI, par son ordonnance du 25 mai 1413, essaya de porter remède à ces désordres: il prononça l'abolition de tous les péages et acquits [I-271] établis sur les routes et les rivières, et qui n'avaient pas une existence immémoriale, ou qui n'étaient pas fondés sur des titres; il défendit d'en établir de nouveaux sans son autorisation, sous peine d'amende arbitraire et de confiscation des terres à cause desquelles ils seraient exigés; il déclara que les péages établis pour l'entretien des ponts, ports, chemins et chaussées, seraient perçus au profit de la couronne, si les conditions sous lesquelles ils avaient été concédés n'étaient pas remplies; il ordonna que les gors, îles et autres empêchemens faits sur les rivières publiques depuis un temps dont le souvenir existait encore, seraient détruits et annulés, et que les lieux seraient remis en leur premier état; enfin, il prescrivit le curage des rivières, et des fossés qui avaient été faits pour faciliter l'écoulement des eaux.
Vingt-cinq ans après la publication de cette ordonnance, les abus qu'elle avait pour objet de détruire n'avaient pas encore cessé; puisque, le 30 juin 1438, Charles VII rendit une nouvelle ordonnance pour l'abolition des péages que les seigneurs continuaient de percevoir sur la Loire.
Par son ordonnance de 1292, Philippe IV avait soumis la pêche de toutes les rivières grandes et petites à certaines règles. Charles VI ne fit non plus aucune distinction entre elles, dans l'ordonnance du 25 mai 1413, sur la réformation du [I-272] royaume ; il les comprit toutes dans les mêmes dispositions. Il paraît donc qu'à cette dernière époque, le principe consacré par les lois romaines, était encore admis en France, et que les rivières qui n'étaient pas navigables, étaient publiques comme les rivières navigables.
Ce principe est, en effet, implicitement consacré par les dispositions de la dernière de ces deux ordonnances.
« Combien que anciennement au fait du gouvernement des eaues et forests de nostre royaume, dit l'article 229, n'y eust aucun qui outré et par-dessus les maistres ordinaires de nos eaues et forests, s'appelast grand et souverain maistre desdits eaues et forests, néanmoins, puis aucun tems en ça aucuns ont vu et impétré de nous le dict office de souverain maistre et gouverneur desdites eaues et forests de nostre dict royaume, et sous umbre et couleur de ce, ont prins et exigé de nous grands et excessifs gaiges, dons et prouffits, à nostre très-grand charge, et fait et commis par eux et leurs commis et sergens, plusieurs grands oppressions à nostre peuple.... »
Charles VI abolit, en conséquence, l'office de grand et souverain maître des eaux et forêts du royaume, et ne conserva que les maîtres des eaux et forêts ordinaires, dont il fixa le nombre à six: deux pour les pays de Normandie et Picardie, deux pour les pays de France, Champagne et Brie, [I-273] un pour le pays de Touraine, et un pour le pays de Languedoc. Il considéra comme usurpation, ainsi qu'on l'a déjà vu, les entreprises faites par les seigneurs sur les rivières publiques, et il ordonna la destruction de tous les travaux qui avaient été exécutés, et qui nuisaient à la multiplication du poisson, à la navigation ou aux propriétés privées. Il appliqua donc à toutes les rivières les principes consacrés par le droit romain.
Les états du Languedoc, dans leurs remontrances de 1456, exposèrent à Charles VII tous les griefs dont ils croyaient avoir à se plaindre; au nombre des abus qu'ils lui signalaient, étaient les vexations que les lieutenans du maître des eaux et forêts faisaient éprouver aux gens d'église et aux nobles, en leur interdisant de chasser même dans les petits buissons, ou de pêcher dans de petits ruisseaux qui n'avaient pas d'eau pendant le tiers de l'année, sans en avoir obtenu la permission du maître des eaux et forêts.
« Aussi, disaient-ils, le maître des eaux et des forêts, qui veut empêcher que nul ne chasse aux bêtes sauvages, ni ne pêche en aucunes eaux sans sa licence; et combien que ne se doive entremettre, ne prendre cognoissance, fors seulement des forests royaux et fleuves portant navires, qui vous appartiennent, et non mie des forests des gens d'église et nobles qui ont leurs bois et rivières en [I-274] toute juridiction, haute, moyenne et basse, et toutefois s'efforce de faire le contraire, et envoie par les villages et les lieux, ses lieutenans commis ou députés, qui tiennent leurs cours et assises en juridiction des dictes gens d'églises et nobles, contre les ordonnances sur ce faites; et, sur ce, font enquestes, et convenir toute manière de gens qui auront chassé en quelque petit buisson, ou pesché en quelque petit ruisseau où n'aura pas eau les deux parts de l'an, contre toute raison, et au très grand préjudice des dictes gens d'église et nobles, ausquels la cognoissance en appartient, ne devroient estre inquiétez ou molestez pour petits poissons, et se devroient régler selon les dictes ordonnances sur ce faites, à l'ombre de son office, entreprend d'avoir cognoissance sur le tout, à la grande charge du peuple, qui en a assez d'autres à porter. »
Les ordonnances sur les eaux et forêts, antérieures au quinzième siècle, n'avaient établi aucune distinction entre les rivières navigables et les rivières non navigables; elles n'avaient pas déclaré que les premiers feraient partie du domaine public, et que les secondes appartiendraient aux gens d'église et aux nobles; elles les avaient, au contraire, toutes soumises au même régime, et il était naturel que les maîtres des eaux et forêts exerçassent leur juridiction sur les unes comme sur les autres. Il serait, par conséquent, bien difficile de dire sur quelles lois [I-275] les états du Languedoc se fondaient pour prétendre que les rivières portant navires appartenaient à la couronne, et les autres aux nobles et aux gens d'église; cette prétention paraît avoir pour objet bien moins de revendiquer un droit que de faire consacrer une usurpation. Si les gens d'église et les nobles s'étaient réellement considérés comme propriétaires des rivières qui ne portaient pas navires, ils nè se seraient pas bornés à se plaindre qu'on les empêchait de prendre de petits poissons dans de petits ruisseaux, qui étaient à sec pendant un tiers de l'année. La modestie de ces plaintes est peu en harmonie avec la grandeur des prétentions dont elles sont accompagnées.
Aussi, Charles VII, en répondant à cette partie des doléances des nobles et du clergé, n'eut garde de reconnaître qu'ils étaient propriétaires de toutes les rivières non navigables; il annonça qu'il avait l'intention de s'occuper prochainement des abus commis, dans tout le royaume, par les officiers des eaux et forêts; il promit de défendre à ces officiers de nommer des lieutenans, et de tenir leur juridiction hors des lieux anciens et accoutumés, et contre la disposition des ordonnances; mais il s'abstint de s'expliquer sur la propriété des cours d'eau, et ne voulut pas admettre en principe que son autorité ne s'étendît que sur les rivières portant navires.
[I-276]
Lorsque, vers la fin du quatorzième siècle, les seigneurs s'emparèrent, par voie de fait, des cours d'eau qui existaient sur la surface de la France, ils ne distinguèrent pas les rivières navigables, des rivières non navigables; ils s'établirent sur le Rhône, sur la Loire et sur la Seine, comme sur les rivières les moins importantes. De leur côté, les princes qui tentèrent de réprimer ces usurpations, ou de soumettre la pêche à certaines règles, ne firent aucune distinction entre les différentes rivières. Les ordonnances de Philippe IV, de Charles V, de Charles VI et de Charles VII, s'appliquaient également à toutes. Vers le milieu du quinzième siècle, les nobles et les gens d'église reconnaissaient que les rivières portant navires faisaient partie du domaine public; mais ils se prétendaient propriétaires de tous les autres...
Au milieu du dix-septième siècle, l'usurpation des rivières non navigables, par la noblesse et le clergé, était accomplie, et Louis XIV lui-même n'osait pas la combattre. L'ordonnance des eaux et forêts de 1669, s'occupe, en effet, des rivières navigables ou flottables; mais elle est muette sur la propriété de toutes les autres. Quelle est la cause de ce silence? On ne croyait pas, sans doute, que les rivières non navigables fussent sans influence sur la prospérité publique, et qu'on pût, sans inconvénient, ne les soumettre à aucune règle. On ne [I-277] pouvait pas ne pas voir que ces rivières intéressaient au plus haut degré toutes les propriétés situées sur leurs rives, et que ce n'était que par elles que les rivières navigables pouvaient exister. Il faut donc croire que le gouvernement de Louis XIV ne gardait le silence à cet égard, que parce qu'il ne voulait pas sanctionner une usurpation qu'il n'avait pas la puissance de faire cesser.
L'ordonnance de 1669 déclarait que la propriété de tous les fleuves et rivières du royaume, portant bateaux de leur fond, sans artifice et ouvrage des mains, faisaient partie du domaine de la couronne, nonobstant tous titres et possessions contraires, sauf les droits de pêche, moulins, bacs et autres usages que les particuliers pouvaient y avoir par titres et possessions valables, auxquels ils étaient maintenus [119].
Elle interdisait à tous propriétaires ou engagistes, sous peine d'amende arbitraire, de faire, sur ces rivières, moulins, bâtardeaux, usines, gords, pertuis, murs, plants d'arbres, amas de pierres de terre et de fascines, ou autres édifices ou empêchemens nuisibles au cours de l'eau, d'y jeter aucunes ordures, immondices, ou de les amasser sur les quais ou les rivages; enfin, de détourner l'eau ou d'en affaiblir et altérer le cours par des [I-278] tranchées, fossés et canaux, sous peine d'être punis comme usurpateurs [120].
Il fut enjoint à ceux qui avaient fait bâtir, sur les mêmes rivières, des moulins, écluses, vannes, gords et autres édifices, sans en avoir obtenu la permission du gouvernement, de les démolir; faute de quoi, la démolition en serait faite à leurs dépens [121],
Il fut ordonné aux propriétaires des héritages riverains de laisser le long des bords vingt-quatre pieds au moins de place en largeur, pour le chemin royal et trait des chevaux; et il leur fut défendu, sous peine de cinq cents livres d'amende, de planter des arbres ou faire des haies ou clôtures à moins de trente pieds de distance du bord destiné au trait des chevaux, et à moins de dix pieds du bord opposé [122].
Enfin, il fut défendu, sous peine de cent livres d'amende, de tirer, sur les bords, des terres, sables ou autres matériaux à une distance moindre de six toises; il ne pouvait être permis, par conséquent, d'en tirer du sein même de la rivière [123].
Cette ordonnance n'avait rien décidé sur la [I-279] propriété des îles, ilots et atterrissemens qui se formaient dans les fleuves et rivières portant bateaux de leur fond, sans artifice et ouvrages des mains; une déclaration du mois d'avril 1683 les considéra comme faisant partie du domaine de la couronne.
Il existe, comme on voit, de nombreuses différences entre le droit reconnu par les lois romaines, et celui qu'établit l'ordonnance de 1669. Les Romains, ayant admis que toutes les rivières, navigables ou non navigables, faisaient partie du domaine public, reconnaissaient à chacun la faculté de profiter de tous les avantages qu'il pouvait en tirer, pourvu qu'il respectât les droits des autres, et qu'il ne leur causât aucun dommage. La monarchie absolue, sortie du régime féodal, réclame, comme faisant partie du domaine de la couronne, les fleuves et rivières navigables et flottables, et ne reconnaît aux particuliers que les droits qu'il lui plaira de leur concéder. Les lois romaines, nées d'un principe de liberté, ne sacrifiaient pas les droits de tous aux prétentions ou aux intérêts de quelques-uns; mais elles n'autorisaient que des mesures répressives. Les lois nées de la monarchie absolue sont au contraire essentiellement préventives: nul ne peut faire servir à son usage les domaines de la couronne, si ce n'est en vertu d'une concession personnelle.
[I-280]
Les premières réprimaient tout acte, toute entreprise qui avaient pour effet, soit de nuire à la navigation, soit de causer quelque dommage; elles ne distinguaient pas les faits entrepris ou exécutés dans les rivières navigables, de ceux qui étaient entrepris ou exécutés dans les cours d'eau par lesquels ces rivières étaient alimentées. Les secondes, au contraire, ne s'occupaient que des entreprises tentées ou exécutées sur des rivières navigables ou flottables; mais aussi elles les prohibaient d'une manière absolue, sans distinguer celles qui ne portaient aucun préjudice à des particuliers ou au public, de celles qui pouvaient leur causer quelque dommage.
Sous les lois de la monarchie, le gouvernement pouvait empêcher et empêchait en effet qu'un propriétaire ne fît aucune prise d'eau dans une rivière navigable ou flottable, pour le service de ses propriétés, même quand aucun dommage n'aurait dû en être la conséquence; mais il n'aurait pu s'opposer à ce que des milliers de prises d'eau fussent pratiquées dans les rivières qui alimentaient celle-là, et qu'elles fussent mises à sec, si cela avait été possible; comme si les rivières navigables avaient une existence indépendante de celles qui ne le sont pas !
Le gouvernement de Louis XIV pouvait s'opposer à ce que personne fit, dans une rivière navigable, [I-281] des bâtardeaux, des murs, des écluses, des gords ou d'autres ouvrages nuisibles au cours de l'eau, et capables d'inonder les propriétés riveraines; mais, si de pareils travaux étaient exécutés dans les petites rivières qui formaient la première, l'ordonnance de 1669 n'en prescrivait pas la destruction, quelque fâcheuses qu'en fussent les conséquences pour les propriétés du voisinage.
Il était interdit à toute personne, par cette ordonnance, de former, dans une rivière navigable ou flottable, des amas de pierres ou de terre, ou d'y jeter des ordures ou immondices; mais il n'était pas défendu de jeter dans les rivières qui y portaient leurs eaux, des ordures, des immondices, des amas de pierres ou de terre, comme si les matières qu'on jette dans celles-ci, ne devaient pas arriver dans celle-là !
En faisant ces observations sur l'ordonnance de 1669, mon intention n'est pas de la condamner; je n'entends pas accuser ceux qui en furent les auteurs, d'imprévoyance ou d'absurdité. Leurs mesures furent un véritable progrès, puisqu'elles avaient pour objet de dépouiller les nobles et les gens d'église d'une partie des usurpations qu'ils avaient commises sur les cours d'eau. S'ils ne firent pas mieux, nous devons croire que cela ne fut pas en leur puissance. Tout ce que je voulais démontrer, c'est l'impossibilité de séparer les rivières navigables des [I-282] rivières non navigables; je voulais faire voir que les unes comme les autres appartiennent au domaine public, et qu'il n'y a pas moyen d'admettre un principe contraire, sans tomber dans une multitude d'inconséquences.
Il faut ajouter toutefois que les mesures prescrites par l'ordonnance de Louis XIV, étaient loin d'être nouvelles. Par son réglement du mois de février 1415, Charles VI en avait pris de semblables pour la Seine et ses affluens. Vers la fin du dix-septième siècle, on n'était donc pas beaucoup plus avancé sur ces matières, qu'on ne l'avait été au commencement du quinzième.
L'ordonnance de 1669 a cependant gouverné la France jusqu'à la révolution; plusieurs de ses dispositions sont encore en vigueur, et son influence s'est étendue sur toutes les lois qui ont été rendues depuis cette époque.
[I-283]
CHAPITRE XVII.
Des lois rendues depuis la révolution sur la propriété, l'entretien et l'usage des cours d'eau. Des dispositions des lois anglaises, et des lois anglo-américaines, sur le même sujet.↩
L'ASSEMBLÉE constituante, par son décret des premiers jours du mois d'août 1790 [124], avait prononcé l'abolition des droits féodaux, et quoiqu'elle n'eût fait aucune mention particulière du droit de pêche ou des autres droits dont les seigneurs jouissaient exclusivement sur les rivières non navigables, ces droits avaient été généralement considérés comme supprimés.
Par une loi du 22 décembre suivant, relative à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives, elle chargea les administrateurs de département de toutes les parties de l'administration départementale, notamment de celles qui étaient relatives à la conservation des forêts, rivières, chemins et autres choses communes [125].
[I-284]
Il ne serait pas facile de déterminer les différences que l'assemblée constituante mettait entre les propriétés publiques et les propriétés communes, parmi lequelles elle plaçait les forêts, les chemins et les rivières. Les jurisconsultes romains entendaient, par choses publiques, celles qui appartenaient au corps entier de la nation, telles, par exemple, que les routes, les rivières et les ports de mer. Ils entendaient, par choses communes, celles qui étaient, en quelque sorte, la propriété du genre humain, et dont on ne pouvait ôter légitimement l'usage à personne, telles que l'air, la lumière, la mer. L'assemblée constituante, en mettant au rang des choses communes celles que les lois romaines classaient parmi les choses publiques, ne déterminait pas les objets qu'elle entendait désigner par cette dernière expression. Quoi qu'il en soit, il nous suffit d'observer qu'elle mettait les rivières sur la même ligne que les chemins et les forêts, et qu'elle les considérait comme communes, sans établir aucune différence entre celles qui étaient navigables et celles qui ne l'étaient pas [126].
[I-285]
Par son instruction du 12 août 1790, elle chargea les assemblées administratives, de rechercher et d'indiquer le moyen de procurer le libre cours des eaux, d'empêcher que les prairies ne fussent submergées par la trop grande élévation des écluses, des moulins, et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières; de diriger enfin, autant qu'il serait possible, toutes les eaux de leur territoire, vers un but d'utilité générale d'après les principes de l'irrigation; mais, quoique l'autorité donnée à ces assemblées pût faire supposer que toutes les rivières étaient des dépendances du domaine public, la puissance législative ne s'expliqua point alors sur la question de savoir si elles appartenaient, en effet, à l'État.
Le 22 novembre de la même année, l'assemblée constituante rendit un décret par lequel elle détermina les biens dont le domaine public était composé. Par l'article 1 er, elle déclara (§ 1) que le domaine national proprement dit s'entendait de toutes les propriétés foncières et de tous les droits réels et mixtes qui appartenaient à la nation, soit qu'elle en eût la possession et la jouissance actuelle, soit qu'elle eût seulement le droit d'y rentrer par voie de rachat, droit de réversion ou autrement.
« Les chemins publics, ajoutait l'article 2, les rues et [I-286] places des villes, les fleuves et rivières navigables, les lais et relais de la mer, les ports, les hâvres, les rades, et, en général, toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public [127]. »
Cette loi ne comprenait donc pas, dans l'énumération des biens faisant partie du domaine de l'État, les rivières non navigables; et l'on pourrait conclure de là que ces rivières n'entraient pas dans la composition du domaine public: mais si, dans ✩ sa pensée, elles n'appartenaient point à l'État, à qui appartenaient-elles? Étaient-elles la propriété des communes qu'elles traversaient? Les propriétaires des héritages riverains en étaient-ils les maîtres, ou bien appartenaient-elles aux populations qui en occupaient les bassins? La loi du 22 novembre, sur les domaines nationaux, ne s'expliquait pas à cet égard.
Le 27 septembre 1794, l'assemblée constituante, [I-287] dans un décret relatif aux biens et aux usages ruraux, s'occupa de nouveau des fleuves et des rivières. Elle déclara d'abord que nul ne pouvait se prétendre propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable. Elle reconnut ensuite que tout propriétaire riverain pouvait, en vertu du droit commun, faire, dans ces rivières, des prises d'eau, sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d'une manière nuisible au bien général et à la navigation [128].
Il semblait résulter de ces deux dispositions, que les rivières qui n'étaient ni navigables ni flottables, étaient ou pouvaient devenir propriétés privées ou communales, et que les propriétaires riverains n'avaient pas, en vertu du droit commun, la faculté d'y faire des prises d'eau, comme quand il s'agissait d'une rivière navigable ou flottable. Si l'on reconnaissait, en effet, à tout propriétaire riverain le droit de pratiquer des prises d'eau dans toute rivière qui bordait son héritage, pourquoi ne faisait-on mention de ce droit que pour les rivières navigables? Pourquoi dire que nul ne pouvait se prétendre propriétaire exclusif de ces rivières? Admettait-on que les autres pouvaient appartenir exclusivement à des personnes qui n'en posséderaient pas les bords, et que les propriétaires [I-288] riverains ne pourraient pas en faire usage?
Ayant reconnu, en principe, que nul ne pouvait se prétendre propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable, et que tout propriétaire riverain pouvait, en conséquence, y pratiquer des prises d'eau, la même loi déclara que personne ne pourrait inonder l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le dommage, et d'une amende qui ne pourrait excéder la somme du dédommagement; elle déclara, de plus, que les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou à construire, seraient garans de tous les dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir ou autrement; qu'ils seraient forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuirait à personne, et qui serait fixée parle directoire du département, d'après l'avis du directoire du district. La peine, en cas de contravention, était une amende qui ne pouvait excéder la somme du dédommagement [129]).
Le décret du 15 mars 1790, qui avait supprimé les droits féodaux de péage, passage, halage, et [I-289] autres de même nature, nominativement désignés, perçus par terre ou par eau, avait provisoirement excepté, par l'article 15 du titre II, 1° les octrois autorisés, qui ne se percevaient sous aucune des dénominations comprises dans cet article; 2° les droits de bac et de voiture d'eau. Le décret du 25 août 1792 fit disparaître cette exception; l'article 7 prononça l'abolition, sans indemnité, de ces péages; l'article 9 déclara que les droits exclusifs des bacs et voitures d'eau, provisoirement conservés, étaient pareillement supprimés ; il reconnut à tout citoyen le droit de tenir, sur les rivières et canaux, des bacs, coches ou voitures d'eau, sous les loyers et rétributions qui seraient fixés et tarifés par les directeurs de département, sur l'avis des municipalités et du directoire de district.
Les nombreuses lois qui avaient prononcé l'abolition des droits féodaux n'ayant fait aucune mention spéciale des droits exclusifs de pêche que les gens d'église et les nobles s'étaient attribués sur toutes les rivières non navigables, la Convention nationale fut invitée à rendre un décret qui dissipât les doutes qui pouvaient s'élever à cet égard; elle écarta toujours les pétitions qui lui furent adressées, par des ordres du jour, motivés sur ce que les droits exclusifs de pêche, dont jouissaient les seigneurs, avaient été abolis par les articles 2 et 5 du décret du 25 août 1792; elle reconnut ainsi [I-290] que tout propriétaire avait le droit de pêcher le long de ses propriétés [130].
L'ordonnance de 1669 avait été modifiée dans quelques-unes de ses dispositions, par les lois qui avaient été rendues dans les trois premières années de la révolution; mais elle n'avait pas été abrogée quand la Convention nationale cessa d'exister. Le Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), déclara, par son article 609, qu'en attendant que les dispositions de cette ordonnance, les lois des 19 juillet et 28 septembre 1791, celle du 20 messidor de l'an 3, et les autres relatives à la police municipale, correctionnelle, rurale et forestière, eussent pu être revisées, les tribunaux correctionnels les appliqueraient aux délits de leur compétence. La réforme annoncée par cet article n'a été faite qu'en partie.
Suivant la loi du 27 septembre 1791, tout [I-291] propriétaire riverain d'une rivière navigable ou flottable pouvait donc, en vertu du droit commun, y faire des prises d'eau, pourvu qu'il n'en détournât ni n'en embarrassât le cours d'une manière nuisible au bien général et à la navigation établie; il résultait de là que celui qui, par une prise d'eau, causait quelque dommage au public, pouvait être condamné à rétablir les choses dans leur premier état.
Il paraît qu'en effet plusieurs particuliers dégradèrent des rivières navigables ou flottables, par les prises d'eau qu'ils y pratiquèrent, puisque le gouvernement directorial jugea convenable de rétablir l'ancienne prohibition. Par un arrêté du 19 ventôse an VI (9 mars 1798), le directoire exécutif enjoignit aux administrations centrales et municipales de veiller, avec la plus sévère exactitude, à ce qu'il ne fût établi aucun pont, aucune chaussée permanente ou mobile, aucune écluse ou usine, aucun batardeau, moulin ou digue, ou autre obstacle quelconque au libre cours des eaux, sans en avoir préalablement obtenu la permission. Il leur enjoignit, en outre, de veiller à ce que nul ne détournât le cours des eaux des rivières et canaux navigables ou flottables, et n'y fit des prises d'eau ou saignées pour l'irrigation des terres, qu'après y avoir été autorisé par l'administration centrale, et sans pouvoir excéder le niveau qui aurait été [I-292] déterminé. Cette dernière disposition était une violation manifeste de l'article 4 de la première section du titre premier de la loi du 27 septembre 1798, et il aurait été bien difficile de la faire exécuter si les citoyens ne s'y étaient pas volontairement soumis [131].
La liberté, reconnue à tout citoyen par l'art. 9 du décret du 25 août 1792, de tenir sur les rivières et canaux navigables, des bacs, coches et bateaux, ne fut pas de longue durée; elle fut détruite par la loi du 6 frimaire an vII (26 novembre 1798), qui transféra ce droit à l'État. Les bacs, bateaux, agrès, logemens, bureaux, magasins et autres objets y relatifs, qui existaient au moment de la promulgation de la loi, tombèrent dans le domaine public. L'État fut chargé d'en payer la valeur aux personnes qui produiraient des titres de propriété; on considéra comme usurpés sur le domaine public, ceux de ces objets pour lesquels aucun titre de propriété n'était produit. Enfin, il fut ordonné, par la même loi, qu'il serait procédé, suivant les formes prescrites pour la location des domaines nationaux, à l'adjudication des droits de passage, bacs, bateaux, passe-cheval, établis [I-293] sur les fleuves, rivières et canaux navigables, pour trois, six ou neuf années [132].
L'abolition du régime féodal avait fait admettre le principe consacré par le droit romain, sur la liberté de la pêche. La loi du 14 floréal an x (4 mai 1802), sur les contributions indirectes, fit disparaître cette liberté relativement aux fleuves et rivières navigables ou flottables. Elle déclara qu'à l'avenir nul ne pourrait pêcher dans les fleuves et rivières navigables, à moins qu'il ne fût muni d'une licence, ou adjudicataire de la ferme de la pêche. Le gouvernement fut autorisé à déterminer les parties des fleuves et des rivières où il jugerait la pêche susceptible d'être mise en ferme, et à régler, pour les autres, les conditions auxquelles seraient assujétis les citoyens qui voudraient y pêcher moyennant une licence. Il fut établi que tout individu qui, n'étant ni fermier de la pêche, ni pourvu de licence, pêcherait dans les fleuves et [I-294] rivières navigables autrement qu'à la ligne flottante et à la main, serait condamné à une amende qui ne pourrait être moindre de cinquante francs, ni excéder cent francs, à la confiscation des filets et engins de pêche, et à des dommages-intérêts, envers les fermiers de la pêche, d'une somme pareille.. Enfin, il fut ordonné que les gords, barrages, et autres établissemens fixes de pêche, construits ou à construire, seraient également affermés, après qu'il aurait été reconnu qu'ils ne nuisaient point à la navigation, qu'ils ne pouvaient produire aucun attérissement dangereux, et que les propriétés riveraines ne pouvaient en souffrir de dommage.
Le 30 du même mois (20 mai 1802), une nouvelle loi prescrivit la perception, dans toute l'étendue de la république, sur les fleuves et rivières navigables, d'un droit de navigation intérieure, dont les produits seraient spécialement et limitativement affectés au balisage, à l'entretien des chemins et ponts de halage, à celui des pertuis, écluses, barrages, et autres ouvrages d'art, établis pour l'avantage de la navigation. Le même droit devait être perçu sur les canaux navigables qui n'y avaient point encore été assujétis, et sur ceux où la perception des anciennes taxes était alors suspendue. Les produits des droits devaient former des masses distinctes, et l'emploi devait en être fait limitativement sur chaque canal, fleuve et [I-295] rivière sur lesquels la perception aurait été faite. Le gouvernement fut chargé d'arrêter, dans la forme des réglemens d'administration publique, un tarif des droits de navigation sur chaque fleuve, rivière ou canal, après avoir consulté les principaux négocians, marchands et mariniers qui les fréquentaient. Les négocians, marchands et mariniers devaient être appelés, à cet effet, au nombre de douze pour chaque fleuve, rivière ou canal; ils devaient se réunir en conseil, auprès du préfet désigné par le gouvernement, et donner leur avis sur la réformation ou le maintien des tarifs existans, pour les fleuves, rivières ou canaux où il n'y en avait pas.
L'impôt établi par cette loi devait être exclusivement destiné à l'exécution des travaux que l'intérêt de la navigation exigeait; il fallait même que le produit de chaque fleuve ou de chaque rivière fût employé dans l'intérêt de la même rivière ou du même fleuve. Il semble qu'on n'aurait pas dérogé à ce principe, si l'on avait consacré les produits d'une rivière navigable à tenir en bon état, non-seulement la partie consacrée à la navigation, mais les principaux affluens qui contribuaient à la rendre navigable. On en jugea autrement : on continua de considérer la partie navigable de chaque rivière comme si elle avait une existence indépendante des parties non navigables, comme si [I-296] les propriétaires riverains pouvaient mettre ces dernières à sec, sans affaiblir d'une manière sensible la puissance de la première. Il fallut donc pourvoir à l'entretien des parties non navigables autrement qu'avec les ressources que les parties navigables présentaient.
La loi du 14 floréal an x1 ordonna qu'il serait pourvu au curage des rivières non navigables et à l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspondaient, de la manière prescrite par les anciens réglemens ou d'après les usages locaux. Dans les cas où l'application des réglemens ou l'exécution du mode consacré par l'usage, exigeraient des dispositions nouvelles, le gouvernement devait y pourvoir par des réglemens d'administration publique, rendus sur la proposition du préfet, de manière que la contribution de chaque imposé fût toujours relative au degré d'intérêt qu'il aurait aux travaux qui devraient être exécutés. Les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux d'entretien, réparation ou reconstruction, devaient être dressés sous la surveillance du préfet, et rendus exécutoires par lui. Le recouvrement devait en être opéré de la même manière que celui des contributions publiques.
Ainsi, les fleuves, rivières et canaux navigables devaient être entretenus au moyen des produits de la navigation, et, en cas d'insuffisance, par les [I-297] contributions publiques, comme toutes les autres propriétés de l'État. Les rivières non navigables, au contraire, ne devaient être entretenues qu'aux frais des propriétaires riverains. Il est vrai que cet entretien était réduit à assurer le libre écoulement des eaux, c'est-à-dire au simple curage.
La loi du 50 floréal an X (20 mai 1802 ) ayant ordonné que les sommes perçues pour droit de navigation sur tous les fleuves, rivières et canaux navigables, seraient employées au profit du fleuve, de la rivière ou du canal, sur lequel la perception aurait été faite, et le gouvernement ayant été autorisé à arrêter un tarif de navigation, il devint nécessaire de diviser le territoire de la France en arrondissemens de navigation. Le 8 prairial an x1, il fut pris à cet égard un arrêté dont les principales dispositions méritent une attention particulière, car elles sont en harmonie avec la division naturelle du territoire.
L'article 1er déclare que la navigation intérieure de la France sera divisée en bassins dont les limites seront déterminées par les monts ou coteaux qui versent les eaux dans le fleuve principal, et que chaque bassin sera divisé en arrondissemens de navigation.
L'article 2 porte que les portions de fleuves et rivières faisant partie de départemeus autres que celui dans lequel sera placé le chef-lieu d'arrondissement [I-298] de navigation intérieure, seront mises dans les attributions administratives du préfet de ce chef lieu; et ce, seulement en ce qui concerne les travaux à exécuter dans le lit et sur le bord de la rivière ou du fleuve, le surplus de l'administration devant continuer à être exercé par le préfet du territoire.
L'ingénieur du département, dans lequel le chef-lieu d'arrondissement est fixé, doit, suivant l'article 3, exercer ses fonctions relativement aux travaux à faire sur toute l'étendue des fleuves et rivières compris dans les attributions du préfet du département. Il est tenu, suivant l'art. 18, de rédiger chaque année le projet des dépenses à exécuter dans l'année, et de les remettre au préfet, qui, de son côté, doit consulter un conseil composé de trois membres de la chambre de commerce, s'il en en existe, réunis à deux citoyens pris parmi les principaux maîtres mariniers fréquentant la rivière, ou s'il n'existe pas de chambre de commerce, de cinq citoyens pris à son choix parmi les principaux commerçans et mariniers.
Après avoir pourvu à la manière dont les tarifs des droits de navigation seront formés, à la comptabilité des agens préposés, à la perception de ces droits, et à quelques autres détails d'administration, le même arrêté dispose, par l'art. 29, qu'aucun particulier ne pourra percevoir aucun [I-299] droit aux pertuis, vannes et écluses, dans les rivières navigables des divers bassins, le tout conformément aux articles 15 et 14 du titre II de la loi des 15 et 28 mars 1790, et des articles 7 et 8 de la loi du 25 août 1792 [133].
Les rivières non navigables n'ayant pas été formellement comprises, par la loi du 22 novembre 1790, parmi les choses qui appartenaient au domaine public, et la loi du 14 floréal an X (4 mai 1802) ayant conféré à l'État exclusivement le droit de la pêche dans les fleuves et rivières navigables et flottables, des communes revendiquèrent le droit d'affermer, à leur profit, la pêche des rivières non navigables qui traversaient ou limitaient leur territoire. De leur côté, des propriétaires riverains prétendirent que le droit de pêcher dans les rivières qui bordaient ou traversaient leurs héritages, n'appartenaient qu'à eux, suivant les deux décrets de la Convention nationale des 6 et 30 juillet 1793.
Le Conseil-d'État ayant été consulté par le gouvernement sur cette question, décida, par son avis du 30 pluviôse an XIII (19 février 1805), que la pêche des rivières non navigables ne pouvait, [I-300] dans aucun cas, appartenir aux communes; que les propriétaires riverains devaient en jouir, sans pouvoir cependant exercer ce droit, qu'en se conformant aux lois générales ou réglemens locaux concernant la pêche, ni le conserver, lorsque, par la suite, une rivière actuellement non navigable deviendrait navigable, et qu'en conséquence tous les actes de l'autorité administrative qui auraient mis des communes en possesion de ce droit, devaient être déclarés nuls.
Le Conseil-d'État considéra que la pêche des rivières non navigables faisait partie des droits féodaux, puisqu'elle était réservée, en France, soit au seigneur haut-justicier, soit au seigneur du fief; que l'abolition de la féodalité avait été faite, non au profit des communes, mais bien au profit des vassaux qui étaient devenus libres dans leurs personnes et dans leurs propriétés ; que les propriétaires riverains étaient exposés à tous les inconvéniens attachés au voisinage des rivières non navigables (dont les lois n'avaient pas réservé les avant-bords aux usages publics); que les lois et arrêtés du gouvernement les assujétissaient aux dépenses du curage et à l'entretien de ces rivières, et que, dans les principes d'équité, celui qui supporte les charges doit aussi supporter les bénéfices; enfin, que le droit de pêche des rivières non navigables, accordé aux communes; serait une [I-301] servitude pour les propriétés des particuliers, et que cette servitude n'existait point, aux termes du Code civil.
L'ordonnance de 1669, par ménagement pour les usurpations féodales, n'avait considéré comme faisant partie des domaines de la couronne, que les fleuves et rivières portant bateaux de leur fond, sans artifices et ouvrages des mains. Le chemin de halage établi par l'article 7 du titre 28 de cette ordonnance, n'était donc pas dû par les propriétaires riverains, aux fleuves et rivières que la main de l'homme avait rendus navigables. La loi du 22 novembre 1790 avait, il est vrai, considéré comme dépendances du domaine public tous les fleuves et rivières navigables, sans admettre ou sans établir aucune distinction entre ceux qui l'étaient naturellement, et ceux qui l'étaient devenus par les travaux qu'on y avait faits; mais il n'avait point parlé des chemins de halage.
Le décret du 22 janvier 1808 leva les difficultés qui pouvaient naître de ce silence. Il déclara, article 1er, que les dispositions de l'article 7 du titre 28 de l'ordonnance de 1669, étaient applicables à toutes les rivières navigables de France, soit que la navigation y fût établie à cette époque, soit que le gouvernement se fût déterminé depuis, ou se déterminât à l'avenir à les rendre navigables: il obligea donc les propriétaires riverains, en quelque [I-302] temps que la navigation se fût établie, à laisser le passage pour le chemin de halage. En même temps, il fut ordonné qu'il serait payé aux riverains des fleuves et rivières où la navigation n'existait pas et où elle s'établirait, une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouveraient. Enfin, l'administration fut autorisée par le même décret à restreindre, lorsque le service n'en souffrirait pas, la largeur des chemins de halage, notamment quand il y aurait antérieurement des clôtures ou haies vives, murailles ou travaux d'art, ou des maisons à détruire [134].
On doit remarquer que si ces nombreuses lois ne classent parmi les choses dont l'ensemble forme le domaine public, que les fleuves et rivières navigables, elles ne reconnaissent pas cependant que les rivières non navigables appartiennent, soit aux particuliers dont elles bordent ou dont elles traversent les propriétés, soit aux communes dont elles limitent ou traversent le territoire; elles accordent aux premiers le droit de pêcher le long de leurs propriétés, et leur imposent la charge du curage : mais il y a loin de cette faculté aux [I-303] droits qui sont reconnus à de véritables propriétaires.
Le Code civil a reproduit quelques-unes des dispositions des lois antérieures; mais il n'y a presque rien ajouté. L'article 538 considère comme des dépendances du domaine public les chemins routes, rues à la charge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les hâvres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée. Il existe, entre cet article et l'article 2 de la loi du 22 novembre 1790, qui avait défini le domaine public, une différence qui mérite d'être remarquée. Celui-ci mettait parmi les dépendances du domaine public « les chemins publics, les rues et places des villes »; celui-là n'y met que « les chemins, routes et rues à la charge de l'État. » Ni l'un ni l'autre ne parlent de rivières non, navigables; mais tous les deux mettent au rang des choses qui composent le domaine public « généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée. » Si donc il était démontré qu'une rivière, même non navigable, n'est pas susceptible de devenir une propriété privée, il s'ensuivrait qu'elle fait essentiellement partie du domaine public. Or, cette démonstration qui, me semble déjà résulter [I-304] des chapitres précédens, ne sera pas, si je ne me trompe, très-difficile à donner.
Les auteurs du Code civil ayant mis au rang des choses qui font partie du domaine public, les fleuves et rivières navigables ou flottables, se sont occupés, au titre des Servitudes, des autres cours d'eau. Par l'article 640, ils ont déclaré que les fonds inférieurs sont assujétis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué. Ils ont interdit au propriétaire inférieur d'élever aucune digue pour empêcher cet écoulement, et au propriétaire supérieur de rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Ils ont reconnu par l'article 641 que celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription; mais ils ont ajouté, par l'article 645, que le propriétaire de la source ne pouvait en changer le cours, quand il fournit aux habitans d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire: seulement les habitans, s'ils n'en ont pas acquis l'usage par prescription, sont tenus de payer, à dire d'experts, une indemnité au propriétaire, s'il la réclame. Enfin, par l'article 644, ils ont reconnu à celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée [I-305] dépendance du domaine public par l'article 538, a le droit de s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés, et à celui dont une eau courante traverse l'héritage, le droit d'en user, dans l'intervalle qu'elle y parcourt, à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. S'il s'élève des contestations entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété; mais, dans tous les cas, ils doivent faire observer les règlemens particuliers et locaux sur le cours des eaux.
Les attérissemens et accroissemens qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou non, et qu'on nomme alluvion, profitent aux propriétaires riverains, à la charge par eux, si leurs propriétés bordent une rivière navigable, de laisser le marche-pied ou chemin de halage. Il en est de même des relais de tout fleuve ou de toute rivière qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre; le propriétaire dont l'héritage touche au fond découvert, en profite, sans que le riverain du côté opposé puisse venir y réclamer le terrain qu'il a perdu [135].
[I-306]
Les îles, ilots et attérissemens qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'État, s'il n'y a titre, ou possession contraire. Les îles et attérissemens qui se forment dans les autres rivières, appartiennent ou aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée, ou, si l'île n'est pas formée d'un seul côté, aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière. Si une rivière ou un fleuve, navigable ou non, en formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, se forme un nouveau cours, en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevée. Enfin, si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève, par une force subite, une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur, ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut, dans l'année, réclamer sa propriété; mais, après ce délai, il ne le peut [I-307] plus, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'ait pas encore pris possession de celle-ci [136].
Le Code civil, qui détermine l'usage que peut faire un propriétaire d'une rivière non navigable qui borde ou traverse sa propriété, et qui attribue les terrains d'alluvion aux propriétaires riverains, ne renferme aucune disposition sur la pêche; il se borne à déclarer que la faculté de chasser et de pêcher est réglée par des lois particulières [137].
La loi du 15 avril 1829 trace les règles auxquelles le Code civil se réfère. L'article 1er déclare que le droit de pêche sera exercé au profit de l'État : 1° dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'État ou de ses ayans-cause; 2° dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables et flottables, dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'État. Sont exceptés toutefois les canaux et fossés existans ou qui seraient creusés dans les propriétés particulières.
Dans toutes les rivières et canaux autres que [I-308] ceux qui sont désignés dans les dispositions précédentes, les propriétaires riverains ont, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possession ou par titres. Si une rivière non navigable était rendue ou déclarée navigable, le droit de pêche accordé aux propriétaires riverains serait de plein droit transféré à l'État, qui serait tenu de les en indemniser, compensation faite des avantagés qu'ils pourraient retirer de la destination nouvelle donnée à la rivière (art. 2 et 3).
Le droit de pêche étant dévolu à l'État pour les fleuves et rivières navigables, et aux propriétaires riverains pour les rivières non navigables, tout individu qui se livre à la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêcher appartient, commet un délit punissable d'une amende de vingt francs au moins et de cent francs au plus, et de la confiscation des filets et engins de pêche, indépendamment de la restitution du prix du poisson et du paiement des dommages-intérêts causés.
Il est cependant permis à toute personne de pêcher à la ligne flottante, tenue à la main, dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, et dans les canaux, boires et fossés appartenant à l'État.
Le droit de pêche ne peut toutefois être exercé par ceux auxquels la loi l'attribue, soit dans les [I-309] fleuves et rivières navigables ou flottables, soit dans les rivières non navigables, que sous les conditions déterminées par les lois, ou par les règlemens faits en vertu de leurs dispositions [138].
Ainsi, d'après les nombreuses dispositions qui précèdent, et dans l'état actuel de notre législation, le propriétaire qui a, dans son fonds, une source, peut en disposer comme d'une chose qui lui appartient, s'il ne l'a point aliénée; mais il ne peut ni en détourner le cours naturel, si elle fournit aux habitans d'une commune, village ou hameau, l'eau nécessaire à leur usage, ni en transmettre les eaux à ses voisins d'une manière nuisible [139].
Celui dont une rivière non navigable traverse les propriétés, a le droit exclusif d'y pêcher, depuis le point où elle commence à passer à travers son héritage, jusqu'au point où elle en sort. Il a le droit d'y former des prises d'eau, pour l'irrigation de ses biens; mais, à la sortie de sa propriété, l'eau doit être rendue à son cours naturel. Il peut y établir des usines, telles que des moulins ou des fabriques, pourvu qu'en faisant usage de la force du courant, il ne cause aucun dommage ni aux propriétaires inférieurs ni aux propriétaires supérieurs. Il profite des alluvions qui se forment sur les rives, et des îles placées entre les deux bords.
[I-310]
Celui dont l'héritage borde seulement une rivière non navigable, peut exercer, sur la moitié qui se trouve située de son côté, les droits qu'il pourrait exercer sur la totalité, s'il était propriétaire des deux rives, sous la même condition de ne causer à autrui aucun dommage.
Les conditions sous lesquelles ces avantages sont accordés aux propriétaires riverains, sont de contribuer au curage du lit de la rivière, dans la proportion de leur intérêt; de ne pas transmettre les eaux aux propriétaires inférieurs d'une manière dommageable, et surtout de ne pas inonder les héritages voisins; de se conformer aux lois établies pour la police de la pêche; enfin, d'observer les règlemens locaux.
De ce que les propriétaires riverains ne peuvent pas transmettre d'une manière nuisible les eaux qui bordent ou traversent leurs propriétés, et de ce qu'ils sont tenus de contribuer au curage, il s'ensuit qu'il leur est interdit de placer ou de déposer dans le lit de la rivière rien de ce qui pourrait en gêner ou en entraver le cours, ni en salir les eaux, de manière à les rendre malfaisantes ou incommodes.
La loi du 27 septembre 1791, concernant les biens et usages ruraux, ayant déclaré que les propriétaires de moulins et usines construits ou à construire, seraient obligés de tenir les eaux à une [I-311] hauteur qui ne nuirait à personne, et qui serait fixée par le directoire du département, d'après l'avis du directoire du district, on a tiré de cette disposition la conséquence que nul ne pourrait établir, même sur une rivière non navigable, un moulin ou toute autre usine, avant que l'autorité administrative n'eût fixé la hauteur à laquelle les eaux devraient être tenues; l'administration a reçu, par cela même, le pouvoir de s'opposer à l'établissement de toute usine nouvelle.
Les droits particuliers accordés sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, aux propriétaires riverains, consistent uniquement dans la faculté de profiter des terrains d'alluvion, et des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre. Le gouvernement peut sans doute autoriser des particuliers ou des communes à établir sur un fleuve ou sur une rivière navigable ou flottable, des moulins ou d'autres usines; mais les propriétaires riverains n'ont pas plus de droits à cet égard que les autres citoyens. Tous leurs avantages se réduisent à ceux qui résultent pour eux du voisinage de leurs propriétés de la rivière sur laquelle des usines peuvent être construites [140].
[I-312]
Il peut arriver que l'établissement d'une nouvelle usine rende dommageables les eaux d'une rivière ou d'un fleuve, pour les propriétés riveraines ou pour la navigation. Dans ce cas, les personnes lésées ont incontestablement le droit de demander que la cause du dommage soit enlevée; mais leur demande ne doit pas toujours être portée devant les mêmes juges. Elle est de la compétence des tribunaux ordinaires, si l'auteur du dommage a agi sans autorisation, ou s'il a violé les conditions que l'administration lui avait imposées. Elle est de la compétence de l'autorité administrative, s'il n'est pas sorti des limites tracées par l'acte d'autorisation.
Les propriétaires riverains n'ayant pas, sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, des droits plus étendus que ceux qui appartiennent aux autres citoyens, il s'ensuit qu'il leur est interdit d'y pêcher, d'y pratiquer des prises d'eau, d'y former aucun établissement, d'en retirer des sables, des pierres ou d'autres matières, d'y jeter des ordures ou immondices, ou de les amasser sur les quais ou sur le rivage; enfin, de tirer des terres, sables [I-313] et autres matériaux, à six toises (onze mètres sept décimètres) de distance du fleuve ou de la rivière.
Les lois sur les fleuves et rivières navigables ou non navigables, ont donné naissance à une multitude de questions, et parmi ces questions, celle qui s'est le plus fréquemment présentée a été de savoir quels seraient les juges du débaț. Par la loi du 22 décembre 1790, l'administration est chargée de veiller à la conservation des rivières; elle est chargée, par la loi du 27 septembre 1791, de fixer la hauteur des eaux des rivières sur lesquelles des usines sont établies, et de faire des règlemens pour l'entretien et le curage des rivières. Suivant la loi du 30 floréal an X (20 mai 1802), les conseils de préfecture sont chargés de prononcer sur les contestations qui s'élèvent au sujet de la perception des droits de navigation ; ils doivent, suivant la loi du 14 floréal an XI (4 mai 1803), prononcer sur toutes les contestations relatives au recouvrement des contributions établies pour le curage des rivières non navigables, aux réclamations des individus imposés, et enfin à la confection des travaux. D'un autre côté, les tribunaux, auxquels il est interdit de se mêler en rien des actes de l'administration, soit qu'il s'agisse d'en arrêter l'exécution, soit qu'il s'agisse de les interpréter, sont les garans naturels des propriétés privées; ils doivent donc prononcer sur les contestations qui s'élèvent entre [I-314] les propriétaires auxquels une rivière non navigable est utile ; et la loi les charge formellement de concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété. De ces diverses dispositions sont nées une foule de difficultés sur la compétence, qui ont embarrassé et qui embarrasseront encore tous les jours l'administration et les tribunaux; mais, comme elles se rapportent moins à la nature de la propriété qu'à la distribution des pouvoirs publics, ce n'est pas ici le lieu de s'en occuper [141].
Les lois romaines n'ayant jamais été reçues en Angleterre comme lois du pays, n'ont pu exercer, sur l'état social des Anglais, l'influence qu'elles ont exercée sur le nôtre. D'un autre côté, le système féodal ayant jeté chez ce peuple des racines plus profondes que celles qu'il a jetées parmi nous, et n'ayant pas été attaqué avec la même persévérance ou avec le même succès par les rois, ni aboli, comme chez nous, par une révolution populaire, les possesseurs de terres, entre les mains desquels le pouvoir a toujours résidé depuis la conquête des Normands, y jouissent, relativement aux fleuves et rivières, de prérogatives inconnues dans le droit romain et dans nos propres lois.
[I-315]
En Angleterre, la propriété territoriale est fondée sur le principe de la conquête, poussé jusqu'à ses dernières conséquences. On admet, en principe, que l'invasion du pays par les Normands, et les confiscations qui en furent la suite, rendirent le général conquérant maître absolu, non-seulement des biens qui composaient le domaine public, mais de toutes les terres du pays, sans exception. On admet que toutes les terres furent données par le chef de la conquête à ses lieutenans, qui les partagèrent entre les officiers et les soldats de l'armée, et qu'il n'y a, même aujourd'hui, de possession légitime, que celle qui remonte à l'invasion, et au partage qui en fut la suite. Tout propriétaire de terres a donc pour titre de propriété une concession royale prouvée par des actes, ou supposée; car la prescription n'est considérée que comme une concession tacite [142].
Les Anglais admettent, comme nous, une distinction entre les rivières navigables et les rivières [I-316] non navigables; mais, chez eux, une rivière n'est considérée comme navigable que jusqu'au point où montent les flots de la marée. Ainsi, quelles que soient la largeur et la profondeur d'une rivière, quelle que soit l'activité de la navigation à laquelle elle est employée, elle n'est pas légalement navigable au-delà du dernier point que la marée peut couvrir. La partie dite navigable, c'est-à-dire celle sur laquelle la marée s'étend, appartient au domaine public, et tout Anglais a le droit d'y pêcher, à moins que le privilége n'en ait été concédé par la couronne à un particulier. Toutes les autres parties sont dévolues aux propriétaires riverains; elles leur appartiennent en vertu de la concession que le roi est réputé leur en avoir faite, en concédant les terres riveraines, soit à eux-mêmes, soit à ceux qui leur ont transmis leurs droits. Le propriétaire des deux rives est maître de toute la partie de la rivière qui traverse sa terre; et il a seul le droit d'y pêcher, ou de s'en servir pour d'autres usages, sauf l'exception dont je parlerai tout à l'heure. Le propriétaire d'une des deux rives est maître de la moitié; l'autre moitié appartient au propriétaire de la rive opposée, ad filum medium aquæ. Le lit [I-317] de la rivière, et les îles qui s'y forment, appartiennent également aux propriétaires riverains.
Les rivières navigables, dans le sens de la loi, appartenant au public, chacun a le droit d'y pêcher et d'y naviguer; mais les propriétaires ne doivent pas à la navigation, comme parmi nous, un chemin de halage. Si ce chemin est dû dans quelques parties de l'Angleterre, il ne l'est qu'en vertu de coutumes ou de statuts locaux. D'anciens auteurs avaient prétendu que le chemin de halage était dû par toutes les propriétés qui bordent les rivières navigables, dans le sens légal du mot. En 1789, la question a été engagée, au sujet de la rivière d'Ouze, dans le comté de Norfolk, pour les parties de cette rivière dans lesquelles la marée monte; mais, après une discussion approfondie, il a été jugé que, d'après la loi commune, les propriétés riveraines ne doivent aucun chemin de halage. Il a été reconnu que, dans la pratique, ce chemin n'est pas accordé, puisque les navigateurs de la Tamise sont souvent obligés, dans certains lieux, de passer d'une rive à l'autre. Les statuts qui ont établi le droit de halage sur quelques parties des rives de la Sever, de la Trent et de la Tamise, ont eux-mêmes prouvé qu'il n'existe pas de droit général [143].
[I-318]
Les rivières qui sont navigables de fait, mais qui ne le sont pas dans le sens de la loi, parce que la marée n'y monte pas, appartiennent, ainsi qu'on vient de le voir, aux propriétaires des fonds riverains; elles sont considérées comme une partie de ces fonds. Mais le public a, sur ces rivières, un droit de passage pour la navigation; chacun peut donc y naviguer comme sur les rivières publiques. Cette servitude ne peut être agravée par ceux qui en font usage; c'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire qui diminue, pour les propriétaires riverains, l'utilité de la rivière, ou qui dégrade leurs héritages. De leur côté, les propriétaires riverains ne peuvent y rien faire qui rende la navigation plus dangereuse ou plus difficile, ou qui gêne l'usage de la servitude au préjudice du public. Ils sont obligés de les tenir en bon état, et par conséquent, de les curer quand elles en ont besoin; les paroisses doivent les contraindre à remplir ce devoir, quand ils le négligent [144].
Les Anglais qui abondonnèrent leur pays pour aller s'établir en Amérique, ne laissèrent en Angleterre, ni leurs idées, ni leurs préjugés, ni leurs habitudes. Ils les emportèrent avec eux, et quoique le temps et des institutions différentes en aient considérablement affaibli l'empire, on en trouve [I-319] encore des traces profondes dans les mœurs et les lois de leurs descendans. Le droit sur la propriété foncière, dit un jurisconsulte des États-Unis, forme un système technique très-artificiel; et quoiqu'il ait éprouvé l'influence de l'esprit libre et commercial de notre âge, il est encore sous l'autorité des principes dérivés du régime féodal. Nous n'avons jamais introduit, dans la jurisprudence de ce pays, tous les caractères essentiels de la loi des fiefs, ou, en perfectionnant nos lois particulières, nous les avons abolis; mais les profondes traces de la féodalité sont toujours visibles dans la doctrine de la propriété foncière, et les fictions, les termes techniques, et même plusieurs règles de ce système sont encore en vigueur [145].
Les Anglais ayant admis comme principe fondamental du droit féodal, que le roi est le propriétaire originaire de toutes les terres du royaume, et la source vraie et unique du droit de propriété, les Anglo-Américains ont adopté le même principe relativement à leurs gouvernemens républicains. Ils admettent, comme doctrine fondamentale, que tout titre ou tout droit individuel à une terre située dans l'étendue de leur territoire, dérive d'une concession faite ou par le gouvernement royal [I-320] avant la déclaration d'indépendance, ou par un État particulier, ou par le gouvernement fédéral depuis leur révolution. Ils ne reconnaîtraient pas la validité d'une concession faite par les indigènes à des particuliers, leur gouvernement s'étant réservé privilège d'obtenir des concessions de cette nature, dans la vue, ou d'empêcher les puissances étrangères de former des établissemens au centre de leur territoire, ou de mettre les Indiens à l'abri des fraudes que des particuliers pourraient pratiquer contre eux.
Le principe admis relativement à la propriété foncière, a fait admettre le même principe relativement aux rivières et aux fleuves. Suivant le droit commun des État-Unis, les rivières navigables sont donc les seules qui fassent partie du domaine public, et dans lesquelles tous les citoyens aient le droit de pêcher; mais on ne considère comme navigables, dans le sens de la loi, que les parties sur lesquelles le flux et reflux de la mer se font sentir. Quant aux autres, elles sont considérées comme appartenant aux propriétaires riverains, sous les conditions admises en Angleterre. Si le droit d'y naviguer existe en faveur du public, ce n'est qu'à titre de servitude; c'est un simple droit de passage, auquel les propriétaires riverains ne peuvent porter atteinte.
Il est cependant plusieurs États particuliers qui [I-321] n'ont pas admis ce principe, et qui considèrent quelques-unes de leurs rivières comme navigables et publiques, quoique le flux et reflux de la mer ne s'y fassent pas sentir. Dans la Pensylvanie et la Caroline du sud, par exemple, on a considéré la doctrine anglaise comme inadmissible au moins à l'égard des rivières dans lesquelles la navigation est réellement praticable. Dans d'autres états, le principe anglais a été modifié par des lois particulières [146].
On n'est pas étonné qu'une nation telle que l'Angleterre, chez laquelle le système féodal a jeté les plus profondes racines, et où les grands possesseurs de terres ont toujours été maîtres du pouvoir, considère comme propriétés privées les fleuves et les rivières. On a plus de peine à comprendre que des peuples aussi avancés dans la civilisation que ceux des États-Unis, aient adopté les mêmes principes. Cependant, quand on connaît l'origine de ces peuples, et l'influence qu'exercent sur l'homme des habitudes invétérées et le langage au moyen duquel il est obligé de représenter ses idées; quand on voit surtout combien la division territoriale des divers états dont se forme la fédération américaine, est éloignée de [I-322] la division naturelle, on n'est plus surpris de trouver au-delà de l'Atlantique les doctrines qui gouvernent encore la Grande-Bretagne.
Les doctrines admises en Angleterre et aux États-Unis d'Amérique, relativement aux fleuves et aux rivières, sont diamétralement opposées aux principes que j'ai établis dans le chapitre XII; mais, quelque puissante qu'ait été l'influence du système féodal en France, en Angleterre, dans les autres états de l'Europe, et même aux EtatsUnis d'Amérique, la nature des choses a été plus forte, dans tous les pays, ainsi qu'on le verra dans le chapitre suivant, que les usurpations et que les doctrines qui en sont nées.
[I-323]
CHAPITRE XVIII.
Des modifications que la nature des choses a fait subir aux lois relatives à la propriété et à la jouissance des cours d'eau.↩
EN observant comment se forment les divers genres de propriétés qui existent chez les peuples, nous avons vu que chaque nation a un territoire qui lui est propre, et dont on ne saurait la dépouiller sans la détruire; que ce territoire, tant qu'il reste inculte et commun à tous les hommes qui le possèdent, n'offre que de faibles ressources à une population peu nombreuse et misérable; qu'il n'acquiert une grande valeur qu'après avoir été divisé entre les individus ou les familles; que cette valeur est le produit médiat ou immédiat de l'industrie humaine; et qu'ainsi les fortunes privées, mobilières ou immobilières, sont généralement le résultat du travail de l'homme, secondé par la puissance de la nature [147].
[I-324]
Mais quoique le travail donne généralement aux choses la valeur qu'elles ont, en les rendant propres à satisfaire nos besoins, il en est plusieurs qui sont utiles à des populations entières, dont l'utilité est même inépuisable, et auxquelles cependant l'industrie humaine ne peut presque rien ajouter; de ce nombre sont les fleuves et les rivières, les ports de mer, les rades, les hâvres, et autres choses analogues que les Romains mettaient au rang des choses publiques, parce que chez eux chacun avait le droit d'en faire usage, en respectant, dans les autres, un droit pareil au sien.
Si, par la nature des choses, les rivières et les fleuves font partie du domaine public, ne peuvent-ils pas tomber dans le domaine privé, soit par suite d'une longue possession, soit par l'effet de lois ou de coutumes particulières? Les doctrines professées en France, relativement aux fleuves et rivières non navigables, et en Angleterre et aux États-Unis, relativement aux rivières dans lesquelles le flux et le reflux de la mer ne se font pas sentir, ne sont-elles pas une preuve que tous les cours d'eau, quelle qu'en soit la grandeur, peuvent être convertis en propriétés privées comme les fonds de terre?
En disant que, par la nature des choses, les rivières font partie du domaine public, je n'ai pas en [I-325] tendu affirmer que les peuples auxquels elles appartiennent, ne peuvent jamais être dépouillés, par la violence, de quelques-uns des avantages qu'elles produisent naturellement pour eux; je n'ai pas voulu dire, par exemple, que la navigation ne peut pas en être entravée par les propriétaires riverains, ou soumise à des tributs arbitraires; ou qu'une caste privilégiée ne peut pas convertir la pêche en monopole, comme la faculté de chasser ; j'ai voulu dire seulement que les cours d'eau qui traversent le territoire d'une nation, appartiennent en commun à tous les membres dont elle se compose; que le partage, s'il était possible, en détruirait en grande partie l'utilité, et qu'on ne peut en dépouiller la population qui la possède, sans commettre à son égard la plus dangereuse et la plus injuste des usurpations.
Dans les temps où le régime féodal était dans toute sa force, des usurpations de ce genre ont été consommées ou tentées dans presque tous les états de l'Europe; mais jamais elles n'ont été complètes, parce que la nature des choses ne permettait pas qu'elles le fussent. Cette nature des choses, contre laquelle on peut lutter quelque temps, mais qui finit tôt ou tard par triompher, a fait cesser presque entièrement ces usurpations dans tous les pays où elles avaient été consommées. Quelques peuples ont, il est vrai, conservé le [I-326] langage et quelques-unes des doctrines qui s'établirent au temps des usurpations de la féodalité; mais si, au lieu de s'arrêter aux mots, on observe ce qui se passe dans la pratique, on verra que, chez eux, les cours d'eau ne sont guère moins publics qu'ils ne l'étaient sous l'empire des lois romaines.
Les principaux avantages que produisent, pour une nation, les rivières qui sillonnent les parties inférieures des bassins qu'elle occupe, consistent, comme on l'a vu précédemment, à faire écouler les eaux qui tombent sur son territoire, à transporter, par la navigation, les objets de son commerce, à porter par des irrigations la fertilité dans ses terres, à mettre en mouvement des moulins ou d'autres usines, à servir de réservoir au poisson, et enfin à fournir à la population entière l'eau dont elle a besoin pour ses usages domestiques.
A aucune époque, les propriétaires des fonds qui bordent les rivières, n'ont eu la folie de prétendre qu'étant maîtres du sol, ils avaient le droit d'empêcher l'eau de couler, et d'inonder ainsi les terres situées au-dessus de leurs héritages. Si, dans le moyen âge, les seigneurs ont entravé le cours des rivières qui bordaient ou traversaient leurs propriétés, pour construire des moulins ou rendre la pêche plus facile, c'est moins en vertu de leur droit qu'en vertu de leur force; et leurs tentatives [I-327] ont été réprimées par l'autorité publique, toutes les fois qu'elle en a eu les moyens.
Les propriétaires riverains n'ont jamais joui du privilége exclusif de transporter leurs denrées ou leurs marchandises sur les fleuves ou les rivières qui bordaient ou traversaient leurs propriétés. On conçoit, en effet, que ce privilége aurait été d'un faible avantage pour chacun d'eux, si aucun n'avait eu le droit de naviguer au-delà des limites de ses propriétés. Les rivières ont donc toujours été considérées comme des routes sur lesquelles chacun avait le droit de transporter ses denrées ou les objets de son commerce. Dans les temps de l'anarchie féodale, les seigneurs, comme souverains, ont établi des péages sur les rivières comme sur les chemins; mais ces concussions ou ces extorsions ont également été réprimées aussitôt que les lois ont repris leur empire [148].
La faculté de faire servir à l'irrigation de ses propriétés une partie des eaux de la rivière qui les borde ou les traverse, existait sous les lois romaines [I-328] comme sous les lois nées du régime féodal. Cette faculté ne prouve donc pas que celui qui l'exerce, est propriétaire de la rivière qui borde son héritage, puisque les lois romaines considéraient toutes les rivières comme faisant partie du domaine public. Ces lois autorisaient également chaque propriétaire à construire des usines sur les cours d'eau qui bordaient ou traversaient son héritage, sous la condition de ne nuire ni à la navigation, ni à la propriété d'autrui. Cette faculté qu'avait un propriétaire riverain d'utiliser à son profit la force du courant, n'empêchait pas que les rivières ne fussent publiques.
Les terres d'alluvion, c'est-à-dire celles que le cours de l'eau ajoute d'une manière insensible aux fonds riverains, devenaient la propriété des personnes auxquelles ces fonds appartenaient, sous les lois romaines, comme au temps de la féodalité; mais ce n'était pas par la raison que ces personnes avaient la propriété de la rivière; c'était parce qu'elles seules pouvaient tirer quelque avantage de ces accroissemens. Comment l'État, ou même des particuliers autres que les propriétaires, auraient-ils pu prendre possession d'accroissemens insensibles, et les mettre en état de culture?
En France et en d'autres pays, les propriétaires dont les héritages bordent une rivière navigable, profitent non-seulement des terrains d'alluvion, [I-329] mais même de la partie du lit que l'eau laisse en se retirant vers l'autre rive. On ne peut pas cependant conclure de là qu'une rivière navigable est la propriété des personnes dont elle borde ou dont elle traverse les terres. La seule conséquence qu'on puisse en tirer, est que, lorsqu'une fraction du domaine public ne peut plus être d'aucune utilité pour la population à qui elle appartient, la loi l'adjuge à la personne à laquelle elle peut profiter. Il n'y a pas d'autres moyens de donner au terrain délaissé la plus grande valeur possible, et d'éviter en même temps toutes sortes de débats. Les droits éventuels que la loi donne à chaque propriétaire riverain sur quelques parties du lit d'un fleuve ou d'une rivière, ne sont donc pas une preuve qu'une partie de cette rivière lui appartient.
Pour attribuer aux propriétaires riverains la faculté exclusive de pêcher le long de leurs propriétés, quand elles ne sont pas séparées de la rivière par un chemin public, il n'est pas nécessaire de reconnaître, en principe, que la rivière est à eux; il suffit qu'on sente la nécessité de mettre toutes les propriétés à l'abri des déprédations. On conçoit, en effet, que, si toute personne, sous prétexte de pêche, pouvait librement parcourir tous les héritages qui bordent les rivières, il n'y aurait, pour les propriétaires, aucun moyen de faire respecter leurs propriétés. Les hommes qui font de la pêche ou de [I-330] la chasse un moyen d'existence pour eux et leurs familles, sont souvent exposés à manquer du nécessaire. Quand ils ne réussissent pas dans leurs excursions, et que la misère les presse, le sentiment qui prend sur eux le plus d'empire, n'est pas le respect du bien d'autrui. On a donc eu de très-bonnes raisons pour ne pas reconnaître à tout le monde indistinctement le droit de pêcher dans les rivières dont on ne peut parcourir les bords qu'à travers les propriétés privées. Il n'était pas possible d'admettre un principe contraire, sans établir sur tous les héritages qui bordent les rivières, une servitude qui en aurait en partie détruit la valeur.
Si l'on ne pouvait pas, sans les plus graves inconvéniens, accorder à chacun la faculté de parcourir les propriétés privées qui bordent les rivières, pour s'y livrer à la pêche, il fallait, ou l'interdire à tout le monde, ou ne la permettre qu'aux propriétaires riverains, dans l'étendue de leurs propriétés. En prenant ce dernier parti, on a fait, pour le poisson que les rivières alimentent, ce qu'on a fait pour les terrains d'alluvion; on a donné la faculté de se l'approprier à ceux qui peuvent user de cette faculté avec le moins d'inconvéniens et le plus d'avantages, Ce droit étant exclusivement exercé par les propriétaires, et ne s'étendant pas au-delà de leurs propriétés, ne peut ni [I-331] donner lieu à aucun débat, ni servir de prétexte au maraudage. On verra bientôt d'ailleurs qu'il ne leur a pas été gratuitement accordé.
Dans les pays où les terres sont très divisées, les propriétaires n'ont pas assez de loisir, et ils sont d'ailleurs resserrés dans un espace trop étroit, pour se livrer à la pêche avec fruit. Ne pouvant en retirer aucun avantage par eux-mêmes, ils laissent souvent la faculté de s'y livrer à ceux qui veulent en profiter; elle devient alors, par le fait, aussi libre qu'elle le serait si elle était permise à tout le monde. Les lois qui la soumettent à certaines règles, afin que les rivières ne soient pas dépeuplées, cessent d'être exécutées, parce que nul n'étant plus intéressé que les autres à leur exécution, personne ne veut prendre sur soi l'odieux d'une poursuite. Chaque propriétaire n'étant mu que par un faible intérêt, n'a pas assez de puissance pour lutter contre ceux qui veulent faire de la pêche un métier. Lorsqu'un tel désordre existe, et que l'administration n'est pas assez éclairée ou assez bien organisée pour y porter remède, il serait de l'intérêt de tous que la pêche fût affermée au profit des communes. Les propriétaires n'en tiraient pas moins de profit; leurs propriétés seraient moins exposées, et il serait moins difficile de faire observer les lois dont l'objet est de prévenir ou de réprimer la dépopulation des rivières.
[I-332]
Mais quelles que soient les mesures qu'on adopte pour la garantie des propriétés riveraines, et pour la conservation du poisson, ces mesures ne prouvent pas que les rivières non navigables appartiennent aux propriétaires riverains; l'avantage particulier qu'une personne, à cause de sa position, retire d'une chose publique, ne fait pas tomber cette chose dans le domaine privé; s'il en était autrement, il faudrait dire que les propriétaires auxquels profitent les terres d'alluvion, laissées par les fleuves les plus considérables, sont les maîtres de ces fleuves.
Enfin, dans aucun temps, ni dans aucun pays, on n'a reconnu aux propriétaires riverains le droit d'empêcher les autres personnes d'aller puiser de l'eau dans les rivières navigables ou non navigables. L'eau courante, considérée en elle-même, est une chose tellement publique de sa nature, que, pour avoir le droit d'en faire usage, il suffit d'avoir un chemin pour y arriver.
En France, les lois romaines et les ordonnances de Philippe V, de Philippe VI et de Charles V, avaient considéré toutes les rivières indistinctement comme publiques. Louis XIV, par ménagement pour les usurpations commises sous le régime féodal, n'osa classer parmi les choses qui appartenaient à l'État, que les rivières qui étaient navigables ou flottables de leur propre fonds, et sans que [I-333] la main de l'homme y eût contribué; il garda le silence sur toutes les autres. La loi du 22 décembre 1790, et l'instruction de l'assemblée nationale du 12 août suivant, mirent de nouveau toutes les rivières, sans distinction, au rang des choses publiques. La loi du 22 novembre de la même année, qui donna la définition du domaine public, et l'article 538 du Code civil, qui a reproduit cette définition, n'ont mis nominativement parmi les choses qui dépendent du domaine public, que les rivières navigables ou flottables. Une distinction, née du régime féodal, a donc été introduite dans les lois au moyen desquelles on avait voulu détruire jusqu'aux derniers vestiges de ce détestable régime.
Cependant, la nature des choses l'a emporté sur une mauvaise classification. Aucune loi, à l'exception de celle du 22 décembre 1790, ne déclare d'une manière générale, que toutes les rivières sont des dépendances du domaine public; mais un grand nombre de dispositions législatives, les traitent comme si elles en faisaient, en effet, partie; et aucune loi ne porte qu'elles appartiennent, soit aux propriétaires des fonds riverains, soit aux communes.
Un propriétaire riverain, loin de pouvoir disposer, de la manière la plus absolue, de la rivière qui borde ou traverse son héritage, ne peut en [I-334] détourner l'eau, pour son usage, qu'à la charge de la rendre à son cours ordinaire; il ne peut y rien jeter qui la rende nuisible pour les propriétaires inférieurs, ou qui soit propre à détruire le poisson; il ne peut en ralentir ni en accélérer le cours, de manière à nuire aux héritages supérieurs ou inférieurs; il ne peut y établir aucune usine, sans en avoir obtenu la permission de l'autorité publique, qui prend soin de déterminer la hauteur à laquelle l'eau devra être tenue; enfin, il peut y prendre du poisson, mais ce n'est qu'à la charge de se conformer aux règles générales établies pour la police de la pêche; ces avantages ne lui sont assurés que sous la condition de contribuer au curage de la rivière, dans la proportion de l'intérêt qu'il a à ce qu'elle soit tenue en bon état.
Suivant l'article 545 du Code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Cette disposition, extraite des constitutions diverses qui ont régi la France depuis 1791, se retrouve, en d'autres termes, dans les articles 8 et 9 de la Charte. Le premier dispose que toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune diffé– rence entre elles. Le second ajoute que l'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause [I-335] d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.
Si toutes les rivières sont des dépendances du domaine public, et si les droits qu'exercent, sur celles qui ne sont pas navigables, les propriétaires riverains, n'existent que par tolérance et comme dédommagement des charges qui leur sont imposées, il s'en suivra que ces droits pourront être supprimés, sans autre indemnité que la suppression des charges qui les accompagnent. Si, au contraire, les rivières navigables ou flottables sont seules des dépendances du domaine public, et si toutes les autres appartiennent aux propriétaires riverains, il s'en suivra que ces propriétaires ne pourront être dépouillés des droits qu'ils y exercent, que pour cause d'intérêt public légalement constaté, et après une juste et préalable indemnité. Il faudra, pour rendre une rivière navigable ou flottable, et la faire passer du domaine privé dans le domaine public, suivre toutes les formes prescrites par la loi du 7 juillet 1855, pour les expropriations pour cause d'utilité publique.
Mais est-ce là ce qui se passe dans la pratique? Quand le gouvernement rend navigable une rivière qui ne l'était pas, la loi l'oblige-t-elle à payer aux propriétaires riverains une indemnité pour chacun des droits dont ils sont dépouillés? l'oblige-t-elle à les indemniser pour le droit d'établir [I-336] des usines et de former des prises d'eau, droits qui leur sont formellement enlevés? En aucune manière: les prérogatives dont ils jouissaient, sont abolies au profit de l'État, qui les décharge de l'obligation de contribuer au curage, et qui en prend la charge sur lui-même. Il y a plus; quand l'État autorise un propriétaire riverain à établir une usine sur une rivière non navigable, c'est toujours avec la clause qu'elle pourra être supprimée sans indemnité, si, par la suite, cette rivière était rendue navigable. Cette clause, qu'on insère également dans toute autorisation d'établir une usine sur une rivière navigable, si l'intérêt du service public venait à en exiger la suppression, n'est-elle pas une preuve que les rivières non navigables appartiennent au domaine public comme les autres?
Les propriétaires riverains d'une rivière non navigable que l'État rend propre à la navigation, n'ont droit à une indemnité que pour le chemin de halage qu'ils sont tenus de fournir, ou pour des cas où elle leur est formellement accordée. Cette indemnité est juste, parce qu'on impose à leurs propriétés une servitude qu'ils ne doivent pas naturellement, la rivière n'étant pas naturellement navigable, et qu'ils éprouvent une perte à laquelle ils ne devaient pas s'attendre en acquérant ces mêmes héritages. Il est même à remarquer [I-337] que, dans le calcul de cette indemnité, on fait entrer la plus-value que les propriétaires riverains peuvent acquérir par la navigation. Quant au droit de faire des prises d'eau, et à celui d'établir des usines, ils s'éteignent sans indemnité, et personne ne se plaint d'usurpation; preuve certaine que ceux qui en jouissent ne sont pas considérés et ne se considèrent pas eux-mêmes comme propriétaires de la rivière sur laquelle ces droits sont exercés. L'État ne pourrait pas ainsi s'emparer, sans indemnité, d'un étang qui appartiendrait à un particulier ou à une commune [149].
Quelques jurisconsultes prétendent cependant que, suivant nos lois, toutes les rivières non navigables ou flottables appartiennent aux propriétaires dont elles bordent ou traversent les héritages. Un d'eux trouve cette attribution de propriété bien [I-338] légitime, et fondée sur la nature des choses. « Le lit d'un cours d'eau, dit-il, étant un démembrement primitif du domaine que ce cours d'eau traverse, il doit être considéré comme en faisant toujours partie [150]. » Ce raisonnement serait concluant, si l'auteur s'était donné la peine de prouver que le partage de la terre en domaines privés a précédé l'existence des rivières; mais tant qu'il n'aura pas constaté ce fait historique, son argument aura peu de force [151].
Un autre écrivain [152] cite à l'appui de la même thèse l'article 640 du Code civil, qui déclare que les fonds inférieurs sont assujétis, envers les fonds plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme Y ait contribué; et l'article 644 qui autorise les propriétaires [I-339] à se servir de l'eau courante qui borde ou traverse leurs héritages.
Les fonds inférieurs sont assujétis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en dé coulent naturellement, non par les dispositions du Code civil, mais par la nature des choses. Les rivières, pour se rendre à la mer, n'ont pas attendu la permission des auteurs du Code civil. L'article 640 de ce Code énonce un fait que les jurisconsultes romains avaient depuis long-temps proclamé, et qui existait avant eux. La reconnaissance de ce fait par les lois romaines n'empêchait pas que les rivières ne fussent publiques. C'est, au contraire, parce que ce fait résulte de la nature des choses, et qu'il est antérieur à toute appropriation individuelle de fonds de terre, que les rivières sont publiques; quand elles ont commencé de couler, elles n'ont envahi les champs de personne.
La faculté que le Code civil accorde aux propriétaires riverains de faire usage des cours d'eau qui borden ou traversent leurs héritages, quand ces cours d'eau ne sont ni navigables, ni flottables, ne prouve pas davantage qu'ils en aient la propriété. Cette faculté, comme on l'a déjà vu, leur était accordée par les lois romaines pour les rivières navigables comme pour celles qui ne l'étaient pas; et cependant les unes et les autres [I-340] étaient publiques. La manière dont le Code. civil dispose à l'égard des rivières non navigables, loin de prouver qu'elles appartiennent aux propriétaires riverains, prouverait plutôt le contraire. Chacun peut faire de la chose qui lui appartient tout ce que les lois ou les bonnes mœurs n'ont pas interdit; mais on ne peut user d'une rivière que dans la mesure permise par la loi. Dans le premier cas, la puissance législative donne des limites au pouvoir qu'a chacun de disposer des choses qui sont à lui; elle ne concède. pas le droit; elle le reconnaît et en détermine les bornes. Dans le second, au contraire, elle accorde l'usage d'une chose publique, et tout ce qu'elle n'accorde pas est refusé. Là elle défend, ici elle permet. Quand il s'agit d'enlever à un citoyen, dans l'intérêt général, une propriété que l'autorité publique lui avait garantie, mais qu'elle ne lui avait pas donnée, il faut qu'il soit préalablement indemnisé. Quand il ne s'agit que de retirer une concession gratuite et essentiellement conditionnelle, il suffit de faire la remise des charges sous lesquelles elle avait été faite. Or, c'est là ce qui arrive lorsqu'une rivière, dont les riverains sont autorisés à faire usage, est rendue navigable.
Le Conseil-d'Etat, en décidant, par son avis du 30 pluviôse an 13 (19 février 1805), que la pêche des rivières non navigables appartenait aux [I-341] propriétaires riverains, et non aux communes, s'est fondé, parmi plusieurs autres motifs, sur ce que la pêche de ces rivières faisait partie des droits féodaux, et sur ce que ces droits avaient été abolis, non au profit des communes, mais au profit des vassaux. On pourrait conclure de là que les rivières non navigables sont tombées dans le domaine des propriétaires riverains, par le seul effet de l'abolition du régime féodal; mais cette conséquence serait une erreur.
Les usurpations féodales ont été supprimées au profit de ceux que les seigneurs avaient dépouillés. Un grand nombre avaient été commises au préjudice des particuliers, plusieurs au préjudice des communes, d'autres au préjudice de l'Etat. L'abolition de la féodalité a rendu à chacun ce qui lui appartenait : l'Etat, les communes, les particuliers, sont donc rentrés dans leurs droits. Les rivières étaient publiques avant le régime féodal ; elles le sont devenues de nouveau et de plein droit, quand ce régime a été aboli. La loi du 22 décembre 1790, en les classant parmi les choses publiques, a reconnu ce qui existait déjà. L'avis du Conseil-d'Etat ne se prononce d'ailleurs que sur le droit de pêche; et il déclare que ce droit cesse d'exister au profit des propriétaires riverains du moment que la rivière est rendue navigable.
Les Anglais, qui n'ont pas encore secoué le joug [I-342] des doctrines nées du régime féodal, n'admettent pas que ce soit le travail ou une longue et paisible possession, qui ont donné naissance à la propriété territoriale; chez eux, il n'y a de propriété légitime que celle qui repose sur une concession royale. Le monarque étant considéré comme seul propriétaire primitif et légitime du territoire entier, a pu concéder les rivières et les fleuves, comme les terres à travers lesquelles ils coulent. Il est donc naturel que les grands propriétaires d'Angleterre, qui tiennent, en effet, leurs vastes domaines de la munificence de la couronne, aient fait prévaloir la théorie qu'ils sont les maîtres des fleuves ou des rivières qui bordent ou traversent leurs héritages.
Mais les faits sont-ils restés asservis à la théorie? Les populations qui occupent les bassins de ces rivières ou de ces fleuves, ont-elles été dépouillées des avantages qu'elles pouvaient en retirer? Un propriétaire anglais peut-il disposer de la rivière ou du fleuve qui borde ou traverse son héritage, comme du fonds qu'il laisse en pâturage ou livre à la culture, selon que cela convient à ses intérêts? Peut-il y jeter des objets qui le dégradent? peut-il y construire des usines, quels que soient les inconvéniens qui en résultent pour les voisins ou pour la navigation? peut-il empêcher que le public en fasse usage pour le transport de ses denrées ou de ses marchandises, comme il empêche qu'on ne [I-343] passe à travers sa ferme ou son parc? pourrait-il enfin y établir des péages comme au temps du régime féodal?
Les propriétaires riverains ont si peu le droit de jeter dans les rivières qui traversent ou bordent leurs héritages, des matières propres à en embarrasser le cours, qu'ils sont tenus, au contraire, de les curer toutes les fois qu'elles en ont besoin. Ils ne peuvent y faire aucun ouvrage capable de nuire aux propriétés supérieures ou inférieures, ou de gêner la navigation. Enfin, ils ne peuvent empêcher personne de s'en servir gratuitement comme moyen de transport. Celui qui s'aviserait d'empêcher la navigation ou d'établir un péage sur une rivière qui traverse ses domaines, serait promptement et sévèrement réprimé. Les droits exclusifs dont jouit un propriétaire riverain sur les rivières qui bordent ou traversent ses terres, consistent dans celui d'y prendre du poisson, et dans celui d'en employer l'eau à son profit, sous condition de ne pas nuire à la navigation, et de ne causer à autrui aucun dommage. Les droits du public sont donc supérieurs aux siens; ils sont aussi plus étendus; car chez une nation riche et commerçante, la liberté de la navigation a plus d'importance que la pêche des rivières. Il faut même remarquer que le curage de celles qui sont navigables de fait, mais qui ne le sont pas dans le sens légal, c'est-à-dire [I-344] par le flux et le reflux de la mer, est à la charge des propriétaires qui profitent de la pêche, et non à la charge du public, auquel profite la navigation.
Les juristes, qui sont, en général, en Angleterre, les défenseurs des doctrines féodales, ont trouvé un moyen de mettre ces doctrines d'accord avec les faits que la force des choses et la puissance de la civilisation ont amenés. Les rivières, disent-ils , appartiennent aux personnes dont elles traversent ou limitent les terres; ces personnes peuvent en disposer comme bon leur semble, pourvu qu'elles ne causent aucun dommage à autrui. Mais cette propriété est soumise à une servitude envers le public, servitude qui consiste à fournir un passage à la navigation, et à l'entretenir avec soin.
La question, réduite à ces termes, n'a presque plus d'importance, parce qu'en elle-même, et abstraction faite des souvenirs qu'elle éveille, elle n'est qu'une dispute de mots. Du moment, en effet, qu'il est reconnu que tous les citoyens peuvent légitimement jouir de tous les avantages que peuvent avoir pour eux les rivières et les fleuves qui traversent le territoire national; et que, de leur côté, les propriétaires riverains n'ont pas d'autres prérogatives que celles qui ne peuvent être utilement exercées que par eux, la question de savoir par quels noms les droits des uns et des autres seront [I-345] désignés, est le dernier terme de la vieille lutte de l'usurpation contre le droit. Dans les pays qui sont encore placés sous l'influence des mœurs et des idées féodales, il est naturel que les propriétaires de terres désignent les droits qu'ils exercent sur les cours d'eau, sous le nom de propriété, et qu'ils considérent les droits du public comme une servitude que leur propriété supporte. Dans les pays, au contraire, qui n'ont pas admis ou qui ont rejeté le langage et les doctrines du régime féodal, les rivières et les fleuves doivent être considérés comme propriétés publiques, et les droits des propriétaires de terres, comme l'usage d'une faculté dont l'exercice doit être permis tant qu'il est innocent, mais qui doit cesser dès que l'intérêt public l'exige.
Les jurisconsultes anglais et ceux des États-Unis ne considérent, disons-nous, comme publics les fleuves et les rivières, que du point où ils se déchargent dans la mer, jusqu'à celui où le flux cesse de se faire sentir; toute la partie située au-dessus du point auquel arrive la marée, est considérée comme appartenant aux propriétaires des héritages riverains. La première partie est dite navigable, la seconde est dite non navigable, quoique, de fait, elle serve à la navigation; les droits publics sur celle-ci ne sont considérés que comme une servitude établie sur des héritages privés.
[I-346]
Mais cette charge, à laquelle sont assujetties les rivières dites non navigables, ne réunit pas les conditions essentielles qui, suivant le droit romain et suivant nos propres lois, caractérisent les servitudes. Si elle est imposée sur un fonds, elle ne l'est pas dans l'intérêt ou pour le service d'un autre fonds; le passage n'est pas dû seulement à ceux qui possèdent des terres sur les bords de la rivière ou dans l'étendue du bassin qui la renferme; il est dû à tout le monde indistinctement; le batelier qui n'a, pour toute fortune, que ses bras, ses rames et son bateau, peut s'en servir comme le lord qui possède la moitié d'une province. Suivant les principes des servitudes, l'entretien du passage est à la charge de ceux à qui il est dû; le propriétaire de l'héritage servant n'a que des obligations passives. Ici, c'est tout le contraire; ce n'est pas le public auquel le passage profite, qui se charge de l'entretien; ce sont les propriétaires par lesquels il est dû; de sorte qu'on peut dire que s'ils ont les honneurs de la propriété, c'est le public qui en a les avantages. Tout cela n'empêche pas qu'en lui-même le principe ne soit faux et vicieux : il y a toujours quelque danger, en législation, à donner aux choses un nom qui n'est pas celui qui leur convient.
La différence la plus frappante qui existe entre les lois anglaises et les lois françaises, c'est que [I-347] celles-là n'exigent pas, comme celles-ci, que les propriétaires riverains fournissent à la navigation un chemin pour le halage. On est d'autant plus étonné de cette différence, que le commerce et la navigation sont plus honorés, et ont infiniment plus d'activité dans la Grande-Bretagne que parmi nous. On est tenté d'abord de l'attribuer à l'immense influence qu'exercent, dans ce pays, les grands propriétaires de terres, et peut-être cette cause n'y est-elle pas tout-à-fait étrangère. Il en est cependant quelques autres qui expliquent la différence qui nous frappe [153].
[I-348]
Les rivières ne sont considérées comme publiques qu'à partir du point où elles se déchargent dans l'Océan, jusqu'au point auquel s'élève le flux de la mer. Dans cet espace, un chemin de halage n'est pas absolument nécessaire, parce que les navires et les bateaux montent ou descendent avec la marée. Les côtes de l'Angleterre étant, en général, peu élevées, et ayant de nombreuses et profondes. découpures, la mer porte les navires presque au centre du territoire. D'un autre côté, le pays n'ayant pas une grande étendue, et étant coupé par des montagnes, les rivières n'ont que peu d'espace à parcourir avant que d'arriver au point auquel le flux amène les navires; la plupart ne peuvent être utiles à la navigation qu'en alimentant les canaux. Les plus considérables ne sont devenus navigables au-dessus du point couvert par le flux, qu'au moyen des travaux qu'on y a exécutés; si alors on a eu besoin d'un chemin de halage, on a dû en payer la valeur aux propriétaires riverains, comme on la paierait parmi nous, en pareilles circonstances. L'état physique du pays suffit donc pour expliquer les différens que nous remarquons entre les lois anglaises et les nôtres.
Mais des dispositions bonnes pour les rivières d'une île peu étendue, comme l'Angleterre, ne pouvaient convenir aux rivières d'un vaste continent, comme l'Amérique. En admettant, en [I-349] principe, qu'une rivière cesse d'être publique au point auquel s'arrête le flux de la mer, le gouvernement des États-Unis s'est gratuitement créé des embarras pour l'avenir. Si, dès son origine, il avait admis le principe des lois romaines et des lois françaises, et réservé un chemin de halage sur toutes les rivières de quelque importance, cette réserve, faite dans un temps où les terres étaient presque sans valeur, aurait diminué de peu de chose les recettes du trésor public. Si, plus tard, il faut prendre ce chemin sur des terres cultivées, couvertes d'une population nombreuse, on ne pourra se dispenser d'accorder aux propriétaires riverains une indemnité proportionnée à la valeur des terrines qu'on leur enlevera. Alors on verra qu'il est plus facile de rester fidèle aux principes qui résultent de la nature des choses que d'y revenir lorsqu'on s'en est une fois écarté.
Il est, entre les lois françaises et les lois anglaises, une autre différence qu'il importe de remarquer. Celles-ci reconnaissent à toute personne le droit de pêcher dans la partie des rivières qu'elles déclarent publique. Celles-là veulent que la pêche des cours d'eau, qui sont des dépendances du domaine public, soit affermée au profit de l'État. La disposition des lois françaises est plus conforme aux principes d'une bonne administration, que la disposition des lois anglaises. Toutes les fois qu'une chose [I-350] apppartenant au public, peut donner un revenu, et que la perception ne cause aucun dommage, il est juste que le public en profite. Il faut ajouter que la pêche est plus facilement soumise à une bonne police, quand elle est affermée, que lorsque tout le monde peut également s'y livrer.
Ayant reconnu que, par la nature des choses, toutes les rivières font partie du domaine public, que leur conservation importe à la population entière, et que celles qui existent dans chaque bassin, forment un système complet qu'on ne peut pas fractionner sans danger, il s'ensuit qu'elles ne peuvent être soumises à un bon régime qu'autant qu'il y a unité dans les lois et dans l'administration, comme dans les choses qui doivent être administrées; cette unité est cependant loin d'exister, soit en France, soit chez les autres nations.
On trouve, dans la volumineuse collection de nos lois, une multitude de dispositions éparses, faites sous différens régimes, sur les fleuves et les rivières ; mais ces dispositions, qui ne s'accordent pas toujours entre elles, ne présentent aucun ensemble, et ne sauraient produire aucun grand résultat, parce qu'elles n'ont point de tendance commune.
Les administrations sont chargées de veiller à la conservation des rivières, et d'empêcher qu'on n'y fasse des entreprises qui seraient dommageables [I-351] pour des particuliers ou pour ou pour le public; mais comme la division politique du territoire n'a aucun rapport avec sa division naturelle, il est bien difficile que cette obligation, soit exactement remplie. Les travaux qui sont exécutés dans quelques parties d'un grand bassin, n'ont souvent que des effets éloignés, soit pour le temps, soit pour la distance; ceux qui les exécutent, et ceux qui en souffrent, sont rarement placés sous la même autorité. Un maire peut s'occuper de ce qui se passe dans sa commune, un préfet dans son département; mais ni l'un ni l'autre ne s'avisera de s'occuper de ce qui se fait dans des communes ou des départemens qui ne sont pas soumis à sa juridiction.
La loi du 30 floréal an x (20 mai 1802), qui créa un droit de navigation dans l'intérêt des cours d'eau sur lesquels il serait perçu, et l'arrêté du 8 prairial de l'année suivante, qui divisa la navigation intérieure de la France en bassins, dont les limites étaient déterminées par les monts ou coteaux qui versent leurs eaux dans le fleuve principal, semblaient annoncer qu'on avait enfin adopté de grandes vues d'ensemble; mais ces mesures n'eurent presque pas d'autres résultats de faire entrer un peu plus que d'argent dans les caisses du fisc.
Les ingénieurs placés dans les arrondissemens de navigation, n'avaient pas à porter leurs regards sur ce qui se passait au-delà du lit des rivières soumises [I-352] à leur juridiction; ils ne devaient pas même s'occuper de celles qui n'étaient pas navigables; enfin, leurs attributions se bornaient à donner des avis à des fonctionnaires qui n'avaient aucun inté– rêt à les mettre à exécution; et en France pas plus qu'ailleurs, il n'est pas commun de trouver des hommes qui mettent leur gloire à faire exécuter ce que d'autres ont conçu.
Les arrondissemens administratifs étant d'ailleurs différens des arrondissemens de navigation, un ingénieur, pour faire adopter ses plans, aurait eu à convaincre plusieurs préfets et plusieurs conseils, souvent opposés de vues et d'intérêts; il n'en aurait pas fallu davantage pour faire échouer les meilleurs desseins, si de semblables desseins avaient, en effet, existé, et si les circonstances politiques avaient permis de les suivre avec persévérance.
[I-353]
CHAPITRE XIX.
De la propriété et de l'usage des rivages de la mer.↩
LES jurisconsultes romains avaient établi, relativement à la mer et à ses rivages, des principes analogues à ceux qu'ils avaient adoptés relativement aux rivières et aux terres qui en formaient les bords. Ils admettaient que toutes les rivières étaient publiques, et que chacun avait le droit d'en faire usage pour la pêche et la navigation de là ils tiraient la conséquence, que chacun pouvait faire usage des bords pour charger ou décharger ses bateaux, ou pour les attacher aux arbres qui s'y trouvaient placés. En admettant que l'usage des rives était public comme les rivières elles-mêmes, ils reconnaissaient que la propriété de ces mêmes rives appartenait aux propriétaires des héritages riverains.
Ils reconnaissaient de même que, par la nature des choses, les mers appartenaient à toutes les nations, et que toute personne avait le droit d'y naviguer et de s'y livrer à la pêche [154]. Ils concluaient [I-354] de ce principe, que les rivages étaient également communs à tous les hommes, et que chacun pouvait en user pour les services de la navigation et de la pêche [155]. En reconnaissant que l'usage en était commun à tout le monde, ils revendiquaient cependant pour leur nation la propriété de ceux qui étaient soumis à sa domination [156].
Les fleuves et rivières appartenant à tous les membres de l'État, tout.citoyen avait le droit d'y former les établissemens qu'il jugeait convenables, sous la condition de ne gêner en rien la navigation, et de ne causer aucun dommage aux propriétés d'autrui. De même, la mer étant commune à toutes les nations, tout homme pouvait former, dans les eaux ou sur les rivages, les constructions ou les établissemens qu'il jugeait utiles à ses intérêts [157]; mais c'était aussi sous la condition qu'il ne porterait aucune entrave au droit qui [I-355] appartenait à tous d'y naviguer et d'y pêcher [158]. La propriété d'une construction n'emportait même pas la propriété du sol; car, l'établissement formé venant à disparaître, la place sur laquelle il était situé, retombait de plein droit au rang des choses dont l'usage était commun [159].
Les rivages qui faisaient partie de l'empire, étant considérés comme la propriété du peuple romain, quoique l'usage en fût commun à tous les hommes pour la pêche et la navigation, ceux qui voulaient y faire des constructions, devaient en obtenir l'autorisation du préteur [160]. Le défaut d'autorisation ne suffisait pas cependant pour faire détruire des ouvrages qui ne nuisaient ni à la navigation, ni à la pêche, et qui ne causaient à autrui aucun dommage [161]. L'autorisation ne paraît pas avoir eu [I-356] d'autre objet que de constater le droit de souveraineté du peuple romain sur les côtes qui faisaient partie de leur territoire.
Tout citoyen avait le droit de traduire en justice celui qui avait formé, sur une rivière ou sur un fleuve, une entreprise qui nuisait à la pêche ou à la navigation, ou qui lui causait tout autre dommage; de même, toute personne avait une action contre celui qui exécutait, dans la mer ou sur le rivage, des travaux au moyen desquels il portait atteinte au droit commun à tous d'y passer, d'y naviguer ou d'y pêcher [162].
Les Romains, en établissant des règles sur la jouissance des rivages de la mer, n'avaient eu généralement en vue que les côtes de la Méditerranée. Leur domination, sur quelques-unes des côtes de l'Océan, n'avait commencé que fort tard, et comme les peuplades qui habitaient sur ces côtes, sortaient à peine de l'état sauvage, on avait peu à s'occuper des établissemens qui se formaient parmi elles. La navigation d'ailleurs n'était pas assez avancée pour que les navigateurs osassent s'aventurer à travers l'Océan pour venir faire le commerce sur les côtes soumises à l'empire, et possédées par des peuplades à demi barbares. Aussi, [I-357] pour déterminer ce qui forme, à proprement parler, le rivage de la mer, les jurisconsultes romains n'ont-ils pris en considération que la Méditerranée, qui n'a point de marée. Suivant les Institutes de Justinien, le rivage de la mer s'entend, en effet, de la terre que couvre le plus grand flot d'hiver [163]; tandis que, sur les côtes de l'Océan, nous entendons par rivage tout ce que la mer couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars (époque des plus grandes marées) se peut étendre sur les grêves [164].
Les peuples modernes ont adopté l'opinion du jurisconsulte Celsus, qui pensait que le rivage soumis à l'empire d'une nation, est la propriété de cette même nation; mais ils n'admettent pas que les hommes de tous les pays aient le droit d'en faire usage pour les besoins de la navigation et de la pêche ; ils considèrent cette partie de leur territoire comme une dépendance du domaine public, dont l'usage est réglé, non par les principes du droit international, mais par leurs lois particulières. En France, le gouvernement a considéré les rivages de la mer comme faisant partie du domaine public, long-temps avant que d'en avoir fait une [I-358] déclaration expresse. L'ordonnance de la marine de 1681, ainsi qu'on l'a vu, répute bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les gréves. Elle fait défense à toutes personnes d'y bâtir, d'y planter aucun pieu, ni faire aucun ouvrage qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire [165].
Mais quoique les rivages de la mer fassent partie du domaine public comme les fleuves, la pêche n'en est pas affermée au profit de l'État. L'ordonnance de 1681 déclare, au contraire, la pêche de la mer libre et commune à tous les nationaux, auxquels elle permet de la faire tant en pleine mer que sur les grêves, en se conformant aux règles qu'elle prescrit [166]. Ces règles ne sont ni fort nombreuses ni bien gênantes: pour ceux qui veulent aller en pleine mer, à la pêche des morues, des harengs et des maquereaux, elles consistent à prendre, pour chaque voyage, un congé de l'amiral; [I-359] et, pour ceux qui veulent pêcher sur les grêves, dans les baies et aux embouchures des rivières navigables, à donner aux mailles de leurs filets, les dimensions déterminées par l'ordonnance. Il est, en outre, interdit aux pêcheurs de construire des parcs dans lesquels il entrerait du bois ou de la pierre, sous peine de démolition, et de rien entreprendre qui puisse faire obstacle à la navigation [167]. La même ordonnance défend à tous gouverneurs, officiers et soldats des îles et forts, villes et châteaux construits sur le rivage de la mer, d'apporter aucun obstacle à la pêche dans le voisinage de leurs places, et de rien exiger des pêcheurs pour la leur permettre, sous peine de destitution contre les officiers, et de punition corporelle contre les soldats [168].
L'herbe qui croît sur le rivage de la mer, et qu'on désigne sous les noms de varech, vraicq, sar ou gouesmon, n'est pas cueillie au profit de l'État, quoiqu'elle pousse sur une partie du domaine public. L'ordonnance de 1681 l'attribue aux habitans des paroisses dont le territoire s'étend jusqu'au rivage de la mer; elle veut que ces habitans s'assemblent le premier dimanche du [I-360] mois de janvier de chaque année, pour régler les jours auxquels devra commencer et finir la coupe. Elle leur interdit d'en faire la coupe pendant la nuit, et hors de l'époque déterminée, et de la vendre aux forains, ou de la transporter sur d'autres territoires. Quant à l'herbe que le flot jette sur les grêves, il est permis à toutes personnes de la prendre en tout temps et en tous lieux, et de la transporter où bon leur semble [169].
L'ordonnance de la marine de 1681 attribue donc exclusivement aux nationaux la faculté de pêcher sur les rivages de la mer, qui font partie du territoire de la France, et de s'approprier les herbes qui y croissent; elle leur garantit de plus la faculté d'introduire leurs vaisseaux dans les rades, et cette garantie est étendue à tous les alliés du peuple français. Voulons, dit cette ordonnance, que les rades soient libres à tous vaisseaux de nos sujets et alliés, dans l'étendue de notre domination. Faisons défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles puissent être, de leur apporter aucun trouble et empêchement, à peine de punition corporelle [170]. Les fleuves étant publics par la nature des [I-361] choses, les lois qui en ont réglé l'usage ont, en général, obligé les propriétaires des fonds riverains à fournir un passage pour les besoins de la pêche et de la navigation. Les rivages de la mer sont également publics, et tout Français a le droit de s'y livrer, soit à la navigation, soit à la pêche; mais l'ordonnance qui reconnaît ce droit, n'oblige pas formellement les propriétaires des héritages riverains à fournir un passage aux navigateurs ou aux pêcheurs. Cependant, comme le rivage, sur la Méditerranée, consiste uniquement dans la partie du territoire couverte par les eaux de la mer dans le plus grand flot de l'hiver, et comme, sur l'Océan, il ne consiste que dans ce que la mer couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le plus grand flot de mars se peut étendre sur les grêves, il s'ensuit que, sur l'une et l'autre mer, il y a toujours, dans l'année, une époque où le rivage est entièrement sous les eaux, et qu'il n'est pas possible d'y parvenir par terre, à moins de passer sur les héritages voisins.
Cette nécessité a déterminé quelques jurisconsultes à penser que les propriétés situées sur le rivage de la mer sont assujéties, par la nature des choses, à une servitude analogue à celle qui existe şur tous les héritages situés le long des fleuves ou rivières navigables. Si cette servitude n'existait [I-362] pas, souvent il ne serait pas possible d'exercer le droit de pêche qui appartient à tous, d'enlever l'herbe de la mer que les flots jettent sur le rivage, et de pourvoir à la sûreté des navigateurs. Il serait également impossible aux agens du trésor public d'empêcher la contrebande, puisque les contrebandiers, pour introduire frauduleusement leurs marchandises, saisiraient toujours le moment où les flots arrivent jusqu'aux propriétés privées. Aussi, sur les côtes de Normandie, un long usage a-t-il établi que les propriétés qui bordent la mer doivent un passage à tous ceux qui, pour quelque motif que ce soit, veulent en parcourir le rivage. Les lois romaines supposaient l'existence d'un chemin le long du rivage de la mer, et défendaient d'y rien faire qui pût en gêner l'usage. Elles reconnaissaient, en outre, à toute personne le droit d'arriver jusqu'à la mer pour y pêcher [171].
La loi du 22 novembre 1790, qui a determiné les biens dont le domaine national se compose, [I-363] déclare que les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les hâvres et les rades, sont considérés comme des dépendances du domaine public. Le Code civil a reproduit cette disposition (art. 538), sans y apporter aucune modification; mais il n'a pas dit en quoi consistent les rivages de la mer; il n'a pas déterminé non plus les droits que les particuliers pourraient y exercer. Il faut donc s'en rapporter à cet égard aux dispositions des lois antérieures, c'est-à-dire aux lois romaines, aux coutumes et à l'ordonnance de 1681, qui régissaient la France [172].
Si l'on s'en rapportait à la définition que les lois romaines et l'ordonnance de 1681 donnaient du rivage de la mer, on croirait qu'il finit, du côté de la mer, au point où le sol cesse d'être découvert pendant les plus basses eaux, et qu'au-delà les hommes de toutes les nations peuvent librement se livrer à la navigation et à la pêche. Il n'en est cependant pas ainsi : tous les peuples maritimes considèrent comme faisant partie de leur territoire national une certaine étendue des mers qui baignent leurs côtes. L'intérêt de leur défense, de leur industrie et de leur commerce, et la nécessité [I-364] d'assurer la perception des revenus du fisc, leur ont fait une loi de porter leur domination exclusive bien au-delà de ce qui ne forme, à proprement parler, que les rivages. L'étendue de cette partie de la mer, que chaque nation considère comme sa propriété, ne saurait être déterminée d'une manière bien précise, puisqu'il n'est pas possible de placer des limites sur la mer, Il importerait cependant qu'elle fût bien connue, afin que les magistrats de chaque pays pussent savoir quelle est la distance à laquelle s'étend leur juridiction, et que, de leur côté, les navigateurs ne fussent pas exposés à violer involontairement les règles que les nations établissent dans la partie des mers qu'elles considèrent comme une dépendance de leur territoire.
Quelques écrivains ont prétendu que la domination exclusive de chaque peuple sur les mers qui baignent son territoire, devait s'étendre aussi loin que la vue; mais de nombreuses objections ont été faites contre ce système. Où se placera-t-on pour fixer le point auquel la vue peut arriver? Se mettra-t-on sur le rivage au niveau de la mer, ou s'élevera-t-on sur une montagne? Regardera-t-on à l'œil nu ou à travers un télescope? Choisira-t-on l'individu qui a la vue la plus longue, ou prendra-t-on un terme moyen? Suffira-t-il d'apercevoir le haut du mất d'un vaisseau de guerre, ou faudra-t-il voir un bâton flottant? L'objection la plus grave [I-365] qu'on peut faire contre un tel système, c'est qu'il n'est fondé sur aucune bonne raison. On ne voit pas, en effet, pourquoi l'on prendrait pour règle la portée de la vue plutôt que la portée du son. Si l'une varie comme les vents, l'autre varie comme les nuages.
Un savant jurisconsulte a cherché à faire reposer sur une base plus solide la domination que chaque peuple entend exercer sur les eaux qui baignent son territoire. Si la mer n'est pas susceptible d'être appropriée par occupation, comme la terre, cela tient principalement, suivant lui, à ce qu'on ne peut pas s'établir sur des places déterminées, d'une manière fixe et durable. Il est, en effet, impossible d'établir une résidence permanente sur des points d'où l'on peut à tout moment être chassé par un coup de vent ou par la violence des vagues. Il ne serait presque pas plus facile à une peuplade de s'établir au milieu de l'Océan, et de s'en attribuer une partie, pour en tirer ses moyens d'existence, que de s'établir dans les airs, et de vivre au moyen des oiseaux qu'elle prendrait au passage. L'occupation exige donc une prise de possession de fait, et un établissement durable; elle ne saurait conférer aucun droit, si elle ne réunit pas ces conditions[173].
[I-366]
Mais aussi toutes les fois qu'une chose susceptible de produire des subsistances ou d'assurer d'autres avantages à un peuple, peut être réellement et exclusivement occupée, elle devient la propriété de la population qui la soumet à son empire d'une manière permanente, quelle qu'en soit d'ailleurs la nature. Une rivière n'est pas moins susceptible d'occupation qu'un pâturage ou qu'une terre propre à la culture; un port de mer est pour une nation une propriété qui n'est pas moins incontestable que les terres dont il est environné.
Ainsi, pour déterminer jusqu'à quel point s'étend sur la mer le domaine des peuples qui en possèdent les bords, il faut savoir quelle est la partie sur laquelle ils peuvent établir leur empire d'une manière permanente et exclusive. Or, cette partie est déterminée par la portée de leurs armes; tout ce qui peut être protégé par l'artillerie de terre, doit donc être considéré comme appartenant à la nation maîtresse du rivage. La mer ne commence à être une chose commune à toutes les nations qu'au point où finit la domination des peuples qui en possèdent les bords [174].
[I-367]
A cette considération on en a joint une autre. Si certaines choses sont communes à toutes les nations, cela tient particulièrement à ce que chacune peut en faire usage, sans diminuer en rien la jouissance des autres. L'utilité qui s'y trouve étant inépuisable, il n'y a aucun motif pour que quelques-unes s'en attribuent la disposition exclusive ce serait faire un mal dont il ne résulterait aucun bien. Mais les avantages qu'une nation retire de la mer, près des côtes, et qui consistent dans les produits de la pêche du poisson, des coquillages, des perles, de l'ambre, sont loin d'être inépuisables ; ils peuvent au contraire être aisément épuisés.
De cette circonstance et de la nécessité dans laquelle une nation se trouve de veiller à sa sûreté, Vattel conclut que la domination d'un État sur la mer qui baigne une partie de son territoire, va aussi loin qu'il est nécessaire pour sa sûreté, et qu'il peut la faire respecter; d'un côté, dit-il, il ne peut s'approprier une chose commune, telle que la mer, qu'autant qu'il en a besoin pour quelque fin légitime; et, d'un autre côté, ce serait une prétention vaine et ridicule de s'attribuer un droit que l'on ne serait nullement en état de faire valoir [175].
[I-368]
La question de savoir jusqu'où s'étend la domination d'un peuple, sur la mer qui baigne ses côtes, ne peut pas, dans tous les cas, être résolue par les mêmes principes. S'il s'agit de faits de police intérieure, on ne peut consulter que les lois et les usages du pays: on est obligé de se régler d'après les principes du droit civil. S'il s'agit, au contraire, de faits de politique extérieure, ce sont les principes ou les usages du droit international auxquels il faut s'en rapporter.
Pour décider, par exemple, si tel fait est ou n'est pas punissable suivant les lois françaises, il faut savoir s'il a eu lieu sous leur empire, ou s'il a été exécuté dans un lieu où elles n'étaient pas obligatoires; de même, pour décider si tel ou tel magistrat est compétent pour connaître de tel fait, ou pour faire exécuter tel acte, il faut savoir quelle est, suivant la loi française, l'étendue de la juridiction de l'un ou de l'autre.
Mais s'il s'agissait de décider si des navigateurs ont le droit de stationner ou de pêcher sur tel ou tel point de la mer, la question ne pourrait plus être résolue que par les traités entre les nations, ou par les principes qui règlent leurs rapports mutuels.
[I-369]
Les magistrats de tous les peuples maritimes peuvent être appelés, soit à juger des faits qui se sont passés sur la mer et près des côtes, soit à y faire exécuter certains actes; on n'a pas cependant cru convenable de fixer, par des lois, les points jusques aux quels s'étendrait leur juridiction; il semble que chez toutes les nations, le vague et l'élasticité de l'arbitraire ont paru plus sûrs que la précision et l'inflexibilité de la loi [176].
Mais quoique les lois soient muettes sur la partie de la mer que chaque peuple considère comme une dépendance de ses côtes, il est certain, en fait, qu'il y en a toujours, chez toutes les nations, une certaine étendue qui appartient au domaine public, comme les rivages; les sauvages eux-mêmes se considèrent comme les maîtres des eaux qui leur fournissent des moyens d'existence, et sans lesquelles ils ne sauraient se conserver.
Les Anglais se sont quelquefois attribué l'empire de la mer qui environne leur territoire, jusque sur les côtes opposées. Suivant Selden, la plupart des nations maritimes de l'Europe admirent cette [I-370] prétention sous le règne d'Edouard Ier [177], et la république des Provinces-Unies l'admit, au moins quant aux honneurs du pavillon, par le traité de Breda, de 1607; mais jamais la France n'y a souscrit.
On conçoit, au reste, que l'étendue de mer qu'une nation s'attribue relativement aux autres nations, ne saurait être invariable, et qu'elle dépend de la puissance relative de chaque peuple, et des dangers qu'on veut écarter. La France avait jadis porté cette étendue, dans la Méditerranée, à dix lieues des côtes, pour toutes les puissances barbaresques : les pirates de ces nations ne se seraient pas permis de faire des prises en deçà de cette limite. Cette appropriation d'une partie de la mer était au moins aussi profitable aux petits états qui ne pouvaient pas faire respecter leur pavillon, qu'à la nation française elle-même [178].
De ce que les eaux qui baignent le territoire d'un peuple, sont considérées comme sa propriété, il ne faut pas conclure qu'il n'est pas permis aux [I-371] autres peuples d'y naviguer. Si l'ordonnance de la marine de 1681 autorise les nations amies à naviguer librement dans les rades françaises aussi loin que s'étend la domination de la France, il ne saurait leur être interdit de passer sur les eaux qui sont soumises à son empire. Les seules conséquences qu'on puisse raisonnablement tirer de cette appropriation d'une partie de la mer, c'est que les navires qui s'y trouvent, sont soumis aux lois et à la police de la nation qui se l'est appropriée, et qu'ils y jouissent par cela même de sa protection. S'ils y étaient attaqués, le peuple sous l'empire duquel ils sont placés, ne pourrait voir, dans cette agression, qu'une violation de son territoire; son devoir serait de la réprimer, et de faire respecter son indépendance.
Les eaux qui environnent le territoire d'un peuple, en tout ou en partie, sont pour lui comme une route destinée à mettre en communication les diverses fractions entre lesquelles il se divise; elles rendent ou peuvent rendre, sur la circonférence du territoire, des services analogues à ceux que rendent à l'intérieur les fleuves et les canaux; elles sont, en outre, un moyen de surveiller les ennemis, d'empêcher toute surprise de leur part, et de prévenir ou réprimer la contrebande; comme sous ces divers rapports, toutes les nations maritimes ont des intérêts semblables, il importe [I-372] également à toutes d'adopter et de faire respecter les mêmes principes [179].
Mais, comme il est de l'intérêt d'un peuple d'ouvrir son territoire à tous les hommes qui se soumettent à ses lois, et qui, sans lui causer aucun dommage, viennent alimenter son commerce, il est également de son intérêt de laisser naviguer dans ses eaux tous ceux qui reconnaissent les règles qu'il a établies, et qui ne menacent ni sa sûreté, ni les lois destinées à protéger son industrie, ou à garantir la perception de certains impôts.
[I-373]
CHAPITRE XX.
De la propriété, de l'usage et de l'entretien des chemins publics.↩
EN considérant dans son ensemble la population formée dans un grand bassin, on voit qu'elle se partage en une multitude de groupes plus ou moins nombreux, plus ou moins éloignés les uns des autres, selon que la terre qui les nourrit, est plus ou moins fertile, et que l'agriculture et les arts sont plus ou moins avancés. Ces groupes, unis par un langage commun et par des besoins réciproques, ne peuvent exister qu'au moyen d'un déplacement continuel de choses et de personnes.
L'agriculture, les manufactures, le commerce, sans lesquels aucune nation civilisée ne saurait subsister, exigent, en effet, que les hommes qui s'y livrent, et la plupart des choses qui en sont l'objet, passent ou soient sans cesse transportés d'un lieu à un autre. La famille qui vit dans le hameau le plus obscur a besoin d'être journellement en communication, non-seulement avec les champs, les vignes ou les prés d'où elle tire ses moyens d'existence, mais encore avec les habitans [I-374] du voisinage et avec les populations urbaines qui consomment une partie de ses denrées, et qui lui fournissent, en échange, une multitude d'objets dont elle ne saurait se passer, et qu'elle est incapable de produire.
Les habitans des villes, de leur côté, ne peuvent exister que par de nombreuses communications, soit avec les campagnes qui les environnent, soit avec d'autres villes ; ils en ont besoin pour se procurer des subsistances, et les matières premières de leur industrie; ils en ont besoin, en outre, pour livrer au commerce les objets qu'ils ont fabriqués, ou pour acquérir ceux qu'il leur est plus avantageux d'acheter que de produire.
La part que les citoyens prennent au gouvernement, et l'action que le gouvernement a souvent à exercer sur eux ou sur leurs biens, nécessitent encore des communications nombreuses entre les diverses fractions dont une nation se compose : les personnes répandues dans les campagnes ont besoin de communiquer entre elles, si elles ont des magistrats ou des délégués à élire; elles ont besoin de communiquer avec les officiers publics, pour invoquer leur appui quand leurs droits sont menacés ou compromis; avec les préposés du trésor public, pour acquitter leurs contributions [180].
[I-375]
Le gouvernement, de son côté, ne peut remplir les devoirs qui lui sont imposés, qu'autant qu'il peut atteindre les personnes et les choses soumises à son empire; il faut que son action se fasse sentir sur chacune des parties du territoire soit pour protéger les citoyens dans l'exercice de leurs droits, soit pour exiger de chacun d'eux l'accomplissement de ses devoirs, soit pour comprimer les atteintes qui seraient portées à l'ordre public; il faut, enfin, que, dans le cas où une armée étrangère menacerait le pays, il puisse faire mouvoir aisément de grandes forces et transporter [I-376] des moyens de défense, dans le moindre temps possible, sur tous les points menacés.
De là la nécessité de consacrer une partie du territoire national à des chemins qui donnent à toutes les parties de la population le moyen de communiquer les uns avec les autres. Ces communications existent chez tous les peuples, quoique partout elles ne soient pas portées au même degré de perfection. Les sauvages eux-mêmes, quand ils ne peuvent passé transporter d'un lieu dans un autre au moyen d'une rivière, pratiquent des sentiers à travers les forêts. A mesure que l'agriculture, les arts, le commerce et le gouvernement font des progrès, les chemins se multiplient et se perfectionnent. Quand une nation est arrivée à un certain degré de civilisation, les routes qui coupent, en tout sens son territoire, sont comme un vaste réseau dont les fils principaux partent d'un centre commun dans lequel réside le gouvernement, et vont aboutir aux extrémités, en passant par les villes les plus populeuses. Les fils secondaires se rattachent à ceux-là, et se subdivisent de manière qu'il n'existe pas une seule habitation, quelque reculée et quelque petite qu'elle soit, qui ne se lie au système général par un chemin public.
Les routes qui mettent en communication les diverses fractions entre lesquelles une nation se partage, donnent naissance à trois questions [I-377] principales, qui sont tout-à-fait indépendantes les unes des autres : la première est de savoir si elles font partie du domaine public, ou si elles appartiennent aux communes ou à d'autres parties de la société ; la seconde, de quelle manière il convient qu'elles soient construites, pour être, le plus possible, favorables aux communications, en occasionnant les moindres dépenses; la troisième est de savoir quels sont les moyens les plus sûrs et les moins dispendieux de pourvoir à leur conservation et à leur entretien.
La seconde de ces questions est une question d'art bien plus qu'une question de législation: c'est, en effet, aux ingénieurs plus qu'aux publicistes et aux jurisconsultes, qu'il appartient de savoir comment il convient de construire une route pour qu'elle soit, le plus possible, courte, facile, durable et d'un entretien peu dispendieux; c'est à ceux qui sont appelés à en faire un fréquent usage, qu'il appartient de déterminer quelles doivent en être la direction et la largeur. Il me suffit d'observer ici. que la meilleure est toujours celle qui, avec le moins de dépenses, exige pour tous les transports le moins de temps et le moins de forces, et que les difficultés qu'il s'agit de surmonter sont, pour les chemins privés, de même nature que pour les chemins publics.
La question de savoir à qui appartiennent les [I-378] chemins destinés à mettre en communication les diverses fractions dont une nation se compose, paraît peu difficile à résoudre, quand on ne consulte que la nature des choses. Si on l'examine, en effet, relativement à des peuples étrangers, il est clair que les chemins font partie du territoire national sur lequel ils sont placés, comme les fleuves et les rivières. Si on l'examine relativement aux habitans même du pays, et dans les rapports. qu'ils ont les uns avec les autres, il ne paraît pas moins évident que ces chemins sont au nombre des choses dont l'usage est commun à tous, mais dont la propriété n'est spécialement dévolue à personne. Ils sont, comme l'eau des rivières, destinés à satisfaire les besoins de chacun, et nul, par conséquent, ne peut en faire un usage qui serait contraire au droit de tous [181].
Les jurisconsultes romains avaient divisé les chemins en trois classes. Ils avaient mis dans la première ceux qu'ils désignaient sous le nom de prétoriens ou de consulaires. Dans la seconde, ils avaient mis ceux qui conduisaient dans les villages [I-379] ou hameaux, et que nous appelons vicinaux : « Vicinales sunt viæ quæ in vicis sunt vel quæ in vicos ducunt. » Enfin, les troisièmes étaient de deux espèces: ceux qui étaient établis sur un fonds particulier pour le service d'un autre fonds, et ceux qui partaient d'un chemin consulaire, et conduisaient dans les champs. Les chemins prétoriens ou consulaires, et ceux qui étaient ou qui conduisaient dans les villages ou hameaux, étaient publics. Ces trois espèces pouvaient donc être réduites à deux : l'une renfermant les chemins publics, l'autre les chemins privés [182].
Sous le régime féodal, les chemins éprouvèrent le même sort que les rivières et les fleuves. Les rois se prétendirent maîtres des plus considérables, de ceux que les Romains désignaient sous le nom de consulaires; les seigneurs se prétendirent propriétaires de tous ceux qui conduisaient dans des villages ou des bourgs. Les rois ni les seigneurs n'empêchaient pas, il est vrai, les particuliers d'en faire usage pour le commerce ou pour la culture de leurs champs, parce qu'ils ne le pouvaient pas, sans rendre le territoire inculte et sans détruire la population; mais ils en usèrent en souverains. Ils établirent des péages sur les points que le commerce ne pouvait éviter, ou 'bordèrent [I-380] les routes de plantations dont ils disposèrent ensuite en propriétaires.
L'abolition du régime féodal, prononcée en 1789, aurait dû suffire pour faire classer parmi les choses qui appartiennent au domaine public, tous les chemins destinés à mettre les diverses fractions dont la population était composée, en communication les unes avec les autres; mais, comme les lois qui avaient supprimé la féodalité ne s'étaient pas expliquées à cet égard, la loi du 10 juillet 1790 leva les doutes qu'elles pouvaient avoir laissé subsister.
Cette loi déclara que nul ne pourrait dorénavant prétendre aucun droit de propriété ni de voirie sur les chemins publics, rues et places des villages, bourgs ou villes. Le droit de planter des arbres ou de s'approprier les arbres crûs sur les chemins publics, rues ét places des villages, dans les lieux où il était attribué aux seigneurs, fut aboli. Les seigneurs furent néanmoins maintenus dans la propriété des arbres existans au moment de la promulgation de la loi, à l'exception de ceux qui avaient été plantés par des particuliers, et dont l'expropriation n'avait pas été légalement prononcée. Les propriétaires riverains furent autorisés à racheter les arbres plantés vis-à-vis de leurs propriétés, sur les rues ou chemins publics. Les communautés d'habitans furent autorisées, de leur [I-381] côté, à racheter les arbres existans sur les places publiques des villes, bourgs ou villages.
La loi du 16 juillet 1790, en déclarant que nul ne pourrait dorénavant prétendre aucun droit de propriété ni de voirie sur les chemins publics des villages, bourgs ou villes, n'avait pas dit si ces chemins feraient partie du domaine de l'État, ou s'ils appartiendraient aux communes. Le premier article du décret du 1er décembre suivant, mit tous les chemins publics parmi les choses qui appartenaient à la nation; il déclara que les chemins publics, les rues et places des villes, et, en général, toutes les portions du territoire national qui n'étaient pas susceptibles d'une propriété privée, étaient considérées comme une dépendance du domaine public [183].
[I-382]
Les droits que la loi du 6 juillet 1790 avait réservés aux seigneurs sur les arbres plantés avant sa promulgation, sur les bords des chemins vicinaux et sur les rues des villes, bourgs et villages, leur furent enlevés, sans. indemnité, par les articles 14 et 15 de la loi du 28 août 1792. Le premier de ces deux articles déclara que tous les arbres existans actuellement sur les chemins publics, autres que les grandes routes nationales, et sur les rues des villes, bourgs et villages, étaient censés appartenir aux propriétaires riverains, à moins que les communes ne justifiassent en avoir acquis la propriété par titre ou possession. Le second ajouta que les arbres alors existans sur les places des villes, bourgs et villages, ou dans des marais, prés ou autres biens dont les communautés avaient ou recouvreraient la propriété, étaient censés appartenir à ces mêmes communautés, sans préjudice des droits que des particuliers, non seigneurs, pouvaient y avoir acquis par titre ou possession. Quant aux arbres plantés sur les grandes routes nationales, l'article 18 de la même loi déclara que nul ne pourrait se les approprier et les abattre, jusqu'à ce qu'il eût été prononcé à cet égard par la puissance législative. Les propriétaires riverains furent autorisés néanmoins à en percevoir les fruits, et à s'approprier les bois morts et les émondages, à charge d'entretenir lesdits arbres, et de remplacer les morts.
[I-383]
Les chemins publics étaient jadis entretenus au moyen de la corvée. Deux déclarations, rendues en 1786 et 1787, supprimèrent cette imposition, et la remplacèrent par une prestation en argent. La loi du 6 décembre 1793 ordonna que tous les grands chemins, ponts et levées, seraient faits et entretenus par le Trésor, et que les chemins vicinaux continueraient d'être aux frais des administrés. Cette obligation du Trésor ayant été très-mal remplie, une loi du 24 fructidor an v (10 septembre 1797), déclara qu'il serait perçu sur toutes les grandes routes de la république une taxe, dont le produit serait spécialement et uniquement affecté aux dépenses de leur entretien, réparation et confection, ainsi qu'à celles de leur administration. La loi de finances du 9 vendémiaire suivant (30 septembre 1797) détermina le mode de perception de cet impôt, et les voitures et animaux qui y seraient assujétis [184]. Les fonds perçus dans l'étendue d'un département devaient être versés dans la caisse du receveur-général, et exclusivement employés à l'entretien et à l'administration de ses grandes routes. En cas d'insuffisance de l'impôt perçu dans un département pour acquitter les dépenses de ses routes, il devait y être pourvu par [I-384] des reprises sur les départemens qui avaient obtenu des produits supérieurs à leurs besoins.
Cette loi avait uniquement pour objet de pourvoir à l'entretien, à la réparation et à l'administration des grands chemins; elle ne les faisait pas sortir du domaine public, pour en attribuer la propriété, soit aux départemens, soit aux communes. La loi du 25 janvier 1804, qui forme le titre Ier du livre second du Code civil, en déterminant les biens dont le domaine public serait composé, parut en exclure les chemins, routes et rues qui ne seraient pas à la charge de l'État. Le projet de loi portait que les chemins publics, les rues et places publiques, étaient considérés comme domaine public. M. Regnault (de Saint-Jean-d'Angely) prétendit que cette rédaction était vicieuse, en ce qu'elle comprenait dans le domaine de l'État tous les chemins publics, les rues et places publiques. Il fit observer que les lois distinguaient entre les grandes routes et les chemins vicinaux, et que, suivant la jurisprudence du Conseil-d'État, ceux-ci étaient la propriété des communes et entretenus par elles. M. Tronchet répondit qu'il y avait des chemins qui, sans être grandes routes, appartenaient à l'État ; mais M. Regnault (de Saint-Jean-d'Angely) répliqua qu'il était facile de distinguer les chemins qui appartenaient à la nation : ce sont dit-il, ceux qu'elle entretient. Cette opinion triompha [I-385] dans le conseil; et, en conséquence, l'art. 558 du Code civil considéra comme dépendances du domaine public, les chemins, routes et rues, à la charge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée.
Cette disposition fut promulguée en 1804, une époque où tous les grands chemins étaient entretenus et administrés au moyen de droits de passe perçus sur ces mêmes chemins. Ces droits furent supprimés par la loi du 24 avril 1806, qui les remplaça par un impôt sur le sel, et qui déclara que le produit de cet impôt aurait la destination de celui qui était supprimé. Le produit de la contribution établie par la présente loi, disait l'article 59, est exclusivement affecté à l'entretien des routes et aux travaux des ponts et chaussées. Les chemins vicinaux furent donc les seuls qui ne furent pas entretenus et administrés aux frais du Trésor public.
Aussitôt que l'impôt sur le sel, qui devait pourvoir aux dépenses des grandes routes et de l'administration des ponts et chaussées, eût été bien établi, on rejeta sur la population presque toutes les dépenses auxquelles il devait pourvoir. Un décret du 16 décembre 1811 divisa les routes de [I-386] France en routes impériales et en routes départementales; les premières furent subdivisées en trois classes. Cette division et cette subdivision n'avaient qu'un objet, c'était d'affranchir le Trésor des charges que lui avait imposées la loi de 1806, en établissant un impôt sur le sel. L'article 6 du décret déclara, en effet, que les frais de construction, de reconstruction et d'entretien des routes de troisième classe, seraient supportés concurremment par le Trésor et par les départemens qu'elles traverseraient. L'article 7 ajouta que la construction, la reconstruction et l'entretien des routes départementales, demeureraient à la charge des départemens, arrondissemens et communes, qui seraient reconnus participer plus particulièrement à leur usage. Il est presque inutile d'ajouter qu'on eut soin de faire entrer dans la troisième classe, et parmi les routes départementales, celles qui, prises en masse, exigeaient les plus fortes dépenses [185].
Lorsque les membres du Conseil-d'État discutaient l'article du Code civil, qui devait donner la définition du domaine public, on ne divisait les chemins qu'en trois espèces, comme sous les [I-387] lois romaines : les grands chemins, les chemins vicinaux, et les chemins privés, dont je n'ai pas à m'occuper dans ce moment. Les premiers étant tous entretenus aux frais du trésor public, les conseillers d'état voyaient peu d'inconvéniens à déclarer que les chemins, routes et rues à la charge de l'État, seraient considérés comme des dépendances du domaine public, et à mettre ou à laisser les chemins vicinaux au rang des propriétés communales. S'ils avaient prévu que bientôt un décret mettrait à la charge des départemens ou des communes la plupart des grandes routes, ils auraient été certainement frappés de la fausseté de la définition qui leur était proposée, et qu'ils adoptèrent avec tant de facilité.
[I-388]
CHAPITRE XXI.
Suite du précédent. De la propriété des chemins publics, et des droits qui en résultent.↩
La question de la propriété des chemins publics est plus grave que ne paraissaient l'avoir cru les jurisconsultes qui s'en sont occupés.
A leurs yeux, elle tire toute son importance des difficultés qui peuvent se présenter quand une route est supprimée, et qu'il s'agit de disposer du terrain dont elle était formée. La question de savoir s'il faut adjuger ce terrain à la commune, au département ou à l'État, dépend, suivant eux, de. celle de savoir si le chemin supprimé appartenait à l'État, au département ou à la commune.
Si la question était réduite à ces termes, elle se présenterait rarement dans la pratique, et n'aurait qu'un faible intérêt; mais elle a une portée beaucoup plus haute. Le pouvoir le plus étendu qu'un homme puisse exercer sur une chose qui lui appartient, est, suivant les lois de tous les peuples civilisés, le pouvoir d'un propriétaire sur sa propriété ce pouvoir est même d'autant plus [I-389] respecté, que la civilisation est plus avancée. Si donc on admettait que les communes et les départemens sont propriétaires des chemins à l'entretien desquels ils doivent pourvoir, il faudrait, ou leur reconnaître une puissance et une indépendance destructives de l'unité nationale, ou donner au mot propriété un sens contraire à celui qu'il a toujours eu. On ne saurait admettre, en effet, que les communes et les départemens sont propriétaires des chemins qu'ils sont chargés d'entretenir, sans reconnaître que chaque commune et chaque département sont souverains sur leur territoire, et sans briser les principaux liens qui unissent entre elles toutes les parties dont une nation se compose.
La faculté de veiller à l'entretien d'une chose, ou de la laisser périr en empêchant que d'autres ne l'entretiennent, peut être considérée comme un signe de propriété, quand le libre exercice de cette faculté est garanti par l'autorité publique. On ne peut pas en dire autant de l'obligation de contribuer à certaines dépenses, pour tenir en bon état une chose qui, par sa nature, est destinée à un usage public. Une charge n'est pas un droit; elle n'est pas toujours et nécessairement une marque de propriété.
Dans l'état actuel de notre législation, les communes sont obligées de pourvoir à l'entretien des chemins vicinaux; les départemens doivent pourvoir [I-390] à l'entretien des routes départementales, et contribuer à celui des routes de troisième classe. Mais que peut-on conclure de là? S'ensuit-il que chaque commune et chaque département ont exclusivement la jouissance et la disposition des chemins qu'ils entretiennent? Ont-ils la faculté de les rétrécir ou de les supprimer? Peuvent-ils les interdire à tous les autres habitans de la France? Peuvent-ils y établir des droits de passe, qui pèseraient exclusivement sur les personnes étrangères à la commune ou au département? On ne saurait soutenir un tel système, à moins de prétendre que chaque commune est souveraine chez elle.
Mais, si les habitans d'une commune ou d'un département n'ont, sur les chemins mis à leur charge, que les droits qui appartiennent à tout le monde, dans quel sens pourrait-il être vrai de dire qu'ils en sont propriétaires? Quand l'usage de certaines choses appartient indistinctement à tous les membres d'une nation, et que nul ne peut y exercer un droit qui n'appartienne à tous, n'est-il pas clair que ces choses sont communes? La charge de les entretenir, imposée à ceux qui en font le plus fréquent usage, et qui sont les plus intéressés à les tenir en bon état, ne prouve donc absolument rien relativement à la propriété.
Il y avait diverses manières de pourvoir aux dépenses qu'exigent les chemins publics on pouvait [I-391] soumettre à la corvée les habitans des paroisses ou des communes, ou contraindre chaque propriétaire riverain à tenir en bon état le chemin qui traverse ou borde sa propriété, ou établir des péages sur toutes les routes, et en employer le produit à les entretenir, ou pourvoir à leur entretien au moyen d'un impôt sur la masse entière de la population, ou bien les diviser en un certain nombre de classes, et adopter pour chacune un mode d'entretien particulier : quel que fût le mode adopté, il n'y avait que deux questions résolues: l'établissement et l'emploi d'un impôt.
Suivant les lois actuelles, chaque commune pourvoit seule à l'entretien de ses chemins vicinaux; chaque département pourvoit à l'entretien de ses routes; mais si les habitans d'une commune n'ont pas, sur les chemins dont ils font les frais, des droits plus étendus que ceux qui appartiennent à tous les autres citoyens, ils ont le droit de faire usage des chemins des autres communes et des autres départemens, quoiqu'ils ne contribuent en rien à les entretenir; il y a ici réciprocité de droits et d'obligations; et c'est cette réciprocité qui concourt à former l'unité de la nation et de son territoire.
Les chemins publics ont pour objet, ainsi qu'on l'a vu, de faciliter les communications entre les particuliers qui ont besoin les uns des autres, [I-392] entre les personnes et les choses propres à leur usage, entre les citoyens et les agens de l'autorité publique, et réciproquement; mais tout en rendant les services pour lesquels ils ont été faits, ils peuvent être utiles d'une autre manière : ils peuvent, par exemple, être bordés d'arbres fruitiers ou de haute futaie.
Ces avantages secondaires, indépendans de l'objet pour lequel ils sont formés, peuvent être attribués par les lois aux propriétaires riverains, aux communes ou à l'État, sans qu'on puisse tirer de cette attribution aucune conséquence relativement à la propriété des chemins. Une loi du 9 ventôse an XIII (28 février 1805), par exemple, obligeait les propriétaires riverains à planter des arbres sur le bord des grandes routes, ou en faisait planter à leurs frais, et leur en abandonnait ensuite la propriété, sous certaines conditions.Quoique ces plantations fussent faites sur un fonds public, et qu'elles fussent attribuées aux propriétaires riverains, elles n'avaient pas pour effet de leur conférer la propriété du sol sur lequel elles avaient lieu.
Dans le cas de la suppression d'un chemin vicinal ou d'une grande route, une loi pourrait attribuer la propriété du sol aux propriétaires riverains ou aux communes, sans qu'on pût en conclure qu'avant la suppression, le sol sur lequel le [I-393] chemin était placé, n'appartenait pas à l'État. C'est ainsi que, quand un fleuve se retire d'une rive pour se porter vers l'autre, la partie abandonnée du lit est attribuée au propriétaire riverain, quoiqu'elle soit incontestablement la propriété de l'État, tant qu'elle n'est pas découverte par la retraite de l'eau. Les motifs qui ont fait adopter ce principe pour le lit abandonné des fleuves, peuvent le faire adopter, tontes les fois qu'il s'agit du terrain d'un chemin supprimé comme inutile.
Nous devons donc admettre aujourd'hui les principes que le jurisconsulte Loyseau professait au seizième siècle; nous devons reconnaître que, s'il est utile de diviser les chemins en diverses espèces, quand il s'agit d'en déterminer la largeur et d'en assurer l'entretien ou la bonne administration, on n'a pas à les diviser quand on expose à qui ils appartiennent et quelles sont les personnes qui peuvent en faire usage; il est évident qu'ils font partie du domaine public, et que la jouissance en est commune à toutes les personnes qui habitent le territoire.
Les chemins publics étant une partie du territoire national, consacrée spécialement aux communications entre les personnes, et au tranport de choses nécessaires à la satisfaction des besoins publics et privés, il s'ensuit que toute personne qui habite le territoire français a le droit de s'en servir, [I-394] soit pour voyager, soit pour envoyer ses marchandises ou ses denrées d'un lieu dans un autre [186].
Le droit que nous reconnaissons à tout particulier de faire usage des chemins publics, donne naissance à plusieurs questions: la première est de savoir si toute personne a une action contre ceux qui sont obligés de les entretenir, pour les contraindre à remplir cette obligation; la seconde, si le droit de poursuivre en justice les individus qui dégradent un chemin public, ou qui y commettent des usurpations, appartient à toute personne lésée; la troisième, si, lorsqu'un chemin public devient impraticable sur quelques points, les particuliers ont le droit de passer sur les propriétés qui les bordent.
Quoique les chemins publics soient entretenus par les communes, par les départemens ou par l'État, ils ne sont pas établis pour satisfaire uniquement les besoins généraux de l'État, des départemens ou des communes; ils ne sont pas. moins nécessaires à la satisfaction des besoins privés qu'à la satisfaction des besoins publics auxquels les corps constitués sont chargés de pourvoir. Le droit qu'a un agriculteur de faire usage [I-395] d'un chemin vicinal pour transporter ses denrées dans la ville voisine, est, en effet, aussi évident que le droit qui appartient au maire de s'en servir pour envoyer ses dépêches à son supérieur dans la hiérarchie administrative : les échanges, sans lesquels une société civilisée ne saurait subsister, ne peuvent pas plus être suspendus qu'une correspondance administrative.
Mais si, d'un côté, l'on admet que ce corps collectif, auquel on donne le nom de commune, et qui est représenté par un ou plusieurs agens, est tenu d'entretenir les chemins qui traversent son territoire, et qui vont ordinairement aboutir à une grande route; et si, d'un autre côté, l'on reconnaît que toute personne a le droit d'en faire usage, soit pour ses communications personnelles, soit pour la culture de ses propriétés, soit pour le transport de ses denrées ou de ses marchandises, ne s'ensuit-il pas nécessairement que chacun a le droit d'agir contre une commune pour l'obliger à remplir les obligations qui lui sont imposées? Si une commune a une action contre les particuliers pour les contraindre à payer les impôts destinés à l'entretien de ses chemins, les particuliers, de leur côté, ne doivent-ils pas en avoir une pour obliger la commune à remplir les engagemens qui lui sont imposés en leur faveur?
C'est, en effet, ce qui se pratique en Angleterre [I-396] et dans tous les pays où les hommes qui font des lois, se piquent d'un peu de logique; mais il n'en est pas de même parmi nous. Ici, rien n'est plus commun que de voir la législature tantôt imposer des obligations à l'administration ou à ses agens, et ne donner à personne le droit d'en exiger l'accomplissement; tantôt reconnaître des droits aux citoyens, et leur refuser, en même temps, toute action pour les exercer. Le pouvoir absolu, đétruit comme théorie, est religieusement conservé dans la pratique; car ce pouvoir existe de fait, partout où les citoyens ne peuvent pas exiger des fonctionnaires publics, qu'ils remplissent leurs obligations. Les révolutions qui font passer ce pouvoir d'une main dans une autre, n'en changent pas la nature.
Les observations que je viens de faire sur les obligations imposées aux communes, relativement aux chemins vicinaux, et sur les droits qu'ont les particuliers, d'exiger que ces obligations soient remplies, peuvent être appliquées aux obligations imposées aux départemens et à l'État, relativement aux routes qui sont à leur charge: si les unes ont plus d'importance que les autres, il n'y a aucune différence dans leur nature.
Celui qui dégrade ou qui usurpe un chemin public, porte atteinte à divers genres d'intérêts : il blesse d'abord les intérêts généraux de la commune, du département ou de l'État, dont la [I-397] conservation est confiée à certains fonctionnaires publics; il blesse, en second lieu, les intérêts individuels, que chacun s'est réservé le droit de défendre. Le fonctionnaire, qui représente la commune, le département ou l'État, a seule qualité pour agir au nom du corps dont il est le représentant et pour demander la réparation des dommages qui lui sont causés. Mais si la dégradation ou l'usurpation d'un chemin public cause un dommage spécial à des particuliers, ils sont certainement fondés à en traduire les auteurs en justice. Les citoyens ne se sont pas dépouillés, au profit des agens de l'autorité publique, du droit de défendre leurs intérêts particuliers. On ne pourrait donc pas les priver de toute action, à moins de prétendre ou qu'ils n'ont pas le droit de faire usage des chemins publics, ou qu'ils peuvent être privés de l'exercice de ce droit, sans qu'il en résulte pour eux aucun dommage.
La question de savoir si, lorsqu'un chemin public est impraticable sur quelques points, les particuliers peuvent passer sur les propriétés qui la bordent, semble présenter d'abord plus de difficulté. Il s'agit, en effet, ici d'envahir des propriétés privées, avant qu'il y ait eu ni indemnité, ni expropriation, et même avant que la nécessité en ait été légalement constatée. Cependant, tels sont le besoin et l'urgence des communications, [I-398] que les lois autorisent à passer sur les propriétés particulières toutes les fois que les chemins cessent d'être praticables, même quand il faut, pour user de cette faculté, enlever ou briser des clôtures [187]. La conservation de propriétés plus ou moins considérables, l'existence d'une ou de plusieurs personnes, et même l'approvisionnement d'une ville, dépendent quelquefois de la promptitude des communications. La défense de passer sur une propriété privée, avant d'avoir fait constater que le chemin public est impraticable, ne serait donc pas observée; car la première de toutes les lois est celle qui commande aux hommes de veiller à leur conservation. Il ne serait même pas bon qu'elle le fût, parce que le mal qui peut résulter, en pareilles circonstances, de la violation de la propriété par l'ouverture d'un passage, est moins grave que celui qui serait la suite d'une interruption de communications.
Mais si chacun doit avoir la faculté de passer sur une propriété privée, quand le chemin public qui la borde est impraticable, le propriétaire dont l'héritage est ainsi envahi, doit être indemnisé du dommage qui lui est causé. Ce n'est [I-399] pas aux hommes à qui le passage est dû, que l'indemnité peut être justement demandée; c'est à ceux qui sont chargés de tenir le chemin en bon état, ou de le rétablir, s'il est détruit par quelque accident. Le propriétaire sur l'héritage duquel un passage a été ouvert, doit donc diriger son action contre la commune, le département ou l'État, selon que le chemin devenu impraticable était à la charge de l'État, du département ou de la commune. Il pourrait aussi la diriger contre celui qui aurait causé le dommage, en rendant le chemin public impraticable.
Les chemins publics n'ont pas la même largeur dans tous les pays; cependant, comme ils ont partout le même objet, et comme les lois de la pesanteur et du mouvement sont les mêmes chez toutes les nations, il ne devrait pas exister entre eux d'autres différences que celles qui sont commandées par la nature du terrain, et des moyens de transport qu'on est obligé d'employer. Quand on donne à un chemin plus de largeur que n'en demandent la facilité et la sûreté des communications et des transports, on fait une double perte. On enlève d'abord à l'agriculture des terrains précieux ; car les routes passent nécessairement sur les terres les plus fertiles, les mieux cultivées, les plus populeuses. On s'engage, en second lieu, à des dépenses d'entretien tellement considérables, qu'il [I-400] est rare qu'on ait toujours le moyen d'y pourvoir. Depuis long-temps, les voyageurs ont fait l'observation que les nations qui ne donnent à leurs chemins que la largeur commandée par les besoins publics, sont celles qui les entretiennent le mieux, et qui, pour cet objet, font le moins de dépenses. Quelle que soit, au reste, la largeur qu'on leur donne, il importe à tous les propriétaires dont ils bordent les héritages, qu'elle soit bien déterminée.
En France, aucune loi rendue depuis la révolution, n'a fixé la largeur des grandes routes ou des chemins vicinaux; mais des édits rendus dans les deux derniers siècles y avaient pourvu. L'ordonnance de 1669 donnait soixante-douze pieds de largeur aux grandes routes qui passaient à travers les forêts; mais cette disposition ne fut jamais bien exécutée. Une ordonnance du bureau de finances de la généralité de Paris, du 29 mars 1754, fixa la largeur des grandes routes de province à province, à soixante pieds de largeur. Les routes de ville à ville devaient avoir au moins quarante-huit pieds, et les chemins de traverse de village à village, trente pieds au moins. En 1776, un arrêt du conseil du 6 février, a fixé la largeur des routes de première classe à quarante-deux pieds, et à trente-six pieds celle des routes de seconde classe, entre les fossés et les empatemens des talus ou glacis. La largeur peut cependant être moins [I-401] considérable, quand la nature des lieux l'exige, comme cela arrive quelquefois dans les montagnes.
On a cru que ce n'était pas assez d'avoir déterminé la largeur des chemins publics, et d'avoir prescrit la répression des dégradations et des usurpations dont ils pourraient être l'objet. On a interdit aux propriétaires de faire sur les bords aucune construction, avant que d'avoir obtenu l'allignement, sous peine d'amende et de démolition des ouvrages entrepris [188]. Il leur est également défendu d'y faire des plantations, avant que l'allignement leur ait été donné par le préfet [189].
Le Code civil ne permet de planter des arbres de haute tige près de la limite qui sépare deux héritages, qu'à la distance prescrite, soit par les règlemens particuliers qui existaient au moment de sa promulgation, soit par les usages constans et reconnus; [I-402] et à défaut de règlemens et d'usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux propriétés, pour les arbres de haute tige, et qu'à la distance d'un demi-mètre pour les arbres et haies vives.
On n'a pas suivi cette règle, à l'égard des propriétés qui bordent les chemins publics. La loi du 9 ventôse an XIII (28 février 1805), relative aux plantations des grandes routes et des chemins vicinaux, après avoir établi que les grandes routes non plantées et susceptibles de l'être, le seront en arbres forestiers ou fruitiers, suivant les localités, par les propriétaires riverains, ordonne que les plantations seront faites dans l'intérieur de la route, et sur le terrain appartenant à l'État, avec un contre-fossé qui sera fait et entretenu par l'administration [190],
Quant aux chemins vicinaux, la même loi dispose (article 6) que l'administration en fera rechercher et reconnaître les anciennes limites, et en fixera, d'après cette reconnaissance, la largeur, suivant les localités, sans pouvoir cependant, lorsqu'il sera nécessaire de l'augmenter, la porter au-delà de six mètres, ni faire aucun changement aux chemins vicinaux qui excèdent actuellement [I-403] cette dimension. A l'avenir', ajoute l'article 7, nul ne pourra planter sur le bord des chemins vicinaux, même dans ses propriétés, sans leur conserver la largeur qui leur aura été fixée en exécution de l'article précédent.
Le premier de ces deux articles est fort obscur; il paraît n'avoir pas d'autre objet que de faire cesser les usurpations commises sur les chemins vicinaux, et de leur conserver la largeur qu'ils ont eue primitivement. Il veut, en effet, que l'administration en fasse rechercher et reconnaître les limites, et qu'elle en fixe la largeur, d'après cette reconnaissance et suivant les localités. Cependant, s'il résultait des recherches qu'il prescrit, qu'un chemin vicinal a été rétréci par des usurpations, on ne devrait prendre sur le terrain usurpé, que ce qui serait nécessaire aux besoins publics, suivant les localités, sans pouvoir lui donner plus de six mètres de largeur. Dans le cas où un chemin vicinal aurait actuellement plus de six mètres, l'administration ne pourrait pas le réduire à une moindre dimension; elle devrait se borner à en reconnaître et à en fixer les limites.
Lorsque les limites d'un chemin ont été régulièrement déterminées, les propriétaires riverains ne sont pas tenus d'observer, pour leurs plantations, la distance qui leur est prescrite dans l'intérêt des propriétés privées qui les avoisinent. Ils [I-404] peuvent planter des arbres de haute tige, sans les placer à deux mètres du chemin, et d'autres arbres ou des haies vives, sans observer la distance d'un demi-mètre. Il suffit, pour les uns comme pour les autres, qu'ils se trouvent en entier sur leurs héritages.
Quand les limites d'un chemin n'ont pas été légalement fixées par l'administration, il peut être sage de faire les plantations de manière qu'on puisse, sans les détruire, donner au chemin six mètres de largeur; cependant, s'il était constant qu'il n'y a jamais eu d'usurpation commise, le propriétaire riverain ne serait pas tenu de laisser six mètres de largeur pour le chemin.
La loi qui permet à l'administration de donner six mètres de largeur à un chemin vicinal, ne l'y autorise que lorsque cela se peut sans excéder les anciennes limites. Elle veut, en effet, que cette largeur soit fixée après que ces limites ont été reconnues, et qu'elle le soit d'après cette reconnaissance. La fixation de six mètres est un maximum qu'il n'est pas permis de dépasser, et n'a lieu que dans l'intérêt des propriétaires riverains. S'ils ont jadis usurpé sur le chemin, ils ne peuvent être tenus de restituer que l'étendue nécessaire pour lui donner la largeur prescrite.
Il ne faut pas conclure de là que, lorsqu'il est nécessaire d'élargir un chemin, on ne peut pas [I-405] prendre sur les propriétés privées; c'est une faculté que le public a toujours, mais qu'il ne peut exercer que moyennant une juste et préalable indemnité, c'est-à-dire en payant toutes les valeurs dont il s'empare.
Le seul cas où il n'y a pas lieu à indemnité est celui où, pour donner à un chemin public la largeur prescrite par la loi, il suffit de reprendre des terrains qui en ont fait jadis partie, et qui ont été usurpés par les propriétaires riverains.
Il ne serait pas possible de pourvoir à l'entretien des chemins publics, si l'on ne tirait pas des propriétés qui les bordent, les matériaux dont on a besoin; mais la valeur de ces matériaux doit être payée par le public qui en profite.
Aussi, la loi du 28 septembre 1791 déclare-t-elle que les agens de l'administration ne pourront fouiller dans un champ, pour y chercher des pierres, de la terre ou du sable, nécessaires à l'entretien des grandes routes ou autres ouvrages publics, qu'au préalable ils n'aient averti le propriétaire, et qu'il ne soit justement et préalablement indemnisé à l'amiable ou à dire d'experts [191].
La loi du 16 septembre 1807 ajoute que les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions publiques, [I-406] pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour la route même; qu'il n'y aura lieu de faire entrer, dans l'estimation, la valeur des matériaux à extraire, que dans les cas où l'on s'emparerait d'une carrière déjà en exploitation, et qu'alors ces matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine.
Lorsqu'il s'agit de prendre sur des propriétés privées, des matériaux nécessaires à l'entretien de chemins publics, on ne suit pas les formes prescrites pour les cas où il y a lieu à expropriation pour cause d'utilité publique; la nécessité d'observer ces formalités rendrait souvent l'entretien des chemins impossible [192].
De nombreuses contestations peuvent s'élever entre les propriétaires dont les héritages sont bordés par des chemins publics, et les personnes auxquelles l'entretien et la garde de ces chemins sont confiés. Quelles que soient les difficultés qui s'élèvent, il est une vérité qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est qu'un peuple n'existe, et que que les propriétés privées n'ont de valeur que par les communications. Le public doit, sans doute, faire les [I-407] sacrifices qu'exigent la formation et l'entretien des routes; mais quand il fait ces sacrifices, il n'est point d'intérêts qui soient supérieurs aux siens.
[I-408]
CHAPITRE XXII.
De la propriété des richesses minérales, et des limites qui en résultent pour les propriétés de la surface.↩
TANT qu'une peuplade laisse inculte le territoire qu'elle occupe, et qu'elle continue de se nourrir ou de gibier ou de poisson, la terre sur laquelle elle trouve sa subsistance, demeure tout entière une propriété nationale. Le sol ne se convertit en propriétés privées que quand des individus ou des familles, renonçant à la vie vagabonde, s'en approprient certaines parties au moyen de la culture. Cette appropriation d'une partie du sol ne fait rien perdre à personne, puisque celui qui devient propriétaire, loin d'empiéter sur la part des autres, renonce, au contraire, ainsi qu'on l'a vu précédemment, à la plus grande partie de ce qui lui était auparavant nécessaire pour sa subsistance.
Si l'appropriation de l'espace de terre qu'un homme met en culture, n'est pas une usurpation, la valeur qu'il donne au terrain qu'il s'est approprié par le travail, est bien moins encore une [I-409] propriété usurpée : c'est une richesse qui n'appartient qu'à lui, parce que ce n'est que par lui qu'elle a été formée. Mais les travaux qui convertissent en propriété privée un terrain qui était commun quand il était inculte, n'ajoutent aucune valeur aux minéraux que la terre renferme dans son sein. Une mine située sous des campagnes florissantes, n'est pas plus facile à exploiter que celle qui se trouve placée sous le sol le plus inculte ou le plus ingrat. L'or qu'on retire des flancs de la montagne la plus stérile, n'a pas moins de valeur que celui qu'on va chercher dans les profondeurs de la terre la mieux cultivée.
L'homme qui s'approprie, par le travail, une certaine étendue du sol, ne fait donc absolument rien pour acquérir la propriété des richesses qui sont ensevelies dans les entrailles de la terre. Entre elles et lui, il n'existe aucun rapport de création ; ce n'est point par elles qu'il a vécu, et que ses habitudes se sont formées; ce n'est pas non plus par son travail ou par ses capitaux, qu'elles ont acquis de la valeur. Il n'a rien reçu d'elles, il n'y a rien mis du sien: la nature a tout fait, sans qu'il se soit mêlé de rien.
Aussi, les publicistes, comme les jurisconsultes, se sont-ils généralement accordés à reconnaître que, pour acquérir la propriété d'une mine, il ne suffit pas de devenir propriétaire du sol sous [I-410] lequel elle est située. Un des plus sages philosophes du dernier siècle, qui était en même temps un administrateur très-éclairé, Turgot, n'hésitait pas à proclamer le principe admis par le plus grand nombre des jurisconsultes, que les richesses souterraines n'appartiennent pas de plein droit aux propriétaires de la surface. Il démontrait qu'ils n'en avaient la propriété, ni par la nature des choses, c'est-à-dire par l'occupation et le travail; ni, chez la plupart des nations, par les dispositions des lois.
Il pensait que la garantie légale, donnée, en général, à toutes les propriétés territoriales, ne s'étendait pas sur les matières souterraines; parce que l'occupation elle-même ne s'y était pas étendue; parce que la raison d'équité et d'intérêt commun, qui a fait garantir aux premiers cultivateurs le fruit de leurs travaux, n'avait aucune application aux matières souterraines, qui ne sont ni l'objet de la culture, ni le produit du travail; parce que le propriétaire ne reçoit ni dommage ni trouble de la recherche de ces matières, lorsque les ouvertures ne sont pas dans son héritage; enfin, parce que, dans les temps voisins de l'origine des propriétés foncières, la société manquait elle-même de moyens pour donner cette garantie légale de la possession des matières souterraines [193].
[I-411]
Mais si une mine n'appartient pas, comme un produit du travail, au propriétaire de la surface, de qui sera-t-elle la propriété? Faudra-t-il admettre qu'elle appartient au premier occupant, ou qu'elle fait partie du domaine public? Les jurisconsultes romains et la plupart des jurisconsultes modernes ont admis, en principe, que les mines sont la propriété de l'État dans lequel elles sont situées. Chez toutes les nations du continent européen, ce principe est consacré par la pratique: ce n'est pas au profit de l'État, il est vrai, que les mines sont partout exploitées; mais partout on reconnaît que l'exploitation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une concession faite par l'autorité publique.
L'abus que plusieurs gouvernemens avaient fait de la faculté de concéder les mines ou de les faire exploiter dans un intérêt qui n'était pas celui du [I-412] public, a fait mettre en doute si les richesses souterraines appartenaient réellement au domaine de l'État. Quelques écrivains ont pensé qu'il fallait les classer au rang des choses qui n'appartiennent à personne, res nullius, et qui deviennent la propriété du premier occupant. Le sage Turgot lui-même avait adopté cette opinion.
Le principe de l'occupation, qui joue un si grand rôle dans l'origine des sociétés et dans les pays où les intérêts de la population ne sont pas protégés par un gouvernement régulier, ne pourrait guère s'appliquer sans danger à une grande masse de richesses, qui ne peuvent être mises en circulation qu'à l'aide de connaissances étendues, de travaux soutenus et de capitaux considérables; si les mines étaient livrées aux premiers occupans, les matières les plus précieuses qu'elles renferment, seraient bientôt perdues par le gaspillage; aussi, dans aucune société passablement organisée, le principe de l'occupation n'a-t-il été appliqué à ce genre de biens.
S'il est vrai que le territoire sur lequel une nation s'est développée et a toujours vécu, forme sa propriété nationale; si tout ce qui ne passe pas, au moyen du travail, dans le domaine des particuliers, reste dans le domaine public, il est évident que les matières souterraines continuent de faire partie du domaine de l'État, et que la nation peut [I-413] les faire exploiter dans son intérêt, sans qu'aucun de ses membres puisse se plaindre qu'elle porte atteinte à sa propriété, si, en effet, l'exploitation n'est une cause de dommage pour aucune propriété privée.
Il existe, chez toutes les nations, des parties plus ou moins considérables du territoire, qui ne sont jamais tombées dans le domaine des particuliers et qui font partie du domaine de l'État. De ce nombre sont, non-seulement les rivages de la mer, les ports, les fleuves, mais encore des pâturages, des forêts, ou même des terres cultivées. Mais, si une forêt, par exemple, peut faire partie du domaine public, pourquoi des dépôts souterrains de charbon de terre ou de pierre, n'en feraient-ils pas aussi partie, quand personne ne se les est encore appropriés? L'adoption d'un principe ou d'une mesure qui livrerait au premier occupant les arbres dont se compose une forêt nationale, serait un acte dépourvu de raison et de justice. Pourquoi serait-il plus raisonnable ou plus juste de livrer au premier occupant les matières combustibles déposées dans l'intérieur de la terre? Pourquoi les richesses qui sont au-dessous du sol, seraient-elles moins protégées que celles qui sont au-dessus?
Une nation peut, sans doute, attribuer aux propriétaires de la superficie toutes les richesses que le sol recèle dans sa plus grande profondeur; mais [I-414] cette mesure, qui serait pour les propriétaires un don purement gratuit, serait, en général, peu profitable pour ceux qui en seraient l'objet, surtout dans les pays où les propriétés sont très-divisées, comme en France; et elle pourrait causer un grand dommage à la masse de la population. Elle serait improfitable, non-seulement à tous ceux qui ne possèdent aucune propriété foncière, mais à tous ceux dont les propriétés n'ont pas une très-grande étendue. Il n'est personne, en effet, qui voulût tenter d'exploiter une mine, uniquement pour fouiller le dessous d'une vigne ou d'un champ; on ne se hasarde, dans de pareilles entreprises, que quand on peut pousser loin ses recherches, et qu'on n'a pas à craindre d'être arrêté au moment où l'on sera sur le point de recueillir le fruit de ses travaux.
Une nation pourrait aussi garantir aux propriétaires du sol, soit une part proportionnelle des produits qui seraient extraits du sein de la terre, soit une redevance fixe, qui durerait autant que l'exploitation opérée au-dessous de leurs propriétés; mais, si cette part ou cette redevance n'avait pas uniquement pour objet de réparer les pertes qui leur seraient causées, on ne pourrait la considérer encore que comme un don gratuit; ce serait une véritable faveur.
Les mines étant considérées, dans les États du [I-415] continent européen, comme une partie du domaine public, ne peuvent être exploitées par des particuliers ou par des compagnies, qu'en vertu des concessions qui leur sont faites par les gouvernemens. L'autorité publique, quand elle fait une concession, détermine ordinairement l'étendue dans laquelle les concessionnaires seront tenus de se renfermer, et quelquefois aussi le temps que devra durer l'exploitation. Elle se réserve souvent aussi la surveillance, et en quelque sorte la direction des travaux, et une part dans les bénéfices.
Il n'est pas possible de se livrer à l'exploitation d'une mine, sans exécuter de grands travaux, et sans faire des dépenses considérables. Il n'est pas même très-rare de voir des entrepreneurs se ruiner, avant que d'être parvenus aux gîtes de minerais qui pourraient les dédommager de leurs dépenses. Les mines ne pouvant être connues que par l'exploitation, ont les inconvéniens et les avantages des jeux de hasard; elles ruinent un grand nombre de ceux qui en tentent l'exploitation, et assurent à quelques-uns des bénéfices fort grands, comparativement à leur mise. On ne serait donc pas fondé à considérer comme un don de la part de l'État, les richesses que des concessionnaires retirent du sein de la terre; la plus grande partie de la valeur qu'elles ont, après l'extraction, est presque [I-415] toujours le résultat des travaux et des capitaux des entrepreneurs.
C'est une question très-difficile à résoudre que celle de savoir quel est, pour un peuple, le meilleur moyen de tirer parti des richesses minérales que son territoire renferme. Les entreprises industrielles que fait un gouvernement, tournent rarement au profit de la nation qui en paie les frais. Les agens de l'exploitation ne portent ni assez d'économie dans les dépenses, ni assez d'activité dans les travaux, ni assez de soins dans la vente des produits, pour les rendre lucratives, à moins que ce ne soit pour eux. S'ils accordent des faveurs, c'est le trésor public qui en fait les frais; mais c'est à eux que profite la reconnaissance. Ils se persuadent volontiers que personne ne souffre d'un dommage qui tombe sur tout le monde, et dont aucun individu ne se sent particulièrement blessé. Ils sont donc portés, par une tendance naturelle, à faire tourner à leur avantage particulier les bénéfices de l'entreprise, et à rendre plus lourdes les charges qui doivent tomber sur le public [194].
D'un autre côté, les risques qui sont inséparables [I-417] de la recherche et de l'exploitation des mines, et les dépenses auxquelles les concessionnaires doivent se livrer, sans avoir la certitude d'en être remboursés par les produits de l'entreprise, permettent difficilement à un gouvernement d'imposer des conditions rigoureuses aux personnes auxquelles il fait des concessions; il n'y a que les hommes qui s'imaginent avoir la chance de faire de grands bénéfices, qui consentent à s'exposer à de grandes pertes.
Un gouvernement se trouve donc, relativement à l'exploitation des mines, dans l'alternative ou de se jeter dans des entreprises périlleuses qui ne seront lucratives que pour ses agens, ou de concéder, pour un mince profit, des biens d'une grande valeur; il faut qu'il se place entre l'accusation d'employer les ressources des contribuables à exécuter de stériles projets, et l'accusation de livrer gratuitement à des spéculateurs, ou même à des favoris, une partie considérable du domaine public: il ne saurait sortir de là, à moins de trouver le moyen de concilier les intérêts de l'Etat avec ceux des concessionnaires, c'est-à-dire qu'il faudrait faire disparaître de la recherche et de l'exploitation des mines tout ce qu'il y a de hasardeux.
Les lois qu'on a faites sur ce sujet en divers pays, et particulièrement en Allemagne, sont [I-418] très-étendues et très-compliquées : celles de la Prusse, par exemple, forment un code tout entier. Il ne serait donc pas possible d'en exposer ici le contenu, et surtout de montrer ce qu'il y a de bon où de vicieux; mais il ne sera pas inutile de faire quelques observations sur celles qui ont été rendues en France, depuis le commencement de la révolution. Ce sera le meilleur moyen de faire voir dans quelles difficultés on se jette toutes les fois qu'on cesse de prendre pour guide les lois qui résultent de la nature des choses. Il ne faut pas, au reste, oublier que, dans ce chapitre, il s'agit de déterminer si le propriétaire de la surface est, de plein droit, propriétaire des richesses placées au-dessous dans la plus grande profondeur, et non de rechercher quelles sont les règles suivant lesquelles les mines doivent être exploitées pour en tirer le meilleur parti.
Avant la révolution de 1789, les richesses souterraines étaient généralement considérées comme faisant partie du domaine de l'Etat; mais, le gouvernement ayant abusé du pouvoir d'en concéder l'exploitation, on se méfiait d'un principe qui semblait avoir engendré de fâcheuses conséquences. L'assemblée constituante prit donc un terme moyen, entre l'opinion de ceux qui voulaient que les mines fussent considérées comme partie du domaine public, l'opinion de ceux qui les mettaient [I-419] au rang des choses n'appartenant à personne, et l'opinion de ceux qui les considéraient comme appartenant aux propriétaires de la surface.
Elle déclara, par la loi du 12 juillet 1791, que les mines et minières étaient à la disposition de la nation, en ce sens seulement qu'elles ne pourraient être extraites que de son consentement, et à la charge d'indemniser les propriétaires de la surface. L'indemnité devait se borner à la réparation des dommages qui résulteraient de l'exploitation; elle consistait à payer le double de la valeur intrinsèque de la surface du sol qui aurait été l'objet de dégâts et non-jouissances.
Le gouvernement, qui s'attribuait le droit de concéder l'exploitation des mines, ne réservait donc à la nation aucune part dans les bénéfices; il n'en attribuait aucune aux propriétaires de la surface; sous ce rapport, on peut dire qu'il ne considérait les richesses souterraines ni comme faisant partie du domaine public, ni comme appartenant aux propriétaires de la surface.
Les droits de ces derniers sur les mines situées au-dessous de leurs propriétés, n'étaient pas cependant complétement nuls; car si un propriétaire voulait exploiter une mine placée au-dessous de sa propriété, la concession ne pouvait lui en être refusée, à moins que sa terre n'eût pas assez d'étendue pour former une exploitation.
[I-420]
Une loi du 21 avril 1810 a adopté des principes différens de ceux de l'assemblée constituante; elle a classé les masses de substances minérales ou fossiles, renfermées dans le sein de la terre, ou existant à la surface, relativement à l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières [195].
Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en Conseil-d'État. Cet acte règle les droits des propriétaires de la [I-421] surface sur le produit des mines. Outre les droits dus aux propriétaires de la surface, les concessionnaires des mines sont tenus de payer à l'État une redevance fixe, et une redevance proportionnée au produit de l'extraction. La redevance fixe est annuelle: elle est de dix francs par kilomètre carré. La redevance proportionnelle est une contribution annuelle, à laquelle les mines sont assujéties sur leurs produits. Si elle n'est pas fixée par abonnement, elle est déterminée chaque année par le budget de l'État, sans pouvoir néanmoins s'élever au-dessus de cinq pour cent du produit net. Le gouvernement peut en faire la remise pour un temps déterminé, s'il juge que cela soit nécessaire à cause de la difficulté des travaux [196].
La redevance due au propriétaire de la surface est indépendante des indemnités auxquelles il peut avoir droit, si l'exploitation de la mine lui cause des dommages.
Le gouvernement n'est pas tenu, suivant cette loi, quand il s'agit de faire la concession d'une mine, de donner la préférence aux propriétaires de la surface. Tout homme, qu'il soit Français ou étranger, peut obtenir une concession, s'il remplit les conditions prescrites par la loi. Ces conditions [I-422] sont de justifier, soit des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, soit des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités imposées par l'acte de concession. S'il y avait des travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations, ou dans leur voisinage immédiat, le concessionnaire devrait, en outre, donner caution de payer toute indemnité, en cas d'accident. Ces conditions remplies, le gouvernement est juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.
Il résulte clairement de ces dispositions que les mines, tant qu'elles n'ont pas été concédées, sont considérées comme appartenant par indivis au domaine de l'État, et aux particuliers sous les propriétés desquels elles sont situées. La redevance payée aux propriétaires du fonds, est la représentation de la part que la loi leur reconnaît dans la propriété. Les redevances qui sont payées à l'État représentent la part qui lui appartient suivant la loi. Quant aux produits qu'en retirent les concessionnaires, ils ne devraient être qu'en raison des capitaux qu'ils y engagent, des travaux qu'ils y consacrent, et des risques auxquels ils s'exposent. Tout ce qu'ils reçoivent au-delà n'est qu'un don gratuit qui leur est fait aux dépens du public.
[I-423]
Tant qu'une mine n'a pas été concédée, elle fait donc partie du domaine de l'Etat, et personne ne peut en rien retirer, pas même les propriétaires de la surface. Aussitôt qu'elle a été régulièrement concédée, elle est, suivant la loi du 21 avril 1810, la propriété des concessionnaires, et se trouve soumise aux mêmes règles que toutes les autres propriétés immobilières. Elle en diffère cependant en ce qu'elle ne peut pas être vendue par lots, ou partagée, sans une autorisation préalable du gouvernement, donnée dans les mêmes formes que la concession, et en ce qu'elle ne peut être exploitée que sous la surveillance des agens de l'autorité publique, spécialement préposés à cet effet. Cette propriété est distincte de celle de la surface, même quand toutes les deux se trouvent dans la même main. La redevance à laquelle le concessionnaire est assujéti en faveur du propriétaire de la surface, est considérée comme faisant partie de cette dernière propriété.
Les minières, les terres pyriteuses et calamineuses, sont considérées par la loi comme appartenant aux propriétaires du fonds dans lequel elles sont situées; néanmoins elles ne peuvent pas être exploitées sans permission. Le gouvernement, en permettant de les exploiter, détermine les limites de l'exploitation, et les règles qui seront observées sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques. [I-424] Le propriétaire qui a sur son fonds du minerais de fer d'alluvion ne peut pas ne pas l'exploiter, ou empêcher qu'il ne soit exploité par un maître de forge, si celui-ci en a besoin. S'il ne veut pas l'exploiter, un maître de forge peut le mettre lui-même en exploitation, après l'avoir prévenu un mois d'avance, et en avoir obtenu l'autorisation du préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur des mines. Le prix du minerai est réglé de gré à gré, entre le proprietaire du fonds et le maître de forge, ou fixé par des experts choisis par les parties ou nommés d'office.
Les carrières appartiennent également aux propriétaires des fonds dans lesquels elles sont situées, et qui peuvent les exploiter sous la simple surveillance de la police, avec l'observation des lois ou réglemens généraux ou locaux. Si l'exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la même surveillance que celle des mines; mais elle n'a lieu qu'au profit du propriétaire de la surface, qui n'est soumis à aucune redevance.
Enfin, les tourbes appartiennent aussi au maître du sol, qui seul a le droit de les exploiter, ou de permettre que d'autres les exploitent; néanmoins elles ne peuvent être mises en exploitation qu'après que la déclaration en a été faite à la sous-préfecture de l'arrondissement, et que l'autorisation de les exploiter a été accordée.
[I-425]
Les auteurs de la loi du 21 avril 1840 ayant admis que les mines forment une partie du domaine public, ils auraient dû, pour être conséquens aux principes qu'ils avaient adoptés, reconnaître qu'elles ne pouvaient être concédées que dans les formes usitées pour la vente des biens de l'État. Il aurait donc fallu qu'après avoir déterminé les conditions auxquelles seraient assujétis les concessionnaires, les mines fussent adjugées à ceux qui offriraient de payer les redevances les plus élevées, ou qui consentiraient à donner à l'État la part la plus considérable dans les bénéfices. La faculté que le gouvernement s'est arrogée de choisir arbitrairement les concessionnaires, et de déterminer à sa volonté l'étendue des concessions, a été et peut être encore la source d'une multitude d'abus, et l'on peut dire même de dilapidations. C'est, en effet, dilapider la fortune publique, que de livrer les richesses de l'État à des hommes qui n'y ont pas d'autres titres que la faveur. Plusieurs fois on s'est vu dans la nécessité de révoquer des aliénations des biens de l'État faites sans une juste cause. Si on soumettait à une révision les concessions des mines, on en trouverait probablement plus d'une qu'il serait difficile de justifier [197].
[I-426]
Le gouvernement, qui peut concéder les mines . déjà découvertes, peut concéder aussi le droit d'en rechercher, même sur le fonds d'autrui; mais, suivant la loi du 21 avril, ce consentement ne peut être donné qu'après avoir consulté l'administration des mines, après avoir entendu le propriétaire, et à la charge d'une préalable indemnité. Les propriétaires de terres, ni les personnes auxquelles ils ont concédé leurs droits, n'ont aucun besoin d'autorisation pour faire des recherches sur leurs fonds; l'autorisation ne devient nécessaire pour eux, que quand il s'agit de se livrer à l'exploitation. Si l'auteur de la découverte n'obtient pas la concession, il est indemnisé par celui auquel elle est faite.
Nulle permission de recherches, ni concession de mines, ne peut, au reste, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner droit de faire des sondes, et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres de ces clôtures ou habitations.
[I-427]
De la distinction faite entre la propriété de la surface et la propriété des mines, il suit que la propriété d'un fonds de terre est souvent limitée, non-seulement par les propriétés qui l'environnent de tous côtés, mais aussi par la propriété qui est située au-dessous.
La limite qui sépare la propriété de la surface, de la propriété de la mine qui est au-dessous, n'est pas très-facile à déterminer. Jusqu'à quelle profondeur pourra descendre le propriétaire du sol, sans porter atteinte à la propriété de la mine, ou jusqu'à quelle hauteur pourra s'élever le propriétaire de la mine, sans que le propriétaire de la surface ait le droit de se plaindre?
La loi du 21 avril 1810 interdit aux concessionnaires de mines d'ouvrir des puits ou galeries, ou d'établir des machines dans les enclos murés, cours ou jardins, ou dans les terrains attenant aux habitations et clôtures, à une distance de cent mètres; elle pourvoit ainsi à la sûreté des personnes, en garantissant de toute atteinte les propriétés sur lesquelles elles font leur résidence habituelle.
La question des limites naturelles entre la propriété de la surface et la propriété du dessous, ne peut donc s'élever. que pour des terres sur lesquelles il ne se trouve ni habitations ni clôtures. En général, l'appropriation de la surface a précédé de beaucoup l'appropriation des mines. La terre a [I-428] fourni des moyens d'existence aux hommes, avant qu'on eût découvert qu'elle recélait des minéraux. Il est donc naturel de faire respecter les possessions les plus anciennes, et les propriétés qui ont été créées les premières. L'homme qui s'approprie, par le travail, un certain fonds de terre, s'approprie par cela même la matière qui le supporte, et qui est nécessaire à son existence.
Il suit de là que si, par leurs travaux, les concessionnaires d'une mine dégradent la surface du sol, ou en diminuent la valeur, ils doivent être tenus de réparer les dommages qu'ils causent; leurs droits s'étendent aussi loin qu'ils peuvent aller, sans nuire à la culture de la terre.
De son côté, le propriétaire de la surface peut faire, sur son terrain, tous les travaux qu'il juge convenables, pourvu que, par ses fouilles, il ne cause aucun dommage aux richesses minérales que le sol renferme, et surtout aux travaux des mineurs.
Dans les questions de ce genre, il faut, pour résoudre les difficultés qui se présentent, examiner quelles sont les propriétés qui ont été créées les premières. Si, avant l'exploitation d'une mine, le sol qui la couvre, a reçu, par la culture ou par les travaux qui y ont été exécutés, une certaine valeur, les familles auxquelles il appartient doivent être protégées dans leurs moyens d'existence. Si, au contraire, l'exploitation de la mine a précédé [I-429] la culture du sol, on doit protéger la propriété souterraine contre les entreprises qui pourrait être formées à la surface. Les maux qui résultent, pour les familles, de la suppression de leurs moyens d'existence, sont infiniment plus graves que les maux produits par une mesure qui ralentit l'accroissement de leurs richesses.
Il est vrai que les richesses enfouies dans les entrailles de la terre peuvent être infiniment plus précieuses que celles qui résultent de la culture du sol; mais quand des hommes, pour créer de grandes valeurs, sont obligés de détruire ou de dégrader certaines propriétés, ils doivent commencer par les acquérir de ceux à qui elle appartiennent.
Le gouvernement anglais, composé de grands propriétaires de terres, n'a pas admis en principe que les richesses minérales que renferme le territoire, appartiennent au corps entier de la nation; il les considère comme appartenant aux propriétaires de la surface.
Tout homme qui veut exploiter une mine, quelle qu'en soit la nature, doit donc commencer par en acquérir le droit de ceux auxquels appartient le sol sous lequel elle est située; mais aussi il n'a besoin d'aucune autre autorisation. Il n'est soumis, dans son exploitation, à aucune surveillance spéciale; l'industrie du mineur n'est pas moins libre que celle de l'agriculteur. Il ne paraît [I-430] pas, si l'on s'en rapporte au témoignage des ingénieurs les plus éclairés du pays, que cette liberté produise aucun inconvénient.
Au Mexique, au Pérou et dans la Nouvelle-Grenade, on n'a jamais séparé la propriété des mines de la propriété de la surface. Les propriétaires du sol qui les ont fait exploiter à leur profit, n'ont même pas permis au gouvernement de se mêler de l'exploitation. M. de Humboldt, par qui ce fait est attesté, ne remarque pas que cette liberté ait eu, en Amérique, des résultats plus fâcheux qu'en Angleterre [198]. Les immenses fortunes de quelques familles hispano-américaines ont été le produit de l'exploitation des mines. Suivant le témoignage du même écrivain, un seul filon a produit, pour une seule famille, dans l'espace de quelques mois, la somme énorme de vingt millions de francs [199].
[I-431]
CHAPITRE XXIII.
De la valeur donnée à des propriétés particulières, communales ou départementales, par des travaux exécutés aux frais de l'État. Du paiement de cette valeur.↩
DES faits exposés dans les chapitres précédens, il résulte deux vérités qui me semblent avoir tout le caractère de l'évidence: l'une, que toute valeur appartient à celui qui l'a formée, et qui ne s'en. est pas dépouillé; l'autre, qu'une propriété, quelle qu'en soit la nature, est estimée par la valeur qu'elle a, ou par les services qu'elle peut rendre, et non par le volume ou l'étendue de la matière dont elle est composée.
Si des propriétés particulières, si le territoire d'une commune ou d'un département reçoivent un accroissement de valeur immédiat et spécial, des travaux exécutés aux frais du public, tels que des routes, des ponts, des canaux, ne faudra-t-il pas tirer du premier de ces deux principes la conséquence que cet accroissement de valeur appartient à l'Etat? Les particuliers, les communes ou les départemens, dont les propriétés auront [I-432] augmenté de prix, ne seront-ils pas tenus, soit de lui payer une indemnité proportionnée à la plus-value, soit de lui rembourser une part proportionnelle des dépenses? Les personnes qui croiront devoir ne lui payer ni la plus-value, ni une part des dépenses, ne pourront-elles pas être obligées à lui céder leurs propriétés pour le prix qu'elles avaient avant l'exécution des travaux?
Ces questions ne pourraient pas s'élever dans un pays où le gouvernement laisserait aux particuliers, aux communes ou aux provinces, le soin d'entreprendre ou de faire exécuter les travaux à l'exécution desquels ils se croiraient intéressés; 'car, dans un tel pays, on conviendrait d'avance de la part pour laquelle chacun devrait y contribuer. Mais si les entreprises d'utilité publique étaient ainsi subordonnées au sentiment et aux calculs de l'intérêt privé, il est probable que des travaux utiles à la population entière seraient rarement entrepris, surtout dans les pays peu avancés dans la civilisation. Un peuple ne pourrait pas, sans compromettre ses intérêts de la manière la plus grave, renoncer à toute espèce d'entreprises d'utilité générale, jusqu'au moment où chacun des propriétaires auxquels elles pourraient profiter, serait assez éclairé pour bien apprécier ses intérêts, et pour avoir la volonté d'y participer.
On n'aurait pas non plus à examiner ces questions [I-433] chez un peuple qui ne formerait jamais que des entreprises dont les revenus doivent couvrir les dépenses; qui, par exemple, ne ferait percer une route ou construire un pont, qu'autant que les droits de péage pourraient l'indemniser de tous les sacrifices auxquels il se serait soumis; qui ne ferait exécuter un canal qu'autant que les droits établis sur la navigation seraient suffisans pour couvrir les frais de l'entreprise. En pareil cas, ce seraient ceux qui feraient usage de la route, du pont ou du canal, qui en supporteraient la dépense, et chacun paierait en raison de sa jouissance; il suffirait, dans un tel système, de concéder les travaux qu'on voudrait faire exécuter, à des compagnies qui en avanceraient les frais, et qui en percevraient les revenus.
Mais l'utilité de tous les travaux publics ne peut pas constamment se mesurer par les revenus qu'ils rapportent quand ils sont exécutés : une route, un pont, un canal, une rue, outre les services qu'ils rendent aux particuliers pour leurs communications, pour le transport de leurs marchandises ou de leurs denrées, pour l'exploitation de leurs propriétés, peuvent être très-utiles au public, par la facilité qu'ils donnent aux approvisionnemens, aux transports, aux communications dont le gouvernement ne saurait se passer, et qui souvent sont nécessaires, non-seulement à la [I-434] bonne administration de l'État, mais à sa défense et à sa sûreté. De tels travaux, d'ailleurs, quand ils sont bien entendus, et qu'ils sont exécutés avec économie, donnent toujours une impulsion plus ou moins forte à tous les genres de perfectionnement; car ce n'est souvent qu'en comparant leur situation à une situation supérieure, que les hommes font des progrès, et cette comparaison ne peut avoir lieu qu'autant que les communications sont faciles et fréquentes.
Enfin, il est des nations dont les mœurs admettent peu les entreprises faites par association, et chez lesquelles tous les grands travaux d'utilité publique sont exécutés sous les ordres et par les agens du gouvernement. Un tel état de choses est loin d'être bon; mais il faut bien l'accepter comme un fait tant qu'il existe, et jusqu'à ce que les mœurs ou les lois aient établi un ordre de choses différent. Or, c'est dans la supposition d'un tel état qu'ont été posées les questions qui se trouvent en tête de ce chapitre.
Il n'est presque pas de propriété foncière qui ne puisse recevoir un accroissement considérable de valeur, par suite de certains travaux publics; qu'un canal ou qu'un chemin de fer soit établi à travers une forêt qui n'avait que des communications difficiles et coûteuses, et que le bois puisse être, à peu de frais, transporté dans des lieux où il s'en fait [I-425] une grande consommation; aussitôt la valeur de la forêt sera considérablement augmentée. L'effet produit par la création d'un moyen de communication peu dispendieux, serait le même sur une terre qui renfermerait une mine de fer ou de charbon, des carrières de marbre, ou d'autres matières qui sont d'un grand poids ou d'un grand volume, comparativement à leur valeur. Il suffit, au reste, pour juger du prix que donne à une propriété foncière un moyen de communication peu coûteux, de comparer le prix des terres situées aux environs d'une grande ville, au prix des terres qui sont éloignées des lieux où se font les grandes consommations.
Une loi du 16 septembre 1807 a prévu les cas où, par l'effet de certains travaux publics, une partie du territoire national recevrait immédiatement une augmentation de valeur; et elle a déterminé la part de dépenses qui devrait être supportée par la population à laquelle l'ouvrage exécuté serait profitable.
Suivant cette loi, lorsque, par l'ouverture d'un canal de navigation, par le perfectionnement de la navigation d'une rivière, par l'ouverture d'une grande route, par la construction d'un pont, un ou plusieurs départemens, un ou plusieurs arrondissemens, sont jugés devoir recueillir une amélioration de leur territoire, ils sont tenus de contribuer [I-436] aux frais des travaux; leur charge ne peut néanmoins s'élever au-delà de la moitié de la dépense qu'exige l'entreprise [200].
S'il y a lieu à l'établissement ou au perfectionnement d'une petite navigation ou d'un canal de flottage, à l'ouverture ou à l'entretien de grandes routes d'intérêt local, à la construction ou à l'entretien de ponts sur ces mêmes routes ou sur des chemins vicinaux, les départemens contribuent dans une proportion, les arrondissemens les plus intéressés dans une autre, les communes les plus intéressées dans une autre, et chacun dans la proportion de l'utilité qu'il doit retirer des travaux à exécuter; dans ces cas, l'État ne fournit une partie des fonds que s'il le juge convenable.
Si, par suite des travaux précédemment énoncés, ou par l'ouverture de nouvelles rues, par la formation de places nouvelles, par la construction de quais, ou par tous autres travaux publics généraux, départementaux ou communaux, ordonnés ou approuvés par le Gouvernement, des propriétés privées ont acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés peuvent être chargées de payer une indemnité, qui peut s'élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu'elles ont acquis.
[I-437]
Les propriétaires dont les biens ont augmenté de valeur, ont la faculté de payer la plus-value en argent ou en rentes constituées à quatre pour cent net, ou par le délaissement d'une partie de la propriété, si elle est divisible; ils peuvent aussi délaisser en entier les fonds, terrains ou bâtimens dont la plus-value donne lieu à l'indemnité. S'ils optent pour le délaissement, il a lieu sur l'estimation réglée d'après la valeur qu'avait l'objet avant l'exécution des travaux qui ont produit la plus-value.
Les indemnités ne sont dues cependant par les propriétaires des fonds voisins des travaux effectués, que lorsqu'il a été décidé par un règlement d'administration publique, rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, et après avoir entendu les parties intéressées, qu'il y a lieu à l'application des dispositions précédentes.
Si, par suite de l'alignement d'une rue, un propriétaire acquérait la faculté de s'avancer sur la voie publique, il serait tenu de payer la valeur qui résulterait pour lui de l'exercice de cette faculté ; s'il refusait de payer la valeur du terrain qui lui serait abandonné, il pourrait être contraint de céder lui-même sa propriété à l'administration, au prix qu'elle avait avant l'entreprise des travaux d'alignement.
Si un propriétaire était obligé à céder une partie [I-438] de sa propriété pour l'exécution de travaux publics, et si, par suite de ces travaux, la partie qui lui reste acquérait une valeur immédiate et spéciale, cette augmentation pourrait être prise en considération dans l'évaluation de l'indemnité à laquelle il aurait droit. (Loi du 7 juillet 1833, art. 51.)
Toutes les fois qu'il s'agit de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves ou rivières et torrens navigables, la nécessité en est constatée par le Gouvernement; mais la dépense en est supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux, à moins qu'il ne soit jugé utile et juste de leur accorder des secours sur les fonds publics.
Lorsqu'il y a lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation des mêmes travaux, au curage des canaux qui sont en même temps de navigation et de desséchement, ou de pourvoir à des dépenses de levées, de barrages, de pertuis, d'écluses, auxquels des propriétaires de moulins ou d'usines sont intéressés, la part contributive de l'État et des propriétaires est fixée par des règlemens d'administration publique.
S'il y a lieu d'ouvrir ou de perfectionner une route ou des moyens de navigation, dont l'objet est d'exploiter avec économie des forêts ou bois, des mines ou minières, ou de leur fournir un débouché, toutes les propriétés de cette espèce, [I-439] nationales, communales ou privées, qui doivent en profiter, contribuent, pour la totalité de la dépense, dans les proportions variées des avantages qu'elles doivent en recueillir. Dans ces cas, comme dans les précédens, les propriétaires se libèrent ou en argent, ou en rentes à quatre pour cent, ou par le délaissement de la propriété au prix qu'elle avait avant l'exécution des travaux qui ont produit la plus-value.
Enfin, s'il s'agit de travaux de salubrité qui intéressent les villes et les communes, ils sont ordonnés par le Gouvernement; mais les dépenses en sont supportées par les communes ou par les villes intéressées. Cependant, si, par suite de ces travaux, des propriétés privées acquéraient un accroissement de valeur ou des avantages particuliers, les propriétaires seraient tenus de contribuer aux dépenses en raison de l'utilité particulière qu'elles auraient pour eux.
Lorsqu'il s'agit de déterminer l'influence produite par des travaux publics sur la valeur de certaines propriétés privées, ou sur le territoire d'une commune ou d'un département, il ne faudrait pas, au reste, se flatter d'arriver à une exactitude mathématique ; dans des calculs de ce genre, on est obligé de se contenter d'approximations, et de suivre des règles générales d'équité. Il ne faudrait pas non plus faire entrer en ligne de compte les avantages [I-440] qui pourront résulter, dans l'avenir, de l'exécution de ces travaux, pour des particuliers ou pour des communes; il ne faut calculer que l'accroissement immédiat de valeur, car c'est le seul qui ne puisse pas être mis en doute. Si l'on se jetait dans les probabilités de l'avenir, il n'y aurait ni limites, ni règles aux évaluations; on ne trouverait, dans le temps, aucun point auquel il fût permis de s'arrêter. Il n'y a pas d'autre moyen de savoir si, par l'effet de certains travaux, une propriété a augmenté de valeur, que de comparer le prix auquel elle aurait pu être vendue avant qu'il fût question de ces travaux, au prix qu'on en trouverait immédiatement après qu'ils ont été exécutés.
Les dispositions qui obligent des propriétaires payer une partie des dépenses qui ont augmenté la valeur de leurs propriétés, ne sont que des conséquences du principe de justice qui veut qu'on garantisse à chacun le sien, aux nations comme aux particuliers; mais il semble qu'on a dérogé à ce principe, quand on a laissé au Gouvernement la faculté, soit de faire exécuter, aux dépens de l'État, des travaux destinés à protéger des propriétés particulières, soit de ne pas exiger la plus - value qui résulte pour des propriétés privées, communales ou départementales, des dépenses faites par l'État.
L'article de la loi qui met à la charge des propriétaires intéressés la construction des digues [I-441] destinées à arrêter les eaux de la mer, des fleuves, rivières et torrens navigables, donne, en effet, au Gouvernement la faculté de payer lui-même une grande partie des frais ; et les articles qui soumettent les particuliers, les communes ou les départemens, à contribuer aux travaux qui doivent augmenter la valeur de leurs propriétés, restent sans effet, toutes les fois que cela convient aux vues de l'administration.
Cette faculté de faire tomber sur le public des charges dont un petit nombre de personnes ou quelques fractions de la population retirent les principaux avantages, devait produire et a souvent produit de nombreux abus. Elle a été un moyen puissant de corruption: les ministres s'en sont plus d'une fois servis dans les élections, pour payer la complaisance ou la servilité des électeurs aux dépens de la généralité des citoyens. Ils en ont fait usage, non pour faire exécuter d'utiles travaux, dans des pays où la population n'était pas assez riche pour y contribuer, mais pour se concilier la faveur des personnes dont l'opinion leur était peu favorable. Les habitans des Alpes ou des Pyrénées out été ainsi condamnés à payer les monumens de luxe de telle ville qu'ils ne verront jamais, tandis que ceux qui en jouissent tous les jours, n'y ont pas plus contribué que s'ils n'avaient eu aucun intérêt particulier à leur construction.
[I-442]
Mais, quels que soient les abus qui sont résultés de cette faculté, on aurait tort de penser qu'un peuple ne doit jamais faire exécuter que les travaux dont les avantages se répartissent d'une manière à peu près égale sur la population tout entière; il arrive souvent, au contraire, qu'un peuple a le plus grand intérêt à faire des dépenses dont les avantages apparens et immédiats ne tombent que sur une des fractions de lui-même, et quelquefois sur une des fractions les moins dignes d'intérêt.
Lorsque les diverses parties dont une nation se compose, ne sont pas toutes parvenues au même degré de civilisation, et que néanmoins elles jouissent des mêmes droits civils et politiques, les moins avancés profitent de tous les avantages qui sont la suite naturelle des progrès que les autres ont faits. De leur côté, celles qui se trouvent au premier rang par leurs richesses, leurs mœurs et leurs lumières, ont à souffrir une partie des maux qui résultent de la misère, des vices et de l'ignorance des autres parties. Dans toute association, il y a toujours une sorte de solidarité pour le mal comme pour le bien entre les associés.
Si, par exemple, une partie de la population est assez vicieuse ou assez ignorante pour se faire représenter dans une assemblée législative, par des hommes disposés à sacrifier sans cesse l'intérêt [I-443] public à leurs intérêts individuels, les conséquences de son ignorance et de sa corruption ne tomberont pas exclusivement sur elle; elles se feront sentir sur toutes les parties qui n'auront pas de pareils reproches à se faire. Si elle est assez aveugle ou assez corrompue pour être l'instrument d'une faction, ou pour devenir l'auxiliaire de l'ennemi en cas d'invasion, son aveuglement et ses vices ne seront pas funestes seulement pour elle, ils le seront principalement pour ceux qui ne les partageront pas.
Des nations ont quelquefois pensé qu'il était de l'intérêt de leur industrie, de leur commerce, de leur sûreté, de porter la civilisation chez les nations voisines ; et si cette politique, aussi éclairée que généreuse, mérite d'être approuvée, à combien plus forte raison ne faudrait-il pas approuver les efforts et les sacrifices d'un peuple qui chercherait à répandre les bienfaits de la civilisation d'une manière à peu près égale sur toutes les parties de son territoire! Si les divers gouvernemens qui se sont succédé parmi nous depuis la révolution de 1789, avaient fait, pour civiliser certaines parties de la France, la moitié des frais qu'ils ont cru devoir faire pour les surveiller, les combattre, les subjuguer ou les corrompre, ils seraient parvenus à des résultats plus satisfaisans que ceux qu'ils ont obtenus. Les autres parties de la nation auraient eu [I-444] des charges moins lourdes à supporter, et les dépenses qu'elles auraient faites, auraient tourné au profit de leur industrie, de leur commerce et de leur propre sûreté. Ainsi, en admettant les que personnes dont les propriétés augmentent considérablement de valeur, par l'effet des travaux exécutés aux frais du public, doivent supporter, dans les dépenses, une part proportionnée aux avantages particuliers qu'elles en retirent, il ne faudrait pas tirer de ce principe la conséquence qu'un peuple ne doit jamais faire exécuter à ses frais, que les travaux qui profitent d'une manière à peu près égale à chacune des diverses fractions dont il se compose, ou ceux dont il peut se faire rembourser la dépense, quand cette dépense tourne au profit particulier d'une ou plusieurs personnes d'une commune ou d'un département. Il y a certainement des circonstances dans lesquelles une nation, pour son intérêt, doit faire des sacrifices dans l'intérêt de quelques-unes des fractions dont il se compose, et quelquefois même dans l'intérêt d'autres nations. Il faut seulement prendre garde que la faculté de faire ainsi des sacrifices qui doivent produire un avantage immédiat et spécial pour certaines personnes ou pour certaines parties de la société, ne devienne, entre les mains de ceux qui ordonnent les travaux, un [I-445] moyen de corruption ou une source de scandaleuses faveurs.
La loi du 16 septembre 1807 n'imposait aucune condition, aucune règle au gouvernement; elle laissait sans garantie les intérêts de la société; et c'est en cela surtout qu'elle était vicieuse. La loi du 7 juillet 1833, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, a mis quelques bornes à son pouvoir, en déclarant que les grands travaux publics ne pourraient être exécutés qu'en vertu d'une loi, qui ne serait rendue qu'après une enquête administrative. Cependant le domaine de l'arbitraire est encore fort vaste, puisqu'il suffit d'une simple ordonnance pour autoriser l'exécution des routes, des canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de vingt mille mètres de longueur, des ponts et de tous autres travaux de moindre importance.
Cette dernière loi a créé des garanties très-précieuses pour les propriétés privées, communales ou départementales, contre les empiétemens que le gouvernement pourrait être tenté d'exécuter dans l'intérêt de certaines entreprises; mais elle n'a pas garanti avec le même soin les intérêts du public. On y trouve les qualités et les vices qui affectent la plupart de nos modernes institutions, assez de soin des intérêts privés, et un abandon [I-446] presque complet de l'intérêt général. Les hommes qui gouvernent de notre temps, trouvent qu'il y a plus de profit et moins de danger à faire leurs affaires aux dépens de la masse de la population, qu'aux dépens de quelques individus ou de quelques familles. On était jadis moins habile.
[I-447]
CHAPITRE XXIV.
De la dépréciation causée à des propriétés particulières par des travaux exécutés dans un intérêt public.↩
L'EFFET que produisent ordinairement les travaux publics sur les propriétés situées près des lieux où ils s'exécutent, est d'en accroître la valeur. Une maison au devant de laquelle on fait une belle rue ou une place publique, une terre auprès de laquelle on fait passer une grande route ou un canal, ont plus de valeur après l'exécution de ces travaux qu'elles n'en avaient auparavant. Il peut arriver cependant que certaines propriétés soient dépréciées par l'exécution de certains travaux publics: on peut, par exemple, en canalisant une rivière ou en y construisant des barrages, priver certaines propriétés de l'eau dont elles ont besoin, ou en faire refluer sur d'autres plus qu'elles n'en demandent. Il est juste qu'en pareil cas les dommages causés soient réparés par ceux à qui les travaux profitent, ou par ceux qui se sont chargés de les faire exécuter.
[I-448]
La loi du 16 septembre 1807 a prévu quelquesuns des cas dans lesquels des propriétés particulières sont dépréciées par l'exécution de certaines entreprises formées dans un intérêt public. Si, par exemple, pour opérer un desséchement, ouvrir une nouvelle navigation, ou construire un pont, il est nécessaire de porter atteinte à des propriétés privées telles que des moulins ou d'autres usines, les propriétaires doivent être indemnisés par l'État, quand c'est lui qui entreprend les travaux, ou par les concessionnaires, quand c'est par concession qu'ils sont exécutés. Il n'y a lieu cependant à une indemnité qu'autant que l'établissement des moulins et usines est légal, ou que le titre d'établissement ne soumet pas les propriétaires à voir démolir leurs constructions sans indemnité, si l'utilité publique le requiert.
Les terrains nécessaires pour l'ouverture de canaux et rigoles de desséchement, des canaux de navigation, de routes, de rues, la formation de places, et autres travaux reconnus d'une utilité générale, doivent, suivant la loi, être payés aux propriétaires d'après la valeur qu'ils avaient avant l'entreprise des travaux, et sans augmentation du prix d'estimation. Mais il ne faut pas apprécier le terrain enlevé comme s'il était isolé, et ne faisait point partie du terrain dont l'État ne juge pas utile de s'emparer: l'indemnité, pour être juste, [I-449] doit être calculée suivant la dépréciation qu'éprouve la propriété entière par l'effet des travaux exécutés.
Il peut arriver que la partie de la propriété dont l'État s'empare, soit si considérable comparativement à celle dont il n'a pas besoin, que le propriétaire ne tienne plus à conserver ce qui reste. Ce cas, que la loi du 16 septembre 1807 ne prévoyait pas, a été prévu par celle du 7 juillet 1853 : l'article 50 de celle-ci dispose que la propriété sera acquise en entier quand le propriétaire l'exigera, si, par suite du morcellement, elle se trouve réduite au quart de la contenance totale, pourvu toutefois que le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement continu, et que la parcelle, ainsi réduite, soit inférieure à dix ares. La loi n'admet aucune distinction quant à la nature ou à la destination des terrains; il est clair cependant que, si une route ou un canal coupait en deux un enclos attenant à une maison, le propriétaire qui ne serait pas cultivateur pourrait ne pas vouloir conserver la partie détachée de son habitation, quand même cette partie aurait plus de dix ares. Quelquefois, au lieu de prendre une partie d'une propriété privée pour faire une route, l'État n'a besoin que d'y prendre des matériaux pour entretenir une route déjà faite. La loi du 28 septembre 1791 avait déclaré, comme on l'a vu [I-450] précédemment, que les agens de l'administration ne pourraient fouiller dans un champ pour y chercher des pierres, de la terre ou du sable nécessaires à l'entretien des grandes routes ou autres ouvrages publics, qu'au préalable le propriétaire n'eût été averti et indemnisé [201]. L'art. 55 de la loi du 16 septembre 1807 a ajouté que les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions publiques, pourraient être payés aux propriétaires comme s'ils avaient été pris pour la route même. C'est donc la valeur du terrain occupé et non la valeur des matériaux qui en sont extraits, qui doit être payée au propriétaire. Si cependant l'État s'emparait d'une carrière déjà en exploitation, il y aurait lieu de faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire. Ils seraient évalués, dans ce cas, d'après leur prix courant, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route ou des constructions auxquelles on la destine.
Une maison n'est pas susceptible d'être divisée de la même manière qu'un terrain sur lequel il n'existe aucune construction. Aussi, la loi du 16 septembre 1807 et celle du 7 juillet 1833, déclarent-elles que les maisons et bâtimens dont il est nécessaire d'acquérir une portion pour cause [I-451] d'utilité publique, seront achetés en entier si les propriétaires le requièrent. On a bien senti qu'une maison dont on emporterait une partie pour faire une place publique ou élargir une rue, pourrait ne plus convenir aux besoins du propriétaire. On n'aurait pu, sans injustice, laisser à sa charge les soins de la faire reconstruire, ou de la vendre en état de démolition.
Si un propriétaire fait volontairement démolir sa maison, ou s'il est contraint de la faire démolir pour cause de vétusté, et qu'il soit contraint à reculer sa construction pour observer l'alignement prescrit par les autorités compétentes, quelle sera l'indemnité à laquelle il aura droit? La loi du 16 septembre (art. 50) ne lui accorde une indemnité que pour la valeur du terrain délaissé; et il ne saurait en effet exiger plus. Des constructions peuvent augmenter la valeur d'un terrain tant qu'elles existent; mais du moment qu'elles ont disparu, le terrain n'a pas plus de valeur qu'il n'en aurait, si jamais il n'y avait existé de bâtiment.
Des propriétaires qui n'auraient fait sur leurs terrains des plantations, des constructions ou d'autres travaux, que dans la prévoyance qu'ils seraient dépossédés pour cause d'utilité publique, et dans la vue d'obtenir une plus forte indemnité, n'auraient droit, en réalité, qu'à une valeur égale [I-452] à celle que leur terrain avait avant ces travaux [202]. S'il n'est pas juste que l'État s'enrichisse aux dépens des particuliers, il ne l'est pas non plus que les particuliers s'enrichissent aux dépens de l'État.
Il arrive souvent que, sans toucher à certaines propriétés particulières, l'Etat leur fait éprouver une dépréciation considérable, au moyen des travaux dont il ordonne l'exécution. Un canal qui détourne le commerce d'une route qu'il avait coutume de suivre, fait baisser la valeur de la plupart des propriétés qui sont situées sur cette route. Si ensuite un chemin de fer détourne d'un autre côté les marchandises que transportait le canal, d'autres propriétés se trouveront encore dépréciées. Il est vrai que quelques-unes de celles qui se trouveront placées près du nouveau chemin auront acquis un accroissement de valeur.
La dépréciation qui, dans des cas pareils, résulte, pour certaines propriétés, des travaux exécutés dans l'intérêt de l'État, est analogue à celle qui résulte pour des fabricans de l'introduction de nouvelles machines. Toutes les fois qu'un moyen de production plus puissante ou moins dispendieuse que ceux qui existaient déjà, est introduit, les anciens perdent une grande partie de leur valeur. Une route qu'on ne parcourt qu'au moyen de [I-453] frais considérables, peut, comme une mauvaise machine, être remplacée par un moyen de communication moins coûteux ou plus rapide.
Avant que de faire opérer un changement semblable, un gouvernement doit calculer sans doute, les inconvéniens et les avantages qui en résulteront; et il est tenu par conséquent de prendre en considération les dommages qu'éprouveront les propriétés situées sur l'ancienne route, comme l'augmentation des valeurs qui aura lieu pour les propriétés situées sur la route nouvelle; mais indépendamment de ces deux classes d'intérêts qui ne sont lesés ou favorisés qu'accidentellement, il y a des intérêts d'un autre ordre auxquels tous les autres doivent céder, ce sont ceux du public au profit de qui tous les grands travaux sont exécutés.
Dans une société très-avancée dans la civilisation, tous les intérêts sont tellement liés les uns aux autres, qu'un homme ne peut faire subir à ses propriétés de grandes modifications, sans causer à ses voisins quelque profit ou quelque dommage. Un homme qui transforme une terre stérile ou marécageuse en une campagne riante, donne de la valeur à toutes les propriétés des environs; celui qui, dans une grande ville, couvre de bâtimens un magnifique jardin, déprécie toutes les maisons dont la vue s'étendait sur sa propriété. Le premier ne peut exiger de ses voisins aucune indemnité [I-454] pour les avantages qu'il leur procure; le second ne peut être condamné à aucun dommage pour le tort qu'il leur fait. Chacun a usé de son droit.
L'Etat est, à l'égard des particuliers, dans la position où ils se trouvent les uns à l'égard des autres : quand il fait exécuter dans son intérêt certains travaux, il peut favoriser ou blesser indirectement quelques particuliers; mais s'il ne gêne personne dans la faculté de jouir et de disposer de ses propriétés, ou dans l'exercice de son industrie; s'il use de ses droits comme un particulier des siens, nul n'est fondé à lui demander le paiement d'une indemnité.
[I-455]
CHAPITRE XXV.
De la loi sur le desséchement des marais qui appartiennent à des particuliers ou à des communes.↩
LE DROIT qu'a chacun de jouir et de disposer des choses qui lui appartiennent, est limité par le droit qu'ont les autres de jouir et de disposer des choses qui sont à eux. Nul ne peut donc faire de ses biens un emploi qui troublerait ses voisins dans la jouissance ou dans la disposition de ceux dont la propriété leur est dévolue. Or, parmi les objets dont on ne peut avec justice contester le libre usage à personne, il n'en est pas de plus nécessaire que l'air. Des terres qui, par l'état où elles se trouvent, vicient l'air qu'on respire dans le voisinage, non seulement altèrent une chose dont la jouissance appartient en commun à tous les hommes, mais elles déprécient en outre tous les biens sur lesquels leur influence se fait sentir. Lorsque des terres semblables existent, les particuliers ou les communes à qui elles appartiennent, doivent done être tenus de les mettre dans un état tel qu'elles ne [I-456] ne puissent pas nuire; s'ils n'en ont pas le moyen, l'administration doit remplir ce devoir pour eux, et leur en faire supporter les charges.
La loi qui prescrit le desséchement des marais, soit qu'ils appartiennent à des particuliers, soit qu'ils appartiennent à des communes, a eu pour objet, en effet, d'empêcher que les exhalaisons malfaisantes que répandent les propriétés de ce genre, ne corrompent l'air nécessaire à l'existence des habitans des environs, et ne troublent ainsi la jouissance d'une chose qui appartient à tous les hommes; elle a eu de plus pour objet d'empêcher que les propriétés situées auprès des marais ne soient dépréciées par le seul effet de ce voisinage; enfin, elle a voulu livrer à la culture des terres que l'état habituel d'inondation dans lequel elles se trouvent, rend presque inutiles pour ceux mêmes qui en sont les possesseurs.
La loi, pour être parfaitement juste, avait à veiller à trois genres d'intérêt aux intérêts des particuliers affectés dans leurs personnes ou dans leurs biens, par le voisinage des terres marécageuses; aux intérêts des propriétaires des marais, et à ceux de l'État qui fait exécuter les desséchemens par des entrepreneurs, ou qui les exécute lui-même à ses risques. Le législateur avait à déterminer par quelles personnes un desséchement pourrait être provoqué, dans quelles formes l'utilité ou [I-457] la nécessité en seraient constatées, par quelle autorité les difficultés auxquelles l'opération donnerait naissance, seraient résolues. Les intérêts de ces trois classes de personnes pouvant se trouver en conflit, il fallait que les formes suivant lesquelles on aurait à procéder, et les autorités qui seraient appelées à prononcer, fussent des garanties égales pour tous.
Personne ne peut mieux savoir si, par les exhalaisons qu'il répand, un marais vicie l'air du voisinage, que ceux qui sont exposés à en éprouver les funestes influences. Tout homme qui prouve qu'il est lésé dans sa personne ou dans ses biens par l'existence de tel ou tel marais, devait donc être admis à en provoquer le desséchement. Le silence gardé par lui-même ou par ses ancêtres, pendant une longue suite d'années, ne pourrait pas être un motif de lui refuser cette faculté; car, en admettant, ce qui n'est pas prouvé, qu'une personne puisse, par son silence, contracter l'obligation de respirer un air mal sain jusqu'à la fin de sa vie, on ne peut pas reconnaître qu'elle ait le droit de prendre un tel engagement pour ses descendans, jusqu'à la postérité la plus reculée. Un particulier et une commune peuvent bien acquérir, par la prescription, les choses qui font partie du domaine privé, telles que des terres, des maisons, des meubles; ils ne peuvent pas acquérir, [I-458] par le même moyen, le droit de vicier des choses qui sont la propriété commune du genre humain. Un père ne peut pas déshériter ses enfans du droit de respirer, ou les condamner à vivre dans une atmosphère mal saine, comme il peut imposer une servitude sur les champs ou sur la maison qu'il leur transmet.
La loi du 16 septembre 1807, qui donne au gouvernement le pouvoir de juger s'il est utile ou nécessaire de dessécher un marais, ne détermine ni les personnes qui peuvent demander le desséchement, ni les formes à suivre pour en constater la nécessité. Sans doute, on n'a pas cru qu'il fût nécessaire d'indiquer les personnes par lesquelles la demande pourrait être faite; car ici, comme partout, l'action appartient à tout homme ayant intérêt et capacité pour agir. Mais on ne pouvait pas croire également qu'il fût inutile de déterminer les formes au moyen desquelles les particuliers ou les communes lésés par l'existence d'un marais. pourraient constater le dommage, et la nécessité du desséchement. Le gouvernement est donc resté libre d'agir ou de ne pas agir, selon que cela conviendrait à ses vues.
Les terres marécageuses ont infiniment moins de valeur que celles qui sont propres à la culture; si les propriétaires laissent exister des marais, ce n'est donc point par suite d'un calcul de leur part; [I-459] c'est, ou parce qu'ils ne savent pas les dessécher, ou parce qu'ils n'ont pas de moyens suffisans, ou parce qu'ils ne peuvent pas s'entendre entre eux. Il n'y a donc aucune faute à leur imputer, ņi aucune peine à leur infliger: aussi la loi se borne-t-elle à prescrire des mesures pour opérer le desséchement, sans s'occuper des dommages que le marais peut avoir causés.
Si, lorsque le desséchement d'un marais est ordonné, et que les conditions en ont été réglées, les propriétaires consentent à l'entreprendre, la loi veut que la concession leur en soit adjugée; si non le gouvernement l'adjuge aux entrepreneurs qui font la soumission la plus avantageuse; il peut le faire exécuter aux frais de l'État, s'il ne se présente pas des entrepreneurs. Ni l'ordonnance qui prescrit le desséchement, ni celle qui l'adjuge à une compagnie ou à l'Etat, n'ont pour objet ni pour effet de dépouiller les propriétaires de leurs. propriétés; mais comme les travaux à exécuter doivent avoir pour résultat d'en augmenter la valeur, il importe qu'on puisse bien constater en quoi l'augmentation consiste, afin qu'après l'opération, cha cun puisse reprendre la part qui lui revient dans la valeur totale des terres desséchées.
Il n'arrive jamais que toutes les parties d'un vaste marais soient également improductives, ou également difficiles à mettre en culture; elles valent [I-460] plus ou moins, selon que, pour donner un revenu déterminé, elles exigent des capitaux plus ou moins considérables. Il faut donc, avant que les travaux de défrichement soient commencés, que les terrains de valeurs diverses qui doivent en profiter, soient classés et estimés. La loi exige qu'il en soit fait un plan général, que chaque propriété y soit distinguée, et que l'étendue en soit exactement circonscrite. Les terrains sont ensuite divisés en diverses classes, selon les divers degrés d'inondation. Le nombre de ces classes ne peut être ni au-dessous de cinq, ni au-dessus de dix.. Si la valeur présumée des différentes parties éprouve des variations autres que celles qui proviennent des divers degrés de submersion, les classes sont formées sans égard à ces degrés. Dans tous les cas, les terres qu'on présume de même valeur, sont mises dans la même classe. Le périmètre des diverses classes est tracé sur le plan cadastral qui a servi de base à l'entreprise.
Lorsque ce plan a été arrêté par l'administration, qui ne prononce qu'après avoir entendu les parties intéressées, ou du moins après leur avoir donné le temps et les moyens de se faire entendre, des experts nommés par les propriétaires et les entrepreneurs, procèdent à l'appréciation de chacune des classes composant le marais, eu égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation dans [I-451] son état de marais. Sur leur rapport, et après avoir entendu les parties, une commission spéciale fixe irrévocablement la valeur des terrains de chaque classe.
Les travaux de desséchement commencent aussitôt que l'évaluation définitive des terrains a été faite; dès qu'ils sont terminés, il est procédé à leur vérification. Des experts sont encore nommés, et ils procèdent, de concert avec des ingénieurs, à la classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle, et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles.
Quand l'estimation des fonds desséchés est arrêtée, les entrepreneurs du desséchement présentent à la commission formée dès le commencement de l'entreprise, un rôle qui contient le nom des propriétaires, l'étendue de leurs propriétés, les classes dans lesquelles elles sont placées suivant le plan cadastral, l'énonciation de la première estimation calculée à raison de l'étendue des classes, le montant de la valeur nouvelle des propriétés depuis le desséchement; enfin la différence entre les deux estimations.
Les portions de terrains, qui n'ont pas pu être desséchées, ne donnent lieu à aucune réclamation de la part des entrepreneurs.
Le montant de la plus-value obtenue par le desséchement est ensuite divisé entre les propriétaires [I-462] d'une part, et les concessionnaires de l'autre, dans les proportions fixées par l'acte de concession.
Si le desséchement a été fait aux frais du Trésor public, la portion qui revient à l'Etat, est fixée de manière à ce qu'il soit remboursé de toutes ses dépenses. Il pourrait donc arriver que la valeur entière de la propriété, après le desséchement, fût emportée par les frais qui ont été faits pour mettre le terrain en état de culture.
Les propriétaires dont les terres ont été desséchées, peuvent se libérer de l'indemnité due à l'Etat, en délaissant une portion de fonds dont la valeur est calculée sur le pied de la dernière estimation. S'ils ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils peuvent constituer une rente sur le pied de quatre pour cent, sans retenue. Cette rente est toujours rachetable, même par portions, pourvu toutefois que ces portions ne soient pas au-dessous d'un dixième.
Les indemnités dues aux concessionnaires ou au Gouvernement, à raison de la plus-value résultant des desséchemens, ont privilége sur toute la plus-value, moyennant la transcription au bureau des hypothèques de l'arrondissement dans lequel les biens sont situés, de l'acte de concession ou de l'ordonnance qui ordonne le desséchement au compte de l'État.
[I-463]
S'il arrivait que le desséchement d'un marais ne pût être opéré par les moyens établis par la loi, ou qu'on ne pût y parvenir à cause des obstacles de la nature ou des oppositions des propriétaires, il pourrait y avoir lieu à expropriation pour cause d'utilité publique, moyennant une indemnité préalable.
Tant que les travaux ne sont pas terminés, les canaux, fossés, rigoles, digues et autres ouvrages, sont gardés et entretenus aux frais des entrepreneurs; mais, du moment qu'ils sont finis, et qu'ils ont été reçus, l'entretien et la garde sont aux frais des propriétaires.
L'administration fixe le genre et l'étendue des contributions nécessaires, sur la proposition des délégués des propriétaires, et de deux ou quatre d'entre eux, qui leur sont adjoints par l'administration elle-même.
La loi commet à l'administration la conservation des travaux de desséchement, celle des digues contre les torrens, rivières et fleuves, et sur les bords des lacs et de la mer.
Les réparations et dommages sont poursuivis par voie administrative, comme pour les objets de grande voirie. Les délit les sont par la voie ordinaire.
Il y a, dans cette loi sur le desséchement des marais, deux espèces de dispositions qu'il importe de [I-464] ne pas confondre : les unes sont relatives aux formes à suivre pour parvenir au desséchement; les autres touchent au principe même de la propriété.
Les premières sont loin d'être à l'abri de toute critique; elles semblent avoir été combinées bien plus pour seconder les vues de l'administration, que pour garantir les droits de toutes les personnes intéressées.
La loi veut que, lorsqu'un desséchement doit avoir lieu, un syndicat soit formé entre les propriétaires; mais c'est au préfet qu'elle donne la nomination des syndics. Elle prescrit la nomination de trois experts pour procéder à l'estimation des terrains; mais un de ces experts est nommé par les syndics élus par le préfet; un autre est choisi par le préfet lui-même; un troisième par des commissaires nommés par le Gouvernement, sur la présentation du préfet. Si le desséchement est opéré aux frais de l'État, le ministre nomme un expert; le préfet que le ministre a choisi, en nomme un second; les syndics nommés par le préfet, nomment le troisième.
Avant de commencer les travaux de desséchement, une commission de sept membres, qui ne peut prononcer sur les objets de sa compétence, à moins que cinq d'entre eux ne soient présens à ses délibérations, est formée. Elle doit connaître de tout ce qui est relatif au classement des diverses [I-465] propriétés, avant ou après le desséchement du marais, à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance, par les concessionnaires, d'une partie des produits, et à la vérification du rôle de plus-value des terres après le desséchement. Elle doit de plus donner son avis sur l'organisation du mode d'entretien des travaux de desséchement, arrêter les estimations, dans le cas où le Gouvernement aurait à déposséder tous les propriétaires d'un marais, et connaître des mêmes objets, lorsqu'il s'agit de fixer la valeur des propriétés avant l'exécution des travaux d'un autre genre. Mais les membres de cette commission, qui prononcent sur les estimations faites par les experts, sont eux-mêmes choisis par le Gouvernement; de sorte que ce sont toujours les délégués de l'autorité qui se contrôlent les uns les autres.
Si les propriétaires des marais sont mal représentés ou ne le sont pas du tout, dans les opérations qui préparent ou suivent le desséchement, les individus ou les communes qui peuvent être affectés par l'existence des marais ou par le dessé chement, ne le sont pas davantage; on ne paraît pas avoir pensé qu'ils peuvent avoir des intérêts à défendre dans des opérations de cette nature.
On ne peut pas faire aux dispositions qui se rapportent au principe même de la propriété, les [I-466] mêmes reproches qu'à celles qui constituent les autorités appelées à résoudre toutes les difficultés. Ces dispositions sont parfaitement justes, soit quand elles font un devoir du desséchement, soit quand elles règlent le partage de la propriété, après qu'elle a été mise en état d'être cultivée. Le principe que nul ne peut, au moyen d'une chose qui lui appartient, vicier une chose dont la jouissance appartient en commun à tous les hommes, telle que l'air atmosphérique, a été formellement reconnu. On a de même reconnu que toute valeur est la propriété de celui qui lui donne l'existence; car c'est d'après ce principe qu'a été réglé le partage des bénéfices qui résultent d'un desséchement.
[I-467]
CHAPITRE XXVI.
Des limites qu'imposent à chaque propriété, les propriétés dont elle est environnée.↩
De la faculté qu'a toute personne de jouir et de disposer de la chose qui lui appartient, il résulte nécessairement que nul ne peut faire de sa propriété un usage qui dégrade celle d'un autre. Chez une nation policée, il n'est pas de propriété qui ne touche immédiatement, de tous les côtés, à d'autres propriétés. Le champ qui n'a pas pour limites d'autres champs, est borné par un chemin, par une rivière ou par d'autres propriétés nationales, communales ou privées.
Mais comme il n'y a pas d'intervalle entre deux propriétés territoriales, et que l'une commence au point où l'autre finit, il serait impossible à une personne de disposer d'une manière absolue des confins de sa terre, sans porter atteinte à celle d'autrui. Il est clair, par exemple, que celui qui planterait des arbres de haute futaie à l'extrémité de son jardin ou de son champ, priverait son voisin [I-468] de la faculté d'en planter à l'extrémité de son propre terrain. Il ne serait pas d'ailleurs en son pouvoir d'empêcher les arbres qu'il aurait plantés de tirer de la terre qu'ils toucheraient une partie de leur subsistance.
L'obligation dans laquelle se trouve chaque propriétaire de respecter la propriété d'autrui, donne donc des limites à la faculté qu'il a de disposer de ses propres biens. Ainsi, par exemple, suivant la loi française, il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance de deux mètres de la ligne de séparation des deux héritages, et des haies vives ou des arbres qui ne sont pas de haute tige, qu'à la distance d'un demi-mètre. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés, et que les branches qui s'étendent sur son terrain soient coupées. Il peut couper lui-même les racines qui se sont avancées sur sa propriété [203].
C'est également pour garantir les propriétés de certaines personnes des dommages qu'elles pourraient éprouver par suite de la disposition des propriétés voisines, qu'il est interdit à tout propriétaire de faire creuser près du mur qui sépare sa propriété de celle d'autrui, un puits ou une fosse [I-469] d'aisance, ou d'y construire une cheminée où âtre, four ou fourneau, ou d'y adosser une étable, ou d'y établir un magasin de sel ou amas de matières corrosives, sans laisser la distance ou faire les ouvrages nécessaires pour éviter de nuire au voisin [204].
Les auteurs du Code civil, en classant parmi les servitudes ces obligations réciproques des propriétaires, ont certainement commis une erreur. Un homme n'est pas esclave, parce qu'il lui est interdit de faire de sa personne un usage qui porterait atteinte à la personne d'autrui. Une semblable interdiction est, au contraire, une condition essentielle de la liberté de tous. On ne peut pas dire, non plus, qu'une propriété est soumise à une servitude , par cela seul que le propriétaire ne peut pas en faire un usage qui nuirait aux propriétés voisines. Il y aurait véritablement servitude si un pareil usage ne pouvait être empêché; et cette servitude pourrait même devenir très-onéreuse.
Chez les nations où il n'existe point de terres qui n'aient été appropriées, toutes les propriétés étant [I-470] contiguës, il s'élève souvent des doutes, soit sur la question de savoir où commencent et où finissent les propriétés de chacun, soit sur la question de savoir à qui des deux propriétaires appartiennent les ouvrages ou les arbres placés sur les limites qui les séparent. Pour prévenir ces doutes, ou pour les faire cesser quand ils n'ont pas été prévenus, les auteurs du Code civil ont établi que tout propriétaire pourrait clore son héritage, ou obliger son voisin au bornage, à frais communs, de leurs propriétés contiguës. Ils ont ensuite établi certaines règles au moyen desquelles on pourrait juger à qui appartiennent certains objets litigieux, tels que des murs, des fossés, des haies ou des arbres de séparation.
Ils se sont encore trompés ici en mettant au rang des servitudes les obligations réciproques des propriétaires, dont l'objet est de bien déterminer où commence et où finit la propriété de chacun, et de la garantir d'usurpation ou de dommage. Peut-on considérer, par exemple, comme une servitude dérivant de la situation des lieux, l'obligation imposée à tout propriétaire de déterminer par des marques permanentes les points où sa propriété finit, et ceux où celle de son voisin commence? Peut-on mettre dans la même classe de servitudes le droit de clore son héritage, c'est-àdire le droit d'élever un mur, de creuser un fossé [I-471] ou de planter une haie sur un fonds qui lui appartient? Ce droit de clore son héritage n'est pas plus une servitude pour les propriétés voisines, que le droit de l'ensemencer, d'y planter des arbres ou d'y construire des bâtimens. C'est aussi sans aucun fondement qu'on a mis au rang des servitudes dérivant de la nature des lieux, la faculté qu'a tout propriétaire, soit d'user à sa volonté d'une source située dans son fonds, soit d'employer à l'irrigation de ses propriétés l'eau courante qui les traverse, à la charge de la rendre à son cours ordinaire [205].
Les haies, les fossés, les murs qui se trouvent entre deux héritages, sont quelquefois communs aux deux propriétaires, et quelquefois ils n'appartiennent qu'à l'un des deux. Les auteurs du Code civil ont adopté, pour juger les questions de propriété qui s'élèvent à cet égard, des règles dont [I-472] on ne saurait contester la sagesse ; mais ils se sont trompés, en mettant au rang des servitudes établies par la loi, les obligations qui résultent de ces règles pour les propriétaires. Ils déclarent, par exemple, que tout mur mitoyen servant de séparation entre bâtimens jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque contraire; ils considèrent également comme mitoyens, à moins de preuve contraire, les haies et les fossés qui séparent les deux héritages; mais l'indivision d'une propriété entre deux personnes, ne çonstitue pas, à proprement parler, une servitude pour l'une ou pour l'autre : elle donne à chacune la faculté d'en jouir dans la mesure de ses droits, à la charge de contribuer aux dépenses dans la même proportion [206].
Ayant admis que les murs, les fossés, les haies, placés entre deux héritages, sont mitoyens, à moins de preuve contraire, on a déterminé quelques-uns des faits qui serviraient à constater la non-mitoyenneté. Il y a marque de non-mitoyenneté pour un mur, par exemple, quand la sommité en est droite et à plomb de son parement d'un côté, et qu'elle [I-473] présente de l'autre un plan incliné; il y a encore marque de non-mitoyenneté, quand il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre mis en bâtissant le mur : dans ces cas, le mur est réputé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. Il y a marque de non-mitoyenneté, pour un fossé, lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve tout d'un côté ; le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
Quand on dit qu'une chose appartient à deux personnes, on dit, par cela même, que chacune des deux doit supporter une partie des charges de la propriété, et jouir d'une partie de ses avantages. Ainsi, la réparation et la reconstruction d'un mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun; de même l'entretien d'un fossé mitoyen doit se faire à frais communs. Dans ce cas, comme dans tous, chacun peut cependant se soustraire aux charges en renonçant aux bénéfices, c'est-à-dire en abandonnant la propriété, et en cessant d'en retirer aucun profit.
Les avantages se répartissent comme les charges : chacun des deux propriétaires peut donc faire bâtir contre le mur mitoyen, et faire placer dans toute l'épaisseur, à cinquante-quatre millimètres près [I-474] (2 pouces), des poutres ou solives; mais ces poutres doivent être réduites à moitié du mur, dans le cas où, du côté opposé, le propriétaire voudrait avoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
On voit bien dans ces dispositions des règles pour la jouissance d'une chose commune à deux propriétaires dont les héritages sont contigus; on n'y voit pas de servitudes proprement dites.
Le Code civil reconnaît à chacun des co-propriétaires d'un mur mitoyen la faculté de le faire exhausser; mais celui des deux qui use de cette faculté, doit à l'autre une indemnité pour la charge en raison de l'exhaussement; il supporte seul les frais de construction et pourvoit aux dépenses qu'exige l'entretien de la partie qu'il a construite. Si le mur mitoyen n'était pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui voudrait l'exhausser devrait le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédant d'épaisseur devrait être pris de son côté. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûtée, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s'il y en a. Celui dont la propriété joint un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen, en tout ou en partie, en remboursant à la personne à laquelle il appartient la moitié de la valeur de toute la portion [I-475] qu'il veut rendre mitoyenne, et la moitié de la valeur du sol sur lequel il est bâti.
L'un des voisins ne peut pratiquer, dans le corps d'un mur mitoyen, aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible à l'autre. Il lui est également interdit d'y pratiquer, sans le consentement de son co-propriétaire, aucune fenêtre ou ouverture, même à verre dormant.
Le propriétaire d'un mur non-mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut, pour recevoir la lumière, pratiquer, dans ce mur, des jours ou fenêtres à fer maillé et à verre dormant; mais il ne peut y faire des ouvertures propres à lui donner la vue de la propriété voisine. Les fenêtres qu'il lui est permis de pratiquer doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles doivent avoir un décimètre d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant. Elles ne peuvent être établies qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est au rez-de-chaussée, et à dix-neuf démètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. Un propriétaire ne peut avoir des vues droites, fenêtres d'aspect, balcons, ou autres semblables saillies sur l'héritage de son voisin, [I-476] à moins qu'il n'y ait entre le mur où il les pratique, et cet héritage, une distance de dix-neuf déci 'mètres (six pieds), ni de vues obliques, à moins d'une distance de six décimètres. Ces distances se mesurent depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, ou depuis la ligne extérieure du balcon ou saillie, jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
Un propriétaire ne peut pas non plus faire couler l'eau de ses toits sur la propriété de son voisin ; il doit la diriger de manière qu'elle tombe sur son propre héritage. Il n'est pas également obligé de détourner celle qui tombe sur ses terres, et qui coule naturellement sur les propriétés inférieures. Chacun est tenu de recevoir sur son héritage les eaux qui y descendent des fonds supérieurs, sans aucune participation des hommes, comme il est obligé de recevoir la pluie qui y tombe directement.
L'interdiction d'ouvrir des fenêtres dans un mur mitoyen, d'établir des vues immédiates sur un fonds dont on n'est pas maître, ou d'y faire couler artificiellement les eaux qui tombent sur son propre fonds, ne constitue pas des servitudes; elle est, au contraire, un moyen d'affranchir les propriétés : elle est une limite pour tous les propriétaires. Il y aurait servitude si un propriétaire était obligé de recevoir les eaux qui tomberaient sur les propriétés [I-477] de ses voisins, et qui lui seraient artificiellement envoyées, ou de souffrir des balcons, des saillies, ou même de simples fenêtres, immédiatement au-dessus de sa propriété.
On parlerait improprement si l'on disait qu'un homme est asservi, parce qu'il est soumis aux lois de sa propre nature, et qu'il lui est interdit de porter atteinte à la liberté de ses semblables. Il semble aussi qu'on s'exprime d'une manière inexacte quand on considère comme des servitudes les charges qui résultent, pour chaque propriété, de la nature des choses, et la défense d'en user pour se nuire mutuellement. Une défense qui s'applique à toutes les propriétés dans leur intérêt commun, et qui, par conséquent, n'établit aucun privilége en faveur d'aucune, est une garantie de liberté, et n'est pas une cause d'asservissement.
Les rédacteurs du Code civil se sont done trompés quand ils ont classé parmi les servitudes les limites données à chaque propriété, soit par la disposition des lois, soit par la nature des choses.
Les limites données à une propriété, dans l'intérêt des propriétés voisines, ne sont pas toujours réciproques; quand il n'y a pas réciprocité, il y a servitude de l'une au profit de l'autre. Cette servitude peut être le résultat des dispositions de la loi ou de la volonté des propriétaires. Dans le dernier cas, elle est réglée par l'acte même qui l'a [I-478] établie; dans le premier, elle doit l'être par l'intérêt public.
Les propriétés qui avoisinent les bois et forêts soumis au régime forestier, par exemple, sont assujéties à des charges qui ne pèsent pas sur les autres. Un propriétaire ne peut, sans l'autorisation du Gouvernement, établir sur sa propriété aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, à moins d'un kilomètre des forêts, sous peine d'une amende de cinq cents francs, et de démolition des établissemens.
Il lui est également interdit d'y établir, sans l'autorisation du Gouvernement, sous quelque prétexte que ce soit, aucune maison sur perches, loge, barraque ou hangar, sans observer la même distance, sous peine de démolition et d'une amende de cinquante francs.
Aucune construction de maisons ou fermes ne peut être effectuée sans la même autorisation, à la distance de moins de cinq cents mètres des bois et forêts, sous peine de démolition.
Il est interdit d'établir, sans une autorisation spéciale, dans les maisons situées à moins de cinq cents mètres des bois et forêts, aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour le commerce de bois, sous peine de confiscation des bois et d'une amende de cinquante francs.
Aucune usine à scier le bois ne peut, sans [I-479] autorisation, être établie à moins de deux kilomètres de distance des bois et forêts, à peine de démolition et d'une amende de cent à cinq cents francs.
Ces dernières dispositions ne sont cependant pas applicables aux maisons et usines qui font partie de villes, villages et hameaux formant une population agglomérée, quoiqu'elles se trouvent dans la distance déterminée par la loi [207].
Les terres qui environnent les places de guerre sont aussi assujéties à des charges qui ne pèsent pas sur les autres propriétés. Ces charges consistent généralement à n'y rien faire de ce qui pourrait nuire à la défense. Les constructions et les plantations propres à favoriser l'approche d'une armée ennemie y sont donc généralement interdites [208].
Les charges de cette nature imposées à quelques propriétés particulières, soit pour la conservation d'autres propriétés, soit pour la défense nationale, soit pour tout autre intérêt public, constituent véritablement des servitudes, et ne doivent pas être confondues avec les limites réciproques qui existent entre toutes les propriétés.
Lorsqu'on veut établir ainsi des charges sur quelques propriétés particulières, soit pour la conservation d'autres propriétés, soit dans un intérêt [I-480] général, on commence par indemniser les propriétaires auxquels on impose des sacrifices, de tous les dommages qu'on leur cause: le refus d'une indemnité aurait pour eux les effets d'une confiscation partielle.
Fin du premier volume
Notes
[1] Tome I, page 24.
[2] De nos jours, les nations sont encore considérées, dans la plus grande partie de l'Europe, comme la propriété des princes qui les gouvernent. Il suffit, pour en être convaincu de lire les traités qu'ils font entre eux.
[3] Voyez le livre IVe du Traité de législation.
[4] L'esclavage proprement dit n'est que l'assujétissement d'un être humain aux volontés ou aux caprices d'un individu de même espèce, qui le considère comme sa propriété. La dépendance dans laquelle un homme se trouve des choses au milieu desquelles la nature l'a placé, n'est pas l'esclavage. M. Dunoyer a donné aux mots esclavage et liberté un sens autre que celui qu'ils ont dans cet ouvrage. Voyez l'écrit qu'il a publié sous ce titre : De la morale et de l'industrie considérées dans leurs rapports avec la liberté.
[5] Les esclaves des colonies n'ont pas besoin d'un laissez-passer ou passeport, tant qu'ils ne veulent que se transporter d'une partie de la plantation à laquelle ils sont attachés, dans une autre partie. Les sujets des despotes orientaux peuvent aussi parcourir les états de leurs maîtres, sans être munis d'un laissez-passer. Les rois du continent européen ne laissent pas à leurs sujets une liberté aussi étendue.
[6] Quod enim nullius est, id ratione naturali occupant; conceditur. Dig. lib. 4, tit. 1, leg. 3 princ. - Grotius, De jure belli ac pacis, lib. 2, cap. 2, § 4 et 5. - Puffendorf, De jure naturæ et gentium, lib. Iv , cap. 6.
Occupancy... is the true ground and foundation of all property. Blackstone, Comment. on the laws of England, book 11, ch. 15.
Occupancy, doubtless gave the first title to property in lands and moveables. James Kent, Comment. an american law, part. v, lect. 34, p. 266.
[7] Unde etiam jus naturæ intelligitur adprobare omnes conventiones, quæ circa res ab hominibus sunt introductæ, modo contradictionem non involvant, aut societate proturbent. Ergo proprietas rerum immediatè ex conventione hominum, tacita aut expressa profluxit. Puffendorf, De jure naturæ et gentium, lib. xv, cap. IV, § 4.
[8] Traité de législation, liv. 3, t. 2.
[9] Traité de législation, liv. 5, ch. 23, p. 502.
[10] De mari libero.
[11] Gaii Instit. , comment., lib. 2, § 66-71. Justiniani Instit., lib. 2, tit. 1, § 11-24.--Dig., lib. 41, tit. 1.
[12] Art. 539.
[13] Blackstone, Comment., book 11, ch. 16, and 26. Thom. Edl. Tomlins, v° Occupant. James Kent, part. v, ect. xxxiv and xxxv, vol. 11, p. 256.
[14] En parlant ici des choses dont on peut disposer légitimement, c'est-à-dire d'une manière conforme aux lois, j'entends parler des lois inhérentes à notre nature, et non des actes de gouvernement qu'on désigne sous le même nom. Il y a quelquefois identité entre les unes et les autres; mais cela n'arrive pas toujours.
[15] Il ne faut pas conclure de là qu'il est bon d'attaquer par la force tous les traités qu'on ne trouve pas justes; l'emploi de la force réussit rarement, quand on y a recours avant que d'en avoir pesé les inconvéniens et les avantages, et surtout avant que d'avoir épuisé les moyens que fournissent la raison et la justice.
[16] W. Lawrence a donné l'histoire de l'enfant trouvé dans une forêt de Hanovre.
[17] Lahontan, Voy. dans l'Amérique sept.,t. 2, p. 175. — Byron, t. 1, chap. 12, p. 167. — Cook, troisième voyage, t. 5, liv. IV, chap. 1, p. 68, 67 et 66. Niebuhr, Voyage en Arabie.
[18] « La propriété territoriale, dit un voyageur, n'existe point dans les particuliers sauvages, parce que ne cultivant pas la terre, ou y jetant tout au plus passagèrement quelques grains de maïs, n'ayant pour demeure que de misérables cabanes qu'ils sont toujours prêts à abandonner, cette propriété personnelle doit leur être indifférente, et leur serait même à charge; mais la propriété nationale, celle qui détermine où chaque nation, chaque tribu a le droit de faire ses excursions de chasse, cette propriété existe dans toute son énergie parmi eux. C'est pour la défendre qu'ils se font des guerres terribles, où le plus fort extermine le plus faible, égorge femmes et enfans, tant que la nation ennemie existe, jusqu'à ce que ces malheureux débris aient été s'incorporer, se fondre dans d'autres nations. » (Robin, Voy. dans la Louis., t. 2, chap. 51, p. 307-308. Lahontan, Voy. dans l'Amér. sept., tom. 2, P. 175.
[19] Les Anglo-Américains qui achètent des terres des Sauvages, ne sont jamais en guerre avec eux; ceux qui les usurpent sont toujours exposés à des hostilités. L'état de Pensylvanie n'a jamais éprouvé d'agression de leur part; mais aussi, avant de se mettre en possession de ce pays, on en paya la valeur à la peuplade dont il était la propriété. (Weld, Voy. au Canada, t. 3, chap. 35, p. 102.-Lewis, Voy.dans l'Océan pacifique, p. xvj de la préface. Wright, lett. 12, p. 208-209.
[20] Pour se faire des idées nettes de la manière dont le genre humain se divise naturellement, on peut se représenter les vallées situées sur les versans opposés des montagnes, comme des triangles qui ne se rapprochent un peu que par leurs sommets, et dont les bases s'éloignent de plus en plus. La distance à laquelle ces triangles sont placés les uns à l'égard des autres, dépend de l'étendue des plateaux ou de l'élévation des montagnes. En s'avançant vers le sommet de chaque triangle, la population décroit en raison composée du rétrécissement des terres susceptibles de culture, de la dimininution de fertilité du sol, et de la difficulté des communications.
[21] L'ignorance a quelquefois produit des divisions plus vicieuses que celles qui ont été la suite de l'ambition et de la violence. Il suffit, par exemple, de jeter un coup d'œil sur une carte des États-Unis d'Amérique, pour être frappé de l'arbitraire qui règne dans la division de ces États. Le territoire des États-Unis du Mexique est, au contraire, divisé de la manière la plus conforme à la nature des choses. Le temps fera sentir les avantages de cette dernière division et les inconvéniens de la première.
[22] La Suisse comprend aussi une partie du bassin de l'Inn; mais cette partie est si petite qu'on peut la négliger ici.
[23] Je n'entends porter ici aucun jugement sur l'organisation politique de ces peuples; c'est un sujet que je traiterai plus tard, si j'en ai le temps.
[24] On peut faire, sur les états du centre de l'Europe, les mêmes observations que sur la Péninsule ibérique : il n'est rien au monde de plus propre à retarder les progrès de la civilisation que ce monstre qu'on a créé en 1815, sous le nom de Confédération germanique, et qui tend constamment à placer sous un même régime les populations des bassins du Rhin, de l'Elbe et du Danube.
[25] Les Sauvages eux-mêmes ont leurs eaux autour de leur territoire comme les peuples civilisés : ils ne souffrent pas que d'autres peuples viennent y prendre du poisson.
[26] Je me suis proposé dans ce chapitre d'exposer simplement quelles sont les limites naturelles du territoire de chaque nation et de celui de chacune des principales fractions dont elle se compose; je m'occuperai des effets qui résultent, soit des divisions contraires à la nature des choses, soit de la domination exercée par la population d'un grand sur une autre population, lorsque je traiterai de la division et de l'organisation politique de chaque peuple.
[27] Il ne faut pas confondre la valeur avec l'utilité. On désigne, par ce dernier mot, les qualités qui rendent une chose propre à satisfaire certains besoins, à procurer certaines jouissances. On désigne, par le premier, les qualités qui sont dans une chose, et qui la rendent propre à obtenir, par un échange, d'autres choses dont on a besoin. L'utilité indique le rapport qui existe entre la chose et l'usage qu'on en doit faire. La valeur indique le degré d'estime qu'on a pour une chose, quand on la compare à une autre contre laquelle elle peut être échangée. Un verre d'eau, dans certaines circonstances, a une grande utilité, quoiqu'il ait peu de valeur; un diamant peut avoir une grande valeur, quoiqu'en lui-même il ne soit pas d'une grande utilité. Il s'agit ici de l'utilité et de la valeur de la terre dans les contrées où la civilisation n'a pas pénétré.
[28] Cæs., Bell. Gall., lib. 7, cap. 9.
[29] Ibid. lib. 4, cap. 5.
[30] Ibid. lib. 5, cap. 1; lib. 6, cap. 5.
[31] Ibid. lib. 6, cap. 4.
[32] Ibid. lib. 5, cap. 4.
[33] Hume's, History of England, chap. XII (1265).
[34] Montesquieu avait très-bien aperçu les vérités que j'expose ici : « Quand les nations ne cultivent pas les terres, dit-il, voici dans quelle proportion le nombre des hommes s'y trouve. Comme le produit d'un terroir inculte est au produit d'un terrain cultivé, de même le nombre des sauvages, dans le pays, est au nombre des laboureurs dans un autre; et quand le peuple qui cultive les terres cultive aussi les arts, cela suit des proportions qui demanderaient bien des détails. » Esprit des lois, liv. XVIII, chap. x.
[35] Le gouvernement d'Archangel, avec une superficie de 30,000 lieues carrées, n'a qu'une population de 170,000 habitans, c'est-à-dire six individus par lieue carrée. Un hectare de terre, en France, est une propriété plus considérable que deux cents hectares dans cette partie de l'empire russe.
[36] Essai politique sur la Nouvelle Espagne, tome 2, liv. 3, chap. 8.
[37] Il est bien entendu que ces calculs ne peuvent avoir de l'exactitude qu'en comparant entre elles de grandes masses, et en comprenant dans la valeur du sol tout ce que l'industrie humaine en a fait sortir.
[38] Tableau du climat et du sol des États-Unis, t. 2, P. 472-476.
[39] Les bêtes qui ne vivent que de proie, sont rares et vont peu en troupes; pour fournir des subsistances, dans la saison la plus rigoureuse, aux animaux dont elles se nourrissent, il faut une étendue de terre immense; ajoutons qu'elles détruisent généralement tous ceux qu'elles rencontrent. L'homme, dans l'état sauvage, se conduit de la même manière : il se saisit de sa proie quand il peut s'en emparer; s'il la laissait échapper il ne serait pas sûr de la rencontrer une seconde fois. Ainsi, en même temps qu'il lui faut un grand nombre d'animaux pour subsister, tout concourt à les rendre rares.
[40] Mackenzie, t. 1, p. 295.- Hearne, chap. IX, p. 299.— Hennepin, p. 122 et 125.—Robin, t. 2, chap. XXXIV, p.356 et 367, et t. 2, chap. LIV, p. 367.
[41] Ces observations sont loin d'être nouvelles; elles sont aussi anciennes que la culture même de la terre. Les sages de l'antique Étrurie les exprimaient sous la forme d'un conte. « Un pauvre laboureur donne en dot à sa fille aînée le tiers de sa vigne, et fait si bien, qu'avec le reste, il se trouve aussi riche. Il donne encore un tiers à sa seconde fille, et il en a toujours autant. » Histoire romaine, par M. Michelet, t. 1, chap. IV, p. 56, 2e édit.
[42] « Partout où il se trouve une place où deux personnes peuvent vivre commodément, dit Montesquieu, il se fait un mariage. La nature y porte assez lorsqu'on n'est point arrêté par la difficulté de la subsistance. » Esprit des Lois, liv. xx111, chap. x. Cette observation de Montesquieu est le fondement de la doctrine que M. Malthus a développée dans son Essai sur le principe de la population.
[43] En 1793, au moment où quelques hommes attaquaient la société jusque dans ses fondemens, un philosophe, M. Rœderer, posa cette question dans un cours public :
« Le droit de propriété est-il inhérent à la nature de l'homme, antérieur à la société, inaliénable de la part de l'individu, et inviolable pour le corps social?
» Je n'hésite pas, ajouta-t-il, à répondre : Oui, sur toutes ces questions, en rappelant toutefois la distinction que j'ai déjà faite entre le droit et l'exercice du droit. » Et il prouva son affirmation. (Voyez le Journal d'économie publique, de morale et de politique, rédigé par M. Rœderer, t. 3, p.118, 212 et 257.
[44] Raynal, Histoire philosophique et politique des établissemens des Européens dans les Indes.
[45] Voyez les livres ix et x de l'Histoire d'Amérique de Robertson.
[46] Aux États-Unis, les familles qui habitent des terres nouvellement mises en culture, éprouvent toutes les maladies que produit l'insalubrité de l'air. La Rochefoucault, Voyage aux États-Unis, t. 1, p. 243, 279 et 280; tom. 2, p. 305. M. Wright, lett. 12 et 13, p. 203, 204, 231 et 232.
[47] On peut juger des difficultés que présenta d'abord la culture par le rapport qu'en ont fait les officiers qui commandaient la première expédition.
« J'avais lieu de craindre que la récolte ne fût point assez abondante, car on ne peut se faire une juste idée de la difficulté qu'éprouvèrent ceux d'entre eux qui étaient chargés du défrichement des terres. Croirait-on que j'ai vu douze hommes occupés durant cinq jours à arracher un arbre jusqu'aux racines? Qu'on joigne à ce travail excessif la faiblesse des travailleurs souvent épuisés par les maladies, la rareté des outils, leur facilité à s'émousser à raison de la dureté du bois, ceux enfin qu'on perdait dans la forêt parmi les herbes, on jugera sans peine que le sort qui nous attendait n'était rien moins qu'agréable. Voyage à New-Sud Wales, p. 142. — Arthur Philipp, Voyage à Botany-Bay. —L. Freycinet, Voyage aux terres australes, tome 11, ch. ix, p. 295. Peron, t. 2, liv. v, ch. 40, p. 393-395.
[48] Raynal, Histoire politique et philosophique, liv. 2. Suivant cet historien, chaque colon reçut gratuitement une lieue carrée de terrain.
[49] Raynal, Hist. philosoph., liv. 13.
[50] De Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, suppl., p. 142 et 143.
[51] Raynal, Histoire philosophique, vol. 7, liv. 13, p. 27.
[52] Larochefoucault, Voyage aux États-Unis, t. 5, p. 192.
[53] Quelques hommes s'imaginent que, lorsqu'un pays est surchargé de population, le gouvernement peut mettre un terme à la misère qui pèse sur certaines classes en formant des colonies. M. Malthus a parfaitement démontré l'inefficacité de ce prétendu remède. An Essay on the principles of population, bk. 36, ch. 4.
[54] Code civil, art. 552. L'article 187 de la coutume de Paris avait admis, avant le Code civil, que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
[55] Et quidem quæ flumina per eamdem regionem tantum labuntur, unde originem ducunt, tota sunt illius regionis. Arnoldi Vinnii Comment. in Instit. , lib. II, tit. 1, § I.
[56] Traité de législation, liv. IV, chap. I, t. 3, p. 241. -- « Les eaux courantes, dit M. G. Cuvier, entraînent les pierres, les sables et les terres des lieux élevés, et vont les déposer dans les lieux bas, quand elles perdent leur rapidité. De là les alluvions des bords des rivières, et surtout de leur embouchure...... Les terres ainsi formées sont les plus fertiles du monde. » Rapport historique sur les progrès des sciences naturelles depuis 1789, p. 144–145.
[57] La différence de fertilité, qui existe généralement entre les terres situées au fond des bassins des fleuves et des rivières, et les terres situées sur les parties les plus élevées des montagnes, est si grande, qu'on ne peut s'en faire une idée exacte qu'après avoir comparé le produit des unes au produit des autres. Les montagnes de France ne sont pas très-élevées; cependant il y a beaucoup de terres qui ne sont susceptibles d'aucune espèce de culture, et qui ne sont propres qu'à former de maigres pâturages. Immédiatement au-dessous de ces terres, il y en a d'autres qui donnent une ou deux récoltes tous les douze ou quinze ans, et cette récolte, qui souvent ne mûrit qu'avec peine, consiste en un peu d'orge ou d'avoine. Dans le département du Doubs, par exemple, il y a plus des deux cinquièmes des terres qui sont sans produit pour l'agriculture. Voyez la Statistique générale de la France, publiée par ordre du Gouvernement en l'an XII et en l'an XIII.
[58] Un décret du quatrième jour complémentaire an XIII (21 septembre 1805), rendu en exécution d'une loi (du 30 floréal an X) qui avait ordonné l'établissement d'un droit de navigation, reconnaît que les fleuves, rivières et canaux appartiennent aux bassins dans lesquels ils sont formés. « En exécution, dit-il, de l'art. 2 de la loi du 30 floréal an X, portant établissement du droit de navigation intérieure, les produits des droits perçus dans chaque bassin seront employés au profit des canaux, fleuves et rivières compris dans les arrondissemens de ce bassin, d'après la répartition qui en sera faite par notre ministre de l'intérieur pour chaque département. »
[59] En 1824, le nombre des usines mises en mouvement par des cours d'eau, dans le seul département de la Seine-Inférieure, était de plus de sept cents; à la même époque, un pouce de chute d'eau, situé aux environs de Rouen, valait mille francs, autant qu'un arpent et demi de terre. A Daviel, Pratique des cours d'eau, p. 11 et 12 des Observations préliminaires.
[60] Traité de législation, liv. III, ch. 27, t. 3, p. 127.
[61] Voyez l'art. 5 du traité de Paris, et les art. 14, 30, 96, 108, 109 et 110 de l'acte du congrès de Vienne, et les réglemens qui en ont été la suite. Supplément au Recueil des Traités d'alliance, de paix et de trève, conclus par les puissances de l'Europe; par G. F. de Martens, t. 6, p. 434-449. — Un traité fait à Mayence le 31 mars 1831, entre le gouvernement français et plusieurs gouvernemens d'Allemagne, promulgué en France le 26 juillet 1833 (Moniteur du 3 septembre 1833), a réglé les droits de ces divers états sur le Rhin, qui est leur propriété commune. On voit avec surprise que la Suisse ne figure pas dans ce traité, quoiqu'on y stipule pour elle.
[62] Dig. lib. 39, til. III, leg. 1, in princ. et § 1, 2, 6, 12, 13, 22; leg. 2, § 1, 2, 3 et 5; et leg. 3, § 2; et leg. 6, in princ.
[63] Ayant été consulté sur ce débat, je ne crus pas que la question de droit dût être résolue autrement qu'elle l'aurait été si elle s'était élevée entre deux particuliers. L'étendue du dommage ne change pas la nature du droit.
[64] Dauxion Lavaysse, Voyage aux Îles de la Trinidad, t. 1, ch. 2, p. 96-97.
[65] Robin, Voyage dans la Louisiane, t. 1, ch. 15, p. 228.
[66] Robin, t. 1, ch. 6, p. 89 et go; ch. 15, p. 228.
[67] Péron, liv. 1, ch. 4, p. 51. — La Pérouse, t. 2, ch. 4, p. 93 et 94.
[68] Voyage aux Etats-Unis, t. 1, ch. 3, p. 26 et 27.
[69] Voyage aux régions équinoxiales, liv. V, ch. 16, t. 5 P. 172-174.
[70] La Perouse, t. 2, ch. 4, p. 92-94.
[71] Voyez Traité de législation, liv. III, ch. 23, t. 3, p. 147-148.
[72] Voyez les Commentaires de César.
[73] Le village de Mandeure était, du temps des Romains, une ville considérable qui portait le nom d'Epamandudorum. Il reste encore beaucoup de vestiges et de ruines de cette ville.
[74] Statistique générale de la France, publié par ordre du Gouvernement. Département du Doubs, ch. 1, p. 3.
[75] Statistique générale de la France. Département de l'Indre, p. 173-257.
[76] Statistique générale de la France. Département des Deux-Sèvres, p. 132.
[77] Travels during the years 1787, 1788 and 1789 undertaken more particularly with a view of ascertaining the cultivation, wealth, resources, and national prosperity of the Kingdom of France, by Arthur Young, vol. 2. ch. p. 26, p. 106.
[78] « Un vandalisme déplorable a fait détruire, dans le cours de la révolution, la presque totalité des arbres champêtres qui ornaient nos coteaux, et une grande partie de ceux qui bordaient les grands chemins.» Statistique générale de la France. Département de la Meurthe, p. 19.
[79] « Des récoltes qui dédommageaient à peine des frais d'exploitation, ont bientôt désabusé les malheureux, séduits par de fausses espérances, et déjà une grande partie de ces terrains reste inculte. » Ibid., p. 167.
[80] Les propriétaires dont les biens étaient menacés par les défrichemens opérés sur les versans des montagnes, auraient certainement été fondés à s'opposer à ces défrichemens, en vertu des principes généraux du droit.
Si cui aqua pluviæ damnum dabit, dit la loi romaine, actione aquæ pluvia arcendæ avertetur aqua. L, 1, in princip. Dig. lib. XXXIX, tit. 3.
Hæc autem actio locum habet in damno nondum facto, opere tamen jam facto, hoc est, de eo opere ex quo damnum timetur, totiesque locum habet, quoties manufacto opere, agro aqua nocitura est; id est, cum quis manufecerit quo aliter flueret quàm natura soleret si fortè immitendo eam aut majorem fecerit, aut citatiorem, aut vehementiorem, aut si comprimendo redundare fecerit. Ibid, leg. 1, § I. Voyez les § 15 et 22.
[81] Le code forestier du 21 mai 1827 a renouvelé ces prohibitions pour vingt années. Voyez les art. 219-225.
[82] Statistique générale de la France. Département du Doubs, ch. 1, p. 5.
Dans le département des Deux-Sèvres, le déboisement a eu pour effet de rendre la pluie plus rare et moins abondante, d'accroître la force des vents, de rendre le temps plus froid et les terres moins productives. Statistique générale de la France. Département des Deux-Sèvres, p. 166.
[83] En France, les terres situées au sommet ou sur les pentes les plus élevées des montagnes, quand elles sont susceptibles d'être cultivées, ne donnent pas une récolte toutes les années; dans quelques départemens, on les cultive une fois tous les trois ou quatre ans ; dans d'autres, une fois tous les six ou sept ans; dans d'autres, à des intervalles plus éloignés encore. Dans le département des Deux-Sèvres, il est des terres qu'on ne culvite qu'une fois tous les sept ou neuf ans. Statistique générale de la France, p. 158 et 250. Sur les montagnes qui formaient jadis une partie du département du Rhin-et-Moselle, les récoltes se succèdent plus lentement encore. « Sur les montagnes et dans les bruyères, disait en 1802 le préfet de ce département, une grande partie des terres n'est ersemencée que tous les dix, douze, quinze et même vingt ans pendant ce long espace de temps, le champ repose, et n'offre qu'une vaine pâture au bétail; de manière que les terres arables sont, dans ces contrées, distribuées à peu près comme les coupes de bois aménagées. Lorsqu'on a fait le tour du territoire, on revient au sol d'où l'on est parti; on y trouve un gazon de mousse, lichen, de carex, de tithymales, de bruyères et de genêts, avec force thym et serpolet sauvage. On lève le gazon au hoyau, on le sèche, on le brûle; et les cendres ou le résidu de ces matières végétales servent d'engrais à la terre; on l'ensemence de seigle, d'avoine ou de blé sarrazin. » Statistique générale de la France. Département du Rhin-et-Moselle, p. 137. << Ce long repos qu'on laisse à un sol ingrat, dans l'intention de l'améliorer, semble le rendre plus paresseux et plus sauvage.» Ibid.
[84] « Leur nourriture, disait le préfet du Doubs, en parlant des habitans des montagnes de ce département, consiste en pain d'avoine, mêlé d'orge et d'un peu de blé, en légumes, en lait et en fromage maigre; deux fois par semaine, ils mangent du lard. » Statistique générale de la France. Département du Doubs, p. 67 et 68.
[85] Voyez les décrets de la Convention nationale du 11 nivôse an II (31 décembre 1793), et 21 prairial suivant (9 juin 1794).
[86] FN1: Environ 19 fr. 35 cent.
[87] FN2: Environ 15 fr.
[88] Travels during the years, 1787, 1788 and 1789, vol. 11, ch. XIV, p. 101–102.
[89] Il est possible cependant qu'un dissipateur sacrifie l'avenir au présent, et qu'il tarisse la source de ses revenus pour se livrer à de folles dépenses. Le bas prix du bois, dans certaines contrées, pourrait bien ne prouver que l'imprévoyance, la gêne ou la prodigalité des propriétaires.
[90] Voyez les ordonnances de Philippe V, du mardi avant Pâques 1318; de Philippe VI, du 29 mai 1346; de Charles VI, du 1er et du 8 mars 1388, du mois de septembre 1402, du 25 mai 1413, et du mois février 1415; de Charles VII, du 8 juin 1456; d'Henri IV, du mois de juin 1601 et du 27 septembre 1607; et de Louis XIV, du mois d'août 1669.
[91] Ordonnance de 1669, tit. XXVI, art. 1 et 2.
[92] Arrêt du conseil du 9 août 1723.
[93] A toutes les époques, le gouvernement a eu beaucoup de peine à faire respecter les forêts : le grand nombre des ordonnances qu'on a faites à ce sujet en fournissent la preuve. On voit, par le préambule de l'ordonnance de Charles VI, du mois de septembre 1402, qu'au moment où ce prince monta sur le trône, c'est-à-dire en 1388, les eauës et forestz étoient moult foulées, détruictes et diminuées en valeur, par le deffault et négligence d'aucuns ses officiers sur le faict desdites eauës et forests.
[94] L'ordonnance des eaux et forêts, du mois d'août 1669, 'imposait aux propriétaires de bois de haute-futaie l'obligation de déclarer d'avance les coupes qu'ils se proposaient de faire, que lorsque ces bois étaient situés à dix lieues de la mer, ou à deux lieues d'une rivière navigable. Tit. 26, art. 3.
[95] Environ sept milliards quarante millions de francs.
[96] Arthur Young, vol. 2, p. 115-116.
[97] Descartes supposait que les eaux de la mer se rendaient, par des conduits secrets, dans des réservoirs placés sous les montagnes; que là elles étaient réduites en vapeur par le feu central; que ces vapeurs, élevées dans l'intérieur des montagnes, se condensaient en eau contre leurs parois, et que cette eau s'écoulait par les fentes des rochers, comme l'eau distillée coule par le bec d'un alambic. Si telles étaient les idées d'un des plus grands philosophes et des meilleurs observateurs du dix-septième siècle, qu'on juge de ce que devaient être celles du vulgaire dans les siècles antérieurs.
[98] Insti. lib. II, tit. 1, § 2. Dig. lib. XLIII, tit. 12, leg. 1, § 3.
[99] Flumina quædam publica sunt, quædam non. Publicum flumen esse Cassius definit quod perenne sit. Dig. lib. XLIII, leg. 1, § 3.
[100] Flumen a rivo magnitudine dicernendum est, aut existimatione circumcolentium. Ibid, § 1. Un auteur, M. Daviel, prétend que, suivant le droit romain, les rivières non navigables étaient la propriété de ceux dont elles bordaient ou traversaient les terres. Il fonde cette opinion, qui est condamnée par la définition même que les jurisconsultes romains donnaient d'une rivière publique, sur la loi 2, Dig, de damn. infect., et sur la loi 1, § 4, de flumin. La première de ces lois ne dit pas un mot de ce qu'on lui fait dire si la citation était exacte, elle prouverait seulement que les propriétaires riverains pouvaient user d'un droit commun à tout le monde. La phrase que l'auteur cite de la seconde loi ne s'applique qu'aux torrens qui ne coulaient qu'à certaines époques de l'année, Pratique des cours d'eau, par A. Daviel, p. xvii et xix des Observations préliminaires.
[101] Si tamen aquam conrrivat vel si spurcam quis immitat, posse eum impediri plerisque placuit. Dig. lib. XXXIX, tit. 3, leg. 3.
[102] Fluminum publicorum communis est usus, sicuti viarum publicarum, et littorum. In his igitur publicè licet cuilibet ædificare et destruere: dum tamen hoc sine incommodo cujusquam fiat. Dig. lib. XXXIX, tit. 2, leg. 24, in princ.
[103] Dig. lib. XLIII, tit. 14, leg. 1, in princ.- Instit. lib. 2, it. 1, § 2 et 4.
[104] Dig. lib. XLIH, tit. 3, leg. 10, § 2. Tit. 8, leg. 2, S $ 16, eod. lib.
[105] Non autem omne quod in flumine publico, ripave fit coërcet prætor: sed si quid fiat, quo deterior statio et navigatio fiat. Dig. lib. XLIII, tit. XII, § 12.
[106] Leg. 2, eod. tit.
[107] La prohibition de pratiquer des cours d'eau dans les rivières navigables et dans celles qui les alimentent, paraît absolue dans le § 18 de la loi 1' re du même titre; mais il est clair qu'il faut l'entendre dans le sens que lui donne le § 15 (Proindè sive derivetur aqua, ut exiguior facta minus sit navigabilis). Autrement il n'aurait jamais été permis de pratiquer une prise d'eau dans une rivière, quelque petite qu'elle fût, puisqu'il n'y a pas de ruisseau qui ne contribue à rendre une rivière navigable, à moins qu'il ne soit située sur le rivage de la mer.
[108] Dig. eod. tit. leg. 1, § 7.
[109] Dig. lib. XLIII, tit. XII, leg. 1, § 19.
[110] Ibid. lib. xxxix, tit. 11, leg. 7, in princ. lib. XLIII, tit. xv, leg. 1.
[111] Ibid, tit. xi, leg. § 3.
[112] Eod. tit. leg,3, §2. -- Vinnii Comment.in Insti.lib. x, tit. 1, §4.
[113] Insti. lib. II ,tit. 1, § 4.
[114] Dig. lib. XLIII, tit. XII, leg.1, §6.
[115] Etablissemens de Saint-Louis, art. 124.
[116] Pour se faire une idée de l'oppression que la noblesse faisait alors peser sur le peuple, il faudrait lire toutes les dispositions de cette célèbre ordonnance, qui avait pour objet la réformation du royaume : « Pour ce que plusieurs louvetiers et loutriers, dit l'article 241, se sont efforcés et s'efforcent plusieurs fois d'empêcher les bonnes gens de prendre et tuer les loups, petits et grans, et exiger sur le povre peuple grans sommes de deniers..... Voulons et permettons par ces présentes que toutes personnes; de quelque état qu'elles soyent, puissent prendre, tuer et chasser sans fraude tous loups et loutres, grans et petits. »
L'article 242 ajoute: « Est vray que plusieurs seigneurs de nouvel et puis XL ans on ça, par la grande force et puissance, et par la faiblesse, povreté et simplesse de leurs sujets et voisins, ont fait et introduit nouvelles garennes, et estendues les leurs anciennes...... En dépeuplant le pays voisin des hommes et habitans, et le peuplant de bêtessauvages, par quo y les labourages et vignes des povres gens ont été tellement endommagiez et gastez par icelles bestes sauvages, que icelles povres gens n'ont eu de quoy vivre; et leur a convenu laisser leurs domiciles. »
[117] Article 246.
[118] « Et aussi plusieurs chemins, chaussées et passages, tels que bonnement on n'y peut passer sans très-grans inconvéniens et dangers. » Article 247.
[119] Art. 41, tit. 27.
[120] Art 42 et 44 du même titre.
[121] Art. 43 du même titre.
[122] Art. 28, tit. 27.
[123] Art. 40 du même titre. Arrêts du Parlement de Dijon du 1er août 1720, et du 20 août 1746.
[124] Loi des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789.
[125] Sect. III, art. 2, §§ 5 et 6.
[126] Des jurisconsultes distinguent le domaine public, des biens. qui appartiennent à l'état; ils mettent dans la première classe les objets qui sont consacrés à un usage public: tels que des routes, des ponts, des ports de mer, des fortifications; ils mettent dans la seconde les choses qui pourraient également appartenir à des particuliers, tels que des maisons, des meubles, et d'autres objets du même genre. Cette classification n'a rien de commun avec celle que fait la loi du 22 décembre 1790.
[127] Cette loi met, en outre, parmi les choses qui appartiennent à la nation, tous les biens et effets, meubles ou immeubles, demeurés vacans et sans maîtres, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers légitimes, ou dont les successions sont abandonnées; les murs et fortifications des villes, entretenus par l'état et utiles à sa défense, enfin les anciens murs fossés et remparts de celles qui ne sont point places fortes. (Art. 3 et 5.
[128] Art. 4. tit. I, sect. Ire.
[129] Décret du 27 septembre et 6 octobre 1791, tit. II, art. 15 et 16.
[130] Décret du 6 juillet 1793.-L'ordre du jour du décret du 30 du même mois est conçu en ces termes :« La Convention nationale, après avoir entendu la lecture d'une délibération prise par l'administration du département de la Charente, le 20 de ce mois, qui réfère à la Convention nationale la question de savoir si le droit de pêche est compris dans l'abolition générale des droits féodaux, et sur la proposition d'un membre, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que les droits exclusifs de pêche et de chasse étaient des droits féodaux, abolis par les décrets précédens, comme tous les autres. »
[131] Le même arrêté ordonnait la destruction de tous les ouvrages faits illégalement sur les fleuves et rivières navigables ou flottables.
[132] L'article 8 (§ 1) de cette loi excepte de la prohibition les bacs et bateaux non employés au passage commun, mais établis pour le seul usage d'un particulier, ou pour l'exploitation d'une propriété circonscrite par les eaux, s'il est constaté qu'ils ne peuvent nuire à la navigation.
L'article 9 du même paragraphe excepte les barques, batelets et bachots servant à l'usage de la pêche et de la marine marchande montante et descendante; mais il interdit aux propriétaires et conducteurs desdits barques, batelets et bachots, d'établir de passage à heure ni lieu fixes.
[133] Le tarif des droits à percevoir sur les bacs, passe-cheval et bateaux de passage, établis dans l'étendue du département de la Seine, a été fixé par l'arrêté du 11 fructidor an XI.
[134] L'art. 3 de l'arrêté du 13 vendémiaire an V avait imposé aux propriétaires des héritages aboutissant aux rivières et ruisseaux qui ne sont flottables qu'à bûches perdues, l'obligation de laisser le long des bords quatre pieds pour le passage des employés à la conduite des flots.
[135] Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer. Il ne peut pas avoir lieu non plus à l'égard des lacs et des étangs. (Code civil, art. 557 et 558.
[136] Code civil, art. 556-563.
[137] Art. 715.
[138] Voyez la loi du 15 avril 1829.
[139] Loi du 27 septembre 1731, art. 4, tit. I, sect. Ire.
[140] Le chemin de halage n'étant, en général, qu'une servitude établie sur les propriétés riveraines, pour le service de la navigation, et ne pouvant, par conséquent, être consacré à un autre usage sans le consentement de ceux qui doivent la servitude, il s'ensuit que les propriétaires riverains ont toujours un avantage sur les autres citoyens pour établir des usines sur les cours d'eau navigables ou flottables.
[141] Voyez, sur ces questions, l'ouvrage de M. A. Daviel, intitulé: Pratique des cours d'eau, pages 99 et suiv. — F. X. P. Garnier, Régime ou Traité des rivières, 2° partie, p. 257 et suiv.
[142] It became, dit Blackstone, a fundamental maxim and necessary principle of our English tennures, « That the king is the universal lord and original proprietor of all the lands in his Kingdom; and that no man doth on can possess any part of it, but what has mediately or immediately been derived as a gift from him, to be held upon feodal services. » i, 1. II, ch. IV, p. 51-53, 86 et 105.
Blackstone, qui était un admirateur sincère du système féodal, prétendait que cet ordre de choses s'était établi par le consentement universel de la nation, tout en reconnaissant qu'une très-grande partie du territoire anglais avait passé dans les mains du conquérant par suite des confiscations.
[143] 3 Term. Rep. 253.
[144] Blackstone, Comment., b. 4, ch. 13, vol. IV, p. 167.
[145] James Kent, Commentaries on american law, part. VI, lect. LI; vol. III, p. 330-350.
[146] James Kent, Comment. on american law, vol. III, lect. 50 and 51.
[147] Si l'on m'objectait qu'il y a beaucoup de grandes fortunes illégitimement acquises, je répondrais que cela même est une preuve que toute richesse est née du travail. Chez les indigènes de la Nouvelle-Hollande, personne ne s'enrichit par des monopoles, par des concussions ou par des confiscations, quoique les terres n'y manquent pas.
[148] Voyez, dans le règlement de Charles VI, du mois de février 1415, pour la juridiction du prévôt des marchands et échevins de Paris, les dispositions relatives aux coustumes et constitucions des rivières (art. 679-698).- Les dispositions de ce règlement, qui ne se rapportait qu'à la Seine et à ses affluens, ont été reproduites dans l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669.
[149] Voici la condition que l'administration est dans l'usage d'insérer dans les autorisations qu'elle accorde d'établir des usines sur des rivières non navigables : « Il est de condition expresse que, dans aucun temps et sous aucun prétexte, le pétitionnaire ou ses ayans-cause ne pourront réclamer de dédommagement pour cause de chômage, ou par suite des changemens que le gouvernement jugerait convenable de faire pour l'avantage de la navigation, de l'industrie cu du commerce, au cours d'eau sur lequel l'usine se trouve placée. Ce dédommagement ne pourra être demandé, même dans le cas où la démolition de l'usine serait ordonnée. » — A. Daviel, Pratique des cours d'eau ; Garnier, Régime des eaux.
[150] Pratique des cours d'eau, par M. A. Daviel, p. 28 et 29 des Observations préliminaires.
[151] Le raisonnement que je rapporte ici est, au fond, le même que celui de ce prédicateur qui excitait ses auditeurs à rendre des actions de grâces à la divine Providence, de ce que, dans son inépuisable bonté, elle avait daigné faire passer les rivières à travers les grandes villes. Le même écrivain cite, à l'appui de son opinion, des dispositions des Capitulaires qui accordent aux propriétaires riverains les mêmes droits que leur reconnaissaient les lois romaines. Ces dispositions ne prouvent donc absolument rien en faveur de la thèse qu'il soutient.
[152] Régime, ou Traité des rivières, par F. X. F. Garnier, 2e partie, p. 85-86.
[153] En France, l'obligation imposée aux propriétés riveraines de fournir à la navigation un chemin de halage, existe depuis les temps les plus reculés. Le réglement de Charles VI, du mois de février 1415, constate qu'à cette époque ce chemin était dû depuis un temps immémorial.
« Et pour ce que de toute ancienneté sur et au long des bords et rivages des dictes rivières, tant comme elles se extendent et comportent de toutes pars, en quelque estat que les eates soient, hautes, moïennes ou basses, doit avoir chemin de vint-quatre piez de lé, pour le trait des chevaux trayans les nefs, bateaulx et vaisseaulx, tant montens comme avalens par ycelles........ ordonnons que aucun ne mette ou fasse mettre sur ses dicts rivages, aucuns empeschemens quelconques, et que chascun sur son héritage seuffre, face et maintieigne convenablement le dit chemin de vint-quatre piez de lé pour le trait des dicts chevaulx, sur les points contenus en l'article précédent. » Art. 680.
[154] Instit. lib. II, tit. I, §1.-Dig. lib.I, tit. VIII, leg. 2, § 1, leg. 4 (De divisione rerum ).
[155] Maris naturam littora sequuntur ac proindè ad littus maris cuivis accedere licet, navem eo appellare ac reficere, retia siccare, et casam, in quam tantisper se recipiat, ponere. Dig. lib. I, tit. VII, L. 4 (De divisione rerum).—Instit. lib. II, tit. I, § 5.
[156] Littora in quæ populus romanus imperium habet, populi romani esse arbitror. Dig. lib. XLIII, tit. VIII, leg. 3.-Cette loi paraît contraire à la loi 14, tit. I, liv. XLI.
[157] Dig. lib. XLI, tit. I, leg. 14, princ. et leg. 3a, § 4; eod. tit. lib. XLIII, tit. VIII, leg. 3, § I.
[158] Dig. lib. XLIII, tit. VIII, leg. 2, §§ 8 et 'g. Tit. XII, leg. 1,817, eod. lib.-Lib. I, tit. VIII, leg. 2 (De divisione rerum et qualitate).
[159] At enim qui locum ita in mari aut littore occupatur, non simpliciter et absolutè occupantis fit, sed duntaxat interea dum occupat, dum ædificium manet: nam, ædificio sublato, locus in pristinam causam quasi jure postliminii revertitur. Dig. lib. I, tit. VIII, leg. 6 et leg. 14, § 1 (De divisione rerum et qualitate).
[160] Quamvis quod in littore publico, vel in mari, extruxerimus, nostrum fiat : tamen decretum prætoris adhibendum est, ut id facere liceat. Dig. lib. XLI, tit. I, leg. 50.
[161] Dig. lib. XLI, tit. I,leg. 14;-lib. XLIII. tit. VIII, leg. 3; tit. XII, leg. 1, § 17. eod. lib.
[162] Dig. lib. XLIII, tit. VIII, leg. 2, §9; — tit. XII, leg. 1, § 17, cod. lib.
[163] Est autem littus maris, quatenus hibernus fluctus maximus excurrit. Instit. lib. II, tit. I, § 3.
[164] Ordonnance de la marine de 1681, liv. IV, tit. VII, art. 1er.
[165] Liv. IV, tit. VII, art. 1 et 2.-Le réglement de Charles VI, du mois de février 1415, renferme des dispositions analogues pour la Seine et ses affluens (art. 680-683). Ces dispositions. ont été étendues à toutes les rivières navigables par l'ordonnance des eaux et forêts de 1669.
[166] Liv. V, tit. I, art. 1er.
[167] Voy. le tit. III du liv. V de l'ordonnance de 1682, art. 1, 2 et 8.
[168] Ibid, art. 10.
[169] Ordonnance de la marine de 1681, liv. II, tit. X, art. 1, 2, 3, 4 et 5.
[170] Liv.IV, tit. VIII, art.13r.
[171] Si in mari aliquid fiat, Labeo ait, competere tale interdictum ne quid in mari, inve littore quo portus, statio ITERVE navigio deterius fiat. Dig. lib. LIII, tit. II, leg. 1, § 17 (De Fluminibus).
Nemo igitur ad littus maris accedere prohibetur, piscandi causâ. Dig. lib. I, tit. VIII, leg. 4.
Voyez le Traité de la voirie, par M. Isambert, 1re partie, p. 244 et 245.
[172] Les terres que la mer laisse en se retirant, et qu'on nomme relais, font aussi partie du domaine public, de même que les rivages. Décrets des 11 nivôse et 19 prairial an II (31 décembre 1793 et 7 juin 1794); Code civil, art. 538.
[173] Corn. van Bynkershoec, De Dominio maris. Voyez aussi Vattel, le Droit des gens, liv. 1, chap. XXII.
[174] Quare omnino videtur rectius, eo potestatem terræ extendi quousque tormenta exploduntur eatenus quippe cum imperare tum possidere videmur. Loquor autem de his temporibus, quibus illis machinis utimur: alioquin generaliter dicendum esset, potestatem terræ finiri, ubi finitur armorum vis; et enim hæc, ut diximus, possessionem tenetur. Corn. van Bynkershoec, De Dominio maris, cap. II, tom. 1, p. 126-127.
[175] Du Droit des gens, liv. Ier, chap. XXIII, § 289.-Suivant Bodin, la domination d'un peuple sur la mer qui baigne son territoire s'étend jusqu'à trente lieues des côtes. De la République, liv. Ier, chap. X. Voy. Grotius, de jure belli ac pacis, lib. II, cap. III, § 8. Mare liberum.
[176] « Quand une nation s'empare de certaines parties de la mer, dit Vattel, elle y occupe l'empire, aussi bien que le domaine........ Ces parties de la mer sont de la juridiction du territoire de la nation; le souverain y commande, il donne des lois et peut réprimer ceux qui les violent; en un mot, il y a tous les mêmes droits qui lui appartiennent sur la terre, et en général tous ceux que la loi de l'état lui donne.» Le Droit des gens, liv. Ier, chap. XXIII, § 235.
[177] Mare clausum, lib. II, cap. XXVIII.
[178] Institutions du droit de la nature et des gens, par Gérard de Rayneval, liv. II, chap. IX, § 10, p. 161, et note 26, p. 86.
[179] Les eaux qui baignent les côtes de la Grande-Bretagne sont, pour la nation anglaise, un moyen puissant de communication entre les diverses fractions dont cette nation se compose. En France, nous n'avons pas encore su tirer parti de ce moyen.
[180] Un arrêté du gouvernement, du 11 juillet 1797, ordonne qu'il sera fait dans chaque département un état général des chemins vicinaux, état d'après lequel l'administration départementale désignera ceux qui, à raison de leur utilité, doivent être conservés, et prononcera la suppression de ceux reconnus inutiles, qui seront rendus à l'agriculture. On lit, en tête de cet arrêté, les motifs suivans :
« Considérant que la destination des chemins vicinaux ne peut être que de faciliter l'exploitation des terres ou les communications de village à village; que toutes les fois qeu ce double objet est rempli, l'ouverture de chemins nouveaux n'est plus qu'une usurpation sur l'agriculture. »
En lisant de tels motifs, ne serait-on pas tenté de croire qu'aux yeux des auteurs de cet arrêté, les communications entre les villes et les campagnes étaient inutiles, et que la population agricole pouvait être parfaitement gouvernée, quoiqu'il n'existât aucun moyen de communication entre elle et le gouvernement?
[181] Prætor ait: Ne quid in loco publico facias, inve eum locum immitas qua ex re illi damni detur: præter quam quod lege, senatusconsulto, edicto, decretove principum tibi concessum est....... Et tam publicis utilitatibus quam privatorum per hoc prospicitur. Dig. lib. XLIII, tit. VIII, leg. 1, in princip. et § 2.
[182] Dig. lib. XLIII, tit. VIII, leg. 2, §§ 22 et 23.
[183] Les principes adoptés par l'Assemblée constituante étaient professés, au seizième siècle, par un des jurisconsultes les plus éclairés de cette époque. Loyseau n'admettait pas que les seigneurs, ni le roi lui-même, fussent propriétaires des chemins publics. La distinction, entre les chemins royaux et les chemins de traverse, n'était convenable que quand il s'agissait d'en déterminer la largeur et d'en assurer l'entretien. « Les chemins, pour être dits royaux, ne sont pas plus au roi, disait-il, que les traverses ou autres chemins publics; ils sont de la catégorie des choses qui sont hors du commerce, dont partant la propriété n'appartient à aucun, et l'usage est à un chacun, qui, pour cette cause, sont appelés chemins publics. » Des Seigneuries, ch. IX.
[184] Voy. le titre VIII de cette loi, qui établit un droit de passe sur les chemins. Un pareil droit est établi sur tous les chemins publics d'Angleterre.
[185] Les routes de première classe sont au nombre de 14; les routes de seconde classe au nombre de 13; celles de troisième classe au nombre de 202; quant aux routes départementales, on ne jugea pas à propos d'en faire le dénombrement.
[186] La loi sur les passeports, qui ne permet de faire usage des chemins qu'avec la permission de la police, n'est-elle pas une atteinte à ce droit?
[187] Cum via publica, vel fluminis impetu vel ruina, amissa est, vicinus proximus viam præstare debet. Dig. leg. 14, §. 1, quemadmodum servitutes amittuntur.-Loi du 28 septembre. 6 octobre 1791, tit. II, art, 41.
[188] Arrêt du conseil du 26 mai 1705; règlement du 17 juin 1721; ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris, du 29 mars 1754; arrêt du conseil du 27 février 1765; loi du 16 septembre 1807, art. 50.
[189] Décret du 16 décembre 1811, art. 91 et 92.
Sur les questions de jurisprudence auxquelles les lois sur les chemins publics peuvent donner lieu, on peut consulter le Traité de la voirie, par M. Isambert, conseiller à la Cour de cassation; le Traité des chemins de toute espèce, par M. F.-X.-P. Garnier; le Traité des chemins communaux, par M. A. Robiou, et le Code des chemins vicinaux, par un avocat à la Cour royale de Paris.
[190] On a vu que ces arbres appartiennent aux propriétaires riverains, qui ne peuvent, néanmoins, les couper ni les arracher sans autorisation.
[191] Section VI, art. 1.— Code forestier, art. 145.
[192] Arrêt du conseil du 25 avril 1820.
[193] Turgot, t. 4, p. 406. Les Anglais admettent en principe que le propriétaire de la surface a la propriété du dessus et du dessous. Chacun peut donc bâtir sur son terrain, ou y faire des fouilles, sans que le gouvernement ait le droit de s'en mêler. Il n'existe chez eux ni lois sur les mines, ni ingénieurs privilégiés pour l'exploitation des mines. Les richesses souterraines sont protégées par les mêmes lois que toutes les autres propriétés. L'autorité publique a bien pu attribuer au propriétaire de la surface la propriété des richesses minérales que le sol renferme; mais ce n'est pas en vertu du principe qui sert de fondement à toute propriété.
[194] « Pour que l'exploitation d'une mine au profit du souverain lui soit avantageuse, dit Turgot, il faut deux conditions: l'une que la mine soit excessivement riche, l'autre, que l'Etat soit très-petit. » T. 4, p. 420.
[195] Sont considérées comme mines celles connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer; en filons ou couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine, ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun, et des sulfates à base métallique. (Loi du 21 avril 1810, art. 2.
Les minières comprennent les minerais de fer dits d'alluvion, les terres pyriteuses, propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes. (Art. 3.
Les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, les poussolanes, le trass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terre à foulon, terre à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses, regardées comme engrais; le tout exploité à ciel ouvert, ou avec des galeries souterraines (Art. 4.
[196] Un décret du 6 mai 1811 règle l'assiette et le mode de perception des redevances fixes et proportionnelles.
[197] Le 18 janvier 1832, M. Voyer d'Argenson a proposé l'abrogation de la disposition de la loi du 24 avril 1810, qui autorise le gouvernement à concéder des mines, et la révision des concessions déjà faites. Dans les développemens imprimés de sa proposition, il a signalé quelques-uns des nombreux abus de cette loi.
[198] Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne, t. IV, liv. IV, chap. XI, p. 29.
[199] Ibid. p. 1.
[200] Les proportions de la contribution doivent être déterminées par une loi spéciale. C'est le seul moyen de prévenir les répartitions arbitraires.
[201] Art. 1, sect.IV, titre 1.
[202] Loi du 7 juillet 1833, art. 52.
[203] Celte règle est cependant subordonnée aux usages locaux. Code civil, art. 671.
[204] Cette distance et ces ouvrages sont généralement déterminés par des usages et des réglemens locaux. (Code civil, art. 674.) On peut voir à cet égard, les articles 188, 189, 190 191 et 192 de la coutume de Paris. Desgodets, Lois des bâtimens.
[205] « Dans les villes et faubourgs, chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis èsdites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture est fixée suivant les règlemens particuliers et les usages constans et reconnus; et à défaut d'usage et de réglemens, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (six pieds de hauteur), compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres.» (Code civil, art. 663.
[206] L'article 664 du Code civil prévoit, au titre des servitudes, le cas où les différens étages d'une maison appartiennent à divers maîtres. Les questions qui s'élèvent en pareil cas sont presque toutes des questions de propriété.
[207] Voyez les art. 151-158 du Code forestier du 21 mai 1827.
[208] Voyez ordonnance du 9 décembre 1713; lois des 7 et 10 juillet 1791, et 17 et 25 juillet 1819.
CHARLES COMTE,
Traité de la Propriété (1834)
Volume 2.
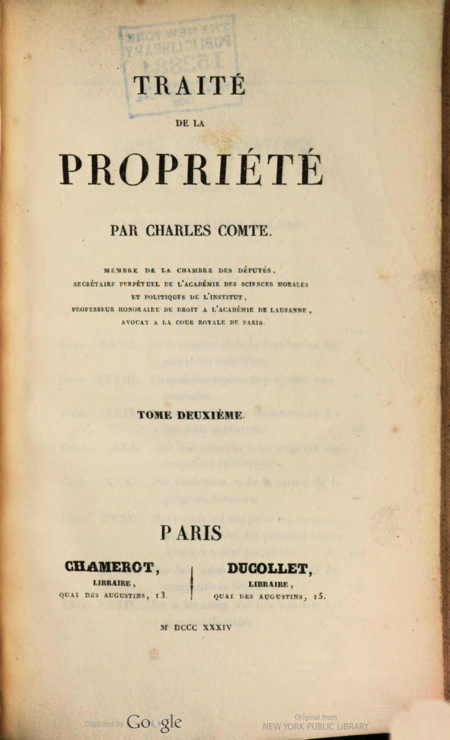
[II-1]
TRAITE DE LA PROPRIÉTÉ.
CHAPITRE XXVII.
De la création et de la distribution des propriétés mobilières.↩
AYANT exposé comment se forment les propriétés qui consistent en fonds de terre ou en bâtimens, et comment se répartit le territoire d'une nation, il me sera facile de faire comprendre comment se forment les propriétés qui consistent en objets mobiliers: on verra qu'elles dérivent toutes du même principe, et qu'elles se créent par des procédés analogues.
Le principal objet de l'appropriation d'un fonds de terre est d'en tirer les choses qui sont nécessaires à la satisfaction de nos besoins ; c'est d'employer le sol comme un instrument doué de la puissance de produire des grains, des légumes, des fruits, des fourrages, du bois, en un mot, toutes [II-2] sortes de végétaux; c'est de le fouiller pour en retirer les divers matériaux qu'il recèle.
Le propriétaire d'un fonds de terre a donc la propriété de tout ce qu'il produit, et même de tout ce qu'il renferme. S'il ne l'avait pas, la terre ne serait pour lui d'aucune utilité; elle n'aurait jamais été mise en culture. Elle ne serait pas devenue une propriété individuelle.
La terre renferme une multitude d'élémens qui, dans leur état primitif, ne nous seraient bons à rien, si nous n'avions pas le moyen de les mettre sous une forme qui les rend propres à satisfaire nos besoins, ou qui du moins nous permet de les convertir à notre usage. Un fruit ne vient pas de rien; il est formé d'une partie des élémens qui se trouvent dans le sol, ou qui sont répandus dans les airs. L'art de l'agriculteur consiste à cultiver la plante qui a la propriété de recueillir et de combiner ces élémens.
Parmi les objets que la terre produit ou qu'elle développe, il en est plusieurs, tels que les fruits, qui peuvent être immédiatement employés à satisfaire quelques-uns de nos besoins; il en est d'autres qui ne peuvent nous servir qu'après avoir subi des modifications plus ou moins nombreuses. Les feuilles qui croissent sur le murier, par exemple, ne peuvent satisfaire immédiatement aucun de nos besoins. Si elles sont livrées à certains insectes, [II-3] elles seront converties en cocons. Après avoir subi cette première transformation, elles en subiront une seconde; elles seront converties en fil de soie.
Le fil sera converti en une pièce d'étoffe, et l'étoffe se transformera en meubles ou en vêtemens.
Lorsqu'on veut observer la manière dont les propriétés mobilières se sont formées et multipliées, on est arrêté par une difficulté semblable à celle qui s'est présentée dans l'examen de la formation des propriétés qui consistent en fonds de terre. On s'aperçoit que, pour les créer, il a fallu en posséder une certaine quantité; les capitaux sont, en effet, considérés par les hommes qui ont écrit sur l'économie politique, comme une des conditions essentielles de l'exercice de toute industrie; mais les capitaux ne sont que des richesses cumulées; et sans industrie il ne saurait exister de richesses.
Il a sans doute fallu, pour exercer une industrie et en retirer un bénéfice, avoir des subsistances pour vivre au moins jusqu'au moment où l'on a obtenu un produit. Il a fallu, de plus, posséder quelques instrumens pour se livrer au travail, et une matière quelconque pour lui donner une valeur; cela ne peut pas être contesté. Mais ce qui n'est pas moins incontestable, c'est qu'il existe une multitude d'industries auxquelles on peut se livrer avec des capitaux extrêmement bornés. Il ne s'agit [II-4] pas, au reste, de donner ici l'histoire de la formation et de l'accroissement des propriétés mobilières: il ne s'agit que d'observer les procédés au moyen desquels elles se créent.
Nous avons admis en principe qu'un des élémens essentiels de toute propriété est l'utilité qui réside dans les choses que nous désignons par ce nom, c'est-à-dire la puissance qui est en elles de satisfaire quelques-uns de nos besoins. Nous avons reconnu qu'à mesure que l'utilité devient plus grande, la propriété augmente, et qu'à mesure que l'utilité diminue, la propriété décroît. Nous avons admis, d'un autre côté, qu'un homme n'est jamais la propriété de personne; que toutes ses facultés sont à lui, et que toute utilité qu'il crée est également à lui. Ces vérités étant reconnues, il sera facile d'observer comment se forment les propriétés mobilières.
Toutes les fois qu'un homme exerce son industrie sur une matière quelconque, il a pour objet d'en accroître la valeur ou l'utilité. Si la matière lui a été confiée par une autre personne qui en a la propriété, et qui doit la reprendre, il est payé de la valeur qu'il y ajoute, par le salaire qu'il reçoit. Il est possible que la valeur qu'il consomme pendant le travail, pour se nourrir, se vêtir et se loger, soient égales à celles qu'il produit par son industrie. Il est possible aussi que ses bénéfices excèdent ses [II-5] dépenses, et qu'il mette tous les jours quelque chose à l'écart.
Dans ce dernier cas, on dit, en économie politique, qu'il forme un capital; nous disons qu'il augmente ses propriétés. Nous pouvons nous faire une idée de la manière dont chacun accroît ainsi ses propriétés, en suivant les diverses transformations que certains objets ont subies, avant que d'être appliqués à la satisfaction de nos besoins.
Un homme achète un habit pour une somme de cent francs qu'il paye à son tailleur. Cette somme tout entière n'est pas un bénéfice pour celui qui la reçoit; car le drap, la toile, le fil, ne lui ont pas été livrés pour rien; les ouvriers qu'il a employés n'ont pas travaillé gratuitement. Supposons que les marchandises qu'il a employées lui aient coûté soixante francs: dans cette supposition, il ne lui restera que quarante francs pour la main-d'œuvre. Cette dernière somme ne sera pas un bénéfice une partie sera donnée aux ouvriers qui ont concouru à faire l'habit; une autre partie servira peut-être à payer les intérêts des avances que le tailleur aura faites; une autre partie payera son propre travail.
Les soixante francs payés au marchand qui a fourni les marchandises avec lesquelles l'habit a été fait, ne sont pas un profit pour lui: il ne [II-6] les a obtenues du fabricant qu'en lui en payant la valeur. La somme que le marchand reçoit audelà de ce qu'il a payé au fabricant, ne reste pas tout entière dans ses mains. Une partie est payée à ses commis, une autre au voiturier qui a porté la marchandise de la fabrique au magasin; une autre sert quelquefois à payer le commissionnaire qui a fait l'emplête; une autre les intérêts d'une partie du capital employé dans le commerce.
La somme reçue par le fabricant qui a fourni le drap, est bien loin aussi d'être un bénéfice pour lui: une partie est donnée au teinturier qui la partage entre lui, ses ouvriers, et les négocians qui lui ont fourni des drogues de teinture; une autre partie est distribuée aux nombreux ouvriers employés dans sa manufacture; une autre paye une partie des intérêts de son capital; une autre enfin est payée au fermier qui lui a vendu la laine dont le drap a été fait.
Le fermier ne s'enrichit pas de tout ce que le fabricant lui paye il en donne une partie à l'homme qui a tondu ses moutons, une autre à ses ouvriers ou à ses domestiques, une autre au propriétaire de la terre; avec une autre, il paye les intérêts du capital consacré à la culture; une autre enfin sert à payer les impôts, et se distribue entre une multitude de fonctionnaires.
[II-7]
Si l'on observait quelle est la valeur des diverses matières dont un habit est formé au moment où elles passent des mains du cultivateur dans celles du manufacturier, on trouverait qu'elle est tout au plus de deux ou trois francs; mais si l'on calculait, d'un autre côté, le nombre de personnes entre lesquelles la valeur totale de l'habit se distribue, on en trouverait plusieurs centaines.
C'est à peu près de la même manière que se distribue la valeur de chacun des objets dont nous faisons tous les jours usage. La valeur d'un livre qui ne se vend que trois francs, se distribue entre l'auteur, le libraire et ses commis; le relieur et ses ouvriers; le tanneur et le marchand de cuir qui ont fourni la couverture; l'imprimeur et ses ouvriers; le marchand et le fabricant de papier et leurs commis il n'y a pas jusqu'au malheureux qui ramasse le chiffon dans la rue, qui n'en ait une petite part.
Toutes les fois qu'un objet quelconque ne peut être employé à satisfaire nos besoins qu'après avoir passé dans les mains de plusieurs chefs d'industrie, chacun d'eux rembourse à celui qui l'a immédiatement précédé, toutes les dépenses qu'il a faites, et de plus, la valeur qu'il y a lui-même ajoutée par son travail. Ainsi, le fabricant de draps rembourse au fermier qui produit la laine, tout ce que, pour l'obtenir, celui-ci a payé à chacun des [II-8] ouvriers dont il a employé le service, et au propriétaire du sol dont il a pris l'exploitation; il lui paye, en outre, la valeur de son propre travail. Le marchand de draps rembourse au fabricant le prix de la laine, et, de plus, il lui paye l'augmentation d'utilité qu'il lui a donnée par lui-même ou par la main de ses ouvriers. Le tailleur rembourse au marchand tout ce que ce dernier a payé au fabricant, les dépenses qu'il a faites pour faire transporter le drap de la fabrique dans ses magasins.
Enfin, la personne qui achète l'habit, rembourse au tailleur le prix du drap, et la valeur qu'il y a ajoutée par sa main-d'œuvre.
On voit, par cette suite de transmissions, que chacun des possesseurs, au moment où il va aliéner sa marchandise, en est propriétaire à deux titres : il a la propriété d'une partie de la valeur, comme l'ayant acquise de ceux qui l'ont créée, et l'autre partie comme en étant lui-même le créateur.
Il arrive souvent qu'une chose de peu de valeur devient une propriété considérable par l'industrie ou le talent d'une seule personne. Un peintre peut faire un tableau d'un grand prix avec des matières qu'il a obtenues pour peu de chose. De même avec un bloc de marbre d'une valeur peu considérable, un statuaire habile peut créer une propriété d'une grande valeur. Dans des cas pareils, c'est uniquement le talent de l'artiste qui crée presque [II-9] toute la propriété. Il est bien évident que celui qui s'enrichit par de tels moyens, ne diminue en rien la fortune de personne.
Il est facile de voir comment en modifiant certaines matières, on en accroît l'utilité, et comment il est possible, par conséquent, d'augmenter ses propriétés, sans rien faire perdre à personne; mais ce qu'on n'aperçoit pas d'abord aussi clairement, c'est la manière dont les propriétés se forment par le commerce. Un simple commerçant ne fait subir, à proprement parler, aucune espèce de modifications aux choses qu'il achète pour les revendre; il se borne à les prendre dans un lieu, et à les transporter dans un autre. Comment un simple déplacement peut-il avoir pour résultat d'augmenter la somme des fortunes? Il a été précédemment démontré qu'un des principaux élémens d'une propriété, est l'utilité qui se trouve dans la chose désignée par ce nom, c'est-à-dire la faculté de satisfaire certains besoins.
Or, deux circonstances sont nécessaires pour qu'une chose satisfasse les besoins d'une ou plusieurs personnes : il faut d'abord qu'elle ait en elle-même des qualités propres à la faire désirer; il faut, en second lieu, qu'elle soit à portée des personnes à qui elle manque. L'objet du commerce est d'opérer ce rapprochement; il est de mettre, en quelque sorte, en contact les choses auxquelles l'industrie [II-10] a donné certaines qualités, avec les besoins qu'elles sont destinées à satisfaire.
Il est une multitude de choses dont toute la valeur résulte du seul fait de ce rapprochement. Sur les bords de la Seine, l'eau qui coule n'a point de valeur; mais si on en prend une partie, et qu'on la transporte sur un point où le besoin s'en fait sentir, on trouve sur-le-champ des gens qui l'achètent s'ils ont le moyen de la payer. Sur les flancs d'une vaste montagne, la pierre est une matière propre à construire des maisons, comme elle l'est au milieu d'une ville: il ne faut, pour lui donner une valeur, que la transporter dans une ville qui prospère. Dans les forêts de l'Amérique, le bois n'est pas moins propre à faire des constructions que sur un chantier de marine; pour en faire une propriété précieuse, il ne faut que le mettre à la portée des gens qui en ont besoin. Le commerce n'a pas la puissance de créer de la matière, et, sous ce rapport, il ne diffère pas des autres genres d'industrie; mais il augmente l'utilité de certaines matières; sous ce rapport encore, il ressemble à toutes les industries.
Il ne faut, pour multiplier les propriétés par la voie du commerce, ni moins de connaissances ni moins d'activité, ni moins de capitaux, que pour les multiplier au moyen de l'agriculture ou des manufactures. Pour amener à Paris le thé qui croît en Chine, le coton qu'on recueille au Brésil, le sucre [II-11] ou le salpêtre qu'on prépare dans l'Inde, les fruits qu'on récolte en Afrique, il faut plus de travaux et de génie que pour cultiver un champ ou tisser une pièce de toile. Je dois ajouter que le commerce est le complément indispensable de toutes les autres branches d'industrie, et rend les mêmes services qu'elles.
Un homme qui produit par ses travaux plus qu'il ne consomme, et qui multiplie ainsi ses propriétés, ne fait donc rien perdre à personne ; il enrichit sa famille, sans qu'aucun de ses semblables en souffre. Il fait mieux, il prépare des moyens d'existence pour un grand nombre d'autres personnes; il produit un bien analogue à celui que fait un homme quand il transforme des terres stériles en une riante campagne.
Lorsqu'un homme est, en effet, parvenu à cumuler, par ses économies, une certaine quantité de richesses mobilières, il ne peut les conserver et en tirer un revenu, sans les engager dans quelque genre d'industrie; il faut qu'il les livre à l'agriculture, à l'industrie manufacturière ou au commerce. Il pourrait bien, il est vrai, les employer à l'acquisition d'une maison ou d'un fonds de terre; mais il n'y aurait là qu'une substitution de personnes. L'individu dont il prendrait la place se mettrait à la sienne, et ne pourrait tirer un revenu du capital qu'il recevrait en échange de [II-12] sa terre ou de sa maison, qu'en le livrant à l'industrie.
Si les valeurs économisées étaient employées à mettre en culture une terre improductive, le propriétaire rendrait à l'humanité le genre de services que j'ai précédemment décrits, c'est-à-dire qu'il créerait des moyens d'existence pour un certain nombre de familles. S'il les employait à établir une manufacture, il rendrait des services analogues: il ouvrirait un débouché au travail d'un certain nombre d'ouvriers; il leur donnerait le moyen d'échanger leurs services contre des choses qui leur sont nécessaires pour vivre.
Ses bienfaits ne se bornent point là; ils se répandent sur tous ceux qui lui fournissent des matières premières, ou qui vendent des subsistances, soit à lui-même, soit à ses ouvriers. Les produits agricoles ne se vendent bien, et les terres n'ont une grande valeur, que dans les pays où l'industrie manufacturière et le commerce ont fait de grands progrès. Ce sont les fabricans et les commerçans de la Grande-Bretagne, qui ont donné aux terres de ce pays une valeur considérable, et augmenté la fortune de ceux à qui elles appartiennent. Si les premiers disparaissaient avec leurs capitaux, les seconds perdraient, par ce seul fait, une grande partie de leurs richesses: les terres n'auraient pas plus de valeur chez eux qu'elles n'en ont en Pologne.
[II-13]
Les propriétés mobilières donnent à ceux qui les possèdent, une grande partie des avantages qui résultent des propriétés immobilières. Les commerçans et les manufacturiers dont la fortune consiste généralement en objets mobiliers, sont aussi bien vêtus, aussi bien logés, aussi bien nourris que les cultivateurs. Il n'est même pas rare de voir les habitans des campagnes porter envie aux habitans des villes. La principale différence qui existe entre les propriétés des premiers et celles des seconds, consiste en ce que les dernières sont sujettes à plus d'accidens.
Pendant long-temps on a donné à un genre de propriété une grande prééminence sur l'autre : les propriétaires de fonds de terre se sont presque toujours prétendus supérieurs aux propriétaires d'objets mobiliers. Ces idées de supériorité sont nées de l'esclavage et du régime féodal; elles s'affaiblissent à mesure que les peuples s'éloignent des causes qui leur ont donné naissance. Elles disparaîtront presque entièrement, quand toutes les propriétés seront également bien garanties, et que la jouissance des droits politiques aura cessé d'être un privilége, dans les mains d'une classe particulière de propriétaires.
Les propriétés qui consistent en fonds de terre ne nous sont utiles que parce qu'elles sont la source d'où sortent toutes les propriétés mobilières; si [II-14] celles-ci ne nous étaient pas garanties, celles-là ne nous seraient bonnes à rien. Quel avantage un propriétaire tirerait-il de ses champs, si, du moment que la moisson est faite, le blé qu'il aurait récolté cessait d'être respecté? A quoi ses prés seraient-ils bons, si, quand ils sont fauchés, chacun pouvait s'emparer du fourrage, ou enlever les animaux qu'il y ferait paître?
On tombe dans une erreur qui n'est pas moins grave, quand on croit élever l'industrie qui s'exerce immédiatement sur des fonds de terre, en dépréciant tous les autres genres d'industrie. Un propriétaire de terres ne tirerait aucun avantage de la plupart de ses produits, s'il ne se trouvait personne pour les rendre propres à nos usages. Que ferait-il de ses mines, si les nombreuses industries qui s'exercent sur les métaux, venaient à disparaître? Que ferait-il de ses carrières, si personne ne travaillait la pierre? des arbres de ses forêts, si personne ne les transformait en meubles, ou ne les faisait entrer dans diverses constructions? de sa laine, si personne ne la convertissait en draps? Le propriétaire de terres fournit, il est vrai, des matières premières à toutes les industries; mais il serait aussi dénué de tout qu'un sauvage, si des hommes industrieux ne mettaient pas ces matières en œuvre. Il ne peut cultiver ses champs, exploiter ses mines ou ses carrières, faire usage des [II-15] arbres de ses forêts, qu'au moyen des instrumens que des gens industrieux lui ont fournis. Il ne peut consommer ses produits qu'en les échangeant contre ceux que l'industrie et le commerce lui présentent.
Les indigènes de l'Amérique septentrionale et ceux de la Nouvelle-Hollande possédaient des terres d'une immense étendue avant l'arrivée des Européens; et cependant ils n'avaient que quelques peaux de bêtes pour se couvrir, ils n'avaient pour habitations que de mauvaises huttes faites de branches d'arbres, et souvent ils étaient réduits à se nourrir de terre, d'écorces d'arbres, de vers ou de poisson pourri.
[II-16]
CHAPITRE XXVIII.
De quelques espèces de propriétés commerciales.↩
Un homme crée, par son travail, une chose propre à satisfaire ses besoins, ou à obtenir par des échanges les objets dont il manque; nous disons que cette chose lui est propre, qu'elle est sa propriété. Nous reconnaissons en lui le pouvoir d'en jouir et d'en disposer comme bon lui semble, pourvu qu'il respecte dans les autres et dans leurs biens des droits qui sont pareils aux siens.
Nous mettons donc certaines choses au rang des propriétés, non parce que telle est la volonté de l'autorité publique, mais parce qu'elles tiennent de l'industrie humaine les qualités qui les rendent précieuses à nos yeux; parce qu'il est impossible d'y porter atteinte, sans attaquer une partie plus ou moins considérable de la population dans ses moyens d'existence; enfin, parce qu'elles cesseraient d'être formées ou conservées, si la jouissance et la disposition n'en étaient pas garanties à ceux qui les ont créés ou à qui elles ont été régulièrement transmises.
[II-17]
L'autorité publique, en effet, peut intimer des ordres ou des défenses, accorder ou retirer sa protection, récompenser ou punir, dépouiller les uns pour enrichir les autres; mais il n'est pas en sa puissance de donner aux choses, par ses déclarations, les qualités qui les rendent propres à satisfaire nos besoins; elle ne peut pas donner l'existence à des propriétés ; sa mission n'est pas de créer des droits; elle est de proclamer et de garantir ceux qui résultent de la nature de l'homme et de la nature des choses.
Toutes les fois donc que nous observons qu'un ou plusieurs individus forment un nouveau moyen d'existence, qui ne porte aucune atteinte à la personne ou à la sûreté d'autrui, et qui ne blesse en rien la morale, nous mettons ce moyen au rang des propriétés, quelle qu'en soit d'ailleurs la nature; nous reconnaissons que ceux qui en sont les auteurs peuvent en jouir et en disposer comme de toutes les autres choses que nous avons désignées par le même nom.
En observant comment les propriétés se forment, nous avons remarqué qu'il s'y rencontre deux élémens essentiels: une matière quelconque, et, dans cette matière, une qualité propre à satisfaire un ou plusieurs de nos besoins. Il est cependant, chez les peuples qui sont parvenus à un certain degré de civilisation, des choses qui sont [II-18] mises au rang des propriétés, et qui ne peuvent être assimilées à un fonds de terre ou à un meuble. Chez tous les peuples policés, on met, par exemple, au rang des propriétés certaines conceptions de l'esprit, telles que des ouvrages littéraires ou scientifiques, des compositions musicales, des dessins et même de simples inventions dans les arts. On ne reconnaît pas au propriétaire la faculté seulement de jouir et de disposer de l'objet sur lequel il fixe ses conceptions; on lui reconnaît de plus la faculté d'empêcher que d'autres ne reproduisent, au moins pendant un certain temps, les mêmes pensées.
On met également au rang des propriétés le nom qu'un homme a toujours porté, la réputation qu'il s'est acquise, ou qu'il a donnée à certains établissemens industriels ou commerciaux, la clientelle qu'il s'est formée. Une personne qui parvient à achalander une maison de commerce, un établissement d'instruction publique, par exemple, vend ensuite sa clientelle ou sa chalandise, comme il vendrait un fonds de terre ou une maison. Cependant, quoiqu'il en obtienne quelquefois un très-grand prix, il n'a nullement la prétention d'être le maître des personnes dont il transmet en quelque sorte les habitudes ou la confiance.
N'est-ce donc point par une sorte d'abus que ces diverses choses sont mises au rang des propriétés? On conçoit très-bien que, lorsqu'un homme a [II-19] tracé sur des feuilles de papier qui sont à lui, des pensées qu'il a conçues, le livre qu'il a produit soit sa propriété; mais s'il en vend des copies, ceux qui les acquièrent ne pourront-ils pas légitimement les reproduire et les vendre à leur profit comme des propriétés nouvelles qu'ils ont eux-mêmes créées? Celui qui donne à une matière dont il est propriétaire une nouvelle valeur, en la convertissant en un outil jusqu'alors inconnu, reste maître de l'utilité qu'il a produite, comme de la matière sur laquelle il l'a fixée. S'ensuit-il que d'autres ne pourront pas suivre son exemple, en créant de semblables outils sans porter atteinte à ses droits? N'est-ce point aussi par une sorte d'abus qu'on met au rang des propriétés le nom, la réputation, les pensées ou les découvertes d'une personne?
Ces questions présentent à résoudre de graves difficultés; cependant il est possible d'en donner une solution propre à satisfaire l'esprit, si l'on observe bien les principes fondamentaux de toute propriété, et si l'on ne les perd jamais de vue. Comme il existe entre elles une certaine analogie, et qu'elles doivent être résolues par les mêmes principes, nous allons les examiner successivement.
La division la plus générale qu'on ait faite dans la science du droit, est celle qui range, sous deux grandes classes, les objets dont cette science s'occupe : [II-20] les personnes et les choses. Au premier aspect, rien ne paraît plus tranché que cette division; il semble impossible de jamais confondre ce qui appartient à l'une avec ce qui appartient à l'autre. Cependant, quand on y regarde de près, on trouve que les personnes sont si étroitement unies aux choses, qu'il est impossible d'établir une séparation absolue entre les unes et les autres. Les hommes ne vivent et ne se multiplient qu'au moyen des choses, et en s'identifiant en quelque sorte avec elle. Il est impossible de dépouiller un homme de ses propriétés, sans porter par cela même atteinte à l'existence de sa personne. On ne saurait donc traiter des unes sans parler en même temps des autres.
Nous avons reconnu que jamais une personne ne peut, suivant les lois de notre nature, être la propriété d'une autre, et que nul n'a d'autre maître que lui-même ; nous avons également reconnu que toute valeur ou toute utilité créée par un individu, est à lui, et que nul autre que lui n'a le droit d'en jouir ou d'en disposer sans son consentement. Mais qu'est-ce donc qui forme une personne? Qu'est-ce qui constitue son individualité? Ce n'est pas seulement son être matériel; se sont ses pensées, ses sentimens, ses relations de famille et de société, son nom, sa réputation, en un mot, tout ce qui fait de lui un être particulier, tout ce qui le distingue de ses semblables.
[II-21]
Une personne dont on usurperait le nom et la réputation, et à laquelle on ravirait le rang qu'elle tient dans la société, et jusqu'à la place qu'elle occupe dans sa famille, se trouverait souvent dépourvue de tout moyen d'existence ou de conservation; elle serait par cela même dépouillée de la plupart de ses propriétés.
Il est, dans toute société civilisée, une multitude de familles dont l'existence ou la fortune reposent sur la renommée attachée à certains noms ou à certains établissemens. Un fabricant, un artisan, mettent leur nom ou une empreinte particulière sur les objets sortis de leurs mains, et livrés au commerce. Tant que l'expérience n'a pas constaté la qualité de leurs produits, leur nom ou la marque qu'ils ont adoptée, est sans influence sur le public. Aussitôt qu'il est reconnu que les objets fabriqués par eux, possèdent les qualités qu'on désire y trouver, on les accepte de confiance. On se borne très-souvent à vérifier s'ils portent le nom ou l'empreinte de celui qu'on en suppose l'auteur.
Il ne suffit pas, pour exercer un art ou une profession d'une manière avantageuse, d'en avoir acquis la capacité; il faut avoir obtenu, de plus, la confiance d'une partie plus ou moins considérable du public. Or, pour obtenir cette confiance, il faut souvent plus de temps et de sacrifices qu'il [II-22] n'en a fallu pour se mettre en état de bien exercer son art ou sa profession. Il arrive quelquefois que des personnes d'une probité ou d'un mérite incontestables ont épuisé leurs ressources, avant d'avoir pu parvenir à se faire connaître. Presque jamais, au contraire, on ne voit une personne tirer de l'exercice de son art ou de sa profession des profits un peu considérables, sans avoir fait de grandes dépenses.
Cette espèce de propriété dont il est ici question ne se forme donc, comme toutes les autres, qu'en donnant à un nom ou à un signe, qui par lui-même est sans importance, une valeur plus ou moins considérable. Pour donner cette valeur à un nom, à un signe, il faut se livrer à de longs travaux, et faire certaines dépenses. Quand elle est formée, elle est pour celui qui en est l'auteur, une propriété non moins incontestable que tout objet matériel dont il aurait créé l'utilité.
Si l'on admet que chacun est maître de soimême, de son nom, et de toutes les valeurs auxquelles il donne l'existence, il n'est pas possible de contester qu'une personne ne soit aussi maîtresse de sa réputation et de tous les avantages qu'elle peut en retirer. La réputation d'une personne, quand elle est acquise par des moyens légitimes, tels que des talens, de la probité, ou par d'autres qualités individuelles, est même la plus incontestable des [II-23] propriétés. Elle est une conséquence nécessaire de la faculté qui appartient à chacun de disposer de lui-même de la manière qu'il juge la plus avantageuse, pourvu qu'il respecte dans les autres la même liberté.
Il arrive souvent que la renommée, au lieu de s'attacher au nom d'une personne, s'attache à un établissement. Une maison de commerce, quand elle est achalandée, se transmet souvent d'un homme à un autre, sans perdre aucun de ses avantages. La raison en est que celui qui la reçoit, a soin de conserver les usages, les conditions et les employés qui en ont fait la prospérité. Il tire ses marchandises des mêmes fabriques; il se contente des mêmes bénéfices, et met dans ses ventes la même bonne foi, la même probité. Il conserve ainsi les mêmes pratiques.
Depuis le moment où un établissement de commerce se forme, jusqu'à celui où il est bien connu, il s'écoule quelquefois un intervalle assez long. Durant cet intervalle, il faut payer des loyers, des commis, des domestiques, et faire tous les frais d'une maison qui serait déjà achalandée. Il faut aussi supporter des pertes sur les marchandises dont on a fait provision et qui ne se vendent pas, ou qui ne se vendent que très-lentement. Il arrive quelquefois qu'en faisant ces divers sacrifices, on ne parvient pas à former un établissement [II-24] commercial, et qu'on est obligé d'abandonner l'entreprise. Tous les frais qu'on a faits sont alors irrévocablement perdus.
Lorsque l'entreprise a réussi, on a créé ce qu'on appelle un fonds de commerce, dont la valeur est indépendante de la valeur des marchandises ou des divers objets qui meublent l'établissement. Ce fonds n'est pas fixé sur une matière qu'on puisse assigner, et qui soit susceptible d'être transmise d'une main à l'autre comme un meuble. Il consiste dans la confiance qu'on a inspirée, dans les habitudes qu'on a fait contracter, dans la renommée qu'on a créée; en un mot, dans la chalandise. Il a une valeur, puisqu'on trouve des gens qui consentent à l'acheter, et cette valeur, comme toutes les autres, ne se crée que par des soins et des dépenses. Il est donc la propriété de celui qui l'a formé ou légitimement acquis.
Les lois françaises ont pris soin de garantir à chacun les avantages de la réputation qu'il s'est acquise dans l'industrie et le commerce; elles ont établi des peines contre tout individu qui usurperait la marque ou le signe qu'un autre se serait déjà approprié. Un arrêté du 23 nivôse an ix [1], afin de conserver aux fabricans de quincaillerie et de coutellerie, les marques particulières destinées [II-25] à constater l'origine de leurs ouvrages, les avaient astreints à faire empreindre ces marques sur des tables communes, déposées dans un lieu public. Un décret du 5 septembre 1810 fit ensuite défenses à toute personne de contrefaire ces marques, sous peine d'une amende de trois cents francs pour la première fois. En cas de récidive, le coupable devait être puni d'une amende double, et d'un emprisonnement de six mois. Dans tous les cas, les objets contrefaits devaient être saisis au profit du propriétaire de la marque.
La loi du 22 germinal an XI [2] a rendu ces dispositions plus générales : elle déclare que la contrefaçon des marques particulières que tout manufacturier ou artisan a le droit d'appliquer sur les objets de sa fabrique, donne lieu à des dommages-intérêts envers celui dont la marque a été contrefaite; elle dispose, en outre, que l'individu coupable de contrefaçon est punissable des mêmes peines que celui qui commet un faux en écriture privée. Cette loi n'autorise les fabricans et artisans à se plaindre de contrefaçon, qu'autant qu'ils ont préalablement fait connaître leurs marques d'une manière légale, par le dépôt d'un modèle au greffe du tribunal de commerce d'où relève le chef-lieu de la manufacture ou de l'atelier [3].
Les Anglais paraissent avoir pensé qu'on n'avait pas besoin d'une loi spéciale pour empêcher une personne de nuire à une autre, en faisant usage de la marque que celle-ci s'est appropriée pour distinguer les produits de son industrie. Ils admettent que, suivant les règles du droit commun, l'homme qui contrefait la marque d'un autre, doit être condamné à lui payer les dommages qu'il lui a causés. Cette espèce d'usurpation ne paraît pas au reste, avoir été mise par eux au nombre des délits: elle ne donne lieu qu'à des réparations civiles.
Il peut se rencontrer d'autres cas où une personne cherche à s'enrichir en usurpant la réputation d'une autre. Un peintre dont le nom serait peu connu, pourrait, par exemple, chercher à vendre ses tableaux, en inscrivant au bas le nom d'un peintre célèbre; un écrivain pourrait mettre sur ses écrits le nom d'un auteur estimé du public; un médecin ou un avocat sans nom, pourraient donner des consultations sous le nom d'un médecin ou d'un jurisconsulte renommés. Dans ces cas et dans d'autres pareils, les personnes dont on usurpe le nom et la réputation, éprouvent un dommage analogue à celui que leur causerait la violation de toute autre espèce de propriété. Ils sont lésés dans leurs intérêts, non-seulement en ce qu'on leur ravit une partie des fruits de la réputation qu'ils ont acquise, [II-27] mais aussi parce que leur réputation peut être altérée par le fait de l'usurpation.
Il n'existe pas de loi spéciale pour garantir les propriétés de ce genre; mais elles sont garanties par les dispositions des lois générales. Ayant admis comme principe général que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui en est l'auteur à le réparer, il était inutile de descencendre aux applications de ce principe.
Il reste à examiner si certaines conceptions de l'esprit, lorsqu'elles ont été réalisées, doivent être mises au rang des propriétés.
[II-28]
CHAPITRE XXIX.
De la propriété des inventions ou des procédés industriels.↩
Le fait de s'emparer d'une chose qui n'a point de maîtres, avec intention de se l'approprier, a été considéré de tout temps comme un des premiers moyens d'acquérir la propriété. Cette manière de juger nous est même si naturelle, que l'homme le moins éclairé qui se verrait enlever une chose qu'il aurait acquise de cette manière, par celui qui n'aurait aucun droit antérieur au sien, se croirait victime d'une injustice manifeste. Il soumettrait, sans hésiter, le jugement d'une telle spoliation à des gens qui n'auraient pas plus de lumières que lui, et il se croirait sûr du gain de son procès, s'il avait la certitude que ses juges ne seraient ni trompés ni corrompus.
Les nations ont adopté, dans leurs relations mutuelles, le principe qu'elles appliquent aux individus dans les relations qu'ils ont entre eux; elles se sont considérées comme propriétaires des terres inoccupées, découvertes dans des expéditions qu'elles [II-29] avaient commandées, et dont leurs agens avaient pris possession en leur nom. C'est à ce titre qu'elles ont établi des colonies en Amérique, dans une partie de l'Afrique, et dans les îles nombreuses qu'elles occupent dans les deux océans. Il a suffi quelquefois qu'un peuple eût découvert une route de commerce à travers les mers, pour qu'il s'en déclarât exclusivement propriétaire, à titre de premier occupant. Le Portugal, par exemple, prétendait jadis avoir seul le droit de faire le commerce des Indes par le cap de Bonne-Espérance, attendu qu'ayant le premier fait la découverte de ce passage, il l'avait acquis par occupation. Grotius crut ne pouvoir repousser ces prétentions qu'en prouvant que les mers étaient libres de leur nature, et que, par conséquent, elles n'étaient pas susceptibles d'une occupation exclusive.
Il paraît que, dans le seizième siècle, des Anglais, ayant introduit dans leur pays des branches d'industrie ou de commerce, prétendirent que le principe admis par les jurisconsultes relativement à l'occupation des choses qui n'avaient pas de maîtres, devait être appliqué aux découvertes qu'ils avaient faites dans le domaine des arts. Il était naturel qu'en voyant les gouvernemens faire explorer les mers pour chercher des terres nouvelles, et s'emparer des pays dont [II-30] leurs agens faisaient la découverte, les hommes qui obtenaient de leurs recherches dans l'industrie, des produits jusqu'alors inconnus, aspirassent à obtenir la jouissance exclusive des procédés qu'ils avaient inventés. La découverte n'était-elle pas le produit de leur travail et de leur génie? N'étaient-ils pas aussi les premiers occupans?
Il aurait fallu plus de lumières et plus de respect pour la liberté du travail, qu'il n'y en avait alors dans les gouvernemens, pour apercevoir le vice de ce raisonnement. On pouvait bien, en effet, trouver quelque analogie entre la prétention d'exploiter, à l'exclusion de tous les autres hommes, une industrie qu'on aurait inventée, et la prétention des Portugais de naviguer, à l'exclusion de toutes les nations, sur les mers qu'ils avaient découvertes; mais était-il possible d'apercevoir quelque ressemblance entre un objet matériel, circonscrit dans d'étroites limites, telles qu'un espace de terre ou une pièce de gibier, et un procédé de l'industrie? Pouvait-on, avec quelque apparence de raison, assimiler l'invention d'un art, à l'occupation d'une pierre précieuse que les flots de la mer ont poussée sur le rivage, ou d'un poisson qu'un pêcheur a pris dans ses filets? L'exploitation d'un art par un individu, était-elle un obstacle à ce que le même art fût exploité par d'autres?
Mais les gouvernemens n'y regardaient pas alors [II-31] de très-près, quand il s'agissait de liberté, d'industrie ou de commerce; ils s'attribuaient le pouvoir de donner arbitrairement des priviléges à des hommes qui n'avaient rien imaginé de nouveau; à plus forte raison devaient-ils croire qu'il leur était permis de donner à l'auteur d'une invention ou à l'introducteur d'un nouveau commerce, le privilége de l'exploiter exclusivement, pendant un nombre d'années déterminé; ayant la faculté de concéder sans raison toutes sortes de monopoles, ils n'avaient pas d'autres motifs à donner de leurs concessions que leur pouvoir ou leur volonté.
Cependant, quelles qu'aient été les prétentions des auteurs de découvertes industrielles, jamais le gouvernement anglais n'a proclamé, en principe et d'une manière absolue, que toute invention est la propriété de l'inventeur, et que le premier qui occupe une branche d'industrie ou de commerce, acquiert le droit de l'exploiter exclusivement; jamais il n'a fait de loi ayant pour objet direct et principal de garantir cette prétendue propriété. La prérogative, dont la couronne s'était emparée, d'accorder des priviléges aux inventeurs pour l'exploitation de leurs inventions, n'a été maintenue que par exception, lorsque tous les autres monopoles ont été abolis, et qu'il a été admis, en principe, que la couronne ne pourrait plus en accorder. La reine Élisabeth ayant réduit en monopoles presque toutes [II-32] les branches d'industrie ou de commerce qui avaient quelque importance, la nation anglaise se souleva, sous son successeur, contre un état de choses devenu insupportable. Un acte rendu dans la vingt-unième année du règne de Jacques Ier (ch. 3), déclara nuls et contraires aux lois du royaume tous les monopoles précédemment établis, et défendit d'en accorder de nouveaux. Toutes personnes et corporations furent déclarées incapables d'en exercer ou d'en faire exercer aucun à l'avenir, et il fut ordonné que tout homme qui serait lésé par un monopole, aurait droit au triple des dommages qu'il aurait éprouvés, et au double des dépens qu'il aurait payées pour obtenir justice.
L'article 5 de cet acte ajouta, que néanmoins les dispositions précédentes ne s'étendaient pas aux lettres-patentes et aux concessions de priviléges, accordées pour le terme de vingt-un ans et au-dessous, à l'inventeur d'une marchandise nouvelle, pour la fabrication et la vente de cette même marchandise, pourvu toutefois que personne ne fût, avant la concession du privilége, en possession de fabriquer ou de vendre des objets semblables. Il fut reconnu, par l'art. 6, que les dispositions qui prohibaient, pour l'avenir, la création de monopoles, ne s'appliqueraient pas non plus aux lettres patentes ou concessions de priviléges qui seraient accordées pour un terme de quatorze ans ou pour [II-33] un moindre terme à l'inventeur ou aux inventeurs d'un produit quelconque, pour la fabrication et la vente de ce même produit. Cependant cette exception ne fut admise que dans le cas où nulle autre personne ne serait, avant la concession des priviléges ou des lettres-patentes, en possession de fabriquer des objets semblables. Ces deux articles déclarèrent, en outre, qu'il était bien entendu que les inventeurs qui auraient obtenu des lettres-patentes, ne pourraient en user de manière à violer les lois ou à porter préjudice à l'État, en élevant le prix des marchandises à l'intérieur, ou en nuisant au commerce par quelque moyen que ce fût [4].
La prérogative d'accorder un monopole temporaire à un inventeur pour l'exploitation de son invention, n'a pas été mise par les jurisconsultes anglais au rang des exceptions au droit commun de leur pays. Richard Godson affirme, au contraire, que le statut du roi Jacques a toujours été considéré comme purement déclaratoire de l'existence de cette prérogative. Il observe toutefois que les princes avaient si rarement fait usage de ce pouvoir au profit des inventeurs, que le parlement, en abolissant d'un seul coup tous les monopoles funestes, fut obligé d'offrir un encouragement [II-34] aux artistes ingénieux. On ne doit pas perdre de vue, au reste, qu'en affirmant que, suivant le droit commun de l'Angleterre, la couronne a la prérogative de donner aux inventeurs le privilége d'exploiter exclusivement leurs inventions pendant un temps déterminé, cet écrivain ne dit pas que, suivant le même droit, tout inventeur était propriétaire de son invention, et pouvait empêcher toute autre personne d'en faire usage.
Lorsque la révolution française éclata, les hommes qui s'occupaient du perfectionnement des lois, tournèrent leurs regards vers l'Angleterre pour y chercher des modèles; car la GrandeBretagne était alors le seul pays gouverné par un roi, dans lequel il existât quelque liberté. Ils trouvèrent que les auteurs de découvertes industrielles y jouissaient du privilége de les exploiter exclusivement pendant un certain nombre d'années, sous certaines conditions, et ils établirent en France le même regime.
Le 31 décembre 1790, l'Assemblée constituante, sur la demande de quelques artistes, proclama que toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie, était la propriété de son auteur, et que tout moyen d'ajouter à quelque fabrication que ce pût être un nouveau genre de perfection, serait regardé comme une invention; elle alla plus loin, elle déclara que quiconque [II-35] apporterait le premier en France une découverte étrangère, jouirait des mêmes avantages que s'il en était l'inventeur.
L'Assemblée constituante ne pensait pas établir, par ces dispositions, des priviléges ou des monopoles au préjudice de la masse de la population; elle croyait, au contraire, reconnaître des droits inhérens à la nature de l'homme. Il lui semblait même qu'elle devait s'expliquer à cet égard d'une manière si formelle, qu'à l'avenir nul ne pût élever des doutes sur la nature de ces droits. Voici les motifs qui servent de préambule à son décret, et les dispositions par lesquelles elle garantit aux inventeurs ce qu'elle considère comme leurs droits naturels.
« Considérant que toute idée nouvelle, dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société, appartient primitivement à celui qui l'a conçue, et que ce serait attaquer les droits de l'homme dans leur essence, que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son inventeur; » Considérant en même temps combien le défaut d'une déclaration positive et authentique de cette vérité, peut avoir contribué jusqu'à présent à décourager l'industrie française, en occasionnant l'émigration de plusieurs artistes distingués, et en faisant passer à l'étranger un grand nombre [II-36] d'inventions nouvelles, dont cet empire aurait dû tirer les premiers avantages;
» Considérant enfin, que tous les principes de justice, d'ordre public et d'intérêt national, lui commandent impérieusement de fixer désormais l'opinion des citoyens français sur ce genre de propriété, par une loi qui la consacre et qui la protége;
» Décrete ce qui suit :
» Art. 1er. Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur; en conséquence, la loi en garantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps qui seront ci-après déterminés.
» Art. 2. Tout moyen d'ajouter à quelque fabrication que ce puisse être, un nouveau genre de perfection sera regardé comme une invention.
» Art. 3. Quiconque apportera le premier en France une découverte étrangère, jouira des mêmes avantages que s'il en était l'inventeur [5]. »
Les Anglo-Américains, qui ne se sont écartés de la législation de leur mère-patrie que par exceptions, n'avaient cependant pas adopté les principes suivis dans la Grande-Bretagne sur les inventions. Ayant repoussé tous les priviléges comme [II-37] à leurs déclarations de droits, ils auraient cru se mettre en opposition avec leurs propres principes, s'ils avaient établi des monopoles dans les arts ou dans le commerce. Mais après que l'Assemblée constituante, qui, à l'exemple des États-Unis, avait fait une déclaration des droits de l'homme, eut proclamé qu'on ne pouvait pas, sans attaquer ces droits dans leur essence, ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son inventeur, le congrès américain suivit l'exemple de l'Angleterre et de la France [6].
Le 21 février 1793, il rendit une loi par laquelle il garantit à l'auteur de toute invention industrielle, qui en aurait fait régulièrement la demande, le privilége de l'exploiter exclusivement pendant quatorze années, à la charge de se soumettre à certaines conditions déterminées par le même acte. Cette garantie ne fut pas donnée seulement aux citoyens des États-Unis, et aux personnes qui résideraient sur le territoire national; elle fut accordée indistinctement à toutes les personnes qui en feraient la demande, soit qu'elles résidassent sur le territoire de la confédération, soit qu'elles habitassent en pays étranger. On crut ne pas devoir [II-38] adopter, pour les découvertes industrielles, la distinction qu'on avait faite relativement aux compositions littéraires.
Il y a dans la déclaration de l'Assemblée constituante une confusion d'idées qu'il faut faire cesser, si l'on veut démêler l'erreur de la vérité, et ne pas admettre en principe des propositions qui conduiraient à des conséquences que le bon sens forcerait à désavouer.
Toute personne qui fait une découverte dans les arts a certainement le droit de l'exploiter à son profit, Pour reconnaître l'existence de ce droit, et en garantir l'exécution, il n'est pas nécessaire d'un acte spécial de la part de l'autorité publique. Il suffit, pour que l'inventeur puisse en jouir sans trouble, que la liberté d'industrie soit proclamée, et que toutes les propriétés soient garanties. Les principes généraux du droit sont suffisans pour le protéger dans l'emploi qu'il fait de ses biens et de ses talens.
Mais entre le droit d'exercer une industrie qu'on a découverte, et le droit d'empêcher que d'autres ne l'exercent, la différence est grande; l'existence du premier est loin de supposer l'existence du second. Celui-là ne peut être mis en question que dans des pays où l'on trouve encore des restes d'esclavage; celui-ci peut être mis en doute dans les pays les plus libres et les mieux policés. Si la [II-39] faculté d'exploiter exclusivement un art qu'on a inventé, n'était pas garantie par un acte spécial du gouvernement, pourrait-on la réclamer en vertu des principes qui garantissent à chacun la disposition de ce qui lui appartient? L'Assemblée constituante paraît l'avoir cru, puisqu'elle a proclamé hautement que toute idée nouvelle, dont la manifestation peut être utile à la société, appartient primitivement à celui qui l'a conçue, et qu'on ne peut contester à un inventeur la propriété de son invention, sans attaquer les droits de l'homme dans son essence. Cependant, si l'on n'avait fait à cet égard aucune loi spéciale, il est douteux qu'il se fût trouvé un tribunal pour faire respecter ce prétendu droit naturel.
L'Assemblée constituante a évidemment appliqué aux inventions industrielles le principe suivi par toutes les nations pour l'occupation des choses qui n'ont pas encore été appropriées. Elle n'exige pas, en effet, pour accorder à un individu l'exploitation exclusive d'un art ou d'une branche d'industrie, que cet individu se soit livré à de longs travaux, ou qu'elle ait fait certaines dépenses : elle ne lui demande que de prouver qu'il en est le premier occupant, et qu'il a fait constater son occupation. Quand même un autre individu prouverait qu'il a fait la même découverte par ses propres efforts, et qu'il n'a pas eu connaissance des [II-40] travaux du premier inventeur, il n'en serait pas moins privé de la faculté de mettre son invention en pratique. Les dispositions de la loi française, de la loi anglaise et de la loi anglo-américaine sont uniformes à cet égard: ce qui prouve que, dans les trois pays, on s'est également laissé diriger par le principe de l'occupation.
Mais ce principe est-il, en effet, applicable aux découvertes faites dans les arts? Existe-t-il quelqu'analogie entre un objet matériel, tel qu'un espace de terre ou un objet mobilier, et un procédé à l'aide duquel on forme un nouveau produit? De ce qu'on admet qu'une terre inoccupée, une pierre précieuse trouvée sur le bord de la mer, ou un animal sauvage, appartiennent aux premiers individus qui s'en emparent, emparent, s'ensuit-il que le premier qui découvre l'art de créer un produit nouveau, a seul le droit de mettre cet art en pratique? je ne le pense pas; les gouvernemens qui ont accordé des priviléges aux inventeurs, ne l'ont pas eux-mêmes cru, et ils ne pouvaient pas le croire.
L'Assemblée constituante a déclaré que toute découverte nouvelle est la propriété de son auteur; mais elle n'a pas agi conformément à cette déclaration. Dans la loi même où elle a proclamé l'existence de cette propriété, elle l'a deniée, puisqu'elle a limité à un petit nombre d'années la jouissance exclusive de l'inventeur. Pour agir conséquemment, [II-41] à sa déclaration, elle aurait dû garantir cette jouissance à perpétuité; mais alors elle serait arrivée à l'absurde; les arts et le commerce auraient été réduits à jamais en monopole, au profit d'un petit nombre de familles : on eût condamné l'espèce humaine, au nom du droit naturel, à rester stationnaire.
Les peuples admettent les uns à l'égard des autres le principe de l'occupation pour les choses purement matérielles; mais ils sont loin de l'admettre pour les découvertes faites dans les arts. Une découverte faite en France ne donne, en Angleterre, aucun privilége à l'inventeur. La loi française est si loin de reconnaître la propriété des découvertes faites et exploitées dans les autres pays, qu'elle encourage les nationaux à les introduire en France. Celui qui importe parmi nous une branche nouvelle d'industrie, peut en obtenir l'exploitation exclusive, même contre l'inventeur. On ne peut pas dire cependant que l'Assemblée constituante se proposait d'encourager le vol.
S'il était vrai que toute idée nouvelle, dont la manifestation peut devenir utile à la société appartient primitivement à celui qui l'a conçue, et que ce serait atttaquer les droits de l'homme dans leur essence, que de ne pas regarder une decouverte industrielle comme la propriété de son inventeur, il s'ensuivrait qu'à l'instant où un [II-42] procédé industriel aurait été trouvé et mis en pratique sur un point du globe, le genre humain tout entier devrait se l'interdire, et que nul ne pourrait en user sans blesser les droits de l'homme dans leur essence.
Ayant eu occasion d'examiner ailleurs les principes proclamés par le décret de l'Assemblée constituante, et les doctrines des écrivains qui les ont développés, je dois me borner à rappeler ici les motifs qui me les ont fait paraître douteux.
On voit, dans les considérans du décret de l'Assemblée constituante, comme dans les écrits qui les ont développés, deux espèces de motifs: les principaux sont tirés du droit naturel qu'a tout inventeur d'exploiter exclusivement le genre d'industrie qu'il a découvert; les autres sont tirés de l'utilité publique. Ceux-ci sont purement hypothétiques; ils n'existent que par supposition. Personne n'affirme que le défaut de monopole en faveur des inventeurs, ait découragé l'industrie, et occasionné l'émigration de plusieurs artistes distingués. On dit qu'il peut avoir produit de tels effets: mais comme ce n'est là qu'un motif secondaire, on ne daigne même pas examiner s'il est justifié ou contredit par les faits.
Il est des légistes qui ne voient dans les lois que [II-43] des conséquences d'un petit nombre de principes placés hors du domaine du raisonnement, et qui raisonnent comme de véritables théologiens. En effet, aussitôt qu'on cesse de traiter ces principes comme des dogmes, et qu'on refuse d'y croire sans examen, ils ne signifient plus rien, même pour ceux qui les invoquent. Comment en prouverait-on la vérité, puisqu'ils forment les premiers élémens du raisonnement ?
Mais, dit-on, ces principes n'ont pas besoin de démonstration; ils sont évidens par eux-mêmes: il suffit de les énoncer pour que tout le monde les reconnaisse ; l'auteur de la nature les a gravés dans tous les esprits. Voilà des faits affirmés d'une manière bien positive; mais où en est la preuve? Quels sont les hommes qui en ont constaté l'existence et l'universalité?
Cela n'est pas nécessaire, ajoute-t-on; on ne prouve pas plus l'évidence, qu'on ne prouve la lumière: ceux qui ne sont pas organisés de manière à en être frappés immédiatement, ne sont pas organisés de manière à en comprendre la démonstration. Il n'y a rien à répondre à ce raisonnement, et il ne nous reste plus qu'à examiner dans quelle proportion les aveugles sont aux voyans. Cet examen ne sera pas inutile; car il pourrait bien avoir pour résultat de prouver à des hommes qui se croient organisés de manière à être frappés par la [II-44] lumière, qu'ils ne sont pas moins aveugles que ceux qui, pour croire à l'existence de la lumière, demandent qu'on leur en donne des preuves.
Il est donc aussi clair que le jour qu'un homme qui fait la découverte d'un procédé, qui aperçoit ce que d'autres n'ont pas aperçu avant lui, qui fait de ses organes un usage que d'autres n'en ont jamais fait, qui donne à de la matière un genre d'utilité que personne ne lui avait donnée, acquiert par cela même le droit exclusif de créer ce genre d'utilité, de faire un tel usage de ses organes, ou d'exécuter un tel procédé. Ce droit qu'il acquiert par son invention, ne lui est pas attribué par les lois de son pays, puisqu'il est, au contraire, la base sur laquelle reposent les lois. Il est éternel, immuable, indépendant de toute institution; il est par conséquent universel, et n'est limité ni par les bornes des États, ni par les montagnes, ni par les mers.
Voilà des vérités évidentes par elles-mêmes, gravées dans tous les esprits et dans tous les cœurs, et qui ne peuvent être contestées que par des hommes qui ont fermé les yeux à la lumière. Suivons-les dans l'application, et nous en serons encore plus vivement frappés. Le premier homme qui conçut et exécuta l'idée de transformer un morceau de bois en une paire de sabots, ou une peau d'animal en une paire de sandales, acquit par ce seul fait le droit exclusif de chausser le genre [II-45] humain. Dès ce moment, tous les hommes se trouvèrent dans l'obligation de marcher nus-pieds, ou d'aller se pourvoir de chaussures auprès de l'heureux inventeur. Si la découverte fut faite par un habitant du pôle boréal, les habitans du pôle austral ne purent, sans blesser les droits de l'homme et sans violer les principes gravés dans tous les cœurs, se permettre de porter des sabots sans les avoir achetés à l'autre extrémité du globe. Si l'inventeur ne put pas en fabriquer une quantité suffisante pour chausser toutes les nations du monde, ou s'il mit un prix qu'on n'eût pas la possibilité de payer, on dut aller sans chaussure et s'écorcher les pieds, de peur de blesser les droits de la nature. Tout cela est clair comme le jour, incontestable comme la lumière pour quelques-uns de nos docteurs.
Il n'est pas moins évident à leurs yeux que le premier homme qui, découvrant un grain de blé, s'avisa de le déposer dans le sein de la terre, de le faire multiplier, et de fabriquer du pain, acquit le droit exclusif de se nourrir et de nourrir le genre humain avec cette nouvelle espèce d'aliment. Dès ce moment, les peuples de toutes les races, blancs, noirs, jaunes, rouges et basanés, durent traverser les mers et les montagnes pour aller se pourvoir de pain auprès de l'inventeur. Ceux qui ne purent faire le voyage furent obligés de continuer de [II-46] manger des serpens, des rats où des grenouilles, ou même de se manger les uns les autres, pour rester fidèles aux droits de la nature. Si une grande partie de la terre est aujourd'hui cultivée, on ne peut l'attribuer qu'à la profonde corruption du genre humain qui viola les droits naturels, exclusifs, et imprescriptibles, du premier cultivateur et du premier fabricant de pain.
Nous devons en dire autant de l'homme qui, pour se former un abri, s'avisa le premier de courber des branches d'arbres ou de creuser un trou dans la terre. Cette découverte lui donna le droit exclusif de se garantir et de garantir les autres des intempéries des saisons. Tout homme qui s'avisa de suivre son exemple, sans en avoir obtenu de lui la permission, fut un violateur de la loi naturelle; il méconnut les principes gravés en caractères ineffaçables dans son esprit par la droite raison....
Nous observons que, dans les considérans de la loi que nous avons citée, les auteurs de cette loi déclarent d'abord que ce serait attaquer les droits de l'homme dans leur essence, que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur, et que tous les principes de justice, d'ordre public et d'intérêt national, lui commandent impérieusement de fixer désormais l'opinion des citoyens français sur ce genre de propriété, par une loi qui la consacre et la protége; [II-47] et puis nous lisons avec étonnement dans le troisième article :
« Quiconque apportera le premier, en France, une découverte étrangère, jouira des mêmes avantages que s'il en était l'inventeur. »
Mais s'il en est ainsi, que deviennent les droits de l'homme? L'étranger qui invente ne serait-il pas un homme? Son invention ne serait-elle pas sa propriété? Son droit n'existe-t-il pas indépendamment de votre loi? Le monopole que vous donnez au premier imitateur, serait-il un encouragement au vol? Est-ce là un bon moyen de consacrer, de protéger ce genre de propriété qui est une partie essentielle des droits de l'homme? Si les habitans de vos frontières faisaient des excursions sur la terre des nations voisines pour s'y livrer au pillage, vous les puniriez comme des brigands. Cependant vous assurez que les inventions sont la propriété des inventeurs, vous dites que vous voulez faire respecter ce genre de propriété, puis, vous excitez vos compatriotes à aller surprendre les secrets des inventeurs étrangers; vous leur assurez le monopole des inventions qu'ils ont volées!....
On dira, sans doute, qu'il ne serait pas raisonnable d'obliger les habitans d'un pays à aller chercher les objets dont ils ont besoin, chez une autre nation qui pourrait se trouver placée à une distance immense; que cette nation pourrait refuser de leur vendre ces objets, ou y mettre un prix [II-48] excessif; qu'elle pourrait aussi ne pas en fabriquer une quantité suffisante pour fournir aux demandes des autres nations. Mais ces réponses qui prouveraient que les principes qu'on donne comme des vérités éternelles, sont subordonnés aux besoins et varient avec eux, ne seraient pas satisfaisantes. Estil plus raisonnable, en effet, de contraindre les habitans du département de l'Ain d'aller se pourvoir des choses dont ils ont besoin auprès de l'imitateur de Brest, plutôt qu'auprès de l'inventeur de Genève? Les habitans du port de Calais auraientils plus de peine à se pourvoir de certains objets auprès d'un inventeur de Londres qu'auprès d'un imitateur de Toulouse ou de Perpignan?
L'inventeur étranger pourrait, dit-on, refuser de vendre ses productions, ou y mettre un prix trop élevé; mais l'imitateur uational n'a-t-il pas les mêmes priviléges? Ces priviléges ne sont-ils pas garantis à l'un et à l'autre par le monopole? Un inventeur pourrait n'avoir pas le moyen d'approvisionner toutes les nations; cela est incontestable; mais est-on sûr qu'un imitateur aura le moyen d'en approvisionner une seule? Serait-il plus facile à un pauvre imitateur des Landes ou des Pyrénées d'approvisionner la France tout entière, qu'à un riche inventeur de Londres ou d'Amsterdam? Un inventeur qui ne peut pas fournir à toutes les demandes, n'a-t-il pas d'ailleurs [II-49] la ressource de céder le droit d'exploiter sa découverte dans certains lieux déterminés?
Ce n'est pas seulement en accordant un monopole aux imitateurs d'inventions étrangères, que les auteurs du décret attaquent, par l'article 8, les droits de l'homme qu'ils ont proclamés dans le préambule; c'est aussi en limitant à un certain nombre d'années, le monopole que la loi naturelle accorde, suivant eux, à l'inventeur. S'il est vrai, comme ils le disent, que toute invention est la propriété de l'inventeur; si cette propriété ne peut pas être attaquée sans que les droits de l'homme soient violés dans leur essence, il est difficile de comprendre pourquoi elle est moins sacrée après la quatorzième année qu'après le premier jour. Pour ne pas être inconséquent, on aurait dû déclarer, ou que toutes les propriétés deviendraient communes après quatorze années de jouissance, ou que le monopole de tout inventeur serait perpétuel [7].
Les auteurs qui ont adopté les maximes de l'Assemblée constituante, se sont aperçus qu'elles conduisaient à des conséquences inadmissibles; ils ont donc tenté de les modifier à l'aide d'un autre principe. Après avoir reconnu les droits exclusifs de l'inventeur, ils ont admis, d'un autre côté, que chacun [II-50] a le droit d'user de sa pensée, quelle qu'en soit l'origine, et d'imprimer à toute portion de matière dont il est le maître, la forme de l'invention comprise par son intelligence et identifiée avec sa pensée. Je n'examinerai pas ici comment ils concilient cette contradiction: cet examen nous écarterait trop du sujet de cet ouvrage, et aurait peu d'utilité.
L'exploitation exclusive d'une découverte industrielle, garantie à l'inventeur pour un temps déterminé, n'a et ne peut avoir pour objet que de donner un encouragement à l'industrie. Il faudrait donc, pour apprécier cette espèce de monopoles, examiner si les avantages qu'ils produisent excèdent les inconvéniens qui en résultent. S'il était démontré que les entraves imposées à l'industrie par les priviléges donnés aux inventeurs, les discussions et les procès qui en sont une suite naturelle, causent, en définitive, plus de dommage que les encouragemens ne produisent de bien, clair qu'il n'y aurait pas de raison pour mettre des entraves à l'industrie.
On dit, pour justifier ces monopoles, que toute invention nouvelle est profitable à la société, et que la société doit une indemnité à ceux de ses membres qui font des sacrifices pour elle; qu'il serait difficile et souvent impossible d'estimer d'une manière équitable, les avantages que la société [II-51] retire de certaines inventions, et que la manière la plus sûre de récompenser un inventeur selon son mérite, c'est de lui garantir, pendant un temps déterminé, l'exploitation exclusive de sa découverte.
Une nation doit, sans doute, indemniser tout individu des sacrifices particuliers qu'elle exige de lui; quand elle a attaché une récompense à un service, et que ce service a été rendu, il est évident qu'elle doit la récompense. Mais est-elle tenue d'indemniser les citoyens des sacrifices qu'ils font dans la gestion de leurs intérêts privés, quand il arrive que ces sacrifices tournent indirectement à l'avantage du public? Si l'on admettait une pareille doctrine, il n'y aurait pas de peuple assez riche pour payer tous les services qui lui seraient rendus. Il y a beaucoup de gens qui se ruinent en se livrant à des entreprises qui ne sont pas sans utilité pour le public; cependant il ne leur vient pas dans la pensée de demander des indemnités.
On dit aussi, pour justifier les priviléges accordés aux inventeurs, que les imitateurs d'une invention ont un immense avantage sur celui qui en est l'auteur, qu'ils n'ont point d'essais à faire, et qu'ils sont dispensés des frais qu'exigent les tâtonnemens. Mais on oublie de faire entrer en ligne de compte les avantages qu'il y a toujours, dans l'exercice d'une industrie, à se présenter le premier, et à se faire une réputation au moyen d'une découverte utile. [II-52] Il faut ajouter qu'on élève des hommes pour se livrer à l'exercice d'une profession, et non pour être des inventeurs : les découvertes ne sont faites, en général, que dans la pratique des arts. Souvent elles ne sont que d'heureux accidens dans la vie des gens qui se livrent à la pratique de l'industrie.
S'il en est quelques-unes qu'on n'a pu mettre en pratique sans se livrer à des dépenses considérables, le plus grand nombre exigent peu de frais, et ne sont dues quelquefois qu'au hasard. Si les lois ne donnaient point de priviléges aux auteurs de découvertes, les hommes qui croiraient avoir trouvé le moyen de produire une chose utile, jusqu'alors inconnue, ne seraient pas dans une position différente de ceux qui se proposent d'établir un art ou un commerce depuis long-temps connus, dans un lieu où ils n'existent pas encore. Les uns et les autres ont des frais plus ou moins considérables à faire et des chances de perte à courir; les premiers, comme les seconds, jugent de la bonté de leur entreprise par les bénéfices qu'ils en attendent, et non par les avantages que le public en pourra retirer. Il y a peut-être plus de gens qui se sont ruinés en essayant d'achalander une nouvelle boutique, ou en établissant une nouvelle manufacture de produits connus depuis long-temps, qu'en faisant des essais pour obtenir des produits d'une nouvelle espèce. C'est à chacun à bien faire [II-53] ses calculs, avant que de se livrer à des expériences dispendieuses.
Du moment qu'une loi a promis à l'auteur d'une invention de lui en garantir la jouissance exclusive pendant un temps déterminé, toute découverte faite et constatée sous l'empire de cette même loi, devient la propriété de celui qui en est l'auteur pour le temps qui a été fixé. L'inventeur, dans ce cas, peut dire que, si on ne lui avait garanti aucun privilége, il ne se serait pas livré à des essais; qu'il n'aurait pas pris certains engagemens; qu'il ne serait pas entré dans la carrière où on l'a poussé par l'appât d'une récompense. L'abrogation d'une loi qui aurait garanti à un inventeur la jouissance exclusive de sa découverte pendant un temps donné, ne saurait donc avoir d'effet que pour les inventions futures. Elle porterait réellement atteinte à la propriété si elle agissait sur les découvertes faites avant sa promulgation.
L'influence des priviléges accordés aux inventeurs sur les progrès de l'industrie, est loin d'être aussi grande que quelques personnes l'ont imaginé. Il est un grand nombre de connaissances qui ont fait, en peu de temps, d'immenses progrès sans le secours des monopoles. Toutes les branches des sciences physiques et mathématiques ont, depuis un demi-siècle, devancé dans leur développement [II-54] les progrès des arts industriels. Quelques branches des sciences morales sont aussi beaucoup plus avancées qu'elles ne l'étaient au commencement de notre première révolution. Cependant, les savans n'ont pas été encouragés par l'appât des priviléges.
Dans les considérans de son décret, l'assemblée constituante dit que le défaut d'une déclaration positive et authentique, sur la propriété des inventions, peut avoir contribué jusqu'à présent à décourager l'industrie française, en occasionnant l'émigration de plusieurs artistes distingués, et en faisant passer à l'étranger un grand nombre d'inventions nouvelles; mais personne ne s'est donné la peine de faire voir, par un examen approfondi des faits, quelles ont été les conséquences de la liberté la plus entière, ou des priviléges accordés aux inventions; le motif de l'assemblée constituante n'est donc qu'une supposition que rien ne justifie. Si des artistes distingués avaient porté leurs découvertes en Angleterre pour y jouir d'un monopole, ces découvertes auraient dû y être publiées pour y être mises en pratique; et elles auraient pu, par conséquent, être sur-le-champ réimportées en France. L'absence de tout monopole ne pouvait donc pas causer un grand dommage à l'industrie française.
La question de savoir si, par la nature des choses, toute découverte nouvelle est la propriété de [II-55] celui qui en est l'auteur, ou si la garantie qui lui est donnée d'une jouissance exclusive, est une restriction mise à la liberté de tous les autres citoyens, n'est pas, comme on pourrait être tenté de le croire, sans importance dans la pratique.
Si l'on admet, avec l'Assemblée constituante, que, par la nature des choses, toute découverte ou nouvelle invention dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur, il s'ensuit premièrement que les dispositions qui ont limité le nombre d'années pendant lesquelles l'inventeur peut jouir exclusivement de son invention, et mis des conditions à cette jouissance, ont limité sa propriété et restreint des droits inhérens à sa nature; il s'ensuit, en second lieu, que les magistrats doivent être naturellement portés à résoudre au profit des inventeurs, les difficultés qui se présentent. Si l'on admet, au contraire, que les droits naturels d'un inventeur consistent uniquement à exploiter son invention, sans pouvoir empêcher que d'autres ne se livrent à la même industrie, il s'ensuit que la garantie qui lui est donnée d'une jouissance exclusive, est un véritable monopole, c'est-à-dire qu'elle est une restriction à la liberté de tous les citoyens. Dans cette supposition, les magistrats doivent tendre naturellement à relâcher les liens mis à la liberté, et résoudre contre l'inventeur les cas douteux qui se présentent.
[II-56]
Les magistrats anglais, tout en admettant que, suivant le droit commun de leur pays, le roi possède la prérogative de donner à l'auteur d'une invention, le privilége de l'exploiter exclusivement pendant un certain nombre d'années, considèrent ce privilége comme un véritable monopole. Ils interprètent, en conséquence, en faveur de la liberté générale, les doutes que les lois présentent dans l'application. Tout inventeur qui ne s'est pas rigoureusement soumis aux conditions que les lois lui ont imposées, est déchu de son privilége. En France, la magistrature tend, au contraire, à restreindre la liberté dans l'intérêt des monopoles; cette fausse tendance paraît être une conséquence de l'erreur dans laquelle l'Assemblée constituante est tombée. Ayant admis en principe qu'une découverte dans les arts est la propriété de celui qui l'a faite, et que ne pas en garantir la jouissance exclusive à l'inventeur, c'était méconnaître les droits inhérens à la nature humaine, il était naturel qu'on donnât à ces prétendus droits toute l'extension qui n'était pas incompatible avec les termes de la loi.
Une mesure qui met momentanément obstacle au développement d'un nouveau moyen d'existence, est, en général, moins désastreuse que celle qui détruit des moyens d'existence déjà établis, comme l'acte qui prévient la formation d'un [II-57] mariage, est infiniment moins funeste que celui qui causerait la destruction d'une famille. Le monopole d'une nouvelle branche d'industrie, donné temporairement à l'inventeur, avant que personne ait pris possession de cette industrie, n'a pas d'autre effet que d'arrêter pour quelque temps la formation de nouvelles richesses; il ne condamne aucune famille à la ruine et à la destruction. Tous les hommes industrieux se trouvent, après l'établissement du monopole, à peu près dans l'état où ils étaient avant l'invention. Si quelques-uns perdent la chance de faire eux-mêmes la découverte, tous sont appelés à jouir des avantages qu'elle doit produire pour la société.
Il existe donc une immense différence entre le monopole d'une industrie dont personne n'a pris possession, et le monopole d'une industrie déjà pratiquée. Celui-ci dépouille nécessairement un nombre de personnes plus ou moins grand, de leurs moyens d'existence, et les condamne à la misère. Celui-là n'a pas, en général, d'autre effet que de surprendre momentanément l'essor d'un genre particulier d'industrie. Cette différence suffit pour expliquer la rigueur avec laquelle les cours de justice de la Grande-Bretagne font observer les conditions imposées aux inventeurs qui veulent réduire leurs découvertes en monopole, pendant le temps déterminé par la loi.
[II-58]
CHAPITRE XXX.
Des lois relatives à la propriété des inventions industrielles.↩
LE statut de la vingt-unième année du règne de Jacques Ier ne déclare pas que toute découverte, quel qu'en soit l'objet, est la propriété de celui qui l'a faite il reconnaît seulement à la couronne la faculté d'accorder à l'auteur d'un nouvel objet fabriqué ou manufacturé, le privilège exclusif de se livrer, pendant quatorze années, à la fabrication de ce même objet, si d'ailleurs personne n'en faisait usage au moment où les lettres-patentes ont été concédées [8].
Le décret de l'Assemblée constituante est beaucoup plus général il proclame, ainsi qu'on l'a. déjà vu, que toute idée nouvelle dont la manifestation peut devenir utile à la société, appartient primitivement à celui qui l'a conçue que toute découverte ou nouvelle invention est la propriété de son auteur, et qu'en conséquence la loi doit lui en garantir la pleine et entière jouissance.
[II-59]
Cependant, quelque générales que soient les dispositions de ce décret on a été obligé de les restreindre, dans la pratique, aux objets produits par la main de l'homme, et qui peuvent faire la matière d'un échange. Si l'on avait voulu les prendre dans le sens le plus large, elles seraient devenues des obstacles à toutes sortes de progrès, sans profit pour personne. Dans un grand nombre de cas, elles auraient été inexécutables [9].
La loi anglaise, comme la loi française, n'accorde un privilége pour la fabrication et la vente d'une nouvelle marchandise, qu celui qui en est le véritable inventeur. Celui qui fabrique une chose qui n'a pas été produite avant lui, n'a droit à aucun privilége si la description en a été donnée dans un ouvrage scientifique [10]. Il importe peu d'ailleurs [II-60] que cet ouvrage soit ou ne soit pas écrit en français, qu'il ait été publié en France ou en pays étranger. En Angleterre, on ne considère pas non plus comme inventeur celui qui se borne à mettre en pratique un procédé qu'on lui a verbalement enseigné, à moins qu'il ne l'ait appris en pays étranger [11].
Après avoir refusé le privilége de l'invention à celui qui emprunte à un ouvrage scientifique le moyen de faire une chose nouvelle, il semble peu raisonnable de l'accorder à celui qui ne fait qu'imiter un produit fabriqué chez une autre nation. Cependant, la jurisprudence anglaise, et le décret de l'Assemblée constituante du 31 décembre 1790, donnent, en pareil cas, à l'imitateur, les mêmes avantages que s'il était inventeur. La loi française (art. 9) se borne à restreindre les brevets d'importation aux industries étrangères dont les inventeurs ont encore le monopole [12].
Dans les deux pays, on s'est laissé diriger, quand on a adopté cette mesure, moins par l'intérêt bien [II-61] entendu de l'industrie, que par cette jalousie commerciale qui, pendant long-temps, a divisé les nations, et qui n'est pas encore éteinte. Lorsqu'une industrie, utile pour celui qui s'y livre comme pour le public, est pratiquée chez une nation, elle ne tarde pas à se répandre chez les autres. Il n'est pas nécessaire, pour la propager, de recourir à l'appât des monopoles. Les communications entre les peuples policés sont aujourd'hui si faciles et si rapides, tous les hommes industrieux sont tellement à l'affût des procédés qui peuvent leur assurer quelques bénéfices, que l'importation d'une industrie nouvelle n'a nul besoin d'être stimulée. Le monopole dont on fait jouir l'auteur de l'importation, est, pour la société, un mal qui n'est compensé par aucun avantage.
Il est possible que deux personnes fassent la même découverte, et demandent un brevet d'invention à peu près en même temps. Lorsqu'un pareil cas se rencontre, la jurisprudence anglaise donne le privilége de l'exploitation à celle des deux qui, après avoir obtenu son brevet, publie la première sa découverte, et qui en assure ainsi une prompte jouissance au public.
Les termes dont se sert le statut de Jacques Ier pour désigner les choses qui peuvent être l'objet d'un monopole (new manufacture), indiquent, non des idées ou des vérités générales, comme le [II-62] décret de l'Assemblée constituante, mais des choses matérielles produites par la main de l'homme. Ces termes sont moins généraux, et surtout moins vagues que ceux qui sont employés par la loi française. Cependant, ils ont donné lieu à de nombreuses difficultés, et ils embrassent tant de choses qu'ils n'ont jamais été complétement définis. Le sens en a été, au reste, assez bien déterminé par un long usage et par les controverses auxquelles ils ont donné lieu devant les cours de justice.
Une chose ne peut être l'objet d'un privilége que lorsqu'elle est faite par la main de l'homme, qu'elle est nouvelle, qu'elle n'a pas encore été mise en usage, qu'elle peut être l'objet d'une vente ou d'un échange, qu'elle est utile à la société, ou que du moins la vente n'en est pas illicite.
L'industrie agricole exerce une influence immense sur la plupart des productions de la nature; cependant on ne considère pas ces productions comme ayant été formées par la main de l'homme. Aussi, quoique beaucoup de découvertes aient été faites dans l'agriculture, il ne paraît pas que ceux qui en ont été les auteurs, les aient considérées comme leur propriété exclusive, et qu'ils aient réclamé le privilége de les exploiter. Un chimiste qui, par le mélange de plusieurs choses déjà connues, parvient à former un tout jusqu'alors inconnu peut obtenir le privilége de le fabriquer. Un [II-63] agriculteur qui, par des combinaisons analogues, obtiendrait de ses terres ou de ses troupeaux des produits précieux que personne n'aurait obtenus avant lui, ne serait pas admis à réclamer le privilége de les produire seul. Les termes mêmes de la loi anglaise condamneraient une telle prétention; ceux de la loi française paraîtraient, au contraire, la justifier. Cependant, si la question se présentait parmi nous, il est probable que le bon sens l'emporterait sur la lettre de la loi. Il faut donc qu'un produit soit fabriqué par la main de l'homme, pour faire l'objet d'un monopole au profit de l'inventeur [13].
Il faut, de plus, qu'il soit nouveau, c'est-à-dire qu'il n'en ait pas existé de semblable. Un ouvrage dans lequel on en trouverait la description, et où l'on aurait exposé les moyens de l'obtenir, suffirait, ainsi qu'on l'a déjà vu, pour lui enlever tout caractère de nouveauté. La circonstance que l'inventeur n'aurait pas connu cet ouvrage, servirait sans doute à prouver son mérite, mais ne prouverait rien en faveur de la nouveauté de l'invention. Il ne suffit pas, en effet, pour obtenir le privilége de fabriquer une marchandise quelconque, de l'avoir inventée; il faut, de plus, que d'autres n'en aient [II-64] pas auparavant publié la découverte : il doit y avoir tout à la fois invention et nouveauté [14].
Personne ne doit avoir été en possession de faire usage de l'objet inventé avant la concession du privilége. La raison de cette condition est facile à voir : la faculté d'en faire de semblables est acquise avant le privilége de l'inventeur. Si l'auteur de la découverte la fait connaître avant que d'avoir demandé un brevet, il donne par cela même la faculté de l'imiter. Or, il la fait évidemment connaître, s'il aliène l'objet qu'il a inventé, ou seulement s'il en fait usage, de manière que d'autres puissent s'approprier et mettre en pratique ses idées ou ses procédés [15].
[II-65]
L'inventeur, avant de faire la demande d'un brevet d'invention, peut cependant avoir besoin de soumettre sa découverte à l'expérience; s'il l'y soumet, ne sera-t-il pas considéré comme en ayant fait usage? Le jurisconsulte anglais qui a soulevé cette question, ne l'a point résolue; il s'est borné a faire observer qu'elle ne s'était encore présentée devant aucune cour de justice.
Si l'usage que l'auteur fait publiquement de son invention, le prive de la faculté d'exercer un privilége, c'est par la raison que son procédé se trouve divulgué, et le droit d'imitation acquis avant la concession du monopole. Toute expérience qui fait connaître sa découverte, a donc le même effet que l'usage public de la chose inventée : elle doit être suivie des mêmes conséquences.
L'objet inventé doit pouvoir faire la matière d'un échange ou d'une vente; s'il ne pouvait être vendu ou échangé, on ne voit pas comment il pourrait tomber sous les dispositions des lois faites pour l'encouragement des arts industriels et du commerce. La découverte d'une méthode ou d'un principe peut donner naissance à un monopole, si elle amène la production d'une chose nouvelle qui soit susceptible d'être vendue ou échangée; mais le monopole existe alors pour le nouvel objet produit, et non pour le principe à l'aide duquel on l'obtient. Une méthode qui n'aurait pour [II-66] résultat que de faciliter le développement de nos organes physiques ou intellectuels, de les rendre plus propres, par exemple, à exécuter certaines opérations, ne pourrait, à plus forte raison, être l'objet d'un privilége. Les produits d'une telle méthode, en la supposant efficace, seraient des hommes plus habiles, plus ingénieux, plus adroits ou plus forts, et de tels produits ne peuvent être ni vendus, ni échangés. Dans la possession d'une méthode ou dans la connaissance de certaines vérités générales, il n'y a rien de matériel, rien qui puisse être l'objet d'un commerce proprement dit, rien que la main de l'homme ait formé[16].
Il ne faut pas confondre un principe de physique, une vérité élémentaire, soit avec les choses nouvelles qu'on peut produire à l'aide de ce principe, soit avec les machines ou les instrumens nouveaux, à l'aide desquels on en tire parti au profit de l'industrie. Le savant qui, le premier, observa quelques-unes des propriétés du feu et de l'eau, la force de la vapeur, par exemple, n'aurait pu obtenir le privilége exclusif de faire usage de cette force, quel que fût d'ailleurs le mérite de sa découverte. Le mécanicien qui inventa une machine propre à en [II-67] tirer parti et à en régulariser l'action, pouvait, au contraire, obtenir le privilége de fabriquer, d'employer ou de vendre des machines de cette espèce [17]. La force de la vapeur n'est pas, comme la machine qu'elle met en mouvement, le produit de l'industrie humaine; elle ne peut pas plus être un objet de commerce que l'électricité, la gravitation, ou que l'élasticité de l'air [18].
Les jurisconsultes anglais exigent, de plus, pour qu'une découverte donne naissance à un privilége, que la chose inventée ait, par elle-même, une certaine importance, et qu'elle soit utile au public. On a quelque peine à concevoir comment une chose qui ne serait d'aucune utilité pour personne, pourrait être un objet de commerce. On ne comprend pas plus facilement pourquoi le producteur d'une chose dépourvue d'utilité, tiendrait à la fabriquer exclusivement, ou pour quelle raison un tel privilége lui serait disputé. Cependant la question s'est quelquefois présentée, et il a été décidé qu'une chose qui, par elle-même, était sans valeur ou sans utilité, ne pouvait donner lieu à un monopole au profit de l'inventeur. La raison en est que, si l'on autorisait des monopoles pour des découvertes qui n'ont aucune importance [II-68] réelle, on surchargerait d'entraves l'industrie et le commerce, sans aucun profit pour la société.
Il pourrait arriver aussi qu'en faisant éprouver à un objet dont le commerce est libre, une modification insignifiante, un individu parvînt au moyen d'un brevet d'invention, à tromper le public auquel il persuaderait qu'une marchandise pour laquelle on a obtenu un brevet d'invention, vaut mieux que celle qu'il est permis à chacun de fabriquer et de vendre [19].
Exiger qu'une chose soit utile, c'est exiger, à plus forte raison, que la production et le commerce en soient licites. Un objet dont la vente serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, ne pourrait pas plus être la matière d'un monopole que d'un commerce libre. Celui qui aurait surpris un brevet d'invention pour la fabrication d'un tel objet, n'obtiendrait de la justice aucune protection pour l'exploitation de son monopole.
Pourvu que la chose produite soit réellement nouvelle, il importe peu qu'elle ait été obtenue en séparant des élémens que la nature avait unis, ou en combinant ensemble des choses qui existaient séparément. Le savant qui découvrit l'art d'extraire du sucre d'une racine, aurait pu prétendre au privilége d'exploiter pendant un [II-69] certain temps cette branche d'industrie, comme celui qui, par le mélange de certaines drogues, parvint à composer cette liqueur noire qui nous sert à fixer nos idées sur le papier. Il importe également peu que la chose produite soit destinée à être immédiatement consommée comme certains remèdes, ou qu'elle soit destinée à produire d'autres marchandises, comme certaines machines ou certains outils. L'essentiel, pour obtenir le monopole de la fabrication, c'est la chose produite soit nouvelle, qu'elle ait une véritable importance, que l'usage en soit licite, qu'elle ait été inventée par celui qui réclame le privilége de la fabriquer, et que le procédé de la fabrication n'ait pas été divulgué par l'usage de la chose ou autrement.
Le mot invention ne désigne pas seulement la découverte d'une chose entièrement nouvelle; il sert aussi à désigner les additions ou perfectionnemens apportés à des choses déjà connues. Les machines un peu compliquées sont rarement le produit des découvertes d'un seul homme; elles n'arrivent à un certain degré de perfection que par les additions qui y sont faites successivement. Or, chaque addition qui en accroît la puissance ou l'utilité, est une découverte pour l'exploitation de laquelle un brevet peut être demandé. La demande et la concession du privilége doivent porter, [II-70] au reste, non sur la chose perfectionnée, mais seulement sur l'addition ou le perfectionnement qu'on y a fait. La concession serait nulle, ainsi qu'on le verra plus loin, si elle portait sur la chose tout entière.
Les lois anglaises considèrent l'exploitation exclusive d'une découverte dans les arts, comme un véritable monopole, c'est-à-dire comme une restriction au droit qui appartient à chacun de se livrer à l'exercice d'une industrie qui, par elle-même, n'a rien d'illicite. Le privilége donné à l'inventeur ne résulte donc pas du seul fait de l'invention; il résulte de la concession que lui fait l'autorité publique. Or, cette concession ne peut pas avoir lieu, si, avant d'être faite, d'autres personnes sont en possession de la découverte. L'inventeur qui, de quelque manière que ce soit, divulgue son secret avant d'avoir obtenu un privilége, donne, par cela même, à chacun la faculté de le mettre en pratique. Cette faculté une fois acquise, ne peut plus être enlevée, quand même personne n'en aurait encore fait usage.
Les lois françaises, après avoir considéré toute découverte comme la propriété de celui qui en est l'auteur, disposent cependant de la même manière que les lois anglaises. Elles font dater le privilége de l'inventeur, non du jour où il a fait sa découverte, mais du jour où le ministre de l'intérieur [II-71] délivre à l'inventeur un certificat qui constate la réception de sa demande. En France, comme en Angleterre, l'auteur d'une découverte ne peut plus prétendre à l'exploiter exclusivement, si, avant l'obtention de son privilége, d'autres ont acquis les connaissances nécessaires pour la mettre en exécution [20].
Cette disposition, toute rigoureuse qu'elle paraît, n'est cependant que l'application d'un principe de justice que tous les peuples doivent se faire un devoir d'observer. Elle n'est qu'une conséquence ou qu'une application de la garantie donnée aux moyens d'existence légitimement acquis, aux espérances légitimement formées. Cette garantie, qui s'applique à tous les genres d'industrie et à toutes les propriétés, est plus importante que les encouragemens donnés au commerce par des [II-72] monopoles. Partout où elle manque, tout autre moyen de faire prospérer les arts et le commerce est illusoire; elle est le premier et le plus grand des encouragemens. Si l'auteur d'une découverte déjà connue du public et dont l'exploitation est permise à chacun, était admis à en demander le monopole, on ne pourrait lui accorder sa demande, sans courir le risque de porter atteinte à des établissemens déjà formés sous la protection des lois. Les pertes qui résulteraient d'une atteinte de ce genre, et les craintes qu'elle inspirerait à ceux qui se proposeraient de former des établissemens industriels, seraient, pour la société, des maux plus graves que la déchéance prononcée contre un inventeur qui n'a pas su garder le secret de son invention. Le privilége attaché à une découverte ne peut donc, comme tous les autres monopoles, exister que par la concession que l'autorité publique en fait à l'inventeur; et la concession ne peut être valable qu'autant qu'au moment où elle a eu lieu, personne ne s'était engagé dans l'exploitation d'une industrie pareille.
La première condition imposée à un inventeur qui veut obtenir le privilége d'exploiter sa découverte, est d'exposer clairement en quoi elle consiste. Cette exposition, à laquelle on donne le nom de spécification, doit être conçue de telle manière qu'en la lisant, tout homme d'une instruction moyenne puisse avoir des idées exactes de l'invention, [II-73] et la mettre en pratique, s'il est versé dans l'art auquel elle se rapporte. Suivant la jurisprudence anglaise, l'inventeur doit décrire non-seulement la chose inventée, mais aussi la méthode suivant laquelle il l'a faite ; il est tenu, de plus, d'indiquer la matière dont il l'a composée. Il doit écarter de sa description tout ce qui est étranger à sa découverte, tout ce qui pourrait la rendre obscure [21].
Le décret de l'assemblée constituante, du 31 décembre 1790, impose à l'inventeur l'obligation de donner une description exacte des principes, moyens et procédés, qui constituent sa découverte, ainsi que les plans, coupes, dessins et modèles qui pourraient y être relatifs. Cette disposition, conforme à ce qui se pratique en Angleterre, a pour objet de déterminer, d'une manière exacte, la nature et l'étendue de chaque découverte, de donner au public une parfaite connaissance de l'invention, et de fournir aux hommes industrieux qui veulent faire faire des progrès à l'industrie, le moyen de s'assurer qu'ils n'empiètent pas sur les priviléges acquis par d'autres inventeurs.
La jurisprudence anglaise est très-sévère sur [II-74] l'exactitude qu'elle exige dans les descriptions; elle déclare nulles toutes les concessions accordées sur des spécifications faites de manière à induire le public en erreur, ou à lui laisser ignorer une partie de la découverte. Un inventeur, par exemple, qui, dans la description de sa découverte, comprendrait des parties qui sont anciennes, en laissant croire que l'invention lui en appartient, perdrait, par ce seul fait, le privilége de fabriquer les parties dont la découverte est à lui. Il doit ne décrire que ce qu'il a inventé, ou, s'il décrit toute la chose, il doit indiquer, d'une manière exacte, les parties qui sont anciennes, et celles qui sont nouvelles. La loi française dispose à cet égard de la même manière que la loi anglaise.
L'omission, dans la description, de quelques parties essentielles suffirait aussi pour invalider la concession du privilége, surtout si l'on avait des raisons de penser qu'elle a été faite volontairement, et dans la vue de tromper le public. La concession peut également être annulée, si l'auteur s'est exprimé dans des termes tellement ambigus, qu'ils puissent s'appliquer à divers procédés, sans qu'on ait le moyen de savoir, par de savoir, par la description, quel est celui qui doit produire le résultat désiré. Elle serait également nulle şi l'inventeur avait compris, dans sa description, des choses inutiles et dont il ne fait pas lui-même usage, dans la vue de rendre sa [II-75] découverte plus compliquée, et d'induire en erreur ceux qui voudraient l'imiter. L'inventeur qui exposerait plusieurs moyens d'obtenir un résultat, serait déchu de son privilége, si parmi les moyens indiqués, il y en avait un qui ne produisît pas l'effet annoncé. Il en serait de même, s'il attribuait à la chose inventée des qualités qu'elle n'a pas, des effets qu'elle ne peut pas produire; s'il n'indiquait pas tous les moyens de créer la chose de la meilleure qualité, ou s'il indiquait des matières plus chères que celles dont il fait lui-même usage. La concession du monopole n'est faite, en un mot, que sous la condition que l'inventeur fait connaître tout ce qu'il sait relativement à sa découverte, et qu'il ne s'attribue que ce qui lui appartient. Si cette condition n'est point remplie, le privilége s'évanouit [22].
La manière d'obtenir la concession d'un privilége pour l'exploitation d'une découverte, n'est pas la même en France qu'en Angleterre. La description ou spécification est exigée dans les deux pays; mais, quand elle est faite, les procédés ne sont plus les mêmes. En France, l'inventeur qui veut obtenir un brevet d'invention, après avoir payé le droit exigé par la loi, met sous enveloppe [II-76] la description de sa découverte, la pétition au ministre de l'intérieur, par laquelle il demande un brevet, les dessins explicatifs de son invention, et l'inventaire de toutes les pièces jointes à sa demande. Le paquet cacheté est déposé à la préfecture, où l'on dresse un procès-verbal du dépôt sur le dos même du paquet, et une copie du procès-verbal est remise au pétitionnaire. Dans la semaine, les pièces ainsi cachetées sont envoyées par le préfet au ministère de l'intérieur, où l'on enregistre le procès-verbal inscrit sur le dos du paquet, à l'instant même où il arrive. Aussitôt, le paquet est ouvert, et l'on expédie à l'inventeur un certificat de sa demande. Ce certificat est son titre de propriété, et ne peut lui être refusé.
On voit, par cet exposé, qu'avant la délivrance du brevet d'invention, personne n'est appelé à prononcer, ni sur la réalité de la découverte, ni sur son utilité, ni sur l'exactitude de la description, ni sur la régularité de la demande. L'autorité publique n'intervient que pour percevoir un impôt, pour constater une prétention et en déterminer la date. Le certificat délivré par elle ne préjuge absolument rien sur la réalité, ou l'importance, ou l'utilité de l'invention. Si, plus tard, des difficultés s'élèvent à ce sujet, entre le prétendu inventeur et ses citoyens, ce n'est qu'aux tribunaux qu'il appartient de prononcer. Chacun est admis à soutenir et [II-77] à prouver, ou que la chose n'est pas nouvelle, ou que le possesseur du brevet n'est pas auteur de l'invention, ou qu'il ne s'est pas conformé aux conditions prescrites par les lois.
Le gouvernement anglais a cru qu'il ne pouvait pas ainsi concéder un monopole pour l'exploitation d'une découverte, avant que d'avoir fait examiner s'il existe, en effet, une découverte, et si elle peut être utile au public. La demande des lettres-patentes pour une invention, doit passer dans plusieurs bureaux, où elle est examinée par les hommes de loi de la couronne. L'objet de cet examen est de garantir le public de toutes tromperies, de mettre la couronne à l'abri des surprises, et de prévenir les inconvéniens qui résulteraient de la concession du privilége de fabriquer et de vendre un produit indigne de protection. Les officiers du gouvernement ont donc la faculté de refuser des lettres-patentes à l'inventeur, et ne sont pas tenus de rendre raison des causes de leur refus. L'auteur d'une découverte leur demande des lettres-patentes, non à titre de droit, mais à titre de concession ou de grâce; sous ce rapport, la loi anglaise est en opposition avec la loi française [23]. S'ils lui en accordent, personne n'est privé pour cela du droit de mettre en question la réalité, [II-78] l'importance ou l'utilité de la découverte; chacun est admis, au contraire, comme en France, à contester la légalité de la concession.
La loi française veille particulièrement aux intérêts de l'inventeur; elle prend toutes les précautions possibles, pour que sa découverte ne lui soit pas injustement enlevée. Elle ne donne pas aux officiers du gouvernement le pouvoir de prononcer sur la réalité ou l'utilité de la découverte, de peur qu'ils ne se trompent ou ne se rendent coupables d'injustice [24]. La loi anglaise paraît s'occuper des intérêts du public plus que de ceux de l'inventeur; elle donne plus de confiance aux officiers de la couronne, et ne craint pas qu'ils abusent de leur autorité, au préjudice de l'auteur de la découverte. Il est douteux cependant qu'en définitive, cette sollicitude soit très-profitable au public; car il n'arrive guère, on pourrait même dire qu'il n'arrive jamais, que le gouvernement refuse les lettres-patentes qui lui sont demandées. Les droits que l'inventeur est obligé de payer au fisc, avant que d'avoir tiré aucun bénéfice de sa découverte, la faculté que chacun possède de discuter publiquement le mérite ou la réalité de l'invention, le pouvoir donné aux tribunaux de prononcer sur la légalité de la concession du privilége, et l'attention que chacun [II-79] apporte dans ses achats, sont des garanties plus sûres que l'examen auquel se livrent les officiers du gouvernement avant la délivrance des lettres-patentes.
La description ou spécification que l'auteur a faite de sa découverte, doit être inscrite sur un registre public, que chacun a le droit de consulter. En Angleterre, toute personne peut, non-seulement consulter ce registre; mais aussi se faire délivrer copie d'une spécification qu'elle se croit intéressée à connaître. Cette disposition a pour objet de garantir au public la possession de la découverte, et de donner à chacun la faculté de l'exploiter, quand le privilége de l'inventeur est expiré. Elle a aussi pour objet de prévenir les pertes des hommes industrieux pourraient faire, en se livrant à des travaux, et en sollicitant la concession d'un privilége pour une industrie qui serait déjà privilégiée. Des inventeurs ont quelquefois tenté d'obtenir que leurs descriptions ou spécifications ne fussent pas livrées au public, en alléguant que les étrangers pourraient profiter de leurs découvertes; mais ces tentatives n'ont eu aucun succès [25]. En France, la description d'une découverte ne pourrait être cachée au public, qu'en vertu d'une loi spéciale qui aurait autorisé le secret, [II-80] après que l'inventeur aurait eu fait connaître les raisons politiques ou commerciales qui s'opposent à la publicité.
L'inventeur qui obtient en France un brevet d'invention, est tenu de mettre sa découverte en activité dans les deux années qui suivent, sous peine de déchéance, à moins qu'il ne justifie des raisons de son inaction. Cette disposition, qui paraît d'abord assez juste, laisse cependant un vaste champ à l'arbitraire, puisqu'elle ne dit pas quelles sont les causes propres à justifier l'inventeur de n'avoir pas mis sa découverte en pratique. L'auteur d'une découverte qui a fait des frais, pour s'en assurer exclusivement l'exploitation, et qui néanmoins ne l'exploite pas, a certainement quelques bonnes raisons à donner de son inaction. La faculté donnée aux juges d'admettre comme valables toutes sortes d'excuses, ou de les repousser toutes, ne peut être considérée comme une garantie, ni pour le public ni pour l'inventeur.
La durée du monopole que les lois anglaises permettent d'accorder à l'inventeur, ne peut pas excéder quatorze ans; mais elle est quelquefois moins considérable. Le gouvernement la détermine, en prenant en considération les frais qu'exigent la mise en action de la découverte, et les bénéfices probables qui peuvent être faits dans un temps donné. En France, la durée du monopole est de [II-81] cinq, de dix ou de quinze ans, au choix de l'inventeur; comme on aurait pu craindre que l'auteur d'une découverte ne donnât toujours la préférence au terme le plus long, on a élevé la somme à payer au trésor public, en raison de la durée du monopole [26]. Le terme fixé pour la jouissance du privilége ne peut être prolongé, soit en France, soit en Angleterre, que par un acte de la puissance législative.
Les lois anglaises ont déterminé le nombre des personnes qui peuvent prendre part à l'exploitation d'une découverte ce nombre ne peut jamais être au-dessus de cinq. Une des conditions les plus rigoureuses sous lesquelles la concession est faite, dit un jurisconsulte anglais, est que l'inventeur ne pourra céder son brevet, ni le diviser en actions, ni chercher des souscripteurs pour l'exploiter, ni le mettre en société, de manière que plus de cinq personnes s'y trouvent intéressées; l'infraction de cette condition suffit pour annuler le privilége. La loi du 25 mai 1794, de l'Assemblée constituante, en reconnaissant à tout inventeur le droit de contracter telle société qu'il [II-82] lui plairait, en se conformant aux usages du commerce, lui avait interdit d'établir son entreprise par actions, à peine de déchéance de l'exercice de son brevet; un décret impérial, daté de Berlin, du 25 novembre 1806, déclara cette disposition abrogée, et soumit les inventeurs qui voudraient exploiter ainsi leurs découvertes, à se pourvoir de l'autorisation du Gouvernement.
Un inventeur jouit donc en France de droits beaucoup plus étendus que ceux dont il jouirait en Angleterre; il peut diviser son privilége en autant de parts qu'il juge convenable, et intéresser au succès de son entreprise, toutes les personnes qui désirent s'associer à lui.
Les lettres-patentes délivrées par le gouvernement anglais ne donnent un privilége à l'inventeur que pour l'Angleterre proprement dite, à moins que les colonies ne s'y trouvent aussi mentionnées. Si l'inventeur veut exercer son privilége sur l'Écosse et sur l'Irlande, il faut qu'il demande des lettres-patentes séparées, pour chacun de ces deux pays. Il a donc besoin de trois brevets d'invention pour avoir un monopole dans les trois royaumes-unis. Cette nécessité ne paraît pas avoir d'autre objet que de grossir les revenus des hommes en place.
Un brevet d'invention délivré par le Gouvernement français, donne à celui qui l'a obtenu le [II-83] droit de former des établissemens dans toute l'étendue du territoire national, et même d'autoriser d'autres particuliers à faire l'application et l'usage de ses moyens et procédés.
Il est, dans la loi du 31 décembre 1791, une disposition dont il est difficile de trouver la raison : elle porte que tout inventeur qui, après avoir obtenu une patente en France, sera convaincu d'en avoir pris une pour le même objet en pays étranger, sera déchu de sa patente. Si cette interdiction faite à l'inventeur devait avoir pour résultat d'empêcher sa découverte d'arriver chez d'autres nations, on pourrait la défendre, comme on défend toutes les prohibitions produites par des rivalités commerciales. Mais, le registre des spécifications étant ouvert à tout le monde, on ne voit pas pourquoi l'on interdit à l'auteur d'une découverte un moyen de fortune licite pour tous les autres citoyens. Cette prohibition, qu'il est d'ailleurs facile d'éluder au moyen de personnes interposées, est nuisible à l'inventeur, et ne peut pas produire le moindre avantage pour le public.
Lorsqu'un brevet a été délivré, il est mis par les lois anglaises et par les lois françaises au même rang que les autres propriétés mobilières : il peut être échangé, vendu, donné, légué par testament, comme toute autre espèce de biens.
Lorsque le terme pour lequel un brevet d'invention [II-84] a été accordé, est expiré, chacun peut se livrer à l'exercice de l'industrie pour laquelle un privilége avait été donné. On admet néanmoins en France, comme en Angleterre, que la puissance législative peut prolonger la durée du monopole, ou pour mieux dire, accorder un nouveau terme sur la demande de l'inventeur. Comme une telle prolongation pourrait causer un dommage considérable aux personnes qui auraient eu l'intention de se livrer à l'exercice de la même industrie après l'expiration du privilége, les lois anglaises obligent l'inventeur à publier, à plusieurs reprises, dans les journaux, la demande qu'il fait d'un nouveau délai. Ce n'est qu'après avoir ainsi donné l'éveil à tous les intérêts, et avoir mis toutes les personnes auxquelles la prolongation du privilége pourrait causer quelque dommage, à même de faire entendre leurs réclamations, que le parlement prononce sur la demande, en observant les délais et les formes prescrits pour la formation des lois [27]. En France, on n'a pas pris de telles précautions; il est vrai que les inventeurs ne font pas usage de la faculté que la loi leur donne, de demander la prolongation de leur privilége, et qu'on n'a pas eu, par conséquent, à prévenir l'abus de cette faculté.
Suivant la loi du 31 décembre 1790, l'inventeur [II-85] breveté dont le privilége a été violé, peut, en donnant caution, requérir la saisie des objets contrefaits, et traduire les contrefacteurs devant les tribunaux. Si la contrefaçon est prouvée, les objets saisis sont confisqués, le contrefacteur est condamné à payer au propriétaire du brevet, des dommages-intérêts proportionnés à l'importance de la 'contrefaçon, et, en outre, à verser, dans la caisse des pauvres, une amende fixée au quart du montant desdits dommages-intérêts, sans toutefois que cette amende puisse excéder la somme de trois mille francs, et au double en cas de récidive.
Si la dénonciation pour contrefaçon, d'après laquelle la saisie aurait eu lieu, se trouvait dénuée de preuves, l'inventeur serait condamné, envers sa partie adverse, à des dommages-intérêts proportionnés au trouble et au préjudice qu'elle aurait pu en éprouver, et, en outre, à verser dans la caisse des pauvres une amende fixée au quart du montant des dommages-intérêts, sans toutefois que l'amende puisse excéder la somme de trois mille fr. et au double en cas de de récidive.
Toute personne poursuivie pour contrefaçon peut opposer au propriétaire du brevet d'invention tous les vices qui, suivant les lois, annulent le privilége, et dont l'énumération a été faite dans ce chapitre.
Les dispositions législatives que le gouvernement [II-86] des États-Unis d'Amérique a adoptées sur les inventions industrielles, ne diffèrent que dans un petit nombre de points, de celles qui sont pratiquées en France et en Angleterre.
Les Américains admettent les brevets d'invention et de perfectionnement; mais ils n'accordent pas de brevets d'importation; une industrie connue ou pratiquée chez une autre nation ne peut donc pas devenir chez eux l'objet d'un monopole.
Un étranger est admis à demander un brevet d'invention ou de perfectionnement; mais il faut pour cela qu'au moment où il forme sa demande, il ait déjà résidé deux années dans les États-Unis.
Un brevet d'invention ou de perfectionnement est, du reste, accordé pour les mêmes objets qu'en France et en Angleterre; il est soumis aux mêmes conditions; la durée du privilége qu'il confère est de quatorze ans [28].
En exposant ici la nature, l'étendue et les principales conditions d'une espèce de monopole qu'on a mis au rang des propriétés, je ne me suis pas proposé de faire connaître aux personnes qui veulent obtenir des brevets d'invention, la marche qu'elles ont à suivre ; je n'ai pas eu, non plus, pour objet de fournir à ceux dont l'industrie est entravée par des [II-87] priviléges, des argumens contre les brevets d'invention; je ne me suis proposé que de faire connaître les principes généraux qu'on a suivis à cet égard, soit en Angleterre, soit en France.
[II-88]
CHAPITRE XXXI.
Des fondemens et de la nature de la propriété littéraire.↩
AYANT admis en principe qu'une personne ne peut jamais être la propriété légitime d'une autre, nous en avons tiré la conséquence que toute utilité, toute valeur appartient à celui qui la crée; nous avons reconnu que, tant qu'il ne l'a pas aliénée, on ne peut la lui ravir sans le dépouiller de sa propriété.
Ces propositions sont peu contestées, tant qu'on ne les applique qu'à des produits purement matériels; ainsi, l'on admet facilement qu'un habile ouvrier qui transforme un morceau d'acier en un instrument d'un grand prix, est le propriétaire de cet instrument, ou de la valeur à laquelle il a donné l'existence; on admet aussi que l'homme qui construit ou fait construire un navire avec des matériaux dont il a payé le prix, est propriétaire de ce navire, surtout quand il a payé la main-d'œuvre des ouvriers qu'il a employés.
[II-89]
On admettra de même, sans contestation, que si, sur un papier qui m'appartient, j'écris un poème que j'ai composé, j'aurai la propriété de toute la chose, des vers et du papier; mais si je livre une copie de mon ouvrage à une personne, soit à titre de dépôt, de prêt ou de vente, celui à qui je l'aurai livré, ne pourra-t-il pas s'en servir pour en faire une copie nouvelle, sans porter atteinte à ma propriété? S'il me restitue, sans lui avoir fait subir aucune altération, le manuscrit que je lui ai confié, ne me rend-il pas ma propriété tout entière? S'il m'a payé la valeur d'une copie, n'a-t-il pas acquis par cela même le droit d'en faire des copies nouvelles et de les vendre? C'est sur ces questions que des doutes s'élèvent.
Ceux qui pensent qu'on ne porte pas atteinte à Ja propriété d'un auteur, en multipliant, sans son aveu, les copies de ses écrits, se fondent sur ce qu'une idée n'est la propriété d'une personne qu'aussi long-temps qu'elle demeure renfermée dans son cerveau; aussitôt, disent-ils, qu'elle est divulguée et qu'elle a pénétré dans l'esprit d'autres personnes, elle devient à leur tour leur propriété; celui qui le premier l'a conçue, n'y a plus aucun droit exclusif.
Considérer ainsi les productions littéraires, lorsqu'il est question de propriété, c'est les envisager sous un point de vue faux. On doit remarquer [II-90] d'abord que des pensées qui n'ont jamais été divulguées, ne peuvent donner lieu à aucune discussion. Il importe donc assez peu de savoir si elles sont ou ne sont pas la propriété de tel ou tel individu. On doit observer, en second lieu, que personne n'a jamais prétendu sérieusement qu'une pensée publiée fût irrévocablement acquise au premier qui l'a conçue. Les hommes qui publient leurs ouvrages, sont si éloignés d'avoir de telles prétentions, qu'ils ne se proposent, au contraire, que de faire passer, dans l'esprit de leurs lecteurs, les idées qu'ils ont exprimées. Aucun n'a jamais été assez fou pour revendiquer, à titre de propriétaire, les idées que d'autres avaient puisées dans ses écrits, et dont ils avaient fait usage, soit en les mettant en pratique, soit en composant des ouvrages nouveaux.
Un écrivain qui s'approprierait par l'étude, toutes les pensées que renferme l'Esprit des lois, et qui s'en servirait pour composer un ouvrage qu'il donnerait comme sien, ne serait pas accusé d'avoir porté atteinte à la propriété d'autrui, quand même les œuvres de Montesquieu appartiendraient encore à ses héritiers. Dans un cas pareil, le nouvel ouvrage produit serait une chose dont la création appartiendrait à celui qui en serait l'auteur, et qu'il ne donnerait pas comme l'œuvre d'un autre. Les pensées qu'il aurait puisées dans les écrits de [II-91] Montesquieu seraient devenues sa propriété, comme celles que puisa ce grand écrivain dans les auteurs qui l'avaient précédé, devinrent les siennes.
Mais ce n'est pas dans des cas semblables que s'élèvent les questions de propriété littéraire. Le libraire qui publie et met en vente les tragédies de Racine, les donne sous le nom de cet auteur, et ne les donne pas sous le sien. Les eût-il apprises par cœur, il n'aurait garde de publier, comme siens, les vers de Phèdre ou d'Athalie; s'il faisait une pareille folie, il pourrait bien se couvrir de ridicule, mais il ne persuaderait à personne que ces vers sont une œuvre qui lui appartient. Si ce système d'appropriation par communication était fondé, il s'ensuivrait que toute comédie serait l'œuvre des comédiens qui l'auraient apprise; s'étant approprié les pensées et les expressions du poète, il ne leur resterait qu'à s'en approprier la gloire et le profit.
Un ouvrage littéraire ne se compose pas seulement des idées et des sentimens qu'il exprime; il se compose aussi de l'ordre dans lequel ces sentimens et ces idées sont rendus ; des termes ou des expressions que l'auteur a employés pour les communiquer; de l'arrangement de ces termes ou du style de l'écrivain; le nom et la réputation de l'auteur sont, presque toujours, un des élémens qui forment la valeur de l'ouvrage.
La même pensée peut se présenter à l'esprit de [II-92] plusieurs personnes; divers écrivains, sans s'être communiqués, peuvent écrire l'histoire des mêmes événemens; ils peuvent traiter la même science, faire un poème sur le même sujet; mais jamais il n'est arrivé, et je ne crois pas qu'il arrive jamais, que deux auteurs qui n'ont eu, entre eux, aucune communication, aient produit ou produisent deux ouvrages parfaitement identiques l'un à l'autre.
Peut-on penser, par exemple, que si Virgile était mort dans l'enfance, ou s'il avait jeté ses écrits au feu, sans les avoir communiqués à personne, un poème semblable en tout à l'Enéide aurait été produit par un autre écrivain? Pourrait-on accuser sérieusement La Fontaine d'avoir dépouillé quelqu'un de ces contemporains ou de ses successeurs de l'honneur d'avoir composé les fables que cet écrivain inimitable nous a données? Si Molière n'avait point écrit, un autre aurait-il fait des comédies exactement semblables à celles qui existent sous son nom? Personne ne peut le croire.
Les phénomènes de ce genre peuvent être mis au rang des choses impossibles; cependant, quand même on admettrait, dans la spéculation, qu'ils ne sont pas impossibles, cette supposition ne conduirait à rien, dans la question de la propriété littéraire. Il n'arrive jamais, en effet, que l'imprimeur ou le libraire, qui multiplie, sans autorisation, les copies d'un écrit qu'un autre a composé, et qui [II-93] les vend à son profit, élève la singulière prétention d'avoir été devancé dans la production de l'ouvrage. Nul ne prétend qu'il l'aurait lui-même composé, s'il n'avait pas été prévenu, ou qu'il s'est rencontré avec l'écrivain qui l'accuse de l'avoir volé, et que, s'il y a identité entre les deux écrits, cela tient à un pur effet du hasard.
On ne prouve donc rien contre l'existence de la propriété littéraire, quand on dit qu'une pensée devient la propriété de toute personne qui la conçoit. La seule conséquence raisonnable qu'on puisse tirer de là, c'est que chacun a le droit d'exprimer, à sa manière, et sous son nom les opinions qu'il a conçues ou adoptées. Mais celui qui multiplie, pour les vendre, les copies des ouvrages d'un écrivain célèbre, n'a nullement la prétention de publier ses propres pensées dans un langage qui soit à lui. Il arrive même souvent qu'il n'a pas lu l'écrit dont il multiplie les copies, ou que, s'il l'a lu, il ne l'a pas compris ou ne l'approuve pas complétement. Comment dire alors qu'il ne publie que les pensées qu'il s'est appropriées en les faisant passer dans son esprit?
On a fait un autre raisonnement pour prouver la non-existence de la propriété littéraire; on a dit que, du moment qu'un écrivain avait livré au public une ou plusieurs copies de son ouvrage, chacun pouvait les multiplier et les vendre sans que l'auteur [II-94] eût aucun moyen de l'empêcher. De là on a tiré la conséquence que les écrivains n'ont, sur leurs écrits, que les droits qui leur sont donnés par l'autorité publique, c'est-à-dire par les lois ou les décrets des gouvernemens, et par les tribunaux qui en assurent l'exécution. Ces droits, dit-on, ne sont qu'un véritable monopole.
Je suis obligé de rappeler ici que les gouvernemens n'ont pas la puissance de changer la nature des choses; ils ne peuvent pas faire que ce qui, de sa nature, est juste, ne le soit pas, et que ce qui ne l'est pas, le soit. La propriété résulte d'un certain ordre de faits, et non des déclarations de l'autorité publique; le devoir des gouvernemens et surtout des hommes qui font des lois, est de la faire respecter elle a donc une existence indépendante d'eux et de leurs actes. Les gouvernemens ne créent pas le droit'; ils le proclament et le protégent quand ils sont bons; ils le dénient et le violent quand ils sont mauvais.
Si, de l'impossibilité dans laquelle un auteur se trouve d'empêcher, par sa propre force, la multiplication et la vente des copies de ses ouvrages, on tirait la conséquence qu'il n'y a pas de propriété littéraire, on serait conduit à nier l'existence de toutes les autres propriétés; les droits de chacun seraient en raison de ses forces individuelles. Quel est l'homme qui, ayant des propriétés territoriales [II-95] un peu étendues, pourrait, par lui-même, empêcher que d'autres n'en prissent les fruits? Serait-il sur tous les points en même temps? y serait-il en force pour repousser les assaillans? Les propriétés mobilières seraient-elles plus respectées que les propriétés immobilières [29]?
Pour décider si la propriété littéraire a une existence réelle, et si ce que nous désignons par cette expression, n'est pas un monopole conféré par les gouvernemens aux hommes qui écrivent, au préjudice de ceux qui lisent, il faut donc examiner si nous rencontrons dans les productions de ce genre [II-96] les circonstances qui font donner à d'autres le nom de propriétés.
Un homme va chez un libraire, et achète avec une partie des produits de son industrie , des livres pour former une bibliothèque. Ces livres, quand il en a payé la valeur, sont certainement sa propriété, si le vendeur les avait acquis d'une manière légitime. S'ils lui coûtent , par exemple , vingt mille francs , cette somme tout entière n'est pas un bénéfice pour le libraire. Celui-ci, pour les acquérir, aura peut-être déboursé dix-huit mille francs. Les deux mille francs qu'il aura reçus au-delà du prix d'acquisition , auront servi à l'indemniser de ses peines , et à payer les frais de son loyer et le salaire de ses commis.
Si une partie des vingt mille francs reste dans les mains du libraire , une autre partie va dans les mains du relieur. Celle-ci se divise entre le chef de l'entreprise , ses ouvriers , et ceux qui lui ont fourni les matières premières nécessaires à l'exercice de son industrie. Le tanneur qui a fourni la peau dont les livres sont couverts, le boucher qui l'a vendue, le fermier qui a élevé l'animal, et le propriétaire qui lui a loué sa terre, ont donc tous une part de la somme qui revient au relieur.
Une troisième partie des vingt mille francs revient à l'imprimeur , et celle-ci se divise encore entre une multitude de personnes : les ouvriers de [II-97] l'imprimerie en ont une part, les fondeurs de caractères une autre; il n'y a pas jusqu'aux mineurs, par lesquels la matière des caractères a été fournie, qui n'en reçoivent quelque chose.
Une quatrième partie revient au marchand de papier; celui-ci la distribue entre lui, ses commis et le fabricant; le fabricant de papier en donne une part à ses ouvriers et au marchand de chiffons; enfin, ce marchand distribue la somme qu'il a reçue, entre lui, ses commis et les malheureux qui font métier de ramasser les chiffons dans les rues.
Chacun de ces hommes industrieux qui ont concouru d'une manière plus ou moins directe à la production des livres, a ajouté une petite valeur à la chose, et cette valeur a été sa propriété; car c'est lui qui l'a créée. Il n'est personne, en effet, qui s'avise de contester au chiffonnier, à l'ouvrier papetier, à l'ouvrier imprimeur, le prix de leur journée. De toutes les propriétés, celle qui résulte immédiatement du travail, est une des plus sacrées.
Cela étant entendu, il s'agit de savoir si, parmi le grand nombre de personnes dont le concours est nécessaire à la formation d'un livre, l'auteur est le seul dont le travail soit sans valeur ou sans utilité; il s'agit de savoir si ce travail est moins nécessaire, et mérite moins d'être protégé que celui de tous les autres. La question ainsi posée, il est [II-98] difficile de comprendre comment l'existence de la propriété littéraire a pu être mise en doute.
Il est un certain nombre de choses nécessaires aux hommes, qui existent en si grande abondance, que chacun peut en prendre autant qu'il en désire sans diminuer eu rien la jouissance des autres ; de ce nombre sont la lumière du soleil, l'eau de la mer, l'air atmosphérique. Nous considérons ces choses comme la propriété commune du genre humain; chacun peut en faire usage, sans craindre d'être accusé par les autres d'usurpation.
Or, n'y a-t-il pas dans les compositions littéraires un point de ressemblance avec ces choses qui sont la propriété commune de tous les hommes? Ne peut-on pas multiplier à l'infini les copies d'un ouvrage, sans altérer en rien les jouissances de ceux qui le possèdent? Quand même l'imprimerie multiplierait les fables de Lafontaine de manière à les mettre pour rien dans les mains de toutes les personnes qui savent lire, chacun n'aurait-il pas l'ouvrage tout entier? Et si, sous ce rapport, les ouvrages littéraires ressemblent aux choses auxquelles les jurisconsultes donnent le nom de communes, n'est-ce pas une raison de la soumettre aux mêmes règles?
Si la production des ouvrages littéraires avait uniquement pour objet l'instruction ou le plaisir qui résulte de la lecture, il est évident, en effet, [II-99] qu'il n'y aurait pas de raison de les distinguer des choses communes; car, en multipliant à l'infini les copies d'un écrit, on ne diminue en rien les moyens d'instruction ou de jouissance de ceux qui le possèdent. Mais l'auteur d'un ouvrage n'a pas eu seulement pour but, en le produisant, d'instruire ou d'amuser ceux qui le liront; il s'est proposé de plus d'échanger un produit propre à donner de l'instruction ou de l'amusement, contre des produits d'un autre genre. Un écrivain est dans la même position que tous les hommes qui, dans un état civilisé, tirent de leur travail leurs moyens d'existence. Il ne peut obtenir les divers objets dont il a besoin, qu'en offrant en échange les choses qu'il produit et que d'autres désirent.
Ainsi, quoique les compositions littéraires, du moment qu'elles ont été mises au jour, ressemblent, sous un point de vue, aux choses communes, elles en diffèrent complétement sous un autre rapport; elles sont le produit d'un travail humain et ne peuvent être obtenues qu'autant qu'elles assurent des moyens d'existence aux producteurs ; ce sont ces dernières circonstances qui les font mettre au rang des propriétés privées.
Un ouvrage, pour peu qu'il ait de valeur, n'a pu être produit, en effet, que par une personne dont l'éducation avait été plus ou moins dispendieuse. Il a fallu, pour le composer, y consacrer un [II-100] certain temps, et pendant ce temps il a fallu que l'auteur consommât des richesses précédemment cumulées. Si, pour le créer, l'auteur a eu besoin d'un génie particulier, nul ne saurait lui en contester la propriété, à moins de lui contester aussi la propriété de son esprit. Il a fallu plus de temps, de veilles, de génie à Corneille pour produire le Cid et les Horaces, à Racine pour produire Athalie et Britannicus, qu'il n'en faut à un jurisconsulte pour faire quelques douzaines de consultations, ou à un fabricant pour produire quelques milliers d'aunes de drap. On admet, sans contestation, que les derniers sont propriétaires des biens qu'ils acquièrent par leur science ou leur industrie; pourquoi n'admettrait-on pas aussi que les premiers sont les propriétaires des produits de leur génie? On peut quelquefois mettre en doute si tels ou tels domaines n'ont pas été usurpés par celui qui les possède ; si les millions que tel banquier a fait passer des mains des contribuables dans sa caisse, ont été bien ou mal acquis; mais jamais on n'a mis en doute si Buffon avait usurpé son Histoire naturelle ou Molière ses comédies.
Les nations se trouvent, relativement aux productions littéraires, dans la même position où elles sont à l'égard de toutes les productions: si elles veulent les obtenir, il faut qu'elles les paient. Les hommes qui se livrent à des travaux littéraires ne [II-101] sont pas d'une nature différente des autres : comme ils ont les mêmes besoins, ils sont mus par les mêmes désirs et par les mêmes craintes. Ils comparent sans cesse les peines qu'exigent certaines productions, aux avantages qui doivent en être la suite: si les peines l'emportent, ils y renoncent.
Un homme ne semera pas son champ s'il est convaincu d'avance qu'un autre viendra faire la moisson; il ne plantera point une vigne si un autre doit en cueillir le fruit; il ne fera point bâtir une maison s'il sait qu'elle lui sera ravie du moment qu'elle sera terminée; il ne fera point venir des diverses parties du monde des marchandises pour remplir ses magasins, s'il a la certitude qu'elles seront livrées au pillage.
Ainsi, la première condition pour qu'une valeur soit produite, pour qu'une propriété soit créée, c'est qu'elle soit assurée d'avance à celui qui en sera l'auteur; le moyen le plus infaillible d'en prévenir la formation, est de donner à celui qui pourrait la créer, la certitude qu'il en sera dépouillé sans indemnité, à l'instant même où elle aura été formée : telle est la loi de notre nature, loi aussi infaillible dans ses résultats que les lois du monde physique.
Les peuples étant placés, relativement aux ouvrages littéraires, dans une position pareille à celle où ils se trouvent relativement à tout autre espèce de produits, il ne s'agit plus que de savoir si les [II-102] compositions de l'esprit sont ou ne sont pas favorables aux progrès et au perfectionnement des hommes. Si cette question pouvait paraître douteuse aux yeux de quelques personnes, il suffirait, pour faire disparaître les doutes, de comparer les peuples qui garantissent, au moins pour un temps, les propriétés littéraires à ceux chez lesquels elles sont étouffées avant d'avoir vu le jour : l'Angleterre à la Turquie, les États-Unis et la France à l'Espagne et au Portugal.
Il y a deux moyens tout différens de porter atteinte aux compositions littéraires : l'un est de les mutiler ou de les étouffer avant la publication; l'autre, de ne pas les garantir aux auteurs, quand elles ont paru. Ces deux systèmes ne sont pas défendus dans les mêmes vues, ni par les mêmes classes de personnes. Les hommes qui défendent le premier, ne se proposent, disent-ils, que de prévenir la propagation de certaines erreurs ; ils n'ont pas d'autre objet que d'assurer le triomphe de la vérité, c'est-à-dire le règne de leurs opinions et de leurs intérêts. Ceux qui défendent le second, n'ont pas d'autre désir que de propager les lumières ; ils disent qu'un ouvrage que chacun a la faculté d'imprimer et de répandre, se donne toujours à bas prix, et qu'il est mis ainsi à la portée de tous les lecteurs.
Ce n'est pas ici le lieu d'examiner l'atteinte qu'on [II-103] porte aux productions littéraires par la mutilation ou par la prohibition de les publier; cette question se lie à d'autres qui sont beaucoup plus élevées. Il me suffit de faire observer, dans ce moment, que ce moyen prévient la conception des ouvrages littéraires, bien plus qu'il ne les étouffe. Les hommes qui, dans la plupart des états du continent européen sont chargés de juger les ouvrages littéraires avant la publication, ont probablement peu d'occupation; il doit leur arriver rarement d'avoir à examiner des conceptions hardies ou des ouvrages de génie.
Quant à ceux qui s'imaginent que, pour répandre rapidement les lumières, il faut que chacun ait la faculté de multiplier indéfiniment les copies d'un écrit du moment qu'il a paru, et qu'on ne peut mettre les productions littéraires sur la même ligne que toutes les productions humaines, sans nuire aux progrès de la civilisation, on peut s'étonner qu'ils n'aient pas fait un pas de plus, pour arriver plus vite au résultat; pourquoi, après avoir proclamé que tous les libraires ont le droit de multiplier gratuitement les copies de tout écrit qui a vu le jour, ne reconnaissent-ils pas à tous les lecteurs le droit de prendre des livres chez les libraires sans les payer? Ne serait-ce pas le meilleur moyen de répandre rapidement toutes sortes de connaissances?
On dira, sans doute, que ce moyen n'aurait [II-104] qu'une utilité passagère; que les libraires ne feraient plus imprimer de livres, si leurs boutiques étaient mises au pillage, et qu'ils ne peuvent continuer leur commerce qu'autant qu'il leur assure des moyens d'existence et que leurs propriétés sont respectées. Cela est incontestable; mais il est difficile de comprendre comment ce qui est une vérité évidente pour ceux qui vendent des livres, ne serait pas vrai pour ceux qui les composent ? Penserait-on que, pour produire un livre, le libraire soit un homme plus nécessaire que l'auteur?
Il suit des considérations qui précèdent que, pour protéger la propriété littéraire dans un État où la justice serait bien administrée, on n'aurait aucun besoin d'une loi spéciale; il suffirait de savoir faire l'application des principes généraux du droit jus suum cuique tribuere. Du moment, en effet, qu'on a déclaré que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il a causé, on est obligé de reconnaître que celui qui contrefait un ouvrage appartenant à un autre, pour s'en approprier le produit, est tenu à un dédommagement.
: La question se présenta jadis en Angleterre, devant la cour du Banc du Roi, au sujet du poème de Thompson, les Saisons. Ce poème, que le libraire Miller avait acquis, ayant été contrefait, l'acquéreur intenta une action en dommages contre l'auteur de la contrefaçon. Le jury se borna à [II-105] prononcer sur le fait de la contrefaçon, et laissa aux juges à prononcer sur la question de droit. La question fut ainsi posée: Savoir, si après une publication générale et volontaire d'un ouvrage, par l'auteur ou de son consentement, ledit auteur a la propriété perpétuelle et exclusive de cet ouvrage, de telle manière que le droit d'en faire de nouvelles copies n'appartienne qu'à lui et à ses successeurs, ou à ceux à qui il l'a légalement transmis. Sur quatre juges, trois furent d'avis que le droit perpétuel existait, et que les propriétés littéraires étaient aliénables et transmissibles comme toutes les autres.
Une seconde fois, en 1774, la question se reproduisit devant la Cour de chancellerie, et les juges se prononcèrent encore en faveur du droit de propriété, perpétuel, exclusif. Cette décision ayant été attaquée devant les douze juges, pour cause d'erreur de droit, plusieurs questions furent successivement agitées et résolues.
La première fut de savoir si, d'après le droit commun, l'auteur d'une composition littéraire avait seul le droit de la faire imprimer, et d'en vendre publiquement des copies ou exemplaires. Neuf juges, au nombre desquels était Blackstone, se prononcèrent pour l'existence du droit de l'auteur, contre le juge Eyre qui avait soutenu l'opinion contraire [30].
[II-106]
La seconde question fut de savoir si, en admettant que, d'après le droit commun, un écrivain [II-107] eût seul la faculté de publier et de vendre son ouvrage, cette faculté ne lui avait pas été enlevée par une disposition de loi particulière, et si toute personne ne pouvait pas le publier et le vendre sans son consentement. Sur cette question de droit local, six juges furent d'avis qu'aucune loi particulière n'avait enlevé à un auteur le droit d'imprimer et de publier ses ouvrages, et que nul ne pouvait, après la publication, les réimprimer et les vendre, sans son autorisation et contre sa volonté. Quatre juges furent d'une opinion contraire.
La troisième question fut de savoir si, en admettant que l'auteur eût une action d'après le droit commun, cette action ne lui avait pas été enlevée par le statut de la huitième année du règne de la reine Anne, ch. 3; et si un auteur était exclu de tout recours, autre que celui que le même statut lui accordait, et aux termes et conditions qui y étaient mis. Six juges décidèrent que toute action, suivant le droit commun, avait été enlevée par ce statut, et que celle qu'il avait accordée était la seule à laquelle il fût permis d'avoir recours. L'opinion contraire fut soutenue par cinq juges.
La quatrième question fut de savoir si, d'après le droit commun, l'auteur d'un ouvrage littéraire, et ses héritiers ou successeurs, avaient seuls le droit de l'imprimer et de le publier à perpétuité? Sept [II-108] juges se prononcèrent pour l'existence de ce droit, quatre furent d'un avis contraire.
Enfin, la cinquième question fut de savoir si ce droit perpétuel de propriété, sur des ouvrages littéraires, avait été dénié, restreint ou enlevé par le statut de la huitième année du règne de la reine Anne. Six se prononcèrent pour l'affirmative, et cinq pour la négative. En conséquence, la décision rendue par la Cour de la chancellerie, fut annulée sur la motion de lord Camden, secondée par le chanchelier [31].
Ainsi, le statut relatif à la propriété littéraire n'a pas été considéré, en Angleterre, par la majorité des magistrats, comme ayant créé un droit en faveur des auteurs; il a été considéré, au contraire, comme ayant restreint un droit de propriété préexistant. Si ce statut n'avait pas été rendu, les ouvrages littéraires auraient été mis sur le même rang que les autres propriétés privées. Ce statut a donc reconnu le droit, il en a limité la durée; mais il ne l'a pas créé.
Richard Godson, dont l'opinion a été citée au commencement de ce chapitre, a considéré comme un droit naturel le pouvoir de multiplier les exemplaires d'un ouvrage dont on a acheté une copie, [II-109] et de les vendre à son profit. Un jurisconsulte anglais, de beaucoup de sens, a réfuté cette erreur d'une manière si nette, que je ne saurais mieux terminer ce chapitre qu'en rapportant son opinion.
« Il n'est rien de plus erroné que l'usage vulgaire de reporter l'origine des droits moraux et le système d'équité naturelle, à cet état sauvage, qu'on suppose avoir précédé les établissemens de la civilisation, et dans lequel les compositions littéraires et par conséquent les droits des auteurs ne pouvaient avoir aucune existence. La véritable manière de s'assurer si un droit moral a une existence, me paraît être de rechercher si ce droit est tel que la raison, la raison cultivée du genre humain, doive nécessairement y donner son assentiment. Aucune proposition ne me semble plus conforme à ce critérion que celle que chacun doit jouir du fruit de son travail, moissonner là où il a semé, cueillir le fruit de l'arbre qu'il a planté. Et si un droit privé doit être plus sacré, plus inviolable qu'un autre, c'est celui qui prend sa source dans un travail d'où le genre humain retire les plus grands bienfaits. La propriété littéraire, il faut bien l'admettre, est très-différente, par sa nature, d'une propriété qui consiste en objets matériels; et cette différence a conduit quelques personnes à en dénier l'existence comme [II-110] propriété. Mais que ce soit une propriété sui generis, ou qu'elle soit classée sous telle autre dénomination de droits qu'on voudra, elle me semble fondée sur le principe d'utilité générale, qui est la base de tous les droits moraux et de toutes les obligations [32]. »
[II-111]
CHAPITRE XXXII.
Des causes qui ont privé les compositions littéraires des garanties accordées aux autres propriétés.↩
EN observant comment se forment les ouvrages littéraires, on voit qu'ils sont soumis aux mêmes lois générales que tous les autres produits de l'industrie humaine; on ne les obtient qu'au moyen d'un travail plus ou moins long, plus ou moins pénible, et par des dépenses plus ou moins considérables; on ne se livre à ce travail, on ne fait ces dépenses que dans les pays où l'on a la certitude d'en recueillir les fruits.
Cependant, quand on compare ce que coûtent d'études, de temps, de talens et de dépenses la plupart des ouvrages littéraires, au prix que les auteurs en retirent des libraires auxquels ils les vendent, on s'aperçoit qu'en général les travaux de ce genre sont moins récompensés que la plupart des autres travaux. Il est des ouvrages dont la composition a exigé des connaissances très-étendues, des frais considérables, et un esprit supérieur, et [II-112] qui n'ont pas été payés, par les libraires auxquels ils ont été vendus, la dixième partie des sommes que les auteurs ont dépensées pour les produire. Dans les autres branches d'industrie, du moment qu'un produit est vendu à un prix inférieur aux frais de production, il cesse d'être créé; car personne ne peut se livrer, pendant long-temps, à une industrie ruineuse. Les écrivains ne seraient-ils pas soumis aux lois générales de l'humanité?
Il est un grand nombre de cas dans lesquels l'auteur d'une composition littéraire, a reçu le prix de son travail, long-temps avant de l'avoir publié. La plupart des ouvrages sur les sciences ou sur les lettres, ont été composés par des hommes qui se livraient à l'enseignement; le prix du travail qu'ils ont exigé, a été payé par les élèves auxquels les leçons ont été données, ou par le public qui a payé, pour eux, les professeurs. Celui qui vend à un libraire des leçons pour lesquelles il a déjà reçu un salaire, ne considère le prix qui lui en est donné, que comme une sorte de supplément de la valeur de ses travaux. S'il n'avait pas dû recevoir d'autre récompense que ce prix, il aurait peut-être recherché un autre genre d'occupations, soit parce que l'état de sa fortune ne lui aurait pas permis de se livrer à un travail peu productif, soit parce qu'il aurait été porté par son goût vers un travail plus lucratif.
[II-113]
Il est une seconde classe d'ouvrages qui ne sont produits qu'au moyen de grandes dépenses, et que les libraires obtiennent à très-bas prix: tels sont les grands voyages à travers les mers ou dans des contrées éloignées et souvent barbares. Les frais de cette sorte de compositions sont payés, en général, par les gouvernemens, c'est-à-dire par le public; et si elles sont livrées à bas prix aux acquéreurs, c'est que la valeur en a été payée d'avance par tous les contribuables. Quelquefois les auteurs de cette espèce d'ouvrages ont été d'avance récompensés de leur travail par des compagnies de commerce, qui les avaient envoyés à la recherche de nouveaux débouchés ou de nouveaux produits. Enfin, il n'est pas rare de voir des hommes qui voyagent principalement pour leur instruction, pour leur plaisir ou pour leurs affaires, et qui publient ensuite la relation de ce qu'ils ont observé, sans prétendre tirer de leurs écrits les sommes qu'ils ont dépensées.
Les orateurs, les avocats, les prédicateurs, les auteurs dramatiques, qui livrent à l'impression leurs discours, leurs plaidoyers, leurs sermons, leurs drames, ne considèrent pas le prix qu'ils en reçoivent des libraires, comme l'unique récompense de leurs travaux. Ils en ont été payés d'avance, du moins en grande partie, par leurs cliens ou par le public; ce qu'ils reçoivent comme écrivains est [II-114] peu de chose, comparativement à ce qu'ils ont reçu en toute autre qualité.
Quelquefois un homme ne se livre à des recherches scientifiques et ne met ses idées en ordre que pour exercer plus facilement une profession lucrative, ou pour se faire des titres à un emploi. S'il publie le résultat de ses travaux, et s'il reçoit des libraires le prix de ses ouvrages, il ne considère pas ce prix comme l'unique récompense de ses occupations; il fait entrer en ligne de compte tous les avantages qu'il en espère. Plusieurs, sans doute, sont trompés dans leur attente; mais il n'est aucun genre de travail qui ne donne lieu à des mécomptes.
Les ouvrages littéraires exercent une grande influence sur l'esprit, les mœurs et la conduite des nations. Les gouvernemens, les castes, les sectes, dont les intérêts sont peu en harmonie avec ceux de l'humanité, aspirent donc sans cesse à en diriger la production, et ils ont toujours à leur disposition des pensions, des emplois, des honneurs pour les écrivains qui se mettent à leur service. En voyant, par la lecture de l'histoire, quels ont été les intérêts dominans, dans certains temps et dans certains pays, on peut se faire une idée de la nature des ouvrages qui ont été publiés; et, d'un autre côté, en voyant les ouvrages qui ont été publiés, on peut se former des idées exactes des [II-115] intérêts qui dominaient au temps où ils ont été mis au jour [33].
Lorsque des ouvrages littéraires sont ainsi composés sous l'influence de certains intérêts, les auteurs n'attendent pas des libraires la récompense de leurs travaux; ils l'attendent des intérêts ou des passions qu'ils ont eu le dessein de servir. Dans des cas pareils, il n'est pas rare de voir des ouvrages livrés au public à un prix qui est de beaucoup inférieur à ce qu'ils ont coûté. Ceux qui les ont fait produire, loin d'exiger le remboursement de leurs dépenses, paieraient volontiers pour qu'on se donnât la peine de les étudier.
On a depuis long-temps fait l'observation que, plus un genre particulier de travail est honoré, moins il est nécessaire de le payer en argent, pour déterminer les hommes à s'y livrer. Dans les pays où il existe assez de lumières et de liberté, pour que les connaissances et les talens soient des causes d'estime, il n'est donc pas très-rare de voir produire des compositions littéraires, dans la vue de se rendre recommandable aux yeux du public. L'estime et l'honneur sont une monnaie qui agit sur [II-116] certains hommes avec plus d'énergie que l'or ou l'argent, surtout quand ils ont d'ailleurs des moyens d'existence assurés. Aussi, tel écrivain qui verrait, sans se plaindre, des libraires multiplier et vendre, sans son aveu, les copies de ses écrits, ne souffrirait pas qu'un autre s'en attribuât l'honneur. L'usurpation de ce genre de propriété, lui paraîtrait bien plus injuste que le vol d'un meuble ou l'usurpation d'un champ.
Enfin, il est des hommes qui, étant fortement préoccupés de certaines idées, ne publient leurs écrits que pour les divulguer et les répandre. Leur objet unique est, ou de propager certaines vérités, ou de détruire certaines erreurs, ou d'abolir certains abus. Pour parvenir à leur but, ils sacrifient leur temps, leur fortune et quelquefois leur liberté; s'ils mettent un prix à leurs ouvrages, c'est moins pour recouvrer une partie des dépenses qu'ils ont faites, que pour avoir de nouveaux moyens d'accomplir leur mission.
On voit, par ces observations, que les ouvrages littéraires sont soumis, beaucoup plus qu'ils ne le paraissent d'abord, aux lois générales qui agissent sur toutes les productions de l'industrie humaine. Le prix n'en est pas toujours payé sous la même forme, ni avec la même monnaie; mais il arrive très-rarement qu'un auteur ne reçoive de ses travaux aucune sorte de récompense. Cela peut arriver [II-117] cependant; mais, si cela se répétait souvent, on finirait par ne plus se livrer à un travail qui ne serait suivi d'aucun avantage. Dans tous les pays, les bons ouvrages sont plus ou moins rares, selon qu'ils sont plus ou moins privés de la protection de l'autorité publique.
Lorsque la propriété des compositions littéraires est mal garantie, ou qu'elle ne l'est que pour un temps très-court, les hommes qui se livrent à ce genre de compositions, sont obligés de chercher la récompense de leurs travaux ailleurs que dans la vente de leurs écrits; il faut qu'ils se fassent payer par des emplois, des pensions ou d'autres faveurs; c'est-à-dire qu'ils sont dans l'alternative de travailler sans fruit, ou de se mettre à la disposition des hommes qui disposent de la richesse et de la puissance.
La tendance naturelle des mauvais gouvernemens et des classes aristocratiques, est de priver de garanties la propriété littéraire. L'indépendance est une condition sans laquelle il est impossible de se livrer à la recherche et à l'exposition sincère de la vérité. Le travail qui donne de l'indépendance en créant la propriété, ne convient, en général, aux hommes investis du pouvoir, qu'autant qu'ils peuvent le diriger dans leur intérêt. Ils encouragent volontiers la production des ouvrages littéraires qui peuvent étendre ou assurer la durée de leur [II-118] domination; mais ils craignent les encouragemens qui viennent du public, parce qu'en général ceux-là ne favorisent que les productions véritablement utiles à l'humanité.
Les classes les plus nombreuses de la société n'ont pas le moyen de se coaliser pour faire produire les ouvrages qui leur conviendraient le mieux; elles n'ont à distribuer ni honneurs, ni pensions, ni emplois. Elles n'ont pas d'autres encouragemens à donner que ceux qui résultent de l'achat des productions littéraires mises en vente; ce moyen n'est même qu'à la portée d'un petit nombre de personnes, parce que la plupart manquent de richesses, ou sont dépourvues de lumières. Les classes populaires sont donc intéressées à ce que les écrivains attendent de l'avenir la récompense de leurs travaux, tandis que les classes aristocratiques sont intéressées, au contraire, à ce qu'ils sacrifient l'avenir au présent. Les ouvrages qui doivent avoir une longue durée, et que le temps doit faire apprécier de plus en plus, conviennent mieux à celles-là; ceux, au contraire, qui sont destinés à disparaître avec les erreurs et les abus qu'ils ont eu pour objet de fortifier, conviennent mieux à celles-ci. Les encouragemens qui naissent de la garantie de la propriété sont donc favorables à la recherche de la vérité, au triomphe de la justice; ceux qui viennent des faveurs des gouvernemens [II-119] sont, dans l'état actuel de la plupart des nations, plus favorables à la propagation de l'erreur.
Les compositions littéraires étant soumises, quant à la production, aux lois générales qui agissent sur tous les autres produits de l'industrie humaine, sont, par la nature même des choses, la propriété de ceux qui en sont les auteurs. Mais n'existe-t-il pas, entre les propriétés de ce genre et toutes les autres propriétés, des différences qui doivent les faire soumettre à des règles particulières? Une propriété privée ne cesse, en général, d'avoir ce caractère, que par , que par le fait ou par la volonté de celui à qui elle appartient. Elle ne passe d'une personne à une autre, que par la transmission qu'en fait le propriétaire; si celui-ci n'en dispose pas pendant sa vie, elle devient la propriété de ses enfans, ou de ceux de ses parens auxquels on suppose qu'il l'aurait donnée, s'il en avait formellement disposé. Quand même elle aurait des siècles de durée, elle ne cesserait pas d'être garantie; elle ne perdrait pas son caractère de propriété privée, par le seul effet de la loi.
Il arrive quelquefois cependant qu'une propriété particulière devient une propriété publique, parce qu'une nation s'en empare dans l'intérêt commun des membres dont elle se compose; mais en pareil cas, le propriétaire dépossédé reçoit un équivalent de la propriété dont on le dépouille, [II-120] de manière que rien n'est dérangé dans ses moyens d'existence. Celui qui, par son travail, avait acquis, par exemple, une proprieté qui lui donnait 3,000 fr. de rentes, jouira du même revenu, si l'Etat juge nécessaire de faire entrer cette propriété dans le domaine public. Il est même probable qu'il jouira d'un revenu plus considérable, parce qu'en général, les nations civilisées paient audelà de leur valeur les propriétés privées qu'elles acquièrent.
La propriété littéraire, à proprement parler, n'a été complétement garantie dans aucun pays. Les gouvernemens qui se sont montrés le plus favorables aux compositions de ce genre, ont restreint les droits des auteurs à une jouissance temporaire. Ils ont voulu que, lorsque le temps de cette jouissance serait expiré, chacun eût la faculté de multiplier et de vendre leurs écrits. Ils ont donc institué les libraires et une partie du public, héritiers légitimes et nécessaires de tous les écrivains.
Le motif apparent de cette disposition a été de favoriser la diffusion de lumières; on a paru croire qu'en dispensant les libraires de payer aucun droit aux écrivains ou à leurs successeurs, les compositions littéraires seraient vendues à plus bas prix, et qu'un plus grand nombre de personnes pourraient les acquérir. On a dit, d'un autre côté, que si ces [II-121] compositions étaient mises sur le même rang que les autres propriétés privées, il dépendrait souvent des caprices, des préjugés ou de l'avidité d'un homme, de priver une nation d'un ouvrage de génie. Si les héritiers d'un auteur, tel que Corneille ou Molière, par exemple, étaient assez superstitieux pour étouffer ses ouvrages, ou assez avides pour les vendre à des gens qui se croiraient intéressés à en empêcher la publication, faudrait-il leur en fournir les moyens? En mettant les productions littéraires au même rang que les autres propriétés privées, ne livrerait-on pas les œuvres du génie à des hommes qui consentiraient à les sacrifier aux intérêts les plus vulgaires?
La protection d'un gouvernement, ajoute-t-on, s'arrête, en général, aux points où finit son empire. Il peut faire respecter la propriété littéraire dans le pays soumis à sa domination ; mais au-delà de ses frontières, chacun a la faculté de multiplier et de vendre, sans autorisation, les copies des ouvrages publiés sous sa protection. Il suit de là que les nations chez lesquelles des écrits sont publiés, et qui garantissent aux auteurs la faculté de les vendre exclusivement, sont obligées de les payer plus cher que les autres. Celles-ci, n'ayant aucun droit à payer aux auteurs, font un commerce de librairie plus avantageux, et ont plus de moyens de s'instruire. Elles peuvent même fournir des livres, par [II-122] un commerce interlope, au peuple qui ne jouit pas de la faculté de faire imprimer, sans payer des droits d'auteur, les ouvrages publiés sur son territoire.
Il est une autre considération qui probablement n'a pas été sans influence sur les mesures qu'on a cru devoir prendre sur les productions littéraires. En général, toute valeur produite peut être consommée; tout ouvrage auquel l'industrie humaine a donné naissance, peut périr faute de soins. Les propriétés immobilières sont susceptibles de dégradation et de destruction comme les autres; on ne les conserve qu'autant qu'on répare les dommages que le temps et la jouissance leur font subir. Une ferme qu'on épuiserait par une suite non interrompue des mêmes récoltes, et de laquelle on ferait disparaître les bois, les bâtimens, les troupeaux, les instrumens d'agriculture, en un mot, tous les objets que l'industrie a formés, perdrait la plus grande partie de sa valeur. Si, au bout d'un temps déterminé, toutes choses sortaient du rang des propriétés privées, pour tomber dans le domaine public, elles seraient presque entièrement détruites, quand le terme prescrit par les lois arriverait. Le pays le plus florissant descendrait ainsi au niveau des contrées soumises aux gouvernemens les plus despotiques. La garantie perpétuelle donnée aux [II-123] propriétés est donc une des principales causes de leur conservation.
Les compositions littéraires font exception à la règle générale : elles ne s'usent ni par l'usage ni par le temps. Quand un écrivain a publié un ouvrage, il n'a plus le moyen de le dégrader ou de le faire disparaître. Si l'autorité publique ne lui en garantit la jouissance que pour un certain nombre d'années, on n'a pas à craindre qu'il profite de ce temps pour l'épuiser ou pour en détruire la valeur. Le seul moyen qu'il ait d'en jouir, est d'en multiplier les copies et de les répandre; et plus le nombre des copies augmente, moins il est à craindre que l'ouvrage ne périsse. On n'a donc pas eu, pour garantir les propriétés littéraires, les mêmes raisons que pour garantir les autres genres de propriétés.
Il faut ajouter que la plupart des gouvernemens modernes, sortis du régime féodal, n'ont, pendant long-temps, accordé quelque considération qu'aux propriétés féodales, c'est-à-dire aux fonds de terre. Le mépris qu'ils avaient pour tous les genres d'industrie, se répandait sur les produits du travail, sur les propriétés mobilières, et sur les hommes dont elles étaient la principale richesse. Les compositions littéraires étant les derniers fruits de la civilisation, ont été moins respectées encore: il ne s'est pas trouvé de gouvernement qui les ait [II-124] mises franchement au rang des propriétés. Ce qu'on nomme, en effet, propriété littéraire n'est pas autre chose qu'une simple jouissance de quelques années. Cela est si vrai, que celui qui proposerait d'appliquer à toutes les créations de l'industrie humaine, les règles qu'on suit à l'égard des ouvrages littéraires, serait considéré comme aspirant à la destruction de toute propriété, et au renversement de l'ordre social.
Si, comme on l'assure, les propriétés littéraires n'étaient privées de garantie, après un certain temps de jouissance, que dans des vues d'intérêt public, et pour favoriser la propagation des lumières, il est difficile de voir pourquoi l'on n'agirait pas, à l'égard des propriétés de ce genre, comme on agit à l'égard de toutes les autres. Lorsque, pour faire un canal, une grande route ou une place de guerre, on a besoin de faire tomber dans le domaine public, la maison ou le champ d'un particulier, on commence par lui en payer la valeur, ou par lui donner une propriété équivalente. On croirait commettre une injustice criante, si on le dépouillait dans l'intérêt du public, sans rien lui donner en échange; la spoliation commise au profit de plusieurs millions d'individus n'est pas plus légitime, en effet, que la spoliation exécutée au profit d'un seul. Elle devrait même être plus odieuse, d'abord parce qu'il est plus difficile de [II-125] s'en garantir, et, en second lieu, parce que l'indemnité à payer pour obtenir une propriété privée, est infiniment petite, quand elle est répartie entre une immense multitude de personnes. Mais comment la spoliation qu'on trouverait injuste quand il s'agit d'un champ ou d'une maison, devient-elle juste quand il est question d'un ouvrage littéraire? Pourquoi l'indemnité qu'on trouve juste dans un cas, ne le serait-elle pas dans l'autre? Les travaux des écrivains qui ont éclairé le monde, de Descartes, de Bacon, de Francklin, seraient-ils moins dignes de protection et de respect que les travaux d'un fabricant de chandelles?
Il est très-vrai que les ouvrages littéraires produits et publiés chez une nation, ne jouissent d'aucune protection chez les autres. Les libraires français, par exemple, réimpriment et vendent, sans payer aucun droit d'auteur, les écrits publiés en Angleterre, et, de leur côté, les libraires anglais réimpriment, sans rien payer, les ouvrages publiés en France. Il résulte de là que, lorsqu'un ouvrage est publié, la nation qui garantit à l'auteur la faculté de le vendre exclusivement, est traitée moins avantageusement, relativement à cet ouvrage, que les nations qui ne donnent à l'auteur aucune garantie. Il en résulte encore que la garantie donnée à la propriété littéraire est un stimulant pour l'introduction des ouvrages publiés [II-126] à l'étranger, et pour lesquels les libraires n'ont eu rien à payer aux auteurs. Ces objections, contre la garantie de la propriété littéraire, sont plus fortes en apparence qu'en réalité.
L'introduction frauduleuse des ouvrages réimprimés à l'étranger, dans la vue de ne payer aucun droit aux auteurs, ne peut nuire en réalité qu'à ceux-ci. Tout libraire qui achète un ouvrage pour le livrer à l'impression, sait d'avance que cet ouvrage sera réimprimé à l'étranger s'il est bon, et qu'un certain nombre d'exemplaires sera introduit frauduleusement dans le pays. Il fait ses calculs en conséquence; il paie d'autant moins le manuscrit, qu'il a plus de chances de perte à courir. C'est donc exclusivement sur l'auteur que tombe le dommage causé par la contrefaçon. Mais de ce qu'on ne peut pas empêcher toutes les atteintes dont la propriété littéraire peut être l'objet, s'ensuit-il qu'on doit la priver de toute garantie?
Les gouvernemens, pour protéger l'industrie des imprimeurs, des relieurs et des libraires, prohibent les ouvrages imprimés ou reliés à l'étranger; ils ne craignent pas de nuire, par ces prohibitions, au commerce ou à l'instruction des peuples qui leur sont soumis. Si donc ils refusent des garanties à la propriété littéraire, ce n'est pas en considération des contrefaçons qui peuvent être exécutées à l'étranger. Il n'est pas plus difficile de protéger [II-127] la propriété des auteurs que l'industrie des imprimeurs, des libraires, des relieurs.
La crainte de voir des hommes ignorans ou cupides priver le public des ouvrages dont ils auraient acquis la propriété, n'est pas non plus une raison de priver de garantie la propriété littéraire.
Il serait très-fâcheux, sans doute, qu'un homme ignorant ou superstitieux eût les moyens d'étouffer les ouvrages d'un grand homme, qu'il aurait acquis par succession ou autrement; mais pour prévenir un tel danger, il n'est nullement nécessaire de priver les productions littéraires de la protection des lois, et de donner à tout libraire la faculté d'en multiplier gratuitement les copies. S'il importe aux citoyens que tel ouvrage soit répandu et qu'il tombe dans le domaine public, il est difficile de voir pourquoi l'on ne procéderait pas, pour l'acquérir, comme on procéde pour acquérir d'autres propriétés dont le public a besoin. Quand on considère les productions littéraires relativement aux nations, on paraît croire qu'elles sont inappréciables; mais quand on les considère relativement aux écrivains et à leurs familles, on les traite comme si elles étaient sans valeur. S'agit-il de s'en emparer, afin d'en faire jouir le public? on juge qu'on ne peut pas trop les estimer. S'agit-il d'indemniser ceux qui les ont produites ou reçues des producteurs? on juge qu'elles ne valent [II-128] rien. N'y a-t-il pas d'ailleurs une injustice choquante à dépouiller une classe entière de personnes de leurs propriétés, de peur qu'il ne s'en rencontre quelqu'une qui fasse des siennes un mauvais usage?
La circonstance que des productions littéraires restent inaltérables quand elles ont été publiées, et qu'il n'est pas à craindre qu'elles soient détruites par les auteurs ou les libraires auxquels on n'en accorde qu'une jouissance temporaire, est, sans doute, une raison de donner à ce genre de propriété, des limites un peu moins étendues qu'aux autres, mais elle n'est pas une raison de les priver de garanties après une jouissance de quelques années.
Les propriétés ne sont pas garanties uniquement dans la vue d'en prévenir la destruction; elles le sont aussi dans la vue d'en encourager le développement, et d'assurer aux familles des ressources qui soient en harmonie avec leur mode d'existence. Si, de la circonstance qu'un ouvrage ne peut plus être détruit par l'auteur après qu'il a été publié, on tirait la conséquence que la propriété ne doit pas en être garantie, on pourrait en conclure aussi qu'on peut le faire tomber dans le domaine public le lendemain de la publication. Avec un tel système, il ne paraîtrait bientôt plus d'autres ouvrages que [II-129] ceux dont le prix aurait été payé d'avance par les gouvernemens ou par des castes privilégiées.
Les gouvernemens, qui se montrent si zélés pour la propagation des lumières, tant qu'il ne faut pour cela que priver de garanties la propriété littéraire, sont loin de montrer le même zèle quand il s'agit de faire quelques frais pour répandre des ouvrages véritablement utiles au public. Ils veulent bien que l'auteur fasse les frais de la composition; mais leur vient-il dans l'idée de faire eux-mêmes les frais de l'impression, et de payer le marchand de papier? Aucun n'a une telle pensée ; chacun laisse au public le soin de payer cette partie de la dépense; on ne lui épargne que les droits d'auteur, afin, sans doute, d'encourager la composition des bons livres.
En Angleterre, on ne garantit pas aux auteurs la propriété de leurs compositions; on ne leur en assure qu'une jouissance temporaire fort courte; mais on garantit aux universités la jouissance perpétuelle des écrits qui leur sont donnés. Il serait difficile toutefois de voir pourquoi ce qui peut appartenir à une corporation, ne peut pas appartenir à une famille ou à un particulier. Le bien qu'on tient de la générosité d'autrui, serait-il plus digne de protection que celui qu'on ne doit qu'à son travail ? On refuse à un écrivain la faculté de transmettre à ses enfans la propriété de ses ouvrages; mais on lui permet [II-130] de la donner à telle ou telle corporation destinée à élever les enfans de l'aristocratie. Il se peut que de telles dispositions aient pour objet de favoriser la diffusion des lumières dans certaines classes; mais il n'est pas possible de les considérer comme un encouragement à la production des bons livres.
Le gouvernement impérial, qui avait aussi la prétention de propager les lumières, avait consacré le principe qu'après un certain nombre d'années, toute composition littéraire tomberait dans le domaine public. En même temps, il avait établi que toute personne qui voudrait réimprimer un ouvrage tombé dans le domaine public, serait tenue de lui payer un droit [34]. Ce gouvernement se constituait donc l'héritier, non-seulement de tous les auteurs à venir, mais de tous les auteurs passés, y compris ceux de Rome et de la Grèce. Il s'attribuait, sur les compositions littéraires, un droit de propriété qu'il ne reconnaissait pas aux écrivains; et cela dans la vue, disait-on, de favoriser le développement des connaissances humaines!
[II-131]
CHAPITRE XXXIII.
Des lois relatives à la propriété des compositions littéraires.↩
LORSQUE l'invention de l'art typographique vint donner à l'industrie le moyen de multiplier à peu de frais les copies des productions littéraires, les nations étaient encore trop ignorantes et trop esclaves, pour qu'il fût possible aux magistrats de connaître la nature de tous les genres de propriété, et de les faire respecter. Si l'on avait des questions de droit à résoudre, ce n'était pas en étudiant la nature des choses et la nature de l'homme, qu'on tâchait d'en donner une bonne solution; on les résolvait par les maximes du pouvoir absolu, par les décisions des jurisconsultes et des empereurs romains, ou par les coutumes féodales. Mais, ni l'aristocratie romaine, ni l'aristocratie féodale, ni les rois absolus n'avaient pu admettre en principe que toute production est la propriété de celui qui l'a formée. Un tel principe aurait suffi pour amener en peu de temps le renversement d'un ordre de [II-132] choses fondé sur la conquête, l'usurpation et l'esclavage [35].
Il est encore aujourd'hui beaucoup d'hommes qui ne savent où chercher des principes de justice, quand ils ne peuvent avoir recours aux dispositions d'un code ou aux opinions d'un jurisconsulte; il était difficile qu'on fût plus avancé, lorsque les nations sortaient à peine de la barbarie du moyen-âge. La faculté de permettre ou de défendre de travailler était alors considérée comme un droit [II-133] domanial et royal [36]. Les rois, soit en France, soit en Angleterre, faisaient un fréquent usage de ce prétendu droit, en créant et en distribuant à leur gré des monopoles. Or, quand le droit de vivre en travaillant, était considéré comme une concession royale, comme un privilége dont le pouvoir avait toujours soin de limiter la durée, pouvait-on avoir la pensée de donner des garanties aux produits d'un travail libre? pouvait-on avoir le courage d'en réclamer [37]?
Si les premiers écrivains avaient eu la faculté de faire imprimer et de vendre librement leurs ouvrages, ils auraient donc été fort embarrassés pour empêcher les contrefaçons; et, s'ils avaient eu recours à la justice, l'existence de la propriété littéraire [II-134] aurait paru fort problématique aux yeux des magistrats; pour la leur faire reconnaître, il n'aurait pas fallu moins qu'un privilége du prince au profit de l'auteur. Le nombre des hommes dont l'intérêt évident et immédiat était que les productions de ce genre fussent respectées, devait d'ailleurs être si petit, et le nombre de ceux qui pouvaient se croire intéressés à ce qu'elles restassent sans protection, si grand, que la balance de la justice aurait nécessairement penché du côté des derniers, si les magistrats avaient été appelés à prononcer. Nous ne devons donc pas être étonnés si les mesures adoptées d'abord en divers pays par l'autorité publique, pour accorder quelques garanties à la propriété littéraire, sont incomplètes, et portent l'empreinte des préjugés et des habitudes qui régnaient au temps où elles ont été prises. Les principes sur la propriété, mal connus, rarement consultés, étaient encore plus rarement suivis [38].
[II-135]
Les rois d'Angleterre, comme ceux de France, créaient et distribuaient à leur gré des monopoles, c'est-à-dire qu'ils interdisaient à la masse de la population un certain genre de travail ou de commerce, et qu'ils donnaient ou vendaient à une ou plusieurs personnes la faculté de se livrer à ce commerce ou à ce travail; on connaît l'abus que fit de ce pouvoir la reine Élisabeth. Il était donc naturel qu'un écrivain qui avait composé un ouvrage, et qui voulait en vendre des exemplaires, en sollicitât le privilége. La protection temporaire qu'il obtenait, n'était considérée par l'autorité que comme un monopole dont elle pouvait disposer arbitrairement, et dont elle avait soin de limiter la durée.
Lorsque chacun eut acquis, en Angleterre, la faculté de publier ses opinions au moyen de la presse, et que les rois n'eurent plus le pouvoir [II-136] d'interdire ou de permettre le travail, les auteurs eurent, par cela même, la faculté de faire imprimer et de vendre leurs ouvrages; mais il paraît que la propriété littéraire fut peu respectée, et que les imprimeurs et les libraires ne se firent aucun scrupule de ruiner les auteurs et leurs familles, en réimprimant et en vendant leurs ouvrages sans leur autorisation [39]. Le moyen le plus naturel et le plus simple de remédier à ce désordre, aurait été de recourir à la justice, et d'invoquer les principes qui protégent toutes les propriétés; mais on était encore dominé par les préjugés et les habitudes contractés dans des temps d'esclavage. Les rois ayant perdu la faculté d'établir et de donner des monopoles pour un temps déterminé, on eut recours au parlement qui avait hérité du pouvoir absolu de la couronne.
En 1710, le parlement rendit, en effet, un acte par lequel il déclara que les auteurs d'écrits déjà publiés auraient seuls le droit de les vendre ou de les faire vendre pendant vingt ans, à partir du jour de la première publication. Quant aux ouvrages non encore publiés, l'exercice du droit exclusif de les faire imprimer et vendre fut limité à un espace quatorze années, à moins qu'à l'expiration [II-137] de ce terme, l'auteur ne fût encore vivant; car, dans ce cas, un second terme de quatorze ans lui était accordé. En agissant ainsi, le parlement n'avait pas la pensée de donner des garanties à une espèce particulière de propriétés ; il croyait établir des monopoles au profit des auteurs. Aujourd'hui même il est des jurisconsultes qui ne voient pas autre chose dans les droits dont la jouissance est assurée aux écrivains [40].
Les rois, quand ils interdisaient à la masse de la population une branche d'industrie ou de commerce, pour en donner l'exploitation exclusive à un particulier ou à une compagnie, prenaient quelquefois des mesures pour que le produit mis en monopole ne fût porté à un prix excessif. Le parlement de 1710, après avoir fixé le temps pendant lequel un écrivain jouirait exclusivement de la faculté de vendre ses ouvrages, crut devoir prendre des mesures analogues pour prévenir l'abus que les auteurs pourraient faire de leur prétendu monopole. Il désigna, dans son statut, un certain nombre de magistrats et de dignitaires ecclésiastiques ou civils, pour fixer le prix des livres, dans le cas où les auteurs ou leurs libraires voudraient faire des bénéfices exagérés. On voyait [II-138] figurer, parmi ces commissaires-priseurs de livres, l'archevêque de Cantorbéry, l'évêque de Londres, le lord-chancelier, les présidens des cours de justice, et les vice-chanceliers des deux Universités. Le libraire qui vendait ses livres à un prix supérieur au prix fixé, était condamné à une amende de cinq livres sterling par exemplaire, applicable moitié au fisc et moitié à la partie poursuivante.
On finit par comprendre qu'une disposition qui obligeait les libraires à vendre leurs livres pour un prix qu'ils n'avaient pas la faculté de fixer, était peu favorable au développement des lettres et des sciences. En déterminant le prix des livres, on fixait en effet, la valeur du travail des écrivains ; et cette fixation devait être moins en raison de la bonté intrinsèque d'un ouvrage, qu'en raison de la conformité des opinions de l'auteur avec celles des commissaires-priseurs. Si une mesure analogue avait été prise en France, et si l'on avait chargé l'archevêque de Paris, les docteurs de la Sorbonne et les principaux membres du parlement de fixer le prix des ouvrages de Montesquieu, de Voltaire, de Raynal ou de Rousseau, les libraires n'en auraient pas tiré de gros bénéfices. Aussi, cette disposition fut-elle rapportée, en 1739, par un statut de la douzième année du règne de George II, chap. 11. Par le même acte, on défendit l'importation des livres imprimés à l'étranger, lorsqu'ils [II-139] avaient été composés et imprimés dans la GrandeBretagne. On déclara, de plus, que les autres dispositions du statut de la huitième année du règne de la reine Anne, chap. 19, continueraient d'être exécutées pendant sept ans, jusqu'à la première session qui suivrait l'année 1746.
Les Universités auxquelles des ouvrages avaient été donnés, étaient persuadées que la propriété qui leur avait été transmise était perpétuelle de sa nature, comme toutes les espèces de propriété. Lorsque la décision de la cour de la chancellerie, qui reconnaissait aux auteurs un droit perpétuel sur leurs productions, eût été annulée, et qu'on eut déclaré que ce droit, qui résultait des principes du droit commun, avait été détruit par l'acte de la huitième année du règne de la reine Anne, elles sollicitèrent et obtinrent une exception en leur faveur. En 1755, un acte du parlement, de la quinzième année de George III, déclara que les deux Universités d'Angleterre, les quatre Universités d'Écosse et les collèges d'Eton, de Westminster et de Winchester, auraient à jamais la propriété exclusive des ouvrages qui leur avaient été ou qui leur seraient donnés ou légués, à moins que le legs ou la donation n'eût été fait pour un temps déterminé. La propriété ne leur en fut garantie cependant que sous une condition : c'est que le collége ou l'université propriétaire d'un [II-140] ouvrage, ne le ferait imprimer que par ses presses et à son profit particulier. Le même statut laissa à ces corps privilégiés la faculté d'aliéner les ouvrages qui leur appartenaient; mais, en cas d'aliénation, les acquéreurs ne pouvaient pas exercer d'autres droits que ceux qui leur étaient accordés lorsqu'ils acquéraient des ouvrages de simples particuliers.
En 1801, le parlement anglais fit un troisième statut pour encourager l'instruction en garantissant le droit des auteurs sur leurs ouvrages. Ce statut garantit aux écrivains et aux libraires acquéreurs de leurs écrits, la faculté d'en vendre exclusivement des exemplaires pendant quatorze ans, dans toutes les parties de l'Europe soumises à l'empire britannique. Dans le cas où, à l'expiration de quatorze ans, l'auteur serait encore vivant, un second terme de quatoze ans lui est donné pour vendre ou faire vendre exclusivement des exemplaires de son ouvrage. Le même statut accorde au collège de la Trinité (Trinity Collège) pour les ouvrages qui lui ont été donnés ou légués, des garanties semblables à celles qui avaient été accordées aux Universités d'Angleterre et d'Écosse, sous les mêmes conditions [41].
Enfin, le 29 juillet 1814, un quatrième statut [II-141] a été fait dans les mêmes vues que les précédens. Ce statut, après avoir modifié les dispositions existantes relativement au nombre d'exemplaires à déposer dans certains établissemens publics, garantit aux auteurs, ou aux libraires auxquels ils ont cédé leurs droits, la faculté de vendre exclusivement des exemplaires de leurs ouvrages pendant vingt-huit ans. Si à l'expiration de ce terme, un auteur est encore vivant, sa jouissance est prolongée pour le reste de sa vie [42].
Les priviléges garantis à des colléges ou à des universités leur sont conservés.
Les Anglo-Américains ont adopté les principales dispositions du statut de la reine Anne. Leurs lois garantissent aux auteurs le droit exclusif de vendre et faire vendre, pendant quatorze ans, des exemplaires de leurs ouvrages'; les écrivains qui sont encore vivans à l'expiration de ce terme, ont un second terme de quatorze ans. Mais ce droit n'est pas garanti par les lois américaines à tous les auteurs indistinctement; la garantie n'est donnée qu'aux citoyens des États-Unis, et aux personnes qui résident sur le territoire de la Confédération [43]. Les lois anglaises sont plus libérales : elles garantissent [II-142] les mêmes droits à tous les hommes, sans distinction de nation [44].
Depuis la renaissance des lettres jusqu'au commencement de notre révolution, les garanties données, en France, à la propriété littéraire, ont été toutes personnelles; c'est-à-dire que le gouvernement accordait à chaque écrivain ou au libraire auquel il avait cédé ses droits, le privilége de faire imprimer et de vendre exclusivement son ouvrage, pendant un temps déterminé : cette garantie n'avait pas d'autre durée que celle qu'il plaisait au gouvernement de lui donner. A l'expiration du terme prescrit, le libraire en demandait quelquefois un second qui lui était rarement refusé: la durée en était plus ou moins longue, selon l'importance de l'ouvrage [45]. On fait remonter au commencement du seizième siècle, en 1507, [II-143] l'origine de ces priviléges. Louis XII est le premier roi de France qui en ait accordé.
Dans des temps où l'on mettait en principe que permettre de travailler était un droit domanial et royal; que nul ne pouvait se livrer à l'exercice d'une profession, s'il n'était maître ès arts et métiers, et que les rois seuls pouvaient faire des maîtres, il était tout simple qu'il n'y eût de protection que pour les ouvrages littéraires dont la publication avait été formellement autorisée; l'absence de toute garantie était la règle générale; la protection individuellement accordée était l'exception; c'était un monopole, un privilége, une loi privée, privata lex.
L'édit du 26 août 1686, le premier par lequel on ait pris des mesures générales sur la propriété littéraire, défend à tous imprimeurs et libraires d'imprimer et de mettre en vente un ouvrage pour lequel aucun privilége n'aura été accordé, sous peine de confiscation et de punition exemplaire; le défaut d'insertion du privilége au commencement et à la fin de chaque ouvrage, était un délit puni des mêmes peines.
Lorsque le gouvernement avait ainsi placé sous sa protection une production littéraire, il était défendu aux imprimeurs et aux libraires d'en faire ou d'en faire faire des contrefaçons, non-seulement à l'intérieur, mais aussi à l'étranger. La [II-144] contrefaçon et le débit d'éditions contrefaites, étaient punis des peines portées par les priviléges; en cas de récidive, les contrevenans étaient punis corporellement, et déchus de la maîtrise, c'est-à-dire du droit de travailler pour leur compte.
Ainsi, toute composition littéraire que le pouvoir n'avait pas prise nominalement sous sa sauvegarde, n'était pas seulement privée de toute protection, elle était confisquée par le gouvernement, et l'imprimeur et le libraire étaient punis.
Cet état de choses a duré jusqu'au commencement de la révolution, époque à laquelle toute personne a eu la faculté de faire imprimer et de vendre ses ouvrages, sans avoir obtenu l'autorisation du gouvernement. La propriété littéraire avait été soumise, pendant des siècles, à un tel arbitraire, qu'on a cru faire beaucoup en sa faveur, en ne permettant plus aux agens du pouvoir d'en disposer selon leur volonté. Le gouvernement n'a plus eu la faculté de confisquer les écrits publiés sans son autorisation; mais les imprimeurs et les libraires se sont attribué le droit d'en multiplier les copies, et de les vendre à leur profit. L'autorité publique, en cessant de porter elle-même atteinte à ce genre de propriété, n'a donc pas réprimé les atteintes que des particuliers y portaient.
Si les atteintes privées portées à la propriété littéraire sont d'abord restées sans répression, il faut [II-145] moins en accuser les intentions des hommes qui gouvernaient, que l'ignorance du temps. Les écrivains, les légistes et les magistrats eux-mêmes auraient été peut-être fort embarrassés, s'ils avaient eu à juger des questions sur la propriété littéraire d'après le droit commun. Comment les uns et les autres se seraient-ils débarrassés tout à coup de préjugés qui avaient plusieurs siècles d'existence? Il n'est personne aujourd'hui qui considère la faculté de travailler comme une concession du pouvoir royal; et cependant, quoiqu'en théorie on repousse les maximes des édits d'Henri III et de Louis XIV, on agit souvent comme si l'on y avait une foi sincère; on a besoin d'une déclaration spéciale de l'autorité, pour respecter ou faire respecter les produits du travail de l'homme, quand ces produits ont été livrés pendant long-temps à l'arbitraire.
Depuis le 3 novembre 1789, époque à laquelle fut promulguée la première déclaration des droits, jusqu'au 24 juillet 1795, jour de la publication de la première loi générale sur la propriété littéraire, toute personne eut la faculté de faire imprimer et vendre ses ouvrages, sans autorisation de la part du gouvernement ou de ses agens ; mais, durant cet intervalle, les auteurs français se trouvèrent dans la position où s'étaient trouvés les écrivains anglais avant le statut de 1710. L'autorité publique ne portait pas atteinte à la propriété littéraire; [II-146] mais elle ne réprimait pas les atteintes privées dont cette propriété était l'objet, de la part des imprimeurs et des libraires. Les légistes ni les magistrats n'avaient pu se défaire, dans une espace de trois ou quatre ans, des habitudes et des préjugés de la monarchie absolue. On n'eût donc pas la pensée d'appliquer aux productions littéraires les principes généraux sur la propriété; on crut qu'elle ne pouvait être garantie que par une loi spéciale.
Dans l'intervalle de 1789 à 1793, il fut rendu cependant une loi qui accorda une protection partielle à une espèce particulière de propriété littéraire, aux compositions dramatiques. La loi du 13 janvier 1794 reconnut d'abord à toute personne le droit d'élever un théâtre public, et d'y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisant préalablement sa déclaration à la municipalité des lieux. Elle déclara de plus que les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus, seraient une propriété publique et pourraient, nonobstant tous les anciens priviléges, être représentés sur tous les théâtres indistinctement. Ensuite elle ajouta que les ouvrages des auteurs vivans ne pourraient être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des [II-147] représentations au profit des auteurs. Les héritiers ou cessionnaires des auteurs furent déclarés, par la même loi, propriétaires de leurs ouvrages durant l'espace de cinq années, à compter de la mort de l'auteur. Cette loi, qui garantissait aux auteurs dramatiques que leurs ouvrages ne seraient pas représentés pendant leur vie, sans leur consentement, ni cinq années après leur mort, sans le consentement de leurs héritiers ou cessionnaires, ne leur donnait aucune garantie relativement à l'impression et à la vente de ces mêmes ouvrages.
Sous ce rapport, les compositions dramatiques n'étaient ni plus ni moins protégées que toutes les autres productions littéraires [46].
En 1795, un projet ayant été présenté à la Convention nationale, dans l'intérêt des auteurs et de [II-148] leurs familles, un député, M. Lakanal, en fit le rapport en ces termes :
« De toutes les propriétés, dit-il, la moins susceptible de contestation, celle dont l'accroissement ne peut ni blesser l'égalité républicaine, ni donner d'ombrage à la liberté, c'est, sans contredit, celle des productions du génie; et si quelque chose peut étonner, c'est qu'il ait fallu reconnaître cette propriété, assurer son libre exercice par une loi positive; c'est qu'une aussi grande révolution que la nôtre ait été nécessaire pour nous ramener sur ce point comme sur tant d'autres, aux simples élémens de la justice la plus commune.
» Le génie a-t-il ordonné dans le silence un ouvrage qui recule les bornés des connaissances humaines? Des pirates littéraires s'en emparent aussitôt, et l'auteur ne marche à l'immortalité qu'à travers les horreurs de la misère. Eh! ses enfans!... Citoyens, la postérité du grand Corneille s'est éteinte dans l'indigence!
» L'impression peut d'autant moins faire des productions d'un écrivain une propriété publique, dans le sens où les corsaires littéraires l'entendent, que l'exercice utile de la propriété de l'auteur ne pouvant se faire que par ce moyen, il s'ensuivrait qu'il ne pourrait en user sans la perdre à l'instant même.
» Par quelle fatalité faudrait-il que l'homme [II-149] de génie, qui consacre ses veilles à l'instruction de ses concitoyens, n'eût à se promettre qu'une gloire stérile, et ne pût pas revendiquer le tribut d'un noble travail. »
A la suite de ce rapport, la Convention nationale rendit un décret portant que les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs, qui faisaient graver des tableaux ou dessins, jouiraient, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages, dans le territoire de la république, et d'en céder la propriété en tout ou en partie; le même droit fut garanti à leurs héritiers ou cessionnaires durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs. Enfin, le même décret déclara que les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartiennent aux beaux-arts, en aurait la propriété exclusive pendant dix années. Ce décret est encore en pleine vigueur [47].
Si la Convention nationale avait reconnu, comme son rapporteur, qu'un auteur est propriétaire de ses ouvrages au même titre qu'un homme industrieux est propriétaire des produits de son travail, elle se serait bornée à donner des garanties aux [II-150] propriétés de ce genre, et n'aurait pas mis des limites à la faculté d'en jouir ou d'en disposer. Il est, en effet, dans la nature de la propriété d'être perpétuelle et absolue, comme il est dans la nature de l'usufruit d'être temporaire et limité. Déclarer qu'une personne et ses héritiers ou successeurs auront à perpétuité la jouissance ou l'usufruit d'une chose, ce serait en réalité leur en attribuer la propriété. Par la même raison, déclarer qu'une personne aura pendant un temps déterminé la propriété de certaines choses, et qu'à l'expiration de ce temps elle les rendra tout entières (salvá rerum substantia), c'est en réalité ne lui reconnaître qu'un simple usufruit.
On se serait exprimé d'uue manière bien plus exacte, si l'on avait dit que les compositions littéraires, les compositions musicales, et les gravures ou dessins, tomberaient au rang des choses communes après leur publication; mais que néanmoins les auteurs en auraient l'usufruit pendant leur vie, et leurs héritiers pendant dix ans. En mettant ainsi le langage en harmonie avec les faits qu'on établissait, on aurait vu, sur-le-champ, que les auteurs d'ouvrages littéraires étaient placés dans un cas d'exception, et que, pour eux, la propriété n'était pas réellement reconnue [48].
[II-151]
Il était fort difficile, au reste, que les principes sur la propriété littéraire fussent examinés et débattus avec soin, lorsque la Convention nationale fut appelée à s'en occuper. Une partie de la France était alors envahie par les armées des puissances coalisées; la guerre civile était allumée dans les départemens de l'Ouest, et les factions se déchiraient dans l'intérieur. Comment, dans de telles circonstances, une assemblée, entre les mains de laquelle résidaient tous les pouvoirs, qui était chargée de tous les soins de l'administration, et qui avait à rétablir la tranquillité intérieure, et à garantir l'indépendance nationale, aurait-elle pu se livrer à des discussions philosophiques sur des droits de propriété ?
La loi du 19 juillet 1793 avait déclaré que les ouvrages publiés du vivant d'un auteur, tomberaient dans le domaine public dix ans après sa mort, et que l'héritier d'un écrivain aurait, pendant dix ans, la propriété des ouvrages qu'il recueillerait à titre de succession. Là-dessus, une difficulté s'éleva: il s'agissait de savoir si, lorsque des [II-152] ouvrages seraient tombés dans le domaine public, l'héritier de l'auteur pourrait en faire des éditions nouvelles, y joindre les ouvrages posthumes restés dans son domaine privé, et en conserver la jouissance exclusive. Un décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) a résolu cette question d'une manière négative: il a déclaré que, pour conserver ses droits sur les ouvrages posthumes, il faut les publier séparément.
Un décret du 5 février 1810 a étendu, au profit des veuves et des enfans des auteurs, la jouissance que la loi du 19 juillet 1793 leur avait assurée. L'article 39 déclare que le droit de propriété est garanti à l'auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, et à leurs enfans pendant vingt ans. L'article 40 ajoute que les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur, ou libraire ou à toute autre personne qui est alors substituée en leur lieu et place pour eux et leurs ayans-cause, comme il est dit en l'article précédent.
Ces dispositions qui, dans l'origine, étaient illégales, ont acquis force de loi par l'usage et la jurisprudence; on n'est pas admis à en contester l'autorité devant les tribunaux.
Suivant l'article 1er du statut de la huitième [II-153] année du règne de la reine Anne, toute personne qui, sans avoir obtenu le consentement écrit du propriétaire, imprime, réimprime ou importe un ouvrage, ou le fait imprimer, réimprimer ou importer, ou qui, sachant qu'il a été imprimé ou réimprimé sans le consentement du propriétaire, le publie, le vend, ou expose en vente, ou le fait publier, vendre ou mettre en vente, encourt deux peines: la confiscation de tous les exemplaires qui peuvent être saisis, et une amende d'un penny (environ dix centimes) pour chacune des feuilles trouvées en sa possession [49]; cette amende est applicable une moitié au fisc, et l'autre moitié à la partie poursuivante [50]. Ces peines sont prononcées sans préjudice des dommages causés au propriétaire, et dont l'évaluation ne peut être faite que par un jury, à moins qu'ils ne soient fixés par une transaction volontaire.
Les auteurs n'ayant, en Angleterre, le droit exclusif de vendre leurs ouvrages que pendant un nombre d'années déterminé, il a été nécessaire de constater l'époque de chaque publication, afin que toute personne eût la faculté de savoir quels sont [II-154] les écrits qu'elle peut faire imprimer ou vendre, sans encourir aucune peine. C'est dans cette vue que le statut de 1710 enjoint à toute personne qui se propose de publier un ouvrage, d'en faire inscrire exactement le titre avant la publication, dans un registre particulier, tenu à cet effet par la corporation des marchands de livres ou de papier (the company of stationers). Le défaut d'inscription d'un ouvrage dans ce registre suffirait pour soustraire les contrefacteurs aux peines prononcées contre eux; mais il ne serait pas suffisant pour faire perdre au propriétaire les droits qui lui sont garantis par la loi [51].
L'acte du congrès américain, du 29 avril 1802, exige, comme le statut de la huitième année de la reine Anne, que le titre de l'ouvrage soit enregistré avant la publication; il exige aussi le dépôt d'un certain nombre d'exemplaires, quand la publication a été effectuée [52].
[II-155]
La loi du 19 juillet 1793 autorise les auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs, leurs héritiers ou cessionnaires, à faire saisir et confisquer à leur profit, par les officiers de paix, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans leur permission formelle ou par écrit.
Cette loi ne prononce pas de peine proprement dite contre les contrefacteurs ou débitans d'éditions contrefaites; elle ne les oblige qu'à payer une somme déterminée aux propriétaires à titre d'indemnité. Pour le contrefacteur, cette somme est équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'édition originale; elle est équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'édition originale pour tout débitant d'éditions contrefaites.
Le code pénal, après avoir défini la contrefaçon, l'a mise au rang des délits, ainsi que l'introduction en France de toute édition contrefaite.
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, dit-il, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et réglemens relatifs à la propriété des auteurs, est déclarée contrefaçon; et toute contrefacon est un délit.
Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits à l'étranger, sont un délit de même espèce.
[II-156]
La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur, est une amende de 100 francs au moins et de 2000 francs au plus; et contre le débitant, une amende de 25 francs au moins et 500 francs au plus.
La confiscation de l'édition contrefaite doit être prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant.
Les planches, moules et matrices des objets contrefaits, doivent être également confisqués.
Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui fait représenter sur son théâtre, des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et réglemens relatifs à la propriété des auteurs, doit être puni d'une amende de 50 fr. au moins et de 500 francs au plus.
Dans les cas prévus par les dispositions précédentes, le produit des confiscations, ou les recettes confisquées, doivent être remis au propriétaire, pour l'idemniser d'autant du préjudice qu'il a souffert; le surplus de son indemnité, ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués, ni saisie de recettes, doit être réglé par les voies ordinaires [53].
En fixant le taux des amendes par le nombre des feuilles imprimées, la loi anglaise a mis la peine [II-157] en rapport avec les bénéfices que les contrefacteurs ou les débitans d'éditions contrefaites, ont cru retirer de l'exécution du délit. Les dispositions de la loi française ont moins de prévoyance et de sagesse : les contrefacteurs ou les débitans peuvent, en aggravant le délit, gagner une somme suffisante pour payer l'amende et leur assurer un bénéfice. Cela n'est pas possible, quand l'amende s'élève à mesure qu'on multiplie les exemplaires de l'ouvrage contrefait.
La disposition qui laisse au jury le soin de fixer l'indemnité due à l'auteur ou au propriétaire de l'ouvrage contrefait, est aussi plus sage que celle qui détermine cette indemnité d'une manière invariable. Une personne qui a été lésée dans sa propriété, a droit à une réparation complète du tort qui lui a été causé; mais, si l'on ne peut justement lui donner moins, elle n'a droit à rien de plus. Le contrefacteur qui aurait vendu dix mille exemplaires de l'édition contrefaite, devrait au propriétaire la valeur de tous les bénéfices résultant de la vente. Celui qui n'en aurait vendu que cinq cents, ne devrait pas être condamné à lui en payer la valeur de trois mille, lors même que l'on considérerait ce paiement comme une sorte d'amende.
La loi du 19 juillet 1793 avait imposé à toute personne qui mettrait au jour un ouvrage de [II-158] littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce fût, l'obligation d'en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la république; celui qui n'avait pas fait ce dépôt n'était pas admis, en justice, à poursuivre les contrefacteurs ou débitans d'éditions contrefaites. Cependant, le non-accomplissement de cette obligation ne privait pas le propriétaire d'un ouvrage, de ses droits de propriété; comme la loi n'avait pas fixé de délai pour faire le dépôt, on était admis à le faire en tout temps, et du moment qu'il était effectué, on était admis à faire saisir les contrefaçons même antérieures [54].
La loi du 21 octobre 1814 a imposé à tout imprimeur l'obligation de déclarer à l'autorité publique le titre de l'ouvrage qu'il se propose d'imprimer, et le nombre d'exemplaires qu'il doit en tirer. L'omission de cette déclaration est punie de la saisie et du séquestre de l'ouvrage, et d'une amende de mille francs pour la première fois, et de deux mille francs en cas de récidive. Les exemplaires saisis sont rendus après le paiement de l'amende.
La même loi impose à l'imprimeur l'obligation d'en déposer, avant la publication, cinq exemplaires dans un des bureaux du ministère de l'intérieur, [II-159] ou au secrétariat de la préfecture, dans les départemens. Elle punit l'omission du dépôt d'une amende de mille francs pour le premier délit, et de deux mille pour les cas de récidive; mais cette omission n'affecte en aucune manière les droits de l'auteur sur son ouvrage.
La loi anglaise, qui prescrit l'inscription du titre d'un ouvrage dans un bureau de la corporation des marchands de livres ou de papier (stationers), n'a pour objet que de donner à chacun le moyen de connaître l'époque de la publication de chaque ouvrage. La loi française, qui prescrit une obligation analogue, n'a été faite que dans un intérêt de police; la déclaration, avant l'impression, avait pour but d'attirer l'attention des agens de la police sur les ateliers de l'imprimeur. Le dépôt avant la publication avait pour objet de faciliter l'exercice d'une sorte de censure préalable [55].
[II-160]
CHAPITRE XXXIV.
De la tendance des lois relatives à la propriété littéraire.↩
On a vu, dans le chapitre précédent, que les lois d'Angleterre, des États-Unis et de France, n'assurent aux auteurs qu'une jouissance temporaire de leurs ouvrages, et qu'ainsi la propriété littéraire proprement dite n'est garantie dans aucun de ces pays. Il serait superflu, par conséquent, de rechercher si elle n'aurait pas été véritablement reconnue et garantie, chez des nations moins avancées. Dans la plupart des autres États, les gouvernemens ne se bornent pas à la réduire à une simple jouissance temporaire : ils en préviennent la formation.
Rien ne prouve mieux que la propriété littéraire n'a été ni comprise ni garantie, même dans les pays les plus civilisés, que les différens systèmes qu'on suit à cet égard, et les variations que les lois ont éprouvées, à mesure que les lumières ont fait des progrès. Dans tous les pays, les droits d'un propriétaire, sur ses biens mobiliers ou immobiliers, sont les mêmes; il n'y a de différence que [II-161] dans les formes au moyen desquelles on en constate la transmission. Un Anglais est propriétaire d'un champ, d'une maison, d'une somme d'argent ou d'un riche mobilier, de la même manière qu'un Américain ou qu'un Français. Les droits des uns sont égaux aux droits des autres, sur les terres et sur les autres objets qui leur appartiennent, parce qu'il n'y a qu'une nature de propriété, comme il n'y a qu'une nature humaine. Pourquoi n'en est-il pas de même des droits des auteurs sur leurs ouvrages? Par la raison que ces droits ont été considérés comme une création de l'autorité publique, comme l'exercice d'un privilége, d'un monopole; tandis que les premiers sont considérés comme ayant une existence indépendante de la volonté des gouvernemens.
Les trois systèmes que j'ai exposés reposent sur la même erreur, mais ils ne sont pas cependant également mauvais; le pire des trois est celui qu'ont adopté les États-Unis d'Amérique ; celui qui existe maintenant en Angleterre, vient en seconde ligne; le moins vicieux est celui que nos lois et notre jurisprudence ont consacré.
Pour apprécier ces trois systèmes, il faut les considérer sous deux rapports: relativement aux auteurs et à leurs familles, et relativement aux autres membres de la société; il faut ensuite examiner comment ils affectent les intérêts des uns et des autres.
[II-162]
Suivant les lois américaines, celui qui publie un ouvrage, et qui meurt dans les quatorze années de la publication, ne jouit que pendant quatorze ans, soit par lui-même, soit par ses successeurs, du droit d'en vendre exclusivement des exemplaires; celui qui vit plus de quatorze ans après la publication, peut pendant vingt-huit exercer ou faire exercer le droit d'en vendre exclusivement des exemplaires.
Lorsqu'on a adopté de pareilles mesures, il semble qu'on s'est efforcé de mettre en opposition l'intérêt des auteurs et l'intérêt des sciences, l'amour des richesses et le désir de la gloire. L'homme de génie qui consacre sa fortune, sa santé, sa vie, à composer un ouvrage propre à immortaliser son nom et son pays, a tout juste quatorze années pour en vendre ou faire vendre des exemplaires, et rentrer ainsi dans une partie de ses dépenses. S'il avait employé son temps à publier, dans sa jeunesse, des romans frivoles, les lois lui auraient accordé vingt-huit ans pour exercer ses droits d'auteur. La durée du temps pendant lequel un écrivain a seul la faculté de vendre ou faire vendre ses ouvrages, est donc en raison inverse du temps et de la fortune qu'il a sacrifiés pour les composer. N'est-ce pas ainsi qu'on aurait agi si l'on avait eu le dessein d'encourager les productions futiles, et de décourager la publication des bons ouvrages?
[II-163]
Les écrits qui flattent les passions et les préjugés régnans, ceux qui sont au niveau des intelligences communes, se vendent toujours rapidement, et assurent aux auteurs et aux libraires des bénéfices plus ou moins grands. Ceux qui, loin de flatter les idées et les passions dominantes, tendent, au contraire, à détruire des préjugés funestes ou à réformer des mœurs vicieuses, ne se vendent que lentement: le succès dépend toujours de l'avenir. Les lois qui font aux auteurs et aux libraires une nécessité de tirer tous leurs bénéfices de la vente des premières années de la publication, tendent donc à multiplier les premiers, et à décourager la production des seconds.
Plus un écrivain est en avant de son siècle, dans quelque science que ce soit, plus le nombre des hommes qui sont capables de le suivre, est petit; à chaque pas qu'il fait, il laisse en arrière quelqu'un de ses auditeurs ou de ses lecteurs. Il suit de là que les ouvrages destinés à faire faire de grands progrès à l'esprit humain ne peuvent, pendant long-temps, être vendus qu'à un petit nombre de personnes. Les exemplaires du Système du monde, de M. de La Place, que l'éditeur a vendus, pendant quatorze années, ont probablement produit beaucoup moins d'argent que n'en a produit, dans le même espace de temps, le moins populaire des almanachs. Un gouvernement qui désire de faire [II-164] faire des progrès aux sciences, fait donc un très-mauvais calcul, quand il limite le droit qu'a un écrivain de vendre exclusivement son ouvrage, aux premières années qui suivent la publication [56].
Les lois anglaises renferment le même vice que les lois américaines, auxquelles elles ont donné naissance; mais, comme elles ont été réformées plus tard, ce vice a été affaibli. Le temps pendant lequel un auteur jouit exclusivement, en Angleterre, de la faculté de vendre ses ouvrages, égale toujours la durée de sa vie, et il ne peut jamais être de moins de vingt-huit ans pour lui-même ou pour ses héritiers. Si donc il arrive qu'un auteur vive vingt-huit ans après avoir publié son ouvrage, chacun peut, immédiatement après sa mort, s'emparer de ce même ouvrage pour le réimprimer et en vendre des exemplaires. S'il meurt avant l'expiration des vingt-huit années, les personnes qui lui succèdent jouissent du reste de ce terme.
[II-165]
Ici l'auteur est encore intéressé à mettre, dans la publication de ses écrits, le moins de retard possible; car le temps qu'il vivra au-delà des vingt-huit années qui lui sont accordées par les lois, est pour lui, et surtout pour sa famille, un bénéfice incontestable. Il est également intéressé à ce que, pendant sa vie ou dans les ving-huit années qui suivent la publication, les libraires vendent le plus grand nombre possible d'exemplaires de son ouvrage. Lui mort ou ce terme expiré, sa famille n'a pas d'autre intérêt au succès de ses écrits qu'un intérêt de réputation.
Les lois françaises tendent moins fortement que les lois américaines et que les lois anglaises à favoriser les productions littéraires dont le succès doit être rapide et passager, au préjudice de celles dont le succès doit être lent et durable; mais elles ont la même tendance. Dans tous les cas, la protection de la loi s'étend à vingt années au-delà de la vie de l'auteur, au profit de sa veuve ou de ses enfans, ou au profit de la veuve et des enfans de l'éditeur auquel l'ouvrage a été vendu. Chaque année que l'auteur consacre du perfectionnement de ses écrits, est donc une année prise sur le temps pendant lequel il aura le droit de les vendre ou de les faire vendre exclusivement. Il faut donc qu'il se hâte, s'il veut que ses ouvrages soient vendus pendant long-temps à son profit ou [II-166] à celui de sa famille; il faut surtout qu'il cherche à plaire bien plus à la génération présente qu'aux générations à venir. Or, on conviendra que des lois qui agissent de cette manière sur les esprits, ne sont favorables ni à la production des bons ouvrages, ni à l'intérêt bien entendu des auteurs et de leurs familles.
En général, les hommes font, pour assurer l'existence et le bonheur de leurs enfans, des efforts plus considérables que pour assurer leur propre bien-être. Rien n'excite autant une personne à conserver et à augmenter ses richesses que la certitude de les transmettre à ses descendans: l'esprit de famille est le principe conservateur de toutes les propriétés. Qu'un gouvernement déclare qu'à l'avenir les enfans ne jouiront que pendant vingt années, des biens que leurs parens leur auront transmis, à l'instant on verra commencer la décadence de toutes les fortunes privées. On pourra bâtir encore des maisons, faire des plantations, ou se livrer à d'autres travaux; mais les frais seront calculés sur la durée de la jouissance promise. On cherchera tout naturellement à ne donner à chaque chose qu'une durée égale au temps accordé pour la jouissance, et le gouvernement, qui aura cru s'enrichir en s'emparant de toutes les successions, ne recueillera que des débris. C'est à peu près de cette manière que les choses se [II-167] sont passées dans les pays soumis à l'empire turc. Si telle est la tendance générale du genre humain, elle doit se rencontrer dans les auteurs de compositions littéraires, comme dans les autres classes de la société, à moins qu'on ne prétende qu'ils forment une espèce particulière qui n'est pas soumise aux lois générales de l'humanité.
On reconaîtra sans peine que les hommes qui se livrent à diverses branches d'industrie, n'y sont généralement portés que par le désir d'accroître ou de conserver leur fortune, et par celui d'assurer l'avenir de leurs familles, et qu'une loi qui ferait cesser les motifs qui les y déterminent, mettrait par cela même un terme à leurs travaux; on conviendra même que les hommes qui se livrent à des compositions littéraires, sont soumis à l'influence des deux principales causes qui déterminent l'espèce humaine à se livrer au travail, le désir de se procurer des moyens d'existence et d'assurer un avenir à leurs familles; mais on dira qu'ils sont placés sous l'influence de causes particulières, qu'ils sont mus par l'amour de la gloire ou de la célébrité, et par le désir d'instruire et de réformer les nations.
Cela est incontestable, non pour tous, mais du moins pour quelques-uns; il est très-vrai qu'il se rencontre quelquefois des hommes disposés à sacrifier leur fortune et le bien-être de leurs familles à [II-168] l'amour de la gloire, et à l'espérance de rendre de grands services à leurs semblables; mais, si le désir d'être utile à l'humanité est assez puissant chez un homme pour le déterminer à sacrifier l'amour des richesses et même l'esprit de famille, il y a peu de générosité à se fonder sur l'existence de ce désir, pour exiger de lui un tel sacrifice, et lui refuser des garanties qu'on serait obligé de lui donner, s'il n'était mu que par les sentimens les plus vulgaires. On donne à l'homme qui se livre à l'industrie la plus commune, la garantie que les richesses qu'il produira, passeront à sa famille, et ne lui seront jamais ravies, parce qu'on est bien convaincu qu'il n'y aurait pas de production sans cette garantie; on suppose que les hommes qui se livrent à des travaux littéraires ont des sentimens plus élevés, plus généreux, et la supposition de ce sentiment leur fait refuser une garantie qu'on leur donnerait, si l'on avait la certitude qu'il n'existe pas !
Rien ne prouve mieux combien peu l'on a consulté, dans cette matière, les lois auxquelles la nature humaine est soumise, que les dispositions faites, dans quelques pays, à l'égard des universités et de certains colléges. On admet, à l'égard de ces corporations, l'existence de la propriété littéraire presque dans toute son étendue, dans la vue, dit-on, d'encourager la propagation des lumières. Mais peut-on croire raisonnablement qu'un écrivain [II-169] fera, dans l'intérêt d'une corporation, des sacrifices et des efforts qu'il ne ferait pas dans l'intérêt de ses enfans? Si l'on n'a considéré que les bénéfices pécuniaires que les universités retirent des ouvrages qui leur sont donnés, ils méritent à peine d'être considérés comme un encouragement au progrès des sciences. Un bon ouvrage qu'on ne peut se procurer qu'en payant un droit d'auteur, est infiniment plus utile que dix ouvrages médiocres ou mauvais, qu'on peut obtenir sans payer un droit semblable. Le prix des livres qu'on achète dans les universités ou dans les colléges, pour l'instruction des jeunes gens, entre pour peu de chose dans les frais de leur éducation, et la partie de ce prix qui revient aux auteurs mérite à peine d'être comptée.
Suivant les lois françaises, le temps pendant lequel un ouvrage littéraire n'est pas livré à tous ceux qui veulent le réimprimer et en vendre des exemplaires, se divise en deux parties: l'une, dont la durée est indéterminée, c'est la vie de l'auteur; l'autre, dont la durée a été fixée par les lois. Si après avoir publié un ouvrage, l'auteur vit trente années, la jouissance sera de cinquante ans ; elle ne sera que de vingt, s'il meurt immédiatement après la publication. Cela pourrait avoir quelque apparence de raison, s'il dépendait de chacun de prolonger la durée de sa vie; mais, comme la mort n'est pas un événement qu'on puisse éloigner à son [II-170] gré, la disposition est en sens inverse du bon sens et de l'humanité.
Il ne faut pas perdre de vue, en effet, qu'aux yeux de tout homme soumis aux lois générales de notre nature, ses intérêts et ceux de sa famille sont identiques; ils ne forment qu'un seul et même intérêt. Supposons donc qu'un auteur ayant une famille, vive pendant vingt ou trente ans après avoir publié ses ouvrages, il aura le moyen d'élever ses enfans, et de les faire jouir pendant le même espace de temps du fruit de ses travaux. Lorsque la mort le séparera d'eux, ils seront complétement élevés, et pourront pourvoir par leurs propres moyens à leur existence; cependant, ils auront encore, pendant vingt années, la jouissance exclusive de ses ouvrages. Si, au contraire, il meurt après la publication de ses écrits, laissant ses enfans en bas âge, la famille, privée de ses secours, n'aura que la même jouissance de vingt années.
La mort de l'auteur est presque toujours une circonstance complétement étrangère aux sacrifices de temps et de fortune que la composition de l'ouvrage a exigés; elle ne devrait donc, ni en augmenter, ni en diminuer la valeur commerciale. Mais tout est contradiction dans les dispositions faites sur les ouvrages littéraires : s'agit-il de priver les auteurs de toute garantie légale, après quelques années de jouissance? On semble croire qu'ils sont [II-171] tellement placés au-dessus de l'humanité, qu'ils se livreront aux plus grands efforts pour la moindre récompense. S'agit-il de fixer la durée de la jouissance accordée à leurs enfans? On semble croire qu'ils sont tellement égoïstes, qu'ils ne portent aucun intérêt à leurs familles, et qu'ils ne demandent qu'à placer leurs biens en rentes viagères.
Si l'on croyait pouvoir, sans injustice, n'accorder aux auteurs sur leurs ouvrages qu'une jouissance temporaire, il aurait fallu du moins que chaque année de jouissance qui leur serait enlevée par la mort, fût ajoutée aux années accordées aux enfans; on aurait ainsi évité de donner aux écrits qu'un homme publie dans sa jeunesse, une prime sur ceux qu'il publie dans l'âge mur; refuser à ceux-ci des avantages qui sont garantis à ceux-là, ce n'est pas seulement commettre une injustice envers l'auteur et sa famille, c'est méconnaître et sacrifier les intérêts du public et des sciences.
[II-172]
CHAPITRE XXXV.
Distinction entre la propriété littéraire et le monopole.↩
Les erreurs dans lesquelles on est tombé au sujet de la propriété littéraire, sont venues de ce qu'on a confondu les garanties réclamées pour cette propriété avec l'établissement des monopoles. Après avoir fait cette confusion, il était naturel qu'on donnât des limites à la jouissance d'un auteur ou de ses héritiers. On aurait pu même se dispenser de leur garantir pendant aucun temps la faculté de vendre ou faire vendre exclusivement des exemplaires de leurs ouvrages [57].
Mais, il faut se hâter de le dire, il n'y a rien de commun entre l'établissement d'un monopole et la garantie littéraire. Un monopole, en effet, n'est pas autre chose que l'interdiction faite, sous des peines plus ou moins sévères, à toutes les classes [II-173] de la population, de se livrer à un genre particulier d'industrie ou de commerce, accompagnée 'une exception au profit d'une ou de plusieurs personnes. L'autorité qui crée un monopole, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs particuliers, convertit a délit, à l'égard de tous les autres, l'exercice innocent de leurs facultés et le bon emploi de leurs capitaux. Elle commet à la fois deux attentats: lin contre la liberté des personnes, l'autre contre la disposition des propriétés.
Ainsi, par exemple, lorsque le gouvernement français interdit, sous de fortes peines, l'exercice de art typographique à tous les citoyens, et qu'il établit une exception au profit de quelques-uns dor il s'est réservé le choix, il crée évidemment un monopole. Il crée aussi un monopole, lorsqu'il défend, sous certaines peines, à tous propriétaires de terres la culture du tabac, et qu'il permet ensuite cette culture à quelques-uns. Enfin, il crée un monopole, quand il interdit à tous les citoyens l'enseignement public, quel qu'en soit l'objet, qu'il le permet ensuite à un certain nombre de personnes. Dans ces divers cas et dans d'autres semblables, il est évident que l'on convertit en délit pour la masse de la population, des actions qui n sont point vicieuses par leur nature, afin de favoriser le développement de certains intérêts particuliers.
[II-174]
Les hommes auxquels l'exploitation d'un monopole est accordé, n'avaient aucun droit préexistant à l'exercice exclusif de l'industrie ou de commerce qu'ils exploitent. Si le gouvernement n'avait fait aucun acte pour attribuer exclusivement à certains personnes la faculté de multiplier, par la press, les copies d'un écrit, comment ces personnes seraient-elles parvenues à établir leur droit exclusif à l'exercice de cette industrie? Comment les hormes auxquels on a donné le monopole de l'enseignement, parviendraient-ils à prouver en juice qu'ils ont seuls le droit d'enseigner, s'ils étaient obligés de mettre de côté l'acte de l'autorité publique, qui convertit en délit l'exercice d'une profession nécessaire et honorablement remplie ? Comment enfin parviendrait-on à démontrer que par la nature des choses, les propriétaires de te ou tels champs ont seuls le droit de cultiver tel ou telle plante? Ici, le droit appartient également à tous; mais ce droit est converti en priviléges au profit de quelques-uns.
On ne peut pas donner le nom de monopole à la garantie donnée à chaque individu d'exercer librement sa profession ou son industrie, et de jouir et de disposer seul des produits qu'il en obtint; la même garantie étant donnée à tous, il n'y a de privilége pour personne. Ainsi, le manufacturer auquel les lois assurent la disposition exclusive du [II-175] produit de sa manufacture, ne jouit d'aucun monopole. Il n'y a pas non plus de monopole pour l'homme auquel les lois garantissent la jouissance et la disposition exclusive de la maison ou du champ dont il a la propriété. On ne saurait à plus forte raison mettre au rang des monopoles les avantages qui résultent pour un homme de ses talens, de ses connaissances, de sa réputation, de ses relations de famille.
Dans quel sens serait-il donc vrai de dire que la garantie donnée à la propriété littéraire, constitue un monopole au profit des auteurs ou de leurs héritiers? Si la même garantie est donnée à tous, n'est-il pas évident qu'il n'y aura de privilége pour aucun? Si chacun est propriétaire de ses œuvres, quel est celui qui pourra se prétendre lésé? Quelle est la base sur laquelle un homme pourrait fonder son droit de multiplier et de vendre à son profit les ouvrages des autres?
Si un acte de l'autorité publique interdisait à la généralité des citoyens d'écrire sur tel ou tel sujet, de traiter telle ou telle science, et s'il établissait ensuite une exception en faveur d'une ou de plusieurs personnes, alors sans doute on pourrait se plaindre avec raison de l'existence d'un monopole; mais il n'y a rien de commun entre un tel privilége et la garantie donnée à chaque auteur de la propriété de ses ouvrages. Cette [II-176] garantie ne donne des entraves au génie de personne; elle laisse à chacun la liberté d'écrire sur tous les sujets qui ont été traités. En remettant Phèdre sur la scène, Pradon ne portait pas atteinte à la propriété de Racine; et Corneille ne se serait pas plaint qu'on attentât à ses droits, s'il avait plu au cardinal de Richelieu de refaire le Cid.
La garantie donnée aux propriétés littéraires n'empêche personne de mettre en pratique les vérités découvertes ou démontrées par les écrivains ; du moment qu'un ouvrage est publié, chacun peut mettre à exécution, dans son intérêt particulier, les principes dont il renferme l'exposition. Sous ce rapport, la garantie des propriétés littéraires diffère essentiellement du privilége donné à l'auteur d'une découverte industrielle; elle n'est un obstacle pour aucun genre de progrès. Un brevet d'invention a pour objet d'empêcher que personne, excepté l'inventeur, ne mette en pratique une idée nouvelle; la publication d'un écrit a pour objet, au contraire, de mettre tout le monde à même de pratiquer toutes les vérités qui s'y trouvent renfermées; chacun a même la faculté de les en tirer, et de les publier sous une forme plus populaire.
Si la garantie donnée à la propriété littéraire était mise au rang des monopoles, il n'y aurait pas de raison pour ne pas y mettre aussi les [II-177] garanties données à toutes les autres propriétés, et surtout aux propriétés immobilières. Le domaine de l'intelligence n'a pas de bornes connues; tout le monde peut y avoir entrée, et la place de chacun est en raison de son génie. Quand un sujet a été traité, chacun peut donc s'en emparer de nouveau, et faire même oublier le premier qui en a pris possession. On peut ne pas en dire autant du domaine de la terre: quand un espace de terrain est devenu la propriété d'un homme, tous les autres hommes en sont à jamais exclus. Cependant la terre susceptible de culture est loin d'être illimitée.
Il est facile, au reste, de réduire à des termes bien simples les différences qui existent entre la garantie donnée à une propriété, et la création d'un monopole. L'établissement d'une garantie suppose, comme on vient de le voir, un droit préexistant; la formation d'un monopole ne suppose l'existence d'aucun droit exclusif antérieur. La garantie reconnaît à tous les mêmes droits; elle constitue le régime de l'égalité devant la loi; elle rend à chacun le sien. Le monopole frappe, au contraire, la masse de la population dans l'exercice de ses droits; il crée des exceptions et constitue des priviléges; il établit le régime de l'inégalité.
Si la protection accordée aux auteurs, pour la jouissance et la disposition de leurs ouvrages, est [II-178] une garantie donnée à un genre particulier de propriété, et non la création d'un certain nombre de monopoles, il s'ensuit que ces propriétés doivent être soumises aux mêmes lois que toutes les autres, à moins qu'on observe dans leur nature des différences qui exigent des dispositions particulières.
Les motifs pour lesquels beaucoup de personnes refuseraient aujourd'hui d'appliquer à la propriété littéraire les règles qu'on suit à l'égard de tous les autres genres de propriétés, sont, au reste, fort différens de ceux qui firent mettre jadis les productions de l'esprit hors du droit commun. On ne considère plus le pouvoir d'interdire ou de permettre arbitrairement le travail, comme un droit domanial et royal; on ne confond pas, en général, la garantie donnée à une propriété avec l'établissement d'un monopole. On est mu par d'autres sentimens et par d'autres idées : on craint de voir sortir du commerce ou porter à un prix excessif, des ouvrages littéraires qu'on croit nécessaires au progrès de l'esprit humain. On n'hésiterait pas à mettre les productions de ce genre sur la même ligne que toutes les autres propriétés, si l'on avait la certitude que chacun pourra toujours s'en procurer des exemplaires à des prix modérés.
Je ferai remarquer d'abord que, dans les pays [II-179] soumis à des gouvernemens despotiques, on ne voit circuler librement que les ouvrages dont la propagation n'inspire aucune crainte à l'autorité publique. Pour proscrire, dans de tels pays, les productions littéraires qui peuvent porter ombrage au pouvoir, on n'a nul besoin de les acheter des propriétaires; on les interdit par un acte d'autorité, et l'on punit, s'il le faut, les auteurs qui les composent, les imprimeurs qui en multiplient les copies, et les libraires qui les vendent. En mettant la propriété littéraire sur la même ligne que toutes les autres, on n'aggraverait donc pas, dans ces pays, l'état du peuple, relativement aux ouvrages qui déplaisent au pouvoir; mais l'on favoriserait la multiplication de ceux qui, sans blesser les hommes investis de la puissance, seraient utiles au public.
La garantie complète donnée à la propriété littéraire, ne serait pas, non plus, un obstacle à la diffusion des lumières, dans les pays où les gouvernemens ne séparent pas leurs intérêts des intérêts du public. S'il arrivait qu'après la publication d'un ouvrage, l'auteur, ou ceux qui l'auraient acquis de lui, ne voulussent pas en permettre la réimpression, rien ne serait plus facile que de vaincre leur résistance. L'autorité publique agirait à leur égard comme elle agit souvent relativement aux propriétaires de biens immobiliers: l'utilité générale motiverait leur expropriation. Les propriétaires [II-180] seraient indemnisés de la valeur de leurs propriétés, et chacun pourrait ensuite en multiplier les copies.
Mais il est beaucoup de gouvernemens qui, sans être complétement despotiques, ne confondent pas leurs intérêts avec ceux des nations qu'ils gouvernent. Ils n'ont pas assez de puissance pour empêcher la réimpression et la vente des ouvrages qu'il est de l'intérêt du public de voir multiplier; mais ils n'ont pas non plus des intentions assez droites et assez pures pour favoriser la propagation de ceux que des intérêts vicieux tendraient à retirer du commerce. Sans puissance pour en empêcher la réimpression et la vente, lorsque la faculté de les réimprimer et de les vendre est donnée à tout le monde, ils ne seraient pas sans moyens pour y mettre obstacle, s'il ne fallait que le consentement d'un petit nombre de propriétaires. Sous la restauration, le gouvernement français, par exemple, n'a pas pu em pêcher que les écrits de Voltaire, de Rousseau, n'aient été reproduits à un nombre immense d'exemplaires; mais si ces écrits avaient été dans le domaine privé, il ne les en aurait pas fait sortir pour les faire tomber dans le domaine public. Il est même permis de croire qu'il aurait fait d'assez grands sacrifices pour les acquérir, non dans la vue de les répandre, mais afin d'en arrêter la multiplication.
[II-181]
Il est incontestable, en effet, que, dans l'état actuel de la civilisation, les gouvernemens qui ont perdu le pouvoir d'empêcher par la force la propagation de certains écrits, n'en ont pas perdu le désir, et que si des moyens indirects d'arriver au même but leur étaient donnés, ils en feraient volontiers usage. Mais ne peut-on éviter ce danger qu'en réduisant les droits des auteurs à une jouissance de quelques années, et en privant ensuite leurs propriétés de toute garantie, à l'égard des imprimeurs et des libraires qui veulent s'en emparer? Il semble que, pour empêcher que des ouvrages importans ne soient étouffés, soit par les héritiers des auteurs, soit par les personnes auxquelles la propriété en a été transmise, il n'est nullement nécessaire de les mettre, après quelques années, à compter du jour de la publication, hors de la protection des lois.
En général, on se laisse trop préoccuper par les écrits qui intéressent la religion ou la politique, les seuls que les sectes religieuses et les gouvernemens soient intéressés à prohiber. Quand on jette les yeux sur une bibliothèque un peu nombreuse, on s'aperçoit sur-le-champ qu'il existe une immense quantité d'ouvrages que personne ne voudrait acheter, dans la vue de les empêcher de se répandre. L'intérêt des familles ou des libraires qui en auraient la propriété, serait d'en multiplier [II-182] les éditions, tant que le public en demanderait de nouveaux exemplaires. Le descendant d'un écrivain célèbre pourrait tenir à honneur de conserver la propriété des ouvrages qu'il aurait reçus de lui, et de les répandre, comme d'autres tiennent à honneur de conserver l'héritage immobilier qu'ils ont reçus de leurs ancêtres. Priver indistinctement toutes les propriétés littéraires de garanties, de peur que, dans le nombre, il ne s'en rencontre quelques-unes que les propriétaires, par préjugé ou par cupidité, se résigneraient à ne pas faire réimprimer, est une mesure qu'il serait difficile de justifier.
Lorsqu'un ouvrage a été répandu dans le public, la garantie donnée à l'auteur n'empêche pas que d'autres ne traitent le même sujet et ne reproduisent les mêmes idées. Le gouvernement ou la secte qui l'acheterait pour en empêcher la réimpression, encouragerait, par cela même, les écrivains à en produire de nouveaux sur le même sujet. Plus les sacrifices qu'il ferait à cet égard seraient grands, plus l'excitation qu'il donnerait serait énergique.
Dans une telle lutte, l'avantage resterait infailliblement du côté des lumières; car il est moins difficile d'épuiser la caisse d'un prince ou d'une secte religieuse, que d'épuiser l'esprit humain. Le danger de voir des hommes abuser des garanties données à la propriété littéraire, pour priver les [II-183] citoyens de certaines productions, a donc beaucoup plus d'apparence que de réalité. En peu de temps, ce danger serait complétement nul pour tous les écrits qui intéresseraient véritablement le public.
Il serait facile d'ailleurs d'écarter un tel danger, s'il était à craindre, sans méconnaître entièrement l'existence de la propriété littéraire. Le gouvernement impérial, se considérant comme administrateur du domaine public, imposait aux libraires l'obligation de lui payer un certain droit pour la réimpression de tous les ouvrages qui n'étaient plus dans le domaine privé. Ce droit qui, dans l'intention du fondateur, devait être perpétuel, était en raison du nombre de feuilles de chaque ouvrage. Or, rien n'eût été plus facile que d'établir pour les ouvrages restés dans le domaine privé, après un certain nombre d'années de jouissance pleine et entière, une disposition analogue à celle qu'on avait adoptée pour les ouvrages sur lesquels les héritiers des auteurs n'avaient plus de droits à exercer. Une telle mesure n'aurait pas été sans doute à l'abri de tout reproche; mais la propriété littéraire ne serait pas restée complétement sans protection, et l'on n'aurait pas eu à craindre que la garantie donnée par les lois devint un moyen de priver le public de la possession de bons ouvrages.
Le problème qui se présente à résoudre relativement [II-184] à la propriété littéraire, offre, au reste, des difficultés qui sont loin d'être aussi grandes qu'elles le paraissent au premier aspect. De quoi s'agit-il en effet? Il s'agit, d'un côté, de ne point paralyser les causes qui peuvent déterminer un homme à sacrifier son temps, ses talens, sa fortune à la production d'un ouvrage utile au public. Il s'agit, d'un autre côté, lorsqu'un bon ouvrage a été produit, d'empêcher qu'il ne soit enlevé au commerce, par suite de préjugés funestes ou de sordides spéculations.
Si l'on veut que les motifs qui sont propres à déterminer un homme à donner à ses talens tous les développemens dont ils sont susceptibles, à tirer de son esprit tout ce qu'il est capable de produire de bon et de grand, il n'y a qu'un moyen: c'est de lui garantir tous les avantages qui doivent être la conséquence naturelle de ses travaux; c'est de ne pas permettre que d'autres usurpent la réputation qu'ils peuvent lui donner, ou qu'ils s'approprient les bénéfices qu'il peut en retirer en les vendant.
La valeur commerciale d'un ouvrage n'est pas seulement en raison de sa bonté intrinsèque; elle est aussi en raison du temps pendant lequel la vente en est exclusivement garantie à l'auteur et aux personnes auxquelles il a transmis ses droits. Il est évident qu'un libraire paiera d'autant moins [II-185] un écrit, que le temps pendant lequel la jouissance exclusive lui est garantie sera plus court; il en donnerait très-peu de chose, si, après avoir vendu le premier exemplaire, tout libraire avait la faculté de le faire réimprimer, et de le vendre à son profit. Il n'est pas moins évident, d'un autre côté, que moins un ouvrage doit être avantageux pour l'auteur, et moins, pour le produire, on fait d'efforts et de sacrifices. Les compositions littéraires qui, dans un court délai, tombent au rang des choses communes, coûtent un peu moins à ceux qui les achètent; mais aussi elles sont moins bonnes. Le défaut de garantie est donc, en définitive, aussi nuisible au public qu'elle peut l'être pour les écrivains.
Le sentiment le plus énergique est celui qui porte les hommes à la conservation et à l'agrandissement de leur famille; la plupart d'entre eux font, pour assurer l'existence et le bien-être de leurs enfans, des sacrifices et des efforts qu'ils ne feraient pas pour eux-mêmes. Les gouvernemens qui refusent de garantir aux enfans la propriété des ouvrages produits par leurs pères, paralysent donc une des causes qui agissent sur l'esprit humain avec le plus d'énergie. Il est peu d'hommes qui, placés dans l'alternative de laisser leurs enfans sans moyens d'existence assurés, ou de renoncer à l'exécution d'un ouvrage peu profitable [II-186] pour eux, mais avantageux pour sa nation, ne prissent ce dernier parti. Un gouvernement d'ailleurs doit toujours éviter de mettre en opposition des sentimens également honorables, et de placer les citoyens dans une position telle, que, quel que soit le parti qu'ils prennent, ils soient condamnés à renoncer à l'accomplissement d'une partie de leurs devoirs. Aspirer à faire le bien d'une nation par la violation des lois de la morale et le sacrifice des sentimens les plus naturels et les plus chers au cœur de l'homme, est une prétention aussi vaine qu'elle est dangereuse.
On tomberait dans une autre erreur si l'on s'imaginait que, pour laisser aux sentimens qui peuvent agir sur l'esprit d'un écrivain, toute leur énergie, il est nécessaire d'adopter, pour la transmission des propriétés littéraires, tous les principes qu'on suit à l'égard des autres genres de propriétés. Le Code civil étend le droit de succéder en ligne collatérale jusqu'au douzième degré inclusivement: c'est porter bien loin les droits de la parenté. A un tel degré, les affections qui naissent d'une communauté d'origine sont bien faibles, si même il en existe aucune. Il y aurait peu d'inconvéniens à réduire le droit de succession, surtout pour les propriétés littéraires, à la ligne directe, et aux degrés les plus rapprochés de la ligne collatérale.
[II-187]
Rien ne serait donc plus facile que de donner aux causes qui peuvent faire exécuter des travaux littéraires utiles au public, toute l'énergie dont elles sont susceptibles. Quant au danger de voir priver le public d'ouvrages qu'il lui serait utile d'obtenir à bas prix, il serait facile de le prévenir: pour cela, il ne faudrait que vouloir.
Dans ce chapitre et dans les quatre qui le précèdent, je n'ai parlé que des compositions littéraires; il est clair cependant que les vérités que j'ai exposées, s'appliquent à d'autres productions. On peut dire des compositions musicales, des dessins ou gravures, et de quelques autres objets d'art, ce que j'ai dit de quelques ouvrages de l'esprit. Si je n'ai parlé que d'un genre de production, ce n'a été que pour éviter des répétitions qui auraient rendu mes observations plus longues sans les rendre plus claires, Chacun peut, au reste, appliquer ce que j'ai dit, et ce qui me reste à dire sur le même sujet, à des compositions musicales ou à d'autres objets d'art.
[II-188]
CHAPITRE XXXVI.
Application des principes établis dans les chapitres précédens, à quelques questions de propriété littéraire.↩
Il existe entre les productions de l'esprit et les autres produits de l'industrie humaine quelques différences qu'il importe d'observer; car elles serviront à résoudre quelques-unes des principales questions auxquelles donne naissance la propriété littéraire.
Du moment qu'un ouvrage est livré à l'impression et mis en vente, toute personne qui en achète un exemplaire acquiert, par cela même, la faculté de s'approprier toutes les idées, tous les sentimens qui s'y trouvent exprimés ; elle a, sous le rapport de l'amusement et de l'instruction que la lecture peut donner, tous les droits qu'elle aurait, si elle avait acquis la propriété entière de l'ouvrage.
Cette faculté de s'approprier par l'étude les sentimens et les pensées exposés dans un ouvrage rendu public par l'impression, n'appartient pas [II-189] seulement à toute personne qui en achète un exemplaire; elle appartient à tous ceux qui veulent se donner la peine d'aller en prendre lecture dans les bibliothèques où le dépôt en a été fait.
Les plaisirs ou les profits qu'on peut tirer de tout autre genre de propriété, ne peuvent pas ainsi se diviser ou se multiplier; tout avantage qu'une personne retire d'un meuble, d'une maison, d'un champ, prive généralement le propriétaire de ce meuble, de cette maison ou de ce champ d'un avantage égal; tout ce qui profite à l'un, est presque toujours perdu pour l'autre [58].
Ainsi, quoique le principal objet d'un ouvrage littéraire soit l'instruction ou le plaisir que donne la lecture, la personne qui en a la propriété, n'a, sous ce rapport, aucun avantage sur les personnes qui en ont acquis des exemplaires; il peut même arriver que, sans se dépouiller de ses droits de propriété, elle ne se soit pas réservé la disposition d'une seule copie.
Le propriétaire d'un objet matériel, d'un meuble ou d'une maison, peut faire éprouver à sa propriété tous les changemens qu'il juge convenables; il peut, sans porter atteinte aux droits de [II-190] personne, l'altérer ou même le détruire; il peut, selon l'expression des jurisconsultes, en user et en abuser, sans avoir à craindre aucune poursuite judiciaire.
L'auteur d'une composition littéraire, peut aussi en disposer comme bon lui semble, tant qu'il ne l'a pas publiée ; il est en son pouvoir de la modifier pour la rendre meilleure ou pire, ou même de l'anéantir complétement; quelle que soit la manière dont il en dispose, personne ne sera reçu à intenter une action contre lui.
Mais à l'instant où un ouvrage a été rendu public, et où des exemplaires en ont été vendus, il n'est plus au pouvoir de l'auteur de le détruire; il peut, dans des éditions nouvelles, corriger ses erreurs, modifier son style; mais là se borne sa puissance; du moment qu'il a lui-même cessé d'exister, son ouvrage devient invariable; la personne à laquelle il en a transmis la propriété, ne saurait ni le détruire, ni l'altérer.
Si le propriétaire d'un ouvrage rendu public, n'a la puissance, ni de l'anéantir, ni même de le modifier, et si, sous le rapport de l'instruction ou de l'amusement qu'on peut en retirer par la lecture, il n'a pas plus d'avantage que la personne qui en possède un seul exemplaire, en quoi consiste donc sa propriété? Elle consiste uniquement dans la faculté d'en multiplier les copies, et de les vendre à son profit, et dans le pouvoir d'empêcher que d'autres [II-191] ne s'enrichissent par le même moyen. Ses droits de propriété ne sont pas, au reste, tellement inhérens à lui-même, qu'ils ne puissent en être séparés; ils sont susceptibles d'être aliénés ou transmis héréditairement, comme tout autre genre de biens.
Il suit de ces faits que la personne à laquelle l'autorité publique garantit, pendant un certain nombre d'années, la jouissance exclusive d'un ouvrage, a pendant ce temps exactement les mêmes droits qu'elle aurait si sa propriété lui était entièrement et à jamais garantie. S'il arrivait que les propriétés littéraires fussent mises sur le rang de toutes les autres, si elles étaient transmissibles de génération en génération, comme tout autre genre de biens, les questions auxquelles elles donneraient naissance, ne seraient pas différentes de celles qu'elles ont fait naître sous les lois actuelles : pour arriver à une bonne solution, on n'aurait pas besoin de recourir à d'autres principes que ceux à l'aide desquels elles ont été déjà résolues.
La circonstance que les lois qui déterminent la durée de la garantie accordée à la propriété littéraire, sont sans influence, soit sur la nature des questions auxquelles cette propriété donne naissance, soit sur la manière dont elles doivent être résolues, me permet d'examiner ici les principales de ces questions et les solutions qui en ont été [II-192] données, sans sortir des limites que je me suis prescrites, ni changer la nature de cet ouvrage.
Avant que d'être livrée à l'impression et mise en vente, une composition littéraire existe en manuscrit; et, sous cette forme, elle est le produit de l'industrie humaine comme un ouvrage imprimé. Cependant la loi du 19 juillet 1793 n'accorde une indemnité aux auteurs dont les ouvrages ont été contrefaits, que lorsqu'ils les ont eux-mêmes livrés à l'impression et publiés ; elle est muette sur l'impression des manuscrits, faite sans l'autorisation des auteurs. Faut-il conclure de ce silence qu'un manuscrit n'appartient pas à celui qui l'a composé, ou que du moins il ne peut en revendiquer que la matière? Celui qui parviendrait à s'en emparer, et qui en prendrait une copie, ne serait-il tenu de restituer que l'original? Pourrait-il, après avoir fait cette restitution, en vendre des exemplaires à son profit?
Ces questions sont peu embarrassantes pour les hommes qui reconnaissent que toute production est la propriété de celui par lequel elle est formée, et qui pensent que les ouvrages littéraires doivent être mis sur le même rang que toutes les autres propriétés. En admettant, en effet, que chacun est propriétaire des valeurs auxquelles il donne naissance, et que nul ne peut légitimement s'enrichir en s'emparant du travail d'autrui, la circonstance [II-193] qu'un écrit a ou n'a pas été publié, ne change absolument rien à la question. Les principes qui protègent toutes les propriétés en général, sont applicables à un ouvrage manuscrit comme à un ouvrage imprimé et mis en vente; et il est impossible de voir pourquoi les atteintes portées à celle-là seraient plus licites que les atteintes portées à celle-ci.
Si les lois qui protègent la propriété en général, n'étaient pas applicables à des ouvrages manuscrits, il n'y aurait pas moyen de les livrer avec sûreté à l'impression, parce que l'auteur, en en perdant la possession, perdrait par cela même tous ses droits. Un homme qui, sans en avoir obtenu le consentement du propriétaire, se permettrait de livrer à l'impression un manuscrit tombé dans ses mains, et d'en vendre des exemplaires, se rendrait donc coupable, d'après les principes généraux du droit, d'atteinte à la propriété. Il devrait être condamné d'abord à restituer au propriétaire tous les bénéfices qu'il aurait faits, à réparer, en second lieu, les dommages qu'il lui aurait causés, et enfin à subir les peines que méritent ceux qui usurpent sciemment la propriété d'autrui [59].
[II-194]
La question relative à la propriété d'ouvrages manuscrits, si simple et si facile pour ceux qui admettent en principe que tout produit appartient à celui qui le crée, n'est pas si aisée pour ceux qui considèrent comme un monopole la garantie donnée aux auteurs. Si, par la nature des choses, toute personne, en effet, avait le droit de faire imprimer et de vendre à son profit un ouvrage tombé dans ses mains; si les lois faites pour garantir aux auteurs la vente exclusive de leurs compositions, avait créé un privilége à leur profit, en portant atteinte aux droits de tous, il s'ensuivrait que ces lois devraient être restreintes aux cas spéciaux qu'elles ont prévus, et que nul ne pourrait réclamer que la protection qu'elles ont formellement donnée. Or, les lois faites en France, depuis 1793, sur la propriété littéraire, n'ont eu pour objet que de réprimer les contrefaçons d'ouvrages rendus publics par la voie de l'impression.
[II-195]
L'article 4 de la loi du 19 juillet 1793 porte, en effet, que tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'édition originale; mais, s'il n'existe pas d'édition originale, c'est-à-dire si l'auteur n'a jamais livré son ouvrage à l'impression, sera-t-il sans droit contre celui qui lui aura volé une copie de son manuscrit, et qui l'aura fait imprimer et mettre en vente? L'article 5 de la même loi, qui détermine l'indemnité à laquelle doit être condamné le débitant de l'édition contrefaite, présente la même difficulté; il fixe cette indemnité à une somme équivalente à la valeur de cinq cents exemplaires de l'édition originale. On suppose donc toujours qu'il s'agit d'un ouvrage que l'auteur a lui-même publié ou fait publier.
L'action que cette loi accorde à l'auteur dont l'ouvrage a été imprimé et mis en vente sans son aveu, est subordonnée à une condition: elle doit être précédée du dépôt, dans la bibliothèque nationale, de deux exemplaires de l'édition qu'il a lui-même fait imprimer; mais, s'il n'y a pas eu de publication de sa part, et si par conséquent aucun dépôt n'a été fait, ne sera-t-il admis à exercer aucune action en justice? celui qui lui aura soustrait son manuscrit pourra-t-il en vendre des exemplaires impunément, et sans être tenu de lui payer aucune indemnité? Oui, si la loi du 19 [II-196] juillet 1793 a créé des priviléges, établi des monopoles; non, si elle a reconnu des droits; si elle a limité le temps pendant lequel ils pourraient être exercés, et si les difficultés qu'elle n'a pas prévues ne doivent être résolues que par les principes généraux du droit.
Les dispositions du Code pénal prévoient le cas où un ouvrage aurait été imprimé ou réimprimé sans le consentement de l'auteur ou du propriétaire, et celui où une contrefaçon faite à l'étranger serait introduite en France; mais il est une violation de propriété qu'elles n'ont pas prévue: c'est celle dont se rendrait coupable une personne qui ferait imprimer à l'étranger la copie d'un ouvrage manuscrit appartenant à une autre personne, et qui en introduirait des exemplaires sur notre territoire. L'article 472 de ce Code, qui qualifie délit de contrefaçon l'introduction sur le territoire français d'ouvrages contrefaits à l'étranger, ne lui donne, en effet, cette qualification que pour les ouvrages qui avaient été déjà imprimés en France. Il n'y aurait donc pas moyen d'atteindre, par nos lois, celui qui, après avoir fait à l'étranger une édition d'un ouvrage non encore imprimé dont il aurait soustrait une copie au propriétaire, introduirait des exemplaires sur notre territoire, à moins toutefois qu'on ne le poursuivît comme coupable de soustraction frauduleuse.
[II-197]
Mais ne pourrait-on pas poursuivre, comme coupable de vol ou de contrefaçon, dans le pays où l'ouvrage aurait été imprimé et mis en vente, l'individu qui publierait ainsi à l'étranger, sans autorisation de l'auteur, un manuscrit dont il posséderait une copie? La solution de cette question dépend des dispositions des lois du peuple chez lequel elle serait agitée. Un Anglais qui volerait un manuscrit à un de ses compatriotes et qui irait le publier sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, ne pourrait pas être poursuivi devant les juges de ce dernier pays, puisque les lois américaines n'accordent à la propriété littéraire aucune protection, quand le propriétaire est étranger, et qu'il ne réside pas sur le territoire national. Si le même individu venait faire imprimer et vendre l'ouvrage en France, je ne doute pas qu'il ne fût condamné à des dommages envers l'auteur, si celui-ci avait le moyen de prouver sa propriété; puisque nos lois garantissent aux étrangers les mêmes droits qu'aux nationaux, pour ceux de leurs ouvrages qui n'ont pas été publiés d'abord hors de notre territoire.
Les lettres qu'une personne adresse à une autre, sont-elles la propriété de celui qui les écrit ou de celui qui les reçoit? Il faut, pour bien résoudre cette question, distinguer diverses espèces de lettres. Les écrits qu'on met sous cette forme, pour leur [II-198] donner un genre particulier d'intérêt, comme les Provinciales, les Lettres persanes et une foule d'autres, ne doivent pas être distingués de toute autre espèce d'ouvrages. Les lettres qu'une personne adresse à une autre sur des sujets de littérature ou sur une science, telles, par exemple, que les Lettres d'Euler à une princesse d'Allemagne, semblent présenter d'abord un peu plus de difficulté. Cependant, si l'on considère et l'intention de la personne par laquelle des lettres semblables sont écrites, et l'intention de celle à qui elles sont adressées, il est impossible d'y voir autre chose que de simples leçons. Celui qui les écrit, ne se propose que d'instruire ou d'amuser la personne à laquelle il les adresse; et celle-ci n'entend recevoir que ce qui lui est véritablement donné. Il n'y a a donc pas de transmission de propriété littéraire proprement dite : il n'y a d'aliénation que pour une seule copie [60].
Les lettres auxquelles donnent lieu des relations d'affaires ou d'amitié, ne peuvent pas être considérées comme des ouvrages littéraires. Ceux qui les écrivent ne se proposent ni de les publier, ni de les vendre; ils entendent encore moins que les personnes auxquelles ils les adressent, en feront un [II-199] objet de spéculation. Il y a peu de gens qui voulussent entretenir par écrit des correspondances amicales, sous la condition que toutes leurs lettres seraient imprimées et livrées au public. Si donc il arrivait qu'un individu livrât à l'impression des lettres confidentielles qui lui auraient été adressées personnellement, ou qui seraient tombées dans ses mains, la personne qui les aurait écrites serait certainement fondée à en demander la suppression. Une telle publication serait considérée, non comme une atteinte à une propriété littéraire, mais comme un abus de confiance, comme une violation du contrat tacite que suppose toute correspondance amicale. C'est en considérant sous ce point de vue la publication de lettres privées et confidentielles, que les cours de justice d'Angleterre l'ont interdite [61].
Une personne à laquelle on adresserait, pour son amusement ou son instruction, des lettres sur la littérature ou sur les sciences, ne serait propriétaire, avons-nous dit, que d'une copie de ces mêmes lettres, parce que celui qui donne des leçons sur un sujet quelconque, n'entend, en aucune manière, aliéner la propriété d'un ouvrage. Par la même raison, ceux qui reçoivent, même dans un [II-200] lieu public, des leçons orales d'un professeur, ne peuvent pas, après les avoir recueillies, les faire imprimer et les vendre sans son autorisation. Enseigner une science à des hommes qui ont le désir de l'apprendre, et vendre un ouvrage à un homme qui fait le commerce de livres, sont, en effet, deux choses tout-à-fait différentes. Celui qui reçoit une leçon qu'il a payée ou que d'autres ont payée pour lui, peut en tirer toute l'instruction qu'elle renferme, comme celui qui paie sa place dans un théâtre, peut tirer de la représentation à laquelle il assiste, tout le plaisir qu'elle peut donner. Mais le premier n'a pas plus le droit de faire imprimer et de vendre le discours du professeur, que le second n'a le droit de faire imprimer et de vendre la tragédie ou la partition de musique qu'il a entendue.
Un orateur a sur ses discours, un prédicateur a sur ses sermons, les mêmes droits qu'un professeur sur ses leçons; chacun est libre d'aller les entendre, et d'en faire son profit sous le rapport de l'instruction; mais nul ne pourra, sans le consentement de l'auteur, en faire un objet de commerce. Bossuet et Massillon étaient propriétaires de leurs oraisons funèbres et de leurs sermons au même titre que Corneille et Racine de leurs tragédies: en les prononçant, ils donnaient à chacun le droit de les écouter, et de profiter de leurs [II-201] leçons; mais ils ne donnaient à aucun libraire le droit de les faire imprimer et de les vendre.
Les droits qu'a un auteur, comme propriétaire, sur les ouvrages qu'il a publiés, consistant uniquement dans la faculté de les faire réimprimer en tout ou en partie, et d'en vendre des exemplaires, il s'en suit que le seul avantage qu'il soit interdit à chacun d'en retirer, est celui qui résulte de la réimpression et de la vente. Toute réimpression, même partielle, d'un ouvrage sans le consentement de l'auteur, est donc une atteinte à sa propriété; il suffit que le fragment réimprimé et livré au public soit assez considérable pour avoir une valeur. Si, d'un côté, les droits de l'auteur ne doivent pas faire obstacle aux progrès de l'esprit humain, d'un autre côté, nul ne doit s'emparer de son travail pour s'en faire un moyen de s'enrichir.
Un écrivain qui, pour donner de la valeur à un ouvrage de sa composition, y ferait entrer un fragment considérable d'un ouvrage appartenant à un autre, et qui, par ce moyen, diminuerait la valeur de celui-ci, se rendrait également coupable d'atteinte à la propriété, quelle que fût d'ailleurs l'importance relative de la partie qui lui serait propre. L'éditeur d'une encyclopédie, par exemple, qui s'emparerait d'un traité particulier appartenant à un autre écrivain, et qui, sans son aveu, y en ferait entrer la plus grande partie, se rendrait [II-202] coupable de contrefaçon. Si l'on jugeait qu'en pareil cas, la propriété n'est pas violée, un libraire pourrait englober dans un vaste dictionnaire des sciences et des arts, tous les traités particuliers qui appartiennent aux meilleurs écrivains [62].
L'insertion, dans une revue ou dans tout autre recueil périodique ou non périodique, de partie d'un ouvrage, est aussi une contrefaçon, si la partie qu'on a prise est assez considérable pour dispenser de la lecture de l'original. Les journaux sont autorisés, sans doute, à rendre compte des écrits nouveaux qui se publient chaque jour; mais il ne leur est pas permis de se les approprier, en paraissant n'en donner qu'une analyse [63].
Il n'est pas plus permis de contrefaire un ouvrage de peu d'étendue que d'en contrefaire un très-considérable; l'auteur d'une romance, d'une fable, peut faire respecter sa propriété, comme l'auteur d'un poème épique peut faire respecter la [II-203] sienne [64]. Un article de journal appartient à celui qui en est l'auteur ou qui l'achète, au même titre qu'une encyclopédie appartient aux savans qui l'ont composée. Le journaliste qui ferait son journal avec des articles pris dans d'autres journaux, porterait donc atteinte à leur propriété, et pourrait être poursuivi comme coupable de contrefaçon [65].
L'écrivain qui fait des notes sur ouvrage tombé dans le domaine public, a-t-il la propriété de ces notes, de telle manière que nul ne puisse les joindre, sans son aveu, à une autre édition du même ouvrage? Cette question s'est présentée plusieurs fois devant les cours de justice d'Angleterre, et elle a été résolue en faveur des auteurs des notes [66]. Il serait difficile de voir sur quoi l'on fonderait une décision contraire, à moins qu'on ne voulût interdire de faire des annotations sur les ouvrages qui ont cessé d'être dans le domaine privé [67].
[II-204]
Mais si l'on ne peut, sans porter atteinte à la propriété, s'emparer de l'ouvrage d'autrui pour le vendre, rien n'est plus licite que de s'en servir pour répandre des lumières ou combattre des erreurs. Un écrivain qui ferait, par exemple, un abrégé d'une histoire, d'un voyage ou d'un traité publié par un autre, ne se rendrait pas coupable de contrefaçon, s'il se livrait à un véritable travail intellectuel ; s'il résumait, dans un langage qui lui serait propre, les faits et les pensées de l'ouvrage principal. Un abrégé fait en conscience serait une propriété aussi inviolable que l'ouvrage sur lequel il aurait été fait. Mais on ne saurait considérer comme un abrégé la réduction d'un ouvrage à de moindres dimensions, si cette réduction était faite par la suppression d'un certain nombre de passages [68].
La traduction d'un écrit dans une autre langue n'a pas été considérée non plus comme une contrefaçon, quoiqu'elle puisse cependant diminuer la vente de l'ouvrage original. Le traducteur s'empare des faits, des observations, de la méthode [II-205] de l'auteur; mais il les rend dans un langage et dans un style qui lui sont propres. Sa traduction est donc sa propriété; mais cette propriété n'est pas un obstacle à ce que d'autres s'exercent sur le même sujet, et fassent des traductions nouvelles du même ouvrage [69].
L'écrivain qui traite un sujet ne ravit donc à personne la faculté de le traiter de son côté; cent écrivains peuvent écrire simultanément ou successivement sur l'histoire de France, sur la morale ou sur la physique; et quoique tous travaillent sur les mêmes documens, racontent les mêmes faits ou décrivent les mêmes phénomènes, aucun ne pourra se plaindre que les autres portent atteinte à sa propriété, si aucun ne copie l'ouvrage d'un autre.
Il est cependant des sujets qu'il est impossible d'exposer de deux manières : tels sont des livres de calcul, des tables d'intérêts, des tables de logarithmes, des tables chronologiques, des almanachs, des dictionnaires, et certaines compilations. Celui qui le premier compose un ouvrage de ce genre, qui publie, par exemple, une table de logarithmes, enlève-t-il à toute autre personne le droit de faire un ouvrage pareil? Si chacun peut faire un ouvrage exactement semblable, n'en résultera-t-il [II-206] pas que la propriété d'aucun ne sera garantie, ou que du moins il ne sera presque jamais possible de constater les atteintes qui y seront portées?
Lorsqu'un ouvrage de cette nature à été composé et publié, et qu'il est impossible de faire, sur le même sujet, un ouvrage qui soit différent sans être inexact, il semble que la propriété de l'ouvrage doit emporter la propriété du sujet. La reconnaissance de cette espèce de propriété constituerait, il est vrai, une sorte de monopole; mais elle ne ferait point obstacle aux progrès de l'esprit humain. L'appropriation, par le travail, d'un sujet qui ne peut pas être traité de deux manières, serait analogue à l'appropriation d'un fonds de terre qui, n'étant occupé par personne, serait devenu la propriété du premier qui l'aurait exploité. On ne pourrait pas dire qu'il y a monopole dans le premier cas, sans reconnaître que le monopole existe aussi dans le second; car l'occupation est aussi exclusive dans celui-ci qu'elle pourrait l'être dans celui-là.
Cependant les jurisconsultes qui admettent le principe de l'occupation quand il s'agit de choses matérielles, ne l'admettent pas pour les sujets qui sont du domaine de l'intelligence; ils ont pensé, sans doute, que si la propriété du sujet était inhérente à la propriété de l'ouvrage, l'auteur pourrait mettre à ses écrits un prix qui serait hors de [II-207] proportion avec la valeur de son travail. Un calculateur peut donc composer et publier une table d'intérêts, une table de logarithmes, et d'autres livres de même genre, quoiqu'il existe déjà des ouvrages parfaitement semblables. Il suffira, pour que ces écrits soient sa propriété, qu'ils soient véritablement le résultat de ses travaux; mais il serait coupable d'atteinte à la propriété, si, au lieu de faire lui-même les calculs, il les avait simplement copiés [70].
On a vu que, lorsqu'un auteur a publié un écrit, un second peut, sans porter atteinte à la propriété du premier, en composer un autre sur le même sujet et sous le même titre; mais pourrait-on également donner à un journal ou à tout autre écrit périodique, le titre d'un journal ou d'un écrit périodique déjà existant? On a toujours jugé qu'on ne pouvait pas s'emparer du titre d'un journal, pour en fonder un nouveau, et c'est avec raison.
Il y a, dans un journal et dans tout ouvrage périodique, deux choses tout-à-fait distinctes: les écrits [II-208] déjà publiés, et la réputation et la clientelle qui s'attachent au titre. Les écrits déjà publiés sont une propriété de même nature que toutes les autres compositions littéraires; il ne serait pas plus licite de les réimprimer et de les vendre sans l'autorisation des propriétaires, que d'imprimer et de vendre d'autres ouvrages. La réputation et la clientelle qui s'attachent au titre, sont une propriété commerciale, bien plus qu'une propriété littéraire. Le titre est, pour les propriétaires du journal, ce qu'est, pour un fabricant, la marque qui sert à distinguer les produits sortis de sa fabrique, de ceux qui ont une origine différente. L'usurpation de ce titre n'est donc, à proprement parler, ni une contrefaçon ni un plagiat; c'est l'usurpation d'une réputation et d'une clientelle qui presque toujours ont été laborieusement et chèrement acquises. Ce sujet, au reste, appartient moins à ce chapitre qu'au chapitre dans lequel il a été question des fonds de commerce [71].
Parmi les divers motifs sur lesquels est fondée la garantie donnée par les lois à toute propriété, il en est deux que personne ne saurait raisonnablement contester: le premier est d'encourager les hommes qui peuvent se livrer à quelque [II-209] travail, à former des propriétés nouvelles en leur donnant la certitude d'en jouir et d'en disposer à leur gré; le second de déterminer les hommes qui sont déjà propriétaires, à veiller à la conservation de leurs biens, dans l'espérance de les transmettre à leurs enfans ou aux personnes qui leur sont chères. On suppose donc toujours, lorsqu'on garantit à chacun les produits de son travail, qu'il importe à l'humanité que ces produits soient formés et conservés; mais, si une production littéraire blessait les bonnes mœurs, si elle devait porter le désordre et le trouble dans la société, l'auteur pourrait-il invoquer la protection des lois, pour vendre exclusivement son ouvrage? La garantie qui lui serait donnée, ne tendrait-elle pas à encourager la production d'une espèce d'écrits dont il serait bon, au contraire, de prévenir l'existence?
Lorsque les gouvernemens ont limité le temps pendant lequel un auteur ou ses héritiers pourraient vendre son ouvrage, ils ont eu principalement pour objet d'encourager les lettres et les sciences; ils ont voulu, dit-on, qu'après un certain temps de jouissance, tous les écrits tombassent au rang des choses communes, afin que chacun pût les réimprimer sans rien payer, et qu'ils fussent vendus moins cher au public. Le simple refus de garantir à un écrivain la propriété d'un [II-210] ouvrage dont on jugerait la tendance vicieuse, aurait donc principalement pour effet de dispenser les imprimeurs et les libraires de lui payer aucun droit d'auteur, et de répandre, par conséquent, un plus grand nombre d'exemplaires de ses écrits. On faciliterait, du moins pour un temps, la vente d'un mauvais ouvrage, en mettant le public à même de l'obtenir à bas prix, afin d'ôter aux écrivains à venir la tentation d'en produire de pareils.
Le refus de garantir à un auteur la propriété d'un ouvrage dangereux ne saurait donc être considéré comme un moyen suffisant de prévenir ou de réprimer la composition et la vente de mauvais écrits; il faudrait, de plus, que les imprimeurs et les libraires ne pussent eux-mêmes retirer aucun bénéfice de la contrefaçon, et que, de leur côté, ils ne trouvassent dans les lois aucune garantie pour le remboursement de leurs avances ou de leurs travaux; ces moyens ne seraient même efficaces et sans danger qu'autant qu'ils se combineraient avec une bonne législation pénale.
Si un ouvrage blesse les bonnes mœurs, s'il renferme des diffamations, ou s'il provoque à commettre des faits punissables, l'auteur et ses complices doivent être mis en jugement et punis. S'il est réimprimé et mis en vente, les auteurs de la nouvelle publication doivent subir les mêmes peines que s'ils l'avaient composé; mais ils ne peuvent [II-211] pas être punis pour avoir porté atteinte à la propriété d'autrui. L'auteur dont l'ouvrage a été contrefait, n'a le droit de demander que la réparation du dommage qui lui a été causé, et ce dommage est toujours en raison du nombre d'exemplaires dont la contrefaçon a empêché la vente. Mais, quand lui-même ne peut pas vendre des exemplaires de son ouvrage, sans se rendre coupable d'un délit, il ne saurait être admis à exiger une indemnité de ceux qui ont porté préjudice à la vente en commettant eux-mêmes le délit.
Lorsque la publication d'un ouvrage ne peut donner lieu à aucune poursuite contre l'auteur ou contre le libraire qui le publie, et que, par conséquent, l'un et l'autre peuvent en vendre des exemplaires sans blesser aucune loi, il y aurait de graves dangers à reconnaître aux tribunaux la faculté de refuser la garantie que les lois donnent à la propriété littéraire, surtout lorsque les questions de propriété ne sont jugées, ni suivant les mêmes formes, ni par les mêmes juges, que les questions de culpabilité.
En France, par exemple, il n'appartient qu'au jury de décider si la publication d'un écrit est ou n'est pas punissable; les jurés sont seuls compétens pour prononcer sur la tendance morale d'un ouvrage. La partie qui se plaint ou qui accuse, est tenue de se soumettre à certaines formes; elle doit [II-212] articuler d'une manière positive les faits qui donnent lieu à la poursuite, et caractériser les délits dont elle se plaint. Ce n'est qu'autant qu'elle se soumet à ces obligations, que la partie accusée a le moyen de se défendre.
Les questions de propriété littéraire sont jugées, au contraire, par des magistrats permanens, élus par le gouvernement, et sans jurés. La question qui se débat entre l'auteur ou son représentant et le contrefacteur, ne porte pas sur la tendance morale de l'ouvrage; elle porte sur l'identité entre l'édition originale et l'édition qu'on prétend en être une copie. Les juges qui s'écarteraient du point qui leur est soumis, pour prononcer sur la tendance de l'écrit qui donne lieu au débat, excéderaient les bornes de leur compétence. Ils condamneraient un auteur ou un éditeur sur une accusation qui n'aurait pas été articulée, et sans les avoir mis à même de se défendre.
En Angleterrre, où les jurés sont appelés à prononcer sur les questions de propriété comme sur les questions de culpabilité, le danger est moins grave; cependant, il y a toujours quelques inconvéniens à confondre des matières qui n'ont entre elles aucun rapport. Les garanties qui existent quand il s'agit de la punition d'un délit, et celles que les lois donnent dans les procès civils, ne sont pas exactement les mêmes; les jurés, d'ailleurs, se [II-213] décident bien plus facilement à refuser la protection des lois à une propriété dont ils ne savent pas toujours apprécier la valeur, qu'à déclarer un homme coupable d'un délit. Les cours de justice ont, au reste, été peu frappées de cet inconvénient; car elles n'ont jamais hésité à refuser toute protection aux ouvrages qui leur ont paru contraires à la morale [72].
Les juges, en refusant toute garantie à des ouvrages contraires aux mœurs, ne se sont pas dissimulé que la circulation en serait plus considérable, puisque les éditeurs seraient dispensés de rien payer aux auteurs; mais cette considération ne les a point arrêtés.
«Il est très-vrai, disait lord Eldon, que le refus de la cour d'arrêter des publications malfaisantes, peut , peut avoir pour effet de les multiplier; mais je réponds à cela que, siégeant ici comme juge d'une simple question de propriété, je n'ai rien à voir à la nature de cette propriété, ni à la conduite des parties, si ce n'est quant à leurs intérêts civils [73] ».
Il est un cas dans lequel les magistrats accordent à l'auteur d'un ouvrage immoral une action, pour en empêcher la contrefaçon : c'est lorsqu'il se reproche de l'avoir publié, et qu'il désire de le supprimer.
[II-214]
Une loi qui prolonge le temps pendant lequel un auteur peut vendre exclusivement des exemplaires de ses ouvrages, ne s'applique pas seulement aux écrits qui ne sont pas publiés au moment de sa promulgation; elle s'applique à tous ceux qui ne sont pas encore tombés dans le domaine du public [74]. Lorsque l'auteur a aliéné ses ouvrages, l'augmentation de temps accordé par la loi, profite à l'acquéreur et à ses héritiers [75].
Si, d'un côté, l'on peut dire que les lois antérieures ne les ont garantis, pendant un temps déterminé, que sous la condition tacite qu'à l'expiration de ce temps, chacun pourrait librement les réimprimer, on peut dire, d'un autre côté, que les auteurs n'ont pas été libres de faire des conditions, et que la loi qui donne la garantie, reconnaît un droit et ne le crée pas. La jurisprudence anglaise et la jurisprudence française sont uniformes à cet égard [76].
[II-215]
Il est une question qui tient plus au droit international qu'au droit particulier de chaque peuple: c'est celle de savoir s'il convient à l'intérêt de tous les hommes que la propriété d'un ouvrage ne soit protégée que dans le pays où la publication en a été d'abord effectuée. Un Anglais qui viendrait publier ses écrits sur notre territoire, avant de les avoir fait imprimer dans aucun autre pays, jouirait, parmi nous, pour la vente de son ouvrage, des mêmes droits que s'il était Français; mais nos lois ne lui en garantiraient pas la propriété, s'il en avait fait d'abord la publication en pays étranger. Un Français qui publierait d'abord ses écrits en Belgique ou en Angleterre, en perdrait la propriété en France, quand même il viendrait immédiatement y en faire une seconde édition.
Il est difficile de bien motiver de semblables dispositions: chaque gouvernement, en ne garantissant aux auteurs que les ouvrages publiés sous son empire, a prétendu sans doute donner des encouragemens à l'art typographique et au commerce de la librairie; mais l'encouragement n'aurait-il pas été le même si l'on avait mis des droits plus ou moins élevés sur les ouvrages imprimés à l'étranger? Si un ouvrage doit être imprimé à Bruxelles, qu'importe aux imprimeurs et aux libraires français qu'il le soit au profit d'un contrefacteur étranger plutôt qu'au profit de l'auteur, [II-216] leur compatriote? La priorité qu'un peuple obtient sur les autres pour la publication d'un ouvrage, lui assure des avantages si petits et même si incertains, qu'il n'est pas facile de voir pourquoi les gouvernemens y ont attaché tant d'importance [77].
Le refus que font les gouvernemens de garantir la propriété des ouvrages qui ne sont pas d'abord publiés sur leur territoire, ne porte pas un grand préjudice aux grandes nations; mais elle nuit beaucoup aux petites. Un écrivain qui publie ses ouvrages en France, en Angleterre ou aux ÉtatsUnis, peut en vendre un nombre d'exemplaires assez considérable pour être indemnisé des sacrifices qu'il a faits. Celui qui publierait les siens à Genève, dans un des petits États d'Italie ou d'Allemagne, ne serait pas sûr de vendre, dans le seul pays où sa propriété serait protégée, un nombre d'exemplaires suffisant pour payer les frais d'impression. Les divers Etats, de la Confédération américaine garantissent à tous les membres de [II-217] l'Union la propriété ou du moins la jouissance temporaire de leurs ouvrages, quel que soit l'État dans lequel la publication en a été faite. C'est un exemple que suivront sans doute un jour les peuples d'Italie, d'Allemagne ou de Suisse. Quant aux grandes nations, elles auront pendant longtemps à régler d'autres intérêts que ceux des lettres et des sciences.
La plupart des questions de contrefaçon ou de plagiat portent sur des points de fait, et appartiennent moins au domaine de la science, qu'à celui de la conscience. On ne peut établir à cet égard que quelques règles générales: c'est aux jurés ou aux magistrats qu'il appartient d'en faire une sage application. « Le principe qui doit servir de base à notre décision, a dit un juge anglais, lord Mansfield, est d'une grande importance pour le pays. Nous devons prendre garde de nous jeter dans deux extrêmes également préjudiciables : l'un serait de priver du fruit de leurs travaux des hommes de talent, qui ont consacré leurs veilles aux intérêts de la société; l'autre d'arrêter le progrès des arts et de priver le monde de perfectionnemens. La loi qui garantit aux auteurs les droits qu'ils ont sur leurs ouvrages, les met à l'abri du plagiat du langage et des opinions; mais il n'interdit pas d'écrire sur le même sujet. S'il s'agit d'histoire, par exemple, un homme peut [II-218] rapporter les mêmes événemens dans le même ordre de temps; s'il s'agit de dictionnaires, il peut donner l'interprétation des mêmes mots. Dans tous ces cas, la question de fait soumise au jury est: si le changement est plausible ou s'il ne l'est pas. Il faut, pour qu'il y ait contrefaçon, que la similitude soit telle qu'on puisse raisonnablement supposer qu'un ouvrage n'est que la transcription de l'autre, et rien que la transcription [78]. »
[II-219]
CHAPITRE XXXVII.
De la propriété des rentes sur des particuliers ou sur l'État.↩
Le principal objet de toute propriété est d'assurer l'existence ou de satisfaire les besoins de celui à qui elle appartient ou des membres de sa famille; toutes les fois donc qu'une personne a formé ou régulièrement acquis un moyen d'existence qui ne porte atteinte ni aux biens, ni à la liberté d'autrui, ni aux bonnes mœurs, ce moyen est sa propriété ; la jouissance et la disposition doivent lui en être garanties, comme s'il s'agissait du produit matériel de son industrie.
Il y a presque toujours, au sein d'un peuple civilisé, un nombre plus ou moins grand de familles qui ne possèdent aucun fonds de terre, qui n'exercent aucune industrie, qui ne portent atteinte ni aux biens ni à la personne d'autrui, et qui cependant ont des moyens d'existence assurés. Comme chez les grandes nations, le nombre des familles qui sont dans ce cas est très-considérable, il importe de se faire, par quelques exemples, des [II-220] idées bien nettes des ressources au moyen desquels elles existent.
Le propriétaire d'un fonds de terre, ne voulant ni le cultiver, ni le donner à ferme, le transmet à une autre personne, sous la condition de payer, à lui et à ses successeurs, à perpétuité, une rente déterminée. Du moment que la convention est parfaite, il n'est plus, à proprement parler, propriétaire du fonds qu'il a donné à rente. L'acquéreur peut en jouir et en disposer comme bon lui semble, pourvu qu'il remplisse la condition à laquelle il s'est soumis. Il pourrait même, suivant les lois françaises, s'affranchir de cette condition, en remboursant le capital de la rente.
Il faut remarquer cependant que la faculté de jouir d'une chose n'existe complétement que dans celui qui a la puissance d'appliquer tous les avantages que cette chose peut produire, à la satisfaction de ses besoins. Si je n'ai la jouissance d'une ferme qui donne un revenu de dix mille francs, que sous la condition d'en payer huit mille toutes les années, il est évident que je ne jouis en réalité que des quatre cinquièmes de la valeur totale. La personne à laquelle les huit mille francs seront payés annuellement, aura la jouissance des quatre cinquièmes du revenu de la terre, et ces quatre cinquièmes seront incontestablement sa propriété.
Le possesseur de la terre pourrait, il est vrai, [II-221] s'en approprier le revenu tout entier, en payant perpétuellement la rente avec les produits d'une autre terre, ou avec les intérêts d'un capital qu'il aurait placé; mais alors la terre ou le capital qui lui servirait à effectuer ce paiement, diminuerait d'utilité, relativement à lui, dans la proportion de tout ce qu'il aurait acquis. D'un autre côté, l'ancien propriétaire, devenu rentier, pour obtenir à perpétuité et en nature les quatre cinquièmes des produits de sa terre, n'aurait qu'à donner au fermier la somme qu'il recevrait annuellement de celui qui en serait devenu acquéreur.
Ce qu'il importe surtout de ne jamais perdre de vue, c'est que le contrat de constitution de rente ne saurait avoir pour effet d'augmenter la somme des revenus qui existent chez une nation. Avant que tel contrat fût formé, la terre qui en est l'objet, donnait, par exemple, un revenu de dix mille francs. Si celui à qui la terre est transmise, s'engage à payer à perpétuité une somme de huit mille francs à celui de qui il la reçoit, il n'y aura pas deux revenus dans la société : un de dix mille francs pour le nouveau propriétaire, et un de huit mille pour le rentier. Le premier pourra bien recevoir, sans doute, dix mille francs du fermier auquel la terre sera donnée à cultiver; mais, sur cette somme, il en devra payer huit mille au second. Il n'y aura donc aucune création de valeurs.
[II-222]
Un capitaliste peut, comme le possesseur d'une terre, transmettre sa propriété à une autre personne qui se charge de lui en payer un revenu. Si le propriétaire d'un capital de cent mille francs, par exemple, le prête à un homme industrieux, moyennant un intérêt annuel de six mille francs, celui-ci en aura la disposition pour le service de son industrie; mais, en réalité, le premier en conservera la jouissance. Dans ce cas, comme dans le précédent, il n'y aura pas deux revenus distincts: celui que donnera l'établissement créé avec le capital, et celui du capitaliste. Si l'on considère les choses d'un point de vue élevé, l'on verra qu'après comme avant le prêt, le capitaliste possède dans les richesses sociales une valeur de cent mille francs, et que cette valeur est incontestablement sa propriété. Il peut, sans doute, la perdre, si l'emprunteur fait de mauvaises affaires ou s'il est un malhonnête homme; mais il pourrait la perdre aussi s'il la gardait dans sa maison, ou s'il la plaçait en dépôt.
Il arrive souvent qu'un capitaliste, au lieu de placer son capital entre les mains d'un homme industrieux qui le fait valoir, et qui lui en paie un intérêt, le prête à un gouvernement qui le consomme, et qui établit un impôt pour en payer les intérêts toutes les années. Si l'on suppose que l'emprunt est fait et employé au profit des [II-223] contribuables, ceux-ci deviennent réellement débiteurs de toutes les sommes empruntées en leur nom : leurs biens ont diminué d'une valeur exactement égale à celle que le gouvernement a consommée; et cette valeur a été transférée aux capitalistes, en échange de celle qu'ils ont prêtée. Les terres ou les autres propriétés immobilières et les établissemens industriels n'ont, en effet, de valeur que par les revenus qu'ils produisent, et les revenus diminuent pour les propriétaires et pour les hommes industrieux, à mesure que les impôts augmentent. Un fermier qui paie dix mille francs toutes les années au propriétaire dont il fait valoir la terre, net voudra plus en payer que neuf mille, si sa ferme est soumise à un nouvel impôt de mille francs. La même cause qui diminue le fermage d'un dixième, diminue la valeur de la terre dans la même proportion.
Telle ferme, par exemple, qui pouvait se vendre deux cent mille francs, ne se vendra plus que cent quatre-vingt mille francs, si un impôt perpétuel enlève au propriétaire un dixième de son revenu; elle ne se vendrait que la moitié de la première somme, si le fisc s'emparait de la moitié de la rente que le propriétaire pouvait exiger du fermier; enfin, elle n'aurait plus de valeur si l'impôt devenait assez considérable pour absorber le fermage tout entier.
[II-224]
Il résulte de ceci que toutes les fois qu'une nation fait un emprunt, et qu'elle consomme improductivement, comme cela se pratique, les capitaux empruntés, il se fait dans la société un immense déplacement de richesses. Les propriétaires de terres, de maisons, d'entreprises industrielles, enfin tous les hommes sur lesquels tombent les charges publiques, sont dépouillés de valeurs égales à celles que le gouvernement a empruntées. Ces valeurs passent aux capitalistes qui en perçoivent les revenus par les mains des agens du fisc, et qui sont ainsi substitués aux propriétaires et aux hommes industrieux, dont les revenus diminuent de tout ce qu'on est obligé de payer aux premiers. Un seul exemple va faire comprendre comment s'opère cette substitution.
Un propriétaire qui constituerait, sur une ferme d'un revenu de douze mille francs, une rente perpétuelle de six mille francs, pour un capital qu'il aurait emprunté et dissipé, ne serait riche que de six mille francs de revenu. S'il constituait, sur sa terre, une rente égale au fermage, pour un capital qu'il aurait également consommé d'une manière improductive, il ne lui resterait plus rien. Il pourrait conserver le titre de propriétaire et quelques-uns des honneurs qui y sont attachés; mais, en réalité, ce serait aux capitalistes ou aux rentiers que les produits de la propriété seraient [II-225] dévolus. Pour simplifier les opérations et pour rendre plus claire la position du propriétaire foncier, il ne faudrait que faire verser directement le prix du fermage entre les mains du propriétaire de la rente. Or, une nation peut aliéner ses revenus de la même manière qu'un particulier, et se dépouiller ainsi de ses propriétés au profit de ceux dont elle emprunte et consomme les capitaux. Il y a cependant une différence: quand c'est un particulier qui constitue une rente pour un capital qu'il dissipe, il n'aliène que ses biens et les produits de son industrie; quand c'est une nation, elle aliène, outre ses biens et son industrie, les propriétés et l'industrie des générations à venir.
Un capitaliste qui, moyennant un capital de cent mille francs, achète une rente perpétuelle de cinq mille, de la personne qui peut légitimement en disposer, devient propriétaire de cette rente au même titre qu'il le serait d'une terre ou d'une manufacture. La jouissance de cette propriété pour lui la plupart des effets qu'aurait la jouissance d'un autre genre de propriété qui lui donnerait un revenu semblable: elle assure son existence et celle de sa famille, comme l'assurerait un immeuble ou un établissement d'industrie ou de commerce. Si elle lui était ravie, elle aurait pour lui tous les effets qui sont la suite ordinaire de [II-226] toutes les confiscations, et de tous les déplacemens violens de propriété.
Quand une nation établit plusieurs millions de rentes, elle n'augmente pas la somme des richesses; elle transfère seulement aux capitalistes dont elle consomme improductivement les capitaux, ainsi qu'on vient de le voir, une part des revenus des autres classes de la société; de même, quand elle abolit des rentes, sans en rembourser la valeur, c'est-à-dire quand elle fait banqueroute, elle déplace les richesses, mais elle ne les augmente pas: elle attribue aux uns les propriétés dont elle dépouille les autres.
En parlant des propriétés qui consistent en rentes, j'ai supposé que les emprunts étaient faits par les propriétaires ou par leurs délégués, et que les capitaux empruntés étaient employés dans leur intérêt. Des emprunts faits par une autorité illégitime, et mis à la charge d'un peuple qui n'en retire aucun profit, sont le plus puissant moyen de spoliation qui ait jamais été imaginé par un gouvernement. A l'aide de ce moyen, les revenus d'une nation et par conséquent ses terres, ses capitaux, son commerce, peuvent être aliénés au profit, non-seulement des capitalistes nationaux, mais encore des capitalistes étrangers. Si, par exemple, lorsque le gouvernement de la restauration a emprunté un milliard pour le livrer aux [II-227] étrangers qui l'avaient établi, ce milliard a été avancé par des prêteurs des autres nations, ces prêteurs ont réellement acquis pour un milliard de propriétés françaises. Si, lorsqu'un peu plus tard, il créa une dette d'un second milliard pour le livrer aux émigrés, ce milliard avait été avancé par des capitalistes étrangers, ces capitalistes auraient encore acquis le droit de percevoir à perpétuité sur les produits de notre industrie les intérêts du capital prêté.
On conçoit qu'en poussant à l'excès un pareil système, la nation la plus intelligente, la plus active, la plus industrieuse, pourrait être transformée en un peuple d'ilotes, travaillant pour quelques milliers d'oisifs qui achèteraient les produits de ses terres, de son industrie et de tous ses travaux, d'un gouvernement qui s'en ferait payer la valeur, et qui la partagerait entre ses favoris ou ses satellites: il n'y a qu'une bonne représentation nationale qui puisse mettre un peuple à l'abri d'une telle spoliation.
Tous les gouvernemens ont senti que pour aliéner à perpétuité, avec avantage pour eux-mêmes, une partie plus ou moins considérable des revenus sur lesquels est fondée l'existence de la masse de la population, il fallait offrir de fortes garanties et de grands bénéfices aux capitalistes nationaux ou étrangers qui se présenteraient pour [II-228] les acheter. Aussi, les lois de tous les pays offrent-elles aux gens qui se présentent pour acheter du gouvernement une partie des moyens d'existence de la population qui lui est soumise, des bénéfices et des priviléges fort grands. Ces bénéfices et ces priviléges sont si exorbitans, qu'on a cru nécessaire de les prohiber par des lois formelles pour les autres genres de propriétés.
Suivant les lois françaises, par exemple, les revenus qui consistent en rentes sur l'État sont affranchis de toute contribution [79]; tandis qu'un propriétaire de terres, soumis à tous les impôts qui pèsent sur le rentier, est, en outre, obligé de payer au gouvernement le quart ou le cinquième de ses revenus, et que nul ne peut se livrer à aucun genre d'industrie ou de commerce, sans avoir payé un impôt spécial désigné sous le nom de patente. Nut capitaliste ne pourrait, sous peine d'être poursuivi correctionnellement comme usurier, stipuler un intérêt au-dessus de cinq pour cent, pour le capital qu'il prêterait à un simple particulier [80]; tandis s'il livre le même capital à un gouvernement qui lui vendra, sous le nom de rente sur l'Etat, une portion plus ou moins considérable des revenus des citoyens, il pourra recevoir un [II-229] intérêt infiniment plus élevé. Enfin, les biens d'une personne peuvent être saisis et vendus au profit de ses créanciers, quand ils consistent en fonds de terre, en maisons, en établissemens d'industrie ou de commerce, tandis qu'ils sont insaisissables quand ils consistent en rentes sur l'Etat [81]. L'individu qui, ayant volé un million de francs, l'emploierait à acheter une rente de cinquante mille francs sur l'État, ne pourrait pas en être dépouillé par la justice, quand même le vol serait manifeste.
On conçoit qu'il ne serait pas difficile à un gouvernement qui possède de tels moyens, d'aliéner à perpétuité, au profit de capitalistes étrangers ou nationaux, une partie des moyens d'existence de la population, s'il voulait abuser de son pouvoir; mais il ne s'agit pas ici d'exposer les attentats dont les propriétés peuvent être l'objet, soit de la part d'un gouvernement, soit de la part des particuliers; je n'ai qu'à faire connaître les diverses espèces de propriétés qui existent chez la plupart des nations civilisées.
[II-230]
CHAPITRE XXXVIII.
De la faculté de jouir et de disposer d'une propriété.↩
Il existe, chez une nation civilisée, une infinie variété de choses auxquelles nous donnons le nom de propriétés. Parmi ces choses, il en est plusieurs que nous employons à satisfaire immédiatement nos besoins, ou à nous procurer certaines jouissances, et qui se consomment par l'usage que nous en faisons; il en est d'autres qui nous servent à nous procurer, par des échanges, les divers objets dont nous avons besoin, et que nous n'avons pas le moyen de produire par nous-mêmes; il en est d'autres enfin qui ne peuvent satisfaire immédiatement aucun de nos besoins, mais qui produisent ou servent à produire celles qui sont nécessaires à notre conservation ou à notre bien-être.
En observant comment se forment la plupart de ces choses que nous appelons des propriétés, nous avons vu qu'en général il s'y trouve divers élémens de matière, qu'il n'est en notre pouvoir ni de créer, ni d'annihiler ; que, dans leur état primitif, et avant que la main de l'homme ait concouru à les modifier [II-231] ou à les combiner, ces élémens de matière ne sont pour nous d'aucun usage, c'est-à-dire qu'ils ne sont propres à satisfaire aucun des besoins que la nature nous a donnés; enfin, que si plusieurs nous sont fournis gratuitement par la nature, il en est d'autres que nous ne pouvons nous procurer que par de pénibles travaux.
Nous avons ensuite observé que l'homme, tantôt par ses seuls efforts, tantôt en faisant usage des forces que la nature lui fournit, tantôt en dirigeant la puissance de production qui est en elle, donne à la matière les qualités qui doivent s'y rencontrer pour satisfaire ses besoins, ou pour produire les divers objets qui lui sont nécessaires; nous avons désigné ces qualités données à la matière, par la puissance qu'elles ont de servir à notre usage, par le mot utilité ; nous avons désigné par le mot valeur l'estime d'une chose que l'on compare à une autre, contre laquelle elle peut être échangée.
Enfin, nous avons observé que si l'homme donne à la matière les qualités qu'elle doit avoir pour lui être utile, ce n'est que dans la vue d'en profiter ou d'assurer l'existence des membres de sa famille ou d'autres personnes auxquelles il s'intéresse ; que tout travail est pour lui une peine, et qu'il ne se soumet à une peine, que pour en éviter une autre qu'il juge plus grave, ou pour se procurer des plaisirs qui excèdent les maux par lesquels il les achète.
[II-232]
Les hommes ne mettent pas dans la classe des propriétés, seulement les choses dont ils ont créé l'utilité, ou celles qui leur ont été régulièrement transmises par les producteurs et qui doivent assurer leur existence; ils mettent dans le même rang les choses au moyen desquelles ils sont nés et se sont développés; celles dont ils ont long-temps et paisiblement joui à titre de propriétaires, sans contestation de la part de ceux qui auraient pu les leur disputer, en leur opposant des titres antérieurs à leur possession : c'est ainsi que les nations, même les plus barbares, se considèrent et sont considérées par toutes les autres, comme propriétaires des terres, des rivières, et même des parties de la mer au moyen desquelles elles ont toujours vécu, et sans lesquelles il leur serait impossible de continuer de vivre.
Il ne nous suffit donc pas, pour mettre une chose au rang des propriétés, d'y voir de la matière et des qualités propres, soit à satisfaire quelques-uns de nos besoins, soit à produire d'autres choses qui nous seraient utiles; il faut de plus que nous considérions cette chose dans les rapports qu'elle a, soit avec la personne qui l'a produite ou à qui elle a été régulièrement transmise par le producteur, soit avec la personne à laquelle elle a en quelque sorte donné la vie, et dont elle doit continuer l'existence; il faut que nous voyions dans l'individu [II-233] qui lui a donné les qualités qu'elle possède ou à qui le producteur l'a transmise, ou dans celui qu'elle a elle-même fait naître et dont elle a formé les habitudes, la puissance ou la faculté d'en jouir et d'en disposer exclusivement. Ce n'est, en effet, qu'en considérant les rapports qui existent entre certaines choses et certaines personnes, que nous donnons aux unes le nom de propriétés, et que nous désignons les autres par le mot propriétaires.
Former une propriété, c'est donner de l'utilité à une matière quelconque ; jouir d'une propriété, c'est retirer d'une chose l'utilité qui s'y trouve, la faire servir à la satisfaction de ses besoins ou de ses plaisirs; c'est en retirer les avantages qu'elle peut donner, quelle qu'en soit la nature. S'il s'agit de substances alimentaires, en jouir, c'est les consommer pour satisfaire nos goûts ou nos appétits; s'il s'agit de vêtemens, en jouir, c'est les employer à nous couvrir ou à nous parer; s'il s'agit d'une maison, en jouir, c'est en faire notre demeure ou en percevoir le loyer, quand on a jugé convenable de la louer; s'il s'agit d'une terre, c'est percevoir, par soi-même ou par les mains d'autrui, toutes les productions, tous les profits qu'elle donne.
Disposer d'une chose, c'est ou lui faire subir les modifications qu'on juge convenables, ou la transmettre à une autre personne pour qu'elle la conserve, en jouisse ou en dispose à son tour; un [II-234] propriétaire dispose de sa maison s'il la fait démolir, comme il en dispose quand il la loue, quand il la vend ou quand il la donne; il dispose de sa terre, s'il la convertit en une forêt ou en un pâturage, comme il en dispose s'il l'échange contre un hôtel ou contre une somme d'argent.
Pour donner des idées complètes des diverses manières dont on peut disposer d'une propriété en la modifiant, il faudrait entreprendre un traité qui n'aurait point de fin, et qui serait sans utilité, du moins pour l'objet de cet ouvrage. Il faudrait également entreprendre un travail fort étendu si l'on voulait exposer, d'une manière complète, comment une propriété peut être transmise d'une personne à une autre.. Il serait nécessaire, en effet, de traiter des successions, des testamens, des donations, de la vente, de l'échange, du prêt, du dépôt et de beaucoup d'autres contrats. Les règles relatives à la transmission des propriétés, forment chez toutes les nations policées, une partie très-considérable de leurs lois civiles.
Le moyen le plus simple de faire connaître le pouvoir qu'un propriétaire peut exercer sur sa propriété, est de chercher à déterminer les limites mises à ce pouvoir par la nature des choses ou par la nature de l'homme. Si ces limites étaient une fois bien déterminées, chacun connaîtrait, par cela même, en quoi consiste la puissance d'un [II-235] propriétaire sur les choses qui sont à lui. On saurait qu'il peut tout, moins ce qui lui est positivement interdit.
Il arrive rarement que le pouvoir d'un propriétaire n'ait pas d'autres limites que celles qui lui sont données par la nature des choses ou par la nature de l'homme. Chez la plupart des nations, l'autorité publique a donné des bornes plus ou moins arbitraires à la faculté de jouir et de disposer de certaines propriétés. Ces bornes, mises au pouvoir de l'homme sur la chose qui est à lui, ne sont pas toutes également funestes; mais il en est plusieurs qui sont de véritables obstacles aux progrès de la civilisation.
La qualité de propriétaire n'est subordonnée ni à l'âge, ni à la capacité d'une personne; un enfant, en venant au monde, ou même du moment qu'il est conçu, peut avoir des propriétés; un homme tombé en démence, peut en avoir également, quoiqu'il soit d'une incapacité telle qu'on soit obligé de l'enfermer. Quand de tels cas se rencontrent, on ne laisse ni à l'enfant, ni à l'insensé, l'administration de ses biens; l'un et l'autre cependant en ont la jouissance, dans le sens légal de ce mot; c'est-à-dire que leurs propriétés sont administrées pour leur compte, et que les produits sont employés à satisfaire leurs besoins. La faculté d'en disposer est suspendue jusqu'au moment où ils [II-236] peuvent agir avec une entière liberté et avec connaissance de cause.
Il existe cependant une grande différence entre la jouissance d'une personne complétement développée et douée de raison, et la jouissance d'un enfant ou d'un individu dont les facultés intellectuelles se sont évanouies. Une personne dont toutes les facultés physiques et morales sont développées détermine elle-même quelle est la portion de ses biens qu'elle veut appliquer à la satisfaction de tel ou tel de ses besoins. Elle peut jouir de ses propriétés de manière à en absorber la valeur en peu d'années, ou de manière à les augmenter plus ou moins rapidement, en tenant ses consommations au-dessous de ses revenus. Un enfant ou un individu privé de raison, n'est pas juge de la manière dont il doit jouir de ses biens, ni de la part qu'il doit en consommer pour ses besoins.
Les agrégations de personnes que les Anglais nomment corporations, ont presque toujours des propriétés, et la manière dont elles peuvent en jouir est nécessairement déterminée par des lois particulières. Une compagnie, une commune, un département, une nation considérés comme corps, sont toujours propriétaires ; car ce n'est que pour jouir en commun de certains biens, qu'elles sont généralement formées. Mais il est clair que chacun des membres dont ces corps sont composés, ne peut [II-237] pas avoir la faculté d'appliquer à la satisfaction de ses besoins individuels, les choses qui sont la propriété de tous. Il faut que chacun de ces corps soit organisé de manière que quelques-uns de ses membres aient l'administration des biens communs et les appliquent à des besoins généraux, ou distribuent à chacun de ses membres la part qui lui revient dans les produits, toutes les fois qu'une part peut, en effet, être distribuée.
La faculté de disposer, comme la faculté de jouir, est limitée par l'incapacité du propriétaire ou par les circonstances au milieu desquelles il est placé.
Cette faculté est suspendue chez les enfans et chez les individus qui sont privés de l'usage de la raison. Les peuples qui ont le mieux garanti les propriétés, ont interdit la disposition de leurs biens aux personnes qui n'auraient pas atteint un certain âge. Tous ont admis qu'il ne peut pas y avoir d'aliénation sans consentement, et que le consentement n'est valable que lorsqu'il est donné avec connaissance de cause. Dans plusieurs pays, en France, par exemple, les femmes placées sous la protection maritale n'ont pas, dans certaines circonstances, la libre disposition de leurs biens. La qualité de propriétaire ne suppose donc pas toujours et nécessairement la puissance ou la faculté actuelle de disposer des choses dont on a la propriété.
[II-238]
Un corps politique, tel qu'une commune ou une nation, ne dispose pas de ses propriétés avec la même facilité qu'un particulier dispose des siennes. Il y a toujours, dans un corps, un nombre plus ou moins grand de personnes, dont les droits sont égaux à ceux des autres, mais qui n'ont pas la même capacité pour défendre leurs intérêts. On est donc obligé de soumettre la jouissance et la disposition de biens communs à des règles qui garantissent à chacun ses intérêts et ses droits particuliers.
Nous n'avons à nous occuper ici que des choses considérées dans les rapports qu'elles ont avec les personnes; nous ne devons donc nous occcuper des limites mises à la faculté d'en jouir et d'en disposer, qu'autant que ces limites tiennent à la nature des choses. Quant à celles qui tiennent à la nature de l'homme, il sera temps de nous en occuper, lorsque nous aurons à traiter des personnes considérées d'une manière individuelle ou collective.
Il est, ainsi qu'on l'a déjà vu, des choses qui peuvent être considérées comme la propriété commune du genre humain, parce qu'elles sont nécessaires à l'existence de tous les hommes et qu'elles nous sont données sans mesure: telles sont la lumière des astres, l'air atmosphérique, la chaleur du soleil, l'eau de la mer; il en est d'autres qui [II-239] sont la propriété commune de tous les membres dont une nation se compose, telles que des grandes routes, des fleuves, des ports de mer, des arsenaux et d'autres établissemens publics; il en est qui appartiennent à des fractions plus ou moins considérables d'un peuple, comme à des communes, à des cantons, à des départemens; il en est enfin qui appartiennent à des familles ou à des individus, et celles-ci sont toujours les plus considérables chez un peuple civilisé.
Ainsi, toute personne, outre la faculté qu'elle a de jouir et de disposer de ses biens particuliers, a, de plus, comme membre d'une commune, la faculté de jouir des biens communs dans la même mesure que les autres habitans; comme membre d'un département ou d'une province, elle doit jouir des propriétés départementales ou provinciales; comme membre de l'État, elle a droit à la jouissance des propriétés nationales; enfin, en sa qualité d'être humain, elle a droit à la jouissance des biens que la nature a donnés à tous les hommes.
Si maintenant nous voulons indiquer d'une manière générale les limites mises, par la nature même des choses, à la jouissance et à la disposition de toute propriété individuelle, il nous suffira de dire que le propriétaire peut en faire tout ce qu'il juge convenable, pourvu qu'il ne s'en serve pas pour porter atteinte à la sûreté des personnes, ou à [II-240] la faculté qui appartient à chacun, soit de jouir et de disposer de ses biens particuliers, soit de faire usage, dans la mesure de ses droits, des biens qui appartiennent à sa commune, à son département, à sa nation ou à l'humanité tout entière.
Toute propriété, quelle qu'en soit la nature, est limitée par d'autres propriétés. Il n'est pas un champ, pas une vigne, pas une forêt, pas une maison, qui ne touchent à d'autres champs, à d'autres vignes, à d'autres forêts, à d'autres maisons. Si une propriété individuelle n'est pas bornée de tous côtés par d'autres propriétés individuelles, elle l'est par des propriétés qui appartiennent à des corps collectifs. Elle a, par exemple, pour limites, une route, une rivière, un fleuve, qui sont aussi des propriétés pour les nations qui les possèdent. Enfin, tous les biens, qu'ils soient meubles ou immeubles, sont plongés dans l'atmosphère que nous respirons, et que nous avons considérée comme la propriété commune du genre humain.
Les droits que tous les propriétaires ont sur leurs propriétés, étant égaux entre eux, sont limités les uns par les autres. Je puis donc faire sur une terre qui m'appartient les plantations, les constructions, les fouilles que je juge convenables; mais je ne puis rien y faire qui nuise au droit que d'autres ont de jouir et de disposer de leurs [II-241] propriétés. Je ne pourrais pas, par exemple, m'y livrer à un genre de culture, y établir des fabrications, ou y déposer des matières qui vicieraient l'air du voisinage. Il n'est pas plus licite, en effet, à une personne d'infecter l'air que d'autres ont le droit de respirer, ou de le vicier par des matières qui blesseraient l'organe de la vue, que de jeter du poison dans leurs alimens. Le besoin qu'ont les hommes de respirer et de voir est aussi impérieux que le besoin de se nourrir [82].
S'il n'est pas permis à une personne de faire usage de sa propriété pour porter atteinte au droit qu'ont tous les hommes de jouir des choses qui sont la propriété commune du genre humain, il ne lui est pas permis non plus de s'en servir pour porter atteinte aux propriétés qui appartiennent à une nation, à une province, à une commune. Ainsi, nul ne peut faire usage d'une chose qui est à lui, pour dégrader une route, une rivière, un fleuve, ou pour en gêner l'usage. Les choses qui appartiennent à des agrégations de personnes, ne sont ni moins précieuses, ni moins dignes d'être respectées que [II-242] celles qui appartiennent à des particuliers. Celles-ci n'ont souvent de valeur ou d'utilité que par l'existence de celles-là; quel parti pourrait-on tirer d'une terre, si l'on n'avait, pour y arriver ou pour en sortir, ni routes, ni fleuves?
Il faut donc bien se garder de considérer comme portant atteinte aux propriétés privées, les actes de l'autorité publique, qui tendent à garantir à chacun des membres d'une commune, d'un département, d'une nation d'une nation, la libre jouissance des choses qui appartiennent au corps entier. Le soin qu'on prend pour mettre à l'abri de toute atteinte les propriétés qui appartiennent à tous les hommes, ou à des fractions plus ou moins considérables du public, est au contraire ce qui distingue un peuple policé d'un peuple qui ne l'est pas. Dans les pays non policés, comme ceux qui sont soumis à l'empire turc, personne ne veille à la conservation des propriétés communes ou publiques; chacun y porte impunément atteinte: aussi tout y dépérit, même les propriétés particulières.
Chez une nation civilisée, la masse des propriétés privées est toujours beaucoup plus considérable que la masse des propriétés communales, provinciales ou nationales. Le droit qu'a chaque particulier de jouir et de disposer de sa propriété, se trouve donc limité par le droit qu'ont tous les autres de jouir et de disposer des choses qui leur [II-243] appartiennent. Les lois et la jurisprudence de chaque pays déterminent la limite de tous ces droits. Quelques exemples suffiront pour rendre ces observations plus claires.
Tout propriétaire peut faire sur son fonds les plantations qu'il juge utiles à ses intérêts; mais il est évident que celui qui planterait des arbres de haute tige sur les limites de sa propriété, empiéterait par cela même sur les propriétés de ses voisins; les racines et les branches de ses arbres s'étendraient sur des terres qui ne seraient point à lui, et les frapperaient de stérilité. C'est donc pour empêcher qu'en jouissant ou en disposant de ses biens, un individu n'attente aux propriétés voisines, que les lois de tous les peuples déterminent l'espace au-delà duquel il n'est pas permis de planter des arbres de haute tige. Suivant notre Code civil, par exemple, il n'est permis de planter des arbres de cette nature qu'à la distance prescrite par les réglemens qui existaient au 10 février 1804, ou par les usages constans et reconnus; et, à défaut de réglemens et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages; la distance n'est que d'un demi-mètre pour les autres arbres et pour les haies vives. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés, et que les branches qui s'avancent sur son fonds, soient coupées; il peut lui-même [II-244] couper les racines qui empiètent sur sa propriété. Quant aux arbres qui se trouvent dans une haie mitoyenne, ils sont considérés comme mitoyens, et chacun des deux propriétaires a le droit de requérir qu'ils soient abattus [83].
On peut nuire à une propriété voisine par certaines constructions ou par certains établissemens, comme par des plantations; aussi le propriétaire qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non; celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, y adosser une étable ou y établir un magasin de matières corrosives, est-il obligé à laisser une certaine distance, ou à faire certains ouvrages pour éviter de nuire au voisin; la distance ou les ouvrages prescrits sont déterminés par des règlemens de police ou par des usages particuliers [84].
Le propriétaire d'un mur joignant immédiatement l'héritage d'autrui, ne peut établir des vues sur cet héritage, sans l'autorisation de celui auquel il appartient. Il ne peut y pratiquer des fenêtres qu'en se soumettant à certaines conditions qui le privent de la vue sur la propriété de son voisin, sans le priver de la lumière. Suivant le Code civil, [II-245] un propriétaire ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres saillies semblables sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres (six pieds de distance) entre le mur où on les pratique et ledit héritage [85].
Le propriétaire d'un fonds de terre peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux droits que d'autres possèdent; il peut, sous la même condition, faire au-dessous toutes les fouilles qu'il juge utiles, et tirer de ces fouilles les produits qu'elles peuvent fournir [86].
La faculté de jouir et de disposer d'une chose est un élément tellement essentiel de la propriété, que, si elle venait à disparaître irrévocablement, la propriété n'existerait plus. Qu'un homme laisse tomber au milieu de la mer l'objet le plus précieux, et que tout moyen de le recouvrer lui soit à jamais ravi, et il ne sera plus considéré comme en ayant la propriété. Il en serait de même du négociant [II-246] qui verrait un de ses navires enlevé par : des corsaires perdre sans retour la puissance de jouir et de disposer d'une chose, c'est, en effet, en perdre la propriété.
[II-247]
CHAPITRE XXXIX.
De quelques lois particulières sur la jouissance et la disposition des propriétés, et sur la liberté d'industrie.↩
DANS presque tous les pays, on a donné des limites plus ou moins arbitraires à la faculté de jouir et de disposer des propriétés, et particulièrement de celles qui consistent en fonds de terre. Plusieurs de ces restrictions, nées sous le régime féodal, ont eu généralement pour objet de perpétuer la prééminence, dans la société, d'un certain nombre de familles privilégiées. Un grand nombre ont eu pour but ou pour prétexte de favoriser le développement de certaines productions, aux dépens de quelques autres. L'agriculture, comme les manufactures et le commerce, a eu son régime réglementaire, quoiqu'il n'ait pas été porté aussi loin; on a quelquefois interdit un certain genre de culture, afin d'en favoriser d'autres.
Il y a deux manières principales de disposer d'une propriété : une personne dispose de ses biens quand elle les transmet à une autre à titre de prêt, de vente, d'échange, de donation; elle en dispose [II-248] encore, quand elle se borne à leur faire subir les modifications qui lui sont commandées par ses intérêts, par ses goûts ou même par ses caprices; quand elle convertit une forêt en terres de labour, ou qu'elle détruit un bâtiment pour jouir d'une vue plus étendue.
Il ne s'agit point ici des dispositions du premier genre; la faculté de disposer de ses propriétés par des aliénations, touche de si près aux intérêts et aux besoins des familles, et à toutes les questions relatives à la population, qu'il serait impossible d'en parler convenablement, avant que d'avoir traité des personnes et des rapports naturels qui existent entre elles. Les dispositions de propriété dont il est question dans ce chapitre, sont celles qui consistent dans les diverses modifications que chacun peut faire subir aux choses qui lui appartiennent, et dans les diverses manières d'en jouir.
J'ai déjà fait observer qu'il existe entre les propriétés et les propriétaires des rapports tellement intimes, qu'il est impossible de toucher aux unes sans atteindre les autres. On ne peut exercer un art, se livrer à un commerce, qu'en agissant sur des choses qui sont des propriétés; une loi qui interdit, par exemple, la culture de la vigne ou du tabac, semble n'affecter que les propriétés; mais elle affecte en même temps une classe plus ou moins nombreuse de personnes ; elle leur interdit l'exercise [II-249] d'une industrie. Une loi qui défend l'exercice de la profession d'imprimeur, paraît d'abord n'atteindre que les personnes ; mais elle affecte aussi les propriétés; elle empêche qu'elles ne deviennent le matériel d'une imprimerie. En interdisant aux hommes l'exercice innocent de leurs facultés, on les dépouillerait de leurs biens, car les choses n'ont de valeur que par l'action que nous exerçons sur elles. De même, en frappant toutes les propriétés d'interdiction, l'on condamnerait les hommes à mort, puisqu'ils ne peuvent se conserver que par elles. Il suit de là que toutes les lois qui affectent l'industrie, soit qu'elles lui donnent des entraves, soit qu'elles la rendent libre, affectent de la même manière les propriétés.
La liberté de disposer de ses propriétés et de se livrer à toute espèce d'industrie et de commerce, n'a été reconnue en France qu'après l'abolition du régime féodal. Par une loi du 2 mars 1791 [87], l'Assemblée constituante supprima les maîtrises, jurandes et tous les priviléges de profession, quelle qu'en fût la dénomination. Elle déclara, en conséquence, que toute personne était libre de faire tel négoce, de se livrer à telle profession, ou d'exercer tel métier qu'elle trouverait bon. Elle n'imposa pas d'autres conditions aux personnes qui [II-250] voudraient profiter de cette liberté, que de se pourvoir d'une patente, c'est-à-dire de se soumettre au paiement d'un certain impôt. Du moment que cette loi fut devenue exécutoire, chacun eut donc la faculté d'engager ses propriétés dans telle branche d'industrie ou de commerce qu'il jugea devoir lui profiter.
L'Assemblée constituante crut n'avoir pas assez fait en abolissant les priviléges, et en rendant à chacun la faculté de disposer de ses biens, et d'exercer son industrie, de la manière la plus conforme à ses intérêts. Elle voulut prévenir le retour des abus qu'elle venait de supprimer, en empêchant les anciens privilégiés de se coaliser entre eux contre le public, et de rétablir, en fait, des monopoles qui ne pouvaient plus exister légalement. Par une seconde loi du 14 juin de la même année, sanctionnée le 17 du même mois, elle déclara que l'anéantissement de toutes les espèces de corporations de citoyens du même état et profession étant une des bases fondamentales de la constitution française, il était défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce fût.
Il fut, en conséquence, interdit aux citoyens d'un même état ou profession, aux entrepreneurs, à ceux qui avaient boutique ouverte, aux ouvriers et compagnons d'un art quelconque, de nommer, lorsqu'ils se trouveraient ensemble, ni présidens, [II-251] ni secrétaires, ni syndics, de tenir des registres, de prendre des arrêtés ou délibérations, et de former des réglemens, pour leurs prétendus intérêts communs. Il fut, de plus, interdit à tous corps administratifs ou municipaux de recevoir aucune adresse ou pétition sous la dénomination d'un état ou profession, et d'y faire aucune réponse. Il leur fut enjoint, en même temps, de déclarer nulles les délibérations qui pourraient être prises de cette manière, et de veiller à ce qu'il ne leur fût donné aucune suite ni exécution.
Si, contre les principes de la liberté et de la constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations ou faisaient entre eux des conventions tendantes à refuser de concert ou à n'accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, ces délibérations et conventions, accompagnées ou non du serment, étaient déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté, et à la déclaration des droits de l'homme; les auteurs et instigateurs qui les avaient provoquées, rédigées ou présidées, devaient être condamnés chacun à une amende de cinq cents francs, et suspendus pendant un pendant un an de l'exercice de tous droits de citoyen actif, et de l'entrée des assemblées primaires.
Si les délibérations ou convocations, affiches, lettres, circulaires, contenaient quelques menaces [II-252] contre les entrepreneurs, artisans, ouvriers ou journaliers étrangers qui viendraient travailler dans le lieu, ou contre ceux qui se contenteraient d'un salaire inférieur, tous auteurs, instigateurs et signataires des actes ou écrits, étaient punissables d'une amende de mille francs chacun, et de trois mois de prison; quant à ceux qui feraient usage de menaces ou de violences contre les ouvriers usant de la liberté accordée, par les lois constitutionnelles, au travail et à l'industrie, ils devaient être poursuivis par la voie criminelle, et punis comme perturbateurs du repos public.
Tous attroupemens composés d'artisans, ouvriers, compagnons, journaliers, ou excités par eux contre le libre exercice de l'industrie et du travail, appartenant à toutes sortes de personnes, et sous toute espèce de conditions convenues de gré à gré, ou contre l'action de la police et l'exécution des jugemens rendus en cette matière, ainsi que contre les enchères et adjudications publiques, étaient considérés comme attroupemens séditieux, et comme tels devaient être dissipés par la force publique, sur les réquisitions légales qui leur étaient faites, et punis, sur les auteurs, instigateurs et chefs, selon toute la rigueur des lois.
Enfin, il fut interdit à tous corps administratifs et municipaux d'employer, admettre ou souffrir qu'on admît aux ouvrages de leurs professions, [II-253] dans aucuns travaux publics, ceux des entrepreneurs, ouvriers et compagnons qui provoqueraient ou signeraient les délibérations ou conventions prohibées par la loi, si ce n'est dans le cas où, de leur propre mouvement, ils se seraient présentés au greffe du tribunal de police pour se rétracter.
L'Assemblée constituante ayant garanti à chacun la libre disposition de ses propriétés mobilières, et, par conséquent, la faculté de les engager dans telle entreprise industrielle ou commerciale qu'il jugerait utile à ses intérêts, fit des dispositions semblables pour les propriétés immobilières. Par la loi du 5 juin 1791 [88], elle déclara le territoire de la France, dans toute son étendue, libre comme les personnes qui l'habitent. Ainsi, dit-elle, toute propriété territoriale ne peut être sujette, envers les particuliers, qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est pas défendue par la loi, et envers la nation, qu'aux contributions publiques établies par la puissance législative, et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Suivant la même loi, les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré les récoltes, [II-254] et de disposer, à leur gré, de toutes les productions de leurs propriétés, dans l'intérieur du royaume et au-dehors, sans préjudicier aux droits d'autrui, et en se conformant aux lois.
Nul agent de l'agriculture ne peut être arrêté dans ses fonctions agricoles extérieures, excepté pour crime, avant qu'il ait été pourvu à la sûreté des bestiaux servant à son travail ou confiés à sa garde; et même, en cas de crime, il doit être pourvu à la sûreté des bestiaux immédiatement après l'arrestation, et sous la responsabilité de ceux qui l'ont exécutée.
Aucuns engrais, meubles ou ustensiles de l'exploitation des terres, et aucuns des bestiaux servant au labourage ne peuvent être saisis ni vendus pour cause de dettes, si ce n'est par la personne qui a fourni les ustensiles ou bestiaux, ou pour l'acquittement de la créance du propriétaire vis-à-vis de son fermier, et seulement en cas d'insuffisance d'autres objets mobiliers.
Enfin, nulle autorité ne peut suspendre ou intervertir les travaux de la campagne dans les opérations de la semence et de la récolte.
Les auteurs de la constitution du 3 septembre 1791, avaient cru que, pour prévenir le rétablissement des monopoles ou des priviléges, et assurer ainsi à toute personne la faculté d'employer ses [II-255] biens à l'exercice de telle industrie ou de tel commerce qu'elle jugerait profitable, il suffisait de garantir à chacun la disposition de ses propriétés; les auteurs de la constitution du 5 fructidor an 3, pensèrent qu'une telle disposition était insuffisante, et qu'il fallait proscrire, en termes formels, le retour de tout monopole.
Dans la déclaration des droits, ils définirent la propriété : « Le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. » Par l'article 355, ils déclarèrent qu'il n'y avait ni privilége, ni maîtrise, ni jurande, ni limitation à la liberté de la presse, du commerce, et à l'exercice de l'industrie et des arts de toute espèce.
«Toute loi prohibitive en ce genre, ajoute le même article, quand les circonstances la rendent nécessaire, est essentiellement provisoire, et n'a d'effet que pendant un an au plus, à moins qu'elle ne soit formellement renouvelée. »
La faculté de disposer de ses biens, de les engager dans toutes sortes d'entreprises industrielles, ou de leur faire éprouver les modifications qu'on jugerait avantageuses, fut encore implicitement reconnue par le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (25 octobre 1799), qui déclara qu'aucun acte, aucune omission ne serait réputée délit, s'il n'y avait contravention à une loi promulguée antérieurement, et que nul délit ne pourrait [II-256] être puni de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'il fût commis.
Ces dernières dispositions ont été textuellement reproduites dans le Code des délits et des peines de 1810, de sorte que, suivant les lois, nul ne devrait être puni pour avoir disposé de ses propriétés d'une manière conforme à ses intérêts, si d'ailleurs personne n'avait été lésé dans ses droits.
Depuis le commencement de la révolution jusqu'au renversement du gouvernement représentatif par la force armée, la constitution et les lois ont donc eu pour objet d'assurer à chacun le libre emploi de ses propriétés; mais, après l'établissement de l'empire, un grand nombre de décrets arbitraires ont rétabli une partie des monopoles ou des priviléges que l'Assemblée constituante avait abolis, et dont la Convention nationale avait voulu prévenir le retour, et il n'a plus été permis de consacrer ses propriétés à l'exploitation de certaines branches d'industrie ou de commerce [89].
Les monopoles établis arbitrairement par des décrets impériaux ont été soigneusement conservés [II-257] par la restauration, et le gouvernement qui lui a succédé ne les a point abolis. Si les divers gouvernemens qui ont existé depuis 1800, n'ont pas toujours montré beaucoup de respect pour les lois et pour les propriétés, il est juste de dire qu'ils ont été peu contrariés par les mœurs de la population. Hors quelques rares circonstances, les citoyens et leurs mandataires se sont résignés à l'arbitraire avec tant de facilité, qu'il aurait fallu, dans un gouvernement, pour s'en interdire l'usage, une prévoyance, un désintéressement et des lumières qu'on rencontre rarement dans les hommes qui ambitionnent l'exercice du pouvoir.
N'ayant pas à faire connaître, dans ce moment, les divers attentats dont les propriétés peuvent être l'objet, soit de la part des gouvernemens, soit de la part des particuliers, je n'ai pas à m'occuper des divers monopoles au moyen desquels les citoyens ont été dépouillés de la faculté d'employer leurs biens dans certaines branches de commerce ou d'industrie; il me suffit de faire observer que, partout où des monopoles existent, les propriétaires n'ont pas la libre disposition de leurs propriétés.
Il est si évident, en effet, que l'établissement de tout monopole est une atteinte à la propriété, que, pour rendre la plupart des terres et des capitaux sans valeur, il suffirait de multiplier les [II-258] priviléges jusqu'à l'excès. Que feraient les propriétaires de leurs biens, sous un gouvernement qui réduirait successivement en monopoles, au profit d'un certain nombre de privilégiés, toutes les branches de l'industrie et du commerce, et jusqu'à la culture des terres?
[II-259]
CHAPITRE XL.
De la garantie des propriétés en général, et particulièrement contre les atteintes de l'extérieur.↩
EN recherchant comment se forment les choses auxquelles nous donnons le nom de propriétés, nous avons vu qu'en général on ne les crée qu'en s'emparant de certaines matières qu'on peut s'approprier sans porter atteinte aux moyens d'existence d'autres personnes; nous avons ensuite observé que l'industrie humaine, tantôt par ses seuls efforts, et tantôt en mettant à profit la puissance des lois de la nature, donne à ces matières les - qualités que nous avons besoin d'y trouver pour nous en servir ; nous avons vu, en outre, que chez les peuples très-avancés dans la civilisation, un nombre plus ou moins grand de personnes donnent de la valeur non-seulement à des objets matériels, mais encore à des établissemens d'industrie ou de commune, à des productions de l'esprit, et même à de simples signes; nous avons remarqué, de plus, que les choses qui sont le fondement de notre existence et que nous appelons des propriétés [II-260] ne reçoivent cette dénomination qu'autant qu'elles sont considérées dans leurs rapports avec les personnes dont elles doivent satisfaire les besoins et qui les ont produites ou légitimement acquises; enfin, nous avons vu qu'une des conditions de toute propriété est la puissance ou la faculté dans l'individu que nous appelons propriétaire, de jouir et de disposer de la chose qui lui appartient.
Il nous reste maintenant à observer comment la faculté de jouir et de disposer des choses que nous appelons des propriétés, est assurée aux personnes qui les ont formées ou légitimement acquises; nous avons à examiner quelle est la nature de cette garantie, d'où elle dérive, jusqu'où elle s'étend, et quels sont les sacrifices aux prix desquels on l'obtient; nous verrons ensuite quelle est l'influence qu'elle exerce sur l'accroissement, la conservation et la valeur des propriétés.
Garantir à une ou à plusieurs personnes la jouissance et la disposition d'une chose, ce n'est pas leur donner la faculté physique d'en jouir et d'en disposer; c'est tout simplement empêcher que poser; d'autres personnes ne portent atteinte ou ne mettent obstacle à l'exercice de cette faculté. Ainsi, donner aux propriétés des garanties, c'est établir ou organiser des forces qui s'opposent à ce qu'un ou plusieurs individus s'attribuent des choses qui appartiennent à d'autres, ou les privent de la faculté [II-261] d'en jouir ou d'en disposer. Toute garantie des propriétés est donc une puissance qui prévient ou réprime le vol, les extorsions, le pillage, en un mot, toutes les spoliations, quelle qu'en soit la nature. La faculté qu'ont certaines personnes de jouir ou de disposer des choses qu'elles ont formées ou qui leur ont été régulièrement transmises, ne peut, en effet, être arrêtée ou suspendue que par l'effet de leur volonté ou par une force qui leur est étrangère; et l'on n'arrête une force, que par une force égale ou supérieure.
Mais où trouver cette puissance qui protége toute personne ou toute agrégration de personnes dans la jouissance et la disposition de leurs biens; qui soit assez grande pour contenir ou réprimer tous les individus disposés à s'emparer de la propriété d'autrui, et qui cependant ne puisse jamais devenir un moyen de spoliation? On ne peut la trouver que dans les lumières, les mœurs, l'union, l'organisation et la force de tous les propriétaires; elle n'est efficace et sûre que lorsqu'elle vient de là. Une puissance qui vient d'ailleurs, peut bien quelquefois prévenir ou réprimer les spoliations qui ne lui profitent pas ou qui lui sont dommageables; mais tôt ou tard elle devient un moyen d'extorsion entre les mains de ceux qui la possèdent.
Lorsqu'on étudie l'origine des propriétés et qu'on en suit le développement, on observe que les [II-262] populations s'accroissent à mesure que la masse des propriétés augmente: les hommes créent d'abord des propriétés, et les propriétés font naître ensuite de nouveaux hommes. Nous n'existons donc qu'au moyen de nos biens, et le même principe qui nous pousse à défendre notre existence, nous porte à défendre les choses qui la soutiennent. Telle est la vraie et je puis même dire l'unique source de la garantie que nous avons à observer.
Il n'y a qu'un moyen de savoir si toutes les propriétés qui existent chez une nation, sont garanties; c'est de rechercher quelles sont les diverses atteintes auxquelles elles sont exposées, et d'examiner s'il existe une puissance qui les mette à l'abri de chacun des dangers qu'elles ont à courir.
En considérant les propriétés dans les rapports qu'elles ont avec ceux dont elles doivent satisfaire les besoins, on peut les diviser en trois grandes classes: il en est qui sont destinées à satisfaire certains besoins nationaux, à assurer la défense du pays, à faciliter des communications, par exemple; il en est d'autres qui sont destinées à satisfaire les besoins d'associations moins considérables, telles que des communes, des départemens, des provinces; il en est d'autres enfin qui ne sont destinées qu'à satisfaire des besoins individuels ou des besoins de famille.
Quand on considère les nations les unes à [II-263] l'égard des autres, on observe que chacune d'elles a un territoire qui lui est propre, et que ce territoire renferme toutes les propriétés qui appartiennent à des individus, à des communes ou à d'autres agrégations plus ou moins nombreuses. Si l'on considère ensuite chaque nation relativement aux diverses fractions entre lesquelles elle se divise, on voit qu'elle a, dans le territoire national, des propriétés particulières dont l'objet est de satisfaire un certain genre de besoins généraux, tels que les besoins de sûreté, de justice, de communications. Les nations, considérées comme des corps organisés, ne sont pas propriétaires seulement des fleuves, des canaux, des routes qui traversent leur territoire ; elles ont toujours des biens qui sont de la même nature que ceux des particuliers. Plusieurs possèdent des forêts, des fermes, des établissemens industriels; toutes ont un trésor qu'alimentent les contributions publiques, et sans lequel elles ne sauraient subsister.
Si nous reconnaissons que, pour une nation comme pour un particulier, la faculté de jouir et de disposer est un des élémens essentiels de la propriété, nous admettrons qu'il y a atteinte à une propriété nationale, toutes les fois qu'une chose appartenant à un peuple, est détournée, sans l'aveu des propriétaires, de sa destination naturelle et appliquée à satisfaire des besoins autres que ceux [II-264] du peuple à qui elle appartient; peu importe d'ailleurs qu'elle ait été détournée ou ravie par une armée ou par un seul homme, par un étranger on par un membre de l'État, par un agent de l'autorité publique ou par un simple particulier; le nombre ni la qualité des personnes ne changent rien à la nature de l'action.
Nous n'avons pas à nous occuper ici des dommages causés à la propriété par des accidens indépendans de la volonté des hommes. Une propriété peut périr ou être endommagée par un naufrage, par une inondation, ou par le feu du ciel, comme par l'invasion d'une armée, ou par l'irruption d'une troupe de brigands. On peut établir des garanties contre les calamités qui viennent de la nature, comme on en établit contre celles qui viennent de la perversité des hommes. Les dernières sont les seules dont il soit ici question.
Les propriétés d'une nation peuvent être attaquées par trois classes de personnes, par des ennemis extérieurs, par les membres même du gouvernement, auxquels la garde et l'administration en sont confiées, et par de simples particuliers; il faut donc qu'il existe des garanties contre ces trois classes de personnes, c'est-à-dire des forces capables de prévenir ou de réprimer leurs attentats.
Il est des nations dont le territoire est en partie garanti contre l'invasion, par les circonstances [II-265] physiques au milieu desquelles il est placé, par de hautes montagnes, par des mers, et quelquefois par de vastes déserts. Nous n'avons pas à nous occuper des garanties de ce genre; les peuples qui en sont privés, n'ont qu'un moyen de les obtenir ; c'est de s'unir à ceux de leurs voisins qui les possèdent, pour ne faire qu'une nation. Nous n'avons à traiter que des garanties que les peuples trouvent en eux-mêmes, contre les agressions dont ils peuvent être l'objet.
Les forces qui peuvent porter atteinte à nos propriétés, et contre lesquelles nous cherchons des garanties, se trouvent dans des hommes, et pour les contenir ou les réprimer, il faut d'autres forces qui ne peuvent également se trouver que dans des hommes. S'il s'agit, par exemple, de garantir le territoire d'une nation contre l'invasion d'une armée étrangère, il est clair qu'on ne peut trouver une garantie que dans l'existence d'une autre armée. S'il s'agit de les mettre à l'abri des entreprises des malfaiteurs de l'intérieur, il faut charger d'autres hommes de les arrêter ou de les punir.
La plus grande difficulté qui se présente, toutes les fois qu'il est question de garanties sociales, n'est pas de trouver une force qui soit un obstacle à l'invasion, ou qui réprime les atteintes portées aux propriétés par de simples particuliers; c'est de trouver une garantie contre l'abus des forces qu'on [II-266] a organisées, soit pour défendre l'indépendance nationale, soit pour réprimer les malfaiteurs de l'intérieur? Quelle sera la puissance qui nous garantira des fraudes, des extorsions, des concussions, des violences de nos garans ? La solution de ce problème est fort difficile; je ne craindrai même pas de dire qu'elle est impossible, chez tout peuple dont les mœurs, l'intelligence et l'industrie n'ont pas fait de grands progrès.
Une nation chez laquelle il existe encore beaucoup de restes de barbarie, ne peut faire que de vains efforts pour établir des garanties ; quand elle a organisé une force ou créé une magistrature, pour prévenir ou réprimer certaines spoliations, il faut qu'elle songe à se mettre à l'abri des attentats de cette force ou de cette magistrature; aussitôt qu'elle a organisé et armé des défenseurs, il faut qu'elle cherche à se garantir de leurs entreprises.
Il n'est pas de constitution, quelque parfaite qu'on la suppose, qui puisse faire sortir de ce cercle un peuple lâche, ignorant ou corrompu. Quelques publicistes ont paru croire que la monarchie constitutionnelle avait donné la solution du problème ; c'est une erreur. Qu'on soumette à telle constitution qu'on voudra, un peuple dont une partie considérable aspire à vivre sur le produit du travail d'autrui, et dont l'autre est façonnée [II-267] à l'oppression; qu'on lui donne deux chambres, un roi inviolable, des ministres responsables, et tout ce qui compose un gouvernement constitutionnel; quand tout cela existera, les législateurs, les ministres, le roi et leurs agens emploieront leur pouvoir à satisfaire leurs appétits. S'ils avaient le désir ou l'habitude de s'enrichir aux dépens d'autrui, chacun d'eux fera servir la part d'autorité qui lui sera dévolue, à vivre aux dépens du public; et si quelques-uns des hommes auparavant asservis, arrivent au pouvoir, ils ne seront pas les derniers à faire leur main.
Il ne saurait donc exister de véritables garanties, qu'on ne l'oublie jamais, soit contre les dangers de l'extérieur, soit contre les dangers de l'intérieur, que là où les hommes sont très-avancés dans la civilisation, là où les mœurs sont bonnes, où les esprits sont éclairés, où les familles les plus influentes ont l'habitude de vivre, non d'extorsions plus ou moins déguisées, mais des produits de leur industrie ou de leurs propriétés ; dans les pays enfin où toutes les classes de la société se respectent et savent se faire respecter [90].
Cela étant entendu, il sera facile de comprendre [II-268] quelles sont les circonstances dans lesquelles les propriétés nationales, communales et individuelles, manquent de garanties, et quels sont les moyens à l'aide desquels les propriétaires s'en assurent la jouissance et la disposition.
La garantie du territoire national et de toutes les propriétés qu'il renferme, contre les attaques de l'intérieur, se compose de deux choses: d'une bonne organisation politique et d'une bonne organisation militaire. Une nation qui n'aurait aucune influence sur son gouvernement, ou dont le gouvernement obéirait à des influences extérieures, ne saurait défendre son territoire et se mettre à l'abri de l'invasion, quand même tous ses membres seraient exercés aux armes. Une nation serait également incapable de se défendre, quand même elle se gouvernerait elle-même, par des hommes qu'elle aurait choisis et qui seraient comptables envers elle de l'exercice de leurs pouvoirs, si elle n'était pas armée, ou si elle ne savait pas faire usage de ses armes. Il ne suffit pas, en effet, pour repousser une agression armée, d'être libre dans ses mouvemens; il faut, de plus, savoir faire usage de ses membres, et ne pas être dépourvu de moyen de défense.
Un peuple trouve aussi une garantie contre les agressions extérieures, dans les alliances qu'il forme avec des peuples intéressés à sa conservation [II-269] et à son indépendance. La France, par exemple, est protégée par l'indépendance et la liberté des cantons suisses, et réciproquement les cantons suisses trouvent une garantie de leur conservation dans l'indépendance et la liberté de la France. Si les petits peuples d'Allemagne avaient tous une organisation sociale analogue à la nôtre, leur existence garantirait une partie considérable de nos frontières de l'invasion; mais, par la même raison, nous serons une garantie pour eux, toutes les fois que nous aurons un gouvernement qui sera l'organe des intérêts de la France.
Il ne faut pas confondre les garanties qui existent dans l'intérêt d'un gouvernement, avec les garanties qui existent dans l'intérêt de la nation à laquelle il donne des lois. Une famille qui considère comme sa propriété le peuple qui lui est soumis, peut avoir des forces pour le défendre contre les attaques venues de l'extérieur. Elle peut avoir aussi des alliés qui lui garantissent son pouvoir; les membres de la Sainte-Alliance, par exemple, se garantissaient mutuellement la possession de leurs États. Mais la force extérieure qui garantit l'existence ou la domination d'un prince, ne protége pas nécessairement sa nation; elle est souvent, au contraire, relativement à elle, un moyen de tyrannie intérieure ou extérieure.
Des atteintes peuvent être portées au territoire [II-270] national, par suite d'une coalition formée entre le gouvernement du pays et des gouvernemens étrangers; les attentats de ce genre ne sont pas même aussi rares qu'on serait tenté d'abord de le croire. Ils ont ordinairement lieu, lorsqu'une nation aspire à s'affranchir de la domination qui pèse sur elle, et que son gouvernement ne possède pas une force suffisante pour la tenir sous le joug. En pareil cas, le gouvernement fait un appel aux gouvernemens étrangers qui peuvent craindre pour eux un sort semblable, et livre le pays à leurs armées, dans l'espérance qu'il lui sera rendu, si non en totalité, du moins en partie.
Montesquieu observe que Sylla et Sertorius, dans la fureur des guerres civiles, aimaient mieux périr que de faire quelque chose dont Mithridate pût tirer avantage; mais que, dans les temps qui suivirent, dès qu'un ministre ou quelque grand crut qu'il importait à son avarice, à sa vengence, à son ambition de faire entrer les barbares dans l'empire, il le leur donna d'abord à ravager [91].
La raison de cette différence est facile à voir : le peuple romain, sous la république, était lui-même le garant de l'inviolabilité de son indépendance et de sa sûreté; mais, du moment qu'il eut été asservi, le territoire national n'eut plus de [II-271] garanties contre les attentats des empereurs ou de leurs ministres.
Il n'est pas rare cependant qu'un prince qui se considère comme le maître du pays et des hommes qu'il gouverne, défende les propriétés nationales contre les attaques qui viennent de l'étranger, si, à l'intérieur, son pouvoir n'est pas contesté; mais les forces dont il dispose pour sa défense, et qui, pour lui, sont une garantie, n'en sont pas une pour ses sujets; rien ne peut s'opposer, en effet, si tel est son bon plaisir ou celui de ses ministres, à ce que les places fortes, les arsenaux, les ports, la marine, et même les trésors de l'État ne soient livrés à l'étranger.
Les nations qui ont fait assez de progrès pour savoir se gouverner elles-mêmes, ne sont pas exposées à des dangers de ce genre; elles trouvent une garantie dans le choix qu'elles font directement ou indirectement des hommes chargés de la direction de leurs affaires, dans la surveillance continuelle qu'elles exercent ou font exercer sur eux, dans la faculté de les récompenser ou de les punir, et enfin dans toute leur organisation sociale.
On considère quelquefois comme une garantie des propriétés nationales, relativement à l'extérieur, la promesse de les respecter, faite par un gouvernement étranger ou par les chefs de ses [II-272] armées. Il n'est pas rare qu'une armée qui se disà envahir le territoire d'un peuple qu'elle pose considère comme ennemi, se fasse précéder par des proclamations dans lesquelles elle dit garantir les propriétés de tous les genres. Ces promesses sont un moyen de faire poser les armes à une partie de la population, et de détruire sans combat les résistances, c'est-à-dire de renverser les seules garanties efficaces. Elles ressemblent, sous quelques rapports, à ces déclarations que fait un prince qui veut affaiblir les obstacles qui s'opposent à son élévation, déclarations auxquelles on donne aussi le nom de garanties, et qui souvent ne sont, ni plus sincères, ni plus efficaces que les manifestes des armées d'invasion.
Quand ces promesses n'ont pas pour but et pour résultat de tromper les peuples auxquels elles sont faites, elles ne valent pas moins que rien; mais elles ne, valent pas beaucoup plus. Une promesse n'est une véritable garantie que lorsqu'il existe au-dessus de celui qui l'a faite, un pouvoir ayant la force et la volonté de la faire exécuter. Elle est presque toujours illusoire, quand celui qui en est l'auteur, n'a au-dessus de lui ni supérieurs ni juges, ou lorsque ces supérieurs sont eux-mêmes intéressés à ce qu'elle ne soit pas exécutée. Tous les hommes, même ceux qui sont investis d'un grand pouvoir, sont, il est vrai, placés sous l'empire [II-273] de leur conscience, mais nous sommes encore loin du temps où les nations pourront, dans leurs rapports mutuels, considérer comme une force invincible la conscience des hommes qui les gouvernent.
Un des élémens essentiels de toute propriété, avons-nous dit, est la faculté, dans le propriétaire, de jouir et de disposer de la chose qui lui appartient. Une nation n'a donc réellement les prérogatives attachées à la qualité de propriétaire, que lorsqu'elle a la puissance de disposer ou de jouir des choses qui sont à elle. Ses propriétés ne lui sont pleinement garanties qu'autant qu'elle se gouverne elle-même; qu'elle détermine, par conséquent, l'emploi de ses biens, et qu'elle peut s'en faire rendre compte.
[II-274]
CHAPITRE XLI.
De quelques lois destinées à garantir les propriétés contre les atteintes de l'extérieur.↩
UNE nation, quelle que soit son organisation politique, ne saurait, sans se faire illusion, se flatter que jamais ses frontières ne seront franchies par une armée ennemie, et que, dans aucun temps, son territoire ne sera le théâtre de la guerre. Or, il n'arrive jamais qu'une armée campe en pays ennemi, et qu'elle s'abstienne de porter atteinte aux propriétés au milieu desquelles elle se trouve placée. Lors même qu'elle ne se permet aucune destruction inutile, et qu'elle est soumise à la discipline la plus sévère, elle exige que la population dont, elle a envahi le territoire lui fournisse des subsistances ou des moyens de transport. Si elle n'attaque pas en détail les propriétés privées, elle les attaque en masse, en soumettant les propriétaires à des contributions. Quelquefois aussi l'intérêt de sa sûreté la détermine à ravager le pays, et à en faire disparaître les ressources que [II-275] l'armée nationale y trouverait, si elle parvenait à s'en rendre maîtresse.
" Les charges de la guerre sont donc toujours infiniment plus pesantes pour les populations placées près des frontières, que pour celles qui sont placées au centre du territoire national. La sécurité de celles-ci est d'autant plus grande que celles-là montrent plus de courage, de désintéressement, de patriotisme, et qu'elles se résignent à plus de sacrifices. Si les habitans des frontières pour mettre leurs propriétés à l'abri du pillage, et échapper aux calamités d'une invasion, consentaient à ouvrir un passage aux armées ennemies, et à ne pas les inquiéter, c'est surtout sur les habitans du centre que tomberait le poids de la guerre.
C'est, en effet, parmi eux que siége ordinairement le gouvernement qui est l'âme de toutes les opérations militaires, et que se trouvent les grandes masses de richesses.
Cependant, il n'y a de véritable association entre les membres dont un peuple se compose, qu'autant que toutes les propriétés sont également garanties, et que les charges et les avantages de la société se répartissent d'une manière égale. Il faut que les bienfaits de la paix et les malheurs inséparables de la guerre se répandent également sur tous, autant du moins que la nature des choses le comporte. Mais si, par leur position, quelques [II-276] parties de la population sont plus exposées que d'autres, et s'il n'est pas possible de prévenir les atteintes auxquelles leurs propriétés sont exposées, quel est le moyen d'établir l'égalité des charges autant que cela se peut? Il n'y en a qu'un : c'est de réparer le mal qu'on n'a pu empêcher; c'est d'indemniser, aux frais de l'Etat, les personnes dont les propriétés ont été ravies ou dévastées par l'ennemi.
En 1792, au moment où l'indépendance et la liberté de la nation française étaient menacées par la plupart des gouvernemens européens, l'Assemblée nationale, par un décret du 11 du mois.
d'août, ordonna qu'il serait accordé des secours ou des indemnités aux citoyens français qui, pendant la durée de la guerre, auraient perdu, par le fait des ennemis extérieurs, tout ou partie de leurs propriétés [92].
[II-277]
Suivant ce décret, tous ceux qui prétendaient à un secours ou à une indemnité, étaient assujétis aux preuves de résidence, et autres formalités imposées aux personnes qui avaient à recevoir quelque paiement aux caisses nationales. Ces conditions avaient pour objet d'écarter les prétentions des personnes qui avaient passé à l'étranger, par haine pour la révolution.
Les hommes qui avaient refusé d'obéir aux réquisitions légales, et ceux qui ne s'étaient pas opposés, lorsqu'ils le pouvaient, aux ravages de l'ennemi, étaient exclus de tout secours et de toute indemnité.
Les citoyens dont les propriétés avaient été dévastées, devaient présenter à la municipalité du lieu un mémoire détaillé et estimatif des pertes [II-278] qu'ils avaient éprouvées ; ils devaient y joindre un extrait certifié de leurs cotes d'impositions aux rôles des contributions foncière et mobilière.
Les municipalités étaient tenues de constater dans la huitaine, les dommages et dévastations; elles devaient envoyer leurs procès-verbaux aux directoires de district, qui, après avoir vérifié les faits, étaient chargés de les faire parvenir, avec leur avis, au directoire du département.
Les directoires de département devaient, dans la huitaine, les envoyer, avec leur avis, mémoires et renseignemens, au ministre de l'intérieur; et celui-ci devait les mettre sous les yeux du corps législatif.
Si la perte éprouvée par un citoyen consistait en meubles, bestiaux, effets ou marchandises, elle devait être justifiée, soit par l'attestation des voisins, soit par des extraits certifiés des livres de commerce, bilans, connaissemens et factures.
Les généraux, commandans et autres chefs militaires étaient chargés de rapporter, autant qu'il leur serait possible, des procès-verbaux des dévastations commises par l'ennemi; ils devaient les adresser au ministre de la guerre, qui devait les remettre de suite au corps-législatif.
L'Assemblée nationale pouvait seule déterminer sur le vu des pièces, et d'après un rapport, la nature et la quotité des secours et indemnités; elle [II-279] devait les proportionner à la fortune qui restait aux citoyens après la dévastation, à leurs besoins et aux pertes qu'ils avaient éprouvées.
Si la totalité d'une commune, d'un canton ou d'un district avait été ravagée, le corps-législatif devait accorder un secours provisoire avant la fixation des indemnités auxquelles les particuliers avaient droit.
Dans ce cas, les procès-verbaux devaient être rapportés par les officiers municipaux des communes limitrophes, et les vérifications faites par les administrateurs du district le plus voisin.
Tout citoyen convaincu d'avoir simulé des pertes dans sa déclaration, pour obtenir une somme plus forte, était déchu de toute indemnité et même de tout secours.
Les citoyens revêtus d'une fonction publique, et ceux qui portaient les armes pour le service de la patrie, avaient droit à une indemnité égale aux pertes qu'ils avaient souffertes dans leurs propriétés.
Il n'appartenait qu'à l'Assemblée nationale de statuer quelle quotité de dommage devait rester à la charge des citoyens, et dans quels cas ils devaient y être assujétis.
L'expérience ne tarda pas à faire voir l'insuffisance de ce décret; en conséquence, la Convention nationale en rendit un second, le 14 du mois [II-280] d'août 1795, par lequel elle essaya de faire disparaître ce qu'il y avait de vicieux dans le premier.
Par ce décret, la Convention déclare, au nom de la nation, qu'elle indemnisera tous les citoyens des pertes qu'ils ont éprouvées ou qu'ils éprouveront par l'invasion de l'ennemi sur le territoire français, ou par les démolitions ou coupes que la défense commune aura exigées de notre part; elle ne prive de tout droit à indemnité que ceux qui seront convaincus d'avoir favorisé l'invasion de l'ennemi, ou de n'avoir pas déféré aux réquisitions ou proclamations des généraux.
Des commissaires nommés par les administrateurs de district et par le gouvernement, doivent faire convoquer les citoyens de chaque commune, et prendre, en présence du conseil communal, les dires et observations de tous ceux qui ont à faire des observations; ils doivent prendre également des renseignemens sur la conduite qu'ont tenue les réclamans lors de l'invasion de l'ennemi et pendant son séjour sur le territoire français, et en faire mention dans leur procès-verbal [93].
Toutes les fois que la perte consiste dans l'enlèvement de la récolte, des meubles ou bestiaux, les commissaires constatent, en présence de la [II-281] municipalité, qui est tenue d'avouer ou de contredire les faits, en quoi consiste la perte, si elle a été de la totalité ou simplement d'une partie des objets, si cette partie est d'un tiers, d'un quart ou de toute autre quotité.
Si le citoyen réclame, à raison de l'incendie de ses bâtimens ou de leur démolition, relativement à une coupe de bois, vignes ou arbres fruitiers, les commissaires se transportent sur les lieux, vérifient en présence de la municipalité, en quoi consiste le dégât dont on se plaint, examinent si tout a été détruit ou simplement une partie. Dans ce dernier cas, ils indiquent dans quelle proportion ce qui reste est relativement à la partie détruite; ils peuvent, s'ils le jugent nécessaire, se faire assister de prud'hommes ou gens de l'art, pour les aider dans leurs opérations.
Le propriétaire qui, exploitant par lui-même ou par des gens à ses gages, a perdu la totalité de sa récolte, reçoit, en rapportant la quittance de toutes ses contributions, une indemnité égale à l'évaluation du revenu net porté dans la matrice des rôles, et, en outre, les frais d'exploitation et de semence, suivant l'estimation qui en est faite par les commissaires, sans que cette partie de l'indemnité puisse néanmoins excéder celle accordée pour le revenu net; s'il n'a perdu qu'une partie de sa récolte, son indemnité doit être réglée d'après [II-282] les mêmes bases, proportionnellement à sa perte.
Si les héritages sont affermés, le fermier ou cultivateur de ces héritages, est indemnisé de la perte qu'il a éprouvée sur la même récolte, suivant l'estimation qui en est faite par les commissaires, sans que néanmoins, dans aucun cas, cette indemnité puisse excéder celle du propriétaire, qui doit être déterminée par les règles précédemment tracées.
La valeur des maisons, dans les villes, est déterminée par le revenu présumé, d'après la contribution foncière qu'elles paient, et d'après les bases établies par le décret du 23 novembre 1790 ; en conséquence, le propriétaire reçoit, sous les conditions déjà indiquées, si elles ont été incendiées ou démolies dans leur entier, la totalité de l'indemnité ainsi fixée, ou une partie, si elles n'ont été détruites qu'en partie.
Il en est de même pour les fabriques, manufactures et moulins qui ont été détruits; l'indemnité due aux propriétaires est également fixée sur la valeur présumée des objets, d'après les bases établies par le même décret: la personne lésée ne peut la recevoir que sous les conditions précédemment énoncées, et dans les proportions de sa perte.
Quant aux maisons situées hors des villes, et aux bâtimens servant aux exploitations rurales, qui ne paient point de contribution foncière, et [II-283] qui ne sont cotisés qu'à raison du terrain qu'ils occupent, leur valeur est réglée par l'estimation qu'en font les commissaires; elle n'est payée aux citoyens qu'en rapportant la quittance de toutes leurs contributions.
Les commissaires procèdent également à l'estimation des dégâts causés par la coupe des vignes, bois ou arbres fruitiers, et à l'évaluation des bestiaux enlevés par l'ennemi.
Quant au mobilier, l'évaluation en est de même déterminée par les commissaires, d'après les renseignemens qu'ils prennent, et eu égard au plus ou moins d'aisance dont le réclamant jouissait.
Un décret du 6 frimaire an II (26 novembre 1793) modifie quelques-unes des dispositions de celui du 14 août; il dispose que l'indemnité accordée aux fermiers pour les frais d'exploitation et de semences, ne pourra, en aucun cas, excéder l'évaluation du revenu et de l'héritage affermé, tel qu'il est porté dans les matrices des rôles, sans que les prix des baux puissent entrer en considération, ni dans l'intérêt des fermiers, ni dans celui des propriétaires.
Il veut, en outre, que la valeur des maisons des villes, des fabriques, manufactures et moulins, soient également déterminées, ainsi qu'il est prescrit par les articles 11 et 12 du décret des 27 février et 14 août, et d'après les basses établies par [II-284] celui du 23 novembre 1790, relatif à la contribution foncière.
Enfin, il déclare que le maximum des meubles meublans, dont on pourra être indemnisé, demeure fixé au double du revenu net, sans que néanmoins il puisse excéder une somme de 2,000 francs, les bestiaux et les instrumens aratoires exceptés.
La Convention nationale craignant sans doute que la faveur ne présidât à la distribution des indemnités, rendit un décret le 16 messidor an II (4 juillet 1794), pour prévenir un pareil abus. Ce décret déclare qu'aucune indemnité définitive sur les pertes éprouvées par l'invasion et le ravage des ennemis, ne sera acquittée qu'en vertu d'un décret spécial. Ce n'est donc qu'à la puissance législative qu'il appartient de fixer définitivement les indemnités auxquelles les propriétaires ont droit, comme sous l'empire du décret du 11 août 1792. Les fixations d'indemnités doivent cependant continuer d'avoir lieu suivant les règles tracées par le décret du 14 août 1793; mais elles ne sont irrévocables que lorsqu'elles ont été approuvées par une loi.
: Il y a, dans ces divers décrets, trois sortes de dispositions qu'il importe de bien distinguer celles qui consacrent le principe que la nation française garantit les propriétés de chacun de ses membres contre les atteintes dont elles pourraient être l'objet de la part des nations étrangères ou de leurs [II-285] armées; celles qui déterminent les bases d'après lesquelles les indemnités doivent être réglées, lorsqu'en effet des propriétés ont été pillées ou dévastées par des armées ennemies; et celles qui désignent les fonctionnaires auxquels le réglement provisoire et la fixation définitive des indemnités sont attribuées.
Le principe de la garantie est une condition si essentielle de l'état social, qu'il n'y aurait pas de société proprement dite, s'il n'était pas admis. Ce n'est, en effet, que pour se mettre à l'abri des spoliations et des violences, que les citoyens d'un Etat libre paient des impôts, et se consacrent pendant un temps plus ou moins long au service militaire. Comme il y a égalité dans les charges que les lois imposent dans l'intérêt commun, il doit il doit y avoir égalité dans la protection. Les moyens d'existence de chacune des fractions de la société, doivent être également protégés contre les agressions des ennemis communs. Si les populations placées sur la circonférence du territoire mettent celles du centre à l'abri des spoliations et des outrages, c'est à celles-ci à les indemniser des sacrifices faits à la sûreté publique.
Dans les pays où le pouvoir n'est exercé que dans l'intérêt de ceux qui le possèdent, ce principe de garantie n'est point admis; parce que, chez des peuples ainsi gouvernés, il n'existe pas, à proprement [II-286] parler, de société, ni par conséquent de garanties. Le gouvernement ne considère les atteintes portées aux propriétés qui se trouvent sur le théâtre de la guerre, que dans les rapports qu'elles ont avec ses intérêts. Il tient plus à ne pas déplaire à la population au milieu de laquelle il est placé, qu'à réparer les dommages qu'ont faits au loin des armées ennemies. Sa propre sécurité demande que les lieux dans lesquels il fait sa résidence, éprouvent, les derniers, et le plus tard possible, les calamités qu'il attire sur le pays, ou qu'il ne sait pas en écarter. Il trouve d'ailleurs qu'il y a moins de danger et de déshonneur à céder aux exigences d'un souverain étranger ou d'une armée ennemie, qu'à subir la loi que lui imposeraient les vœux et les intérêts de ses sujets. Il ne saurait admettre le principe de la garantie, sans admettre par cela même celui de la propriété, et sans reconnaître, par conséquent, que, sous son empire, chacun est maître de sa personne et de ses biens. Ce serait avouer qu'entre l'État et chacun de ses membres, il y a des obligations réciproques, et arriver ainsi au principe de la souveraineté nationale. Les gouvernemens absolus et ceux qui tendent à le devenir, ne doivent donc pas admettre que la société soit tenue de réparer les atteintes portées par une armée ennemie à des propriétés particulières.
Les peuples libres ne peuvent, au contraire, [II-287] se flatter de conserver leur indépendance et leur liberté, que par l'observation rigoureuse de ce principe. Il est impossible que les populations dont les propriétés sont les plus exposées au ravage de la guerre, fassent de grands efforts pour repousser l'ennemi, si ces efforts, utiles à la nation entière, ne doivent pas avoir pour elles d'autres résultats que la ruine et la misère. D'un autre côté, les populations dont les propriétés sont hors des atteintes de l'ennemi, et qui ne sont pas actuellement frappées par les calamités d'une invasion, ne peuvent pas mettre beaucoup d'énergie à défendre leur indépendance, si elles n'ont pas le sentiment actuel des maux que la guerre entraîne à sa suite. La défense ne peut être énergique et générale que lorsque chacun des coups portés à une partie du corps social, est immédiatement senti par le corps tout entier, et lorsque chacune des parties frappées est à l'instant secourue par celles qui ne le sont pas. Les lois qui garantissent les propriétés contre les atteintes dont elles peuvent être l'objet de la part d'une armée ennemie, et qui font un devoir au gouvernement de répartir, entre tous les membres de l'État, les dommages causés à quelques-unes, sont donc une condition aussi essentielle à la conservation de l'indépendance nationale qu'à la bonne administration de la justice.
Les dispositions de ces lois, qui déterminent les [II-288] bases sur lesquelles les indemnités doivent être établies, ont principalement pour objet de prévenir l'arbitraire dans les évaluations. Ces bases varient comme la nature des propriétés; mais, en général, elles sont prises dans les lois faites pour déterminer la quotité de l'impôt que chacun doit payer en raison de son revenu. S'il s'agit d'indemniser des fermiers pour leurs frais d'exploitation et de semence, l'indemnité ne peut excéder l'évaluation du revenu net de l'héritage affermé, tel qu'il est porté sur les matrices du rôle. La valeur des maisons des villes, des fabriques, manufactures et moulins, doit être déterminée, ainsi qu'on l'a vu, d'après les bases établies par la loi du 23 novembre 1790, relative à la contribution foncière [94]. Les meubles meublans ne peuvent être évalués à une somme qui excède le double du revenu net, sans qu'elle puisse jamais s'élever au-dessus de deux mille francs. Quant aux autres objets, la valeur en est fixée suivant les règles tracées par le décret du 14 août 1793.
Les autorités appelées par ce dernier décret et par celui du 6 frimaire an II (26 novembre 1793), [II-289] à concourir à la fixation provisoire des indemnités dues aux personnes dont les propriétés seraient pillées ou dévastées, étaient les commissaires du gouvernement, les commissaires nommés par les administrations de district, et les conseils des communes; c'est à la puissance législative qu'appartenait et qu'appartient encore la fixation définitive. Les administrations de district ayant été supprimées, doivent être remplacées, pour la nomination des commissaires, par les conseils d'arrondissement. Elles ne doivent pas l'être par les sous-préfets, puisque le gouvernement aurait une double nomination de commissaires.
[II-290]
CHAPITRE XLII.
De la garantie des propriétés de tous les genres, contre les atteintes du gouvernement et de ses agens.↩
Les propriétés nationales peuvent recevoir des atteintes de la part de deux classes de : personnes de l'intérieur de la part des hommes auxquels la garde ou l'admistration en sont confiées, et de la part de simples particuliers. Il faut donc, pour qu'elles soient garanties, qu'il existe dans l'État une puissance qui prévienne ou réprime les atteintes qui peuvent être commises par les uns et par les autres, et qui ne soit pas disposée à devenir leur complice. Or, cette puissance ne peut pas être distincte de celle des propriétaires, c'est-à-dire de la nation elle-même, qui l'exerce par des délégués qu'elle choisit, ou qu'elle donne mission de choisir.
Une nation manque donc de garanties, relativement à ses propriétés, toutes les fois qu'elle est sans influence sur la nomination des fonctionnaires qui en ont la garde ou l'administration, et qu'elle ne peut ni déterminer l'emploi des choses qui lui [II-291] appartiennent, ni s'en faire rendre compte. Les peuples qui sont soumis à des gouvernemens absolus, tels que la plupart de ceux de l'Europe, sont complétement privés de garanties, relativement à leurs propriétés nationales, et aux atteintes que peuvent y porter les hommes qui les administrent. Quelle est, par exemple, en Russie, en Autriche, en Italie, en Espagne, la puissance qui peut empêcher les gouvernans de détourner à leur profit particulier les propriétés nationales, ou les contraindre, soit à en prendre soin, soit à les appliquer aux besoins des vrais propriétaires, c'est-à-dire des nations?
Sous les gouvernemens aristocratiques, les classes de la population qui sont exclues de toute participation aux affaires publiques, sont privées de garanties relativement aux propriétés nationales. Il n'existe, en effet, aucun pouvoir qui empêche les membres de l'aristocratie d'appliquer aux besoins de leurs familles les biens qui ne devraient être employés qu'au profit de tous les membres de l'État. Aussi, dans tous les pays soumis à ce mode de gouvernement, observe-t-on qu'une bonne part des revenus nationaux est employée à faire vivre et souvent même à enrichir les possesseurs du pouvoir.
Pour les communes, de même que pour les nations, il n'y a de garantie pour leurs propriétés qu'autant qu'elles ont la faculté d'en jouir et d'en [II-292] disposer, et qu'il existe dans l'État une puissance qui prévient ou réprime les atteintes dont elles sont ou peuvent être l'objet. Si, par violence ou par fraude, on privait un particulier de la faculté de jouir et de disposer de ses biens, on porterait évidemment atteinte à ses propriétés ; et si cette privation devait être perpétuelle, l'atteinte aurait tous les caractères d'une véritable spoliation. Par la même raison, si un pouvoir quelconque s'emparait de l'administration et de la disposition des biens des communes, elles se trouveraient par ce seul fait dépouillées de leurs propriétés.
Au commencement de ce siècle, une spoliation semblable fut exécutée contre toutes les communes de France, lorsqu'un général dispersa, par la force armée la représentation nationale, et s'empara de l'autorité publique. Le simulacre de constitution qui fut publié pour donner à l'usurpation des droits des citoyens une apparence de légalité, ne disait pas un mot des propriétés des communes; mais il attribuait au chef du gouvernement ou à ses délégués la nomination de tous les officiers auxquels l'administration en était confiée, et qui pouvaient en demander compte.
Dès ce moment, il n'exista plus d'association communale proprement dite: les délégués des communes furent destitués; des hommes élus par le nouveau gouvernement se mirent à leur place; ils [II-293] s'emparèrent de l'administration des biens communaux; ils en déterminèrent l'emploi selon leurs vues particulières, ou selon les ordres qui leur étaient transmis par leurs supérieurs; enfin, ils ne furent tenus de rendre compte de leur gestion qu'au pouvoir qui les avait élus ou à ses agens.
Si jamais un attentat semblable était exécuté contre les citoyens; si un général, après avoir détruit la représentation nationale et renversé le gouvernement, faisait passer dans les mains de ses délégués toutes les propriétés privées; s'il ne les rendait comptables qu'envers lui-même, quel est l'homme qui ne verrait pas dans une telle mesure une spoliation générale? La circonstance, que le possesseur du pouvoir aurait chargé ses délégués de consacrer les revenus des biens ravis à satisfaire quelques-uns des besoins des personnes qu'il aurait dépouillées, ne changerait pas la nature du fait. Il suffirait, pour que la spoliation fût complète, que les propriétaires fussent privés de la faculté de jouir et de disposer de leurs biens, et qu'ils fussent mis dans l'impuissance de jamais en demander compte. Or, il est évident que l'acte qui serait une spoliation pour une personne, en est une pour une agrégation de personnes : il n'y a de différence que dans le nombre des citoyens dépouillés, et dans l'importance de la spoliation.
Les propriétés des communes ne sont donc [II-294] véritablement garanties que lorsqu'elles sont hors des atteintes particulières des fonctionnaires auxquels l'administration en est confiée, et du gouvernement ou de ses agens; lorsque les propriétaires, c'est-à-dire les membres de la commune, les font administrer par des hommes qu'ils ont choisis, et auxquels ils peuvent demander compte de leur gestion.
Il ne faudrait pas cependant assimiler à un particulier ces agrégations de personnes auxquelles on donne le nom de communes ou de nations. Un individu, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, passe par divers états, et est soumis à des règles différentes, selon qu'il est plus ou moins capable. Au moment où il vient de naître, et même plusieurs années après, il peut avoir des propriétés, et cependant sa volonté n'exerce sur elle aucune influence. Lorsqu'il est complétement développé, il jouit et dispose de ses biens, sans être soumis à aucune sorte de contrôle; sa volonté a la puissance d'une loi. Si ses facultés intellectuelles disparaissent ou s'affaiblissent considérablement, il perd la faculté de disposer de ses propriétés, ou est soumis à diverses restrictions.
Ces périodes de faiblesse et de force, d'incapacité et d'intelligence, ne se font pas remarquer, du moins de la même manière, chez ces corps que nous appelons des nations ou des communes; mais aussi [II-295] l'on y trouve, à toutes les époques, un grand nombre de personnes qui ne peuvent prendre aucune part directe ou indirecte à l'administration des biens communs, et qui cependant ont à ces biens les mêmes droits que les hommes les plus capables. Les enfans, les femmes, les interdits, et ceux que leur incapacité supposée prive de l'exercice de tout droit politique, ont droit de jouir, comme tous les autres membres de l'État, de tous les avantages que peuvent procurer les propriétés de la commune et celles de la nation. Aucun d'eux cependant ne peut concourir à l'élection des hommes chargés de les administrer, ou d'en faire rendre compte.
Une commune, et moins encore une nation, ne peut administrer ses biens par elle-même; elle ne peut pas, non plus, examiner par elle-même la manière dont ils ont été administrés. Il faut qu'elle en confie la gestion à certains de ses membres, et qu'elle délégue à d'autres le pouvoir de vérifier les comptes de ses administrateurs. Mais, quand une commune ou une nation délègue une partie de ses pouvoirs, les élections ne se font pas à l'unanimité; ce n'est pas, non plus, à l'unanimité que les résolutions se forment dans les corps délibérans. Il y a donc toujours, soit dans une commune, soit dans une nation, un grand nombre de personnes qui n'ont pas été appelées à prendre part aux élections, ou qui ont refusé leurs suffrages aux hommes chargés des [II-296] affaires publiques. Il y a aussi, dans tout corps délibérant, des membres qui désapprouvent les résolutions qui y sont prises. Les hommes qui forment la minorité et ceux qui ne sont pas appelés à donner leur suffrage, soit dans les élections, soit dans les assemblées délibérantes, n'ont pas moins de droit cependant que ceux qui composent la majorité, aux propriétés communales ou nationales.
La nécessité, soit de refuser l'exercice des droits politiques à un grand nombre de personnes incapables de les exercer, soit de s'en rapporter, dans une infinité de circonstances, aux décisions de la majorité, ont fait mettre certaines restrictions, donner certaines limites à l'autorité des hommes chargés d'administrer les biens d'une commune ou d'une nation. On a senti qu'il était nécessaire de prévenir les abus que les majorités peuvent faire de leur pouvoir, et surtout de protéger les intérêts des personnes que leur âge, leur sexe ou d'autres causes, privent de toute influence dans l'administration des choses publiques. Les restrictions données aux divers pouvoirs de l'État, quand elles ont pour but et pour résultat la conservation des droits ou des intérêts des personnes qui ne peuvent pas se défendre, soit par elles-mêmes, soit par leurs délégués, ne sont pas des atteintes à la propriété; elles sont, au contraire, de véritables garanties. Elles sont, pour un grand nombre des membres des [II-297] communes ou de l'État, ce que sont les lois relatives à la tutelle pour les enfans qui n'ont point atteint leur majorité.
Les propriétés individuelles ou de famille sont exposées aux mêmes dangers que les propriétés de l'État et des communes ; elles peuvent recevoir des atteintes de la part des peuples voisins, de la part des membres du gouvernement ou de ses agens, et de la part des simples particuliers. Elles ne sont donc complétement garanties que lorsqu'il existe, au sein de la nation, des pouvoirs qui préviennent ou répriment les atteintes dont elles sont ou peuvent être l'objet, quels qu'en soient les auteurs.
La puissance qui met les propriétés nationales à l'abri des attaques de l'étranger, garantit par cela même les propriétés privées des atteintes qui pourraient venir de l'extérieur. Il peut arriver cependant qu'une propriété individuelle reçoive une atteinte, non d'une nation voisine, mais d'un homme qui fait partie de cette nation. Il peut arriver aussi qu'un étranger que les lois nationales ne peuvent atteindre, soit détenteur des biens d'un citoyen. Lorsque de tels événemens arrivent, et que la personne lésée dans ses intérêts, ne peut pas obtenir justice des juges de la personne dont elle se plaint, elle est protégée par les agens diplomatiques. L'ins¬ titution de ces agens est donc une véritable garantie, même pour les simples particuliers; mais [II-298] cette garantie n'est efficace qu'autant qu'elle peut, au besoin, être appuyée par une force qui sait se faire respecter.
Lorsque nous parlons des atteintes qu'un gouvernement peut porter aux propriétés privées, il faut entendre ces mots dans le sens le plus large. Ce mot gouvernement ne désigne pas seulement ici les ministres auxquels l'exécution des lois est confiée; il embrasse les principaux pouvoirs de l'État et leurs agens. Les propriétés peuvent recevoir des atteintes de la puissance qui fait les lois, comme de la force armée qui en assure l'exécution; des magistrats chargés de l'administration de la justice, comme des officiers dont la mission est de faire exécuter les jugemens. Les propriétés ne sont pas garanties, lorsque les législateurs chargés de voter les impôts se les partagent, sous le nom de fonctionnaires, de concert avec les ministres; et surtout lorsque la part de chacun est en raison de sa complaisance pour les agens comptables de la fortune publique.
On ne doit pas non plus perdre de vue que par le mot propriété nous n'entendons pas seulement les propriétés territoriales, ainsi que cela se pratique trop souvent; nous entendons les propriétés de tous les genres, tous les moyens d'existence qu'un individu s'est créés sans blesser les lois de la morale, et sans attenter à la liberté d'autrui, ou qui lui ont été [II-299] régulièrement transmis par ceux qui les avaient formés.
Un gouvernement peut porter atteinte aux propriétés des citoyens, en s'en emparant par une simple voie de fait; en imputant aux propriétaires certains délits, afin de s'approprier leurs biens par confiscation; en s'attribuant le monopole d'une industrie qui fournit des moyens d'existence à une ou à plusieurs familles; en faisant banqueroute à ses créanciers, ou, ce qui est la même chose, en se libérant de ses dettes au moyen d'une monnaie dépréciée; en s'attribuant, pour son avantage particulier, une part plus ou moins grande des revenus des citoyens; enfin, en empruntant des sommes considérables qu'il emploie dans son intérêt particulier, et dont il déclare le peuple débiteur
Les atteintes que les gouvernemens portent aux propriétés privées sont plus ou moins brutales, plus ou moins déguisées, selon que les nations qu'ils régissent sont plus ou moins éclairées. Les gouvernemens des peuples civilisés ont renoncé aux spoliations les plus violentes; ils trouvent qu'il est plus lucratif et moins dangereux de s'approprier une part des revenus de chacun, que de dépouiller un petit nombre de riches familles de tous leurs biens. Il n'y a plus que des gouvernemens qui sont tout-à-fait barbares et qui n'entendent rien aux raffinemens de la civilisation, qui cherchent [II-300] à s'enrichir par des confiscations. Si les autres n'ont pas toujours plus de probité, ils ont du moins plus d'habileté; selon le précepte du plus sage des rois, ils oppriment leurs peuples avec prudence.
Il n'est, pour une nation, qu'un moyen véritablement efficace de mettre les propriétés privées comme les propriétés publiques hors des atteintes des hommes chargés du gouvernement; c'est de s'organiser de telle manière que les malhonnêtes gens ne puissent jamais s'emparer de la direction de ses affaires, ou que du moins ils ne puissent pas la conserver, si, par ruse ou par hypocrisie, ils parviennent à s'en saisir. Un peuple qui ne pourrait pas ou qui ne saurait pas empêcher des hommes disposés à s'enrichir à ses dépens, de parvenir aux plus hauts emplois, chercherait en vain des garanties contre leur improbité; il ne saurait en trouver. L'organisation de tous les propriétaires, pour leur défense commune est, ainsi que je l'ai déjà dit, le fondement de toute véritable garantie.
Mais il ne suffit pas, pour que les propriétés soient hors des atteintes des personnes investies de l'autorité publique, que les propriétaires soient organisés et qu'ils se gouvernent par des hommes qu'ils ont choisis; il faut, de plus, que nul impôt ne puisse être exigé ni perçu, à moins que la nécessité n'en ait été constatée, et qu'il n'ait été [II-301] consenti par les délégués de ceux qui doivent le payer; il faut, en troisième lieu, que les hommes qui votent les impôts, ne soient pas autorités à se les partager; il faut enfin il faut enfin que les fonctionnaires auxquels l'exécution des lois est confiée, et qui sont dépositaires d'une part des propriétés nationales, soient responsables, envers le public, de l'usage qu'ils ont fait de leurs pouvoirs, et que, par conséquent ils puissent être poursuivis au nom de la nation à laquelle ils ont à rendre compte.
Enfin, la troisième condition nécessaire à l'existence de la garantie, est que toute personne qui se croit lésée dans ses biens par des dépositaires du pouvoir, quel que soit leur rang, puisse les traduire devant un tribunal intègre, éclairé, indépendant. Un tribunal dont tous les membres auraient été choisis par une des parties intéressées, et qui attendraient d'elle leur avancement et leur fortune, ne serait pas toujours, pour l'autre partie, une garantie bien sûre [95].
En Angleterre, où les juges sont nommés par le Roi, de même qu'en France, on croirait qu'il [II-302] n'existe aucune garantie, soit pour les personnes, soit pour les propriétés, si ces délégués de la couronne étaient appelés à prononcer sur les questions qui s'élèvent entre les particuliers et le gouvernement; cependant, ces juges sont réellement inamovibles; pour eux, il n'y a pas d'avancement possible. En France, nous pensons ou du moins nous agissons différemment; c'est aux hommes que le monarque a choisis et qui attendent de lui leur avancement et leur fortune, qu'est dévolu le jugement de tous les procès qui peuvent exister entre lui et les citoyens. Cette manière de procéder est, sans doute, une garantie pour le prince; mais elle n'en est pas une pour les personnes auxquelles il fait intenter des procès par ses délégués.
[II-303]
CHAPITRE XLIII.
De la garantie des propriétés de tous les genres, contre les atteintes des particuliers.↩
LES atteintes portées aux propriétés privées, communales ou publiques, par des particuliers, sont celles que les gouvernemens répriment le plus volontiers, parce qu'elles leur sont rarement profitables, et que presque toujours elles leur sont funestes. Les garanties données aux propriétés de tous les genres, contre les atteintes des personnes qui n'exercent aucune fonction publique, sont donc les moins imparfaites. Quand elles sont faibles ou inefficaces, il faut en accuser non les intentions des hommes qui gouvernent, mais leur incapacité.
On doit remarquer ici que toutes les fois qu'il s'agit de prévenir ou de réprimer les atteintes portées à la propriété par de simples particuliers, il n'est plus nécessaire de distinguer les propriétés nationales ou communales, des propriétés privées; la puissance, qui est une garantie pour celles-ci, [II-304] peut être une garantie pour celles-là. Aussi, dans la pratique, l'homme accusé d'avoir attenté aux propriétés d'une commune ou à celles de l'État, est-il traduit devant les mêmes juges, et soumis aux mêmes peines que s'il avait porté atteinte à des propriétés privées. Nous n'avons donc pas besoin de nous occuper désormais des distinctions faites dans les deux derniers chapitres.
Les propriétés peuvent être attaquées clandestinement et par des moyens frauduleux, ou à force ouverte, par des hommes qui se sont coalisés pour le pillage ou la spoliation. Elles peuvent aussi recevoir des atteintes de la part des personnes qui ne veulent pas affronter les lois pénales, et qui ne cherchent à s'approprier le bien d'autrui, qu'au moyen des imperfections inséparables de toutes les institutions humaines. Les premières de ces atteintes sont du ressort de la justice criminelle; les secondes sont du ressort de la justice civile.
La garantie la plus sûre contre les atteintes qui peuvent être portées à la propriété, à force ouverte et par des attroupemens, est l'organisation armée de tous les propriétaires. Lorsque tous les hommes qui n'existent qu'au moyen de leurs propriétés ou de leur industrie, sont armés et organisés, et qu'ils sont commandés par des officiers de leur choix, les propriétés ne peuvent courir un véritable danger, à moins que les propriétaires ne se divisent. [II-305] La force destinée à les garantir se trouve toujours là où le besoin s'en fait sentir; on ne peut ni la séduire, ni la surprendre, ni la détourner de sa véritable destination. Les attentats commis ouvertement et au grand jour contre les propriétés, chez des nations où chacun possède quelque chose, ont, au reste, si peu de chances de succès, qu'ils sont devenus presque impossibles. Dans un moment de disette, une population affamée peut tenter de s'emparer ouvertement des subsistances qui sont à sa portée; mais ces atteintes sont toujours très-circonscrites, quant aux choses qui en sont l'objet, et aux circonstances ou aux lieux dans lesquels elles sont faites.
Les garanties contre les atteintes cachées sont de deux espèces: les unes préviennent le mal ou l'arrêtent avant qu'il soit entièrement consommé; les autres le répriment par le châtiment des coupables, ce qui est aussi une manière de le prévenir. On établit les premières en instituant des officiers qui veillent à la garde des propriétés, et qui arrêtent les malfaiteurs à l'instant même où leurs mauvais desseins se manifestent. En France, les gardes qui surveillent les propriétés rurales, les gendarmes qui parcourent les grandes routes, les factionnaires qu'on place sur certains points dans les grandes villes, sont des garanties de la première espèce.
[II-306]
En Angleterre , des officiers de police à cheval parcourent les grandes routes , surtout pendant la nuit. Comme ils n'ont pas la mission d'arrêter les voyageurs inoffensifs , et de fouiller dans leurs papiers, ils ne sont revêtus d'aucun costume particulier. Ils sont plus craints que nos gendarmes , parce que les malfaiteurs ne peuvent pas les reconnaître de loin, et qu'ils peuvent tomber dans leurs mains en croyant attaquer des voyageurs.
Dans toutes les villes, il existe une autre sorte de gardes qu'on nomme des watchmen , et qui se répandent dans les rues du moment que la nuit est venue. Chacun d'eux est muni d'une lanterne , d'une crécelle et d'un bâton , et porte sur le dos , écrit en gros caractères, le numéro sous le quel il est inscrit à la police. Ils parcourent les rues de distance en distance ; ils observent les personnes qui leur paraissent suspectes , et s'assurent si les portes des maisons ou des boutiques sont bien fermées. Si un d'eux trouve une porte qu'on ait oublié de fermer ou qu'on ait mal fermée , il avertit le propriétaire; et si celui-ci est absent, il garde la boutique ou la maison jusqu'à ce que quelqu'un soit arrivé pour en prendre soin. S'il est témoin de quelque délit, et qu'il ne soit pas assez fort ou assez agile pour se saisir du coupable , il fait jouer sa crécelle, et de toutes les rues voisines il lui arrive des secours. Le malfaiteur, qui cherche à fuir, se [II-307] trouve investi de tous les côtés par les gardes accourus au bruit de la crécelle, et si ceux qu'il rencontre n'étaient pas assez forts, ils en appelleraient d'autres par le même moyen. Les watchmen n'ont pas pour mission seulement de mettre les propriétés et les personnes à l'abri des atteintes des malfaiteurs ; ils sont chargés aussi de faire con naître les incendies qui se déclarent à l'instant même où ils en aperçoivent des indices. Enfin, ils sont obligés d'annoncer dans les rues qu'ils parcourent, toutes les heures et toutes les demi-heures de la nuit, et de faire ainsi l'office d'horloges ambulantes. Ils sont donc obligés d'être toujours à leur poste.
Mais quelles que soient les précautions qu'on prenne pour empêcher les atteintes à la propriété, on ne saurait les prévenir toutes. Dans les pays les mieux policés , il y a des hommes qui échappent à toute surveillance, et qui parviennent à exécuter leurs desseins. Il faut donc, pour que les propriétés soient garanties , des officiers chargés d'arrêter les malfaiteurs et de les livrer à la justice ; il faut une procédure pour les convaincre , des lois en vertu desquelles on puisse les punir , des magistrats pour leur faire l'application des peines qu'ils ont encourues, et des hommes chargés de mettre les jugemens à exécution. Il faut, de plus , une justice civile bien organisée; [II-308] car il y a toujours des moyens de s'emparer de la propriété d'autrui ou de la retenir, sans s'exposer à une poursuite criminelle. La garantie des propriétés exige donc une procédure civile qui, dans toute discussion, soit propre à mettre la vérité au jour. Elle exige, en outre, des jurés ou des juges pour prononcer entre les parties, et des officiers pour exécuter leurs jugemens.
Si je voulais faire connaître en détail chacune des conditions nécessaires pour mettre les propriétés hors de toute atteinte, il faudrait ne rien laisser à dire sur aucune des branches du gouvernement; il faudrait traiter de la puissance législative, du pouvoir exécutif, de la force armée, des administrations municipales, du pouvoir judiciaire, de la procédure en matière civile et en matière criminelle, des lois pénales, des impôts, en un mot, de toute l'organisation sociale, et de chacun des moyens à l'aide desquels elle subsiste. Il serait impossible de se livrer à un tel examen, sans perdre de vue le sujet de cet ouvrage, et sans excéder les bornes que je me suis prescrites; on ne doit pas oublier d'ailleurs que les mêmes forces qui garantissent à chacun la jouissance et la disposition de ses biens, lui garantissent le libre exercice de ses autres droits. Ce n'est donc qu'après avoir fait connaître ces droits, qu'il convient de traiter en détail des institutions par lesquelles l'exercice en [II-309] est garanti à chacun des membres de la société.
Il me suffit d'avoir fait remarquer ici que les propriétés sont exposées à recevoir des atteintes de la part de toutes sortes de personnes, et qu'elles ne sont complétement garanties que lorsqu'il n'est aucune espèce d'atteintes qui reste sans répression; que les atteintes aux propriétés, soit qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, soit qu'elles partent du gouvernement qui devrait les protéger, ou qu'elles aient lieu de la part de simples particuliers, sont toujours le résultat d'une force; qu'on ne peut arrêter ou vaincre une force, que par une force supérieure, et que les peuples qui prennent des déclarations, des promesses ou même des sermens pour des garanties, tombent dans une grave et dangereuse erreur; ce qu'il importait surtout de faire observer, c'est que les propriétaires seuls, en prenant ce mot dans le sens le plus large, peuvent garantir les propriétés des diverses atteintes auxquelles elles sont exposées, et qu'ils ne peuvent les garantir qu'autant qu'ils sont organisés et armés pour les défendre.
La puissance qui garantit les propriétés ne dispense pas chaque propriétaire de la surveillance de ses biens; dans la société, chacun est le premier garant des choses qui lui appartiennent. S'il arrive que, par fraude ou par violence, un particulier soit dépouillé de sa propriété, l'autorité [II-310] publique interviendra pour la lui faire rendre ou pour punir le spoliateur; mais elle ne réparera pas le dommage causé. Une nation qui s'engagerait à réparer toutes les atteintes portées aux propriétés, s'exposerait par cela même à donner à la négligence de tels encouragemens, qu'elle aurait à craindre de se trouver dans l'impossibilité de remplir les engagemens qu'elle aurait pris.
S'il arrivait cependant que les propriétés d'une personne fussent pillées ou dévastées, parce que les autorités chargées de les protéger n'auraient pas rempli leurs devoirs, ne serait-il pas juste de condamner ces mêmes autorités à indemniser le propriétaire? A une époque où toutes les communes de France nommaient les magistrats chargés de maintenir l'ordre public dans leur sein, et où elles étaient organisées pour leur défense, il fut rendu une loi qui les rendait responsables des attentats commis sur leur territoire, soit envers les personnes, soit contre les propriétés. Cette loi, qui est encore en vigueur, était fort juste quand les communes se gouvernaient elles-mêmes, et qu'elles avaient le moyen de défendre l'ordre public; mais elle cessa de l'être quand le pouvoir les eût dépouillées de la faculté de nommer leurs magistrats et leurs officiers. Aujourd'hui qu'elles sont rentrées, au moins en partie, dans l'exercice de leurs droits, la seule objection qu'elles pourraient [II-311] faire contre la loi qui les déclare responsables des attentats commis à force ouverte sur leur territoire contre les propriétés, consisterait à dire que le gouvernement a trop de part dans le choix de leurs magistrats. Ce serait une raison pour ne pas restreindre leur liberté; mais il serait fâcheux qu'elle les fit affranchir de la responsabilité qui pèse sur elles.
Suivant les dispositions de cette loi, qui est du 10 vendémiaire an 4 (2 octobre 1795), tous citoyens habitant la même commune sont garans civilement des attentats commis sur le territoire de la commune, soit envers les personnes, soit contre les propriétés.
Chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, par des attroupemens ou rassemblemens armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages intérêts auxquels ils donneront lieu.
Dans le cas où les habitans ont pris part aux délits commis sur son territoire par des attroupemens ou rassemblemens, cette commune est tenue de payer à l'État une amende égale au montant de la réparation principale.
Si les attroupemens ou rassemblemens ont été formés d'habitans de plusieurs communes, toutes sont responsables des délits qu'ils ont commis, et [II-312] contribuables tant à la réparation et dommagesintérêts qu'au paiement de l'amende.
Les habitans de la commune ou des communes contribuables qui prétendent n'avoir pris aucune part aux délits, et contre lesquels il ne s'éleve aucune preuve de complicité ou participation aux attroupemens, peuvent exercer leur recours contre les auteurs et complices des délits.
Dans les cas où les rassemblemens ont été formés d'individus étrangers à la commune, sur le territoire de laquelle les délits ont été commis, et où la commune a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir, à l'effet de les prévenir et d'en faire connaître les auteurs, elle demeure déchargée de toute responsabilité.
Lorsque, par suite de rassemblemens ou attroupemens, un individu, domicilié ou non sur une commune, y a été pillé, maltraité ou homicidé, tous les habitans sont tenus de lui payer, ou, en cas de mort, à sa veuve et à ses enfans, des dommages-intérêts.
Lorsque, par suite de rassemblemens ou attroupemens, un citoyen a été contraint de payer, lorsqu'il a été volé ou pillé sur le territoire d'une commune, tous les habitans de la commune sont tenus de la restitution, en même nature, des objets pillés et choses enlevées par force, ou d'en [II-313] payer le prix, sur le pied du double de leur valeur, au cours du jour où le pillage a été commis.
En Angleterre, il existe une loi analogue à celle de France, pour la garantie des propriétés : les habitans des villes, bourgs ou villages sont responsables des attentats commis contre la propriété, sur leur territoire, par des attroupemens ou rassemblemens [96].
Une nation, de même qu'une commune, devrait être responsable des atteintes portées à des propriétés privées ou communales, toutes les fois que ces atteintes n'ont eu lieu que par la raison que les officiers de l'État n'ont pas fait leur devoir. On ne voit pas, en effet, pourquoi un peuple ne répondrait pas des fautes ou des délits de ses agens, comme une [II-314] commune répond de la négligence, de l'incapacité ou des délits des siens.
Les nations n'obtiennent pas gratuitement la garantie de leurs propriétés; elles sont obligées de la payer de leurs trésors, de leurs services et quelquefois même de leur sang. Un peuple qui voudrait tout faire faire pour de l'argent, et qui ne voudrait prendre part, ni à la garde de son territoire, ni à la confection de ses lois, ni à l'administration de la justice, ni au maintien de l'ordre intérieur, serait bientôt le peuple le plus esclave. Il n'y a de véritables garanties que pour les nations qui possèdent assez d'énergie, d'activité et de lumières, pour se garder, se donner des lois, s'administrer, se juger, en un mot, pour se gouverner elles-mêmes. Or, il faut pour cela le sacrifice de beaucoup de temps et même de beaucoup d'argent.
On se tromperait cependant si l'on s'imaginait que la liberté coûte plus aux nations que le despotisme; elle est, au contraire, infiniment moins dispendieuse. Si l'on a vu des nations qui semblaient libres, plus chargées d'impôts que des peuples privés de toute liberté politique, c'est que leurs princes avaient été assez riches pour corrompre les hommes chargés de la défense des intérêts nationaux. Avec les contributions perçues sur les citoyens, ils soudoyaient des majorités législatives; et avec ces majorités ils établissaient des impôts pour [II-315] acheter leurs suffrages. Montesquieu, qui n'avait pas observé ce jeu, a répandu l'erreur, que la servitude est moins dispendieuse que la liberté; et cette erreur a été défendue, comme une maxime incontestable, par tous les hommes qui, ne pouvant plus mener les nations par la force, ont voulu les gouverner par la corruption. Les Anglais, qu'on a cités pour exemple, supportaient les charges de deux régimes: celles qu'exige la liberté, et celles que faisait peser sur eux la domination de leur aristocratie.
Il ne suffit pas d'ailleurs, pour savoir ce que coûte un gouvernement, de calculer les sommes qu'on paie aux receveurs de contributions, ou les sacrifices de temps auxquels les citoyens sont obligés; il faut faire entrer en ligne de compte les pertes dont il est la cause, ou les bénéfices qu'il empêche de faire. En calculant les sacrifices de tous les genres, qui sont inséparables des diverses formes de gouvernement, on peut aisément se convaincre que le régime sous lequel les propriétés sont le mieux garanties, est celui qui coûte le moins, et qui donne en même temps le plus de sécurité.
[II-316]
CHAPITRE XLIV.
De la garantie donnée aux possesseurs des biens acquis par usurpation, et des causes de cette garantie.↩
EN exposant comment se forment les propriétés privées, et comment des familles et des nations peuvent, sans dépouiller personne de ses biens, arriver au plus haut degré de prospérité, je n'ai pas dit ou voulu faire entendre que le hommes ne se sont jamais enrichis que par les moyens que j'ai décrits. Une pareille affirmation, si je l'avais faite, aurait été démentie par l'histoire de toutes les nations du globe, et surtout par les faits que j'ai rapportés dans un autre ouvrage. Il est, en effet, chez tous les peuples, un nombre plus ou moins grand de familles qui ne doivent les richesses qu'elles possèdent qu'à des actes de violence ou de fraude. Ces familles considèrent leurs biens comme des propriétés très-légitimes, et reçoivent de l'autorité la même protection que les personnes qui ne se sont enrichies que par leur industrie. Quelquefois même, la protection qu'elles obtiennent est plus prompte et plus efficace que celle [II-317] dont jouissent les autres membres de la société, surtout sous les gouvernemens qui sont fondés sur le principe de la conquête.
On peut ranger dans quatre grandes classes les acquisitions faites par la violence et la fraude: dans la première, on peut mettre celles qui s'exécutent à la suite de la conquête, quand, par exemple, une armée étrangère s'établit sur une nation industrieuse, et s'empare de ses moyens d'existence; on peut mettre dans la seconde celles qui s'exécutent à la suite des dissentions religieuses ou politiques, quand la faction la plus forte proscrit la plus faible, et confisque ses propriétés; on peut mettre dans la troisième celles qui s'opèrent par des priviléges ou des monopoles, quand, pour enrichir certaines familles, on leur attribue la faculté d'exploiter certaines branches d'industrie ou de commerce, et qu'on l'interdit à la masse de la population; enfin, on peut mettre dans la quatrième les usurpations qui se commettent individuellement, par suite des vices de la législation, soit au préjudice du public, soit au préjudice de quelques particuliers.
Il n'est aucune nation en Europe qui, à une époque plus ou moins reculée, n'ait vu commettre sur son territoire toutes sortes de spoliations. Avant l'invasion des Romains, la population était partout divisée en maîtres et en esclaves : ce qui [II-318] nous prouve que déjà des peuples industrieux avaient été dépouillés par des peuples guerriers. Il est probable que partout où les armées romaines s'établirent, elles se mirent à la place des anciens conquérans, et dépouillèrent principalement les descendans des usurpateurs. Il est également probable que les peuples germaniques, qui, dans le quatrième et le cinquième siècle, renversèrent l'empire romain, se substituèrent particulièrement aux familles des conquérans qui les avaient précédés. Dans la Grande-Bretagne, par exemple, les Romains, qui avaient dépossédé les Celtes, furent ensuite dépossédés par les Saxons, lesquels le furent, quelques siècles plus tard, par les Normands. Dans tous les temps, les richesses ont subi les mêmes révolutions que le pouvoir: les hommes qui dépouillaient certaines classes de la société de leur puissance, les dépouillaient en même temps de leurs propriétés.
Les spoliations commises par des confiscations, à la suite des dissentions politiques ou religieuses, ont produit un déplacement de richesses moins considérable que ceux dont étaient jadis suivies les invasions à main armée; mais elles ont été cependant la source d'un nombre considérable de fortunes particulières. Les peuples chrétiens, avant de se diviser en sectes, et de se dépouiller les unes les autres de leurs richesses, avaient proscrit les [II-319] juifs par milliers, afin de s'emparer de leurs biens. Plus tard, ce furent les biens des chrétiens dissidens qui formèrent la fortune des familles qui jouissaient d'un grand crédit. Dans d'autres occasions, les querelles entre des hommes qui se disputaient la possession du pouvoir, ont fait passer les richesses des vaincus entre les mains des vainqueurs.
Les monopoles ou les priviléges ont été, chez toutes les nations industrieuses, la source d'un grand nombre de fortunes privées. Ces moyens de s'enrichir aux dépens du public, ont été même plus souvent employés chez les peuples qui, par leurs dispositions naturelles ou par leur situation, étaient appelées à faire un grand commerce, que chez les autres. L'Angleterre et la France ont été plus opprimées par des monopoles de tous les genres que les autres nations européennes.
Quant aux fortunes acquises par des abus particuliers de pouvoir ou par les vices des lois, elles sont moins nombreuses que celles auxquelles des invasions armées ont autrefois donné naissance; mais il en existe toujours un assez grand nombre chez toutes les nations qui, pendant long-temps, ont été soumises à de mauvais gouvernemens; et comme tous les peuples connus ont passé par un tel état, il n'en est aucun où l'on ne trouve des fortunes dont la source ne soit vicieuse.
[II-320]
Lorsqu'une nation envahit un territoire occupé par une autre, et qu'elle s'empare de ses moyens d'existence, la population placée sur le même sol reste pendant long-temps divisée en deux castes: celle des vainqueurs et celle des vaincus. Si la première demeure séparée de la seconde, non-seulement par une différence d'origine, mais par des différences de religion et de lois, et par les mesures qu'elle prend pour empêcher que les descendans des vaincus ne deviennent propriétaires, la guerre continue entre les deux races. Les descendans des vainqueurs trouvent la garantie de leurs possessions dans leur organisation politique et militaire, et dans la division, la faiblesse et la misère des vaincus. Les grandes questions de propriété qui s'élèvent dans un tel état, ne sont ordinairement résolus que par la force, et il n'y a que des révolutions qui puissent établir le règne de la justice et de la liberté.
Si les deux populations se mêlent, si les aliénations de propriétés immobilières sont autorisées, si la classe des vaincus obtient quelques garanties pour les produits de son industrie, le travail finit par donner aux hommes laborieux la prépondérance sur ceux qui vivent dans l'oisiveté. L'aversion du travail et le goût de la dissipation, qui se rencontrent toujours dans les castes habituées à vivre sur les produits des [II-321] travaux d'autrui, ne tardent pas à ruiner les familles qui s'y livrent, et qui ne peuvent pas réparer les brèches faites à leur fortune par le monopole du pouvoir. Il arrive alors que les valeurs anciennement usurpées sont graduellement consommées par ceux qui les avaient acquises, et qu'elles sont remplacées par les nouvelles valeurs auxquelles l'industrie donne naissance.
Autant les hommes sont portés, par leur tendance naturelle, à s'élever dans l'ordre social, autant ils éprouvent de répugnance à descendre ou à voir descendre leur postérité. Les mariages produisent généralement moins d'enfans dans les hauts rangs de la société, que dans les rangs inférieurs. On craint peu, dans ceux-ci, de voir déchoir sa race, tandis que dans ceux-là, cette crainte est un frein puissant. Il résulte de cette tendance que les familles qui, par préjugé de caste, méprisent le travail, et sont portées vers la dissipation, ne peuvent long-temps se perpétuer, si elles sont obligées de respecter les propriétés d'autrui. S'il était possible de suivre, pendant plusieurs siècles, la filiation des familles qui existent sur notre territoire, il est douteux qu'on y trouvât beaucoup de descendans, je ne dis pas des grandes familles romaines qui s'y étaient établies, mais des compagnons de Clovis. En supposant qu'on en trouvât quelques-unes, il est plus douteux encore [II-322] qu'on pût trouver parmi les biens qu'elles possèdent une part de ceux qui furent acquis à l'époque de la conquête.
On peut faire des observations semblables sur les biens acquis par suite des confiscations qui furent la suite des proscriptions religieuses du moyen âge et du seizième siècle; les familles qui furent alors dépouillées, et celles qui s'emparèrent de leurs dépouilles, sont pour la plupart éteintes. Si quelques-unes des dernières existent encore, elles ont probablement cessé de posséder des biens qui furent autrefois injustement acquis. Il ne serait guère possible d'ailleurs de suivre à travers les révolutions religieuses on politiques dont un vaste pays a été le théâtre, à plusieurs siècles de distance, toutes les mutations qui se sont opérées dans les propriétés, et de distinguer celles qui furent légitimes, de celles qui ne furent que des usurpations.
Lorsque les familles qui possédaient jadis une partie du territoire à titre de propriétaires, se sont éteintes, et que les mêmes terres ont donné naissance à de nouvelles familles, celles-ci les considèrent comme leurs propriétés. Les hommes, en effet, ne croient pas avoir seulement la propriété des divers objets qu'ils ont formés par leur industrie; ils se considèrent aussi comme propriétaires des choses auxquelles ils doivent eux-mêmes l'existence et sans lesquelles ils ne sauraient [II-323] se conserver. Le seul fait de posséder une chose est, chez tous les peuples, un titre pour en jouir et en disposer, quand personne ne peut produire un titre préférable. Une longue et paisible jouissance à titre de propriétaire, suffit également, chez toutes les nations, pour transférer la propriété d'une chose, quand celui qui aurait pu la revendiquer, n'en a été empêché par aucun obstacle qu'il ne pût surmonter.
Ces espèces de rapports qui existent entre les hommes et les choses au moyen desquelles ils se conservent et se perpétuent, se dissolvent et périssent par la cessation de la jouissance ou par l'abandon, comme ils se forment par la possession. Il semble même que lorsqu'on a déterminé la durée du temps pendant lequel il faudrait posséder une chose pour l'acquérir irrévocablement, on ait voulu prendre pour mesure le terme moyen de la vie humaine. La famille qui, pendant trente années, a joui d'une chose à titre de propriétaire, a dû régler ses habitudes, ses besoins, ses alliances suivant l'état présumé de sa fortune. L'en dépouiller après une possession si longue, ce serait la condamner à la ruine ou même à la destruction.Celle, au contraire, qui, pendant la même durée de temps, n'a retiré d'une chose aucune espèce d'avantage, et qui n'a même pas manifesté la volonté d'en jouir, n'est condamnée à s'imposer [II-324] aucune privation nouvelle, en restant dans l'état où elle a si long-temps vécu.
Quant aux biens acquis aux dépens du public, à l'aide de monopoles ou par suite des vices des lois, il serait difficile de les priver de garantie, sans porter une atteinte funeste à la sécurité de tous les propriétaires. Lorsqu'un homme a exercé, pendant un certain temps, un monopole plus ou moins lucratif, il ne serait pas possible de déterminer quelle est la part de sa fortune qu'il doit à l'exercice légitime de son industrie ou de son commerce, et quelle est la part qui doit être considérée comme le produit du privilége dont il a joui. Le bien qui pourrait être la suite de la réparation, étant réparti entre tous les membres de la société, serait imperceptible; mais le mal qui en résulterait serait immense. Nul ne pourrait plus se croire en sûreté, si chacun pouvait être appelé à rendre compte des biens qu'il aurait acquis sous une législation qui aurait manqué de justice ou de prévoyance.
Lorsqu'on observe l'origine de quelques grandes fortunes qui frappent les yeux, chez une nation qui a fait de grands progrès dans l'industrie, on peut être frappé de la manière scandaleuse dont elles ont été acquises; mais elles ne sont ni très-nombreuses, ni même très-considérables, quand on les compare à la masse des richesses que le travail a formées et qui sont légitimement possédées. [II-325] C'est par respect pour celles-ci qu'on est obligé de garantir celles-là, toutes les fois qu'on ne peut pas les atteindre par des moyens que les lois ont déterminés. La même raison qui s'oppose à ce qu'on remette en jugement un homme injustement acquitté, s'oppose à ce qu'on prive de garantie des biens qui ont déjà obtenu la protection des lois. Une nation qui parviendrait à mettre toutes les propriétés hors des atteintes, non-seulement des malfaiteurs, mais encore des membres de son gouvernement, serait déjà si heureuse, qu'il y aurait de la folie de sa part à compromettre toutes les garanties pour revenir sur le passé.
[II-326]
CHAPITRE XLV.
De l'influence des garanties légales sur l'accroissement, la conservation et la valeur des propriétés.↩
Si l'on cherchait, soit dans les temps anciens, soit dans les temps modernes, des nations chez lesquelles toutes les propriétés aient été garanties contre tous les genres d'atteintes, probablement on aurait de la peine à en découvrir une seule. Il est sans doute plusieurs peuples qui, dans des temps encore peu éloignés de nous, ont mis, autant que le comportait la nature des choses, les propriétés hors des atteintes qui pouvaient y être portées par de simples particuliers ou par des armées ennemies. Il en est peu qui se soient organisés de manière à n'avoir rien à craindre de la part de leurs propres gouvernemens; il en est peu surtout qui, après avoir mis leurs propriétés à l'abri des spoliations irrégulières et violentes, les aient garanties des atteintes qui peuvent y être portées par des impôts, des monopoles, des emprunts qui ne sont [II-327] profitables que pour les hommes investis de l'autorité publique [97].
S'il y a peu de nations chez lesquelles les propriétés de tous les genres soient à l'abri de toutes les atteintes, il y en a peu ausssi, peut-être même n'y en a-t-il point chez lesquelles les propriétés soient complètement privées de garanties. Les gouvernemens les plus arbitraires, les plus despotiques, préviennent ou punissent autant qu'ils le peuvent, les délits ou les crimes commis contre les propriétés par de simples particuliers, lorsque ces crimes sont improfitables pour eux. Les voleurs, quand on les prend, sont punis en Perse, en Turquie, en Russie, et en Autriche, comme ils le sont chez les nations les plus libres; ils le sont même plus sévérement. Les gouvernemens même les plus despotiques cherchent également à mettre les propriétés des nations qu'ils gouvernent, hors des atteintes des ennemis étrangers, [II-328] quand ils n'ont pas un intérêt contraire; s'ils ne réussissent pas toujours, c'est qu'il y a, dans leur nature, des obstacles insurmontables.
Ainsi, quand nous parlons des garanties légales, ces mots n'ont pas un sens absolu, invariable. Une garantie est une puissance, et toute puissance est susceptible de plus et de moins une force peut prévenir ou réprimer tels abus, et ne pas prévenir ou réprimer des abus d'un autre genre. Entre une nation qui ne manque d'aucune garantie, et une nation livrée à un arbitraire sans limites, il est une multitude d'intermédiaires. Si donc nous disons que les propriétés de tel ou tel peuple sont garanties, il faut entendre qu'elles le sont, non d'une manière absolue, mais contre telle ou telle espèce de dangers.
Les richesses déjà cumulées, qui jouent un si grand rôle dans la production, sont, du moins en très-grande partie, des résultats de l'industrie humaine; et les forces de la nature, dont nous tirons de si grands secours, ne nous rendraient que de faibles services, si nous ne prenions pas la peine de les diriger: il n'est donc pas de propriété qui puisse être produite sans le concours médiat ou immédiat du travail de l'homme. Mais il n'est aucune sorte d'industrie qu'on ait apprise sans faire aucune espèce de sacrifices, aucun travail qui n'ait [II-329] été suivi de fatigue ; il faut donc, pour nous déterminer à nous livrer à certains travaux, que nous ayons l'espérance d'en recueillir les fruits. Il faut que ces travaux puissent avoir pour résultats, ou de procurer certaines jouissances, soit à nous-mêmes, soit à ceux qui sont l'objet de nos affections, ou de nous mettre à l'abri de certaines douleurs. Il n'y a donc de propriétés produites que là où le producteur croit avoir quelque garantie d'en tirer un avantage.
Dans aucune position, les hommes ne sont aussi dépourvus de garanties que dans l'état sauvage. Toute peuplade qui se trouve dans un tel état, est continuellement exposée aux irruptions et aux violences des peuplades voisines; chaque individu peut être dépouillé de ce qu'il possède, par tout homme qui lui est supérieur en force. Un homme dans un pareil état, n'essaie pas de produire des choses qu'il n'aurait aucun moyen de conserver; il ne cherche à obtenir de la nature que les choses qu'il peut immédiatement consommer, et sans lesquelles il ne saurait vivre. La chasse qui lui fournit la partie la plus considérable de ses alimens, lui fournit aussi ses vêtemens; et il ne lui faut pour se faire un abri que quelques branches d'arbres ou un trou dans la terre. L'impossibilité de rien conserver le dispense de toute économie; et il est aussi pauvre [II-330] après avoir habité une terre pendant un demi-siècle, que le jour où il vint au monde [98].
Il est souvent arrivé que deux peuples ont simultanément occupé le même sol; que l'un des deux se livrait à tous les travaux qu'exigent l'existence et le bien-être des hommes, et que l'autre considérait le sol et les hommes qui le cultivaient, comme sa propriété. Un tel ordre existait jadis chez tous les peuples de la Grèce et de l'Italie; il existe encore chez plusieurs nations du continent américain, et dans la plupart des colonies que les modernes ont fondées. Cette division de la population en deux classes, dont l'une n'a rien en propre, et dont l'autre possède tout, quoiqu'elle ne produise rien, est, aux yeux des maîtres, aussi naturelle que la famille elle-même. Suivant Aristote, un esclave était un élément aussi essentiel dans une famille, qu'une femme et des enfans.
Lorsque deux peuples se trouvent ainsi placés sur le même sol, les individus qui appartiennent à la population esclave, sont dépouillés de toute garantie relativement à leurs maîtres. A l'égard des étrangers, ils sont protégés par les mêmes forces qui forment obstacle aux invasions: il est vrai que les étrangers ne sont jamais leurs ennemis. Enfin, [II-331] relativement aux individus par lesquels ils ne sont pas possédés, ils sont protégés par les forces qui garantissent les propriétés de leurs possesseurs. J'ai fait voir ailleurs, en parlant de l'influence qu'exerce l'esclavage domestique sur la production, l'accroissement et la distribution des richesses, que partout où la classe laborieuse est privée de garanties, les propriétés ne s'accroissent qu'avec une extrême lenteur [99].
Lorsqu'un pays, après s'être élevé à un certain degré de prospérité, a le malheur de tomber sous la domination d'une armée conquérante, et d'être dépouillé de toute garantie, les vaincus ne se livrent au travail que pour produire les choses qui leur sont rigoureusement nécessaires pour exister et pour fournir aux besoins de leurs maîtres. Non-seulement aucune propriété nouvelle ne se forme dans un tel état, mais celles qui existaient au moment de la conquête, tombent rapidement en décadence. La population s'éteint à mesure que ses moyens d'existence disparaissent, et ce sont toujours les familles le moins aisées qui sont frappées les premières par la misère. Tel est le sort qu'ont éprouvé tous les peuples tombés sous la domination des Turcs.
Il y a un état où, sans être à l'abri de toute atteinte, les propriétés peuvent s'accroître cependant [II-332] d'une manière assez rapide: c'est celui d'un peuple qui est hors des atteintes de ses ennemis extérieurs ; qui, à l'intérieur, jouit de toute la liberté nécessaire à la production des richesses; qui, par une bonne organisation du pouvoir judiciaire, n'a presque rien à craindre de la part des particuliers ni des agens du gouvernement; qui ne peut, en un mot, être atteint dans ses propriétés qu'au moyen des impôts établis et dévorés par une classe aristocratique; cet état, vers lequel tendent la plupart des nations européennes, a été celui de la Grande-Bretagne, depuis l'établissement du gouvernement parlementaire jusqu'au moment où elle a réformé sa chambre des communes.
Il n'est pas possible, en effet, de ne pas mettre au rang des atteintes aux propriétés la création d'un impôt par une classe de la population, sur toutes les autres classes, lorsque cet impôt n'est établi et consommé que dans l'intérêt de ceux qui en ont ordonné la perception. Cependant, il suffit qu'il soit réparti d'une manière à peu près égale, entre tous les membres de la société, et qu'il laisse aux personnes qui le paient une part plus ou moins considérable du produit de leur industrie, ou des revenus de leurs terres ou de leurs capitaux, pour qu'il ne prévienne pas la formation de nouvelles richesses, et ne soit pas un obstacle à la conservation des propriétés anciennement produites.
[II-333]
Les hommes se livrent au travail avec plus ou moins d'énergie, selon que les résultats qu'ils en attendent sont plus ou moins avantageux; ils s'imposent plus ou moins de privations ou se donnent plus ou moins de peine, pour conserver les biens qu'ils ont acquis, selon que la jouissance et la libre disposition leur en sont plus ou moins assurées ; il n'y a donc pas de stimulant plus actif et plus puissant qu'une véritable garantie.
Quoiqu'il soit évident que la garantie des propriétés est une des principales causes de la prospérité des nations, il serait difficile de déterminer d'une manière exacte quelle est la valeur qu'elle ajoute à chacun de nos biens. Il ne suffirait pas, pour connaître cette valeur, de comparer ce que vaut une maison à Constantinople, par exemple, à ce que vaudrait à Paris une maison parfaitement semblable. Tant de circonstances influent sur la valeur des choses, qu'il n'est pas possible de déterminer exactement la part d'action qui appartient à chacune.
Pour résoudre cette question, il faudrait laisser sans garanties quelques propriétés, à côté d'autres propriétés semblables qui seraient hors de toute atteinte. Il suffirait ensuite de voir ce que les unes valent de moins que les autres, pour connaître la valeur exacte de la garantie. Une pareille expérience ne saurait être faite chez une nation civilisée; [II-334] mais une expérience analogue a été faite dans le moyen âge, et il ne sera pas inutile d'en rapporter ici les résultats.
Le pape Célestin, qui occupait le trône pontifical vers la fin du treizième siècle, s'était aliéné le clergé par ses exactions et sa tyrannie. Son successeur, Boniface VIII, voulut porter son autorité plus loin il forma le dessein de soumettre à sa domination tous les princes chrétiens. Il ne pouvait parvenir à son but que par le concours du clergé, et il ne pouvait compter sur le clergé qu'autant qu'il servirait son ambition ou sa cupidité. Il y avait deux moyens d'y parvenir : l'un était de lui faire part de ses propres trésors; l'autre de l'enrichir, en le dispensant de payer aucun impôt. Il prit le dernier, comme étant le plus facile et le moins dispendieux.
En conséquence, au commencement de son pontificat, vers l'année 1296, il publia une bulle, dans laquelle il défendit à tous les princes chrétiens de lever, sans son consentement, aucun impôt sur les membres du clergé. Prévoyant qu'il y aurait des princes qui ne se conformeraient pas à sa bulle, il fit défense, en même temps, à tous les prêtres de payer aucune des contributions qu'on voudrait exiger d'eux. La peine d'excommunication fut prononcée, soit contre les princes, soit contre les ecclésiastiques qui se rendraient coupables de désobéissance.
[II-335]
Les biens possédés par le clergé étaient immenses, et il était impossible de les exempter d'impôts sans tarir une des sources les plus abondantes des revenus des princes. Un roi d'Angleterre, Edouard Ier, pressé par le besoin d'argent, se mit au-dessus de la bulle du pape : il fit ordonner aux membres du clergé d'acquitter les impôts comme par le passé. Les moines, les abbés, les évêques, étaient des gens trop consciencieux et avaient trop de religion, pour désobéir au chef de leur église, ils refusèrent de payer, pour ne pas être excommuniés.
Le prince les ayant menacés de faire saisir leurs biens, le primat d'Angleterre, qui avait donné l'exemple de la résistance, se chargea de justifier leur refus d'obéir; il représenta que les prêtres avaient deux souverains, l'un spirituel, l'autre temporel; qu'ils devaient obéissance à l'un et à l'autre, mais que leurs devoirs envers le premier étaient au-dessus de leurs devoirs envers le second; que celui-là leur ayant interdit, sous peine d'excommunication, de payer les impôts, ils ne pouvaient obéir à un roi qui leur en ordonnait le paiement.
Si Edouard avait exécuté ses menaces et fait saisir les biens du clergé, il aurait soulevé contre lui l'opinion publique et compromis son autorité; car les peuples étaient alors très-dévots, et les [II-336] prêtres exerçaient sur eux une grande puissance: il eut donc recours à un autre moyen.
« Je ne veux pas, dit-il au primat, vous contraindre à manquer à vos devoirs envers votre prince spirituel; vous pouvez donc vous conformer à ce qu'il vous prescrit; mais comme il ne peut pas exister de gouvernement sans impôts, et comme il ne serait pas juste de faire payer mes autres sujets pour la protection de vos personnes et de vos biens, le gouvernement va cesser d'exister à votre égard. Il n'attaquera point vos propriétés; mais il ne vous les garantira plus: si vous avez contracté des obligations envers ceux de mes sujets qui ne sont pas ecclésiastiques, vous serez tenus de les remplir, car vos créanciers ayant payé leur part des frais de l'administration publique, ont droit à être protégés par elle dans l'exercice de leurs droits; quant à vous, qui ne payez rien, vous protégerez vous-mêmes vos propriétés, et vous ferez exécuter comme vous pourrez les engagemens pris envers vous; et si votre force ne vous suffit pas, vous invoquerez le secours de votre souverain spirituel. »
Ce que ce prince avait annoncé fut exécuté: il fut interdit à toutes les cours de justice de faire droit à aucune des demandes ou d'écouter aucune des plaintes des membres du clergé ; il leur fut en même temps ordonné de continuer à rendre la [II-337] justice à tous les autres habitans du royaume, même contre les ecclésiastiques. Ainsi, en pleine paix, une immense quantité de propriétés se trouvèrent tout à coup privées de garanties légales, quoique aucune faction ne se fût emparée des pouvoirs publics, pour proscrire les propriétaires.
La défense faite par Edouard aux cours de justice et à tous les officiers de l'ordre judiciaire, ne tarda pas à être connue des débiteurs et des fermiers du clergé dès ce moment les uns et les autres cessèrent de payer.
« Bientôt, dit l'historien qui raconte ces faits, les ecclésiastiques se trouvèrent dans la situation la plus déplorable; ils ne pouvaient rester dans leurs maisons ou dans leurs couvens faute de subsistance; et, s'ils en sortaient pour chercher des ressources ou de l'appui, les brigands leur enlevaient leurs chevaux, les dépouillaient de leurs vêtemens et les insultaient, sans crainte d'être réprimés par la justice. Le primat lui-même fut attaqué sur un grand chemin, et réduit, après s'être vu prendre tout son bagage, à se retirer avec un seul domestique chez un ecclésiastique de la campagne. »
Quoique placé dans l'alternative de mourir de faim ou de payer les impôts, le clergé ne perdit pas courage il lança les foudres de l'excommunication contre les brigands qui l'attaqueraient dans [II-338] ses propriétés, et contre les débiteurs sans foi, qui ne lui paieraient pas leurs dettes.
L'excommunication lancée par Boniface VIII, avait été toute puissante: celle de l'archevêque ne produisit aucun effet. Il est vrai que la première affranchissait les membres du clergé d'une partie de leurs dettes, et que la seconde avait pour objet de leur garantir leurs biens.
Enfin, les prêtres, se trouvant dépourvus de tout moyen d'existence, furent obligés de capituler: ils consentirent, non à payer de leurs mains les impôts qu'ils devaient à l'Etat, mais à déposer, dans telle église qui leur serait indiquée, une somme semblable à celle dont ils étaient débiteurs; le roi pouvait l'y faire prendre, s'il consentait à se charger du péché [100].
Il n'était pas dans la nature des choses qu'une masse considérable de propriétés restât long-temps sans garantie; mais, si un pareil état avait dû continuer, il eût été facile de se convaincre qu'à l'exception des choses qui se consomment par le premier usage, et qu'on tient sous la main, une propriété qui n'est pas garantie, est une propriété qui n'a presque point de valeur.
Si l'on veut déterminer, au moins approximativement, quelle est la valeur que la garantie légale [II-339] ajoute à une propriété, il suffit d'examiner quelles sont les principales circonstances qui rendent une chose précieuse à nos yeux, et de voir comment ces circonstances sont affectées par l'absence de toute garantie.
Nous devons compter, parmi ces circonstances, l'étendue ou l'intensité des jouissances que la chose peut donner; la durée qu'elles doivent avoir; la certitude plus ou moins grande de conserver l'objet qui les produit, le nombre de personnes qui doivent en profiter.
La privation de toute garantie fait disparaître complètement la certitude de jouir d'une propriété, pendant un temps assez long pour être apprécié, et le défaut de certitude détruit tout le plaisir que la possession actuelle pourrait causer. La terre la plus belle, l'hôtel le plus magnifique, auraient peu de charmes et de valeur pour un homme qui pourrait à tout instant en être dépossédé par la force, et qui ne trouverait aucun appui dans la société. Ces biens, si estimables et si recherchés, quand la jouissance et la disposition en sont assurées, seraient si peu estimés s'ils n'étaient pas garantis, que nous ne voudrions faire aucun frais pour en prendre possession. Nous préférerions une simple cabane, dont nous aurions la certitude de jouir et de disposer toujours, à un château dont nous pourrions à tout moment être expulsés.
[II-340]
La privation de garantie qui suffit pour prévenir la formation de toute propriété nouvelle, suffit aussi pour faire disparaître en peu de temps les propriétés anciennement formées. Quelque grandes que fussent les richesses du clergé d'Angleterre, quand Edouard Ier les mit hors de la protection des lois, elles auraient été promptement détruites, si elles avaient continué d'être la proie du plus fort. Elles auraient subi le sort qu'ont éprouvé les richesses de toutes les nations qui ont eu le malheur de tomber sous des gouvernemens despotiques.
La mesure prise par Edouard Ier aurait été cependant moins efficace, si, au lieu de frapper des moines, des abbés, des évêques ou d'autres membres du clergé, elle avait été dirigée contre les cultivateurs, les fabricans, les commerçans. Comme une nation ne peut vivre qu'au moyen des produits de ses travaux, elle prendrait le parti de s'organiser et de protéger elle-même ses propriétés, si son gouvernement cessait de remplir ses fonctions. Il est moins difficile à une nation de trouver dans son sein des hommes qui la gouvernent, qu'à des princes déchus de trouver des peuples à gouverner.
[II-341]
CHAPITRE XLVI.
Des rapports qui existent entre l'accroissement des propriétés, et l'accroissement des diverses classes de la population.↩
PLUSIEURS écrivains, ayant observé que, dans tous les pays, il y a toujours un certain nombre de personnes qui sont emportées par la misère ou par les maux qu'elle produit, ont pensé que partout la population s'élève au niveau de ses moyens d'existence, et qu'elle tend même à aller au-delà.
D'autres ont contesté la vérité de cette observation; ils ont prétendu que l'accroissement des moyens d'existence, bien loin d'être en arrière de l'accroissement de la population, était, au contraire, plus rapide et tendait à le dépasser; ils se sont fondés sur ce que le nombre des familles aisées s'augmente sans cesse chez toutes les nations qui prospèrent.
Il est rare que les propositions générales qu'on fait sur une population nombreuse soient parfaitement exactes, parce qu'une nation civilisée se divise toujours en un certain nombre de classes, et que ce qui est vrai pour les unes, ne l'est presque [II-342] jamais pour les autres. Le terme moyen de la vie, sur lequel tant de calculs ont été faits, par exemple, le même dans tous les rangs de la société; il est infiniment plus court pour les classes qui sont sans cesse assiégées par le besoin, que pour celles qui jouissent de toutes les aisances de la vie.
Les mêmes expressions ne désignent même pas toujours les mêmes choses: une famille, née dans l'opulence, entend par ses moyens d'existence, autre chose que ce qu'entend une famille d'ouvriers qui fait usage des mêmes termes. Si chacune des deux se croit parvenue aux limites de ses ressources, quand elle ne peut plus s'accroître sans déchoir dans la société, on conviendra que, pour conserver son rang il ne faut pas à chacune la même somme de richesses.
Ainsi, l'on peut bien admettre qu'en tout pays la population s'élève au niveau de ses moyens d'existence, et que les classes les moins prévoyantes et les moins riches les dépassent même souvent; mais il faut qu'il soit bien entendu qu'il y a toujours chez une nation civilisée, un nombre plus ou moins considérable de familles qui peuvent arriver là, non seulement sans manquer d'aucun des objets nécessaires à la vie, mais en jouissant même de beaucoup de choses dont le besoin n'est pas même senti dans d'autres classes de la société.
Entre le mendiant auquel il ne faut pour exister [II-343] que du pain et des haillons, et le prince qui consomme chaque jour un capital suffisant pour faire vivre à l'aise et à perpétuité une modeste famille, il existe un grand nombre de classes intermédiaires; chacune de ces classes a des habitudes et des besoins particuliers, et considère comme nécessaires à sa conservation toutes les choses dont il lui serait imposssible de s'abstenir sans descendre dans un un rang inférieur.
Cette manière de juger ou de sentir n'est point particulière à une nation ou à une race; on l'observe chez tous les peuples qui ont fait quelques progrès; ce sentiment semble même se fortifier à mesure que la civilisation se développe de plus en plus. Il y a plus de honte à déchoir de son rang chez une nation qui prospère et qui jouit de toutes les garanties sociales, que chez une nation qui rétrograde vers la barbarie.
Il suit de là qu'en général, l'accroissement de la population, qui a lieu dans chacune des classes de la société, est en raison de l'augmentation des moyens d'existence exigés par ses habitudes et ses besoins particuliers. Si, par exemple, telles familles ne peuvent conserver leur rang ou leur position, qu'en dépensant annuellement une valeur de 6,000 francs, il faudra, pour que cette classe de la population s'accroisse d'une famille, qu'il se forme un revenu suffisant pour la faire vivre.
[II-344]
Ce n'est qu'en prenant ainsi en considération les besoins, les habitudes et même les préjugés de chacune des classes de la société qu'on peut dire, comme Montesquieu, que partout où une famille peut vivre à l'aise, il se forme un mariage.
Il n'est presque aucun genre d'industrie qui puisse produire des revenus un peu considérables, sans le secours d'un nombre plus ou moins grand de personnes. Il faut, Il faut, pour rendre une terre fertile, le concours de plusieurs ouvriers qui se livrent directement aux travaux de l'agriculture; il faut, de plus, que d'autres ouvriers se livrent à la fabrication des instrumens dont les premiers ont besoin. Le propriétaire de la terre la plus fertile qui serait réduit à la cultiver de ses propres mains, et qui n'aurait pas d'autres instrumens que ceux qu'il aurait lui-même fabriqués, n'en tirerait presqu'aucun revenu.
Un fabricant ne saurait non plus tirer presque aucun avantage de ses machines ou de ses capitaux, s'il n'avait, pour les mettre en œuvre, que ses forces individuelles ; il ne peut tirer de ses propriétés et de son industrie, un revenu suffisant pour faire exister sa famille, qu'en employant un certain nombre d'ouvriers.
Un commerçant ne peut également faire son commerce qu'au moyen d'un certain nombre de personnes qui sont employées, soit au transport [II-345] de ses marchandises, soit à faire l'office de commis.
Il résulte de là qu'on ne peut former, dans les classes élevées de la société, des moyens d'existence pour une famille nouvelle, sans créer en même temps des moyens d'existence pour un nombre plus ou moins considérable d'autres familles dont les besoins sont moins étendus.
Si, pour établir un de ses enfans, un riche cultivateur, par exemple, convertit en une ferme un vaste marais; il est évident qu'il crée des moyens d'existence pour une famille de fermiers, et pour un certain nombre d'ouvriers et de domestiques.
Il est également évident que le manufacturier qui fonde une nouvelle fabrique, le commerçant qui fonde une nouvelle maison de commerce, créent des moyens d'exister pour les ouvriers ou les commis qui seront nécessaires à ces nouveaux établissemens.
Toutes les fois donc que de nouveaux moyens d'existence se forment chez une nation, les classes de la population qui vivent du travail de leurs mains, s'accroissent d'une manière beaucoup plus rapide que celles qui vivent des revenus de leurs terres ou de leurs capitaux; l'établissement d'une manufacture nouvelle, qui n'augmentera que d'une famille la classe des fabricans, augmentera peut-être de vingt ou trente familles la classe qui lui fournit des ouvriers ou des domestiques.
[II-346]
Plus les familles qui vivent des revenus de leurs terres, de leurs capitaux ou de l'exercice d'une grande industrie, prennent des habitudes d'aisance et de luxe, moins elles peuvent se multiplier; moins, par conséquent, elles sont nombreuses, comparativement aux familles qui appartiennent à la classe ouvrière. L'Angleterre, par exemple, est le pays dans lequel on trouve le plus de grandes fortunes, mais aussi il n'y en a aucun dans lequel la classe des ouvriers ou des domestiques soit aussi nombreuse, comparativement à celle des maîtres. Celle-ci ne peut pas s'accroître d'une seule, à moins que celle-là ne s'augmente de vingt ou de trente, plus ou moins.
Lorsqu'un établissement industriel est formé, la part de revenu qu'il donne à tous les hommes auxquels il procure du travail, est, en général, plus considérable que la part qui revient au capitaliste ou à l'entrepreneur d'industrie. Le propriétaire de la terre la mieux cultivée, retire à peine le quart des produits bruts qu'elle donne; les autres trois quarts sont consommés par les personnes employées directement ou indirectement à la culture. De même, les sommes payées par un fabricant à ses ouvriers ou à ses commis, excèdent généralement de beaucoup les bénéfices qu'il retire de ses manufactures, et qu'il peut consacrer à ses propres consommations.
[II-347]
L'accroissement des propriétés, quelle qu'en soit la nature, exerce donc sur les classes qui vivent du travail de leurs mains, une influence plus étendue que celle qu'il exerce sur les classes qui vivent des revenus de leurs terres ou de leurs capitaux; il leur fournit une plus grande somme des moyens d'existence, et agit, par conséquent, avec plus de force sur leur multiplication.
Les jouissances d'une personne ne peuvent pas s'accroître dans les mêmes proportions que sa fortune; les plus simples et les plus naturelles, celles qui tiennent aux affections morales sont aussi vives et aussi durables chez un homme sans ambition, qui jouit d'une fortune médiocre, que chez celui qui jouit d'immenses richesses; il en est de même de celles qui résultent d'une bonne constitution, d'une bonne santé, de la possession de certains talens, de l'exercice de certaines facultés; la somme de bien-être que produit chez une nation qui prospère, l'accroissement des propriétés pour les classes laborieuses, excède donc la somme qui en résulte pour les autres classes de la société.
Si les classes de la population, qui vivent du travail de leurs mains, se multiplient plus rapidement que les autres, par suite de l'accroissement des propriétés, et si elles en retirent des avantages plus considérables, elles souffrent de maux plus grands, et disparaissent plus rapidement, quand [II-348] les atteintes portées aux propriétés poussent un pays vers sa décadence.
Toutes les fois que des impôts excessifs enlèvent aux habitans d'un pays la part la plus considérable de leurs revenus, ou que les propriétés sont menacées, soit par des troubles intérieurs, soit par l'invasion d'une armée ennemie, il se manifeste une grande détresse dans toutes les classes de la population, qui n'ont pour vivre que les produits de leur travail de chaque jour; ce fait a été constaté des expériences si nombreuses qu'on ne saurait le mettre en doute avec quelque apparence de par raison.
Les causes de ce phénomène sont faciles à apercevoir. Les classes aisées de la société peuvent opérer certains retranchemens sur leurs consommations, ou s'imposer certaines privations, sans manquer d'aucune des choses indispensables à la vie. Il n'en est pas de même des classes qui sont habituellement réduites à l'absolu nécessaire; l'événement qui n'impose aux premières qu'une simple privation de jouissance, condamne les secondes à une excessive misère, et les voue à la destruction.
Il est, pour les classes qui ne vivent que des produits de leur travail, une cause de misère qui n'existe pas pour les classes qui vivent des revenus de leurs terres ou de leurs capitaux. La prudence individuelle exerce sur le sort des familles qui tirent [II-349] leurs moyens d'existence de leurs propriétés, une très-grande influence. Comme les propriétés ne sont pas communes, chacun à la faculté de s'abstenir du mariage, quand il croit n'avoir pas le moyen d'élever une famille, et de conserver ainsi les moyens de vivre. Si, dans cette classe, il se forme des mariages imprudens, ces mariages n'ont presque point d'influence hors des familles auxquelles ils ont donné naissance. Les enfans qui en naissent, quelque nombreux qu'ils soient, ne vont pas dépouiller leurs voisins d'une partie de leurs propriétés.
Les classes qui vivent du travail de leurs mains, sont dans une position plus fâcheuse. Leur richesse se compose du travail qui est à exécuter dans la société, ou pour mieux dire, des salaires qui peuvent être accordés annuellement à ce travail. Ces salaires sont plus ou moins élevés, selon que le nombre des personnes entre lesquelles ils doivent être répartis, est plus ou moins grand. Il est évident que plus il y a d'ouvriers pour exécuter un ouvrage déterminé, et moins les salaires sont élevés; la concurrence produit sur la main-d'œuvre, les mêmes effets qu'elle produit sur toute autre chose. Les classes les plus laborieuses ne peuvent jouir de quelque aisance que lorsqu'il y a dans la société moins de travail offert que de travail demandé.
Mais la prudence individuelle, dans les mariages [II-350] des personnes qui ne vivent que de salaires, a peu d'influence sur la destinée particulière de chaque famille. Un mariage qui donne naissance à de nombreux enfans, condamne à la misère les familles formées avec le plus de prudence; ces enfans, s'ils peuvent vivre, viendront, en effet, en concurrence avec tous les autres pour prendre part au travail, et leur disputer leur subsistance. Quel avantage pourrait assurer aux siens sur les autres, un ouvrier qui ne se marierait que dans la force de l'âge, et qui n'en aurait que deux ou trois? Le partage du travail, produit, relativement aux classes ouvrières, l'effet que produirait, relativement aux capitalistes et aux possesseurs de terres, le partage des propriétés par égales portions, opéré à chaque génération. Il fait descendre au même niveau toutes les personnes qui appartiennent à la même classe.
Il suit de là que ces classes de personnes touchent toujours aux limites de leurs moyens d'existence, et que, dans la société, il n'y en a aucune qui ait plus à souffrir des atteintes portées aux diverses espèces de propriétés. On se trompe donc, quand on s'imagine que les grands possesseurs de terres, les commerçans, les manufacturiers, sont plus intéressés à la conservation de l'ordre public, que les autres classes de la population. Un événement qui leur impose, pour un temps de peu de durée, quelques privations légères, suffit pour [II-351] plonger dans la plus profonde détresse des milliers de familles d'ouvriers, et pour condamner leurs enfans à la destruction.
En disant que les classes de la société qui vivent de salaires, sont plus intéressées que les autres à la conservation des propriétés, et à l'existence d'un bon gouvernement, je n'entends pas affirmer que, dans toutes les circonstances, elles comprennent parfaitement leurs intérêts; il leur faudrait pour cela des connaissances qu'il leur est rarement possible d'acquérir.
[II-352]
CHAPITRE XLVII.
Des opinions des jurisconsultes sur l'origine et la nature de la propriété.↩
LA distinction entre le tien et le mien est aussi ancienne que le monde; il n'en est aucune qui pénètre plus promptement dans l'esprit de l'homme; les enfans la connaissent long-temps avant de savoir parler.
Les idées les plus simples, les plus élémentaires de la propriété sont donc au nombre des premières qui se forment dans l'intelligence humaine; elles sont comprises par les gens les moins éclairés, et cependant il en est peu qui donnent lieu à plus de discussions.
Si l'on observe ce que les hommes entendent ordinairement par des propriétés, on voit qu'ils désignent en général, par ce mot, des choses matérielles, ayant des qualités qui les rendent propres à nous procurer quelques jouissances, considérées relativement aux personnes qui peuvent en jouir ou en disposer dans l'ordre naturel de la [II-353] production ou de la transmission, et garanties à ces personnes par l'autorité publique.
Il est cependant certaines propriétés, telles que des fonds de commerce, des clientelles, qui ne consistent dans aucun objet matériel, et qui cependant ont une valeur plus ou moins considérable; mais les propriétés de ce genre n'ont de prix que parce qu'elles produisent des objets matériels, dont la jouissance et la disposition sont assurées aux propriétaires.
En exposant comment se forment les propriétés, et en cherchant à en faire connaître la nature et l'objet, je n'ai attaché à ce mot que le sens qu'on lui donne vulgairement, celui qu'il a dans la pratique ordinaire de la vie, et non celui que lui ont donné quelques jurisconsultes ou quelques philosophes.
Il me semble évident, en effet, que toutes les fois qu'un homme parle de ses propriétés, il désigne en général des objets matériels, des objets qui peuvent, ou satisfaire ses besoins, ou lui procurer certaines jouissances; des objets qu'il a formés ou régulièrement acquis, et dont il peut jouir ou disposer; des objets, enfin, dont la jouissance et la disposition exclusives lui sont garanties par l'autorité publique.
C'est dans le même sens que ce mot est entendu par les constitutions qui garantissent à chacun la disposition et la jouissance de ce qui lui appartient, [II-354] et par les lois qui répriment les atteintes qui y sont portées; les hommes n'existent que par les choses, et l'on ne peut attenter à leurs propriétés sans porter atteinte à leurs moyens d'existence.
J'ai précédemment fait observer que les jurisconsultes qui s'étaient exclusivement livrés à l'étude des lois romaines ou des lois sorties du régime féodal, au lieu d'étudier la nature des choses, n'avaient pu se faire des idées exactes de la propriété; l'histoire des Romains et des peuples soumis au régime féodal, se compose, en effet, d'une longue suite d'attentats contre les propriétés, attentats qui étaient toujours sanctionnés par la puissance publique.
Dans leurs relations avec les étrangers, les Romains ne reconnaissaient presque pas de propriétés; chez eux, toute guerre avait pour objet de s'emparer des biens de leurs ennemis, et de réduire leurs personnes en servitude. Ils mettaient dans le pillage et la distribution du butin l'ordre que met dans la gestion de ses affaires une bonne maison de commerce; jamais, avant eux, aucun peuple n'avait aussi savamment organisé le brigandage.
Dans leurs relations intérieures, les propriétés n'étaient pas beaucoup plus respectées. Une partie de la population, la classe des maîtres, vivait des extorsions qu'elle exerçait sur une autre partie sur la classe des esclaves. Sous un tel régime, il [II-355] n'était pas possible d'admettre en principe que toute valeur appartient à celui qui la crée. Il est incontestable, pour nous, que toute propriété vient originairement du travail; mais comment aurait-on pu reconnaître cette vérité, dans un temps où les travailleurs étaient considérés comme la propriété d'un peuple d'oisifs?
Dans les relations que les hommes non esclaves avaient entre eux, ils n'avaient pas, les uns à l'égard des autres, ce genre de probité qu'on observe quelquefois parmi des hommes qui se sont organisés pour le brigandage. L'aristocratie s'emparait des terres conquises, et les faisait cultiver à son profit par ses esclaves; elle faisait également exploiter, dans son intérêt, les arts et le commerce, de sorte qu'elle ne laissait à la masse de la population libre, aucun moyen d'existence.
Dans leurs relations individuelles, ils admettaient qu'un citoyen pouvait devenir la propriété d'un autre; un homme avait la faculté d'aliéner sa femme, ses enfans et ses petits-enfans, et de se vendre lui-même; le débiteur qui ne pouvait pas payer ses dettes, devenait la propriété de son créancier.
Quand les factions commencèrent à déchirer la république, les Romains portèrent dans les civiles, l'esprit de rapacité qui les animait dans [II-356] leurs guerres avec d'autres nations: les vaincus furent dépouillés au profit des vainqueurs.
Sous le règne des empereurs, les propriétés ne furent pas plus respectées que du temps de la république; les extorsions de la population oisive sur les classes laborieuses continuèrent; les maîtres, qui dépouillaient leurs esclaves, furent à leur tour dépouillés par les empereurs ; les nations devinrent en quelque sorte la propriété d'un homme.
Les peuples barbares qui renversèrent l'empire romain, s'emparèrent des hommes et des choses; comme ils ne se livraient à aucun genre d'industrie, il est évident qu'ils ne pouvaient vivre que d'extorsions.
Le système féodal ne fut qu'un nouveau mode d'oppression et de pillage. Le despostisme royal qui le suivit, ne fut pas beaucoup plus favorable à la recherche et à la reconnaissance des principes de la propriété.
Il était nécessaire de rappeler ces faits, pour faire comprendre comment des écrivains qui ne manquaient, ni de connaissances, ni de talens, devaient s'égarer en allant chercher chez les peuples de l'antiquité ou chez les nations du moyen-âge, les fondemens de la propriété; ce n'est pas chez des possesseurs d'esclaves, habitués à vivre de pillage, qu'ils pouvaient trouver la vérité.
Grotius nous a donné l'histoire de la propriété [II-357] en une demi-page, et il est remonté jusqu'à la création. Il nous apprend qu'après la création du monde, Dieu conféra au genre humain un droit général sur toutes choses. Ce droit fut une seconde fois donné à tous les hommes après le déluge.
« Cela, dit-il, dit-il, faisait que chacun pouvait prendre pour son usage ce qu'il voulait, et consumer ce qui se pouvait consumer. Cet état, ajoute-t-il, aurait pu durer, si les hommes fussent demeurés comme ils étaient, dans une grande simplicité de mœurs. »
Ayant raconté comment le genre humain fut obligé de se diviser en nations, et comment dans chaque nation les hommes jouissaient de tout en commun, il continue en ces termes :
« Cela dura jusqu'à ce que le nombre des hommes, aussi bien que celui des animaux, s'étant augmenté, les terres, qui étaient auparavant divisées en nations, commencèrent à se partager par familles; et parce que les puits sont d'une très-grande nécessité dans les pays secs, et qu'ils ne peuvent suffire à un très-grand nombre, chacun s'appropria ceux dont il put se saisir. »
» Les écrivains qui sont venus à la suite de Grotius, tels que Volf, Puffendorf, Burlamaqui, se sont bornés à paraphraser ses idées : tous se sont imaginé que, dans l'origine du monde, les hommes, pour satisfaire leurs besoins, n'avaient qu'à prendre [II-358] ce qui se trouvait sous leurs mains. En les lisant, on serait tenté de croire que les maisons s'élevaient au son de la lyre; que, dans les pays arides, les puits se formaient sur le simple commandement des hommes qui en avaient besoin; et que, depuis le partage primitif des terres, aucune révolution n'a troublé les co-partageans dans leur possession.
Enfin, arrive Montesquieu. Comme la propriété tient, dans les lois de tous les peuples policés, une place très-considérable, on pouvait se flatter qu'elle en tiendrait une non moins étendue dans l'Esprit des lois. Mais il n'en est pas ainsi : ce grand publiciste ne consacre pas à ce vaste sujet même un simple chapitre; il n'en parle que pour nous apprendre qu'il ne faut pas régler par les lois politiques, les matières qui doivent être réglées par les lois civiles. Du reste, il ne fait pas un pas de plus que Grotius et Puffendorf.
« Comme les hommes, dit-il, ont renoncé à leur indépendance naturelle, pour vivre sous des lois politiques, ils ont renoncé à la communauté naturelle des biens, pour vivre sous des lois civiles. Ces premières lois leur acquirent la liberté, les secondes la propriété [101]. »
Tous les biens, suivant Montesquieu, ont donc [II-359] été communs entre tous les hommes; ce qui prouve que, dans son opinion, les biens existaient indépendamment de tout travail humain. C'est la pensée de Grotius: Chacun pouvait prendre pour son usage ce qu'il voulait, et consumer ce qui se pouvait consumer.
Montesquieu pense, en outre, que la propriété ne doit l'existence qu'à la loi civile; d'où l'on pourrait conclure que toutes les propriétés ont été formées par les législateurs, c'est-à-dire par des princes ou par leurs conseillers. Je fais remarquer cette opinion, parce qu'on va la retrouver dans les écrits d'un autre célèbre jurisconsulte.
Blackstone paraît après Montesquieu, et il tente d'aller un peu plus loin que les écrivains qui l'ont précédé. L'on croirait même d'abord, qu'il a mieux vu que les autres la nature et l'origine des propriétés. Ses paroles sont si remarquables que je dois les rapporter.
« Il n'est rien, dit-il, qui frappe plus généralement l'imagination, et qui soit un objet d'affection pour les hommes, autant que le droit de propriété, c'est-à-dire du pouvoir absolu que chaque homme réclame et exerce sur les choses extérieures de ce monde, à l'exclusion du droit de tout autre individu dans l'univers.
» Il y a cependant très-peu de personnes qui veuillent se donner la peine de considérer l'origine [II-360] et les fondemens de ce droit. Satisfaits que nous sommes de la possession, il semble que nous n'osons regarder les moyens par lesquels elle fut acquise, comme si nous avions peur de découvrir quelque vice dans notre titre ! Nous restons du moins satisfaits de la décision des lois en notre faveur, sans examiner la raison ou l'autorité sur laquelle ces lois sont fondées.
» Nous pensons que c'est assez que notre titre dérive de la concession qui nous a été faite par un premier propriétaire, par la transmission de nos ancêtres, ou par le testament de l'individu auquel elle appartenait, ne nous mettant point en peine de réfléchir, qu'à proprement parler, on ne voit pas, dans la nature, ni dans la loi naturelle, pourquoi une série de mots sur parchemin transporterait d'une personne à une autre la propriété d'une terre; pourquoi un fils aurait le droit d'exclure ses semblables d'un espace de terre déterminé, sur le fondement que son père l'avait avant lui; ou pourquoi le possesseur d'un champ ou d'un meuble, couché sur son lit de mort, et incapable d'en retenir plus long-temps la possession, serait autorisé à déclarer à tous les hommes quel est celui d'entre eux qui, après lui, aura le droit d'en jouir et d'en disposer.
» Ces recherches, ajoute Blackstone, seraient inutiles et fatigantes dans le cours ordinaire de la [II-361] vie ; c'est bien assez que le genre humain obéisse aux lois quand elles sont faites, sans rechercher les raisons qu'on avait de les faire; mais, lorsque les lois doivent être considérées, non-seulement comme un objet de pratique, mais comme une science fondée sur la raison, il ne peut pas être inutile d'examiner plus profondément les élémens et les bases de ces constitutions positives de la société [102]. »
Après un tel début, on s'imagine que Blackstone va exposer, en effet, d'une manière philosophique, la nature et les fondemens de la propriété; mais il n'en fait rien. Il se met à la suite de Grotius et de ses disciples; il monte à la création du monde; il prend un passage de la Bible, et, à l'aide de ce passage, il explique la formation de toutes les propriétés.
Enfin, arrive un jurisconsulte philosophe, dégagé de toute espèce de préjugés, et repoussant l'autorité des livres, des législateurs et des opinions antiques : c'est Bentham. Il se propose de nous faire connaître la nature et les fondemens de la propriété, que personne avant lui n'avait bien expliqués.
« Pour mieux faire sentir le bienfait de la loi, dit-il, cherchons à nous faire une idée nette de la propriété. Nous verrons qu'il n'y a point de [II-362] propriété naturelle, qu'elle est uniquement l'ouvrage de la loi.
» La propriété n'est qu'une base d'attente: l'attente de retirer certains avantages de la chose qu'on dit posséder, en conséquence des rapports où l'on est déjà placé vis-à-vis d'elle.
» Il n'est point d'image, point de peinture, point de trait visible qui puisse exprimer ce rapport qui constitue la propriété. C'est qu'il n'est pas matériel, mais métaphysique; il appartient tout entier à la conception de l'esprit.
» L'idée de la propriété consiste dans une attente établie, dans la persuasion de pouvoir retirer tel ou tel avantage, selon la nature du cas. Or, cette persuasion, cette attente, ne peuvent être que l'ouvrage de la loi. Je ne puis compter sur la jouissance de ce que je regarde comme mien, que sur la promesse de la loi qui me le garantit.
« La propriété et la loi sont nées ensemble et mourront ensemble. Avant les lois, point de propriétés; ôtez les lois, toute propriété cesse [103]. »
Bentham tombe dans la même erreur que Montesquieu; il s'imagine qu'une nation sort de son état naturel, quand elle fait des progrès dans la civilisation; quand elle se développe en suivant les lois de sa nature. Ayant ailleurs réfuté cette erreur, [II-363] je crois inutile de m'y arrêter ici. Si les nations ne peuvent exister qu'au moyen de leurs propriétés, il est impossible d'admettre qu'il n'y a point de propriété naturelle, à moins de reconnaître qu'il n'est pas naturel pour les hommes de vivre et de se perpétuer.
Il est très-vrai qu'il n'est point d'image, point de peinture, point de trait visible qui puisse représenter la propriété en général; mais on ne peut pas conclure de là que la propriété n'est pas matérielle, mais métaphysique, et qu'elle appartient tout entière à la conception de l'esprit.
Il n'y a pas non plus de trait visible à l'aide duquel on puisse représenter un homme en général; parce que, dans la nature, il n'y a que des individus, et ce qui est vrai pour les hommes l'est aussi pour les choses.
Les individus, les familles, les peuples existent au moyen de leurs propriétés; ils ne sauraient vivre de rapports métaphysiques ou de conceptions de l'esprit. Il y a dans une propriété quelque chose de plus réel, de plus substantiel qu'une base d'attente. On en donne une idée fausse, ou du moins très-incomplète, quand on les définit comme un billet de loterie, qui est aussi une base d'attente.
Suivant Montesquieu et Bentham, c'est la loi civile qui donne naissance à la propriété, et il est [II-364] évident que l'un et l'autre entendent, par la loi civile, les déclarations de la puissance publique qui déterminent les biens dont chacun peut jouir et disposer. Il serait peut-être plus exact de dire que ce sont les propriétés qui ont donné naissance aux lois civiles; car on ne voit pas quel besoin pourrait avoir de lois et de gouvernement, une peuplade de sauvages, chez laquelle il n'existerait aucun genre de propriété. La garantie des propriétés est sans doute un des élémens essentiels dont elles se composent; elle en accroît la valeur, elle en assure la durée. On commettrait cependant une grave erreur, si l'on s'imaginait que la garantie seule compose toute la propriété; c'est la loi civile qui donne la garantie, mais c'est l'industrie humaine qui donne naissance aux propriétés. L'autorité publique n'a besoin de se montrer que pour les protéger, pour assurer à chacun la faculté d'en jouir et d'en disposer.
S'il était vrai que la propriété n'existe ou n'a été créée que par les déclarations et par la protection de l'autorité publique, il s'en suivrait que les hommes qui, dans chaque pays, sont investis de la puissance législative, seraient investis de la faculté de faire des propriétés par leurs décrets, et qu'ils pourraient, sans y porter atteinte, dépouiller les uns au profit des autres: ils n'auraient pas d'autres régles à suivre que leurs désirs ou leurs caprices.
[II-365]
Bentham et Montesquieu ne sont pas les seuls écrivains qui ont admis, en principe, que la propriété n'existe pas par les lois de notre nature. « La propriété, a dit un auteur de notre temps, n'a point existé dans l'état primitif du monde, et elle n'est pas plus inhérente à la nature humaine que l'hérédité. [104] » C'est là l'opinion de Montesquieu sur l'hérédité comme sur la propriété; car cet illustre écrivain n'admettait pas que, suivant les lois de notre nature, les enfans fussent appelés à recueillir la succession de leur père.
Les jurisconsultes praticiens, les commentateurs ou les compilateurs des lois civiles, n'ont pas mieux connu que les autres l'origine et la nature de la propriété. Pothier, qui avait un esprit si juste, et qui portait tant de sagacité dans toutes les discussions de jurisprudence, n'a vu que ce que les jurisconsultes romains avaient observé avant lui. Dans son ouvrage sur la propriété, il traite des moyens d'acquérir, les plus usités chez un peuple barbare; mais on n'y trouve pas un seul mot sur la manière dont les propriétés se forment chez les nations civilisées. Il traite, par exemple, de l'occupation, de la chasse, de la pêche, de l'oisellerie, des épaves, des choses rejetées par la mer, du butin fait sur l'ennemi, des conquêtes, des prises de [II-366] corsaires, des prisonniers de guerre et de leur rançon, en un mot, de tous les moyens exclusivement estimés par une tribu de barbares; il ne dit rien des moyens qui enrichissent un peuple policé.
Un des écrivains de notre temps, qui s'est placé, par ses ouvrages, au rang des premiers jurisconsultes, a tenté d'expliquer la nature, l'origine et les progrès de la propriété; mais il n'est pas allé beaucoup plus loin que Volf et Puffendorf. Admettant, comme un fait démontré, le système de J.-J. Rousseau sur l'état naturel de l'homme, il a pensé qu'avant l'établissement de l'état civil, la terre n'était à personne, et que les fruits étaient au premier occupant. Il a cru que les hommes, répandus sur le globe, vivaient dans un état que les auteurs ont appelé communauté négative, laquelle consistait, dit-il, en ce que les choses communes à tous n'appartenaient pas plus à chacun d'eux en particulier qu'aux autres, et en ce qu'aucun ne pouvait empêcher un autre d'y prendre ce qu'il jugeait à propos, pour s'en servir dans ses besoins. C'est là le roman de Grotius. L'auteur partage, au reste, l'opinion de Bentham et de Montesquieu, et confond les propriétés avec les garanties qu'elles obtiennent des lois civiles et des lois politiques [105].
[II-367]
CHAPITRE XLVIII.
Des définitions de la propriété, par la puissance législative.↩
DES philosophes et des jurisconsultes célèbres nous ont appris, ainsi qu'on l'a vu dans le chapitre précédent, que la propriété n'est pas inhérente à la nature humaine, et qu'elle ne doit l'existence qu'à la loi civile, c'est-à-dire aux déclarations et à la protection de l'autorité publique. Cette opinion n'a pas été généralement partagée par les peuples qui, après avoir fait la conquête de leur indépendance, ont été appelés à donner à la puissance législative, une organisation et des limites. Tous, en effet, loin de reconnaître à cette puissance la faculté de donner l'existence à la propriété, lui ont imposé le devoir de la respecter et de la protéger.
On trouve à la tête de presque toutes les constitutions américaines, l'énumération des divers objets qui sont, en quelque sorte, placés au-dessus de tous les pouvoirs sociaux, et qu'il est du devoir de chacun d'eux de respecter et de faire respecter: de ce nombre sont la liberté des cultes, la faculté [II-368] de publier son opinion sur toutes choses, celle de défense personnelle, celle d'acquérir et de posséder des propriétés et de les défendre.
Cet exemple a été suivi par la France, dans les diverses constitutions qu'elle s'est données, ou auxquelles elle a été soumise depuis la révolution de 1789. Nous lisons, en effet, dans le titre des Dispositions fondamentales garanties par la constitution, du 3 septembre 1791, que la constitution garantit l'inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. Nous y lisons, de plus, que le pouvoir législatif ne pourra faire aucune loi qui porte atteinte et mette obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la constitution.
La constitution du 24 juin 1793, la plus démocratique qu'on ait jamais faite, renferme des dispositions semblables. Elle déclare que le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels, et elle met au nombre de ces droits, l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété. Elle définit la propriété, le droit qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. Elle ajoute ensuite que nul genre de travail, de culture, de commerce, [II-369] ne peut être interdit à l'industrie des citoyens, et garantit ainsi à chacun la faculté de former des propriétés nouvelles. Enfin, après avoir fait connaître quels sont les droits naturels que la constitution garantit, elle déclare que, lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
Ces dispositions, à l'exception de la dernière, ont été de nouveau proclamées par la constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795). Ainsi, on déclare, par cette constitution, que les droits de l'homme en société sont la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété. L'on définit la propriété, le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. Enfin, on déclare que la constitution garantit l'inviolabilité de toutes les propriétés, ou la juste indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice [106].
La constitution consulaire, du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799), est muette sur la propriété en général, comme sur tous les droits que les constitutions antérieures avaient garantis. Il semble que les auteurs de cette constitution [II-370] prévoyaient que bientôt ils auraient à rétablir la confiscation dans le Code pénal, et qu'ils écartaient d'avance les obstacles qui auraient pu s'opposer à l'accomplissement de leurs projets.
Le Code civil définit la propriété, le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglemens. Il déclare, de plus, que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité [107].
Enfin, la charte de 1814, amendée en 1830, déclare que toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles; et que l'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable [108].
Il résulte des dispositions qui précèdent que, par les constitutions de 1791, de 1793, de 1795, comme par la charte de 1814, on a voulu mettre toutes les propriétés hors des atteintes qui pourraient y être portées, non-seulement par les particuliers, mais par les divers pouvoirs de l'État. [II-371] On a voulu qu'elles fussent à l'abri des entreprises des Chambres et du roi, aussi bien que des attaques des ministres et de leurs agens; car une constitution n'est pas moins obligatoire pour les pouvoirs qui font les lois, que pour ceux qui les exécutent. L'autorité publique doit donc protéger les propriétés comme les personnes; mais elle ne donne pas l'existence aux unes plus qu'elle ne la donne aux autres.
La propriété n'a pas changé de nature depuis 1789; et cependant on ne l'a pas toujours définie de la même manière. En faisant l'analyse des divers élémens qui la constituent, j'ai précédemment fait voir qu'en général, les hommes désignent par ce mot certaines choses considérées relativement à certaines personnes, et dont la jouissance et la disposition sont assurées à celles-ci, par l'autorité publique. C'est dans le même sens que ce mot est entendu par les lois qui garantissent à chacun la disposition de ses biens, et qui répriment les atteintes qui y sont portées. Il est clair, par exemple, que la loi qui détermine les conditions sous lesquelles une personne peut être obligée de céder à l'État sa propriété, pour cause d'utilité publique, entend, par ce mot, certains objets matériels, tels que des fonds de terre ou des maisons. Il n'est pas moins évident que les lois qui répriment les atteintes à la propriété, entendent généralement, par [II-372] la même expression, des choses matérielles. Les voleurs qui dévalisent un voyageur ne portent atteinte à ses droits qu'en s'emparant de choses matérielles qui sont sa propriété.
Cependant les définitions données de la propriété, soit par les constitutions de 1795 et de 1795, soit par le Code civil, la font consister, non dans les choses dont on a le droit de jouir et de disposer, mais dans le droit de jouir et de disposer des choses. Cette différence dans les expressions n'est pas, comme on pourrait être tenté de le croire, sans importance. Il est facile d'observer comment se forment, se conservent et se transmettent ces choses, auxquelles nous donnons le nom de propriétés ; mais il est moins aisé d'observer comment se forment se conservent et se transmettent ce qu'on appelle des droits. Les hommes qui, chez une nation, sont investis du pouvoir de faire des lois, n'éleveront jamais la folle prétention d'être les créateurs des choses que nous appelons des propriétés. On ne trouverait point étrange qu'ils se prétendissent les créateurs de tous les droits; il n'est même pas très-rare de voir de pareilles prétentions se manifester.
, Si la définition du Code civil était admise, il s'en suivrait que la puissance législative, et même les simples agens du gouvernement, pourraient disposer des propriétés de la manière la plus absolue, [II-373] sans crainte d'être accusés d'y porter atteinte. Une loi qui défendrait à une personne de semer dans sa terre aucune espèce de grains, d'y planter des vignes ou des arbres, d'y élever aucune construction, ou qui lui interdirait de la vendre, de l'échanger, de la donner, ne serait pas une atteinte à la propriété. Ne pourrait-on pas dire, en effet, après qu'elle aurait été rendue, comme auparavant, que le propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, pourvu qu'il n'en fasse pas un usage prohibé par les lois? Une personne pourrait donc être dépouillée de presque tous les avantages de la propriété, sans que la définition du Code civil cessât d'être exacte, et qu'on eût besoin de la modifier. Ce n'est pas seulement par des lois que les propriétés pourraient être réduites à rien, mais aussi par des réglemens.
La définition du Code civil est tellement inexacte, qu'elle peut s'appliquer à toute autre chose qu'à l'objet défini, et que les gouvernemens les plus despotiques pourraient l'adopter sans lui faire subir aucune modification, et sans craindre qu'elle leur fit éprouver aucune entrave. Un fermier, un usufruitier, un usager, ont le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue de la chose qu'ils détiennent à titre de ferme, d'usufruit ou d'usage, pourvu qu'ils n'en fassent pas un usage [II-374] prohibé par les lois ou par les réglemens. Les Egyptiens, écrasés sous le poids des monopoles, peuvent, comme nous, jouir et disposer de leurs biens de la manière la plus absolue, pourvu qu'ils n'en fassent pas un usage prohibé par les lois et par les réglemens de leur pacha [109].
Il ne faut pas être surpris si les hommes qui ont tenté de donner, en quelques lignes, une définition exacte et complète de la propriété, ont tous échoué; une telle définition ne me semble pas possible, moins d'y consacrer plusieurs volumes. Il faut ajouter que l'influence des lois romaines, des doctrines du moyen-âge, et des erreurs de quelques grands écrivains, suffisaient pour égarer les meilleurs esprits.
Les définitions données par la puissance législative peuvent être utiles, quand elles renferment un commandement ou une défense, ou qu'elles ont pour objet de déterminer des actes qu'on est tenu d'exécuter ou de s'interdire; mais quand elles n'ont pas d'autre objet que de faire connaître la nature des choses, elles sont inutiles et dangereuses; [II-375] il faut les laisser à la science. En fait de doctrines, un législateur n'a pas plus d'autorité qu'un simple particulier, à moins qu'on ne commence par admettre en principe qu'il est infaillible.
[II-376]
CHAPITRE XLIX.
Examen critique des dispositions du Code civil sur la nature de la propriété.↩
Si les observations que j'ai déjà faites ne suffisaient pas pour pas pour démontrer que la nature et les fondemens de la propriété n'ont jamais été bien observés par les jurisconsultes ou par les législateurs qui s'en sont occupés, ce qui me reste à dire, sur ce sujet, rendrait la démonstration complète.
J'ai précédemment fait observer que partout où l'homme n'a pas la certitude de jouir et de disposer des biens qu'il a créés ou légitimement acquis, il ne se forme plus de propriétés nouvelles; que celles qui ont été anciennement créés dépérissent plus ou moins rapidement, et que la population s'éteint à mesure que ses moyens d'existence disparaissent.
De là, j'ai tiré la conséquence qu'une nation ne se conserve et ne prospère qu'en garantissant à chacun de ses membres la faculté de jouir et de disposer des valeurs qu'il a formées ou régulièrement [II-377] acquises, et de tous les produits qu'il peut en retirer, de quelque nature qu'ils soient.
Mais il arrive quelquefois qu'une chose qui appartient à une personne, reçoit un accroissement de valeur, soit par suite des travaux d'une autre personne, soit par des circonstances fortuites, indépendantes de toute volonté; il arrive aussi que diverses propriétés se mêlent ou se confondent de manière à ne pouvoir plus être séparées.
Les jurisconsultes anciens et les jurisconsultes modernes ont été fort embarrassés lorsque des cas pareils se sont présentés, et qu'ils ont été appelés à rendre à chacun le sien; ils n'ont même pas toujours su déduire les conséquences les plus simples des principes qu'ils avaient admis sur la propriété. Parmi les décisions qu'ils ont rendues, un grand nombre ont manqué de justesse, et celles dont la justesse ne peut être contestée, ont été rarement fondées sur de bonnes raisons.
Pour donner une bonne solution des questions qui les ont embarrassés, et surtout pour voir le vide des motifs sur lesquels leurs décisions ont été fondées, il suffira de bien observer la nature des choses, et de savoir en déduire les conséquences qui en découlent naturellement.
Toute propriété sé compose, ainsi qu'on l'a vú, de plusieurs élémens; en général, ce mot désigne une chose ayant les qualités qui la rendent [II-378] propre à satisfaire médiatement ou immédiatement quelques-uns de nos besoins considérée relativement à une ou à plusieurs personnes qui ont la faculté d'en jouir et d'en disposer, et garantie à ces mêmes personnes par les dispositions des lois, et par la puissance publique.
Cela étant entendu, si l'on nous demandait à qui appartiennent les fruits de tels arbres, le blé de tel champ, le fourrage de tel pré, nous serions peu embarrassés pour répondre; il nous semblerait évident que le fruit produit par une chose appartient en général au propriétaire de la chose, s'il ne l'a pas aliénée.
Si l'on allait plus loin, et si l'on voulait savoir les motifs de cette décision, nous les trouverions dans les élémens même qui constituent la propriété; nous remarquerions que la faculté de jouir d'une chose est une des conditions essentielles de la propriété, et qu'il n'y a pas d'autres moyens de jouir d'une terre que d'en percevoir les fruits par soi-même ou par la main d'autrui.
Si la même question était adressée à un jurisconsulte qui, au lieu d'observer la nature des choses, n'aurait étudié que des livres de jurisprudence, sa décision, qui serait la même au fond, serait fondée sur un autre motif; il nous apprendrait que les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, tels que les loyers des maisons et [II-379] l'intérêt des capitaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
Mais, si nous voulions à notre tour aller plus loin, si nous voulions savoir ce que c'est que le droit d'accession, et pourquoi il y a un droit d'accession, plutôt qu'un droit d'attraction, de gravitation ou de génération, il serait fort difficile de donner une réponse satisfaisante.
Je fais cette observation, d'abord, parce qu'en jurisprudence rien n'est plus commun que de s'imaginer qu'on a donné une raison sans réplique, quand on a prononcé un mot qui n'a point de sens; et, en second lieu, pour faire remarquer qu'il suffit de l'emploi d'une expression vicieuse, pour rompre le fil des idées, et rendre impossible tout bon raisonnement.
Lorsqu'un gouvernement rédige un corps de lois, et qu'il veut qu'elles soient bien entendues, il doit, ce me semble, exposer les principes généraux sur chaque matière, dans les termes les plus clairs possibles, et laisser aux jurisconsultes et aux magistrats le soin d'en déduire les conséquences, et d'en faire l'application; s'il se méfie de l'intelligence des hommes pour lesquels ses lois sont faites, et s'il veut lui-même déduire les conséquences des principes qu'il a établis, il doit les donner pour ce qu'elles sont, pour des déductions des maximes qu'il a consacrées.
[II-380]
Ce n'est pas ainsi qu'ont procédé les auteurs du Code civil, quand ils ont traité de la propriété ; ils ont commencé par établir quelques dispositions générales, et ils en ont ensuite présenté les développemens comme des principes d'une nature toute différente.
Il résulte de là que les principes généraux semblent ne conduire à rien, et peuvent être considérés comme des vérités stériles, et que les con séquences ne reposent sur aucune raison qu'on puisse assigner.
Le deuxième titre du livre second du Code civil est consacré à établir des règles sur la propriété. Dans un premier article, on définit la propriété : Le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglemens. On déclare, par un second article, que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Enfin, dans une troisième, on reconnaît que la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur tout ce qui s'y nuit, soit naturellement, soit artificiellement.
On voit, dans la définition de la propriété, le droit de jouir et de disposer de la chose, et par conséquent le droit d'en percevoir les fruits; dans toutes les [II-381] langues, en effet, jouir exclusivement d'une chose c'est s'approprier les avantages qu'elle produit ; l'article qui déclare que la propriété d'une chose donne droit surtout ce qu'elle produit, n'est donc qu'une amplification de l'article par lequel la propriété a été définie.
Il me semble qu'après avoir admis en principe que tout propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose, et avoir expliqué que le droit de jouir d'une chose, soit mobilière ou immobilière, consiste dans la faculté de s'approprier tout ce qu'elle produit, il était inutile d'ajouter que les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux appartiennent au propriétaire ; cette explication d'une disposition fort claire était tout-à-fait sans objet.
Cependant, si l'on croyait qu'elle était bonne à quelque chose, il fallait la donner pour ce qu'elle était, pour l'application d'un principe qu'on venait de poser; après avoir dit que la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, il fallait ajouter en conséquence, la propriété d'une terre donne droit à tous les fruits qui en proviennent; la propriété d'un animal donne droit au croît de cet animal.
Mais ce n'est pas ainsi qu'on a procédé; l'on a d'abord établi quelques principes généraux sur le [II-382] droit de propriété; puis est apparu tout à coup un droit d'une espèce nouvelle, le droit d'accession ; et celui-ci est bien plus considérable que le premier, si l'on en juge par le nombre des articles dans lesquels il est développé : le premier n'en a exigé que trois, tandis que le second en a demandé trente-et-un.
Du moment que le droit d'accession a paru, il n'est plus question du droit de propriété ; on traite successivement: 1° du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose; 2º du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose; 3º du droit d'accession relativement aux choses immobilières; 4º enfin, du droit d'accession relativement aux choses mobilières.
Il ne s'agit pas de rechercher ici ce que c'est que le droit d'accession, ni pourquoi l'accession produit un droit; les recherches auxquelles nous pourrions nous livrer à cet égard, n'auraient pas d'autres résultats que de nous faire voir que c'est un mot imaginé par des hommes qui n'avaient pas su observer la nature de la propriété, et en marquer les limites.
Les dispositions relatives à ce prétendu droit d'accession peuvent être divisées en plusieurs classes.
Quelques-unes ne sont que des explications des articles qui avaient défini la propriété; il est bien évident, par exemple, que les dispositions qui [II-383] attribuent au propriétaire de la terre les revenus qu'elle produit, au propriétaire d'une maison les revenus qu'elle donne, et au propriétaire d'un animal le croît de cet animal, ne sont que des explications des articles qui reconnaissent au propriétaire le droit de jouir de sa chose et de tout ce qu'elle produit.
Les dispositions qui déterminent les effets de la possession, qui déclarent, par exemple, que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi; que, dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la réclame; que le possesseur est de bonne foi, quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété, dont il ignore les vices, et qu'il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus, reposent sur des principes que je n'ai pas exposés dans cet ouvrage, mais elles n'ont rien de commun avec ce qu'on est convenu d'appeler droit d'accession.
Il ne me paraît pas moins évident que la disposition qui déclare que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, n'est qu'une explication de la propriété qu'on a mal définie. Que serait, en effet, la propriété du sol, pour celui qui n'aurait la propriété, ni du dessus, ni du dessous? Quels sont les points auxquels le dessus et le dessous [II-384] commencent? Avoir le sol, sans dessus, ni dessous, c'est n'avoir rien du tout; c'est une ligne géométrique, une pure conception de l'esprit.
Lorsqu'on ajoute que la personne qui a la propriété du dessus et du dessous, peut faire au-dessus toutes les constructions et plantations qu'il juge à propos, et au-dessous toutes les constructions ou fouilles qu'il juge convenables, on explique tout simplement les termes qui reconnaissent au propriétaire le droit de disposer de sa chose de la manière la plus absolue; on commente la définition qu'on a donnée de la propriété; le prétendu droit d'accession n'est ici pour rien.
De ce que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, il suit nécessairement que toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais, et lui appartenir, à moins que le contraire ne soit prouvé.
Il est, dans le même chapitre, des dispositions qui ont pour objet, non d'expliquer la définition qu'on a donnée de la propriété, mais de déterminer ce qui arrive quand une chose, qui appartient à une personne, reçoit des mains d'une autre, une augmentation de valeur, ou quand plusieurs choses appartenant à différens propriétaires, s'unissent de manière à ne former qu'un seul tout.
[II-385]
Les questions de ce genre ne peuvent embarrasser beaucoup les hommes qui admettent en principe que toute valeur appartient à celui qui l'a formée, et qu'il ne faut jamais enrichir une personne aux dépens d'une autre. Il suit, en effet, de là, que toutes les fois que, par ses travaux, un individu donne un accroissement de valeur à la propriété d'un autre, celui-ci ne doit reprendre sa chose qu'en payant à celui-là la valeur qu'il lui a donnée.
Si, par exemple, une personne cultive une terre qui ne lui appartient pas, le propriétaire n'en devra percevoir les fruits qu'à la charge de rembourser les frais de labours, travaux et semences, c'est-à-dire qu'il devra payer l'accroissement de valeur que les travaux d'autrui auront donné à sa propriété. L'inintelligible droit d'accession est ici tout-à-fait étranger.
Les jurisconsultes anciens et modernes ont été fort embarrassés, lorsqu'ils ont eu à résoudre des questions de propriété, nées de l'union ou du mélange de diverses choses appartenant à différens maîtres; si le droit d'accession n'était pas venu au secours de quelques-uns, accompagné de la distinction du principal et de l'accessoire, il est douteux qu'ils fussent sortis d'embarras.
Nous allons examiner, en ne consultant que la nature des choses, les principales questions qu'ils [II-386] ont résolues, et nous verrons si nous ne pouvons pas arriver à des solutions plus justes, et surtout plus faciles.
Un homme fait construire une maison sur un fonds dont il est propriétaire; mais il emploie des matériaux qui ne sont point à lui. Que déciderat-on en pareil cas? La maison sera-t-elle démolie, et les matériaux rendus à la personne à laquelle ils appartenaient? Si la maison ne doit pas être démolie, appartiendra-t-elle au propriétaire des matériaux, ou au propriétaire du sol, qui l'a fait construire?
Le Code civil décide que c'est au propriétaire du fonds qui l'a fait bâtir; et qu'il paiera la valeur des matériaux qu'il a employés et qui sont devenus sa propriété ; mais en vertu de quel droit? En vertu du droit d'accession. Il resterait à savoir pourquoi l'accession ne donne pas au propriétaire des matériaux la propriété des valeurs qui y sont ajoutées ; mais on ne s'avise guère d'examiner des questions de cette nature.
En examinant les divers élémens qui constituent une propriété, il serait facile de trouver des raisons un peu plus satisfaisantes que le droit d'accession. Un des principaux élémens qui forment une propriété, est la valeur qui se trouve dans la chose que nous désignons par ce nom. Or, nous avons admis que toute valeur appartient à celui qui l'a [II-387] créée. Une personne qui emploie des matériaux pour construire une maison, en augmente la valeur de tout ce que la main-d'œuvre y ajoute. On ne pourrait la condamner à les rendre, sans or donner la destruction d'une valeur considérable; il y aurait une double perte: celle des frais de construction, et celle des frais de démolition: Ces pertes ne seraient profitables pour personne; elles seraient un mal qui ne serait compensé par aucun bien. On ne devait donc pas ordonner que la maison serait démolie.
Mais auquel des deux propriétaires la maison doit-elle être adjugée? à celui des matériaux, ou à celui qui l'a fait construire sur son fonds? Il suffit pour résoudre cette question, d'examiner quelle est la décision qui produira le plus d'avantages et le moins d'inconvéniens.
Il est certain d'abord que la maison convient au propriétaire du sol, puisqu'il l'a fait construire, et qu'il a eu la faculté de l'accommoder à ses besoins, ou même à ses fantaisies; il ne serait pas également sûr qu'elle convient au propriétaire des matériaux: elle a donc pour le premier une valeur qu'elle pourrait ne pas avoir pour le second.
Il n'est presque pas possible que celui qui a fait construire la maison, ait pris à une seule personne tous les matériaux qu'il a employés; il peut avoir pris la pierre, ou la chaux, ou le bois, ou le fer, [II-388] ou la tuile; mais il ne saurait lui avoir tout pris. Or, si l'on fait le calcul de la valeur du fonds, de celle de la main-d'œuvre, et des matériaux qui n'ont été enlevés à personne, ou dont la valeur a été payée, on trouvera que celui qui a fait faire la construction a, dans la valeur de la maison, une part plus grande que celui auquel une partie plus ou moins grande des matériaux appartenait.
Si donc il faut que l'un des deux paie à l'autre la part qu'il a dans la maison, il faut laisser la nouvelle propriété à celui qui aura le plus petit remboursement à faire. Il est probable que celui qui fait construire une maison, a le moyen de payer les matériaux qui lui sont nécessaires ; il ne serait pas aussi sûr que le propriétaire de certains matériaux eût le de la valeur de la maison à la consmoyen payer truction de laquelle ils auraient été employés.
Enfin, il en est des matériaux propres à construire une maison, comme de toutes les choses qui peuvent être multipliées par l'industrie humaine; pourvu qu'on ait de l'argent pour en acheter, rien n'est aussi facile que de remplacer ceux qu'on a perdus. Si donc le propriétaire du fonds paie au propriétaire des matériaux la valeur qu'ils avaient, celui-ci pourra se procurer des choses exactement semblables à celles dont il a été privé. Si, au contraire, le propriétaire des matériaux gardait la maison, en payant la valeur qui n'est point à lui [II-389] le propriétaire du fonds, par les soins duquel elle a été construite, ne pourrait pas en avoir une autre dans la même situation.
Il y a donc des raisons très-fortes pour que la maison ne soit pas démolie, et qu'elle reste à celui qui l'a fait construire, moyennant qu'il rembourse la valeur des matériaux, et qu'il répare les dommages qu'il a causés; mais le droit d'accession n'est pour rien dans la question.
Ce droit prétendu a conduit à une solution juste dans le cas que je viens de supposer; mais on se tromperait si l'on pensait qu'il y conduit toujours. Voici un cas qui peut se présenter plus fréquemment, et où le droit d'accession me semble loin d'être infaillible.
Un homme se croit propriétaire d'un fonds qui appartient à une autre personne : il y fait apporter des matériaux dont il a payé la valeur, et y fait construire une maison.
Auquel des deux la propriété nouvelle sera-t-elle adjugée? Si nous consultons le droit d'accession, il nous dira que la propriété de la maison doit rester au maître du sol; mais si nous consultons le bon sens, il n'est pas sûr qu'il nous donne toujours la même solution.
Les jurisconsultes ont ici prévu deux cas : celui où l'individu qui a fait construire la maison était [II-390] possesseur du sol de bonne foi, et celui où il était possesseur de mauvaise foi.
Dans le premier cas, ils décident que la maison appartient au propriétaire du sol; mais qu'il est tenu ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
Pourquoi, dans ce cas, la maison appartiendrat-elle au propriétaire du fonds? Est-ce parce qu'elle lui convient mieux qu'à celui qui l'a construite avec ses propres matériaux? Cela n'est guère probable. Il est bien sûr qu'elle convient à celui-ci, puisqu'il l'a faite; mais il ne l'est pas du tout qu'elle convient à celui-là.
La maison serait-elle adjugée au propriétaire du sol, par la raison que le sol a plus de valeur que la maison? Cela peut arriver quelquefois; mais cela n'est pas commun.
Une maison d'une valeur immense peut être élevée sur un terrain presque sans valeur. Supposons que le cas arrive: un riche propriétaire fait bâtir un château sur l'un des confins de sa terre où il a une belle vue. Lorsque le château est construit, il est constaté que le sol sur lequel il se trouve appartient à un homme sans fortune. Quel sera le parti que cet homme pourra prendre?
Il n'en est que deux : il faudra qu'il paie la [II-391] valeur du château, ou qu'il abandonne son fonds sans indemnité. Il ne pourra demander ni la suppression du bâtiment, ni le paiement du sol sur lequel il aura été élevé. Cela n'est guère conforme au bon sens, à la justice; mais c'est ainsi que l'ordonne le droit d'accession, consacré par l'art. 555 du Code civil.
Un autre exemple fera mieux comprendre encore combien il importe de consulter toujours la nature des choses, et de ne pas se laisser dominer par des mots qui souvent n'ont aucun sens.
Supposons qu'un homme possède un terrain dont il se croit réellement propriétaire, quoique sa possession ne réunisse pas toutes les conditions que la loi demande pour qu'il soit réputé de bonne foi; car il peut y avoir bonne foi dans le vrai sens du mot, quoiqu'il n'y ait pas bonne foi dans le sens légal.
Supposons, dis-je, que cet homme qui se croit mal à propos propriétaire, fasse construire un bâtiment sur le terrain qu'il croit lui appartenir : à qui appartiendra la propriété de ce bâtiment et du sol sur lequel il est établi?
Le propriétaire du sol a deux partis à prendre : il peut demander la suppression du bâtiment sans indemnité, ou bien il peut le retenir; mais, dans ce dernier cas, il doit rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre.
[II-392]
Qu'un bâtiment d'une valeur de cinq cent mille francs ou d'un million soit construit sur un terrain d'une valeur de dix ou douze mille francs, comme cela arrive souvent dans une grande ville; qu'une manufacture qui fournira des moyens d'existence à un village entier, soit élevée sur un terrain propre à servir de pâturage à quelques moutons; mais que le capitaliste qui aura fait construire le bâtiment ne soit pas propriétaire du sol, et qu'il ne réunisse pas toutes les conditions requises pour être réputé de bonne foi, toute la propriété nouvellement créée devra être détruite, sans qu'il en reste le moindre vestige, si le propriétaire du sol le veut ainsi.
Le fabricant, sa famille, ses créanciers, les habitans du pays qu'il faisait exister, seront peut-être ruinés: n'importe, le sol n'eût-il qu'une valeur de cinquante francs, le propriétaire sera satisfait.
On peut dire, sans doute, que cette disposition a été dictée par un sentiment profond du respect qu'on doit à la propriété; mais il y a ici deux propriétés en conflit : l'une, que nous supposons de la valeur de cent cinquante ou de deux cents francs, et l'autre, que nous supposons de cinq cent mille francs ou d'un million. Or, détruire une valeur d'un million de francs, en faveur d'une valeur de deux cents francs, est une singulière manière de respecter la propriété.
[II-393]
Ajoutons qu'il pourrait arriver que la propriété de cinq cent mille francs ou d'un million, fût affectée au paiement de créances dues à des mineurs, à des femmes ou à d'autres personnes fort innocentes de la prétendue mauvaise foi de celui qui aurait fait construire le bâtiment.
Mais ce n'est pas tout: supposons que le propriétaire du sol soit honnête homme, et qu'il veuille retenir le bâtiment, au lieu d'en demander la suppression; quelle est la valeur qu'il devra payer pour en rester propriétaire?
Il ne suffira pas de payer la valeur actuelle; il faudra qu'il paye tout ce qu'il aura coûté en matériaux et en main-d'œuvre. Si, par exemple, le bâtiment ne valait que cinq cent mille francs, et qu'il eût coûté un million, le propriétaire du sol ne pourrait le retenir qu'en payant un million. Il n'en serait pas ainsi dans le cas où le constructeur du bâtiment serait réputé de bonne foi dans ce cas, le propriétaire du sol aurait le choix de payer les matériaux et la main-d'œuvre, ou la valeur actuelle du bâtiment. Or, conçoit-on que la mauvaise foi du constructeur du bâtiment prive le propriétaire du sol d'une faculté qu'il aurait dans le cas où il y aurait eu bonne foi?
Il est vrai que si la loi le prive de la faculté de garder le bâtiment, en en payant la juste valeur, elle l'autorise à le faire supprimer sans indemnité, [II-394] et qu'elle lui donne ainsi le moyen de faire capituler son adversaire; mais on ne saurait voir dans tout cela ni raison ni justice.
Les diverses questions de propriété auxquelles peuvent donner naissance les modifications que font subir les fleuves et les rivières aux héritages qui les bordent, sont résolues par le droit d'accession. En traitant ces questions, dans un des chapitres qui précèdent, j'ai fait connaître les véritables motifs des solutions qui en ont été données.
C'est aussi par le droit d'accession que le Code civil résout la question de savoir à qui appartiennent les pigeons, lapins et poissons qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang; il décide qu'ils appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.
[II-395]
CHAPITRE L.
Du mélange de propriétés mobilières appartenant à différens maîtres.↩
Si le droit d'accession a jeté dans l'embarras les jurisconsultes qui l'ont imaginé ou adopté, quand ils en ont fait l'application à des propriétés immobilières, il a fait naître des difficultés bien plus graves quand ils ont voulu l'appliquer à des propriétés mobilières.
Quand il est question d'immeubles, il est facile de voir quelle est, entre deux choses, celle qui va s'ajouter à l'autre ; s'il s'agit, par exemple, de prononcer sur la propriété d'une maison construite sur le fonds d'autrui, on ne peut pas mettre en doute si ce sont les matériaux qu'on a placés sur le fonds, ou si c'est le fonds qu'on a placé sous les matériaux. Il y a là un fait évident que l'homme le moins intelligent est capable de reconnaître; ce fait, il est vrai, ne devrait avoir qu'une bien faible influence sur la solution de questions de propriété; mais on conçoit cependant que les jurisconsultes lui aient donné une certaine importance.
Mais, lorsque des choses mobilières se réunissent [II-396] pour ne former qu'un seul tout, ou qu'une personne fait une chose nouvelle avec une matière qui appartient à une autre personne, quel est celui des deux propriétaires au profit de qui le droit d'accession se prononcera? S'il s'agit, par exemple d'un couteau, est-ce la propriété du manche qui entraînera la propriété de la lame, ou la propriété de la lame qui entraînera la propriété du manche par droit d'accession? Si, d'un bloc de marbre qui ne lui appartient pas, un sculpteur fait une belle statue, à qui, du statuaire ou du propriétaire du marbre, appartiendra le nouvel objet produit? Si le blé de mon voisin se mêle au mien, auquel des deux appartiendra le mélange? Les questions de ce genre ont fort embarrassé les jurisconsultes romains; et lorsque les jurisconsultes modernes les ont abordées, ils ont eu bien de la peine à découvrir des principes propres à en donner la solution.
Il semble qu'aucune question n'a paru plus difficile à résoudre aux jurisconsultes de Rome, que celle de savoir à qui l'on doit adjuger une chose qu'une personne a faite avec une matière dont une autre avait la propriété. Les uns pensaient qu'il fallait l'adjuger au propriétaire de la matière, attendu que, sans matière, il ne peut pas exister de forme; les autres estimaient qu'il fallait l'adjuger à celui qui avait donné à la matière une forme [II-397] nouvelle, attendu qu'il n'y a point de matière sans forme.
Justinien se plaçant entre les deux sectes, n'adopta l'opinion ni de l'un ni de l'autre. Si la matière, dit-il , peut être réduite à sa première forme, la chose doit être adjugée au propriétaire de la matière ; si elle ne peut pas y être réduite, la chose appartient à l'auteur de la nouvelle forme. Quant à la question de savoir quel est l'intérêt des parties, ou quelle est celle des deux qui a la plus grande part dans la valeur de la chose produite, Justinien ne s'en occupe pas plus que les jurisconsultes entre lesquels il vient interposer son autorité, et sa décision n'est ni moins arbitraire, ni moins absurde que les leurs.
Le nouvel objet fabriqué se compose-t-il d'une matière fusible, d'or, d'argent, de bronze, de fer ou d'acier? Il appartient au propriétaire de la matière, quelque grande que soit d'ailleurs la valeur que l'artiste lui a donnée. Se compose-t-il de bois, de marbre, ou de toute autre matière qui ne peut pas être rendue à sa première forme, il faut l'adjuger à celui qui l'a fabriqué. Un artiste fait une statue équestre du plus grand prix avec du bronze dont il n'a pas la propriété; c'est le propriétaire de la matière auquel on adjugera l'ouvrage. Un autre transforme une pièce de bois en une paire de sabots, et il devient ainsi propriétaire de la [II-398] matière. Quel était le fondement de cette décision? Justinien lui-même n'aurait su le dire.
Les rédacteurs du Code civil ont rejeté les subtiles et puériles distinctions des jurisconsultes romains; mais comme ils n'avaient pas, sur l'origine et la nature de la propriété, des idées plus claires que celles de leurs prédécesseurs, il ne leur a pas été possible de découvrir des principes généraux applicables à toutes les questions qui pourraient se présenter. L'embarras dans lequel les a jetés le droit d'accession, relativement aux choses mobilières, se manifeste dès le premier article du chapitre.
« Le droit d'accession, disent-ils, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différens est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. Les règles suivantes serviront d'exemple. »
Pourquoi le droit d'accession est-il subordonné aux principes de l'équité naturelle, quand il a pour objet des choses mobilières, plutôt que lorsqu'il a pour objet des choses immobilières ? Ces principes, bons pour résoudre les questions auxquelles certaines propriétés peuvent donner naissance, seraient-ils mauvais, quand il s'agit de résoudre les questions que font naître des propriétés d'un autre genre? Les propriétaires de fonds de terre seraientils au-dessus des principes de l'équité naturelle, [II-399] et faut-il que les règles de la justice ne soient applicables qu'aux propriétaires d'objets mobiliers?
Les rédacteurs du Code civil ont donc voulu que ce qu'ils appellent droit d'accession fût subordonné aux principes de l'équité naturelle, dans les cas seulement où il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres; ils ont voulu qu'il cessât d'être subordonné à ces principes, toutes les fois qu'il aurait pour objet des choses immobilières, ou une chose immobilière et une chose mobilière.
Mais, puisqu'ils admettaient, dans certains cas, des principes supérieurs au droit d'accession; puisque ces principes doivent servir à résoudre les questions auxquelles donne naissance le mélange de diverses propriétés appartenant à différens maîtres, pourquoi ne les a-t-on pas clairement indiqués? Etaient-ils moins clairs ou plus difficiles à trouver que le droit d'accession, auxquels on dit qu'ils sont supérieurs? c'est parce qu'on n'avait pas des idées bien claires, soit sur l'origine, soit sur la nature des propriétés.
Ne pouvant énoncer clairement les principes dont les magistrats auraient à faire l'application, les rédacteurs du Code ont tenté de leur donner au moins des exemples. Les règles suivantes, ont-ils dit, serviront d'exemple au juge pour se déterminer [II-400] dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.
Cette manière de s'exprimer est loin d'être exacte. On peut bien dire et l'on dit même souvent qu'un exemple sert de règle; mais on ne peut pas dire, en droit, qu'une règle servira d'exemple pour juger des cas différens de ceux qu'elle a déterminés. Si les cas à juger sont les mêmes qu'on a prévus, la règle n'est pas un exemple, elle est une loi; s'ils sont différens, la règle n'apprend plus rien; elle n'est pas même un exemple; il faut recourir à d'autres principes.
Par les règles qu'il donne comme exemples, le Code civil décide que, lorsque deux choses appartenant à différens maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie; et l'on entend par la partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement et le complément de la première. Si néanmoins la chose unie était beaucoup plus précieuse que la principale, et si elle avait été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci pourrait demander que la chose unie fût séparée, pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelques [II-401] dégradations de la chose à laquelle elle aurait été jointe.
Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.
Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer ce qui en a été formé, en remboursant le prix de la main-d'œuvre. Cependant, si la main-d'œuvre était tellement importante, qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.
Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soient entièrement détruites, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière [II-402] qui lui appartenait; quant à l'autre, en raison à la fois de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'œuvre.
Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différens propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux. Si la matière appartenant à un des propriétaires, était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenant du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.
Dans tous les cas, où le propriétaire de la matière qui a été employée à son insu à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté ou valeur.
[II-403]
Ceux qui ont employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, peuvent aussi être condamnés à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice de poursuites extraordinaires, s'ils se sont rendus coupables de quelque délit.
On a vu, dans le chapitre précédent, que lorsqu'il s'agit de choses immobilières, le Code civil distingue le possesseur de bonne foi de celui qui n'est pas de bonne foi, dans le sens légal. Nous ne trouvons pas ici la même distinction: la position de celui qui fait usage de la matière d'autrui pour composer une chose nouvelle, sachant que cette matière ne lui appartient pas, n'est pas plus mauvaise, si, d'ailleurs, il n'a commis aucun délit, qu'elle ne le serait s'il avait cru être propriétaire de la matière dont il a fait usage. Dans les deux cas, il doit payer la valeur de la matière dont il s'est servi et payer les dommages-intérêts qu'il a causés; mais il ne doit rien au-delà. S'il a commis un délit, il doit en étre puni, soit par une amende, soit autrement; mais sa bonné foi ne peut nuire, ni sa mauvaise foi profiter au propriétaire de la matière.
Dans l'examen des questions qui peuvent naître de l'union de plusieurs choses appartenant à différens maîtres, ou du travail exercé par une personne sur une matière qui appartient à une autre, il est quelques principes qu'il faut ne jamais perdre [II-404] de vue, si l'on ne veut pas courir le risque de s'égarer.
Il faut, par exemple, ne jamais oublier que toute personne est propriétaire de la valeur à laquelle elle donne naissance, ou qu'elle a régulièrement reçue de la part du propriétaire pour en jouir et en disposer; que, si des choses appartenant à différens maîtres ont été unies pour n'en former qu'une seule, sans le concours de leurs volontés, et si elles peuvent être séparées, sans qu'il en résulte aucune destruction de valeur pour personne, il faut rendre à chacun ce qui lui appartient; que si elles ne peuvent être séparées sans qu'il en résulte une destruction de valeur, il faut, en général, adjuger la chose à celui qui l'a formée, comme étant celui à qui elle convient le mieux, ou du moins à celui qui, pour avoir la chose, a le moins à payer à l'autre ; que, dans aucun cas, il ne faut ordonner une destruction de valeur, qui ne serait pas suivie d'un avantage au moins équivalent; que celui qui a commis un délit doit en porter la peine, mais que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'un autre, ou être appauvri par le fait d'autrui.
[II-405]
CHAPITRE LI.
Des diverses manières dont une propriété peut être partagée.↩
UNE propriété peut devenir commune à plusieurs personnes par suite d'une multitude de circonstances: il ne s'agit pas ici de savoir quels sont les événemens qui peuvent la rendre commune; il s'agit seulement d'observer comment elle peut être divisée ou démembrée, et de déterminer les suites naturelles que doit avoir la division.
Un des principaux élémens de toute propriété est la puissance qu'elle a de nous procurer certaines jouissances, de satisfaire quelques uns de nos besoins: c'est par là qu'elle est surtout appréciée. Or il n'est aucun genre d'utilité qui ne puisse être commun à plusieurs personnes, et qui ne soit susceptible d'être divisé entre elles.
Une chose qu'on ne saurait partager matériellement, sans en détruire presque entièrement la valeur, telle qu'un cheval, une montre, une statue ou un tableau, peut cependant être commune à plusieurs personnes, et, dans la pratique, rien n'est plus facile que de s'en partager les avantages.
Pour déterminer les diverses manières dont une [II-406] propriété peut être partagée, il faut distinguer si elle est susceptible de produire des fruits, comme un champ, un pré, une vigne, ou si naturellement elle n'en produit aucun, comme une statue ou une pierre précieuse.
Si elle est susceptible de produire des fruits, comme une terre, les diverses manières dont on peut s'en partager les avantages, sont pre sque infinis: on peut faire le partage de la terre, des fruits, du temps de la jouissance, du fermage. Si l'on partage la terre, on peut diviser la superficie et la profondeur, de manière que chacun ait une part du dessus et du dessous. On peut aussi la diviser de manière que l'un ait la superficie, jusqu'à une certaine profondeur, et que l'autre ait le dessous pour y faire des constructions ou des fouilles. On peut la partager encore de manière que l'un en ait tous les produits, et que l'autre n'en retire qu'un avantage spécial, comme un droit de vue, un passage, un aqueduc, un égout.
Si, de sa nature, une chose est indivisible, comme un cheval, un tableau, une statue, il y a plusieurs manières de s'en partager les avantages: on peut diviser le temps de la jouissance, c'est-à-dire que chacun des propriétaires peut en avoir la possession entière pendant un temps déterminé; on peut la louer, et se partager le prix du loyer; on peut la vendre, et en partager la valeur.
[II-407]
Il n'est pas possible de déterminer ici les diverses manières dont toutes les propriétés peuvent être partagées; car il faudrait, pour cela, faire l'énumération des diverses espèces d'utilité qui peuvent se rencontrer dans chaque chose, et rechercher comment chaque espèce d'utilité peut être divisée il me suffit de faire observer que la part qu'on a dans une propriété, est en raison de l'utilité qu'on est en droit d'en retirer.
Lorsqu'une chose appartient à plusieurs personnes, chacune d'elles, disons-nous, est propriétaire de la part d'utilité qui lui revient; cette part est pour elle une véritable propriété. Cependant, les parts qui reviennent à chacun des co-propriétaires prennent souvent différentes dénominations; il importe de les remarquer, parceque nous sommes naturellement portés à croire que les choses changent de nature, toutes les fois qu'elles changent de noms. Cette erreur est si commune, que les hommes qui rédigent des lois ne savent pas toujours l'éviter: on en verra bientôt la preuve.
Une propriété appartient, je suppose, à deux personnes. Voulant la partager, elles conviennent que l'une en aura la jouissance exclusive pendant vingt années, et qu'à l'expiration de ce terme, l'autre en aura, à perpétuité, la jouissance et la disposition. Du moment que cette convention est accomplie, chacune des deux parties a sa part [II-408] de la chose, et cette part est pour elle une propriété dont elle peut disposer comme bon lui semble. Elle peut la vendre, l'échanger, la donner comme toute autre espèce de propriété.
Il n'est pas impossible que celui des deux propriétaires qui, pour sa part, a pris la jouissance exclusive de la chose, pendant un nombre d'années déterminée, ne soit mieux partagé que celui qui doit avoir plus tard le fonds en même temps que la jouissance. S'il s'agit, par exemple, d'un objet déterminé qui périt nécessairement par l'usage, comme un cheval, un meuble ou même une maison, celui qui a la jouissance pendant un certain nombre d'années, a une part plus considérable que celui qui n'a que la nue-propriété. Il en serait de même s'il s'agissait d'une terre ou d'un capital: une jouissance de trente années consécutives, par exemple, serait de beaucoup préférable à la nue-propriété.
Lorsqu'une chose se trouve ainsi partagée entre deux personnes de manière que l'une en a la jouissance exclusive pendant un nombre d'années déterminé, et que l'autre doit en avoir la jouissance et la disposition également exclusives, quand le temps pendant lequel le premier doit jouir est expiré, on donne le nom d'usufruit à la part dévolue au premier, et le nom de nue-propriété à la part dévolue au second.
[II-409]
Mais il ne faut pas perdre de vue qu'un usufruit, lorsqu'on le considère relativement à la personne à laquelle il appartient, est une véritable propriété, ou, si l'on aime mieux, une part considérable d'une de ces choses que nous désignons sous le nom de propriétés; l'usufruitier a le droit de jouir et de disposer de cette part comme bon lui semble, pourvu qu'il ne porte aucune atteinte aux droits de son copropriétaire.
Toutes les choses qui ont une valeur quelconque sont susceptibles d'être divisées de manière que l'un des propriétaires en ait la jouissance exclusive pendant un temps déterminé, et que l'autre en ait la jouissance et la disposition perpétuelles à l'expiration de ce temps. Les objets qui sé consomment par le premier usage qu'on en fait, comme le blé, le vin, le bois de chauffage, ne sont pas moins susceptibles que les autres de ce genre de division. Celui auquel l'usufruit de choses de ce genre est déféré, est tenu, non de les conserver, mais d'en rendre de même nature et de même valeur, à l'expiration du temps fixé pour la jouissance.
L'usufruit de choses qui se consomment par le premier usage qu'on en fait, n'est pas moins précieux que celui d'une maison, d'une terre ou d'une somme d'argent. La personne à laquelle il appartient a deux manières d'en jouir : l'une de les aliéner et de placer à intérêt le prix qu'il en a reçu ; [II-410] l'autre, de les consommer, et d'économiser ainsi les revenus dont elle aurait été obligée de faire la dépense. L'usufruit d'une somme de vingt mille francs pendant vingt ans, aurait infiniment plus de valeur que la nue-propriété de la même somme; car il donnerait à l'usufruitier vingt fois mille francs, et de plus l'intérêt composé.
Les auteurs du Code civil ont tenté de donner la définition de l'usufruit; mais ils n'ont pas mieux réussi que dans leur définition de la propriété. Suivant eux, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
Cette définition empruntée, en partie, au droit romain, renferme deux erreurs palpables [110]. L'usufruit est un démembrement, une fraction de la chose que nous appelons propriété, et cette fraction est plus ou moins considérable relativement à ce qui reste, selon que la durée de la jouissance doit être plus ou moins longue. Il résulte de là que, lorsqu'une chose est divisée entre deux personnes, de manière que l'une en a, pendant un temps donné, la jouissance exclusive, et que l'autre doit en avoir, à l'expiration de ce temps, la jouissance et la [II-411] disposition exclusives et perpétuelles, aucune des deux n'en a actuellement la propriété complète. Toutes les deux ont en réalité une fraction plus ou moins grande de la propriété.
Il ne faut pas oublier que, suivant la nature des choses, comme suivant la définition du Code civil, le droit de jouir et de disposer d'une chose, est au nombre des élémens essentiels de toute propriété. Mais, si le droit de propriété renferme nécessairement le droit de jouir d'une manière exclusive, il n'est pas vrai de dire que l'usufruit est le droit de jouir d'une chose dont un autre a la propriété. Ce serait dire, en d'autres termes, que l'usufruit est le droit de jouir exclusivement d'une chose dont une autre personne a le droit de jouir de la manière la plus absolue: ce serait affirmer l'existence simultanée de deux droits qui s'excluent.
La propriété, en donnant à ce mot le sens que les auteurs du Code civil y ont attaché, renferme tous les droits qu'une personne peut avoir sur une chose; il renferme, par conséquent, tous ceux qui peuvent appartenir à un usufruitier. Si l'on en extrait le droit de jouir de la chose pendant un certain nombre d'années, elle n'existe plus telle qu'elle a été définie, elle peut n'avoir presque plus de valeur. L'usufruit d'une maison, pendant un siècle, par exemple, serait une portion de la propriété tellement considérable, qu'on donnerait peu [II-412] de chose de ce qui resterait. Il n'est donc pas exact .de dire que l'usufruit est le droit de jouir d'une chose dont un autre a la propriété, c'est-à-dire a le droit de jouir et de disposer d'une manière absolue.
La seconde partie de la définition est moins claire, et n'est pas plus exacte que la première. On dit que l'usufruit est le droit de jouir d'une chose, à la charge d'en conserver la substance. Mais qu'est-ce qu'on entend par ce mot? L'idée de substance n'est-elle pas plus obscure que le mot qu'on a prétendu définir ? Substance vient de sub stare, être dessous, mais sous quoi? Sous les qualités des corps, dont nos sens sont frappés. Et qu'est-ce qui se trouve sous ces qualités? Personne ne saurait nous l'apprendre; aucune secte philosophique ne s'est jamais chargée de nous l'expliquer. Nous ne connaissons des choses que les qualités sensibles'; nous ne savons pas et nous ne saurons jamais quelle en est la substance, ni même s'il y a une substance.
Il n'est pas exact de dire, d'ailleurs, que l'usufruitier soit toujours obligé de conserver la substance de la chose dont il a l'usufruit, et qu'il ne soit tenu à rien de plus. Quand un usufruit est établi sur des comestibles, sur du blé, du vin, de l'huile, du fourrage, ou même sur une somme d'argent, l'usufruitier n'est pas obligé de conserver la substance de ces choses. Il a le droit d'en jouir et d'en disposer de la manière la plus absolue, [II-413] comme s'il en avait la propriété; il n'est tenu qu'à rendre, à la fin de l'usufruit, des choses de même nature et de même valeur. On peut avoir l'usufruit d'un cheval ou d'une rente viagère; si avant l'expiration du temps fixé pour la durée de l'usufruit, l'animal vient à périr ou la rente à s'éteindre, quelle est la substance qu'on devra conserver? Celui qui réduirait en lingots des bijoux d'un grand prix, en conserverait la substance; et cependant il excéderait les droits qui lui sont attribués.
On voit, par ces observations, et par celles que j'ai faites précédemment sur la manière dont la propriété a été définie, combien il est difficile, en législation, de donner des définitions exactes de choses très-compliquées. Ces définitions sont d'autant plus dangereuses, qu'elles disent presque toujours plus ou moins qu'on n'a voulu dire, et qu'elles compromettent l'autorité de la puissance législative. Il est, sans doute, au pouvoir d'un législateur de donner ou de défendre certaines actions; mais il n'est pas en son pouvoir de changer la nature des choses. S'il en donne une définition inexacte, il n'a pas plus d'autorité que n'en aurait un particulier qui tomberait dans l'erreur.
Un usufruit, n'étant en réalité qu'un démembrement de certaines propriétés, peut être établi par tous les moyens dont on peut faire usage pour [II-414] transporter ces propriétés d'une personne à une autre. Il est évident, par exemple, que celui qui peut vendre, échanger, donner ses propriétés, peut les partager de manière qu'une personne en ait l'entière jouissance pendant un temps déterminé, et qu'à l'expiration de ce temps une autre personne en ait la jouissance et la disposition. Il n'est pas moins évident qu'on peut mettre à cette jouissance toutes les conditions qu'on juge convenable, pourvu qu'elles n'aient rien de contraire aux bonnes mœurs ou aux prohibitions faites par les lois. Enfin, il est également incontestable qu'on peut l'établir sur toute espèce de biens, meubles ou immeubles. Cette puissance d'un propriétaire sur les choses qui lui appartiennent, est reconnue par la définition même qu'on a donnée de la propriété; la faculté de disposer des choses de la manière la plus absolue, emporte nécessairement la faculté de les partager comme on juge convenable.
Il est des cas où les lois attribuent à certaines personnes la jouissance temporaire ou l'usufruit de certaines choses, tandis qu'elles en attribuent à d'autres la disposition et la jouissanceà, l'expiration des droits accordés aux propriétaires : c'est ainsi qu'elles donnent, pour un temps, aux pères et mères l'usufruit des biens de leurs enfans mineurs. Les auteurs du Code civil ont pensé, en conséquence, qu'il était nécessaire de déterminer clairement les [II-415] droits et les obligations de l'usufruitier, et les circonstances qui mettraient fin à l'usufruit. Toutes les fois qu'un usufruit est constitué par la loi, c'est la loi elle-même qui en détermine la durée, et qui règle les obligations et les droits de l'usufruitier. Toutes les fois, au contraire, qu'un usufruit est établi par une convention particulière, par une donation ou par un testament, l'acte qui l'établit, en règle les conditions, et fixe, le temps auquel il doit finir. La loi n'intervient que pour régler les cas non prévus par le titre constitutif: elle fait l'office d'un acte auquel les parties s'en seraient rapportées.
Les droits de l'usufruitier, quand il n'existe pas de conditions contraires, consistent à jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils; à jouir, de plus, des droits de servitude, de passage, d'alluvion, et généralement de tous les droits attribués au propriétaire ; il peut, en outre, jouir, comme le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit, en se soumettant aux conditions prescrites par les lois ; mais il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.
On entend, par fruits naturels, les produits [II-416] spontanés de la terre, et le croît des animaux; les fruits industriels sont ceux qu'on obtient par la culture; les fruits civils sont le prix des baux à ferme, les loyers des maisons, les intérêts des capitaux placés, les arrérages des rentes.
Les fruits naturels et industriels, pendans par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. Ceux ,qui, au moment où l'usufruit finit, sont dans le même état, appartiennent au propriétaire. Il n'y a lieu, ni dans le premier cas, ni dans le second, à aucune récompense de part ni d'autre des labours et des semences. Mais aussi les droits de l'usufruitier, ni ceux du propriétaire, ne sauraient porter préjudice à la portion de fruits acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.
Les fruits civils, quelle qu'en soit la nature, s'acquièrent jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Ainsi, quand même les prix des baux à ferme, les loyers des maisons, les intérêts des capitaux, ne seraient pas exigibles au moment de la cessation de l'usufruit, l'usufruitier aurait droit à une part proportionnée à la durée de sa jouissance : il y aurait droit à un quart, si l'usufruit n'avait duré que trois mois, et à la moitié s'il avait eu six mois de durée. L'usufruitier d'une rente viagère a [II-417] le droit d'en percevoir les arrérages, et n'est tenu à aucune restitution.
Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, à la charge d'en rendre, en même quantité, de même qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit. S'il comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme le linge, les meubles meublans, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires, sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. S'il comprend des bois de haute futaie, l'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires pour les parties mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de [II-418] terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.
Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie; il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; et s'ils ne suffisent pas pour les réparations nécessaires, il peut en faire abattre, après en avoir fait constater la nécessité avec le propriétaire.
L'usufruitier peut prendre dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut prendre aussi sur les arbres, les produits annuels ou périodiques, en se conformant à l'usage du pays ou à la coutume des propriétaires, ainsi que les arbres fruitiers qui meurent, et ceux qui sont arrachés ou brisés par accident, accident, à la charge de les remplacer par d'autres; enfin, il peut s'approprier les arbres qu'il peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, en se conformant à l'usage des lieux pour le remplacement.
L'usufruitier peut jouir de son usufruit par lui-même, le donner à ferme, ou même le vendre, ou le céder à titre gratuit; il est seulement tenu, s'il le donne à ferme, de se conformer, pour la durée des baux, et les époques où ils doivent être renouvelés, aux règles établies par le Code civil pour le mari, à l'égard des biens de sa [II-419] femme; c'est-à-dire, que les baux qu'il fait pour un temps qui excède neuf années, ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires pour ceux auxquels appartient la nue-propriété, que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve [111].
La personne à laquelle appartient la nue-propriété, ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier; mais aussi l'usufruitier, de son côté, ne peut réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, quand même la valeur de la chose aurait été augmentée; il est autorisé seulement à enlever les glaces, tableaux ou autres ornemens qu'il aurait fait placer, à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
Si les obligations de l'usufruitier n'ont pas été déterminées par l'acte qui constitue l'usufruit, elles consistent à prendre les choses dans l'état où elles sont; à faire dresser, avant son entrée en jouissance, et en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un [II-420] état des immeubles sujets à l'usufruit, et à fournir caution de jouir en bon père de famille.
Une caution ne peut cependant être exigée des pères et mères ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfans, du vendeur ou du donateur sous réserve d'usufruit, ni de l'usufruitier qui en a été dispensé par l'acte sur lequel ses droits sont fondés.
Si l'usufruitier ne peut pas on ne veut pas donner caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre; les sommes comprises dans l'usufruit sont placées; les denrées sont vendues, et le prix en est également placé; les meubles qui dépérissent par l'usage, si la personne à laquelle est dévolue la nue-propriété l'exige, sont aussi vendus, et le prix en est placé comme celui des denrées; néanmoins, les juges peuvent, sur la demande de l'usufruitier, ordonner qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
Lorsque les immeubles sont donnés à ferme, ou mis en séquestre, et que le prix des objets mobiliers est placé faute de caution, les droits de l'usufruitier se réduisent à percevoir les intérêts des sommes placées et le prix des fermages. Le retard de donner caution ne le prive pas des [II-421] fruits auxquels il a droit; ils lui sont dus du moment que l'usufruit est ouvert.
Les grosses réparations, telles que celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier, sont à la charge de la personne à laquelle appartient la nue-propriété; toutes les autres sont considérées comme réparations d'entretien, et sont mises, en conséquence, à la charge de l'usufruitier : ni l'un ni l'autre ne sont tenus de rebâtir ce qui tombe de vétusté, ou ce qui est détruit par cas fortuit.
Les charges annuelles, qui, dans l'usage, sont considérées comme charges des fruits, telles que les contributions, sont supportées par l'usufruitier; quant à celles qui sont imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, la personne à qui la nue-propriété appartient est obligée de les payer; mais l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts: si celui-ci en fait l'avance, il peut en demander le remboursement à la fin de l'usufruit.
La rente viagère ou pension alimentaire léguée par un testateur, est à la charge du légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et du légataire à titre universel de l'usufruit, dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.
L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds soumis à l'usufruit est hypothéqué s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le débiteur, à l'acquit duquel il a fait le paiement [112].
L'usufruitier universel ou à titre universel, et celui à qui la nue-propriété appartient, contribuent au paiement des dettes de la succession de la manière suivante : la valeur du fonds sujet à usufruit est estimée, et la contribution aux dettes est en raison de cette valeur. Si l'usufruitier consent à avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans intérêt. S'il ne veut pas faire cette avance, la personne à laquelle appartient la nue-propriété a le choix, ou de payer cette somme, et d'en exiger l'intérêt de l'usufruitier pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une partie de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
Si la propriété donne naissance à des procès, l'usufruitier n'est tenu que des frais de ceux qui concernent la jouissance, et des condamnations auxquelles ils peuvent donner lieu; les frais et les condamnations qui peuvent être la suite des autres sont à la charge de la nue-propriété. Il faut [II-423] remarquer cependant qu'un procès dans lequel la propriété entière serait mise en question, affecterait en même temps la nue-propriété et l'usufruit. Les parties intéressées devraient donc y contribuer en raison de leurs intérêts.
L'usufruitier est tenu de dénoncer à la personne à laquelle appartient la nue-propriété les usurpations commises sur son fonds pendant la durée de l'usufruit; s'il ne remplit pas cette obligation, il est responsable des conséquences que ces usurpations peuvent avoir, comme des dégradations qu'il aurait lui-même commises.
sans Si un animal sur lequel l'usufruit est établi périt sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu, ni d'en payer l'estimation, ni d'en rendre un autre. Il en serait de même si un troupeau périssait entièrement, par accident ou par maladie, la faute de l'usufruitier; seulement, dans ce dernier cas, l'usufruitier serait tenu de rendre compte des cuirs ou de leur valeur. Si le troupeau ne périssait pas entièrement, l'usufruitier serait tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui auraient péri.
L'usufruit s'éteint par l'expiration du temps pour lequel il a été constitué; par la mort naturelle ou civile de l'usufruitier; par la réunion sur la même tête de la qualité d'usufruitier et de propriétaire; par la perte totale de la chose sur [II-424] laquelle l'usufruit est établi; par le non - usage du droit pendant trente ans; enfin, par la renonciation de l'usufruitier.
L'usufruit peut cesser aussi par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Si l'extinction en est demandée pour une de ces deux causes, les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans la contestation pour la conservation de leurs droits, et offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayans-cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, mais à des corps collectifs, ne dure que trente ans, si la durée n'en est pas autrement fixée par le titre constitutif. S'il est accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixé, il dure jusqu'à cette époque, quand même ce tiers serait mort avant d'avoir atteint l'âge déterminé.
L'usufruitier peut toujours renoncer à son usufruit; [II-425] mais ses créanciers ont le droit de faire annuler la renonciation faite à leur préjudice.
Si une partie seulement de la chose soumise à l'us fruit est détruite, l'usufruitier conserve ses droits sur ce qui reste. Si l'usufruit n'est établi que su un bâtiment, et si ce bâtiment est détruit par ua incendie ou autre accident, ou s'il s'écroule de vétusté, tous les droits de l'usufruitier sont éteints; celui-ci n'a rien à prétendre, soit sur le sol, soit sur les matériaux. Cependant, l'usufruitier jouirait des matériaux et du sol, si le bâtiment faisait partie d'un domaine sur lequel l'usufruit serait établi.
La vente que fait de ses droits la personne à laquelle la nue-propriété appartient, ne produit aucun changement dans les droits de l'usufruitier, lequel continue de jouir de son usufruit, à moins qu'il n'y ait formellement renoncé.
Il peut arriver qu'un propriétaire, au lieu de partager sa propriété de manière que, pendant un temps, une personne en ait la jouissance exclusive, et qu'à l'expiration de ce temps, une autre personne en ait la jouissance et la disposition absolues, la divise de manière qu'un particulier, pendant un temps déterminé, puisse en faire usage pour ses besoins personnels et pour ceux de sa famille, et que tous les autres avantages que la chose peut produire, appartiennent à un tiers. Ce mode [II-426] de jouissance prend le nom de droit d'habitation, quand il s'applique à une maison, et le nom d'usage, quand il s'applique à tout autre immeuble.
Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et s'éteignent de la même manière que l'usufruit. Les personnes auxquelles ils appartiennent sont tenues, comme les usufruitiers, avant d'entrer en jouissance, de donner caution, et de faire des états et inventaires. L'étendue de ces droits est déterminée par le titre même qui les a établis, c'est-à-dire par la volonté des parties.
Si le titre constitutif n'en détermine pas l'étendue, et n'en fixe pas les conditions, ils sont réglés ainsi qu'il suit celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille; il peut en exiger pour les besoins des enfans qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.
Celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où le droit a été constitué; mais aussi il ne peut rien exiger au-delà de ce que demandent les besoins de sa famille. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujéti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au paiement des contributions, comme l'usufruitier. S'il ne prend qu'une partie [II-427] des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.
L'usager et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille; ils ne peuvent ni céder ni louer leurs droits.
[II-428]
CHAPITRE LII.
Du démembrement d'une propriété, pour le service ou l'utilité d'une autre propriété.↩
Si l'on peut démembrer ou partager un immeuble, de manière qu'une personne en ait la jouissance pendant un temps déterminé, et qu'à l'expiration de ce temps, une autre personne en ait la jouissance et la disposition perpétuelles, on peut la démembrer aussi dans la vue d'augmenter la valeur ou l'utilité d'un autre immeuble appartenant à un maître différent. Un propriétaire, par exemple, peut renoncer à élever aucun bâtiment sur son terrain, ou à y planter des arbres, afin de conserver une belle vue à une propriété voisine; il peut accorder un passage sur son champ pour le service d'un autre champ; on donne le droit d'y faire passer un cours d'eau pour arroser d'autres propriétés.
Lorsqu'une propriété immobilière est ainsi démembrée pour le service ou l'utilité d'une autre propriété de même genre, appartenant à une autre [II-429] personne, on donne le nom de servitude à la charge qui pèse sur la première; l'héritage auquel la servitude est due, prend le nom d'héritage dominant ; celui qui la doit, prend le nom d'héritage servant.
Les auteurs du Code civil ont distingué trois genres de servitudes : celles qui dérivent de la situation naturelle des lieux; celles qui sont établies par des dispositions législatives, et celles qui sont établies par le fait ou la volonté des propriétaires.
Ils mettent dans la première classe l'assujettissement des fonds inférieurs envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué. Ils déclarent, en conséquence, que le propriétaire inférieur ne peut élever aucune digue qui empêche cet écoulement, et que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui le rende onéreux.
S'il est vrai, comme le Code civil le déclare, qu'une servitude soit une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, on n'est peut-être pas très-fondé à mettre au rang des servitudes l'obligation dans laquelle se trouve le propriétaire d'un fonds, de laisser couler l'eau qui descend des lieux supérieurs, à moins qu'on ne mette en principe que c'est dans l'intérêt d'une certaine classe de propriétés que les lois de la gravitation ont été faites. Nous voyons ici la défense [II-430] faite aux propriétaires de certains fonds de se causer mutuellement aucun dommage: il est interdit aux uns de nuire aux propriétaires inférieurs, en rendant plus malfaisante l'eau qui coule de leurs héritages; il est interdit aux autres de nuire aux propriétés supérieures, en mettant des obstacles à cet écoulement. Mais cette réciprocité d'obligations, qui tend à conserver à chacun la pleine jouissance et la libre disposition des choses qui lui appartiennent, constitue-t-elle, à proprement parler, une double servitude? Y a-t-il des propriétés démembrées pour leur usage ou leur utilité réciproques? Les obligations qui sont des conséquences nécessaires de la nature des choses, doivent-elles être mises au rang des servitudes? je ne saurais le penser.
Le droit qu'on reconnaît à un propriétaire d'user à sa volonté de la source qu'il a dans son héritage, celui de se servir de l'eau courante qui le borde ou le traverse, ne sont pas non plus des servitudes. Quand une chose est commune à plusieurs personnes, comme les chemins publics et les cours d'eau, l'usage qui appartient à chacune d'elles, n'est pas une servitudes pour les autres. Le droit de clore son héritage, que le Code civil a mis également parmi les servitudes qui dérivent de la situation des lieux, n'est pas plus une servitude que le droit de fermer la porte de sa maison. L'obligation réciproque de concourir au [II-431] bornage de sa propriété, quand le propriétaire voisin l'exige, me semble de même avoir été mise mal à propos au rang des servitudes; c'est tout simplement un moyen de prévenir les usurpations, et de garantir à chacun ce qui lui appartient.
Le Code civil ne reconnaît à un propriétaire le droit d'user de la source qu'il a dans son fond, que sauf le droit que le propriétaire inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription. Il ajoute que la prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir que par uue jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparens destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété. Une servitude qui ne peut s'acquérir qu'au moyen d'une possession de trente ans, et d'ouvrages apparens constatant qu'on a possédé à titre de propriétaire, ne dérive pas essentiellement de la situation des lieux. La disposition législative qui l'établit aurait dû, par conséquent, être placée dans un autre chapitre.
Les auteurs du Code civil ont mis dans le chapitre relatif aux servitudes établies par la loi, une multitude de dispositions qui n'ont rien de commun avec les servitudes, et qui n'ont pas d'autre objet que de résoudre des questions de propriétés. J'en ai fait l'observation ailleurs, en parlant des limites [II-432] qui résultent pour chaque propriété, des propriétés qui l'environnent.
Ils déclarent d'abord que les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou l'utilité communale, ou l'utilité particulière, comme si ce caractère n'était pas commun à tous les genres de servitudes qu'on a établis; comme s'il était plus licite de dégrader une grande route ou un canal, en donnant aux eaux qui descendent des lieux supérieurs, une force inaccoutumée, que de dégrader une propriété particulière; comme si les propriétaires inférieurs, qui sont tenus de laisser couler les eaux des fonds supérieurs, quand ces fonds appartiennent à des particuliers, avaient le droit de les inonder au moyen de digues, quand ils appartiennent à des communes ou à l'Etat !
Les servitudes établies par la loi pour l'utilité publique ou communale, ont pour objet, suivant le Code civil, le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. On a pu voir dans les chapitres relatifs à la propriété des cours d'eau, à la propriété des chemins publics, et aux lois rendues à différentes époques sur ces matières, en quoi consistent les servitudes de cette espèce.
J'ai précédemment fait observer que toutes les propriétés immobilières sont limitées les unes par [II-433] les autres, et j'ai démontré que les limites qu'elles se donnent réciproquement, n'ont rien de commun avec les servitudes proprement dites. Chacun ne peut, en effet, jouir et disposer des choses qui lui appartiennent, que sous la condition de respecter dans les autres des droits qui sont égaux aux siens : mon voisin a le droit de jouir et de disposer de son champ, comme j'ai le droit de jouir et de disposer du mien. Si donc une loi nous interdit de nous nuire mutuellement par l'usage ou la disposition de nos héritages, elle n'a ni pour objet, ni pour effet, de consacrer une propriété à l'usage ou à l'utilité d'une autre. Les deux propriétés restant égales, quant aux droits et aux obligations des propriétaires, il n'y a ni héritage servant, ni héritage dominant; on ne peut pas dire, par conséquent, qu'il y a servitude de l'un au profit de l'autre. Les auteurs du Code civil, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer en parlant des limites qu'imposent à chaque propriété les propriétés dont elle est environnée [113], ont donc commis une grave erreur, quand ils ont classé parmi les servitudes établies par la loi, les obligations ayant pour objet d'empêcher que des propriétaires dont les héritages se touchent, ne se nuisent mutuellement, au moyen de plantations, de constructions ou de fouilles.
[II-434]
Il existe souvent, entre deux héritages limitrophes, des choses qui sont utiles à l'un et à l'autre, telles que des haies, des fossés, des murs. Si ces choses sont communes, il en résulte pour les propriétaires des droits et des obligations réciproques; mais cette communauté n'engendre aucune servitude. Toutes les fois, en effet, qu'il y a égalité de droits et d'obligations, et qu'un des deux héritages n'est pas en partie consacré à l'usage et à l'utilité de l'autre, il n'existe de servitude pour aucun. Il n'y a pas, non plus, de servitude, par le seul fait qu'une haie, un fossé, un mur de séparation, appartient à un des deux propriétaires. C'est donc sans aucun fondement que les auteurs du Code civil ont placé dans le chapitre relatif aux servitudes établies par la loi, une multitude de dispositions relatives à la mitoyenneté des haies, des murs ou des fossés de séparation.
Il n'y a de véritables servitudes établies par les lois, que celles qui pèsent sur les propriétés situées aux environs des places de guerre, des postes militaires, des forêts nationales, et de quelques villes closes pour la perception des droits d'octroi, et celles qui sont accordées aux propriétaires de fonds enclavés, pour arriver jusqu'à la voie publique.
Toute personne qui peut aliéner une propriété immobilière, peut la soumettre à une charge, dans [II-435] l'intérêt d'une propriété appartenant à un maître différent, pourvu que les services auxquels il la soumet, n'aient rien de contraire à l'ordre public. Lorsqu'une propriété est ainsi assujétie à une autre par la volonté du propriétaire, les droits et les obligations qui résultent de cet assujétissement, sont déterminés par l'acte même qui les établit. Le Code civil ne les règle que dans les cas qui n'ont pas été prévus par le titre constitutif.
On a divisé les servitudes en plusieurs classes: celles qui sont établies pour le service ou l'utilité d'un bâtiment sont dites urbaines, même quand le bâtiment est situé à la campagne; celles qui sont établies pour le service ou l'utilité d'un fonds de terre, sont dites rurales, même quand le fonds de terre auquel elles sont dues est situé dans l'intérieur d'une ville.
On a aussi distingué les servitudes continues des servitudes discontinues; on a mis dans la classe des premières, celles dont l'usage est ou peut être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de l'homme, comme les conduites d'eau, les égouts, les vues; on a placé dans la seconde, celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées, comme les droits de passage, de puisage, de pacage et autres semblables.
Enfin, on a distingué les servitudes apparentes des servitudes non apparentes; on a mis parmi les [II-436] premières, celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'un acqueduc, une fenêtre, une porte; on a mis au nombre des secondes, celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de bâtir au-delà d'une certaine hauteur.
La distinction faite par les auteurs du Code civil, entre les servitudes rurales et les servitudes urbaines, ne les a conduits à rien dans la pratique aussi n'en est-il plus question du moment qu'elle a été faite; elle était donc inutile.
Les autres distinctions avaient uniquement pour objet de déterminer comment les unes pourraient s'établir ou s'éteindre; car toutes ne sont pas, à cet égard, assujéties aux mêmes règles.
Les servitudes continues ou apparentes, peuvent être acquises par des titres ou par la possession de trente ans; les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres; celles-ci ne peuvent pas être acquises même par la possession immémoriale.
Cependant, lorsque deux héritages ont appartenu au même propriétaire, la destination du père de famille vaut titre; et il y a destination du père de famille quand la personne à laquelle les deux propriétés ont appartenu, a mis les choses dans l'état duquel résulte la servitude.
[II-437]
Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des deux, sans s'expliquer sur la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur ou à la charge du fonds aliéné. Celui qui accorde une servitude accorde par cela même tous les droits nécessaires pour en faire usage; s'il donne, par exemple, le droit de puiser de l'eau à sa fontaine, il est censé donner le passage nécessaire pour y arriver.
Le titre constitutif des servitudes qui ne peuvent pas être acquises par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, émané du propriétaire du fonds asservi.
Le propriétaire de l'héritage auquel une servitude est due, a droit de faire à ses frais tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour les conserver; mais il ne peut exiger que ces ouvrages soient faits aux frais du propriétaire du fonds servant, à moins que le contraire n'ait été formellement stipulé. Dans ce dernier cas, le propriétaire de l'héritage par lequel la servitude est due, peut s'affranchir de cette charge, en abandonnant le fonds assujéti, au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
Si l'héritage au profit duquel la servitude est établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition [II-438] du fonds assujéti soit aggravée; si, par exemple, il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires sont obligés de l'exercer sur le même endroit.
Le propriétaire du fonds qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. De son côté, le propriétaire du fonds par lequel la servitude est due, ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Il ne peut, par exemple, changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Néanmoins, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujéti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Les servitudes cessent quand les choses se trouvent dans un tel état qu'on ne peut plus en user, elles revivent si les choses sont rétablis de manière qu'on puisse en faire usage. Néanmoins, l'extinction serait définitive, si la cessation avait duré pendant trente années.
[II-439]
Les servitudes s'éteignent, en outre, par la réunion dans la même main, de l'héritage qui la doit, et de celui à qui elle est due, et par le non-usage pendant trente ans. Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même.
Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous. Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.
Il peut arriver que, par suite de quelque accident naturel, le chemin qui conduit dans une propriété soit détruit, et que le propriétaire, pour y arriver, n'ait pas acquis le droit de passer sur les héritages voisins. Toutes les fois qu'une propriété se trouve ainsi enclavée, le propriétaire qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il doit [II-440] occasionner. En pareil cas, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, à moins qu'en le prenant d'un autre côté, il ne soit moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Le droit à une indemnité pour le passage peut s'éteindre par la prescription comme toutes les autres créances..
Des jurisconsultes ont prétendu que la partie du Code civil dans laquelle les principes sur les servitudes sont exposés, n'était pas complète; ils auraient voulu qu'elle fût beaucoup plus étendue. Il me paraît évident, au contraire, que le titre de ce code, relatif aux servitudes ou services fonciers, est trop étendu, parce qu'on y a fait entrer un grand nombre de dispositions qui appartiennent à d'autres matières. Si l'on mettait, dans l'étude et dans l'enseignement du droit, plus de logique et surtout de méthode qu'on n'y en met ordinairement, on verrait que, pour bien résoudre les questions qui se présentent sur chaque sujet, il suffit de connaître un petit nombre de principes. Un législateur ne doit pas faire l'office d'un jurisconsulte; il doit clairement établir sur chaque matière les principes qui doivent la régir; mais, quand il les a proclamés, il n'a nul besoin d'en faire le commentaire.
Pour trouver la solution de la plupart des questions [II-441] auxquelles les servitudes peuvent donner naissance, il suffit d'en bien connaître la nature et l'objet ; il ne faut que se rappeler qu'une servitude n'est que le démembrement d'une propriété immobilière, pour le service ou l'utilité d'une autre propriété du même genre. Tout propriétaire qui établit une charge sur son héritage, pour le service ou l'utilité d'un héritage appartenant à une autre personne, aliène, par cela même, une fraction de sa propriété ; il abandonne, en partie, le droit d'en jouir ou celui d'en disposer. La part de propriété dont il se dépouille, devient une partie intégrante de l'héritage pour le service ou l'utilité duquel l'aliénation est faite; celui-ci s'accroît de tout ce qui est perdu par celui-là.
De là résultent les droits et les obligations réciproques des propriétaires des deux héritages. Pour déterminer l'étendue de ces droits et de ces obligations, il n'y a pas d'autres règles à suivre que celles qui servent à résoudre toutes les questions de propriété. Chacun des deux propriétaires paie les frais d'entretien qu'exige la chose qui lui appartient; chacun jouit et dispose comme il l'entend de sa propriété, pourvu qu'il ne porte aucune atteinte à celle de son voisin. La servitude étant une fraction ou un démembrement de la propriété sur laquelle elle est établie, s'éteint lorsque cette propriété périt: la partie ne saurait exister quand le [II-442] tout est anéanti. Ayant uniquement pour objet le service ou l'utilité d'un autre fonds, elle s'éteint également quand un fonds n'existe plus ; car il n'y a pas de service à rendre à ce qui n'a plus d'existence. Pouvant être créée par les moyens à l'aide desquels une propriété se transmet d'une personne à une autre, elle peut être abolie par les mêmes moyens.
Les démembremens de propriété, qui ont pour objet de créer des servitudes, ayant généralement lieu par l'effet de la volonté des propriétaires, il s'ensuit que la plupart des questions auxquelles les servitudes donnent naissance, ne peuvent être résolues que par une bonne interprétation des actes qui les ont établies. Il faut donc s'en rapporter, à cet égard, aux règles suivies pour l'interprétation des conventions ou des autres actes au moyen desquels les propriétés se transmettent d'une personne à une autre.
[II-443]
CHAPITRE LIII.
De la classification des propriétés, ou de la distinction des biens.↩
AYANT vu quels sont les élémens dont les propriétés sont généralement composées, et quelles sont les diverses manières dont elles peuvent être partagées, il reste à examiner comment elles doivent être classés, et comment elles l'ont été, soit par les jurisconsultes, soit par les législateurs.
Il n'existe dans la nature que des individus; les espèces, les genres, ne sont que des conceptions de notre esprit : ce sont des méthodes au moyen desquelles nous rendons nos études plus faciles, et donnons à notre langage plus de précision et de généralité.
En désignant par un seul mot tous les individus entre lesquels il existe un grand nombre de points de ressemblance, ou des qualités communes, nous pouvons donner à nos affirmations et à nos raisonnemens une généralité qui serait impossible sans l'emploi de ce moyen.
[II-444]
Si l'on ne divisait pas en espèces et en genres les individus qui existent dans la nature, il n'y aurait pas de science possible; on ne connaîtrait que des faits individuels dont on ne saurait tirer aucune conclusion générale.
Mais quel peut être, dans la science de la législation, l'objet des classifications ou de la division en diverses espèces, des choses ou des personnes? Est-il de faciliter l'observation de toutes les qualités particulières qui se trouvent dans les personnes ou les choses, qu'on divise en plusieurs classes? Non, sans doute si l'on classait les propriétés par les différences ou par les points de ressemblance qui existent entre elles, on formerait un nombre infini de genres et d'espèces, et ces divisions ne seraient d'aucune utilité.
L'objet pour lequel on divise, en législation, les choses ou les personnes en diverses classes, est de soumettre à certaines règles ou à certaines dispositions législatives, les choses, les personnes ou les actions qui ont un certain nombre de points de ressemblance : c'est ainsi, par exemple, qu'on divise en genres et en espèces les actions punissables, afin de soumettre aux mêmes peines, les personnes qui les commettent; c'est encore ainsi qu'on divise les personnes en diverses classes, afin de pouvoir soumettre les unes à des règles qui ne conviendraient pas pour les autres.
[II-445]
Il ne suffit pas, pour former une classe particulière de propriétés, qu'elles soient l'objet d'une disposition spéciale d'une loi; car, si cela suffisait, il faudrait faire un nombre immense de divisions. Il n'est, en effet, presque aucun objet propre à satisfaire quelqu'un de nos besoins, sur lequel la puissance législative n'ait cru devoir prendre quelque mesure. On a fait des lois sur les forêts, sur les mines, sur les vignes, sur les boissons, sur les tabacs, sur le salpêtre, sur la poudre à canon, et sur une multitude d'autres choses. On ferait cependant une très-mauvaise classification dans un code de lois, ou dans un traité général de législation, si l'on disait que les propriétés immobilières se divisent en vignes, en forêts, en mines, en champs ou en prairies.
Il y a deux manières de considérer les choses auxquelles nous donnons le nom de propriétés, en elles-mêmes ou dans leur nature, et dans les rapports qu'elles ont avec une certaine classe de personnes. Si nous les considérons en elles-mêmes, nous n'avons pas à nous occuper de tous les points par lesquels elles se ressemblent, et de ceux par où elles diffèrent; il nous suffit d'observer les qualités qui influent sur l'ensemble de la législation. Nous devons négliger les autres, même lorsqu'elles ont été l'objet de lois spéciales.
La manière dont il convient de classer les [II-446] propriétés dépend de la matière dont on s'occupe: si un homme traite de la police, il pourra les consi– dérer sous le rapport de la sûreté, de la salubrité, de la rareté, de l'abondance; s'il traite des impôts, il pourra les considérer dans les rapports qu'elles auront avec les revenus publics; il pourra distinguer celles qui sont imposables de celles qui ne le sont pas, et faire des premières autant de divisions qu'il y aura d'impôts différens.
Nous n'avons à nous occuper ici que de législation générale : toutes les propriétés sont de notre domaine; mais nous ne devons les considérer que dans les rapports qu'elles ont avec l'ensemble des lois. Si, en les considérant sous un point de vue général, nous trouvons qu'il existe, entre les unes et les autres, des différences tellement marquées, qu'elles dominent l'ensemble de la législation, et influent sur la plupart des lois qui régissent les propriétés, nous sommes obligés d'en former diverses classes, afin de pouvoir désigner par un seul mot, celles qui doivent être soumises aux mêmes règles. Si les différences qui nous frappent n'ont aucune influence sur la législation générale, si elles n'exigent que quelques dispositions spéciales pour des cas déterminés, elles ne suffisent pas pour motiver une classification particulière, quelque grandes que soient d'ailleurs ces différences.
On voudra bien ne pas perdre de vue qu'il ne [II-447] s'agit ici que d'une question de méthode; tout se réduit à trouver l'ordre le plus propre à faciliter les opérations de notre entendement; pour un législateur qui divise en genres et en espèces, les divers objets dont il s'occupe, il ne s'agit, comme pour un jurisconsulte, que de classer les choses de manière qu'il puisse exposer ses pensées dans le moindre nombre de termes possibles, et avec assez de clarté pour être toujours parfaitement compris.
Les jurisconsultes romains avaient divisé les choses en un grand nombre de classes. Ils distinguaient d'abord celles qui sont dans notre patrimoine, de celles qui n'y sont pas, division qui comprenait tout ce qui existe dans l'univers. Dans la pratique, cette distinction ne pouvait être d'aucune utilité.
Ils avaient fait une autre division qui comprenait l'universalité des choses : ils avaient mis d'un côté toutes les choses corporelles, et de l'autre les choses incorporelles, telles que les droits et les obligations.
Une troisième division renfermait quatre classes: les choses communes au genre humain, les choses publiques ou nationales, les choses appartenant à des villes ou à des corporations, et enfin les choses appartenant à des particuliers.
Une quatrième division comprenait les choses sacrées ou appartenant à la religion, les choses religieuses ou consacrées aux morts, les choses saintes [II-448] ou placées sous une protection spéciale des lois, telles que les portes des villes, les murs, les fortifications.
Une cinquième division renfermait les choses fongibles, c'est-à-dire qui se consomment par le premier emploi qu'on eu fait, telles que nos alimens, et les choses non fongibles, telles que des maisons.
Enfin, ils avaient divisé les choses en meubles et en immeubles : cette dernière classification a été conservée chez toutes les nations.
Un jurisconsulte philosophe, qui a rendu d'immenses services à la législation, Jérémie Bentham, a proposé de classer d'une nouvelle manière les choses qui tombent sous l'empire des lois; mais il semble avoir oublié, dans sa classification, le principe d'utilité qui l'a dirigé dans la plupart de ses recherches.
Toutes ses divisions sont fondées sur la nature même des choses; mais cela ne suffit pas pour les faire admettre : il faudrait de plus qu'elles fussent appropriées à la science pour laquelle elles sont faites, et c'est là ce qui leur manque.
Bentham divise d'abord les choses en naturelles et en artificielles. Les premières, suivant la définition qu'il en donne, sont celles auxquelles leurs noms respectifs peuvent convenir dans l'état où elles se trouvent, lorsqu'elles sortent des mains de [II-449] la nature, avant que d'êtres modifiées par l'industrie humaine, telles que les productions animales ou végétales. Les secondes sont celles qui ne peuvent acquérir leurs appellations respectives qu'en vertu des qualités que leur donne l'industrie humaine, telles que des meubles, des vêtemens.
L'auteur de cette division reconnaît que les deux classes se touchent par une infinité de points, et que la ligne par laquelle on les séparera, sera le plus souvent arbitraire; mais cela n'empêche pas qu'il ne soit persuadé de la nécessité de cette classification dans un bon code civil; il l'a croît indispensable, ne fut-ce que pour avoir la paix.
On a eu la paix, quoique cette décision n'ait pas été admise, et quand la guerre a eu lieu, ce n'est pas parce que les choses n'avaient pas été classées en choses naturelles et en choses artificielles. Des choses ne doivent former une classe particulière, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, que lorsque les qualités qui sont inhérentes à leur nature, exerçent quelque influence sur les dispositions générales des lois. Or, la circonstance qu'une chose est naturelle ou artificielle, n'influe en aucune manière sur l'ensemble de la législation; les lois sous l'empire desquelles sont placés le blé, la laine, les fruits qui composent la récolte d'un fermier, ne sont pas différentes des lois sous l'empire desquelles se trouvent les draps d'un fabricant ou la farine d'un [II-450] meunier; et si les choses artificielles doivent être régies par les mêmes dispositions que les choses artificielles, à quoi bon les distinguer les uns des autres dans la science de la législation?
La seconde division de Bentham est celle que les lois de tous les pays ont admise; elle classe les choses en meubles et en immeubles; mais elle n'est pas motivée. On en verrra bientôt l'importance et la nécessité.
Les divisions des choses en employables et en consumables, en simples et en complexes, et quelques autres que le jurisconsulte anglais a cru devoir adopter, ne sont pas moins inutiles que celle qui les distingue en naturelles et en artificielles. Une glace, un vase, un flambeau, sont des choses simples; une pendule, une montre, sont des choses complexes; mais quelle est l'influence que ces différences peuvent exercer sur un code civil, sur un code pénal ou sur un code de procé dure? La division à laquelle Bentham attacha le plus d'importance, est celle qui distingue les objets en sensibles et ou insensibles; suivant lui, cette division dont les romanistes ne se sont pas occupés, vaut toutes les autres. Je ne saurais partager cette opinion; la distinction dont il s'agit ici, n'est pas moins inutile dans un traité de législation que la plupart de celles dont j'ai précédemment parlé.
Les Anglais ont pensé qu'ils devaient réprimer, [II-451] par des peines de police, les cruautés gratuites exercées sur certains animaux, et particulièrement sur les animaux domestiques. Les dispositions qu'ils ont prises à cet égard, sont très sages, et devraient être adoptées partout; car nulle part des actes de cruauté ne devraient être tolérés, surtout à l'égard des animaux qui nous rendent les plus grands services, et qui, à cause de cela, sont constamment exposés à la brutalité des hommes.
Mais il ne suffit pas, je l'ai déjà fait observer, qu'une chose soit l'objet d'une loi spéciale, pour qu'il soit bon d'en faire une classe à part dans un code général. Admettons qu'une loi réprime les cruautés gratuites exercées sur certains animaux ; cette répression exigera sans doute un petit nombre de dispositions dans un code de police; mais la circonstance de la sensibilité ou de l'insensibilité des choses sera sans influence sur les autres parties de la législation. Pour s'en convaincre, il suffit de parcourir les dispositions des divers codes qui existent parmi nous; non seulement on ne sent pas la nécessité d'une telle division, mais il est impossible de trouver un seul cas où il serait bon d'en faire usage. Elle est d'autant moins admissible qu'il est une multitude d'êtres sensibles qu'il serait ridicule de placer sous la protection des lois.
Plusieurs jurisconsultes avaient divisé les choses qui sont l'objet de la législation, en biens corporels, [II-452] et en biens incorporels. M. Toulier adopte cette division comme la meilleure; il la considère comme la plus générale, la plus exacte, la plus propre à faire connaître la véritable nature des choses. Cette opinion me paraît peu fondée : il y a, ce me semble, peu d'utilité à mettre dans une classe toutes les choses ou toutes les propriétés ; et à mettre dans une autre, les droits et les obligations. Cette classification n'exerce aucune influence sur l'ensemble des lois, et par conséquent elle est au moins inutile.
Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que l'objet principal de toute division, est de simplifier le travail de l'esprit, ou de donner plus de concision au langage, en désignant un grand nombre de choses, à l'aide d'un seul mot; c'est ainsi par exemple qu'au moyen du mot immeubles on désigne les bois, les champs, les prairies, les vignes, les maisons et beaucoup d'autres choses, et qu'au moyen du mot meubles on désigne un nombre de choses encore plus grand. Mais, quand on fait des divisions inutiles, on ne rend pas les idées plus claires; au contraire, on les obscurcit; au lieu de simplifier le travail de l'esprit, on le complique; on le rend plus difficile. Toute division inutile doit donc être repoussée.
J'ai déjà fait observer qu'il y a deux manières de considérer les choses, en elles-mêmes, et abstraction faite des personnes à qui elles à qui elles [II-453] appartiennent, et dans les rapports qu'elles ont avec ceux qui les possèdent.
Quand on les considère en elles-mêmes, et par les qualités inhérentes à leur nature, la classification la plus simple et la plus naturelle, celle dont l'influence se fait sentir dans presque toutes les parties de la législation, est celle que les auteurs du Code civil ont adoptée, celle qui range toutes les propriétés et tous les biens, sous les dénominations de meubles et d'immeubles.
Ces dénominations sont d'autant mieux choisies qu'elles indiquent les principales différences qui existent entre les choses, et qu'elles motivent ainsi, du moins en partie, les différences des règles auxquelles elles sont soumises. On désigne, en effet, par le mot meubles, toutes les choses qui sont mobiles de leur nature, ou qu'on peut transporter d'un lieu à un autre sans les dégrader. On entend, au contraire par le mot immeubles, toutes les choses qui, de leur nature, sont immobiles et qu'on ne saurait déplacer sans les détruire ou du moins leur faire subir des dégradations considérables. Les différences qui existent entre ces deux genres de biens, sont très-nombreuses, et l'influence s'en fait sentir sur les principales branches de la législation; aussi cette classification est admise par toutes les nations policées, et elle exerce partout à peu près la même influence.
[II-454]
Voici quels sont les points principaux sur lesquels ces deux genres de biens diffèrent, et qui ont exigé pour les uns, des dispositions ou des règles qu'on n'a pas crues nécessaires pour les autres.
Les meubles, comme le mot l'indique, peuvent être aisément déplacés sans dégradation; les immeubles, comme le mot l'indique encore, ne peuvent être déplacés.
En général, les meubles de même espèce se ressemblent, et peuvent être difficilement distingués les uns des autres; les immeubles, au contraire, occupant toujours la même place, et ayant des limites déterminées, ne peuvent jamais être confondues, même avec ceux qui sont de même espèce.
Les meubles sont très-variés dans leurs espèces, le nombre en est en quelque sorte incalculable; les immeubles sont au contraire très-peu variés dans leurs espèces; ce sont des fonds de terre ou des bâtimens. Les biens meubles se produisent et se consomment avec plus ou moins de rapidité; il est, au contraire, de la nature des immeubles d'être durables, et en quelque sorte indestructibles.
La plupart des biens meubles soumis à l'action de l'industrie humaine subissant des transformations continuelles, les immeubles peuvent recevoir quelques modifications; mais l'identité peut en être toujours constatée.
Les meubles passent rapidement d'une main à [II-455] une autre ; cette circulation rapide est une condition essentielle de l'existence de la société; les immeubles, au contraire, restent long-temps dans les mêmes mains. Les meubles peuvent être aisément enlevés, soustraits, cachés, sans qu'il soit possible de les retrouver, ou de les reconnaître si on les retrouve; les immeubles, au contraire, ne sont pas susceptibles de soustraction; on peut en dérober les titres ou les falsifier, mais la chose reste toujours en évidence.
Ces nombreuses différences sont inhérentes à la nature des choses; elles sont indépendantes des volontés humaines. Or, il suffit qu'elles existent par elles-mêmes', et qu'il ne soit pas au pouvoir des hommes de les faire disparaître, pour que l'influence s'en fasse sentir sur les principales branches de la législation. Leur existence étant dans la nature des choses, elles ont, en législation, des conséquences que les nations sont obligées d'accepter, comme elles sont tenues de se soumettre aux lois de la gravitation.
Aussi, devons-nous remarquer que cette distinction des biens, en meubles et en immeubles, se trouve dans les lois de toutes les nations policées, et que les différences qui existent entre les uns et les autres sont suivies partout à peu près des mêmes conséquences. Les dénominations ne sont pas, il est vrai, les mêmes dans tous les pays; les Anglais, [II-456] par exemple, appellent propriété personnelle, ce que nous appelons biens meubles, et propriété réelle, ce que nous appelons biens immeubles; mais la différence n'est que dans les termes, elle n'est pas dans la classification.
J'ai dit que les différences qui existent, par la nature des choses, entre les meubles et les immeubles, exercent une certaine influence sur les principales branches de la législation; s'il s'agit, en effet, de minorité, d'interdiction, de mariage, de divorce, de vente, d'échange, de louage, de gage, d'hypothèque, de procédure, de compétence, de saisie, de possession, de prescription, les immeubles sont soumis, sur un grand nombre de points, à des règles qui ne sont pas applicables aux biens mobiliers, et ceux-ci, d'un autre côté, sont soumis à des dispositions qui ne s'appliquent point aux immeubles.
Il me serait facile de faire voir que les différences qui se trouvent dans les lois, sont des conséquences nécessaires des différences qui existent dans la nature des choses; mais cette démonstration nous conduirait trop loin, car elle exigerait l'examen d'une partie considérable de nos lois civiles, de nos lois de procédure, et même de nos lois politiques; cet examen d'ailleurs serait étranger à la nature de cet ouvrage.
Le Code civil, après avoir déclaré que tous les [II-457] biens sont meubles ou immeubles, ajoute que les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. Il met au rang des immeubles par leur nature, les fonds de terre et les bâtimens, les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment; les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, les coupes ordinaires des bois taillis ou des futaies mises en coupes réglées, tant que les arbres n'ont pas été abattus. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont considérés comme faisant partie des objets auxquels ils sont attachés, et sont mis, par conséquent, dans la classe des immeubles.
Il est des choses qui sont meubles par leur nature, et qui sont soumises par nos lois et par celles de presque tous les peuples, aux mêmes dispositions que les immeubles auxquels elles sont attachées. Le Code civil, par exemple, déclare que les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier et au métayer, pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles, tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. Il dispose de plus que les objets que le propriétaire du fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce même fonds, sont immeubles par destination.
L'on considère donc comme immeubles par [II-458] destination, lorsqu'ils ont été placés par le propriétaire, pour le service et l'exploitation du fonds, les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, les semences données au fermier ou colon partiaire, les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les ruches à miel, les poissons des étangs, les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tous les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines, les pailles, engrais et tous les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds, pour y demeurer à perpétuité.
Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d'un appartement, les tableaux et autres ornemens sont considérés comme mise à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel ils sont attachés fait corps avec la boiserie. Quant aux statues, elles sont considérées comme immeubles lorsqu'elles sont placées dans des niches pratiquées exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.
Le Code civil met au rang des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, l'usufruit des choses [II-459] immobilières, les servitudes ou services fonciers, et les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
Il est des peuples qui ne soumettent pas tous les biens mobiliers attachés à des immeubles aux lois par lesquelles ces mêmes immeubles sont régis. Dans le canton de Vaud, par exemple, le Code civil a été adopté; mais on a jugé convenable de supprimer les dispositions de l'article 524, qui considèrent comme immeubles par destination, les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds.
Il serait difficile de dire si ces dispositions ont été rejetées, parce que la rédaction en a paru vicieuse, ou parce qu'elles ont paru mauvaises. Il était possible de faire quelques légers reproches à la rédaction; on pouvait croire qu'il était peu conforme à la nature des choses, de mettre dans la classe des immeubles, des chevaux, des pigeons et des lapins; mais si l'expression manquait d'exactitude, rien n'était plus facile que de la corriger; il suffisait de dire que, quoique ces divers objets fussent meubles par leur nature, leur nature, ils seraient considérés comme faisant partie des immeubles auxquels ils seraient attachés.
Je dois faire remarquer ici que rien n'est plus commun que de rencontrer dans les lois de presque tous les peuples, ce qu'on appelle des fictions, [II-460] c'est-à-dire des suppositions mensongères imaginées pour soumettre certaines choses à des règles faites pour des choses différentes. C'est ainsi, par exemple, qu'après avoir établi certaines dispositions pour les immeubles, et des dispositions différentes pour les meubles, on dira que des lapins sont réputés immeubles, afin de les soumettre aux règles qui régissent les fonds sur lesquels ils sont placés. Des fictions ou des mensonges de ce genre pouvaient être nécessaires aux jurisconsultes romains, qui n'avaient pas la puissance de changer des lois qu'ils trouvaient malfaisantes, et dont ils voulaient éluder l'application; mais un législateur n'a pas besoin de faire mentir les faits pour prescrire ce qui lui paraît juste.
Les auteurs du Code civil, au lieu de diviser les immeubles en trois classes et de dire que les biens sont immeubles par leur nature, par leur destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent, auraient mieux fait de laisser à chaque chose sa dénomination naturelle, et de déclarer ensuite dans quels cas certains objets mobiliers ne pourraient pas être séparés des fonds auxquels ils auraient été attachés, ou seraient régis par les lois faites pour les immeubles; mais il ne s'agit pas ici que d'un vice de rédaction, et ce vice n'est pas très-dangereux.
Une question plus importante est celle de [II-461] savoir s'il est bon que, dans certains cas, des choses qui sont meubles par leur nature, soient considérées comme faisant partie des immeubles auxquels elles sont attachées, et qu'elles soient régies par les mêmes lois.
Pour résoudre cette question, il faut d'abord observer que les dispositions qui soumettent des choses meubles par leur nature, aux mêmes règles que les immeubles, ne portent aucune atteinte à la faculté qu'a toute personne de jouir et de disposer de ses biens comme elle juge convenable; tout propriétaire peut disposer de ses propriétés quelle qu'en soit la nature, sans être arrêté par des classifications.
Les dispositions qui considérent certains objets mobiliers comme faisant partie des immeubles auxquels ils sont attachés, n'ont que deux effets légaux; le premier est de dispenser un propriétaire qui dispose de ses biens, d'une multitude d'explications pour faire connaître sa volonté. Celui qui donne, vend, échange ou hypothèque un immeuble, sait d'avance qu'il aliéne ou qu'il engage, s'il ne manifeste pas une volonté contraire, les objets qu'il y a placés pour l'exploiter. Cela n'empêche pas qu'il ne puisse, dans l'acte d'aliénation, diviser sa propriété comme il juge convenable; donner à une personne la terre et à une autre les capitaux consacrés à l'exploitation.
[II-462]
Le second effet des dispositions qui considèrent certains objets qui sont meubles par leur nature, comme faisant partie des fonds auxquels ils sont attachés, est d'empêcher que les créanciers d'une personne, pour obtenir leur remboursement, ne fassent saisir et vendre les objets qui servent à l'exploitation d'un fonds, à moins qu'ils ne fassent saisir et vendre en même temps l'immeuble auquel ils sont attachés.
Les inconvéniens qui résultent d'une telle prohibition ne sont pas très-considérables; ils se réduisent à diminuer, relativement à quelques personnes, le crédit des propriétaires de fonds de terre. Lorsqu'on ne peut obtenir le paiement d'une dette peu considérable, qu'au moyen d'une saisie d'immeubles d'une grande valeur, on prête moins volontiers que lorsqu'on a la faculté de faire saisir des biens mobiliers, et de proportionner la saisie à la créance dont on veut obtenir le paiement; mais le mal qui peut résulter de là mérite à peine d'être compté, quand on le compare aux fâcheux effets que produirait le système contraire.
L'importance de toute propriété est toujours en raison de sa valeur ou des services qu'elle peut rendre; tout ce qui diminue la valeur détruit donc une partie de la propriété. Or, lorsque deux choses ont été faites l'une pour l'autre, et qu'elles ne sont utiles qu'au moyen des services qu'elles se rendent, [II-463] on ne peut les séparer sans qu'il résulte de leur séparation une perte plus ou moins considérable. Si l'on séparait, par exemple, les pièces dont se compose la montre la plus parfaite, et si l'on essayait de les vendre séparément, on ne trouverait personne qui voulût les acheter; elles n'auraient aucune valeur. Il en serait de même des pièces des machines les plus considérables et les plus précieuses; celui qui vendrait séparément les diverses parties dont une machine à vapeur ou un navire sont composés, n'en obtiendrait pas un prix beaucoup plus élevé que s'il vendait des matériaux bruts.
Il suit de là qu'on ne peut séparer des choses qui tirent de leur union une grande partie de leur valeur, sans détruire inutilement une partie de la propriété; si des choses qui valaient six mille francs, par exemple, quand elles étaient unies, ne valent que la moitié de cette somme quand elles sont séparées, il est clair que la séparation équivaut à la destruction gratuite d'une propriété qui vaudrait trois mille francs.
Il est, sans doute, moins difficile de remplacer les objets nécessaires à l'exploitation d'une ferme, quand on possède des capitaux suffisans, que les pièces qui manquent à une montre; mais, dans un cas comme dans l'autre, il y a nécessairement une destruction de valeur; séparer les fourrages, des animaux qu'ils sont destinés à nourrir; les [II-464] engrais et les instrumens aratoires, des terres qu'ils doivent fertiliser; les pigeons, de leur colombier, c'est rendre ces choses improductives, c'est en diminuer considérablement la valeur.
Une ferme, comme tout autre grand établissesement d'industrie, n'est productive qu'au moyen de chacune des choses qui sont consacrées à la production; il suffirait quelquefois d'enlever une de ces choses, dans certaines circonstances, pour arrêter l'action de toutes les autres; la saisie des semences ou des instrumens aratoires, ou des animaux de labour, ou des fourrages, ou des engrais, pourrait avoir pour effet de tout paralyser ; ce serait comme si l'on opérait la saisie d'une des roues d'une voiture.
Le mal qui en serait la suite, ne se bornerait pas à causer au propriétaire une perte considérable, il s'étendrait sur le fermier et sur sa famille, et sur une multitude d'ouvriers qui seraient privés de travail et de tout moyen d'existence; il s'étendrait même sur une partie plus ou moins nombreuse de la société, puisque les produits nécessaires à sa conservation seraient moins considérables.
Il y avait donc des raisons très-puissantes pour considérer comme faisant partie d'un immeuble, les objets mobiliers que le propriétaire y a attachés, soit pour le rendre productif, soit pour en accroître la valeur. Toutes les fois qu'il s'élève des [II-465] doutes sur la question de savoir si une chose mobilière de sa nature, doit être considérée comme faisant partie d'un immeuble, il suffit d'examiner si elle est ou si elle n'est pas nécessaire pour le rendre propre à l'usage auquel il est destiné. La question peut être également résolue par l'examen de l'influence que doit produire la séparation sur la valeur des deux choses. Si elles ne peuvent être séparées sans qu'il en résulte, pour l'une ou pour l'autre, une destruction plus ou moins considérable de valeur, il est bon qu'elles restent unies.
Suivant le Code civil, il y a deux sortes de meubles : les uns sont tels par leur nature; les autres le sont par la détermination de la loi. Nous pouvons encore observer ici qu'il aurait été plus raisonnable de ne mettre au rang des meubles que les choses qui sont mobiles par leur nature. On aurait pu déclarer ensuite qu'elles étaient les choses qui seraient régies par les dispositions faites pour cette espèce de biens.
Le Code civil met dans la classe des choses qui sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les corps inanimés. La grandeur ou le prix des choses qui sont mobiles de leur nature, n'empêchent pas qu'elles [II-466] ne soient mises dans la classe des meubles. On y place donc les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison. On y place aussi les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, et ceux qui sont assemblés pour en construire un nouveau, tant qu'ils n'ont pas été employés par l'ouvrier dans une construction.
Le Code civil considère comme meubles, par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, à l'égard de chaque associé seulement, et tant que dure la société ; les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur les particuliers, soit sur l'État. Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, sont considérées comme meubles, même lorsque des immeubles dépendans de ces entreprises appartiennent aux compagnies [114].
En divisant en deux grandes classes, en meubles et [II-467] en immeubles, toutes les choses qui peuvent tomber sous l'empire des lois, les auteurs du Code civil ne pouvaient pas changer le langage, et obliger les citoyens à donner aux termes un sens différent de celui qu'ils étaient dans l'habitude d'y attacher. Or, dans la pratique ordinaire des affaires, on ne donne jamais au mot meubles un sens aussi étendu que celui qu'il a dans la classification générale des biens. Il a donc fallu prévoir que ce terme aurait, dans un grand nombre de cas, un sens plus restreint.
Aussi, d'après les dispositions du Code civil, le mot meuble employé seul, soit dans une loi, soit dans les dispositions d'une personne, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas ce qui fait l'objet d'un commerce; il ne comprend pas non plus l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instrumens des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées.
Les mots meubles meublans comprennent les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des [II-468] appartemens, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables et autres objets de cette nature; ils comprennent, en outre, les tableaux, les statues, les porcelaines qui font partie du meuble ou de la décoration d'un appartement; ils ne comprennent pas les collections de tableaux qui peuvent être dans des galeries ou pièces particulières.
L'expression biens-meubles celles de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble, d'après les règles précédemment établies. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublans. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres y sont déposés. Elle comprend tous les autres effets mobiliers, quelle qu'en soit la nature.
Après avoir divisé les choses en les considérant dans leur nature, on les a divisées en les considérant dans leurs rapports avec les diverses classes de personnes à qui elles appartiennent. On a fait, par exemple, une classe des biens qui sont la propriété d'une nation; une autre de ceux qui appartiennent à des villes, à des communes; une autre de ceux qui appartiennent à des particuliers ou à des familles. On s'est fondé, pour faire ces distinctions, sur ce que les propriétés qu'on a ainsi divisées, ne sont pas soumises aux mêmes règles. Ce motif [II-469] aurait dû faire pousser la division plus loin; elle aurait dû faire distinguer les propriétés qui appartiennent à des mineurs, de celles qui appartiennent à des majeurs; celles qui appartiennent à des femmes placées sous la puissance maritale, de celles qui appartiennent à des personnes entièrement libres.
Une grande partie des biens qui appartiennent à une nation ou à une commune, sont de la même nature que ceux qui appartiennent à des particuliers; les propriétés d'un mineur ne diffèrent en rien, par leur nature, des propriétés d'un majeur. Si, sur quelques points, toutes ne sont pas soumises aux mêmes dispositions législatives, cela ne tient pas à la nature des choses; cela tient aux différences qui existent dans la capacité des personnes. Ce n'est donc qu'après avoir traité des personnes qu'on peut avoir à s'en occuper.
[II-470]
CHAPITRE CHAPITRE LIV.
Des idées rétrogrades contre la propriété. —Conclusion.↩
J'AI tenté de donner, dans cet ouvrage, des idées exactes des propriétés qui sont la base de notre existence; mais je suis loin d'en avoir donné des idées complètes. La faculté de disposer des choses est un des élémens essentiels de toute propriété; et, dans tous les pays policés, on a cru nécessaire de donner à cette faculté des limites et des règles. On ne peut donc se flatter de connaître parfaitement le sujet que j'ai traité, que lorsqu'on possède la connaissance de ces règles et de ces limites. Cela même ne suffit pas; il faut savoir de plus quels sont les divers moyens à l'aide desquels une chose peut être acquise et devenir la propriété de telle ou telle personne.
Pour avoir une connaissance entière de la propriété, il est donc nécessaire de connaître presque toutes les branches de la science du droit; car la plupart ont pour objet de régler ou de limiter la faculté de jouir et de disposer des choses qui nous appartiennent. Je fais cette observation, afin qu'on ne s'imagine pas qu'on peut, à l'aide d'une [II-471] définition, acquérir la connaissance des choses qui, pour être bien connues, exigent de longues études. L'explication d'un des termes de la définition donnée par nos lois, du mot disposer, a donné naissance à un nombre de volumes suffisant pour former une bibliothèque.
Si j'ai laissé beaucoup de choses à dire sur le sujet que j'ai traité; si je n'ai parlé ni des règles ni des limites données à la faculté de disposer, ni des divers moyens à l'aide desquels on peut se dépouiller de ses biens pour en investir une autre personne; si même je me suis abstenu de faire mention de quelques moyens à l'aide desquels on peut acquérir le titre de propriétaire, c'est parce qu'il ne m'était pas possible d'aller plus loin avant que d'avoir traité des personnes, et des rapports qui existent entre elles.
Un homme qui vit au sein d'une nation civilisée, n'est pas un être isolé comme une pyramide au milieu d'un désert; il tient, par une multitude de liens, aux êtres de son espèce qui l'environnent. La puissance qu'il exerce sur les choses dont il est propriétaire, est toujours plus ou moins limitée par les obligations qui lui sont imposées, soit par sa propre nature, soit par les conventions qu'il a formées, soit par les institutions de la nation à laquelle il appartient. La protection dont il jouit pour ses biens et pour sa personne, exige elle [II-472] même qu'il ne puisse se dépouiller de ses propriétés, qu'en suivant certaines règles. Il est donc nécessaire, avant que de traiter des diverses manières dont on peut disposer de ses biens, et de parler des limites mises à cette faculté, d'avoir fait connaître quels sont les rapports qui unissent les hommes entre eux.
Les jurisconsultes romains et la plupart des jurisconsultes modernes ont pensé qu'avant de traiter des choses qui sont l'objet de la législation, il convenait de traiter des personnes. Je n'ai point partagé cette opinion; j'ai cru qu'avant de parler de la manière dont les familles se forment, et des obligations qui résultent de leur formation, je devais faire connaître les choses qui composent la base de leur existence. La plupart des obligations qui existent entre les hommes, n'ont une importance réelle que parce qu'elles affectent les choses au moyen desquelles ils se conservent. Si l'on s'occupe des devoirs réciproques qui résultent de l'association conjugale, soit pour les époux, soit pour les pères et mères, soit pour les enfans, on s'aperçoit qu'il est toujours question de moyens d'existence. Il est impossible de parler de tutelle, d'interdiction, de divorce, de séparation de corps, et de ne pas s'occuper des propriétés des mineurs, des interdits, des époux séparés. Les dispositions dont le principal objet est la conservation des biens, [II-473] tiennent même souvent la place la plus considérable dans les lois qui semblent ne se rapporter qu'aux personnes. Enfin, il n'est pas un homme doué d'un peu de prévoyance qui ne songe, avant que de former une famille nouvelle, à s'assurer les moyens de la faire exister. Il fallait donc s'occuper des propriétés avant que de traiter des personnes.
Je ne terminerai point cet ouvrage sans faire quelques observations sur certains systèmes dont l'objet était de déplacer les propriétés, et de fonder la société sur des bases nouvelles. Je m'étais d'abord proposé de soumettre ces systèmes à un examen rigoureux et détaillé ; mais je n'ai pas tardé à m'apercevoir que ce projet n'était pas exécutable. J'y ai donc renoncé; je dois en dire les raisons.
Les fondateurs ou les propagateurs de ces systèmes ont tenté de persuader au public, et peut-être ont fini par se persuader à eux-mêmes qu'ils avaient laissé bien loin derrière eux les hommes les plus éclairés de leur siècle et ceux du siècle dernier; enivrés par l'esprit de secte ou de prosélytisme, ils ont traité les savans les plus distingués de leur temps avec un dédain et un orgueil tout-à-fait propres à imposer à la partie la plus ignorante de la multitude.
Cependant, il est impossible de lire ce qu'ils ont écrit sans s'apercevoir aussitôt que, bien loin d'être plus avancés que leur siècle, ils sont de beaucoup [II-474] en arrière; que non seulement ils n'ont rien vu, rien observé par eux-mêmes, mais qu'ils ne connaissent même pas les premiers élémens des sciences dont ils ont la prétention de s'occuper; que, s'ils parlent des hommes les plus distingués qui ont écrit sur ces sciences, ils ne les ju gent que sur ouï-dire, et comme de jeunes séminaristes jugent les philosophes dont la lecture leur est interdite ; c'est-à-dire qu'ils se bornent à reproduire des préjugés vulgaires qui feraient rougir un homme doué de la moindre instruction.
Quand on examine avec un peu d'attention ces merveilleuses découvertes, qui devaient mettre un terme à toutes les calamités dont le genre humain est affligé, on n'y trouve qu'un assemblage bizarre d'idées empruntées à des époques de barbarie, à des sectes religieuses que le temps a détruites, à quelques-uns des philosophes les moins religieux du XVIIe siècle, et à des écrivains de notre âge. Ce mélange, fait sans intelligence, par des imaginations désordonnées, méritait de subir la destinée qui semble réservée à tout ce qui choque le sens commun; il devait se montrer sous l'appareil des formes religieuses, et c'est, en effet, le sort qu'il a éprouvé.
Comment aurait-il été possible de soumettre de pareilles conceptions à un examen sérieux et méthodique? N'aurait-il pas fallu pour combattre des [II-475] idées formées dans des temps d'ignorance et de barbarie, reproduire les faits et les observations devant lesquels ces idées ont disparu? N'aurait-il pas fallu refaire, ou pour mieux dire copier les ouvrages qui ont porté certaines sciences au point où nous les voyons? Quand des esprits arriérés ou rétrogrades viennent nous présenter, comme des nouveautés, des erreurs surannées, il n'y a qu'un moyen de leur répondre : c'est de les renvoyer à la lecture des écrivains auxquels les sciences doivent les progrès qu'elles ont faits.
Si j'avais voulu réfuter les écrits des hommes qui se sont imaginé qu'il était en leur puissance de faire mettre en commun toutes les propriétés, et d'établir la société sur des bases nouvelles, je n'aurais pas été seulement obligé de reproduire des faits et des raisonnemens qui sont connus de tous les gens un peu instruits; je n'aurais pu me dispenser de rappeler ce que j'avais moi-même écrit, il y a plusieurs années, dans l'ouvrage dont celui-ci forme la suite.
On sait, par exemple, qu'il y a, pour les peuplades barbares qui veulent passer de la vie nomade à la vie agricole, un état de transition qu'il est impossible d'éviter. Toutes les forces doivent se réunir pour mettre la terre en culture; et comme il y a communauté dans le travail, il y a jouissance commune des produits. Cet état était celui dans [II-476] lequel se trouvaient, au rapport de Tacite, plusieurs des tribus qui peuplaient les forêts de la Germanie, quand les légions romaines y portèrent leurs armes. C'était également celui d'un certain nombre de peuplades qui habitaient les forêts de l'Amérique septentrionale, quand les Européens allèrent s'emparer de ce pays. Plusieurs sectes religieuses, et particulièrement les Jésuites du Paraguay, avaient adopté un pareil genre de vie.
Si j'avais voulu combattre ici ce système de communauté, qu'on nous a présenté comme une invention merveilleuse, et qu'on a même tenté de mettre en pratique, il ne m'aurait pas été difficile de démontrer qu'un pareil système, s'il était permanent, ne serait guère moins contraire à la nature de l'homme, que l'esclavage le plus abrutissant; qu'il aurait pour résultat, non une égalité de bonnes habitudes et de bien-être, mais une égalité d'ignorance, de paresse, de misère et de vices; qu'il détruirait toutes les affections de famille, et qu'il ferait descendre la masse de la population au niveau des esclaves de nos colonies; mais comment prouver cela, sans reproduire les observations que j'avais faites ailleurs, en réfutant le même système que l'abbé Raynal avait aussi trouvé admirable [115]?.
Montesquieu ayant prétendu que, si un père [II-477] était tenu de nourrir ses enfans, il n'était pas obligé de leur laisser sa succession, d'autres écrivains du dernier siècle allèrent plus loin; ils prétendirent qu'il serait bon que les biens qu'un homme laisserait en mourant, rentrassent dans la masse des biens publics, et fussent distribués aux familles les plus pauvres, ou employés à récompenser les vertus, à encourager les talens; ils voulaient que la part de chacun fût en raison de son mérite.
« Un homme qui a terminé sa carrière, disait Raynal, peut-il avoir des droits? En cessant d'exister, n'a-t-il pas perdu toutes ses capacités? Le grand être, en le privant de la lumière, ne lui a-t-il pas ôté tout ce qui était une dépendance à ses volontés dernières, peuvent-elles avoir quelqu'influence sur les générations qui suivent? Non. Tout le temps qu'il a vécu, il a joui et dû jouir des terres qu'il cultivait. A sa mort elles appartiennent au premier qui s'en saisira et qui voudra les ensemencer. Voilà la nature...
» Entre les différentes institutions possibles sur l'héritage des citoyens après leur décès, ajoute Raynal, il en est une qui trouverait peut-être des approbateurs. C'est que les biens des morts rentrassent dans la masse des biens publics, pour être employés d'abord à soulager l'indigence, après l'indigence, à rétablir perpétuellement une [II-478] égalité rapprochée entre les fortunes des particuliers; et, ces deux points importans remplis, à récompenser les vertus, à encourager les talens [116]. »
Les hommes qui, après nous avoir annoncé que les philosophes du dix-huitième siècle étaient venus uniquement pour accomplir une œuvre de destruction; que leur règne était passé, et que le temps des fondateurs était enfin arrivé, se sont avisés de remettre en question le droit des enfans de succéder à leurs pères, n'ont donc pas eu d'autre mérite que de paraphraser les conceptions les moins sensées des écrivains qu'ils avaient l'air de dédaigner; ils ont reculé de plus d'un demi-siècle, pour se donner un air de nouveauté; l'époque de l'histoire humaine la plus fertile en expériences et en grandes découvertes, a donc passé devant eux sans être aperçue.
Si j'avais voulu combattre, dans cet ouvrage, les erreurs empruntées à l'abbé Raynal, sur le droit des enfans de recueillir les biens que leurs parens laissent en mourant, je n'aurais pu me dispenser de faire voir que l'esprit de famille est une des principales causes de la production et de la conservation des richesses; qu'un homme, pour [II-479] assurer l'existence de ses enfans, se livre à des travaux et s'impose des privations qu'aucun autre sentiment ne saurait obtenir de lui; que les familles contractent des habitudes conformes à leurs moyens d'existence, et que si les richesses d'une personne ne devaient point passer à ses descendans, elle devrait habituer ses enfans aux privations les plus dures, et leur en donner l'exemple; qu'elle ne pourrait, par conséquent retirer, presque aucun avantage réel de ses propriétés, même de son vivant; enfin, qu'une nation chez laquelle les enfans seraient exclus de la succession de leurs parens, descendrait, en très-peu d'années, beaucoup plus bas que ne sont descendus les habitans de l'Egypte sous la domination des Mameloucks, les Grecs sous la domination des Turcs.
Mais, pour donner une démonstration complète de ces propositions, j'aurais eu besoin de rappeler une multitude de faits et d'observations que j'ai rapportés dans le Traité de législation, pour expliquer la décadence de plusieurs peuples qui sont tombés du faîte de la prospérité, dans la misère et la dégradation les plus profondes; je n'aurais pu me dispenser de reproduire une multitude de vérités que la science de l'économie politique a démontrées de manière à les mettre hors du domaine de la contestation; enfin, il eut été nécessaire de rechercher et d'exposer quelles sont les lois de notre [II-480] nature, qui président à la formation et à la conservation des familles.
Cette nécessité d'exposer les élémens d'une science qu'il n'est pas permis à une personne bien élevée d'ignorer, de rappeler des vérités que j'ai déjà suffisamment démontrées, et de traiter une matière qui doit faire l'objet d'un autre ouvrage, ne me permettait donc pas de réfuter ici les erreurs empruntées à l'abbé Raynal; j'ai dû, par conséquent m'en abstenir.
Quelques écrivains, en observant ce qui se passe au sein des nations les plus civilisées, ont cru s'apercevoir que, chez la plupart d'entre elles, il y a deux classes de personnes dont l'existence n'est pas fondée sur les mêmes moyens; ils ont cru voir qu'une partie de la population, et c'est la plus nombreuse, vit au moyen des produits de son travail, de ses capitaux, de ses terres, tandis que l'autre n'existe qu'au moyen des richesses qu'elle se fait livrer par la première, sous des noms divers; cet état leur a paru vicieux, et ils ont cru qu'il serait possible d'en établir un meilleur; il leur a semblé que, dans une société bien organisée, l'État ne devait payer les services qui lui sont rendus, qu'en raison de leur valeur.
Nos modernes réformateurs, dénaturant cette pensée, ont aussi divisé la société en deux classes; ils ont également trouvé mauvais qu'une partie de [II-481] la population existât aux dépens de l'autre; mais ils ont mis dans la classe qui vit aux dépens de toutes les autres, les familles qui n'existent que par les revenus de leurs terres ou par les produits de leurs capitaux; ils ont pensé que ces familles d'oisifs devaient être supprimées, et que leurs capitaux et leurs terres devaient être adjugés aux hommes les plus capables de les faire valoir.
Le système emprunté à l'abbé Raynal était la négation partielle de la propriété ; celui-ci en est la négation complète. Dans le premier, on accordait au propriétaire la jouissance viagère; il n'y avait spoliation que pour ses enfans ou pour les autres membres de la famille. Dans le second, la jouissance, même temporaire, n'est pas admise; tout propriétaire doit être dépouillé de ses biens, du moment qu'il se présente un homme plus capable que lui de les faire valoir.
Si je ne pouvais pas faire voir, dans ce Traité, les vices des deux précédens systèmes, il m'était encore moins permis de me livrer à l'examen du troisième. Comment raisonner, en effet, avec des hommes qui n'ont jamais pu comprendre qu'il ne saurait exister d'industrie sans capitaux, et que les capitaux ne se forment que dans les pays où la jouissance et la disposition en sont assurées? Pour m'en abstenir, je n'avais pas seulement les raisons que j'ai déjà fait connaître : il en existait une beaucoup [II-482] plus grave. Quel que soit le sujet dont on s'occupe, il est un moment auquel toute controverse doit cesser: c'est celui où l'on commence à mettre sérieusement en doute si les idées qu'on réfute sont du domaine de la logique ou de celui de la thérapeutique.
On a prétendu que les inventeurs, ou, pour mieux dire, les paraphraseurs de ces divers systèmes, avaient au moins rendu un service, en ce qu'ils avaient appelé l'attention des hommes éclairés sur le sort des classes les plus nombreuses et les plus pauvres de la société. C'est une erreur; si ce mérite, qui est très-grand, pouvait être attribué à un seul homme, il appartiendrait incontestablement à Jérémie Bentham; car c'est lui qui le premier a donné pour règle fondamentale de toutes les institutions, l'intérêt général de toutes les classes de la population. Quelques-unes de ses idées, il est vrai, semblent avoir influé sur la formation des systèmes dont je viens de parler; mais elles ont été si défigurées et si mal appliquées, qu'il semble qu'on n'ait pas eu d'autre dessein que de les travestir, et de les rendre absurdes ou criminelles.
Si les systèmes qu'on a imaginés sur la propriété n'étaient adressés qu'à des personnes douées d'un peu d'instruction, et habituées à réfléchir, ils mériteraient peu qu'on s'en occupât, car ils ne sauraient faire beaucoup de mal; mais exposés devant des [II-483] hommes qui ne possèdent aucune connaissance, qui n'ont ni les moyens, ni le temps de réfléchir, et qui ne peuvent se procurer qu'avec beaucoup de peine de faibles moyens d'existence, ils ne sont pas sans danger; le moindre mal qu'ils puissent produire est de donner aux classes les plus nombreuses et les moins aisées de la population, des espérances qui ne sauraient se réaliser; de leur faire considérer la spoliation des familles qui, par leurs travaux et leurs économies, ont acquis quelque fortune, comme un moyen sûr et légitime de mettre un terme à leur misère, et de porter ainsi le trouble et l'inquiétude parmi les hommes qui n'ont pas des vues assez élevées pour connaître toute l'étendue de la puissance qui protège les propriétés.
Les fausses espérances qu'on cherche quelquefois à donner à la partie de la population la moins intelligente et la plus énergique, peuvent être employées comme un levier à l'aide duquel on se flatte d'ébranler un pouvoir qu'on a dessein de renverser; mais ce levier est plus dangereux encore pour ceux qui tentent d'en faire usage, que pour les hommes contre lesquels il est employé. Il est impossible de le mettre en jeu, sans rallier aussitôt autour du gouvernement toutes les classes de la société, qui se croient menacées dans leurs moyens d'existence; et quand ces forces sont unies, il n'est rien qui puisse les surmonter. Si de pareils moyens [II-484] avaient un moment de succès, les hommes qui les auraient mis en usage, ne jouiraient pas long-temps de leur triomphe; ne pouvant réaliser les espérances qu'ils auraient fait naître, ils seraient battus avec les armes qu'ils auraient employées, et dont ils auraient d'avance proclamé la légitimité.
Il est des personnes qui, sans attaquer les propriétés, voudraient au moins assurer à la partie la plus pauvre de la population, une plus grande part dans les produits annuels qui composent les revenus d'un peuple. Le sort de presque toutes les classes de la société s'est amélioré par le seul effet des progrès de la civilisation; et il y aurait de la témérité à prédire ce qui arrivera dans des temps plus ou moins éloignés. Je doute cependant qu'il soit possible de produire, par des moyens artificiels, c'est-à-dire par des mesures législatives, une amélioration prompte et sensible dans le sort des hommes qui vivent des produits de leur travail de chaque jour.
Il n'est au pouvoir d'aucun gouvernement d'élever d'une manière permanente le taux des salaires.
Un agriculteur, un fabricant, peuvent, pendant quelques jours, payer le travail au-delà de ce qu'il leur produit. Le premier peut, dans un moment donné, dépenser la valeur de dix mesures de froment pour faire 'produire la valeur de huit; mais il serait bientôt ruiné, si une telle opération se [II-485] renouvelait souvent. Le second peut aussi, dans certaines circonstances, faire le sacrifice de cinq francs, pour obtenir une marchandise qu'il ne saurait vendre plus de quatre. Il n'est pas de puissance qui pût lui imposer un tel sacrifice d'une manière permanente, à moins de rendre sa fortune inépuisable, et de lui ouvrir une source de revenus. L'autorité publique ne saurait donc intervenir dans la fixation des salaires, sans porter atteinte à la propriété du maître ou à la liberté de l'ouvrier. Or, tant que le taux des salaires sera soumis aux lois de la concurrence, il subira l'influence de toutes les variations du commerce et de la population.
S'il était possible que tout à coup le prix, en numéraire, de la main-d'œuvre fût doublé dans tous les pays, que la journée qui vaut trois francs en valût six, le sort des classes laborieuses ne serait pas plus heureux. Les revenus d'une nation, c'est-à-dire la quantité d'alimens et de vêtemens qui sont créés toutes les années, ne sont pas illimités. Tout ce qui se produit se consomme; mais il n'y a pas moyen de consommer au-delà de ce qui se produit; on ne peut augmenter la part de l'un, que sous la condition de diminuer d'autant la part d'un autre. Il n'existe pas, en effet, de puissance qui ait le moyen de faire consommer un grain de blé au-delà de celui qui a été produit. Si donc il arrivait que tout à coup le prix de toutes [II-486] les journées fût doublé, quelles en seraient les conséquences? On verrait arriver sur le marché la même quantité de denrées, le même nombre d'acheteurs ayant les mêmes besoins, et les mêmes moyens de les satisfaire. Il n'y aurait rien de changé dans la position de personne : la concurrence des acheteurs éleverait le prix de toutes choses au niveau du prix de la main-d'œuvre. Il serait même fâcheux qu'elle n'eût pas ce résultat; car, si elle ne l'avait pas, les premiers qui seraient pourvus, affameraient les derniers qui se présenteraient.
Il est vrai que cet accroissement du prix nominal de la main-d'œuvre pourrait avoir pour effet d'opérer quelques retranchemens sur les consommations des classes qui vivent des revenus de leurs terres, de leurs maisons, de leurs capitaux. Mais il ne faut pas s'exagérer les avantages qui résulteraient de là, pour les classes les plus laborieuses et les moins aisées. Quand les classes les plus riches de la société sont obligées de réduire leurs dépenses, ce n'est pas sur les choses de première nécessité qu'elles font porter la réduction. La concurrence resterait donc la même relativement à ces choses, et, par conséquent, il n'y en aurait pas une plus grande abondance pour les classes les plus nombreuses.
Quand on compare le nombre des familles qui possèdent une fortune considérable, au nombre [II-487] de celles qui vivent du produit de leurs travaux, et qui ne possèdent que les moyens rigoureusement nécessaires pour exister, on s'aperçoit que le premier est infiniment petit, comparativement au second; la spoliation des riches au profit des pauvres, si jamais elle pouvait s'effectuer, pourrait bien avoir pour résultat de condamner les premiers à la destruction: mais elle n'apporterait à la condition des seconds qu'une amélioration faible et momentanée, et serait suivie, même pour ceux-ci, des conséquences les plus désastreuses.
Qu'on ne se méprenne pas sur le but de ces observations; elles n'ont pas pour objet de démontrer qu'il n'y a rien à faire dans l'intérêt des classes qui n'existent qu'au moyen de leur travail, et qu'un gouvernement n'a point à s'occuper d'elles ; elles tendent seulement à faire voir qu'on n'a rien de bon à espérer d'un déplacement forcé des richesses; qu'il n'est pas possible d'accroître les revenus des personnes qui vivent des produits de leur travail, en diminuant les revenus des personnes qui vivent des produits de leurs terres ou de leurs capitaux, sans porter atteinte à la propriété; que les atteintes de ce genre sont encore plus funestes pour les classes ouvrières que pour les autres; que les capitaux ne sont pas moins nécessaires à la production que le travail; qu'il n'est pas de leur nature d'être immobiles; [II-488] qu'ils fuient toujours les pays dans lesquels ils sont menacés; et que, quand ils disparaissent, la population dont ils alimentaient l'industrie, ne tarde pas à être moissonnée par la misère et la famine.
Si ces observations sont incontestables, et l'expérience de tous les siècles et de tous les pays en a rendu la démonstration évidente, il s'ensuit que les classes de la population qui vivent des produits de leur travail de chaque jour, n'ont jamais eu d'ennemis plus dangereux que les hommes dont les systèmes menacent tous les genres de propriétés, et particulièrement celles qui servent d'aliment à l'industrie et au commerce. Ces systèmes, si le bon sens public n'en avait pas fait une prompte justice, auraient suffi pour amener les désordres les plus graves, et pour plonger dans une détresse sans exemple toutes les familles dans l'intérêt desquelles on prétendait les avoir imaginées.
Mais si l'autorité publique n'a point à se mêler de la manière dont les produits annuels d'une nation se répartissent entre les hommes qui concourent à les former, à moins que ce ne soit pour protéger chacun dans la jouissance et la disposition de ses biens, il ne s'ensuit pas qu'elle soit impuissante pour adoucir le sort des classes les plus nombreuses et les moins aisées; elle peut [II-489] leur assurer une plus grande part dans les produits de l'industrie, soit par la diminution, soit par un meilleur emploi ou par une répartition plus équitable des charges publiques; elle peut délivrer l'industrie et le commerce des entraves ou des impôts mal assis, qui en arrêtent l'essor; elle peut faciliter l'enseignement, et concourir ainsi au bien-être des classes les plus pauvres, par le développement de leur intelligence et le perfectionnement de leurs mœurs.
L'emploi de ces moyens ne dépouillera personne des fruits de ses travaux ou de ses économies; et, loin de faire déserter les capitaux, sans lesquelles aucune industrie ni aucun commerce ne sauraient exister, il appellera les capitaux qui ne trouveront point ailleurs les mêmes garanties.
FIN.↩
Notes
[1] 13 janvier 1801.
[2] 12 avril 1803.
[3] Art. 16, 17 et 18.
[4] Richard Godson, Practical treatise on the law of patents for inventions, p. 379-384.
[5] Les autres dispositions du décret déterminent les conditions et la durée de la jouissance de l'inventeur.
[6] Les monopoles sont prohibés par les constitutions de plusieurs états, notamment par celles de New-Hampshire, de Massachusetts, de Vermont, de la Caroline du Nord, de l'Ohio et de l'Illinois.
[7] Voy. Revue encyclop., année 1826, t. 1, p. 692-696.
[8] Richard Godson, Practical treatise on the laws of patents for inventions, pag. 379.
[9] La loi des 3r décembre 1790 et 7 janvier 1791 dispose- d'une manière si générale sur la propriété des découvertes, que quand elle eut été promulguée plusieurs personnes demandèrent des brevets d'invention pour des établissemens de finances. Une loi du 2o septembre 179a déclara que la première ne rappliquait qu'aux découvertes faites dans les arts et métiers, et que le pouvoir exécutif ne pouvait plus accorder de brevets. d'invention aux établissemens relatifs aux finances.
[10] James Godson, Practical treatise, p. 53. Loi du 31 décembre 1790, art. 16, § 3. Arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 1828. J.-B. Sirey, t. XXVIII, iT.e part., p. 9496. – Arrêt de la Cour royale de Rouen du i janvier 1829. – Ibid, t. XXIX, 2e part., p. 65.
[11] James Godson, Practical treatise on the law of patents for inventions, p. 53.
[12] Ibid, p. 98-99. — Une industrie pratiquée en pays étranger, qui serait décrite dans un ouvrage scientifique, ne pourrait pas faire l'objet d'un brevet d'importation. Cela parait résulter, du moins, de la loi et des arrêts cités dans la première note de ce chapitre.
[13] Joseph Chitty, Treatise on the laws of commerce and manufactures, vol. II, chap. XII, p. 192. — Richard Godson, Practical treatise, p. 58.
[14] Loi du 31 décembre 1790, art. 16, § 3. - James Godson, Practical treatise, p. 80.
[15] Joseph Chitty, Treatise on the laws of commerce and manufactures, vol. II, ch. XII, p. 196-197. - Richard Godson, Practical treatise, p. 60-61. - Arrêt de la Cour de cassation du 10 février 1806.
On peut prouver par témoins que l'industrie pour laquelle un brevet d'invention a été accordé, était connue et pratiquée avant l'obtention du brevet. Arrêts de la Cour de cassation des 19 mars 1821 et 8 février 1827. — J.-B. Sirey, t. XXVII, Ire partie, p. 107 et 108.
La preuve testimoniale, sur la possession de la découverte, doit être admise, même lorsque chacune des deux parties a obtenu un brevet d'invention. - Arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 1832. - Ibid, t. XXXII, 1re partie, p. 387 et 388.
[16] Par un arrêt du 12 juin 1830, la Cour royale de Grenoble a décidé, avec raison, qu'une méthode de lecture, quelque bonne qu'elle pût être, ne pouvait pas être l'objet d'un brevet d'invention. -J.-B. Sirey, t. XXXII, 2e part., p. 11.
[17] Joseph Chitty, Treatise on the laws of commerce and manufactures, vol. II, ch. XII, p. 194.
[18] James Godson, Practical treatise, p. 78-94.
[19] James Godson, p. 66.
[20] Un fabricant poursuivi comme contrefacteur n'a pas besoin de prouver, pour demander la nullité du brevet d'invention en vertu duquel il est attaqué, qu'il était personnellement en possession de l'industrie brevetée, ou qu'il possédait les connaissances nécessaires pour l'exercer, avant l'obtension du brevet; il lui suffit d'établir que cette industrie était exercée ou connue par d'autres que par l'inventeur, avant que celui-ci eût obtenu son brevet. Les jugemens qui décidaient le contraire, ont toujours été annulés, lorsqu'ils ont été dénoncés à la Cour de cassation. (Voy. les arrêts des 20 décembre 1808, 19 mars 1821 et 11 janvier 1825, dans le Recueil général des lois et arrêts, de M. J.-B. Sirey.)
[21] Richard Godson, Practical treatise, p. 109. - Joseph Chitty, Treatise on the laws of commerce and manufactures, vol. II, ch. XII, p. 201-204.
[22] Loi du 31 décembre 1789, art. 16. - James Godson, Practical treatise, p. 102-136.
[23] James Godson, p. 47.
[24] Loi du 25 mai 1791, art. 1er.
[25] James Godson, Practical treatise, p. 143-144.
[26] L'impôt est de 300 fr. pour cinq ans, de 800 fr. pour dix ans, et de 1500 fr. pour quinze ans. Il y a de plus quelques frais à payer pour l'expédition des brevets et pour d'autres actes; mais ces frais sont peu considérables.
[27] James Godson, Practical treatise, p. 148.
[28] James Kent, Commentaries on the American law, vol. II, part. 5, lect. 36, p. 299-305.
[29] Rien n'est plus commun que de voir confondre le pouvoir avec le droit, surtout quand il s'agit de droit naturel. « Tout individu, par les droits naturels du genre humain, dit un jurisconsulte anglais, est autorisé à exercer un pouvoir sans contrôle sur toute propriété dont il est une fois légalement en possession, soit qu'il l'ait obtenue par achat, soit qu'il l'ait produite par son travail. L'acquéreur d'une marchandise quelconque, d'une machine, ou d'un livre, serait donc libre de disposer de ses biens de la manière qui lui serait la plus avantageuse, et il pourrait multiplier le nombre des machines ou des livres autant que l'exigerait son intérêt ou son plaisir. - Ce droit naturel à une liberté illimitée de commerce a été envahie à différentes époques par les souverains ou par des individus. » (Richard Godson, Practical treatise on the law of patents for inventions and of copyright, b. I. ch. I, p. 1.) Il est évident que cet écrivain prend ici le pouvoir pour le droit, et qu'il met en principe ce qui est en question.
[30] Lorsqu'un homme, par l'exercice de ses facultés intellectuelles, dit Blackstone, a produit un ouvrage original, il semble avoir évidemment le droit de disposer comme bon lui semble de ce même ouvrage; de même que toute tentative de changer la disposition qu'il en a faite, me paraît être une violation de ce droit. L'identité d'une composition littéraire consiste entièrement dans la conformité des opinions et du langage; les mêmes conceptions, revêtues des mêmes paroles, sont nécessairement la même composition; et quel que soit le moyen qu'on prenne d'exposer cette composition aux yeux ou aux oreilles d'autrui, par récit, par écriture manuscrite ou par l'impression, dans quelque nombre d'exemplaires ou à quelque époque que ce soit, c'est toujours le même ouvrage de l'auteur, qui est ainsi exposé; et aucun autre homme (du moins on l'a pensé) ne peut avoir le droit de l'exposer, particulièrement pour en tirer un bénéfice, sans le consentement de l'auteur. Ce consentement peut être considéré comme ayant été donné tacitement au genre humain, lorsqu'un auteur souffre que son ouvrage soit publié par une autre personne, sans réclamation ni réserve de ses droits, et sans y mettre l'empreinte de sa propriété. Mais lorsqu'un écrivain vend un seul exemplaire de son ouvrage, ou lorsqu'il aliène complétement ses droits d'auteur, on a cru que, dans le premier cas, l'acquéreur n'avait pas plus le droit de multiplier les copies de cet exemplaire pour les vendre, qu'il n'aurait le droit d'imiter, dans un but pareil, le billet qu'il a acheté pour entrer à l'Opéra ou assister à un concert; et que, dans le second cas, la propriété entière, avec ses droits exclusifs, est transférée à perpetuité à l'acquéreur. Commentaries on the laws of England, B. 2, ch. XXVI, § 8, vol. II, p. 405 et 406.
[31] Richard Godson, Practical treatise on the law of patents for inventions and of copyright, B. III, chap. I, p. 204206.
[32] Voici les termes mêmes dans lesquels l'auteur anglais s'exprime : « Nothing is more erroneous than the common practice of referring the origin of moral rights and the system of natural equity, to that savage state, which is supposed to have preceded civilized establishmens: in which litterary composition, and of consequence the right to it, would have no existence. But the true mode of ascertaining a moral right seems to be to inquire whether it is such as the reason, the cultivated reason of mankind, must necessarily assent to. No proposition seems more conformable to that criterion, than that every one should enjoy the reward of his labour, the harvest where he has sown, or the fruit of the tree he has planted. And if any private right ought to be preserved more sacred and inviolate than another, it is that where the most extensive benefit flows to mankind from the labour by which it is acquired. Litterary property, it must be admitted, is very different in its nature from a property in substantial and corporeal objects; and this difference has led some to deny its existence as property; but whether it is sui generis, or under whatever denomination of rights it may more properly be classed, it seems founded upon the same principle of general utility to society, which is the basis of all other moral rights and obligations. » T. E. Tomlins, Law-Dictionary, v°. Litterary Property.
[33] Les compositions littéraires sont soumises aux mêmes influences que les productions des arts: il suffirait, par exemple, de classer, par époques, les grands tableaux qui ont été faits chez une nation, pour savoir quels sont les intérêts et les idées qui tour à tour ont eu la domination.
[34] Décrets des 21 avril et 3 juin 1811.
[35] Les jurisconsultes modernes, qui ont en à parler de la propriété des choses acquises par le travail ou créées par l'industrie, et qui n'ont pas su se placer au-dessus des principes du droit romain ou du droit féodal, ont été fort embarrassés. Blackstone, par exemple, n'a pu fonder la propriété littéraire que sur le droit de premier occupant, admis par les jurisconsultes romains: Quod enim ante nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur. ( Instit. lib. II, tit. I, § 12. — Dig. lib. I, tit. VIII, leg. 3.)
There is still another species of property, dit-il, which.... is more properly reducible to the head of occupancy than any other..... And this is the right which an author may be supposed to have in his original literary compositions. Comment. în the laws of England, Book II, ch. XXVI, § 8, p. 405.
Il résulte de là qu'un homme qui trouve une perle sur le bord de la mer, et celui qui compose un poème épique, sont propriétaires au même titre. On verra plus loin que les auteurs du Code civil n'étaient pas plus avancés que le jurisconsulte anglais, et qu'ils étaient enchaînés, comme lui, par les maximes des peuples possesseurs d'esclaves.
[36] Edit d'Henri III, de 1581.
[37] Dans un édit de 1691, Louis XIV a exprimé, quoiqu'en termes moins clairs, la pensée d'Henri III. Il n'appartient qu'aux rois de faire des maîtres des arts et métiers. On sait que les maîtres des arts et métiers avaient le privilége de travailler ou de faire travailler. Ces prétentions royales n'ont été abandonnées, en France, que vers la fin du dix-huitième siècle. On en trouve la condamnation dans un édit de Louis XVI, de 1776.
Les lois romaines ne disent pas un mot de la propriété littéraire; elles nous apprennent seulement que, dans le cas où une personne écrit sur une matière qui est la propriété d'une autre, le tout appartient au propriétaire de la matière; il est évident qu'il ne s'agit, dans ce cas, que de la propriété d'une copie.
[38] On se tromperait cependant si l'on s'imaginait qu'à la renaissance des lettres, tous les gouvernemens mirent volontairement des obstacles au progrès des sciences. Avant l'invention de l'imprimerie, il existait à Paris, pour le service de l'Université, vingt-quatre libraires, deux relieurs, deux enlumineurs, et deux écrivains jurés. Les membres de cette corporation étaient élus par l'Université, et jouissaient du privilége de ne payer aucun impôt; le nombre en avait éte fixé par deux édits royaux. Un édit de Louis XII, du 9 avril 1523, le premier dans lequel il ait été fait mention de l'imprimerie, ordonna la conservation de leurs priviléges et libertés, pour la considération, dit-il, du grand bien qui est advenu en notre royaume au moyen de l'art et science d'impression, l'invention de laquelle semble estre plus divine qu'humaine : laquelle, grâce à Dieu, a été inventée et trouvée de notre tems par le moyen et industrie des dits libraires, par laquelle notre saincte foy catholique a été grandement augmentée et corroborée, la justice mieux entendue et administrée........ et au moyen de quoi tant de bonnes et salutaires doctrines ont été manifestées, communiquées et publiées à tout chacun : au moyen de quoy nostre royaume précède tous autres.........
[39] Voy. le préambule de l'acte de la huitième année du règne de la reine Anne.
[40] Richard Godson's, Practical treatise on the law of patents for inventions and of copyright, book 1, ch. I, p. 8.
[41] 41 George III, ch. 107.
[42] 54 George III, ch. 156.
[43] Les actes du congrès qui donnent quelques garanties aux auteurs américains ou aux étrangers qui résident aux États-Unis, sont du 31 mai 1790 et du 29 avril 1802.
[44] James Kent, Commentaries on american law, vol. II, part. V, lect. XXXVI, p. 3o6. Le savant auteur des Commentaires sur les lois américaines approuve l'opinion qu'avait Blackstone de la propriété littéraire. Il croit qu'avant le statut de la huitième année du règne de la reine Anne, un auteur avait, par le droit commun, la propriété perpétuelle de ses ouvrages.
[45] Le privilége donné, en 1643, pour l'Histoire de France de Mézerai, par exemple, fut de vingt ans, à compter du jour de la publication. Le privilége donné à Grotius, pour la vente de son Traité du droit de guerre et de paix, fut de quinze ans.
[46] Le décret impérial du 6 juin 1806, qui détruisit la liberté que chacun avait d'ouvrir un théâtre et d'y faire représenter toutes sortes de pièces, respecta, sous d'autres rapports, les droits garantis aux auteurs par la loi du 13 janvier 1791. L'article 10 déclare que les auteurs et les entrepreneurs seront libres de déterminer entre eux, par des conventions mutuelles, les rétributions dues aux premiers par sommes fixes ou autrement. L'article 11 charge les autorités locales de veiller strictement à l'exécution de ces conventions. L'article 12 ajoute que les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes ont les mêmes droits que l'auteur, et que les dispositions, sur la propriété des auteurs et sa durée, leur sont applicables, ainsi qu'il est dit au décret du 1er germinal an XIII.
[47] Loi des 19 et 24 juillet 1793. art. 1er.
[48] Le langage mensonger que je signale ici se trouve dans tous les ouvrages de jurisprudence anglais, qui parlent du droit des auteurs. — Je dis que les compositions littéraires et autres conceptions de l'esprit tombent au rang des choses communes, et non au rang des propriétés publiques. Il est évident, en effet, que des choses dont chacun peut s'emparer dans tous les pays sont communes à tous comme l'air et la lumière.
[49] L'amende est aujourd'hui de trois pences (environ trente centimes). 40, George III, c. 107, s. 1; 54 ib., c. 156, s. 4.
[50] Les exemplaires sont confisqués au profit du propriétaire du manuscrit; mais ils doivent être détruits, et ne peuvent servir que comme papier maculé.
[51] 8, Anne, ch. XIX, § 2. -Godson's, Practical treatise on the law of patents for inventions and of copyright, b. III, ch. I, p. 211. — - Le statut de la huitième année du règne de la reine Anne, exigeait le dépôt de neuf exemplaires de chaque ouvrage, pour les Universités ou pour d'autres établissemens publics, sous peine de cinq livres d'amende, pour chacun des exemplaires non déposés. Cette obligation a été abolie par les statuts subséquens.
[52] J. Kent, Commentaries on american law, part. V, lect. 36, p. 308.
[53] Voy. les art. 425-429 du Code des délits et des peines.
[54] J.-B. Sirey, t. IV, 2e part. p. 15.
[55] Le gouvernement de la restauration avait trouvé le moyen de cumuler les moyens préventifs avec les moyens répressifs. Il soumettait tous les ouvrages à la censure après l'impression, mais avant la publication, et les faisait saisir avant qu'aucun exemplaire en eût été mis en vente. Ensuite il poursuivait les auteurs, et les faisait condamner comme s'ils avaient librement publié leurs écrits. Ayant démontré l'injustice d'un tel procédé, en 1817, dans les débats d'un procès qui eut alors quelque célébrité ( Censeur européen, t. IV, p. 232 et suiv., et t. V, p. 139 et suiv. ), le gouvernement voulut, dans la même année, le faire consacrer par une loi; mais son projet fut rejeté. Du nouveau Projet sur la presse, pag. 4-12.
[56] Les ouvrages purement littéraires ont moins besoin que les ouvrages scientifiques, de la consécration du temps; il n'est pas très-rare, cependant, de voir des écrits qui d'abord n'ont donné aucun bénéfice aux hommes qui en étaient les auteurs, avoir plus tard de grands succès. Le drame le plus médiocre, joué sur un de nos théâtres de troisième ordre, est plus productif pour l'auteur que ne le fût Athalie pour Racine. Les tragédies de Chénier feront peut-être la fortune des comédiens qui sauront les jouer, tandis qu'elles n'auront rien produit, ni pour cet écrivain, ni pour ses héritiers.
[57] En Angleterre, tous les jurisconsultes sont loin d'avoir partagé cette erreur; on a vu, au contraire, que lorsque la question a été approfondie, presque tous les magistrats ont été d'avis que la propriété littéraire devait être régie par les lois communes; mais déjà le Parlement avait prononcé.
[58] Ces propositions reçoivent quelques exceptions. Les maisons qui environnent un beau jardin profitent des avantages de la vue et de la salubrité de l'air, sans rien faire perdre à celui qui en est propriétaire.
[59] Le nom et la renommée d'une personne sont, pour elle, une propriété, à laquelle il n'est pas plus permis de porter atteinte, soit par usurpation, soit autrement, qu'à toute autre espèce de propriété. Une personne ne pourrait donc pas légitimement exploiter le nom ou la réputation d'une autre, pour s'enrichir, en lui attribuant des ouvrages que celle-ci n'aurait pas composés. Ainsi, un libraire qui avait publié des Mémoires sous le nom d'un personnage célèbre (Fouché, duc d'Otrante), auquel ils n'appartenaient pas, a été condamné, sur la poursuite du fils de l'auteur prétendu, à déposer au greffe du tribunal l'édition entière pour être détruite, ou à payer à la partie poursuivante, à titre de dommages-intérêts, cinq francs pour chacun des exemplaires qui ne seraient pas représentés.—Arrêt du 20 mars 1826, Cour royale de Paris, 2e chambre. -J.-B. Sirey, t. XXVII, 2e part., p. 156 et 157.
[60] Richard Godson, Practical treatise on the law of patents for inventions, b. III, ch. II, p. 224-225.
[61] Ibid, 225-227. Il ne faut pas conclure de là qu'une personne n'a pas le droit de publier, comme preuves ou comme moyens de justification, des lettres qu'elle a reçues.
[62] L'éditeur d'une encyclopédie anglaise y avait inséré une partie considérable d'un Traité de l'art de l'escrime (75 pages sur 118). Traduit en justice comme coupable de contrefaçon, il fut condamné. R. Godson's Practical treatise, b. III, ch. III, p. 233.
[63] Cette question s'est plusieurs fois présentée en Angleterre, et elle a toujours été résolue dans le même sens. R. Godson's Practical treatise, b. III, ch. IV, p. 246-247. - Jugement du 8 juin 1830, tribunal de la Seine; J.-B. Sirey, t. XXX, 2e part., p. 162.
[64] R. Godson's Practical treatise, b. III, ch. V, p. 280-281. -Joseph Chitty, Treatise on the laws of commerce and manufactures, vol. II, ch. XII, p. 241.
[65] Arrêt du 28 octobre 1830, Cour de cassation, section criminelle; J.-B. Sirey, t. XXXI, 1гe part., p. 568.
[66] Joseph Chitty, Treatise on the laws of commerce and manufactures, vol. II, ch. XII, p. 242.-R. Godson's Practical treatise, b. III, ch. III, p, 242-245.
[67] La contrefaçon d'un ouvrage annoté ne donnerait lieu à des dommages que pour la valeur des notes, si l'ouvrage était tombé dans le domaine public. —Arrêt du 4 septembre 1812, Cour de cassation. -J.-B. Sirey, t. XXI, 1re part., p. 266.
[68] R. Godson's Practical treatise, part. III, ch. III, p. 238240. -J. Chitty, Treatise on the laws of commerce and manufactures, vol. II, ch. XII, p. 242.
[69] Ibid, p. 241-243.
[70] R. Godson's Practical treatise, part. III, ch. III, p. 228-237. S'emparer des recueils et compilations qui ne sont pas de simples copies, qui ont exigé, dans leur exécution, du discernement, du goût, de la science, et le travail de l'esprit, c'est commettre le délit de contrefaçon, quoique l'auteur ait gardé l'anonyme. Arrêt du 2 décembre 1814, Cour de cassation. J.-B. Sirey, t. XV, 1re partie, p. 60.
[71] R. Godson's Practical treatise, part. III, ch. IV, p. 268-271.
[72] R. Godson's Prac. treat., b. III, ch. I, p. 212-213.
[73] R. Godson's Practical treatise, b. III, ch. I, p. 213-214.
[74] Ibid, p. 210. - J. Chitty, Treatise on the laws of commerce and manufactures, vol. II, ch. XII, p. 240.
[75] J. Chitty, Treatise on the laws of commerce and manufactures, ch. XII. R. Godson's, p. 211.
[76] La plupart des questions transitoires auxquelles ont donné lieu les lois sur la propriété littéraire, ont été traitées par M. Merlin, dans ses Questions de droit, et dans son Répertoire de jurisprudence, aux mots : CONTREFAÇON et PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.
[77] L'auteur qui a publié un ouvrage en pays étranger, et vient ensuite le faire réimprimer en France, n'est pas admis à poursuivre les contrefacteurs, même lorsque cet ouvrage a été intercalé dans un ouvrage nouveau qui n'a pas été publié hors de France. Arrêt du 26 novembre 1828, Cour royale de Paris, chambre de police correctionnelle. J.-B. Sirey, t. XXIX, 2e part., p. 6.
[78] R. Godson's Practical treatise, b. III, ch. IV, p. 294.
[79] Lois des 4 et 10 décembre 1790.
[80] Loi du 3 septembre 1807.
[81] Loi du 22 floréal an VII (11 mai 1799), art. 7.
[82] Un décret du 15 octobre 1810 détermine quels sont les ateliers et manufactures qui répandent une odeur insalubre ou incommode, et fixe les conditions sous lesquelles il est permis de les établir.
Ce décret est vicieux en ce qu'il donne à des fonctionnaires amovibles le jugement de questions de propriété.
[83] Code civil, art. 671, 672 et 673.
[84] Ibid, art. 674. - V. le décret du 10 mars 1809.
[85] On a écrit sur les droits ou les obligations qui résultent du voisinage des propriétés, des ouvrages fort étendus. Je n'en parle ici que pour faire comprendre comment les droits des propriétaires sont limités les uns par les autres.
[86] La faculté de faire des fouilles dans une propriété et d'en extraire certaines matières, est limitée en France par les lois sur les mines.
[87] Promulguée le 17 du même mois.
[88] Sanctionnée le 10 du même mois.
[89] La Charte de 1830, comme celle de 1814, déclare que toutes les propriétés, sans exception, sont inviolables; mais il est sous-entendu qu'on n'en fera point usage pour exercer une branche d'industrie ou de commerce, réduite en monopole; autrement il y aurait lieu à confiscation, malgré l'inviolabilité promise par la Charte.
[90] Il ne faudrait pas conclure de ces observations que, pour un peuple peu civilisé, toutes les formes de gouvernement sont également mauvaises; il y a des degrés dans le mal comme dans le bien.
[91] Grandeur et décadence des Romains.
[92] Les motifs de ce décret méritent d'être rapportés; les voici :
« L'Assemblée nationale considérant que si, dans une guerre dont l'objet est la conservation de la liberté, de l'indépendance et de la constitution française, tout citoyen doit à l'État le sacrifice de sa vie et de sa fortune, l'État doit à son tour protéger les citoyens qui se dévouent à sa défense, et venir au secours de ceux qui, dans le cas d'invasion ou de séjour passager de l'ennemi sur le territoire français, auraient perdu tout ou partie de leurs propriétés ;
» Voulant donner aux nations étrangères le premier exemple de la fraternité qui unit les citoyens d'un peuple libre, et qui rend commun à tous les individus du corps social le dommage occasionné à un de ses membres;
» Certaine que tous les habitans des départemens frontières trouveront dans la sollicitude paternelle des représentans de la nation un nouveau motif d'attachement à la patrie et de dévouement à la cause de la liberté;
» Considérant qu'il importe de proportionner aux besoins et aux ressources individuelles les secours que la situation du Trésor public permettra d'accorder, et de prendre les précautions nécessaires pour que les sommes destinées à ce saint usage soient également réparties,
» Décrète ce qui suit, etc.
[93] Les commissaires du gouvernement ont été supprimés par un décret du 26 floréal an II (15 mai 1794), qui les a remplacés par des commissaires de district.
[94] Voici quelques-unes des dispositions de la loi du 23 novembre 1790 :
« Le revenu net d'une terre est ce qui reste à son propriétaire, déduction faite, sur le produit brut, des frais de culture, semences, récolte et entretien. » Art. 2, tit. I.
« Pour déterminer la cote des contributions des maisons, il sera déduit un quart sur leur revenu, en considération du dépérissement, des frais d'entretien et de réparations. » Art. 10, tit. II.
« Les fabriques et manufactures, les forges, moulins et autres usines, seront cotisés à raison des deux tiers de leur valeur locative, en considération du dépérissement, et des frais d'entretien et de réparations qu'exigent ces objets. » Art. 14, tit. II.
[95] Quand Bonaparte s'empara du pouvoir, il inséra dans sa constitution une disposition qui défendait de traduire en justice un agent du gouvernement, à moins que la poursuite n'eût été autorisée par le Conseil-d'État. Cette disposition, que la restauration conserva, et qui n'a pas encore été abrogée, suffirait pour rendre illusoires toutes les garanties.
[96] Statut 57, George III, ch. XIX, § 38.
Les dispositions de la loi française et de la loi anglaise semblent avoir été empruntées aux usages de la Perse. Dans ce pays, suivant Chardin, quand un vol est commis sur un grand chemin, ce sont les gardes des grandes routes qui en répondent. Si un vol est commis dans une ville à force ouverte, les habitans du quartier dans lequel il a eu lieu sont tenus, ou de retrouver la chose volée, ou d'en payer la valeur au propriétaire. Si le vol a été fait secrètement, c'est l'individu chargé de la sûreté publique qui en est responsable. Les magistrats ont un droit proportionnel sur les objets qu'ils font retrouver ou dont ils font payer la valeur. Chardin attribue à cet usage la grande sûreté dont on jouit en Perse. Chardin, Voyage en Perse, t. VI, chap. XVIII, p. 123-127.
[97] Il ne faut jamais perdre de vue que les produits du travail sont les premières, les plus incontestables et les plus sacrées des propriétés; que là où l'esclavage existe, sous quelque forme et sous quelque dénomination que ce soit, les propriétés nées du travail sont ravies à mesure qu'elles sont produites, et que, par conséquent, elles ne sont pas garanties; enfin, que les monopoles, les impôts et les emprunts qui grèvent les produits du travail, dans un intérêt autre que celui des travailleurs, sont encore plus attentatoires à la propriété que la confiscation qu'on a prétendu abolir.
[98] Voyez le Traité de législation, t. II, chap. XIV, XXV, XXVI et XXVII.
[99] Traité de législation, t. IV, liv. V, chap. XIII, p. 237.
[100] Hume, Histoire d'Angleterre.
[101] Esprit des lois, liv. XXVI, ch. 15.
[102] Comment., b. II, ch, 1.
[103] Traité de législation, t. 2, p. 33 et 35.
[104] Institutions du droit de la nature et des gens; par le citoyen Gérard de Rayneval, page 96.
[105] Le droit civil français suivant l'ordre du Code, par M. Toullier, tome 3, 40, § 64.
[106] Art. 1, 5 et 358.
[107] Art. 544 et 545.
[108] Art. 9 et 10.
[109] Une définition de la propriété, par Robespierre, publiée récemment par une société politique, a soulevé l'indignation d'un grand nombre de personnes. Cette définition n'est pas bonne; mais elle n'est pas plus mauvaise que d'autres qu'on adopte sans examen. Elle est fondée sur l'erreur fort répandue que c'est la loi civile qui donne l'existence à la propriété.
[110] Ususfructus est jus alienis rebus utendi fruendi, salvá rerum substantiâ. Instit., lib. II, tit. IV, in princ.
[111] Code civil, art. 595 et 1429.
[112] Voyez art. 120 du Code civil.
[113] Tome I, chap. XXVI, page 467.
[114] Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable. Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans : toute stipulation contraire est nulle. Code civil, art. 530.
[115] Traité de législation, tome IV, liv. 5, chap. 23.
[116] Raynal, Histoire philosophique des établissemens des Européens dans les Deux-Indes, tome VIII, liv. 6, pages 245-247.
[II-590]
TABLE DES MATIÈRES.
(Le chiffre romain indique le volume, le chiffre arabe la page.)
A.
ABOLITION. Voy. Péages.
ABRÉGÉ. Un abrégé fait consciencieusement n'est pas une violation des droits de l'auteur de l'ouvrage original. II, 214.
ACCESSION. Mot imaginé pour résoudre des questions de propriété. II, 379. - Fausses conséquences auxquelles le prétendu droit d'accession a conduit les auteurs du Code civil. 370.- Difficultés que fait naître ce prétendu droit quand il s'applique à des choses mobilières. 395.- Les auteurs du Code civil, après avoir admis le droit d'accession pour les choses mobilières, ne savent comment l'appliquer. 398.
ACCROISSEMENT. Voy. Population.
ACQUISITION. Voy. Propriété.
ADMINISTRATION. Elle est chargée de la conservation des forêts, rivières et chemins, par la loi du 22 décembre 1790. I, 283.
ADMINISTRATION FORESTIÈRE. Elle est organisée par l'assemblée constituante. I, 241.
AGRICULTURE. Garanties données à la liberté de l'industrie agricole. II, 253. Voy. Industrie.
AIR. Voy. Choses.
ALIENATION. Voy. Brevet d'invention
ALIGNEMENT. Voy. Chemins publics.
ALLUSIONS. Les allusions aux circonstances politiques du moment, sont déplacées dans un ouvrage scientifique. I, xiv.
ALLUVION. Les altérissemens et accroissemens qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riveraius d'un [II-491] fleuve ou d'une rivière, navigable ou non, profitent aux propriétaires riverains. I, 305. Pour quels motifs les terres d'alluvion appartiennent aux propriétaires riverains. 328. Voy. Rivière.
ANALYSE. L'analyse des divers élémens dont la propriété se compose, est le meilleur moyen de résoudre les questions qui Embarras des se présentent sur cette matière. II, 377. jurisconsultes qui veulent résoudre des questions de propriété, sans avoir fait l'analyse des élémens dont elle se compose. 377.
ANGLAIS. Voy. Mer.
ANGLETERRE. Voy. Halage, Mines, Propriété littéraire, Rivières.
APPROPRIATION. C'est l'action d'un être organisé, qui unit à sa propre substance les choses au moyen desquelles il se conserve et se reproduit. I, 49.-Il n'est aucun être organisé qui puisse se conserver, sans s'approprier une partie des choses au milieu desquelles la nature l'a placé. 49. L'homme est soumis, sous ce rapport, aux mêmes lois que les autres animaux. 50. - Toutes les choses que l'homme a besoin de s'approprier, n'existent pas en même quantitě. 52. — Parmi ces choses, les unes sont communes au genre humain; les autres appartiennent à des nations, à des villes ou communes, ou à des particuliers. 52. - Les choses que l'homme s'approprie dans l'ordre naturel de la production ou de la transmission, prennent le nom de propriétés. 55. — Voy. Fonds de terre, Obstacles, Propriété foncière, Terres.
ARBRES. Voy. Chemins publics.
ASSEMBLÉE CONSTITUANTE. Ses mesures pour la conservation des forêts. I, 239.
ASSOCIATION. Droit, exercice d'une faculté naturelle de l'homme. I, xiv. Nécessité de donner des règles à l'exercice du droit d'association, et d'établir des moyens de répression contre les abus des associations. I, xvI. Quels sont les vices de la loi contre les associations. I, xvI.
ATTÉRISSEMENS. Voy. Ordonnance de 1669, Iles.
B.
BACS. Tous les citoyens sont autorisés à établir des bacs, coches [II-492] ou voitures d'eau, sur les rivières et canaux, par le décret du 25 août 1792. I, 289. — La loi du 6 frimaire an VII prive les citoyens du droit de tenir, sur les rivières et canaux navigables, des bacs, coches et bateaux. 292.
BASSINS. Les bassins des fleuves forment la division la plus naturelle des nations, I, 89. — Division de la France par bassins, en arrondissemens de navigation. 294. - Voy. Navigation,
BATEAUX. Voy. Bacs.
BENTHAM. Il tente inutilement d'expliquer la nature et l'origine de la propriété. Il tombe dans la même erreur que Montesquieu. II, 361. Voy. Classification.
BIENS. Voy. Classification.
BLACKSTONE. Son opinion sur la nature de la propriété littéraire II, 105. — Il fait à la propriété littéraire une fausse application du principe de l'occupation. 132. Il tente en vain d'expliquer l'origine de la propriété. Il finit par adopter l'opinion de Grotius. 359.
BOIS. Voy. Déboisement, Forêts.
BONIFACE VIII. Il dispense le clergé de payer aucun impôt, et laisse aux peuples la charge de garantir ses propriétés. Un roi d'Angleterre refuse cette garantie. II, 334.
BORNES. Voy. Propriété foncière.
BREVET D'INVENTION. Quels sont les objets pour lesquels un brevet d'invention peut être accordé, soit en France, soit en Angleterre. II, 59. La découverte d'un principe ou d'une vérité générale, ne peut donner lieu à un brevet d'invention. 61. — La découverte d'un produit agricole ne peut donner lieu à un brevet d'invention. 67. — En Angleterre, une chose qui n'aurait aucune importance, ne donnerait pas lieu à un brevet d'invention. 69. — Les additions ou perfectionnemens faits à des choses déjà connues, peuvent donner lieu à un brevet d'invention. 69. Conditions prescrites pour obtenir un brevet d'invention. 72.—Un brevet d'invention devient nul, si la découverte n'est pas mise en pratique dans les deux ans du jour où il a été obtenu. 80. — La personne qui obtient un brevet d'invention en France ne peut, sous peine de déchéance, en prendre un pour le même objet en pays étranger. 83. - Un brevet d'invention peut [II-493] être aliéné comme toute autre propriété. 83. La durée du monopole créé par un brevet d'invention peut être prolongée par la puissance législative. 83. La violation du privilége de l'inventeur donne lieu à la saisie des objets contrefaits. 85. Voy, Invention, Découverte.
BREZIL. Voy. Terres.
BYNKERSHOEC. Son opinion sur l'étendue de mer qui fait partie du territoire de chaque nation. I, 365.
C.
CAMPAGNES. Au commencement du 15e siècle, les campagnes sont dépeuplées d'hommes, et peuplées de bêtes sauvages par les seigneurs. I, 269.
CANADA. Voy. Terres.
CANAUX. Voy. Bacs.
CAP DE BONNE-ESPÉRANCE. Voy. Colonisation.
CAPITAUX. Voy. Rentes.
CARRIERES. Ce qu'on entend par ce mot. A qui elles appartiennent. I, 420.—Elles ne peuvent être exploitées que sous la surveillance de la police. 424
CHARDIN. Voy. Perse.
CHARGES. Voy. Mitoyenneté.
CHARLES VI. Dans son ordonnance, rendue le 25 mai 1413, pour la réformation du royaume, il n'admet aucune distinction entre les rivieres navigables et les rivières non navigables. I, 271. — Il tente, par son ordonnance du 25 mai 1413, de réprimer les usurpations commises par les seigneurs, sur les fleuves et les rivières. 270. - Au mois de février 1415, il donne des règles à la navigation de la Seine et de ses affluens. Les dispositions qu'il prend sont adoptées par Louis XIV. 327.
CHARLES VII. En répondant aux remontrances des états du Languedoc, de 1456, ce prince n'admet pas les prétentions des seigneurs et gens d'église sur les rivières non navigables. I, 276. Il prononce, par son ordonnance du 30 juin 1438, l'abolition des péages que les seigneurs ont établis sur la Loire. 271.
[II-494]
CHEMINS PUBLICS. De la propriété, de l'usage et de l'entretien des chemins publics. 373. Quels sont les services qu'ils rendent aux diverses classes de la population. I. 373. — Erreur grave de l'arrêté du gouvernement, du 11 juillet 1797, sur l'objet des chemins publics. 374. — Une nation ne peut exister qu'à l'aide de chemins qui mettent en communication chacune des fractions dont elle se compose. 376. — Principales questions auxquelles donnent naissance les chemins publics. 376. Les jurisconsultes romains divisaient les chemins en trois classes. 378.-Sous le régime féodal, les chemins publics éprouvent le même sort que les rivières. 379. L'abolition du régime féodal, et la loi du 16 juillet 1790, remettent les chemins publics au rang des choses qui composent le domaine national. 380.-Les arbres plantés sur les chemins publics cessent d'appartenir aux seigneurs. 382. — Lois sur l'entretien des chemins publics. 383. — Le Code civil ne met dans le domaine public, que les chemins entretenus aux frais de l'Etat. 384, Quand un chemin public devient impraticable, les particuliers sont autorisés à passer sur les propriétés qui le bordent. Indemnité due aux propriétaires. 397. Lois qui en détérminent la largeur. 399. Allignement des chemins publics. 401.-On peut prendre, dans les propriétés qui bordent les chemins publics, les matériaux nécessaires pour les entretenir. 405. Voy. Halage, Loyseau, Routes, Sel.
CLASSIFICATION. De la classification des propriétés et de la distinction des biens. II, 443.- Quel est l'objet de la classification des biens ou des propriétés. 443. Comment il convient de classer les propriétés. 445. - Comment les jurisconsultes romains avaient divisé les choses. 447. —Comment Bentham proposa de diviser les choses. 448. Vices de cette division. 448. La meilleure classification des biens est celle qui les divise en meubles et en immeubles. Motifs de cette distinction. 455.
CHOSES. Quelles sont les choses communes à tous les hommes. I, 63. Dans un pays civilisé, il n'est pas permis à une personne de troubler les autres dans la jouissance des choses communes à tous les hommes. 64. Le mot choses a un sens plus étendu que le mot propriétés. 68. - On désigne [II-495] par le mot choses les objets qui ne sont pas des personnes. 68. Voy. Mer, Personnes.
CIVILISATION. Voy. Europe, Travaux publics.
CLÔTURE. Le droit de clore son héritage, qui appartient à tout propriétaire, n'est pas une servitude. I, 470.
COCHES. Voy. Bacs.
CODE CIVIL. Examen critique des dispositions du Code civil sur la nature de la propriété. II, 376. — Les auteurs du Code civil, en exposant les principes relatifs à la propriété, n'ont pas su en déduire les conséquences. 38o. Voy. Accession, Définition, Occupation, Rivières.
COLONISATION. Obstacles que présentent la formation des colonies, et l'appropriation des fonds de terre. Exemple de la Guyane. I, 164. Sacrifices qu'exige l'appropriation et la culture des terres dans la partie de l'Amérique qui forme aujourd'hui l'État de Virginie. 165. Appropriation des terres de la Nouvelle-Hollande par les Anglais. Sacrifices qu'elle exige. 170. Appropriation des terres du cap de Bonne-Espérance. Sacrifices qu'elle exige. 171.
COMMERCE. Le commerce concourt à la formation des propriétés comme toutes les autres branches d'industrie. II, 9.
COMMUNAUX. Voy. Lois.
COMMUNES. Voy. Péche, Disposer, Garanties.
COMPÉTENCE. Quels sont les juges qui doivent connaître des débats auxquels les fleuves et rivières donnent lieu. I, 313. Voy. Administration, Mer.
COMPOSITIONS LITTÉRAIRES. Les compositions littéraires sont, en général, vendues moins cher que la plupart des autres productions. Raisons de cela. II, 111.
CONCURRENCE. Voy. Invention, Ouvriers.
CONDITIONS. Voy. Inventions.
CONFISCATION. Voy. Usurpation.
CONNAISSANCE. Voy. Propriété.
CONSERVATION. Voy. Forêts, Rivières.
CONTREFAÇON. Disposition des lois anglaises sur la contrefaçon des compositions littéraires. II, 153. Disposition des lois françaises sur la contrefaçon des propriétés littéraires,
CORPORATIONS. Il est interdit d'établir des corporations, sous [II-496] quelque prétexte et sous quelque dénomination que ce soit. II, 250. Voy. Industrie.
COURS D'EAU. Ils ne peuvent être rendus dommageables, soit par les propriétaires supérieurs au préjudice des inférieurs, soit par ceux-ci au préjudice de ceux-là. I, 304. Voy. Daviel.
CULTURE. Voy. Population.
D.
DANGERS. Voy. Garantie.
DAVIEL. Erreur qu'il commet sur les dispositions des lois romaines relatives aux cours d'eau. I, 261.~Singulier motif qui le détermine à considérer les rivières non navigables comme appartenant aux propriétaires riverains. 338.
DEBOISEMENT. Effets de la loi du 10 juin 1793, sur le partage des biens communaux. I, 210. Obstacle mis au déboisement des montagnes, par la loi du g floréal an XI (29 avril 1803). 215. Les mesures prises pour arrêter les déboisement des montagnes, et conserver ainsi les rivières, ne sont pas des atteintes à la propriété; elles sont, au contraire, des garanties. 220. Le déboisement et le défrichement des montagnes sont peu profitables aux propriétaires de ces terres.221. Voy. Fleuves, Bois, Montagnes.
DÉBORDEMENT. Voy. Rivières.
DÉCHÉANCE. Voy. Brevet d'invention.
DÉCOUVERTE. Voy. Importation, Inventions.
DEFINITION. La constitution du 5 fructidor an III définit la propriété. II, 255. Des définitions de la propriété par la puissance législative. 367. La constitution du 24 juin 1793 et celle du 5 fructidor an III, définissent la propriété dans les mêmes termes. 368. - Le Code civil définit la propriété autrement qu'elle n'avait été définie jusqu'alors. 370. La proVices des définitions de la propriété. 371. priété ne peut pas être bien définie en quelques lignes. 374. Le Code civil, ayant mal défini la propriété, donne de l'usufruit une fausse définition. 410. Voy. Immeubles, Mines, Minières, Propriété, Servitude.
DEGRADATION. Voy. Fleuves.
DÉFRICHEMENT. La loi du 9 floréal an XI y met obstacles. I, 241. Voy. Déboisement.
[II-497]
DÉMEMBREMENT. Du démembrement d'une propriété, pour le service ou l'utilité d'une autre propriété. II, 428.
DESCARTES. Son opinion sur les causes des sources. I, 257.
DÉPENSES. Voy. Travaux publics.
DÉPOPULATION. Voy. Campagnes.
DESCRIPTION. Toute personne qui veut obtenir un brevet d'invention doit donner une description exacte de sa découverte II, 73.
DESPOTISME. Voy. Garantie.
DESSÉCHEMENT. Voy. Marais.
DEVOIRS. Les devoirs et les droits d'une personne sont inhérens à sa nature; ils ne dépendent pas des volontés des gouvernenemens. I. 15. Les nations ont des devoirs et des droits inhérens à leur nature comme les particuliers. Ces droits et ces devoirs les appellent à être libres. I, 15. Voy. Liberté.
DISCOURS. Voy. Leçons publiques.
DISPOSER. Disposer d'une chose, c'est lui faire subir les modifications qu'on juge convenables, ou la transmettre à une autre personne, pour qu'elle la conserve, en jouisse ou en dispose. II, 233. La faculté de disposer d'une chose est un des élémens essentiels de la propriété. 232. - Quelles sont les limites mises par la nature des choses ou par la nature de l'homme, à la faculté de jouir ou de disposer d'une propriété. 234. Motifs qui s'opposent à ce qu'une nation ou une commune disposent de leurs biens avec la même liberté que les particuliers. 294. Voy.Jouir.
DISTINCTION. Voy. Classification.
DISTRIBUTION. Comment se distribue la valeur d'une propriété mobilière, entre les personnes qui l'ont produite. Exemple de cette distribution. II, 4. '
DIVISIONS. Voy. Limites, Nations, Partage, Territoire.
DOCTRINES. Voy. Esclavage.
DOMAINE PUBLIC. Choses dont il se compose', suivant la loi du 22 novembre 1790. I, 285. - La loi du 22 novembre 1790 ne met pas les rivières non navigables au rang des choses qui composent le domaine public. 286. - Il est défini par le Code civil. Différence entre la définition donnée par ce code, et la définition donnée par la loi du 22 novembre 1790. 303.- Voy. Chemins publics, Iles, Mines, Péche, Rivières, Routes.
[II-498]
DOMINATION. Voy. Mer.
DOMMAGES. Voy. Travaux publics.
DRAMES. Voy. Propriété littéraire.
DROIT. Le pouvoir est souvent pris pour le droit, même daus les questions de propriété. II, 95. Voy. Association, Devoirs, Liberté, Routes, Usufruitier.
DROIT ROMAIN. Toutes les dispositions des lois romaines, sur les rivières, ne sont que des conséquences d'un même principe. I, 166. Voy. Classification, Occupation, Rivage, Rivières.
DUNOYER. Sa définition de l'esclavage et de la liberté. I, 20.
DURÉE. Voy. Brevet d'invention.
E.
EAU. L'eau courante est une propriété commune, en ce sens que toute personne qui peut y arriver, a le droit de s'en servir. 1. 532. Voy. Choses.
EAUX ET FORÊTS. Les dispositions de l'ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts, qui n'ont pas été formellement abrogées, sont maintenues par l'article 609 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV. I. 290. Voy. Louis XIV.
EFFETS. Voy. Garantie, Rentes.
ÉGALITÉ. Voy. Territoire.
ENTRETIEN. Voy. Chemins publics, Rivières, Servitudes.
EPAVES. Voy. Occupation.
ERREUR. Voy. Descartes.
ESCLAVAGE. Influence des doctrines des possesseurs d'esclaves, sur les idées des nations civilisées. I, 1.- Les peuples possesseurs d'esclaves ne pouvaient avoir des idées exactes sur l'origine de la propriété. 7. Nécessité de connaître les divers états par lesquels les nations ont passé, pour bien juger de leur état présent. 8. Effets généraux de l'esclavage sur les maîtres et sur les esclaves. 10. L'esclavage est contraire aux lois de notre nature. 12. Suivant les lois de cette nature, uu homme ne peut en considérer un autre comme sa propriété, ni permettre qu'on le fasse lui-même esclave. 12. L'abdication de la liberté ne peut être obligatoire pour personne. Raisons de cela. 13. Quels sont la [II-499] fin et les moyens de l'esclavage. 20. → Quels sont les élémens qui constituent l'esclavage. 21. — Voy. Liberté.
ÉTATS-UNIS. Voy. Inventions, Propriété littéraire, Rivières.
EUROPE. Quel était l'état de l'Europe à la fin de la république romaine. I, 121.
EXÉCUTION. Voy. Brevet d'Invention.
EXPLOITATION. Voy. Invention.
EXPROPRIATION. La loi du 7 juillet 1833, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, a corrigé quelques-uns des vices de la loi du 16 septembre 1807. I, 445.
F.
FAMILLES. Dans tous les pays où l'on a trouvé des hommes, ils étaient groupés en familles, et les familles en peuplades. I, 77. - Les individus qu'on a trouvés isolés dans les bois étaient des idiots abandonnés par leurs parens. Erreur de Rousseau et de Montesquieu à cet égard. 77.
FÉODALITÉ. Pourquoi, sous le régime féodal, on ne pouvait avoir des idées exactes de la propriété. II, 356.
FÉODALITÉ. Voy. Campagnes, Chemins publics, Propriété foncière, Rivières.
FERTILITÉ NATURELLE. Voy. Propriété foncière.
FLEUVES. Les fleuves et les rivières sont publics par leur nature. I, 181. Quels sont les services que les fleuves et les rivières rendent aux peuples auxquels ils appartiennent. 182.Usage que chacun peut faire des fleuves et rivières. 186. Fleuves et rivières qui traversent le territoire de plusieurs nations. 187. Règles établies par les lois romaines sur l'usage des fleuves et rivières. 189. Effets qui résultent de l'indivision d'un fleuve ou d'une rivière entre plusieurs nations. 191. Influence du déboisement des montagnes sur les fleuves et les rivières 195. — Les habitans des montagnes ne peuvent dégrader les fleuves ou les rivières par la manière dont ils disposent de leurs propriétés. 195. Dégradation des rivières en France, depuis la révolution, par le déboisément des montagnes. 209. Rapports qui existent entre les cours d'eau qui concourent à former un fleuve. 259.
[II-500]
FONDS DE COMMERCE. Un fonds de commerce est une propriété. En quoi cette propriété consiste. II, 24. Voy. Propriétés industrielles.
FONDS DE TERRE. Quel est le principal objet de l'appropriation des fonds de terre, II, 1.
FORCE. Voy. Garantie.
FORÊTS, Les bois et forêts ne doivent pas être appréciés seulement par les revenus qu'ils donnent aux propriétaires. Ils rendent au public des services que les propriétaires ne peuvent pas se faire payer. I, 232.- Réfutation de l'erreur commise par Arthur Young à ce sujet. 232. Nécessité de l'intervention de l'autorité publique pour la conservation des bois et forêts. 234. Les mesures prises par les gouvernemens à diverses époques, pour la conservation des bois et forêts, n'ont pas toujours été fondées sur de bonnes raisons. 236. - Dispositions de l'ordonnance de 1669 sur la conservation des forêts. 236. Mesures prises par l'assemblée constituante pour le même objet. 239. Dispositions de la loi du 9 floréal an XI, sur le même sujet. 241.- Dispositions du Code forestier du 21 mai 1827 sur le même sujet. 243. Insuffisance des mesures prises pour la conservation des bois et forêts. 247. Voy. Louis XIV, Fleuves, Rivières.
FORMATION. Voy Propriété foncière.
FORME. Voy. Matière.
FOSSÉS. Voy. Mitoyenneté.
FRAIS. Voy. Garantie, Liberté.
FRANCE. Voy. Territoire.
G.
GARANTIE. De la garantie des propriétés contre toute sorte d'atteintes, et particulièrement contre les atteintes de l'extérieur. II, 259. Ce qu'on entend par ce mot, quand on l'applique aux propriétés, 260. Toute garantie est une force ou une puissance qui met obstacle à l'emploi d'une autre force, ou qui en détruit les effets. 260. - La garantie des propriétés ne peut se trouver que dans les lumières, les mœurs, l'union, l'organisation et la force de tous les propriétaires. 261. — Quel est le moyen de savoir si toutes les propriétés qui existent chez une nation sont garanties. 262. Les [II-501] propriétés d'une nation ne sont pas garanties, quand une chose qui appartient au public, peut être impunément détournée de sa destination sans l'aveu des propriétaires. 263. Quelles sont les garanties du territoire d'une nation contre les atteintes de l'extérieur. 264. Quels sont les dangers et les difficultés que présente l'établissement de toute garantie. 265. Quelles sont les garanties d'une nation contre les dangers de l'extérieur. 268. Des lois destinées à garantir les propriétés contre les atteintes de l'exterieur. 274. -La garantie des propriétés individuelles contre les atteintes des armées ennemies, est une condition essentielle de l'indépendance d'un peuple. 275. — Un décret du 11 août 1791 déclare que la France indemuisera les citoyens des dommages causés à leurs propriétés par l'invasion des armées ennemies. 276. Un décret de la Convention nationale du 14 août 1793 modifie celui de l'Assemblée législative du 11 août sur les indemnités dues aux personnes dont les propriétés ont été ravagées par l'ennemi. 279. Si les propriétés individuelles n'étaient pas garanties par la nation contre les ravages de la guerre ou le pillage des ennemis, il n'y aurait pas de société proprement dite. 285. Pourquoi, sons les gouvernemens despotiques, les propriétés individuelles ne sont pas garanties par l'Etat, contre les ravages de la guerre. 285. Raisons qui rendent cette garantie nécessaire pour les états libres. 286. De la garantie des propriétés de tous les genres contre les atteintes du gouvernement et de ses agens. 290. Quelles sont les circonstsnces dans lesquelles les propriétés d'une nation manquent de garanties relativement à son gouvernement. 290. Quelles sont les circonstances dans lesquelles les propriétés d'une commune manquent de garantie relativement à ses administrateurs. 291. Les propriétés peuvent recevoir des atteintes de la part de chacune des branches du gouvernement; de la part du pouvoir qui fait les lois ou qui les applique, comme de la part de celui qui les exécute. 298. Comment une nation peut mettre toutes les propriétés hors des atteintes du gouvernement. 300. De la garantie des propriétés de tous les genres contre les atteintes des particuliers. 303. La garantie la plus sûre contre les atteintes qui peuvent être portées aux propriétés particulières est l'organisation [II-502] armée de tous les propriétaires commandés par des hommes de leur choix. 304. De la garantie des propriétés contre les atteintes cachées. 305. La garantie des propriétés ne dispense pas les particuliers de la surveillance de leurs biens. 309. Les communes garantissent les propriétés de chacun de leurs habitans contre les atteintes portées à force ou-' verte par des attroupemens. 310. Quels sont les frais ou les sacrifices au moyen desquels un peuple obtient la garantie des propriétés. 314. De la garantie donnée aux possesseurs de biens acquis par usurpation, et des causes de cette garantie. 316. De l'influence des garanties légales sur l'accroissement, la conservation et la valeur des propriétés. 326. Les propriétés n'ont jamais été complétement garanties, soit chez les peuples anciens, soit chez les modernes. 326. Les propriétés ne sont jamais complétement dépouillées de toute garantie, même sous les gouvernemens despotiques. 327. Les propriétés peuvent être garanties contre un certain genre de dangers, et ne pas l'être contre des dangers d'un autre genre. 328. - La garantie des propriétés est une des conditions de leur production et de leur conservation. 328. Quelles sont les principales circonstances sous lesquelles les propriétés manquent de garanties. 329.-Comment on pourrait déterminer l'influence que la garantie légale exerce sur la valeur des propriétés. 333. — Exemple remarquable d'une quantité considérable de propriétés, privées de garanties légales, à côté d'autres propriétés auxquelles ces garanties étaient accordées. 334.-Le paiement des impôts est une condition essentielle de la garantie des propriétés. Exemple. 335. Voy. Boniface VIII, Ouvriers, Promesses, Propriété, Territoire.
GARNIER. Motif qui le porte à considérer les rivières non navigables, ni flottables, comme non appartenant aux propriétaires riverains. I, 338.
GENRE HUMAIN. Aspect général sous lequel il se présente, et comment il est divisé. I, 80.
GODSON (Richard). Son opinion sur la propriété littéraire.. 108.
GOUVERNEMENT. Voy. Garantie.
[II-503]
GROTIUS. Son opinion sur l'origine et sur l'histoire de la propriété. II, 356.
GUERRES. Voy. Garantie, Indemnités.
GUYANE. Voy. Colonisation.
H.
HABITATION. Un droit d'habitation est un démembrement d'une Comment s'établit et s'éteint le droit propriété. II, 426. d'habitation. 426.
HALAGE. Tous les propriétaires riverains des rivières navigables sont tenus de laisser un chemin de halage, en quelque temps que la navigation ait été établie. I, 301. En Angleterre, les propriétaires riverains d'une rivière navigable ne doivent pas, en général, un chemin de halage à la navigation. I, 317.En Angleterre, un chemin de halage est moins nécessaire à la navigation qu'en France. I, 348.
HENRI HII. Il considère le droit de travailler comme un droit domanial et royal, dont il peut permettre ou interdire l'exercice. II, 132,
HERBES MARINES. Voy. Rivage.
HORDES. Voy. Territoire.
I.
IDÉES RÉTROGRADES. Des idées rétrogrades contre la propriété. II, 470.
ILES. Les îles, îlots et attérissemens qui se forment dans le lit des fleuves et des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'État. I, 306.
IMMEUBLES. Ce qu'on entend par ce mot. II, 455. Voy. Classification, Meubles.
IMPORTATION. L'importation d'une industrie nouvelle donne les mêmes droits que l'invention. Vice de cette disposition. II, 60.
IMPÔTS. Voy. Garantie, Sel.
IMPRIMERIE. Voy. Louis XII.
INDEMNITÉ. Comment sont réglées les indemnités dues aux personnes dont les propriétés ont été dévastées ou pillées par des armées ennemies. II, 280.
[II-504]
INDEMNITÉ. Voy. Péche.
INDÉPENDANCE NATIONALE. Voy. Garantie.
INDUSTRIE. De quelques lois particulières sur la liberté d'industrie. II, 247. — Rapports qui existent entre la liberté d'industrie, et la faculté de jouir et de disposer des propriétés. 248. La liberté d'industrie reconnue par la loi du 2-17 mars 1791. 249. · La loi du 5-10 juin 1791 établit la liberté de l'industrie agricole. 258. Voy. Agriculture, Corporations.
INFLUENCE. Voy. Esclavage.
INVASION. Voy. Garantie, Usurpations.
INVENTION. De la propriété des inventions ou des procédés industriels. II, 28.-Le gouvernement anglais n'a pas reconnu en principe que toute invention est la propriété de l'inventeur. 31. Lorsque les monopoles ont été abolis en Angleterre, on a fait exception de ceux accordés aux inventeurs. 31. - Conditions sous lesquelles les lois anglaises accordent aux inventeurs le monopole de leurs inventions. 32. — L'Assemblée constituante proclame que toute invention est la propriété de l'inventeur, et que toute idée nouvelle appartient à celui qui l'a conçue. 34. Les États-Unis adoptent les lois anglaises sur le monopole des inventions. 36. — Erreurs de l'Assemblée constituante sur la propriété des inventions. II, 38.- En proclamant que tout inventeur est le propriétaire de son invention, l'Assemblée constituante n'a pas adinis les conséquences de ce principe. 40. Examen de la question si toute invention est la propriété de celui qui en est l'auteur. 42. Un grand nombre de sciences ont fait des progrès sans le secours des monopoles. 53. - Des lois relatives à la propriété des inventions industrielles. 58. La mise en pratique d'un procédé décrit dans un ouvrage scientifique, ne peut donner lieu à un brevet d'invention. 59. Ce qui arrive quand une invention est faite en même temps par deux personnes. 61. La découverte d'un principe ne peut être l'objet d'un monopole; mais il en est autrement de la chose nouvelle fabriquée pour le mettre en pratique. 66. Les droits de l'inventeur à l'exploitation exclusive de son invention, résultent de l'acte qui lui en donue le monopole, et non du fait de sa découverte. 70. Quel est, en Angleterre, le nombre de personnes qui peuvent prendre [II-505] part à l'exploitation d'une découverte. 81. Voy. Brevet d'invention, Occupation.
J.
JOUIR. De la faculté de jouir et de disposer d'une propriété. II, 230. — Jouir d'une propriété, c'est obtenir d'une chose l'utilité qui s'y trouve, et la faire servir à la satisfaction de ses besoins et de ses plaisirs. 233. — La faculté de jouir d'une chose est un des élémens essentiels de la propriété. 232. Voy. Disposer.
JOURNAL. Le titre d'un journal est une propriété commerciale, plus qu'une propriété littéraire. II, 208. Voy. Propriété lit téraire.
JURISCONSULTES. Erreur des jurisconsultes qui considèrent les rivières non navigables comme appartenant aux propriétaires riverains. I, 337. Voy. Propriétés.
JUSTINIEN. Il rend une décision absurde sur une question de propriété. II, 397.
L.
LAKANAL. Il fait un rapport à la Convention nationale sur le projet de loi relatif à la propriété littéraire. II, 148. LANGUEDOC. Les états du Languedoc adressent des remontrances à Charles VII, en 1456, sur les abus de l'administration des eaux et forêts. I, 273.
LARGEUR. Voy. Chemins publics.
LEÇONS PUBLIQUES. Les leçons que donne un professeur, les dis cours qu'un orateur prononce, les sermons que fait un prédicateur dans sa chaire, ne peuvent pas être imprimés et vendus sans leur aveu. II, 200.
LETTRES MISSIVES. Si les lettres missives sont la propriété de la personne qui les reçoit ou de celle qui les écrit. Distinctions à faire à cet égard. II, 197.
LIBERTÉ. La liberté est une conséquence nécessaire des devoirs imposés à l'homme par les lois de sa nature. I, 13–14. — La liberté civile et la liberté politique sont des conditions essentielles de l'exercice de tous les devoirs et de tous les droits. 17. De ce qui constitue la liberté. 19. On entend [II-506] par ce mot l'état d'une personne qui ne rencontre, dans ses semblables, aucun obstacle, soit au développement de son être, soit à l'exercice innocent de ses facultés. 19. La liberté ne se définit bien que par des négations. 20. Des conditions qui la constituent. Parallèle entre l'esclavage et la liberté. 21. Différence entre la liberté et des libertés. 27. La liberté est moins dispendieuse que le despotisme. Erreur de Montesquieu sur les dépenses qu'exigent les gouvernemens des peuples libres. II, 314.- Voy. Esclavage, Industrie, Garantie.
LIMITES. Les limites naturelles qui divisent le genre humain en diverses fractions, ne sont pas toutes également prononcées, et ne produisent pas les mêmes effets. I, 104. Les limites que les propriétés se donnent réciproquement ne sont pas des servitudes. Erreur des auteurs du Code civil à cet égard. I, 469. Les obligations réciproques qui résultent, pour deux propriétaires, du voisinage de leurs propriétés, ne sont des servitudes. I,470. - Les limites données à une propas priété, dans l'intérêt des propriétés voisines, ne sont pas toujours réciproques: quand il n'y a pas réciprocité, il y a servitude de l'une au profit de l'autre. I, 477. Voy. Disposer, Montagnes, Propriété foncière, Territoire.
LOI. Du 10 juin 1793, sur le partage des biens communaux. Effets de cette loi sur le déboisement et le défrichement des montagnes. I, 219. Voy. Lois.
LOIRE. Voy. Charles VII.
LOIS. Lois destinées à prévenir le déboisement des montagnes. I, 227. De la tendance des lois relatives à la propriété lit téraire. II, 160. Les lois sur la propriété littéraire sont plus favorables aux productions éphémères qu'à celles qui doivent durer long-temps. 165.
LOIS CIVILES. Les lois civiles garantissent les propriétés; elles ne leur donnent pas l'existence. Erreurs de Montesquieu et de Bentham à cet égard. II, 363.
LOIS. Voy. Association, Déboisement, Garantie, Inventions, Mines, Propriété littéraire, Rivières.
LOIS NATURLLES. Voy. Esclavage.
LUMIÈRE. Voy. Choses.
LOUIS IX. Il ne permet à un gentilhomme qui a eau courante [II-507] dans ses terres, d'y défendre la pêche qu'avec le consentement du baron et du vavasseur. I, 267.
LOUIS XII. Il considère l'imprimerie, découverte de son temps, comme une utile et grande découverte. II, 134.
LOUIS XIV. Ses mesures pour la conservation des forêts. I, 136. — Il n'ose combattre les usurpations commises par les Les disseigneurs sur les rivières non navigables. 276. positions de l'ordonnance de Louis XIV, de 1669, sur les eaux et forêts, ont été empruntées en grande partie au réglement de Charles VI, du mois de février 1415. 327. Il s'attribue implicitement le pouvoir de conférer le droit de travailler. II, 133.
LOYSEAU. Son opinion sur la propriété des chemins publics. I, 381.
M.
MANUSCRIT. La propriété d'un manuscrit n'est garantie à celui qui en est l'auteur, que par les principes généraux du droit sur la propriété. II, 192. Les conditions mises à la garantie de la propriété littéraire, ne sont pas applicables aux manuscrits. 192. La question de la propriété des manuscrits est insoluble, ou ne peut être résolue que d'une manière absurde, pour ceux qui ne voient, dans la propriété littéraire, qu'un monopole. 164.
MARAIS. De la loi sur le desséchement des marais qui appartiennent à des particuliers ou à des communes. I, 455. — Objet de la loi qui prescrit le desséchement des marais. 455. -Tous les intérêts engagés dans les questions de desséchement des marais ne sont pas garantis par la loi du 16 septembre 1807. 458. Quels sont les intérêts engagés dans le desséchement des marais. 456. Mesures qui doivent précéder le desséchement d'un marais. 459.
MARINE MILITAIRE. Opinion d'Arthur Young à ce sujet, I, 253. - Voy. Forêts.
MARQUE. La marque adoptée par un fabricant pour distinguer les produits de son industrie, est sa propriété. Les lois la lui garantissent. II, 24.
MATIÈRE. Embarras des jurisconsultes romains sur la question de savoir laquelle de la matière ou de la forme doit avoir la [II-508] prééminence dans les questions de propriété. Décision absurde de Justinien. 396. II, Voy. Propriété immatérielle.
MÉLANGE. Du mélange de propriétés mobilières appartenant à différens maîtres. II, 395.
MER. Les mers ne sont pas susceptibles d'être acquises par occupation. Quelle en est la raison. I. 41. - Elles sont au nombre des choses communes à tous les hommes. 66. Toutes les nations maritimes considèrent comme faisant partie de leur territoire national, une certaine étendue de mer. 363.Jusqu'à quel point s'étend la domination de chaque peuple sur les mers qui environnent son territoire. Opinion des jurisconsultes à cet égard. 364. — Nécessité de déterminer par des lois jusqu'à quel point s'étend l'empire d'une nation sur les mers qui bordent son territoire. 368. Les Anglais se sont quelquefois attribué l'empire de la mer qui environne leur territoire, jusque sur les côtes opposées. 369. Conséquences qui résultent de l'attribution qu'un peuple se fait d'une partie de la mer qui borde son territoire. 370. - Voy Bynkershoec, Rivage, Selden, Vattel.
MÉTHODE. Motifs pour lesquels l'auteur de cet ouvrage a traité de la propriété avant que de traiter des personnes. II, 472.
MEUBLES. Ce qu'on entend par ce mot. II, 455. — Pour quels motifs des objets mobiliers sont soumis aux mêmes règles que les immeubles. II, 461. Voy. Classification.
MINES. De la propriété des richesses souterraines, et des limites qui en résultent pour les propriétés de la surface. I, 408.Les travaux qui convertissent un terrain inculte en propriété privée, n'exercent aucune influence sur les richesses minérales. 409. En Angleterre, le principe que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, ne reçoit pas d'exception pour les mines. 410. — Le principe de l'occupation ne peut pas, sans danger, s'appliquer aux richesses minérales. 412. Par la nature des choses, les mines font partie du domaine public. 413. Il est difficile pour une nation, de tirer parti des mines que son territoire renferme. 416. Lois rendues sur les mines. 417. — Définition des mines. 420. Vices de la loi du 21 avril 1810, sur les mines. 425. — Difficulté de tracer des limites entre [II-509] la propriété de la surface, et la propriété de la mine qu'elle couvre. 427. Voy. Turgot.
MINIÈRES. Ce qu'on entend par ce mot. I, 420. Quoique les minières appartiennent aux propriétaires de la surface, elles ne peuvent être exploitées sans autorisation. 423.
MITOYENNETÉ. Signes auxquels on reconnait la mitoyenneté, ou la non-mitoyenneté d'un mur, d'un fossé, d'une haie. I, 472. Quels sont les droits et les obligations qui résultent de la mitoyenneté d'un mur, d'une haie, d'un fossé. 473.
MONOPOLE. L'établissement d'un monopole est une atteinte aux propriétés. II, 257.- Voy. Invention, Propriété littéraire, Usurpation.
MONTAGNES. Les grandes montagnes sont les limites les plus naturelles du territoire de chaque nation. I, 91. - Funestes effets produits en divers, pays sur les rivières, par le déboisement des montagnes. 198. Destruction des forêts des montagnes, avant la révolution. Effets de cette destruction. 205. Voy. Déboisement, Fleuves, Rivières.
MONTESQUIEU. Il ne parle de la propriété qu'accidentellement dans son Esprit des lois. Il adopte les opinions de Grotius. II, 358. Voy. Familles.
MOULINS. Voy. Usines.
MOYENS D'EXISTENCE. Tout moyen d'existence qui ne porte aucune atteinte à la personne ou à la sûreté d'autrui, et qui ne blesse en rien la morale, est la propriété de celui qui en est l'auteur. II, 17.- Ce qu'il faut entendre par cette expression. Dans quel sens il est vrai de dire qu'en tout pays la population s'élève au niveau de ses moyens d'existence. 341.
MURS. Voy. Mitoyenneté.
N.
NATIONS. Le genre humain, en se divisant en grandes fractions, se conforme partout aux divisions que la nature a fait subir à ses moyens d'existence. I, 139. Moins la civilisation est avancée, plus le genre humain se divise en petites fractions. 91. Causes naturelles qui divisent le genre humain en grandes fractions. 92. Voy. Disposer, Territoire.
[II-510]
NAVIGATION. La loi du 3o floréal (20 mai 1802) établit uu droit de navigation sur les fleuves et rivières navigables. I, 294. Les droits de navigation perçus sur une rivière navigable doivent être employés à l'entretien ou à l'amélioration de la même rivière. 295. Voy. Bassin, Charles VI, Halage.
NOM. Le nom et la renommée d'une personne sont pour elle une propriété dont elle seule a droit de recueillir les avantages. II, 193.
NOTES. Les notes faites sur un ouvrage que tout le inonde a le droit d'imprimer, sont la propriété de l'auteur. II, 203.
NOUVELLE-HOLLANDE. Voy. Colonisation.
0.
OBLIGATION. Voy. Usufruitier.
OCCUPATION. Ce qu'on entend par ce mot. Elle est un moyen d'acquérir la propriété. I, 29.-Elle n'enrichit personne chez une nation civilisée. I, 29. —Pourquoi toutes les nations l'ont admise comme moyen d'acquérir les choses. 3o. - Elle est le premier fondement de la propriété. 31. — .-L'industrie humaine ne peut s'exercer que sur des choses qui ont été acquises primitivement par occupation. 32. Elle est le premier titre des nations à la propriété du territoire sur lequel elles sont placées. 34. — Les jurisconsultes n'ont pu l'expliquer d'une manière satisfaisante. 35. Elle ne tire pas sa force d'une convention faite entre tous les peuples. 36. -Quels sont les motifs qui l'ont rendue respectable aux yeux de toutes les nations. 37.-Il n'y aurait pas de progrès possible si elle n'était pas respectée. 38.—Elle est une des lois de notre nature. Démonstration de cette vérité. 39. - Elle a été admise en fait, long-temps avant que d'avoir été consacée par aucune disposition législative. 44. Elle est soumise à diverses règles, selon qu'elle est considérée dans les rapports de particulier à particulier, ou dans les rapports de nation à nation. 44. Doctrine des jurisconsultes romains sur l'occupation. 45. Disposition du Code civil sur l'occupation. 46. Elle est admise en principe par les Anglais et par les Anglo-Américains. 46. Les choses égarées ne sont pas susceptibles d'occupation. 47. Différence entre [II-511] l'occupation et la possession. 47.-Le principe de l'occupation des choses matérielles appliqué aux découvertes faites dans les arts. II, 29.- Il n'y a point d'analogie entre un procédé industriel, et un objet matériel dont on peut acquérir la propriété par occupation. 3o. Voy. Blackstone, Mer, Mines, Territoire.
OBSTACLES. Quels sont les obstacles que présente, même aux nations civilisées, l'appropriation des fonds de terre, dans des contrées sauvages. I, 162. Voy. Déboisement.
ORDONNANCE DE 1669. Ses dispositions sur les rivières navigables. I, 277.- Voy. Rivières.
ORIGINE. Voy. Propriété.
OUVRAGES DRAMATIQUES. Le décret du 6 juin 1806, qui détruit la liberté de l'art dramatique, étend les droits garantis aux auteurs. II, 147.
OUVRAGES POSTHUMES. Comment se conserve la propriété des ouvrages posthumes. II, 152.
OUVRIERS. Effets de la concurrence sur les classes qui vivent de salaires. II, 349. Les classes qui vivent des produits de leur travail de chaque jour, ne sont pas moins intéressées que les autres au respect des propriétés. 350.
P.
PARTAGE. Des diverses manières dont une propriété peut être partagée. II, 405. Quand une propriété est partagée de manière que, pendant un certain temps, une personne en a la jouissance, et qu'à l'expiration de ce temps, une autre personne doit en avoir la jouissance et la disposition perpétuelles, la part de la première prend le nom d'usufruit. 407.
PÉAGES. Les seigneurs établissent des péages sur les fleuves comme sur les rivières. I, 270. Les péages sur les rivières sont abolis par les lois des 15 mars 1790 et 25 août 1792. I, 288.
PÊCHE. Le droit exclusif de pêche, dont les seigneurs jouissaient, est aboli par le décret du 25 août 1792. I, 289. — La liberté de pêcher sur les rivières navigables est abolie par la loi du 14 floréal an x (4 mai 1802). 293. - La pêche des rivières non navigables n'appartient pas aux communes, elle appartient aux [II-512] propriétaires riverains. 299. Quelles sont les eaux dans lesquelles la pêche est exercée au profit de l'État. 307. — La pêche des rivières non navigables appartient aux propriétaires riverains jusqu'au milieu du cours de l'eau. 307. Quand une rivière non navigable est rendue navigable, la pêche appartient à l'Etat, qui doit indemniser les propriétaires riverains qui en sont privés. 3o8. Les règles établies pour la pêche s'appliquent à toutes les rivières. 308. Motifs pour lesquels la pêche des rivières non navigables est exclusivement accordée aux propriétaires riverains. 329. Voy. Louis XIV, Rivage.
PERFECTIONNEMENT. Voy. Brevet d'invention.
PERSE. Dispositions empruntées à la Perse sur la garantie des propriétés. II, 315.
PERSONNES. Les personnes sont intimement unies aux choses. Elles s'identifient avec elles. I, 19.
PHILIPPE IV. Il règle la pêche de toutes les rivières, grandes et petites. I, 267.
PHILIPPE VI. Rend une ordonnance sur les eaux et forêts, le 29 mai 1346. I, 268.
PLAGIAT. Ce qui le constitue. II, 201.
PLANTATIONS. Voy. Routes.
POPULATION. Elle est nécessairement stationnaire dans l'état sauvage. Elle ne peut s'accroître que par la culture. I, 153. — Chacune des classes de la population s'accroît en raison des moyens d'existence dont elle dispose. II, 343. — Les classes de la population qui vivent du travail de leurs mains, s'accroissent plus rapidement que celles qui vivent des produits de leurs terres ou de leurs capitaux. Raisons de ce phénomène. 344. Voy. Moyens d'existence.
POSSESSION. Voy. Occupation.
POTHIER. Il traite la propriété comme s'il n'avait étudié que les lois d'un peuple barbare. II, 365.
POUVOIR. Voy. Droit.
PRÉJUGÉS. Voy. Propriété.
PRINCIPE. Voy. Brevet d'invention, Invention.
PRISES D'EAU. Un arrêté du 19 ventôse an VI abolit le droit de former des prises d'eau dans les rivières navigables, établi par la loi du 27 septembre 1791. I, 292. Les propriétaires riverains peuvent former des prises d'eau dans les rivières non [II-513] navigables. Conditions mises à l'exercice de cette faculté. I, 304. Voy. Rivières.
PRIVILEGE. Voy. Péche, Rentes.
PRODUCTIONS LITTÉRAIRES. Différences qui existent entre les productions littéraires et les autres produits de l'industrie humaine. II, 188. Influence de ces différences sur les lois relatives aux compositions littéraires. 190. Voy. Commerce, Distribution, Garantie.
PROMESSES. Des promesses ne sont pas une garantie, quand il n'existe, au-dessus de celui qui en est l'auteur, aucune puissance qui ait la force et la volonté de les faire respecter. II, 271.
PROPRIÉTAIRES. Voy. Rivières.
PROPRIÉTÉ. Elle est produite par l'industrie humaine. I, 56. Elle est estimée en raison des services qu'elle peut rendre. 58. Le travail est le principe de toutes les propriétés. 60. - Elles sont des choses destinées à satisfaire, médiatement ou immédiatement, nos besoins, dans l'ordre naturel de la production ou de la transmission, 85. - Il y a trois moyens principaux d'acquérir des propriétés. Quels sont ces moyens. 117. - Les jurisconsultes imbus des doctrines du droit romain ou du droit féodal, n'ont pas su comment expliquer les propriétés acquises par le travail. II, 131. - Des rapports qui existent entre l'accroissement des propriétés et l'accroissement des diverses classes de la population. 341. Les idées les plus élémentaires sur la propriété sont au nombre des premièrs qui se forment dans l'intelligence humaine. 352. Pour avoir des idées complètes sur la propriété, il serait nécessaire de connaître presque toutes les branches de droit. 470. - Des opinions des jurisconsultes sur l'origine et la nature des propriétés. 352. - Le devoir de respecter les propriétés est imposé à la puissance législative, par la plupart des constitutions américaines. 367. - Toutes les constitutions faites en France depuis 1789, à l'exception de celle du 22 frimaire an VIII, imposent également au pouvoir législatif l'obligation de respecter les propriétés, 368. -Ce qui arrive quand des valeurs, appartenant à différentes personnes, sont réunies dans une chose.-Comment on peut rendre à chacun le sien. 384. Quelles sont les règles qu'il convient de suivre, quand des choses, appartenant à [II-514] différens maîtres, s'unissent pour n'en faire qu'une seule. 404.
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE. Quels sont les pays dans lesquels on peut en observer la formation. I, 219.-Moyen de juger quelles sont les propriétés territoriales auxquelles l'industrie humaine a donné naissance en Europe. 122. Comment on peut juger de la valeur donnée à des fonds de terre par l'industrie humaine. 123. — Quelle est, en divers pays, la valeur des fonds de terre. 126. -Ressources que la terre fournit à l'homme, quand elle est abandonnée à sa fertilité naturelle. 130. Obstacles que présente l'appropriation des fonds de terre, dans l'état sauvage. Comment ces obstacles sont surmontés. 144. L'appropriation d'un fonds de terre par la la culture, n'est pas une usurpation. Preuve de cette proposition. 148. Effets de l'appropriation d'un fond de terre sur toutes les parties de la population. 148. — Effets qu'elle produit sur la valeur des terres non cultivées. 151.- Effets qu'elle produit sur l'accroissement de la population. 153. -Comment se forment les propriétés immobilières chez les nations civilisées. Elles ne sont pas des usurpations. 155. — En Angleterre, le roi est considéré comme le propriétaire originaire de toutes les terres. 315.-Des limites qu'imposent à chaque propriété, les propriétés dont elle est environnée. 467. Les propriétés étant limitées les unes par les autres, nul ne peut faire de la sienne un usage qui nuirait à celle d'autrui. 467.-Conséquences qui résultent de ce principe relativement aux arbres, aux puits et fosses d'aisances placés Les droits que les sur les limites d'une propriété. 468. propriétaires ont sur les propriétés, étant égaux entre eux, sont limités les uns par les autres. 239. — De quelle manière les droits des propriétaires sur leurs propriétés se limitent les uns les autres. 240. Les propriétés qui consistent en fonds de terre, ne nous sont généralement utiles que parce qu'elles sont la source d'où sortent toutes les propriétés mobilières. 13. De quelques lois particulières sur la jouissance et la disposition des propriétés. 247. Voy. Accession, Alluvion, Analyse, Appropriation, Bentham, Blackstone, Chemins publics, Choses, Classification, Code civil, Déboisement, Définition, Démembrement, Disposer, Eau, Esclavage, Féodalité, Fonds de commerce, Garantie, Grotius, [II-515] Habitatation, Idées rétrogrades, Industrie, Inventions, Jouir, Limites, Lois civiles, Marque, Mélange, Mer, Mines, Monopole, Montesquieu, Moyens d'existence, Nom, occupation, ouvriers, Partage, Population, Pothier, Rayneval, Rentes, Rivages, Romains, Servitudes, Systèmes, Toullier, Usage, Usufruit, Usurpation.
PROPRIÉTÉ IMMATÉRIELLE. Il est, chez les nations civilisées, des propriétés qui ne sont fixées dans aucune matière. Quelles sont ces propriétés. II, 17. Les propriétés de ce genre se forment par les mêmes moyens, et exigent les mêmes sacrifices que les autres. 22.
PROPRIÉTÉS INDUSTRIELLES. De quelques espèces de propriétés commerciales ou industrielles. II, 16.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. Des fondemens et de la nature de cette propriété. II, 88.-Questions qu'elle présente à résoudre. 89. -On confond mal à propos la propriété d'un ouvrage littéraire et la propriété des idées qu'il renferme. 89. — Quels sont les élémens divers qui constituent un ouvrage littéraire. 91. L'imprimeur ou le libraire qui réimprime ou qui vend l'ouvrage d'autrui, ne le donne pas comme une conception sortie de son esprit. 92. La puissance qu'a toute personne de faire réimprimer l'ouvrage d'autrui, ne prouve rien contre l'existence de la propriété littéraire. 95. On trouve, dans la propriété littéraire, les élémens essentiels qui se rencontrent dans les autres propriétés. Démonstration de cette proposition. 95. —Elle se forme de la même manière que les autres. Démonstration de cette vérité. 96. – La propriété littéraire, pour être garantie, n'avait pas besoin d'autres principaux que ceux du droit commun. 104. Les statuts relatifs à ce genre de propriété ont été considérés en Angleterre, non comme ayant créé les droits des auteurs, mais comme en ayant limité la durée. 104. Des causes qui ont privé les compositions littéraires, des garanties accordées aux autres propriétés. III. Quels sont les intérêts qui s'opposent à ce que les propriétés littéraires soient garantics. 114. La propriété littéraire n'a jamais été complètement garantie. Elle a été réduite à une jouissance temporaire dans les pays où elle a été le mieux protégée. 120. -Objections contre une garantie complète de la propriété littéraire. 120. Examen des objections faites contre la [II-516] garantie de la propriété littéraire. 124. En Angleterre, les universités qui ont acquis des propriétés littéraires, en ont la jouissance perpétuelle. 129. Des lois relatives à la garantie des compositions littéraires. 131.-Le Parlement anglais, par un statut de 1710, fixe à vingt-cinq ans le terme pendant lequel un auteur aura le privilége de faire vendre son ouvrage. 136. Le Parlement anglais veut que le prix des exemplaires des ouvrages littéraires soit fixé par des commissaires. 137. - Par deux statuts, l'un de 1801, et l'autre de 1814, le parlement anglais étend les droits garantis aux auteurs. 140. -Les Etats-Unis adoptent en partie les lois anglaises sur la propriété littéraire. 141.- Un édit du 26 août 1686 dẻfend d'imprimer et de mettre en vente tout écrit pour lequel on n'aura pas obtenu un privilége. 143. Depuis 1789 jusqu'au 24 juillet 1793, la propriété littéraire, à l'exception des ouvrages dramatiques, ne jouit en France d'aucune garantie. 145. La loi du 13 janvier 1791 garantit pour un temps, aux auteurs d'ouvrages dramatiques, la jouissance de leurs ouvrages. 146. Loi des 19 et 24 juillet 1793 sur la propriété littéraire. 149. Le décret du 5 février 1810 étend les droits garantis aux auteurs. 152. Comparaison entre les lois de France, d'Angleterre et des Etats-Unis sur la propriété littéraire. 161. — La protection accordée aux auteurs de compositions littéraires, est en raison inverse de l'utilité de leurs travaux. 165. — Différences qui existent entre les garanties données à la propriété littéraire et les monopoles. 172. Toute personne a droit de traiter un sujet déjà traité par d'autres écrivains. 205. — La loi doitelle garantir à un écrivain la propriété d'un ouvrage contraire aux bonnes mœurs? 208. Voy. Abrégé, Blackstone, Contrefaçon, Godson, Lakanal, Leçons publiques, Lettres missives, Lois, Manuscrit, Notes, Plagiat, Ouvrages dramatiques, Ouvrages posthumes, Traduction.
PROPRIÉTÉS MOBILIERES. De quelle manière les propriétés mobilières se forment, et comment elles se distribuent entre ceux qui les produisent. II, 1. —Effets salutaires que produit, pour les classes ouvrières, la formation de propriétés mobilières. 11.
PROPRIÉTÉS PUBLIQUES. Parties du territoire national qui ne peuvent être converties en propriétés privées, et qui restent publiques. I, 181
[II-517]
PUISSANCE. Voy. Garantie.
Q.
QUESTIONS. Les questions sur la propriété ne peuvent être bien résolues que par une exacte observation de la nature des choses. Exemples. II, 382.
R.
RADES. Les rades qui font partie du territoire français, sont ouvertes à toutes les nations alliées de la France. I, 360.
RAPPORTS. Voy. Fleuves.
RAVAGES. Voy. Garanties.
RAYNEVAL. Il croit que la propriété n'est pas inhérente à la nature humaine. Il suit l'opinion des écrivains qui l'ont précédé. II, 365.
REGLES. Voy. Association, Péche.
REGNAULT (de St.-Jean d'Angely). Erreur dans laquelle il tombe au sujet des chemins publics. I, 384.
REMONTRANCES. Voy. Languedoc.
RENTES. De la propriété des rentes sur des particuliers ou sur l'Etat. II, 219. - Celui qui transmet à un autre une propriété mobilière ou immobilière pour une rente perpétuelle, se réserve, par cela même, un des principaux avantages de la propriété. 220. La création d'une rente par un particulier ou par un Etat, n'a pas pour effet de donner naissance à un nouveau produit; elle opère un simple transfert de revenu. 221. Un gouvernement qui crée des rentes, transfère aux rentiers dont il consomme les capitaux, une part des revenus des propriétaires des terres, des capitalistes et de tous les hommes industrieux. Il peut aliéner ainsi, même au profit des étrangers, les propriétés sur lesquelles l'existence de la population est fondée. 224. — Avantages garantis par les lois aux possesseurs de rentes sur l'Etat. 228.
REPUTATION. Voy Nom.
RÉTROGRADATION. Voy. Idées rétrogrades.
RIVAGE. De la propriété et de l'usage des rivages de la mer. I, 353. Les Romains avaient adopté, relativement aux rivages de la mer, des principes analogues à ceux qu'ils avaient admis pour les bords des rivières. 353. Parallèle entre [II-518] les lois relatives aux rivages de la mer, et les lois relatives aux bords des rivières. 353. Les rivages des mers que bordaient l'empire romain, étaient considérés comme faisant partie du territoire national; mais tous les peuples avaient le droit d'en faire usage pour les services de la navigation et de la pêche. 354. La définition des rivages de la mer donnée par les jurisconsultes romains, ne s'appliquait qu'aux rivages de la Méditerranée. Raisons de cela. 356. Les rivages de la mer chez les nations modernes font partie du territoire des nations sous l'empire desquelles ils sont placés. 357.- La définition des rivages, donnée par l'ordonnance de la marine de 1681, a été faite pour les rivages de l'Océan. 357. En France, quoique les rivages de la mer fassent partie du domaine public, la pêche n'en est pas affermée au profit de l'Etat comme celle des fleuves; elle est libre à tous les nationaux. 358. L'herbe qui croît sur le rivage de la mer, appartient aux habitans des communes sur le territoire desquelles elle croft. 359. Les propriétés situées sur le rivage de la mer doivent-elles un passage au public, comine celles qui sont situées sur le bord d'un fleuve navigable? 361. Chaque nation considère une certaine étendue de la mer qui borne son territoire comme eu faisant partie. 363. Voy. Mer, Rades.
RIVE. Définition de la rive par les lois romaines. I, 265. - Les rives des rivières appartenaient aux propriétaires riverains suivant les lois romaines; mais le public avait le droit d'en user, pour l'usage des rivières. 266.
RIVIERES. Le déboisement et le défrichement des montagues produisent, en France, le débordement des rivières. I, 216. Des anciennes lois sur la jouissance et la conservation des fleuves et des rivières. 257.- Services qu'elles rendent aux nations qui les possèdent. 259. — Disposition des lois romaines sur les fleuves et les rivières. 260. Toutes les rivières étaient publiques suivant le droit romain. 261. Droits garantis aux particuliers sur les rivières, par le droit romain. 262. Dispositions des anciennes ordonnances sur le même sujet. 267. Usurpation des fleuves et rivières par la noblesse et le clergé. 276. Dispositions de l'ordonnance de 1669 sur les fleuves et les rivières. Vices de ces dispositions. 276. Au commencement du 15e siècle, les [II-519] fleuves et rivières sont usurpés par les seigneurs. Conséquences de ces usurpations. 269. Au 17e siècle, l'usurpation des rivières non navigables, par les seigneurs et les gens d'église, était consommée. 276. Comparaison des dispositions des lois romaines sur les rivières, avec les dispositions de l'ordonnance de 1669. 279. Des lois rendues depuis la révolution sur les fleuves et les rivières. 283. — La loi du 27 septembre 1791 autorise les prises d'eau dans les rivières navigables. 287.-Comment il doit être pourvu à l'entretien des rivières navigables. 294. Comment il doit être pourvu à l'entretien des rivières non navigables. 296. — Aucune loi ne déclare que les rivières non navigables appartiennent aux propriétaires riverains. 302. - Disposition du Code civil sur les cours d'eau. Elles sont, presque sur tous les points, conformes aux dispositions des lois antérieures. 3o3. — Droits que peuvent exercer les propriétaires riverains sur les rivières non navigables qui traversent leurs propriétés. 309.-Charges imposées aux propriétaires dont les héritages sont bordés ou traversés par une rivière non navigable. 310. Droits accordés aux propriétaires riverains sur les fleuves et rivières navigables ou flottables qui bordent leurs héritages. 311.-Lois anglaises sur les rivières. 314. — Influence du régime féodal sur les dispositions des lois anglaises relativement aux rivières. 315. En Angleterre, une rivière n'est considérée comme navigable que jusqu'au point auquel la marée s'élève. 316.En Angleterre, les rivières non navigables, dans le sens légal du mot, sont considérées comme appartenant aux propriétaires riverains. Charges de cette propriété. 318. Loi anglo-américaine sur les rivières. 319. Les Etats-Unis ont généralement adopté les principes suivis en Angleterre reiativement aux fleuves et aux rivières. 320. Modifications que la nature des choses a fait subir aux lois relatives à la propriété et à la jouissance des cours d'eau. 323. Les propriétaires riverains, même sous le régime féodal, n'ont pas eu la propriété réelle des fleuves et rivières qui bordaient ou traversaient leurs propriétés. 326. Dans les pays même où les rivières ont été usurpées sous l'influence du régime féodal, elles ont fini par devenir publiques. 326. En France, la force des choses a maintenu les rivières, même non navigables, dans le domaine public. 326. Les droits accordés [II-520] aux propriétaires riverains sur les rivières non navigables, ne sont pas une preuve que ces rivières leur appartiennent. Preuve de cette proposition. 327. Dispositions particuliè res qui mettent les rivières, même non navigables, au rang des choses qui font partie du domaine public. 333. — Les motifs qui justifient les dispositions des lois anglaises sur les rivières, n'étaient pas applicables au continent américain. 348. -Vices des lois françaises sur les fleuves et les rivières. 350. Voy. Alluvion, Bacs, Charles VI, Charles VII, Compétence, Daviel, Droit romain, Eaux et Forêts, Fleuves, Garnier, Halage, Jurisconsultes, Louis IX, Louis XIV, Navigation, Péage, Péche, Philippe 1V, Philippe V1, Prise d'eau, Rivage, Services, Territoire.
ROMAINS. Pourquoi les Romains ne pouvaient se faire des idées exactes de la propriété. II, 354.
ROUTES. Elles sont divisées en routes impériales et en routes départementales. Celles-ci sont subdivisées en trois classes. But fiscal de cette division. I, 386.-Les routes appartiennent essentiellement au domaine public. Quelle est la raison de cela. 388.- L'usage des routes est commun à toutes les personnes qui habitent le territoire. 395. — Questions auxquelles l'usage des routes donne naissance. 394.- Droits des partiticuliers relativement aux chemins publics. 394.-Obligation imposée aux propriétaires riverains, de planter les bords des grandes routes. 402.- Voy. Chemins publics.
S.
SAUVAGES. Voy. Territoire.
SCIENCE DE LA LÉGISLATION. Voy. Méthode.
SEL. Les droits de passe, établis pour l'entretien des chemins publics, sont supprimés et remplacés par un impôt sur le sel, destiné au même usage. I, 385.
SELDEN. Son opinion sur la domination maritime de la nation anglaise. I, 369.
SERMON. Voy. Leçons publiques.
SERVITUDES. Quelles sont les servitudes légales établies sur les propriétés voisines des forêts soumises au régime forestier. I, 478.- Une servitude est le démembrement d'une propriété immobilière pour le service ou l'utilité d'une autre propriété [II-521] du même genre. II, 428. Quelles sont les espèces de servitudes reconnues par le Code civil. 429.- La défense de disposer d'une propriété de manière de nuire à la propriété voisine, n'est pas une servitude. Erreur du Code civil à cet égard. 232. Quelles sont les véritables servitudes légales. 434. Des différentes espèces de servitudes. 435. - Comment elles peuvent s'acquérir. 446. — Comment elle s'éteignent. 438.- Comment peuvent être résolues les questions auxquelles elles donnent naissance. 440,- Voy. Cloture, Limites, Rivages, Rives.
SOL. Voy. Mines.
SPECIFICATION. Voy. Brevet d'invention, Description.
SOURCES. Voy. Descartes.
SUISSE. Voy. Territoire.
SURVEILLANCE. Voy. Garantie.
SYSTÈMES. Les nouveaux systèmes contre la propriété, ne sont que la reproduction de vieilles idées. Pour quels motifs l'auteur de ce traité ne les a pas réfutées. II, 474.
Ꭲ .
TENDANCE. Voy. Lois.
TERRE. De l'utilité primitive des fonds de terre. I, 117. Quelles sont les ressources que la terre fournit à l'homme quand elle n'est pas cultivée. 130. Quelle est l'étendue de terre qu'exige l'existence d'un homme dans l'état sauvage. 136. Après la découverte de l'Amérique, la terre parut aussi commune que l'eau de la mer; chacun pouvait en obtenir gratuitement. 163. Quelle fut la valeur primitive des fonds de terre de la Guadeloupe et de quelques autres îles. 172. Valeur primitive des terres au Brésil et dans le Canada. 173. Appréciation des usurpations de terres commises par les Européens dans la fondation de leurs colonies. 175. La plupart des objets que la terre produit ou recèle, ne peuvent nous servir qu'après avoir subi divers transformations. 2.-Voy. Colonisation, Propriété foncière.
TERRITOIRE. Quel est le territoire propre à chaque nation. 68. — Le territoire qui appartient à chaque nation, à des limites indépendantes des volontés humaines. 70. Toutes les contrées habitables sont habitées depuis un temps immémorial. Il est impossible de savoir comment la plupart des nations ont acquis le territoire qu'elles occupent. I, 74. - [II-522] Les hordes les plus barbares ont un territoire qui leur est propre, et qu'elles font respecter. 78, Les violations de territoire produisent des guerres sanglantes chez les sapvages. 78. Plus une nation se developpe, plus son territoire devient pour elle une propriété incontestable et incontestée. 8o. Les partisans les plus outrés de l'égalité, 'ne reclament pas l'égalisation ou l'échange des territoires entre les nations. 82.-Les hommes qui mettent en question la propriété privée, ne contestent pas aux nations le territoire qu'elles possèdent. 84.- Les nations conquises qui conservent leur territoire, finissent par absorber les conquérans. 85. Quelles sont les forces qui garantissent à chaque nation le territoire qu'elle possède. 87. -Quelles sont les limites naturelles du territoire propre à chaque nation. 89. Chaque peuple trouve les limites de son territoire au point qui le sépare d'un autre penple, en rendant les communications impraticables ou très difficiles. 90. Dans quels cas les cours d'eau servent de limites, ou de moyens de communication. 91.-Les mers sont les limites naturelles des nations.—94. — La Suisse offre un exemple de la manière dont un pays est naturellement divisé par les montagnes. 96. — Division naturelle du territoire français.. 101. Quel est le point ou se trouve la ligne naturelle qui sépare deux nations. 107. Il existe, en Europe, un grand nombre de divisions territoriales contraires à la nature des choses. 108. - Circonstances qui affaiblissent les mauvais effets des divisions territoriales contraires à la nature des choses. 111.- Comment le territoire national se convertit en propriétés privées. 139. Voy. Bassins, Limites, Occupation.
TOMLINS (T. E.) Il refute l'opinion de Richard Godson sur la propriété littéraire. II, 109.
TOULLIER. Lorsqu'il traite de la propriété, il ne va pas plus. loin que Grotius et Volf. 366.
TRADUCTION. Traduire ou ouvrage dans une autre langue, n'est pas violer les droits de l'auteur de l'ouvrage original. 204.
TRAITÉ DE LÉGISLATION. Pour quels motifs il n'embrasse qu'une partie de la science. I, préface 11. Il a besoin d'être complèté par des traités particuliers. . Motifs qui ont déterminé l'auteur à exposer dans ce traité, les divers Etats par lesquels les nations ont passé. vII.
[II-523]
TRAITÉ DE LA PROPRIÉTÉ. Circonstance qui ont déterminé l'au teur à la compositoin et à la publication de cet ouvrage. I, préface vi- Objet de ce traité. I, xii.
TRAVAIL. Voy. Henri III, Louis XIV.
TRAVAUX PUBLICS. De la valeur donnée à des propriétés particulières, communales et départementales, par des travaux exécutés aux frais de l'Etat. I, 431 Si les personnes dont les propriétés augmentent de valeur par l'effet des travaux exécutés aux frais. de l'Etat, doivent compte de cet accroissement. 431. L'utilité de tous les travaux publics ne peut pas se mesurer par les revenus immédiats qu'ils produisent. 433. Quelle est la part de dépenses que doivent supporter, dans l'exécution de travaux publics, les personnes auxquelles ces travaux doivent particulièrement profiter. I, 435. Une nation est intéressée à la civilisation et aux progrès de chacune des fractions dont elle se compose. 442. - De la dépréciation causée à des propriétés particulières par des travaux exécutés dans un intérêt public. 447. – Les personnes dont les propriétés particulières sont dégradées par suite de travaux publics, ont droit à une indemnité. 448. Il est des cas où les torts causés par des travaux publics à des particuliers, ne donnent lieu à aucune réparation 452.
TURGOT. Son opinion sur la propriété des mines. I, 410.
U.
USAGE. Un droit d'usage est un démembrement d'une propriété comme un usufruit. II, 425. — Comment s'établit et s'éteint le droit d'usage. II, 426. — Voy. Fleuves, Routes.
USINES. Les propriétés d'usines sont garans des dommages qu'elles peuvent causer I, 288.
USUFRUIT. Un usufruit est une part plus ou moins considérable de la propriété. II, 408. — Un usufruit est, pour la personne à laquelle il appartient, une véritable propriété. 409. — Toute sorte de biens sont susceptibles d'être divisés de manière qu'une personne en ait l'usufruit et une autre la nuepropriété. 409. L'usufruit peut être établi par tous les moyens, à l'aide desquels on peut aliéner une propriété. 413. Comment il finit 423. - Voy. Définition, Partage.
[II-524]
USUFRUITIER. Les droits et les obligations d'un usufruitier sont déterminés par l'acte qui établit l'usufruit, et par la loi, pour tous les cas que cet acte n'a pas prévus. II, 414. — En quoi consistent les droits de l'usufruitier suivant les dispositions de la loi. 415. Quelles sont les obligations que la loi impose. 419.
USURPATIONS..Les biens acquis par usurpation; divisés en quatre classes. II, 317.-Des usurpations de propriétés commises à la suite d'invasions armées. 317. Des usurpations de propriétés commises au moyen de confiscations. 318. - Des usurpations de propriété, commises à l'aide de mo-nopoles, 319. Des usurpations commises au moyen de l'imperfection ou des vices de lois. 319. Quels sont les effets des usurpations de propriétés, exécutées à la suite d'invasions. 320. Comment les propriétés acquises par usurpation finissent par se confondre avec les propriétés acquises d'une manière légitime. 320. - Voy. Garantie, Propriété foncière, Rivières.
UTILITÉ. Différence qui existe entre la valeur et l'utilité.—Signification de ces deux mots. I, 117.- Voy. Propriété foncière, Terres, Travaux publics, Forêts.
V.
VALEUR. Voy. Compositions littéraires, Garantie, Propriété, foncière, Terres, Utilité.
VARECH. Voy. Rivage.
VATTEL. Son opinion au sujet de la domination qui appartient à chaque peuple sur les mers qui environnent son territoire. I, 367.
VIOLATION. Voy. Brevet d'invention, Territoire.
Y.
YOUNG (Arthur.) Témoin du ravage des forêts des Pyrennées. - Il déplore l'aveugle destruction de ces forêts I, 206. Son opinion sur la conservation des bois. -Erreur dans laquelle il tombe à cet égard. I, 229.· Son opinion sur les dangers et sur l'inutilité d'une marine militaire puissante. 253. — Voy. Forêts.