
CHARLES DUNOYER,
Nouveau traité d’économie sociale (1830)
2 Volumes in 1
 |
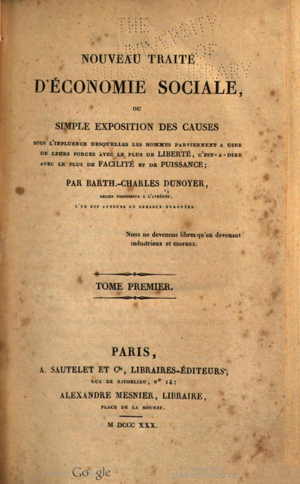 |
| Charles Dunoyer (1786-1862) |
[Created: 27 October, 2023]
[Updated: 13 December, 2023 ] |
The Guillaumin Collection
 |
This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |
Source
, Nouveau traité d’économie sociale, ou simple exposition des causes sous l’influence desquelles les hommes parviennent à user de leurs forces avec le plus de LIBERTÉ, c’est-à-dire avec le plus FACILITÉ et de PUISSANCE (Paris: Sautelet et Mesnier, 1830). 2 volumes in 1.http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Dunoyer/1830-NouveauTraite/Dunoyer-NT-2volsin1.html
Charles Dunoyer, Nouveau traité d’économie sociale, ou simple exposition des causes sous l’influence desquelles les hommes parviennent à user de leurs forces avec le plus de LIBERTÉ, c’est-à-dire avec le plus FACILITÉ et de PUISSANCE (Paris: Sautelet et Mesnier, 1830). 2 volumes in 1.
This title is also available in a facsimile PDF of the original [vol.1 and vol.2] and various eBook formats - HTML, PDF, and ePub.
This book is part of a collection of works by Charles Dunoyer (1786-1862).
Tables des matières
Tables des chapitres contenus dans le tome premier.
- PRÉFACE p. i [missing]
- INTRODUCTION.p. 1
- CHAPITRE PREMIER. Ce que l'auteur entend par le mot liberté. 25
- CHAPITRE II. Influence de la race sur la liberté. p. 52
- CHAPITRE III. Influence des circonstances extérieures sur la liberté. p. 97
- CHAPITRE IV. Influence de la culture sur la liberté. p. 137
- CHAPITRE V. Liberté compatible avec la manière de vivre des peuples sauvages. p. 168
- CHAPITRE VI. Liberté compatible avec la manière de vivre des peuples nomades. p. 201
- CHAPITRE VII. Liberté compatible avec la manière de vivre des peuples sédentaires qui se font entretenir par des esclaves.p. 231
- CHAPITRE VIII. Liberté compatible avec la manière de vivre des peuples chez qui l'esclavage domestique a été remplacé par le servage. p. 281
- CHAPITRE IX. Liberté compatible avec la manière-de vivre des peuples chez qui le servage a été remplacé par le privilège. p. 335
- CHAPITRE X. Liberté compatible avec la vie des peuples chez qui nulle classe n'a plus de privilèges, mais où une portion considérable de la société est emportée vers la recherche des places. p. 365
- CHAPITRE XI. Liberté compatible avec la manière de vivre des peuples purement industrieux.p. 406
- CHAPITRE XII. Obstacles qui s'opposent encore à la liberté dans le régime industriel, ou bornes inévitables qu'elle parait rencontrer dans la nature des choses. p. 456
- TABLE analytique des chapitres contenus dans le tome prremier p. 493 [missing]
- Notes
Tables des chapitres contenus dans le tome deuxième
- CHAPITRE XIII. Des divers ordres de travaux et de fonctions qu'embrasse la société industrielle.p. 1
- CHAPITRE XIV. Des conditions auxquelles toute industrie peut être libre. p. 43
- CHAPITRE XV. Application de ces moyens de liberté aux diverses industries, et d'abord aux industries qui agissent sur les choses. — De la liberté de l'industrie qui se borne à exécuter de simples déplacemens des choses, ou de l'industrie improprement appelée commerciale. p. 125
- CHAPITRE XVI. De la liberté de l'industrie manufacturière. p. 219
- CHAPITRE XVII. De la liberté de l'industrie agricole. p. 312
- CHAPITRE XVIII. Application des mêmes moyens de liberté aux arts qui agissent sur les hommes , et d'abord aux arts qui agissent sur le corps de l'homme. — De la liberté des arts qui ont pour objet la conservation et le perfectionnement de l'homme physique. p. 403
- CHAPITRE XIX. De la liberté des arts qui travaillent à l'éducation de nos facultés intellectuelles. p. 478
- TABLE ANALYTIQUE DES CHAPITRES CONTENUS DANS LE TOME II. p. 549
- Notes
Volume I
[I-1]
INTRODUCTION.
Objet et plan de cet ouvrage. — Méthode que l'auteur a suivie.↩
§ 1. Nous ne pouvons sortir de l'état de faiblesse et de dépendance où la nature nous a mis que par nos conquêtes sur les choses et par nos victoires sur nous-mêmes: nous ne devenons libres qu'en devenant industrieux et moraux. Telle est la vérité fondamentale qui sera développée dans ce livre. Je ne veux faire ni un traité de morale, ni un traité sur l'industrie je veux, comme mon épigraphe l'annonce, montrer l'influence de ces deux choses sur l'exercice de nos facultés; mon dessein est de faire voir comment elles donnent naissance à la liberté humaine [1] .
[I-2]
§ 2. Que l'on considère la société dans toutes ses manières d'agir, dans tous les ordres de fonctions et de travaux que sa conservation et son développement réclament, et l'on verra que, depuis le plus simple jusqu'au plus élevé, depuis le labourage jusqu'à la politique, il n'en est pas un qui, pour s'exercer avec facilité, avec puissance, avec liberté, ne demande aux hommes deux choses: du savoir-faire et du savoir vivre, de la morale et de l'industrie.
§ 3. Je ne sais point si je m'abuse; mais il me semble que dans nos efforts pour étendre et faciliter l'exercice de nos forces, que dans notre tendance vers la liberté nous commettons de fâcheuses méprises.
La première, et à mon sens la plus capitale, c'est de ne pas assez voir les difficultés où elles sont, c'est de ne les apercevoir que dans les gouvernemens. Comme, en effet, c'est ordinairement là que les plus grands obstacles se montrent, on suppose que c'est là qu'ils existent, et c'est là seulement qu'on s'efforce de les attaquer. On ne veut pas arriver jusqu'aux nations qui sont par derrière. On ne veut pas voir que les nations sont la matière dont les gouvernemens sont faits; que c'est de leur sein qu'ils sortent ; que c'est dans leur sein qu'ils se recrutent, qu'ils se renouvellent; que par conséquent, lorsqu'ils sont mauvais, il faut bien [I-3] qu'elles ne soient pas excellentes. On ne veut pas voir que tout le mal qu'ils font alors a ses véritables causes ou dans la corruption du public qui le provoque, ou dans son ignorance qui l'approuve, ou dans sa pusillanimité qui le tolère, quand sa raison et sa conscience le condamnent. On ne veut voir que le gouvernement : c'est contre le gouvernement que se dirigent toutes les plaintes, toutes les censures; c'est sur le gouvernement que portent tous les projets de réformation; il ne s'agit que de réformer le gouvernement; il n'est pas question que la société s'amende; on ne paraît pas admettre qu'elle en ait besoin; on nous dit bien assez que nous sommes victimes des excès du pouvoir on ne s'avise point de nous dire que nous en sommes coupables, et ceci, qui n'est pas moins vrai, serait pourtant un peu plus essentiel à nous apprendre [2] .
[I-4]
Ce n'est pas tout. Tandis qu'on ne veut pas voir les obstacles où ils sont, on ne veut apercevoir qu'une partie de ces obstacles, on ne veut considérer que ceux qui naissent des vices du gouvernement, où, comme il serait plus exact et plus juste de s'exprimer, ceux qui résultent de l'imperfection de nos idées et de nos habitudes politiques. Cependant il est sûrement très-possible que nous ne soyons pas imparfaits seulement dans cette partie de nos moyens d'agir. Il est possible que nous ignorions la plupart des arts et des sciences; il est possible que nous ayons beaucoup de vices personnels; il est possible que nous tombions, les uns envers les autres, dans un grand nombre d'injustices et de violences particulières. Or, très-certainement, cette ignorance et ces désordres privés, s'ils n'affectent pas la liberté au même degré que le manque d'instruction et de moralité politiques, ne laissent pas de lui être encore excessivement pernicieux. On a donc tort de ne pas les [I-5] comprendre au nombre des causes qui nous empêchent d'être libres.
Une troisième erreur fort accréditée, et qui peut-être n'est pas moins grave, c'est, en même temps que nous ne voulons pas prendre garde à tous nos défauts, ni même en général tenir compte de nos défauts, de croire que certains de nos progrès nous sont nuisibles, de prétendre, par exemple, que l'industrie, l'aisance, les lumières sont des obstacles à la liberté. Il n'est sûrement personne parmi nous qui n'ait fréquemment entendu dire que nous sommes trop civilisés, trop riches, trop heureux pour être libres. C'est une expression universellement reçue, et dont les beaux esprits, et quelquefois même les bons esprits se servent comme le vulgaire [3] . Un de nos publicistes les plus justement renommés, M. B. de Constant, dans son ouvrage sur les religions, croit que l'Europe marche à grands pas vers un état pareil à celui de la Chine, qu'il représente à la fois comme très-civilisée et très-asservie. M. de Châteaubriand, dans un opuscule en faveur de la septennalité, enseigne expressément que plus les hommes sont éclairés et moins ils sont capables d'être libres. De sorte que, suivant ces écrivains, l'espèce [I-6] humaine semblerait être réduite à la triste alternative de rester barbare ou de devenir esclave, et qu'il lui faudrait nécessairement opter entre la civilisation et la liberté.
Enfin, tandis qu'on veut que la liberté soit diminuée par de certains progrès, il semblerait, à voir l'insouciance que l'on montre pour des perfectionnemens d'un ordre plus élevé, qu'on regarde ces perfectionnemens comme inutiles. Nous travaillons de toutes nos forces à l'accroissement de cette industrie, de cette aisance, qui sont mortelles, disons-nous, pour la liberté, et, en même temps, nous ne mettons aucun zèle à développer nos facultés morales qui lui pourraient être si favorables. Nous faisons aux arts de merveilleuses applications de la mécanique, de la chimie et des autres sciences naturelles, et nous ne songeons point à y appliquer la science des mœurs, qui pourrait tant ajouter à leur puissance [4] . Nous ne voulons pas voir combien sont encore imparfaits les peuples qui ne sont qu'habiles, et combien se montrent plus habiles [I-7] ceux qui sont aussi moraux. Nous ne sentons pas assez d'ailleurs qu'il n'est pas seulement question d'habileté, mais aussi de dignité, d'honneur, de puissance, de liberté; et que si la liberté naît de l'industrie, elle naît surtout de bonnes habitudes, soit privées, soit publiques.
§ 4. Je m'écarterai, sur ces points fondamentaux, des idées qui paraissent le plus généralement reçues.
D'abord je ne parlerai point des gouvernemens, ou du moins ce que j'en pourrai dire ne se distinguera pas de ce que j'ai à dire des populations. Je ne porterai mes regards que sur les masses; leur industrie et leur morale seront le sujet de toutes mes observations, la matière de toutes mes expériences. C'est en effet là que sont tous les moyens de la liberté, et aussi tout ce qu'elle peut rencontrer d'obstacles, même ceux qui naissent du gouvernement, ordre de travaux ou de fonctions qui, comme tous les autres, n'est jamais, à dire vrai, que ce que l'état des peuples veut qu'il soit. Je trouverai les obstacles dans le défaut d'industrie, de savoir, de capitaux, de bonnes habitudes particulières et politiques. Les moyens sortiront du progrès de tout cela [5] .
[I-8]
Je considérerai ce progrès dans les masses, parce que c'est là qu'il doit se faire pour être de quelque effet, et aussi parce que c'est réellement là qu'en est le mobile et que s'en opère le développement. Les nations vivent d'une vie qui leur est propre. Elles ont, en toutes choses, l'initiative des améliorations. Ce sont les agriculteurs qui perfectionnent l'agriculture; les arts sont avancés par les artistes, les sciences par les savans, la politique et la morale par les moralistes et les politiques. Il y a seulement, entre les choses qui sont l'affaire particulière de chacun et celles qui sont l'affaire de tout le monde, cette différence que, dans les premières, [I-9] les perfectionnemens sont immédiatement applicables pour celui qui les invente, tandis que dans les secondes, à savoir dans les politiques, les applications ne peuvent avoir lieu que lorsque la pensée du publiciste est devenue la pensée commune du public, ou du moins d'une portion très-considérable du public. Jusque-là, on ne peut faire, pour les réaliser, que des tentatives impuissantes. Il est possible qu'un pouvoir de bonne volonté entreprenne de les établir; mais il ne fera point œuvre qui dure. Il est possible que la chose soit essayée, malgré le pouvoir, par un parti qui le renverse et le remplace; mais les insurrections les plus heureuses n'auront pas plus d'effet que les concessions les plus bienveillantes. La chose ne s'établira que fort à la longue, à mesure qu'elle passera dans les idées et les habitudes du grand nombre. Par où l'on voit que ce dernier ordre de perfectionnemens, qu'on voudrait réserver exclusivement à certains pouvoirs ou à certains hommes, est, plus qu'aucun autre, l'affaire de la société ; puisque aucune amélioration de ce genre n'est praticable que lorsque la société y donne son consentement, et ne devient effective que lorsqu'elle l'a réellement adoptée.
Encore une fois, je n'envisagerai donc que la société; je ne chercherai les moyens de la liberté que dans les progrès de la société.
Ensuite je me garderai bien de ne considérer [I-10] qu'une partie de ces progrès : je tiendrai compte de tous. Je me garderai bien de dire que certains sont nuisibles à la liberté, ou d'avoir l'air de croire que d'autres lui sont inutiles : je dirai qu'ils lui sont tous favorables et nécessaires, les progrès industriels comme les progrès moraux, les moraux comme les industriels. Telle est l'idée que je me fais des uns et des autres, qu'il me serait fort difficile de dire lesquels la servent le mieux, et quels hommes travaillent davantage à se rendre libres, de ceux qui acquièrent de l'industrie, de ceux qui contractent de bonnes habitudes personnelles, ou de ceux qui se forment à de bonnes habitudes civiles. Cet homme est un pilote expérimenté : il ne sera pas embarrassé pour conduire une barque et franchir une rivière; cet autre a vaincu son penchant à l'intempérance : l'ivresse ne le fera plus trébucher malgré lui; ceux-là renoncent mutuellement à toute prétention injuste: ils vont cesser par cela même de s'entraver dans l'usage inoffensif de leurs facultés. On voit ainsi que nos progrès de toute nature contribuent également à nous rendre libres : les uns nous tirent de la dépendance des choses, les autres de la dépendance de nous-mêmes, les autres de la dépendance de nos semblables.
Après cela on verra que ces divers développemens, bien loin de se contrarier, comme on veut [I-11] le dire, se soutiennent, s'aident réciproquement, et contribuent à l'extension les uns des autres, de même qu'ils contribuent tous à l'accroissement de la liberté. Nous ne faisons pas une espèce de progrès qui n'en provoque plusieurs autres sortes. Nous ne pouvons pas développer une partie de nos moyens sans travailler par cela même au dévelop pement de tous. L'amélioration des mœurs ajoute aux pouvoirs de l'industrie; les progrès de l'industrie amènent ceux de la morale. Il n'est pas vrai qu'en acquérant plus de bien-être nous devenions moins sensibles à la considération. Je ne veux pas admettre que les habitans de Paris aient moins d'honneur aujourd'hui qu'ils n'en avaient au temps de la Ligue ou à des époques plus reculées et partant plus barbares. Je ne saurais imaginer qu'en pavant et éclairant leurs rues, en purifiant et ornant leurs demeures, en se procurant de meilleurs habits et de meilleurs alimens, en se tirant par le travail de l'ordure et de la misère, ils aient dû perdre de leur dignité. Il est vrai qu'en nous élevant sous un grand nombre de rapports nous semblons avoir décliné sous quelques autres. On peut observer avec raison, par exemple, que beaucoup de villes ont aujourd'hui moins de pouvoirs municipaux qu'elles n'en possédaient aux XIII et XIV siècles; mais il ne serait ni raisonnable, ni historiquement vrai de dire que c'est la faute de l'industrie. [I-12] C'était au contraire à l'industrie que ces villes étaient redevables de ces pouvoirs, qu'elles ne purent défendre plus tard contre les envahissemens de la puissance royale. C'était l'industrie, au moyen âge, qui avait affranchi les communes de la tyrannie des seigneurs; ce sera elle, tôt ou tard, qui les délivrera du despotisme plus concentré des cours et de la domination des capitales. L'industrie prépare les peuples à l'activité collective comme à tous les genres d'activité nécessaires au développement et à la conservation de l'espèce. Il ne faut qu'ouvrir les yeux pour voir que, de notre temps, les populations les plus industrieuses et les plus cultivées sont aussi celles qui ont le plus de vie et de capacité politiques. Les Espagnols du littoral, plus laborieux et plus aisés que ceux du centre, ont beaucoup mieux défendu les institutions protectrices qu'une partie de la nation avait voulu établir. Nous voyons en Grèce les hommes riches et éclairés donner, tout les premiers, l'exemple des dévouemens héroïques. Enfin ne sont-ce pas en France les villes commerçantes et manufacturières qui usent de leurs droits politiques avec le plus d'intelligence, de mesure et de fermeté?
Il n'est donc pas vrai que le développement de nos facultés morales soit incompatible avec celui de nos facultés industrielles. Mais ce qui est vrai, et ce que j'aurai soin de reconnaître, c'est que [I-13] certaines dispositions de notre ame peuvent mettre de grands empêchemens aux progrès des unes et des autres. Voilà ce que font notamment la passion du faste et cette sensualité excessive auxquelles, d'âge en âge, on accuse les peuples de se laisser entraîner. Il ne faut pas croire ce qu'on dit de ces vices, qu'ils sont un fruit de la civilisation, qu'ils sont particuliers aux nations que l'industrie a rendues très-opulentes. On verra bien au contraire que ces nations, toute proportion gardée, s'y laissent infiniment moins emporter que les peuples barbares, et que la civilisation, qui nous éloigne de tant d'excès, tend aussi à nous détourner de celui-là. Mais enfin il pourrait être vrai de dire que nous y donnons beaucoup trop encore; et qu'au point où ils dominent, ils continuent à opposer de grands obstacles aux progrès de l'industrie, et surtout à celui des mœurs. Certainement, si nous consacrions à l'avancement de nos travaux ce que nous donnons de trop à la satisfaction de nos plaisirs, la richesse, et les arts qui en sont les créateurs, prendraient des accroissemens bien plus rapides. Certainement encore si nous étions aussi sensibles à l'honneur qu'à la volupté; si nous prenions de notre dignité morale autant de soin que de notre bien-être physique, les mœurs ne resteraient pas autant en arrière de l'industrie. C'est, il n'en faut pas douter, à notre amour trop exclusif pour les jouissances [I-14] sensuelles, c'est à l'universelle préférence qu'elles obtiennent sur des plaisirs plus nobles et plus relevés qu'il faut attribuer cette disproportion choquante qu'on remarque entre la perfection des arts et celle des habitudes, entre la capacité industrielle et la capacité politique, entre la grandeur des fortunes et le peu d'importance des personnes. Je m'attacherai donc à faire sentir combien il nous importe de ne pas nous laisser absorber par le soin de notre bien-être physique, combien nous avons besoin de cultiver nos facultés morales, et à quel point le progrès de ces dernières, si nécessaire à celui des autres, est particulièrement indispensable à la liberté.
§ 5. Je commencerai par dire ce que j'entends par ce mot.
Je chercherai ensuite successivement :
Si toutes les variétés de l'espèce humaine sont également aptes à devenir libres;
Si elles peuvent également devenir libres sous toutes les latitudes et dans toutes les situations;
Si la liberté peut être la même à tous les degrés de culture;
Quel degré de liberté est compatible avec la manière de vivre des peuples sauvages;
Avec celle des peuples nomades;
[I-15]
Avec celle des peuples sédentaires qui se font entretenir par des esclaves;
Avec celle des peuples chez qui la servitude domestique a été remplacée par le servage;
Avec celle des peuples chez qui le servage a été remplacé par le privilège;
Avec celle des peuples chez qui tout privilège est aboli; mais où une portion considérable de la société est emportée vers la recherche des places;
Enfin, avec celle des peuples où l'activité universelle est dirigée vers l'industrie; où l'on ne voit plus ni maîtres, ni esclaves, ni privilégiés, ni solliciteurs; où il n'y a que du travail et des échanges, et où le gouvernement lui-même n'est qu'un travail fait par une petite portion de la société au nom et pour le compte de la société tout entière [6] .
Parvenu à la vie industrielle, qui est le terme [I-16] le plus élevé où il semble possible d'atteindre, au moins du point où est maintenant arrivée la société, je m'arrêterai quelques instans pour faire remarquer les obstacles qu'y trouve encore la liberté, et les bornes inévitables qu'elle paraît rencontrer dans la nature des choses.
Après quoi je considérerai cet état social dans les divers ordres de travaux et de fonctions qu'il embrasse, en commençant par les industries qui agissent sur les choses, telles que :
L'agriculture;
La fabrication;
Le commerce;
Et en continuant par les arts qui s'exercent sur les hommes, tels que :
Ceux qui s'occupent du perfectionnement de notre nature physique;
Ceux qui se chargent de l'éducation de notre intelligence;
Ceux qui ont plus spécialement pour objet la culture de notre imagination;
Ceux enfin qui travaillent au perfectionnement de nos habitudes morales.
Je montrerai la place que chacune de ces professions occupe dans la société, la nature des fonctions qu'elle y exerce, l'importance du rôle qu'elle y joue, et l'ensemble des moyens auxquels se lie sa puissance.
[I-17]
Je parlerai, en dernier lieu, de certaines fonctions ou de certains actes qui ne sont pas proprement des industries, mais qui sont communs à toutes les classes d'industrieux, qui entrent de nécessité dans l'économie sociale, qui sont indispensables au mouvement, à la vie, au développement de la société; tels que :
Les associations;
Les échanges;
Les transmissions gratuites de biens entre vifs ou à cause de mort;
Et de même que j'aurai d'abord cherché comment nous devenons libres dans la pratique de tous les arts qu'embrasse la société industrielle, de même je chercherai comment nous devenons libres dans ces derniers modes d'activité, et quelle influence leur liberté exerce sur celle de tout le reste.
§ 6. Il me semble qu'en me réduisant ainsi à de simples recherches sur des ordres de faits assurément très-susceptibles d'observation; en me bornant à demander ce qui résulte, pour la liberté, de telle manière de vivre, de telles connaissances, de tels talens, de tels artifices, de la possession de tels instrumens, de la pratique de telles vertus, je n'ai pas à craindre de me laisser égarer par l'esprit de système. Qu'ai-je voulu prouver? Rien. Je cherchais une chose je désirais savoir comment se [I-18] produisait cette manière d'être à laquelle je donne le nom de liberté. Il m'a paru qu'elle naissait des progrès de l'industrie et de la morale, de tout ce qui étend nos facultés, et de tout ce qui en rectifie l'usage. J'ai voulu exposer comment cela se faisait. J'ai pu sûrement me tromper dans mes explications; mais sûrement aussi ce n'a pas été la faute de ma méthode. J'ai pu me tromper comme je l'aurais pu en faisant un calcul, sans que pour cela on dût faire le procès à l'arithmétique. Mes erreurs d'ailleurs sont faciles à rectifier: en donnant le résultat de mes observations, j'en ai exposé la matière; de sorte que si je me suis trompé, il est bien aisé de le voir chacun peut refaire mes expériences.
On remarquera sans doute combien cette méthode diffère de celle de ces philosophes dogmatiques qui ne parlent que de droits et de devoirs; de ce que les gouvernemens ont le devoir de faire, de ce que les nations ont le droit d'exiger: chacun doit être maître de sa chose; chacun doit pouvoir dire sa pensée; tout le monde devrait participer à la vie publique voilà leur langage accoutumé. Je ne m'explique point de la sorte; je ne dis pas sentencieusement: les hommes ont le droit d'être libres; je me borne à demander : comment arrivet-il qu'ils le soient? à quelles conditions peuvent-ils l'être ? par quelle réunion de connaissances et [I-19] de bonnes habitudes morales parviennent-ils à exercer librement telle industrie privée? comment s'élèvent-ils à l'activité politique? Il n'y a là, comme on le voit, rien d'impérieux, rien qui oblige. Je ne dis pas il faut que telle chose soit ; je montre comment elle est possible. Chacun peut voir sans doute si elle vaut que nous acquérions les qualités nécessaires pour en jouir; mais je n'impose rien, je ne propose même rien : j'expose.
Non-seulement cette méthode ne tend point à surprendre ou à violenter les esprits; mais elle est la seule propre à les éclairer. C'est celle qu'on suit dans toutes les sciences d'observation; c'est par elle que, depuis un quart de siècle, ces sciences ont fait de si remarquables progrès. On ne parle point en physique, en mathématiques de ce qui doit être; on cherche simplement ce qui est, ou comment il arrive qu'une chose soit. Le géomètre remarque dans quelles circonstances deux lignes forment un angle; mais il ne dit pas que deux lignes ont le droit de former un angle. Le chimiste observe que l'eau soumise à l'action du feu passe à l'état de vapeur; mais il ne dit pas qu'un des droits de l'eau est de se transformer en gaz. Le publiciste peut observer de même dans quelles circonstances l'homme parvient à la liberté; mais il ne doit pas dire, s'il veut parler scientifiquement, que l'homme a droit d'être libre. Que nous apprendrait en effet [I-20] ce langage, et que prétend-on en disant ici que l'homme a droit? veut-on dire qu'il est dans l'ordre, qu'il est droit, qu'il est désirable qu'il devienne libre ? mais exprimer des vœux n'est pas expliquer des vérités. Veut-on dire que la liberté est une propriété de sa nature? mais cela n'est vrai qu'à de certaines conditions. Deux lignes droites ont la propriété de former un angle; mais ce n'est que lorsqu'elles se rencontrent en un point. L'eau a la propriété d'être compressible; mais elle ne l'est à un haut degré que lorsqu'elle est réduite à l'état de gaz. La liberté est une propriété de la nature humaine, mais seulement quand cette nature est cultivée. Vous avez beau dire à priori que l'homme est une force libre, tant qu'il conserve son ignorance et ses vices, il reste en effet très-dépendant. Au lieu donc de nous dire dogmatiquement que la liberté est sa loi, enseignez-nous comment elle devient sa manière d'être. Ce n'est véritablement qu'ainsi que vous pouvez nous éclairer [7] .
[I-21]
Enfin, tandis que cette méthode est plus propre à instruire, elle est aussi plus propre à faire bien agir. Quand on dit aux hommes: Vous avez droit d'être libres, la justice ordonne que vous le soyez; on parle vivement à leur imagination, on leur inspire le désir de la liberté, mais sans leur rien communiquer de ce qui la donne; et il est possible qu'on les pousse, pour la conquérir, à des résolutions violentes, qui leur causeront de grands maux, sans laisser peut-être après elles aucun bon résultat. Mais si on leur dit : « plus vous serez habiles, ingénieux, éclairés, et mieux vous disposerez de vos forces; plus vous aurez de modération, d'équité, de courage, et plus vous aurez de liberté ; » on n'a sûrement rien de pareil à craindre. Il se pourra que ce langage touche peu; mais s'il excite à agir, ce sera d'une façon utile. Ce qu'il recommande en effet c'est de s'instruire, de se fortifier, de se rendre meilleur ; il n'excite à la liberté qu'en exhortant à acquérir les qualités qui la [I-22] procurent il ne saurait jamais être dangereux d'inspirer aux hommes l'amour d'un art utile ou d'une vertu quelconque, et l'on est sûr, en les en les poussant dans les voies de l'industrie et de la morale, de les mettre sur le vrai chemin de la liberté [8] .
J'aurai donc soin de rester fidèle à l'objet de cet écrit, qui est de montrer la liberté dans ses causes. Au lieu de la considérer comme un dogme, je la présenterai comme un résultat; au lieu d'en faire l'attribut de l'homme, j'en ferai l'attribut de sa civilisation; au lieu de me borner, comme on l'a presque toujours fait, à imaginer des formes de gouvernement propres à l'établir, ce qu'aucune forme de gouvernement n'est, à elle seule, capable de faire, j'exposerai de mon mieux comment elle naît de tous nos progrès [9] .
[I-23]
§ 7. Que n'ai-je tout ce qu'un tel travail demanderait de talent et de connaissances positives pour être convenablement exécuté! Je me croirais assuré de rendre un service réel à la politique. Je croirais aussi pouvoir contribuer efficacement à répandre parmi nous des semences d'ordre et de paix. Il est vrai que ce livre n'a pour objet que d'expliquer un seul mot; mais que ce mot renferme de choses, et combien pourrait faire cesser de discordes une bonne définition de la liberté ! Qui de nous n'a vu quelquefois tout ce que peut, au milieu des débats les plus animés, une explication lumineuse et vraie de la chose débattue?
Mais ce sujet-ci est-il matière à expériences, comme d'autres ? est-il de nature, par exemple, à être aussi clairement, aussi catégoriquement expliqué que ceux sur lesquels s'exercent les véritables sciences d'observation? Je n'en fais aucun doute. Il n'y a [I-24] pas plus d'effets sans cause en politique qu'en chimie. L'enchaînement des causes aux effets n'est pas plus impossible à apercevoir dans la première de ces sciences que dans la seconde. J'ai peine à croire, par exemple, que le phénomène moral auquel je donne le nom de liberté se refuse à l'analyse plus que la chaleur, la lumière, l'électricité et plusieurs autres phénomènes sensibles. Il me paraît très-possible de bien expliquer comment la liberté naît, s'étend, se resserre, se modifie. Je ne me flatte pourtant pas de porter dans cet exposé le degré de certitude et de précision qu'on trouve dans les bons livres de chimie et de physique; mais cela viendra moins encore, je dois l'avouer, de la difficulté de la matière que de l'insuffisance de l'auteur. Tout en étant convaincu de l'imperfection de mon travail, je crois fermement à la possibilité de le bien faire, et peut-être ce que je tente d'autres réussiront-ils à l'exécuter. Quand je ne ferais dans cet ouvrage qu'ouvrir aux études politiques une nouvelle voie, que leur imprimer une direction un peu plus sûre, que montrer un peu plus clairement le but où il s'agit d'arriver et les moyens que nous avons de l'atteindre, je serais loin d'avoir perdu mon temps. Mais cela même est une tâche immense, et je n'oserais dire que j'ai pris la plume avec l'espérance de la remplir.
[I-25]
CHAPITRE PREMIER.
Ce que l'auteur entend par le mot liberté.↩
§ 1. L'homme, aux premiers regards que nous portons sur lui, se présente à nous comme un être sujet à des besoins, et pourvu de facultés pour les satisfaire. Nous savons tous qu'il a besoin de se nourrir, de se désaltérer, de se vêtir, de s'abriter, etc. Nous savons aussi qu'il a pour cela une intelligence, une volonté, des organes.
On a beaucoup cherché si le mobile de ses facultés était en lui-même ou hors de lui, en sa puissance ou hors de sa puissance; s'il donnait son attention, comparait, jugeait, désirait, délibérait, se déterminait, parce qu'il le voulait et comme il le voulait; ou bien si ses facultés étaient mises en jeu sans lui, malgré lui, par l'influence de causes sur lesquelles il n'avait aucun empire, et si le résultat de leur travail était aussi indépendant de sa volonté. Certains philosophes ont prétendu qu'il était également maître de leur action et des résultats de leur action; et ce suprême ascendant qu'ils lui attribuaient sur elles, ils l'ont appelé libre arbitre, liberté morale. D'autres, au contraire, ont nié qu'il eût sur elles un tel pouvoir, et ils ont soutenu que, [I-26] la première impulsion leur étant donnée du dehors, tous leurs mouvemens, toutes leurs fonctions, tous leurs actes étaient des conséquences nécessaires de cet ébranlement extérieur. Je n'ai point à m'occuper ici de ce débat. Il y a une autre recherche à faire.
Que l'homme ait ou n'ait pas en lui-même le premier mobile de son activité, on conviendra du moins qu'il n'agit pas toujours avec la même aisance; on m'accordera sans doute qu'il peut y avoir en lui, je veux dire dans ses infirmités, son inexpérience, ses vices, ses dispositions à la violence et à l'injustice, des causes très-propres à l'empêcher de se servir de ses facultés; on m'accordera sûrement aussi qu'il parvient, plus ou moins, à s'affranchir de ces causes naturelles de faiblesse et de servitude, et qu'à mesure qu'il y réussit, il entre en possession d'une certaine puissance, d'une certaine facilité d'action qu'il ne sentait pas en lui auparavant. Enfin, on reconnaîtra, j'espère, que lorsqu'il vient à désapprendre ce qu'il avait appris, à recontracter les vices et les infirmités dont il était parvenu à se défaire, il perd peu à peu le pouvoir qu'il avait acquis, il repasse par tous les degrés d'impuissance au-dessus desquels il s'était successivement élevé, et finit par retomber dans son premier état d'imperfection et de dépendance.
Ce que j'appelle liberté, dans ce livre, c'est ce [I-27] pouvoir que l'homme acquiert d'user de ses forces plus facilement à mesure qu'il s'affranchit des obstacles qui en gênaient originairement l'exercice. Je dis qu'il est d'autant plus libre qu'il est plus délivré des causes qui l'empêchaient de s'en servir, qu'il a plus éloigné de lui ces causes, qu'il a plus agrandi et désobstrué la sphère de son action.
Et il ne faut pas dire, comme on l'a fait, que lorsque je me sers ainsi du mot liberté, je l'écarte de son acception ordinaire; car je l'emploie au contraire dans son sens le plus usuel et le plus familier. Consultez, en effet, les livres des écrivains qui ont le plus cherché à mettre de la clarté et de la précision dans leur langage; ouvrez Locke, Condillac, de Tracy; interrogez l'Académie et son dictionnaire, et vous verrez que ce qu'on entend le plus communément par liberté c'est puissance, c'est le pouvoir que nous acquérons d'user de nos facultés à mesure que nous écartons les obstacles qui s'opposent à leur exercice, de quelque nature d'ailleurs que soient ces obstacles, que le principe en soit en nous ou hors de nous, dans nos propres infirmités ou dans l'injustice des autres hommes. C'est ainsi qu'on dit qu'un homme a l'esprit libre, qu'il jouit d'une grande liberté d'esprit, non-seulement quand son intelligence n'est troublée par aucune violence intérieure, mais encore quand elle n'est ni obscurcie par l'ivresse, ni altérée par la [I-28] maladie, ni retenue dans l'impuissance par le défaut d'exercice. C'est encore ainsi qu'on dit qu'un homme a la langue et les mains libres, non-seulement quand on ne lui a mis ni des fers aux mains, ni un bâillon à la bouche, mais encore lorsque ces organes ne sont, chez lui, ni frappés de paralysie, ni livrés à une agitation convulsive, etc. La moindre réflexion suffit pour nous assurer que, dans le langage habituel, on appelle liberté le pouvoir que nous avons acquis d'user de nos forces, de quelque nature que fût l'obstacle qui s'opposait à leur exercice et dont nous sommes parvenus à les affranchir.
Au reste, sans m'inquiéter davantage de l'emploi que chacun peut faire de ce mot, je me borne à redire ici comment je l'entends, et quel sens il faut consentir à y attacher si l'on a le désir de m'entendre. J'avertis donc le lecteur, encore une fois,, que le mot liberté correspond, dans ma pensée, à l'idée de puissance, et que le phénomène que je veux désigner par là, c'est ce pouvoir toujours croissant d'agir qui se manifeste en nous à mesure que nous parvenons à débarrasser nos facultés de quelques-uns des obstacles qui nous empêchaient d'en faire usage.
§ 2. Naturellement l'homme, dans l'usage de ses facultés, peut être empêché par plusieurs causes très-générales.
[I-29]
Il est d'abord circonscrit par les lois de son organisation, lesquelles ne lui permettent pas de sortir d'une certaine sphère d'activité. Tandis qu'en un sens il peut se développer et s'étendre presque à l'infini, sous un autre aspect, il touche immédiatement aux limites du possible. Tout ce qui implique contradiction avec sa nature, il est dans l'impossibilité la plus absolue de l'exécuter. Il n'est aucunement en son pouvoir, par exemple, de se dérober aux lois générales de la pesanteur, de respirer dans un lieu privé d'air, de voir en l'absence de toute lumière. Il ne faut donc pas demander en quoi consiste à cet égard sa liberté ; car, un obstacle insurmontable s'opposant ici à son action, il est visible qu'en ceci toute liberté lui est refusée [10] .
Ensuite, dans la sphère même qui a été ouverte [I-30] à son activité, l'homme peut naturellement être empêché d'agir, d'un côté par l'ignorance, qui retient toutes ses facultés dans l'inertie, et d'un autre côté par la passoin, qui leur donne une activité désordonnée, qui l'excite à s'en servir d'une manière préjudiciable pour lui-même ou pour les autres, et qui tend ainsi perpétuellement à en affaiblir, à en entraver l'usage.
L'homme, par les lois invincibles de sa nature, ne peut donc user de ses forces sans empêchement ou avec liberté que dans l'espace où il lui a été donné d'agir; et, dans cet espace même, pour qu'il puisse en disposer librement, il faut,
Premièrement, qu'il les ait développées ;
Secondement, qu'il appris à s'en servir de manière à ne pas se nuire;
Troisièmement, qu'il ait contracté l'habitude d'en renfermer l'usage dans les bornes de ce qui ne peut pas nuire aux autres hommes.
§ 3. Je dis premièrement qu'il doit les avoir développées. Et en effet, qui ne voit qu'il n'a pas la liberté de s'en servir tant qu'il n'a pas appris à en faire usage. Mettez le clavier d'un piano sous les doigts d'un homme qui, de sa vie, n'aura manié que la bêche ou la charrue : sera-t-il libre d'exécuter une sonate? Nos organes, avant que nous les ayons formés, sont pour nous comme s'ils n'existaient[I-31] point; nous ne sommes nullement les maîtres de nous en servir. Il est bien en général en notre pouvoir d'apprendre ce que nous ignorons; mais nous ne sommes les maîtres de le faire qu'après l'avoir appris: l'ignorance a pour nous tous les effets d'un insurmontable empêchement, et le plus violent despotisme ne nous mettrait pas dans une impuissance plus absolue d'agir que ne le fait manque d'exercice et d'expérience.
En second lieu, je dis que, pour être libres d'user de nos facultés, il faut que nous sachions en renfermer l'usage dans les bornes de ce qui ne nous peut pas nuire. Il est clair, en effet, que nous ne pouvons nous en servir de manière à nous faire du mal sans diminuer, par cela même, le pouvoir que nous avons d'en faire usage. Nous sommes bien les maîtres, jusqu'à un certain point, d'exécuter des actions qui nous sont préjudiciables; mais nous ne le sommes pas, en exécutant de telles actions, de ne rien perdre de notre liberté. Il est d'universelle expérience que ce qui déprave, énerve, abrutit nos facultés, nous ôte la liberté de nous en servir; et de toutes les prétentions la plus absurde et la plus contradictoire serait sans doute de vouloir à la fois en abuser et les conserver saines, vivre dans la débauche et ne pas nuire à sa santé, prodiguer ses forces et n'en rien perdre, etc.
Je dis enfin, et cette troisième proposition n'est [I-32] pas moins évidente que les deux premières, que, pour disposer librement de nos forces, il faut que nous nous en servions de manière à ne pas nuire à nos semblables. Nous avons bien, dans une certaine mesure, le pouvoir de nous livrer au crime; mais nous n'avons pas celui de nous y livrer sans diminuer proportionnellement notre liberté d'agir. Tout homme qui emploie ses facultés à faire le mal, en compromet par cela même l'usage: c'est en quelque manière se tuer que d'attenter à la vie d'autrui; c'est compromettre sa fortune que d'entreprendre sur celle des autres. Il n'est sûrement pas impossible que quelques hommes échappent aux conséquences ou du moins à quelques-unes des conséquences d'une vie malfaisante; mais les exceptions, s'il y en a de réelles, n'infirment point le principe. L'inévitable effet de l'injustice et de la violence est d'exposer l'homme injuste et violent à des haines, à des vengeances, à des représailles, de lui ôter la sécurité et le repos, de l'obliger à se tenir continuellement sur ses gardes, toutes choses qui diminuent évidemment sa liberté. « Si vous voulez, disait Sully à Henri IV, soumettre par la force des armes la majorité de vos sujets, il vous faudra passer par une milliasse de difficultés, fatigues, peines, ennuis, périls et travaux; avoir toujours le cul sur la selle, le haubert sur le dos, le casque en tête, le pistolet au poing et l'épée à la [I-33] main [11] . » Il n'est au pouvoir d'aucun homme de rester libre en se mettant en guerre avec son espèce. C'était, a-t-on dit, un propos banal de Bonaparte qu'il n'est rien qu'on ne puisse avec une forte armée. « Eh bien! j'irai à Madrid, j'irai à Vienne avec une armée de cinq cent mille hommes on peut ce qu'on veut. » Avec une armée de cinq cent mille hommes on peut aller mourir, captif et délaissé, sur un rocher désert, au milieu de l'Atlantique. Le despote le plus puissant ne saurait être assez puissant pour rester toujours le maître. Et ce que je dis d'un individu on peut le dire des plus vastes réunions d'hommes. On a vu bien des partis, on a vu bien des peuples chercher la liberté dans la domination, on n'en a pas vu que la domination, à travers beaucoup d'agitations, de périls et de malheurs provisoires, n'ait conduit tôt ou tard à une ruine définitive.
Hobbes dit qu'en l'état de nature il est loisible à chacun de faire ce que bon lui semble [12] . Il n'est pas douteux qu'en quelque état que ce soit, un homme n'ait le pouvoir physique de commettre un certain nombre de violences. Mais est-il quelque état, selon Hobbes, où l'on puisse être injuste et [I-34] méchant avec impunité? N'est-il pas également vrai dans tous les temps et dans toutes les situations, que l'injure provoque la haine, que le meurtre expose la vie du meurtrier? Que signifie donc de dire qu'en l'état de nature il est permis à chacun de faire ce que bon lui semble? Il est, en tout état, impérieusement commandé, à qui ne veut pas souffrir d'insultes, de n'en pas commettre. Je sais bien que, dans les premiers âges de la société, chacun exerce plus de violences; mais chacun aussi en endure beaucoup plus. La résistance se proportionne naturellement à l'attaque, et la réaction à l'action. C'est par là que l'espèce se maintient : il n'y a que ce qui résiste qui dure.
Aussi ajouterai-je que si, pour être libre, il est nécessaire de s'abstenir du mal, il est tout aussi indispensable de ne pas le supporter; car c'est par l'énergie qu'on met à ne pas le supporter qu'on intéresse les autres à ne pas le faire. Tant qu'on veut bien se plier à une injustice, on peut compter qu'elle se commettra. Rien de plus corrupteur que la faiblesse en consentant à tout souffrir, on intéresse les autres à tout oser. Alceste fait un partage égal de sa haine entre les hommes malfaisans et les hommes complaisans. Je ne sais s'ils y ont un même droit. Le mal vient peut-être moins de la malice des hommes injustes, que de la faiblesse [I-35] des hommes pusillanimes. Ce sont ceux-ci qui gâtent les autres. C'est le grand nombre qui déprave le petit en se soumettant trop facilement à ses caprices. Nous avons tous besoin de frein, et d'autant plus que nous disposons de plus de forces. S'il faut que les individus soient contenus par le pouvoir, le pouvoir a encore plus besoin d'être contenu par la société. C'est à la société à lui fournir des motifs de bonne conduite; c'est à elle d'attacher tant de dégoûts et tant de périls à l'abus de la puissance, que les despotes les plus hardis, que les factions les plus effrénées sentent le besoin de se contenir. Veut-on savoir combien nous avons besoin d'être retenus pour ne pas donner dans l'injustice, et à quel point une légitime résistance est nécessaire à la liberté, il n'y a qu'à voir comment les forts traitent partout les faibles; il n'y a qu'à voir comment notre race, qui se dit chrétienne et civilisée, traite celles qui ne sont pas capables de résister à ses violences: les Européens font encore le commerce des nègres, et ont, suivant M. de Humboldt, plus de cinq millions d'esclaves dans les colonies! [13]
Au reste, à voir les choses d'une manière un peu étendue, on peut dire que l'humanité ne s'est pas manquée à elle-même, et que, s'il y a eu dans [I-36] le monde une effrayante masse d'agressions injustes, il y a eu encore plus de justes et d'honorables résistances. Cela est prouvé par cela seul que le genre humain n'a pas péri, que le bon droit, que les actions conservatrices de l'espèce, ont de plus en plus prévalu. Il faut donc que le mauvais droit ait été réprimé, que les méchans aient été punis; et, pour revenir à ma proposition précédente, il reste constant que l'homme injuste perd le libre usage de ses forces dans la pratique de la violence et de l'iniquité.
Ainsi l'homme, par la nature même des choses, ne peut avoir de liberté (dans l'espace où il lui a été permis d'exercer ses forces), qu'en raison de son industrie, de son instruction, des bonnes habitudes qu'il a prises à l'égard de lui-même et envers ses semblables. Il ne peut être libre de faire que ce qu'il sait ; et il ne peut faire avec sûreté que ce qui ne blesse ni lui, ni les autres. Sa liberté dépend tout à la fois du développement de ses facultés, et de leur développement dans une direction convenable.
§ 4. Si, pour être libres, nous avons besoin de développer nos facultés, il s'ensuit que plus nous les avons développées, plus est étendu, varié, l'usage que nous en pouvons faire, et plus aussi nous avons de liberté. Ainsi nous sommes d'autant plus [I-37] libres que nous avons plus de force, d'activité, d'industrie, de savoir; que nous sommes plus en état de satisfaire tous nos besoins; que nous sommes moins dans la dépendance des choses : chaque progrès étend notre puissance d'agir, chaque faculté de plus est une liberté nouvelle. Tout cela est évident de soi. Rousseau a beau mettre la liberté de l'homme sauvage au-dessus de celle de l'homme civil, son éloquence ne fera point que celui dont les facultés sont à peine ébauchées en puisse disposer aussi librement que celui qui les a développées, fortifiées, perfectionnées par la culture.
Si, pour être libres, nous avons besoin de nous abstenir, dans l'exercice de nos facultés, de tout ce qui nous pourrait nuire, il s'ensuit que mieux nous en savons régler l'emploi relativement à nous, plus nous avons appris à en faire un usage éclairé, prudent, modéré, et plus aussi nous sommes libres. Mettez un homme qui ait de bonnes habitudes morales à côté d'un homme incapable de régler aucun de ses sentimens, de satisfaire avec mesure aucun de ses appétits, et vous verrez lequel, en toute circonstance, conservera le mieux la libre disposition de ses forces.
Si, pour être libres enfin, nous devons nous défendre, dans l'emploi de nos facultés, de tout acte préjudiciable à autrui, il s'ensuit que mieux nous [I-38] savons en tirer parti sans nuire, plus nous avons appris à leur donner une direction utile pour nous-mêmes sans être offensive pour les autres, et plus aussi nous avons acquis de liberté. Cette proposition a toute la certitude des précédentes. Comparez l'état des peuples qui prospèrent par des voies paisibles à l'état des peuples qui ont fondé leur prospérité sur la domination; comparez les nations guerrières de l'antiquité aux nations industrieuses des âges modernes; comparez l'Europe, où tant d'hommes encore cherchent la fortune dans le pouvoir, à ces États-Unis d'Amérique où l'universalité des citoyens n'aspire à s'enrichir que par le travail, et vous découvrirez bientôt où il y a le plus de liberté véritable.
Les hommes ne sont donc esclaves que parce qu'ils n'ont pas développé leurs facultés et appris à en régler l'usage. Ils ne sont libres que parce qu'ils les ont développées et réglées. Il est vrai de dire, à la lettre, qu'ils ne souffrent jamais d'autre oppression que celle de leur ignorance et de leurs mauvaises mœurs; comme il est vrai de dire qu'ils n'ont jamais de liberté que celle que comportent l'étendue de leur instruction et la bonté de leurs habitudes. Plus ils sont incultes et moins ils peuvent agir; plus ils sont cultivés, et plus ils sont libres: la vraie mesure de la liberté c'est la civilisation.
[I-39]
§ 5. Il est peu de choses qu'on ait entendues plus diversement que la liberté, et dont on ait, en général, des idées plus imparfaites. Il est assez rare, au moins dans les livres de politique et de morale, qu'on la considère comme un résultat de notre développement. Loin de penser qu'elle suit le progrès de nos facultés, bien des gens s'imaginent qu'elle décroît à mesure qu'elles se perfectionnent, et que l'homme inculte, l'homme sauvage était plus libre que ne l'est l'homme civilisé. On n'a pas l'idée surtout que tous nos progrès, de quelque nature qu'ils soient, contribuent immédiatement à l'étendre. On dira bien peut-être que les hommes deviennent plus libres en devenant plus justes, en se renfermant tous plus exactement dans les bornes de l'équité; mais on ne dira pas, quoique la chose soit aussi certaine, qu'ils deviennent plus libres en devenant plus sobres, plus tempérans en apprenant à mieux user de leurs facultés respectivement à eux-mêmes. On ne dira pas non plus qu'ils deviennent plus libres par cela seul qu'ils deviennent plus industrieux, plus riches, plus instruits, bien que ce soit une vérité également incontestable. Examinons succinctement quelques-unes des idées qu'on a de la liberté. Nous achèverons par là d'éclairer et de confirmer celle que, suivant nous, on doit s'en faire.
Les hommes naissent et demeurent libres, a [I-40] dit l'assemblée constituante [14] Ce peu de mots me feraient douter que cette illustre assemblée eût de la liberté une idée bien juste. La liberté n'est pas quelque chose de fixe et d'absolu, comme cette déclaration semblerait le faire entendre. Elle est susceptible de plus et de moins; elle se proportionne au degré de culture. Ensuite, elle n'est pas une chose qu'on apporte en naissant. Il n'est pas vrai, en fait, que les hommes naissent libres; ils naissent avec l'aptitude à le devenir; mais l'instant de leur naissance est assurément celui où ils le sont le moins. S'ils ne naissent pas libres, on ne peut pas dire qu'ils demeurent tels; mais on peut dire qu'ils le deviennent, et ce qu'il faut dire c'est qu'ils le deviennent d'autant plus qu'ils apprennent à faire de leurs facultés un usage plus étendu, plus moral et plus raisonnable.
L'assemblée constituante définissait la liberté le pouvoir de faire ce qui ne nuit point à autrui [15] . Cette définition était au moins incomplète. Une des conditions de la liberté c'est bien sans doute que les hommes s'abstiennent réciproquement de se nuire; mais cette condition essentielle n'est pas la condition unique. Il ne nous suffirait pas, pour être libres, de savoir nous respecter les uns les autres, [I-41] il faut encore que chacun de nous sache se respecter soi-même. Il ne nous suffirait pas non plus d'être moraux, il faut aussi que nous soyons habiles. La liberté dépend de toutes ces conditions et non pas d'une seule ; elle est d'autant plus grande qu'elles sont toutes plus pleinement accomplies.
Un célèbre jurisconsulte anglais a sévèrement critiqué la définition de l'assemblée constituante. Il n'est pas vrai, suivant lui, que la liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas. « Elle consiste, dit-il, à pouvoir faire ce qu'on veut, le mal comme le bien; et c'est pour cela même que les lois sont nécessaires pour la restreindre aux actes qui ne sont pas nuisibles [16] . » On n'est pas peu surpris de voir un philosophe aussi éminemment judicieux que Bentham placer ainsi la pleine liberté dans la licence, et trouver que les lois la restreignent en nous interdisant de faire le mal. Rien n'est assurément moins exact que cette proposition. Il n'est pas vrai que nous serions plus libres si les lois ne nous défendaient pas de nous faire mutuellement violence; il est manifeste au contraire que nous le serions beaucoup moins; nous ne jouirions d'aucune sécurité; nous vivrions dans de continuelles alarmes; presque toutes nos facultés seraient [I-42] paralysées. Les lois augmentent donc notre puissance d'agir, bien loin de la restreindre en nous interdisant certaines actions; et au lieu de dire, comme le fait Bentham, « qu'on ne saurait empêcher les hommes de se nuire qu'en retranchant de leur liberté [17] , il faut dire qu'un des meilleurs moyens d'étendre leur liberté, c'est de les empêcher de se nuire.
Au surplus l'erreur que je relève ici n'est pas particulière à Bentham. C'est un préjugé de la plupart des publicistes, que les hommes jouissent d'une liberté plus étendue dans l'état sauvage, dans ce qu'ils appellent état de nature, qu'au sein de la société perfectionnée. « Dans l'état de nature, disent-ils, les hommes jouissent d'une liberté illimitée, tandis que dans l'état de société ils sont obligés de sacrifier une portion de leur liberté pour conserver l'autre. » Tout cela me paraît très-peu exact. Observons d'abord qu'il n'existe point, en fait, d'état de nature différent de l'état de société. La société est l'état naturel de l'homme. L'homme est en état de société dans la vie sauvage, dans la vie nomade, dans la vie agricole et sédentaire. Il est également en état de nature dans tous ces états, c'est-à-dire que tous ces états lui sont naturels, ou qu'il est dans sa nature de passer par [I-43] tous. Si, dans l'infinie diversité de ceux qu'il traverse pour arriver à son plein développement, il en était quelqu'un qui méritât de préférence le nom d'état de nature, ce serait celui où il approche le plus de sa destination, l'état de société perfectionnée, et non certainement l'état imparfait qu'on a désigné par le nom d'état sauvage. Ensuite, si l'état sauvage n'est pas celui qui mérite le mieux le nom d'état de nature, il n'est pas non plus celui où l'homme jouit de la liberté la plus étendue. La liberté, bien loin d'y être illimitée, y est beaucoup plus circonscrite que dans aucun autre état. J'en ai dit assez pour le faire comprendre, et je n'insiste pas sur cette vérité qui sera d'ailleurs développée dans un autre chapitre. Enfin, il n'est pas vrai que dans l'état de société perfectionnée l'homme ne jouisse de la liberté qu'en en sacrifiant une partie, Ce qui est vrai, c'est que dans tous les états possibles l'homme ne peut être libre qu'en faisant le sacrifice de son ignorance et de ses vices, de sa violence et de ses faiblesses. Mais en faisant ce sacrifice à la liberté, ce n'est pas la liberté qu'il sacrifie, c'est ce qui la détruit ou l'empêche de naître. Il ne borne pas sa puissance en s'interdisant le vol, le meurtre, la débauche, en s'ôtant la triste faculté de déraisonner et de se mal conduire; il est visible au contraire qu'il l'étend, et ce n'est même qu'en s'enchaînant de la sorte qu'il peut se donner plus [I-44] de latitude pour agir, et acquérir toute la liberté à laquelle sa nature lui permet de prétendre.
Rien n'est plus ordinaire que de voir présenter la liberté comme quelque chose d'opposé à l'ordre, à la raison, à la sagesse. On parle continuellement d'une liberté raisonnable, d'une sage liberté par opposition à la liberté simplement dite, qui à elle seule ne paraît ni assez raisonnable, ni assez sage. On dit aussi que la liberté est précieuse, mais que l'ordre est plus précieux encore, et chaque jour on s'en vient demander, dans l'intérêt de l'ordre, le sacrifice de la liberté. Ai-je besoin de dire qu'il n'y a point entre ces choses l'opposition qu'on affecte d'y mettre? En quoi consistent la sagesse et la raison, si ce n'est dans l'usage le plus parfait de toutes nos facultés? et comment pouvons-nous jouir de la liberté, si ce n'est précisément en usant de nos facultés ainsi que le demandent la raison et la sagesse ? Où voyons-nous régner l'ordre le plus vrai? n'est-ce pas là où chacun s'abstient de toute agression, de toute injustice? Et que demande la liberté ? n'est-ce pas, entre autres choses, que chacun s'interdise la violence et l'iniquité? Il n'y a donc sous les mots d'ordre, de sagesse, de raison, aucune idée que le mot liberté n'embrasse ; et qui demande le sacrifice de la liberté dans l'intérêt de l'ordre est tout aussi ennemi de l'ordre qu'ennemi de la liberté.
[I-45]
Un préjugé peu différent de celui que je viens de combattre est celui qui présente la liberté comme un élément de trouble, et le despotisme comme un gage de paix. C'est le sens de cet adage politique si connu et si fréquemment cité: Malo periculosum libertatem quam quietum servitium: je préfère les orages de la liberté à la paix de la servitude. Il est insensé d'allier ainsi les idées d'ordre et de sécurité au despotisme, et celles d'agitation et de péril à la liberté. Si le despotisme était, plus que la liberté, favorable au repos des hommes, il faudrait le préférer, cela est indubitable. Mais il n'en est point ainsi : ce qui trouble le monde, au contraire, c'est le despotisme; ce qui le pacifie, c'est la liberté ; et voilà justement pourquoi la liberté est préférable au despotisme. C'est la liberté qui est tranquille, c'est le despotisme qui est turbulent. Partout où des hommes en veulent opprimer d'autres, il y a violence, désordre et cause de désordres; partout où nul n'affecte de prétentions dominatrices, partout où il y a liberté, il y a repos et gage de repos. Il ne faut qu'ouvrir les yeux pour s'en convaincre. Comparez les pays où il y a le plus de tyrannie à ceux où il y en a le moins, et dites si les plus libres ne sont pas aussi les plus paisibles? Quoi de plus horriblement convulsif que le despotisme turc! quoi de plus profondément paisible que la liberté anglo-américaine!
[I-46]
Certaines personnes placent, dans leur estime, la liberté fort au-dessous de la sûreté; d'autres l'estiment moins que la propriété; d'autres, moins que l'égalité, et toutes croient devoir la distinguer de ces choses. Cette distinction me paraît peu motivée. Il y a ici plus de différence dans les mots que dans les idées qu'ils expriment ; et quiconque tient à sa sûreté, quiconque regarde la propriété et l'égalité comme des choses importantes, doit, par cela même, attacher le plus grand prix à la liberté. Toutes ces choses en effet ne peuvent exister qu'aux lieux où la liberté règne. Il y a sûreté là où aucun homme ne songe à faire violence à aucun autre. Il y a propriété là où aucun homme n'en empêche aucun autre de disposer comme il lui plaît, en tout ce qui ne nuit pas à autrui, de sa personne, de ses facultés et du produit de ses facultés. Il y a égalité non pas là où tout le monde possède le même degré de vertu, de capacité, de fortune, d'importance, car une telle égalité ne peut exister nulle part; mais là où nul ne possède que l'importance qui lui est propre, là où chacun peut acquérir toute celle qu'il est légitimement capable d'avoir. L'égalité, la propriété, la sûreté résultent donc, sinon de toutes les causes qui concourent à la production de la liberté, du moins de l'une de celles qui contribuent le plus à la produire, c'est-à-dire de l'absence de toute injuste [I-47] prétention, de toute entreprise violente. Ces choses sont la liberté même, considérée sous un certain point de vue. La sûreté est spécialement cette liberté de disposer de sa personne, la propriété cette liberté de disposer de sa fortune, l'égalité cette liberté de s'élever en proportion de ses moyens, qui se manifestent là où chacun se tient dans les bornes de la modération et de la justice.
§ 6. Parmi les erreurs où l'on tombe au sujet de la liberté, il en est une de particulièrement fâcheuse, et qu'il faut, pour cela, que je considère à part. On veut que la liberté résulte non de l'état de la société, mais de la volonté du gouvernement. On dit qu'il y a liberté de faire une chose quand le gouvernement la permet; on dit qu'il y a dans un pays tout juste autant de liberté que le gouvernement en accorde ; et par gouvernement on entend une chose distincte de la société, et existant en quelque sorte en dehors d'elle.
C'est là, je crois, une manière très-inexacte et très-incomplète d'envisager la chose.
Il n'y a pas moyen d'abord de distinguer le gouvernement de la société. Le gouvernement est dans la société ; il en fait intrinsèquement partie ; il est la société même considérée dans l'un de ses principaux modes d'action, savoir la répression des violences, le maintien de l'ordre et de la sûreté. [I-48] Les formes suivant lesquelles il exerce cette action, et la manière plus ou moins éclairée et plus ou moins morale dont il l'exerce dépendent essentiellement de la volonté de la société. Il est, dans tous les temps, l'expression exacte des idées et des habitudes politiques qui prédominent au milieu d'elle, ou dans les pays dont elle est entourée et à l'influence desquelles elle est plus ou moins soumise [18] . Plus ces idées et ces habitudes sont imparfaites, et plus le gouvernement est imparfait. Il est d'autant meilleur qu'elles sont meilleures elles-mêmes. Il n'est pas une institution défectueuse, il n'est pas un acte vicieux du pouvoir dont on ne puisse montrer avec détail toutes les causes dans l'état de la société. Au lieu donc de dire que la liberté dépend uniquement de cet ensemble d'individus et de corps constitués auquel on donne le nom de gouvernement, il faudrait dire d'abord qu'elle dépend de la bonté des idées et des habitudes politiques qui prédominent parmi les peuples.
Ensuite cette expression, quoique plus exacte, aurait encore le défaut de ne pas donner une idée complète des sources de la liberté. La liberté en effet ne dépend pas uniquement de la bonté de nos idées et de nos habitudes politiques; elle dépend de la bonté de toutes nos idées et de toutes nos [I-49] habitudes; c'est-à-dire que nous sommes d'autant plus libres que nous savons faire, sous tous les rapports, un meilleur usage de nos facultés. Il est vrai que les connaissances et les vertus propres à constituer le bon citoyen en peuvent faire supposer un grand nombre d'autres, et que lorsqu'un peuple est parvenu à un point de culture assez élevé pour se bien conduire politiquement, il y a lieu de croire qu'il a fait des progrès considérables dans les autres parties de la civilisation, et qu'il jouit, sous tous les rapports, d'une liberté fort étendue. Mais de ce que la capacité politique en fait ordinairement supposer un grand nombre d'autres, il ne faut pas conclure que la liberté vient uniquement de celle-là ; elle vient de celle-là et des autres; elle découle généralement de toutes; elle s'accroît par le progrès de tous nos moyens. Je ne vois pas la moindre raison pour dire que nous devenons libres en nous formant à la justice publique et non en nous formant à la justice privée, en devenant habiles dans le gouvernement et non en devenant habiles dans l'agriculture, le commerce ou tel autre mode spécial d'activité. Nos progrès en effet ont tous également pour résultat d'écarter quelques-uns des obstacles qui s'opposent à l'exercice de nos forces: ils ont donc tous pour résultat de contribuer immédiatement à l'extension de notre liberté.
[I-50]
Non-seulement la liberté ne gît pas tout entière dans ce que nous avons de vertu et d'habileté politiques, mais nos autres développemens mêmẹ ne dépendent pas nécessairement de celui-là. Nous commençons à faire des progrès en intelligence, en industrie, en morale, long-temps avant d'être sortis politiquement de la barbarie. Il est vrai que la barbarie politique rend d'abord ces progrès excessivement lents; mais l'expérience démontre qu'elle ne les rend pas absolument impossibles. Il suffit,, pour s'en convaincre, de considérer à travers quelle série de guerres, de violences et de désordres publics de toute espèce la civilisation est parvenue à se faire jour.
Encore une fois, il n'est done pas vrai que toute la liberté soit renfermée dans ce que nous avons de capacité politique, ni même que nos autres progrès dépendent nécessairement de ceux que nous avons faits sous ce rapport. La capacité politique est ordinairement la dernière qu'un peuple acquiert [19] . Se bien conduire politiquement est la dernière chose dont il devient capable. Ce dernier progrès couronne la liberté; mais il n'est pas la liberté tout entière. Il rend, à mesure qu'il s'accomplit, les[I-51] autres progrès plus faciles; mais il n'est sûrement pas la condition de tout progrès. Un peuple peut jouir d'une immense liberté avant de s'être élevé au gouvernement de lui-même, et surtout avant d'avoir appris à se gouverner raisonnablement. Il peut y avoir chez lui beaucoup de savoir, d'industrie, de capitaux, de bonnes habitudes personnelles et relatives. Or il est visible qu'il ne peut avoir acquis tout cela sans s'être procuré, par cela même, une grande puissance, sans s'être donné beaucoup de facilité et de latitude pour agir. Il ne faut pas sans doute exclure la plus haute des capacités, la capacité politique de l'idée de la liberté; mais il ne faut pas l'y comprendre seule. Pour la définir avec exactitude, il faudrait faire l'inventaire de tout ce que l'humanité possède de connaissances réelles et de véritables vertus. Elle est égale pour chaque peuple à ce qu'il a fait de progrès dans toutes les branches de la civilisation; elle se compose de tout ce qu'il a de savoir-faire et de savoir-vivre : voilà sa véritable définition.
[I-52]
CHAPITRE II.
Influence de la race sur la liberté.↩
§ 1. Les hommes, ai-je dit, sont d'autant plus libres qu'ils ont plus développé leurs facultés et mieux appris à en régler l'usage. Mais d'abord les facultés de toutes les races d'hommes sont-elles susceptibles du même degré de rectitude et de développement?
§ 2. Il n'est peut-être pas d'espèce vivante qui offre des variétés plus nombreuses que le genre humain. Ces variétés, par des causes qui ne nous sont que très-imparfaitement connues, se sont tellement multipliées, qu'il est devenu comme impossible d'en faire une énumération exacte. On peut cependant, en supprimant un nombre infini de nuances intermédiaires, et en ne tenant compte que des différences les plus saillantes, en noter un certain nombre de très-distinctes. Les zoologistes en comptent ordinairement cinq: la Caucasienne, qu'ils placent au centre, et qu'ils regardent comme [I-53] la souche du genre humain ; la Mongole et l'Ethiopienne, qui sont aux deux extrémités opposées, et à une égale distance de la première; enfin, l'Américaine et la Malaie, qui se trouvent comme intermédiaires, la première entre la caucasienne et la mongole, et la seconde entre la caucasienne et l'éthiopienne [20] .
Les principaux traits caractéristiques de chacune de ces races sont assez connus.
Ce qui distingue surtout la caucasienne, c'est une peau blanche; un teint rosé ou tendant au brun; des joues douées de la faculté singulière de rougir, de pâlir, et de trahir ainsi les émotions de l'ame; une chevelure douce, épaisse et plus ou moins bouclée ; une figure ovale et droite ; le haut de la tête et surtout le front très-développés; le [I-54] devant du crâne s'abaissant perpendiculairement du côté de la face, etc.
La variété mongole est particulièrement caractérisée par un teint olive tirant sur le jaune ; des cheveux noirs, droits, gros et clair-semés; peu ou point de barbe ; une tête carrée ; une face large et plate avec un front étroit et bas ; les pommettes des joues saillantes; les yeux bridés et obliquement fendus; de grandes oreilles; des lèvres épaisses; une taille en général plus courte et plus ramassée que celle des Européens.
Les principaux traits de la variété éthiopienné sont une peau d'ébène; des cheveux noirs et laineux; le crâne comprimé par les côtés, aplati sur le devant, et s'allongeant démesurément en arrière ; un front bas, étroit et irrégulier; des yeux ronds et à fleur de tête; les os des joues proéminens; les mâchoires étroites et saillantes; les dents incisives supérieures inclinées en avant; le menton retiré en arrière; de grosses lèvres, un nez épaté et se confondant en quelque sorte avec la mâchoire supérieure; les genoux ordinairement tournés en dedans.
Tels sont les traits des trois variétés les plus prononcées et les plus distantes l'une de l'autre. Ceux des deux variétés intermédiaires n'en sont que des nuances différentes, qui servent comme de transition de la race caucasienne à ses deux dérivations [I-55] les plus opposées. Les traits de la race américaine sont un mélange de ceux de la râce caucasienne et de la race mongole; les traits de la race malaie sont un mélange de ceux de la race caucasienne et de la race éthiopienne [21] .
On sent que des signalemens aussi généraux né sauraient convenir également à toutes les nuances qu'embrasse chaque variété. Cependant il n'est pas douteux qu'ils ne s'appliquent plus ou moins à chacune d'elles, et l'on a pu dire avec une certaine exactitude quels sont les peuples dont chaque variété se compose.
On a compris dans la race blanche ou caucasienne tous les Européens anciens et modernes, moins les Lapons et les débris de la race finnoise; tous les habitans anciens et houveaux de l'ouest de l'Asie, dans l'étendue des pays qu'embrassent l'Oby, la mer Caspienne et le Gange; enfin les habitans du nord de l'Afrique, en y réunissant quelques tribus avancées vers le sud.
La race jaune ou mongole à embrassé le resté dés nations asiatiques, les Lapons et les Finnois au nord de l'Europe, et les Eskimaux répandus à l'extrémité la plus septentrionale de l'Amérique, depuis le détroit de Béring jusqu'aux confins du Groenland.
[I-56]
Toutes les nations de l'Afrique qui ne font pas partie de la première variété, ont été comprises dans la race noire ou éthiopienne.
La variété rouge ou américaine a été composée de tous les naturels de l'Amérique, moins les Eskimaux.
Enfin, à la variété brune ou malaie ont appartenu tous les habitans des nombreuses îles de la mer du Sud, depuis le vrai Malai que sa couleur, ses traits, ses cheveux longs et doux rapprochent beaucoup de la race européenne, jusqu'au sauvage de la terre de Diémen, qui, par sa peau noire et sa chevelure courte, crépue et serrée, paraît se confondre avec l'Africain [22] .
Les différences que nous venons de noter entre les principales variétés du genre humain ne sont pas les seules qui les distinguent. Ces variétés, si fortement séparées par la couleur, les traits, les cheveux, l'air de la tête, ne diffèrent guère moins par la taille, par les proportions du corps, peut-être par la finesse des sens, mais surtout par la forme et la capacité du crâne, par le volume et le mode de développement du cerveau.
Il y a certainement quelque distance du crâne haut et bombé de l'Européen au crâne large et aplati du Mongol, ou au crâne étroit et oblong du [I-57] nègre. Cette distance serait sensible alors même que, dans chaque race, on prendrait ses objets de comparaison dans les formes moyennement caractérisées. Tous les Caucasiens sans doute n'ont pas le front haut, ni tous les Mongols le crâne aplati, ni tous les Ethiopiens le crâne allongé ; mais on ne peut nier que cette différence, dans la conformation du crâne, ne soit, en général, un des types les plus caractéristiques de chacune de ces races....
Le volume et la disposition du cerveau paraissent avoir, dans la race caucasienne, une supériorité marquée sur les deux variétés qui s'éloignent le plus d'elle. Les organes de l'intelligence sont ceux qui prédominent dans la tête de l'Européen, et ceux de l'animalité dans la tête du Mongol et surtout du nègre. Ces dernières races sont peut-être mieux partagées du côté des sens; mais la première paraîtrait supérieure par les organes de la pensée. La face, qui est petite dans le Caucasien, comparativement au reste de la tête, est énorme dans le Mongol, et surtout dans l'Ethiopien relativement au volume du cerveau [23] .
Les proportions du corps ne sont guère moins différentes. Le Mongol a le buste large et carré [I-58] les extrémités courtes et musculeuses [24] . Le nègre, au contraire, est mince du corps et surtout des reins; il a souvent les extrémités longues et grêles, et presque toujours la jambe et le pied renversés en dedans [25] . Le Caucasien s'éloigne également de ces formes; il n'est ni trapu comme le Mongol, ni fluet et dégingandé comme l'Ethiopien.
Au surplus, il ne s'agit point ici d'attribuer la supériorité à la race caucasienne, ni de constituer les races de ébuleur dans un état d'infériorité il s'agit seulement de noter quelques-unes des différences qui distinguent les diverses races; et quand on ne serait pas frappé de toutes les remarques qui ont été faites à l'avantage de la race blanche, il n'en resterait pas moins évident qu'il existe, sous beaucoup de rapports, des différences très-saillantes entre les grandes variétés dont la famille humaine se compose.
Ajoutons à ces remarques que les diverses variétés, tant qu'elles ne s'allient point entre elles, conservent invariablement les caractères qui leur sont propres. Ces caractères restent les mêmes sous toutes les latitudes et dans tous les climats. L'Américain est rouge d'un bout de l'Amérique à [I-59] l'autre ; l'Africain reste noir sous les glaces du pôle ; l'Européen naît blanc sous le soleil d'Afrique ; les Maures et les Arabes, qui sont de notre race, font encore, après une longue suite de générations, des enfans qui sont, en faissant, aussi blancs que les nôtres [26] . Les Hottentots restent éternellement petits à côté des Cafres qui sont grands; et les Chaymas, chétifs et fluets, à côté des Caraïbes ou des Carives qui sont énormes. Les Gallas, nation africaine placée directement sous la ligne, ont, suivant Bruce [27] , un teint presque blanc que n'altèrent pas les feux du soleil; et les Cafres, qui sont à quelques degrés du cap, sous un climat don't la chaleur est très-supportable, conservent, suivant Paterson [28] , leur peau du noir d'ébène le plus foncé. Une même race, qui ne se mêle pas, reste identique sous les climats les plus divers [29] . Dès races diverses, qui ne se mêlent pas, conservent toutes, dans un même pays, les traits qui leur sont propres. Les mêmes quartiers du globe ont été successivement habités par des peuples très-différens, sans que les traits caractéristiques d'aucun dé ces peuples aient subi la moindre altération. Il n'est pas au pouvoir dé l'homme enfin de modifier sa postérité en agissant sur lui-même. Nulle mutilation, [I-60] accidentelle ou volontaire, n'est transmissible par la génération : les Caraïbes se déforment artistement le crâne; les femmes chinoises réduisent leur pied au tiers de ses justes dimensions; certains sauvages s'allongent démesurément les oreilles, et nul d'eux ne réussit à transmettre ces difformités à ses descendans. Il y a trois ou quatre mille ans que les Juifs se livrent à la pratique de la circoncision, et leurs enfans naissent encore incirconcis, dit le docteur Prichard [30] .
§ 3. Ce serait sortir du sujet que je traite que de rechercher ici d'où ont pu provenir ces différences entre les principales variétés de notre espèce. Sont-elles originaires ou adventices? A-t-il existé primitivement plusieurs races distinctes, comme le croient quelques auteurs, ou bien le genre humain était-il identique dans son origine, et toutes les variétés de l'espèce humaine ne sont-elles que des déviations plus ou moins sensibles de ce type original et primitif? S'il en est ainsi, comment se sont opérées ces déviations? Ont-elles été le fruit du climat, du sol, des alimens, ou d'autres causes extérieures, comme on l'avait toujours prétendu ; ou bien, comme on l'a récemment expliqué, ont-elles été produites par cette tendance des espèces à la variation, qui est, dit-on, une [I-61] loi du monde physique, qui agit également sur les plantes et sur les animaux, qui agit surtout dans l'état de domesticité, et avec une force d'autant plus grande qu'on est dans un état plus avancé de culture et de civilisation [31] ?
Toutes ces questions, plus ou moins curieuses, [I-62] plus ou moins importantes, sont du domaine de la zoologie, et je n'ai point à m'en occuper dans cet ouvrage. Mais ce dont je peux et dois m'occuper ici, c'est de savoir si des différences aussi sensibles, aussi permanentes entre les variétés, n'en doivent entraîner aucune dans le degré de culture, et par suite dans le degré de liberté dont elles sont susceptibles.
§ 4. Il est difficile de douter qu'elles n'en entraînent de considérables. On sait à quel point l'âge, les infirmités, les passions influent sur l'usage que l'homme est capable de faire de ses forces: comment la différence de conformation serait-elle, à cet égard, sans influence? On reconnaît que cette différence en peut mettre une grande entre la capacité de deux individus : comment n'en mettrait-elle [I-65] aucune entre la capacité de deux races? On avoue que, hors du genre humain et dans les autres espèces d'animaux, toutes les variétés ne sont pas susceptibles d'une éducation uniforme; que, par exemple, il n'est pas possible de donner au cheval flamand la vitesse du cheval anglais ou limosin, de procurer au dogue l'agilité du lévrier, de donner au lévrier l'odorat du chien de chasse, de communiquer au mâtin l'intelligence du barbet et du chien de berger: comment done serait-il plus facile de tirer un même parti de toutes les races d'hommes? Existe-t-il entre un Boschisman et un naturel d'Europe, entre un Caraïbe et un Caucasien moins de différence qu'entre un mâtin et un chien de chasse, qu'entre un coursier arabe et le cheval pesant que nous employons aux charrois?
Je suis loin de prétendre (et j'insiste sur cette remarque, parce que plusieurs écrivains qui m'ont combattu paraissent n'y avoir fait aucune attention), je suis loin de prétendre, dis-je, que certaines variétés de notre espèce ne sont susceptibles d'aucune culture; je crois, au contraire, qu'une quảlité commune à toutes, c'est de pouvoir se perfectionner par l'éducation; mais, en même temps, il me paraît impossible d'admettre qu'elles sont toutes également perfectibles [32] .
[I-64]
§ 5. Et d'abord, comment admettre que l'Eskimau pourrait par la culture devenir aussi grand que le Patagon? que les Hottentots pourraient acquérir autant de force que les Cafres? que les Lapons, les Groenlendais et les autres peuples pygmées de la variété mongole parviendraient à tirer de leurs facultés physiques le même parti que les races les plus belles et les plus robustes de la variété caucasienne? Quand les Espagnols envahirent l'Amérique, dit Herréra, ils trouvèrent en général les Indiens plus faibles qu'eux, et ce fut même cette faiblesse des Indiens qui donna lieu à l'introduction des esclaves d'Afrique, beaucoup plus capables de soutenir les rudes travaux des mines [33] . Volney remarque que, dans leurs combats, soit de troupe à troupe, soit d'homme à homme, les habitans européens de la Virginie et du Kentucky ont toujours déployé plus de vigueur physique que les indigènes de l'Amérique [I-65] septentrionale [34] . Plusieurs autres voyageurs ont trouvé, sur divers points de l'Amérique du nord, la même infériorité de force musculaire aux naturels du pays. D'un autre côté, certains peuples indigènes de l'Amérique paraissent doués d'une vigueur de corps qu'il serait probablement aussi difficile de trouver chez la plupart de nos paysans que de leur communiquer. Quel est, je le demande, le régime diététique qui pourrait donner aux habitans de certaines de nos provinces, dont la taille moyenne n'est pas de cinq pieds, la vigueur singulière de ces Caraïbes, qui peuvent ramer quinze heures de suite contre le courant le plus rapide, par une chaleur de trente degrés du thermomètre de Réaumur, ou bien la force encore plus athlétique de ces Indiens Ténatéros, employés aux travaux des mines du Mexique, qui peuvent rester, pendant six heures, chargés d'un poids de deux cent vingt-cinq à trois cent cinquante livres, et monter sept ou huit fois de suite, avec de tels fardeaux, des escaliers de dix-huit cents gradins [35] ? Il est sensible que, par cela même que certaines variétés diffèrent [I-66] par la taille et les justes proportions du corps, elles doivent différer aussi par la vigueur physique, et que, sous ce rapport, elles ne peuvent se développer et devenir libres qu'à des degrés très-inégaux.
§ 6. Au reste, la force que les hommes possèdent dans leurs bras est toujours si petite en comparaison de celle qu'ils peuvent se procurer par leur intelligence, qu'elle mérite à peine d'être comptée; et, quelque différence qu'on puisse remarquer entre leurs muscles, je n'hésiterais pas à dire qu'ils sont susceptibles de la même liberté, s'ils l'étaient d'ailleurs du même degré de culture intellectuelle et morale. Mais la diversité de leur conformation physique n'en doit-elle entraîner aucune dans leurs pouvoirs moraux? Peut-on admettre que les sauvages tribus de la Terre-de-Feu ou de la Nouvelle-Hollande, par exemple, seraient capables, dans des situations d'ailleurs égales, d'apprendre à faire de leurs facultés intellectuelles un usage aussi étendu et aussi raisonnable que les nations de l'Europe les plus heureusement organisées ?
J'ai déjà fait remarquer la différence que les principales variétés de l'espèce offrent dans la conformation de la tête. Cette différence est l'une de celles qui paraissent les distinguer le plus fortement; [I-67] et un nègre, un Calmouck, un Européen ne sont peut-être pas plus séparés par la couleur de la peau que par la forme du crâne. Pense-t-on qu'une pareille différence dans les organes intellectuels n'en doive entraîner aucune dans les fonctions de l'intelligence? et, voulût-on ne voir dans l'homme qu'un pur esprit servi par des organes, serait-il possible d'admettre que cet esprit est également puissant, quels que soient les organes qui le servent?
Nous n'avons, je le sais, aucun moyen de connaître comment, à cet égard, le physique influe sur le moral; mais il paraît qu'il est d'observation constante en zoologie que plus la tête des animaux s'approche de certaines formés, et moins est imparfait l'usage qu'ils peuvent faire de leurs facultés intellectuelles. C'est par là que certains animaux se montrent supérieurs à d'autres ; c'est par là surtout que l'homme se distingue de la brute: pourquoi la même cause ne distinguerait-elle pas l'homme de l'homme?
§ 7. Si les phénomènes de l'intelligence ne dépendaient en rien de l'organisation physique, on ne remarquerait aucune coïncidence entre les lumières des peuples et le mode de leur conformation. On rencontrerait indistinctement, dans toutes les races, un même mélange d'habileté et [I-68] d'impéritie, de prospérité et de misère; les beaux caractères et les grands talens se montreraient en même nombre, toute proportion d'ailleurs gardée, dans les meilleures conformations et dans les organisations les plus imparfaites; l'Ethiopien, le Mongol, l'Européen seraient au même point civilisés. Mais il s'en faut qu'il en soit ainsi. Il se trouve au contraire que la supériorité de civilisation coincide ici avec la supériorité d'organisation physique, et que la race dont la tête paraît la mieux faite est aussi la plus civilisée. Le Calmouck, à la face large, au front écrasé, ne s'est pas en général beaucoup élevé au-dessus de la vie nomade; le nègre, au crâne étroit et allongé, a toujours croupi dans un état voisin de la pure barbarie; tandis que le Caucasien, dont le front est très-développé, et la figure presque verticale, est parvenu, à diverses époques, et surtout dans les temps modernes, à un degré comparativement très-élevé de civilisation. Tout semble indiquer que, des animaux de notre espèce, le plus susceptible de culture, c'est l'homme de couleur blanche, c'est l'animal que Linnée appelle homo sapiens europeus.
Je ne dis pas qu'un certain nombre d'individus dans les races de couleur foncée ne puissent s'élever aussi haut et plus haut peut-être que le commun des hommes de la race blanche: je serais certainement démenti par les faits. Je sais qu'on [I-69] peut citer des exemples de nègres qui se sont plus ou moins distingués dans les arts, dans les lettres, même dans les sciences [36] . Mais ces exceptions, quoique nombreuses, ne semblent pas l'être assez pour infirmer la règle, et l'on ne parviendrait guère, en les réunissant, et en les comparant à la masse d'hommes distingués qu'a renfermée dans tous les temps la race caucasienne, qu'à montrer combien celle-ci est en général supérieure par les facultés de l'esprit et la force de la pensée.
Je ne dis pas non plus que les autres races, considérées dans leur ensemble, ne puissent pas s'élever à un certain degré de civilisation : les faits me seraient encore contraires. On peut citer, dans la race africaine, les noirs de Saint-Domingue; dans la malaie, les Otaïtiens; les Péruviens et les Mexicains, dans l'américaine; et dans la mongole, les Japonais et surtout les Chinois, qui sont par chacun à leur manière, à un degré de culture plus ou moins élevé. Cependant, quelle comparaison peut-on établir entre ces diverses civilisations et celle de la race européenne? Combien ne lui sont-elles pas inférieures en étendue en intensité, en perfection? Celle des Chinois, [I-70] la plus remarquable de toutes, paraît en être, sous beaucoup de rapports, à une distance infinie. Et d'ailleurs, fût-elle actuellement plus parfaite, un seul de ses caractères suffirait, avec le temps, pour la rendre inférieure. Je veux parler de son immobilité. Elle est stationnaire depuis quarante siècles; elle ressemble à une sorte d'instinct : bien différente de la civilisation européenne, dont le caractère essentiel est d'être à la fois mobile et progressive, c'est-à-dire de se modifier sans cesse et de s'améliorer en se modifiant [37] .
La race caucasienne se distingue des autres dès les premiers temps de son histoire. Aucun monument, aucune tradition ne la montrent dans un [I-71] état de dégradation et d'abrutissement pareil à celui où l'on a surpris diverses tribus des autres variétés. Il est permis de supposer qu'elle a commencé par être tout-à-fait sauvage; mais l'on ne saurait assigner d'époque où elle l'ait été, et les plus anciens monumens la représentent au moins dans l'état nomade. Les Arabes de la Genèse, les Grecs d'Homère, les Germains de Tacite ne sont pas encore sans doute des peuples très-avancés ; mais qui pourrait nier que leur état ne soit très-supérieur à celui où l'on a trouvé les naturels de la Nouvelle-Hollande et plusieurs tribus de l'Amérique?
Si les Caucasiens se distinguent des autres variétés à leur origine, ils s'en distinguent bien davantage dans les temps postérieurs. Plus on s'éloigne de leur point de départ, et plus on les trouvé en avant des autres races. Ils ne font pas des progrès ininterrompus; leur civilisation est irrégulière dans sa marche; elle s'arrête, elle rétrograde; elle ne disparaît jamais entièrement; elle reparaît au contraire avec plus de force; elle se répand sur des espaces plus étendus; de proche en proche, elle a envahi ainsi toute l'Europe, et depuis plusieurs siècles, elle y fait des progrès soutenus et toujours plus généraux.
Dans le même temps, l'éducation des autres races ne paraît pas avoir fait de progrès sensibles. Je [I-72] parlais tout à l'heure de l'immobilité des Asiatiques, on peut parler de celle des Africains. Ils restent plongés, depuis deux mille ans, dans leur barbarie originelle, et le nègre que nous connaissons n'est pas supérieur à l'Ethiopien que les anciens ont connu. Quant aux naturels de l'Amérique et des îles de la mer du Sud, on sait dans quel état ils ont été trouvés et dans quel état ils sont encore.
Et il ne faut pas, comme on l'a fait, attribuer au climat le développement de la race européenne, Toutes les races sont répandues sous des latitudes extrêmement variées. On sait quelle est l'étendue de l'Afrique ; l'Amérique touche aux deux pôles; l'Asie embrasse les climats les plus divers: comment, dans des situations si prodigieusement différentes, les races de couleur foncée n'auraient-elles pas fait des progrès comparables à ceux de la race blanche, si elles n'étaient pas naturellement inférieures? Les Européens se sont développés dans les climats les plus défavorables; les autres races sont restées plus ou moins incultes dans tous les climats. Les Européens se sont civilisés dans les mêmes lieux où d'autres races n'ont jamais pu cesser d'être sauvages. Quel argument la florissante république des Etats-Unis n'offre-t-elle pas contre ceux qui veulent faire honneur au climat d'Europe de la civilisation des Européens?
Il ne serait pas plus exact de dire que les Européens [I-73] sont redevables de leur civilisation à de meilleurs gouvernemens, à des institutions moins barbares; car ces choses font partie de leur civilisation et sont précisément le fruit de leur supériorité. Si les autres races en étaient naturellement capables, pourquoi ne les possèderaient-elles pas ? Pourquoi n'auraient-elles pas aussi des gouvernemens réguliers et des institutions raisonnables? Les lois, les mœurs, les sciences, les arts, l'industrie de la race européenne ne sont pas des créations du ciel ; l'auteur des choses en avait déposé le germe en elle; mais elle a le mérite de l'avoir développé : sa civilisation est son ouvrage; elle est l'effet et non la cause de sa supériorité.
On n'expliquerait pas mieux la supériorité des Européens sur d'autres races, et par exemple sur la noire, observée dans nos colonies, en disant que l'infériorité de celle-ci tient à son état de servitude. D'abord cette servitude est elle-même un phénomène assez étrange, et qui demanderait explication. Pourquoi n'est-ce pas la race noire qui commande? Pourquoi n'est-ce pas la blanche qui sert? Ensuite, la race noire ne soutiendrait peut-être pas mieux la comparaison avec la blanche dans son pays natal, où elle est libre, que dans nos colonies, où elle est esclave. Enfin, la race blanche a été vue aussi dans l'esclavage, et dans un esclavage pire que celui des noirs. M. Jefferson, [I-74] dans ses excellentes notes sur la Virginie, observe avec raison que la condition des esclaves chez les Romains, particulièrement au siècle d'Auguste, était infiniment plus dure que ne l'est celle des nègres que nous avons réduits en esclavage. Cependant, dit-il, malgré tous ces genres d'oppression, et beaucoup d'autres circonstances décourageantes, les esclaves, chez les Romains, inontraient fréquemment les plus grands talens. Plusieurs excellèrent dans les sciences; de sorte que leurs maîtres leur confiaient communément l'éducation de leurs enfans. Epictète, Phèdre et Térence furent esclaves; mais ces esclaves étaient de la race des blancs. Ce n'est donc pas, ajoute-t-il, l'esclavage, mais la nature qui a mis entre les races une si grande différence [38] . »
Non-seulement les races de couleur foncée ne se sont pas développées, de leur propre mouvement, au même degré que la race blanche; mais il semble même qu'elles soient incapables de s'approprier så civilisation. Depuis trois siècles, par exemple, que les naturels de l'Amérique ont sous leurs yeux le spectacle des arts de l'Europe, transplantés sur leur propre sol, leurs arts n'ont rien perdu de leur grossièreté native. Ils ont vu naître, grandir de puissantes colonies sans être tentés d'imiter les [I-75] travaux auxquels elles devaient leur prospérité croissante. L'exemple, la persuasion, les encouragemens, rien n'a pu leur faire abandonner leur vie vagabonde et précaire pour l'agriculture et les arts.
On voudrait mettre en doute la prééminence intellectuelle de la race blanche, et l'on est sans cesse averti de sa supériorité par quelque considération nouvelle. Combien, par exemple, n'est-ce pas une chose frappante que l'importance du rôle qu'elle joue sur notre planète, que l'étendue de la domination qu'elle y exerce, et l'extension continuelle de cette domination? Elle occupe presque exclusivement l'Europe; elle est souveraine maîtresse de l'Amérique; elle règne sur une portion considérable de l'Asie; elle a des colonies en Afrique et à la Nouvelle-Hollande; elle s'est répandue dans tous les quartiers du globe; elle a des établissemens partout, et ces établissemens s'étendent sans cesse. Les autres races sont bien loin d'avoir montré la même curiosité, la même audace, la même force expansive. Ce ne sont pas elles qui sont venues chercher les Européens, ce sont les Européens qui ont été au-devant d'elles', qui sont allés les découvrir, les visiter dans les coins de la terre les plus retirés. Le monde, sans les Européens, ne saurait pas même leur existence, et la plupart d'entre elles seraient demeurées ignorées du reste du genre humain.
[I-76]
Une dernière marque de l'infériorité de ces dernières, un fait dont il semblerait résulter qu'elles ne sont que des dégénérations de la race blanche, c'est qu'elles tendent à revenir à sa couleur et à ses traits, tandis qu'elle ne prend leur couleur et leurs traits que fort difficilement. Tel est du moins l'avis de Blumenbach, adopté par W. Lawrence, et que ces savans naturalistes appuient sur des observations faites dans les îles de la mer du Sud et dans plusieurs parties de l'Afrique [39] .
Les faits sembleraient donc établir que les races de couleur foncée, soit que leur système nerveux et cérébral soit moins développé ou autrement développé, soit que cet appareil ne soit pas doué chez elles du même degré de sensibilité ou d'énergie, sont loin de manifester la même vivacité d'intelligence, de déployer le même fonds d'industrie, de se montrer au même point capables d'accroître par l'art leur puissance naturelle, en un mot de faire de leurs forces un usage aussi ingénieux, aussi savant, aussi varié, aussi étendu, surtout aussi sensiblement progressif; et si, dans le nombre des différences qui distinguent les diverses variétés de l'espèce, il est une chose qui soit particulièrement de nature à frapper, c'est cette supériorité d'intelligence que manifeste dans l'ensemble de ses [I-77] travaux et de ses œuvres la variété caucasienne.
§ 8. La conséquence à tirer de ces remarques, en les supposant fondées, n'est sûrement pas que celle-ci peut se passer d'être juste envers les autres, et qu'au lieu d'employer son intelligence à étendre les bienfaits de la civilisation, elle doit la faire servir à écraser l'ignorance et la faiblesse ; que son rôle est d'achever de rendre misérables les races qui ont déjà le malheur de lui être inférieures; qu'elle a bien fait d'établir la traite et l'esclavage des Africains; qu'elle avait eu raison de commencer par massacrer les indigènes de l'Amérique; qu'elle a fait preuve de sagacité quand elle a mis en question si les Indiens étaient des hommes, et s'il ne fallait pas des bulles du pape pour les traiter comme tels; qu'elle s'est montrée bien habile quand elle a condamné à une minorité perpétuelle le petit nombre de ces malheureux qu'elle n'avait pas exterminés [40] ..... Si quelque chose pouvait rendre [I-78] douteuse la supériorité de son esprit en même temps que celle de ses affections morales, c'est bien, assurément, la conduite qu'elle a tenue envers ses parentes d'Afrique et d'Amérique, conduite non-seulement odieuse, inhumaine, mais singulièrement absurde, et qui peut devenir aussi désastreuse pour elle-même qu'elle l'a été pour les peuples qui en ont ressenti les premiers effets.
Tout ce que je veux induire de l'infériorité des races de couleur, c'est qu'étant, au moins dans leur état actuel, moins susceptibles de culture que la race blanche, elles sont moins susceptibles de liberté. Je n'ai pas la moindre envie de flatter la vanité de celle-ci ; encore moins voudrais-je offenser la dignité de celles-là. Mon seul dessein est de constater une vérité dont la connaissance importe à toutes, savoir que la liberté des hommes dépend, avant toutes choses, de la perfection de leurs facultés. Or, les faits rendent, je crois, cette vérité manifeste. La civilisation supérieure de la race blanche ne procède d'aucun hasard heureux; elle n'est pas le fruit de circonstances locales plus favorables : j'ai commencé à le faire voir dans ce chapitre [41] , [I-79] et on le verra mieux dans le chapitre suivant [42] : Elle résulte donc de la supériorité naturelle ou acquise de sa conformation. Par cela seul que cette race est douée d'organes plus parfaits, elle peut tirer un plus grand parti de son intelligence; elle est, plus qu'une autre, capable d'exercer une action utile et puissante sur la nature et sur elle-même, et de porter dans les travaux et les fonctions de la société les connaissances scientifiques, et les habitudes morales qui peuvent en faciliter l'exercice et le faire fructifier.
§ 9. Je ne dois pas laisser ignorer à mon lecteur. que ces idées, sur la prééminence de la race européenne, ont été fort attaquées. M. Comte, dans un ouvrage considérable et justement estimé, qui a paru quinze mois environ après la première édition de ce volume, a consacré plusieurs chapitres à combattre les raisons qui paraissent établir la supériorité de la race blanche sur les races de couleur foncée [43] . Ce n'est pas à moi nominativement que cette critique s'adresse. L'auteur n'a dirigé son argumentation que contre W. Lawrence, que j'avais beaucoup cité dans le cours de ce chapitre, et à qui je devais la meilleure partie de mes observations. [I-80] Mais comme, en ne nommant que l'anthropologiste anglais, l'auteur du Traité de législation attaque pourtant des idées qui me sont particulières, et cite plusieurs fois mes propres expressions, il m'est impossible de ne pas prendre pour moi une partie du blâme philosophique qui est déversé sur l'opinion de Lawrence; et d'ailleurs n'y eût-il, dans ces remarques, que Lawrence d'atteint, il suffit que j'aie adopté les principales idées de cet auteur pour que je me croie obligé de faire connaître les objections élevées contre sa doctrine.
M. Comte commence par observer qu'il est extrêmement difficile de discerner l'influence de la race au milieu de toutes celles qu'exercent sur les progrès d'un peuple, non-seulement les circonstances locales où il se trouve placé, mais le langage, les lois, les mœurs, la religion, le gouvernement, etc. Il me semble, au contraire, que ne devrait être plus propre que le gouvernement, la religion, les lois, les mœurs, à montrer l'influence de la race; car rien de tout cela n'existant antérieurement à toute culture et à tout développement, il est évident que ces choses ne peuvent être que ce que les a faites le génie du peuple qui les a produites, sous l'influence, si l'on veut, des circonstances extérieures qui l'ont inspiré. De même qu'on juge de l'arbre par le fruit, de même le caractère des arts, de la langue, de la religion, [I-81] des mœurs, du gouvernement, de tout ce qui constitue la civilisation d'un pays, peut servir à montrer de quelle race d'hommes cette civilisation est l'ouvrage. Sans doute, il n'est pas aussi aisé de juger de la race par la civilisation que de l'arbre à l'inspection du fruit; mais loin que la civilisation d'un peuple empêche de voir comment il a été influencé par sa nature, il semble que rien ne doit être plus propre que ses œuvres à révéler la nature et l'étendue de ses facultés.
L'auteur du Traité de Législation n'approuve pas qu'en cherchant à faire remarquer ce qu'il y a de divers dans les races, et leur plus ou moins de perfectibilité, on s'applique particulièrement à faire ressortir les traits favorables à l'une d'elles. Il a tout-à-fait raison; et si, en relatant les faits qui paraissent établir la supériorité intellectuelle de la race blanche, Lawrence ou moi avons eu l'air de faire son apologie, nous avons eu tort l'un et l'autre. Mais s'il faut s'abstenir de prendre parti pour une race, il faut s'abstenir aussi de paraître plaider contre elle; car il ne serait certainement pas plus philosophique de la déprimer que de l'exalter. C'est une chose à quoi M. Comte n'a peut-être pas assez pris garde. Mais peu importe ce qu'il a fait: son erreur n'excuserait pas la nôtre; sa remarque n'en reste pas moins fondée, et il est certain que, dans l'examen d'un ordre de faits quelconque, et surtout [I-82] de faits graves comme ceux-ci, on ne peut mettre trop de soin à se dégager de toute préoccupation.
Par cela même qu'il faut écarter toute préoccupation de ses recherches, il est évident qu'en étudiant la question des races, il n'y a pas lieu à s'inquiéter d'avance des résultats que pourra avoir telle ou telle solution. Partant il n'y a pas lieu à dire, avec M. Comte, que si toutes les races ne sont pas susceptibles de la même culture, plusieurs conséquences fâcheuses vont se manifester. Il faut, sans doute, mettre le plus grand soin à examiner si la chose est exacte; mais il serait peu scientifique, si je ne me trompe, de commencer, avant de savoir si le fait est vrai, par énumérer tout ce qu'a d'affligeant la thèse de ceux qui le regardent comme véritable. Ce ne serait pas le moyen de préparer le lecteur à porter dans cette étude un esprit dégagé de prévention.
Je conviens que de l'inégale perfectibilité des races il peut résulter plusieurs choses assez tristes; par exemple, l'impossibilité de faire que toutes deviennent également industrieuses, riches, éclairées, morales, heureuses; ou bien d'empêcher que les plus fortes n'abusent souvent de leur prééminence, qu'elles n'en abusent long-temps, qu'elles n'en abusent jusqu'à ce qu'elles soient assez avancées pour comprendre que l'injustice dégrade celui qui l'exerce, et que l'oppression ne nuit pas [I-83] seulement aux opprimés. Mais de l'inégalité naturelle des individus, il résulte aussi, dans chaque race et dans chaque nation, des choses malheureusement assez fâcheuses [44] . Est-ce une raison pour élever des doutes sur cette inégalité? Non sans doute. De même donc que les inconvéniens qu'entraîne l'inégalité naturelle des individus, n'empêche pas de reconnaître qu'ils naissent avec des facultés très-inégales, de même les suites plus ou moins graves que peut avoir l'inégalité des races, n'est pas non plus une raison pour fermer les yeux sur cette inégalité, si elle a en effet quelque chose de réel.
J'ai quelque peine à comprendre pourquoi l'on s'est récrié si fortement contre cette idée de l'inégalité des races. Il me semble pourtant qu'elle n'offre rien de plus étrange et de plus paradoxal que celle de l'inégalité des individus. Si un individu peut différer d'un autre, on ne voit pas pourquoi dix individus ne pourraient pas différer de dix autres, mille de mille autres. Si un homme peut avoir sa physionomie, son caractère, son tour d'esprit particulier, on ne voit pas pourquoi ce qu'il y a de plus saillant dans cet esprit, ce caractère, cette physionomie, ne pourrait pas être commun à une multitude d'hommes. Non-seulement l'inégalité des races n'a rien de plus extraordinaire [I-84] que celle des individus, mais la première de ces inégalités se présente comme une conséquence naturelle de la seconde. Toutes les races en effet ayant commencé par des individus, il est clair que si ces individus ont pu différer, leur postérité a pu naître différente; que si les premiers auteurs de chaque race ont pu avoir, chacun de leur côté, leur type particulier de figure, d'intelligence, de caractère, ces différences originaires ont pu continuer à se reproduire dans les races qui sont sorties d'eux. Il a suffi pour cela que ces races ne se mêlassent pas; et des causes malheureusement trop nombreuses ont concouru à prévenir les mélanges, la distance qui séparait les populations, les obstacles naturels qui s'élevaient entre elles, l'attachement au sol natal, les différences de couleur, de forme, de langage, d'idées, de goûts, de mœurs; les antipathies violentes que toutes ces différences devaient produire, et que la guerre est venue encore envenimer, etc. Aussi, malgré beaucoup d'invasions, de conquêtes, de migrations, les diverses variétés dont la famille humaine se compose se sont-elles peut-être moins mêlées qu'on n'est communément disposé à le croire. D'abord la fusion entre les cinq principales variétés semble avoir été à peu près nulle. Le fond de chacune de ces grandes fractions du genre humain est resté fidèle au quartier du globe qui l'avait vu [I-85] naître, ou sur lequel il s'est développé. Le fond de la race blanche est demeuré en Europe, de la rouge en Amérique, de la jaune en Asie, de la noire en Afrique, de la brune en Océanie. Les portions de notre race qui ont fait irruption parmi d'autres, en sont restées séparées. Des Européens ont envahi l'Amérique, sans se mêler à la race cuivrée. Ils y ont transporté des millions d'Africains, sans s'allier à la race noire. Il y a eu, de fait, quelques croisemens entre plusieurs races sur le sol de l'Amérique, mais ces croisemens ont été furtifs, clandestins, peu nombreux, et l'on peut dire qu'en réalité, il ne s'est point encore opéré de fusion entre les principales races. Bien plus, les diverses nuances de ces races, dans chaque quartier du globe, ne se sont encore que très-imparfaitement mêlées. L'esprit de nationalité s'est plus ou moins maintenu par toute la terre, et les antipathies, les rivalités, qui divisaient les peuples ne sont encore complètement effacées nulle part, pas même dans la race européenne, chez qui pourtant la raison et la sociabilité ont fait infiniment plus de progrès que dans aucune autre. Si donc les pères des nations, si les individus de qui les peuples sont sortis ont pu différer entre eux, comme on n'hésite point à le reconnaître, qu'y aurait-il d'étonnant à ce qu'il se manifestât encore des différences entre les générations qu'ils ont produites, surtout lorsque [I-85] ces générations sont restées plus ou moins séparées. On trouve jusque dans notre race des preuves frappantes de cette constance avec laquelle une nation peut retenir les traits et le caractère de ses ancêtres. La nation juive en est un exemple. Les Écossais en sont un autre.
«L'ensemble des mœurs écossaises, observe un écrivain anglais, nous offre le spectacle le plus étonnant : c'est toute l'ardeur des passions méridionales alimentées sous un ciel rigoureux ; amitiés passionnées, haines vives et profondes, amours sans frein, instinct poétique et musical, habitudes domestiques, jusqu'à la danse rapide des paysans provençaux, tout se retrouve chez les habitans des monts et des plaines situés au nord de la Tweed. On ne peut méconnaître la race celtique et gallique, ancienne usurpatrice de ces plages désertés, et à jamais séparée par la force du sang et l'empire des mœurs de la racé germanique qui a peuplé l'Angleterre [45] . »
Encore une fois, l'idée qu'il peut y avoir, non-seulement au physique, mais au moral, des différences entre les races ne présente donc rien de bien singulier.
On est tellement averti de ces différences, que M. Comte lui-même sent quelquefois le besoin d'en tenir compte. Il reproche à Montesquieu de ne pas le faire assez; et si, pour montrer l'influence [I-87] du climat, l'auteur de l'Esprit des Lois imagine d'opposer les Chinois à des peuples d'Europe, M. Comte ne manque pas de lui dire qu'il compare des peuples divers par la race, tandis que, pour raisonner juste, il ne devrait établir de parallèle qu'entre des peuples de même espèce, placés sous des degrés de chaleur différens. M. Comte croit donc à la diversité des races et à l'influence que cette diversité peut produire sur celle des développemens.
Je conviens que les différences, non-seulement entre les peuples de même couleur, mais entre les variétés de l'espèce les plus caractérisées et les plus distantes l'une de l'autre, ont été assez mal observées, surtout en ce qui tient aux organes de l'intelligence; et peut-être le peu qu'on sait, à cet égard, ne suffit-il pas pour rendre raison de la prééminence que j'ai attribuée à la race européenne. Mais, que la supériorité de cette race tienne à une organisation plus heureuse ou à une sensibilité plus vive, elle se montre avec tant d'éclat dans ses œuvres qu'il est difficile de ne pas croire qu'elle existe aussi dans ses facultés, surtout quand on ne saurait l'attribuer, ainsi qu'on le verra dans le prochain chapitre, à l'avantage des circonstances locales sous l'influence desquelles elle s'est développée.
M. Comte, au contraire, pense que c'est dans [I-88] la différence des situations qu'il faut chercher la cause de celle qui existe entre les progrès qu'ont faits les diverses variétés de l'espèce. Si les Européens, observe-t-il, s'étaient trouvés dans des circonstances locales aussi défavorables que les Calmoucks, que les Hottentots, que les sauvages de la Nouvelle-Hollande; si tout le sol de l'Europe avait ressemblé au désert de Cobi; si les Anglais n'avaient emporté aucun des produits de la mère-patrie dans la nouvelle Galle méridionale; si les Hollandais s'étaient trouvés réduits, au cap de Bonne-Espérance, aux seules ressources que la terre offrait aux naturels du pays; - on aurait eu beaucoup plus de peine à faire des progrès, j'en demeure d'accord avec M. Comte. Mais est-ce bien là la question? Il est clair que les hommes de toute espèce doivent être plus lents à se développer lorsqu'ils se trouvent dans des situations où les progrès sont plus difficiles. Mais tous les peuples de race mongole ne sont peut-être pas établis dans des déserts; toutes les nations africaines n'habitent pas des plages arides... Il s'agit de savoir si les peuples de couleur, qui se sont trouvés dans des circonstances locales aussi avantageuses que les Européens, ont fait des progrès comparables, Or, ceci devient difficile à soutenir. Je ne sais point d'ailleurs, si le sol du Cap et de la Nouvelle-Hollande offre aux indigènes aussi peu de ressources qu'on le prétend. Il paraît que [I-89] le sol de la Nouvelle-Hollande est loin d'être aussi dépourvu de rivières et de régions fertiles qu'on l'avait cru. Le tableau que Malte-Brun trace du cap de Bonne-Espérance, ne semblerait pas indiquer que ce pays soit naturellement aussi pauvre que le pense l'auteur du Traité de Législation. Bref, il est prouvé que les Hottentots sont restés au Cap des peuples stupides, et il ne l'est pas que des Européens, placés dans de semblables circonstances, fussent demeurés dans le même état d'abrutissement.
Si les Européens, objecte M. Comte, sont plus perfectibles que les autres races parce qu'ils sont plus perfectionnés, il faut admettre que ceux d'entre eux qui sont plus perfectionnés, sont, par cela même, plus perfectibles. Et pourquoi n'y aurait-il pas, en effet, des différences entre les diverses nations dont se compose la race caucasienne? Qui voudra affirmer que les Celtes, les Germains, les Scandinaves, les Hellènes, furent originairement des peuples également aptes à tout? Et encore, même, quoique le mélange et le frottement aient sensiblement effacé la primitive empreinte des divers peuples de l'Europe, qui osera assurer qu'il n'existe entre eux aucune différence, et qu'ils naissent tous avec les mêmes aptitudes et les mêmes inclinations? Qui me répondra que les Espagnols sont naturellement doués du même talent pour [I-90] les affaires que les Anglais; ou mieux encore, que les Anglais sont aussi heureusement organisés pour la musique que les Italiens? Montesquieu avait surement tort d'attribuer au climat les effets si différens qu'il avait vu produire à la musique en Angleterre et en Italie; mais aurait-il eu tort dé dire que l'organe musical était plus prononcé dans les cerveaux italiens que dans les têtes anglaises; ou, si l'on n'approuve pas ce langage, les Italiens naissaient avec plus que de dispositions pour la musique que les Anglais ? — Au surplus, les peuples européens pourraient être inégaux entre eux sans cesser pour cela d'être supérieurs aux autres races.
M. Comte ne voit point une preuve de cette supériorité dans le caractère à la fois mobile et progressif de notre civilisation. Si les Chinois, observe-t-il, n'ont pas avancé d'un pas depuis quatre mille ans, qu'est-ce que cela prouve, sinon qu'ils avaient déjà fait d'immenses progrès, quand nous étions encore barbares ?. .... Celà prouve de plus que tout progrès chez eux a depuis long-temps cessé, et qu'ils se trouvent excessivement reculés quoiqu'ils eussent une immense avance. Il ne me semble pas qu'il y ait là de quoi les glorifier. Il est, dans le nombre des êtres animés, des espèces qui font, dès en naissant, par une impulsion instinctive, des ouvrages miraculeux, et qui, après, [I-91] reproduisent éternellement les mêmes merveilles. On ne sait vraiment si les peuples de la Chine ne tiennent pas un peu de ces espèces-là. Il serait difficile, quoi qu'on en dise, de trouver dans notre race des exemples d'une immobilité comparable à la leur. Les invasions, les conquêtes, les oppressions, n'ont sûrement pas manqué parmi nous; et néanmoins je ne sache pas de conquête qui ait eu le pouvoir de nous arrêter quarante siècles. L'état de rétrogradation ou d'immobilité, comparativement peu durable dans notre race, n'a d'ailleurs été que local; et lorsque le mouvement et la vie ont été étouffés chez une nation, on les a bientôt vus renaître au sein d'une autre.
Je ne suiverai pas plus loin l'auteur du Traité de Législation. Il y a, sans contredit, dans toute la partie de son ouvrage à laquelle je réponds, un talent d'argumentation très-remarquable. Cependant j'avoue que je n'ai point été convaincu, et que les objections élevées contre la supériorité que paraît posséder, sous des rapports importans, la variété caucasienne, quoique souvent spécieuses, sont loin en général de me paraître insolubles.
Au surplus, je ne veux me faire ici, je le répète, ni l'apologiste de cette race, ni le détracteur d'aucune autre ; je ne me propose, proprement, ni d'établir que la blanche est supérieure à celles de couleur, ni de marquer le rang qui appartient [I-92] à chaque espèce. Certaines qualités peuvent être communes à toutes. Il est possible que chacune ait ses avantages particuliers. Peut-être y aurait-il pour toutes du profit à se rapprocher, à se mêler, à se croiser. A Dieu ne plaise, que j'avance légèrement rien qui soit de nature à entretenir des préjugés hostiles entre les diverses branches de la famille humaine, surtout lorsque, dans plusieurs quartiers du globe, un nombre considérable d'individus appartenant à ces diverses branches se trouvent réunis sur le même sol, et que leurs mutuelles inimitiés peuvent avoir pour les uns et pour les autres des conséquences si déplorables. Mais de même qu'on peut dire que les individus sont inégaux sans les exciter à se haïr, de même on peut observer qu'il existe entre les races des inégalités, sans les pousser pour cela à se faire la guerre. Tout ce que de telles observations doivent naturellement produire dans l'esprit des hommes, c'est un désir commun de travailler à l'amélioration de leur racé, et il n'y aurait sûrement rien de fâcheux à faire naître en eux un semblable désir.
Ce que j'ai dessein de montrer, c'est donc qu'il existe des différences entre les hommes ; c'est qu'ils ne se ressemblent ni au physique, ni au moral; c'est qu'ils ne naissent pas tous également beaux, robustes, intelligens, sensibles, énergiques; c'est que le degré de puissance et de liberté qu'ils sont [I-93] susceptibles d'acquérir, dépend, au plus haut degré, de la nature et de l'étendue des moyens dont ils naissent pourvus, et que, par conséquent, le premier besoin de tous, est de songer à perfectionner leur race, comme le premier soin d'un propriétaire qui veut améliorer ses bestiaux, si l'on veut bien ne pas s'offenser de la comparaison, est de chercher d'abord à en perfectionner l'espèce.
Or, la question, réduite à ces termes, paraît à peine susceptible d'être controversée. Personne ne conteste d'abord que les individus, dans chaque race, ne naissent extrêmement différens, et que, par conséquent, le premier intérêt de ceux dont l'organisation est peu avantageuse, ne soit de se rapprocher de ceux qui sont plus heureusement organisés.
Mais on ne peut pas contester non plus qu'il n'existe des différences entre les races. Il est plusieurs de ces différences qui sautent aux yeux. Telles sont celles qui se manifestent dans la couleur, les traits, la physionomie, la chevelure, etc. Celles qui existent dans l'intelligence et les affections morales peuvent être plus difficiles à observer sans être pour cela moins réelles. Quand il n'y a pas deux hommes dans une nation qui aient précisément la même tournure d'esprit, la même mesure d'intelligence, le même degré de sensibilité, une parfaite identité de caractère, il est bien [I-94] difficile de croire qu'aucune nation n'a son génie propre, ses passions dominantes, son tour d'esprit particulier. Quand il se manifeste entre les variétés d'une même espèce d'animaux des différences si sensibles d'humeur, d'instinct, d'intelligence, il est bien difficile d'admettre que toutes les races humaines sont intellectuellement et moralement semblables. Il est plus que probable, en un mot, que le terme moyen de la force, de la beauté, de l'esprit, des inclinations douces et bienveillantes n'est pas le même dans toutes les variétés.
Partant il ne peut pas être indifférent d'être semblable aux hommes de telle variété ou à ceux de telle autre. S'il importe à tel individu, né dans telle race et vivant au milieu d'elle, d'avoir les qualités qu'elle estime le plus, il y a de l'avantage, en général, à être fait à la guise de la race la plus puissante, et à posséder les facultés dont il est possible de tirer le plus grand parti. Il peut y avoir quelque chose à gagner à se rapprocher de telle race pour la taille, à ressembler à telle autre pour les proportions du corps ou la régularité des traits, à telle autre pour la vivacité de l'esprit ou l'énergie mo rale. Il me paraît incontestable, finalement, que le premier intérêt d'un peuple qui voudrait paryenir à un haut degré de puissance et de liberté, serait de réunir, s'il était possible, dans la personne de tous ses membres, les perfections physiques, [I-95] intellectuelles et morales qui peuvent se trouver départies entre les diverses variétés du genre humain.
Cependant, quelque évidente que cette opinion me paraisse, je n'oserais dire qu'elle est universellement partagée. M. Comte, par exemple, a été conduit, en examinant l'influence qu'exerce sur l'homme le monde extérieur, à attacher une telle importance à l'action de cette cause, qu'il finit par compter l'influence de la race pour presque rien. Il pense que les races les plus imparfaites sont encore assez heureusement douées pour parvenir à faire un usage facile et étendu de leurs forces. Il croit qu'un peuple quelconque pourrait pousser très-loin le perfectionnement de son industrie et de ses mœurs, sans donner à ses facultés toute l'extension et toute la rectitude dont elles sont naturellement susceptibles. Il avance que ce sont les cir constances extérieures, et non le plus ou moins d'énergie et d'intelligence naturelle d'un peuple, qui décident de l'étendue de ses progrès, et, en propres termes, que sa civilisation dépend, non du degré de développement dont il est susceptible par sa propre nature, mais de celui que sa position géographique lui permet de recevoir.
J'avoue que cette conclusion ne me paraît point admissible. Je crois bien, et je vais avoir tout à [I-96] l'heure occasion de dire pourquoi, que notre développement dépend, à un haut degré, des circonstances physiques qui nous entourent, du milieu plus ou moins favorable dans lequel nous nous trouvons placés; mais, en même temps, je ne puis croire que, dans le fait de notre développement, les causes externes jouent le premier rôle ; je pense, au contraire, que le principe de notre développement est en nous-mêmes, dans la vigueur de notre intelligence, dans l'énergie de notre volonté ; que la civilisation de l'homme est surtout l'œuvre de la nature humaine; en un mot, que c'est l'homme qui se fait et non les choses qui le font. Il est sans doute fort essentiel qu'il soit placé de manière à pouvoir tirer parti de ses forces; mais il faut premièrement que ces forces existent; c'est de ce fait que tout procède, et sa culture dépend, avant toutes choses, du plus ou du moins de puissance et de perfection dont ses facultés sont naturellement douées.
[I-97]
CHAPITRE III.
Influence des circonstances extérieures sur la liberté.↩
§ 1. Je n'avais pas donné à ce sujet, dans la première édition de ce volume, toute l'attention dont il est digne. Je n'en avais parlé qu'incidemment et avec peu d'étendue. J'avais bien reconnu, d'une manière générale, que l'homme est plus ou moins aidé ou contrarié, dans l'exercice et le développement de ses forces, par la nature des choses matérielles au milieu desquelles il vit, par la chaleur, l'humidité, le froid, la fertilité ou la stérilité du sol, la disposition des eaux et des terres, et en général par toute la constitution physique ainsi que par la position géographique du pays où il est placé; mais je n'avais pas montré avec assez de détail jusqu'où s'étendent ces influences. J'avais mis, au contraire, une sorte de hâte à écarter cet ordre de considérations, pour reporter l'attention du lecteur sur les forces naturelles et acquises de l'homme; observant qu'il était, de tous les animaux, celui sur qui le monde extérieur avait le moins d'empire, et que ce serait [I-98] méconnaître évidemment sa nature que d'attribuer ses progrès à l'influence des causes externes, encore bien que cette influence fût très-réelle, et qu'il y eût nécessité de reconnaître qu'elle pouvait entraver ou seconder très-puissamment l'action de ses facultés [46] .
J'ai donc besoin de revenir sur cette matière et d'en faire l'objet d'un examen particulier; non pour rectifier à cet égard mes premières idées, que je crois justes; mais pour les présenter avec plus de développement. Je persiste à penser et à dire, que le premier principe de la puissance et de la liberté de l'homme est en lui-même, dans son activité, dans son énergie, dans la perfection plus ou moins grande des instrumens dont la nature l'a pourvu, dans le pouvoir qu'il a de perfectionner encore ces instrumens par la culture, et non dans la nature des choses matérielles dont il est environné. Seulement, j'ai à montrer, avec plus de soin que je ne l'avais fait d'abord, jusqu'à quel point ces choses peuvent nuire au progrès de ses forces, ou bien jusqu'à quel point il est en elles de le favoriser.
§ 2. Certains écrivains n'ont pas vu de bornes, [I-99] en quelque sorte, à l'influence que le monde extérieur exerce sur le développement, non-seulement de l'homme, mais de tout ce qui a vie. Cabanis va jusqu'à croire que les différens êtres que la nature a placés dans chaque climat reçoivent leur caractère et leur physionomie des circonstances physiques qui les environnent. Il retrouve dans les productions végétales les qualités du sol qui leur sert de support, de l'eau et de l'air qui les alimentent. Les animaux, dont la nature est plus souple, modifiés, façonnés sans relâche par les impressions qu'ils reçoivent des objets extérieurs, lui paraissent la vivante image du lieu qu'ils habitent, de ses productions végétales, des aspects qu'il offre, du ciel sous lequel il est placé; et l'homme, le plus souple des animaux, diffère, dit-il, si sensiblement de lui-même, dans les divers climats, que certains naturalistes ont cru que le genre humain avait été formé originairement de plusieurs espèces distinctes. Cabanis ajoute que l'analogie de l'homme avec les objets qui l'entourent et qu'il est obligé d'approprier à ses besoins est si frappante qu'on peut presque toujours, à la simple inspection, assigner la zone à laquelle appartient chaque individu. Il ne fait pas difficulté de considérer, avec Buffon, les différences que les diverses variétés de l'espèce présentent dans les caractères extérieurs qui les distinguent, comme l'ouvrage des circonstances [I-100] physiques auxquelles elles sont soumises. Enfin, il va jusqu'à attribuer la diversité des dispositions morales à la manière différente dont la sensibilité est excitée dans les divers climats, observant que des impressions particulières, mais constantes et toujours les mêmes, comme celles qui résultent de la nature des lieux, sont capables de modifier les dispositions organiques, et de rendre, par la génération, ces dispositions fixes dans les races [47] .
M. Comte, dont j'ai parlé dans le précédent chapitre, ne va peut-être pas aussi loin que Cabanis. Il n'admet pas comme lui, par exemple, qu'il soit au pouvoir des causes externes d'altérer les caractères particuliers à une race, et de la faire dévier de son type primitif. Il convient, au contraire, que chaque race conserve inaltérablement, dans toutes les situations, les caractères qui lui sont propres [48] . Mais, à part cela, il est peu de chose, si je ne me trompe, qu'il ne reconnaisse au climat le pouvoir de faire. S'il hésite à attribuer quelque influence à la race, il en accorde sans hésitation une [I-101] immense au climat, je veux dire à l'ensemble des circonstances extérieures dont tout homme subit l'action. Il consacre une portion considérable de son ouvrage à montrer jusqu'où s'étend cette influence.
« Si le climat, dit-il, ne peut pas effacer les traits caractéristiques des espèces, il peut diminuer ou accroître les forces physiques des individus, affaiblir ou fortifier leurs facultés intellectuelles, irriter ou calmer leurs passions. L'ordre dans lequel les facultés des peuples se développent, correspond en tout à la nature physique des régions où ils sont placés. Nous trouvons la même physionomie sociale à tous les peuples placés dans des circonstances physiques analogues, quelle que soit d'ailleurs la race à laquelle ils appartiennent ; et la même analogie s'observe dans les animaux et jusque dans les végétaux. La différence des lieux étant donnée, il devient facile d'expliquer la différence des progrès qu'ont faits de certaines populations. Si, à la suite d'un naufrage, des Européens avaient été jetés nus sur la côte du cap de Bonne-Espérance, et qu'ils s'y fussent trouvés réduits aux seules ressources que le pays offrait aux naturels, ils auraient été tout aussi incapables que les Hottentots de faire le moindre progrès dans la civilisation. C'est dans la différence des circonstances locales qu'on trouve la raison des progrès très-différens qu'avaient faits les peuples indigènes de l'Amérique. Pêcheurs, [I-102] chasseurs, pasteurs, les peuples sont à peu près toujours ce que veulent qu'ils soient les circonstances où ils se trouvent. Ce qui a pu manquer à certains d'entre eux, ce ne sont pas les dispositions naturelles, mais des circonstances extérieures favorables à leur développement. Tout peuple convenablement placé, à quelque espèce qu'il appartienne d'ailleurs, porte en lui-même les moyens de parvenir à un haut degré de culture. L'avantage d'une bonne position est plus que suffisant pour compenser le désavantage de la race, si tant est que, sous ce rapport, un peuple puisse être inférieur à un autre ; et le peuple le moins susceptible de développement ira plus loin que le mieux organisé, si celui-ci se trouve dans des circonstances moins favorables. En un mot, le degré de civilisation où chacun peut atteindre dépend, non du degré de développement dont il est susceptible par sa propre nature, mais de celui que sa position géographique lui permet de recevoir [49] . »
§ 3. Je ne sais si je suis dans l'erreur, mais je crois que M. Comte, dans la suite de propositions que je viens de citer, et qui sont comme le résumé de ses idées sur influence des causes externes, [I-103] accorde à ces causes beaucoup trop de pouvoir. J'ajoute que Cabanis me paraît en avoir encore plus exagéré la puissance.
§ 4. Comment admettre d'abord avec Cabanis que les différens êtres reçoivent des circonstances physiques qui les entourent, leur caractère et leur physionomie? Nul être n'aurait donc de caractère qui lui fût propre ! Tout porterait une physionomie d'emprunt ! Les choses ne ressembleraient pas à ce qu'elles sont réellement, mais à ce que les objets extérieurs les feraient paraître ! Je ne sais pas s'il est parfaitement conforme à la raison d'ôter ainsi à chaque chose la figure qui lui est particulière pour lui en composer une des traits de tous les objets dont elle est environnée. Il me semble que tout être créé à sa propre nature, qui se maintient identique partout où il peut exister. Un chêne, un peuplier, un bouleau, conserveront, en quelque Heu qu'on les transplante, la forme, le port, le feuillage particulier à l'espèce à laquelle chacun de ces arbres appartient. Ils pourront bien ne pas prospérer au même degré dans tous les terrains et sous toutes les latitudes, mais partout où ils pourront vivre, ils conserveront les traits caractéristiques de leur espèce, et l'on ne verra certainement pas leur figure varier comme la nature des lieux. Or, ce que je dis des plantes, on peut le [I-104] dire à plus forte raison des animaux, et à plus forte raison encore des hommes. Les hommes, non plus que les animaux, non plus que les plantes, ne prospèrent pas au même degré partout; mais partout où un peuple peut vivre il conserve invariablement les traits particuliers à sa race.
§ 5. S'il ne paraît pas possible de dire avec Cabanis que le caractère et la physionomie des différens êtres, sont déterminés par l'influence des objets extérieurs, je ne crois pas qu'on puisse admettre davantage avec M. Comte que le développement d'un peuple dépend de la bonté de sa position géographique, et non du plus ou moins de perfection naturelle de ses facultés.
Sans doute il est telle position où la race la mieux organisée ne saurait apprendre à faire usage de ses organes. Placez les hommes les plus heureusement doués au sein d'une nature immuable, sur une roche aride et dépouillée, au milieu d'un océan sans rivages, mettez-les dans une position où il leur soit impossible de vivre, et il est clair qu'ils ne pourront exercer aucun des arts qui ont pour objet de conserver, d'embellir ou d'honorer la vie
Mais, de ce que la race la mieux faite a besoin, pour se développer, de se trouver dans une position où les progrès lui soient possibles, s'ensuit-il [I-105] que les progrès dont un peuple est susceptible dépendent uniquement ou même principalement de la nature des lieux où il se trouve établi?
Si la civilisation des peuples dépendait, avant tout, de leur position géographique, ceux qui occuperaient les meilleures places sur cette planète devraient être, par cela même, les plus civilisés. Il faudrait graduer l'échelle de la civilisation d'après la position et la nature des territoires, et l'on verrait le degré de culture correspondre exactement, par toute la terre, à l'avantage des situations.
Pense-t-on qu'en fait il en soit ainsi ? c'est la première chose que je demande. Je crois bien que, dans les divers quartiers du globe, les portions de terre les plus favorables à la vie des hommes, sont celles où les hommes ont dû commencer d'abord à se développer. Mais trouve-t-on que les progrès ont été partout dans la même proportion que les avantages physiques; et peut-on dire, à considérer la sphère terrestre d'une manière générale, que la civilisation s'est répandue dans le monde ainsi que l'ordonnait la nature des lieux? Est-il possible de prétendre que les régions de la terre les plus favorisées de la nature sont aussi celles où la civilisation a été le plus loin ?
Je conviens sans peine que lorsque les Européens découvrirent l'Amérique, ils trouvèrent, [I-106] dans cet immense continent, les peuples du centre plus avancés que ceux des extrémitées. Mais quoiqu'il y eût, sans contredit, moins de culture au Groenland qu'au Mexique, et dans la Terre-de-Feu qu'au Pérou, il y en avait certainement moins au Mexique et au Pérou qu'il n'y en avait eu anciennement, et qu'il n'y en avait de nouveau alors en Europe. Est-ce donc que les Européens s'étaient trouvés, sous le rapport des circonstances locales, dans une meilleure situation que les peuples indigènes du Mexique et du Pérou ? Il serait difficile de le prétendre. Quels sont les pays de l'Europe qui, sous le rapport des avantages physiques, peuvent soutenir la moindre comparaison avec les contrées du Nouveau-Monde que je viens de nommer, surtout avec le Mexique ? Où trouverait-on, dans notre quartier du globe, une contrée qui ait pu offrir originairement à ses habitans, des ressources plus variées, des mines plus riches, un sol plus fécond et plus propre à toute espèce de culture, un plus grand nombre de produits indigènes pouvant servir à l'exercice des arts et à la subsistance des hommes, un air plus doux et plus sain [50] ? Il est vrai que l'Europe, par ses contrées les plus [I-107] méridionales, avait pu communiquer de bonne heure avec l'Égypte, que l'Égypte avait eu des communications avec l'Inde, et que l'Inde est un des plus riches pays du monde, et des plus anciennement civilisés. Mais si la supériorité de la culture doit être décidée par celle des lieux, on ne voit pas trop pourquoi la civilisation n'aurait pas été aussi avancée au Mexique que dans l'Inde même; et puis il s'agit de savoir si, dans l'Inde, elle se trouve bien en rapport avec l'avantage des situations.
Si donc nous passons d'Amérique en Asie, j'accorderai encore que les peuples de cette partie du monde qui en habitent la portion la plus élevée, la plus froide, la plus stérile, sont moins avancés que ceux qui occupent les régions basses et les plus susceptibles d'être cultivées : je conviendrai que la civilisation a fait moins de progrès sur le plateau central que parmi les habitans de la Chine et de l'Inde. Mais on m'accordera sans doute aussi que la civilisation des Chinois et celle des Hindous, [I-108] quoique supérieure peut-être à celle qui s'était formée au Mexique, est encore très-inférieure à celle qui s'est développée parmi nous; qu'elle est loin d'être aussi éclairée, aussi forte, aussi savante, aussi correcte... J'ai donc à demander encore si les peuples d'Europe se sont trouvés, pour faire des progrès, dans une meilleure situation que ceux de la Chine et de l'Indostan? Si, par exemple, il est en Europe des contrées que la nature ait plus favorisées que l'Inde, qui soient arrosées par des fleuves plus larges et plus nombreux, où l'on respire un air en général plus salubre, où une terre plus fertile se couvre de productions plus variées, plus propres à la nourriture de l'homme et à l'exécution de toute sorte de travaux; où l'on puisse cultiver à la fois les arbres, les céréales, les fruits, les fleurs de la zone tempérée, et les productions qui croissent entre les tropiques; où les entrailles de la terre recèlent des trésors plus précieux; où le règne animal présente un plus grand nombre de variétés utiles; où la nature offre aux hommes plus de moyens de communiquer entre eux et de se mettre en rapport avec d'autres nations?... Je ne crois pas qu'il soit possible de faire une réponse affirmative.
Voulons-nous nous transporter dans une autre partie du monde, et comparer à la situation des peuples de notre race, celle des peuples d'espèce [I-109] malaie? Avec quel immense avantage ne pourra-t-on pas opposer au continent d'Europe ces innombrables archipels de la mer du Sud, ces labyrinthes d'îles dont les voyageurs nous ont donné des descriptions si ravissantes, où l'air est si pur et si doux, la nature si riante et si féconde; où les peuples, unis plutôt que séparés par l'Océan au sein duquel ils sont répandus, et qui les embrasse tous, trouvent, dans des eaux qui ont mérité le nom de pacifiques, un moyen naturel si puissant de communiquer entre eux ?... Et pourtant quelle comparaison sera-t-il possible d'établir entre la civilisation de ces peuples, si heureusement situés, et celle des peuples de notre race, qui se sont trouvés originairement dans des circonstances physiques comparativement si désavantageuses?
On trouve donc, en rapprochant successivement de l'Europe les plus belles régions de la terre, et en comparant la civilisation de ces pays à celle qui a crû parmi nous, la preuve constante que la civilisation ne s'est pas répandue dans le monde en raison de l'avantage des situations. Il se peut bien, je le répète, que, dans chaque quartier du globe, la race à qui ce quartier était affecté ait fait ses premiers progrès dans les lieux où la vie était le plus facile, où les arts destinés à la soutenir avaient le plus de moyens de s'exercer; mais il paraît impossible de dire, d'une manière générale, [I-110] que les avantages physiques ont décidé de l'étendue des développemens, et que les régions qui réunissaient le plus d'avantages, sont celles où l'espèce s'est le plus perfectionnée. Les Otaïtiens de race brune n'ont pas fait, et surtout n'avaient pas fait, il y a quatre siècles, autant de progrès qu'en avaient fait les Mexicains de race cuivrée, quoique ces peuples-ci ne se trouvassent pas, géographiquement, dans une situation plus avantageuse. Les Mexicains d'espèce américaine n'avaient pas fait autant de progrès que les Chinois de race mongole, quoiqu'il ne semble pas que ces derniers peuples fussent dans une meilleure situation géographique que les Mexicains. Aucun de ces peuples enfin n'avait fait des progrès comparables à ceux de la plupart des nations d'Europe, quoique l'avantage des circonstances locales n'ait certainement pas été du côté des Européens. Il suffit de comparer ce qu'il y a de développemens acquis dans notre quartier du globe, que la nature a traité avec tant de parcimonie et de mauvaise grace, avec ce qu'on trouve de culture dans d'autres parties du monde, qu'elle a comblées de ses plus riches dons, pour être forcé de reconnaître que l'influence de la race a prévalu sur celle des lieux, et que le génie de l'homme a plus fait pour les progrès de la civilisation, que les circonstances physiques les plus favorables.
[I-111]
§ 6. S'il est difficile de dire, en général, que les lieux les plus favorisés de la nature sont ceux où l'espèce a fait le plus de progrès, peut-on soutenir, en particulier, qu'elle s'est surtout développée dans les régions très-chaudes et très-fertiles?
Montesquieu, dans les portions de son principal ouvrage où il traite du sujet qui nous occupe en ce moment, a paru regarder l'élévation de la température et la fertilité du sol, comme contraires, en général, au perfectionnement physique et moral de l'espèce; de sorte que si l'on voulait déterminer l'influence de ces deux causes d'après ses principes, il faudrait, ce semble, faire un tableau dans lequel on verrait la civilisation décroître à mesure qu'on s'éloignerait des pôles, et qu'on descendrait vers les régions de la terre où la température est la plus élevée et la végétation plus vigoureuse.
M. Comte a fort longuement combattu sur ce point la manière de voir de l'auteur de l'Esprit des Lois; et, se conformant aux idées plus justes que les progrès de l'histoire naturelle et de la géographie permettent de concevoir de la manière dont la vie s'est répandue sur notre planète, il a présenté au lecteur, dans une suite de chapitres, un tableau dans lequel les formes sous lesquelles la vie se manifeste, et les effets qu'elle [I-112] produit, au lieu d'aller en se dégradant, des régions polaires au centre du globe, s'affaiblissent et se détériorent, au contraire, à mesure qu'on s'éloigne du centre de la terre et qu'on s'élève vers les pôles.
Cette manière d'envisager la sphère terrestre et les lois suivant lesquelles la vie s'y est propagée, paraît conforme, à beaucoup d'égards, à l'exacte observation des choses. Il paraît certain que le règne végétal, à mesure qu'on s'éloigne des régions centrales de la terre, perd graduellement de sa force et de ses proportions [51] . Il paraît également vrai que la stature des animaux diminue à mesure que l'on avance vers les pôles. Enfin, il est peut-être possible de soutenir, malgré les exceptions assez nombreuses qu'on pourrait citer à cet égard, que les hommes eux-mêmes sont plus grands entre les tropiques que dans la zone tempérée, et surtout vers les cercles polaires[52] .
Mais la vie morale observe-t-elle ici les mêmes [I-113] lois que la vie physique, et peut-on dire qu'elle perd aussi de sa force à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur? Je ne dirai sûrement pas que la civilisation nous est venue des régions polaires; je ne pense pas même qu'on pût, avec justice, accuser Montesquieu d'avoir eu une telle idée. Mais faudra-t-il adopter la proposition inverse; et dirons-nous, avec M. Comte, qu'elle s'est particulièrement développée dans la zone torride, et que c'est de là qu'elle s'est répandue dans les zones tempérées? Je ne sais pas si cette proposition, est plus conforme à la vérité que ne le serait la première. La Chine, l'Inde, l'Égypte, la Grèce, le Mexique, le Pérou voilà les lieux qu'on signale communément comme de premiers foyers de civilisation. Or, de tous ces lieux, il n'y a réellement que l'Inde qui soit sous une température torride. La Chine est en dehors des tropiques ; le centre de l'Égypte est sous le trentième parallèle; celui de la Grèce sous le trente-septième. Si le Mexique et le Pérou se trouvent, en grande partie, dans les régions équatoréales, l'influence de la latitude est ici fortement contre-balancée par l'élévation du sol. Les deux tiers du Mexique, élevés, sous la forme d'un immense plateau, à une hauteur de deux mille à deux mille cinq cents mètres au-dessus du niveau de la mer, jouissent d'un climat plutôt froid ou [I-114] tempéré que brûlant [53] ; et si la civilisation, pour se développer, a besoin d'une haute température, il semble que, dans le Nouveau-Monde, ce n'est pas sur le plateau du Mexique qu'elle aurait dû faire ses plus grands progrès. Il semble aussi que, dans l'ancien continent, ce n'est pas en Chine, en Égypte, en Grèce, qu'elle aurait dû naître ; puisque ces pays sont tous dans la moyenne région du globe, et que la chaleur y est, et surtout y dut être d'abord assez modérée [54] . Faut-il donc admettre que la civilisation a eu son premier foyer dans l'Inde, et que c'est de là que tout est venu ? Mais comment le prouver; comment établir, par exemple, que la civilisation de l'Europe moderne est un produit d'origine asiatique? Quels traits de ressemblance ou quel air de famille pourrait-on apercevoir entre notre civilisation et celle des Indiens? Pourquoi vouloir d'ailleurs que toutes les civilisations soient sorties d'une seule? Pourquoi n'y aurait-il qu'un peuple au monde dont les progrès auraient été spontanés?
«Il ne faut pas, dit, à ce [I-115] sujet, un écrivain très-instruit, chercher en Asie ni Éthiopie des origines obscures qui font négliger des faits certains et à notre portée. Il y a eu en Europe, notamment parmi les Turdetains, parmi les Celtes, parmi les Scandinaves, parmi les Étrusques, des foyers de civilisation contemporains de la civilisation primitive des Hellènes » [55] .
Si donc on ne pourrait pas soutenir raisonnablement que la civilisation est descendue des pôles, on ne peut pas admettre davantage qu'elle est venue de l'équateur.
§ 7. Non-seulement l'espèce humaine ne s'est pas développée de préférence dans la zone torride, mais la partie chaude de la zone tempérée ne paraît pas être celle où elle a fait les plus grands progrès. La civilisation avait été moins parfaite en Égypte, sous le trentième degré de latitude, qu'elle ne le fut ensuite en Grèce sous le trente-septième. Elle le fut peut-être moins en Grèce qu'elle ne l'a été plus tard en Italie, à quelques degrés plus au nord. Elle n'a jamais été en Italie, si ce n'est sous le rapport des beaux-arts, aussi avancée qu'elle l'est maintenant dans d'autres contrées plus septentrionales de l'Europe. Qui pourrait nier que la civilisation de la France, de l'Angleterre, de [I-116] l'Allemagne, des Pays-Bas, ne soit en général plus développée que ne l'est la civilisation présente, et que ne l'a été la civilisation passée du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique ? Bien loin donc de dégénérer en s'éloignant des tropiques, il paraît certain, au moins jusqu'ici, qu'elle a acquis plus de perfection.
M. Comte paraît vouloir attribuer ces progrès des dernières contrées que je viens de nommer, à une révolution survenue dans leur température. Du temps de Julien et de César, observe-t-il, la Gaule voyait, chaque hiver, tous ses fleuves se glacer au point de pouvoir, pendant plusieurs mois, servir de ponts et de routes. Peu à peu, ajoute-t-il, ces cas devinrent plus rares, et le climat s'étant adouci, il fut possible d'introduire dans le nord des cultures du midi qui exercèrent la plus heureuse influence sur les arts et bientôt sur la vie des hommes.
Mais, cette révolution dans la température, qu'est-ce qui prouve qu'elle avait devancé les efforts des populations; et pourquoi, au lieu de faire honneur au climat des progrès de l'homme, ne pas attribuer à l'homme les changemens heureux survenus dans le climat? Il est très-probable que cette révolution que la température a subie en Europe, et les changemens non moins remarquables qu'elle éprouve graduellement dans l'Amérique du nord, sont la conséquence des modifications[I-117] successives que la main des hommes a fait subir au sol, du dessèchement des marais, du défrichement des forêts, de tous les travaux qui ont eu pour objet ou pour effet de faciliter le prompt écoulement des eaux, et, en diminuant ainsi l'évaporation, de détruire par degrés l'une des principales causes du refroidissement de l'atmosphère.
Bien loin donc qu'on doive attribuer à l'adoucissement de la température les progrès qu'ont faits les peuples de la région moyenne de l'Europe, il semble qu'un de leurs principaux mérites est d'avoir forcé leur climat à s'adoucir, et de l'avoir plié par des degrés à une multitude de cultures que sa nature semblait repousser. C'est malgré l'extrême désavantage de leur position qu'ils ont devancé les peuples du midi, dont l'éducation avait commencé bien avant la leur, et dans des circonstances infiniment plus favorables.
§ 8. En somme, il se peut bien que les pays les plus chauds et les plus fertiles soient ceux où la civilisation a pris naissance; mais ils ne sont pas ceux où elle a le plus grandi. Je conçois que l'homme ait d'abord cherché à se fixer dans les lieux les plus favorables à sa faiblesse, à son inexpérience, à sa paresse, là où la vie était la plus aisée, là où il y avait le moins d'efforts à faire; mais les lieux où il y avait le moins à faire, ne [I-118] sont certainement pas ceux où il a le plus fait. Il n'y a rien de déraisonnable à supposer que l'état imparfait où demeure l'industrie des peuples qui habitent les îles de l'Océan pacifique, est dû en partie au soin que la nature a pris elle-même de pourvoir aux besoins de ces peuples, et de leur rendre la vie douce et aisée. Un géographe non moins judicieux qu'érudit, Malte-Brun, regarde l'extrême fertilité de certains territoires en Asie, comme ayant presque autant nui aux progrès des hommes que l'extrême stérilité de quelques autres.
« La vie nomade, dit-il, est prescrite par la nature elle-même, à beaucoup de nations asiatiques; mais dans d'autres régions de l'Asie, la fertilité uniforme du sol et la douceur constante du climat, en récompensant trop rapidement le plus léger travail, ont étouffé, presque dès sa naissance, l'énergie de l'esprit humain qui, pour ne pas se ralentir, veut être stimulé par le besoin et les obstacles [56] . »
C'est en ce sens que Montesquieu dit que les terres ne sont pas toujours cultivées en raison de leur fertilité; qu'on voit quelquefois des déserts dans les pays les plus fertiles; que les hommes restent incultes là où la terre produit d'elle-même beaucoup de fruits propres à les nourrir; que pour devenir industrieux, sobres, actifs, courageux, ils [I-119] ont besoin que le sol leur refuse quelque chose et leur fasse acheter ses produits [57] . Enfin c'est dans le même sens que M. Comte lui-même voulant expliquer pourquoi les Caraïbes sont les plus imprévoyans des sauvages, dit que la nature de la terre et des eaux sur lesquelles ils vivent, en leur assurant des provisions pour toute l'année, les dispense par cela même de prévoyance [58] . Or, si des circonstances trop favorables peuvent dispenser l'homme de prévoyance, pourquoi ne pourraient-elles pas le dispenser aussi d'activité, d'industrie, etc.?
Bien certainement donc les lieux où l'homme peut vivre avec le moins d'efforts, né sont pas ceux où il fait les progrès les plus considérables. Il est sensible que sous un ciel accablant, que sur un sol qui se couvre spontanément de produits propres à sa nourriture, sa paresse doit être doublement favorisée, et qu'il ne peut avoir ni le même ressort pour agir, ni le même intérêt à se donner de la peine. Diminuez le nombre de nos besoins, et vous réduisez, par cela même, celui de nos facultés. Qù l'on est déjà vêtu par le climat, il y a moins à s'évertuer pour trouver les moyens de se vêtir. Où l'on n'a pas d'hiver à craindre, il n'y a pas, non plus, de précautions [I-120] à prendre contre le froid. Il est assez connu qu'on se chauffe mieux en Russie qu'en Italie ou en Espagne. Les maisons sont mieux construites et de plus belle pierre en Hollande, où le sol ne renferme pas un caillou, qu'en France, où le pays est plein de carrières. C'est dans les pays très-favorisés de la nature que viennent les fruits les plus doux, et dans les contrées moins heureuses qu'ils sont cultivés avec le plus de soin. Le marquis de Caraccioli ne dirait plus que les pom-. mes cuites sont le seul fruit qui mûrisse en Angleterre. Le soleil de ce pays, auquel il reprochait de n'être pas plus chaud que la lune de Naples, a maintenant le pouvoir de colorer et de mûrir des fruits, non pas sans doute aussi savoureux, mais plus beaux peut-être que ceux d'Italie [59] .
On peut poser en principe que l'industrie des hommes est moins stimulée la facilité que par la difficulté de vivre. La nécessité est notre plus pressant aiguillon ; et des obstacles, pourvu qu'ils ne soient pas invincibles, peuvent être regardés, jusqu'à un certain point, comme une circonstance favorable à notre développement. Lorsque, pour trouver les moyens de satisfaire leurs besoins les plus immédiats, des hommes ont été obligés [I-121] de tendre fortement toutes leurs facultés, leur intelligence éveillée sur un point se porte ensuite plus facilement sur d'autres objets, et, de proche en proche, ils arrivent à des perfectionnemens que ne soupçonnent même pas les hommes qui, dès leur entrée dans la vie, en ont connu les jouissances.
Voilà ce qui explique, au moins en partie, comment des peuples placés dans des circonstances comparativement peu favorables, ont été plus loin que d'autres peuples très-avantageusement situés; comment des pays pour qui la nature avait tout fait, ont moins prospéré que d'autres contrées où l'homme avait, pour ainsi dire, tout à faire. Les deux plus belles et plus fertiles provinces de la Chine, sont les provinces de Kiang-Nan, qui ont été tirées de dessous les eaux. Deux des plus riches contrées de l'Europe, ce sont les Pays-Bas et la Hollande, qui n'étaient originairement que des marais. On sait quelle puissance les Vénitiens étaient parvenus à fonder dans les lagunes de l'Adriatique. L'Europe entière, au rapport des historiens et des géographes, ne fut d'abord qu'une région indigente et rude, que la nature n'avait ornée que de forêts, n'avait enrichie que de fer. Il n'y avait ni or dans nos mines, ni diamans parmi nos cailloux. Nous ne pouvons nommer que quinze à vingt espèces de quadrupèdes qui nous appartiennent exclusivement; et encore sont-ce de petits [I-122] animaux de peu d'apparence, tels que des rats et des chauves-souris [60] . Nos races animales et végétales les plus précieuses paraissent être, en grande partie, des produits d'origine étrangère. Nous n'avions ni le cheval, ni le boeuf, ni l'âne ni le mouton, Le ver à soie est natif de l'Inde. Le noyer croissait en Perse, ainsi que le pêcher; l'oranger à la Chine, l'olivier en Syrie, la vigne aux bords de la mer Caspienne, l'orge et le froment en Tartarie, la patate en Amérique [61] . Quelle prodigieuse métamorphose n'avons-nous pas fait subir à cette région, que la nature avait si cruellement disgraciée!
« La science chercherait en vain maintenant à distinguer les bienfaits de l'art des produits indigènes; la culture a changé jusqu'au climat ; la navigation a apporté les végétaux de toutes les zones; cette Europe, où le castor bâtissait en paix ses digues et ses cabanes au bord des fleuves solitaires, s'est peuplée d'empires puissans, s'est [I-123] couverte de moissons et de palais ; cette médiocre péninsule est devenue la métropole du genre humain et la législatrice de l'univers. L'Europe est présente dans toutes les parties du monde; un continent entier n'est peuplé que de nos colonies; la barbarie, les déserts, les feux du soleil ne soustrairont pas long-temps l'Afrique à nos actives entreprises; l'Océanie semble appeler nos arts et nos lois; l'énorme masse de l'Asie est presque traversée par nos conquêtes; bientôt l'Inde britannique et la Russie asiatique se toucheront, et l'immense, mais faible empire de la Chine, ne résistera pas à notre influence, s'il échappe à nos armes. L'Océan tout entier est le domaine exclusif des Européens ou des colons d'Europe: tandis que même les nations les plus policées des autres parties du monde n'osent s'éloigner de leurs rivages, nos hardis navigateurs suivent, d'un pôle à l'autre, la route que, du fond de leur cabinet, leur ont tracée nos géographes. Seuls, nous soumettons à notre volonté les forces de la nature même les plus redoutables. La foudre du ciel tombe enchaînée aux pieds de nos savans. Nous avons tenté, non sans succès, la conquête de l'atmosphère : nous pouvons nous élever avec sûreté au-dessus des nuages, et peut-être découvrirons-nous les moyens de nous diriger dans les régions de l'air, comme nous avons trouvé celui de nous conduire au sein [I-124] des mers les plus vastes. L'arbre de la science a crû sur notre terre, d'abord si âpre et si sauvage, plus que dans les lieux du monde que la nature avait le plus comblé de ses faveurs [62] . »
A la vérité ces progrès si surprenans de l'Europe doivent être, en grande partie, attribués au génie particulier de la race d'hommes qui l'habite; mais peut-être cette race elle-même, si une tâche moins forte lui avait été imposée, si elle était née sur une terre plus féconde et sous un ciel plus doux, se serait-elle beaucoup moins illustrée par ses œuvres.
§ 9. Du reste l'élévation de la température et la fertilité du sol ne sont pas, à beaucoup près, les seules circonstances extérieures qui influent sur notre développement. A vrai dire, tout ce qui entre dans la constitution physique d'un pays: la nature de l'air et celle des vents qui y règnent; la qualité, le volume et la direction des eaux; la configuration du sol; sa nature et celle de ses productions de toute sorte, sont autant de circonstances qui peuvent agir plus ou moins sur nous, solliciter dans un sens ou dans un autre l'action de nos facultés, et influer à la fois sur le caractère des arts que nous exercerons, et sur les progrès que nous parviendrons à y faire.
[I-125]
Il n'est pas possible, on le sent aisément, qu'un peuple soit inspiré de la même manière dans toutes les positions; que toutes les localités le portent à faire le même usage de ses forces; qu'il agisse pour se procurer des alimens, par exemple, de la même façon au bord d'une rivière ou d'une mer poissonneuse, qu'il le ferait au milieu d'un pays giboyeux ou au sein d'un désert qui n'offrirait de ressources que pour le pâturage. Il est dans les arts que les hommes exercent, comme dans les usages qu'ils observent ou dans les pratiques auxquelles ils se livrent, une multitude de différences qui n'ont pu être inspirées que par la diversité des lieux. Toutes les différences ne sont pas venues de celles-là; mais celles-là en ont certainement entraîné beaucoup d'autres.
Partout l'homme a cherché, quoique avec des degrés très-divers d'intelligence, d'activité, de courage, de persistance, et par suite avec des succès très-divers aussi, à tirer parti de sa position locale, à profiter des avantages et à paralyser les inconvéniens qu'elle présentait. Ici on a cultivé la vigne; là les céréales; ailleurs on a dû se livrer de préférence à l'éducation des bestiaux. Tel peuple vit de la pêche; tel autre des produits de la chasse. Les nations méridionales de l'Asie cultivent le riz et le maïs; celles de la zone froide le millet et l'orge. Le défaut de bois de construction oblige [I-126] l'habitant du plateau central à se loger dans des tentes couvertes de peaux ou d'étoffes, provenant les unes et les autres de ses troupeaux; l'Indien, au contraire, qui est riche en bois et surtout en bois de palmier, s'est logé dans de légères maisonnettes, telles que lui conseillaient de les faire sa paresse naturelle et la douceur de son climat, etc., etc.
Le caractère des usages ne s'est pas moins ressenti que celui des travaux de la position locale des populations. Voltaire observe fort sensément que le même législateur qui était sûr de se faire obéir avec joie en ordonnant aux Indiens de se baigner dans le Gange, à certains temps de la lune, se serait fait lapider s'il avait voulu prescrire l'usage du bain aux peuples des bords de la Dwina. Il ajoute que Mahomet, qui avait interdit l'usage du vin en Arabie, où l'on a besoin de boissons rafraîchissantes, ne l'aurait peut-être pas défendu en Suisse, surtout avant d'aller au combat. Il dit encore que certaines libations de vin pouvaient être prescrites dans les pays de vignoble, qu'aucun législateur n'aurait imaginé d'ordonner là où l'on n'aurait pas connu le vin [63] . Il est possible qu'on ait quelquefois cédé légèrement, inconsidérément aux indications de la nature; mais il est [I-127] certain que beaucoup de pratiques et d'habitudes ont été déterminées par ces indications.
Si la nature des lieux a influé sur la direction que nous avons donnée à l'usage de nos forces, elle n'a pas eu moins d'influence sur leurs progrès. Non-seulement on ne peut pas se livrer partout aux mêmes travaux, mais les mêmes travaux ne peuvent pas s'exercer partout avec la même puissance. Il n'est pas une industrie, surtout dans la classe de celles qui agissent sur le monde matériel, qui ne trouve dans la constitution physique des pays où il est possible de l'exercer des circonstances locales plus ou moins favorables à son exercice. Tout pays ne possède pas des mines également riches et également faciles à exploiter. On ne voit pas partout des terres, également fertiles, se prêter à des cultures également précieuses et également variées. Le travail de la végétation, puissamment secondé, en certains lieux, par l'état habituel du ciel, peut être ailleurs fréquemment interrompu ou contrarié par la même cause. Un pays est plus ou moins bien arrosé. Les rivières qui le traversent offrent à la navigation des voies plus ou moins commodes. Ses fleuves débouchent dans des mers plus ou moins fréquentées et entourées de peuples plus ou moins riches. Les côtes qu'il présente à ces mers ont plus ou moins d'étendue; elles sont plus ou moins accessibles et plus ou moins [I-128] bien découpées. Tout cela est incontestable ; et il est incontestable aussi que, de, ces circonstances, il doit résulter plus ou moins de facilité pour l'exécution d'un grand nombre de travaux.
Si les circonstances locales ont le pouvoir de décider, jusqu'à un certain point, du progrès des arts, elles ne sont pas sans influence non plus sur le perfectionnement des sciences, des mœurs, des relations sociales. On sait l'étroite liaison qu'il y a entre toutes ces choses. Où l'industrie ne saurait se développer, on n'a pas le même intérêt à cultiver les connaissances que son exercice réclame; on n'a pas non plus les mêmes moyens de les cultiver. Où manquent les lumières et le bien-être, il est rare que les mœurs se distinguent par beaucoup de délicatesse et de pureté, et que les relations sociales soient très-sûres et très-douces. Placez un peuple dans un pays qui ne soit absolument propre qu'au pâturage, et il sera bien difficile que son industrie, ses connaissances, ses mœurs, ses relations avec d'autres peuples, et les relations de ses membres entre eux, soient autres que celles qu'on remarque chez la plupart des peuples nomades. Je laisse au lecteur le soin d'examiner s'il est possible que l'intelligence, les affections, les habitudes de l'Arabe bédouin ou du Tartare ne tirent pas une partie de leur caractère de la situation particulière où ces peuples sont placés.
[I-129]
On peut donc dire qu'il n'est aucun ordre de développemens qui ne dépende, dans une certaine mesure, de l'action que le monde matériel exerce sur nous, et que, par conséquent, les circonstances extérieures ont une influence très-réelle sur la liberté.
§ 10. Cependant il est essentiel d'observer que le pouvoir de ces circonstances peut être modifié par beaucoup de causes.
Premièrement, il n'agit pas au même point sur toutes les races. Tout peuple ne se montre pas également habile à tirer parti des circonstances favorables et à se dérober à l'action des causes nuisibles. Il est possible qu'un peuple, très-convenablement posé, laisse perdre, par inaptitude, par négligence, par paresse, les avantages d'une bonne situation. Il est possible qu'un peuple entouré de circonstances peu favorables, compense, à force d'industrie et d'activité, les désavantages d'une mauvaise place. Il y a assez d'exemples de l'une et l'autre de ces choses, et je ne reviens pas sur un sujet qui nous a déjà beaucoup arrêtés.
Secondement, l'influence des circonstances locales n'est pas la même à tous les degrés de civilisation. A mesure que la société devient plus puissante, le pouvoir des circonstances favorables [I-130] augmente, et celui des causes adverses diminue [64] . Plus un peuple est avancé, et plus il est en état de profiter des avantages que sa position présente; plus il est avancé, et moins il est dominé par les inconvéniens de sa situation. Des Européens établis dans quelques-unes des plus belles îles de la mer du Sud, ne se contenteraient probablement pas de la vie qu'y mènent les indigènes: aux délices du climat ils voudraient joindre les plaisirs de la civilisation, et ils sauraient faire sortir des ressources naturelles de ces lieux favorisés, des moyens de bien-être bien supérieurs à ceux qu'en tirent les peuples encore barbares de ces îles. Les naturels de la Nouvelle-Galle méridionale, quand ils n'éprouveraient, sous le rapport de la race, aucune infériorité, seraient beaucoup plus influencés par ce que peut offrir de fâcheux la nature des lieux qu'ils habitent, que ne doivent l'être des Anglais, qui se sont établis dans ces lieux avec tous les moyens d'action que l'homme a acquis en Europe. La nature la plus rebelle finit toujours par accorder [I-131] quelque chose aux efforts industrieux et patiens de l'homme civilisé. Aussi serait-il peu sage d'affirmer que telle contrée encore déserte doit demeurer à jamais inhabitée. Qui sait jusqu'où est destinée à s'étendre la culture, à mesure que se multiplieront les hommes et que s'accroîtra la masse de leurs moyens? Cabanis observe avec raison que le climat n'agit pas de la même façon sur le riche et sur le pauvre [65] . Un homme riche peut se faire un climat à sa guise partout. Il n'y a pour ainsi dire pas d'hiver à Saint-Pétersbourg pour un grand seigneur russe dont l'hôtel est parfaitement échauffé, et qui ne sort qu'enveloppé d'épaisses fourrures. Un lord anglais voit mûrir dans ses serres les fruits des tropiques, et il y cueille des raisins aussi doux que ceux de la France et de l'Italie.
Une troisième remarque à faire c'est que les mêmes causes externes peuvent être alternativement favorables ou contraires suivant les circonstances. Par exemple, la douceur du climat et la fertilité du sol pourraient très-bien ne pas produire le même effet moral sur un peuple lorsqu'il est très en arrière et lorsqu'il est très-avancé. Nous avons vu que ces circonstances contribuaient à entretenir la paresse de l'homme encore inculte, dont les [I-132] besoins sont très-bornés; et peut-être ne feraient-elles qu'imprimer un nouveau degré d'activité à l'industrie de l'homme civilisé dont les besoins croissent sans cesse, et qui aspire à tirer de la position où il se trouve tout ce qu'elle peut donner. - C'est une circonstance très-favorable aux progrès d'un pays que d'être extrêmement accessible, et de pouvoir se mettre aisément en communication avec un grand nombre d'autres contrées; cependant il ne faudrait qu'une chose pour que cette circonstance si favorable pût lui devenir excessivement funeste, ce serait qu'il se trouvât entouré de nations barbares qui aspireraient à l'envahir et à le subjuguer : mieux vaudrait peut-être alors qu'il fût bordé de rochers et de précipices, et qu'on ne pût arriver jusqu'à lui de pas un côté. — Les montagnes, qui ont l'inconvénient de gêner beaucoup les communications du commerce, ont, par contre-coup, l'avantage d'arrêter la marche des conquérans et de protéger quelquefois la liberté des peuples. Supposez l'Europe paisible, active, prospère, raisonnablement gouvernée, et il y aura pour les États-Unis un désavantage réel à se trouver si éloignés d'elle: supposez, au contraire, la sainte-alliance reformée, la liberté vaincue, la contre- révolution triomphante, et ce sera alors pour les Anglo-Américains un circonstance heureuse que d'être séparés par quinze ou dix-huit [I-133] cents lieues de mer d'un tel foyer de tyrannie, de désordre et d'obscurantisme.
Enfin, une quatrième et dernière observation, c'est que la chose la plus essentielle pour un peuple n'est peut-être pas tant de se trouver entouré d'un grand concours de circonstances favorables, que de bien connaître sa situation, et de savoir diriger ses facultés de manière à tirer le plus grand parti possible des avantages qu'il possède. Un seul avantage, habilement exploité, suffit quelquefois pour faire la fortune d'un peuple. Les Danois, pendant un temps, trouvèrent dans la simple pêche du hareng la source d'une opulence et d'un luxe que n'avaient pas encore connus les peuples du nord. « Habillés autrefois comme de simples matelots, les Danois, dit Arnold de Lubeck, sont aujourd'hui vêtus d'écarlate et de pourpre. Ils regorgent des richesses que leur procure chaque année la pêche du hareng sur les côtes de Scanie [66] . » — La même industrie, en apparence si vulgaire et si bornée, fut la première source où les Hollandais puisèrent leur richesse et leur force. Telle était l'extension que cette pêche avait prise parmi eux, vers la fin du dix-septième siècle, qu'ils y employaient, selon Jean de Witt, plus de mille [I-134] bâtimens de vingt à trente tonneaux de charge [67] . En général, le principal et presque le seul avantage que les Hollandais trouvassent dans leur situation géographique était de pouvoir se livrer aisément à la navigation: mais ils surent tirer si habilement parti de cette circonstance, que, pendant un siècle et demi, ils furent les colporteurs et les agens commerciaux à peu près exclusifs de toute l'Europe. L'Angleterre ne jouit ni d'un ciel bien brillant, ni d'une température bien chaude; les productions naturelles de son sol ne sont ni des plus riches ni des plus variées : mais ce pays a été si heureusement constitué pour l'exercice de certaines industries; il offre à l'agriculture, à la fabrication, au commerce un petit nombre d'agens naturels si puissans, de circonstances locales si particulièrement favorables, que ces avantages, en apparence assez bornés, mis à profit par un peuple intelligent, laborieux, et doué surtout d'un grand esprit de suite dans ses affaires, ont suffi pour développer sur le sol que ce peuple habite, plus de richesse et de puissance que le monde n'en a jamais vu ailleurs sur un espace de terre aussi étroit [68] . [I-135] —Mieux vaut donc, sans contredit, ne posséder qu'un petit nombre d'avantages dont on sait bien profiter, que de se trouver au milieu d'une multitude de ressources qu'on n'aurait pas l'esprit de faire valoir, et de moyens de prospérité qu'on laisserait perdre.
Cependant si un peuple était doué de facultés assez souples et assez actives pour exceller à la fois dans un grand nombre d'arts, ou bien si ses facultés devaient s'étendre à mesure qu'un champ plus vaste s'ouvrirait à leur action, il n'est pas douteux qu'il n'y eût profit pour lui à se trouver entouré d'une nombreuse réunion de circonstances favorables. Il est clair qu'à égalité proportionnelle de talens et d'émulation, le peuple qui possède le plus d'avantages doit être aussi celui qui fait le plus de progrès; de même qu'à égalité de force naturelle et de perfection dans les organes, l'arbre qui se trouve placé dans le milieu le plus favorable au travail de [I-136] la végétation, est celui qui pousse les jets les plus vigoureux et qui développe les rameaux les plus vastes. Sûrement il y a peu d'avantage à être chargé d'une tâche supérieure à ses forces, à posséder plus de ressources qu'on n'est en état d'en mettre à profit; mais lorsque les facultés de deux peuples sont également capables de suffire à tous les travaux, de se proportionner à toutes les tâches, il est évident que celui qui a le plus de mines à exploiter, que celui à qui sa position offre le plus de sources de richesse est aussi celui qui peut devenir le plus riche et le plus puissant.
§ 11. Concluons donc que si, pour devenir libre, le premier intérêt d'un peuple est d'être doué de facultés droites, fortes, actives, ardentes, perfectibles, son besoin le plus immédiat après celui-là, est de se trouver dans une situation physique qui n'offre pas trop d'obstacles à l'application de ces facultés, ou plutôt dans une situation qui présente à leur développement le plus grand nombre possible de circonstances favorables.
[I-137]
CHAPITRE IV.
Influence de la culture sur la liberté.↩
§ 1. Les deux causes dont je viens de décrire les effets sont de nature à produire, entre les individus et les nations, les plus notables différences. Il est évident qu'un homme doué de peu de facultés, et placé dans des circonstances peu favorables à leur développement, ne saurait acquérir le même degré de puissance et de facilité d'action qu'un homme placé dans des circonstances plus heureuses, avec des facultés plus fortes, et qui voudrait profiter, autant qu'il serait en lui de le faire, de cette supériorité de position et de facultés.
§ 2. Cependant hâtons-nous de remarquer que, pour que le dernier conservât sa supériorité, il faudrait qu'il voulût en effet tirer parti de ses avantages; car si son concurrent était le seul à faire effort pour se développer, il n'est pas douteux que, malgré le désavantage de sa position et l'infériorité de ses facultés naturelles, il ne réussît bientôt à le surpasser. L'influence d'une meilleure organisation [I-138] et d'une situation plus heureuse peut être en effet singulièrement modifiée par celle de la culture. Si les deux premières causes tendent à produire de grandes inégalités, la dernière est peut-être de nature à en faire naître de plus sensibles encore. Si l'homme né avec des facultés plus puissantes conserve sa prééminence sur l'autre pour les choses auxquelles ils se sont également exercés, le dernier, malgré l'imperfection relative de ses organes, a plus d'avantage encore sur le premier pour les choses qu'il a seul apprises.
Ce que l'homme peut ajouter par la culture, non pas peut-être à ses organes eux-mêmes, mais au pouvoir de s'en servir, est immense: c'est là la vraie source de la liberté. Qui ne connaît la puissance de l'éducation! qui ne sait ce que peut la fréquente répétition des mêmes actes! qui n'a remarqué l'étendue et la variété des fonctions auxquelles l'homme parvient à plier ses facultés de toute espèce! et qui n'a été frappé mille fois en sa vie de l'extrême avantage qu'a pour faire une chose celui qui l'a apprise, sur celui qui ne s'y est point exercé! Est-il de races si imparfaites et si abruties qui ne se montrent infiniment supérieures aux races les mieux organisées et les plus savantes, pour les arts auxquels elles se sont formées et que celles-ci ignorent? Où sont les Européens qui, pour certains exercices de l'ouïe, de la vue, de l'odorat, de la [I-139] main ou de telle autre partie du corps, pourraient se mesurer avec les membres de certaines peuplades appartenant à ce qu'il y a de plus difforme et de moins cultivé dans les races de couleur? Qui de nous pourrait se flatter de voir, d'entendre, de flairer à d'aussi grandes distances que certains sauvages; de se diriger avec autant de sûreté à travers des forêts où nul chemin n'a été tracé; de suivre aussi exactement, sur un terrain qui n'a pu recevoir aucune empreinte, les pas de l'homme ou des animaux; de tirer de l'arc avec une aussi rare justesse; de nager, de plonger avec une aussi prodigieuse facilité? Est-ce que ces sauvages, d'ailleurs si grossiers, seraient, pour ces exercices, mieux organisés que nous?-Rien ne l'annonce. - Est-ce que leur position locale est plus favorable que la nôtre à la conservation des facultés de l'espèce? —Bien loin de là.
A quoi tient donc la singulière aisance avec laquelle ils exécutent de certains actes qui nous sont absolument impossibles, ou dans lesquels nous montrons une infériorité si marquée? A une seule cause: à celle qui fait que, parmi nous, certaines personnes exécutent en se jouant, et presque sans y songer, des choses que d'autres, avec toute l'application possible, ne parviendraient point à faire, ou ne feraient d'abord que très-imparfaitement: à l'éducation, à l'exercice, à la longue habitude que leur position et leur manière de vivre leur ont fait [I-140] contracter, dès l'enfance, d'exécuter ces actes qui excitent notre étonnement.
§ 3. Il n'est pas de mode d'existence dans lequel l'homme ne soit obligé de donner un certain développement à ses affections morales, de tirer quelque parti de ses facultés intellectuelles, de diriger dans un sens ou dans un autre l'action de ses forces physiques. Il faut partout quelque activité, quelque intelligence, quelque mesure dans la satisfaction de ses appétits, quelque respect pour la personne et la propriété des autres hommes. Il y a partout à examiner plus ou moins attentivement quel usage on va faire, pour sa conservation, des organes dont on est pourvu; et à former ces organes à de certains actes. Partant, il n'est pas de mode d'existence dans lequel l'homme n'acquière une certaine liberté.
Cependant, il faut convenir que, de toutes les manières de vivre, celle de l'homme civilisé est, sans la moindre comparaison, celle où l'espèce humaine peut parvenir à faire l'usage le plus facile et le plus étendu de ses forces. La liberté dont un peuple est susceptible dépend des progrès qu'il est capable de faire et que sa position lui permet de faire dans les arts de la civilisation; la liberté dont il jouit dépend des progrès qu'il y a déjà faits. Chacun, dans la mesure de sa capacité naturelle et des avantages que présente sa position géographique, est plus ou [I-141] moins libre, selon qu'il occupe dans l'échelle de la civilisation une place plus ou moins élevée.
§ 4. J'ai déjà énoncé cette vérité dans mon premier chapitre, et elle est si simple qu'elle ne devrait, à ce qu'il semble, souffrir aucune sorte de contradiction. Il en est peu cependant de plus contredite: on accuse la civilisation de ruiner les mœurs, d'avilir les caractères, de tendre à la dissolution de la société, que sais-je ?
Examinez un peu l'idée que la plupart des hommes se font de la marche de leur espèce, observée collectivement. On veut que les agrégations d'hommes, les sociétés, les nations aient, comme les individus, leur enfance, leur virilité, leur décrépitude; mais en même temps on croit que le progrès de l'âge produit sur elles des effets tout contraires à ceux qu'il opère sur les individus. On pense qu'il n'est donné qu'aux individus de devenir plus sages en prenant des années. Quant aux nations, on soutient qu'en vieillissant elles se dépravent, se gâtent; et, chose singulière! c'est, dit dans l'âge de la caducité qu'elles se laissent entraîner aux plus grands désordres: c'est alors qu'elles deviennent turbulentes, débauchées, corrompues, tous excès auxquels il serait, ce semble, plus naturel de supposer qu'elles se livrent dans la fougue de l'âge, que lorsqu'elles sont sur le [I-142] retour et qu'elles touchent à leur fin. On avoue qu'en vieillissant elles se civilisent; mais on dit qu'en se civilisant elles dégénèrent, et qu'elles dégénèrent d'autant plus qu'elles se civilisent davantage.
Ce procès à la civilisation n'est pas nouveau. On voit dans la plus ancienne des histoires que l'homme, qui était né innocent et non sujet à la mort, dès qu'il eut porté la main à l'arbre de la science, ne fut plus qu'un être vicieux et périssable. Non-seulement il dégénéra affreusement au moral, mais sa nature physique elle-même subit une altération sensible: sa stature diminua; son existence, qui devait ne jamais finir, ne dura plus d'abord que neuf ou dix siècles [69] , et il continua d'aller en se détériorant. On cesse de voir, dans les livres de Moïse, des races de géans après le déluge, et des hommes vivant huit ou neuf cents ans [70] . A plus forte raison n'en voit-on plus à des époques postérieures. Homère, dans ses chants, fait souvent à ses contemporains le reproche d'avoir perdu de la taille et de la force des héros de Troie. Pline assure que, dans tout le genre humain, la stature de l'homme devient de jour en jour plus petite: Cuncto mortalium generi minorem in dies fieri [71] .
[I-143]
Si nous passons des anciens aux modernes, nous allons voir les écrivains des opinions les plus opposées accuser la civilisation de corrompre, de faire dégénérer les hommes.
« L'élévation et l'abaissement journalier des eaux de l'Océan, dit Rousseau, n'ont pas été plus régulièrement assujettis au cours de l'astre qui nous éclaire durant la nuit que le sort des mœurs et de [I-144] la probité au progrès des sciences et des arts. On a vu la vertu s'enfuir à mesure que leur lumière s'élevait sur notre horizon, et le même phénomène s'est observé dans tous les temps et dans tous les lieux [72] . »
Cette opinion de Rousseau est déjà ancienne et fort connue. Voici des phrases beaucoup plus nouvelles et qui le sont moins.
« Déjà une fois, dit M. de Constant, l'espèce humaine semblait plongée dans l'abîme. Alors aussi une longue civilisation l'avait énervée... Chaque fois, ajoute le même écrivain, que le genre humain arrive à une civilisation excessive, il paraît dégradé durant quelques générations [73] . »
[I-145]
« Nous ne sommes pas, observe M. de Châteaubriand, de ces esprits chimériques qui veulent sans cesse améliorer, et le tout parce que la nature humaine, selon eux, marche vers un perfectionnement sans terme. Ce n'est pas cela: la Providence a mis des bornes à ce perfectionnement. Pour l'arrêter, il a suffi à celui qui nous a faits de mettre les mœurs de l'homme en contraste avec ses lumières, et d'opposer son cœur à son esprit [74] ›
J'ai sous les yeux un volumineux pamphlet sur l'état de l'Angleterre, dont on attribue généralement la publication au ministère britannique. L'auteur remarque que la grande masse de la nation russe n'est pas encore parvenue au même degré de civilisation que d'autres peuples de l'Europe; et la preuve qu'il en donne, c'est que ses mœurs ne sont pas aussi corrompues [75] .
M. de Montlosier écrivait textuellement en 1818 que la première chose que le gouvernement eût à [I-146] faire, c'était de « marcher bien armé et AVEC DU GROS CANON, s'il était possible, contre tout ce qui s'appelle accroissement des lumières et progrès de la civilisation [76] . »
Un grave magistrat posait en fait, quatre ans plus tard, que « les sociétés périssent par l'excès de la civilisation, de même que les corps, hu mains périssent d'excès d'embonpoint; et ce fait, disait-il, il le donnait comme pouvant seul expliquer les inconcevables agitations dont nous étions les témoins [77] . »
Un autre écrivait que la France, marchant la première à la tête de la civilisation, courait naturellement le risque d'arriver la première à ce rendez-vous de l'abîme où tous les peuples aboutissent quand ils ont échangé les vertus pour les connaissances, et les mystères pour les découvertes, c'est-à-dire quand ils sont très-civilisés [78] . Ces paroles ont été traduites dans la plupart des journaux ministériels du continent, et un puissant monarque les a trouvées si raisonnables et si belles, qu'il a cru devoir, des extrémités de [I-147] l'Europe, faire parvenir à Paris des félicitations à l'auteur [79] .
Je ferais aisément des volumes de ce qu'on écrit ainsi contre la civilisation. Et ce langage, comme on le voit, n'est pas seulement celui de quelques esprits moroses ou bizarres; il est l'expression d'un préjugé populaire, qui est commun aux esprits les plus cultivés, et qu'en plus d'un pays l'autorité partage. Personne ne nie que la civilisation ne nous rende plus ingénieux, plus savans, plus riches, plus polis; mais on veut qu'elle nous déprave. Les uns l'accusent de nous rendre turbulens et factieux; d'autres, faibles et pusillanimes; presque tout le monde, égoïstes et sensuels. Or ce ne sont pas là des qualités bien propres à nous rendre libres; et, s'il était vrai que la civilisation tendît à nous les donner, ma thèse évidemment serait mauvaise; j'aurais tort de dire que les peuples les plus libres ce sont les plus civilisés. Examinons donc un peu ce procès de tendance qu'on fait de toutes parts à la civilisation.
§ 5. Il est essentiel d'abord de nous entendre sur les termes. Qu'est-ce que la civilisation?
Le mot de civilisation dérive visiblement de celui [I-148] de cité, CIVITAS. Cité, c'est société. Civiliser les hommes, c'est les rendre propres à la cité, à la société; et les rendre propres à la société, qu'est-ce faire? c'est évidemment leur donner des idées et des habitudes civiles, sociales. La véritable propriété de la civilisation est donc, comme le mot l'indique, de nous inspirer des idées et des mœurs favorables à la cité, à la société. Une civilisation qui produirait des effets anti-civils ou anti-sociaux serait une civilisation qui n'en serait pas une; ce serait le contraire de la civilisation; et dire, comme on le fait, que la civilisation tend à la ruine de la cité, c'est dire une chose contradictoire: cela est visible à la simple inspection des mots.
Mais, observe-t-on, le mot de civilisation est particulièrement, et même exclusivement employé à désigner l'industrie, les arts, les sciences, la richesse; et le propre de la richesse et de tout ce qui l'engendre, ajoute-t-on, est d'introduire la mollesse et la corruption dans les mœurs.
A cela, deux réponses bien simples :
La première, c'est que ceux qui emploient ainsi le mot de civilisation en font un mauvais usage; c'est qu'ils lui donnent un sens beaucoup trop restreint; c'est qu'il signifie tout ce qui nous rend propres à la cité, et non pas seulement une partie de ce qui nous rend sociables; c'est qu'il comprend les mœurs en même temps que la science, [I-149] et qu'il est absurde de dire que la civilisation nous façonne à la société, sans nous donner aucune bonne habitude sociale, ou même en dépravant nos habitudes, et en nous en imprimant de funestes à la cité. Aussi n'est-ce point ainsi que l'entendent les personnes qui se piquent d'en avoir des idées justes et complètes; et, quand elles donnent à une nation le titre éminent de nation civilisée, elles ne veulent pas dire seulement de cette nation qu'elle est riche, polie, éclairée, industrieuse; elles veulent dire surtout qu'elle a de bonnes habitudes, qu'elle entend et pratique mieux la justice et la morale qu'une autre, et qu'elle sait mieux à quelles conditions il est possible aux hommes de bien vivre en société [80] .
Ma seconde réponse, c'est qu'alors même que le mot de civilisation n'impliquerait pas immédiatement l'idée de morale, alors qu'on ne voudrait [I-150] lui faire signifier que les arts et la richesse des peuples, il serait encore insensé de prétendre qu'elle tend à la corruption des mœurs.
Il est vrai que les arts adoucissent les mœurs; il n'est pas vrai qu'ils les corrompent. On leur reproche d'amollir les courages, de détruire les vertus favorables à la guerre. Ils font mieux que cela : ils détruisent la guerre même. Ils tendent à rendre inutiles les vertus farouches des peuples conquérans ; ils apprennent aux hommes le secret de prospérer simultanément sans se nuire; ils les placent dans une situation où ils peuvent se conserver sans ces efforts surnaturels que des peuples guerriers s'imposaient autrefois la dure obligation de faire; efforts qui ne sont pas long-temps possibles à l'humanité, vertu qui s'use par les obstacles particuliers qu'elle rencontre, par les revers auxquels elle expose, surtout par les succès qu'elle obtient, par les profits qu'elle rapporte, par la dépravation qui suit toujours la fortune acquise dans le pillage, et qui, lorsqu'elle vient à s'éteindre, laisse le peuple de brigands, à qui elle avait donné d'abord un faux air de grandeur et de noblesse, dans un état de dégradation et d'avilissement auquel rien ne se peut comparer.
Les arts, dis-je, nuisent à la guerre ; mais ils ne nuisent pas aux vertus guerrières. Ils n'offrent rien d'incompatible avec le courage, ils changent [I-151] seulement sa nature; ils lui donnent un meilleur mobile; au lieu de l'enflammer pour le brigandage, ils l'enflamment contre le brigandage; au lieu de lui montrer des biens à ravir, ils lui donnent des biens à conserver. Toute la question est de savoir si l'homme n'est pas aussi susceptible de s'exalter pour sa propre défense que pour la ruine d'autrui; s'il ne peut avoir d'ardeur que pour l'oppression, et n'en saurait éprouver contre l'injustice. Or cette question n'en est pas une assurément. L'histoire nous montre assez d'exemples de peuples laborieux et pacifiques, de peuples d'artisans, de laboureurs, de marchands, poussés à la guerre par le besoin impérieux de la défense, et qui ont su faire bonne contenance devant leurs oppresseurs, quoiqu'ils ne fussent pas soutenus comme eux par l'expérience des armes et l'habitude de la discipline.
Loin que les arts abâtardissent le courage, il semble qu'ils le rendent et plus ferme et plus vif. Les Grecs ont plus d'industrie que les Turcs: de quel côté se montre-t-on plus intrépide? Les Français sont plus cultivés que les Espagnols: lequel de ces peuples a le plus de valeur militaire ? On l'a pu juger dans la dernière guerre; on l'a pu juger surtout à la déplorable affaire de Llers, où, des deux parts, les Français sont restés seuls sur le champ de bataille, et où ils se sont battus entre eux pour un peuple qui, des deux côtés, avait fui. [I-152] Si les arts nuisent au courage, les Anglais doivent être le peuple le moins brave de l'Europe; car ils sont le plus riche et le plus industrieux. Cependant l'armée anglaise qui fit la première guerre d'Espagne, l'armée qui se présenta sous les murs de Toulouse, l'armée que nous rencontrâmes à Waterloo, cette armée que l'Angleterre tenait si abondamment pourvue de toutes choses n'était sûrement pas dépourvue de valeur.
Loin que les arts abâtardissent le courage, dirai-je encore, ils ont pour effet de l'épurer et de l'ennoblir. Il s'y mêle toujours, dans les premiers âges de la société, des vices qui le déshonorent, du penchant à la forfanterie, à la férocité, etc. Peu peu il revêt un meilleur caractère: il devient plus humain, plus généreux; il devient surtout plus simple. Dans les temps barbares, le guerrier cherche à épouvanter son ennemi en se donnant un aspect formidable de là le tatouage des sauvages; de là tous ces accoutremens plus ou moins bizarres destinés à agir sur l'imagination, et à affaiblir son adversaire en l'effrayant; de là ces débordemens d'injures que s'adressent des guerriers barbares avant d'en venir aux mains. Tout cela tombe à mesure que l'homme se civilise, et le courage gagne en force réelle ce qu'il perd en vaine ostentation. Le caractère qui lui reste alors est celui d'une intrépidité calme, digne, réfléchie, sans éclat [I-153] bruyant, sans pompe théâtrale. Pour juger des progrès que la civilisation lui fait faire, il suffit de comparer l'attitude, le langage et toute la manière d'être du guerrier sauvage à celle du guerrier très-civilisé. J'ai vu dans les salons de la capitale des officiers appartenant à la marine des États-Unis : rien dans leur costume, dans leurs paroles, dans leurs manières, n'annonçait des gens de guerre ; on eût dit des hommes de cabinet, des hommes qui avaient pâli sur les livres, et ils parlaient en effet comme des hommes très-instruits et très-éclairés : c'étaient d'intrépides marins, et qui avaient pris des vaisseaux de guerre à l'abordage.
Les arts ne nuisent donc pas au courage militaire. Ils ne sont pas plus défavorables au courage civil. Si les peuples, à mesure qu'ils se civilisent, paraissent moins enclins à la résistance, ce n'est pas qu'ils soient plus disposés à supporter l'oppression, c'est que l'oppression devient moins insupportable; c'est que véritablement les personnes et les fortunes sont beaucoup plus respectées. Loin que la civilisation tende à diminuer le courage civil, il est évident qu'elle doit l'accroître ; car, nous donnant plus de lumières et de dignité, elle doit nous rendre plus sensibles à l'injure, plus impatiens de toute injuste domination. On n'a jamais dit: ô tyrannie aimée des peuples civilisés ! comme les Grecs disaient: ô tyrannie aimée des [I-154] barbares! Nos ancêtres, encore incultes, souffraient des choses que leurs descendans, plus cultivés, ne consentiraient sûrement pas à souffrir ; nous en avons supporté que nos neveux trouveront, j'espère, intolérables. Si, à des époques plus ou moins rapprochées de nous, on a pu faire, sans nous émouvoir, tant de sottises et d'iniquités, dont la moindre aurait dû exciter des réclamations universelles, ce n'est certainement pas que nous fussions trop civilisés ; c'est bien, au contraire, que nous manquions de culture; et la preuve, c'est que les mêmes excès qui laissaient le gros du public indifférent, excitaient au plus haut degré l'indignation d'un petit nombre d'hommes qui avaient le sentiment éclairé du mal qu'on faisait à la France. Il y a donc lieu de croire que si leurs lumières avaient été plus générales, le public n'eût pas été aussi endurant.
Au reste, pour achever de se rassurer sur les effets de la civilisation relativement au courage civil, il suffit de considérer le reproche qu'on lui fait, d'un côté, de nous rendre ingouvernables; reproche,, pour le dire en passant, qui n'est pas mieux fondé que le reproche inverse; car rien, à coup sûr, ne ressemble moins à l'esprit de rébellion que la haine des brigandages politiques, et l'on peut dire que la société ne se montre jamais plus loyale et plus fidèle que lorsque les progrès de la civilisation [I-155] lui ont appris à défendre son gouvernement contre les ambitieux et les pervers qui ne cessent de le pousser à mal faire [81] .
Mais, dit-on, les arts nous ont enrichis, et c'est ainsi qu'ils nous ont corrompus [82] . Autre méprise. Je concevrais que l'on dît cela de l'art du pillage et des extorsions. Je crois bien, en effet, que les [I-156] arts divers par lesquels le conquérant, le voleur, l'intrigant, l'agioteur se procurent le bien d'autrui, peuvent contribuer à les pervertir alors même qu'ils les enrichissent. Mais comment oser attribuer le même effet aux arts utiles, aux arts vraiment producteurs? Gardons-nous de confondre les gens qui travaillent avec les gens qui intriguent, et les hommes industrieux avec les chevaliers d'industrie. Si, pour prospérer, ceux-ci ont besoin de plus d'un vice, ceux-là, pour réussir, ne peuvent se passer de qualités morales qui constituent l'homme de bien. Tandis que le courtisan puise, suivant Montesquieu, ses plus grands moyens de succès dans la bassesse, la flatterie, la trahison, la perfidie, l'abandon de ses engagemens, le mépris de ses devoirs sociaux, le véritable industrieux trouve ses meilleures chances de fortune dans le travail, l'activité, l'économie, la probité et la pratique de toutes les vertus sociales. Les arts, bien loin de nous corrompre en nous enrichissant, contribuent donc à nous rendre meilleurs en même temps qu'ils nous rendent plus riches.
Ensuite, considérée en elle-même, et abstraction faite des moyens de l'acquérir, il s'en faut bien, sans doute, que la richesse soit une cause de dépravation. S'il y a ordinairement beaucoup de corruption dans les cours, c'est moins la faute des grandes fortunes dont on y jouit que celle de [I-157] l'espèce particulière d'industrie par laquelle on y devient riche. Le courtisan, loin d'être rendu plus pervers par ses richesses, leur doit le peu qu'il a de bon; c'est à l'état où elles le mettent qu'il doit cette politesse, cette urbanité, cette bienséance qui, si elles ne sont pas des vertus, servent du moins de masque à ses vices. De tous les moyens de réformer les mœurs, la richesse est peut-être la plus efficace elle nous assure le bienfait d'une meilleure éducation; elle nous inspire des goûts et nous fait contracter des habitudes d'un ordre plus élevé; elle nous place dans une situation où nous avons un plus grand intérêt à nous bien conduire; elle nous donne un état et une considération à ménager; elle nous procure du loisir enfin, et tous les moyens d'acquérir des lumières; et, loin que par-là elle tende, comme on le dit, à nous corrompre, c'est par-là surtout qu'elle tend à nous réformer. Quelle apparence, en effet, que les lumières, qui nous mettent en état de mieux apercevoir les conséquences des mauvaises actions, soient pour nous un stimulant de plus à mal agir? Sans doute il ne suffit pas pour faire le bien de le connaître ; il faut encore que les bonnes habitudes viennent à l'appui de la saine instruction: mais ce n'est que sur la saine instruction que peuvent se fonder les bonnes habitudes, et le commencement de toute sagesse est dans la science.
[I-158]
Ainsi ne voulût-on voir sous le mot de civilisation que des idées d'arts, de sciences, de richesses, il serait encore impossible évidemment de lui faire signifier, par induction, la corruption des mœurs. Encore une fois, ce qui déprave, c'est la manière de s'enrichir, et non pas la richesse; ce sont les arts qui la font seulement changer de mains, et non pas les arts qui la produisent. Loin que ces derniers, les seuls que la civilisation avoue, nous conduisent, par la fortune, à la dépravation, il est clair comme le jour qu'en accroissant la masse des richesses, ils sont la cause la plus active de la diffusion des lumières et du perfectionnement des mœurs.
§ 6. Mais si, de sa nature, la civilisation n'entraîne pas la ruine des mœurs et de la société, comment, dira-t-on, expliquer l'histoire? On n'y voit de nations fortes que les nations peu cultivées. Parvenus au faîte de la civilisation, les empires tombent et s'écroulent. Voyez les États de l'antiquité [83] .
Il n'y a point dans l'histoire ce qu'on prétend y voir: on n'y saurait découvrir de nations qui aient péri par excès de culture. A proprement parler, il ne peut pas y avoir excès dans la culture d'un peuple: [I-159] il serait absurde de dire qu'un peuple est cultivé avec excès: autant vaudrait dire qu'il a trop d'instruction, trop de connaissances, trop de moyens d'action, trop de bon sens et de régularité dans ses mœurs, trop de justice dans ses relations sociales... Mais il est encore plus insensé de prétendre qu'il y avait excès dans la civilisation des peuples antiques, et que c'est pour avoir été trop civilisés qu'ils ont péri. Jugez en effet de l'excès de civilisation où devaient être parvenus des peuples qui avaient fondé leur existence sur la guerre et sur l'esclavage: Il serait curieux de rechercher dans quel état se trouvaient au vrai les Romains, lorsqu'ils furent parvenus, comme on dit, au faîte de leur civilisation, c'est-à-dire lorsqu'ils eurent achevé leurs conquêtes;, lorsqu'ils eurent pillé, saccagé, détruit un nombre immense de villes; massacré ou réduit en servitude des millions d'êtres humains; et ce que tout cela avait produit lorsqu'ils devinrent, à leur tour, la proie des barbares [84] ? Il y a apparence qu'au lieu d'accuser la civilisation de leur décadence, on ne verrait dans leur chute finale que -la dernière conséquence de leurs brigandages et des moyens exécrables par lesquels ils s'étaient élevés. Loin que l'empire romain ait péri d'excès de civilisation, il est évident que, s'il avait été civilisé [I-160] seulement au point où le sont aujourd'hui quelques-unes de ses anciennes provinces, et par exemple la Gaule ou la Bretagne; si son sol avait été couvert d'une population aussi compacte, aussi avancée dans tous les arts, pourvue d'autant de moyens de défense et aussi intéressée à se défendre, le torrent des barbares aurait été facilement contenu. Qu'on juge en effet de la belle figure que feraient aujourd'hui, malgré toute leur fougue et toute leur ardeur pour le pillage, les bandes à moitié nues d'un Alaric ou d'un Attila, devant les armées disciplinées de l'Europe, et en présence de leur formidable artillerie ; ou bien la plus nombreuse flotte de pirates normands devant un petit nombre de vaisseaux de guerre, munis de leurs canons, de leurs boulets, de leurs fusées à la congrève, et mis en mouvement par la machine à vapeur!
D'ailleurs les peuples de l'antiquité auraient été aussi civilisés que réellement ils le furent peu, qu'il n'y aurait pas encore le moindre sujet d'accuser la civilisation de leur ruine. On pourrait faire honneur de leur élévation à leur culture, aux arts utiles et vivifians qu'ils auraient pratiqués; mais il est évident qu'on ne pourrait accuser de leur chute. que la barbarie de leurs ennemis. On pourrait se plaindre, non de ce que certains peuples étaient trop civilisés; mais de ce que beaucoup d'autres peuples ne l'étaient pas assez. Ce ne fut pas la [I-161] civilisation des Grecs qui causa leur ruine; ce fut la barbarie des Romains. Les Romains, à leur tour, ne furent pas détruits par leur civilisation; mais par la brutalité des Goths, des Huns, des Vandales et de toutes ces hordes de barbares qui, durant plusieurs siècles, ne cessèrent de fondre sur eux. A l'époque où s'écroula leur empire, la barbarie sur la terre était encore beaucoup plus robuste et plus vivace que la civilisation. Ils ne pouvaient donc manquer de succomber. Combien de fois, depuis sa naissance, la civilisation n'a-t-elle pas éprouvé de ces catastrophes! On l'a vue expirer successivement en Égypte, en Grèce, à Rome, à Constantinople. Mais, étouffée sur un point, elle ne tardait pas à renaître sur un autre ; elle s'y développait avec plus d'énergie; elle se répandait sur de plus vastes espaces. Il n'est plus maintenant en Europe de nation qu'elle n'ait attachée au sol, qu'elle n'ait plus ou moins éclairée et adoucie; et je cherche où seraient, parmi nous ou autour de nous, les barbares assez puissans pour la détruire.
S7. Ceux qui nous trouvent trop civilisés nous font un reproche qu'en vérité nous ne méritons guère. Nous périssons d'excès de civilisation, disent-ils, et la civilisation, toute grande, toute ancienne qu'elle est, se trouve encore, sous bien des rarports, dans un véritable état d'enfance. La plupart [I-162] de nos progrès sont d'hier; les plus essentiels sont encore à faire; si nos arts sont avancés nos mœurs sont loin de l'être, ou si nos mœurs privées le sont un peu, nos mœurs publiques ne le sont pas du tout.
Je touche ici à la véritable cause de nos discordes. Si le monde est dans un continuel état d'agitation, ce n'est pas, comme on le dit, que la civilisation ait trop pénétré dans nos arts, dans nos usages, dans nos relations privées, c'est qu'elle n'a pas encore assez pénétré dans nos relations politiques.
Observez dans le commerce ordinaire de la vie l'élite des hommes qu'on appelle bien élevés : voyez-vous qu'ils s'injurient, qu'ils s'accusent, qu'ils s'attaquent, comme nous le faisons sans cesse de gouvernans à gouvernés? Non sans doute. Et d'où vient entre eux cet état habituel de bonne intelligence? de ce qu'ils savent à quels égards, à quelles règles de justice et de bienséance ils doivent mutuellement se soumettre pour rendre leurs relations sûres et faciles. Et d'où viennent entre nous, gouvernans et gouvernés, ces honteuses dissensions? de ce que, dans les rapports que nous avons ensemble, nous ne voulons pas nous assujétir, aux mêmes règles de convenance et d'équité. Gouvernans, nous sommes hautains et iniques; gouvernés, nous sommes brouillons et mutins : [I-163] faut-il s'étonner que nous ayons peine à nous entendre, et que nos querelles remplissent le mondé de trouble et de confusion? Mais attendez que le temps et l'expérience nous aient enfin appris à nous soumettre, dans nos rapports publics, aux mêmes règles de morale qu'observent les gens de bien dans leurs relations domestiques et civiles; attendez que la civilisation ait pénétré dans le gouvernement, seulement au degré où elle est entrée dans la vie privée, et vous verrez bientôt cesser nos discordes. Le trouble et l'agitation qui règnent dans la société sont donc visiblement le symptôme d'un défaut, et non pas d'un éxcès de civilisation.
§ 8. En résumé, la civilisation accroît sans cesse, on le reconnaît, la masse de nos idées, de nos découvertes, de nos richesses, de tous nos moyens d'action. Loin que par-là elle nous corrompe, c'est par-là surtout, nous venons de le voir, qu'elle tend à nous amender. Elle adoucit les mœurs, elle les épuré et les élève; elle est favorable à la justice, à la dignité, au courage; elle implique les idées d'ordre et de morale aussi fortement que celles de richesse et d'industrie. Elle renferme donc en elle-même tous les élémens de la liberté, et j'ai raison de dire que les peuplés les plus cultivés sont les plus libres.
[I-164]
§ 9. Je prie, avant de finir, qu'on prenne garde à la manière dont je m'explique. Je dis qu'un peuple est d'autant plus libre qu'il est plus civilisé, que plus il est civilisé, et plus il est libre; mais je ne dis pas que sa liberté soit nécessairement égale à sa civilisation. Cette proposition, en effet, pourrait très-bien n'être pas exacte; et, de vrai, il n'arrive presque jamais qu'elle le soit.
La raison en est simple : c'est qu'un peuple n'est jamais parfaitement isolé; c'est qu'il est entouré de populations plus ou moins civilisées que lui, et dont la civilisation doit nécessairement modifier les effets de la sienne et influer en bien ou en mal sur la liberté. Une commune tient à son chef-lieu; les départemens se lient à la capitale; la France au reste de l'Europe; l'Europe a des rapports avec l'Amérique, et la race européenne avec les nations de l'Afrique et de l'Asie.
Dans cet état de connexion universelle où presque tous les peuples sont entre eux, on pourrait dire sans doute que la liberté du genre humain est égale à sa civilisation; mais on ne peut sûrement pas répondre que la liberté de tel peuple en particulier soit exactement proportionnée à l'état de ses mœurs, de son industrie, de ses lumières. Il est en effet très-possible, et même très-ordinaire que l'ignorance et les vices d'un peuple voisin ou même d'un peuple éloigné viennent contrarier le résultat [I-165] de son instruction et de ses bonnes habitudes, et le rendre moins libre qu'il ne le serait sans l'interposition de cet élément étranger.
Ainsi, par exemple, il n'est pas douteux que l'état arriéré de la plupart de nos départemens ne nuise beaucoup à la liberté de la capitale. On ne peut pas douter davantage que la liberté de la France ne souffre de l'état des pays environnans qui sont moins avancés qu'elle. La Manche ne soustrait pas complètement la liberté anglaise à l'influence du continent; ni même l'Atlantique celle des États-Unis à ce qui reste de barbarie en Europe. Quand M. le président Monroë dit, dans son message, qu'à la distance où l'Amérique est de nous, sa liberté ne saurait être affectée de notre état politique [85] , il est évident qu'il se trompe, et le fait même le prouve; car l'état de l'Europe oblige l'Amérique d'élever des fortifications sur son littoral, d'entretenir une forte marine, d'avoir de nombreuses milices et une armée; et, certes, ces précautions dispendieuses et gênantes, que l'état imparfait de notre civilisation l'oblige de prendre, ne peuvent pas ne pas nuire beaucoup à sa liberté.
Cependant, quelle que soit cette influence [I-166] réciproque que la plupart des nations exercent les unes sur les autres, soit en bien, soit en mal, il est certain qu'elle a des bornes, et qu'elle ne change qu'en partie les résultats de la civilisation développée dans chaque pays. Ainsi, quoique l'état moral et politique de l'Europe nuise à la liberté des Anglo-Américains, l'Amérique septentrionale, politiquement plus civilisée que l'Europe, a par ce seul fait, au moins sous ce rapport, beaucoup plus de liberté. Ainsi la France reste plus libre que des nations moins civilisées qu'elle, malgré les efforts que ces nations font pour l'abaisser à leur niveau; ainsi la capitale, malgré la pernicieuse influence des départemens, a beaucoup plus de liberté qu'ils n'en possèdent, par cela seul qu'il y a dans son sein beaucoup plus d'intelligence, d'activité, d'industrie, de savoir, de richesse, de bonnes habitudes, et, en général, d'élémens d'ordre et de force de toute espèce. La liberté n'est peut-être nulle part exactement proportionnée à la civilisation; mais partout où la civilisation est plus avancée, la liberté est plus grande; partout les populations deviennent plus libres à mesure qu'elles sont plus cultivées.
§ 10. Au surplus, nous allons voir si l'étude des faits confirme ces remarques; et, parcourant l'un après l'autre les principaux états par lesquels a [I-167] passé la civilisation, depuis les plus informes jusqu'aux plus perfectionnés, nous examinerons quel est le degré de liberté que comporte chacun de ces degrés de culture.
[I-168]
CHAPITRE V.
Liberté compatible avec la manière de vivre des peuples sauvages.↩
§ 1. S'il est vrai que la liberté soit en raison de la civilisation, les peuples qu'on appelle sauvages doivent être les moins libres de tous les peuples; car ils sont précisément les moins civilisés. A ce premier âge de la vie sociale, les hommes ne savent faire encore ni un usage étendu, ni un usage bien entendu de leurs forces; ils n'ont encore appris ni à pourvoir amplement à leurs besoins, ni à les satisfaire avec mesure, ni à les contenter sans se faire mutuellement de mal. Ils ne savent pas comment il est possible à de nombreuses populations de subsister simultanément dans un même lieu sans se nuire; et lorsque les productions naturelles d'une contrée ne peuvent plus suffire aux besoins des tribus qui l'habitent, le seul moyen qu'elles conçoivent d'accroître leurs ressources, c'est de s'exterminer les unes les autres, et de réduire par la guerre le nombre des consommateurs. On peut dire que, dans cette enfance de la société, les hommes ne se doutent nullement encore des conditions auxquelles il est possible d'être libre.
[I-169]
§ 2. Par quel singulier renversement d'idées, des philosophes du dernier siècle ont-ils donc affecté de présenter cet état social comme le plus favorable à la liberté ? Plus un peuple était inculte, et plus ils le déclaraient libre. Un Français, un Anglais, un homme civilisé de leur temps était un esclave [86] ; un Romain était un homme libre, à plus forte raison un Germain ; à plus forte raison un Tartare, un nomade. Finalement, le plus libre des hommes, à leurs yeux, c'était un sauvage, un Algonquin, un Iroquis, un Huron.
«Quand on sait creuser un canot, battre l'ennemi, construire une cabane, vivre de peu, faire cent lieues dans les forêts, sans autre guide que le vent et le soleil, sans autre provision qu'un arc et des flèches; c'est alors, dit Raynal, qu'on est un homme [87] . »
«Tant que les hommes, dit Rousseau, se contentèrent de leurs cabanes rustiques; tant qu'ils se bornèrent à coudre leurs habits de peaux avec des épines ou des arêtes; à se parer de plumes et de coquillages; à se peindre le corps de diverses couleurs; à tailler avec des pierres tranchantes quelques canots de pêcheurs ou quelques grossiers instrumens de musique; en un mot, tant qu'ils ne [I-170] s'appliquèrent qu'à des ouvrages qu'un seul pouvait faire, et qu'à des arts qui n'avaient pas besoin du concours de plusieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons et heureux autant qu'ils pouvaient l'être par leur nature...[88] . »
Ailleurs, le même écrivain ajoute qu'il n'y a pas d'oppression possible parmi les sauvages.
« Un homme, dit-il, pourra bien s'emparer des fruits qu'un autre a cueillis, du gibier qu'il a tué, de l'antre qui lui servait d'asile; mais comment viendra-t-il jamais à bout de s'en faire obéir?... Si l'on me chasse d'un arbre, j'en suis quitte pour aller à un autre; si l'on me tourmente dans un lieu, qui m'empêchera de passer ailleurs [89] ? »
§ 3. Ainsi, un sauvage est libre, suivant Rousseau, par cela seul qu'il a la faculté, s'il est tracassé dans un lieu, de se réfugier dans un autre. Mais à ce compte, un homme civilisé est-il beaucoup moins libre qu'un sauvage? n'a-t-il pas aussi la faculté de fuir? Si on le tourmente dans un lieu, ne peut-il pas aller dans un autre? Et s'il ne trouve de sûreté nulle part dans la société des hommes, n'aura-t-il pas toujours, comme le sauvage de Rousseau, la faculté de s'enfoncer dans les bois et d'aller vivre avec les bêtes ?
[I-171]
On dira sans doute que l'homme civilisé ne saurait prendre une résolution pareille; qu'il tient à la société par trop de liens : mais faut-il donc ne tenir à rien pour être libre? La liberté consiste-t-elle dans la nécessité d'étouffer tous ses sentimens, de réprimer toutes ses affections? Est-ce être libre que d'être à tout moment contraint d'abandonner son fruit, son gibier, son asile? Qu'y aurait-il de pire à être serf ?
Rousseau nous apprend comment nous pouvons être libres en consentant à ne rien produire, à ne rien posséder. N'ayez que des arbres pour abri; ne vous couvrez que de peaux d'animaux; ne les attachez qu'avec des épines; interdisez-vous toute industrie; réduisez-vous à la condition des brutes, et vous serez libres. Libres ! de quoi faire? de vivre plus misérables que les bêtes mêmes? de périr de froid ou de faim? Est-ce à cela que vous réduisez la liberté humaine? Étrange manière de nous procurer la liberté, que de commencer par interdire tout perfectionnement à nos forces, tout développement à nos plus belles facultés !
1
Les hommes ne sont pas libres en raison de leur puissance de souffrir, mais en raison de leur pouvoir de se satisfaire. La liberté ne consiste pas à savoir vivre d'abstinence; mais à pouvoir satisfaire ses besoins avec aisance, et à savoir les contenter avec modération. Elle ne consiste pas à pouvoir fuir, comme dit Rousseau, ou à savoir battre [I-172] l'ennemi, comme dit Raynal; mais à savoir diriger ses forces de telle sorte qu'il soit possible de vivre paisiblement ensemble; de telle sorte qu'on ne soit pas réduit à se fuir ou à s'entre-tuer. La liberté, finalement, ne consiste pas à se faire bête, de peur de devenir un méchant homme; mais à tâcher de devenir, autant que possible, un homme industrieux, raisonnable et moral.
Quand on sait creuser un canot, construire une cabane, faire cent lieues dans les forêts, c'est alors qu'on est un homme! Oui, c'est alors qu'on est un homme sauvage; mais pour être réellement un homme, il y faut bien d'autres façons vraiment: il faut savoir faire un usage étendu et élevé de ses forces; il faut avoir développé son intelligence ; et l'on est d'autant plus libre et d'autant plus homme qu'on sait mieux tirer parti de toutes ses facultés. Cela résulte même des expressions de Raynal; car, si l'on est un homme quand on sait creuser un canot, à plus forte raison doit-on l'être quand on sait construire un navire; si, quand on peut édifier une cabane, à plus forte raison quand on sait élever des maisons, des temples, des palais; si enfin, quand on peut faire cent lieues dans les forêts, à plus forte raison quand on peut faire le tour de la terre ?
§ 4. Les détracteurs de la vie civile trouvent donc, comme nous, qu'on est d'autant plus libre [I-173] qu'on sait mieux user de ses forces. Mais alors sous quel rapport serait-il possible de soutenir que l'homme encore sauvage est plus libre que l'homme civilisé ? L'emporte-t-il par la force du corps, par les facultés de l'esprit, par les habitudes privées et sociales? Comparons-les un peu sous ces divers points de vue.
§ 5. On a long-temps présenté la vie sauvage comme la source de la vigueur physique.
« Le corps de l'homme sauvage, dit Rousseau, étant le seul instrument qu'il connaisse, il l'emploie à divers usages dont, par le défaut d'exercice, les nôtres sont incapables; et c'est notre industrie qui nous ôte la force et l'agilité que la nécessité l'oblige d'acquérir. S'il avait une hache, son poignet romprait-il de si fortes branches? S'il avait une fronde, lancerait-il de la main une pierre avec tant de raideur? S'il avait une échelle, grimperait-il si légèrement sur un arbre ? S'il avait un cheval, serait-il si vite à la course? Laissez à l'homme civilisé le temps de rassembler toutes ses machines autour de lui, on ne peut douter qu'il ne surmonte facilement l'homme sauvage; mais si vous voulez voir un combat plus inégal encore, mettez-les nus et désarmés vis-à-vis l'un de l'autre, et vous reconnaîtrez bientôt quel est l'avantage d'avoir sans cesse ses forces à sa disposition, d'être toujours prêt à [I-174] tout événement, et de se porter, pour ainsi dire, toujours tout entier avec soi [90] . »
Voilà des idées admirablement exprimées sans doute; mais ont-elles autant de justesse que d'éclat? Je ne nierai point que la vie sauvage ne paraisse propre, sous quelques rapports, à développer les forces physiques. Le sauvage est appelé par son état à un très-grand exercice, et l'exercice est père de la vigueur. Mais si un exercice modéré fortifie, un exercice trop violent, énerve; et le sauvage excède ordinairement son corps plutôt qu'il ne l'exerce. Ajoutez que, si souvent il agit trop, plus souvent encore il se nourrit mal, et qu'il s'exténue doublement par la fatigue et par le jeûne.
« Le sauvage, dit Péron, entraîné par le besoin impérieux de se procurer des alimens, se livre, pendant plusieurs jours, à des courses longues et pénibles, ne prenant de repos que dans les instans où son corps tombe de fatigue et d'épuisement. Vient-il à trouver une pâture abondante? alors, étranger à tout mouvement autre que ceux qui lui sont indispensables pour assouvir sa voracité, il n'abandonne plus sa proie, il reste auprès d'elle jusqu'à ce que de nouveaux besoins le rappellent à de nouvelles courses, à de nouvelles fatigues, non moins excessives que les précédentes. Or, quoi de [I-175] plus contraire au développement régulier, à l'entretien harmonique des forces, que ces alternatives de fatigue outrée, de repos automatique, de privations accablantes, d'excès et d'orgie faméliques [91] ? »
Joignez à cela ce que les relations des voyageurs rapportent de la saleté des peuples sauvages, de l'insalubrité de leurs alimens, de la puanteur de leurs habitations, de la manière dont ils s'y entassent quelquefois, des maladies, des infirmités auxquelles l'ensemble de ce détestable régime les expose, et vous reconnaîtrez que leur corps est presque toujours soumis à l'action d'un concours plus ou moins nombreux de causes essentiellement énervantes [92] .
Il paraît done fort incertain que dans le combat proposé par Rousseau, l'homme sauvage eût, en général, sur l'homme cultivé autant d'avantage qu'il le suppose. Sans doute, si l'on affectait de mettre aux prises avec l'artisan le plus chétif de nos cités, un sauvage choisi chez l'un des peuples de l'Amérique ou des îles de la mer du Sud qui sont les plus remarquables par la taille, les proportions et la force du corps, il est fort probable [I-176] que le citadin ne sortirait pas vainqueur de la lutte. Mais pour juger quelle est de la vie civile ou sauvage la plus favorable au développement de la vigueur physique, il ne faut pas faire combattre un colosse avec un pygmée, un montagnard suisse ou écossais avec un Eskimau, un guerrier Cafre ou Carive avec le citoyen le moins robuste de Londres ou de Paris; il ne faut pas non plus faire combattre un homme de cabinet avec un homme de guerre, un homme qui n'aura jamais fait travailler que sa tête avec un homme qui se sera exercé, depuis l'enfance, à la lutte et au pugilat : il faut mettre en présence deux hommes égaux sous le rapport de la race, deux hommes qui se livrent habituellement aux mêmes exercices, et entre lesquels il n'y ait de différence que celle qu'y a pu mettre la manière de vivre et la civilisation. Or, si la lutte s'établit entre deux hommes choisis de la sorte, on peut poser hardiment en fait que l'homme sauvage sera constamment battu par l'homme civil.
On trouve dans la relation du voyage de découvertes aux terres australes des preuves péremptoires de ce que j'avance. Péron a voulu juger sur les lieux ce grand procès de la supériorité de la nature brute sur la nature cultivée. Il a comparé les forces respectives des Européens et des naturels de la Nouvelle-Hollande. Il a vu lutter, corps à corps, et à plusieurs reprises, des matelots de [I-177] l'expédition avec des sauvages: ceux-ci ont toujours été culbutés. Il a éprouvé leurs forces respectives avec le dynamomètre, et les sauvages ont encore été vaincus. Péron, bien loin de trouver dans les faits la preuve de cette plus grande force musculaire qu'on a voulu attribuer aux peuples incultes, a été conduit par l'observation à penser que les hommes sont, en général, d'autant plus faibles qu'ils sont moins civilisés. Il a trouvé que les naturels de la Nouvelle-Hollande, un peu moins bruts et moins misérables que ceux de la terre de Diémen, étaient un peu plus vigoureux; que ceux de Timor étaient plus forts que ceux de la Nouvelle-Hollande, et les Européens beaucoup plus forts que les habitans à demi civilisés de Timor. Il a remarqué que la vigueur physique, dans cette échelle de la civilisation, suivait la progression suivante : 50, 51, 58, 69 [93] ; c'est-à-dire que les sauvages de la terre de Diémen n'avaient pu, terme moyen, faire marcher l'aiguille de pression du dynamomètre que jusqu'à 50 degrés, ceux de la Nouvelle-Hollande à 51, et ceux de Timor à 58; tandis que les Français, malgré l'affaiblissement résultant pour eux des fatigues d'une navigation très-longue et très-pénible, l'avaient fait avancer jusqu'à 69 [94] .
[I-178]
Il y a peut-être à reprocher à Péron de n'avoir pas assez tenu compte dans ces expériences de la différence des races. Il serait possible en effet que l'infériorité des indigènes de la Nouvelle-Hollande vînt en partie de leur mauvaise conformation naturelle, et qu'elle ne résultât pas uniquement du peu de progrès qu'ils ont faits. C'est ce que j'ignore. Mais, fallût-il accorder quelque chose à la différence des races, la conséquence générale tirée par Péron de ses expériences n'en resterait pas moins certaine. Elle serait modifiée, mais non pas détruite; et il serait toujours vrai de dire que la civilisation est favorable au développement et à l'extension des forces physiques [95] . La civilisation ne fait pas sans doute que les hommes civilisés soient supérieurs aux hommes incultes dans de certains exercices que leur position leur permet de négliger, et auxquels les sauvages sont, par leur position même, obligés de se livrer habituellement; mais elle fait, et c'est là tout ce que je prétends ici, [I-179] qu'ils sont, en général, mieux portans, plus sains, plus vigoureux, plus robustes. Un historien fort en crédit, M. Dulaure, m'en fournit une preuve curieuse dans son Histoire de Paris.
Cet écrivain, parlant des jeux auxquels se livraient au quinzième siècle les habitans de cette bonne ville, raconte que le 1" septembre 1425, il fut planté dans la rue aux Ours, en face la rue Quincampoix, un mât de cocagne qui n'avait pas plus de trente-six pieds de haut, et il ajoute que, dans tout le cours de la journée, il ne se trouva personne qui pût grimper jusqu'au faîte et aller décrocher le prix qu'on y avait suspendu [96] . Si le fait est vrai, et l'historien le puise à bonne source, il faut convenir que les Parisiens de nos jours pourraient se moquer un peu de leurs robustes ancêtres, Est-il, en effet, rien de si commun dans nos fêtes publiques que de voir des gens du peuple grimper lestement à la cime de mâts de cocagne, non pas de trente-six pieds, mais de plus de soixante? Ce qui nous porte à croire que la civilisation tend à faire dégénérer l'homme physique, c'est la vue de ces individus faibles et chétifs, qui se trouvent toujours en plus ou moins grand nombre dans des pays riches et très-peuplés. Mais l'existence de ces individus est peut-être ce qui montre [I-180] le mieux à quel point la civilisation est favorable à l'homme physique. Tous ces êtres en effet sont autant de forces que la civilisation conserve, et qui, dans l'état de sauvage, seraient voués à une inévitable destruction. Il n'y a dans cet état rigoureux que les individus nés avec une complexion très-forte qui puissent se promettre de vivre. Tout le reste est condamné d'avance à périr.
Un Spartiate dirait peut-être que c'est un des mauvais effets de la civilisation de conserver ainsi des corps grêles, des avortons, des guenilles...
Guenille si l'on veut; ma guenille m'est chère,
répondrait-on avec Chrysale. Il n'est pas du tout besoin d'être taillé en Hercule pour trouver la vie douce et se féliciter d'en jouir :
Mécénas fut un galant homme.
Il a dit quelque part: qu'on me rende impotent,
Cul-de-jatte, goutteux, manchot; pourvu qu'en somme
Je vive, c'est assez; je suis plus que content.
D'ailleurs, il n'est ni impossible, ni rare que des épaules faibles portent une tête forte, qu'une ame énergique loge dans un corps fluet. Or les têtes fortes et les ames énergiques ont bien aussi leur puissance peut-être. Il y a dans la tête de Newton ou de Blaise Pascal mille fois plus de pouvoir que dans les bras d'Alcide. Permis à des sauvages de ne [I-181] tenir compte que de la vigueur des reins ou de l'énergie du jarret : les hommes cultivés savent que l'homme vaut surtout par le sentiment et l'intelligence [97] .
Enfin la question ici n'est pas de savoir si la civilisation a tort ou raison de conserver les êtres faiblement constitués; mais bien si elle est ou n'est pas favorable à la vigueur physique. Or cela se montre avec évidence non-seulement dans ce qu'elle ajoute à la force des hommes naturellement robustes; mais surtout dans ce qu'elle donne de vie et de santé à des corps naturellement débiles; non-seulement dans ces millions d'êtres vigoureux qu'elle fait croître, mais surtout dans cette multitude de frêles existences qu'elle conserve : c'est [I-182] dans ce qui la fait accuser d'être une cause de dépérissement et de mort que je la trouve particulièrement vivifiante.
Si une vérité si simple, et pourtant si long-temps méconnue, avait besoin de nouvelles preuves, on en trouverait de frappantes dans les curieuses recherches de M. Villermé sur la population de Paris. Ce judicieux observateur nous a appris qu'à l'époque où nous vivons, la mortalité générale annuelle dans Paris n'est que d'un habitant sur trente-deux, tandis qu'au dix-septième siècle elle était d'un sur vingt-cinq ou vingt-six, et au quatorzième, d'après les données fournies par un manuscrit de cette époque, d'un sur seize ou dix-sept. On peut juger par ce seul fait à quel point les progrès de la civilisation tendent à accroître la durée moyenne de la vie, et à quel point par conséquent elle est favorable à la conservation des forces physiques [98] .
[I-183]
Rousseau s'est donc grandement abusé quand il a voulu établir que les hommes sont d'autant plus vigoureux qu'ils sont plus incultes. C'est justement le contraire qui est la vérité. Pourquoi d'ailleurs, en mettant aux prises un homme civilisé avec un sauvage, veut-il dépouiller le premier de ce qui fait son principal attribut; des forces artificielles qu'il a su ajouter aux siennes, des armes, des outils qu'il s'est appropriés et qui sont devenus pour lui comme autant de nouveaux sens? Nu et désarmé, sa supériorité est déjà évidente; mais elle sera immense si à ses forces naturelles vous ajoutez celles qu'il a su se procurer par son art.
[I-184]
§ 6. La véritable puissance de l'homme civil est dans son intelligence. C'est à elle qu'il doit d'abord sa plus grande vigueur de corps; car il n'est plus robuste que parce qu'il sait mieux entretenir sa santé, parce qu'il pourvoit mieux à tous ses besoins physiques. Mais cette plus grande force corporelle dont il lui est redevable n'est rien en comparaison de celle qu'elle lui procure d'ailleurs. Elle plie à son usage toutes les puissances de la nature; elle ajoute aux forces qui lui sont propres celles des animaux, celles des métaux, celles de l'eau, du feu, du vent; elle élève son pouvoir de un à mille, à cent mille; elle l'étend d'une manière indéfinie.
L'homme cultivé, déjà plus libre que le sauvage dans l'usage de ses membres, est donc infiniment plus libre que lui dans l'exercice de son entendement. Sous ce nouveau rapport, il n'y a vraiment entre eux aucune comparaison possible. Le parti que l'homme civilisé tire des facultés de son esprit est immense; l'usage qu'en fait l'homme sauvage n'est rien; son intelligence commence à peine à luire ; et l'on peut juger par ce que nous avons mis de temps à dissiper un peu l'épais brouillard qui enveloppait la nôtre, de ce qu'il devra s'écouler de siècles avant que la sienne brille de quelque éclat.
Non-seulement l'intelligence du sauvage n'est pas développée, mais il y a dans sa manière de [I-185] vivre des obstacles presque insurmontables à ce qu'elle fasse aucun progrès sensible. Le sauvage, chasseur et guerrier par état, épuise toute son activité dans les exercices violens auxquels sa condition le condamne ; et quand il revient de la chasse ou de la guerre, il ne sent plus que le besoin de réparer ses forces par la nourriture et le sommeil. Il n'y a de place dans sa vie que pour l'action physique ; il n'y en a point pour le travail de l'esprit. Pour qu'il devînt capable de réflexion, il faudrait que son existence ne se partageât pas entre une activité désordonnée et un repos presque léthargique; il faudrait qu'il pourvût à sa subsistance par des moyens qui requissent moins de force et plus de calcul; c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il changeât de manière de vivre; mais tant qu'il reste chasseur et guerrier il paraît impossible que son intelligence se forme, et l'on n'a pas vu de peuple, dans cet état, dont les idées ne fussent excessivement bornées.
Telle est l'ignorance du sauvage, qu'il est incapable de pourvoir aux plus simples besoins de la vie. On sait dans quel état ont été récemment trouvés les naturels de la terre de Diémen et de la Nouvelle-Hollande. Ils étaient, dit Péron, sans arts d'aucune espèce, sans aucune idée de l'agriculture, de l'usage des métaux, de l'asservissement des animaux; sans habitations fixes, sans autres retraites que d'obscurs souterrains ou de misérables [I-186] abat-vents d'écorce, sans autres armes que la sagaie et le casse-tête, toujours errans au sein des forêts ou sur le rivage de la mer [99] . Cook trouva les habitans de la Terre-de-Feu mourant de froid et de faim, couverts d'ordure et de vermine, et placés sous le climat le plus rude sans avoir su découvrir aucun moyen d'en adoucir la rigueur [100] . Le sauvage ne sait, en général, tirer de la terre que ce qu'elle produit spontanément, et telle est quelquefois sa stupidité que pour cueillir le fruit qui le nourrit, il coupe au pied l'arbre qui le lui donne [101] . Il reste exposé aux plus cruelles privations sur des terrains que féconderait la culture la plus imparfaite, et il s'y nourrit des mets les plus dégoûtans, il y souffre des famines hideuses quand la moindre industrie pourrait l'y mettre à l'abri du besoin [102] . Il perd, faute de propreté, l'avantage d'occuper des régions étendues et naturellement saines, et quelquefois des hordes entières sont emportées par des épidémies que la moindre prudence aurait pu prévenir [103] . Il ne reçoit enfin [I-187] presque aucune aide de son intelligence; elle le laisse à la merci de tous les élémens et sous le joug d'une multitude de nécessités dont se jouerait parmi nous l'industrie la plus vulgaire.
Rousseau trouve que la liberté ne souffre pas, tant qu'on ne dépend ainsi que des choses [104] . C'est se méprendre étrangement. Les choses, dans bien des cas, n'agissent pas sur nous avec moins de violence que les hommes, et il n'est pas plus doux de dépendre d'elles que d'être sous le joug des plus formidables tyrans. Non-seulement cela n'est pas plus doux, mais cela n'est pas plus noble, Nous dépendons des choses au même titre que des hommes. Nous leur appartenons, comme aux despotes, par notre ignorance, notre incurie, notre lâcheté. Il est tel cas où un homme peut n'avoir pas à rougir de son indigence; mais pour un peuple, en général, être pauvre est tout aussi honteux qu'être esclave, et je sais tel pays qui n'est pas moins flétri par sa misère que par le peu de sûreté dont on y jouit. Un peuple n'est gueux, partout où la nature ne lui est pas trop contraire, que parce qu'il manque d'activité et de courage; il n'est dans la servitude ou l'anarchie que parce qu'il manque de justice et d'équité. Tout cela provient des mêmes causes générales, c'est-à-dire du défaut de culture. Mais revenons à notre sujet.
[I-188]
§ 7. Je disais donc que dans l'état sauvage l'homme ne sait encore tirer presque aucun parti de son intelligence et de ses forces : il n'est pas beaucoup plus habile à diriger ses sentimens. Il n'a point en-· core appris à mettre de la mesure dans ses actions à l'égard de lui-même et envers ses semblables; et y a dans son mode d'existence autant d'obstacles à la formation de ses mœurs qu'au développement de ses idées.
Comme la manière dont il pourvoit à ses besoins l'expose fréquemment aux horreurs de la faim, il est naturel qu'il mange avec voracité lorsque l'occasion s'en présente, et l'intempérance est une suite presque inévitable de sa situation [105] . D'un autre côté, comme il faut aux peuples chasseurs d'immenses terrains pour se nourrir, il est très-difficile, quelque peu nombreux qu'ils soient, qu'ils ne se disputent pas l'espace; et la guerre, avec toutes les passions qu'elle allume et qu'elle alimente, est encore, pour ainsi dire, une conséquence obligée de leur état [106] . L'intempérance et le penchant à l'hostilité sont donc deux vices [I-189] inséparables de la manière de vivre du sauvage; et certes, il suffit bien de ces deux vices pour prévenir chez lui le développement de toute bonne morale personnelle et relative.
§ 8. Le sauvage, considéré dans la portion de sa conduite qui n'a de rapport qu'à lui-même, semble presque entièrement destitué de moralité. L'homme moral sait résister aux séductions du moment; il sait se priver d'un plaisir dans la prévoyance du mal qui peut en être la suite. Le sauvage paraît tout-à-fait incapable de calcul; il cède sans résistance à l'impulsion de ses appétits; et telle est encore l'imperfection de ses mœurs, qu'il ne rougit pas même de son immoralité; il se livre à ses vices avec candeur et confiance, sans paraître soupçonner qu'il y ait dans cette conduite rien de funeste et de honteux.
Il me serait aisé de trouver dans les relations des meilleurs voyageurs de quoi confirmer ces remarques générales. On peut voir les détails qu'elles renferment sur les habitudes personnelles de l'homme encore inculte; sur sa voracité, son ivrognerie, son incontinence, son oisiveté, son apathie, son excessive imprévoyance; et l'on jugera aisément combien ses mœurs sont éloignées de ce caractère d'innocence et de pureté dont on a voulu faire l'apanage des peuples barbares, et qui n'appartient [I-190] véritablement qu'à la meilleure portion des sociétés très-cultivées [107] .
§ 9. La morale de relation de l'homme sauvage [I-191] ne vaut pas mieux que sa morale personnelle. Il ne paraît conduit dans ses rapports avec les autres que par des passions, comme il ne l'est envers lui-même que par des appétits; et il cède à ses affections [I-192] comme à ses appétits, remarque Fergusson, sans songer le moins du monde aux conséquences de ses actes [108] .
Sa conduite, observée dans les rapports de père, d'époux, d'enfant, est remplie d'actions brutales et cruelles. Abandonner l'enfant qu'on ne peut plus nourrir, le vieux parent qui ne peut plus marcher, et non-seulement les abandonner, mais les détruire, sont, d'après les récits des voyageurs, des actes ordinaires à cette époque de la vie sociale [109] . Les femmes surtout y sont maltraitées. Le mot de servitude est trop doux pour rendre l'état auquel elles sont réduites elles font à la fois l'office de servantes et de bêtes de somme. Péron, parlant de celles de la Nouvelle-Galle du sud, dit qu'on remarque en elles je ne sais quoi d'inquiet et d'abattu, [I-193] que la tyrannie imprime toujours au front de ses victimes, et il ajoute que presque toutes sont couvertes de cicatrices, tristes fruits des mauvais traitemens de leurs féroces époux [110] .
Il n'est pas d'âge où la société soit plus livrée à l'empire de la force. Nous sommes blessés des inégalités qu'elle présente encore: elle en offre alors de bien autrement cruelles; elle laisse en général le faible à la merci du fort; elle abandonne à chacun le soin de venger ses injures et de se [I-194] défendre comme il pourra contre ses ennemis particuliers [111] .
Il est vrai qu'on n'y cherche pas encore à s'asservir les uns les autres; on n'a point d'intérêt à cela: ferait-on de ses esclaves [112] ? les hommes, à cet âge, ne savent point encore comment il est possible de faire de l'homme un instrument. Mais s'ils ignorent comment il peut devenir un outil, ils savent très-bien comment il est un obstacle, et s'ils ne cherchent pas à s'asservir, c'est qu'ils trouvent mieux leur compte à s'entre-exterminer.
Ne cultivant pas la terre, et ses productions naturelles ne pouvant suffire qu'aux besoins d'un très-petit nombre d'individus, c'est à qui aura le peu qu'elle donne sans culture, et ils sont, comme [I-195] dit Cook, sans cesse occupés à s'entre – détruire, comme leur seule ressource contre la famine et la mort [113] .
Plus, dans cet état, il est difficile de vivre, et plus il est aisé de se diviser. Chaque tribu garde son gibier avec une attention jalouse : la moindre apparition des étrangers sur ses terres suffit pour lui mettre les armes à la main, Le simple accroissement d'une tribu voisine est regardé comme un acte d'agression [114] . La guerre, allumée par le besoin de défendre sa subsistance, est entretenue par le désir de se venger, le plus violent des sentimens que paraisse éprouver l'homme sauvage; plus l'intérêt en est grand, plus les sentimens qui y poussent sont impétueux et plus elle se fait avec furie. Joignez qu'elle est encore envenimée par la férocité naturelle du sauvage, passion tellement emportée, dit Robertson, qu'elle ressemble plutôt à la fureur d'instinct des animaux qu'à une passion humaine [115]
Divisés ainsi par des, haines cruelles, implacables, éternelles, les hommes, dans l'état que je décris, jouissent de beaucoup moins de sécurité qu'à aucun autre âge de la civilisation.
«Je suis fondé à croire, dit Cook, d'après mes propres observations [I-196] et les renseignemens que m'a fournis Taweiarooa, que les habitans de la Nouvelle-Zélande vivent dans une crainte perpétuelle d'être massacrés par leurs voisins. Il n'est pas de tribu qui ne croie avoir éprouvé de la part de telle autre quelque injustice ou quelque outrage dont elle est sans cesse occupée à tirer vengeance... La manière dont s'exécutent ces noirs projets est toujours la même : on fond, de nuit, sur l'ennemi qu'on veut détruire, et s'il est surpris sans défense, on tue tout, sans distinction d'âge ni de sexe... Ce perpétuel état de guerre, ajoute Cook, et la manière destructive dont elle se fait, produisent chez ces peuples une telle habitude de circonspection, que, de nuit ou de jour, on n'y voit aucun individu qui ne soit sur ses gardes [116]
Telles sont les relations des hommes sauvages: voilà comme ils usent entre eux de leurs facultés ; ils les emploient à subjuguer les femmes, à accabler la faiblesse, à se faire entre eux des guerres atroces et non interrompues.
§ 10. Sous quelque point de vue donc qu'on les considère, il est visible qu'ils sont infiniment moins libres que l'homme cultivé. Ils le sont moins physiquement: ils ont moins de force corporelle, [I-197] et ne sont pas capables, à beaucoup près, de tirer de leurs forces le même parti. Ils le sont moins intellectuellement : ils ont incomparablement moins d'esprit, d'industrie, de connaissances de toute espèce. Ils le sont moins moralement : ils n'ont, sous aucun rapport, aussi bien appris à régler leurs sentimens et leurs actions. Ils le sont moins, en un mot, dans toute leur manière d'être : ils sont exposés à une multitude de privations, de misères, d'infirmités, de violences dont l'homme civil sait se préserver par un usage plus étendu, plus juste et plus raisonnable de ses facultés. Voyez le sauvage dans les situations les plus ordinaires de sa vie, en proie à la famine que lui font souffrir son ignorance et sa paresse, dans l'état d'immobilité stupide où le retient son inertie, au sein de l'ivresse brutale où l'a plongé son intempérance, environné des périls qu'il a provoqués par ses fureurs; et vous reconnaîtrez qu'à aucun autre âge de la vie sociale l'homme ne fait de ses forces un usage aussi borné, aussi stérile, aussi violent, aussi dommageable, et que, par conséquent, à aucun autre âge il ne jouit d'aussi peu de liberté.
§ 11. Cependant, si l'on ne trouve pas la liberté dans l'état sauvage, on y en découvre les élémens; on y aperçoit quelques commencemens d'industrie, de morale, de justice. L'homme n'y est pas [I-198] exclusivement occupé à détruire; il s'y livre aussi quelquefois au travail paisible et productif; il construit une hutte; il la meuble de quelques ustensiles informes; il cultive quelquefois le sol qui l'entoure immédiatement; il échange contre des denrées, des outils, des ornemens, la dépouille des animaux qu'il a pris à la chasse. Qu'il porte davantage son activité dans ces directions; que l'agriculture, le commerce, les arts, deviennent ses principaux moyens d'existence, et nous verrons croître insensiblement sa liberté. Sa nouvelle manière de vivre exigeant plus de réflexion et d'étude, son esprit deviendra plus inventif; ses exercices étant plus modérés, son inertie sera moins profonde; sa subsistance étant plus assurée, il mangera avec plus de modération; la vie lui devenant plus facile, il aura moins de sujets de dispute, il menacera moins ses voisins, et en sera moins menacé; finalement l'usage de ses forces s'étendant et devenant par degrés moins préjudiciable, sa liberté croîtra dans la même proportion.
Il suffit done que l'homme sauvage fasse, à quelques égards, de ses forces un usage utile et non offensif, pour qu'on découvre les premiers élémens de la liberté dans sa manière de vivre. J'ai dit qu'elle existait en germe dans le peu d'industrie qu'il possède : elle existe aussi dans son impatience de toute suprématie factice, de toute injuste [I-199] domination. Le sauvage se soumet volontiers au chef qu'il a choisi pour le conduire à la guerre ou pour diriger les chasses entreprises en commun; mais il ne supporterait pas, en général, qu'un de ses pareils voulût s'arroger quelque autorité sur sa personne, et entreprendre de soumettre sa conduite à ses directions. Comme cet âge est celui où il y a le moins de sûreté, il est naturellement celui où l'homme est le plus disposé à la résistance, où il se montre le plus farouche, le plus ennemi de toute sujétion. Cette passion d'indépendance individuelle, cette personnalité du sauvage est un de ses plus énergiques sentimens, au moins dans les bonnes races; elle le rend capable d'actions héroïques; elle l'arme d'une patience invincible au sein des tourmens. Il n'est pas de torture qu'un prisonnier sauvage ne supporte, plutôt que de s'avouer vaincu ; et ce n'est pas seulement un courage passif que cette vertu lui inspire, elle lui donne quelquefois autant de valeur que de résolution. La guerre d'indépendance que les Araucans soutinrent contre les Espagnols, dit l'historien Molina, est comparable à tout ce qu'offrent de plus admirable, dans ce genre, les histoires anciennes et modernes de l'Europe. « Lorsque les Américains, dit Robertson, virent que les Espagnols les traitaient en esclaves, un grand nombre d'entre eux [I-200] moururent de douleur ou se tuèrent de désespoir [117] . »
§ 12. La suite de nos recherches va nous apprendre comment ce sentiment se modifie dans les âges subséquens de la société, et en général comment se développent les germes de liberté que nous venons d'apercevoir dans la vie sauvage.
[I-201]
CHAPITRE VI.
Liberté compatible avec la manière de vivre des peuples nomades [118] . ↩
§ 1. Dans le précédent chapitre, nous avons vu Rousseau faire de la liberté un attribut distinctif des peuples sauvages; dans celui-ci, nous allons voir d'autres écrivains la considérer, à leur tour, comme un apanage des peuples nomades.
« Ces peuples, dit Montesquieu, jouissent d'une grande liberté; car, comme ils ne cultivent point la terre, ils n'y sont point attachés : ils sont errans, vagabonds; et si un chef leur voulait ôter la liberté, ils l'iraient d'abord chercher chez un autre, ou se retireraient dans les bois pour y vivre avec leur famille [119] . »
Voilà donc que les peuples nomades sont libres, suivant Montesquieu, parce qu'ils peuvent se retirer dans les bois ; comme les peuples sauvages sont [I-202] libres, suivant Rousseau, parce que, si on les chasse d'un arbre, ils peuvent se réfugier au pied d'un autre. Il y a, comme on voit, beaucoup d'analogie dans les idées que ces deux grands écrivains paraissent se faire ici de la liberté.
A la vérité, ce que Montesquieu dit en cet endroit ne l'empêche pas de reconnaître, quelques pages plus loin, que les peuples nomades de la grande Tartarie sont dans l'esclavage politique [120] . Mais aussi déclare-t-il les Tartares le peuple le plus singulier de la terre ( ce sont ŝes, expressions).
Ces gens-là, dit-il, n'ont point de villes; ils n'ont -point de forêts, ils ont peu de marais; leurs rivières sont presque toujours glacées; ils habitent une plaine immense, ils ont des pâturages et des troupeaux, et par conséquent des biens, et ils n'ont aucune espèce de retraite [121] . Or, l'important, pour être libre, c'est de savoir où se réfugier, où fuir; c'est à pouvoir fuir que la liberté consiste; et la règle générale, c'est qu'on est d'autant plus libre qu'on peut se sauver plus aisément, qu'on est moins chargé de biens, qu'on ne tient point à la terre, qu'on ne la cultive point, qu'on n'a ni feu ni lieu, qu'on vit de pillage et de vol au sein d'une vie, errante et vagabonde.
[I-203]
Ces préjugés étaient ceux du temps où Montesquieu a écrit ; et si un esprit aussi éminent n'a pas su s'en défendre, on sent qu'il ne faut pas demander des idées plus justes à des écrivains d'un ordre moins élevé. J'ai cité Raynal à côté de l'auteur d'Émile: je peux faire parler Mably après l'auteur de l'Esprit des lois. « On jugera sans peine, dit Mably parlant des Francs, tandis qu'ils erraient encore à la suite de leurs troupeaux dans les forêts de la Germanie, on jugera sans peine qu'ils devaient être souverainement libres. » Et veut-on savoir pour quelle raison on en pourra porter ce jugement, d'après Mably? c'est qu'ils étaient un peuple fier, brutal, sans patrie, sans lois, ne vivant que de rapine [122] .
Assurément, voilà de singulières manières d'entendre la liberté. Un peuple est libre parce qu'il ne sait pas cultiver la terre, qu'il ne produit rien, qu'il ne possède rien, que rien ne l'empêche de fuir, qu'il ne vit que de pillage; parce qu'il est à la fois ignorant, brutal, intempérant, emporté, voleur. N'est-il pas étrange de voir des hommes comme Montesquieu, et même comme Mably, faire de la liberté l'apanage de moeurs pareilles?
§ 2. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit [I-204] précédemment de cette triste faculté de fuir, qui est le partage commun de tous les peuples errans et misérables, et dans laquelle on a voulu placer la liberté. La liberté ne consiste pas à pouvoir fuir quand on voudrait rester; mais à pouvoir rester ou partir, suivant qu'on le désire. Le nomade qu'on oblige de lever sa tente et d'abandonner ses pâturages, n'est pas plus libre que le sauvage qu'on expulse de sa cabane et de ses terres à gibier. Montesquieu l'a si bien senti, qu'il trouve les Tartares, tout misérables qu'ils sont, trop riches encore pour être libres; et il présente le peu de ressources qu'ils possèdent comme une des causes de leur assujettissement. Il ne voit pas que, ne possédassent-ils rien, on leur ferait encore violence en les forçant à fuir contre leur juste volonté, et que, par conséquent, il ne suffit, en aucun cas, de pouvoir fuir pour être libre. La servitude, d'ailleurs, n'est pas de ces maux auxquels on peut se dérober en fuyant ; elle est étroitement liée à la faiblesse, à l'ignorance, aux vices, aux injustices des hommes, et un peuple grossier et vicieux aurait beau changer de place, il la retrouverait partout où il irait s'établir.
Je dois remarquer, à ce sujet, combien est outré ce que dit Montesquieu de l'influence qu'exercent sur la liberté le climat, le sol et d'autres circonstances extérieures. Autant j'aime qu'il parle de la longue chevelure des rois francs, à propos [I-205] de la nature du terrain [123] , que de le voir expliquer la servitude de l'Asie par la neige qui manque à ses montagnes [124] , ou la liberté des anciens Athéniens par la stérilité du sol de l'Attique [125]
Il peut y avoir sûrement dans la constitution physique du pays qu'habitent les Tartares des obstacles assez forts à l'exercice des arts sur lesquels se fonde l'existence des peuples civilisés. Il est possible que le sol s'y refuse d'une manière plus ou moins absolue aux travaux de l'agriculture, que la fabrication et le commerce ne pussent que difficilement y faire des progrès, que les sciences qui se rapportent à l'exercice de ces arts y soient par cela même impossibles, que la grossièreté et la violence des mœurs y répondent à la barbarie forcée des esprits; il est possible, en un mot, que la nature du pays s'oppose plus ou moins à tous ces développemens qui permettent à un peuple de disposer avec facilité et avec étendue de ses forces, et qui constituent proprement la liberté.
Cependant, avouons que les Tartares ne sont pas esclaves, comme le dit Montesquieu, parce qu'ils n'ont point de villes, point de forêts, peu de [I-206] marais; et qu'il n'est ville, forêt ni marais qui pussent faire un peuple libre d'un peuple inculte comme les Tartares.
Avouons aussi que les peuples pasteurs ne sont pas libres, parce qu'ils sont errans et vagabonds: lorsque la faim, le froid, les maladies et la guerre, plus meurtrière encore, vinrent assaillir dans leur migration les Calmoucks partis des bords du Volga pour aller former un nouvel établissement' à la Chine, le grand nombre de ceux qui succombèrent ne trouvaient probablement pas que la vie errante fût très-favorable à la liberté [126] .
Les peuples nomades ne sont pas libres davantage, parce qu'ils sont ignorans l'ignorant ne sait point tirer parti de ses forces, et c'est mal prouver la liberté d'un homme que de dire qu'il ne peut faire aucun usage de ses facultés.
Ils ne le sont pas non plus, parce qu'ils sont intempérans : l'intempérance, qui use et déprave nos organes, est sûrement un mauvais moyen d'en faciliter le jeu, d'en étendre et d'en affermir l'exercice.
Ils ne le sont pas non plus, parce qu'ils sont fiers et brutaux: la brutalité du nomade, si elle le rend quelquefois impatient de la domination, le dispose habituellement à la violence, et la [I-207] violence est certainement un mauvais moyen de liberté.
Ils ne le sont pas non plus, parce qu'ils ne cultivent point la terre, qu'ils ne produisent rien, et ne vivent que de proie tout peuple pillard est menacé de pillage. Montesquieu, parlant des ravages que les hordes errantes de la Germanie venaient exercer dans l'empire romain, dit que les destructeurs étaient sans cesse détruits [127] leur destruction était donc la conséquence naturelle de leur manière de vivre. Ce résultat n'indique pas qu'elle fût très-favorable à leur liberté
Ainsi, tout ce que disent Montesquieu et Mably pour établir que les peuples nomades. sont libres, 1prouvé tout au contraire qu'ils ne le sont pas. Des 1hommes qui ne cultivent pas la terre, qui n'exercent aucun art, qui sont ignorans, débauchés, violens, ne sauraient être des hommes libres. Il ne peut y avoir de liberté véritable qu'au sein des pays où l'on possède de l'industrie et des lumières, et où l'on sait plier ses forces aux règles de la morale et de l'équité.
§ 5. Si, prenant ainsi la liberté dans son acception véritable, je veux chercher maintenant quelle est celle dont jouissent les peuples pasteurs, [I-208] je serai conduit à reconnaître qu'ils sont un peu plus libres que les nations sauvages. En effet, leur esprit ne se meut pas dans un cercle aussi étroit; ils savent faire un usage un peu plus étendu de leurs facultés naturelles; ils savent mieux se nourrir, s'abriter, se vêtir; leur nourriture est à la fois plus saine, plus abondante et moins précaire; leurs vêtemens sont aussi meilleurs, et on n'en voit pas d'absolument nus; enfin la tente du nomade, toute grossière qu'elle est, vaut pourtant mieux que la hutte du sauvage.
J'ai dit qu'on apercevait quelquefois chez les peuples chasseurs de faibles commencemens d'agriculture; on les retrouve avec un peu plus d'extension chez certains peuples pasteurs. Ces peuples commencent à faire usage des métaux; ils ont subjugué plusieurs espèces d'animaux, et les ont pliés à diverses sortes de services. Leur industrie manufacturière est un peu plus avancée que celle des peuplés chasseurs : ils construisent des chariots ; ils fabriquent de meilleures armes, ils fou-dent le feutre, filent la laine, tissent quelques grossières étoffes. Ils ont aussi sur le commerce, les échanges, le calcul, des notions plus étendues que les sauvages. Enfin, comme ils sont en général plus industrieux, ils ne se trouvent pas sous le joug de nécessités aussi cruelles: ils ne tuent point, par exemple, une partie de leurs enfans, faute de pouvoir [I-209] voir les nourrir tous; si une mère vient à mourir pendant la durée de l'allaitement, ils ne se croient pas obligés d'étouffer sur son sein le fruit de ses entrailles; enfin, comme ils possèdent quelques moyens de transport, ils peuvent, dans leurs fréquentes émigrations, emporter avec eux leurs vieux parens, et il ne paraît pas qu'ils soient jamais réduits à regarder le parricide comme un bon office [128] .
Les peuples nomades savent donc faire de leurs facultés un usage un peu plus étendu que les peuples sauvages. D'une autre part, ils savent en faire vis-à-vis d'eux-mêmes un usage un peu mieux réglé: habituellement moins affamés, ils ne mangent pas, dans l'occasion, avec le même excès d'intempérance; leur ivresse a peut-être quelque chose de moins brutal; leurs fatigues étant moins outrées, ils sont moins enclins à la paresse; leur repos n'offre pas le même caractère d'apathie et de stupidité. Ils sont donc en général plus dispos, plus maîtres d'eux-mêmes; et, sous ce second point de vue, ils peuvent user de leurs forces avec plus de liberté.
Enfin, les peuples nomades commencent à mettre [I-210] quelque calcul dans leurs relations avec les autres hommes, et, sous ce rapport encore, ils sont supérieurs aux peuples chasseurs. Le sauvage ne faisait la guerre que pour exterminer ses ennemis: le nomade me se propose pas toujours de les détruire; il est capable de concevoir la pensée de les asservir, et ceci même, chose singulière ! est un progrès vers la liberté. L'intérêt, qui, à cet âge de la civilisation, persuade déjà à l'homme de ne plus massacrer ses prisonniers, lui persuadera plus tard de ne plus faire la guerre, et donnera par degrés une tendance moins violente et moins destructive à son activité. On est donc déjà plus près d'être libre. On est même déjà plus libre par le fait: comme le meurtre et la dévastation ne sont plus l'unique fin de la guerre, elle ne se fait peut-être pas avec le même degré d'exaltation et de fureur; elle n'excite pas des ressentimens aussi violens, aussi implacables [129] : il y a donc un peu plus de sécurité; la liberté souffre moins aussi des suites immédiates de la guerre; car, quels que soient les malheurs de la servitude, il vaut mieux encore être pris pour être réduit en esclavage, que d'être pris pour être attaché à un épieu, mutilé, déchiré, brûlé, dévoré; et un esclave a beau être esclave, [I-211] il est pourtant plus libre qu'un homme mort. Soit donc que l'on considère les peuples nomades dans leurs relations avec les choses, avec eux-mêmes, avec leurs semblables, on trouve qu'ils font de leurs facultés un usage un peu moins borné, moins stupide, moins déréglé, moins violent que les peuples sauvages, et qu'en conséquence ils jouissent, sous tous ces rapports, d'un peu plus de liberté.
§ 4. Cependant, ces progrès sont loin encore d'être très-sensibles; et, quand je dis qu'ils font de leurs forces un usage un peu moins aveugle et moins emporté, je ne prétends pas dire assurément qu'ils s'en servent d'une manière bien éclairée et bien morale. Quoique logés, nourris, vêtus un peu moins misérablement que les peuples chasseurs, ils ne savent pourtant encore pourvoir que très-imparfaitement aux premières nécessités de la vie physique. Les anciens Scythes, suivant Justin [130] , n'avaient pour tout logement que des chariots couverts de peaux. C'est encore là l'unique abri de la plupart des peuples tartares. Les Germains ne savaient employer dans la construction de leurs habitations ni la pierre, ni la brique, ni le ciment, ni la chaux: leurs demeures n'étaient que des huttes [I-212] basses et grossières, construites de bois non façonné, couvertes de chaume, et percées à leur sommité pour laisser à la fumée un libre passage. Quelquefois même ils n'avaient pour asile que des souterrains obscurs, qu'ils recouvraient d'une couche épaisse de fumier [131] .
Le vêtement des peuples pasteurs est encore plus grossier que leurs demeures. S'ils ne sont pas dans un état d'absolue nudité, comme plusieurs peuples sauvages, ils sont en général découverts de plus de la moitié du corps. Tacite et César s'accordent à dire que les Germains n'avaient, pour se défendre contre la rigueur du froid, qu'un léger manteau formé de la peau de quelque animal, qu'ils fixaient sur les épaules avec une agrafe et plus souvent avec une épine, et qui laissait la plus grande partie de leur corps à nu [132] . La tunique que joignaient à ce vêtement la plupart des femmes germaines n'était qu'une espèce de sac de toile grossière, qui ne leur voilait ni les jambes, ni les bras, et qui laissait à découvert tout le haut de leur poitrine [133]
Les nations pastorales trouvent un aliment sain et substantiel dans le lait et la chair des troupeaux dont elles font leur principale nourriture; mais [I-213] plus cette nourriture est aisée à obtenir, plus la population s'élève rapidement au niveau de ce faible moyen de subsistance, et, quand elles ont épuisé cette ressource, elles ne savent y suppléer que fort imparfaitement elles ne tirent presque rien du sol par la culture. Outre que les pays qu'elles habitent y sont généralement peu propres, elles sont encore plus détournées de s'y livrer par leur paresse et par la férocité de leurs mœurs que par l'aridité du sol. Les Usbecks de la Grande-Bucharie, dit l'auteur de l'Histoire généalogique des Tartares, ne sont excités ni par la fécondité singulière de leur pays, ni par la prospérité de ceux qui le cultivent, à se livrer aux arts paisibles de l'agriculture et du commerce [134] . Les Germains, au rapport de Tacite, ne répondaient guère mieux à la fertilité de leur contrée : ils ne lui faisaient produire que très-peu de blé [135] , et tous les fruits qu'ils mangeaient étaient sauvages [136] .
D'ailleurs, la paresse et la grossièreté des peuples. pasteurs ne sont pas la seule cause qui arrête les progrès de leur agriculture; elle est encore arrêtée par leurs continuels déplacemens, qui ne leur permettent de faire aucune accumulation, de donner aucune suite à leurs travaux ; elle l'est surtout par [I-214] leurs éternelles déprédations, qui ne laissent au laboureur aucun espoir de recueillir le fruit de ses peines [137] ; elle l'est enfin par les précautions mêmes qu'ils prennent quelquefois pour empêcher qu'elle ne fasse trop de progrès, qu'elle n'adoucisse leurs mœurs, et ne finisse par les dégoûter du brigandage. C'est dans cet esprit que les Germains faisaient tous les ans un nouveau partage du sol [138] . Ils craignaient, dit César, que les charmes de la propriété ne leur fissent enfin quitter la guerre et les armes pour les douces occupations de la culture [139] .
En somme, les peuples, à ce second âge de la civilisation, n'exécutent encore que des travaux singulièrement grossiers. Pour se faire une idée de l'imperfection de leurs arts, il suffit de dire qu'ils [I-215] ignorent l'écriture [140] , et qu'en général la monnaie manque à leurs échanges, et le fer à leur industrie [141] . Aussi sont-ils excessivement misérables. Le commun des Bédouins, dit M. de Volney, vit dans un état habituel de misère et de famine. La frugalité des Arabes, ajoute-t-il, n'est pas une vertu de choix; elle leur est commandée par la nécessité des circonstances où ils se trouvent [142] . Les Calmoucks, suivant Pallas, mouraient de faim eu sein des steppes fertiles du Volga; les hommes des dernières classes y étaient plongés dans la plus profonde misère. Ils étaient habituellement réduits à faire usage de toutes les espèces d'animaux, de plantes et de racines qui pouvaient leur fournir quelque aliment: des chevaux usés ou blessés, des bêtes mortes de maladie, pourvu qu'elles n'eussent succombé à aucune maladie contagieuse, étaient pour eux un véritable régal. Ils allaient jusqu'à manger des animaux tombés en putréfaction; et telle était la détresse des plus misérables, qu'ils étaient quelquefois réduits, pour tromper leur faim, à dévorer la fiente des bestiaux [143] .
[I-216]
§ 5. Si les peuples nomades pourvoient encore si mal à leurs besoins, ils ne savent guère mieux régler leurs appétits, et la grossièreté de leur industrie se reproduit dans leur morale. Privés de tous les arts qui pourraient occuper leurs loisirs, ils passent à manger ou à dormir le temps que ne remplissent pas les exercices violens de la guerre ou de la chasse ; des esclaves gardent leurs troupeaux, leurs femmes vaquent aux travaux domestiques, et ils se reposent. Plus est profonde leur oisiveté, plus ils ont besoin d'émotions fortes pour sortir de leur engourdissement, et c'est de leur indolence même que naissent leurs passions les plus fougueuses [144] . Ils se livrent sans aucune mesure aux excès de la boisson et du jeu. Les Germains avaient un goût si effréné pour les liqueurs enivrantes, qu'il était aussi facile, au rapport de Tacite, de les détruire par la boisson que par la guerre [145] . Ils mettaient leur gloire à rester des jours entiers à table, et l'ivresse où ils se plongeaient était si brutale, qu'il était rare de ne pas voir ces parties de débauche finir par des rixes [I-217] sanglantes [146] . Tel était enfin le bonheur qu'ils trouvaient à satisfaire leur passion pour les liqueurs fermentées, qu'ils n'en voyaient pas de plus doux à promettre à leurs guerriers après une mort glorieuse ; et plusieurs de leurs tribus avaient imaginé une sorte de paradis grossier où les héros devaient s'enivrer durant la vie éternelle [147] .
Un seul trait suffit pour montrer avec quel emportement ils se livraient au jeu. Quand ils avaient tout perdu, ils se jouaient eux-mêmes, dit Tacite; et ces caractères indomptables, qui ne pouvaient souffrir aucun frein, même à leurs violences, mettaient leur liberté et leur personne au hasard d'un coup de dé [148] .
Les peuples nomades, quoique moins malheureux que les sauvages, semblent être encore beaucoup trop exposés à la misère pour être très-enclins aux plaisirs de l'amour; cependant, il s'en faut qu'ils aient, à cet égard, des mœurs sévères, et même qu'ils soient capables d'imposer quelque gêne à leurs désirs. Au nombre des causes les plus fréquentes de leurs querelles, on peut placer les enlèvemens de femmes. Ils en épousent ordinairement plusieurs, et s'entourent, quand ils le peuvent, [I-218] d'un nombre illimité de concubines. Tacite, en disant que les Germains se contentaient d'une seule femme, observe qu'ils étaient les seuls barbares qui montrassent à cet égard tant de retenue[149] . Encore l'exception chez eux n'était-elle pas générale, ni peut-être bien réelle ; et des écrivains judicieux ont pensé que, dans son éloge de la continence des Germains, Tacite s'était un peu laissé aller au noble plaisir d'opposer la pureté de pâtres grossiers aux mœurs dissolues des dames romaines [150] .
On retrouve done dans les habitudes privées des peuples pasteurs la plupart des vices des nations sauvages; et, bien que ces vices n'aient peut-être pas chez eux le même degré de violence et de brutalité, il n'est pas douteux que leurs facultés n'en soient fort altérées, et que leur liberté n'en reçoive de graves atteintes.
[I-219]
§ 6. Ajoutons ici que leur liberté n'a pas moins à souffrir des excès auxquels ils se livrent les uns envers les autres, que de ceux où ils tombent à l'égard d'eux-mêmes. Leur vie, dans les relations de peuple à peuple, n'est qu'un tissu d'horribles violences, et l'usage qu'ils font de leurs forces dans l'intérieur de chaque tribu n'est pas, à beaucoup d'égards, plus modéré.
Quoique les femmes, parmi eux, ne soient pas traitées avec le même degré de mépris et de dureté que chez les peuples sauvages, elles s'y trouvent encore dans un profond état de dépendance et d'avilissement. Tandis que leurs maris peuvent avoir plusieurs épouses et faire des concubines de toutes leurs captives, la moindre infidélité de leur part les exposerait à des châtimens rigoureux. C'est sur elles que pèsent tous les travaux de la vie domestique: elles dressent les tentes, fabriquent le feutre qui doit les couvrir, préparent les fourrures qui serviront de manteaux à leurs maris, apprêtent leur repas, le leur servent, et ne sont pas admises à le partager, font à tous égards l'office d'esclaves, sont enfin soumises, ainsi que leurs enfans, à une autorité qui ne connaît point de limites, et dont le mari abuse quelquefois jusqu'à vendre comme esclaves la mère et les enfans [151] .
[I-220]
Ici, comme je l'ai dit, les prisonniers ne sont pas toujours massacrés, mais ils sont alors asservis, et ce n'est pas une douce destinée que d'être l'esclave d'un Maure, d'un Arabe, d'un Tartare. Fergusson cite le propos d'un Grec qui aimait mieux, disait-il, être esclave des Scythes que citoyen de Rome [152] . Ce Grec faisait de Rome une satire trop forte. Je ne crois pas que le sort des Romains ait jamais été bien digne d'envie; mais il y avait sûrement encore assez loin de la condition d'un citoyen romain à celle de l'esclave d'un barbare. Tacite, qui s'efforce d'atténuer les maux que souffraient chez les Germains les hommes enchaînés à la glèbe, reconnaît pourtant que leurs maîtres, dans un accès de colère, pouvaient impunément leur ôter la vie [153] .
Voilà donc chez les peuples pasteurs plusieurs classes de personnes, les femmes, les enfans, les esclaves, qui vivent sous l'empire absolu de la violence et de la force. Le guerrier lui-même n'y est pas à l'abri de toute sujétion. Ses terreurs superstitieuses le livrent sans défense au despotisme de [I-221] ses prêtres; et, d'une autre part, la nécessité de la discipline, au sein des guerres éternelles où il est engagé, le force à se soumettre presque aveuglément à la volonté de ses généraux. Le Germain, qui ne voulait plier sous aucune espèce de justice humaine, se laissait patiemment battre de verges par le ministre du dieu des batailles [154] . Le Tartare, qui ne reconnaît habituellement aucune espèce d'autorité, jure, lorsqu'il s'unit à son kan pour quelque expédition militaire, d'aller partout où il l'enverra, d'arriver sitôt qu'il l'appellera, de tuer quiconque il lui désignera, de considérer dorénavant sa parole comme une épée [155] : il ne met plus de bornes à sa dépendance.
Enfin, tandis que dans l'intérieur du camp tout le monde subit quelque espèce de sujétion arbitraire, la horde tout entière est dans un péril continuel d'être assaillie, pillée, asservie. C'est la suite toute naturelle des violences qu'elle ne cesse de commettre, de l'état permanent d'hostilité dans lequel elle vit avec d'autres tribus. L'homme, à cet âge de la société, n'est encore qu'un animal de proie; les nations ne sont que des bandes de voleurs. L'universelle occupation est de chercher où l'on pourra trouver du butin à faire, et d'aviser par [I-222] quel moyen on parviendra le plus sûrement à s'en saisir [156] .
Fergusson veut que la liberté ne soit pas incompatible avec un tel ordre de choses.
«Dans les âges de barbarie, dit-il, les hommes ne manquent de sûreté ni pour leurs personnes ni pour leurs biens. Chacun, il est vrai, a des ennemis; mais chacun aussi a des amis; et si l'on court le risque d'être attaqué, on est sûr d'être secouru[157] . »
Ce raisonnement est un pur sophisme. Il est véritablement insensé de placer ainsi la sécurité au sein de la guerre et des alarmes; autant vaudrait dire que, sur un champ de bataille, il y a aussi de la sûreté pour les personnes et pour les biens. En effet, si on a les ennemis en face, n'est-on pas entouré de ses amis, et si l'attaque est imminente, la défense n'est-elle pas assurée ? Cependant qui oserait dire qu'on est en sûreté sur un champ de bataille? Eh bien ! on ne l'est pas davantage dans l'état social que je décris. La terre, à cet âge de la civilisation, n'est qu'un vaste champ de guerre où les hommes sont perpétuellement aux prises, où chacun est, tour à tour, assaillant ou assailli, [I-223] pillard ou pillé, massacreur ou massacré, maître ou esclave. Il n'y a pas de sûreté dans l'Arabie, même pour les pasteurs arabes [158] . Les Tartares s'entr'exterminent au sein de leurs déserts; les Germains, les Normands, toutes les hordes de barbares qui, à différentes époques, se sont précipitées du nord de l'Europe sur le midi, ne jouissaient d'aucune sûreté dans le cours de leurs déprédations et de leurs ravages : les destructeurs, comme dit Montesquieu, étaient perpétuellement détruits.
§ 7. Bien donc que les peuples pasteurs, considérés dans leurs travaux industriels, et dans leur morale personnelle et sociale, soient un peu plus avancés que les peuples chasseurs, il est certain que, sous tous ces rapports, ils font encore un usage très-grossier et très-violent de leurs facultés, et qu'à cet âge de la vie sociale, par conséquent, l'homme ne peut encore jouir que d'une liberté fort imparfaite.
§ 8. Je dois ajouter que le principe des violences et de la brutalité des peuples pasteurs est dans ła manière même dont ils pourvoient à leurs besoins, dans leur état de nations pastorales. Quoi [I-224] que la terre, dans ce nouvel état, puisse nourrir un peu plus d'habitans que sous le régime économique des peuples chasseurs, la quantité d'alimens qu'elle peut produire est encore excessivement bornée, et les hommes, comme au premier âge de la civilisation, sont invinciblement entraînés à lutter pour leur subsistance.
La vie pastorale a ceci de particulier qu'elle est de tous les modes d'existence celui où l'homme obtient avec plus de facilité les ressources propres à chaque manière de vivre. Le chasseur ne trouve et n'atteint ordinairement sa proie qu'avec beaucoup d'efforts; l'agriculteur ne féconde son champ qu'avec de grandes peines: le pasteur, au contraire, recueille presque sans fatigue ce que peuvent lui donner ses pâturages et ses troupeaux. Cette manière de vivre est donc celle où doit se produire et se renouveler le plus facilement, non pas une population très-forte, mais une population supérieure aux moyens d'exister, une population excédante [159] . Par conséquent, elle est celle où la population doit sentir le plus souvent le besoin de sortir du pays, de former des entreprises guerrières. D'autres causes encore fomentent en elle cet [I-225] esprit de conquête et d'émigration : le genre d'industrie sur lequel est fondée sa subsistance se concilie très-bien avec les nécessités de la vie militaire; ses troupeaux, qui lui servent d'aliment, lui servent aussi de véhicule; elle se transporte par le même moyen qu'elle se nourrit, et le principe de ses entreprises est dans la même source que celui de sa vie; d'ailleurs elle est toujours assemblée, elle est armée, elle est désœuvrée, son désœuvrement l'ennuie, la famine l'aiguillonne, la vue de ses forces réunies et l'habitude qu'elle a de se mouvoir en masse excitent sa confiance et son audace... Elle est donc irrésistiblement poussée au brigandage, à la guerre, aux invasions.
De là ces irruptions formidables des peuples pasteurs du Nord vers le Midi, à une époque où le Midi n'était encore que très-faiblement peuplé, et l'excessive facilité avec laquelle ces peuples réparaient leurs pertes et recommençaient leurs attaques [160] . On ne vit la fin de leurs invasions que [I-226] lorsqu'ils eurent successivement occupé les plus beaux pays de la terre, qu'ils s'y furent établis, qu'un certain degré de civilisation y eut développé leurs forces, et que les derniers venus de ces peuples trouvèrent enfin devant eux des populations trop nombreuses et trop puissantes pour pouvoir essayer de les détruire ou de les déloger [161] . Maintenant, et depuis plusieurs siècles, toute nouvelle entreprise de ce genre leur est devenue décidément impossible, et le reste de ces hordes barbares se trouve à jamais confiné dans les déserts brûlans de l'Afrique, ou dans les régions les plus élevées et les plus froides de l'Asie. Mais les mêmes causes continuent à produire parmi elles des effets [I-227] semblables; et désormais trop faibles pour pouvoir attaquer les nations civilisées, elles consument l'excédant de leur population dans leurs querelles mutuelles et sans cesse renaissantes.
La guerre est donc la suite inévitable du mode imparfait de subsistance adopté par les peuples pasteurs. Pour achever de faire sentir combien cette remarque est fondée, il suffit de dire que chez les Arabes la tradition a conservé, seulement pour les temps antérieurs à Mahomet, le souvenir de dix-sept cents batailles, et de rappeler cette trève annuelle de deux mois qu'ils observaient aveć une fidélité religieuse, et qui caractérisait avec encore plus de force, comme l'observe Gibbon, leurs constantes habitudes d'anarchie et d'hostilité [162] .
Si la guerre est une chose forcée dans la vie pastorale, l'ignorance et les excès de tout genre qui s'opposent au développement de la liberté y sont, à leur tour, des suites inévitables de la guerre. Le barbare, qui croit améliorer son sort par le pillage, ne fait qu'arrêter toute production, et se rendre de plus en plus misérable. La misère, en croissant, fortifie son penchant à la rapine, et le rend toujours plus incapable de faire de ses forces un utile emploi. Son incurable paresse naît, comme [I-228] son ignorance, de ses exercices violens; son intempérance et ses débauches naissent, à leur tour, de sa paresse tous ses vices sont ainsi la conséquence de son état social. L'esclavage de ses serviteurs, celui de sa femme; ses disputes, ses rixes sanglantes, sa dépendance politique et religieuse découlent de la même source. C'est parce qu'il fait la guerre qu'il a besoin de se soumettre à la volonté arbitraire d'autrui; c'est parce qu'il fait la guerre qu'il est ignorant, par conséquent superstitieux, par conséquent sous le joug de ses prêtres; c'est parce qu'il fait la guerre qu'il veut vider toutes ses querelles comme on les vide à la guerre, c'est-à-dire à main armée; c'est parce qu'il fait la guerre, et que la guerre le rend fainéant et brutal, qu'il néglige tous les travaux utiles, et en rejette le fardeau sur les êtres les moins capables de le supporter. Finalement, tout ce qu'il y a de grossier dans son esprit et dans ses mœurs naît de son état habituel de guerre, qui, de son côté, est l'accompagnement en quelque sorte obligé de l'état pastoral.
§ 9. Toutefois, on retrouve dans cet état les germes de liberté que j'ai fait apercevoir dans celui qui précède, et, comme je l'ai dit d'abord, on les y retrouve plus développés. Il y a un peu plus d'industrie, un peu plus d'instruction, un [I-229] peu moins de férocité; on entre en composition pour les injures et pour le meurtre; on maltraite moins les femmes; on n'extermine pas toujours les prisonniers, et il n'arrive jamais qu'on les dévore, comme cela se pratique quelquefois dans l'âge précédent.
Seulement, comme les périls et les maux sont moins grands, les mœurs ne sont plus tout-à-fait aussi farouches, et il semble que le sentiment de l'indépendance individuelle ait déjà perdu quelque chose de son âpre énergie. Quelque sauvage que fût la vertu de ces femmes cimbres, qui, au moment d'une déroute, s'efforçaient de soustraire par la mort leurs parens à la servitude, étouffaient leurs enfans de leurs propres mains, les foulaient aux pieds des chevaux, et finissaient par se tuer elles-mêmes [163] , il y a loin pourtant de cette frénésie à la fanatique obstination de ce sauvage qui, attaché à l'épieu fatal, subit, plutôt que de s'avouer vaincu, les plus effroyables tortures; qui, pour quelque danger de la mort voisine, ne relasche aucun point de son asseurance, et qui expire, comme dit Montaigne, en faisant la moue à ses bourreaux [164] .
[I-230]
§ 10. Nous allons voir maintenant ce que deviennent ces progrès chez les peuples sédentaires; et, procédant par ordre, nous examinerons d'abord quelle liberté comporte la manière de vivre de ceux de ces peuples qui se font entretenir par des hommes asservis.
[I-231]
CHAPITRE VII.
Liberté compatible avec la manière de vivre des peuples sédentaires qui se font entretenir par des esclaves.↩
§ 1. L'homme fait d'abord sa principale nourriture de fruits et d'animaux sauvages; puis du lait et de la chair des animaux qu'il a subjugués; puis des produits du sol qu'il fait cultiver par son esclave. Il ne passe qu'avec une extrême lenteur de l'un de ces états à l'autre ; et, quelque barbare que soit encore le dernier, on est obligé de reconnaître qu'il se trouve à une longue distance de ceux qui le précèdent, et qu'il y a déjà un grand espace de parcouru dans la route de la civilisation. Le guerrier sauvage ne fait point d'esclaves : ses passions sont encore trop impétueuses; et, d'ailleurs, quel moyen aurait-il de les garder, et à quel usage les emploierait-il? Le guerrier nomade n'en fait qu'autant qu'il en peut vendre : il lui en faut peu pour la garde de ses troupeaux et pour l'exploitation du peu de terres qu'il livre à la culture; mais, à mesure que les produits du sol entrent pour une plus grande part dans la nourriture de l'homme barbare, le nombre des captifs qu'il fait à la guerre [I-232] devient plus considérable : le labour succédant au pâturage, il met des esclaves à la place des troupeaux, et finit par faire sa principale ressource de l'asservissement de ses semblables.
Je ne connais point d'expression propre à désigner l'état des peuples qui se font nourrir ainsi par des hommes vaincus et enchaînés à la glèbe. Le nom de peuples agricoles qu'on leur a donné ne leur paraît guère applicable; ce nom appartiendrait à l'esclave qui féconde la terre plutôt qu'au barbare qui vit de ses sueurs. En général, il serait plus convenable de donner aux peuples encore barbares des noms pris de la guerre, que des noms empruntés à l'industrie. On devrait, à ce qu'il semble, réserver ceux-ci pour les nations qui ont abjuré toute violence, tout brigandage, toute sujétion forcée d'une classe à un autre, tout esprit de monopole et de domination, et fondé constitutionnellement leur existence sur le travail et les échanges de services.
Toutefois, pour n'avoir pas de dénomination qui lui convienne, l'état dont je parle n'en a pas été moins réel, ni moins général. Il n'est pas de nation qui, en passant de la vie errante à la vie sédentaire, n'ait été d'abord, et pendant fort longtemps, entretenue par des hommes asservis. Les peuples de l'antiquité ne connurent jamais d'autre manière de vivre. On voit dans la Genèse que, du [I-233] temps des patriarches, l'esclavage existait déjà chez les Hébreux, et qu'Abraham possédait un nombre considérable d'esclaves [165] : c'étaient des esclaves qui pourvoyaient à la subsistance des anciens Grecs. Rome eut des esclaves dès son origine, et le nombre chez elle, ainsi que chez les Grecs, s'en accrut, avec le temps, d'une manière presque infinie. Il y avait à Athènes, du temps de Démétrius de Phalère, quatre cent mille esclaves pour nourrir vingt mille citoyens. Rome, à la fin de la république, comptait moitié moins de citoyens que d'esclaves. César trouva l'esclavage établi chez les Gaulois. Lorsque les peuples barbares du nord de l'Europe s'établirent et se fixèrent dans le midi, ils eurent partout des esclaves pour travailler à la terre et produire les choses nécessaires à leurs besoins. Dans toutes les parties du monde où les Européens ont pénétré : en Afrique, en Amérique, dans les îles de la mer du Sud, partout où ils ont trouvé un commencement de culture, ils ont vu ce qui s'opérait de travail utile exécuté par des hommes plus ou moins asservis. Je ne sache pas finalement que l'histoire ancienne nous fasse connaître, ni qu'on ait découvert dans les temps modernes de société ayant un commencement [I-234] d'industrie et d'agriculture, chez qui le travail fùt exécuté par des hommes libres, ou chez qui les hommes libres eussent commencé par chercher dans le travail les moyens de pourvoir à leurs besoins. Partout la première disposition des forts a été de se faire servir par les faibles, et l'esclavage des professions utiles a été le régime économique de toute société nouvellement fixée [166] .
§ 2. Il semble dérisoire de demander si la liberté est compatible avec un état social où la moitié, les trois quarts, et quelquefois une portion beaucoup plus considérable de la population se [I-235] trouve ainsi la propriété de l'autre : aussi la question n'est-elle pas de savoir si cette portion de la population est libre, mais si celle qui a fondé sa subsistance sur son asservissement peut jouir de la liberté; si la liberté est compatible avec la manière de vivre des peuples qui se font entretenir par des esclaves.
Bien des gens peut-être décideraient encore cette question affirmativement. Qui n'a considéré les peuples de l'antiquité comme des peuples essentiellement libres? Qui n'a entendu parler de la liberté des Grecs et des Romains? Combien de temps, en fait de liberté, n'avons-nous pas puisé [I-236] chez eux nos autorités et nos exemples? Rousseau appelle quelque part les Romains le modèle de tous les peuples libres. Il dit, en parlant des Grecs: « Des esclaves faisaient leurs travaux; leur grande affaire, c'était la liberté [167] . » Il est si loin de considérer la liberté comme inconciliable avec le mode d'existence des peuples qui font exécuter leurs travaux par des esclaves, qu'il fait assez clairement de l'esclavage une condition de la liberté.
« Quoi! se demande-t-il, la liberté ne se maintient qu'à l'appui de la servitude? peut-être. Tout ce qui n'est pas dans la nature a ses inconvéniens, et la société civile plus que tout le reste. Il y a des positions malheureuses où l'on ne peut conserver sa liberté qu'aux dépens de celle d'autrui, et où le citoyen ne peut être parfaitement libre que l'esclave ne soit extrêmement esclave... Pour vous, peuples modernes, ajoute-t-il, vous n'avez pas d'esclaves, mais vous l'êtes; vous payez leur liberté de la vôtre [168] . »
Rousseau avait dit d'abord qu'on ne pouvait être libre que dans la vie sauvage, et en s'abstenant de toute industrie, de tout progrès. Il paraît ajouter maintenant que si l'on veut vivre dans un état aussi hors de nature que la société, il faut au moins, pour être libre, faire exécuter ses travaux [I-237] par des esclaves. Cette nouvelle proposition est-elle plus admissible que la première ?
Nous avons vu que les hommes ne sont libres qu'en proportion du développement qu'ils donnent à leurs facultés : bien loin donc que, pour jouir d'une grande liberté, ils doivent se faire nourrir par des esclaves, il est évident que s'ils se déchargent sur des esclaves du soin d'exécuter leurs travaux, leurs facultés resteront incultes, et qu'ils n'acquerront que très-imparfaitement la liberté de s'en servir. Nous avons vu que, dans la société, tout le monde dispose d'autant plus librement de ses forces, que chacun sait mieux en renfermer l'usage dans les bornes de ce qui ne nuit point : bien loin donc que, pour être libre, il soit nécessaire d'asservir une partie de ses semblables, il est visible que celui qui fonde sa liberté sur la servitude d'autrui n'établit par-là que sa propre servitude, qu'il se place dans une situation violente où il est sans cesse obligé de se tenir en garde contre ceux qu'il opprime, et où il est ainsi plus ou moins. privé de la libre disposition de ses mouvemens. On peut donc apercevoir déjà que les peuples qui se veulent faire nourrir par des esclaves fondent leur existence sur une ressource naturellement contraire à la liberté.
§ 3. Je commencerai pourtant par reconnaître [I-238] que la liberté est un peu moins incompatible avec ce nouveau mode d'existence qu'avec le précédent, de même qu'elle l'était moins avec celui-ci qu'avec celui qui l'avait précédé. La raison en est simple c'est que cette nouvelle manière de vivre est un peu moins violente et moins destructive. L'homme fondant ici sa subsistance, sur les produits du travail de l'homme, il est impossible que les facultés humaines restent dans le même état d'inertie et d'abrutissement. Précédemment, on asservissait ses ennemis pour en faire des pâtres; maintenant on les asservit pour en faire des laboureurs, des artisans, comme on les asservira plus tard pour en faire des rhéteurs, des grammairiens, des instituteurs. Or, il est aisé de voir que ces nouvelles destinations données à l'esclave rendent l'esclavage moins ennemi de la civilisation et de la liberté. D'une autre part, la liberté a moins à souffrir des suites de la guerre. Dans l'état pastoral, le guerrier voulait tout convertir en pâturages et en déserts: il rasait les villes, massacrait les populations, et n'épargnait que le petit nombre de captifs qu'il se croyait assuré de vendre, ou qu'il pouvait employer à la garde de ses troupeaux [169] . Dans l'état actuel, il pille peut-être davantage, mais il [I-239] détruit moins; il asservit plus d'hommes, mais il n'en extermine pas un aussi grand nombre: il ne commet que les ravages et les massacres indispensables au but de la guerre, qui est la conquête du terrain et la réduction des habitans à l'état d'esclaves ou de tributaires [170] . Il est manifeste que cette nouvelle manière de vivre, toute violente qu'elle soit, est pourtant moins contraire à la liberté que la précédente.
Aussi l'expérience montre-t-elle que chez les peuples dont la subsistance est fondée sur ce nouveau moyen l'espèce peut parvenir à un plus haut degré de dévelopement et de liberté que chez les nations pastorales. Les monumens qui nous restent des arts et de la civilisation des anciens ne permettent d'élever aucun doute sur ce point. On ne peut sûrement pas nier que les peuples de la Grèce et de Rome n'aient été beaucoup plus cultivés qu'aucun de ceux de l'âge que j'ai décrit dans mon dernier chapitre; qu'ils n'aient été mieux [I-240] pourvus des choses nécessaires à la vie; que l'industrie et surtout l'agriculture n'aient fait chez eux des progrès beaucoup plus grands; qu'ils n'aient eu des relations commerciales infiniment plus étendues. Ces peuples ont surtout excellé dans les arts de l'imagination et du goût; leurs poètes, leurs orateurs, leurs statuaires, n'ont été depuis ni surpassés, ni peut-être égalés. Enfin les écrits de leurs philosophes et les monumens de leur législation que le temps a épargnés prouvent que leurs moeurs avaient fait, à plusieurs égards, des progrès non moins remarquables que leurs idées.
§ 4. Cependant, quels qu'aient été les progrès de ces peuples, je crois qu'il y a fort à rabattre de l'admiration que le monde leur accorde, et qu'on ne peut admettre qu'avec beaucoup de réserve et de grandes restrictions ce que l'on dit communément de leur culture et de leur liberté. Je crois cela surtout à l'égard des Romains, de tous les peuples de la terre celui qui a fondé le plus énergiquement son existence sur l'esclavage, et chez qui on peut le mieux observer tous les effets de ce genre de vie.
Par cela seul d'abord que ce peuple faisait exécuter la plupart de ses travaux par des esclaves, il semble que ce serait à ses esclaves, et non point à lui qu'on en devrait rapporter la gloire. Est-ce bien [I-241] le peuple romain qui a construit ces nombreux monumens d'architecture, ces égouts, ces ponts, ces routes, ces aquéducs que l'on attribue à la civilisation romaine? non: ce sont, pour la plus grande partie du moins, des captifs, des esclaves, qui n'appartenaient point au peuple romain. C'est avec l'industrie et les capitaux des nations vaincues que Rome a exécuté ses plus magnifiques ouvrages. Il ne se faisait, sous son empire, presque rien de véritablement utile qui ne fût exécuté par des hommes asservis. La loi de Romulus avait interdit au. Romain toute profession industrielle ; les arts libéraux furent long-temps enveloppés dans la même proscription: c'étaient des esclaves qui exerçaient la médecine; la grammaire, la rhétorique, la philosophie étaient enseignées par des esclaves. Tout ce qu'il y avait chez ce peuple de vraie civilisation, toute celle qui pouvait survivre à ses violences, il la reléguait hors de l'État. Son industrie à lui, c'était la guerre ; ses œuvres, c'étaient des pillages et des massacres; les monumens qu'il laissa ce furent des ruines, ce furent l'appauvrissement et la dépopulation de l'univers. Sans lui, peut-être, nous n'aurions pas eu les débris d'un Panthéon d'un Colysée; mais qui sait ce qu'aurait transmis à la postérité l'industrie libre et féconde des nations vaincues, par les mains de qui furent érigés ces fastueux édifices? Il y a tout lieu de croire que, [I-242] sans ce peuple, la civilisation aurait été beaucoup plus en mesure de se défendre contre la barbarie, lorsque les hordes errantes du nord de l'Europe vinrent exercer leurs effroyables dévastations dans le midi; et l'on peut justement imputer à ses brigandages le long retard que d'autres brigands purent, après lui, mettre aux progrès de l'espèce humaine [171] .
Il s'en faut bien, d'ailleurs, quê les arts eussent fait de vrais progrès chez les Romains, au moins tant qu'ils étaient demeurés fidèles au principe de [I-243] leur institution. Ils restèrent barbares tout le temps qu'ils furent purement militaires, et ils ne commencèrent à civiliser le monde qu'après l'avoir pillé et asservi, Rome, à l'époque où les Gaulois lą brûlèrent, c'est-à-dire 364 ans après sa fondation, ne renfermait encore que des cabanes couvertes de chaume [172] . Rebâtie alors, elle le fut d'une manière un peu plus solide, mais non pas plus régulière. Il n'y avait pas de rues, les maisons étaient confusément éparses, et elles furent si grossièrement construites, que, du temps de Pyrrhus, à plus d'un siècle de là, elles n'étaient encore couvertes que de lattes et de planches [173] , et qu'au commencement de l'empire la plupart étaient encore en bois [174] . On peut juger par là de l'état où l'industrie devait se trouver sous d'autres rapports. Ce ne fut que sous le règne d'Auguste que la ville éternelle commença à posséder de beaux édifices, et, après avoir été incendiée par Néron, qu'elle fut bâtie avec une véritable splendeur [175] Les lettres ne commencèrent à fleurir que vers la fin de la république ; elles ne brillèrent d'un grand éclat que sous les premiers empereurs; enfin les sciences et les arts utiles ne furent cultivés avec un [I-244] grand succès à aucune époque. Il n'y a pas la moindre comparaison à établir entre les progrès qu'ils avaient faits chez eux, et ceux qu'ils ont faits parmi nous; entre l'agriculture des Romains et la nôtre, entre leur commerce et le nôtre, entre les manufactures qu'ils avaient et celles que nous avons. C'est même faire beaucoup d'honneur aux Romains, que de parler de leurs manufactures. A proprement parler, ils n'en avaient point: ils n'avaient, pour ainsi dire, qu'une industrie de ménage, et chacun faisait fabriquer chez soi, par les mains de ses femmes et de ses esclaves, les produits ordinaires de sa consommation. Auguste, suivant Suétone, n'avait d'habits que ceux que lui faisaient ses femmes et ses filles. A prendre le mot de manufacture dans l'acception étendue que lui ont donnée les peuples modernes, on peut dire qu'il n'y a eu de manufactures dans aucun Etat de l'antiquité.
« Je ne me souviens point, dit Hume, d'avoir lu dans les auteurs anciens un seul passage où la prospérité d'une ville soit attribuée à l'existence de quelque genre de fabrique; et, quant au commerce, il se bornait presque, là où l'on dit qu'il a le plus fleuri, à l'échange des productions propres au sol et au climat de chaque contrée [176] . »
Ce que le monde a gagné depuis les Romains en lu [I-245] lumières, en richesses, est incalculable: de simples bourgeois, à Paris, à Londres et ailleurs, ont des habitations plus agréables, des ameublemens plus commodes, des vêtemens aussi riches et plus élégans que les plus riches patriciens de Rome. Les Romains, comme on sait, n'avaient pas de chemise, et portaient immédiatement la laine sur la peau. Les étoffes de lin étaient, chez eux, très-rares et du plus haut prix. Il n'y avait pas de vitres aux fenêtres des maisons: on les fermait avec du filet, de la toile de lin, de la corne ou de la pierre transparente. Il paraît que la même pièce (atrium) servait à la fois de cuisine, de salle à manger, de salon de compagnie, d'atelier, de galerie. On y étalait simultanément la vaisselle, les images des dieux, les portraits des aïeux, les objets fabriqués, etc. La lumière y pénétrait d'en haut, et, comme il n'y avait pas de cheminée, tout y était ordinairement très-enfumé. Les meubles des Romains pouvaient se distinguer par la beauté, l'élégance, la pureté des formes; mais ils ne possédaient qu'à un faible degré ce mérite de la commodité, de la convenance, de la propriété, que l'esprit d'invention et le génie scientifique sont parvenus à imprimer parmi nous à une multitude d'ustensiles. Les Romains n'avaient pour écrire que l'écorce de l'arbre appelé papyrus; ils ne commencèrent à faire usage du parchemin que vers la [I-246] fin de la république, et ne connurent jamais le papier. Un poinçon de fer ou un roseau taillé leur servait de plume. Ils n'écrivaient qu'en lettres majuscules. Ils ignoraient absolument l'art de multiplier les copies par l'imprimerie. Ils n'avaient aucune idée de l'établissement des postes, et faisaient porter leurs lettres par des messagers. La plupart de leurs arts étaient dans l'état d'enfance le plus complet [177] . Enfin, si le progrès des mœurs n'a suivi que de loin, parmi nous, le progrès des arts, si nous avons moins de vertu que d'instruction et de bien-être, il est toutefois impossible de nier que nous ne vivions mieux que ne faisaient les Romains, que nous ne sachions faire un usage plus juste et plus modéré de nos forces. On sait que les mœurs de ces maîtres du monde, d'abord horriblement violentes, devinrent ensuite horriblement dissolues, et que le plus inique de tous les peuples finit par se montrer le plus dépravé. De quelque manière donc qu'on les considère, on est conduit à reconnaître qu'ils avaient moins de vraie civilisation, et, par suite, moins de vraie liberté que nous.
§ 5. Non-seulement le peuple romain n'a pas été industrieux, éclairé, moral, et libre par conséquent, [I-247] au même degré que nous le sommes, mais il n'était pas même possible qu'il le fût. L'obstacle était dans le genre de vie qu'il avait adopté, et dans l'état social qui devait en être la conséquence. Il était naturellement impossible qu'un peuple qui avait fondé son existence sur le pillage et l'asservissement successif de tous les autres pût croître beaucoup en civilisation, et jouir jamais d'une liberté bien grande.
Une telle manière de subvenir à ses besoins demandait une guerre perpétuelle; elle était dans l'objet de l'association; elle tendait d'ailleurs à se perpétuer d'elle-même; et, quand les Romains ne l'auraient pas faite pour renouveler ou accroître leurs provisions en denrées et en esclaves, ils l'auraient faite pour aller au-devant des vengeances et des représailles dont ils étaient perpétuellement menacés [178] .
Voués ainsi à une éternelle guerre, il fallut que leur état social s'assortît à leur destination. La population en masse reçut, dès le commencement, une organisation toute militaire: elle fut divisée en tribus, curies, décuries; puis en classes et centuries, [I-248] et ces divisions, toutes militaires, furent commandées par des tribuns, des curions, des décurions, des centurions, qui eurent sur elle toute l'autorité de chefs militaires [179] . Le sénat, composé des officiers les plus riches et les plus distingués, fut en quelque sorte l'état-major général de l'armée; les consuls, choisis parmi les officiers supérieurs, en étaient les généraux en chef; les soldats, c'est-à-dire presque tous les citoyens, juraient aux consuls de se rassembler au premier ordre, et de ne jamais quitter l'armée sans permission [180] . Ce serment était peut-être moins énergique que celui des Tartares; mais il n'était pas moins obligatoire, et, de fait, il subordonnait invinciblement le peuple à ses chefs.
Cette subordination fut encore affermie par l'établissement des patronages et des clientelles. Tous les citoyens furent obligés de se choisir, dans la caste patricienne, des protecteurs qui devaient défendre leurs procès en justice, mais auxquels ils s'enchaînaient par les noeuds les plus étroits : de sorte que chaque individu, déjà subordonné comme militaire, le fut encore comme client...
Une dépendance encore plus rigoureuse s'établit au sein des familles. Chaque maison, domus, fut une domination; chaque chef de maison, dominus, [I-249] fut investi d'un pouvoir sans bornes. Le père était à la fois le pontife, le souverain, le juge de toute sa famille; il pouvait condamner ses enfans. à la prison, au fouet, à l'exil, à l'esclavage, à la mort. Enfin ce pouvoir, que rien ne limitait, et auquel on ne pouvait se dérober durant la vie du père, s'étendait à la fois à la mère, aux enfans, aux petits-enfans, à toute la postérité. La femme, en se mariant, devenait en quelque sorte la fille de son mari, et la sœur de ses propres enfans; elle perdait la possession de tout ce qu'elle avait, et ne pouvait rien acquérir qui ne fût acquis au mari : tout, dans la maison, tombait sous la puissance du père de famille.
Puissamment fortifiée par l'institution du patronat et de la puissance paternelle, la subordination, militaire établie entre les Romains fut encore affermie par l'établissement des censeurs, officiers d'un grade élevé, que l'on chargea spécialement de faire le recensement de l'armée, et d'y maintenir, la rigidité des mœurs et l'inflexibilité de la discipline [181] .
« Entre autres pouvoirs, dit Plutarque, un censeur a loy d'enquérir sur la vie et de réformer les mœurs d'un chascun; parce que les Romains ont estimé qu'il ne fallait pas qu'il fût [I-250] loysible à chascun de soy marier, vivre chez soy en privé, ni faire banquets et festins à sa fantaisie [182] »
Outre ces pouvoirs extraordinaires sur la vie privée, les censeurs en avaient d'immenses sur la vie publique. Ils pouvaient expulser les sénateurs du sénat, les chevaliers de l'ordre équestre, et rayer les simples individus de la liste des citoyens [183] .
On eut encore une attention pour entretenir l'esprit militaire, ce fut d'empêcher que les Romains ne pussent s'occuper d'aucun travail manuel. Les professions industrielles, que l'on qualifia de sordides (sordidæ artes), leur furent sévèrement interdites; et, dans le même temps, le service militaire fut pour eux d'obligation si étroite, que le citoyen qui aurait refusé de prendre les armes, ou qui seulement aurait négligé de se faire inscrire sur les livres du cens, aurait été dépouillé de ses biens, battu de verges et vendu comme esclave au delà du Tibre [184] .
C'est ainsi que leur état social s'était assorti au genre de vie qu'ils avaient adopté, et que tout tendait à les rendre forts pour la guerre, pour la conquête, pour le brigandage. Il faut bien comprendre [I-251] cela pour avoir la clef de leurs institutions: elles avaient essentiellement pour objet d'imprimer le plus haut degré d'énergie possible aux arts violens sur lesquels ils avaient fondé leur existence. C'est mal interpréter, je crois, leurs lois fondamentales, que de prétendre, avec Montesquieu et d'autres publicistes venus après lui, que l'égalité des biens, les lois agraires, la censure, la juridiction illimitée du père de famille étaient des conséquences naturelles des formes républicaines de leur gouvernement. Je ne crois pas que Condorcet, M. de Sismondi et M. de Constant aient expliqué ces institutions d'une manière plus heureuse, quand ils ont dit que les anciens n'attachaient d'importance qu'à l'exercice des droits de cité, et que c'était dans l'intérêt de leur activité politique qu'ils avaient consenti à sacrifier toute indépendance individuelle. D'une part, il est peu exact de dire que les lois agraires, l'ostracisme, la censure, etc., entrent de nécessité dans la constitution du gouvernement républicain; et, d'un autre côté, il n'est pas croyable que des peuples se soient soumis aux plus dures contraintes pour le seul plaisir d'être en république et de prendre une part active à l'exercice du pouvoir collectif. Aussi, lorsque les citoyens romains consentaient à se rendre esclaves du corps politique dont ils étaient membres, avaient-ils des motif plus sérieux et plus [I-252] solides que ceux que leur prêtent les écrivains célèbres que je viens de nommer; s'ils voulaient bien se plier à un tel régime, c'est qu'ils sentaient qu'il y allait pour eux de la vie ; c'est que, s'étant voués à la conquête et à l'asservissement des autres peuples, ils avaient besoin d'adopter l'ordre le plus propre à assurer le succès de leurs périlleuses expéditions [185] .
§ 6. Que, dans cet état, la nation romaine se trouvât très-fortement organisée pour la domination, je l'accorde. Mais de quelle liberté était-elle susceptible? On voit d'abord qu'elle ne pouvait jouir de celle que donne le développement de [I-253] l'intelligence et de l'industrie. Ce développement n'était pas compatible avec le genre de vie qu'elle avait adopté; et, d'ailleurs, nous venons de dire qu'elle s'était interdit tous les travaux qui auraient pu le faire naître. Le Romain, pour être propre à la guerre, avait besoin de rester grossier, brutal, superstitieux. C'eût été diminuer sa capacité pour le brigandage, que de le laisser se livrer à l'étude des sciences ou à la pratique des arts, et la première attention à avoir était sans doute de le préserver soigneusement de toute culture: aussi ne négligea-t-on rien pour le maintenir dans un favorable abrutissement. Rome, après cinq cents ans d'existence, n'était guère moins ignorante et moins farouche que sous ses premiers rois; et telle était, [I-254 ] tes, lrsque Diogènes et Carnéades parurent dans ses murs, l'horreur qu'on y avait encore de toute instruction, que Caton se hâta de proposer au sénat de congédier ces ambassadeurs philosophes, et que, dans une diatribe insensée contre les lumières, ce vieux fanatique s'oublia jusqu'à traiter Socrate de bavard et de séditieux [186] .
Il est vrai que, malgré ces semonces de Caton et des vieux sénateurs qui, comme lui, tenaient ferme pour le maintien de l'ignorance et des anciennes mœurs, il arriva à Rome ce qui était arrivé en Grèce, après une suite de guerres heureuses, c'est-à-dire lorsqu'on eut battu, pillé, asservi ses ennemis, et qu'on se fut procuré par ces honnêtes moyens du loisir et des richesses, n'ayant rien de mieux à faire, on eut le désir d'étudier. Mais comme la manière de vivre resta la même, que l'on conserva le même mépris pour les travaux de l'industrie, les effets de cette passion nouvelle ne furent que très-médiocrement avantageux. On étudia, comme on le faisait en Grèce, par passe-temps, sans aucune vue d'application utile, ou seulement dans des vues d'ambition. On apprit la rhétorique, la dialectique; on disputa sur le souverain bien; on s'exerça à séduire la multitude par l'artifice du langage et des discours étudiés; on eut des légistes, [I-255] des orateurs, des sophistes, des poètes, des musiciens; mais, pour des hommes vraiment éclairés et capables de faire d'utiles applications de leurs connaissances, il ne pouvait guère s'en former: ce n'est que chez les peuples industrieux que les études, bien dirigées, peuvent produire de véritables lumières, et qu'elles conduisent à d'heureuses applications [187] .
Ajoutons que, dans le temps où la vie guerrière des Romains prévenait en eux le développement de toute industrie, le régime de l'esclavage produisait le même effet parmi leurs esclaves, et qu'ainsi ils se privaient de la faculté de se servir eux-mêmes, sans acquérir véritablement celle de se faire servir par d'autres. On sait quels sont sur l'homme asservi les effets de la servitude : si elle abrutit le maître, elle abrutit bien plus sûrement l'esclave. L'homme n'a dans l'esclavage presque aucun intérêt à développer ses forces: la crainte du châtiment, loin de l'exciter à montrer sa puissance, lui conseille au contraire de la déguiser : « il se mettrait à l'amende par une œuvre de surérogation; il ne ferait, en montrant sa capacité, que hausser la mesure de ses devoirs. Il s'établit donc une ambition inverse, et l'industrie aspire à descendre plutôt qu'à monter [188] . »
[I-256]
Aussi, partout où les Romains substituèrent des esclaves à des hommes libres, la vit-on décliner très-rapidement. L'agriculture fut également en décadence. Toutes les fois, dit Hume, que les agronomes de l'antiquité se plaignent de la diminution du blé en Italie, ils ne manquent pas d'attribuer ce décroissement de richesse territoriale à l'introduction de l'exploitation servile [189] . L'esclavage eut, à cet égard, de tels effets, que l'Italie finit par devenir presque aussi improductive que l'est aujourd'hui la campagne de Rome, et qu'au lieu d'exporter du blé, comme elle l'avait fait pendant quelque temps, elle fut obligée de compter pour sa subsistance sur les moissons de la Barbarie, de l'Égypte et de la Sicile [190] .
Les effets de l'esclavage ne s'arrêtèrent pas là. La population déclina non moins rapidement que les moyens de subsistance. Les légions romaines avaient beau faire la traite et envoyer en Italie des nations entières réduites en servitude, elles ne pouvaient suffire à l'effroyable consommation d'hommes que faisaient l'esclavage et la misère, et le nombre des artisans et des cultivateurs allait sans cesse en décroissant. Il en était de même des hommes libres : il fallut tirer des citoyens du dehors, comme on [I-257] en tirait des denrées et des esclaves; et le peuple-roi, recruté d'abord en Italie, le fut ensuite dans les provinces, et ensuite chez les barbares.
« La nation tout entière, dit un publiciste, disparut peu à peu par l'effet de cet odieux régime. On ne trouvait plus de Romains qu'à Rome, d'Italiens que dans les grandes villes. Quelques esclaves gardaient encore quelques troupeaux dans les campagnes; mais les fleuves avaient rompu leurs digues, les forêts s'étaient étendues dans les prairies, et les loups et les sangliers avaient repris possession de l'antique domaine de la civilisation [191] .
Voilà quels étaient, relativement à l'industrie, à [I-258] la richesse, à la population, les effets de la guerre et de l'esclavage.
§ 7. Joignez que ce système, si contraire à l'industrie des Romains, n'était pas moins funeste à leur morale.
Je sais que les peuples qui fondent leur existence sur la spoliation et l'asservissement des autres nations peuvent concilier quelquefois une grande rigidité de mœurs avec le goût du brigandage, Tant que ces peuples ont affaire à des populations pauvres, qui ont peu de choses à leur donner, et qui savent défendre énergiquement ce qu'elles possèdent, il faut bien de nécessité qu'ils s'accoutument à vivre de peu. Mais cette frugalité n'est pas ordinairement une vertu bien méritoire; elle ne dure qu'autant qu'elle est forcée [192] ; et si les mêmes peuples parviennent à subjuguer des nations opulentes, et à se placer dans une situation où ils puisssent jouir avec quelque sécurité du fruit de leurs rapines, on les verra se livrer à des profusions, [I-259] à des orgies, à des débauches incroyables. Voilà ce que montrent toutes les histoires de races militaires, et la Romaine plus qu'aucune autre. Les Romains furent des modèles de tempérance et même d'austérité, tant qu'ils n'eurent à combattre que les Eques, les Volsques, les Latins, les Samnites, qui, sans cesse défaits, revenaient sans cesse à la charge, et qui leur vendaient très-cher des victoires qui ne produisaient rien. Mais quand enfin ils eurent soumis l'Italie, quand ils eurent vaincu Carthage, quand ils n'eurent plus d'ennemis сараbles de leur résister, qu'ils furent tranquilles sur leur puissance et qu'ils eurent conduit à Rome les dépouilles de la terre, ils tombèrent dans une horrible dissolution de mœurs. Ces désordres étaient la conséquence toute naturelle de leur mode d'existence. Ce ne furent pas leurs richesses qui les corrompirent, comme on l'a tant écrit, et comme on le répète encore: ce fut la manière dont ils se les étaient procurées. Les hommes ne jouissent avec modération que des biens qu'ils ont acquis avec [I-260] honneur. Il en est du butin fait à la guerre comme de l'argent gagné au jeu, comme des sommes extorquées aux nations qu'on opprime on dissipe presque toujours d'une manière honteuse ce qu'on s'est procuré d'une manière honteuse. Il n'est pas possible que des hommes assez dépravés pour fonder leur existence sur le pillage, le vol, la levée de tributs illégitimes, soient en même temps assez purs pour faire un usage moral de biens aussi immoralement acquis.
Le genre de vie des Romains ne faisait donc pas d'eux seulement des hommes ignorans, il tendait à en faire aussi des hommes dissolus, et l'on comprend assez qu'il ne pouvait leur procurer l'espèce de liberté qui naît du bon emploi qu'on fait de ses facultés par rapport à soi-même.
§ 8. Enfin il leur pouvait encore moins donner celle qui résulte pour les hommes de l'usage inoffensif qu'ils font entre eux de leurs facultés.
Bien loin d'user ainsi de leurs forces, les Romains en faisaient l'usage le plus injuste et le plus agressif. Leur objet même était la spoliation et l'asservissement du monde. Or il n'était pas possible qu'ils fissent ainsi violence à tout l'univers, sans se placer eux-mêmes dans une situation extrêmement violente.
On a vu de quelle manière ils avaient besoin de [I-261] s'ordonner pour faire la guerre avec succès. Voulant asservir les autres, ils étaient obligés de commencer par s'enchaîner eux-mêmes. Il leur fallait, comme dans une armée, se classer, s'enrégimenter, se subordonner l'un à l'autre, multiplier au-dessus d'eux les pouvoirs arbitraires et illimités, renoncer à toute indépendance individuelle, n'exister en quelque sorte qu'en abstraction et comme membre de la masse organisée dont ils faisaient partie; se soumettre enfin aux plus tyranniques volontés de cette masse d'hommes, ou plutôt à celles des ambitieux qu'elle se donnait pour directeurs et pour maîtres.
Voilà à quel prix les Romains pouvaient dépouiller et asservir les autres peuples. Plus ils voulaient être forts pour la domination, moins ils pouvaient. avoir de liberté. La liberté n'entrait pas dans l'objet de leur institution, elle n'était pas possible; elle aurait même été funeste; car elle aurait affaibli l'esprit guerrier et relâché le nerf de la discipline. Il eût été contre nature de vouloir donner de l'indépendance aux individus dans un état social où les individus, toujours engagés dans des expéditions militaires, avaient besoin, par cela même, de former une masse compacte et très-fortement constituée.
J'ai parlé des pouvoirs exorbitans que la nécessité de la discipline avait fait établir; mais ai-je [I-262] énuméré les actes arbitraires et violens qu'elle faisait commettre? Un père exilait ses enfans, il leur infligeait les travaux forcés des esclaves, il les condamnait à périr par la main du bourreau. Un censeur dégradait sans formalité un sénateur, un chevalier, un citoyen; il s'ingérait dans tous les détails de la vie privée, et défendait les actes les plus innocens ou en commandait qui moralement n'avaient rien d'obligatoire. Les derniers rangs de l'armée tombaient-ils dans le dénûment? on procédait à des expropriations pour rétablir entre les fortunes une égalité impossible; on décidait que nul ne pourrait posséder au-delà d'une certaine étendue de terrain, et on enlevait l'excédant à ceux qui en avaient pour le distribuer aux citoyens pauvres. La guerre, l'esclavage, le vice, la misère' réduisaient-ils le nombre des citoyens et des soldats? on rendait des lois ridiculement vexatoires pour contraindre les gens à se marier et à procréer beaucoup d'enfans. Une fois, on réglait comment on pourrait voyager; une autre fois, comment on serait vêtu; une autre fois, la dépense qu'on pourrait faire pour sa table et le nombre des convives qu'il serait permis d'y recevoir. Il n'y avait réellement ni propriété, ni sûreté, ni liberté ; on ne tenait point compte de cela : tout était sacrifié au maintien de la discipline et à la bonne constitution de l'armée.
[I-263]
Et ce n'était pas seulement à cause de cet arbitraire que les Romains étaient peu libres. Remarquez qu'en se soumettant à ce dur régime le gros de l'armée n'en retirait presque aucun profit. Dans cette domination, comme dans toutes, les agens subalternes n'obtenaient qu'une très-petite part de richesse et d'autorité. Les dépouilles des ennemis vaincus étaient distribuées là, comme ailleurs les contributions levées sur les peuples : les gros lots étaient pour l'état-major de l'armée, pour les consuls, le sénat, les patriciens; le peuple, les soldats récevaient à peine de quoi vivre. On eût craint sans doute, en les enrichissant, d'affaiblir en eux cet utile amour des conquêtes et du pillage d'où dépendait la fortune des classes élevées. Jamais aristocratie n'a fait de son ascendant un usage plus dur, plus inique, plus hautain que l'aristocratie romaine. Tel était l'abaissement où elle tenait le peuple, que les mariages entre les personnes de la classe patricienne et de la classe plébéienne avaient fini par être regardés comme des unions contre nature; et que lorsque ces sortes d'alliances furent autorisées, on prétendit qu'il en sortirait des monstres [193] . Telle était la hauteur des chefs, même du temps de la république, que lorsqu'un consul venait à passer, tout citoyen devait s'écarter de la [I-264] route, se découvrir la tête, se lever de son siège ou descendre de cheval. Quiconque eût négligé de lui donner ces marques de déférence et de respect eût été promptement rappelé à son devoir par les licteurs le préteur Lucullus ne s'étant pas levé, dans un moment où il rendait la justice, devant le consul Acilius, celui-ci fit briser à l'instant sa chaise curule [194] . Il n'est peut-être pas de pays où une autorité plus arbitraire se soit exercée avec des formes plus dures et plus impérieuses. C'était proprement le régime d'un camp de Tartares.
Dépendans sous mille rapports comme individus, les Romains n'étaient pas même libres comme corps de nation. Leur existence sociale était perpétuellement menacée, au dedans par les esclaves et les prolétaires, au dehors par les ennemis que ne cessait de soulever leur ambition.
On sait ce que la république avait à craindre des esclaves. Le désespoir leur donna souvent des armes, dit Gibbon, et leur soulèvement mit plus d'une fois l'État sur le penchant de sa ruine. On les jugeait si redoutables qu'on n'osa pas les distinguer par un habit particulier. On pensa que le jour où ils pourraient s'apercevoir de leur nombre, leurs maîtres seraient exposés aux plus grands périls [195] . Il fallut faire des lois terribles pour se [I-265] mettre à l'abri de leurs entreprises, et agir avec eux comme avec des ennemis mortels. Ils purent être, pour de légers manquemens, torturés, fouettés marqués au visage d'un fer chaud, condamnés à tourner la meule [196] . On établit que si un maître était tué dans sa demeure, et que le meurtrier ne fût pas découvert, tous les esclaves pourraient être mis à mort; et Tacite parle d'un cas où quatre cents esclaves furent exécutés par cela seul que leur maître avait péri et qu'ils n'avaient pas fait connaître l'auteur du meurtre [197] . Voilà à quelles extrémités on en était réduit. On sent que de telles atrocités, loin d'augmenter la sûreté des citoyens, devaient achever de la détruire: ce fut, observe Montesquieu, lorsque les Romains eurent perdu pour leurs esclaves tous les sentimens de l'humanité que l'on vit naître ces guerres serviles que l'on a comparées aux guerres puniques [198]
La sûreté du peuple romain, si gravement menacée par ses esclaves, l'était plus encore par ses prolétaires. Quoique dans l'origine les terres eussent été assez également partagées, il s'établit bientôt entre les fortunes cette inégalité inévitable, que nulle bonne institution ne pourrait entièrement [I-266] prévenir [199] , mais que favorisent presque toujours des institutions iniques; et l'on vit à Rome, comme ailleurs, et d'une manière beaucoup plus tranchée qu'ailleurs, la population partagée entre un petit nombre de gens riches et une masse de citoyens misérables. Dans un pays où les arts utiles n'eussent pas été avilis et abandonnés à des esclaves, cette dernière classe d'individus aurait pu trouver dans l'industrie une ressource contre l'indigence, et en devenant moins à plaindre elle eût été moins à redouter. Mais ne possédant rien et ne se livrant à aucun travail, cette populace gueuse et fière ne pouvait manquer de se rendre à la fin très-redoutable. Elle ne cessait de contracter des dettes qu'elle n'avait aucun moyen d'acquitter, et qui devenaient entre elle et ses créanciers une source inépuisable de démêlés violens. On était obligé, pour étouffer ses clameurs, de lui faire régulièrement des aumõnes qui ne servaient qu'à l'accroître et à la rendre de plus en plus menaçante. Sans doute, dans l'état de dénûment où elle se trouvait, et où s'efforçait peut-être de la retenir une politique avare et cruelle, elle offrait à l'ambition des sénateurs un puissant levier pour la conquête et l'oppression du monde; mais aussi quel point d'appui contre la république ne présentait-elle pas aux ambitieux [I-267] mécontens? On pouvait s'en servir pour la guerre civile comme pour la guerre étrangère; elle était l'instrument des brigues, des conjurations, des discordes; « elle devint l'auxiliaire soldé d'un Marius et d'un Sylla, d'un César et d'un Pompée, d'un Octave et d'un Antoine; » et après avoir soumis l'univers à Rome, elle finit par mettre Rome sous les pieds des plus exécrables tyrans.
Enfin, tandis que le système des Romains entretenait parmi eux deux classes d'ennemis si redoutables, il ne cessait de leur susciter au dehors des ennemis encore plus dangereux. Les Romains, dit Montesquieu, étaient dans une guerre éternelle et toujours violente; ils n'avaient pas le temps de respirer; il leur fallait faire un continuel effort; exposés aux plus affreuses vengeances s'ils étaient vaincus, ils s'étaient imposé la terrible obligation de toujours vaincre ; ils ne pouvaient faire la paix que vainqueurs; ils étaient obligés à des prodiges de constance [200] . On peut juger de la violence de leur situation par celle des lois qu'ils avaient rendues contre quiconque se dérobait au service militaire... Enfin, après avoir été constamment, pendant le long cours de leurs triomphes, sous l'oppression morale de périls toujours imminens, ils [I-268] finirent par subir à leur tour autant de violences matérielles qu'ils en avaient fait souffrir à d'autres. Vainqueurs du monde civilisé, ils ne surent que le livrer au joug des barbares. Rien n'égala la dégradation, la honte, et le malheur de leurs derniers momens.
§ 9. Voilà comment furent libres les Romains, ces modèles, suivant Rousseau, de tous les peuples libres. Nous voyons en nous résumant que le système de la guerre et de l'esclavage sur lequel ils avaient fondé leur subsistance s'opposait directement aux progrès de leur industrie et de leurs idées, qu'il tendait non moins fortement à la dépravation de leurs mœurs, qu'il les obligeait de se soumettre au régime social le plus dur et le plus arbitraire, qu'il leur suscitait au dedans et au dehors les ennemis les plus dangereux; qu'enfin, après avoir rempli leur existence de trouble, de corruption et de violence, il finit par amener leur totale destruction [201] .
[I-269]
§ 10. Il me serait aisé, si je voulais insister sur le sujet que je traite, de montrer que l'esclavage [I-270] avait été d'abord aussi funeste aux Grecs qu'il le fut ensuite aux Romains.
Les citoyens des villes grecques, pourvus par des esclaves des choses nécessaires à la vie, et affranchis à cet égard de tout travail et de tout soin, employaient leur temps à la guerre, à l'exercice des droits de cité, à la poursuite des magistratures, à des luttes d'ambition, à des querelles intestines; ou bien ils partageaient leurs loisirs entre les exercices de la gymnastique et l'étude des sciences qu'ils appelaient libérales, c'est-à-dire de la grammaire, de la rhétorique, de la philosophie, de la musique, et de quelques autres arts, qu'ils ne cultivaient que par forme de passe-temps et seulement pour leur plaisir.
Cette manière d'être, qui forma d'abord des guerriers et plus tard des rhéteurs, des sophistes, des poètes, des artistes, opposait d'insurmontables obstacles au vrai développement des peuples qui l'avaient adoptée. Elle était destructive de toute paix et de tout ordre; elle ne comportait le progrès ni de la population, ni de la richesse, ni des mœurs, ni des arts utiles, ni des connaissances véritables. Aussi les Grecs n'acquirent-ils jamais que d'une manière fort imparfaite ces élémens de force et de liberté. Ils consumaient leur vie en querelles ou en vaines disputes. Ils furent d'abord tout militaires, et puis, quand la guerre les eut enrichis, [I-271] ils se livrèrent à de dangereux plaisirs et à de frivoles exercices, dans lesquels ils perdirent leur ancienne énergie guerrière, sans acquérir la force, l'instruction, la richesse, les bonnes habitudes morales que leur eût données la pratique de l'industrie. Voilà ce qui explique en partie leur chute et celle de la plupart des peuples de l'antiquité : c'est l'histoire de toutes les sociétés militaires [202] .
§ 11. Une circonstance empêche que l'esclavage ne soit aussi funeste en Amérique qu'il le fut en Europe dans l'antiquité; c'est la manière dont on s'y procure les esclaves. On les obtient par le commerce, et non par la guerre ; ils sont achetés, et non pas conquis. Les Créoles ne sont pas, comme [I-272] le furent les Grecs et les Romains, des peuples militaires, voués au brigandage et à la domination; leur titre est celui de planteurs, de colons; ce sont des entrepreneurs d'industrie; seulement leurs ouvriers sont des esclaves achetés à des rois d'Afrique, qui font la guerre pour eux.
Cette manière de vivre est moins mauvaise que celle des anciens : il y a de moins la guerre extérieure et les discordes intestines, que l'ambition devait continuellement susciter parmi des hommes à l'activité desquels il n'y avait, dans chaque État, qu'une seule carrière d'ouverture, celle du gouvernement. Cependant l'esclavage a encore, dans les parties de l'Amérique où il existe, des conséquences fort graves; il est pour les habitans une cause d'inactivité, d'insouciance, d'incapacité; il corrompt leur morale, il compromet leur sûreté ; enfin il a ceci de particulier et de terrible, qu'on ne saurait trop comment le détruire, et que cette plaie honteuse de l'Amérique semble être à jamais incurable. L'abolition graduelle de l'esclavage eût été facile chez les anciens, où les maîtres avaient pour esclaves des hommes de leur couleur et de leur race. Mais que faire là où les esclaves sont d'une autre race et d'une autre couleur? Les éloigner en les affranchissant? cela, dans bien des cas, serait impraticable: il est tel pays de l'Amérique où ils forment la presque totalité de la classe ouvrière [I-273] et le fond de la population. Les affranchir et les garder? mais quel serait, au milieu d'un peuple de noirs délivrés des liens de la servitude, et devenus graduellement propriétaires et citoyens, le sort du petit nombre de blancs qui auraient été leurs maîtres, surtout si ces blancs craignaient de se dégrader en s'alliant avec eux, et ne voulaient pas souffrir le mélange des races [203] ? On tournera longtemps dans les difficultés de cette question avant de trouver un bon moyen d'en sortir; elle fait le désespoir des hommes d'état les plus éclairés de l'Amérique septentrionale.
§ 12. Je ne suivrai pas les effets de l'esclavage dans tous les pays où il a existé ; comme il ne s'est pas établi dans des circonstances semblables, et n'a pas été partout le même, on sent que ses résultats ont dû beaucoup varier. Mais l'esclavage a des effets généraux qui se reproduisent également partout; partout il a pour effet d'abrutir et de dépraver les populations qu'il fait vivre, de s'opposer aux progrès de leur industrie, de leur morale privée, de leurs habitudes sociales, et de prévenir ainsi chez elles le développement des causes d'où nous savons que découle toute liberté.
«Dans un climat chaud, dit M. Jefferson, nul [I-274] homme ne travaille s'il peut en contraindre un autre à travailler pour lui. » Cela est vrai dans tous les climats possibles. Partout où des hommes peuvent en contraindre d'autres à travailler pour eux, il est fort rare qu'ils s'instruisent, qu'ils deviennent industrieux, qu'ils se rendent capables de quelque chose d'utile. « L'inactivité de l'esprit comme l'observe un économiste, est la conséquence de celle du corps: le fouet à la main, on est dispensé d'intelligence.
J'ajoute qu'il n'est pas plus facile à ces hommes, d'acquérir des mœurs que de l'industrie; ils sont dans une position qui tend directement à corrompre leur morale. Un maître peut abuser impunément des femmes qu'il tient en servitude: comment serait-il continent? Ce qu'il récolte ne lui a coûté aucun effort: comment en userait-il avec mesure? Il vit dans un état habituel d'oisiveté : comment n'aurait-il pas les vices qu'engendrent l'indolence et le désœuvrement [204] ?
[I-275]
Enfin, s'il est difficile, dans une telle situation, de contracter de bonnes habitudes personnelles, it l'est peut-être plus encore de se former à de bonnes habitudes sociales.
« Le commerce entre le maître et l'esclave, dit Jefferson, est un exercice continuel des plus violentes passions de la part de celui-là, et de la soumission la plus abjecte de la part de celui-ci. Nos enfans, qui ont ce spectacle sous les yeux, suivent bientôt l'exemple qu'on leur donne. Le chef de famille s'emporte contre son esclave: l'enfant l'observe; il imite dans les mouvemens de son visage les traits du maître irrité, et prend bientôt le même air dans le cercle des jeunes esclaves qui l'entourent. Il apprend ainsi à lâcher la bride à ses plus dangereuses passions; et élevé dans la [I-276] pratique de l'injustice, exercé journellement à la tyrannie, il demeure pour ainsi dire marqué de leurs traits les plus odieux. L'homme placé dans de telles circonstances serait un prodige s'il conservait la bonté de son caractère et de sa morale [205] .
En somme, ignorance, incapacité, mollesse, faste, iniquité, violence, voilà ce que l'esclavage tend naturellement à donner aux populations qui en font leur ressource.
§ 13. Et pourtant il est vrai de dire que, lorsque ce nouveau mode d'existence vint à s'établir parmi les hommes, on fut plus près de la liberté qu'on ne l'avait été aux époques antérieures, où l'usage le plus général était encore de massacrer les prisonniers. Les esclaves, servi, étaient, comme [I-277] le mot l'indique, des hommes conservés, servati, et l'action de faire des serfs, qui nous paraît avec raison la chose du monde la plus sauvage, fut, dans l'origine, un acte d'humanité et un trait de civilisation [206] .
La destination donnée aux esclaves rendit ce trait encore plus favorable à la liberté. A l'âge de la société que je décris, l'homme de guerre ne conserva pas ses prisonniers pour les associer à ses brigandages ou pour en faire de simples gardeurs de troupeaux, il les conserva pour il les conserva pour les appliquer à la culture du sol, à l'exercice de divers métiers et, peu à peu, à tous ces travaux d'où est sortie avec le temps la civilisation de l'espèce humaine.
A la vérité, ces hommes ne travaillaient pas pour eux ; ils ne travaillaient que contraints; mais il valait encore mieux qu'ils fussent asservis, que s'ils avaient été tués, et que tout fût resté, comme auparavant, dans le brigandage. Au sein d'une telle barbarie, l'introduction de l'esclavage était une innovation heureuse, et l'usage de condamner les vaincus au travail fut, sans contredit, un grand acheminement à la liberté. L'essentiel était que, de manière, ou d'autre, l'industrie devînt la principale ressource.
[I-278]
Sans doute, il eût encore mieux été qu'on cessât de toutes parts de faire la guerre, et qu'au lieu de chercher à s'asservir les uns les autres, on s'assujettît soi-même au travail; mais il n'était pas dans la nature de l'espèce de faire tout d'un coup un si grand progrès; un tel changement était bien loin encore d'être possible; c'était beaucoup que l'on cessât d'exterminer les prisonniers, et que l'on s'avisât de les réduire en servitude.
Je ne sais pas même, à vrai dire, s'il n'était pas indispensable de commencer par là. Outre qu'à un âge de la société où les passions étaient encore si ardentes, personne peut-être ne se fût condamné spontanément et de son plein gré aux travaux patiens de la vie sédentaire, celui qui l'aurait fait serait infailliblement, et au bout de très-peu de temps, devenu la proie des peuples demeurés barbares. Il fallait donc, même avec l'intention de se civiliser, si l'on avait pu dès-lors être préoccupé d'un pareil soin, que l'on se bornât à réserver pour les occupations utiles les ennemis qu'on avait vaincus, et que l'on continuât soi-même à rester propre à la guerre.
Sûrement, ce n'était pas avancer beaucoup; mais peut-être était-ce là tout ce qu'on pouvait, et ce peu était déjà quelque chose. Non-seulement, par l'institution de l'esclavage, il y avait des hommes utilement occupés; mais ces hommes pouvaient [I-279] travailler avec quelque sécurité sous la protection de leurs maîtres, qui, en les opprimant pour leur compte, étaient pourtant intéressés à les préserver de tout trouble étranger. En outre, par l'effet de cette protection et de la fixité des établissemens, quelques accumulations devenaient possibles, et ceci préparait beaucoup d'autres progrès.
D'ailleurs, ces esclaves, qui d'abord ne travaillent que pour autrui, travailleront un jour pour eux. Ils sont faibles, ils deviendront forts; ils sont aux sources de la vie, de la lumière, de la richesse, de la puissance : il ne faut que leur inspirer le désir d'y puiser, et les maîtres eux-mêmes sentiront un jour le besoin de leur inspirer ce désir. Voulant stimuler leur activité, ils relâcheront un peu leurs chaînes ; ils leur laisseront une part de la richesse qu'ils auront créée. Ceux-ci conserveront ces faibles produits; ils les accroîtront par le travail et par l'épargne, et quelque jour les fruits lentement accumulés de leur pécule étoufferont ceux de la violence et de l'usurpation. Esclaves dans l'antiquité, les hommes d'industrie ne seront plus que serfs tributaires dans le moyen âge; puis ils deviendront les affranchis des communes, puis le tiers-état, puis la société tout entière.
C'est ici, c'est chez les peuples entretenus par des esclaves, c'est au sein même de l'esclavage que [I-280] commence réellement la vie industrieuse, la seule, comme on le verra bientôt, où les hommes puissent donner un grand essor à leurs facultés, acquérir de bonnes habitudes morales, prospérer sans se faire mutuellement de mal; la seule, par conséquent, où ils puissent devenir vraiment libres.
[I-281]
CHAPITRE VIII.
Liberté compatible avec la manière de vivre des peuples chez qui l'esclavage domestique a été remplacé par le servage.↩
§ 1. Le monde, dans son adolescence, n'a pas connu d'état social plus avancé que celui dont je viens d'offrir le tableau. L'esclavage proprement dit, la servitude domestique, a été le régime économique de tous les peuples qu'on appelle anciens. Ce régime existait encore, au moins en bonne partie, dans les derniers temps de la domination romaine. Quoique l'esclavage eût subi, sous les empereurs, diverses altérations, il y avait toujours dans la société une classe nombreuse d'individus directement possédée par d'autres, attachée au service des personnes, dont les personnes disposaient comme de leur propriété, et qui était dans une dégradation profonde. Pour montrer quelle était encore cette dégradation au quatrième siècle de notre ère, sous le règne de l'empereur Constantin, il suffit de dire qu'un édit de ce prince prononçait la peine de mort contre la femme qui descendrait jusqu'à épouser son esclave, et condamnait celui-ci à être brûlé [207] .
[I-282]
Il serait difficile de désigner l'époque où a commencé et celle où s'est trouvée accomplie l'abolition de la servitude domestique. Quand on considère la condition des classes asservies à l'époque où l'esclavage a existé sur la terre dans sa plus grande plénitude, au fort de la domination romaine, à la fin de la république et dans les premiers temps de l'empire, on trouve qu'alors les esclaves de toutes les classes, ceux qu'on employait à la culture des champs, ceux par qui l'on faisait exercer les métiers, ceux qui étaient immédiatement attachés au service des personnes, étaient pleinement possédés, et pouvaient être isolément vendus. Quand, au contraire, on considère les mêmes classes au moyen âge, à l'époque du complet établissement du régime féodal, vers les onzième et douzième siècles, on n'aperçoit plus d'esclaves proprement dits. Les hommes qui exercent les arts et métiers, dans l'intérieur des villes, sont encore sujets à bien des violences, à bien des exactions; mais ils ne sont la propriété de personne. Ceux qu'on voit répandus dans les champs se trouvent comme enchaînés à la terre qu'ils cultivent; ils en font pour ainsi dire partie: ils peuvent être échangés, donnés, vendus avec elle; mais s'il ne leur est pas permis de la quitter, on ne peut pas non plus les en distraire, et il y a quelques limites à la domination exercée sur eux. Enfin, il n'y a [I-283] pour ainsi dire plus d'esclaves dans l'intérieur des maisons les principales fonctions du service domestique sont remplies par des parens, des amis, et en général par des personnes de la condition des maîtres.
§ 2. Comment s'est opérée cette transition du dur esclavage des anciens à la servitude un peu adoucie du moyen âge? c'est ce qu'il n'est pas aisé de déterminer. Il paraît que ce mouvement avait commencé sous l'empire romain; que, dans les derniers temps de cet empire, l'industrie était généralement sortie de la domesticité; qu'à la place d'artisans esclaves, travaillant dans l'intérieur des maisons pour le compte des maîtres, il s'était formé dans les villes des corps d'artisans libres travaillant pour le public et à leur profit; que cette révolution avait été plutôt favorisée que contrariée par la chute de la domination romaine et l'invasion des peuples du Nord; qu'au milieu des désordres de cette invasion et du renversement de la fortune des anciens maîtres, les artisans des villes avaient pris un peu plus d'importance et d'activité; que, bien qu'exposés ensuite à beaucoup d'excès de la part des nouveaux dominateurs, ils n'étaient pourtant pas rentrés dans la servitude domestique; que les colons répandus dans les campagnes, et particulièrement exposés aux violences des barbares, [I-284] avaient sans doute beaucoup souffert du fait matériel des invasions; mais que néanmoins leur condition, au lieu d'empirer, était peu à peu devenue meilleure; enfin que tout ce qui était échu d'esclaves proprement dits aux nouveaux dominateurs, ou tout ce qui s'en était fait dans le cours des invasions et des guerres, avait été envoyé par degrés à la culture du sol; et que les Gaulois ayant imité sur ce point les mœurs des Germains, il avait fini par ne plus rester du tout d'esclaves domestiques [208] .
On s'est fort divisé sur les causes qui ont présidé à ce grand changement. Quelques-uns ont voulu en rapporter tout l'honneur au christianisme, d'autres aux progrès des lumières et de l'industrie, d'autres à la générosité des mœurs germaines, d'autres encore à la nécessité où l'on s'est trouvé de ménager ses esclaves lorsqu'il a fallu se contenter de ceux qu'on avait, et qu'il est devenu difficile de les remplacer par d'autres. Il est probable que toutes ces causes ont agi. Reste à savoir de quelle façon, et dans quelle mesure.
D'abord, je ne doute point qu'il ne faille placer, avec Gibbon, au nombre de celles qui avaient le plus contribué à adoucir l'esclavage, dès le temps des [I-285] Romains, la nécessité des circonstances nouvelles où ce peuple s'était trouvé placé lorsqu'il avait eu achevé ses conquêtes et réuni sous un même sceptre les principales nations de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie [209] . On sent aisément, en effet, que lorsque les sources étrangères de l'abondance des esclaves avaient commencé à se tarir, il n'avait plus été possible d'abuser de cette classe d'hommes comme on l'avait fait tant que les légions romaines avaient été employées à faire la traite, et qu'on avait vu les nations vaincues et réduites en servitude affluer de toutes parts sur les marchés de l'Italie. Telle avait été pour lors l'abondance des esclaves, qu'ils s'étaient donnés quelquefois pour presque rien. Plutarque nous apprend que, dans le camp de Lucullus, un esclave fut vendu 4 drachmes, environ 3 livres 10 sous [210] . On conçoit que, dans des temps où les esclaves étaient à ce prix, il n'avait pu guère être question d'abolir ou simplement de modifier l'esclavage: moins la denrée était chère, et plus on avait dû s'endurcir dans l'habitude qu'on avait prise d'en user et d'en abuser. Mais on conçoit aussi que lorsque les Romains eurent tout vaincu, lorsqu'il n'y eut plus de nations à réduire en servitude, lorsqu'il fallut se contenter, [I-286] par conséquent, des esclaves qu'on possédait, la nécessité de les conserver dut tout naturellement faire adopter à leur égard des habitudes moins cruelles.
« L'existence d'un esclave, observe Gibbon, devint un objet plus précieux; et, quoique son bonheur tînt toujours au caractère et à la fortune de celui dont il dépendait, la crainte n'étouffa plus la voix de la pitié, et l'intérêt du maître lui dicta des sentimens plus humains. La vertu ou la politique de quelques souverains accéléra le progrès des mœurs; et, par les édits d'Adrien et des Antonins, la protection des lois s'étendit à la classe la plus nombreuse et la plus misérable de la société. Après bien des siècles, le droit de vie et de mort sur les esclaves fut enlevé aux particuliers, qui en avaient si souvent abusé; il fut réservé aux magistrats seuls. L'usage des prisons souterraines fut aboli; et dès qu'un esclave put se plaindre d'avoir été injustement maltraité, il obtint sa délivrance ou un maître moins cruel [211] . »
Cet adoucissement au sort des esclaves leur permit de faire quelques progrès; leur pécule sé grossit; beaucoup acquirent les moyens de se racheter; le nombre des affranchissemens se multiplia; et comme les affranchis ne devenaient pas en général membres [I-287] de la cité, comme ils ne remplissaient point de fonctions publiques, force leur fut de continuer à se livrer aux travaux de l'industrie privée, et c'est ainsi probablement que se formèrent peu à peu ces corps d'artisans libres que les barbares trouvèrent établis dans les villes d'Italie et des Gaules, et dont l'origine remontait au monde romain. J'ajoute que cè besoin de traiter les esclaves moins durement, que les Romains avaient dû commencer à sentirà une certaine époque, dut également être éprouvé plus tard par les barbares, lorsque ceux-ci eurent enfin cessé leurs courses, qu'ils se furent décidément fixés, qu'il y eut partout des nations sédentaires, et que chacune de ces nations se trouva réduite, pour l'exécution de ses travaux, aux seuls esclaves qu'elle avait sous la main. Alors encore les hommes de travail devenant plus précieux et plus rares, il fallut commencer à les ménager; l'esclavage dut nécessairement s'adoucir. Il arriva ce qui arriverait infailliblement aujourd'hui dans les colonies si la traite y devenait décidément impossible, et qu'on se vît pour jamais réduit aux seuls esclaves qu'on possède en ce moment... On céda à l'intérêt pressant qu'on avait de ménager une population indispensable, qu'il n'était plus possible de remplacer autrement que par les voies douces et lentes de la reproduction [212] .
[I-288]
Je suis loin de prétendre, néanmoins, que ce motif ait agi à l'exclusion de tous autres, et, par exemple, que l'influence du christianisme sur l'abolition de l'esclavage ait été nulle. Quand on songe quels furent les premiers chrétiens, pour quelles classes de la société ils manifestaient le plus de sympathie, dans quelles classes d'abord ils cherchèrent à faire des prosélytes: quand on fait attention que la société chrétienne ne fut, dans les premiers temps, qu'une réunion de paysans, d'ouvriers, de mendians, et surtout d'esclaves, on ne peut guère douter que le christianisme n'ait été, au moins dans l'origine, opposé à l'esclavage. Si l'on ne peut induire cela d'aucun texte formel des Évangiles, on peut l'inférer de la nature même de la société chrétienne, toute composée de gens à qui l'esclavage devait naturellement être odieux. Plus tard, lorsqu'il entra dans cette association des personnes d'un autre ordre, lorsque le christianisme pénétra dans les rangs supérieurs de la société, il est probable qu'il se trouva, parmi ces nouveaux prosélytes, des hommes d'une nature généreuse [I-289] qui partagèrent sur la servitude les sentimens des opprimés, et peut-être aussi des hommes d'une nature ambitieuse qui sentirent tout ce qu'on pouvait acquérir de force en sympathisant avec le grand nombre et en se montrant touché de l'infortune des classes asservies. Il est vrai que saint Pierre avait fait aux esclaves un mérite de l'obéissance, et leur avait recommandé d'être profondément soumis à leurs maîtres [213] ; mais il y a lieu de croire qu'on ne s'en tint pas toujours là; et qu'après avoir prêché la soumission aux esclaves, on exhorta les maîtres à la modération. Je ne doute point qu'on ne puisse trouver dans les écrits des prédicateurs, des docteurs, des Pères de la foi, aux premiers siècles de l'Église, des choses très-véhémentes contre la dureté des riches, contre l'oppression des puissans, contre l'injuste servitude où étaient retenus les malheureux et les pauvres. Or, il est juste de penser que cette masse de sentimens éprouvés et plus ou moins manifestés en faveur des esclaves, agissant dans le même sens que cet intérêt des maîtres, dont je parlais tout à l'heure, dut contribuer à adoucir l'esclavage. Ensuite l'histoire atteste qu'à l'époque où la domination romaine fut remplacée par celle des barbares, les chefs de l'Église chrétienne surent profiter avec habileté et avec [I-290] courage de l'ascendant que leurs lumières relatives, leur union, leur esprit de corps, et surtout leur caractère de prêtres, leur donnait sur l'esprit de ces peuples grossiers et profondément superstitieux, pour tâcher d'adoucir un peu la férocité de leurs mœurs et de mettre quelques bornes à leurs déprédations et à leurs violences... Mais ce que l'histoire atteste aussi, c'est qu'ils ne furent ni moins habiles, ni moins ardens, à se servir de ces moyens pour fonder leur propre domination; c'est qu'après avoir été auprès des races victorieuses les défenseurs officieux des populations vaincues, ils cherchent à se placer à côté des vainqueurs, même au-dessus d'eux, et qu'ils prennent une ample part à l'oppression exercée sur les masses. Il leur arrive bien encore de recommander le sort des plébéiens, des pauvres, des esclaves; quelquefois même d'excommunier les maîtres qui tuent leurs serfs sans jugement; mais ils sont loin de donner toujours l'exemple de l'humanité qu'ils prêchent. Sortis du fond de la population, ils ne se montrent pas plus qu'elle exempts des vices et de la grossièreté des temps. L'Église se ressent, comme tout alors, de la barbarie qui règne : elle condamne l'avarice des vainqueurs, et elle les surpasse en avarice; elle réprouve quelquefois l'esclavage, et nul plus qu'elle n'a de serfs; non contente de recevoir la dîme de tous les biens, elle réclame celle des esclaves; elle [I-291] en reçoit en don; elle en achète avec des terres ; elle fait établir que, si l'on tue un de ses esclaves, il lui en sera restitué deux; elle souffre que, par eşprit de dévotion, on se livre à elle en servitude; elle favorise de tout son pouvoir la pratique de ces oblations immorales, qu'elle appelle des dévouemens pieux ; elle enseigne que devenir serf de l'Église, c'est se mettre au service de Dieu même; que la vraie noblesse, la vraie générosité, consistent à rechercher un tel servage; que la gloire en est d'autant plus grande que l'asservissement est plus complet; et telle est, à cet égard, la puissance de ses prédications et de ses maximes que, de l'aveu de ses écrivains, l'usage des oblations devient une des causes les plus actives de l'accroissement de la servitude [214] . Plus tard, lorsque les serfs des villes et des campagnes se soulèvent pour s'affranchir, elle est, de tous les pouvoirs existans, celui qui oppose à ce mouvement la résistance la plus opiniâtre. Elle se répand en malédictions, en imprécations contre l'établissement des communes ;
« novum ac pessimum nomen, s'écrie l'abbé Guibert, nouveauté détestable qui réduit les seigneurs à ne pouvoir rien exiger des gens taillables au-delà d'une rente annuelle une fois payée, et qui affranchit [I-292] les serfs des levées d'argent qu'on avait coutume de faire sur eux. »
Si quelques seigneurs ecclésiastiques se montrent favorables à cette innovation, c'est le très-petit nombre les : papes, les évêques, les abbés, les plus saints personnages, un saint Bernard, par exemple, maudissent de concert les exécrables communes; on fulmine les plus terribles anathèmes contre les bourgeois qui entreprennent de s'affranchir; on dégage canoniquement leurs débiteurs de l'obligation de les payer; on voit des évêques se parjurer, ourdir les trames les plus noires pour reprendre aux habitans de leurs métropoles, des libertés qu'ils leur ont chèrement vendues; lorsqu'on parvient momentanément à remettre ces malheureux sous le joug, on leur prêche la servitude au nom du ciel; l'obéissance que saint Pierre avait conseillée aux esclaves, en compatissant affectueusement à leur infortune, et en leur faisant aux yeux de Dieu un mérite de leur soumission, on la leur prescrit avec l'accent impérieux de l'orgueil et de l'injustice; un archevêque leur crie du haut de la chaire :
« Servi, subditi estote, in omni timore, dominis; serfs, soyez soumis à vos seigneurs avec toute sorte de crainte; et si vous étiez tentés de vous prévaloir contre eux de leur avarice et de leur dureté, songez que l'Apôtre vous commande d'obéir non-seulement à ceux qui sont bons et doux, mais à ceux qui sont [I-293] fâcheux et rudes; songez que les canons frappent d'anathème quiconque, sous prétexte de religion, encouragerait des serfs à désobéir à leurs seigneurs, et à plus forte raison à leur résister de vive force [215] . »
Cette invincible opposition de l'Église à l'abolition du servage se perpétue à travers les siècles; et, dernièrement encore, lorsque notre révolution éclata, il y avait en France des couvens qui possédaient des gens de main-morte; de sorte que les derniers serfs qu'il y ait eu parmi nous étaient une possession de l'Église. Ce n'est pas qu'il n'eût été possible d'entendre la religion plus humainement; et je ne nie point que, dans tout le cours du moyen âge, il n'y eût eu beaucoup de personnes qui eussent regardé la servitude comme contraire aux préceptes de l'évangile. Il paraît qu'il nous est resté, particulièrement des onzième et douzième siècles, un grand nombre de chartes d'affranchissement accordées par des motifs religieux; mais la grossièreté de l'époque se reproduit jusque dans ces actes, qui paraissent dictés moins par un sentiment de commisération pour le malheur des classes asservies que par des motifs personnels, par la peur des peines éternelles, par l'espoir [I-294] des récompenses célestes [216] . C'est au sein des revers, dans les calamités publiques, à l'annonce de quelque grande catastrophe, aux approches de la mort qu'on se décide à ces actes de justice. Encore cherche-t-on souvent, dans ces tardives réparations, à composer avec le ciel, à faire des réserves, à stipuler des termes, et, par exemple, à retenir la jouissance de ses serfs jusqu'à sa mort, à n'être juste qu'à sa dernière heure, à ne s'exécuter que dans la personne de ses héritiers [217] . Voilà comment la religion concourt alors à l'abolition de la servitude. Tout se ressent de l'esprit du temps: il n'y a pas dans les sentimens religieux plus de délicatesse et d'élévation que dans les autres... On a dit souvent que le christianisme nous avait civilisés : peut-être serait-il plus exact de dire que la civilisation a épuré notre christianisme. Si la lettre des évangiles n'a pas changé, nous avons beaucoup changé dans notre manière d'entendre l'évangile; nos sentimens et nos principes religieux ont suivi la marche de tous nos sentimens et de tous nos principes; ils sont devenus plus purs et plus raisonnables à mesure que nous [I-295] avons été plus cultivés. Les chrétiens d'aujourd'hui ne le sont pas à la manière de ceux du temps de la ligue. Notre religion, qui souffre encore que nous trafiquions du sang et de la vie des Africains, deviendra peut-être moins inhumaine lorsque la dure expérience nous aura mieux fait comprendre tous les dangers de cette cruauté... Mais, pour en revenir à la question de savoir quelle part d'influence la religion avait exercée sur l'état des classes asservies, à l'époque dont il s'agit dans ce chapitre, on peut voir par tout ce que je viens de dire que, soit aux premiers temps du christianisme, soit dans le moyen âge, des motifs religieux plus ou moins purs avaient pu se joindre souvent, pour inspirer des mesures favorables aux esclaves, à l'intérêt évident. qu'on avait de les ménager.
Je ne serais pas éloigné de croire que le caractère particulier des mœurs germaines n'eût pu contribuer aussi à l'adoucissement de l'esclavage', et notamment à l'abolition de la servitude domestique. Il paraît qu'une sorte d'orgueil, propre aux dominateurs du moyen âge, et qu'on n'aperçoit point chez ceux de l'antiquité, ne leur permettait pas de se laisser approcher par des hommes de condition servile, et qu'ils ne consentaient à avoir auprès d'eux que des personnes de leur condition. Accepter le service de quelqu'un, l'introduire dans sa maison, dans sa famille, ce n'était pas [I-296] l'humilier, l'avilir: c'était lui donner une marque de considération et de confiance.
« L'effet de cette dispotion, observe M. de Montlosier, fut de renvoyer peu à peu à la profession des métiers et à la culture des terres ces misérables que les Gaulois faisaient servir, ainsi que les Romains, dans l'intérieur des maisons. Les Francs, ajoute-t-il plus loin, n'admirent, en s'établissant dans les Gaules, aucun esclave à leur service personnel. A mesure que les Gaulois ingénus devinrent Francs, et adoptèrent les mœurs franques, ils se défirent de même de leurs esclaves, et à la fin l'esclavage tomba et s'abolit. Il est constant, dit encore M. de Montlosier, que, vers le douzième et le treizième siècle, c'est-à-dire au temps où les mœurs franques ont été pleinement établies, on n'a plus vu en France d'esclaves. »
Il y avait des serfs de la glèbe, il y avait des artisans dans la condition de sujets et taillables à merci; mais la servitude domestique avait complètement disparu.
« Il est constant, poursuit M. de Montlosier, qu'à cette époque, aucun gentilhomme, baron, châtelain ou vavasseur, n'a admis ce qu'on appelle un esclave à son service. Il est constant qu'il n'y a eu d'autres serviteurs parmi les nobles que des parens ou des amis, et que, pour approcher, en général, un gentilhomme, il a fallu être gentilhomme comme lui. Le service personnel, le service qui faisait approcher habituellement [I-297] de la personne du maître, qui mettait avec lui dans un commerce journalier, dans une familiarité intime, un tel service ne pouvait être confié qu'à ce qu'il y avait pour lui de plus noble et de plus cher. Ce fut, de la part d'une femme de qualité, une faveur de permettre à d'autres femmes de partager avec elle les soins domestiques; ce fut également une faveur, de la part d'un haut baron, de permettre à des enfans de ses parens et de ses amis de venir s'adjoindre aux enfans de la maison pour remplir à leur place, ou conjointement avec ceux-ci, les fonctions dont ils étaient chargés : les seigneurs envoyaient ainsi réciproquement les uns chez les autres leurs enfans pour soigner les chevaux, servir à table, remplir les offices de pages et de valets. Ces mœurs, concentrées d'abord dans un petit nombre de familles, se propagent insensiblement, envahissent tous les domaines, et descendent de la demeure des rois, où l'on avait pu les remarquer dès l'origine, jusqu'au château du plus petit seigneur. Telle est cette grande innovation, dont les progrès ont été lents, mais qui, du moment qu'elle se manifeste, présente tout à coup deux grands mouvemens : le premier, qui porte tous les anciens esclaves à la condition de serfs tributaires, et abolit ainsi le véritable esclavage; et le second, qui porte le lustre de la grandeur et de la noblesse à des fonctions que les [I-298] autres peuples avaient affecté de flétrir, etc. [218] .
J'adopte de cette explication ce qui va à la solution de la question qui m'occupe. Peu d'écrivains ont eu, au même degré que M. de Montlosier, le sentiment des mœurs féodales, et j'admets sans difficulté ce qu'il dit de cette singulière hauteur, ou, si l'on veut, de cette dignité personnelle, qui faisait qu'un gentilhomme se serait regardé comme souillé par l'approche habituelle d'un homme asservi, et qu'il lui fallait des fils de bonne maison pour panser ses chevaux, et pour le servir à table. Sans être d'avis, comme M. de Montlosier, que ce sentiment ait tout fait, je crois qu'il a pu contribuer avec le reste à modifier la servitude, et notamment à faire tomber l'usage d'avoir des esclaves pour son service personnel.
Enfin l'on ne saurait douter qu'à toutes les époques les classes asservies n'aient, par leurs efforts, par leur courage, par leur industrieuse et patiente activité, par leur économie constante, puissamment contribué à l'amélioration de leur état.
«L'histoire est là pour attester, dit l'auteur des Lettres sur l'histoire de France, que, dans le grand mouvement d'où sortirent les communes ou les républiques du moyen âge, pensée et exécution, tout fut l'ouvrage des marchands et des artisans, [I-299] qui formaient la population des villes [219] . »
Cela est vrai; et il est impossible de lire les documens si curieux et si instructifs que M. Thierry a réunis sur cette grande époque, sans demeurer convaincu que les fondateurs des communes ne trouvèrent de véritable appui qu'en eux-mêmes, et furent plutôt desservis que secondés par le pouvoir royal, à qui l'on rapporte d'ordinaire tout l'honneur de leur affranchissement. Cependant il faut convenir que, si les esclaves avaient toujours été traités avec autant de dureté qu'ils l'avaient été chez les Romains, tant que la guerre avait offert le moyen de les remplacer, et permis d'être prodigue de leur existence; que si les maîtres, sous la domination romaine d'abord, et ensuite sous la domination barbare, n'avaient pas été amenés par diverses causes à sentir la nécessité de les épargner, de relâcher un peu leurs chaînes, de leur laisser une partie de leur temps et des fruits de leur travail, il eût été bien difficile qu'ils se trouvassent, aux douzième et treizième siècles, dans cet état de force qui leur permit d'entreprendre la révolution dont parle M. Thierry. Il ne serait donc pas possible de rapporter la situation où ils étaient alors à une seule cause. Les classes asservies avaient sans doute habilement profité, pour se relever de leur ancien état de dégradation, du peu de facilités qui [I-300] leur avaient été offertes; mais on ne peut nier que leurs possesseurs, par superstition, par calcul, par humanité, par orgueil, par toute sorte de motifs, ne leur eussent fait des concessions, et accordé des facilités.
Au reste, sans insister plus long-temps sur les causes qui les avaient placées dans la demi-servitude où elles se trouvaient à l'époque dont il s'agit dans ce chapitre, occupons-nous à décrire cette situation, et à voir quel est le degré de liberté qu'elle comporte.
§ 3. La société, au moyen âge, offre un aspect tout-à-fait différent de celui qu'elle avait présenté dans les États de l'antiquité, notamment dans les républiques grecques. Tandis qu'en Grèce les dominateurs, les maîtres, les seigneurs, les citoyens, les hommes libres, comme on voudra les appeler, vivaient tous ensemble dans de jolies villes élégamment ornées, les mêmes hommes, ou leurs analogues, dans l'occident de l'Europe, au moyen âge, sont disséminés dans les campagnes, et vivent isolés dans de noirs châteaux, situés ordinairement dans des lieux élevés, surmontés de girouettes, entourés de fossés, flanqués de bastions et de tourelles, et au pied desquels se trouvent groupées, en plus ou moins grand nombre, les chaumières destinées à la population asservie.
[I-301]
Les premiers parlent une langue correcte, forte, sonore, harmonieuse; ils aiment à exercer leur esprit pour le moins autant qu'à faire agir et à fortifier leurs membres; ils cultivent la poésie, les lettres, la philosophie; ils se réunissent au Portique, dans les jardins de l'Académie; ils vont applaudir, au théâtre, les vers d'Eschyle et de Sophocle. Les autres emploient à monter à cheval, à chasser, à conduire des meutes, à dresser des faucons, à lancer des levriers, le temps qu'ils ne passent pas à se battre; à part l'équitation et une gymnastique brutale, ils ne cultivent aucun art; la langue qu'ils parlent n'est encore qu'un jargon barbare; ils ne sont point capables de la lire, encore moins de l'écrire; le seul exercice intellectuel auquel ils se livrent, dans l'intérieur de leurs châteaux, est d'écouter parfois la lecture de quelque roman de chevalerie, ou les chants insipides de quelque ménestrel; ils entretiennent ordinairement auprès d'eux quelque être singulier, un nain difforme, un fou facétieux, un poète, un barde, un trouvère, officier domestique dont la charge est de chasser l'ennui qui assiège leur demeure, charge difficile, et qui n'est jamais qu'incomplètement remplie. La vie des seigneurs ecclésiastiques diffère peu de celle des autres seigneurs. Les moines, les religieux, les hommes lettrés de l'époque, emploient leurs loisirs, quand les gens de [I-302] guerre les laissent tranquilles, à écrire, dans un latin corrompu, des chroniques remplies parfois de contes puérils, de détails insignifians, ou bien à effacer des manuscrits grecs ou romains, pour copier à la place de fabuleuses légendes, etc.
Cette société du moyen âge n'offre guère, sur celle de l'antiquité, qu'un seul avantage; mais cet avantage est grand : c'est que, chez elle, la classe asservie, le fond de la société, le peuple, est dans une meilleure condition. Sûrement l'aristocratie féodale n'est pas aussi instruite, aussi lettrée, aussi polie, que l'aristocratie grecque; mais sûrement aussi les serfs du moyen âge ne sont pas aussi esclaves que les esclaves grecs. Tandis qu'en Grèce tout ce qu'il y a d'hommes qui cultivent la terre, qui exercent les métiers, qui font le service personnel, sont la pleine propriété des hommes libres, qui peuvent en user et en abuser à leur gré, toute cette partie de la société, dans le moyen âge, au milieu des violences brutales et des pilleries de toute espèce auxquelles elle est encore en butte, se trouve pourtant à moitié sortie de la main des dominateurs. Or, il faut avouer que cette nouvelle manière d'être de la société lui permet de faire des progrès qui n'eussent pas été possibles dans le régime de la servitude pleine.
§ 4. Toutefois, en faisant cet aveu, et avant de [I-303] le justifier, je dois reconnaître les graves obstacles qui s'opposent encore ici aux progrès des facultés humaines.
Tout le monde sait comment étaient organisés les dominateurs du moyen âge, et ce que c'était que le régime féodal. On sait aussi combien était faible le lien qui unissait, dans chaque État, les membres de la hiérarchie féodale, et à quels excès ils se livrèrent entre eux, surtout lorsqu'il n'y cut plus de hordes étrangères à repousser, et que les possesseurs définitifs du sol n'eurent plus à lutter que les uns contre les autres. On a beaucoup parlé de leurs guerres privées, de leurs meurtres, de leurs rapines, de leurs brigandages. Je veux qu'il y ait quelque exagération dans les récits que nous ont transmis de tous ces désordres les écrivains contemporains: on n'en peut nier néanmoins ni la gravité, ni l'étendue, ni la multiplicité, ni la reproduction continuelle: rien ne montre mieux quels ils devaient être que la nature des moyens qu'il fallut employer pour les réprimer.
De la fin du dixième siècle jusque vers le milieu du onzième, en moins de cinquante années, nous voyons, en France seulement, neuf ou dix conciles assemblés pour aviser aux moyens de faire cesser les guerres particulières. La religion épuise en vain contre ces brigandages tous ses moyens de terreur elle excommunie; elle anathématise; [I-304] elle a recours aux imprécations, aux cris à Dieu, aux formules de prières les plus effrayantes; il y a dans tous les couvens une cloche particulière, qui a reçu le nom de cloche iritée, CAMPANA IRATA, et qu'on ébranle à toute heure; les reliques des saints sont brisées; on déchire leurs images; on traîne leurs statues dans la boue ; on jette à terre le crucifix et les Évangiles; on renverse et l'on éteint des cierges allumés [220] .....
Certes, pour que l'Église se livre à de telles démonstrations, il faut qu'il se passe quelque chose de grave; mais ce qui montre mieux quelle est l'ardeur qui pousse les dominateurs d'alors à la guerre et au pillage, c'est que ces moyens, qui auraient dû faire une profonde impression sur des esprits aussi ouverts aux terreurs superstitieuses, ne produisent presque aucun effet, et qu'on est réduit, ne pouvant faire mieux, à composer avec le crime. Un concile (le concile de Tulujes, en 1041) établit qu'il sera permis aux seigneurs féodaux de se faire la guerre pendant quatre jours de la semaine, à condition que, pendant les trois autres jours, qui appartiennent plus particulièrement à Dieu, ils feront trève à leurs ravages, et laisseront un peu respirer l'humanité. C'est ce qu'on appelle la trève de Dieu [221] .
[I-305]
Veut-on une autre preuve des dévastations qui devaient alors se commettre? L'histoire nous apprend que, de la fin du dixième siècle au commencement du douzième, dans l'espace de cent douze ans, la famine, qui, dans les siècles précédens, avait déjà fait d'affreux ravages, reparut treize ou quatorze fois, presque toujours accompagnée de la peste, ou d'autres épidémies meurtrières, qu'elle dura cinquante-une années sur cent douze, à peu près une année sur deux, et qu'en de certaines années la rage de la faim fut telle, que les hommes furent plusieurs fois poussés à s'entretuer pour se manger les uns les autres [222] .
Enfin, une dernière marque des désordres et de la désolation de ces temps, c'est cet aspect de tristesse profonde que présente alors la société, tristesse telle, que l'impression en est arrivée jusqu'à nous, à travers six siècles, telle, qu'il est encore impossible de prononcer le nom du moyen âge sans réveiller des sentimens de terreur et de mélancolie, et dont on ne peut trouver l'explication que dans les calamités sans pareilles que les dominations de cette époque faisaient peser sur la société.
Le caractère de ces dominations n'était pas celui de ces despotismes réguliers, symétriques, fortement [I-306] sanglés, dans lesquels tout tend sans déviation à une fin commune, et sous lesquels rien ne bouge, ni ne peut bouger. Au contraire, ce qui caractérise la féodalité, c'est l'insubordination de tous ses membres, c'est, dans chacun d'eux, un orgueil individuel, une personnalité hautaine, qui font que nul ne veut reconnaître de supérieur. Mais à cette passion d'indépendance, dans laquelle on ne peut pas méconnaître une certaine noblesse, et qui est d'un si bon exemple pour les opprimés, il se mêle une telle ardeur pour la guerre, un tel goût pour la rapine un tel amour de la vengeance, que toute sûreté est comme anéantie, que la société est plus troublée, et peut-être plus malheureuse, qu'elle ne le serait sous le despotisme le plus vigoureux, et que, malgré le mouvement et la vie dont elle est pleine, elle ne peut faire presque aucun progrès.
Il n'est resté que trop de preuves de cette extrême difficulté que la société a eue à se développer dans le long et ténébreux passage de la domination des Romains à celle des gouvernemens qui existaient au douzième siècle. Un siècle après l'établissement des barbares, toutes les traces de la civilisation romaine avaient disparu, et, six ou sept siècles après, cette civilisation n'était encore remplacée par aucune autre. L'histoire nous offre quelques moyens de juger de l'état où se trouvaient encore, aux douzième et treizième siècles, [I-307] les arts, les mœurs, les relations sociales. Peu de traits suffiront pour montrer combien tout cela était encore imparfait.
§ 5. Pour les arts, on ne peut douter qu'ils ne fussent dans un état de grossièreté tout-à-fait barbare. Parlons d'abord de ceux qui avaient pour objet de pourvoir aux premiers besoins de la vie.
Les premiers progrès de l'agriculture et du jardinage sont d'une époque postérieure. Dans le nombre des fruits, des légumes, des céréales, qui nous servent d'aliment, des arbustes et des fleurs qui décorent nos parterres, des plantes qui fournissent des matières utiles à la fabrication, il en est un grand nombre, même parmi les plus communes, dont l'introduction ne remonte pas au delà du seizième ou du quinzième siècle [223] . Suivant un ancien auteur, « on ne faisait quasi des jardins, à Paris, au commencement du siècle dix-septième, que pour des choux, de la porée, et quelques autres légumes [224] . » Qu'en devait-il être trois ou quatre siècles plus tôt ? On voit dans Dulaure les fruits qu'on mangeait à Paris au quatorzième siècle : j'ai occasion d'en parler ailleurs [225] [I-308] On y voit aussi comment on y était logé à la même époque, et surtout dans les siècles immédiatement précédens. Les rues les plus sales des quartiers les plus mal habités de la ville ne donneraient aujourd'hui qu'une faible idée de la plupart de celles d'alors étroites, tortueuses, non pavées, bordées seulement de misérables bicoques, hormis dans les endroits le long desquels régnait quelque édifice public, remplies d'ordures et d'immondices qui n'étaient jamais enlevées; c'étaient des cloaques infects, aussi hideux à voir que malsains à habiter[226] . La première idée de les paver ne vint qu'à la fin du douzième siècle, en 1185. Ce fut le roi Philippe-Auguste qui eut l'idée de cette nouveauté singulière, un jour que, se trouvant à la fenêtre de son palais, dans la Cité, il se sentit plus incommodé que de coutume par les odeurs méphytiques que quelques charrettes faisaient arriver jusqu'à lui en remuant la boue [227] . Mais cette idée ne reçut alors qu'un très-faible commencement d'exécution; et, quatre siècles et demi plus tard, sous Louis XIII, il n'y avait encore que la moitié des rues de pavées. Une lettre de Philippe-Auguste peut donner quelque idée du luxe qu'offrait sa royale demeure :
« Nous donnons, écrivait-il, à la [I-309] Maison de Dieu de Paris, située devant l'église de la bienheureuse Marie (à l'Hôtel-Dieu, près NotreDame), pour les pauvres qui s'y trouvent, toute la paille de notre chambre et de notre maison de Paris, OMNE STRAMEN DE CAMERA ET DOMO NOSTRA PARISIENSI, chaque fois que nous partirons de cette ville pour aller coucher ailleurs [228] . »
Ainsi, de la paille fraîche, de la litière, voilà, à la fin du douzième siècle, ce qui tient lieu de pavés de marbre, de parquets, de tapis, à des rois de France. Qu'on juge par ce luxe des palais royaux de celui des habitations particulières, et par les maisons de la capitale de celles du reste du pays. Il y a peu de maisons qui aient des cheminées; on manque des meubles et des ustensiles les plus indispensables: par exemple, on n'a point encore inventé les fourchettes, et chacun mange avec ses doigts; on n'a pas non plus de serviettes, et l'on s'essuie avec la nappe [229] . Je peux montrer d'un seul trait où devait en être l'éclairage intérieur des habitations: à un siècle de là, sous Charles V, on ne place pas encore de lumière sur la table, et nous lisons que, dans le palais du comte de Foix, le prince le plus magnifique de son temps, le souper n'est éclairé que par quelques chandelles de suif que des [I-310] domestiques tiennent à la main [230] . L'art de se vêtir n'est pas plus avancé que celui de se loger. Sans doute, les nobles seigneurs du douzième siècle ne sont pas aussi misérablement vêtus que l'avaient été, au sixième, ces Visigoths, établis dans le midi de la France, et que le poète Sidonius Apollinaris nous représente siégeant dans leur conseil général, ceints de leurs épées, vêtus d'habits de toile pour la plupart sales et gras, et chaussés de mauvaises guêtres de peau de cheval [231] . Cependant, à juger des costumes du douzième siècle par cette veste de cuir que l'amoureux Pétrarque portait au quatorzième, et sur laquelle il écrivait ses vers, de peur de les oublier [232] on a quelque sujet de croire que l'art des ajustemens n'avait pas fait encore de bien grands progrès : il faut songer qu'on n'avait point de chemises; que les plus grands seigneurs portaient la serge sur la peau; et que, fort en-deçà de ce temps, à la fin du quatorzième siècle, ou au commencement du quinzième, la femme de Charles VI, la reine Isabeau de Bavière, se fait accuser de prodigalité, pour avoir voulu se donner deux chemises de lin. Les bas étaient faits de morceaux d'étoffes cousus ensemble. L'invention du tricot est d'une époque fort postérieure : le [I-311] premier bas tricoté qu'on ait vu en France est du milieu du seizième siècle. Au onzième et au douzième, la plupart des ecclésiastiques n'ont encore que des sandales pour toute chaussure. Au quatorzième, les papes leur reprochent, comme un luxe intolérable, de porter des souliers [233] . On sent assez qu'à l'époque que je décris, il ne faudrait pas parler de fabriques: tout ce qu'il y a d'objets d'industrie est fait à la main.
Si telle est l'imperfection des arts qui pourvoient aux besoins physiques des hommes, ceux d'une nature plus relevée ne sont probablement pas plus avancés. J'ai dit un mot de la barbarie du langage; j'ai dit aussi que les classes les plus élevées ne savaient pas lire, et qu'on aurait fort embarrassé un grand seigneur en lui demandant d'écrire son nom. Il est resté de ces âges grossiers des actes, dans lesquels on voit que des personnages du plus haut rang sont réduits à faire une croix, faute de savoir écrire, signum crucis manu propria pro ignoratione litterarum. Et cette ignorance n'est pas le partage exclusif des laïques : beaucoup d'ecclésiastiques n'entendent pas le bréviaire qu'ils sont obligés de réciter tous les jours; quelques-uns ne sont pas même en état de le lire. On voit figurer dans les conciles des ecclésiastiques en dignité, qui ne [I-312] peuvent pas signer les délibérations auxquelles ils ont concouru. Il est prescrit de demander aux candidats qui se présentent pour recevoir la prêtrise s'ils savent lire les Épîtres et l'Évangile, et s'ils pourraient en expliquer, au moins littéralement, le sens, etc. [234] .
Voici où en est en ce temps l'art de la médecine : comme cet art est exercé par les prêtres, et se trouve, en quelque sorte, dans le domaine de la religion, on procède à la guérison des maladies du corps comme à la cure de celles de l'ame, par des oraisons, par des actes religieux. La plupart des maladies ont dans le ciel un patron dont elles portent le nom, qui exerce tout pouvoir sur elles, et qu'on invoque lorsqu'on en est atteint. Quand les remèdes ordinaires sont inefficaces, on imagine.de faire des processions; on sort nu-pieds des églises, portant les reliques les plus précieuses; et, arrivés devant le lit du malade, on les lui fait baiser, on les lui applique successivement sur toutes les parties du corps où il éprouve de la souffrance, et surtout sur celles où est le principal siège du mal : c'est là le dernier et le souverain remède, celui dont on attend les effets les plus décisifs [235] . Je ne dois pas omettre de dire qu'après les objets saints rien ne paraît doué d'une vertu plus curative que les objets de grande valeur, et, par exemple, que les diamans, que les perles. Telle est la foi qu'on a alors, et plus tard, dans ce remède, qu'en 1397, on voit deux moines s'engager, sous peine de mort, à guérir radicalement le roi Charles VI, au moyen d'une potion formée d'eau distillée sur des perles mises en poudre, et, ne pouvant y réussir, subir en effet le dernier supplice [236] .
Des faits non moins extraordinaires que ceux que je viens de rapporter font voir où en est, à la même époque, l'art qui consiste à régler les actions des hommes, et ce qu'on est capable alors de mettre de raison dans la morale. La considération du bien et du mal que les actions tendent à produire n'entre pour rien dans le jugement qu'en portent les casuistes du temps. L'Église tonne contre l'usage de certains alimens, qui n'offrent absolument rien de malfaisant, et dont l'abus seul semblerait condamnable, ou bien contre l'emploi, tout aussi peu répréhensible, de certains ajustemens. Il est permis de douter qu'elle eût jamais autant crié contre le vol, le meurtre, l'assassinat, qu'elle [I-314] commence à le faire alors contre les souliers à la poulaine : les chroniques, les sermonaires, se remplissent de torrens d'invectives contre cette chaussure, et les moralistes la prennent dans un tel guignon, qu'ils la disent inventée en dérision de Dieu et de son Église. D'autres fois, c'est contre l'usage d'un vêtement dont nous ne saurions aujourd'hui comment nous passer, contre l'usage des culottes, que l'Église entre dans une sainte fureur; et nous voyons alors Pierre, dit le Vénérable, prieur de Vézelay et abbé de Cluny, s'attirer les plus vives censures pour avoir permis à ses religieux de por ter des hauts-de-chausses. D'autres fois encore, l'Église dirige la même sévérité judicieuse contre l'usage des perruques, des fourrures, des longues. barbes, etc. [237] . —Les actions qui passent alors pour les plus morales, ce ne sont pas celles qui sont les plus favorables à l'humanité, qui la conservent, qui l'honorent, qui l'élèvent : ce sont les austérités monacales, la pénitence, le jeûne, tout ce qui est fait dans un esprit de mortification. On voit des femmes pécheresses (les Recluses) renfermées, pour le reste de leur vie, dans des maisons dont elles ont fait murer la porte sur elles, et d'où elles ne communiquent plus avec le monde que par une fenêtre élevée, qui sert à leur faire parvenir les [I-315] choses les plus indispensables à la vie [238] . Vers le même temps, saint Bernard, abbé de Clairvaux, écrit à des moines italiens qu'il n'est expédient, ni à leur état, ni à leur salut, de chercher des remèdes pour conserver la santé. Il trouve indécent à la profession religieuse d'acheter des drogues d'appeler des médecins, de prendre des breuvages de médecine. Cela, dit-il, est contraire à la pureté.
« Nos saints pères, et bienheureux prédécesseurs, écrit un peu plus tard un autre abbé de Clairvaux, choisissaient des vallées humides et basses pour y bâtir des monastères, bâtir des monastères, afin que les religieux, étant souvent malades, et ayant la mort devant les yeux, vécussent toujours dans la crainte du Seigneur [239] . »
C'est tellement dans les pratiques de la vie dévote qu'on fait consister la morale, qu'on a voulu que le vice eût aussi son culte, qu'on lui a choisi des patrons dans le ciel, comme on en a donné à la misère et à la maladie ; que l'impudicité se trouve placée sous l'invocation de sainte Madeleine [240] , le vol sous le patronage de saint Nicolas, et que le plus vil coquin peut se flatter d'entrer en paradis par l'intercession du saint en qui il a foi, et qui est l'objet de sa dévotion particulière. Ajoutons, pour [I-316] ce qui touche aux penchans vicieux, qu'il s'agit moins de s'en corriger que de racheter les crimes qu'ils ont fait commettre; et qu'on expie ses crimes, moins en prenant de nouvelles et meilleures habitudes, qu'en composant avec le ciel, en lui payant rançon, en le traitant comme on traite les hommes. On cherche à apaiser Dieu par des présens, à corrompre quelque saint par des largesses, en lui votant un cierge, une lampe d'argent, une église, ou bien en faisant devant lui acte de soumission et de servilité. On appelle les saints, croyant beaucoup les flatter, monseigneur, monsieur, madame on dit monsieur ou monseigneur saint Denis, monsieur saint Éloi, madame sainte Geneviève, etc. On appelle, par excellence, Dieu le Seigneur, et la Vierge Notre Dame, n'imaginant pas qu'en effet on puisse trouver rien de plus propre à les toucher que ces qualifications féodales. Voilà où en est la morale considérée comme art, wt par où l'on juge que les hommes se rendent agréables à l'auteur de toute vertu et de toute sainteté.
Je ne dis qu'un mot pour montrer où en était, en ces temps, l'art de constater les faits et discerner les vérités juridiques : on sait que tout se décidait par le combat, par l'épreuve du fer chaud ou de l'eau bouillante; que l'homme le plus adroit, le plus fort, celui qui avait la peau la plus dure ou [I-317] la plus calleuse, était toujours celui qui avait le meilleur droit ; et que cette forme inouïe de procédure recevait de la sagesse des hommes le nom de jugement de Dieu.
§ 6. A cette extrême imperfection de tous les arts correspond, dans les mœurs, une licence qui n'est pas moins excessive. Il nous est resté de la corruption qu'elles offraient alors des témoignages irrécusables et nombreux. Ce qu'il y avait, dans leur caractère, de commun, de bas, d'ordurier, est demeuré long-temps empreint, à Paris et dans nos principales villes, jusque sur le nom d'une multitude de rues. Quelques rues de Paris, telles que les rues Pavée d'Andouilles, Trop-va-quidure, Qui-mi-trouva-si-dure, du Puits-quiparle, Bertrand-qui-dort, Brise-Miche, TaillePain, Jean-Pain-Mollet, etc., ne portaient que des noms platement ridicules; mais beaucoup d'autres, telles que les rues Merderais, Merderet, Merduriaux, Merderel, Orde - Rue, rue Bre neuse, Trou-Punais, Fosse-aux-Chiens, Fosseaux-Chieurs, Tire-Pet, du Pet, du Petit-Pet, du Gros-Pet, du Cul-de-Pet, du Pet-au-Diable, en avaient de décidément grossiers. Enfin, il en existait un grand nombre, servant de repaire à la débauche, à qui la licence effrontée de ces temps avait donné hardiment des noms pris de l'ordre [I-318] même d'actions qui s'y faisaient tous les jours, et tellement déshonnêtes, qu'on ne les trouverait plus aujourd'hui, même dans le vocabulaire des halles. Les seuls de ces noms qu'on puisse citer sans blesser toutes les bienséances, sont ceux des rues Vald'Amour, Pute-y-Muce, Putigneuse, cul-de-sac Putigneux; mais le lecteur qui voudrait savoir comment la grossière naïveté de nos âges barbares avait baptisé les rues Transnonain, Tire-Boudin, Deux-Portes-Saint-Sauveur, du Pélican, Marie-Stuart, etc., peut consulter les Fabliaux de Barbassan, dans l'édition qu'en a donnée M. Méon, ou le Dictionnaire des rues de Paris, de M. de la Tynna [241] .
A ces preuves indirectes de la corruption des temps que je décris, rien ne serait si aisé que d'en ajouter de directes. Chacun peut lire dans le tableau moral que Dulaure trace de Paris, de Hugues Capet à Charles V, pendant le cours des onzième, douzième et treizième siècles, et pendant la première moitié du quatorzième, les témoignages que des prélats, des papes, des conciles, viennent rendre tour à tour de la dépravation morale de ces siècles. On peut y voir quelles infames bacchanales, aux onzième et douzième siècles, le [I-319] clergé célébrait publiquement dans l'église NotreDame de Paris, ainsi que dans la plupart des églises cathédrales et collégiales du royaume, et ce que disait de ces exécrables orgies l'évêque de Paris Eudes de Sally, qui eut le premier, en 1198, la gloire de les blâmer et de les interdire. On y peut voir aussi à quelle dissolution et à quels désordres étaient livrés une multitude de couvens, et quelle peine on avait à les ramener à la règle. On y apprendra que l'esprit superstitieux et des terreurs religieuses du temps n'empêchaient pas qu'on ne transformât en lieu de débauche les églises et les cimetières, et que le cimetière des Innocens notamment ne devînt tous les soirs le théâtre des désordres des plus honteux. La prostitution, à cette époque, emportait si peu note d'infamie, que la nour, dans ses voyages, était habituellement suivie par des filles de joie, et que ces filles portaient officiellement le titre de prostituées royales, regia meretrices. On pouvait faire, sans choquer les des choses qui révolteraient maintenant la pudeur publique. Il n'était pas très-rare, par exemple, que des hommes et des femmes fussent condamnés par jugement à être promenés nus dans les rues de Paris; et encore moins que des confesseurs, dans les églises, infligeassent la discipline à leurs pénitens et à leurs pénitentes dépouillés jusqu'à la ceinture. Des femmes de condition [I-320] n'éprouvaient aucune répugnance à se faire rendre par leurs pages des services pour lesquels les moins délicates emploient aujourd'hui le ministère d'une femme de chambre. Un poète de ce temps, qui ne pouvait écrire que pour la bonne compagnie, donne aux femmes les conseils les plus étranges: par exemple, de ne permettre à aucun homme, autre que leur mari, de les embrasser sur la bouche, ou de leur mettre la main dans le sein; de ne se découvrir ni la gorge, ni les jambes, ni le côté ; de boire avec mesure, de ne point jurer, ni mentir, ni voler, d'user de modestie lorsqu'elles luttent avec des hommes, etc. [242] .
Un trait particulier, rapporté par Dulaure [243] , suffirait à lui seul pour montrer combien on était encore peu averti de l'indécence et de la grossièreté de certaines actions. Cet historien, parlant de l'église Sainte-Marie-l'Égyptienne, qui existait déjà du temps de saint Louis, dit que la patrone de cette église avait été peinte sur l'un des vitraux, dans un bateau, troussée jusqu'au genou devant le batelier, avec ces mots au-dessous de la peinture: Comment la sainte offrit son corps au batelier pour son passage. II y a à ajouter que de nombreuses générations d'ecclésiastiques et de laïques passèrent devant cette image obscène sans [I-321] paraître sentir ce qu'elle offrait de choquant, surtout à une telle place, et qu'elle ne disparut de l'église où elle se trouvait qu'après plus de quatre siècles, en 1667, où elle fut retirée de là par les soins du curé de Saint-Germain-l'Auxerrois.
§ 7. J'ai à peine besoin de dire combien un ordre de choses qui avait si peu hâté le progrès des arts et des mœurs devait avoir été peu favorable, d'un autre côté, au perfectionnement des relations sociales. Les anciens noms des rues de Paris sont encore là pour rendre témoignage de l'esprit antisocial de ces temps, aussi bien que pour en révéler les habitudes grossières et licencieuses. Il suffit de dire que, dans une ville encore peu grande, qui était le siège du gouvernement, et où, par conséquent, la police devait être mieux faite qu'ailleurs, il se trouvait néanmoins une multitude de rues assez mal famées pour mériter les noms de Maudestour, Mauconseil, Maldesirant, Maleparole, Malivaux, Mauvoisin, des Mauvais-Garçons, du Coup-de-Báton, Tire-Chappe, Vuide-Gousset, Coupe-Gorge, Coupe- Gueule, etc., pour comprendre qu'il ne devait pas y avoir alors beaucoup plus de sûreté dans les relations, que de pureté dans les habitudes individuelles, ou d'habileté dans l'exercice des arts et métiers.
Au surplus, le détail des périls auxquels on était [I-322] exposé, et des violences dont la société était pleine, se trouve partout, dans les récits des historiens, dans les monumens de la législation, dans les actes des conciles. Un écrivain de notre temps [244] , parlant d'une époque fort antérieure à celle-là, fait la remarque que presque toute la partie pénale de la loi salique avait été dirigée contre des rapines ou des meurtres, et que, sur trois cent quarante-trois articles de droit criminel que cette loi renfermait, il y en avait cent cinquante qui se rapportaient à des cas de vol, et cent treize qui étaient relatifs à des attaques contre les personnes. Les mœurs qui avaient rendu toutes ces dispositions nécessaires sont encore loin d'être effacées au douzième siècle.
Au milieu du désordre extrême des volontés et des forces individuelles que la société continue à présenter à cette époque, il n'y a réellement de sûreté pour personne, pas même pour les dominateurs. Vainqueurs d'aujourd'hui, destinés à être vaincus demain, ils sont presque toujours sûrs d'expier un succès injuste par quelque revers funeste. Celui qui a dévasté les champs, enlevé les serfs et les bestiaux, incendié les habitations d'un seigneur voisin, est dans un danger imminent de voir exercer sur ses terres les mêmes déprédations et les mêmes ravages.
[I-323]
Si le plaisir de la victoire est grand, combien ne sont pas amers la honte et le malheur de la défaite! Malheur au vaincu, en effet; il n'a pas de quartier à attendre: il aura beau se coucher à terre, se rouler, pleurer, prier, crier merci [245] , le vainqueur, à moins qu'il n'ait une forte rançon à espérer, n'écoutera que sa vengeance; maître de son ennemi, il tâchera de soulever quelque pièce de son armure pour y introduire la pointe de son poignard, à peu près comme on fait pénétrer la lame d'un couteau entre les écailles d'une huître, et il lui boutera la dague au corps [246] .
Le vaincu qui pourra racheter sa vie ne l'obtiendra qu'en se soumettant à des réparations avilissantes. Ce que le vainqueur exigera le plus ordinairement, ce sera qu'il se transforme, pour quelques momens, en bête de somme, qu'il marche à quatre pattes devant lui, une selle sur le dos, et, dans cet équipage, qu'il vienne se mettre à ses pieds, et qu'il lui serve de monture. Il y a une multitude d'exemples de seigneurs féodaux qui ont infligé ce châtiment à leurs ennemis défaits. L'histoire cite, entre autres, celui de Foulques Néra, qui condamna son propre fils, le comte d'Angers, à parcourir, ainsi harnaché, un espace de plusieurs milles, et à venir ensuite se prosterner devant lui, [I-324] la selle sur le dos :
« Eh bien! lui criait-il, monté sur son corps et le foulant aux pieds, te voilà enfin vaincu[247] !
Si les désordres de ce temps peuvent avoir de telles conséquences pour les hommes puissans, on sent à quelles extrémités ils doivent souvent réduire les personnes de condition inférieure. Tel est l'état de misère, d'oppression et de désespoir où tombent, au milieu de ces violences, une multitude d'hommes libres, que plusieurs se voient réduits à donner leur liberté pour assurer leur vie; et, de là, la pratique des obnoxiations [248] .
Pour achever ces infortunés, le clergé s'efforce de leur persuader que leur malheur est le fruit de leurs crimes, de la dureté de leurs cœurs, de ce qu'ils ne font point de dons à l'Église : il prêche l'abstinence à des affamés; il demande l'aumône à des gens dépouillés de tout, et, quand il ne leur reste absolument rien, il leur persuade de se donner eux-mêmes: c'est de là que naît, en partie, la pratique des oblations [249]
Une classe d'hommes est l'objet d'une persécution spéciale; ce sont les juifs : ils sont traités avec un degré d'injustice, de dureté, de mépris, d'inhumanité, qui passe toute croyance.
[I-325]
Et pourtant les classes asservies semblent encore plus à plaindre; c'est sur elles surtout que pèsent les maux causés par les guerres privées. Un seigneur jouit encore de quelque sûreté derrière les murailles de son château; mais rien ne protège le serf dans sa chaumière ; et quand on ne peut arriver jusqu'au seigneur, on tue, on pille les colons, on met le feu à leurs villages, on les emmène pêle-mêle avec leurs bestiaux.
Il y a dans la position de ces malheureux quelque chose de particulièrement triste s'ils défendent avec courage le château de leur seigneur, l'agresseur leur fait expier cette marque de dévouement; si leur résistance n'est pas assez ferme, c'est par leur seigneur qu'ils sont punis. L'oppression leur arrive ainsi de tous les côtés; et la victoire, qui ne peut manquer d'être favorable à l'une des parties belligérantes, est toujours funeste pour eux.
D'ailleurs, à combien d'exactions et de violences ne sont-ils pas habituellement exposés de la part de leur seigneur? Ils ne sont plus aussi pleinement possédés sans doute; mais ils sont encore soumis à une multitude de charges onéreuses et de devoirs humilians. Ils doivent à leur seigneur la dîme, le champart, le cens, la taille, la corvée; le seigneur exerce sur eux des justices de toute sorte, de routes, de moutures, de rivières, de fours, de [I-326] pressoirs, de monnaies, de foires; ils doivent défendre la nuit son château contre tout danger et contre tout bruit incommode; ils sont tenus, au besoin, de lui servir d'otages, d'aider à payer sa rançon s'il est pris, de contribuer pour la dot de sa fille; dans le même temps, ils n'exercent qu'un pouvoir précaire sur leurs propres enfans; ils ne peuvent les marier qu'avec la permission du seigneur, et moyennant une redevance; ils ne peuvent non plus tester ou hériter sans permission; quiconque les blesse ou les tue doit une réparation au seigneur, mais cette réparation, pendant long-temps, ne s'était point étendue jusqu'à eux ou à leur famille, et ils sont encore au plus bas degré des compositions; ils sont considérés comme un appendice de la propriété immobilière à laquelle ils sont attachés; ils sont transmis avec elle: on donne un homme avec son fonds, unum hortulanum cum terra sua, duos homines et mensuras suas, duos villanos, etc. [250] ; non-seulement ils ne peuvent pas quitter la terre dont ils dépendent ainsi, mais ils le voudraient vainement; ils portent toujours quelque marque visible de leur servitude: à la différence des hommes libres qui laissent croître leurs cheveux, ils sont obligés de se faire raser [I-327] la tête; quelquefois même ils portent autour du cou, comme certains animaux domestiques, un collier de cuivre attaché à demeure, et sur lequel est écrit leur nom et celui du maître à qui ils appartiennent [251] .
Ainsi les arts, les mœurs, la justice sociale, toutes les choses d'où nous savons que résultent pour les hommes le pouvoir d'user de leurs forces avec puissance et facilité, ne pouvaient faire et n'avaient fait encore que de bien faibles progrès sous le régime économique du servage.
§ 8. Et néanmoins, s'il est vrai que les siècles naissent les uns des autres, que le présent dérive du passé, que les idées, les mœurs d'une époque ont ordinairement leur première raison dans les idées et les mœurs des époques antérieures, il faut bien que ce moyen âge, d'où s'est si lentement et si laborieusement dégagée la civilisation moderne, non - seulement n'opposât pas d'insurmontables obstacles au développement de cette civilisation, mais qu'il en renfermât les germes, et même les germes un peu développés; car, malgré les cinq ou six siècles qui nous en séparent, on ne concevrait pas les progrès que nous avons faits, si nous n'avions eu déjà quelque avance.
[I-328]
Aussi, si nous voulons apprécier avec justice l'état que présente alors la société, serons-nous obligés de reconnaître que cet état, si violent et si irrégulier à beaucoup d'égards, offrait pourtant, sous des rapports essentiels, moins d'obstacles à la liberté que celui qui a été décrit dans le précédent chapitre. Le fait est qu'il y a une distance énorme de l'état où se trouvent ici les classes asservies à l'état où elles se trouvaient sous le régime économique des anciens. Au fort des dominations grecques et de la domination romaine, l'esclave n'était, dans toute la rigueur du mot, qu'un animal domestique; animal d'une nature supérieure, si l'on veut, plus intelligent que l'âne, que le bœuf, que le cheval, mais dans la même condition que ces quadrupèdes ; employé, comme eux, à tous les travaux de la maison; pouvant être, comme eux, impunément maltraité; traité, presque toujours, plus inhumainement que les bêtes mêmes, et cela précisément parce qu'il était homme, et plus sujet à oublier sa condition; enfin ne trouvant de protection nulle part, ni dans les idées, ni dans les mœurs, ni dans la religion, ni dans les lois qui gouvernaient ses maîtres. Au moyen âge, c'est un peu différent. La population serve forme toujours le fond de la société, comme dans les temps antiques; mais elle est loin, nous l'avons déjà dit, d'appartenir au même degré. En fait, la condition [I-329] des artisans des villes, et même des serfs des campagnes, est assez différente de celle des anciens esclaves. Elle l'est aussi en droit: la religion et la morale ne sont plus aussi complètement indifférentes au sort des classes asservies; les lois ne gardent plus un silence aussi absolu sur les violences dont elles peuvent être l'objet ; la loi des compositions protège, jusqu'à un certain point, le serf dans sa vie et dans ses membres; il a un commencement de propriété, comme un commencement de sûreté personnelle; il n'est plus aussi complètement en dehors de la société ; l'un des pouvoirs qui la gouvernent, le pouvoir spirituel, se recrute en grande partie dans la classe des artisans libres, et même dans la population serve; presque toute la milice cléricale sort des derniers rangs de la société ; tandis que les esclaves, chez les anciens, ne pouvaient faire partie de l'armée, les artisans et les paysans, au moyen âge, forment toute la population militaire des seigneurs; témoins de leur insubordination, acteurs dans toutes leurs querelles, il est impossible qu'ils ne prennent pas quelque chose de l'esprit d'indépendance qui les anime. Chaque seigneurie, au moyen âge, est un petit État et un foyer d'activité politique. Cette activité locale, quoiqu'elle ne soit pas d'une excellente nature, ne laisse pas de produire quelques bons effets. Le seigneur, gouvernant, administrant [I-330] pour son propre compte, a plus d'une raison pour ne pas le faire avec trop de démence et de tyrannie. Son premier intérêt est de ne pas détériorer son fief, de n'en pas faire fuir les habitans, de ne pas se mettre dans l'impuissance de résister au seigneur voisin avec qui il pourra bientôt se trouver en guerre. Il lui importe done de protéger la population de la seigneurie, de faire qu'elle croisse en nombre, en richesse, en bien-être, en affection pour le seigneur. Aussi, s'il lui arrive de l'op primer pour son propre compte, a-t-il au moins grand soin de la défendre contre toute entreprise étrangère, et même contre tout trouble intérieur qui ne viendrait pas de lui ou des siens. Les seigneurs se laissent fréquemment aller à de honteux brigandages; mais c'est un privilège de leur condition, et un privilège dont ils sont extrêmement jaloux. Ils ne souffrent pas que les hommes obscurs imitent ces sortes de prouesses, et mal prend aux volereaux de faire les voleurs. Il y a quelque police dans les seigneuries, si ce n'est contre les seigneurs mêmes la population est responsable des désordres qui se commettent dans son sein; chacun est obligé d'accourir au eri d'une personne attaquée; si le voleur ou l'assassin prend la fuite, le cri poussé contre lui se propage de commune en commune, et il est rare que le coupable ne soit pas atteint. Aussi la clameur de haro, [I-331] institution de ces temps, est-elle regardée comme la sauvegarde de la tranquillité publique [252] . Enfin le seigneur, vivant plus ou moins isolé, au milieu des serfs de ses domaines (à la différence des maîtres d'esclaves de l'antiquité qui étaient réunis dans des villes), et pouvant craindre pour lui ou les siens les conséquences d'une conduite trop tyrannique, a bien aussi quelque intérêt à ne pas trop abuser de ce pouvoir de mal faire que lui donne son titre de seigneur, et à s'abstenir des excès que ne peuvent commettre impunément les habitans de la seigneurie. Il y a donc dans l'état des vaincus, des serfs, des sujets, amélioration évidente [253] .
Aussi la preuve que cet état ne leur rendait pas tout progrès impossible se montre-t-elle dans les progrès mêmes qu'ils avaient faits. On ne saurait douter, par exemple, qu'aux douzième et treizième siècles la France ne fût beaucoup plus peuplée qu'elle ne l'avait été du temps des Romains. Le nombre des villes s'était fort accru [254] Les [I-332] villes anciennement existantes s'étaient agrandies [255] . Paris, sous Philippe-Auguste, à la fin du douzième siècle, en était déjà à sa troisième enceinte, et couvrait un espace de terrain quatre ou cinq fois plus étendu que sous la domination romaine [256] . Les autres villes, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Tours, avaient pris aussi des accroissemens. Il y avait eu, surtout dans le voisinage des villes, une multitude de terrains enclos. Des défrichemens étendus avaient adouci le climat, facilité l'extension des cultures existantes, et préparé le sol à l'introduction de cultures nouvelles. On sentait le besoin et l'on avait déjà les moyens de consacrer des sommes considérables à des objets d'intérêt commun. Il commençait à s'établir dans les villes des marchés clos sous le nom de halles. On fondait des établissemens d'instruction et de charité. C'est à cette époque que s'élevèrent dans toute l'Europe ces églises cathédrales dont le nombre et la grandeur n'attestaient pas seulement la puissance du sentiment religieux qui animait les masses, mais aussi l'étendue des ressources dont [I-333] elles pouvaient disposer. Ces monumens, dans lesquels l'architecture sarrazine avait succédé à l'architecture romane, annonçaient, en même temps, un progrès dans le goût et surtout un grand mouvement dans les imaginations. Imparfaits à quelques égards sous le rapport de l'art, ils étaient si remarquables sous le rapport du sentiment et de la pensée, qu'aujourd'hui même que le sentiment qui les avait inspirés a beaucoup perdu de sa force, que l'architecture a changé de caractère, que le goût n'est plus le même, que tous les arts ont fait de grands progrès et qu'on est devenu particulièrement sensible à la perfection de leurs formes, les églises dites gothiques, où tant de formes sont incorrectes, ont conservé, au plus haut degré, le pouvoir de toucher et d'émouvoir. Ce n'est pas tout. A l'époque où s'élevaient ces immenses édifices, fruit d'une conception si forte et d'une imagination si hardie, les études devenaient plus actives; les écoles se multipliaient; saint Louis fondait l'université de Paris; on commençait, dans les ouvrages instructifs et amusans, à faire un usage plus fréquent de la langue vulgaire. En même temps on essayait de corriger la barbarie de l'ancienne procédure, de mettre un terme aux désordres des guerres privées et quelques bornes aux prétentions illimitées de l'église romaine. Certes, on ne saurait dire qu'un état social au sein duquel un tel [I-334] mouvement était possible ne comportait aucune sorte de progrès.
Mais une chose où se montrent encore mieux les progrès qu'il permettait de faire, c'est la révolution que les classes asservies purent entreprendre pour s'affranchir à l'époque même du plus complet établissement de la domination féodale : révolution dans laquelle ces classes firent voir qu'elles étaient assez riches pour acheter leur liberté, assez courageuses pour la défendre après l'avoir acquise, souvent assez entreprenantes pour l'acquérir sans la payer, assez constantes pour résister aux épreuves les plus décourageantes, assez hardies pour braver alternativement tous les pouvoirs du temps et quelquefois plusieurs de ces pouvoirs ensemble, assez habiles enfin pour savoir profiter de leurs dissensions et en engager toujours quelqu'un dans leurs entreprises : révolution qui, ayant aboli le servage et fait perdre aux classes dominatrices la distinction de la liberté, poussa bientôt ces classes à chercher une nouvelle distinction dans le privilège, et conduisit ainsi la société à la nouvelle manière d'être que je vais décrire dans le chapitre suivant.
[I-335]
CHAPITRE IX.
Liberté compatible avec la manière de vivre des peuples chez qui le servage a été remplacé par le privilège.↩
§ 1. La crise qui prépara la société à l'établissement de ce nouveau mode d'existence, fut, comme je viens de le dire, celle-là même qui amena l'abolition du régime précédent. Cette crise commença avec le douzième siècle, et elle se prolongea pendant tout le cours de ce siècle et des deux siècles suivans. A l'origine de cet immense mouvement, les classes laborieuses étaient partout dans la demi-servitude qui vient d'être décrite. Cependant, eu égard à leur ancienne manière d'être, elles avaient sûrement fait de grands progrès. Elles étaient, comme on vient de le voir, infiniment plus puissantes qu'elles ne l'eussent jamais été dans les temps antiques; et, favorisées par quelques circonstances heureuses, elles se crurent assez fortes pour achever de sortir de leur ancien état de dépendance et d'abaissement. Les premières tentatives de délivrance eurent lieu en Italie. Elles furent ensuite imitées en France; puis en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, en Espagne; peu [I-336] à peu le même esprit d'affranchissement s'éveilla dans toute l'Europe occidentale; et l'on vit les hommes de travail faire partout des efforts plus ou moins énergiques et plus ou moins heureux pour se soustraire à la domination des gens de guerre.
On sait quel fut l'effet immédiat de cette vaste révolution. Elle partagea, en quelque sorte, les habitans de chaque pays en autant d'agrégations d'hommes qu'il y avait de villes, de communautés, de professions qui entreprenaient de se délivrer [257] .
Long-temps cette organisation fut purement défensive; elle prit plus tard un caractère agressif : les hommes qui s'étaient ligués pour l'indépendance du travail finirent par en vouloir faire le monopole, et par imiter à leur manière l'esprit dominateur de ceux qui les avaient opprimés. Il n'y eut plus en quelque sorte d'esclaves ni de demi-esclaves; aucune classe n'était la propriété matérielle d'aucune autre; mais chacune, à l'exclusion de toutes, voulut s'emparer de quelque mode spécial d'activité, de quelque branche particulière de fonctions [I-337] ou de travaux; et, avec le temps, on vit sortir de ce conflit de prétentions injustes un état de choses dans lequel la masse entière des individus se trouva partagée en un certain nombre de classes, d'ordres de corporations qui eurent tous leurs intérêts séparés, leurs lois particulières, leurs privilèges (privatæ leges), et dont chacun exerçait sur tout le reste quelque genre de tyrannie.
Je suis arrivé tout d'un coup au bout de cette grande révolution. Il serait hors de mon sujet d'en exposer ici le détail et la suite. Je n'ai besoin que d'en montrer les conséquences, et de bien faire connaître l'état social qui se manifesta lorsqu'elle fut pleinement accomplie.
§ 2. D'abord les gens de guerre, en voyant les hommes d'industrie élevés à la condition d'hommes libres, s'étaient formés en état séparé sous le nom de Noblesse. Les gens d'église s'étaient isolés à leur tour sous le nom de Clergé. Les légistes, les officiers de justice, les savans, les artisans, tous les hommes voués aux professions dites libérales ou mercantiles, avaient formé un troisième état sous le nom de Tiers.
Chacune de ces grandes divisions s'était subdivisée ensuite en corporations nombreuses. La noblesse avait eu ses ordres militaires; le clergé, ses ordres religieux; le barreau, ses compagnies; la [I-338] science, ses facultés ; l'industrie, ses jurandes. L'esprit général des trois ordres était une vive émulation de haine ou de mépris les uns pour les autres; le même esprit avait pénétré dans l'intérieur des corporations. On avait partout affecté d'établir des hiérarchies factices: la science avait ses degrés comme la noblesse; l'industrie comme la science; et de même que, parmi les nobles, on s'était distingué par les grades d'écuyer et de chevalier, de même on avait voulu se distinguer, parmi les savans, par ceux de bachelier et de licencié, et parmi les artisans, par ceux de compagnon et de maître.
Enfin un esprit universel d'exclusion s'était emparé de toutes les classes, de toutes les agrégations. C'était à qui obtiendrait le plus de privilèges odieux, le plus d'injustes préférences. La noblesse avait le monopole du service public; le clergé, celui de l'enseignement et des doctrines; le tiers-état, celui des travaux industriels. Dans ce troisième ordre, les arts libéraux étaient devenus l'apanage d'un certain nombre de compagnies; divers corps de marchands avaient envahi lé négoce; les arts mécaniques étaient tombés au pouvoir d'autant de communautés qu'on avait pu distinguer de genres différens de fabrication.
Les rois avaient favorisé, à prix d'argent, toutes ces usurpations criantes. Ils ne cessaient de vendre [I-339] à des corps ou à des individus désignés ce qui était le droit naturel de chacun et de la masse. Ils vendaient la noblesse, c'est-à-dire l'aptitude au service public; ils vendaient le droit de rendre la justice; ils vendaient jusqu'au droit de travailler : le travail, que dans les âges précédens on renvoyait dédaigneusement aux esclaves, était devenu, on ne sait comment, une prérogative de la couronne, un droit royal et domanial [258] , qu'on n'exerçait que par délégation du chef de l'État et moyennant finance. Nul ne pouvait, sans payer, gagner honnêtement sa vie ; et quelques-uns, en payant, acquéraient le droit de faire seuls ce que naturellement tout le monde aurait dû avoir le droit de faire.
Enfin ce mouvement ne s'était pas arrêté à des individus, à des compagnies. Les villes avaient voulu avoir leurs privilèges comme les corporations; les provinces, comme les villes; les royaumes, comme les provinces. Il y avait des ports francs, qui avaient, à l'exclusion de tous autres, le droit de faire librement le commerce maritime. Certaines villes manufacturières étaient en possession de fabriquer seules de certains produits. Il existait des provinces à qui appartenait, par privilège exclusif, l'exploitation de certaines branches [I-340] de commerce. Enfin il n'était pas de pays qui n'eût voulu avoir un accès libre sur tous les marchés étrangers, et qui cependant ne prétendît écarter de ses marchés toute concurrence étrangère. Depuis les plus petites communautés jusqu'aux plus vastes États, c'était une manie générale d'accaparement, un débordement universel de prétentions exclusives et iniques.
§ 3. Dans ce nouveau mode d'existence, chacun donna le nom de liberté aux privilèges dont il jouissait au détriment de tout le reste. Ainsi la noblesse appela ses libertés son droit exclusif aux faveurs de cour, son monopole des fonctions honorifiques et de la plupart des fonctions lucratives, ses exemptions d'impôt, ses bannalités, ses droits de chasse, et une multitude d'autres droits plus ou moins oppressifs, qu'elle avait sauvés du naufrage de ces anciennes tyrannies. Les libertés du clergé, ce furent le droit d'imposer les croyances, le droit de lever la dîme, le droit de ne pas payer de taxes, le droit d'avoir des tribunaux particuliers; celles de chaque communauté d'artisans, le droit exclusif de fabriquer de certaines marchandises et de faire la loi aux marchands; celles de chaque corps de marchands, le droit de vendre seul de certaines denrées, et de faire sur les consommateurs des profits illégitimes. Il n'y en avait presque point [I-341] qui ne consistassent en injustices, en exactions, en violences.
§ 4. Il semble qu'aucune véritable liberté ne devait pouvoir se concilier avec des libertés pareilles; et, en effet, nous verrons bientôt qu'elles opposaient le plus grand obstacle au développement de l'intelligence et de l'industrie; qu'elles étaient la source des désordres les plus graves, et que, de toute manière, la liberté ne pouvait qu'en beaucoup souffrir. Cependant, comparées aux excès de l'âge précédent, elles lui étaient certainement favorables, et il n'est pas douteux qu'elle ne pût prendre plus d'extension sous le régime des privilèges, qu'elle ne l'avait fait sous celui de l'esclavage ou du servage proprement dits.
Par cela seul que, dans ce nouveau régime, une moitié de la population avait cessé d'être la propriété matérielle de l'autre, il est visible qu'il devait y avoir plus de liberté. D'abord l'industrie humaine y pouvait prendre plus d'essor : les anciens dominateurs, ne fondant plus uniquement leur subsistance sur les produits de la guerre et le travail des hommes vaincus, devaient commencer à faire quelque usage de leurs facultés productives; et, d'un autre côté, les hommes anciennement asservis, travaillant maintenant pour eux-mêmes, devaient se livrer au travail avec plus de zèle, de suite [I-342] et d'activité. Chacun, il est vrai, se trouvait encore comme emprisonné dans le cadre où le hasard l'avait fait naître; ce n'était qu'avec la plus grande peine qu'on pouvait abandonner l'état de ses parens pour embrasser celui auquel on se sentait plus particulièrement appelé. Mais du moins, chacun, dans la condition où il était né, pouvait, jusqu'à un certain point, user de ses forces pour son propre compte et commencer à accumuler les fruits de son travail. Pour reconnaître que cet ordre social ne rendait pas tout développement impossible, il suffit de faire attention que c'est au sein même de cet ordre qu'ont commencé à s'étendre, à s'élever, à prendre de l'importance, ces classes si diversement laborieuses, à qui les nations de notre âge sont redevables de presque tout ce qu'elles possèdent de lumières et de bien-être, et que la nature des choses appelle hautement à devenir les premières dans l'ordre politique, comme elles le sont depuis long-temps dans toutes les autres branches de la civilisation [259] .
[I-343]
Il faut ajouter que ce mode d'existence, plus favorable que les précédens aux progrès de l'industrie et des lumières, l'était aussi aux progrès des mœurs. L'homme de guerre, ne comptant plus autant sur le pillage pour entretenir ou accroître sa fortune, devait un peu mieux sentir la nécessité de la dépenser avec discernement et modération. L'homme d'industrie, devenu plus maître de lui-même et des fruits de son travail, avait acquis un intérêt.plus grand à se bien conduire. Sûr d'augmenter son bien-être par l'application, l'économie, l'ordre, la régularité, il était naturellement excité à contracter l'habitude de ces vertus. Il devenait moins intempérant par cela même qu'il était moins misérable; il était moins excité à chercher dans la débauche un dédommagement à des privations qu'il n'éprouvait plus; ses goûts devenaient plus délicats, à mesure qu'il avait plus de quoi les satisfaire; et, croissant en instruction et en richesses, il devait croître nécessairement en bonnes mœurs.
[I-344]
Enfin, tandis que, dans ce régime, les hommes apprenaient à mieux user de leurs facultés à l'égard d'eux-mêmes, ils en faisaient aussi, des uns aux autres, un usage moins violent et moins agressif. Quelles que fussent les rivalités des corporations et des ordres, il ne pouvait pas, à beaucoup près, régner entre eux autant d'animosité qu'il y en avait eu précédemment entre les maîtres et les esclaves. Quelles que fussent les jalousies commerciales qui divisaient les nations, leurs haines mutuelles ne pouvaient pas avoir l'énergie de celles qui avaient existé entre des peuples acharnés à se piller et à s'asservir. Dans le nouvel ordre social, l'opposition des intérêts était visiblement moins forte : la guerre intestine et extérieure devait donc être moins ardente, et, par cela même, ses conséquences ne pouvaient pas être aussi fatales à la liberté. D'une autre part, l'esprit de domination étant affaibli, l'organisation sociale n'avait pas besoin d'être aussi tendue; les gens de guerre pouvaient relâcher un peu les liens de l'ancienne discipline, et donner quelque liberté à leurs mouvemens; les gens d'industrie en acquéraient, par cela seul, davantage; enfin, tandis que le pouvoir ne pesait plus sur ceux-ci avec la même intensité, leur ordre intervenait de plusieurs manières dans son action, et pouvait encore en tempérer l'exercice.
Il y avait donc, sous le régime du privilège, [I-345] progrès incontestable vers la liberté. Les facultés humaines y prenaient plus de développement; les hommes s'y conduisaient mieux envers eux-mêmes; ils ne s'y faisaient pas mutuellement autant de mal. Il suffit, pour se convaincre de la justesse de ces remarques, de comparer les peuples de cet âge avec ceux de l'antiquité qu'on dit avoir été les plus libres. Il n'y a pas le moindre doute, par exemple, qu'on n'eût en France, avant la révolution et sous le régime des corporations et des ordres, infiniment plus de vraie liberté qu'on n'en posséda jamais à Sparte ou à Rome dans les plus beaux temps de ces républiques [260] .
[I-346]
§ 5. Cependant, si le régime du privilège était favorable à la liberté, ce n'était que par comparaison avec ceux qui l'avaient précédé; car, envisagé en lui-même, il lui opposait encore d'immenses obstacles.
§ 6. On ne pouvait d'abord, sous ce régime, jouir que très-incomplètement de la liberté qui résulte du progrès de nos facultés industrielles et productives. Il ne comportait pas le plein développement de ces facultés; il le rendait au contraire impossible, et il retenait les arts et les sciences dans un véritable état d'imperfection, comparativement du moins à ce qu'ils peuvent devenir dans un ordre de choses plus naturel et plus raisonnable.
Le trait caractéristique de cet état social, c'était que la profession de chacun était déterminée par sa naissance. On était ce qu'on était né; on faisait [I-347] ce qu'avaient fait ses ancêtres [261] . Il n'était pas absolument impossible de changer d'état; mais cela du moins était fort difficile: la tendance la plus énergique de toute corporation était de repousser les étrangers de son sein, et de réserver pour les siens la place vacante.
L'emploi des forces humaines, dans cet état, se trouvait donc déterminé par une circonstance absolument étrangère à la véritable vocation des hommes, Tel était avocat, que la nature avait fait médecin; tel autre maçon, qu'elle avait destiné à être statuaire. Ce n'était en quelque sorte que par hasard que l'on était à sa place. Une multitude de capacités se trouvaient détournées de leur véritable application. De là une immense déperdition de forces, et par conséquent un très-grand retard mis aux progrès de l'humanité.
Tandis qu'une masse de forces considérable était mal employée, une masse encore plus grande peut-être se trouvait perdue faute d'emploi. C'était la suite toute naturelle de la tendance des corps à se réduire, à diminuer dans chaque carrière le nombre [I-348] des compétiteurs. Il résultait de là qu'une multitude d'hommes, surtout dans les rangs inférieurs de la société, restaient toute leur vie sans profession, et languissaient dans un état misérable, où leurs facultés ne pouvaient prendre aucun essor. Il y avait donc encore, sous ce rapport, perte de talens, de capacités, de forces, d'où résultait visiblement un nouveau retard dans le progrès des facultés de l'espèce.
C'était peu de diminuer la masse des hommes actifs; c'était peu d'empêcher que les hommes occupés le fussent de la chose à laquelle ils auraient eu le plus d'aptitude; le système des corporations avait encore pour effet d'empêcher que dans l'état qu'on exerçait on fît tout ce qu'on eût été capable de faire. Je ne dirai pas qu'il détruisît entièrement l'émulation; mais qui pourrait nier qu'il ne l'amortît d'une manière sensible. S'il est vrai que, plus on a de rivaux dans une profession, plus il faut travailler, s'évertuer pour obtenir la préférence; il est clair qu'un système qui délivrait de beaucoup de concurrens dispensait, par cela même, de beaucoup d'efforts, et devait laisser beaucoup de forces inactives. C'était donc, de la part de ce système, une nouvelle manière de diminuer les travaux de toute espèce, et, par conséquent, de retarder les progrès de la culture et de la liberté.
Avant d'arriver à la maîtrise, dans toute profession, [I-349] il fallait dépenser infructueusement un temps et des sommes considérables. Quand on y était parvenu, il fallait en dépenser encore davantage pour défendre contre toute usurpation le privilège qu'on avait acquis. Enfin, comme tout privilège était une injustice criante, et qui ne pouvait se maintenir d'elle-même, il fallait, pour en jouir sans trouble, avoir l'appui de l'autorité, et l'autorité faisait payer cher cet appui. C'était donc encore une masse considérable de capitaux, de temps, d'activité, qui était dérobée au travail utile, et dépensée, non-seulement sans fruit, mais d'une manière très-préjudiciable au progrès des facultés et de la liberté.
J'ai dit que les privilèges affaiblissaient l'émulation; ce n'est point assez: sous un certain rapport, ils rendaient les progrès impossibles. Toute découverte relative à un art, faite hors de la communauté qui en avait le monopole, restait sans application la communauté ne souffrait pas que l'inventeur en profitât à son préjudice [262] ; et toute découverte, faite dans le sein même d'une corporation, était également perdue : les membres à qui elle n'appartenait pas, sentant qu'elle ne pouvait que nuire au débit de leurs propres produits, la [I-350] traitaient d'innovation dangereuse, et ne négligeaient rien pour la faire avorter [263] . L'emploi de tout nouveau procédé se trouvait donc comme impossible. Dès lors, on n'avait plus aucun intérêt à rechercher les meilleurs; et, pendant des siècles, les sciences et les arts se traînaient péniblement dans la même ornière.
J'ai parlé des efforts qu'on faisait pour écarter la concurrence des hommes; on n'en faisait pas moins pour se débarrasser de celles des choses. Les communautés travaillaient, à l'envi l'une de l'autre, à répousser de leur territoire les marchandises des forains. Il en résultait que l'action du commerce, comme celle de la fabrication, se trouvait resserrée dans les bornes les plus étroites; que chacun vivait dans l'isolement; que partout on était réduit à sa propre expérience; qu'une découverte faite dans un lieu ne servait de rien au reste de l'humanité, et qu'un bon procédé, pour devenir général, avait besoin en quelque sorte d'être autant de fois inventé qu'il y avait de peuples qui s'entouraient de barrières, et qui, en repoussant les produits de l'étranger, s'ôtaient la ressource si précieuse et si commode de l'imitation.
[I-351]
Je ne finirais point si je voulais montrer de combien de manières le système des privilèges nuisait au développement de l'intelligence et de l'industrie. Les faits, à cet égard, en disent plus que tous les raisonnemens ; les faits montrent avec évidence que, partout où l'on a pu discuter et travailler šans contrainte, les sciences et les arts ont fait de rapides progrès; tandis qu'ils sont restés plus ou moins stationnaires partout où quelques hommes ont eu le monopole des doctrines et de l'industrie. Le gros de la population est fort ignorant en Espagne, où le clergé a depuis plusieurs siècles une juridiction illimitée sur les travaux de l'esprit ; l'instruction est plus commune en France, où ces travaux ont joui d'une latitude plus grande; et beaucoup plus commune en Angleterre, où, depuis long-temps, ils ne sont plus sujets à aucun obstacle préventif. On a vu en Angleterre les villes qui avaient des corps de métiers croître d'une manière beaucoup moins prompte que celles qui n'en avaient pas. Yorck, Bristol, Cantorbéry, soumis au régime des corporations, ont perdu, observe M. Say, le rang qu'ils tenaient anciennement ; et, sous le rapport des richesses et de la population, ils ne viennent plus que fort après les villes de Manchester, de Birmingham et de Liverpool, qui n'étaient que des bourgades, il y a deux siècles, mais qui avaient l'avantage de ne point avoir de corps [I-352] de métiers [264] . A Londres, la ville du centre, où l'industrie est sujette aux réglemens, a diminué de population, tandis que les faubourgs, où elle est libre, ont envahi la moitié du comté de Midlesex, et s'étendent chaque jour davantage [265] . On sait qu'à Paris, sous l'ancien régime, l'industrie était incomparablement plus avancée dans la partie de la ville où elle n'était point gênée que dans celle où elle se trouvait sous le joug des maîtrises [266] Il n'y aurait enfin aucune exagération à dire que l'industrie, malgré les troubles et les guerres de la révolution, a plus fait de progrès en France, dans les trente-cinq ans qui se sont écoulés depuis l'abolition des privilèges, qu'elle n'en avait fait, en plusieurs siècles, sous l'ancienne monarchie.
§ 7. Si le régime des privilèges nuisait aux progrès des arts, il n'était pas moins contraire à celui [I-353] des mœurs, et la liberté, sous ce rapport, en recevait encore de graves atteintes. Les mœurs sans doute avaient beaucoup gagné à l'abolition de l'esclavage; mais combien n'avaient-elles pas encore à souffrir des privilèges des ordres et des corporations? Sans rappeler tel de ces privilèges, qui, dans des temps reculés, avait fait, en certains cas, pour certains hommes, un droit du viol et de l'adultère, il en subsistait encore de fort corrupteurs. Tel était notamment le privilège des hautes classes de conserver la noblesse dans l'oisiveté, ou plutôt le privilège qui faisait, pour elles, de l'oisiveté une condition de la noblesse [267] ; tel, le privilège de [I-354] ces aînés de famille, que leur titre dispensait, pour être riches, de toutes les qualités nécessaires pour acquérir une fortune, et que leur position particulière appelait souvent à dépenser follement et licencieusement celle qu'ils avaient; tel, le privilège de ces propriétaires de biens substitués, qui pouvaient s'abîmer de dettes sans courir le risque de grever ces biens, et d'appauvrir ceux qui devaient en hériter; tel encore, le privilège de ces hommes de cour qui, visant à accroître leur fortune, pouvaient commencer par la dissiper, assurés qu'ils étaient de rattraper par des dons et des graces encore plus de biens qu'ils n'en détruisaient par leurs profusions [268] .
Mais, outre que certains privilèges tendaient immédiatement à corrompre les mœurs, ils y tendaient tous d'une manière plus éloignée, en s'opposant, comme je l'ai dit, au développement du travail, de la richesse et des lumières. Tout ce qui met obstacle aux progrès de l'instruction nuit essentiellement à la morale, qui est le fruit du bon [I-355] sens autant que des bons sentimens; tout ce qui s'oppose aux progrès de la richesse nuit également aux bonnes mœurs, qui viennent à la suite de l'aisance, au lieu que le dénuement et la misère marchent presque toujours escortés de la dépravation. La morale enfin est directement attaquée par tout ce qui gêne le travail, puisque l'oisiveté est mère du vice, et qu'à l'indigent qu'on empêche de travailler il ne reste que le vol ou la mendicité pour ressource [269] .
Si l'on veut juger à quel point la morale souffrait du régime des privilèges, il n'y a qu'à considérer le nombre de personnes qu'il dispensait de toute honnête occupation dans les rangs élevés de la société, et le nombre encore plus grand de celles à qui il interdisait toute industrie dans les conditions inférieures; il n'y a qu'à regarder un peu tout ce qu'il [I-356] faisait naître dans le monde de dissipateurs, d'intrigans, d'oisifs, de valets, de mendians.
Ajoutez que ce système ne dépravait pas seulement les hommes des dernières et des premières classes, mais encore, bien qu'à un moindre degré, ceux de l'ordre intermédiaire des citoyens. Il y avait en effet dans leur prospérité quelque chose de violent et d'illégitime; elle n'était pas seulement le fruit du travail, elle était aussi celui du monopole, et une partie de leurs profits venait toujours de ce qu'ils pouvaient réduire, d'autorité, le nombre de leurs concurrens. C'était même à écarter les rivaux, beaucoup plus qu'à les surpasser en mérite, qu'était dirigée leur activité, et leur esprit, dans ce système, était continuellement préoccupé d'idées injustes et tyranniques.
§ 10. Enfin, tandis que le même régime pervertissait ainsi les mœurs, il troublait violemment [I-357] la paix, il mettait de toutes parts les hommes aux prises, et c'était surtout par là qu'il était funeste à la liberté.
Je l'ai déjà dit, depuis les plus petites communautés jusqu'aux plus vastes États, il n'était pas une agrégation qui n'exerçât en dehors d'elle quelque genre de despotisme; mais il n'en était pas une, en revanche, qui ne souffrît une multitude d'oppressions. Si chacun faisait la loi, chacun, à son tour, la subissait. Tel ordre d'artisans demandait-il le monopole de tel genre de fabrication? tous élevaient des prétentions analogues; et, pour vouloir accaparer une industrie, on se faisait interdire toutes les autres. Telle classe de marchands voulait-elle avoir le privilège de telle branche de commerce? toutes prétendaient rendre leur commerce privilégié; et, pour faire plus de bénéfices dans ses ventes, on s'exposait à être surfait dans tous ses achats : c'était une société de fripons dans laquelle tout le monde était plus ou moins dupe. Repoussiez-vous les marchandises des forains? tous les forains repoussaient vos marchandises? Vous refusiez de souffrir la concurrence des étrangers? nul étranger ne voulait souffrir votre concurrence. Non-seulement, dans ce système, les hommes placés hors des corps qui avaient accaparé les divers modes d'activité et d'industrie se trouvaient injustement dépouillés de l'usage innocent de leurs [I-358] facultés, mais, entre les accapareurs même, il n'y avait que vengeances et que représailles, qu'injustices souffertes pour des injustices exercées : c'était un véritable état de guerre, et de guerre universelle.
A la vérité, cette guerre n'entraînait pas partout l'effusion du sang. Les petites corporations, au sein de chaque peuple, étaient ordinairement contenues par l'ascendant des grands corps entre les mains de qui résidait la puissance publique. Mais si les rivalités des basses corporations se manifestaient rarement par des meurtres, elles ne cessaient d'éclater en procès, et la violence mutuelle qu'elles se faisaient par leurs droits exclusifs était perpétuellement aggravée par des démêlés judiciaires. On a vu des communautés plaider, durant des siècles entiers, contre d'autres communautés : les tailleurs, par exemple, contre les fripiers, pour établir la ligne de démarcation entre un habit tout fait et un vieil habit; les cordonniers contre les savetiers, pour ôter à ceux-ci le droit de faire . leurs souliers et ceux de leurs enfans et de leurs femmes [270] . Les communautés de Paris, suivant un habile financier, dépensaient près d'un million tous les ans en frais de procédure [271] .
[I-359]
Et ce n'était pas seulement ainsi que se combattaient les corps inférieurs. Chacun voulait avoir la grande corporation des gouvernans pour auxiliaire, et s'efforçait de la rendre complice de l'iniquité de ses prétentions. On allait effrontément la supplier de prohiber telle industrie dont on redoutait la concurrence; on ne demandait pas mieux que de recevoir d'elle des chaînes, que de lui payer des tributs, pourvu qu'elle daignât concéder de tyranniques privilèges. On s'épuisait en frais, en sollicitations, en prières, et toutes ces bassesses, on les commettait pour obtenir le droit d'être injuste : et omnia serviliter pro dominatione.
« Lorsqu'on commença à fabriquer des cotonnades en France, dit M. Say, le commerce tout entier des villes d'Amiens, de Reims, de Beauvais, se mit en réclamation, et représenta l'industrie de ces villes comme détruite... Ce fut bien pis quand la mode des toiles peintes vint à s'introduire : toutes les chambres de commerce se mirent en mouvement. De toutes parts il y eut des convocations, des délibérations, et beaucoup d'argent répandu. Rouen peignit à son tour la misère qui allait assiéger ses portes, les femmes, les vieillards, les enfans, dans la désolation, les terres les mieux cultivées du royaume restant en friche, et cette belle et riche province devenant un désert. La ville de [I-360] Tours fit voir les députés de tout le royaume dans les gémissemens, et prédit une commotion qui occasionerait une convulsion dans le gouvernement politique. Lyon ne voulut pas se taire sur un projet qui répandait la terreur dans toutes les fabriques. Paris ne s'était jamais présenté au pied du trône, que le commerce arrosait de ses larmes, pour une affaire aussi importante. Amiens regarda la permission des toiles peintes comme le tombeau dans lequel toutes les manufactures du royaume devaient être anéanties. Son mémoire, délibéré au bureau des marchands des trois corps réunis, était ainsi terminé : « Au reste il suffit, pour proscrire à jamais l'usage des toiles peintes, que tout le royaume frémit d'horreur quand il entend annoncer qu'elles vont être permises: vox populi, vox Dei [272] . »
Ces réclamations, dans lesquelles la sottise le disputait à l'iniquité [273] , ces demandes odieuses [I-361] et sans cesse renouvelées de privilèges pour soi et d'interdictions pour les autres, n'étaient pas toujours écoutées; mais on sent quel ascendant elles devaient donner à l'autorité sur les professions qui les faisaient entendre; on sent combien il devait être aisé d'asservir, de rendre tributaires des corps qui demandaient sans cesse à faire échange de la liberté contre la domination: aussi, en leur accordant des droits abusifs, ne leur épargnait-on ni les charges, ni les réglemens, ni les maîtres. Chaque corporation, déjà opprimée par les privilèges de ses rivales, encore opprimée par les procès qu'elle avait à soutenir pour la défense de ses privilèges particuliers, l'était d'une troisième, d'une quatrième, d'une cinquième manière par les taxes qu'on lui faisait payer, par les entraves auxquelles elle était soumise, par l'abus que ses membres en dignité faisaient d'un pouvoir déjà vexatoire de sa nature, enfin par la domination que le gouvernement exerçait sur elles en dominant les chefs qu'il lui avait donnés.
Si les privilèges des corps d'industrie et de commerce n'amenaient ordinairement que des procès, ceux des ordres supérieurs provoquaient des dissensions beaucoup plus graves. Ce que ces ordres avaient à souffrir du système général des corporations n'était rien en comparaison de ce qu'ils en retiraient d'avantages. Leur part, dans cette [I-362] distribution de tyrannies de toute espèce, était manifestement la meilleure. Ils recevaient bien, sans doute, quelque dommage des privilèges des ordres inférieurs; mais le tort que chaque communauté pouvait leur faire, à la faveur du monopole dont elle jouissait, était amplement compensé par tout ce qu'ils retiraient de l'ordre établi, en droits seigneuriaux, en immunités pécuniaires, en honneurs, en traitemens, en pensions, en gratifications, en graces de cour de toute espèce. Aussi, dans l'impuissance de rétablir leur ancienne domination, étaient-ils grandement partisans d'un système qui, confinant pour ainsi dire tous les citoyens des ordres inférieurs et secondaires dans l'exercice des professions privées, leur livrait par cela même le monopole du service public et de tout ce qu'il donnait de richesse et de lustre.
Mais plus les privilèges des ordres supérieurs étaient grands, et plus la jalousie qu'ils excitaient était violente. Le clergé, la noblesse, la judicature, étaient l'objet de l'universelle animadversion des corporations inférieures. Ces corporations, dans lesquelles on jouissait sans scrupule de droits extrêmement odieux, ne pouvaient souffrir qu'au-dessus d'elles on en eût de plus considérables et de plus odieux encore; et telle communauté d'artisans ou de marchands, telle compagnie de lettrés ou de légistes, qui auraient accaparé volontiers tout ce qu'il [I-363] y avait au monde de procès, de savoir, d'industrie, de commerce, frémissaient d'indignation en voyant une classe d'hommes appelés nobles prétendre, de leur côté, au monopole de certaines places, à l'exemption de certains impôts, etc. On sait assez, sans que je le dise, ce que les rivalités de la noblesse et du tiers-état ont produit de troubles et de dissensions dans la plupart des contrées de l'Europe, et tout ce que ces ordres, dans leurs querelles, se sont mutuellement fait souffrir de violences et d'oppressions. Le régime sous lequel ils vivaient était donc pour chacun d'eux une source féconde de maux et de servitudes.
Ce régime, qu'on a présenté comme une source d'ordre, parce que les hommes y étaient arrangés avec une sorte de symétrie, n'avait donc tout au plus de l'ordre que les apparences, et recélait, en réalité, une profonde anarchie. Depuis la base du système jusqu'à son sommet, tout le monde y était en état d'hostilité; et c'est précisément dans ce qu'on représente comme un principe de paix qu'était le germe de cette universelle discorde. C'est parce que d'avance la place de chacun y était arrêtée, que nul n'y était content de sa place; il divisait les hommes, parce qu'il les classait arbitrairement; il les excitait à se jalouser, parce que le bien-être y était le fruit de la faveur, et non du mérite; il rendait, à tous les étages, les rangs [I-364] inférieurs ennemis des supérieurs, parce qu'il donnait partout aux supérieurs le moyen d'être injustes envers les subalternes.
Enfin, tandis que ce régime entretenait ainsi la division parmi tous les ordres de la société, entre la classe ouvrière et le corps des maîtres, entre les corporations et les corporations, entre les ordres inférieurs et les classes supérieures, il était surtout une cause de guerres de nation à nation. Personne n'ignore le rôle que les jalousies commerciales ont joué, depuis trois siècles, dans les guerres de l'Europe, et les maux horribles que les peuples de ce quartier du globe se sont faits pour s'exclure mutuellement des champs du commerce et de l'industrie, pour accaparer, chacun de leur côté, toute l'activité industrielle et commerciale. Il y a eu pour cela, on le sait bien, des millions d'hommes égorgés, des fleuves de sang répandu.
Le système des ordres et des corporations, très-préférable à celui de l'esclavage, était donc encore, sous beaucoup de rapports, excessivement contraire à la liberté. Il s'opposait au plein développement de l'industrie, de la richesse et des lumières; il entretenait une profonde corruption dans les mœurs; il fomentait violemment la guerre civile et la guerre extérieure... Hâtons-nous d'avancer vers un meilleur état.
[I-365]
CHAPITRE X.
Liberté compatible avec la vie des peuples chez qui nulle classe n'a plus de privilèges, mais où une portion considérable de la société est emportée vers la recherche des places.↩
§ 1. Une grande révolution, opérée en France il y a quarante ans, y détruisit, à peu près radicalement, l'ordre social que je viens de décrire. Toutes les distinctions d'ordre furent effacées, toutes les hiérarchies artificielles abolies, toutes les influences subreptices annulées, toutes les corporations oppressives dissoutes.
Il ne faut pourtant pas dire, comme on l'a fait si souvent et si faussement, que l'on passa le niveau sur les têtes. Il ne fut sûrement pas décidé que les hommes de six pieds n'en auraient que cinq, que la vertu serait abaissée au niveau du vice, que la sottise aurait sa place à côté du génie, que l'ignorance et le dénuement obtiendraient dans la société le même ascendant que la richesse et les lumières: bien loin de chercher à détruire les inégalités naturelles, on voulut, au contraire, les faire ressortir en ôtant les inégalités factices qui les empêchaient de se produire.
C'étaient les hommes du régime précédent, [I-366] c'étaient les apôtres du privilège, qui avaient été de vrais niveleurs. Dans leurs classifications arbitraires et immuables, ils ne tenaient aucun compte des prééminences réelles, et ils voulaient que l'on fût grand ou petit, bon ou mauvais, habile ou sot, par droit de naissance. C'est contre cette égalisation absurde et forcée que fut dirigée la révolution : elle brisa le niveau que des mains oppressives tenaient abaissé sur les masses; et, sans prétendre assigner de rang personne, elle voulut que chacun pût devenir tout ce que légitimement il pourrait être, et ne fût jamais dans le droit ce qu'il serait dans la réalité.
Le moyen qu'elle prit pour arriver à ce but était simple : il fut décidé tout uniment que nul ne pourrait être gêné dans l'usage inoffensif de ses facultés naturelles; que toutes les carrières paisibles seraient ouvertes à toutes les activités; que toutes les professions, tous les travaux, tous les services légitimes seraient livrés à la concurrence universelle. C'est en cela que consistait le nouvel ordre social qu'elle proclama [274] .
§ 2. Que la liberté existât virtuellement au fond [I-367] d'un tel ordre de choses, c'est ce qui ne paraît pas pouvoir être mis en doute. Cet ordre nouveau permettait, en quelque sorte, aux facultés humaines de prendre un développement illimité; i assurait le progrès des mœurs, par cela même qu'il assurait celui des lumières et du bien-être ; il excluait enfin toute violence. Mais en même temps il froissait trop d'intérêts illégitimes pour qu'il pût aisément s'établir; et, d'ailleurs, il y avait dans les mœurs publiques une passion, parmi beaucoup d'autres, qui seule aurait suffi pour l'empêcher de se fonder, quand même il n'aurait pas rencontré dans celles qu'il comprimait une aussi grande résistance. Je veux parler de l'amour des places et de cette tendance presque universelle qu'on avait contractée de chercher l'illustration et la fortune dans le service public.
[I-368]
Que le public eût considéré le gouvernement, la police du pays, son administration, sa défense, comme une chose qui intéressait les citoyens, qui les regardait tous et sur laquelle il importait qu'ils eussent tous les yeux ouverts; qu'il l'eût envisagé comme une entreprise d'intérêt public, qu'il fallait adjuger aux plus dignes et aux meilleures conditions possibles, comme tous les travaux publics, ce n'est pas là qu'eût été le mal, et ce n'est pas la chose que je signale.
Mais, en pensant qu'en effet on devait, sans nulle distinction de naissance, adjuger le service public aux meilleurs citoyens et aux conditions les meilleures pour la société, chacun songeait un peu à y prendre une part directe et aux meilleures conditions pour soi; chacun, à l'imitation des classes qu'on en avait dépouillées, était assez disposé à l'envisager comme une ressource; chacun voulait y puiser quelque chose de la richesse et du lustre qu'il avait toujours répandus sur ses possesseurs. Toutes les professions étaient déclarées libres; mais c'était vers celle-là, de préférence, que se dirigeait l'activité; la tendance des idées et des mœurs était d'en faire en quelque sorte un moyen général d'existence, une carrière immense, ouverte à toutes les ambitions. Or, c'était cette tendance qui seule aurait suffi pour dénaturer le nouvel ordre social, quand toutes les passions de l'ancien [I-369] régime ne se seraient pas liguées pour le détruire [275] .
§ 3. On sait d'où était venue cette disposition. Quoique les classes laborieuses eussent acquis diverses sortes de privilèges, la position sociale des classes gouvernantes était restée, comme je l'ai dit, incomparablement la meilleure. Leurs professions étaient celles qui conduisaient le plus sûrement et le plus rapidement à la fortune; elles étaient les seules, d'ailleurs, qui donnassent l'illustration. L'industrie, en passant dans le domaine royal, n'avait pas cessé d'être roturière : c'était déroger que de faire le commerce; il n'y avait de nobles que les travaux de service public. Ainsi l'avaient décidé les classes qui s'en étaient réservé le monopole; et, à cet égard comme à beaucoup d'autres, [I-370] c'était d'elles encore que le public recevait ses idées. Il y avait donc toute raison pour qu'on préférât le pouvoir à l'industrie : aussi la tendance avait-elle été, de tout temps, d'abandonner les professions privées pour l'exercice des fonctions publiques. Les classes laborieuses n'étaient pas encore assez avancées pour comprendre que la dignité véritable n'est pas tant dans la profession qu'on exerce que dans ce qu'on y apporte de lumières et de sentimens élevés; elles ne voyaient de gloire qu'à se rapprocher des classes dominatrices, qu'à leur appartenir, qu'à participer à leurs privilèges; il était fort peu d'hommes, parmi elles, qui ne fussent prêts à troquer contre un titre, un brevet, un emploi public, la fortune qu'ils avaient péniblement acquise dans l'exercice des professions privées; on, allait de toutes parts au-devant de ces sortes d'échanges, et le pouvoir avait beau multiplier les offices, il ne suffisait qu'à grand'peine à l'empressement des solliciteurs : « Le roi, disait Colbert, ne peut pas créer une charge, que Dieu, tout aussitôt, ne crée un sot pour l'acheter. ».
« Où l'abus des places s'est-il étendu plus loin qu'aujourd'hui en France? écrivait le marquis d'Argenson, il y a près d'un siècle. Tout y est emploi, tout s'en honore, et tout vit des deniers publics. Gens de finance et de robe, administrateurs, [I-371] politiques, gens de cour, militaires, tout prétend satisfaire son luxe par des emplois, et des emplois très-lucratifs. Les jeunes gens ne savent que faire s'ils n'ont pas de charge. Il faut donc que tout le monde se mêle d'administration: par-là l'État est perdu. Chacun veut dominer le public, rendre service, dit-on, au public, et personne ne veut être de ce public. Les abus sensibles de cette vermine augmentent chaque jour, et tout dépérit [276] . »
Le marquis d'Argenson faisait ces remarques en 1735, quelques années après qu'il fut appelé au ministère. Depuis, l'abus dont il se plaignait ne fit que croître. A mesure que le tiers-état devint plus puissant et plus riche, les fonctions publiques furent plus convoitées, et chaque jour on conçut plus d'aversion et de jalousie contre les privilèges des classes qui en faisaient le monopole.
§ 4. On conçoit donc avec quelle impétuosité la multitude dut se porter vers le pouvoir, lorsque la révolution vint renverser les barrières qui en défendaient l'approche au grand nombre, et le déclarer accessible à tous [277] . Il était odieux, il était [I-372] criant que quelques familles eussent joui seules jusqu'alors de ses avantages. La justice voulait que tout le monde y eût part; et au lieu de le considérer, ainsi que le prescrivait la raison, comme une chose indispensable sans doute, mais naturellement onéreuse, et à laquelle il était désirable que la société n'eût à appliquer que le moins possible de son temps, de son activité et de ses ressources, on fut réduit à l'envisager comme une source commune de bénéfices, où chacun devait pouvoir aller puiser, et d'où en effet un nombre immense de personnes voulurent bientôt tirer leur subsistance [278] .
« Du sein du désordre et de l'anarchie, dit un publiciste, on vit sortir une nuée de petits [I-373] administrateurs despotes, couverts de l'encre et de la poussière des dossiers, la plume sur l'oreille, le considérant à la bouche. Cette armée dressa ses bureaux en manière de tente sur toute la surface de la France. C'est à tort qu'on en attribue la création à Napoléon; lorsqu'il parut, elle était déjà en pleine activité... Mais Napoléon n'eut garde de détruire un ordre de choses qui servait merveilleusement la centralisation du pouvoir, et paralysait toutes les indépendances particulières [279] . »
Bien loin de combattre les passions ambitieuses et cupides, le chef du gouvernement s'appliqua à les enflammer; il en fit son principal moyen d'élévation et de fortune; il agit constamment comme si la nation, en proclamant l'égale admissibilité de tous les citoyens à tous les emplois, n'avait voulu qu'étendre à tous le droit de tirer sa fortune du public, qui avait été précédemment le patrimoine d'une classe. Il est vrai qu'on n'était que trop disposé à sentir ainsi l'égalité. On l'a encore été davantage après la chute de l'empire. Nous avons vu le plus libéral de nos ministères, le ministère de 1819, entreprendre de justifier l'énormité des dépenses publiques, en disant que l'égalité politique devait nécessairement enchérir le gouvernement. [280] [I-374] Nous avons vu les écrivains les plus recommandables excuser et presque défendre la disposition du public à prospérer par l'industrie des places. Qu'importe, après tout, semblaient-ils dire, que le personnel du gouvernement soit plus ou moins nombreux, que son action s'exerce avec plus ou moins d'intensité et d'étendue, que ses dépenses soient plus ou moins considérables, si d'ailleurs il est conforme à l'esprit de la société, si sa conduite est droite et dirigée au bien public?
« La véritable économie ne se laisse pas toujours réduire en chiffres. Il y en a beaucoup à élire ses députés, à discuter ses lois, à jouir de la sûreté des personnes et des biens, de la liberté de la presse, lors même que la machine qui procure ces avantages coûte fort cher [281] . »
§ 5. Les objections se présentent en foule contre cette doctrine. Je vais m'attacher à une seule qui les renferme toutes. Il y a économie, dit-on, à dépenser beaucoup en frais de gouvernement, si l'on obtient, à la faveur de cette dépense, la sûreté [I-375] des personnes et des biens, la liberté de l'industrie et de la pensée. Mais la question est justement de savoir si, lorsqu'un gouvernement coûte fort cher, il peut procurer ces avantages; s'il n'est pas contradictoire de vouloir à la fois être libre, et dépenser beaucoup en frais de gouvernement. C'est ce que ne se demandent pas les honorables publicistes dont je parle, et c'est pourtant ce qu'il serait essentiel d'examiner. C'est aussi la recherche que je vais faire. Mon objet ici est de savoir quelle est la liberté dont peut jouir un peuple qui a aboli tout privilège, déclaré toute profession libre, mais dont l'activité reste particulièrement tournée vers l'exercice du pouvoir, qui dépense en frais d'administration et de gouvernement une portion très-considérable de son temps, de ses capitaux, de son intelligence, de ses forces.
§ 6. J'accorderai volontiers que cette nouvelle manière d'être comporte plus de liberté que celle qui a été décrite dans mon dernier chapitre. Par cela seul que toutes les distinctions de caste y sont abolies, que nulle corporation n'y fait le monopole d'aucune sorte de travaux, que toutes les professions y sont livrées à la concurrence; il est aisé d'apercevoir que les facultés humaines y y doivent prendre plus d'essor, que les mœurs y doivent devenir plus pures, qu'elles y doivent être moins [I-376] violentes; que par conséquent il y doit avoir, de toute manière, plus de liberté.
L'état de la France depuis le commencement de la révolution offre de ceci des preuves éclatantes. Ce qu'elle a gagné en industrie, en lumières, en richesses, par le seul fait de l'abolition des corporations et des privilèges, et malgré les obstacles qu'ont mis à ses progrès la passion des places et le régime dispendieux et oppressif qu'il est dans la nature de cette passion de faire naître, est véritablement incalculable. Elle a donc fait, sous ce premier rapport, de grands progrès en puissance et en liberté.
En même temps que ses habitans ont acquis plus de lumières et de bien-être, ils ont pris de meilleures mœurs. C'est un fait que tout observateur impartial sera disposé à reconnaître. Il n'est pas d'homme de bonne foi qui, ayant vu les Français sous l'ancien régime, et les comparant à ce qu'ils sont devenus depuis la révolution, ne convienne qu'ils sont aujourd'hui plus occupés, plus actifs, plus soigneux de leurs affaires, mieux réglés dans leurs dépenses, moins livrés au libertinage, au faste, à la dissipation, plus capables, en un mot, de faire, par rapport à eux-mêmes, un usage judicieux et moral de leurs facultés. Ils sont donc encore, sous ce rapport, devenus beaucoup plus libres.
[I-377]
Enfin, ils sont devenus plus libres aussi parce qu'ils se sont fait réciproquement moins de violence, parce que des uns aux autres ils ont usé plus équitablement de leurs facultés. Il n'a plus été au pouvoir d'un homme d'empêcher qu'un autre ne pût gagner honnêtement sa vie. Nul n'a élevé la prétention de faire exclusivement ce qui ne nuisait à personne, et ce qui, par cela même, devait être permis à tous. Ce que ce changement a fait tomber d'entraves; ce qu'il a fait cesser d'oppositions, de haines, de rivalités, de procès, de guerres intestines; ce que, par cela même, il a mis de facilité et de liberté dans les actions individuelles et dans les relations sociales ne pourrait être que très-difficilement et très-imparfaitement apprécié.
Je pourrais, si je voulais insister, donner de la vérité de ces résultats des preuves de détail innombrables. Mais d'abord les progrès de notre puissance industrielle sont si patens, que nul ne songe à les contester; et, quant à ceux de nos mœurs, sont-ils moins évidens parce qu'on est plus disposé à les mettre en doute? Il est des traits auxquels on les reconnaît aisément. Que sont devenus tous ces poètes licencieux qui faisaient autrefois les délices de la meilleure compagnie ? Pourquoi les Boufflers, les Parny, les Bertin, les Gentil-Bernard, les Piron, n'ont-ils pas un successeur dans nos jeunes poètes? c'est que le libertinage n'est [I-378] plus de bon ton. Les liens de famille sont plus forts, plus respectés : il n'est plus plaisant de porter le désordre dans un ménage; on rit moins des maris trompés; on méprise davantage les suborneurs : qui cherche aujourd'hui à passer pour un homme à bonnes fortunes? D'une autre part, les dépenses sont plus sensées : si l'on n'a pas encore une probité politique bien sévère, si l'on n'est pas très-délicat sur les moyens de tirer de l'argent du public, du moins dissipe-t-on moins follement celui qu'on tui vole. Tout possesseur de sinécures songe à économiser; les courtisans font des épargnes; on ne bâtit plus de grands châteaux'; on démolit beaucoup de ceux qui restaient. Les grands seigneurs ne traînent plus à leur suite cette nombreuse valetaille, qui débauchait par passe-temps les paysannes de leurs terres et des autres lieux où ils passaient. La dépense pour le logement, la table, les vêtemens, le service domestique, est infiniment mieux entendue. Voilà pour ce qui est des habitudes privées. Quant à la morale de relation, les progrès ne sont pas moins manifestes. On est peut-être moins cérémonieux, moins complimenteur; mais on se respecte mutuellement davantage; les hommes de tous les rangs ont plus de valeur. Surtout on méprise et on maltraite moins les classes inférieures: de beaux messieurs ne s'aviseraient pas aujourd'hui de distribuer des coups de [I-379] canne à des cochers de fiacre, comme il était de bel air de le faire, et comme on le faisait impunément, à Paris, avant la révolution. On ne vit plus dans la même familiarité avec son valet de chambre; mais, si on ne le met pas dans le secret de ses faiblesses, on ne le traite pas non plus avec la même dureté. On a cessé également de faire des confidences à ses gens et de les battre : on est beaucoup plus, à tous égards, dans la mesure de la justice et des convenances envers ses inférieurs. En même temps, il y a infiniment moins de distance entre toutes les classes: personne, il y a quarante ans, n'eût osé prendre le costume d'un état supérieur au sien; un notaire n'était pas reçu dans les bonnes maisons; à peine un homme riche admettait-il son médecin à sa table; l'agent de change du trésor royal n'osait se permettre le carrosse, et allait en voiture de place, quoiqu'il fût riche à millions, etc., etc. Tout cela est bien changé. Nous sommes tous vêtus de la même manière; nous recevons tous la même éducation : le fils du prince du sang et celui du riche épicier fréquentent les mêmes écoles, et concourent pour le même prix. Aucune classe, aucune profession n'est tenue dans un état de dégradation systématique ; nous ne distinguons plus les hommes que par le degré de culture. Sans doute l'homme riche ne fait pas sa société du crocheteur, du porte-faix; mais ce n'est [I-380] pas que leur travail lui semble méprisable, c'est que leurs esprits sont différens, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes mœurs, le même langage. Il n'est pas d'utile profession qui ne paraisse honorable, exercée par des hommes capables de l'honorer. Il n'est donc pas douteux que, depuis l'abolition de l'ancien régime, depuis la suppression des ordres, des corporations, des privilèges, des monopoles, on n'ait fait, en général, de ses forces un usage plus étendu et mieux réglé, et qu'on ne soit devenu par conséquent beaucoup plus libre.
§ 7. Mais, en même temps, il faut reconnaître que la convoitise des places a beaucoup diminué les effets de cette grande réforme, et en général qu'il y a dans cette passion, surtout lorsqu'elle est devenue très-commune, d'immenses obstacles à la liberté. Commençons par observer le changement qu'elle produit dans l'économie de la société, et l'ordre de choses tout nouveau qu'elle tend à substituer à l'ancien régime des privilèges.
Dans ce nouvel état social, il n'y aura plus de classes, d'ordres, de corporations, de communautés; mais, à la place de ces agrégations diversement privilégiées, la passion que je signale va élever une administration gigantesque qui héritera de tous leurs privilèges; ce qui était affaire de corps deviendra affaire de gouvernement; une [I-381] multitude de pouvoirs et d'établissemens particuliers passeront dans le domaine de l'autorité politique [282] . Cet effet est naturel, il est inévitable, on l'a assez pu voir chez nous. A mesure que les passions ambitieuses ont attiré plus d'hommes vers le pouvoir, le pouvoir a graduellement étendu sa sphère. Il a multiplié non-seulement les emplois, mais les administrations. On compterait difficilement le nombre de régies qu'il a créées pour ouvrir des débouchés à la multitude toujours croissante des hommes zélés, et surtout désintéressés, qui demandaient à se vouer à la chose publique : régie des tabacs, des sels, des jeux, des théâtres, des écoles, du commerce, des manufactures, etc. Il a peu à peu étendu son action à tout; il s'est ingéré dans tous les travaux avec la prétention de les régler et de les conduire. On n'a plus trouvé sur son chemin les syndics des corporations; mais on a eu devant soi les agens de l'autorité. Dans les champs, dans les bois, dans les mines, sur les routes, aux frontières de l'État, aux barrières des villes, sur le seuil de toutes les professions, à l'entrée de [I-382] toutes les carrières, on les a rencontrés partout.. Le premier effet de la passion des places a été de les multiplier au-delà de toute mesure : cette passion a fait prendre à l'autorité centrale des développemens illimités.
Cet effet en a entraîné d'autres. Plus les attributions du pouvoir se sont étendues, et plus les dépenses ont dû s'élever. En même temps que le personnel de toutes les administrations s'est augmenté, les frais de tous les services se sont accrus. Il serait long de considérer ces accroissemens de dépense dans tous leurs détails; mais observons-les dans leur ensemble. C'est sûrement une chose curieuse que de suivre la filiation des lois de finance depuis le commencement de ce siècle, et de voir comment, d'un budget énorme, il est né tous les ans un budget un peu plus colossal. De 1802 à 1807, les dépenses se sont élevées de 500 millions à 720; elles ont été de 772 en 1808, de 788 en 1809, de 795 en 1810; elles ont atteint un milliard en 1811; elles l'ont passé de 30 millions en, 1812, et de 150 millions en 1813. En 1814, la France, rendue à la paix et à ses anciennes limites, n'a pas pu ne pas réduire ses frais de gouvernement; cependant, ces frais sont restés proportionnellement plus considérables, et le budget a toujours continué à suivre son mouvement de progression: de 791 millions en 1815, il a été de 884 en [I-383] 1816, d'un milliard 69 millions en 1817, et a touché à 1,100 millions en 1818. Rendu alors, par le départ des étrangers, à des proportions moins effrayantes, il est pourtant resté beaucoup plus fort qu'il ne l'était avant leur arrivée; et, tandis qu'il ne s'était élevé qu'à 791 millions en 1815, il s'est trouvé de 845 en 1819, de 875 en 1820, de 896 en 1821, de plus de 912 en 1822, et voilà qu'il dépasse encore un milliard; c'est-à-dire que les dépenses sont redevenues aussi fortes qu'elles l'étaient en 1812, lorsque la France mettait l'Europe à contribution, qu'elle était d'un grand tiers plus étendue, qu'elle touchait à Lubeck et à Rome, qu'elle avait six cent mille hommes sous les armes, et qu'elle faisait la guerre sous Cadix et à Moscou [283] .
Où le chapitre des dépenses croît ainsi, on sent [I-384] que celui des voies et moyens resterait difficilement stationnaire. Il n'y aura pas d'expédient dont [I-384] on ne s'avise pour tâcher de soutirer tous les ans au public un peu plus d'argent. Aucune source ne paraîtra assez impure pour qu'on rougisse d'y puiser; aucun impôt, assez immoral pour qu'on craigne de le fonder ou de le maintenir. Toutes les denrées, toutes les industries, toutes les transactions, toutes les jouissances, tous les mouvemens, pour ainsi dire, seront soumis à quelque genre de rétribution. On imaginera de se faire une ressource de l'arriéré, et d'enfler ses dettes pour pouvoir accroître ses dépenses. On percevra, sous divers prétextes, des rétributions qu'aucune loi n'aura autorisées. Le génie de la fiscalité, pour surprendre les revenus du public, revêtira successivement toutes les formes. Non content d'épuiser les revenus, il se mettra, par des emprunts, à attaquer les capitaux, et l'on pourra voir, en peu d'années, croître de plusieurs milliards la dette nationale [284] .
Ce n'est pas tout. A mesure que les passions cupides étendront ainsi les empiétemens et les dépenses, elles voudront, pour se mettre plus à l'aise, [I-386] pervertir toutes les institutions. Plus elles tendront à rendre l'administration fiscale, et plus elles seront intéressées à rendre le gouvernement despotique. On les verra, à chaque nouvelle révolution, à chaque changement de régime, s'efforcer de corrompre ou de fausser tous les pouvoirs, créer des lois d'élection frauduleuses, interdire la discussion aux corps délibérans, ôter la publicité à leurs séances, transformer les jurys en commissions, substituer des juges prévôtaux à la justice régulière, livrer l'élection des conseils généraux et municipaux aux fonctionnaires responsables, que ces conseils doivent surveiller; ne pas se donner de relâche enfin qu'elles n'aient subjugué tous les corps destinés à protéger les citoyens, et ne les aient convertis en instrumens d'oppression et de pillage.
Ajoutons, pour compléter le tableau de ce régime, qu'avec lui et par lui se fortifieront les passions qui l'engendrent, et qui sont les plus propres à le perpétuer. Plus s'agrandit la carrière des places, et plus les places sont avidement recherchées. Il arrive à cet égard ce qui arrive à l'égard de toute branche d'industrie qui vient à ouvrir de nombreux débouchés à l'activité générale : la foule se tourne naturellement de ce côté. Il y a même une raison pour qu'on se porte vers le pouvoir avec plus d'empressement qu'on ne ferait vers [I-387] autre profession. Il faut, pour se pousser dans les voies de l'industrie, des talens et des qualités morales qui sont loin d'être également indispensables dans les voies de l'ambition. Le hasard, l'intrigue, la faveur, disposent d'un grand nombre d'emplois. Dès lors, il n'est plus personne qui ne croie pouvoir en obtenir; le gouvernement devient une loterie dans laquelle chacun se flatte d'avoir un bon lot; il se présente comme une ressource à qui n'en a point d'autre; tous les hommes sans profession prétendent en faire leur métier, et une multitude presque innombrable d'intrigans, de désœuvrés, d'honnêtes et de malhonnêtes gens, se jettent pêle-mêle dans cette carrière, où bientôt il se trouve mille fois plus de bras qu'il n'est possible d'en employer.
Enfin, tandis que ce régime va fomenter dans tous les rangs de la société la cupidité qui l'a fait naître, il détruit partout le désintéressement et le courage qui seraient capables de le réformer. Ne cherchez ici ni esprit public, car il n'y a pas de public; ni esprit de corps, car il n'y a plus de corps; ni indépendance individuelle, car que peuvent être les individus devant le colosse formidable que l'ambition universelle a élevé? De même que tous les corps se sont fondus dans une corporation, toutes les volontés semblent s'être réduites à une seule. Il n'y a de personnalité, d'existence [I-388] propre, que dans l'administration. Hors de là, rien qui vive, qui se sente, qui résiste ni individus, ni corps constitués. N'espérez pas que des pouvoirs élevés, n'allez pas croire qu'un Tribunat, un Corps Législatif, un Sénat, mettent à défendre les intérêts du public le courage que, dans d'autres temps, les corporations les plus faibles et les plus obscures mettaient à garder leurs privilèges particuliers: l'esprit de sollicitation qui a envahi les derniers rangs de la société règne dans les ordres supérieurs avec encore plus d'empire; électeurs, députés, sénateurs, tout est descendu au rôle de client, et les postes les plus éminens ne sont envisagés que comme des positions particulières où l'intrigue a plus de chances de fortune, et où les bassesses sont mieux payées.
Voici donc ce que la passion qui a été de nos jours la plus populaire, la passion des places, tend naturellement à produire : sous le nom d'administration, je ne sais quel corps monstrueux, immense, étendant à tout ses innombrables mains, mettant des entraves à toutes choses, levant d'énormes contributions, pliant par la fraude, la corruption, la violence, tous les pouvoirs politiques à ses desseins, soufflant partout l'esprit d'ambition qui le produit, et l'esprit de servilité qui le conserve..... Il ne s'agit plus que d'examiner ce que, sous l'influence de ce corps et des passions qui [I-389] l'ont créé et qui le font vivre, il est possible d'avoir de liberté ; ce que peuvent être l'industrie, les mœurs, les relations sociales, et, en général, toutes les choses d'où nous savons que dépend l'exercice plus ou moins libre de nos facultés.
§ 8. Je reconnaîtrai de nouveau que l'industrie est ici moins comprimée que sous le régime des privilèges : le pouvoir ne lui oppose pas autant d'entraves que lui en opposaient les corporations; il n'est pas aussi porté à resserrer ses mouvemens, et n'y met pas le même zèle. Cependant que d'obstacles ne trouve-t-elle pas encore dans ce nouvel état!
Observez d'abord que, plus ici l'esprit d'ambition est fort, et plus l'esprit d'industrie y doit demeurer faible. Ces deux esprits ne sauraient animer à la fois la même population. Ils ne diffèrent pas seulement, ils sont contraires : le goût des places exclut les qualités nécessaires au travail. On n'a pas assez remarqué à quel point l'habitude de vivre de traitemens peut détruire en nous toute capacité industrielle. J'ai vu des hommes remplis de talent et d'instruction pratique s'affecter profondément de la perte d'un emploi qui était loin de leur donner ce qu'ils auraient aisément pu gagner par l'exercice d'une profession indépendante. La possibilité de se créer une fortune par un usage [I-390] actif et soutenu de leurs facultés productives ne valait pas, à leurs yeux, le traitement exigu, mais fixe et assuré, qu'ils avaient perdu. Ils ne supportaient pas l'idée d'être chargés d'eux-mêmes, de se trouver responsables de leur existence, d'avoir à faire les efforts nécessaires pour l'assurer; et avec des facultés réelles et puissantes, ils ne savaient de de quoi s'aviser pour subvenir à leurs besoins. Ils étaient comme ces oiseaux élevés dans la captivité, et qui n'ont jamais eu à s'occuper du soin de leur nourriture: si on leur donnait la liberté, ils ne sauraient comment vivre, et seraient exposés à périr au milieu des moissons [285] .
Le goût des places altère donc profondément les facultés industrielles du peuple qui en est infecté. Il détruit en lui l'esprit d'invention et d'entreprise, l'activité, l'émulation, le courage, la patience, tout ce qui constitue l'esprit d'industrie.
[I-391]
Il est, sous ce rapport, d'autant plus nuisible, qu'il domine principalement les classes supérieures, et qu'il prive ainsi les arts utiles du concours des hommes qui pourraient le plus contribuer à leur avancement.
Et il ne leur nuit pas seulement en leur enlevant le secours des classes que leur fortune et leur position sociale mettraient le mieux à même de les servir, il leur fait un tort encore plus grave, peut-être, en ce sens qu'il détourne d'eux une portion beaucoup trop considérable de la population [286] .
Joignez que les hommes dont il les prive sans nécessité ne sont pas seulement annulés, mais rendus nuisibles : leur activité n'est pas uniquement dérobée à l'industrie, elle est dirigée contre elle. Comme les offices nécessaires ne peuvent suffire à les occuper, il en faut créer d'inutiles, de vexatoires, dans lesquels ils ne font que gêner les mouvemens [I-392] de la société, troubler ses travaux et retarder le développement de sa richesse et de ses forces.
C'est peu de leur enlever les hommes, il leur fait perdre aussi les capitaux. Chaque nouvelle création d'emplois entraîne une création correspondante de taxes nouvelles, et l'industrie, déjà privée des services des individus que l'ambition jette sans nécessité dans la carrière des places, est encore obligée de faire les fonds nécessaires pour entretenir ces individus dans leur nouvel emploi.
Notez encore que ces fonds, de même que ces individus, ne sont pas seulement perdus pour l'industrie, mais employés contre elle. Ils servent à gager non des oisifs, non des possesseurs de sinécures (il n'y aurait que moitié mal), mais des hommes à qui on veut faire gagner leur argent, et dont l'activité s'épuise en actes nuisibles; de sorte qu'elle est dépouillée de capitaux considérables, et qui [I-393] contribueraient puissamment à ses progrès, pour voir, en retour, son développement contrarié de mille manières.
Enfin, comme de lui-même un tel ordre aurait quelque peine à se maintenir, il faut, pour le mettre à l'abri de toute réforme, arrêter autant que possible l'essor de la population; détruire en elle toute capacité politique, tout esprit d'association, toute aptitude à faire elle-même ses affaires; empêcher, du mieux qu'on peut, qu'elle n'apprenne à lire, qu'elle ne s'instruise, qu'elle ne parle, qu'elle n'écrive; et l'industrie, déjà très-affaiblie par l'argent qu'on lui prend et les fers qu'on lui donne, se trouve encore privée de ce que l'activité de l'enseignement, celle des débats publics et l'esprit d'association sous toutes ses formes pourraient lui communiquer de force et de liberté.
Je ne prétends point donner ici une idée complète du dommage que cause à l'industrie la fureur des places; il faudrait pour cela connaître la quantité d'hommes qu'elle détourne inutilement de ses travaux, et pouvoir dire en même temps ce que ceux-là mettent d'obstacle à l'activité de tous les autres; il faudrait savoir ce qu'ils leur enlèvent de fonds, ce qu'ils leur imposent de gênes, ce qu'ils leur font souffrir de violences; il faudrait pouvoir estimer le temps qu'ils leur font perdre, les distractions qu'ils leur causent, le découragement [I-394] qu'ils leur inspirent. Tout cela n'est guère susceptible d'évaluation ; mais quand je dirais que, par l'ensemble des lois fiscales et des mesures compressives que la passion que je signale a fait établir en ce pays, la puissance productive de ses habitans a été quelquefois réduite de moitié, je ne sais si je ferais une estimation bien exagérée du sous ce rapport, elle lui cause [287] .
§ 9. Si tel est le tort que cette passion fait aux arts, elle n'est guère moins funeste à la morale. Quand elle n'aurait d'autre effet que de retarder les progrès de la richesse et de l'aisance universelle, [I-395] elle serait déjà un grand obstacle au perfectionnement des mœurs; mais elle va directement à les corrompre, parce qu'elle enseigne de mauvais moyens de s'enrichir. Des citoyens elle fait des courtisans; elle étend les vices de la cour à toute la partie de la société qui a quelque instruction et quelque activité politique; où devrait régner l'industrie elle fomente l'ambition; à l'activité du travail elle fait succéder celle de l'intrigue; un ton obséquieux, des habitudes uniformément ministérielles, se communiquent à tous les rangs de la société : flatter, solliciter, mendier, n'est plus le privilège d'une classe, c'est l'occupation de toutes; plus il y a de gens qui se vouent à ce métier, et plus, pour l'exercer avec fruit, il y faut déployer de savoir-faire: on met de l'émulation dans la bassesse; on s'évertue à s'avilir, à se prostituer. Les mœurs, sous d'autres rapports, ne sont pas meilleures; à la servilité des courtisans on joint leurs habitudes licencieuses, leur goût du faste et de la dissipation; la débauche se propage sous le nom de galanterie; le luxe accompagne la luxure; on est guidé dans ses dépenses, non par ce désir éclairé d'être mieux, c'est-à-dire plus sainement, plus commodément, plus confortablement, qui naît des habitudes laborieuses et qui les encourage, mais par le vain désir de briller, d'en imposer aux yeux: on n'aspire pas à être, mais à paraître. [I-396] Il a été aisé d'observer la plupart de ces effets du temps de l'empire, à cet âge classique de l'ambition, où l'amour des places régnait sans partage, où chacun voulait être quelque chose, et où l'on n'était quelque chose que par les places; où la recherche et l'exploitation des places étaient la principale industrie du pays, la véritable industrie nationale. On a pu voir alors, dis-je, ce que cette industrie peut mettre de frivolité, de corruption, et surtout de servilité dans les habitudes d'un peuple: notre caractère retient encore, à plus d'un égard, les fâcheuses empreintes qu'il reçut en ce temps, et il faudra plus d'une génération pour qu'elles s'effacent.
§ 10. Autant enfin la passion dont j'expose ici les effets peut introduire de dépravation dans les mœurs, autant elle porte de trouble dans les relations sociales. Où domine l'amour des places, les places ont beau se multiplier, le nombre en est très-inférieur à celui des ambitieux qui les convoitent. Dès lors, c'est à qui les aura; aucun parti ne se croit obligé d'y renoncer en faveur d'aucun autre. Bien des gens s'abstiendraient d'y prétendre, si l'on consultait pour les établir l'intérêt du public, qui en veulent leur part, comme tout le monde, du moment qu'elles n'existent que pour satisfaire les ambitions privées.
« Puisque la [I-397] destination du pouvoir est de faire des fortunes, il doit faire la mienne ainsi que la vôtre; s'il n'est qu'une mine à exploiter, pourquoi ne l'exploiterais-je pas aussi bien que vous? Allons, monsieur, vous avez assez rançonné le public; c'est maintenant mon tour; ôtez-vous de là que je m'y mette...; »
et voilà la guerre au sujet des places. L'effet le plus inévitable du vice honteux que je dénonce, surtout quand il est devenu très-général, comme c'est ici mon hypothèse, est de faire naître des partis qui se disputent opiniâtrément le pouvoir; et, comme aucun de ces partis ne le recherche que pour l'exercer à son profit, un autre effet de la même passion est de rendre le public également mécontent de tous les partis qui s'en emparent, et de le disposer à faire cause commune avec tous ceux qui ne l'ont pas, contre tous ceux qui le possèdent.
Enfin la passion des places peut agrandir encore le cercle des discordes qu'elle suscite, et à des luttes intestines faire succéder la guerre extérieure. Mère de gouvernemens despotiques, elle donne aussi naissance à des gouvernemens conquérans : c'est elle qui a détourné notre révolution de sa fin, qui a fait dégénérer en guerres d'invasion une guerre de liberté et d'indépendance, qui a fourni des instrumens à Bonaparte pour la conquête et la spoliation de l'Europe, comme elle lui en fournissait [I-398] pour le pillage et l'asservissement de la France. Il suffit qu'elle élève, en chaque pays, le nombre des ambitieux fort au-dessus de ce qu'il est possible de créer de places, pour qu'elle donne à tout gouvernement qui consent à la satisfaire un intérêt puissant à étendre sa domination, et devienne ainsi, entre les peuples, une cause très-active de dissensions et de guerres.
§ 11. Cette passion est donc également funeste à l'industrie, aux mœurs, à la paix, à tout ce qui facilite, affermit, étend l'exercice de nos forces. Pour apercevoir d'un coup d'œil à quel point elle lui est contraire, il n'y a qu'à considérer ce qu'elle fait perdre annuellement à l'industrie d'hommes et de capitaux ; ce que, par cette dépense énorme et sans cesse renouvelée, elle apporte de retard au développement de nos richesses intellectuelles et matérielles ; ce que le pernicieux emploi qu'elle fait faire de ces moyens ravis à notre culture ajoute encore d'obstacles au développement de nos facultés; comment, en arrêtant le progrès de nos idées en général, elle arrête celui de nos idées morales; comment, en nous forçant à rester pauvres, elle fait que nos goûts demeurent grossiers; quel trouble elle met dans nos relations mutuelles ; combien elle soulève d'ambitions, combien elle fait naître de partis, quel aliment elle fournit à [I-399] leurs haines jalouses, quelles luttes homicides elle provoque entre eux, quelle discorde elle entretient entre les citoyens et la puissance publique, quelle extension enfin elle donne quelquefois aux querelles qu'elle suscite, et comment des dissensions d'un seul pays elle peut faire des guerres européennes, universelles.
§ 12. Il y a deux manières de sortir de l'état social que cette passion a produit parmi nous. La première serait de retourner au régime des privilèges, c'est-à-dire à un état où le droit de s'enrichir par l'exercice de la domination serait, comme autrefois, le privilège d'une classe. La seconde est d'arriver au régime de l'industrie, c'est-à-dire à un état où ce droit ne serait le privilège de personne ; où ni peu ni beaucoup d'hommes ne fonderaient leur fortune sur le pillage du reste de la population; où le travail serait la ressource commune, et le gouvernement un travail public, que la communauté adjugerait, comme tout travail du même genre, à des hommes de son choix, pour un prix raisonnable et loyalement débattu.
Le premier moyen est celui que l'on tente. Depuis 1815, et surtout depuis 1820, il s'agit, non de diminuer le budget, non de défaire les régies fiscales, non de réduire le nombre des emplois, mais de faire que tout cet établissement[I-400] administratif, ouvrage des ambitions de tous les temps et des cupidités de tous les régimes, devienne la propriété exclusive, incommutable, des classes qui tenaient autrefois le pouvoir [288] .
Cette entreprise, dont beaucoup de gens s'alarment pour la liberté, me paraît, à moi, destinée à la servir. Il n'y a pas grande apparence qu'elle soit faite dans son intérêt, et je crois bien qu'à la rigueur nous pouvons nous dispenser de reconnaissance; mais je dis qu'en résultat elle la sert. Déjà, elle a commencé à produire dans nos mœurs une révolution très-salutaire. En refoulant dans la vie privée une multitude d'hommes intelligens, actifs, ardens, que la révolution avait entraînés vers le pouvoir, on a mis ces hommes dans le cas d'apprendre qu'il est quelque chose de plus noble, de plus généreux, de plus moral et même de plus fructueux que la domination : le travail. Il est impossible de ne pas voir que, depuis quelques années, il se fait à cet égard dans nos dispositions un [I-401] changement considérable; que les passions ambitieuses nous travaillent moins; que les titres, les rubans, les sinécures, baissent de valeur dans nos esprits; que les arts utiles, au contraire, prennent à nos yeux plus d'importance; qu'en un mot nous cherchons davantage à prospérer par l'industrie. A mesure que nous nous affermirons dans cette manière de vivre, nous en prendrons davantage les mœurs, nous acquerrons de plus en plus les connaissances qui s'y rapportent, nous nous instruirons surtout du régime politique qu'elle requiert, et après avoir noblement renoncé aux places inutiles, le temps viendra, j'en ai l'espérance, où nous ne voudrons plus les payer. Il me paraît donc évident qu'en faisant effort pour nous ramener au régime des privilèges [289] , on contribue à nous pousser vers le régime de l'industrie, et que ce nouveau mode d'existence est celui où nous conduit l'époque actuelle. Ce mouvement d'esprit public est d'un si haut intérêt qu'on me pardonnera, avant de finir ce chapitre, de m'arrêter un instant encore à le constater et à en montrer le vrai caractère.
Je le répète, la réaction politique qui s'opère depuis dix ans, en France et en Europe, en amène une très-heureuse dans les mœurs. Je ne voudrais [I-402] pour rien au monde approuver l'esprit qui paraît la diriger; je déplore les nombreuses infortunes particulières qu'elle a faites; mais je bénis sincè– rement l'effet général qu'elle produit, effet tellement avantageux qu'il suffit, à mon sens, pour compenser amplement tout le mal que d'ailleurs elle peut faire.
La contre-révolution ne vaincra pas la révolution la révolution est inhérente à la nature humaine; elle n'est que le mouvement qui la pousse à améliorer ses destinées, et ce mouvement est heureusement invincible. Mais la contre-révolution tend à changer le cours de la révolution; d'ambitieuse et de conquérante qu'elle était, elle la rend laborieuse; elle se dirigeait de toutes ses forces vers le pouvoir, elle la contraint à tourner son immense activité vers l'industrie. Il importe de savoir précisément en quoi ce changement consiste.
Sans doute, la pratique des arts, l'étude des sciences, la culture et le perfectionnement de nos facultés ne sont pas des choses nouvelles; mais ce qui est nouveau, c'est la manière dont on commence à envisager tout cela. Autrefois on se livrait bien au travail, mais c'était en vue de la domination; l'industrie n'était qu'un acheminement aux places; la véritable fin, la fin dernière de toute activité, c'était d'arriver aux emplois. Ce n'est pas [I-403] pour cela, si l'on veut, que la révolution a été faite; mais elle a été faite avec cela : l'amour des fonctions publiques y a joué son rôle; et ce rôle n'a pas été petit, si l'on en juge par les résultats ; car ce qu'elle a produit avec le plus d'abondance, ce sont des fonctions et des fonctionnaires : nous l'avons vue inonder l'Europe de soldats, de commis, de douaniers, de directeurs, de préfets, d'intendans, de gouverneurs, de rois.
Il se peut donc bien que jusqu'ici on eût pratiqué les arts; mais je dis que c'était en attendant les places, et comme moyen éloigné d'y parvenir. Le principal effet de la réaction actuelle est de changer cette tendance. Non-seulement la révolution est ramenée au travail par ses défaites, mais elle commence à l'envisager mieux : on n'en fait plus seulement un moyen ; il devient la fin de l'activité sociale; on commence à ne plus rien voir au-delà de l'exercice utile de ses forces et du perfectionnement de ses facultés.
Je sais fort bien que cette tendance est loin d'être générale; toutes les passions qui ont gouverné la société la gouvernent plus ou moins encore. La servitude de la glèbe a conservé des partisans; les privilèges en ont encore davantage, et les sinécures infiniment plus. Mais enfin il n'y a pas moyen de se dissimuler que la tendance à l'industrie devient chaque jour plus forte et plus générale;[I-404] infiniment plus de gens cherchent dans cette voie la fortune, et même l'illustration; on y applique plus de capitaux; on y porte plus de lumières; on y met davantage les sciences positives à contribution; les notions d'économie industrielle se propagent; avec elles se répand la connaissance du régime politique qui convient à l'industrie; enfin ce régime passe de la théorie dans la pratique : c'est d'après ses principes que sont constitués les ÉtatsUnis, c'est d'après ses principes que se constituent les nouvelles républiques américaines, c'est d'après ses principes que la monarchie anglaise réforme ses lois : l'Angleterre lève les prohibitions, diminue les impôts, réduit le nombre des places, fait servir le gouvernement à restreindre l'action du gouvernement, et tend ainsi à se rapprocher du régime de l'Amérique. Or, si ce régime a pu franchir l'Océan, n'y a-t-il pas quelques motifs d'espérer qu'un jour il pourra passer aussi la Manche? N'est-il pas permis de croire que la France qui a fait la révolution, après avoir renoncé aux places inutiles, ne se résignera pas toujours à les payer? Cette France ne voudra sûrement pas que tous ses efforts n'aient abouti qu'à doubler ses impôts, qu'à tripler ses entraves, qu'à lui faire payer quatre fois plus de fonctionnaires [290] . Plus elle se corrigera de toute[I-405] tendance à la domination, et moins elle consentira à rester tributaire d'une classe de dominateurs. Elle deviendra, j'espère, assez forte pour exiger que tout le monde vive, comme elle, par quelque utile travail; et, donnant au pouvoir son vrai titre, celui de service public, il y a lieu de penser que quelque jour elle s'arrangera pour avoir des serviteurs, et non des maîtres.
Je ne crois donc pas me tromper, quand je dis que le monde tend à la vie industrielle, et je me flatte qu'en parlant maintenant de cet état et du degré de liberté qu'il comporte, je n'aurai pas trop l'air de composer une utopie.
[I-406]
CHAPITRE XI.
Liberté compatible avec la manière de vivre des peuples purement industrieux.↩
§ 1. Le mot industrie est une traduction à peu près littérale du mot latin INDUSTRIA. Les étymologistes supposent que celui-ci avait dû être formé de deux autres, INDU pour INTUS, dans, et STRUO, j'arrange, je dresse, je construis. Ainsi l'on aurait dit INDUSTRIA de INTUS-STRUO, INTUS-STRUERE, construire dans, action exercée dans les choses ou sur les choses pour arriver à une certaine fin.
Ce mot, d'après son étymologie, exprimerait donc à la fois l'idée d'action et celle d'action exercée avec intelligence, l'idée d'action appropriée à un certain but. Il est clair, en effet, que ces deux idées se trouvent également comprises dans le verbe actif qui lui sert de base. STRUERE, bâtir, construire, c'est d'abord agir; mais, de`plus, c'est agir avec dessein, c'est disposer les choses en vue d'un objet quelconque. Aussi paraît-il que les Romains se servaient également du mot industria pour désigner l'activité, les soins, l'application qu'on mettait à faire les choses, et pour exprimer la dextérité, l'adresse avec laquelle on les faisait. Dans le latin, un homme industrieux, industrius, [I-407] c'est d'abord un homme actif, et, en second lieu, un homme habile. Le mot, en passant dans notre langue, n'a guère retenu que la dernière de ces deux acceptions; il implique bien toujours l'idée d'action, puisque nous ne pouvons montrer notre dextérité que dans nos actes; mais ce qu'il signifie plus particulièrement, c'est l'intelligence avec laquelle nous agissons.
Le mot industrie ne réveillant, dans son acception primitive, que l'idée d'une certaine habileté on a dû l'appliquer d'abord à toutes les actions faites avec art, exécutées avec adresse, de quelque espèce qu'elles fussent d'ailleurs, c'est-à-dire qu'elles fussent bonnes ou mauvaises, utiles ou pernicieuses, qu'elles eussent un caractère moral ou immoral. Ainsi l'on a dit une honnête industrie, et une industrie malhonnête; on a dit l'industrie d'un intrigant, d'un escroc, de même qu'on a dit l'industrie d'un laboureur, d'un artisan. Il semble même que d'abord on ait donné de préférence le nom d'industrie à des actions peu honorables; et quand on a voulu dire d'un homme privé de fortune que tous les moyens lui étaient bons pour s'enrichir, pour se tirer d'affaire, on a dit que cet homme vivait d'industrie; on a appelé chevaliers d'industrie, chevaliers de l'industrie, les hommes distingués dans l'art de la fraude, les hommes féconds en expédiens honteux.
[I-408]
Cependant, tout en étendant le mot industrie à la détestable habileté des fripons, on n'a pas laissé de s'en servir aussi pour désigner l'art des hommes livrés à des travaux honnêtes et licites; mais, conformément à son sens étymologique, on ne l'a d'abord appliqué qu'aux travaux où se montraient plus particulièrement l'esprit d'invention ou d'exécution, l'adresse à trouver et à faire, je veux dire aux arts mécaniques. Il est une multitude de personnes pour qui le mot industrie, honorablement entendu, n'exprime encore que les travaux de la fabrication, et qui disent l'industrie, pour désigner les manufactures, en les séparant de l'agriculture et du commerce. D'autres comprennent sous ce mot la fabrication et le commerce, et en excluent seulement l'agriculture. D'autres disent indistinctement les industries agricole, manufacturière, commerciale, qui ne consentiraient pas à dire les industries scientifiques, littéraires, religieuses, politiques. Peu de personnes encore, si je ne me trompe, étendent ce terme à tous les ordres d'action qu'il devrait naturellement embrasser.
Il est dans la destinée des mots de changer avec les sciences qui en font usage, et de prendre, à mesure qu'elles se perfectionnent, une acception mieux déterminée. C'est ce qui arrivera infailliblement au mot industrie, à proportion que se développera et que se fixera tout à la fois la science de [I-409] l'économie sociale. On vient de voir que, d'un côté, on avait étendu ce terme à beaucoup de mauvaises actions, tandis que, d'une autre part, on refusait de l'appliquer à plusieurs ordres de travaux utiles. Je pense qu'on finira par l'étendre à tous les travaux utiles, et par le retirer à toutes les actions malfaisantes. C'est ce qui ne pourra manquer d'avoir lieu, à mesure que le phénomène de la production sera mieux expliqué.
On a long-temps ignoré que l'homme était capable de produire des richesses. La chose peut sembler étrange, et pourtant elle ne saurait être contestée. C'était une opinion fort générale, il n'y a pas encore quatre-vingts ans, qu'il était impossible de s'enrichir sans nuire, et que ce que gagnaient un homme ou un peuple était nécessairement perdu par d'autres hommes ou d'autres peuples. L'abbé Galiani, qui était un des écrivains les plus spirituels de son temps, et un des plus éclairés sur les matières d'économie publique, écrivait formellement, en 1750, qu'une fortune ne pouvait s'accroître sans que d'autres fortunes fussent diminuées. Faut-il s'étonner qu'avec de telles idées on eût donné par préférence le nom d'industrie à l'art de s'emparer de la fortune des autres, et que les fripons fussent les industrieux par excellence, les chevaliers de l'industrie?
Heureusement, depuis ce temps, on est parvenu [I-410] à mieux connaître la vraie nature de la richesse. On a découvert qu'elle était, non de la matière, non une chose, mais une qualité des choses, qu'elle consistait dans leur utilité, dans les divers usages qu'on en pouvait faire, dans le prix qu'on y mettait, à raison de ces usages, en un mot, dans leur valeur, dans des valeurs échangeables; et comme, s'il n'est pas possible aux hommes de créer de la matière, il est plus ou moins en leur pouvoir de la rendre propre à leur usage, de lui donner de l'utilité, de créer des valeurs; on a dû reconnaître aussi qu'il était en leur pouvoir de créer de la richesse [291] .
Dès lors, il a fallu distinguer nécessairement deux manières très-différentes de s'enrichir : celle des hommes qui produisent des utilités, qui créent des valeurs, d'une espèce ou d'une autre, et celle des hommes qui s'emparent, par ruse ou par force, des valeurs créées par autrui; et, comme deux ordres d'actions d'une nature si différente, quoique exigeant plus ou moins d'adresse et d'habileté l'une et l'autre, ne pouvaient cependant continuer à être désignés par le même nom, il me semble que, depuis, on a commencé à réserver exclusivement [I-411] le nom d'industrie aux travaux des hommes qui s'enrichissent sans dépouiller personne, et laissé ceux de vol, d'escroquerie, d'extorsion, de pillage, aux arts malheureusement très-divers et très-multipliés des hommes qui fondent leur fortune sur la spoliation d'autrui. Aujourd'hui, un homme vivant d'industrie n'est pas un homme indifférent sur les moyens de subsister, et se faisant au besoin une ressource de la fraude; c'est un homme occupé à créer des utilités d'une espèce quelconque, et, avec ces utilités, se procurant, par des échanges loyaux et libres, toutes les autres utilités dont il peut avoir besoin. Le mot industrie, employé seul, ne se prend plus qu'en bonne part; et, quand on dit d'une manière générale l'industrie, on entend universellement par là l'action des facultés humaines, appliquées à quelque bonne et utile opération.
Ainsi, lorsque je vais chercher, dans ce chapitre, quel est le degré de liberté qui est compatible avec l'industrie, ce que je veux savoir, ce n'est pas, on le comprendra, j'espère, quel est le degré de liberté qui est possible dans une société où l'on n'exercerait que des arts mécaniques, comme me l'ont fait dire, assez bêtement, des critiques qui ne m'avaient point entendu; mais quelle est la liberté possible dans un état social où chacun serait occupé à ajouter à la valeur des choses ou des hommes, et [I-412] contribuerait, par son travail actuel ou par les fruits d'une industrie antérieure, à accroître la masse des idées, des bons sentimens, des vertus, des utilités de toute espèce, dont se composent la richesse et la puissance du genre humain.
§ 2. Il n'est pas d'époque, dans l'histoire de la civilisation, où l'industrie n'entre pour quelque chose dans les moyens dont l'homme fait usage pour satisfaire ses besoins. L'anthropophage ne vit pas seulement de meurtre; le nomade, seulement de rapines: le premier se livre à la chasse, cueille des fruits, se fait une hutte, se vêtit de la peau des bêtes farouches; le second élève des troupeaux, dresse des tentes, construit des chariots, tisse quelques étoffes grossières. Lorsque l'homme s'est fixé au sol, le travail paisible et productif contribue à sa subsistance dans une proportion encore plus étendue. A mesure qu'il se civilise, le nombre des personnes vivant par des moyens inoffensifs devient graduellement plus considérable. Enfin, quelle que soit encore, dans le genre humain, la masse des hommes qui fondent leur subsistance sur le brigandage et la spoliation, il est pourtant des pays où la très-grande majorité de la population vit par des moyens en grande partie exempts de violence.
Cependant, quoiqu'il y ait toujours plus ou [I-413] moins d'industrie dans la société, il s'en faut bien que la société puisse toujours être qualifiée d'industrielle. Il ne suffit pas que quelques hommes, dans un pays, vivent des fruits de leur travail ou de celui de leurs capitaux, pour qu'on puisse donner au peuple qui l'habite le nom de peuple industriel. Il ne suffirait pas même pour pour cela que l'universalité des habitans y fût livrée, comme parmi nous, à des occupations inoffensives, si d'ailleurs il n'était pas une classe de ces habitans dont les revenus ne fussent, jusqu'à un certain point, le fruit de la violence, et qui ne profitât, directement ou indirectement, de quelque privilège, de quelque monopole, de quelque prohibition inique. A la rigueur, ce titre d'état industriel, de société fondée sur l'industrie, n'est applicable qu'au pays où l'on s'est désisté, constitutionnellement, de toute prétention injuste; où le travail utile est le seul moyen avoué de s'enrichir; où nul homme ne peut rien exiger d'aucun autre à titre de seigneur, de maître, de privilégié, de monopoleur, mais seulement à titre de rétribution librement convenue pour un produit livré ou un service rendu; où le gouvernement lui-même se trouve, à cet égard, dans la même position que le dernier des citoyens, et ne peut pas demander une obole au-delà de ce qui lui a été volontairement octroyé pour prix de ses services; où le service [I-414] public a tous les caractères d'une entreprise d'industrie, avec la seule différence que cette entreprise est plus vaste qu'une autre, et qu'au lieu d'être faite pour le compte de personnes ou d'associations particulières, elle est faite de l'ordre et pour le compte de la personne publique, de la communauté générale, qui l'adjuge à des hommes de son choix, et aux prix et conditions qui sont jugés les plus favorables [292] .
§ 3. Si, dans tout le cours de cet ouvrage, la liberté m'a paru incompatible avec l'esprit de domination, il ne manque pas d'écrivains qui l'ont déclarée inconciliable avec le travail. Dans les premiers âges de la société, on reprochait à l'industrie de détruire la liberté en amortissant les passions guerrières, et en portant les hommes à la paix [293] . [I-415] Dans des temps plus avancés, on lui a reproché de détruire la liberté en poussant les hommes à la guerre. Nombre d'écrivains modernes ont représenté l'état d'un peuple industrieux comme un état nécessaire d'hostilité. Le malheur d'un État commerçant, a-t-on écrit sententieusement, est d'être condamné à faire la guerre [294] . Montaigne consacre un chapitre de ses Essais à prouver que, dans la société industrielle, ce qui fait le prouffit de l'un fait le dommaige de l'aultre [295] . Rousseau ne croit pas que, dans la société, il puisse exister d'intérêt commun. Comme Montaigne, il pense que chacun trouve son compte dans le malheur d'autrui, et dit qu'il n'est pas de profit légitime, si considérable qu'il puisse être, qui ne soit surpassé par les gains qu'on peut faire illégitimement [296] . Tous les jours enfin, on entend encore soutenir que « les diverses professions industrielles ont des intérêts nécessairement opposés, et qu'il n'est pas d'habileté qui pût réunir dans un même faisceau les classes nombreuses qui les exercent [297] » Ce n'est [I-416] pas tout tandis qu'on reproche à l'industrie d'être un principe de discorde, on lui reproche encore d'être une source de dépravation; tandis qu'on l'accuse de troubler la paix, on l'accuse aussi de corrompre les mœurs [298] . Enfin, comme elle n'obtient de très-grands succès que par une extrême division des travaux, on lui a fait encore le reproche de resserrer l'activité des individus dans des cercles extrêmement étroits, et de borner ainsi le développement de leur intelligence [299] ; c'est-à-dire, qu'on l'accuse tout à la fois d'arrêter l'essor de nos facultés, et d'en pervertir l'usage, tant à l'égard de nous-mêmes que dans nos rapports avec nos semblables; d'où il suivrait qu'un état social où l'on fonde son existence sur l'industrie est, de toute manière, défavorable à la liberté.
Je crois peu nécessaire de faire à chacune de ces objections une réponse directe. Elles seront toutes assez réfutées par la simple exposition des faits. [I-417] Occupons-nous seulement de savoir comment les choses se passent, et voyons quels sont, relativement à la liberté, les effets de l'industrie.
§ 4. Trois conditions, avons-nous dit, sont nécessaires pour que l'homme dispose librement de ses forces la première, qu'il les ait développées; la seconde, qu'il ait appris à s'en servir de manière à ne pas se nuire; la troisième, qu'il ait contracté l'habitude d'en renfermer l'usage dans les bornes de ce qui ne nuit point à autrui.
Sans doute ces conditions ne sont pas remplies par cela seul qu'on veut donner à ses facultés une direction inoffensive. Un homme n'a pas développé ses facultés, et appris à en régler l'usage, parce qu'il a conçu le dessein de n'en faire désormais qu'un utile et légitime emploi. Il est très-possible que d'abord il soit inhabile à s'en servir; il peut très-bien ignorer aussi dans quelle mesure il en faut user pour ne faire de mal ni à soi, ni aux autres hommes. Mais, si l'homme n'est pas libre par cela seul qu'il veut détourner sur les choses l'activité qu'il dirigeait auparavant contre ses semblables, il est certain qu'il peut devenir libre dans cette direction, et que ce n'est même que dans cette direction qu'il peut acquérir le degré de puissance, de moralité et de liberté, dont il est naturellement susceptible.
[I-418]
§ 5. Et d'abord il est évident que c'est dans les voies de l'industrie que les facultés humaines peuvent prendre le plus de développement. Le cercle des arts destructeurs est borné de sa nature : celui des travaux inoffensifs et des arts utiles est en quelque sorte illimité. Il faut à la domination quelques hommes habiles et une multitude d'instrumens: l'industrie n'a nul besoin d'hommes aveugles: l'instruction n'est incompatible avec aucun de ses travaux; tous ses travaux, au contraire, s'exécutent d'autant mieux que les hommes qui s'y livrent ont plus d'intelligence et de lumières. Le dominateur et ses satellites vivent sur un peuple de victimes, qu'ils tiennent dans la misère et l'abrutissement : l'industrie ne veut point de victimes; elle est d'autant plus florissante que tous les hommes sont, en général, plus riches et plus éclairés. Le dominateur enfin se nourrit de pillage, et si tous les hommes voulaient se soutenir par le même moyen, l'espèce, visiblement, serait condamnée à périr : l'industrie est essentiellement productive; elle vit de ses propres fruits, et, loin de craindre que les hommes industrieux se multiplient trop, elle voudrait voir tout le genre humain livré à des travaux utiles, et serait assurée de prospérer d'autant plus qu'il y aurait plus d'hommes utilement occupés.
L'homme, dans la vie industrielle, dirige ses forces précisément comme il convient le mieux à [I-419] ses progrès. Ce genre de vie est le seul, je supplie le lecteur de le bien remarquer, où il étudie convenablement les sciences, et où les sciences servent véritablement à le rendre puissant. Dans les pays et dans les temps de domination, l'étude n'est guère qu'une contemplation oiseuse, un amusement, un frivole exercice, destiné uniquement à satisfaire la curiosité ou la vanité [300] . On apporte aux recherches l'esprit le moins propre à acquérir de véritables connaissances. De plus, on ne songe point à faire de ses connaissances d'utiles applications. On tient que la science déroge sitôt qu'elle est bonne à quelque chose. Le savant croirait la dégrader et se dégrader lui-même en la faisant servir à éclairer les procédés de l'art [301] . L'artiste, de son côté, se soucie peu des théories scientifiques. Il rend à la science tout le mépris dont le savant fait profession pour l'industrie; et, tandis que l'industrie est exclue, comme roturière, du sein des [I-420] compagnies savantes, la science est écartée des ateliers de l'industrie, comme futile, vaine, et bonne tout au plus pour les livres.
Il n'en va pas ainsi dans les pays livrés à l'industrie, et organisés pour cette manière de vivre. On ne voit pas là ce fâcheux divorce entre la science et l'art. L'art n'y est pas une routine; la science une vaine spéculation. Le savant travaille pour être utile à l'artiste ; l'artiste met à profit les découvertes du savant. L'instruction scientifique se trouve unie généralement aux connaissances techniques. L'étude n'est pas un simple passe-temps, destiné à charmer les loisirs d'un peuple de dominateurs, régnant en paix sur un peuple de dociles esclaves; c'est le travail sérieux d'hommes vivant tous également des conquêtes qu'ils font sur la nature, et cherchant avec ardeur à connaître ses lois, pour les plier au service de l'humanité. On sent qu'une activité ainsi dirigée, des études ainsi faites, soutenues d'ailleurs par tout ce que peuvent leur donner de constance et d'énergie le désir de la fortune, l'amour de la gloire et l'universelle émulation, doivent imprimer aux travaux scientifiques une impulsion bien autrement sûre et puissante que les spéculations sans objet de dominateurs et d'oisifs, livrés à la vie contemplative. L'homme est ici évidemment sur le chemin de toutes les découvertes, de toutes les applications, de tous les travaux utiles.
[I-421]
Sans doute, le régime industriel ne peut pas faire que tout homme soit instruit de toutes choses: une condition essentielle du développement de l'industrie, c'est que ses travaux se partagent, et que chacun ne s'occupe que d'un seul ou d'un petit nombre d'objets. Mais ceci est la faute de notre faiblesse, et non point celle de l'industrie, ni celle de la séparation des travaux, qui n'est qu'une manière plus habile de mettre en œuvre nos facultés industrielles. L'effet de cette séparation, si propre à augmenter la puissance de l'espèce, n'est point, comme on l'a dit, de diminuer la capacité des individus. Sans la séparation des travaux, la puissance de l'espèce aurait été nulle, et celle des individus serait restée excessivement bornée. Chaque homme, par suite de cette séparation, est incomparablement plus instruit et plus capable qu'il ne l'eût été, si, dès l'origine, chacun avait travaillé dans l'isolement, et s'était réduit à l'usage de ses seules forces individuelles. Chacun, il est vrai, n'exerce qu'un petit nombre de fonctions; mais, si l'on ne sait bien qu'une chose, on a communément des idées justes d'un assez grand nombre. D'ailleurs, en n'exerçant qu'une seule industrie, on peut en mettre en mouvement une multitude d'autres: il suffit de créer un seul produit pour obtenir tous ceux dont on a besoin; et, par l'artifice de la séparation des travaux, la puissance de chaque [I-422] individu se trouve en quelque sorte accrue de celle de l'espèce.
Veut-on juger si la vie industrielle est favorable au développement de nos forces? On n'a qu'à regarder ce que le monde acquiert d'intelligence, de richesse, de puissance, à mesure qu'il est plus utilement occupé ; on n'a qu'à comparer les progrès qu'il fait dans les pays où l'on pille et dans ceux où l'on travaille; aux époques de domination et dans les temps d'industrie. L'Écosse, au milieu du dernier siècle, était encore à demi barbare : comment, en moins de quatre-vingts ans, est-elle devenue un des pays de l'Europe les plus savans, les plus ingénieux, les plus cultivés? Un mot explique ce phénomène : depuis 1745, le pillage, le meurtre et les luttes d'ambition y ont cessé, on s'y battait, on y travaille; des partis contraires s'y disputaient le pouvoir, ils s'y livrent de concert à l'industrie. D'où vient que l'Amérique septentrionale fait des progrès si singuliers, si hors de proportion avec ce qu'on voit dans d'autres quartiers du globe? c'est qu'on n'y lève pas des milliards d'impôts; c'est qu'on n'y est pas occupé à garotter les populations pour les dévaliser plus à l'aise; c'est qu'on ne s'y bat pas pour leurs dépouilles; c'est qu'au lieu de s'y disputer les places, on s'y livre universellement au travail. Supposez que, par un miracle que le temps opérera, j'espère, la même [I-423] chose arrive en Europe; que les partis contraires, au lieu de rester face à face, et d'être toujours prêts à en venir aux mains, se décident enfin à tourner sur les choses l'activité meurtrière qu'ils dirigent les uns contre les autres; qu'ils convertissent leurs instrumens de guerre en outils propres au travail; que les classes laborieuses se voient ainsi délivrées des gênes et des vexations qu'elles éprouvent; qu'elles conservent les millions qu'on leur prend; que leurs ennemis deviennent leurs auxiliaires; que l'universalité des hommes enfin mettent au travail le génie ardent, l'application soutenue qu'on les a vus déployer à se nuire; supposez, dis-je, un tel miracle accompli, et vous verrez bientôt si la vie industrielle est favorable au développement des facultés humaines.
§ 6. Non-seulement l'industrie est la voie où l'humanité peut donner le plus de développement et d'extension à ses forces, mais elle est encore celle où elle en use avec le plus de rectitude et de moralité. L'homme s'instruit naturellement dans le travail à faire un bon emploi de ses facultés relativement à lui-même. Comme il ne travaille que pour satisfaire ses besoins, il ne s'interdit aucune honnête jouissance; mais comme il ne se porte au travail que par un effort vertueux, comme il n'accroît sa fortune qu'avec beaucoup de peine, il [I-424] semble qu'il doit être naturellement disposé à jouir avec modération des biens que lui donne l'industrie.
Il va sans dire que je parle ici du véritable industrieux, et non de l'homme qui joue; de la fortune lentement amassée, comme l'est presque toujours la fortune acquise par le travail, et non de celle que peuvent donner tout d'un coup l'intrigue ou l'agiotage. Il en est de la richesse comme de toutes les forces: pour en user raisonnablement, il faut en avoir usé quelque temps; c'est un apprentissage à faire, et cet apprentissage ne se fait bien que lorsqu'on s'enrichit par degrés. Tout homme dont la fortune est très-rapide, commence par faire des folies : c'est le malheur ordinaire des parvenus. Nous en voyons, Dieu merci, assez d'exemples; je sais le nom de tel traitant qui a perdu quatre cent mille francs dans une séance d'écarté il avait besoin de cela, disait-il, pour se donner de l'émotion et se faire circuler le sang. On a vu, dans de certains salons, des joueurs à la hausse démontrer mathématiquement qu'il n'était pas possible de vivre avec soixante mille francs de rente; et telle est l'extravagance des dépenses que font les parvenus de la trésorerie et de la bourse, que, pour peu que les riches d'ancienne date cèdent au désir de l'imitation, soixante mille francs de rente seront bientôt en effet une fortune [I-425] médiocre. Mais les hommes qui poussent ainsi au faste, ceux qui donnent le plus aux autres l'exemple de l'ostentation, ce sont les riches improvisés dans les tripots et les antichambres, et non pas les industrieux qu'un long et honnête travail a enrichis.
On a souvent reproché à la vie industrielle de nous donner une âpreté peu honorable pour le gain.
« Il n'y a aux États-Unis, observe M. de Sismondi, aucun Américain qui ne se propose un progrès de fortune, et un progrès rapide. Le gain à faire est la première considération de la vie ; et, dans la nation la plus libre du monde, la liberté elle-même a perdu de son prix, comparée au profit. L'esprit calculateur descend jusque dans les enfans; il soumet les propriétés territoriales à un constant agiotage; il étouffe les progrès de l'esprit, le goût des arts, des lettres et des sciences: il imprime au caractère américain une tache qu'il serà difficile d'effacer [302] . »
Cet excès, en le supposant fondé, ne saurait être justement imputé à la vie industrielle. De ce qu'un peuple a renoncé à tout brigandage, à tout moyen injuste de s'enrichir, il ne s'ensuit nullement qu'il ne doive être sensible qu'au plaisir d'accroître son bien-être physique. Il se peut bien que ce soin l'occupe trop; [I-426] mais ce n'est sûrement pas parce qu'il a donné à l'exercice de ses facultés une direction inoffensive: rien n'empêcherait qu'il donnât moins de temps aux arts qui pourvoient aux besoins du corps, et plus à ceux qui s'occupent de la culture et des plaisirs de l'intelligence. L'amour des sciences et de la poésie peut se trouver réuni, jusque dans les derniers rangs de la société, avec l'esprit d'industrie. Les paysans d'Écosse, observe un écrivain anglais, ont embelli leur vie agreste de tous les charmes d'une civilisation perfectionnée. Un fermier écossais dépense la meilleure partie de son revenu modique pour que ses fils acquièrent ce qu'il estime le plus au monde, le savoir [303] . Ce n'est donc pas un effet de l'industrie de faire que nous ne soyons touchés que du plaisir d'accroître nos jouissances matérielles. D'ailleurs si la première disposition de l'homme, dans la vie industrielle comme dans toutes, est de pourvoir à ses besoins physiques, ce mode d'existence est incontestablement celui qui le conduit le plus vite au point de désirer des plaisirs d'un ordre plus élevé.
L'industrie, que de certains moralistes affectent de nous représenter comme une source de vices, l'industrie véritable est la mère nourricière des [I-427] bonnes mœurs. Il est bien possible que les peuples industrieux soient moins rigides que certains peuples dominateurs; ils n'ont sûrement pas l'austérité des Spartiates et des Romains des premiers temps de la république ; mais s'ils ne donnent pas dans le rigorisme qu'ont si souvent étalé des associations guerrières ou monacales, ils ne sont pas sujets non plus à tomber dans les mêmes dérèglemens; s'ils ne se privent de rien, ils ont pour principe de n'abuser de rien; et, se tenant également loin de l'abstinence et de la débauche, de la parcimonie et de la prodigalité, ils se forment à la pratique dé deux vertus privées éminemment utiles, à la tempérance et à l'économie, qui ne sont que l'usage bien réglé de nos facultés par rapport à nous-mêmes, ou l'habitude d'user de tout en ne faisant excès de rien.
Il est digne de remarque que les sectes de stoïciens, que les moralistes ascétiques, ne se sont guère montrés que dans les pays de domination, et aux époques où il ne restait plus qu'à consumer dans le faste et la débauche les biens qu'on avait acquis par le brigandage. La morale devient tout à la fois moins relâchée et moins absurdement sévère dans le pays et dans les temps d'industrie. On ne voit là ni des Néron, qui se livrent sans pudeur aux plus sales crapules, ni des Sénèque qui s'indignent puérilement contre les hommes qui ont [I-428] inventé de conserver la glace et de boire frais quand il fait chaud [304] . On réserve son indignation pour les vices qui énervent les hommes, qui les dégradent, qui détruisent leurs facultés ou épuisent leurs ressources; mais l'on ne s'interdit d'ailleurs aucun plaisir innocent, on se permet tous ceux dont il ne peut résulter de mal ni pour soi ni pour les autres. Voilà comment la vie industrielle agit sur les mœurs.
Nous avons si peu étudié ce mode d'existence, que nous sommes encore assez malhabiles à en démêler les effets. Un économiste, voulant défendre l'industrie contre le reproche que lui font des déclamateurs ascétiques de corrompre les mœurs, disait qu'il y a quelque chose de profondément moral dans la conquête de la nature par l'homme. Il n'y a ni moralité, ni immoralité à faire des conquêtes sur la nature; mais l'homme qui veut s'enrichir par ce moyen ne peut se passer d'activité, d'application, d'ordre, de prévoyance, d'économie, de frugalité, etc.; et voilà comment l'industrie influe utilement sur la morale.
§ 7. Enfin, tandis que l'industrie nous fait contracter des habitudes privées si favorables à la conservation de nos forces, elle bannit toute violence de nos rapports mutuels.
[I-429]
On a cru jusqu'ici qu'il était possible de faire régner la paix entre les hommes par une certaine organisation politique, quels que fussent d'ailleurs la manière de vivre et le régime économique de la société.
Les philosophes grecs commençaient toujours par poser l'esclavage en principe, et puis ils cherchaient par quel arrangement politique on pourrait assurer l'ordre public. Une cité, pour être complète et parfaite, dit d'abord Aristote, doit être composée d'hommes libres et d'esclaves. Les hommes libres, ajoute-t-il, doivent être affranchis de tous les soins qu'exige la satisfaction des besoins de première nécessité. Les seules occupations dignes d'eux, dit-il encore, sont l'exercice du pouvoir et la vie contemplative ou l'étude des sciences libérales [305] . Puis, après avoir ainsi fondé la société sur l'esclavage, notre philosophe cherche quelle est la forme de gouvernement la plus propre à y maintenir la paix. Il n'avait pas étudié, pour résoudre ce problème, moins de cent cinquante-huit constitutions, suivant quelques écrivains, et moins de deux cent cinquante, selon d'autres.
Certains politiques de nos jours posent d'abord en fait que toutes les classes d'hommes ont des [I-430] intérêts nécessairement opposés; que, par la nature même des choses, il n'en est pas une qui ne fonde sa prospérité sur des privilèges ou des monopoles contraires à la prospérité des autres, et ensuite ils prétendent par leur art faire vivre en paix toutes ces classes ennemies. « La subdivision de nos sociétés modernes en tant d'états et de métiers divers produit trop d'intérêts opposés, disent-ils, pour qu'aucune habileté révolutionnaire puisse les réunir dans un faisceau solide. Établissez la liberté du commerce, vous aurez contenté l'armateur qui veut parcourir sans gêne la vaste étendue de la mer; vous plairez au consommateur qui veut acheter à bon marché de bonnes marchandises; mais comment ferez-vous partager leurs sentimens par ce fabricant qui fonde son débit sur l'exclusion des concurrences étrangères? Partout la liberté et le monopole sont en présence dans le monde industriel, comme l'égalité et le privilège dans le monde politique.« C'est donc uniquement par des illusions, par des fables, par des bruits mensongers, qu'on peut enrégimenter ces intérêts contraires sous un étendard commun; pour se désunir, ils n'ont qu'à se regarder. »
Et veut-on savoir quel est le remède que l'auteur de ces paroles propose à cette opposition? c'est d'enrégimenter tous les intérêts analogues, de les armer, et de leur donner le moyen de défendre leurs prétentions [I-431] exclusives, qu'il appelle les intérêts permanens et généraux de la société : il prétend fonder l'ordre en constituant, en rendant permanente et indestructible l'anarchie que lui-même vient de signaler [306] .
Les publicistes de l'école libérale, à la différence de ceux de l'école monarchique, ne croient point, eux, à la nécessité de cette opposition entre les intérêts des diverses classes, et ils soutiennent que tout le monde pourrait vivre sans le secours de la violence et de l'iniquité; toutefois, ils ne disconviennent pas qu'il n'y ait dans la société beaucoup de prétentions injustes, beaucoup de gens qui veulent aller à la fortune par de mauvais moyens ; mais ils pensent qu'une habile organisation du pouvoir pourrait neutraliser tous ces vices, et faire aller les choses comme s'ils n'existaient pas.
On s'est autrefois beaucoup moqué des alchimistes: ne se pourrait-on pas moquer un peu des politiques qui prétendent établir la paix par des formes de gouvernement? les alchimistes se proposaient-ils un problème plus insoluble que ces politiques? est-il plus difficile de produire de l'or avec d'autres métaux que de parvenir, par je ne sais quelles combinaisons, à faire sortir la paix de [I-432] l'esclavage, du privilège ou de toute autre manière inique de s'enrichir?
Montesquieu, qui raille si amèrement dans ses Lettres persanes les gens qui se ruinaient à la recherche de la pierre philosophale, me semble avoir donné dans un travers pour le moins aussi énorme quand il a prétendu faire de la liberté avec des divisions et des balances de pouvoir[307] . Si les Anglais, à ses yeux, sont un peuple libre, ce n'est pas à cause de leur régime économique, et parce qu'on vit en général chez eux par des moyens exempts de violence. Il ne tient pas compte de ces causes; il ne cherche pas même si elles existent; la vraie raison pour lui de la liberté des Anglais, c'est que la puissance législative est séparée, chez eux, de l'exécutrice, l'exécutrice de la judiciaire; c'est que la puissance publique est divisée en trois branches qui se font mutuellement obstacle, de telle sorte qu'aucune ne peut opprimer.
« Voici, dit-il, la constitution fondamentale du gouvernement anglais. Le corps législatif étant composé de deux parties, l'une enchaînera l'autre par sa faculté mutuelle d'empêcher. Toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice, qui le sera elle-même par la législative. Ces trois puissances devraient former un repos ou une inaction; mais [I-433] comme, par le mouvement nécessaire des choses, elles seront contraintes d'aller, elles seront forcées d'aller de concert [308] . »
Voilà, suivant Montesquieu, par quels artifices on a obtenu la liberté en Angleterre. Je doute que Raymond Lulle et Nicolas Flamel aient jamais écrit sur l'art de transmuer les métaux quelque chose de moins raisonnable.
A l'exemple de Montesquieu, la plupart des publicistes de notre âge ont pensé que ce n'était que par une bonne distribution des pouvoirs publics qu'on empêchait les hommes de se faire mutuellement violence. L'oppression est-elle excessive en Turquie? c'est que tous les pouvoirs y sont confondus; le pouvoir est-il modéré dans la plupart des monarchies de l'Europe? c'est qu'il est partout plus ou moins divisé ; pourquoi la liberté ne sortit-elle pas de la constitution de 1791? c'est que les pouvoirs y étaient mal répartis ; pourquoi la convention fut-elle terroriste? c'est qu'elle réunissait tous les pouvoirs; pourquoi le directoire fit-il le 18 fructidor? c'est que, dans la constitution de l'an 3, les pouvoirs étaient trop séparés. Finalement il n'est pas un désordre public, pas une violence politique dont on ne soit toujours prêt à montrer la cause dans quelque vice organique des pouvoirs établis.
[I-434]
Sûrement l'organisation de ces pouvoirs est d'une grande importance; mais sûrement aussi elle n'est pas la première chose à considérer. La première chose à considérer, c'est la manière dont la société pourvoit généralement à sa subsistance. Tel pourrait être, en effet, le régime économique de la société que l'organisation politique la plus savante ne parviendrait pas à y faire régner la paix. Dites, comme les philosophes grecs, qu'il faut se faire nourrir par des esclaves; dites, comme nos écrivains monarchiques, que toutes les classes de la société veulent avoir des privilèges, et que chaque classe doit avoir les siens; supposez les hommes livrés à l'esprit de domination, de rapine, d'exaction, de monopole, et je défie qu'aucune habileté politique parvienne jamais à établir une paix réelle et durable parmi eux.
Il faut donc, avant tout, pour avoir la paix, convenir d'un mode d'existence avec lequel elle soit compatible. Or, je dis qu'elle n'est compatible qu'avec l'industrie. Non-seulement la vie industrielle est la seule où les hommes puissent donner un grand développement à leurs facultés, une véritable perfection à leurs habitudes personnelles, elle est aussi la seule qui comporte de bonnes habitudes sociales, la seule dans laquelle il soit possible de vivre en paix.
Il y a cela, dans les pays où l'industrie est la [I-435] commune ressource des hommes, qu'ils peuvent tous satisfaire leurs besoins sans se causer mutuellement aucun dommage, sans attenter réciproquement à leur liberté. Par cela même que chacun porte son activité sur les choses, il est visible que nul homme n'est opprimé. On a beau se livrer, chacun de son côté, à l'étude des sciences, à la pratique des arts, nul ne fait ainsi violence à personne; on peut de toutes parts entrer dans ces voies, et s'y donner carrière sans crainte de se heurter; on ne s'y rencontre point, on ne s'y fait pas obstacle, même alors qu'on s'y fait concurrence. Celui qui exerce une autre industrie que moi ne me trouble point; au contraire, son travail encourage le mien, car il m'offre la perspective d'un moyen d'échange, et la possibilité de satisfaire deux ordres de besoins, en ne créant qu'une seule sorte de produits. Celui qui se livre au même travail que moi ne me trouble pas davantage; sa concurrence, loin de m'empêcher d'agir, me stimule à mieux faire; et si j'ai moins de succès que lui, je peux m'affliger de mon incapacité, mais non me plaindre de son injustice. Il n'y a donc dans la carrière des arts producteurs que des rivalités innocentes; il n'y a point d'oppresseur, point d'opprimé, et il n'est pas vrai de dire que l'on s'y trouve naturellement en état de guerre.
Toute domination disparaît des lieux où l'homme [I-436] cherche uniquement dans le travail les moyens de pourvoir à sa subsistance; les rapports de maître et d'esclave sont détruits; les inégalités artificielles s'évanouissent; il ne reste entre les individus d'autre inégalité que celle qui résulte de leur nature. Un homme peut être plus heureux qu'un autre, parce qu'il peut être plus actif, plus habile, plus éclairé; mais nul ne prospère au détriment de son semblable; nul n'obtient rien que par l'échange ou la production; le bonheur de chacun s'étend aussi loin que peut le porter l'exercice inoffensif de ses forces, celui de personne ne va au-delà.
S'il n'existait aucun moyen de prospérer sans nuire, il n'y aurait dans ce monde ni ordre, ni paix, ni liberté praticables. Mais la proposition que tout homme vit aux dépens d'un autre, vraie dans la domination, est fausse et absurde dans l'industrie. Il est très-vrai qu'en pays de tyrans et de voleurs, on ne prospère qu'en se dépouillant les uns les autres, si tant est que l'on puisse prospérer en de tels pays. Mais il n'en est sûrement pas de même en pays de gens qui travaillent; tout le monde ici peut prospérer à la fois. Deux laboureurs qui améliorent simultanément leur terre, deux fabricans, deux négocians, deux savans, deux artistes, qui se livrent avec intelligence, chacun de leur côté, à l'exercice de leur profession, peuvent sans contredit prospérer ensemble. Ce que je dis de deux [I-437] personnes, on peut le dire de dix, de cent, de mille; de tous les individus d'une cité, d'une province, d'un royaume, du monde entier. Tous les peuples de la terre peuvent prospérer à la fois, et l'expérience l'atteste; car le genre humain, considéré en masse, est certainement plus riche aujourd'hui qu'il ne l'était il y a trois cents ans, et à plus forte raison qu'il ne l'était à six siècles, à douze siècles en arrière.
Il est donc vrai que, dans l'industrie, tous les hommes peuvent satisfaire leurs besoins sans se faire mutuellement violence. S'il arrive que les hommes d'une même profession, ou de professions diverses, se regardent comme ennemis, que des peuples industrieux et commerçans se font la guerre, ce n'est pas, comme dit Montaigne,' parce que le proufit de l'un est le dommaige de l'aultre, mais parce qu'ils ont le malheur de ne pas comprendre l'accord véritable que la nature a mis entre leurs intérêts; ce n'est pas, comme dit Rousseau, parce que leurs intérêts sont opposés, mais parce qu'ils ne voient pas qu'ils sont conformes; ce n'est pas, comme dit M. de Bonald, parce que le commerce est un état d'hostilité, mais parce qu'ils n'ont pas le véritable esprit du commerce. Voilà des vérités que le temps éclaircit tous les jours, et que ne contesteront bientôt plus [I-438] ceux-là même qui se croient le plus intéressés à les méconnaître.
En un mot, je ne nie pas qu'on ne puisse former beaucoup de prétentions injustes; mais je nie que par la nature des choses les intérêts des hommes soient opposés. Je ne nie pas non plus qu'ils ne soient opposés là où la violence a agi et troublé le cours naturel des choses; mais je dis que sans ce trouble ils ne l'eussent pas été.
Par exemple, dans l'état actuel des choses, il y a en France et en Angleterre des fileurs de coton dont les intérêts sont opposés, cela n'est pas douteux, Nos fileurs, moins habiles que ceux d'Angleterre, ne pourraient se soutenir sans le secours du monopole: il faut qu'ils empêchent les fileurs anglais de nous vendre leurs produits, sans quoi force leur serait de fermer leurs manufactures. Mais qu'est-ce qui a créé ces deux classes d'intérêts ennemis? C'est précisément l'injuste faveur qu'on a faite au Français qui entreprenait de filer du coton. Sans les primes accordées à sa maladresse, à son inexpérience, à sa paresse, il ne se serait pas engagé dans une carrière où il ne pouvait soutenir la concurrence avec des hommes plus actifs ou plus avancés que lui; ou bien il s'y serait engagé avec les moyens de lutter, sans le secours honteux de l'injustice. Il serait allé en Angleterre, [I-439] il s'y serait instruit avec soin des procédés de l'art qu'il voulait pratiquer, il y aurait acheté des machines, il en aurait emmené des ouvriers, et il serait ainsi parvenu à importer en France une branche d'industrie capable de s'y maintenir d'elle-même les fileurs d'Angleterre et de France n'auraient pas maintenant des intérêts opposés.
On croit qu'il n'est possible de naturaliser une industrie étrangère, dans un pays où elle n'a pas encore existé, qu'en l'entourant dans ce pays, au préjudice des consommateurs indigènes et des fabricans étrangers, d'une multitude de privilèges injustes. C'est au contraire par ces privilèges qu'on parvient à l'empêcher de se naturaliser dans le pays où on veut l'introduire, et où, dans bien des cas, elle se serait établie d'elle-même. Tel est, par exemple, d'après l'avis de l'un de nos savans les plus distingués et de nos manufacturiers les plus habiles [309] , l'avantage de la France dans le prix de la plupart des choses nécessaires à la fabrication de la poterie, et notamment dans le prix de l'argile plastique, du kaoli, du silex calciné, et dans celui de diverses façons et de divers ustensiles, que l'on pourrait aisément en France, malgré l'infériorité d'industrie, fabriquer de la poterie fine aussi bonne que celle d'Angleterre, à meilleur [I-440] marché qu'en Angleterre même. Cependant notre poterie fine, beaucoup moins bonne que celle d'Angleterre, est plus chère de vingt pour cent. D'où vient cela? Précisément de ce qu'on a prétendu faire, pour l'encourager, des prohibitions qu'on lui a accordées au détriment de tout le monde. Nos fabricans, aidés des chimistes, et versés dans la technologie, seraient sûrement assez instruits pour faire aussi bien faire aussi bien que les fabricans anglais, surtout avec les avantages de position dont j'ai parlé plus haut. Mais il faudrait qu'ils se donnassent de la peine, qu'ils fissent des essais longs, quelquefois infructueux, toujours dispendieux. Or, ne concourant qu'entre eux, et ayant en France un débit qui leur paraît suffisant, ils n'ont aucun motif puissant de faire des efforts; ils n'ont point à craindre la concurrence étrangère; la prohibition les en affranchit; et le gouvernement, qui voulait servir l'industrie, lui a fait un tort grave en permettant aux frabricans de rester dans l'apathie.
Non-seulement donc c'est la violence qui crée les intérêts opposés, mais c'est elle aussi qui fait les ouvriers malhabiles. Si les choses avaient été laissées à leur cours naturel, si nul n'avait pu prospérer que par son travail, sans aucun mélange d'injustice et de violence, non-seulement les arts seraient plus également développés partout, mais les [I-441] artisans des divers pays, plus capables de concourir ensemble, auraient des intérêts moins opposés: l'opposition entre les fileurs de France et d'Angleterre, par exemple, ne serait pas plus forte qu'entre ceux de Rouen et de Saint-Quentin.
Ce que je dis du caractère inoffensif de l'industrie est également vrai, sous quelque aspect qu'on la considère. Que les hommes, dans ce mode d'existence, agissent ensemble ou isolément, l'effet est toujours le même, et l'action collective' des associations n'y est pas plus hostile que né le sont les efforts isolés des individus.
Quelle que soit la direction générale que les hommes donnent à leurs forces, ils ne peuvent en tirer un grand parti qu'en s'associant, et en établissant entre eux une certaine subordination. Ils ont besoin de s'unir, de s'échelonner, de se subordonner pour la défense comme pour l'attaque, et pour agir sur la nature comme pour exercer l'oppression. Il y a donc, dans l'industrie comme dans la guerre, ligue, association, union d'efforts.
« Aux quatorzième et quinzième siècles, dit un auteur, tout homme qui se sentait quelque force de corps et d'ame, avide de la déployer, se livrait, sous le moindre prétexte, au plaisir de guerroyer avec un petit nombre de compagnons, tantôt pour son propre compte, tantôt pour celui d'un autre. [I-442] La milice était un pur trafic; les gens de guerre se louaient de côté et d'autre, selon leur caprice et leur avantage, et traitaient pour leur service comme des ouvriers pour leur travail. Ils s'engageaient, par bandes détachées et avec divers grades, au premier chef de leur goût, à celui qui, par sa bravoure son expérience, son habileté, avait su leur inspirer de la confiance; et celui-ci, de son côté, se louait avec eux à un prince, à une ville, à quiconque avait besoin de lui [310] . »
Voilà comme on s'associe dans le brigandage.
Il se fait dans la vie industrielle des arrangemens fort analogues. Tout homme qui se sent quelque activité, quelque intelligence, quelque capacité pour le travail, se livre, avec un certain nombre de compagnons, non au plaisir honteux de piller, mais au noble plair de créer quelque chose d'utile. On s'engage dans une entreprise d'agriculture, de fabrique, de transport, d'enseignement, de prédication, etc., comme on s'engageait autrefois dans une entreprise de guerre. Le fermier, l'armateur, le manufacturier, le chef d'une entreprise littéraire et scientifique, ont à leur solde, comme les anciens chefs de milice, un nombre d'hommes plus ou moins grand. On voit quelquefois des chefs de [I-443] manufactures soudoyer jusqu'à dix mille manoeuvres. Il s'établit entre les ouvriers, les chefs d'atelier, les entrepreneurs, la même subordination qu'à la guerre, entre le chef supérieur, les officiers en sous-ordre et les soldats. Finalement, on voit se former dans le régime industriel des associations encore plus nombreuses et plus variées qu'au sein de la guerre et du brigandage. Seulement l'objet de ces associations est tout autre, et les résultats, par suite, sont fort différens.
Le lecteur sait pourquoi l'on s'associe dans toute domination. Prenons pour exemple le régime des privilèges : il n'y a là, comme on l'a vu, aucune agrégation qui ne se propose quelque objet inique ces marchands sont unis pour empêcher que d'autres ne fassent le même commerce qu'eux; ces nobles, pour écarter la roture du service public, et tirer du peuple, sous forme d'impôt, ce qu'ils ne reçoivent plus à titre de redevance féodale; tous les membres de ce gouvernement, pour étendre au loin leur empire, et mettre plus de peuples à contribution; ces populations en masse, pour ouvrir à main armée des débouchés à leur commerce, et agrandir l'espace d'où elles pourront exclure la concurrence des étrangers : il s'agit pour tous de privilèges à obtenir, d'exactions à exercer, de violences à faire.
Il n'en est pas ainsi dans l'industrie on y est [I-444] également associé, mais c'est pour agir sur les choses, et non pour dépouiller les hommes; c'est encore pour se défendre, ce n'est plus du tout pour opprimer. Il n'y a pas une association dont l'objet soit hostile. On est uni pour la propagation d'une doctrine, pour l'extension d'une méthode, pour l'ouverture d'un canal, pour la construction d'une route; on est ligué contre les fléaux de la nature, contre les risques de mer, contre les dangers de l'incendie ou les ravages de la grêle; mais il n'y a visiblement rien d'oppressif dans tout cela. Il ne s'agit pas ici, comme dans les anciennes corporations, d'accaparer, de prohiber, d'empêcher les autres de faire : loin que des coalitions, ainsi dirigées, limitent les facultés de personne, elles ajoutent à la puissance de tout le monde, et il n'est pas un individu qui ne soit plus fort par le fait de leur existence qu'il ne le serait si elles n'existaient pas. Aussi, tandis que les corporations du régime des privilèges étaient une cause toujours agissante d'irritation, de jalousie, de haine, de discorde, les associations du régime industriel sont-elles un principe d'union autant que de prospérité [311] .
[I-445]
Ce que je dis des petites associations, je dois le dire également des grandes, et de celles qui se forment pour le gouvernement, comme de celles qui se forment pour quelque objet particulier de science, de morale, de commerce. L'association chargée du service public n'a pas, dans le régime industriel, un caractère plus agressif que les autres. Le pouvoir n'y est pas un patrimoine; ceux qui le possèdent ne le tiennent pas de leur épée ; ils ne règnent pas à titre de maîtres; ils n'exercent pas une domination; l'impôt n'est pas un tribut qu'on leur paie. Loin que la communauté leur appartienne, ils appartiennent à la communauté ; ils dépendent d'elle par le pouvoir qu'ils exercent; c'est d'elle qu'ils ont reçu ce pouvoir. Le gouvernement, dans l'industrie, n'est en réalité qu'une compagnie commerciale, commanditée par la communauté, et préposée par elle à la garde de l'ordre public. La communauté, en le créant, ne se donne pas à lui; elle ne lui donne pas d'autorité sur elle; elle ne lui confère pas sur les personnes et les propriétés un pouvoir qu'elle-même n'a point : elle ne lui donne de pouvoir que contre les volontés malfaisantes, manifestées par des actes offensifs; elle ne lui permet d'agir contre les malfaiteurs qu'à raison de ces volontés et de ces actes. Du reste, chaque homme est maître absolu de sa personne, de sa chose, de ses actions; et le [I-446] magistrat n'a le droit de se mêler en rien de la vie d'un citoyen tant qu'il ne trouble par aucun acte injuste l'existence d'aucun autre. Comme le pouvoir n'est pas institué en vue d'ouvrir une carrière aux ambitieux, et seulement pour créer une industrie à ceux qui n'en ont aucune, la société ne lui permet pas de s'étendre sans motifs, et d'agrandir la sphère de son action pour pouvoir multiplier le nombre de ses créatures; elle veille attentivement à ce qu'il se renferme dans son objet. D'une autre part, elle ne lui donne en hommes et en argent que les secours dont il a besoin pour remplir convenablement sa tâche. Elle regrette même d'avoir à faire un tel emploi de ses capitaux et de son activité; non que cette dépense, tant qu'il y a d'injustes prétentions à réduire, des ambitions à contenir ou des méfaits à réprimer, ne lui paraisse très-utile et même très-productive; mais parce qu'il vaudrait encore mieux pour elle qu'elle ne fût pas nécessaire, et qu'elle pût employer à agir sur les choses le temps et les ressources qu'elle consume à se défendre contre certains hommes. Aussi, à mesure que tous ses membres apprennent à faire un usage plus inoffensif de leurs forces, diminue-t-elle par degrés celles de son gouvernement, et ne lui laisse-t-elle jamais que celles dont il a besoin pour la préserver de tout trouble.
Enfin ce que je dis de l'action du gouvernement [I-447] sur la société, je peux le dire également de l'action des sociétés les unes à l'égard des autres. Ces vastes agrégations n'ont pas un caractère plus hostile que toutes les associations particulières dont elles sont formées. Il serait difficile, quand les individus tournent généralement leur activité vers le travail, que les nations voulussent prospérer encore par le brigandage. Il ne s'agit pas pour elles dans le régime industriel de conquérir des trônes à leurs ambitieux, des places à leurs intrigans, des débouchés exclusifs à leur commerce. Le temps que d'autres peuples mettent à guerroyer, elles l'emploient à développer toutes leurs ressources et à se mettre en communication avec quiconque a d'utiles échanges à leur proposer. Elles souhaitent la civilisation et la prospérité de leurs voisins comme la leur propre, parce qu'elles savent qu'on ne peut avoir des relations sûres qu'avec les peuples éclairés, ni des relations profitables qu'avec les peuples riches. Elles font des voeux particuliers pour la civilisation de leurs ennemis, parce qu'elles savent encore que le seul vrai moyen de n'avoir plus d'ennemis c'est que les autres peuples se civilisent. Tous leurs efforts contre le dehors se bornent à empêcher le mal qu'on tenterait de leur faire; elles se tiennent strictement sur la défensive; elles déplorent même la triste nécessité où on les réduit de se défendre : non sans doute qu'elles soient peu sensibles à [I-448] l'injure, ou qu'elles manquent de moyens pour la repousser; mais parce qu'elles savent combien sont encore funestes les guerres les plus légitimes et les plus heureuses, et combien il serait préférable pour elles et pour le monde qu'elles pussent employer à des travaux utiles le temps et les ressources que la barbarie de leurs ennemis les oblige de sacrifier à leur sûreté. Aussi n'auraient-elles pas, malgré la supériorité de leur puissance, de plus grand désir que de pouvoir poser les armes, abandonner leurs forteresses, relâcher les liens que la nécessité de la défense a formés, laisser agir en liberté l'esprit local et l'indépendance individuelle, et consacrer en paix toutes leurs forces à ouvrir au monde de nouvelles sources de prospérité [312] .
[I-449]
Les faits rendent de ces vérités un témoignage irrécusable. Il est impossible de ne pas voir que les relations des hommes deviennent partout d'autant plus faciles et plus paisibles qu'ils approchent plus de la vie industrielle et en comprennent mieux les véritables intérêts. Ceci est surtout évident en Amérique. Il n'est besoin aux États-Unis, pour obtenir la paix, ni de hiérarchies factices, ni de balances de pouvoirs. On ne cherche à l'établir, ni par l'opposition des intérêts contraires, ni par la soumission violente de tous les intérêts à une seule volonté. Il n'est point question de subordonner les classes laborieuses à une aristocratie militaire, cette aristocratie à des rois, les rois à un pape. Il ne s'agit pas davantage de mettre en présence la démocratie, l'aristocratie et la royauté, et de faire que ces trois forces rivales se tiennent [I-450] mutuellement en respect. L'Amérique laisse à l'Europe toutes ces merveilleuses inventions de sa politique; elle tend à la paix par d'autres moyens. La paix résulte surtout de son régime économique. Il suffit en quelque sorte, pour qu'elle règne, que l'universalité de ses citoyens ne cherche la fortune que dans le travail et de libres échanges. Par le seul effet de cette tendance, des millions d'individus, au milieu de l'infinie diversité de leurs mouvemens, agissent sans se heurter et prospèrent sans se nuire. Ils forment les associations les plus variées; mais tel est l'objet de ces associations et la manière dont elles sont dirigées, qu'elles ne font de violence à personne, et ne sauraient exciter de réclamations. Les classes ouvrières sont subordonnées aux entrepreneurs qui leur fournissent du travail, les chefs d'entreprise aux ingénieurs qui leur donnent des conseils, les ingénieurs aux capitalistes qui leur procurent des fonds; chacun se trouve placé par ses besoins dans la dépendance des hommes dont il réclame l'aide ou l'appui ; mais cette subordination toute naturelle, n'a pas besoin pour s'établir de l'assistance du bourreau, cet auxiliaire obligé des subordinations contre nature. Les citoyens, soumis à l'ordre public, ne sont d'ailleurs sujets de personne. Le gouvernement, chargé de réprimer les injustices des individus, peut à son tour être contenu par la société; il est [I-451] comptable envers elle; et comme la vie toute laborieuse des citoyens laisse peu à faire pour le maintien de l'ordre, on ne lui donne pas assez de force pour qu'il pût s'affranchir de cette responsabilité, quand même il pourrait concevoir la pensée de s'y soustraire. Enfin, la société anglo-américaine dans son ensemble n'affecte pas plus de dominer les autres peuples que ses gouvernemens ne prétendent dominer les citoyens; on ne la voit occupée ni à envahir des territoires, ni à fonder au loin des colonies dépendantes, ni à s'ouvrir par la violence des marchés exclusifs. L'union des États, leur subordination à un centre commun, leurs milices, leur armée, leur marine militaire ont pour unique objet la sûreté du pays. Et quoique, dans ce déploiement de forces purement défensives, l'Amérique reste fort en arrière de ce qu'elle pourrait, elle va encore fort au-delà de ce qu'elle voudrait. Son désir le plus ardent serait de pouvoir être tout entière à ses affaires, à ses travaux, au soin de sa culture intellectuelle et de son perfectionnement moral; et lorsqu'un jour l'activité industrielle, devenue prédominante en Europe, y aura détruit enfin les ligues de l'ambition, elle sera heureuse sans doute de rompre celle que nous la contraignons de former pour sa défense, et de pouvoir offrir au monde le spectacle de populations innombrables, livrées sans partage aux arts de la paix.
[I-452]
L'Amérique, dis-je, sera heureuse de relâcher les liens que nous l'avons contrainte de former. Ce n'est guère en effet que pour sa sûreté et à cause de l'esprit dominateur des gouvernemens d'Europe, qu'elle s'est fédérée et qu'elle reste unie. Il n'y a guère dans l'industrie de motifs à des coalitions aussi vastes; il n'y a point d'entreprise qui réclame l'union de dix, de vingt, de trente millions d'hommes. C'est l'esprit de domination qui a formé ces aggrégations monstrueuses ou qui les a rendues nécessaires; c'est l'esprit d'industrie qui les dissoudra un de ses derniers, de ses plus grands, de ses plus salutaires effets sera de multiplier les centres d'action, et, pour ainsi dire, de municipaliser le monde.
Sous son influence, les peuples commenceront par se grouper plus naturellement; on ne verra plus réunis sous une même dénomination vingt peuples étrangers l'un à l'autre, disséminés quelquefois dans les quartiers du globe les plus opposés, et moins séparés encore par les distances que par le langage et les mœurs. Les peuples se rapprocheront, s'agglomèreront d'après leurs analogies réelles et suivant leurs véritables intérêts.
Ensuite, quoique formés, chacun de leur côté, d'élémens plus homogènes, ils seront pourtant entre eux infiniment moins opposés. N'ayant plus mutuellement à se craindre, ne tendant plus à [I-453] s'isoler, ils ne graviteront plus aussi fortement vers leurs centres et ne se repousseront plus aussi violemment par leurs extrémités. Leurs frontières cesseront d'être hérissées de forteresses; elles ne seront plus bordées d'une double ou triple ligne de douaniers et de soldats. Quelques intérêts tiendront encore réunis les membres d'une même agrégation, une communauté plus particulière de langage, une plus grande conformité de mœurs, l'influence de villes capitales d'où l'on aura contracté l'habitude de tirer ses idées, ses lois, ses modes, ses usages; mais ces intérêts continueront à distinguer les agrégations sans qu'il reste entre elles d'inimitiés. Il arrivera, dans chaque pays, que les habitans les plus rapprochés des frontières auront plus de communications avec des étrangers voisins qu'avec des compatriotes éloignés. Il s'opérera d'ailleurs une fusion continuelle des habitans de chaque pays avec ceux des autres. Chacun portera ses capitaux et son activité là où il verra plus de moyens de les faire fructifier. Par là, les mêmes arts seront bientôt cultivés avec un égal succès chez tous les peuples; les mêmes idées circuleront dans tous les pays; les vieilles mœurs nationales ces mœurs étroites et mesquines que la barbarie avait décorées du nom de patriotisme, iront s'effaçant de plus en plus; les langues elles-mêmes se rapprocheront, s'emprunteront leurs vocabulaires, et [I-454] finiront à la longue par se fondre dans un idiome commun à tous les peuples cultivés ; l'uniformité de costume s'établira dans tous les climats en dépit des indications de la nature : les mêmes besoins, une civilisation semblable, se développeront partout.
Dans le même temps, une multitude de localités, acquérant plus d'importance, sentiront moins le besoin de rester unies à leurs capitales; elles deviendront à leur tour des chefs-lieux; les centres d'activité iront se multipliant sans cesse; et finalement les plus vastes contrées finiront par ne représenter qu'un seul peuple, composé d'un nombre infini d'agrégations uniformes, agrégations entre lesquelles s'établiront, sans confusion et sans violence, les relations les plus compliquées et tout à la fois les plus faciles, les plus paisibles et les plus profitables.
§ 8. Autant donc la vie industrielle est propre, d'une part, à développer nos connaissances, et d'un autre côté, à perfectionner nos mœurs, autant, en troisième lieu, elle est opposée à la violence, aux prétentions anti-sociales et à tout ce qui peut troubler la paix. On voit, en somme, que ce mode d'existence est celui où les hommes usent de leurs forces avec le plus de variété et d'étendue; où ils s'en servent le mieux à l'égard d'eux-mêmes; [I-455] où, dans leurs relations privées, publiques, nationales, ils se font réciproquement le moins de mal. Concluons qu'il est celui où ils peuvent devenir le plus libres, ou plutôt qui est le seul où ils puis sent acquérir une véritable liberté..
[I-456]
CHAPITRE XII.
Obstacles qui s'opposent encore à la liberté dans le régime industriel, ou bornes inévitables qu'elle paraît rencontrer dans la nature des choses.↩
§ 1. Cependant l'industrie a beau être favorable à la liberté, quand l'universalité des hommes vivrait ainsi par des moyens exempts de violence, il y aurait dans cette manière de vivre des bornes à la liberté du genre humain, parce qu'il y en a très-probablement aux progrès dont l'espèce humaine est susceptible; et de plus, tous les hommes n'y seraient pas également libres, parce qu'il n'est pas possible qu'ils donnent tous le même degré de développement et de rectitude à leurs facultés.
Il faut, si nous voulons éviter les illusions et les mécomptes, nous bien imprimer dans l'esprit une chose : c'est qu'il n'est pas d'état social où tout le monde puisse jouir d'une même somme de liberté, parce qu'il n'en est point où tout le monde puisse posséder à un égal degré ce qui fait les hommes libres, à savoir: l'industrie, l'aisance, les lumières, les bonnes habitudes privées et sociales.
[I-457]
§ 2. Sans doute on ne verrait pas dans le régime industriel des inégalités comparables à celles qui se développent dans les systèmes violens que j'ai précédemment décrits. On n'y verrait pas surtout, au même degré, l'inégalité des fortunes, qui en entraîne tant d'autres après elle. Les différences révoltantes que produisent à cet égard, dans la domination, les levées continuelles de taxes énormes; la distribution du produit de ces taxes à des classes favorisées; les marchés ruineux faits aux dépens du public avec des prêteurs, des traitans, des fournisseurs; les primes, les privilèges, les monopoles accordés à certaines classes de producteurs au détriment des autres; les obstacles de toute sorte, mis à l'activité laborieuse des classes les moins fortunées; les lois enfin destinées à retenir violemment dans un petit nombre de mains les fortunes qui y sont accumulées par tous ces brigandages; les criantes inégalités de richesse, dis-je, qu'engendrent tous ces excès de la domination, n'existeraient pas dans l'industrie. Il n'y aurait sûrement pas des profits de l'ouvrier le plus misérable à ceux de l'entrepreneur le plus opulent la même distance que, dans certaines dominations, des profits du chef des dominateurs à ceux du dernier de ses instrumens, et, à plus forte raison, de la dernière de ses victimes; la même distance, par exemple, que des profits de tel roi d'Europe à ceux [I-458] du dernier fantassin de son armée, ou du plus pauvre artisan de son royaume[313] .
§ 3. Cependant, qu'un peuple tourne ses facultés vers l'exercice des arts violens, ou bien qu'il les applique à la culture des arts paisibles, il s'établira entre ses membres, il n'en faut pas douter, des inégalités fort grandes.
L'effet du régime industriel est de détruire les inégalités factices; mais c'est pour mieux faire ressortir les inégalités naturelles. Or ces inégalités, par leur seule influence, et sans que la violence y contribue en rien, auront la vertu d'en faire naître beaucoup d'autres, et de produire ainsi de grandes [I-459] différences dans le degré de liberté dont chacun pourra jouir.
Que des hommes s'associent sur le principe de l'égalité la plus parfaite; que, s'établissant ensemble dans un pays inoccupé, ils s'en partagent également le territoire; que les principes de leur association leur laissent à chacun la même latitude pour le travail; qu'ils aient tous la pleine disposition de leur fortune; que, dans la transmission qui s'en fera à leurs successeurs, elle se partage avec la plus parfaite équité; qu'il n'existe entre eux, en un mot, d'autres différences que celles qu'on ne saurait effacer, celles que la nature a mises entres leurs organes, et cette seule inégalité suffira pour en produire dans tout le reste, dans la richesse, dans les lumières, dans la moralité, dans la liberté.
Je peux bien supposer, à la rigueur, que ces hommes auront, en commençant, les mêmes ressources matérielles; mais je ne peux pas admettre qu'ils seront tous également capables d'en tirer parti. Ils n'auront pas le même degré d'activité et d'intelligence, le même esprit d'ordre et d'économie leur fortune commencera donc bientôt à devenir inégale. Ils n'auront pas le même nombre d'enfans; il pourra arriver que les moins laborieux et les moins aisés aient les familles les plus nombreuses : ce sera une nouvelle cause d'inégalité. Ces [I-460] inégalités, peu sensibles à une première génération, le seront bien davantage à une seconde, à une troisième. Bientôt il existera des hommes qui, n'ayant plus un fonds suffisant pour s'occuper et se procurer les moyens de vivre, seront obligés de louer leurs services. Les causes qui auront fait naître cette classe d'ouvriers tendront naturellement à l'augmenter; les ouvriers, en se multipliant, feront nécessairement baisser le prix de la main-d'œuvre. Cependant, quoique leurs ressources diminuent, ils continueront à pulluler; car un des malheurs inséparables de leur condition sera de manquer de la prudence et de la vertu dont ils auraient besoin pour user avec circonspection des plaisirs du mariage, pour ne pas jeter trop d'ouvriers sur la place, et ne pas travailler eux-mêmes à se rendre de plus en plus malheureux. Enfin, il est probable qu'ils se multiplieront assez pour que les derniers venus aient de la peine à subsister, et qu'il en périsse habituellement un certain nombre de misère.
Ceci sans doute arrivera plus tard dans l'état social que je me plais à supposer que dans un mode moins heureux d'existence; mais, dans le mode le plus heureux d'existence, cela finira toujours par arriver. L'absence de toute contrainte illégitime, la certitude de recueillir le fruit de son travail donneront probablement à la production, dans [I-461] le régime industriel, une impulsion très-vive, qui multipliera les ressources à mesure que s'accroîtra la population mais il sera fort à craindre que la population ne croisse plus rapidement encore que les ressources; on verra prospérer un beaucoup plus grand nombre d'hommes: mais il y en aura à la fin dont les facultés manqueront d'emploi; et l'on aura eu beau faire, au commencement, un partage égal du territoire et des autres ressources, et laisser à chacun la libre et pleine disposition de ses facultés, la seule différence de ces facultés amènera avec le temps, et par un enchaînement inévitable, un état où la société sera composée d'un petit nombre de gens très-riches, d'un très-grand nombre qui le seront moins, et d'un plus grand nombre encore qui seront comparativement à plaindre, et parmi lesquels même il pourra s'en trouver de très-misérables, absolument parlant.
Non-seulement l'état social que j'ai supposé n'empêchera pas la misère de naître, mais ce serait en vain qu'en la secourant on s'y flatterait de l'extirper. Tous les sacrifices qu'on pourrait faire pour cela, en procurant d'abord le soulagement de quelques infortunes particulières, auraient pour résultat permanent d'étendre le mal qu'on voudrait effacer. Partout où l'on a établi des modes réguliers d'assistance, partout où les pauvres ont pu compter sur des secours certains, on a vu croître [I-462] le nombre des pauvres, cela n'a jamais manqué [314] . On sait quelle populace de mendians est habile à faire éclore autour des couvens la charité monacale. La taxe des pauvres a élevé, dans l'espace de cent quinze ans, la population nécessiteuse de l'Angleterre du dixième au cinquième de sa population totale. Les fonds affectés à l'entretien de cette population, en 1815, ont été à ceux qu'on avait consacrés au même objet, en 1776, comme 81 est à 17. On a vu les contributions pour les pauvres se quadrupler dans l'espace de quarante ahs, et se doubler dans celui de vingt [315] . L'institution des hôpitaux a produit en France des effets analogues : l'administration des hospices de Paris, par exemple, a eu à assister, en 1822, près de sept mille indigens de plus qu'elle n'en avait assisté en 1786 [316] . On a des preuves innombrables de cette tendance des secours systématiques à multiplier le nombre des malheureux.
Une seule chose pourrait la réduire : ce serait que les procréateurs de cette misère sussent contenir la passion qui les pousse à la propager; ce [I-463] serait que les pauvres fussent plus en état de régler le penchant qui porte l'homme à se reproduire [317] . Or, j'ai déjà dit qu'un de leurs malheurs est d'être encore moins capables de cette prudence que les classes qui en auraient moins besoin. Cependant, s'il est un état où ils doivent en sentir la nécessité, ce sera sûrement celui dont je parle, et auquel je nous suppose arrivés. Dans cet état, en effet, l'indigent, comme les autres hommes, ne pourra compter, pour subvenir à ses besoins, que sur l'exercice légitime de ses forces. Il ne sera soumis à aucune injuste rigueur; mais il ne jouira non plus d'aucun privilège; les autres classes ne seront pas obligées de contribuer pour le soutenir; nul ne sera reçu à spéculer sur la charité publique; il n'y aura de secours que pour les infortunes non méritées; je suppose même que pour celles-ci ils ne seront qu'un objet d'espérance, comme le demande judicieusement Malthus: tout homme sera certain de subir la peine de sa paresse ou de son imprévoyance..... Eh bien! cette certitude n'empêchera pas qu'il n'y ait des hommes paresseux, imprévoyans, et par suite des hommes malheureux, ou tout au moins des hommes très-inégalement heureux.
§ 4. Voilà une des vérités les plus essentielles[I-464] que l'on puisse énoncer sur l'homme et la société. Cette vérité peut paraître triste; mais elle est malheureusement incontestable, et l'on ne pourrait la méconnaître sans de grands dangers. Lorsque Rousseau présente, d'une manière absolue, les inégalités sociales, et, par exemple, les inégalités de fortune, comme une chose de pure convention, comme l'effet d'un privilège accordé aux uns au détriment des autres [318] , il donne des choses une idée fausse; il avance une proposition absurde et anarchique. Il est bien possible sans doute que l'inégalité des fortunes soit l'effet de la violence; il n'est même que trop ordinaire qu'elle le soit, et si l'on me demandait d'expliquer les différences qui existent à cet égard dans le monde, je serais sûrement obligé de dire qu'une multitude d'iniquités privées et surtout de brigandages publics ont puissamment contribué à les faire naître. Mais s'il est vrai que l'inégalité des fortunes puisse être l'effet de la violence, il n'est pas vrai qu'elle ne puisse être l'effet que de la violence; il est certain, [I-465] au contraire, qu'elle résulte, à un haut degré, de la nature des choses, et qu'il faudrait commettre d'horribles violences pour l'empêcher de s'établir, pour l'effacer quand elle est établie, et, si l'on parvenait un moment à l'effacer, pour l'empêcher de se reproduire.
§ 5. Si l'on ne peut éviter que les hommes soient inégalement riches, on ne peut pas éviter davantage qu'ils soient inégalement industrieux, éclairés, moraux. C'est d'abord la différence d'industrie, d'activité, de bonne conduite qui introduit l'inégalité dans les fortunes [319] . Ensuite, l'inégalité de fortune et de bien-être est cause que tous les hommes ne peuvent pas posséder le même degré d'instruction, de capacité, de vertu. Il y a une action continuelle de chacune de ces causes sur toutes les autres ; les inégalités de toute sorte doivent ainsi nécessairement coexister; et de même que les fortunes, suivant [I-466] l'expression d'un économiste [320] , descendent, par des gradations insensibles, depuis la plus grande, qui est unique, jusqu'aux plus petites, qui sont les plus multipliées, de même le savoir, l'habileté, la vertu doivent aller en décroissant depuis les hommes les plus habiles, les plus savans, les plus vertueux, qui sont uniques chacun dans leur genre, jusqu'aux moins vertueux, aux moins savans et au moins habiles, qui sont partout les plus nombreux.
§ 6. Il faut ajouter que ces inégalités une fois établies tendent naturellement à se perpétuer; c'est-à-dire que la misère, l'ignorance et le vice sont des raisons très-fortes pour rester pauvre, ignorant et vicieux, et qu'il est d'autant plus malaisé de parvenir à un certain degré d'instruction, de moralité et de bien-être, que, pour s'élever à cet état, on prend son essor de plus bas.
[I-467]
S'agit-il, par exemple, d'acquérir du bien? moins on en a et plus la chose est difficile. On ne peut commencer à s'enrichir que lorsqu'il devient possible d'économiser; et comment songer à faire des épargnes, lorsqu'on n'a pas même de quoi satisfaire les premiers besoins? Dans les sociétés les plus prospères, il y a toujours un certain nombre d'hommes dont les facultés manquent absolument d'emploi. Il y en a beaucoup d'autres qui, en travaillant avec excès, gagnent à peine de quoi vivre. Ceux-là même dont les profits commencent à s'élever au-dessus des besoins ordinaires se déterminent difficilement à faire des économies ; ils regardent comme impossible de s'élever à une meilleure condition; ils ont rarement assez de force de tête et de volonté pour oser concevoir la pensée et poursuivre la résolution de parvenir à une certaine aisance. Que de difficultés pour eux en effet dans une telle entreprise! Combien de désavantages dans leur situation! Le moindre accident peut renverser l'édifice de leur petite fortune, et leur faire perdre en un instant le fruit de plusieurs années de fatigues et de privations. Un progrès dans l'industrie, l'introduction d'une machine, l'abandon d'une mode, vont rendre tout à coup leurs bras inutiles et les laisser plus ou moins long-temps sans travail.
Joignez que l'ouvrier, ayant un marché moins étendu que l'entrepreneur, a toujours quelque [I-469] désavantage dans les transactions qu'il fait avec lui. L'ouvrier ne travaille que pour l'entrepreneur, tandis que l'entrepreneur travaille pour le public. Un ouvrier en horlogerie, par exemple, ne peut offrir ses services qu'à des horlogers, tandis que l'horloger peut vendre ses montres à tout le monde. On sent combien est meilleure la position de ce dernier. Il est sûrement plus facile aux horlogers de s'entendre pour réduire le salaire de leurs ouvriers qu'au public de se concerter pour faire baisser le prix des montres.
Joignez encore que, dans le temps où son marché est plus resserré, ses nécessités sont plus urgentes, et que ceci donne à l'entrepreneur un nouveau moyen de lui faire la loi.
« Le maître et l'ouvrier, observe M. Say, ont bien également besoin l'un de l'autre, puisque l'un ne peut faire aucun profit sans le secours de l'autre ; mais le besoin du maître est moins immédiat moins pressant. Il est peu de maîtres qui ne pussent vivre plusieurs mois, plusieurs années même sans faire travailler un seul ouvrier; tandis qu'il est peu d'ouvriers qui pussent, sans être réduits aux dernières extrémités, passer plusieurs semaines sans ouvrage. Il est bien difficile que cette différence de position n'influe pas sur le réglement des salaires[321] . »
[I-469]
L'ouvrier devient-il, à son tour, chef d'entreprise? avec un fonds d'industrie inférieur au sien, le possesseur d'un grand capital matériel aura sur lui des avantages considérables. Par lui-même, sans [I-470] doute, un tel capital ne peut rien; mais il ajoute beaucoup aux pouvoirs de l'industrieux qui le possède. On sait que plus un homme a de richesse, et plus il lui est aisé d'en amasser. L'entrepreneur riche peut travailler plus en grand, et introduire dans ses travaux une meilleure division; il lui est plus aisé de faire les avances qu'exige l'emploi des moyens d'exécution expéditifs et économiques; il peut acheter à meilleur marché, parce qu'il a la facilité de payer comptant; les ressources qu'il a devant lui lui permettent de profiter des bonnes occasions qui se présentent, et de faire à propos ses approvisionnemens. Il a finalement mille moyens de réduire ses frais de production qui manquent au petit entrepreneur, et qui peuvent mettre celui-ci dans l'impossibilité de soutenir sa concurrence.
A la vérité, les petits entrepreneurs pourraient trouver dans la faculté de s'associer et d'unir leurs forces un moyen de diminuer le désavantage de leur position; mais, outre qu'il est rarement facile de fondre plusieurs petites entreprises en une grande, celles dans lesquelles il y aurait unité de vue, d'intérêt et de volonté, auraient encore un grand avantage sur celles où des intérêts différens pourraient introduire des vues et des volontés divergentes.
S'agit-il d'acquérir de l'instruction? L'homme des derniers rangs de la société n'est pas dans une [I-471] situation moins désavantageuse. Tout contribue à prévenir le développement de ses facultés, la nature de ses relations, la simplicité de ses besoins, la grossièreté et l'uniformité de ses travaux, le peu de loisir qu'ils lui laissent, la faiblesse des ressources qu'ils lui procurent. Aussi, quelque peine qu'il ait à s'enrichir, en a-t-il davantage encore à s'éclairer. Uniquement occupé du soin d'accroître ses moyens d'existence, il ne fait guère de progrès, même quand il est parvenu à un certain bien-être, que dans les idées relatives à son art; il reste étranger aux autres connaissances; il acquiert peu d'idées générales, ét lorsqu'il est devenu riche, il s'écoule encore bien du temps avant qu'il ait mis son esprit au niveau de sa fortune.
S'il est si difficile, en partant des derniers rangs de la société, de parvenir à la richesse et aux lumières, il n'est pas moins difficile de s'élever à un haut degré de moralité. Les bonnes habitudes privées et sociales sont le fruit d'un certain bien-être dont le pauvre ne jouit pas, et d'une certaine éducation qu'il n'est guère en position de recevoir. Les privations qu'il endure rendent ses appétits plus véhémens, et sa raison encore inculte l'avertit moins du danger qu'il y a de les satisfaire avec excès: il est donc plus difficile qu'il se conduise bien à l'égard de lui-même. D'une autre part, il est plus aigri par la difficulté de vivre; toutes ses passions [I-472] malfaisantes sont plus violemment excitées, et sa raison est, moins forte pour les contenir : il est donc plus difficile qu'il se conduise bien à l'égard des autres. Dans ses mœurs privées, il est plus sujet à l'intempérance, à l'ivrognerie, à l'incontinence; dans ses relations avec les autres individus, il est plus enclin au vol, au meurtre, à l'injure; dans ses rapports avec la société, il est plus disposé aux émeutes, aux rébellions, au pillage. Il est donc, sous tous les rapports, plus entraîné au mal, et, sous tous les rapports aussi, la réflexion l'avertit moins du danger qu'il y a de mal faire; double raison pour qu'il succombe plus aisément aux tentations et ait plus de peine à acquérir de bonnes habitudes morales.
§ 7. Ainsi, dans l'état social le plus exempt de violences, il serait très-difficile qu'il ne s'établît pas des inégalités dans les conditions; et lorsque ces inégalités sont une fois établies, il est encore plus difficile qu'elles s'effacent on ne parvient qu'avec des peines extrêmes d'une condition inférieure à un état un peu élevé, et les familles tombées dans un certain abaissement sont exposées à y rester par cela seul qu'elles s'y trouvent. Je ne dis pas qu'il soit impossible de se relever de cet état; mais cela, dis-je, est très-difficile, et le nombre des hommes qui en sortent est toujours petit en [I-473] comparaison de ceux qui y restent. D'ailleurs, s'il y a continuellement des familles qui s'élèvent, il y en a continuellement qui déclinent; s'il s'opère un mouvement constant d'ascension, il se fait un mouvement non moins constant de décadence ; tandis que le travail et les bonnes mœurs tirent les uns de l'abjection, le vice et l'oisiveté y font tomber les autres; les mêmes degrés ne sont plus occupés par les mêmes personnes, mais il y a toujours des gradations, et la société continue à présenter le spectacle d'une agrégation d'individus très-inégalement partagés du côté de la fortune, de la capacité, des mœurs, de l'instruction, de tout ce qui donne l'influence.
Toutes ces inégalités sont donc, dans un certain degré, des choses essentielles à notre nature; elles sont une loi de l'espèce humaine, elles sont aussi nécessaires dans l'ordre moral que les inégalités du sol dans l'ordre physique; il n'est pas plus étrange de voir des hommes inégaux dans la société que des arbres inégaux dans une forêt; ou bien de voir des hommes différens par la fortune, le savoir, la moralité, que des hommes différens par la figure, la taille, les proportions du corps, les facultés de l'ame.
En un mot, quoique le régime industriel tende à rendre les inégalités sociales infiniment moins sensibles, l'effet de ce régime n'est pas tant encore [I-474] de faire disparaître l'inégalité d'entre les hommes que de les classer autrement. Il tend à faire que les plus industrieux, les plus actifs, les plus sages, les plus honnêtes, soient aussi les plus heureux, les plus riches, les plus libres, et non à faire qu'ils soient tous également heureux, également riches, également libres, parce que cela n'est pas possible [322] .
§ 8. Non-seulement cela n'est pas possible, mais cela n'est pas désirable. On pourrait souhaiter que les hommes fussent mieux classés, mais non pas qu'ils fussent confondus. Il est sûrement bien [I-475] affligeant que la sottise, la violence, l'hypocrisie, aient encore parmi nous tant de moyens de conduire à la fortune et à la considération; mais non pas qu'il y ait des degrés dans la considération et la fortune. Les supériorités qui ne sont dues qu'à un usage plus moral et plus éclairé de nos facultés naturelles, loin d'être un mal, sont un véritable bien; elles sont la source de tout ce qui se fait de grand et d'utile ; c'est dans la plus grande prospérité qui accompagne un plus grand effort qu'est le principe de notre développement; rendez toutes les conditions pareilles, et nul ne sera intéressé à mieux faire qu'un autre; réduisez tout à l'égalité, et vous aurez tout réduit à l'inaction; vous aurez détruit tout principe d'activité, d'honnêteté, de vertu.
Enfin, le régime industriel est si loin d'exclure les inégalités sociales qu'il en implique au contraire l'existence, et que tout développement de l'industrie serait, à ce qu'il semble, impossible si les hommes étaient tous également heureux. L'action de l'industrie embrasse, comme l'enseigne l'économie politique, trois ordres distincts de travaux l'étude des lois de la nature, l'application de ces lois à des objets déterminés, l'exécution des ouvrages conçus. Il faut donc à la société industrielle trois classes distinctes de personnes : des savans, des entrepreneurs, des ouvriers. Or rendez toutes les conditions égales, supposez un [I-476] instant que tout le monde jouisse de la même fortune et de la même éducation, et la dernière de ces classes manquera; tout le monde naturellement voudra faire le travail du savant ou de l'entrepreneur; nul ne voudra s'abaisser au rôle de manœuvre ; ou bien chacun sera obligé de remplir les fonctions de savant, d'entrepreneur et d'ouvrier, ce qui rendra tout progrès impossible.
Sans doute l'avantage de l'industrie ne suffirait pas pour légitimer le partage violent de la société en entrepreneurs et en ouvriers, en riches et en pauvres ; mais prenez garde que ce n'est pas là non plus ce que je dis ce que je dis, c'est que ce partage, qui s'opère de lui-même, qui s'opérerait quoi qu'on fît pour le prévenir, paraît nécessaire pour que l'industrie puisse faire aisément toutes ses fonctions; et j'ajoute que lorsqu'il n'est pas l'œuvre de la violence, lorsqu'il provient uniquement de la différence d'activité, de capacité, de bonne conduite, il n'a rien que de conforme à la justice et de favorable au bien des individus et de la société.
Il ne faut pas croire que le partage égal des richesses entre tous les habitans, dans un pays comme la France, par exemple, améliorât sensiblement le sort des classes inférieures. L'avoir de celles-ci, par la spoliation des riches, serait à peine accru: on a calculé que nous aurions [I-477] chacun de deux cents à deux cent cinquante francs à dépenser par an. Encore faudrait-il cela que pour cela les établissemens d'industrie actuellement en rapport continuassent à subsister, et l'on ne voit pas trop comment cela serait possible; car, avec un revenu de deux cent cinquante francs, quels seraient les produits que chacun pourrait consommer, et que deviendraient les établissemens qui produisent tous ceux auxquels nous ne pourrions plus atteindre? Qui pourrait acheter, par exemple, des vêtemens un peu recherchés, des livres, des meubles passables? et que deviendraient les capitaux engagés dans les entreprises destinées à produire ces objets et une multitude d'autres ? Le capital national serait donc diminué de la valeur de tous les établissemens qui produisent les choses qu'on ne pourrait plus consommer, et par conséquent le revenu de chacun descendrait fort au-dessous du taux auquel nous l'avons fixé d'abord. Ensuite, quel stimulant resterait-il au milieu d'une population où chacun aurait le même revenu, quelle que fût d'ailleurs sa conduite? et quel effort pourrait-on obtenir d'hommes dont la position, quelques efforts qu'ils fissent, ne serait pas meilleure que celle des derniers citoyens? Visiblement, le projet d'améliorer le sort du grand nombre, en rendant les conditions égales, serait une entreprise insensée, une pure démence.
[I-478]
Au surplus, la question ici n'est pas précisément de savoir si le partage de la population en plusieurs classes est une chose utile; ce que je voulais surtout établir, c'est qu'il est inévitable; c'est que, dans l'industrie, les hommes sont autrement classés que sous l'empire de la force, mais qu'il y a toujours entre eux des gradations; c'est que les inégalités y sont moins sensibles, mais qu'elles y sont toujours très-réelles, et que les hommes y sont encore fort inégalement riches, instruits, éclairés, vertueux, etc.
§ 9. Ils y sont donc très-inégalement libres, la conclusion est forcée. Il y a un très-grand nombre de choses, impossibles aux hommes des conditions inférieures, qui sont faciles à des hommes de classes plus élevées et mieux élevées. Les premiers ne sont pas libres de satisfaire autant de besoins que les seconds, de se procurer autant de jouissances. Il y a une multitude de sentimens qu'ils ne sont pas susceptibles d'éprouver, de conceptions auxquelles leur esprit ne peut atteindre, de travaux et d'entreprises d'intérêt commun auxquels ils sont obligés de demeurer étrangers. Et dans l'état que je suppose ce n'est pas la violence des institutions qui les prive de toutes ces libertés, c'est leur propre impuissance; ils sont tout ce qu'ils peuvent être ; ils font tout ce qu'ils peuvent faire; [I-479] les institutions étendraient indéfiniment leurs droits, qu'elles n'ôteraient rien à leur faiblesse, qu'elles n'ajouteraient rien à leur capacité. Ils sont moins libres, parce qu'il ne leur est pas possible d'exercer une action aussi étendue ; ils sont moins libres aussi parce qu'ils ne sont pas capables d'agir d'une manière aussi bien entendue : leurs vices les rendent plus esclaves d'eux-mêmes; des inclinations malfaisantes les rendent plus esclaves des autres, les exposent à plus de vengeances particulières ou de châtimens publics. Autant, en un mot, il y a de différence entre la richesse, les lumières, la capacité, la moralité des classes et des individus, autant il y en a précisément entre leur liberté.
Je répète seulement que dans le régime industriel ces différences doivent être beaucoup moins sensibles que dans les états sociaux où elles sont favorisées par des institutions violentes. Il n'est pas douteux en effet qu'un régime qui laisse les choses à leur cours naturel, qui protège également tous les hommes dans l'usage inoffensif de leurs forces qui réprime seulement les excès, qui proscrit tous les monopoles, tous les privilèges, qui défend les faibles contre la collusion des puissans, aussi bien que les puissans contre les complots des faibles; qui n'oppose enfin aucun obstacle au progrès et à la diffusion des richesses et des lumières; il n'est [I-480] pas douteux, dis-je, qu'un tel régime ne doive faire que les lumières, les richesses, les bonnes habitudes privées et publiques ne se répandent avec moins d'inégalité, et que par suite les diverses classes d'hommes ne soient moins inégalement libres. Il y a moins de disproportion entre les classes les plus basses et les plus élevées : les premières sont moins misérables, les secondes ont des fortunes moins colossales. En même temps les rangs intermédiaires renferment un nombre beaucoup plus considérable de personnes aisées, instruites, morales et libres par conséquent. Il y a cela enfin que tout le monde est à sa place : nul obstacle ne contrarie dans son mouvement d'ascension celui qui a les moyens de s'élever; nul appui factice ne retient dans une condition supérieure celui qui n'est pas en état de s'y maintenir; et tandis que l'espèce peut parvenir à toute la liberté dont elle est susceptible, chaque homme jouit, eu égard à la condition où il est né, de toute celle dont il est digne.
§ 10. Je ne dois pas finir sans dire qu'il m'a été adressé, de plusieurs côtés, des réclamations très-vives, très- éloquentes, très-philanthropiques, contre ces conclusions.
D'une part, on s'accorde à reconnaître avec moi qu'il doit rester encore, dans le dernier état [I-481] social que je viens de décrire, de grandes inégalités; mais on ajoute que ces inégalités tiennent aux vices même de ce système, au principe de la compétition universelle, à l'isolement des travaux, au morcellement de l'industrie, etc. D'un autre côté, on nie la vérité même des résultats que j'énonce; on ne veut point convenir que, dans le régime industriel, tel que je le décris, il dut rester encore entre les hommes des inégalités aussi sensibles que je le prétends.
« Vous prouvez au mieux, m'écrit l'un de ces honorables contradicteurs, que les peuples qui ont le plus de forces, et qui disposent le mieux de leurs forces, sont ceux qui honorent le travail, qui créent le plus de richesses, qui acquièrent le plus d'instruction, qui perfectionnent le plus leurs habitudes morales. Mais, en définitive, vous avouez que le classement en entrepreneurs et en ouvriers, classement toujours tenu pour indéfectible, amènerait bon nombre des inconvéniens du classement en maîtres et en esclaves, en privilégiés et non privilégiés, en gens à places et gens sans place. En effet, le régime industriel pourrait bien n'aboutir qu'à substituer à la féodalité militaire, nobiliaire, administrative, une pure féodalité mercantile [323] . A coup sûr, si le sort des ouvriers de Manchester, Londres ou Rouen, est, absolument parlant, moins intolérable que celui des ilotes de Sparte, des esclaves des Romains, dè ceux des Turcs ou de ceux de nos colons, nos ouvriers à la journée ou à la tâche, nos domestiques, toujours si nombreux, et dont vous n'indiquez pas les moyens de se passer, sont, relativement, à pêu près aussi malheureux, quand, avec moins de sujétion sans doute, ils ont plus d'instruction et d'élévation d'ame. L'imagination, l'illusion, sont pour beaucoup, vous le savez, en affaires de bonheur et de malheur humain. Or, ces facultés, qui sont à peine éveillées chez le sauvage et chez l'esclave, sont excitées, dans nos sociétés perfectionnées, par une multitude de causes, par la lecture, par les spectacles, par notre luxe, par nos mœurs. Bref, on voit plus d'industrieux que d'esclaves ou de sauvages poussés par le désespoir à se donner la mort. »
La personne qui m'a fait l'honneur de m'adresser ces remarques, pense qu'il serait possible et même facile de remédier à ces maux par quelques changemens, assez simples suivant elle, dans le mécanisme social. J'avoue que je n'ai qu'une foi très-faible dans l'efficacité des moyens qui me sont indiqués. Cependant, comme je ne veux point condamner ce que je ne suis pas assuré de bien entendre, je renvoie le lecteur que ce débat pourrait [I-483] intéresser à l'ouvrage même que cette personne m'adresse ; il est intitulé : des Vices de nos procédés industriels, ou Aperçus démontrant l'urgence d'introduire le procédé sociétaire [324] . Ce travail est de M. J. Muiron, l'auteur même de la lettre dont je viens de citer un fragment, et qui a été inspirée par les sentimens les plus honorables.
D'un autre côté, sans chercher à effacer les inégalités sociales par des artifices d'organisation, on nie, tout uniment, que, dans le régime industriel, ces inégalités demeurassent aussi sensibles, et fussent aussi durables que je le pense. On ne croit point qu'il doive toujours y avoir au fond de la société une certaine masse de gens malheureux. Ici, comme partout ailleurs, observe-t-on, la raison la plus sévère se trouve d'accord avec la bienveillance la plus expansive. Il est bien possible que tous les hommes, dans la vie industrielle, ne pussent pas devenir également heureux, également riches, également libres; mais il est très-permis de croire que les moins heureux seraient pourtant dans une condition très-supérieure à celle des classes que nous nommons maintenant misérables. Il est dans la nature de l'homme de tout améliorer, non-seulement en lui, mais autour de lui. Il commence par fixer le bien où il se trouve, puis il [I-484] l'étend çà et là jusqu'à ce que tout s'en ressente. Nous voyons, de toutes parts, le travail mieux dirigé, les saines doctrines plus répandues, les richesses plus considérables et mieux distribuées. La civilisation ne concentre pas ses bienfaits sur une seule classe, elle les étend à toutes; il n'est pas de genre de perfectionnement dont les effets ne se fassent sentir jusque dans les derniers rangs de la société, etc. [325] .
Tâchons de nous entendre. Je ne dis sûrement pas qu'il soit impossible que le sort des classes inférieures devienne meilleur, que l'espérance de les voir sortir de leur état implique contradiction avec la nature des choses, que l'extinction de la mendicité soit un problème insoluble, que le pauvre soit enchaîné par des liens de fer à sa triste situation, qu'il soit condamné à des douleurs éternelles, à une misère indestructible. Je regarderais un tel arrêt non-seulement comme une erreur, mais presque comme un crime. Il n'y a que des dominateurs sans conscience et sans pitié qui puissent prêcher une certaine résignation aux misérables, et, par exemple, les exhorter à regarder leur misère comme [I-485] un état définitif, comme un état dans lequel l'auteur des choses a voulu qu'ils naquissent et qu'ils mourussent, eux et toute leur postérité, jusqu'à la consommation des siècles. Aussi, grace à Dieu, n'ai-je dit ni pensé rien de pareil.
Il y a pour les classes les plus malheureuses des moyens naturels et légitimes de s'élever à un meilleur état. Et il le faut bien; car comment expliquerait-on, sans cela, l'élévation de tant de familles qui se sont enrichies sans dépouiller personne? Ces moyens sont connus: c'est le travail, c'est la prévoyance, c'est une pratique constante de l'économie; ce serait surtout l'adoption, relativement au mariage, d'une morale plus sensée; ce serait une sévère attention de la part des familles ouvrières à ne pas trop multiplier le nombre des ouvriers; par suite, l'élévation du prix de la main d'œuvre ; par suite de cette élévation, le perfectionnement des machines; par suite de ce perfectionnement, l'extension d'une multitude de travaux; par suite de cette extension, une demande plus considérable d'ouvrage, des salaires plus élevés, l'application des forces de l'homme à des travaux moins rebutans et moins pénibles, etc. Je pourrais énumérer toute une série de moyens propres à élever les classes malheureuses, et à éteindre graduellement la mendicité.
Mais, soit que ces moyens n'aient encore été que [I-486] très-imparfaitement analysés, soit qu'il fût fort difcile, alors même qu'on le voudrait, d'en faire descendre la connaissance dans les dernières classes de la société, soit qu'il fût plus difficile encore de déterminer ces classes à les mettre en pratique, il est certain que la destruction de la misère est la chose du monde la moins aisée ; et la preuve, c'est qu'au milieu des progrès de la richesse sociale, le nombre des misérables s'est prodigieusement accru. On sait l'extension que la pauvreté a prise en Irlande, en Angleterre, et même, quoiqu'à un moindre degré, dans notre pays. Il y a plus de gens riches, sans doute; mais il y a surtout plus de gens pauvres, et la population nécessiteuse a suivi une progression infiniment plus rapide que la population aisée. On n'a pas oublié ce fait, publié il n'y a pas long-temps, que dans le nombre de personnes qui meurent annuellement à Paris, il y en a plus des quatre cinquièmes qui ne laissent pas de quoi payer leurs funérailles, et qui sont inhumées aux frais de la ville ou des hôpitaux [326] . Un voyageur [I-487] intelligent, qui a visité récemment la fabrique de Lyon, observe que, quoique la production s'y soit prodigieusement accrue, la population ouvrière n'y est ni plus heureuse ni plus riche qu'autrefois.
« Ces hommes précieux, » dit-il, parlant des ouvriers en soierie, sont presque tous vêtus de haillons. Entassés dans des habitations dégoûtantes, ils couchent pêle-mêle sur des grabats, et ne subsistent que d'une nourriture chétive [327] . »
On peut m'objecter, il est vrai, que tout ce qu'il existe aujourd'hui de misère s'est développé sous l'influence d'un ordre de choses très-différent de celui que j'ai décrit dans mon dernier chapitre. J'ai moi-même reconnu ailleurs [328] , que la misère actuellement existante avait eu ses principales causes dans la manière dont les choses ont commencé, dans le partage inégal qui s'est fait d'abord de la richesse, dans l'expropriation originaire des classes les plus nombreuses de la société, dans l'état de servitude où elles ont été retenues pendant des siècles et où elles se trouvent encore en beaucoup de pays, dans les impôts dont ailleurs on les écrase, dans les obstacles de toute espèce mis aux progrès de leur aisance et de leur instruction, dans les lois qui les empêchent de tirer de leur travail le meilleur parti possible, dans celles qui favorisent à leur [I-488] détriment des maîtres à qui leur position donne déjà tant d'avantage sur elles, dans des préceptes religieux qui bannissent toute prudence du mariage, dans des mesures politiques qui les provoquent à la population, dans des institutions de charité qui les dispensent de toute prévoyance, dans des maisons de jeu, des loteries et autres établissemens corrupteurs qui les détournent de l'épargne, et les excitent directement à la débauche et à la dissipation, dans des systèmes de pénalité et des régimes correctionnels qui ne sont propres qu'à achever de les corrompre, dans tout un ensemble de choses qu'on dirait combiné pour les tenir dans un état permanent d'ignorance, de misère et de dégradation.....
Mais l'état de ces classes ne tient pas seulement aux torts que peut avoir eus envers elles la partie supérieure de la société; il a aussi sa racine dans les vices qui leur sont propres, dans leur apathie, leur insouciance, leur défaut d'économie, dans leur ignorance des causes qui font hausser ou baisser le prix du travail, dans l'abus que leur grossièreté les porte à faire du mariage, dans le nombre toujours croissant de concurrens qu'elles se suscitent à elles-mêmes, et qui font baisser les salaires à mesure que les progrès de l'industrie et la demande toujours plus grande de main-d'œuvre tendraient naturellement à les élever. Je suis persuadé [I-489] que leur détresse est pour le moins autant leur propre ouvrage que celui des classes qu'on peut accuser de les avoir opprimées; et quand la société se serait établie originairement sur des bases plus équitables, quand les forts se seraient abstenus envers les faibles de tout esprit de domination, je ne doute point qu'il ne se fût développé au fond de la société une classe plus ou moins nombreuse de misérables.
Au surplus, quelles que soient les causes qui ont produit toute cette population nécessiteuse, c'est maintenant un fait qu'elle existe, et la question n'est pas de savoir si le régime industriel pourrait l'empêcher de naître, mais si elle parviendrait, sous ce régime, à une bonne condition; la question est de savoir si, dans un ordre de choses où rien ne favoriserait sa paresse, et où rien non plus n'enchaînerait ou ne découragerait son activité, il serait en son pouvoir de se tirer du triste état où elle se trouve. J'ai dit que la théorie indiquait pour cela des moyens; mais j'ai ajouté, et je répète,, que ces moyens sont, à l'application, d'une difficulté extrême. On a vu, dans le cours de ce chapitre, combien, avec la meilleure volonté, et par la seule force des choses, les hommes placés au dernier degré de l'échelle sociale devaient avoir de peine à s'élever à un certain état d'aisance et d'instruction. Une chose surtout contribue à les [I-490] détourner des efforts que réclame une semblable tentative, c'est l'idée que ces efforts seraient vains; et il est sûr que beaucoup de causes peuvent contribuer à les rendre inutiles. A quoi servirait, par exemple, à une famille d'ouvriers qui voudrait se tirer de la misère de n'user du mariage qu'avec la plus grande circonspection, si, à côté d'elle, une multitude de misérables continuait à peupler sans mesure, et de la sorte tenait constamment la main-d'œuvre à vil prix? A quoi servirait même que tous les pauvres d'un pays missent dans leur conduite la même sagesse, si on n'en faisait autant dans les pays environnans? N'a-t-on pas vu, dans ces dernières années, les classes ouvrières de certaines villes d'Angleterre menacées de perdre tout le fruit de leurs bonnes habitudes par l'apparition de ces bandes de pauvres affamés que l'Irlande jetait au milieu d'elles, et qui venaient offrir leur travail à peu près pour rien? Dans une situation aussi décourageante que celle où se trouvent les hommes des dernières classes, il n'y a que les individus les plus heureusement doués qui puissent avoir assez d'énergie pour concevoir la pensée de parvenir à un certain bien-être. Le reste perd souvent dans la misère jusqu'au désir de s'en tirer. N'avons-nous pas vu des serfs regarder la liberté comme onéreuse, et demander comme une faveur qu'on les retînt dans la servitude? N'arrive-t-il pas tous les [I-491] jours que des ouvriers refusent un supplément de salaire, à condition de faire un peu plus de travail? Est-il bien rare de les voir, alors même que leur tâche est des plus modérées, travailler un peu moins sitôt qu'ils peuvent gagner un peu davantage? Il ne faut pas croire que l'émulation, que l'activité, que le désir de conquérir par le travail une honnête aisance, soient des sentimens qu'il soit si aisé de faire naître dans les derniers rangs de la société [329] .
Conclusion:
Un état d'égalité parfaite entre les hommes est une situation impossible.
Un état où l'on verrait croître à la fois le nombre [I-492] des familles opulentes, celui des familles aisées, et surtout celui des familles misérables, est une situation non-seulement possible, mais réelle: c'est l'état où nous nous trouvons.
Un état où la misère se circonscrirait, où la population nécessiteuse s'accroîtrait moins, où l'aisance se répandrait davantage, est une situation réalisable, mais non encore réalisée : c'est l'état où nous devons tendre, c'est celui où l'on peut arriver sous le régime industriel, à mesure qu'on donnera une meilleure direction à l'exercice de ses forces, à mesure surtout que les classes ouvrières seront mieux instruites des causes qui peuvent les faire descendre ou monter.
Enfin un état où, sans que les hommes fussent égaux, on ne verrait plus du tout de misérables, est une situation qui n'offre rien d'absolument impossible, rien de contradictoire avec la nature des choses, mais à laquelle il paraît singulièrement difficile d'atteindre, et que le publiciste le plus philanthrope ne peut apercevoir, lorsqu'il ne cherche pas à se tromper lui-même, que dans l'avenir le plus reculé.
FIN DU TOME PREMIER.
Notes↩
[1] On peut voir par le titre de cet ouvrage, on a déjà vu dans la préface, et l'on verra mieux, plus loin, chap. Ier, ce que j'entends ici, et dans tout le cours de ce livre, par le mot liberté.
[2] Cette censure a été l'objet d'un reproche grave : « Ne découragez pas, m'a-t-on dit, les esprits positifs et les caractères énergiques qui se mettent à travers le torrent du mal pour retarder le cours. » ( Rev. encyclop., janv. 1825.) On ne saurait trop estimer les esprits positifs, ni trop honorer les caractères énergiques; mais si le mal vient du public, est-il positif qu'on peut l'arrêter en faisant la guerre à des noms propres ? et si cela n'est pas positif, est-ce faire un bon emploi de son énergie que de le combattre de cette façon ? Je ne voudrais sûrement pas décourager les hommes qui se dévouent pour empêcher le mal; mais je voudrais qu'un si beau dévouement ne fût pas en pure perte; je voudrais qu'on ajoutât au prix du sacrifice, en le rendant aussi fructueux qu'il est susceptible de le devenir. Or, se sacrifie-t-on aussi utilement qu'il serait possible de le faire? Cette question est assez importante pour mériter d'être examinée avec soin. J'y reviendrai à la fin de cet ouvrage, en répondant aux diverses objections qu'on a élevées contre les doctrines qu'il renferme, et notamment contre celle qui est énoncée dans cet alinéa.
[3] Cette remarque, depuis quelque temps, a perdu une partie de sa vérité: c'est un changement dans les idées auquel la publication de ce livre n'a pas été, j'ose m'en flatter, complètement inutile.
[4] Il y aurait à faire, sous le titre de Morale appliquée aux arts, quelque chose de très-neuf et d'éminemment utile. Je ne sais pas si l'on enseigne rien de semblable dans les écoles d'arts et métiers des départemens; mais je sais bien qu'il ne se fait, à Paris, de cours de ce genre dans aucun établissement public, et cela est sûrement très-regrettable. Je ne pense pas qu'il y ait d'enseignement que réclamassent davantage les besoins de l'industrie et des classes industrieuses.
[5] On a dit que, par cette manière d'envisager les choses, « je transportais la théorie politique hors de la sphère trop sujette à controverse des institutions, pour la ramener dans les termes beaucoup plus positifs de l'amélioration morale et industrielle de l'homme. » (Rev. encyclop., janv. 1825.) Il est très-vrai que je fais dépendre la perfection de la société de la perfection des arts et de celles des mœurs. Cependant il ne faudrait pas induire de là que je ne tiens pas compte des institutions, et que j'exclus le gouvernement des considérations de la politique. J'évite seulement de séparer le gouvernement de la société ; mais je considère la société dans son activité politique comme dans tous ses autres modes d'activité. Je la considérerai même dans celui-là avec plus de soin que dans aucun autre ; parce qu'il n'en est pas dans lequel il lui importe davantage de bien agir, et je montrerai qu'elle est d'autant plus libre qu'elle déploie à cet égard plus d'art et de moralité. Je ferai sur cet ordre de faits les mêmes raisonnemens que sur tous les autres. Voyez, tome III, chapitre 21 ce que je dis des industries politiques, et de l'influence que ces industries, les plus élevées de toutes, exercent sur la société.
[6] On sentira aisément, sans que je le dise, qu'en passant en revue ces divers âges de la société, ce n'est pas proprement une histoire de la civilisation que j'ai l'intention de faire. Mon seul dessein est d'examiner, dans leur ordre naturel, une série d'états sociaux, de manières d'être plus ou moins déterminées par lesquelles il me paraît qu'il est dans la nature de notre espèce de passer, à mesure qu'elle se développe, et de chercher quel est le degré de liberté que comporte chacun de ces modes généraux d'existence. Cela suffit pleinement à l'objet de mon travail, qui est de montrer comment l'espèce humaine devient plus libre à mesure que ses facultés deviennent plus parfaites et plus puissantes, à mesure qu'elle acquiert plus de morale et d'industrie.
[7] Les hommes ont droit d'etre libres! Autant j'aimerais dire qu'ils ont le droit d'être intelligens, actifs, instruits, prudens, justes, fermes, en un mot qu'ils ont le droit de réunir toutes les conditions d'où l'on sait que dépend l'exercice plus ou moins libre de leurs facultés. Les hommes ont sûrement le droit d'être libres... s'ils peuvent; mais l'essentiel est de savoir à quelles conditions cela leur est possible. L'abbé Raynal disait qu'avant toutes les lois sociales l'homme avait le droit de vivre. Il aurait pu, observe judicieusement Malthus, dire avec tout autant de vérité qu'avant l'établissement des lois sociales tout homme avait le droit de vivre cent ans. Il avait ce droit sans contredit, ajoute Malthus, et il l'a encore; il a le droit de vivre mille ans, s'il peut, etc.» (Essai sur le principe de la pop., liv. 4, c. 4. ) Mais quels moyens a-t-il d'assurer, de prolonger son existence? Voilà ce qu'il faudrait lui apprendre, et dont Raynal ne dit pas un mot. Il est vrai que ceci est moins facile que de proclamer emphatiquement le droit qu'il a de vivre, droit qu'on ne lui conteste pas, ou qu'il ne doit jamais supposer qu'on lui conteste.
[8] Tout effet, en un mot, tient de sa cause, et celui qu'on obtient par des déclamations ne vaut ordinairement pas mieux que les déclamations qui le produisent. On parvient sans doute par ce moyen à exciter les passions des hommes contre une domination injuste, à leur inspirer le courage nécessaire pour la renverser; mais le courage n'a de bons effets que lorsqu'il naît des lumières, et la seule manière vraiment utile de faire haïr l'injustice c'est d'éclairer sur ses effets.
[9] Dire que je ne me bornerai pas à parler des formes du gouvernement, ce n'est sûrement pas dire que je ne parlerai pas de ces formes. La manière dont la société s'ordonne pour agir n'est indifférente dans aucun ordre d'actions, et surtout elle ne l'est pas dans celui-ci. Je sais ce que peut une bonne organisation de la puissance publique; mais je sais aussi ce qu'il y a d'insuffisant et de trompeur dans les théories qui font venir toute liberté de là. C'est beaucoup sans doute que les pouvoirs publics soient bien constitués; mais ce n'est pas assez pour qu'ils agissent d'une manière éclairée et morale. Ensuite, quand une nation serait capable à la fois de bien organiser son gouvernement et de le faire bien agir, cela seul ne la ferait pas être libre. Sa liberté, en effet, ne vient pas uniquement de sa capacité politique, elle vient de toutes ses capacités. Il ne suffit donc pas de la considérer dans un seul de ses modes d'action; il faut, pour juger à quel point elle est libre, examiner ce qu'elle déploie dans tous d'intelligence et de moralité.
[10] Le mot liberté n'exprime jamais qu'une quantité relative. Il n'y a pas de liberté absolue. Tout être créé est soumis à des lois et ne peut agir que dans des limites fixes et précises. L'expression, libre comme l'air, dont on se sert quelquefois, comme pour désigner une liberté sans bornes, n'exprime qu'une liberté très-limitée : l'atmosphère est invinciblement liée à la terre; les vents sont soumis à d'irréfragables lois : l'air n'est donc pas indéfiniment libre. Nul corps matériel ne l'est. Les êtres animés ne le sont pas davantage, et l'homme ne l'est pas plus que le reste de la création. L'homme, ainsi que les animaux, ainsi que toutes les forces répandues dans la nature, n'est susceptible que d'une certaine espèce et d'une certaine étendue d'action.
[11] Économies royales.
[12] Élémens philosophiques du citoyen.
[13] Voyez la Revue protestante, premier cahier.
[14] Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, art. 1er.
[15] Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, art: 4.
[16] Bentham, Tactique des assemblées représentatives, t. II, p. 343, édition de 1822.
[17] Tactique des assemblées représentatives, t. II, p. 285.
[18] V. chap. IV, à la fin.
[19] Je dis ordinairement, parce que cette règle n'est pas sans exception. Aux Etats-Unis, par exemple, le développement de la capacité politique a précédé celui des autres capacités. On sait à quelles circonstances cela a tenu.
[20] Cette classification, qui appartient à Blumenbach (De gen. hum. variet. nativa), a été adoptée par W. Lawrence (Lectures on physiology, zoology and the natural history of man, p. 549 à 572). Elle n'est sûrement pas à l'abri d'objection; elle a, comme toutes les classifications, le défaut d'être plus ou moins arbitraire: on ne passe en effet d'une race à une autre que par des nuances imperceptibles. Elle peut d'ailleurs paraître incomplète, et il n'est pas douteux que chacune des variétés notées par Blumenbach n'en renferme un grand nombre de très-différentes. Mais outre que, dans l'état actuel de nos connaissances, il serait probablement impossible de faire une division exacte et complète du genre humain, celle que j'emploie est plus que suffisante pour l'objet que je me propose dans ce chapitre,
[21] W. Lawrence, p. 549 à 572.
[22] Law., p. 549 à 572.
[23] « The intellectual characters are reduced, the animal features enlarged and exagerated», dit W. Law. parlant de la tête du nègre. (Ouvr. cité plus haut, p. 363.)
[24] Law. et les auteurs qu'il cite, ib., p. 354 et 355.
[25] Ibid., p. 398.
[26] Poiret. Voyage en Barbarie, t. I, p. 31.
[27] Cité par Law., ib., p. 533.
[28] Id., ibid.
[29] Témoin la nation Juive, entre beaucoup d'autres.
[30] Cité par Law., p. 509.
[31] W. Lawrence, qui croit à l'unité originaire du genre humain, et qui a donné de cette opinion des raisons plus plausibles peut-être qu'aucun autre naturaliste ne l'avait fait avant lui, est le premier, si je ne me trompe, qui ait expliqué de cette façon la diversité des races humaines. On ne peut, suivant lui, assigner qu'une cause raisonnable à cette diversité : la survenance occasionnelle, accidentelle d'enfans nés avec des caractères particuliers et jusqu'alors inconnus, qui en font une variété nouvelle, et la perpétuation de cette variété par la génération. ( Voy. l'ouvrage cité, p. 300, 446, 510 et 515.)
Lawrence avoue que, dans l'état actuel de la science, on n'a aucun moyen d'expliquer ces survenances inattendues de nouvelles races; mais l'expérience démontre, dit-il, qu'elles sont possibles, et il en cite de nombreux exemples. Il rapporte, entre autres, celui d'un homme appelé Edouard Lamberg, né dans le comté de Suffolk, à qui l'on avait donné le sobriquet de Porc-Épic, parce qu'il avait tout le corps, moins la face, la tête, la plante des pieds et l'intérieur des mains, couvert d'excroissances assez analogues à celles dont le porc-épic est revêtu. C'était comme une sorte de verrues noires, d'une substance cornée, longues d'environ un pouce, serrées les unes contre les autres, raides, élastiques et résonnantes.
Cet homme fut présenté, en 1731, à la société royale de Londres. Il se maria et eut six enfans, tous porcs-épics de naissance, comme lui. Un seul de ces enfans vécut. Il se maria à son tour, et transmit à ses descendans le trait caractéristique de sa race. On a vu, en Allemagne, les deux enfans qu'il eut, John et Edouard Lamberg: ils avaient l'un et l'autre la peau recouverte des mêmes excroissances que leur père et leur aïeul.
Or, supposons maintenant, dit Lawrence, que, par l'effet de circonstances quelconques, cette famille se fût trouvée reléguée dans une île déserte, et s'y fût perpétuée par la génération : elle aurait formé dans l'espèce une variété bien plus différente de nous que ne le sont les nègres; et si, plus tard, cette ile avait été découverte, on n'aurait pas manqué de dire que c'était l'air, le sol, le climat qui en avaient ainsi défiguré les habitans; ou bien on aurait soutenu que c'était une espèce qui n'avait pu provenir d'aucune autre, une espèce originairement différente, et nul de nous sans doute n'aurait voulu reconnaître pour parente une race d'hommes poncs-épics. ( Ibid., 448 à 451.)
[32] Voilà, mot pour mot, ce que je disais dans la première édition de ce volume, et voici comment s'exprime M. B. Constant dans l'examen critique qu'il a bien voulu faire de mon travail, t. 29, p. 427 de la Rev. Encyclop. : « D'ailleurs ce système ( le système de la diversité des races) est faux en ceci que, s'il y a des races plus parfaites, toutes les races sont susceptibles de perfectionnement. » Que dis-je autre chose? Est-ce que je nie que toutes les races ne soient perfectibles? Non; j'affirme le contraire. J'ajoute seulement que toutes ne me paraissent pas perfectibles au même degré.
[33] Dec. 1, lib. 9, cap. 5.
[34] Tableau des États-Unis, t. I, p. 447.
[35] D'après les comptes présentés aux chambres en 1826, par le ministre de la guerre, sur 1,043,422 jeunes gens convoqués devant les conseils de révision, il y en a eu 380,213, fort au-delà du tiers, de réformés, parce qu'ils n'avaient pas la faible taille de 4 pieds 10 pouces. (V. le Courrier Français du 20 juillet 1827.)
[36] Voir les exemples rapportés par Blumenbach, de gen. var. nat., et ceux qu'ajoute Lawrence, p. 494 et 498 de l'ouvrage déjà cité. Voir aussi l'intéressant ouvrage de M. Grégoire sur la littérature des nègres.
[37] Adelung dit, en parlant de la Chine et des contrées voisines de ce vaste empire : « Les peuples de ces immenses régions retiennent encore dans leur langage toutes les imperfections d'une langue qui vient de naître. Comme les enfans, ils n'articulent que des monosyllabes. Ils parlent comme ils parlaient il y a plusieurs milliers d'années, quand l'espèce était encore au berceau. Nulle division des mots en plusieurs classes, comme cela a lieu dans toutes les langues; confusion pleine et entière des personnes et des temps; nulle inflexion des mots; nulle distinction des cas et des nombres; on forme le pluriel, ainsi que le forment les enfans, en répétant plusieurs fois le même nombre, comme trois et encore trois, trois et plusieurs autres, etc. (Mithridate, p. 18.) Un langage aussi imparfait, continue le même auteur, rend tout progrès impossible; et tant que les Chinois n'en parleront pas d'autre, ils feraient de vains efforts pour s'approprier les arts et les sciences de l'Europe.» (Ib. p. 28, cité par Law. p. 471.)
[38] Note sur la Virginie, traduction française, p. 206 à 208.
[39] W. Law., ouv. cité, p. 554.
[40] « Dans un siècle où l'on discuta formellement si les Indiens étaient des êtres raisonnables, dit M. de Humboldt, on crut leur accorder un bienfait en les traitant comme des mineurs, en les mettant à perpétuité sous la tutelle des blancs, et en déclarant nul tout acte signé par un natif de la race cuivrée, toute obligation que ce natif contracterait au-dessus de la somme de 15 fr. Ces lois se maintiennent dans leur pleine vigueur; elles mettent des barrières insurmontables entre les Indiens et les autres castes dont le mélange est généralement prohibé. Des milliers d'habitans ne peuvent faire des contrats valables ( no pueden tratar y contratar). Condamnés à une minorité perpétuelle, ils deviennent à charge à eux-mêmes et à l'État dans lequel ils vivent. » ( Essai polit. sur la Nouvelle-Espagne, t. I, p. 433.
[41] V. ci-dessus p. 72.
[42] V. plus bas p. 105 et suiv.
[43] Traité de législation, t. III, liv. 1v, ch. 10, 11, 12 et 13.
[44] On verra cela plus loin, ch. xii.
[45] Rev. Britannique, tom. 14, pag. 38.
[46] Voir la première édition de ce volume, publiée sous le titre de l'Industrie et la Morale, etc., p. 159 et suiv.
[47] Rapports du physique et du moral de l'homme, neuvième mémoire. Influence des climats, etc.: V. l'introduction de ce mémoire et les paragraphes 3 et 5.
[48] V. ci-dessus p. 58 et suiv. C'est un point sur lequel j'avais insisté dès la première édition de ce volume, et qu'on doit à Lawrence d'avoir mis hors de contestation.
[49] Traité de Législation, t. II, p. 113 et 228; t. III, p. 243, 257, 271, 296, 353, 487.
[50] La presque totalité du Mexique jouit d'un climat tempéré, Dans la région que les indigènes appellent tierras templadas, pays tempérés, la chaleur moyenne de toute l'année est de 20 à 21°; et dans la zone à laquelle ils donnent le nom de tiérras frias, pays froids, on jouit d'une température moyenne de 12 à 13o, égale à celle de la France ou de la Lombardie. La chaleur n'est très-forte que vers les côtes, dans des terrains bas et entrecoupés de collines peu considérables. Encore, dans cette partie comparativement peu étendue du Mexique, la température ne s'élève-t-elle qu'à 25 ou 26o du thermomètre centigrade, 8 ou 9° au-dessus de la chaleur moyenne de Naples. (V. Malte-Brun, Précis de la Géogr. Univ., t. V, p. 457 et suiv. de la 2o édit. ).
[51] Personne n'ignore que le même phénomène s'observe sur la pente des montagnes, à mesure qu'on s'élève à des régions plus froides. On peut, au Mexique, sans changer de degré de latitude, voir passer sous ses yeux les productions de toutes les zones, depuis celles des tropiques jusqu'à celles de la zone glaciale. Il suffit pour cela de s'élever, de plateau en plateau, jusqu'à la région des neiges éternelles.
[52] On peut trouver un certain nombre d'exceptions dans l'ouvrage de M. Comte, et l'auteur ne les cite pas toutes.
[53] Précis de la Géograph. Univ., t. V, p. 445.
[54] Il est assez de points de l'ancien et du nouveau monde où l'on a la preuve que la température s'est graduellement adoucie pour qu'on soit fondé à supposer qu'il en a été de même partout, et surtout dans tous les pays où la terre a été cultivée, s'il est vrai, comme il est encore permis de le croire, que la culture a pour effet d'adoucir le climat. V. plus loin p. 116 et 117.
[55] Malte-Brun, Précis de la Géog. Univ., t. VI, p. 78, 2o éd.
[56] Précis de la Géograp. Univ., t. III, liv. 46, p. 21 de la 2o éd.
[57] Esprit des lois, liv. 18, ch. 3, 4 et 9.
[58] Traité de Législation, t. II, liv. 3, ch. 8, p. 173.
[59] V. dans la Rev. Brit., t. 2, p. 223 et suiv., un article curieux sur les progrès que l'horticulture a faits en Angleterre,
[60] Précis de la Géog. univ., t. VL, p. ret 20
[61] Malte-Brun, en disant que la puissance organique dont la nature est douée, n'a pas agi, dans l'origine, sur un seul point du globe, et qu'un grand nombre de végétaux, en Europe, pourraient se passer de l'honneur d'une origine étrangère, avoue pourtant que les migrations de l'homme ont singulièrement favorisé l'extension géographique des plantes, et que l'Europe dans l'origine était dans un grand dénuement de plante et d'animaux utiles. Rapprochez de ce qu'il dit, t. 2, liv. 42, p. 504 de son Précis, ce qu'il ajoute p. 505, et ce qu'il dit encore t. VI, p. 1 et 2.
[62] Précis de la Géog. univ., t. VI, p. 2 et 3.
[63] Dictionnaire Philos., au mot climat.
[64] Il ne serait pas exact de dire, d'une manière générale, ainsi qu'on le fait quelquefois, que l'influence du climat est d'autant plus grande que l'homme est moins civilisé : cette influence est plus grande sans doute dans ce qu'elle a de pernicieux, mais non pas dans ce qu'elle a d'utile; les influences salutaires sont au contraire d'autant plus faibles que l'homme est moins en état d'en tirer parti, d'autant plus faibles qu'il est plus inculte.
[65] Rapports du physique et du moral de l'homme: Influence des climats, § xvi.-M. de Tracy fait une observation analogue dans son commentaire de l'Esprit des lois.
[66] V. l'Histoire des expéd. marit. des Norm., t. II, p. 197. Paris, 1826. — V. aussi le Mémorial portatif de chronologie, etc., I" partie, au mot Poissons, p. 578 de l'édit. de 1829.
[67] V. le Mémorial, idib., p. 581 et 582.
[68] On peut voir dans l'ouvrage de M. Comte, t. 3, liv. 4, ch. 5, p. 333 et suiv., quelles sont ces circonstances particulières dont l'Angleterre a su si habilement profiter. J'en avais indiqué une partie dans la première édition de ce volume, et surtout dans le cours que je fis à l'Athénée en 1826, lorsque je traitai du commerce et des diverses causes auxquelles sa puissance se lie: V. plus loin, t. 2, chap. 17 de cet écrit. M. Ch. Dupin, dans son ouvrage sur les forces productives de la Grande-Bretagne, avait fait voir aussi combien la terre et les eaux sont heureusement disposées en Angleterre pour l'exercice de l'industrie commerciale. M. Comte joint à des remarques du même genre des considérations sur la température habituelle de ce pays et sur ses mines de charbon de terre, qui achèvent de montrer ce que peuvent, pour la puissance d'une nation, un petit nombre de circonstances favorables, lorsqu'elles sont vigoureusement exploitées.
[69] Genèse, chap. 5.
[70] Ibid. chap. 11, verset 10 et suiv. La vie humaine, après le déluge, a déjà décru de près de moitié.
[71] M. Cuvier explique fort bien à quoi a pu tenir l'illusion qui faisait supposer aux anciens que l'homme allait ainsi perdant toujours de sa force et de sa taille.« Il est probable, observe cet illustre naturaliste, qu'on a pris souvent des os d'éléphant pour des os humains, et que ce sont eux qui ont occasioné toutes ces prétendues découvertes de tombeaux de géans dont parle si souvent l'antiquité.» (Recherches sur les ossemens fossiles). M. Cuvier cite, à ce sujet, une multitude d'auteurs anciens qui parlent tous d'ossemens monstrueux qui avaient été déterrés par diverses causes, et qu'on a pris tantôt pour ceux d'Oreste, tantôt pour ceux d'Entelle ou d'Otus, tantôt pour ceux d'Antée ou d'autres héros ou géans. «De tout temps, observe un autre géologiste, on a trouvé des ossemens d'éléphans fossiles; mais ces ossemens jusqu'ici avaient presque toujours été méconnus, et c'est à leurs découvertes qu'on doit les histoires fabuleuses de la mise à nu des cadavres d'anciens géans: car, dans un temps où l'anatomie avait fait si peu de progrès, l'amour du merveilleux pouvait d'autant mieux s'emparer de pareils événemens pour accréditer des idées qui frappent l'imagination, que l'éléphant est, aux dimensions près, un des animaux dont le squelette présente le plus de ressemblance avec celui de l'homme. On ferait un volume entier des histoires d'ossemens fossiles de grands quadrupèdes que l'ignorance ou la fraude ont fait passer pour des débris de géans humains. » (Lettres sur les Révolutions du globe, par Alex. Bertrand, p. 169. Paris, 1824.)
[72] Discours sur l'influence des sciences et des arts.
[73] De la Religion, etc., t. I, p. 236 et la note. Cette citation m'a attiré plusieurs reproches. M. de Constant s'est plaint, premièrement, de ce que j'avais fait figurer son nom dans une liste où se trouvent des ennemis de la civilisation; secondement, de ce que je n'avais pas cité fidèlement ses paroles; troisièmement, de ce que j'avais conclu de ses paroles qu'il voudrait que la civilisation pût reculer (Revue Encyclop., cahier de fév. 1826, p. 419, 420). N'est-ce pas moi, ici, qui aurais quelque sujet de me plaindre? Je ne conclus absolument rien des paroles de M. de Constant; je ne mets pas le moins du monde en doute ses sentimens en faveur de la civilisation; je me borne à faire connaître le jugement qu'il porte de ses effets. Or, ce jugement, c'est qu'une longue civilisation énerve les hommes, c'est que lorsque l'espèce humaine arrive à une civilisation excessive, elle paraît dégradée durant plusieurs générations. L'auteur ajoute, il est vrai, que cette dégradation n'est que passagère, et que l'espèce, se remettant ensuite en marche, arrive à de nouveaux perfectionnemens. Mais cette restriction ne détruit certainement pas l'idée principale, et M. de Constant n'en a pas moins dit qu'une longue civilisation nous énerve et nous dégrade, au moins passagèrement. J'aurais pu trouver des phrases de ce genre dans une multitude d'auteurs: si M. B. Constant est un de ceux que j'ai cités de préférence, c'est que rien n'était plus propre à montrer la force du préjugé que j'entreprenais de combattre, que de faire voir que ce préjugé n'avait pas encore perdu tout empire, même sur les esprits les plus élevés.
[74] Du Renouvellement intégral, broch. in-8°, novemb. 1823,
[75] De l'état de l'Angleterre au commencement de 1822, p. 132.
[76] De la monarchie française en 1816, p. 450.
[77] Réquisitoire de M, Bellart dans l'affaire de la Rochelle. Voir le Moniteur du 14 juin 1822.
[78] Réquisitoire de M. de Marchangy dans la même affaire. Voir les journaux de la fin d'août et des premiers jours de septembre
[79] Voir, dans les journaux du commencement de décembre 1822, une lettre de l'empereur Alexandre à M. de Marchangy.
[80] Je ne puis point admettre, avec M. de Constant, que le mot de civilisation n'ait impliqué les idées d'honneur, de morale, d'humanité, de sociabilité que dans l'origine, et qu'il ait perdu cette acception en arrivant jusqu'à nous (Rev. Encyclop., cahier de fév. 1826, p. 121 et 123). Lorsqu'on oppose un peuple civilisé à un peuple sauvage, ce sont leurs mœurs encore plus que leurs arts qu'on cherche à faire contraster : c'est par les mœurs surtout qu'on est civilisé ou barbare; et toutes les fois qu'un peuple se rend coupable de quelque trait de perfidie ou de cruauté: ce sont là, observe-t-on, les pratiques de la barbarie : ce n'est point ainsi qu'en usent les nations civilisées.
[81] L'expression de société fidèle à son gouvernement est une expression qui ne semble pas trop convenable. La société a sans doute le devoir d'être fidèle à la raison, à la justice; mais il paraît choquant de dire qu'elle doit fidélité à ses délégués, à ses gens, aux hommes qu'elle charge d'une portion quelconque de ses affaires. Cependant, si l'on veut transporter à la société une vertu qui est surtout le devoir de ses ministres, je dirai que les sociétés fidèles ce ne sont pas celles qui approuvent tout ce que fait le gouvernement, mais celles qui n'approuvent que ce qu'il fait de bien, qui l'empêchent courageusement de mal faire, qui s'efforcent de le soustraire à l'influence des mauvais conseils.
Un gouvernement aurait beau être animé des intentions les plus honorables, si la masse des bons citoyens restait indifférente à sa conduite, il serait presque impossible qu'il se conduisit bien. La foule des ambitieux et des intrigans ne s'endort pas en effet comme le public. Moins le public se soucie de ses affaires et plus les intrigans les prennent à cœur. Ils investissent le gouvernement, l'envahissent, l'obsèdent, le subjuguent; ils s'en servent comme d'un instrument; ils lui font entreprendre à leur profit les choses les plus condamnables; ils le poussent, de violence en violence, jusqu'à lasser la patience universelle; et la société qui, par un respect mal entendu, n'avait pas voulu d'abord le contenir, se trouve, la fin, entraînée quelquefois à le détruire.
[82] En même temps que les lois encourageront le mouvement des arts et de l'industrie comme principe de prospérité pour l'État, l'opinion s'empressera de le châtier comme source de dépravation pour les mœurs.» (Montlosier, de la Monarchie française en 1816, p. 314.)
[83] Réquisitoire déjà cité, de M. de Marchangy.
[84] On le verra, en partie, plus loin, ch. 75
[85] V. dans les journaux français du commencement de janvier 1825, le message dont il est ici question,
[86] Pour vous, peuples modernes, vous n'avez pas d'esclaves, mais vous l'êtes...» (Rousseau, Contrat social, liv. 3, ch. 15.)
[87] Histoire philosophique et polit. des deux Indes, liv. 15 p. 20.
[88] Discours sur l'origine de l'inégalité.
[89] Discours sur l'origine de l'inégalité.
[90] Discours sur l'origine de l'inégalité.
[91] Voyage de découvertes aux terres autrales, t. I, p. 464.
[92] V. ce que dit là-dessus, d'après les relations des meilleurs voyageurs, l'auteur de l'Essai sur le principe de la population, t. I, ch. 3 et 4.
[93] Je néglige les fractions.
[94] Dans ces épreuves, les Anglais établis au port Jackson firent avancer l'aiguille du dynamomètre jusqu'à 71 degrés. Mais Péron observe que cette différence à l'avantage des Anglais pouvait tenir à celle de l'état de santé où se trouvaient les individus des deux nations, dont les uns, établis dans leurs foyers et parfaitement dispos, jouissaient de la plénitude de leurs forces, tandis que les autres descendaient à peine de leurs vaisseaux, à la suite d'une navigation très-longue et qui avait été excessivement fatigante.
[95] V. t. I, p. 472 à 475, de son voyage, tout ce qu'il cite de faits et d'autorités à l'appui de cette assertion.
[96] Hist. phys., civ. et mor. de Paris, t. II, p. 661 et 662, 1 er éd.
[97] On a fait la remarque, observe un écrivain anglais, que la plupart des artistes, des poètes, des philosophes qui ont le plus honoré l'humanité étaient d'une faible complexion. Pope fut forcé, par sa constitution débile, de vivre constamment au foyer domestique; Pascal, Fontenelle, Samuel-Johnson et beaucoup d'autres hommes d'un esprit éminent ont passé leur vie dans un état habituel de souffrance. Walter-Scott, lord Byron, autres exemples d'une haute intelligence dans un corps chétif. On serait tenté de croire que la faiblesse physique est généralement compensée par un plus grand développement des facultés intellectuelles, et par l'habitude, en quelque sorte indispensable, de la méditation. Nous sommes convaincus que cette persévérance dans l'étude qui a distingué James Watt, pendant la durée de sa longue et pénible carrière, doit être attribuée, en grande partie, à la faiblesse de son tempérament. (Rev. Brit., t. 2, p. 217. Notice sur James Watt.)
[98] Le mémoire de M. Villermé a été lu à l'Académie des sciences le 29 novembre 1824. On en peut voir des extraits dans la 64o liv., p. 169, de la Rev. encyc. Voici encore quelques-unes des observations qu'il renferme et qui toutes viennent à l'appui de la proposition principale, que la civilisation accroît la durée moyenne de la vie. Autrefois le nombre des morts l'emportait sur celui des naissances, aujourd'hui celui des naissances l'emporte de beaucoup sur celui des morts. Il meurt beaucoup plus de monde parmi les pauvres que parmi les riches : la proportion est du tiers à la moitié, c'est-à-dire que sur un nombre de pauvres qui n'est que d'un tiers plus grand, la quantité des morts est double. Il naît beaucoup plus d'enfans parmi les pauvres que parmi les riches, et il s'en conserve beaucoup plus parmi les riches que parmi les pauvres. Toutes les fois que le peuple vient à souffrir, quelles qu'en soient les causes, le nombre des morts augmente, celui des naissances diminue, et la durée moyenne de la vie devient plus courte. Toutes les fois, au contraire, que le peuple est heureux, le nombre des décès diminue, celui des naissances augmente, et la durée moyenne de la vie s'accroît. — La durée plus longue de la vie moyenne, au temps où nous sommes, tient aux progrès de la civilisation, à l'aisance devenue plus générale, à un air plus salubre, à une meilleure éducation physique des enfans, à une meilleure tenue des hôpitaux, à une administration publique plus éclairée, etc., etc.
M. Finlaison, archiviste de la dette publique anglaise, a consigné, dans un ouvrage de statistique, ce fait important que la durée de la vie a été tellement prolongée en Angleterre, dans le cours du dernier siècle, que le terme moyen à cet égard est aujourd'hui au terme moyen il y a cent ans comme quatre est à trois. V. la Rev. Brit., t. II, p. 372.
[99] Voyages de découv. aux terres australes, t. I, p. 463 et suiv.
[100] Second voyage, t. II, p. 137.
[101] Lettres édif., citées par Montesquieu.
[102] Voy. notamment ce que Péron et d'autres voyageurs racon. tent de la manière dont se nourrissent quelquefois les peuples de la Nouvelle-Hollande.
[103] Voy. Malthus et les voyageurs qu'il cite, Essai sur le principe de la pop., liv. I, ch. 4.
[104] Emile, liv. 2.
[105] Robertson, Hist. d'Amér., liv. 4.
[106] En Amérique, dit Robertson (ib.), de petites sociétés de sauvages chasseurs de deux ou trois cents personnes occupent souvent des pays plus considérables que certains royaumes d'Europe, et quoique très-éloignées les unes des autres, ces petites nations sont dans des guerres et des rivalités perpétuelles.
[107] Voici quelques traits des mœurs privées de l'homme au premier âge de la civilisation. — VORACITÉ. Lorsque les naturels de la Nouvelle-Hollande ont tué un phoque, dit Péron, « des cris de joie s'élèvent de toutes parts; on ne pense plus qu'à la curée; les féroces vainqueurs se groupent autour de leur victime; on la déchire de tous les côtés à la fois; chacun mange, dort, se réveille, mange et dort encore. L'abondance avait réuni les tribus les plus ennemies entre elles, les haines paraissaient éteintes ; mais dès que les derniers lambeaux corrompus de leur proie ont été dévorés, les ressentimens se réveillent et des combats meurtriers terminent ordinairement ces dégoûtantes orgies. Il y a quelques années que, dans les environs du port Jackson, une double scène de cette nature cut lieu entre les naturels du comté de Cumberland, à l'occasion d'une baleine énorme qui y avait échoué, et sur les ossemens de laquelle ils s'entr'égorgèrent. » (Voyage de découv. aux terres australes, t. II, p. 50.)
IVROGNERIE « La police, dans la capitale de Mexico, dit M. de Humboldt, fait circuler des tombereaux pour recueillir les ivrognes que l'on trouve dans les rues; ces Indiens, que l'on traite comme des corps morts, sont menés au corps de garde principal; on leur met le lendemain un anneau de fer au pied, et on les fait travailler pendant trois jours à nettoyer les rues. En les relâchant le quatrième jour, on est sûr d'en saisir plusieurs dans la même semaine.» M. de Humboldt ajoute que les Indiens montrent le même penchant à l'ivrognerie dans les pays chauds et voisins des côtes, et il trouve que leur grossièreté se rapproche, pour ainsi dire, de celle des animaux. (Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, t. I, p. 393.)
INCONTINENCE. Le sauvage a peu de penchant à la volupté. C'est l'effet des rigueurs de sa condition, de la faim qu'il endure, des fatigues énervantes qu'il supporte. Les naturels de la terre de Diémen, dit Péron, ne comprenaient aucun des signes par lesquels nous manifestons nos sentimens affectueux. Les baisers, les caresses, l'action d'embrasser leur paraissaient des choses inintelligibles et tout-à-fait surprenantes. On a fait des remarques analogues sur la froideur des indigènes de l'Amérique et d'un grand nombre de peuples sauvages. Mais le sauvage est froid sans être continent; et partout où une condition moins dure le rend plus propre aux plaisirs de l'amour, la licence de ses mœurs est excessive. Les indigènes de l'Amérique, suivant Robertson, n'attachent aucun prix à la chasteté des femmes. John Heckwelder dit qu'elles sont peu fécondes, et avoue que cela tient à la vie dissolue qu'elles mènent depuis qu'elles font usage des liqueurs fortes. (Hist., mœurs et coutumes des six nations, etc., p. 354. )
OISIVETÉ. C'est de tous les vices de l'homme inculte celui qu'il a le plus de peine à vaincre. Il y tient à la fois par inclination et par préjugé. Notre vie active lui paraît basse et servile. (Francklin, OEuv. mor.) Il n'y a, suivant lui, de dignité que dans le repos. Aussi, lorsqu'il n'est pas engagé dans quelque entreprise de guerre ou de chasse, passe-t-il son temps dans une inaction absolue, n'enviant d'autre bien que de ne rien faire, et restant des jours entiers couché dans son hamac ou assis à terre dans une stupide immobilité, sans changer de position, sans lever les yeux de dessus la terre, sans articuler une parole. (Bouguer, Voyage au Pérou, p. 102.)
IMPRÉVOYANCE. La famine a beau châtier la paresse du sauvage et l'avertir de la nécessité du travail, elle ne le rend ni plus actif ni plus industrieux. Il subit, sans fruit pour ses mœurs, toutes les conséquences de ses vices, et la centième expérience est aussi perdue pour lui que la première. Le sauvage, dit Robertson, ne songe à bâtir une hutte que lorsqu'il y est contraint par la rigueur du froid, et si le temps s'adoucit tandis qu'il a la main à l'œuvre, il laisse sa tâche imparfaite, sans songer que la froidure puisse jamais revenir. Lorsque le Caraïbe a dormi, il donnerait son hamac pour une bagatelle; le soir il sacrifierait tout pour le recouvrer, et le lendemain il le donnerait encore pour rien, sans penser à ses regrets de la veille. ( Hist. d'Amér., liv. 4.)
Je pourrais, sur tout cela, multiplier à l'infini les citations et les exemples.
[108] « They acted from affection, as they acted from appetite, without regard to its consequences. (Essai on the civ. soc., p. 130, Basil.)
[109] Voy. Péron et les voyageurs qu'il cite, t. I, p. 468 de sa relation.
[110] Ibid., p. 252 et 253. -Les femmes sont les esclaves de la vie sauvage; elles forment la classe ouvrière de cet état; elles exécutent presque tout ce qui s'y fait de travail utile. Partout où il y a un commencement d'agriculture, ce sont elles ordinairement qui labourent la terre, qui sèment et récoltent le grain, qui l'écrasent et le préparent (John Heckwelder, ouv. cité, p. 236 et 237; Robertson, Introduct, à l'hist. de Charles V, t. II, note 18; Hist. d'Amér., liv. 4.) Elles font sécher la viande, préparent les peaux, ramassent les racines pour la teinture ( Heckwelder, ib., p. 240 ). Ailleurs, elles vont à la pêche pour leurs maris ( Péron, t. I, p. 254). Dans les voyages, elles portent les enfans en bas âge, les ustensiles et tout le mobilier (Heckwelder, p. 237). Tout ce qu'elles produisent est la propriété du mari (ib. p. 242 ). Elles n'ont pas même toujours part au fruit de leur travail. Péron raconte que, dans une entrevue qu'il eut avec les naturels de la Nouvelle-Hollande, il vit les hommes se partager le poisson que leurs femmes avaient pris, et le manger sans leur en rien offrir ( t. I, p. 252 à 256 ). Elles préparent le repas de leur mari; elles le balancent dans son hamac quand il a mangé. Elles ne mangent point, en général, avec lui. Dans certains pays, elles ne participent même pas aux jeux auxquels il semblerait le plus naturel de les admettre, par exemple à la danse. M. de Humboldt, parlant de celles de l'Amérique méridionale, observe qu'elles auraient plus de vivacité que les hommes, dont le chant est lugubre et mélancolique; « mais, dit-il, elles partagent les malheurs de l'asservissement auquel ce sexe est condamné chez tous les peuples où la civilisation est encore très-imparfaite elles ne prennent point part à la danse; elles y assistent seulement pour présenter aux danseurs des boissons fermentées, qu'elles ont préparées de leurs ́mains. » ( Essai pol, sur la Nouv.-Esp. t. I, p. 424). Humiliation et fatigue, tel est partout leur lot dans la vie sauvage. Ce qui caractérise surtout cet âge de la société, c'est l'état de dégradation auquel les femmes y sont réduites. ( Roberts., Hist. d'Amér. liv. 4. )
[111] Robertson, Hist. d'Amér., liv. 4.
[112] Dans la vie sauvage, on mange, ou, tout au moins, on tue ses ennemis : l'action de les asservir appartient, comme on le verra, à une époque moins barbare.
[113] Premier voyage, t. III, p. 45.
[114] Malthus, Essai sur le principe de la pop., t. I, ch. 4.
[115] Hist. d'Amér., liv. 4 .
[116] Troisième voyage, t. I, p. 124.
[117] Hist. d'Am., liv. 4.
[118] Quoiqu'on se serve de ce mot pour désigner indistinctement tous les peuples sans établissement fixe, il s'applique particulièrement aux peuples pasteurs, comme son étymologie l'indique, et c'est dans cette acception restreinte qu'il est pris ici.
[119] Esp. des lois, liv. 18, ch. 14.
[120] Esp. des lois, liv. 18, ch. 19.
[121] ibid.
[122] Observat. sur l'hist. de France, t. I, p. 158; in-12, 1782,
[123] Esprit des lois, liv. 18: des lois dans les rapports qu'elles la la ont avec nature du terrain. Chap. 18 du même liv. de la longue chevelure des rois francs.
[124] Liv. 17, ch. 6.
[125] , Liv. 18, ch, 1.
[126] V. le Voyage de Benj. Bergmann chez les Calmoucks,
[127] , Esprit des lois, liv. 18, ch. 4.
[128] Voy. dans Péron, t. I, p. 468 et suiv., combien ces excès sont fréquens dans la vie sauvage. Ils ne sont plus tolérés dans la vie nomade: « Numerum liberorum finire, aut quemquam ex agnatis necare flagitium habetur.» (Tac.Mœurs des Germ., c. 19.)
[129] C'est dans la vie nomade que commence à s'introduire l'usage des compositions, qui permet d'entrevoir un terme aux dissensions et aux guerres particulières.
[130] Liv. 2, ch. 2.
[131] Tac. Mœurs des Germ., ch. 16.
[132] Mœurs des Germains, c. 17. — Guerres des Gaules, 1. 6.
[133] Mœurs des Germ., il.
[134] Tome II, p. 455.
[135] Mœurs des Germ., ch. 26.
[136] Ib., ch. 23 et 26.
[137] « C'est moins la richesse du sol qu'un certain degré de sécurité, observe judicieusement Malthus, qui peut encourager un peuple à passer de la vie pastorale à la vie agricole. Lorsque cette sécurité n'existe point, le cultivateur sédentaire est plus exposé aux vicissitudes de la fortune que celui qui mène une vie errante et emmène avec lui toute sa propriété. Sous le gouvernement des Turcs, à la fois faible et oppressif, il n'est pas rare de voir les paysans abandonner leurs villages pour embrasser la vie pastorale, dans l'espérance d'échapper plus aisément au pillage de leurs maitres et à celui de leurs voisins. (Ess, sur le principe de la pop., t. I, p. 177.).
[138] Arva per annos mutant...... Tacite., Moeurs des Germains, C. 26.
[139] De Bello gall., liv. 6, ch. 21.
[140] Litterarum secreta viri pariter ac feminæ ignorant. Tac., Mœurs des Germ., ch. 19.
[141] Id., ch. 5 et 6.
[142] Voyage en Syrie, t. I, p. 339.
[143] Pallas, Voyage en Russie, t. III, p. 272 à 274.
[144] Il n'y a point à cet égard, dans leurs mœurs, la contradiction que croit y remarquer Tacite (Mœurs des Germ., ch. 15). L'indolence et l'impétuosité des Germains étaient deux excès qui naissent l'un de l'autre, et qui tenaient tous deux à la manière de vivre de ces peuples.
[145] Ib., ch. 23.
[146] Ib., ch. 22.
[147] L'Edda, fab. 20, trad. par Mallet, introd. à l'histoire de Danemarck.
[148] Mœurs des Germains, ch. 24.
[149] Mœurs des Germ., ch. 18.
[150] Gibb., t. II, p. 76. — Voltaire, Essai sur les mœurs, t. I, p. 218. « Tacite, dit Voltaire, loue les mœurs des Germains, comme Horace chantait celles des barbares, nommés Gètes. L'un et l'autre ignoraient ce qu'ils louaient, et voulaient seulement faire la satire de Rome. Le même Tacite, au milieu de ses éloges, avoue que les Germains aimaient mieux vivre de rapines que de cultiver la terre, et qu'après avoir pillé leurs voisins, ils passaient leur temps à manger et à dormir. C'est la vie des voleurs de grand chemin d'aujourd'hui et des coupeurs de bourse. Et voilà ce que Tacite a le front de louer... »
[151] Malthus, Essai sur le principe de la pop., t. 1, p. 173 de la trad. - Chez les Barbares, dit Aristote, la femme et l'esclave sont confondus dans la même classe (Polit. liv. 1 ch. 1, § 5). Chacun, maître absolu de ses fils de ses femmes, leur donne à toutes des lois... (Homère, cité par Arist. ib., § 7; trad. de M. Thurot.)
[152] Fergusson, Essai sur l'hist. de la soc. civ., p. 161; édit. de Båle, angl.
[153] Mœurs des Germ., ch. 25.
[154] Ib., ch. 7.
[155] Fergusson; Hist de la soc. civ., p. 156.
[156] Ib., p. 150 et 151.
[157] Fergusson, p. 162. « In the rude ages, the persons and properties of individuals are secure; because each has a friend, as well as an ennemy; and if the one is dispose to molest, the other is ready to protect. »
[158] Voy. la peinture animée que Gibbon, t. X de son histoire, fait des dissensions furieuses et interminables des Arabes bédouins.
[159] Ce sont deux choses fort différentes, comme le fait très-bien voir Malthus. Il peut y avoir excès de population dans les pays les moins peuplés: il suffit pour cela qu'il y ait plus d'hommes que de vivres.
[160] C'est cette facilité avec laquelle une certaine population se renouvelle et se déplace, dans la vie pastorale, qui a fait supposer si long-temps que le Nord était autrefois plus peuplé qu'aujourd'hui. La connaissance des vrais principes de la population a permis à Malthus de réfuter victorieusement cette erreur. Il prouve sans peine que le Nord, à une époque où il était encore couvert de bois et de marais, ne pouvait pas renfermer une population bien nombreuse; mais en même temps il montre que la population devait s'y élever rapidement au niveau des moyens de subsistance, et fournir bientôt à l'esprit entreprenant des barbares le moyen de tenter de nouvelles expéditions, qui, à leur tour, laissaient la place libre pour des générations nouvelles, et préparaient de loin de nouvelles invasions. (Voy. son ouv., t. F, ch. 6.)
[161] Pendant le cours des huitième, neuvième et dixième siècles, les nations de l'Europe réputées aujourd'hui les plus puissantes par les armes et par l'industrie avaient été livrées comme sans défense aux constantes déprédations des Normands. « A la fin, dit Malthus, elles crurent en force, et parvinrent à ôter aux peuples du Nord toute espérance de succès dans leurs futures invasions. Ceux-ci cédèrent lentement et avec répugnance à la nécessité, et apprirent à se renfermer dans leurs propres limites. Ils échangèrent peu à peu leur vie pastorale ainsi que le goût du pillage et l'habitude des migrations, pour les travaux patiens du commerce et de l'agriculture, qui, en les accoutumant à des profits moins rapides, changèrent imperceptiblement leurs mœurs et leur caractère. » (Essai sur le princ. de la pop., t. I, p. 155 et suiv. de la trad. fr.)
[162] Hist. de la déc. de l'emp. rom., t. X de la trad., édit. de Guizot.
[163] Plutarque, Vie de Marius; et Taciet, Mœurs des Germ., ch.7 et 8.
[164] ESSAIS, des Cannibales.
[165] Quod cum audisset Abram, captum videlicet Lot, fratrem suum, numeravit expeditos vernaculos suos trecento decem et octo, et persecutus est Dan. (Genes., cap. 19, vers. 14.)
[166] M. Comte paraîtrait ne point adopter cette idée. Il pose en fait que la civilisation s'est d'abord développée dans les pays les plus favorables à la culture, et il semble supposer qu'elle s'y est développée librement, qu'il n'y a point eu d'abord d'esclaves, que tous les hommes s'y sont livrés au travail; mais que l'industrie ayant fait naître chez eux des qualités différentes de celles qu'il faut pour se livrer à la guerre, ils n'ont pu se défendre ensuite contre de peuples placés dans des circonstances moins favorables et qui avaient conservé les habitudes et les talents de la barbarie. De là, suivant M. Comte, l'origine de l'esclavage. Il a été d'abord l'œuvre de la civilisation, qui ensuite a réagi contre lui, et peu à peu est devenue assez forte pour le détruire.
Que la culture ait commencé dans les pays qui lui étaient le plus favorables, je n'ai nulle peine à en convenir; que la population de ces pays ait ensuite été subjuguée par des peuples demeurés barbares, je le reconnais de même sans difficulté. Mais il ne me paraît pas, à beaucoup près, aussi certain que les premiers travaux de la civilisation aient été faits par des mains libres, et que, chez les premiers peuples un peu civilisés qui ont été subjugués par des barbares, tout le monde jouît de la liberté. Les peuples les premiers asservis n'avaient-ils pas eux-mêmes des esclaves? Existe-t-il quelque coin de la terre où l'industrie se soit d'abord librement développée, et où les hommes assez forts pour en contraindre d'autres au travail aient consenti à travailler eux-mêmes? Je ne le pense point. Il me paraîtrait au contraire que l'industrie est née partout sous l'influence de la contrainte; que dans les premières sociétés civilisées il n'y a eu de travailleurs que les hommes faibles, tandis que les hommes forts se sont maintenus en armes au-dessus de la société, et que les premiers conquérans n'ont subjugué que des populations qui avaient déjà des maîtres. Il y avait très-probablement des esclaves chez les petits peuples d'Italie que subjuguèrent d'abord les Romains; ils en trouvèrent chez les Gaulois; il y en avait chez les Germains; ils en trouvèrent chez les Grecs: je demande s'il a jamais existé de société nouvellement fixée au sol, de société naissante qui ait exercé les arts et fait de l'agriculture sans esclaves?
[167] Contrat social, liv. 3, 15.
[168] Id., ib.
[169] Voltaire dit en parlant de Gengis-Kan : « Dans ses conquêtes il ne fit que détruire, et si l'on excepte Boccara et deux ou trois autres villes dont il permit qu'on relevât les ruines, son empire, des frontières de la Russie à celles de la Chine, fut une dévastation. » ( Ess. sur les Mœurs, ch. 60.)
[170] Tout ce que demandaient les Romains c'était de forcer leurs ennemis à se rendre. Aussi condamnaient-ils ceux qui posaient les armes à un esclavage moins rigoureux que ceux qu'ils prenaient sur le champ de bataille ou après l'assaut d'une ville. Les premiers, qu'ils appelaient dedititii, conservaient une espèce de liberté, les seconds étaient vendus comme esclaves. ( Tit.-Liv., liv. 5, ch. 22, et liv. 7, ch. 31.)
[171] Avant les Romains, l'Italie, la Grèce, la Sicile, l'Asie Mineure, l'Espagne, la Gaule, la Germanie étaient pleines de petits peuples et regorgeaient d'habitans..... Toutes ces petites républiques furent englouties dans une grande, et l'on vit insensiblement l'univers se dépeupler... « On me demandera, dit Tite-Live, où les Volsques ont pu trouver assez de soldats pour faire la guerre, après avoir été si souvent vaincus. Il fallait qu'il y eût un peuple infini dans ces contrés, qui ne seraient aujourd'hui qu'un désert, sans quelques SOLDATS et quelques ESCLAVES romains.—Les oracles ont cessé, dit Plutarque, parce que les lieux où ils parlaient « sont détruits : à peine trouverait-on aujourd'hui dans la Grèce trois mille hommes de guerre.—Je ne décrirai point, dit Strabon, l'Épire et les lieux circonvoisins, parce que ces pays sont entièrement déserts. Cette dépopulation qui a commencé depuis long-temps, continue tous les jours de sorte que les soldats romains ont leur camp dans les maisons abandonnées. » Strabon trouve la cause de ceci dans Polybe, qui dit que Paul Emile, après sa victoire, DÉTRUISIT SOIXANTE ET dix villes de L'ÉPIRE, ET EN EMMENA CENT CINQUANTE MILLE ESCLAVES... On eût dit que les Romains n'avaient conquis le monde que pour l'affaiblir et le livrer sans défense aux barbares. » (Montesquieu, Esprit des lois, liv. xxvIII, ch. 18, 19 et 23.)
[172] Antiquités rom. d'Adam, t. II, p. 389 de la trad. fr.
[173] Id., ibid.
[174] Ibid.
[175] Id., p. 389 et 390.
[176] Essais, t. I, 2e partie, Essai x1, p. 434.
[177] V. les Antiquités rom. d'Adam.
[178] Depuis le règné de Numa jusqu'à celui d'Auguste, dans un intervalle de sept cents ans, le temple de Janus ne fut fermé que deux fois, la première sous le consulat de Manlius, à la fin de la première guerre punique, et la seconde sous Auguste même, après la bataille d'Actium. (Tit.-Liv., I, 10,)
[179] Denis d'Halicarnasse, l. 2, c. 3, § r.-Tit.-Liv., I, 42 et 43.
[180] Tite-Live, III, 20; XXII, 38
[181] Les censeurs étaient d'anciens généraux qui avaient passé par tous les grades de l'armée. Ils étaient pris ordinairement dans les familles consulaires. ( Tite-Live, IV, 8; VII, 22.)
[182] Hommes illustres de Plut., vie de Marc. Cat.
[183] Senatu ejiciebant, equum adimebant, tribu movebant, ærarium faciebant. (Tit.-Liv.)
[184] Cic., pro Cacina, 34. Tit.-Liv., IV, 53.
[185] M. de Constant trouve qu'en ayant l'air ici de réfuter Condorcet, M. de Sismondi et lui-même, je ne fais réellement que m'emparer de leurs idées. Il me semble, ne lui en déplaise, que c'est là redresser ses prédécesseurs et non les piller. Je ne suis d'accord avec M. de Constant ni sur le but qu'il suppose à l'activité des anciens peuples, ni sur le sens des institutions par lesquelles il prétend qu'ils tendaient à ce but. Il croit qu'il s'agissait pour les Romains de liberté politique: je crois qu'il s'agissait de conquêtes à faire, de brigandages à exercer. Il croit que c'était pour être libres politiquement qu'ils avaient renoncé à toute indépendance individuelle je crois que c'était pour être plus forts comme armée. Quel rapport y a-t-il entre ses idées et celles que je développe ? S'il ne s'était agi pour les anciens que de jouer, en quelque sorte, à la souveraineté nationale, que de s'amuser à faire des lois et à rendre des jugemens, ils n'auraient pas eu besoin pour cela de se soumettre à tant de gênes, à tant d'institutions tyranniques : ils auraient pu, comme nous, faire servir l'activité politique à protéger l'indépendance privée. Mais il s'agissait de guerroyer, d'envahir des territoires, de subjuguer des populations, et pour cela on ne pouvait trop resserrer les individus, ni soumettre le corps entier des citoyens à une discipline trop sévère.
M. de Constant trouve très-ingénieuse la distinction que j'ai faite, suivant lui, entre la liberté des modernes et celle des anciens. C'est lui qui a fait cette distinction, non pas moi. J'aurais pu parler de la domination des anciens, mais non de leur liberté. Je ne crois pas qu'il soit possible, en aucun sens, de soutenir que les peuples anciens fussent des peuples libres. Les anciens étaient libres comme ces tyrans qui ne peuvent dormir qu'en s'entourant de gardes et de sentinelles, ou bien comme ces corps de troupes, placés en pays ennemi, et qui ne peuvent avancer qu'en ayant le plus grand soin d'éclairer leur marche, de ne marcher que l'arme au bras, et de se tenir bien unis, bien serrés, bien disciplinés. Mais je m'aperçois que j'anticipe sur ce que je vais avoir à dire.
[186] Plut., vie de Marc. Cat.
[187] V. plus loin chap. xi.
[188] Bentham, Traité de Législation, t. II, p. 183 et suiv.
[189] Essai XI, p. 504.
[190] Antiquités romaines, t. II, 429.
[191] Sismondi, Nouv. Princ. d'Éc. pol. tom. I, p. 113.. Des enquêtes faites par les soins de l'Angleterre nous montrent à quel point l'esclavage est funeste à la population dans les colonies. A Tortola, à Démérari, à la Jamaïque, la population noire diminue continuellement et ne peut être maintenue au même niveau que par la traite. La perte moyenne, pour toutes les colonics anglaises, moins la Barbade et les îles de Bahama, est de dix-huit mille esclaves tous les trois ans. Et la preuve que ce décroissement de la population noire tient uniquement à son état de servitude, c'est qu'elle fait des progrès considérables à Haïti depuis qu'elle y est affranchie. Au commencement de la révolution française, la population totale de cette dernière île n'était que de six cent soixante-cinq mille ames, et malgré la suite d'expéditions sanglantes qui l'ont dévastée depuis cette époque jusqu'en 1809 où l'expédition française a été expulsée, la population s'y élève maintenant à plus de neuf cent trente-cinq mille ames. (Voy. l'Edimburg review de juillet 1825.
[192] Voici ce que dit un habile peintre de mœurs, parlant des montagnards d'Écosse, à une époque où la guerre était encore leur principale industrie : « Waverley ne pouvait en croire ses yeux; il ne pouvait concilier cette singulière voracité (des montagnards) avec ce qu'il avait entendu dire de leur vie frugale; il ignorait que leur sobriété n'était qu'apparente et forcée, et que, semblables à certains animaux de proie, les montagnards savaient jeûner au besoin, se réservant de se dédommager de cette abstinence lorsqu'ils en trouveraient l'occasion. » (Waverley, ou l'Écosse il y a soixante ans.) Voilà la frugalité que nous admirons chez les premiers Romains et dans les temps héroïques de la Grèce : c'est ce que nous appelons du beau antique. Les mœurs que décrit ici Walter-Scott sont tout-à-fait dans le goût de celle des héros d'Homère.
[193] Proles secum ipsa discors. (Tite-Live. )
[194] Antiquités rom. d'Adam, t. I, p. 163 et 164.
[195] Hist. de la décad. de l'emp. rom., t. I, ch. 2.
[196] Ibid. Ant. rom., t. I, p. 56.
[197] Annales, XIV, 42.
[198] Esp. des lois, liv. 15, ch. 16.
[199] V. plus loin, ch. 12.
[200] Causes de la grandeur et de la décadence des Romains, passim.
[201] Un de mes critiques, le Producteur, s'est fort récrié contre cette explication du régime économique des Romains et des conséquences de ce régime. Il ne voit, quant à lui, dans le long effort de ce peuple pour conquérir le monde, qu'une immense entreprise de philanthropie, qu'une vaste et noble tentative en faveur de la civilisation. La grande tâche qu'avait embrassée son génie était conforme au besoin le plus général de l'humanité; elle était la condition nécessaire de tous les progrès ultérieurs, etc. De sorte que c'était pour assurer les progrès ultérieurs de la civilisation que les Romains commençaient par l'étouffer partout où elle avait pris naissance, qu'ils détruisaient une multitude de petites républiques en Italie, qu'ils renversaient Carthage, qu'ils subjuguaient la Grèce, qu'ils massacraient des millions d'hommes, qu'ils en réduisaient un plus grand nombre encore en servitude. Il y avait au fond de tout cela, suivant le Producteur, une grande pensée philanthropique. Les Romains étaient animés des sentimens généraux qui dominaient de leur temps, et la seule chose qui les distingue des autres peuples de cet âge, c'est d'avoir conçu plus virilement les passions qui régnaient alors. (V. le Prod., t. II, p. 462 et suiv.)
On trouve une grande preuve de cette philanthropie qui présidait aux guerres des Romains dans l'expédient dont s'avisa l'honnête, le probe, le sévère Caton, pour faire décider cette troisième guerre punique qui amena la finale destruction de Carthage. Notre vieux censeur, qui connaissait son monde, au lieu de se perdre en vaines paroles, imagina de lâcher au milieu du sénat une ample provision de superbes figues, qu'il avait apportées de la côte d'Afrique et qu'il tenait cachées dans le pan de sa robe. « Et comme les sénateurs, observe Plutarque, s'esmerveilloient de voir de si belles, si grosses et si fresches figues : la terre qui les porte, leur dit Caton, n'est distante de Rome que de trois iournées de navigation. » Cette manière'philanthropique de motiver le delenda Carthago par lequel le même honnête homme terminait tous ses discours, est tout-à-fait dans le goût de la morale de ces sauvages d'Afrique, qui, lorsqu'ils veulent faire la guerre à quelque peuple voisin, se répandent en éloges des richesses qu'il possède, et se décident d'après la valeur plus ou moins grande du butin qu'ils pourront faire chez lui. (V. le voyage du major Gordon-Laing dans le Timani, le Kouránko et le Soulimana, p. 275 et suiv. de la traduction française.)
[202] Rien de și étrange que la faveur dont jouissent auprès des classes industrieuses de nos sociétés modernes ces fiers républicains de l'antiquité, dont le premier principe politique était qu'il fallait tenir dans l'esclavage tout homme livré à l'industrie. Ces classes ne feraient-elles pas mieux de se passionner pour les seigneurs féodaux du moyen âge? La méprise, à mon avis, serait moins forte. Ces seigneurs, il est vrai, n'étaient pas aussi beaux parleurs que les nobles citoyens d'Athènes au temps de Périclès, ou de Rome à la fin de la république; mais ils n'étaient peut-être pas aussi ennemis des classes laborieuses; ils ne les tenaient pas aussi abaissées, ils ne méprisaient pas autant leurs travaux; je ne sais s'ils avaient au même degré les préjugés de la barbarie. Il y a dans la politique du citoyen Aristote et dans la république du philosophe Platon des principes que n'oserait pas avouer l'aristocrate le plus renforcé de nos monarchies les plus absolues.
[203] Voy. les notes de M. Jefferson sur la Virginie, p. 212.
[204] L'état moral et religieux des blancs (à la Jamaïque) est, comme celui des noirs, aussi mauvais qu'on puisse l'imaginer. Presque tous les blancs attachés aux plantations vivent publiquement en concubinage avec des négresses ou des femmes de couleur: sous ce rapport, la corruption est générale. Au lieu d'être appelées aux saints devoirs de la maternité, les jeunes esclaves sont livrées, dès l'âge le plus tendre, et prostituées par leurs maîtres aux amis auxquels ils veulent se rendre agréables. Sur vingt blancs qui débarquent dans la colonie, il y en a dix-neuf dont le moral est ruiné avant qu'ils y aient fait un mois de séjour... Parmi les esclaves, le mariage n'a point de lois; les femmes disent qu'elles ne sont pas assez folles pour s'en tenir à un seul homme; aussi leurs engagemens avec l'autre sexe ne sont que temporaires et n'ont à leurs yeux rien d'obligatoire... Tout étranger qui vient rendre visité à un planteur et qui couche chez lui, est dans l'habitude, au moment d'aller au lit, de se faire amener une jeune négresse avec aussi peu de cérémonie qu'il demanderait une bougie; et lorsqu'il n'en demande pas on lui en propose, c'est une politesse d'usage. Ainsi des actes auxquels, dans toutes les sociétés civilisées, les libertins les plus déhontés ne se livrent qu'à l'ombre du mystère, se commettent au su de tout le monde, et sont de mode au sein même des plus honorables familles. » (De l'État actuel de l'esclavage aux États-Unis et aux Antilles, par Cooper. Cet ouvrage me manque, et je le cite d'après la Rev. Brit., t. 7, p. 129.)
[205] Notes sur la Virginie, pag. 212. La cruauté des traitemens qu'on a presque toujours fait subir aux hommes asservis tient à la nature particulière de cette espèce de serfs, beaucoup plus généreux et plus difficiles à soumettre que les autres animaux voués à la servitude domestique. A la rigueur, un maître peut traiter humainement son cheval, son chien, son âne: il n'a pas à craindre que ces esclaves-là se concertent et se révoltent; mais il ne saurait être aussi tranquille sur la soumission des êtres semblables à lui qu'il tient dans l'asservissement: comme leur nature est plus noble, il sent qu'il a plus à faire pour les subjuguer, et il les traite avec inhumanité précisément parce qu'ils sont des hommes. Il est tel propriétaire d'esclaves qui passerait avec raison pour un fou furieux, digne d'être à jamais interdit, s'il s'avisait de traiter ses bêtes comme il lui arrive de traiter ses gens.
[206] Servi autem ex eo appellati sunt quod imperatores captivos vendere, ac per hoc servare, nec occidere solent. Justin., Instit. lib. I, tit. 3, § 3.
[207] Cod. théod. lib. 9, tịt. 9, 1. I.
[208] V. le cours d'hist. mod. de M. Guizot, 1828-1829; t. 1, p. 71 à 73, et p. 80; et M. de Montlosier, de la Monarch. franç. t. 1.
[209] Hist. de la décad. de l'emp. rom.; traduct. franç., édit. de Guizot, t. 1, p. 80 et suiv.
[210] Hommes illustres, vie de Lucullus.
[211] Hist. de la décad. de l'emp. rom., tr. franç., édit. de Guizot, t. 1, p. 85.
[212] « Il faut recommander aux maîtres des hommes en servage, disait Charlemagne dans ses Capitulaires, d'agir avec douceur et bonté avec leurs hommes, de ne point les condamner injustement, de ne pas les opprimer avec violence, de ne pas leur enlever injustement leurs petits biens, et de ne point exiger avec des traitemens durs et cruels les redevances qu'ils ont à percevoir sur eux. » (Cap. Carol. Magn., lib. II, cap. 47; cités par l'Acad. des inscrip., t. 8, p. 483, de ses mém.)
[213] B. Petri apost. epist. prima, cap. II, V, 18]
[214] V. les Mém. de l'Acad. des inscrip. t. VIII, p. 541, 564, 565, 567, 572, 583, et les documens originaux cités dans les notes. V. aussi l'Introduct. à l'Hist. de Charles-Quint, t. II, note xx.
[215] V., sur toute cette conduite du clergé, lors de l'affranchissement des communes, les Lettres de M. Thierry sur l'Histoire de France, p. 248 à 504 de la deux. édit.
[216] Pro remedio, pro redemptione anima; pro timore Dei omnipotentis, etc. V. les formules d'affranch. citées par Roberts., Introd. à l'Hist. de Charles-Quint, t. II, note xx, et les sources originales où il puise.
[217] Mém. déjà cités de l'Acad. des inscrip., t. VIII, p. 596.
[218] De la Monarchie française, etc.; t. I, p. 23 et 141 à 146.
[219] Lettres sur l'Hist. de France, p. 256, deux. éd.
[220] Hist. de Paris par Dulaure, t. I, p. 462 à 467, prem. éd.
[221] Id., p. 468.
[222] Ibid., p. 470 et suiv.]
[223] V. le Mémorial de chronologie, d'Hist. industrielle, etc., au mot Végétaux, prem. partie, éd. de 1829.
[224] V. le Mémorial, ibid, p. 694.
[225] V. tom. II, mon chap. sur l'Agriculture.
[226] Dul., Hist. de Paris, t. I, p. 432 de la prem, éd.
[227] Id., t. II, p. 66 et 67.
[228] Ibid., p. 107 et 205.
[229] Ibid., p. 417.
[230] V. le Mémorial, etc., au mot Chandelle.
[231] Thierry, Lett. sur l'Hist. de France, p. 519 de la deux, éd.
[232] V. le Mémorial au mot Fourrure.
[233] Id., aux mots Lin et Chanvre, Bas, Costume, Chaussure, etc.
[234] V., sur tout cela, l'Introd. à l'Hist. de Charles-Quint, t. II, note x.
[235] V., dans Dulaure, t. II, p. 112 de son Hist. de Paris, prem. éd., le détail de la procession qui fut faite et des cérémonies religieuses qui eurent lieu, en 1191, pour guérir le fils de PhilippeAuguste d'une dyssenterie contre laquelle la médecine ordinaire ne pouvait rien.
[236] Mémorial de Chronologie, etc., au mot Médecine.
[237] V., sur tout cela, le Mémorial au mot Costume.
[238] Hist. de Paris, t. II, p. 24 de la prem. édit.
[239] V. le Mémorial au mót Médecine.
[240] Hist. de Paris, t. II, p. 110.
[241] Cités par Dulaure, t. I, p. 432 et suiv. de son Hist. de Paris, prem. édit.
[242] Hist. de Paris, t. II, p. 414 et suiv.
[243] Ibid., t. II, p. 167.
[244] M. Guizot, Cours d'hist. mod., 1828-1829, t. I, p. 340 et 341.
[245] Hist. de Paris, t. I, p. 460.
[246] Expression des Chroniques.
[247] Hist. de Paris, t. I, p. 461.
[248] Introd. à l'Hist. de Charles-Quint, t. II, note ix.
[249] Ibid.
[250] Hist. des Expéd. maritimes des Normands, t. II, pag. 247. París, 1826.
[251] Walter-Scott, roman d'Ivanhoe, t. I, ch. 1.
[252] V. sur ce système de police, ce que dit l'auteur de l'Hist. des Expéd. marit. des Normands, t. II, p. 132 et suiv., et les notes placées à la fin du vol.
[253] Peut-être est-ce à cet isolement des seigneurs au milieu de leurs serfs qu'il faudrait attribuer l'usage qu'ils avaient adopté de ne s'entourer que de personnes de leur condition, usage que M. de Montlosier, comme on l'a vu plus haut, attribue au caractère particulier des mœurs germaines.
[254] Hist. des Français des divers états, aux cinq derniers siècles; XIVe siècle, t. I, p. 23, et t. II, p. 387, les notes.
[255] Ibid., p. 20, 21 et 22. Quoique l'auteur parle du xive siècle, on sent que dans les siècles immédiatement précédens, les progrès ne devaient pas avoir été nuls.
[256] Dulaure, Hist. de Paris. Comparer la carte qui se trouve en tête du second vol. à celle qui se trouve au commencement du premier. V. aussi le texte.
[257] Il faut reconnaître pourtant que les élémens de tout cela existaient d'avance. Il y avait eu notamment, dans beaucoup de villes, des corps d'arts et métiers dès le temps des Romains, et il paraît que ces communautés d'artisans n'avaient jamais été complètement abolies. Mais l'esprit de corps agit alors avec beaucoup plus de force qu'il ne l'avait jamais fait, et sur une échelle infiniment plus étendue.
[258] Edit de Henry III, de 1581.
[259] Rien n'oppose de plus grand obstacle au développement des classes laborieuses que le défaut de capacité politique je ne dis pas le défaut d'ambition, la répugnance à chercher dans l'intrigue une fortune qu'on ne serait pas capable d'acquérir par le travail; mais le défaut de zèle à s'occuper des affaires publiques et d'aptitude à juger les opérations du gouvernement. Les hommes d'industrie ne sauront que la moitié de leur métier tant qu'ils ne seront pas capables de considérer d'un point de vue général les intérêts de la société industrieuse, tant qu'ils ne pourront pas juger sainement de ce qui est favorable ou nuisible à ses divers travaux, tant qu'ils ne seront pas disposés à empêcher que les pouvoirs établis ne fassent rien qui lui soit contraire. Cette capacité est tout-à-fait dans l'ordre de leurs professions; elle s'y lie de la manière la plus étroite; elle est une de celles qu'il leur importerait le plus d'avoir pour les exercer avec succès et avec fruit. Malheureusement, elle est encore une de celles qu'ils possèdent le moins; mais elle ne peut manquer de naître après les autres; elle en sera la conséquence nécessaire et tout à la fois le véhicule le plus puissant.
[260] Quand nous parlons des peuples anciens, nous ne voyons jamais que le petit nombre d'hommes qui formaient le corps politique, c'est-à-dire les citoyens, les dominateurs, les maîtres; et nous ne tenons aucun compte des esclaves. La classe des esclaves est pourtant celle qu'il nous faudrait surtout considérer quand nous nous comparons aux anciens peuples, et que nous voulons juger des progrès qu'a faits la société. Cette classe, en effet, était celle qui formait le fond de la population, celle qui nourrissait la société, celle qui répondait aux classes laborieuses de nos temps modernes et à ce que nous nommons aujourd'hui le peuple, la nation. Or, je demande si jamais elle fut aussi libre que l'était devenu, sous le régime des privilèges, le peuple de nos sociétés modernes? Non-seulement, du temps des privilèges, le peuple, parmi nous, était beaucoup plus libre que ne le furent jamais les classes laborieuses dans l'antiquité, mais il l'était même plus, à beaucoup d'égards, que ne l'avaient été chez les anciens les classes dominatrices. Il y avait sûrement dans notre tiers-état, avant la révolution, plus de savoir, d'habileté, de richesse, de morale et de vrais élémens de liberté qu'il n'y en avait eu à Rome, sous la république, dans le corps des citoyens et des hommes libres, Seulement, du côté de nos bourgeois la capacité politique était moins grande; le tiers-état ne s'appartenait pas autant que s'était appartenu le peuple romain; il ne décidait pas des intérêts de l'industrie comme le citoyen romain avait décidé deux de la guerre. On ne peut nier que, sous ce rapport, il ne reste encore aujourd'hui beaucoup à faire aux classes industrieuses: elles ont à effacer les dernières traces de la conquête, c'est-à-dire à devenir complètement maîtresses d'elles-mêmes, à se gouverner dans les intérêts de l'industrie.
[261] Il est tout-à-fait dans la nature des choses qu'un fils suive la carrière de son père : c'est celle dont l'accès lui est plus facile, celle où il a le plus de chances de succès. Mais il ne suit pas de lå qu'il faille lui fermer les autres voies vers lesquelles pourrait l'entrainer son penchant naturel. Or c'est ce qui avait lieu sous le régime des corporations et des privilèges.
[262] Voy. les exemples que cite M. Say, dans son Traité d'économie politique, t. I, p. 246 et 247, quatr. édit.
[263] Les moyens, à une certaine époque, ne manquèrent pas. Colbert soumit la plupart des fabrications à des règles dont il fut strictement défendu de s'écarter. Nul ouvrier ne put, sous peine d'amende et de confiscation, se permettre de mieux faire qu'un autre. ( Ordonnance du mois d'août 1669.)
[264] Traité d'écon. pol., t. I, p. 245, deux. édit.
[265] La population de la Cité, à Londres, n'est plus maintenant que les deux cinquièmes de ce qu'elle était au commencement du dix-huitième siècle (Ch. Dupin, Voyage dans la Grande Bretagne, force commerc., t. II, p. 3). M. Dupin attribue ce décroissement de population à des causes qui ont pu influer, mais qui n'ont pas agi seules. Il n'est pas douteux que les trente-deux compagnies exclusives de la ville du centre n'aient aussi contribué à la faire déserter. V. ce que dit à ce sujet un écrivain anglais, cité par M. Say, t. I, p. 246, de son Traité d'économie politique.
[266] M. Say, ibid.
[267] Il n'y eut, long-temps, comme on sait, d'exercices permis à la noblesse que les exercices propres à la domination. Elle ne pouvait, sans déroger, exercer aucune profession utile. Elle envisageait le service public comme un pouvoir, non comme un service. Montesquieu, qui voit la raison de tout dans la forme du gouvernement, dit qu'elle ne faisait pas le commerce, parce que c'eût été contraire à l'esprit de la monarchie. Ce n'est pas cela. Elle ne faisait pas le commerce par la même raison que les Grecs, que les Romains, que les Germains ne l'avaient pas fait ; par la même raison que les Turcs ne le font pas parce qu'il n'est pas dans l'esprit des races militaires; parce qu'il répugne à la barbarie; parce qu'il affaiblit le penchant à la guerre et l'amour de la domination. La raison de ses mœurs à cet égard était dans son origine tant soit peu sauvage. On sait que les Germains, au dire de César et de Tacite, avaient une telle peur de prendre le goût de l'agriculture et de perdre celui du brigandage, qu'ils faisaient tous les ans un nouveau partage du sol : c'était par un reste de cet esprit que la noblesse s'était toujours abstenue de faire le commerce.
[268] Montesquieu dit, en parlant de la noblesse : « Cette noblesse toute guerrière, qui pense qu'en quelque degré de richesse que l'on soit, il'faut faire sa fortune, mais qu'IL EST HONTEUX D"AUGMENTER SON BIEN, SI L'ON NE COMMENCE PAR LE DISSIPER, etc. » ( Esprit des lois, 1. 20, ch. 22.) On sait d'où lui venaient ces belles maximes : elle n'aurait pas tenu si fort à honneur de commencer par se ruiner, si elle n'avait eu, pour s'enrichir, que les moyens ordinaires.
[269] S'il est une chose qui dût paraître désirable, surtout après une révolution qui aurait soulevé beaucoup de passions ambitieuses, ce serait sans doute de voir les citoyens tourner leur activité vers l'industrie, se livrer à des travaux utiles et paisibles. Il est clair que rien ne serait aussi propre à délivrer le pouvoir d'ennemis dangereux, à calmer les têtes effervescentes, à ramener la paix, à épurer les mœurs, à faire naître la prospérité générale. Que penser donc d'administrations qui, loin d'exciter une tendance aussi favorable, s'appliqueraient de temps en temps à la contrarier; qui, non contentes de fermer aux partis qui leur seraient opposés l'accès des fonctions publiques, prétendraient leur interdire encore l'exercice des professions privées; qui, par vengeance, prohiberaient le travail, l'étude; qui chasseraient des jeunes gens des écoles; qui défendraient de prendre un état; qui empêcheraient de devenir médecin, avocat, avoué, notaire, professeur, maître de pension, imprimeur, libraire, marchand de vin, que sais-je? qui réduiraient, pour ainsi dire, un homme à l'alternative de mourir de faim ou de vivre par des moyens condamnables?.... Voilà pourtant ce qui s'est vu et qu'on ne sait comment qualifier. Les expressions manquent pour flétrir, comme il conviendrait de le faire, un tel mélange d'absurdité et de tyrannie. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'est rien de plus irritant que de tels excès, si ce n'est pourtant la mollesse d'un public qui consentirait à les souffrir sans se plaindre.
[270] M. Say, Cours d'écon. pol. à l'Athénée; voy. une brochure de M. Pillet-Will, intitulée : Réponse à M. Levacher-Duplessis,
[271] M. Vital-Roux, Rapport sur les corps d'arts et métiers, 1805, imprimé par ordre de la Chambre du commerce.
[272] Traité d'écon. pol., t. I, p. 181 et suiv., quat. édit.
[273] Ce qui constituait la sottise de ces réclamations, c'est qu'elles étaient directement contraires à l'intérêt de ceux-là même qui les formaient. En effet, l'introduction de toute industrie nouvelle crée une nouvelle main-d'œuvre, provoque un surcroît de richesse et de population, fait naître des consommateurs avec des moyens d'échange, et ouvre ainsi de nouveaux débouchés aux produits des industries déjà existantes. Le plus mauvais service qu'on eût pu rendre aux pétitionnaires, dans les cas cités par M. Say, c'eût été d'écouter leurs demandes; c'est ce que l'expérience ne tarda pas à faire voir.
[274] Il n'y a que cet ordre de raisonnable, on ne saurait trop le répéter. Ce n'est que par le libre concours de tous les citoyens à tous les genres de services que les hommes parviennent à se classer, ainsi que le demandent la justice et l'utilité commune. Il ne peut y avoir de rangs déterminés d'avance qu'entre les diverses classes d'individus qui doivent concourir à une entreprise quelconque, partout où il faut qu'il existe une certaine subordination pour que le service se fasse, dans une manufacture, dans une administration, dans une armée. Mais établir des rangs entre les membres de la société en général est une chose absolument impossible. Rien de moins stable que la grandeur, le talent, la moralité, la richesse et toutes les qualités qui pourraient motiver d'abord un pareil arrangement. Ces qualités se déplacent sans cesse; et vouloir assigner d'avance et à perpétuité un certain rang à de certaines familles, ce serait prendre une décision dont les motifs pourraient cesser presque aussitôt que la décision aurait été prise.
[275] ́ J'espère que ceci ne donnera lieu à aucune équivoque. On voit assez ce que je blâme. Ce que je blâme, ce n'est pas l'activité politique, comme quelques personnes ont paru le croire; ce n'est pas la disposition à surveiller la gestion des intérêts généraux de la société ; ce n'est pas même le désir de devenir l'homme d'affaires de la société; pourvu que ce soit de son consentement et à des conditions librement débattues avec elle ou avec ses délégués loyalement élus : le vice politique que je signale, c'est la disposition à vivre des ressources du public, à accepter des places sans être sûr qu'elles lui sont utiles, et des honoraires sans trop examiner si, dans un marché libre et éclairé, il consentirait à donner des services qu'on prétend lui rendre le prix que l'on consent à en recevoir.
[276] Mémoires inédits.
[277] C'est ce qu'ont fait toutes nos constitutions, depuis celle de 1791, jusqu'à la charte de 1814 et à l'acte additionnel de 1815. Il n'est pas un de ces pactes sociaux dans lequel n'ait été expressément stipulée l'égale admissibilité de tous les citoyens à toutes les fonctions publiques; tandis qu'il n'en est pas un, si j'ai bonne mémoire, où l'on ait consacré le libre exercice des professions privées : preuve malheureusement trop claire que, jusqu'à ces derniers temps, on à plus tenu à la faculté de parvenir aux places qu'à celle de n'être pas gêné dans son travail.
[278] Je ne voudrais pourtant pas dire que la révolution fut entreprise dans des vues d'ambition. Je crois que ce qu'on voulait avant toute chose, c'était la réforme des abus; mais je crois aussi qu'à cette haine généreuse contre les abus se joignait, dans l'esprit public, une propension très-ancienne et très-forte à parvenir aux places; penchant que la destruction de beaucoup d'industries privées, la défaite et l'émigration des classes anciennement gouvernantes, la nécessité de reformer un gouvernement, celle de défendre la révolution, et d'autres circonstances encore, excitèrent bientôt au plus haut degré.
[279] M. Alex. de Laborde, De l'Esprit d'association, p. 43, prem. édit.
[280] Voir, dans le Moniteur du mois de juin 1819, séances de la Chambre des députés, les discours de MM. Decazes et de Saint-Aulaire, dans la partie de la discussion du budget relative aux traitemens des préfets. — L'égalité politique multiplie sans doute le nombre des citoyens actifs; mais de ce qu'il y a plus de citoyens, il ne s'ensuit pas que le gouvernement doive coûter davantage.
[281] M. Guizot, Des moyens de gouvernement et d'opposition.
[282] C'est ainsi, par exemple, qu'après avoir détruit les corps enseignans et les collèges particuliers, on a créé des écoles publiques avec une direction centrale à Paris, et que les hommes livrés à l'enseignement, d'hommes privés qu'ils étaient, sont devenus des fonctionnaires. Il serait aisé de citer d'autres exemples, et de montrer comment, par l'effet de la passion dominante, une multitude d'états particuliers ont été transformés en offices publics.
[283] Un publiciste allemand, Frédéric Gentz, a entrepris, d'expliquer et de justifier les rapides progrès que font les dépenses de gouvernement dans toutes les contrées de l'Europe, et surtout dans les contrées riches. « Cet accroissement, dit-il, tient au progrès même de la richesse, qui, en même temps qu'elle crée une multitude de nouveaux besoins, fait hausser le prix de toutes les marchandises. Chaque homme veut dépenser davantage, et, avec la même quantité d'argent, à peine peut-il avoir la moitié de ce qu'il obtenait il y a cinquante ans. Le gouvernement, comme personne collective, se trouve dans la même position que les individus. A l'exemple de tout ce qui l'environne, il faut qu'il étende la sphère de ses dépenses, et d'année en année, il est obligé de payer plus cher tous les objets de son immense consommation, » ( Essai sur l'administration des finances et de la richesse de la Grande-Bretagne, p. 12 à 22. )
Ces remarques, toutes spécieuses qu'elles sont, ne justifient point l'extrême accroissement des dépenses publiques. S'il y a des raisons pour qu'elles augmentent, des raisons bien meilleures devraient les faire diminuer. Il n'est point exact de dire d'abord que tout augmente de valeur. Le progrès des arts a fait baisser au contraire le prix de bien des choses. Ensuite, on ne peut nier que le gouvernement, qui est aussi un art, ne fût, comme tous les autres, si on le voulait, susceptible de se simplifier, et par cela même de devenir moins cher. Toute manière de faire la police et d'administrer la justice n'est pas également bonne. A cet égard, comme à tout autre, les méthodes seraient certainement très-susceptibles d'amélioration. Joignez que les besoins publics dont je viens de parler, les besoins de police et de justice, deviennent, à mesure que nous nous civilisons, plus faciles à satisfaire: il faut sûrement moins de peine et de dépense pour maintenir l'ordre au sein d'un peuple laborieux et cultivé qu'au milieu d'une troupe de barbares. Enfin il est une multitude de choses, cela devient chaque jour plus patent, que l'autorité pourrait, avec grand profit pour le public, abandonner aux efforts de l'activité particulière.
Ainsi, en admettant que les services politiques, comme tous les autres, doivent être mieux rétribués aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a cinquante ans, il y aurait encore de bonnes et nombreuses raisons pour que les dépenses publiques dussent baisser; et si, tout au contraire, elles s'élèvent, cela tient, comme je le dis, au penchant dépravé qui pousse les populations à prendre part aux exactions exercées sur elles, à la sottise qui leur fait souffrir ces exactions alors même qu'elles n'y peuvent point participer, et à la disposition toute naturelle de vieux gouvernemens corrompus à profiter de nos erreurs et de nos vices pour maintenir et accroître de vieux abus.
[284] Au mois d'avril 1814, la dette publique était, en compte rond, de 61 millions; maintenant elle est de 207. Elle s'est donc accrue de 146 millions qui, au taux où est aujourd'hui la rente, font une dette capitale de près de 3 milliards et demi, dont la France a été grevée depuis quinze ans. Il est juste d'observer que cet accroissement provient presque tout du fait des administrations précédentes.
[285] On a d'étranges preuves de cette aversion que des hommes accoutumés à ne pas s'inquiéter du soin de leur subsistance, ont pour tout changement d'état qui mettrait ce soin à leur charge. A ce prix, des esclaves eux-mêmes n'accepteraient pas toujours la liberté. De 1807 à 1811, on a voulu affranchir en Prusse tout ce qu'il y avait de paysans qui étaient restés serfs; et, chose singulière! cet acte de justice et d'humanité a été froidement accueilli de la classe d'hommes qu'il intéréssait le plus. Beaucoup de paysans ont mieux aimé demeurer serfs que de perdre ce qu'ils appelaient l'appui de leur seigneur, et de sortir d'une position où leur existence était sûrement très-misérable, mais où elle était pourtant assurée. (Voy. le Globe du 27 février 1827.)
[286] Non-seulement, par l'effet de ce penchant, on a créé chez nous le plus d'administrations qu'on a pu, mais l'on s'est arrangé pour que, dans chaque administration, il y eût le plus d'emplois possible. L'égalité voulant que tout le monde participât aux bénéfices du pouvoir, on a pensé qu'il fallait moins rétribuer les fonctionnaires et créer un plus grand nombre de fonctions. C'est ainsi qu'on a porté le nombre des juges à cinq ou six mille, et borné à 60 louis le traitement de la plupart de ces officiers publics. Il n'est pas une branche du service public, en France, qui ne rende témoignage de ces efforts pour multiplier les places. Cela s'aperçoit surtout dans l'armée : « Je demande, observait M. Casimir Perrier (Chambre des députés, séance du 2 juin 1826), quelle est notre situation militaire : elle est, dit-on, de deux cent trente et un mille cinq cent soixante hommes, y compris les enfans de troupes, musiciens, tambours, etc., pour lesquels nous dépensons 190,308,027 fr. Sur ce nombre d'hommes, il y a dix-sept mille huit cent sept officiers et cinquante et un mille quarante-cinq sous-officiers, total soixante-huit mille huit cent cinquante-deux. Il nous reste cent cinquante-neuf mille six cent cinquante-sept soldats, ce qui fait à peu près un officier ou sous-officier pour deux hommes.»
[287] Les taxes, observe un écrivain anglais, font beaucoup moins de bien à l'aristocratie qu'elles sont destinées à enrichir, qu'elles ne font de mal à ceux qui les paient. L'aristocratie ne reçoit pas la cinquième partie des dépenses extravagantes que nous faisons pour nos flottes, nos armées, nos colonies. Un régiment de cavalerie, par exemple, ne lui est avantageux que pour son état-major; mais indépendamment des frais de cet état-major, et pour qu'il existe, il faut aussi que nous supportions la dépense des chevaux et des simples soldats, qui est bien plus considérable. Les vaisseaux de guerre ne sont bons pour l'aristocratie qu'à cause des places d'amiraux, de vice-amiraux, de capitaines, etc.; mais les frais de construction et d'entretien de chaque vaisseau sont énormes pour le peuple. Il en est de même des colonies, qui ne profitent aux privilégiés qu'à cause des places de gouverneurs et des autres emplois administratifs ou militaires des établissemens coloniaux.
Au fond le moyen le plus économique d'entretenir l'aristocratie serait de lui faire des pensions, etc....» (Rev. Britan., t. 10, p. 197 et suiv.)
[288] Je dois observer que ceci a été écrit sous le ministère de M. de Villèle. Je laisse au lecteur le soin de juger jusqu'à quel point ces remarques, sous l'administration présente, peuvent paraître encore fondées. On assurait, sous le précédent ministère, que la grande propriété était intéressée pour 300 millions dans la levée des contributions publiques, et qu'elle tirait 60 fr. du trésor pour chaque écu qu'elle y versait (Labbey de Pompières, Chambre des députés, séance du 13 juillet 1821). J'ignore jusqu'à quel point ces proportions ont varié depuis.
[289] Je répète ce qui a été écrit sous un autre ministère.
[290] En 1791 le budget des dépenses n'excédait guère 500 millions; le nombre des emplois et des employés était infiniment moins considérable; il nous restait quelques libertés municipales que nous avons perdues; nombre d'industries et de professions privées étaient moins qu'aujourd'hui dans la dépendance de l'autorité publique.
[291] Jusqu'ici pourtant on avait laissé dans l'obscurité un point très-capital: c'est que nous pouvons créer de la richesse en donnant de la valeur aux hommes, comme en en donnant aux choses. V. plus loin, ch. 13.
[292] La société adjugeant la direction du service public à des hommes de son choix! quelle chimère! La société peut-elle agir collectivement? Voudriez-vous qu'elle mit son gouvernement à T'enchère ? La société ne peut pas agir collectivement; mais elle peut agir par des délégués, et rien sûrement n'empêcherait que, par l'intermédiaire de ses délégués, elle n'accordât ou ne retirât sa confiance à tel parti d'hommes d'état, à telle coalition ministérielle actuellement en possession du pouvoir, ou aspirant à l'obtenir. Non-seulement cela serait praticable, mais cela se pratique tous les jours.
[293] C'est le reproche que lui font tous les politiques de l'antiquité, et c'est par-là qu'ils prétendent justifier l'exclusion de la cité de la plupart des hommes livrés à des professions industrielles.
[294] Bonald, Réflexions sur l'intér. général de l'Europe, p. 46.
[295] Liv. 1, ch. 21.
[296] Disc. sur l'inég., les notes, note 9.
[297] Journal des Débats du 9 décembre 1820, col. 4. Il est peu d'écrits de l'école monarchique dans lesquels on ne retrouve la même idée. Elle sert de base à tous les raisonnemens par lesquels on a prétendu prouver la nécessité de diviser la société en corporations et en ordres.
[298] C'est l'accusation banale que lui adressent la plupart des publicistes de l'école monarchique, et beaucoup de moralistes chrétiens, surtout dans la communion catholique. Des écrivains d'un autre ordre, des philosophes, et notamment Rousseau, lui ont intenté le même procès.
[299] Voy. dans le spirituel ouvrage intitulé Raison et Folie, un morceau remarquable sur l'influence morale de la division du travail. Voy. aussi M. Say, qui, dans les dernières éditions de son Traité d'éc. pol., liv. I, ch. 8, s'est laissé entraîner par les idées spécieuses, quoique peu fondées à mon avis, de M. Lémontey.
[300] Voy. ci-dessus, ch. VII, p. 254.
[301] L'étude des sciences, chez les anciens, ne passait pour libérale qu'autant qu'on s'abstenait de les appliquer et de les faire servir à quelque chose d'utile (Aristote, Polit., liv. 8, ch. 2, § 3 ). Il parait qu'à cet égard nous ne sommes pas encore bien guéris des préjugés de la barbarie. On a vu récemment, dit-on, quelques membres de l'un des premiers corps savans de l'Europe refuser de se donner pour collègues des hommes très-distingués comme savans, parce que ces hommes avaient le malheur d'être aussi très-distingués comme artistes.
[302] Nouveau Principes d'Éc. pol., t. I, p. 457, deux. éd.
[303] Rev. Brit., t. XIV, p. 38 et 39: vie de Robert Burns.
[304] Quest. Naturelles, liv. 4, ch. 13.
[305] Polit., liv. 1, ch. 2, § 1; liv. 2, ch. 6, § 2; liv. 7, ch. 3, § 1, et liv. 8, ch. 2, § 3; traduction de M. Thurot.
[306] Journal des Débats du 9 décembre 1820.
[307] Voy. l'Esprit des Lois.
[308] Esprit des Lois, liv. 2, ch. 6.
[309] M. Brongniart, Mémoire au ministre de l'intérieur, inédit.
[310] Recueil périodique de Goethe sur l'art et l'antiquité, deux. vol., trois. cah., exam. du comte de Carmagnola. Voy. cette pièce, traduite de l'italien par M. Fauriel.
[311] Les corporations divisaient les hommes de tous les métiers, sans créer pour l'industrie aucune force nouvelle. Les associations, au contraire, créent pour le travail des forces immenses, sans produire entre les hommes aucune inimitié.
[312] De cette passion des peuples industrieux pour la paix, on a conclu qu'ils devaient être peu disposés à repousser les agressions étrangères; c'est la conclusion contraire qu'il aurait fallu tirer plus ils sentent le besoin de la paix, et plus ils doivent être disposés à repousser toute attaque. Il est très-vrai que les hommes sont moins farouches dans les temps d'industrie qu'aux époques de domination. Les vertus sauvages, comme l'observe très-bien Malthus, ne viennent qu'où elles sont nécessaires; or, à mesure que l'on pourvoit à sa subsistance par des moyens moins hostiles, la sûreté générale devenant plus grande, chacun peut sans péril déposer une partie de sa férocité. Mais de ce que dans l'industrie on est moins exposé à l'insulte, suit-il qu'on soit plus d'humeur à la souffrir? non, sans doute. L'énergie n'est pas détruite; elle a seulement moins d'occasions de s'exercer, ou, pour mieux dire, elle s'attaque à d'autres obstacles.
On fait à la vie industrielle un autre reproche: il est vrai, dit-on, que dans l'industrie les hommes sont moins opposés ; mais ils sont aussi moins fortement unis. On ne voit plus de ces liaisons indissolubles, de ces dévouemens mutuels et absolus qui donnaient tant de vie et d'intérêt aux âges barbares.- Sans doute, les peuples industrieux ne sont pas unis par le désir d'attaquer, mais ils peuvent l'être encore par le besoin de se défendre; et quand ce besoin viendrait à cesser, quand ils n'auraient plus d'ennemis à craindre, les motifs ne manqueraient pas encore à leur union : ils seraient unis comme parens, comme amis; ils seraient unis par le plaisir de se trouver ensemble; ils seraient unis par l'avantage qui résulte pour chacun du rapprochement de plusieurs; ils ne seraient plus unis pour résister aux hommes; mais ils le seraient encore pour agir sur la nature.
[313] On peut se convaincre aisément de ceci en portant les yeux sur les États-Unis, de tous les pays du monde celui qui approche le plus du mode d'existence dont je parle. Quoiqu'il y ait là sans doute la même différence qu'ailleurs entre les facultés naturelles des individus, il y en a infiniment moins entre les fortunes et les divers degrés de rapidité avec lesquels elles se font. On n'y voit pas comme ailleurs, par exemple, des traitans qui réalisent plusieurs millions de bénéfices en un jour, et des ouvriers qui ne gagnent pas trente sous par semaine. Pourquoi cela? parce que les traitans, s'il y en a, n'y trouvent pas à traiter avec des gouvernemens exacteurs et dissipateurs; parce que le travail y est la ressource commune, et que ce mode d'existence, quelle que soit la différence d'aptitude, d'activité et de moralité avec laquelle on s'y livre, ne saurait amener un état de choses où un homme gagne des millions, dans le même temps où cent mille autres gagnent à peine quelques sous.
[314] Malthus, Essai sur le princ. de la pop., liv. 3 et 4.
[315] V., dans la Rev. brit., cah. de déc. 1826, un tableau relatif à l'entretien des pauvres, publié par ordre du parlement.
[316] Comptes moraux et administ. des hosp. et hôp. de Paris pour 1822, p. 24 et 25, et le tableau B.
[317] Malthus, liv. 4, ch. 3.
[318] « Je conçois dans l'espèce humaine, dit-il, deux sortes d'inégalités l'une que j'appelle naturelle ou physique, parce qu'elle est établie par la nature, et qui consiste dans la différence des âges, de la santé...; l'autre qu'on peut appeler morale ou politique, parce qu'elle dépend d'une sorte de convention... Celle-ci consiste dans les différens privilèges dont quelques-uns jouissent au préjudice des autres, comme d'être plus riches, etc. » (Disc. sur l'inégalité.)
[319] Et voilà, pour le dire en passant, pourquoi, dans l'état social que je décris, la fortune est un titre à l'estime. Que chez un peuple voué au brigandage on considérât les hommes pour les richesses qu'ils possèderaient, cela devrait choquer sans doute; mais il n'en doit pas être de même là où la fortune ne se peut acquérir que par une utile et généreuse industrie. La fortune ici honore celui qui la possède, l'indigence déconsidère celui qu'elle atteint; et c'est avec raison qu'on estime un homme, parce qu'il est riche, et qu'on en méprise un autre, parce qu'il est gueux. Il y a lieu de présumer, en effet, que l'homme riche possède les qualités recommandables qui, dans l'industrie, sont nécessaires pour arriver à la fortune, ou tout au moins qu'il appartient à une famille qui a possédé ces qualités ; tandis que la vue d'un misérable fait faire justement les suppositions contraires. Aussi aurais-je quelque peine à approuver le reproche qu'on a fait aux Américains de parler avec une sorte de dédain des hommes sans fortune. Il est sûr qu'il y a quelque chose de honteux à manquer de moyens d'existence dans des pays où le travail n'est soumis à aucune gêne et où les fruits en sont pleinement assurés. L'indigent ou sa famille y peuvent être justement suspects d'incapacité, de paresse ou d'imprévoyance.
[320] M. Say, Trait. d'écon. polit., t. II, p. 11, quatr. édit.
[321] Traité d'écon. polit., t. II, p. 113, quat. éd.— Il arrive quelquefois aux ouvriers de chercher à balancer le désavantage de leur situation en se coalisant pour obtenir de meilleurs gages. Ces entreprises, criminelles lorsqu'ils emploient la violence pour les faire réussir, leur sont nuisibles, alors même qu'elles sont innocentes, si leur travail est au prix où la concurrence peut naturellement le porter. Les ouvriers sont fondés à se plaindre toutes les fois qu'ils ne peuvent disposer de leur activité sans contrainte, louer leurs services au plus offrant, chercher la condition la meilleure. Mais, du moment que rien ne gêne l'emploi de leurs forces, et que leur travail est au prix où peut le porter un libre marché, il n'y a plus pour eux que deux moyens légitimes de faire hausser le prix de la main-d'œuvre, c'est de faire qu'elle soit moins offerte, ou qu'elle soit plus demandée. Le dernier de ces moyens n'est guère à leur disposition; mais ils disposent complètement de l'autre s'ils ne peuvent pas augmenter la demande de l'ouvrage, ils peuvent au moins diminuer le nombre des ouvriers; comme ce sont eux qui en fournissent la place, il dépend toujours d'eux d'en prévenir la multiplication. Il n'est pas de situation où il ne leur importe d'user de cette ressource. On aurait beau leur laisser toute liberté pour le travail, la demande de l'ouvrage aurait beau croître, si, à mesure qu'ils gagneraient davantage, ils créaient toujours un plus grand nombre d'ouvriers, il est clair que leur situation ne saurait devenir meilleure. Ils ne sont à plaindre que parce qu'ils se multiplient trop: c'est leur extrême accroissement, qui, faisant baisser le prix de la main-d'œuvre, est cause que leur part dans les profits de la production est quelquefois si peu proportionnée à la peine qu'ils se donnent; c'est par l'effet de leur grand nombre qu'ils éprouvent tant de désavantage dans les marchés qu'ils font avec les entrepreneurs.
[322] De ce qu'il y a des inégalités inévitables, certaines gens seraient fort disposés à conclure qu'il doit Ꭹ avoir nécessairement des maîtres et des sujets, des dominateurs et des tributaires. « La loi, dit-on fièrement, ne saurait ni créer, ni anéantir l'aristocratie; toujours la force vient se placer à la tête de la société : détruisez une classe de dominateurs, il en naîtra d'autres : le tiers-état, après avoir cru renverser l'ancienne noblesse, a vu tout à coup sortir de son sein une autre noblesse, qui s'est trouvée aussitôt revêtue des indestructibles supériorités de l'ancienne. » (Journal des Débats du 9 décembre 1820.) Voià bien le langage de toutes les dominations: les sacerdotales disent que les portes de l'enfer ne sauraient prévaloir contre elles; les militaires s'appellent d'indestructibles supériorités. Heureusement, le temps, qui n'a fait de pacte avec aucune, va les détruisant toutes à petit bruit ; il efface insensiblement les inégalités nées de la violence et de l'imposture, et il finira par ne laisser apercevoir entre les hommes que les différences naturelles et légitimes dont je parle, les seules qu'il ne soit ni possible ni désirable d'anéantir.
[323] V. ci-dessus. p. 442 et suiv.
[324] Vol. in-8. A Paris, chez mad. Huzard, lib., rue de l'Éperon.
[325] Les personnes qui ignorent combien, parmi nous, l'éducation de toutes les classes a fait de progrès, n'apprendront peut-être pas sans quelque surprise que ces excellentes observations m'ont été adressées par un simple notaire de province.
[326] Sur 23,399 personnes, terme moyen, décédées annuellement à Paris, pendant les trois années 1821, 1822 et 1823, il n'y en a eu, année moyenne, que 4,290 qui aient laissé de quoi pourvoir aux frais de leur inhumation; 12,663 autres, décédées à domicile, ont été enterrées aux frais de la ville, sur certificat d'indigence; le reste, plus misérable encore, est décédé dans les hôpitaux. (Rech. stat. sur la ville de Paris, pub. par le préfet de la Seine, tableaux 27, 37, 42 et 58. Paris, 1826.)
[327] V. la Rev. encyclop., cah. de nov. 1828, p. 312.
[328] Dans la Rev. encyclop., cah. de juin 1827, p. 617.
[329] Il y a de ceci assez de preuves. Je pourrais citer tel établissement dont les propriétaires ont voulu vainement faire des sacrifices considérables pour améliorer le sort de leurs ouvriers. Dans la manufacture importante dont je veux parler ici, cinq cents ouvriers étaient employés à faire un certain ouvrage à raison de 13 sous le pied carré. Chaque ouvrier en faisait environ deux pieds par jour, ce qui ne portait guère le prix de sa journée qu'à 26 sous. Les propriétaires, par un mouvement spontané de générosité, se décidèrent à élever le prix de 13 sous à 16: c'était un sacrifice de cinquante écus par jour, et de quarante-cinq mille francs par an. La paresse et la mauvaise conduite des ouvriers rendit ce sacrifice inutile: comme ils gagnaient un peu plus d'argent, ils firent un peu moins d'ouvrage, et le loisir que leur procurait ce supplément de salaire, ils l'employèrent à aller au cabaret. Leur besogne s'en ressentit; en même temps qu'ils en firent moins, elle fut plus mal faite. Force fut aux propriétaires de remettre les choses sur l'ancien pied.
Nouveau traité d’économie sociale, ou simple exposition des causes sous l’influence desquelles les hommes parviennent à user de leurs forces avec le plus de LIBERTÉ (1830).
Volume II
[II-1]
CHAPITRE XIII.
Des divers ordres de travaux et de fonctions qu'embrasse la société industrielle.↩
§ 1. J'ai cherché, dans le premier volume de cet ouvrage, quelles étaient les conditions de la liberté, considérée d'une manière générale et hors de tout mode spécial d'activité. On a vu qu'elle dépendait : 1° de la race, 2° des circonstances extérieures, 3° de la culture; c'est-à-dire que les hommes parvenaient d'autant plus à agrandir la sphère de leur activité et à se mettre à même d'agir avec facilité et avec puissance, que la nature les avait doués d'organes plus parfaits, qu'ils avaient été placés dans des circonstances plus favorables au développement de leurs forces, et finalement qu'ils les avaient plus développées. Je me suis appliqué surtout à faire voir combien la liberté [II-2] dépendait du degré de culture. J'ai fait la revue successive des principaux modes d'existence par lesquels paraît être passée l'espèce humaine, et j'ai constamment trouvé que l'homme était d'autant plus libre qu'il était parvenu à un état de culture plus perfectionné. Ainsi les faits nous ont clairement démontré qu'il y avait plus de liberté dans la vie nomade que dans la vie sauvage; dans la vie sédentaire que dans la vie nomade; dans la servitude, telle qu'elle existait au moyen âge, que dans l'esclavage domestique des anciens; sous le régime du privilège que dans la demi-servitude du moyen âge; chez les peuples dominés par une tendance; commune vers l'industrie des places que dans les pays où tout se fait par privilège. Enfin, arrivé à cette manière de vivre que j'appelle l'industrie, la vie industrielle, il m'a paru, tout en tenant compte des obstacles que trouvait encore ici la liberté, que ce mode d'existence était, de tous ceux que j'avais traversés, le mieux approprié à la nature de l'homme, le plus favorable au plein développement de ses facultés, celui, en un mot, dans lequel il pouvait devenir le plus libre.
§ 2. Je reviens maintenant sur ce dernier état. Après l'avoir considéré dans son ensemble, il me reste à l'envisager dans ses détails. J'ai à parler des divers ordres de travaux et de fonctions qu'il [II-3] embrasse. J'ai à faire connaître la nature, l'influence, et principalement les moyens de ces divers modes d'activité. Mais il faut que je cherche d'abord quels sont tous ces modes d'activité que comprend la société industrielle. J'ai fait connaître précédemment sa nature; j'ai dit quel était le caractère commun à tous ses travaux [1]; mais je n'ai pas dit quels étaient les travaux et les actions dont elle se compose. L'ordre des idées veut que je commence par-là. Avant de chercher à quelles conditions tout travail peut s'exécuter librement dans la société dont je m'occupe, il faut que je dise quel est l'ensemble des professions et des fonctions qui entrent dans l'économie de cette société et qui concourent au développement de ses forces.
§ 3. Puisque l'industrie, ainsi que nous l'avons vu, consiste à faire quelque chose d'utile; puisque industrie c'est production d'utilité, il est évident qu'il faudra appeler classes industrieuses toutes les classes utiles, toutes les classes productrices. Mais qui est-ce qui est, et qui est-ce qui n'est pas producteur? et, dans cette multitude de professions qui concourent simultanément à l'activité sociale, quelles sont celles qui contribuent véritablement à la production? Je ne sais si la chose est [II-4] très-malaisée à déterminer; mais il est certain qu'à cet égard on est encore loin de s'entendre.
Dans le langage habituel, on ne reconnait comme productrices, et l'on n'appelle conséquemment industrielles, que les classes dont l'activité s'exerce sur la nature physique, et dont les produits se réalisent dans quelque chose de matériel. Ainsi l'on appelle producteur, homme d'industrie, le cultivateur, le maçon, le charron, le maréchal, le menuisier, le serrurier, et une multitude d'autres travailleurs qui, à l'aide de certaines forces, de certains outils et d'un certain artifice, parviennent à fixer de certaines utilités dans les choses. Mais quant à tous ceux qui agissent sur les personnes, quant au médecin, à l'instituteur, à l'avocat, au prédicateur, au fonctionnaire, au musicien, au comédien, etc., on ajoute qu'ils ne sont point des gens d’industrie; et la raison qu'on en donne, c'est que leur travail ne s'exécute sur aucune matière, qu'il ne laisse après lui rien de réel, rien de durable, rien qui soit susceptible de s'accumuler et de se vendre; d'où l'on conclut qu'il est improductif.
« Le travail de quelques-unes des classes les plus respectables de la société, dit Smith, ne produit aucune valeur; il ne se fixe, il ne se réalise sur aucune chose qui puisse se vendre, qui subsiste après la cessation du travail, et qui puisse [II-5] servir à acheter par la suite une quantité de travail pareille. Le souverain, par exemple, ainsi que tous les autres magistrats civils et militaires qui servent sous lui, toute l'armée, toute la flotte, sont autant de travailleurs improductifs. Leur service, tout honorable, tout nécessaire qu'il est, ne produit rien avec quoi l'on puisse acheter ensuite une pareille quantité de service. La protection, la tranquillité, la défense de la chose publique, qui sont le résultat du travail d'une année, ne peuvent servir à acheter la protection, la tranquillité, la défense qu'il faut pour l'année suivante. Quelques-unes des professions les plus graves, et quelques-unes des plus frivoles, doivent à cet égard être mises sur le même rang : ce sont celles des ecclésiastiques, des gens de loi, des médecins, des gens de lettres de toute espèce, et celles des comédiens, des farceurs, des musiciens, des chanteurs, des danseurs de l'Opéra, etc. Le travail de la plus noble comme celui de la plus vile de ces professions ne produit rien avec quoi l'on puisse ensuite acheter ou faire faire une pareille quantité de travail. Leur travail à toutes, tel que la déclamation de l'acteur, le débit de l'orateur ou les accords du musicien, s'évanouit au moment même qu'il est produit [2]. »
[II-6]
M. de Tracy, dont l'esprit est si net et si ferme, ne voit pas, à cet égard, les choses autrement que l'auteur de la Richesse des nations. Tout en commençant par reconnaître, ce que ne fait pas Smith, que tous nos travaux utiles sont productifs [3], il trouve ensuite, comme Smith, plusieurs sortes de travaux improductifs, bien qu'ils lui paraissent éminemment utiles. « Il n'est pas douteux, dit-il, qu'un gouvernement quelconque ne soit très-nécessaire à toute société : il faut bien que ses membres soient jugés, administrés, protégés, défendus, garantis, contre toute espèce de violence [4] ; » et néanmoins, « une première chose bien certaine, ajoute-t-il, c'est que le gouvernement ne peut être rangé parmi les consommateurs de la classe industrieuse... Sa consommation est définitive ; il ne reste rien du travail qu'il solde [5]. » M. de Tracy en dit autant des services personnels des avocats, des médecins, des soldats, des domestiques : « leur utilité est celle du moment du besoin, comme celle d'un concert, d'un bal, d'un spectacle, qui est instantanée, et disparaît aussitôt [6]. » L'auteur [II-7] avait déjà exprimé les mêmes idées dans un autre ouvrage.
« N'oublions jamais, disait-il, que le travail productif est celui dont il résulte des valeurs supérieures à celles que consominent ceux qui s'y livrent. Le travail des soldats, des gouvernemens, des avocats, des médecins peut être utile; mais il n'est pas productif, puisqu'il n'en reste rien. Tout ce qui est employé à payer les soldats, matelots, juges, administrateurs, prêtres et ministres, est ab, solument perdu; aucun de ces gens-là ne produit riep qui remplace ce qu'ils consomment [7]. »
Je retrouve toute la même doctrine dans M. de Sismondi. La société, suivant cet auteur, ne peut se passer d'administrateurs, de juges, de militaires; et, néanmoins, « toute cette population gardienne, depuis le chef de l'État jusqu'au moindre soldat, ne produit rien, par la raison, dit-il, que son ouvrage ne revêt aucune forme matérielle, et n'est pas susceptible de s'accumuler, » La société ne peut également se passer d'instituteurs, de prêtres, de savans, d'artistes; et, néanmoins, les travaux de ces hommes sont improductifs, « parce qu'ils ne donnent pas de fruits matériels, et qu'on ne thésaurise pas de ce qui n'appartient qu'à l'âme. » Enfin la société n'a pas moins besoin des [II-8] professions qui soignent le corps de l'homme, que de celles qui perfectionnent son intelligence; et toutefois, suivant M. de Sismondi, les travaux des médecins et des chirurgiens sont tout aussi improductifs que ceux des savans et des artistes, par la raison que « les effets de ces travaux ne peuvent de même s'accumuler [8].
Un autre écrivain, M. Malthus, dans ses Principes d'économie politique, paraît dire implicitement les mêmes choses. Il ne reconnaît de richesses réelles que celles qui sont fixées dans des objets matériels, et trouve que c'est renverser de fond en comble les principes de la science que de regarder comme productive toute industrie dont l'activité ne s'épuise pas sur la matière [9].
J'ai sous les yeux le livre d'un autre économiste anglais, M. Mill, qui reconnaît que le gouvernement, lorsqu'il se renferme dans son véritable objet, remplit une fonction de la plus grande importance; et, néanmoins, il ne laisse pas de ranger dans la classe des consommations stériles le prix que coûte son travail, disant qu'il ne concourt à [II-9] la production que d'une manière très-indirecte, et que directement il ne produit rien [10].
M. Say est, à ma connaissance, le seul économiste qui ait essayé de rectifier cette doctrine, et il me semble, je dois le dire, que cet essai est loin d'avoir été heureux [11]. A la différence de Smith et des autres économistes que je viens de citer, il met au rang des professions productives les industries du médecin, de l'instituteur, de l'avocat, de l'homme de lettres, du fonctionnaire, et en général de toutes les classes de travailleurs que Smith qualifie d’improductrices. M. Say dit que ces classes sont productrices de produits immatériels; mais telle est en même temps la nature qu'il assigne à ces produits, qu'autant vaudrait qu'il eût dit, comme Adam Smith, que les industries qui les créent ne sont pas du tout productives. En effet, les produits auxquels il donne le nom d'immatériels sont, d'après ses propres paroles, des produits qui ne s'attachent à rien, qui s'évanouissent à mesure qu'ils naissent, qu'il est impossible d'accumuler, qui n'ajoutent rien à la richesse nationale, qu'il y a du désavantage à multiplier, et dont [II-10] la nature est telle, finalement, que la dépense que l'on fait pour les obtenir est improductive.
On désigne par le nom de produits immatériels, dit M. Say, une utilité produite qui n'est attachée à aucune matière [12]; et il cite pour exemple l'ordonnance du médecin, l'opération du chirurgien, la consultation de l'avocat, la sentence rendue par le juge, l'air chanté par le musicien, le jeu de l'acteur qui représente une pièce de théâtre, etc. Ce qui caractérişe ces produits, ajoute-t-il, c'est qu'ils n'ont de durée que le temps même de leur production, et qu'ils doivent nécessairement êtreconsommés aų moment même qu'ils sont produits [13]. De la nature des produits immatériels, dit encore M. Say, il résulte qu'on ne saurait les accumuler, et qu'ils ne servent point à augmenter le capital national; le capital d'une nation ou il se trouverait une foule de musiciens, de prêtres, d'employés, ne recevrait de tout le travail de ces hommes industrieux aucun accroissement direct [14]. M. Say conclut également de la nature des produits immatériels qu'il n'est pas aussi avantageux de les multiplier que toute autre [II-11] espèce de produits [15]. Enfin il met la dépense faite pour les obtenir au rang des consommations stériles. C'est ainsi qu'après avoir (liv. 1, ch. 13, de son Traité) placé les services rendus par un instituteur, un moraliste, un juge, un administrateur, au nombre des produits les plus réels, les plus utiles, les plus nécessaires, il met (liv. 3, ch. 4 et 6) au rang des consommations improductives les dépenses faites pour obtenir ces produits. C'est par des consommations improductives, dit-il, que l'homme acquiert des connaissances, qu'il étend ses facultés intellectuelles, qu'il élève ses enfans, etc. Les dépenses qu'il fait pour son perfectionnement moral sont également des consommations improductives ; ces consommations n'ajoutent rien aux richesses de la société, comme on l'a répété trop souvent [16]. Bien que les fonctionnaires publics, lorsqu'ils rendent de véritables services, soient des travailleurs productifs, dit-il encore, leur travail n'augmente en rien le capital national: l'utilité qu'ils produisent est détruite à mesure qu'elle est produite, comme celle qui résulte pour les particuliers du travail des médecins et des autres producteurs de produits immatériels [17]. Les gouvernans, que [II-12] M. Say place au nombre des travailleurs productifs, lui paraissent néanmoins si peu producteurs, qu'il appelle la protection qu'ils procurent un avantage négatif, et dont on est peu touché; qu'il dit des sommes que leur paient les contribuables, qu'elles leur sont livrées gratuitement et sans compensation ; qu'il assimile enfin les impôts par eux perçus, en échange de leurs services, à une destruction pure et simple, pareille à celles qu'opèrent les fléaux naturels, comme la grêle, la gelée [18] . De telle façon que M. Say, qui commence par faire le procès à Smith, parce qu'il n'a pas placé le médecin, l'avocat, le juge, l'administrateur, au rang des travailleurs productifs, finit par aller plus loin que Smith mênie, et par assimiler à une perte sèche ce que l'on paie au gouvernement et à ses agens.
Ainsi voilà dans la société une multitude de travailleurs, non pas ceux dont les produits commencent par se réaliser dans les choses, mais ceux qui agissent directement sur les hommes, ceux qui s'occupent de la conservation de leur santé, du développement de leurs forces, de la culture de leur intelligence ou de leur imagination, de la direction de leurs facultés affectives et de la formation de leurs habitudes morales; voilà, dis-je, le médecin, le gymnasiarque, le savant, l'artiste, le [II-13] magistrat, le moraliste, qui ne sont pas du tout des producteurs, selon Smith et d'autres écrivains de son école, et qui, suivant M. Say, ne sont que des producteurs équivoques qui créent bien, il est vrai, des produits, mais des produits tels, que la dépense qu'on fait pour les obtenir est improductive, — qu'il y a du désavantage à les multiplier, qu'ils n'ajoutent absolument rien à la richesse sociale, — et cela par la raison qu'ils ne s'attachent à rien, qu'ils périssent à mesure qu'ils naissent, — et qu'il est impossible de les conserver et de les accumuler.
§ 4. Il me semble que, sur ce point très-capital, les idées ont besoin d'être mieux éclaircies qu'elles ne l'ont été par les fondateurs de la science. Je crois, sans vouloir porter la moindre atteinte aux droits qu'ils ont, sous tant d'autres rapports, à l'estime et à la reconnaissance des lecteurs, qu'ils nous donnent ici des notions peu justes de la nature des choses, et qu'ils n'ont compris qu'imparfaitement le rôle que jouent dans l'économie sociale et la part que prennent à la production les classes de travailleurs très-nombreuses et très importantes dont il s'agit en ce moment.
Il n'est pas exact de dire, selon moi, que le travail de ces classes ne contribue pas à la produce tion, ou, ce qui revient absolument au même, que [II-14] ce qu'elles produisent est consommé en même temps que produit. Ce qui est consommé en même temps que produit, c'est leur travail : il a cela de commun avec celui des travailleurs de toutes les classes ; mais l'utilité qui en résulte ne l'est certainement pas.
C'est faute d'avoir distingué le travail de ses résultats (et je prie qu'on prenne garde à cette distinction, car elle est des plus essentielles), e'est, dis-je, faute d'avoir distingué le travail de ses résultats, que Smith et ses principaux successeurs sont tombés dans l'erreur que je signale. Toutes les professions utiles, quelles qu'elles soient, celles qui travaillent sur les choses, comme celles qui opèrent sur les hommes, font un travail qui s'évanouit à mesure qu'on l'exécute, et toutes créent de l'utilité qui s'accumule à mesure qu'elle s'obtient. Il ne faut pas dire avec Smith que la richesse est du travail accumulé, il faut dire qu'elle est de l'utilité accumulée. Encore une fois, ce n'est pas lé travail qu’on accumule, c'est l'utilité le travail produit : le travail se dissipe à mesure qu'il se fait; l'utilité qu'il produit demeure [19] .
[II-15]
Très-assurément, la leçon que débite un professeur est consommée en même temps que produite, de même que la main-d'œuvre répandue par le potiér sur l'argile qu'il tient dans ses mains ; mais les idées inculquées par le professeur dans l'esprit des hommes qui l'écoutent, la façon donnée à leur intelligence, l'impression salutaire opérée sur leurs facultés affectives, sont des produits qui restent tout aussi bien que la forme imprimée à l'argile par le potier. Un médecin donne un conseil, un juge rend une sentence, un orateur débite un discours, un artiste chante un air ou déclame une tirade : c'est là leur travail; il se consomme à mesure qu'il s'effectué, comme tous les travaux possibles; mais ce n'est pas leur produit, ainsi que le prétend à tort M. Say : leur produit est dans le résultat de leur travail, dans les modifications utiles et durables que les uns et les autres ont fait subir aux [II-16] hommes sur lesquels ils ont agi, dans la santé que le médecin a rendue au malade, dans la moralité, l'instruction, le goût qu'ont répandus le juge, l'artiste, le professeur. Or, ces produits restent; ils sont susceptibles de se conserver, de s'accroître, de s'accumuler, et nous pouvons acquérir plus ou moins de vertus et de connaissances, de même que nous pouvons amasser plus ou moins de blé, de drap, de monnaie, et de toutes ces utilités qui sont de nature à se fixer dans les choses.
Il est vrai que l'instruction, le goût, les talens, sont des produits immatériels. Mais en créons-nous jamais d'autres ? et n'est-il pas surprenant de voir M. Say en distinguer de matériels et d'immatériels, lui qui a si judicieusement remarqué que nous ne pouvons créer la matière, et qu'en toutes choses nous ne faisons jamais que produire des utilités ? La forme, la figure, la couleur, qu'un artisan donne à des corps bruts sont des choses tout aussi immatérielles que la science qu'un professeur communique à des êtres intelligens; ils ne font que produire des utilités l'un et l'autre, et la seule différence réelle qu'on puisse remarquer entre leurs industries, c'est que l'une tend à modifier les choses, et l'autre à modifier les hommes.
On ne peut pas dire que les produits du professeur, du juge, du comédien, du chanteur, ne s'attachent à rien ; ils s'attachent aux hommes, de [II-17] même que les produits du fileur, du tisserand, du teinturier se réalisent dans les choses.
On ne peut pas dire qu'il est impossible de les vendre: ce qui ne se vend point, du moins dans les pays assez civilisés pour n'avoir plus d'esclaves, ce sont les hommes dans lesquels l'industrie les a fixés; mais quant à ces produits eux-mêmes, ils sont très-susceptibles de se vendre, et les hommes en qui ils existent les vendent en effet continuellement. L'industrie, les capacités, les talens, sont un objet d'échange comme les utilités de toute autre espèce; ces valeurs affluent de même sur le marché; le prix s'en établit absolument de la même manière, et la place est couverte de gens qui offrent de communiquer, moyennant une certaine rétribution, les qualités, les talens, les facultés, que l'art a fixés dans leur personne, de même qu'une foule d'autres marchands offrent de céder, à prix d'argent, les utilités que l'art a réalisées dans les choses qu'ils possèdent; seulement ceux-ci livrent les choses avec l'utilité qu'elles renferment, tandis que les premiers communiquent l'utilité qui est en eux, sans pour cela se livrer eux-mêmes [20] .
[II-18]
On ne peut pas dire que les valeurs fixées dans les hommes ne sont pas de nature à s'accumuler: il est aussi aisé de multiplier en nous-mêmes les modifications utiles dont nous sommes susceptibles, que de multiplier dans les choses qui pouş entourent les modifications utiles qu'elles peuvent recevoir.
On ne peut pas dire qu'il y a du désavantage à les multiplier: ce qu'on ne peut multiplier sans désavantage, ce sont les travaux nécessaires pour obtenir une espèce quelconque de produits; mais quant aux produits eux-mêmes, on ne peut sûrement pas dire qu'il y a du désavantage à les accroître: on ne voit pas plus les hommes se plaindre d'avoir trop d'industrie, de savoir, de bons sentimens, de vertus, qu'on ne les voit se plaindre de posséder trop d'utilités de quelque autre espèce [21] .
[II-19]
On ne peut pas dire que la dépense faite pour obtenir ces produits est improductive ; ce qui serait improductif, ce seraient les frais que l'on ferait inutilement pour les créer; mais quant aux frais nécessaires pour cela, ils ne sont pas improductifs, puisqu'il en peut résulter une véritable richesse, et une richesse supérieure à ses frais de production : il n'est sûrement pas rare que des talens acquis vaillent plus que la dépense faite pour les acquérir ; il n'est pas impossible qu'un gouvernement fasse naître, par une administration éclairée de la justice, des habitudes morales d'un prix très-supérieur à la dépense qu'il faut faire pour cela [22] .
[II-20]
On ne peut pas dire, enfin que ces produits n'ajoutent rien au capital national : ils l'augmentent aussi réellement que peuvent le faire des produits de toute autre espèce. Un capital de connaissances ou de bonnes habitudes ne vaut pas moins qu'un capital d'argent. Une nation n'a pas seulement des besoins physiques à satisfaire : il est dans sa nature d'éprouver beaucoup de besoins intellectuels et moraux; et, pour peu qu'elle ait de culture, elle placera la vertu, l'instruction, le goût, au rang de ses richesses les plus précieuses. Ensuite ces choses, qui sont de vraies richesses par elles-mêmes, par les plaisirs purs et élevés qu'elles procurent, sont en outre des moyens indispensables pour obtenir cette autre espèce de valeurs que nous parvenons à fixer dans les objets matériels. Il ne suffit pas en effet, pour produire celles-ci, de posséder des ateliers, des outils, des machines, des denrées, des monnaies: il faut des forces, de [II-21] la santé, de la science, du goût, de l'imagination, de bonnes habitudes morales, et les hommes qui travaillent à la création ou au perfectionnement de ces produits, peuvent à juste titre être considérés comme producteurs des richesses improprement dites" matérielles, tout aussi bien que ceux qui travaillent directement à les créer. Il est sensible, en un mot, que si une nation accroît son capital en étendant ses cultures, en améliorant ses terres, en perfectionnant ses usines, ses instrumens, ses bestiaux, elle l'accroît, à plus forte raison, en se perfectionnant elle-même, elle qui est la force par excellence, la force qui dirige et fait valoir toutes les autres.
Il est d'autant plus étrange qu'on refuse aux nombreuses classes d'ouvriers qui travaillent à l'éducation de l'espèce humaine le titre de travailleurs productifs, que les économistes qui leur refusent ce titre d'un côté le leur accordent presque tous d'un autre. C'est ainsi que Smith, après avoir dit, dans dans les passages de son livre que nous avons cités plus haut, que les gens de lettres, les savans et autres personnes semblables, sont des ouvriers dont le travail ne produit rien, dit expressément ailleurs que les talens utiles acquis par les membres de la société (talens qui n'ont pu être acquis qu'à l'aide de ces hommes qu'il appelle des travailleurs improductifs), sont un produit fixé et réalisé pour [II-22] ainsi dire dans les personnes qui les possèdent, et forment une partie essentielle du fonds général de la société, une partie de son capital fixe [23] . C'est ainsi que M. Say, qui dit des mêmes classes d'industrieux que leurs produits ne sont pas susceptibles de s'accumuler et qu'ils d'ajoutent rien à la richesse sociale, prononce formellement, d'un autre côté, que le talent d'un fonctionnaire public, que l'industrie d'un ouvrier (créations évidentes de ces hommes dont on ne peut accumuler les produits), forment un capital accumulé [24] . C'est ainsi que M. de Sismondi, qui, d'une part, déclare improductifs les travaux des instituteurs, etc., affirme positivement, d'un autre côté, que les lettres et les artistes (ouvrage incontestable de ces instituteurs) font partie de la richesse nationale [25] .
Comment des esprits si forts et si logiques ont-ils pu tomber dans une si évidente contradiction? Par une seule cause : parce qu'ils n'ont pas songé à distinguer ici le travail de ses résultats. Tantôt ils ont vu les produits du médecin, du professeur, du musicien, de l'artiste dramatique, dans leur travail, dans l'ordonnance de l'un, dans la leçon de l'autre, dans le chant ou le jeu du troisième et du quatrième, et alors ils ont dit, très-conséquemment, [II-23] qu'il était dans la nature de ces produits de ne pouvoir s'accumuler, de se consommer à l'instant même de leur naissance : il est clair, en effet, que l'air dont un musicien frappe nos oreilles, que le discours que débite un orateur, que le peu de mots qu'un médecin articule au chevet du lit de son malade, ne forment par eux-mêmes aucun produit qui puisse être retenu et mis en réserve: « Leur production, pour me servir des paroles mêmes de M. Say, leur production est de les dire, leur consommation de les entendre : ils sont consommés en même temps que produits [26] . » Tantôt, au contraire, les mêmes économistes ont vu les produits de ces classes de travailleurs, dans le résultat de leur travail, dans les forces et la santé que le médecin a rendues aux malades, dans la salutaire impression que le prêtre du haut de sa chaire a faite sur l'âme de ses auditeurs, dans les modifications utiles que le professeur a fait subir à l'intelligence de ses élèves ; et alors ils ont dit, très-conséquemment encore, que leurs produits étaient un capital fixé et réalisé dans les personnes mêmes sur lesquelles ils avaient agi. Cependant il est clair que les produits de ces travailleurs ne peuvent être à la fois une chose qui s'évapore et une chose qui se fixe, des valeurs qui [II-24] s'évanouissent en naissant et des valeurs qui s'accumulent à mesure qu'elles naissent. [27]
La vérité, pour ces travailleurs comme pour tous les industrieux possibles, c'est qu'il n'y a que leur travail qui s'évanouisse en s'opérant, et que, quant à leurs produits, ils sont aussi réels que ceux des classes les plus évidemment productrices. Que peut-on faire de mieux, en effet, pour accroître le capital d'une nation que d'y multiplier le nombre des hommes sains, vigoureux, adroits, instruits, vertueux, exercés à bien agir et à bien vivre? Quelle richesse, alors même qu'il ne s'agirait que de bien exploiter le monde matériel, pourrait paraître supérieure à celle-là? Quelle richesse est plus capable [II-25] d'en faire naître d'autres? Or, voilà précisément celle que produisent toutes les classes de travailleurs qui agissent directement sur les hommes, à la différence de celles qui ne travaillent pour eux qu'en agissant sur les choses. Un gouvernement, quand il est ce qu'il doit être, est un producteur d'hommes soumis à l'ordre public et rompus à la pratique de la justice; un véritable moraliste est un producteur d'hommes moraux; un bon instituteur est un producteur d'hommes éclairés; un artiste digne de ce nom est un producteur d'hommes de goût et d'ame, d'hommes exercés à sentir tout ce qui est bon et beau ; un maître d'escrime, d'équitation, de gymnastique, est un producteur d'hommes hardis, agiles, robustes; un médecin est un producteur d'hommes bien portans. Ou bien, si l'on veut, ces divers industrieux sont, suivant la nature de l'art qu'ils exercent, des producteurs de santé, de force, d'agilité, de courage, d'instruction, de goût, de moralité; toutes choses qu'on espère bien acquérir lorsqu'on consent à payer les services destinés à les faire naître, toutes choses dont le prix est, pour ainsi dire, coté; ayant par conséquent une valeur vénale, et formant la portion la plus précieuse et la plus féconde des forces productives de la société.
C'est donc à tort incontestablement que Smith regarde comme absolument improductifs, et M. Say [II-26] comme productifs seulement d'une sorte d'utilité fugitive, aussitôt détruite que créée, et n'ajoutant rien directement à la richesse sociale, les travaux des médecins, des instituteurs, des artistes, des officiers de morale, des fonctionnaires publics, et en général de toutes les classes de travailleurs dont l'industrie s'exerce immédiatement sur les hommes. Ce qui est détruit en même temps que produit, c'est le travail de ces industrieux : il a, je l'ai dit, cela de commun avec celui des industrieux de toutes les classes; mais quant aux résultats de leur travail, quant aux facultés qu'il développe dans l'homme, ce sont là des richesses réelles, durables, transmissibles, échangeables, tout comme celles que d'autres classes de travailleurs parviennent à attacher à des corps bruts, à la matière inanimée. On peut même dire que ces richesses sont plus susceptibles de conservation et d'accroissement que celles que nous parvenons à fixer dans la matière ; car nous ne pouvons user de celles-ci sans les détruire, ni les transmettre sans les perdre, tandis que les idées, les affections, les sentimens se perfectionnent par l'usage et s'accroissent par la communication.
Encore une fois, c'est donc limiter d'une manière très-peu exacte le sens du mot producteur que de le restreindre aux seuls industrieux dont l'activité s'épuise sur les choses et de le refuser à ceux qui [II-27] travaillent sur les hommes, ou bien de dire que ceux-ci sont moins producteurs que les autres, que leurs produits sont moins susceptibles de se conserver, de s'accumuler, d'ajouter à la masse de nos richesses. La seule différence réelle qu'il y ait tre ces deux grandes classes de travailleurs, c'est que les uns fixent dans les choses des utilités d'une certaine espèce, et les autres dans les hommes des utilités d'une autre espèce; que les uns donnent aux choses une multitude de formes, de figures, d'odeurs, de sons, de couleurs, de saveurs, et les autres aux hommes une multitude non moins grande de notions, de connaissances, de talens, d'aptitudes, d'habitudes, etc. Mais quant aux utilités que les uns fixent dans les choses, et à celles que les autres réalisent dans les hommes, ce sont également des utilités; ceux qui les produisent sont également des producteurs, et il faut dire, en parlant des uns et des autres, qu'ils concourent tous, chacun à leur façon, à la vie, à la prospérité, à la force, à la gloire, à la dignité de l'espèce humaine.
Ainsi il y a à faire entrer dans la société plusieurs classes d'individus que les économistes n'y ont pas encore admises, ou qu'ils n'y ont pas admis à leur vrai titre, ou qu'ils n'y admettent en quelque sorte que temporairement. Smith nie que les officiers civils et militaires, les ecclésiastiques, les gens de loi, les médecins, les gens de lettres, les [II-28] comédiens, les artistes de toute sorte soient des producteurs : on vient de voir qu'ils le sont, ou du moins qu'ils le peuvent être. — M. Say, en les tenant pour producteurs, dit qu'il est de la nature de leurs produits de s'évanouir en se produisant, de ne pouvoir s'accumuler, de ne rien ajouter à la richesse sociale : on vient de voir au contraire que leurs produits se conservent, qu'ils s'accumulent, et qu'ils contribuent à l'accroissement du capital social autant qu'aucune autre espèce de valeurs. -D'autres écrivains veulent que certains de ces travailleurs, notamment les magistrats et les agens de la force publique, ne soient destinés à figurer dans la société que pour un temps, observant que la nécessité de leurs services se fait de moins en moins sentir, et que leur importance sociale suit une marche décroissante [28] : il y a à répondre que le fonds sur lequel agissent les travailleurs dont il s'agit ici, n'est pas plus aisé à connaître, à régler, à épuiser, que les divers sujets sur lesquels agissent les travailleurs de toutes les autres classes. A la vérité, leur tâche, comme celle de toutes les industries, devient graduellement plus aisée ; mais nous n'avons aucun sujet de penser qu'elle sera un jour inutile, et par conséquent il n'y a pas plus [II-29] lieu de ne les admettre dans la société que provisoirement, que d'y admettre d'autres classes de travailleurs d'une façon purement provisoire.
Qu'il me soit permis, en terminant ce long paragraphe, de faire remarquer la lente gradation avec laquelle les idées se développent et la peine que la science éprouve à se former. D'abord les hommes d'aucune.classe n'étaient pour rien dans la création des biens de ce monde. La richesse était un don du ciel, existant dans la société de toutes pièces, y existant de toute éternité, passant des mains des uns dans celles des autres, se distribuant dans les proportions les plus inégales et les plus variées, mais n'éprouvant d'ailleurs aucune altération dans sa masse et n'étant susceptible ni d'augmentation ni de diminution. Arrive la secte des économistes, qui, frappée de la force végétative du sol, reconnaît aux hommes qui sollicitent cette force, aux agriculteurs le pouvoir d'accroître la masse des richesses, mais qui refuse ce pouvoir à toutes les autres classes de la société. Plus tard, on étend la même puissance de produire aux hommes qui font subir d'utiles transformations aux matériaux fournis par l'agriculture, aux manufacturiers, mais sans l'accorder encore aux agens du commerce : on déclare positivement, au contraire, que le commerce n'est pas créateur [29] . Ensuite [II-30] cependant on fait la remarque que cette industrie transporte, distribue les produits que les autres transforment, et qu'en leur donnant cette dernière façon, en les faisant arriver ainsi sous la main du consommateur qui les réclame, elle ajoute encore à la valeur qu'ils avaient déjà : le commerce est donc rangé au nombre des industries productives. Mais après qu'on a reconnu ainsi successivement à toutes les industries qui travaillent sur les choses, le pouvoir d'accroître la masse des valeurs répandues dans la société, on refuse encore ce pouvoir à tous les arts qui s'occupent de la culture de l'espèce, aux arts qu'exercent l'homme d'état, le magistrat, le professeur, etc.; on en parle comme on avait parlé d'abord des manufactures et du commerce : on convient qu'ils sont utiles, mais on les déclare formellement improductifs. Bientôt pouryant on veut essayer de prouver qu'ils contribuent aussi à la production; mais sans réussir à montrer comment en effet ils y concourent : con: fondant leurs produits et leur travail, et voyant leurs produits dans leur travail même, on dit que leurs produits s'évanouissent en naissant, parce qu'en effet leur travail se dissipe à mesure qu'il s'exécute. Enfin, distinguant de leur action les résultats qu'elle produit, je crois avoir réussi à établir nettement que leur action, comme celle de tous les arts, laisse après elle, quand elle est bien [II-31] dirigée, les résultats les plus réels et les plus utiles. Ainsi l'on n'a commencé que fort tard à s'apercevoir que les richesses sociales étaient l'ouvrage de la société, et ce n'a été qu'après une longue suite de tâtonnemens et d'hésitations que l'on est parvenu à reconnaître peu à peu que toutes les professions de la société, depuis celle du simple laboureur jusqu'à celle de l'homme d'État, depuis les plus mécaniques jusqu'aux plus intellectuelles, concouraient immédiatement, chacun à leur façon, à l'accroissement des forces, des vertus, des talens, des utilités, des valeurs de toute espèce dont se compose le capital national.
§ 5. Mais en disant que toutes les professions de la société peuvent contribuer à la production, faut-il admettre qu'elles y contribuent dans toutes les circonstances ? Il y a ici une seconde erreur fort singulière à relever. Tandis que, dans les idées communes, on n'appelle productives que de certaines classes d'hommes, on voudrait étendre cette qualification à toutes leurs manières d'agir. D'une part, il n'y a de créateurs de la richesse que les travailleurs dont les produits se réalisent dans les choses; et, d'un autre côté, ces hommes-ci sont des producteurs, des gens d'industrie, quelque usage d'ailleurs qu'ils fassent de leurs facultés. Un capitaliste se rend-il complice [II-32] d'une entreprise injuste en prêtant les fonds nécessaires pour l'exécuter? c'est là le fait d'un industriel. Un armateur loue-t-il ses navires pour porter à Chio la troupe qui doit en exterminer les habitans ? il fait un acte d'industrie. Lorsque les marchands génois, établis dans les faubourgs de Constantinople, trahirent les Grecs leurs alliés, et livrèrent la ville aux Turcs, avec qui ils espéraient faire les mêmes affaires qu'avec les Grecs, ils furent fidèles à l'esprit de leur profession, ils firent un acte de commerce.
Les hommes d'industrie font de mauvaises actions, les mauvaises actions sont des actes d'industrie : voilà sûrement deux propositions fort différentes. Il peut se commettre des crimes dans toutes les professions; il s'en commet malheureusement dans toutes : s'ensuit-il que le crime est une création d'utilité, et que celui qui s'en rend coupable fait l'acte d'un homme d'industrie?
Ce qui fait d'un homme un travailleur productif, ce n'est pas la profession qu'il exerce, mais la manière dont il agit; ce n'est pas l'instrument dont il se sert, mais la manière dont il en use. Toutes les professions de la société peuvent être dites industrielles, puisque toutes, on vient de le voir, peuvent concourir à la production; mais il est clair qu'aucune ne l'est quand elle fait un usage destructif de ses forces. Le paysan qui emploie le soc de [II-33] sa charrue à labourer sa terre est dans ce moment un homme d'industrie: il ne sera plus qu'un meurtrier s'il vient à se servir de son outil pour assommer un homme. Un banquier participe de ses fonds à l'exécution d'un ouvrage utile, c'est de l'industrie : il concourt de son argent au succès d'une guerre inique, c'est du brigandage. Un fabricant est un homme d'industrie lorsqu'il emploie son intelligence à perfectionner ses ateliers ou ses machines, et un chevalier d'industrie lorsqu'il se sert de son esprit pour obtenir de l'autorité qu'elle le délivre de la concurrence qu'il redoute, et qu'elle force les consommateurs à lui acheter chèrement ce qu'ils pourraient avoir ailleurs à bon marché. Un législateur, un prince, un magistrat sont des industrieux du premier ordre quand ils répriment les malfaiteurs, quand ils corrigent leurs inclinations malfaisantes; et ils sont eux-mêmes des malfaiteurs de la pire espèce quand ils emploient la force que la société leur a confiée, à commettre, pour leur compte, des crimes pareils à ceux qu'ils sont chargés à de réprimer. Dans l'état actuel de la société en Europe, il y a peu de professions qui soient complétement productives; il y en a peu qui soient purement spoliatrices. Chez nous, un boulanger, un boucher, un imprimeur, un courtier, un agent de change, un notaire, sont gens d'industrie par l'art qu'ils exercent, et hommes d'exaction par le [II-34] monopole dont ils jouissent. Un même magistrat peut être à la fois homme d'industrie, producteur d'utilité, en ce sens qu'il peut contribuer, sous certains rapports, à faire naître de bonnes habitudes civiles, et agent de tyrannie, destructeur d'utilité, en ce sens que, d'un autre côté, il peut donner lui-même l'exemple de l'injustice et contribuer à dépraver la société. Bref, le fabricant, le banquier, le juge, le militaire, les hommes de toutes les professions peuvent être des hommes d'industrie, puisque tous peuvent faire de leurs forces un usage très-utile, très-productif, très-propre à accroître nos facultés de telle ou telle espèce; mais si le militaire met son épée au service du despotisme, si le juge lui vend sa conscience, si le banquier lui loue son argent, si le fabricant lui achète des privilèges iniques, il est clair qu'ils devront tous recevoir une autre qualification. On ne peut pas plus appeler homme d'industrie l'homme de Nantes qui fait la traite des noirs, que l'homme de Tripoli qui fait la traite des blancs; l'armateur qui loue ses navires aux assassins des Grecs, que l'officier impérial qui les assiste de son sabre; le marchand d'argent qui va offrant sa bourse à toutes les tyrannies solvables, que l'homme d'État qui trafique avec elles de ses conseils. De quelque manière que l'on participe à une action nuisible, on n'est point homme d'industrie en y prenant part. Je ne dis pas qu'il y [II-35] ait toujours de la vertu à produire; je dis que le crime n'est jamais productif; je dis qu'après une mauvaise action il y a destruction, déplacement, mais jamais augmentation de richesse dans le monde ; je dis en un mot que le brigandage, quels que soient les instrumens qu'il emploie et la manière dont il en use, doit toujours être distingué très-soigneusement de l'industrie [30] .
§ 6. On abuse donc également des termes quand on n'étend le mot d'industrieux, de producteur, qu'à de certaines classes d'hommes, et quand on cherche [II-36] à l'étendre à toutes leurs manières d'agir; quand on ne veut l'accorder qu'aux travailleurs qui agissent sur la matière, et quand on le leur donne encore alors qu'ils s'enrichissent par des méfaits. La véritable société industrielle ne serait pas celle où l'on ne verrait que des agens de l'agriculture, de la fabrication, du commerce; mais celle où toutes les professions, depuis celle du dernier artisan jusqu'à celle du premier magistrat, seraient dégagées de tout mélange d'injustice et de violence. De sorte que l'état social dont il s'agit ici c'est la société même au sein de laquelle nous vivons, moins ce qu'il y peut avoir de gens qui s'enrichissent en dépouillant les autres; ou plutôt, comme il n'est guère de professions, même dans le nombre des plus honorables, qui ne doivent, légalement ou illégalement, une partie de leurs bénéfices à des moyens que la justice désavoue, c'est l'ensemble de toutes les professions utiles, moins ce qu'il s'y mêle de privilèges, de monopoles, d'exactions ou de toute autre espèce d'injustices, injustices qui ne font partie essentielle d'aucune de ces professions, et qui, dans aucun cas, ne peuvent être considérées comme productives d'utilité, ni par conséquent être confondues avec l'industrie.
Après de semblables explications, il serait assez superflu de dire que, dans une société pareille, il n'y a de place pour aucun ordre privilégié. Rien [II-37] sans doute n'empêche d'y admettre les hommes à qui, par un sentiment de courtoisie, on accorde encore des qualifications nobiliaires ; car ces hommes, par leurs qualités morales, par leurs talens, par leurs terres, par leurs capitaux de toute espèce, peu: vent rendre des services importans et variés; mais il est évident qu'ils n'y peuvent figurer qu'au même titre que tout le monde, c'est-à-dire comme hommes utiles et non comme privilégiés. En cette dernière qualité, il n'y a nul moyen de les y comprendre ; car, en cette qualité, ils ne sont rien moins que producteurs ; ce qu'ils gagnent à ce titre n'est pas la mesure de ce qu'ils produisent, mais de ce qu'ils extorquent; ils ne contribuent pas à la vie de la société, ils vivent de sa vie ; ils se nourrissent de sa substance.
« Ne demandez point, disait énergiquement et très-sensément l'abbé Sieyes, quelle place des classes privilégiées doivent occuper dans l'ordre social : c'est demander quelle place on veut assigner dans le corps d'un malade à l'humeur maligne qui le mine et le tourmente. Il faut neutraliser cette humeur; il faut rétablir la santé et le jeu de tous les organes assez bien pour qu'il ne se forme plus de ces combinaisons morbifiques propres à vicier les principes les plus essentiels de la vitalité [31] . »
[II-38]
Ainsi il y a ici des hommes d'État, des légistes, des militaires, des prêtres, des savans, des artistes, des laboureurs, des fabricans: il y a tout un concours de professions, tout un ensemble d'organes qui participent de mille façons au mouvement, à la vie, au développement du corps social: mais on ne sait ce que c'est que démocratie, aristocratie, noblesse, clergé, bourgeoisie; et rien de tout cela, avec ses prétentions diversement dominatrices, ne peut venir prendre place dans une société où nul ne vit que des utilités qu'il crée par lui-même ou par les choses qu'il possède, ou bien de celles qu'il peut obtenir par l'échange d'une partie de celles-là contre des utilités créées par d'autres. Notons bien surtout que cet état n’exclut pas seulement les privilèges d'un ordre supérieur. Si, à l'époque où furent convoqués les états-généraux, les nombreuses communautés du tiers-état avaient voulu, à la manière du clergé et de la noblesse, venir figurer à l'assemblée nationale pour y défendre, chacune de leur côté, leurs iniquités, leurs exactions, leurs voleries particulières, ces prétentions, tout aussi intolérables que celles des ordres supérieurs, n'auraient pas dû davantage être tolérées. En leur qualité de monopoleurs, en effet, les corps d'arts et métiers n'étaient pas moins en dehors de la société que le clergé et la noblesse, et par conséquent ils ne pouvaient figurer davantage [II-39] dans une assemblée où devaient se trouver seulement les représentans de toutes les professions hon, nêtes et utiles de la nation.
§ 7. On vient de voir quels sont les actes qu'il est impossible de comprendre sous le mot industrie, et quel est l'ensemble des professions que la société industrieuse embrasse. On me demandera peut-être maintenant dans quel ordre ces professions veulent être classées. Je répondrai qu'il paraît impossible de leur assigner aucun ordre; qu'il n'y a, parmi elles, ni première ni dernière; qu'elles sont dans une dépendance mutuelle ; que chacune a besoin de toutes les autres; que toutes concourent à la vie de chacune. Y a-t-il un ordre, diles, moi, entre les divers appareils qui contribuent à la vie de l'individu? A quel organe appartient la première place ? Est-ce au système nerveux, à l'encéphale, aux poumons, au cæur, à l'estomac? Elle n'appartient à aucun ; elle appartient à tous; aucun ne peut se passer des autres; tous travaillent à l'entretien de la vie commune. Eh bien, il en est absolument de même des divers ordres de professions qui entrent dans l'économie de la société. Les arts qui approprient les objets matériels aux besoins de l'homme; ceux qui préparent l'homme à l'exploitation du monde matériel; ceux qui cultivent sa nature physique, ceux qui font l'éducation de son [II-40] intelligence ou de son imagination, ceux qui donnent des soins à ses facultés affectives, tous sont essentiels, tous sont honorables, tous présentent des difficultés et demandent, pour être bien exercés, une réunion de talens et de qualités morales malheureusement assez rares. Une fabrique agricole n'est pas moins importante qu'une fabrique judiciaire; il n'est pas plus aisé de gouverner une école ou une manufacture que de diriger un tribunal; ni de régir une grande maison de commerce ou de banque que de conduire un ministère. Il n'y a que la fatuité la plus sotte et la plus stupide qui puisse chercher à constituer quelqu'une des grandes divisions de l'industrie humaine dans un état d'infériorité. Il y a sans doute, dans la société en général, et dans chaque ordre de professions en particulier, des hommes bien élevés et des hommes mal élevés, des hommes forts et des hommes faibles, des hommes pauvres et des hommes riches, partant des hommes fort inégalement placés dans l'estime et la considération de leurs semblables. Il y a aussi dans chaque entreprise particulière une subordination indispensable de ceux qui exécutent à ceux qui dirigent, des ouvriers aux chefs d'atelier, des chefs d'atelier au chef d'entreprise. Mais il n'y a d'ailleurs de subordination obligée d'aucune classe de professions à aucune autre. L'ordre particulier de travaux à qui l'on donne le nom de gouvernement [II-41] ne gouverne ou ne devrait gouverner que sa spécialité, spécialité qui consiste surtout à réprimer les prétentions injustes, à corriger les penchans anti-sociaux; et, loin que les autres professions dépendent naturellement de celle-ci, il semble que celle-ci, par sa nature même, devrait être la plus dépendante de toutes, puisque, à la différence des autres, qui agissent de leur propre mouvement, parce qu'elles agissent pour leur propre compte, elle n'agit que pour le compte et par conséquent ne devrait agir que sur le mandat de la société.
§ 8. De toutes les professions qui entrent dans l'économie sociale, il n'en est pas une qui n'ait l'homme pour objet; mais toutes n'ont pas l'homme pour sujet. J'ai déjà fait entendre qu'elles se divisaient en deux grandes classes, dont l'une se compose de toutes les industries qui approprient les choses aux besoins de l'homme, et l'autre de tous tes celles qui s'exercent directement sur lui. Je m'occuperai d'abord des premières. Je traiterai ensuite des secondes.
Cependant mon travail serait incomplet, si je m'arrêtais là. Il y a, en dehors de tous les travaux que la vie du corps social nécessite, de certains ordres de faits, d'actions, de fonctions, comme on voudra les appeler, qui ne sont point des industries, mais que toutes les industries ont besoin [II-42] d'exécuter, et que toutes sans distinction exécutent. Tels sont les faits de s'associer, d'échanger, de tester. S'associer en vue d'un travail à faire n'est sûrement pas travailler; mais il n'est pas un ordre de travaux dans lequel on n'ait besoin, pour réussir dans ses entreprises, de former diverses sortes de sociétés, de ligues, de coalitions. Vendre, acheter, échanger les fruits du travail n'est pas non plus travailler; mais il n'est pas une classe de travailleurs qui ne se trouve dans l'indispensable nécessité de présenter sur la place les utilités qu'elle crée, pour se procurer, avec le prix de celles-là, toutes celles dont elle a besoin, et que d'autres classes produisent. Transmettre, au moment de sa mort, la fortune qu'on a créée par son travail n'est pas non plus travailler; mais les progrès de la société se lient étroitement au fait même de cette transmission et à la manière dont elle s'effectue.
Pour donner une idée complète de l'économie de la société, il faudra donc, après avoir parlé des principaux ordres de travaux qu'elle embrasse, que je m’occupe aussi des fonctions que je viens d'indiquer. Mais, avant tout, j'ai besoin d'exposer les conditions générales auxquelles la puissance de toutes les professions et de toutes les fonctions se lie. Il ne me restera plus ensuite qu'à faire connaître de quelle manière et jusqu'à quel point ces principes généraux s'appliquent à chaque ordre de professions et de fonctions en particulier.
[II-43]
CHAPITRE XIV.
Des conditions auxquelles toute industrie peut être libre.↩
§ 1. Si, comme on vient de le voir dans le précédent chapitre, les économistes n'ont pas réussi à déterminer la part que certaines classes de producteurs prennent à la production, et le droit qu'ils ont de figurer dans la société industrielle; s'ils n'ont pas assez fait voir quel est l'ensemble de professions et de fonctions qui entrent dans l'économie de cette société et qui concourent au développement de ses forces, ils n'ont pas non plus suffisamment montré, du moins je le pense, par quels moyens les diverses professions produisent, et à quel ensemble de causes se lie la puissance de leur action. M. J.-B. Say, celui de ces écrivains, à ma connaissance, qui a fait des moyens généraux de l'industrie l'analyse la plus détaillée et la plus étendue, me paraît loin néanmoins d'en avoir fait une description complète, et même, à plusieurs égards, une description exacte.
§ 2. D'abord, et avant d'entrer dans l'examen de cette analyse, je regretterai, avec quelques [II-44] économistes, que M. Say ait assigné à la production plusieurs causes originaires, et voulu que l'homme fût redevable des acquisitions qu'il a faites, non pas seulement à ses efforts, sans lesquels pourtant toutes les forces répandues dans la nature, à commencer par ses propres facultés, eussent été nulles pour lui, mais tout à la fois à ses efforts et au concours de la nature et des capitaux, qui, dès l'origine, suivant M. Say, auraient travaillé à ses progrès conjointement avec lui-même.
« Il existe autre chose que du travail humain dans l'œuvre de la production, dit-il... L'industrie, abandonnée à elle-même, ne saurait donner de la valeur aux choses; il faut qu'elle possède des produits déjà existans, et sans lesquels, quelque habile qu'on la suppose, elle demeurerait dans l'inaction; il faut, de plus, que la nature se mette en communauté de travail avec elle et avec ses instrumens. »
L'industrie, d'après M. Say, ne figure jamais qu'en tiers dans l'acte de la production ; il y a dans tout produit une partie de l'effet obtenu qui vient de la nature, et un autre qui vient des capitaux.
Je crains, comme je l'ai déjà dit ailleurs [32] , qu'en assignant ainsi plusieurs causes primitives à la production, M. Say n'ait porté quelque confusion là où il voulait introduire un plus grand ordre, et qu'il [II-45] n'ait obscurci, au lieu de l'éclaircir, la source primitive de tous nos progrès. Je crois, avec Adam Smith, et particulièrement avec M. de Tracy, qui, là-dessus, a été encore plus net que Smith, que le travail en a été la seule cause génératrice.
Sans doute, l'activité humaine n'est pas la seule force qu'il y ait dans la nature. En dehors de celle-là, il en existe une multitude d'autres que l'homme n'a point créées, qu'il ne saurait détruire, dont l'existence est tout-à-fait distincte et indépendante de la sienne. Il y a des forces mortes, et il y en a de vives. La dureté, la résistance, la ductilité de certains métaux, sont des forces inertes. Le soleil, l'eau, le feu, le vent, la gravitation, le magnétisme, la force vitale des animaux, la force végétative du sol, sont des forces actives. Mais si ces forces existent, rien n'annonce en elles qu'elles existent pour l'homme : laissées à elles-mêmes, elles se montrent parfaitement indifférentes à son bonheur; pour qu'elles le servent, il faut qu'il les plie à son service; pour qu'elles produisent, il faut qu'il les force à produire. L'homme ne les crée pas sans doute ; mais il crée l'utilité dont elles sont pour lui; il les crée comme agens de production, comme forces productives. Il est encore vrai qu'il a plus ou moins de peine à se donner pour cela : toute espèce d'acier n'est pas également propre à છે faire une lime; toute espèce de sol ne se laisse pas [II-46] rendre également apte au travail de la végétation; mais il faut qu'il mette la main à toutes choses, et naturellement rien n'est arrangé pour le servir. A quoi auraient servi pour la production les qualités du fer, si l'industrie n'eût imprimé à ce métal les formes propres à rendre ses qualités utiles ? A quoi aurait servi le vent pour faire tourner la meule sans les ailes du moulin? A quoi servait le fluide magnétique, pour diriger les navigateurs, avant l'invention de la boussole? A quoi serviraient la pluie et le soleil, pour faire germer les plantes, sans le travail préalable qui présente à la rosée du ciel et à la chaleur des rayons solaires le sein d'une terre labourée et ensemencée? Encore une fois, les forces de la nature existent indépendamment de tout travail humain ; mais, relativement à l'homme, et comme agens de production, elles n'existent que dans l'industrie humaine et dans les instrumens au moyen desquels l'industrie s'en est emparée. C'est elle qui a créé ces instrumens, c'est elle qui en dirige l'usage. Elle est la source unique d'où sont sorties, non pas les choses, ni les propriétés des choses, mais toute l'utilité qu'elle tire des choses et de leurs propriétés.
M. Say a donc tort, je crois, lorsqu'il dit que la richesse est venue originairement de la combinaison de trois forces : l'industrie, les capitaux et les agens naturels, parmi lesquels il fait jouer un rôle [II-47] particulier aux fonds de terre. L'industrie, dit-il, serait restée dans l'inaction sans le secours d'un capital préexistant. Mais, s'il en est ainsi, l'on ne conçoit plus comment elle a pu commencer d'agir; car il est bien évident que l'existence des capitaux n'a pu devancer le travail qui les a fait naître. Pour approprier les choses à son usage, l'homme n'eut d'abord que son intelligence et ses bras. Bientôt, à l'aide de ces leviers, il s'en procura d'autreś? il mit des outils au bout de ses doigts; il remplaça ces outils par des machines; il ajouta à ses forces celles des animaux, celles des métaux, celles de l'eau, du feu, du vent. Peu à peu; toutes les puissances de la nature, subjuguées sous sa direction les unes par les autres, entrèrent sans confusion à son service, et se mirent à travailler pour lui. Les capitaux, qui se composent de l'ensemble des forces qu'il a ajoutées ainsi au peu qu'il avait en sortant des mains de la nature, y compris les développemens successifs de ses propres facultés, les capitaux sont de création humaine. La terre, à son tour, n'est qu'un capital. Un fonds de terre, ainsi que l'observe très-bien M. de Tracy [33] , n'est, comme un bloc de marbre, comme une masse de minerai, qu'une certaine portion de matière, douée [II-48] de certaines propriétés, et que l'homme peut disposer, ainsi qu'une multitude d'autres choses, de manière à rendre ses propriétés utiles. L'homme ne crée pas cette matière, ni les propriétés qu'elle a, pas plus qu'il ne crée la matière, ni les propriétés de la matière, dont sont formées cent autres espèces de capitaux; mais il crée le pouvoir de tirer parti des unes et des autres; il les crée comme instrumens de production; et ces forces, que M. Say fait agir, dès l'origine, conjointement avec l'industrie humaine, sont elles-mêmes des créations de l'industrie, et doivent être comprises au nombre des moyens qu'elle s'est donnés et des agens qu'elle s'est faits à mesure qu'elle a développé ses propres forces.
Ainsi l'homme a créé tous ses pouvoirs, à commencer par ceux qu'il possède en lui-même. Il n'a créé sans doute ni ses propres facultés, ni les forces répandues dans la nature; mais tout le pouvoir qu'il a de tirer parti des unes et des autres, c'est lui, encore un coup, qui sé l'est donné.
§ 3. Ensuite, et après avoir ainsi rejeté, comme il convenait de le faire, les forces que M. Say fait agir, dès l'origine, conjointement avec l'homme, parmi les moyens généraux de production que l'homme s'est créés, je répéterai qu'il ne me paraît pas avoir fait de ces moyens une analyse [II-49] suffisamment complète, ni même suffisamment exacte.
J'observe, en premier lieu, que l'auteur du Traité d'économie politique exclut de la masse de nos fonds productifs, ainsi que l'avait fait l'auteur de la Richesse des nations, toute cette partie du fonds général de la société qui est employée à satisfaire des besoins, publics ou privés, particuliers ou généraux [34] . Ainsi toute la partie de ce fonds, que les individus emploient à entretenir leurs forces physiques, à étendre leurs facultés intellectuelles, à perfectionner leurs habitudes morales, à élever les enfans qui les seconderont un jour, ne fait point partie de leurs moyens de production. Ainsi encore toute la partie du même fonds qui est employée à satisfaire des besoins publics, et, par exemple, à maintenir l'ordre dans la communauté, à faire naître parmi ses membres des habitudes de respect pour les biens et pour les personnes, à procurer quelque instruction aux classes qui naturellement n'en recevraient point, ne fait pas partie non plus du fonds productif de la société. Tout cela sert à satisfaire des besoins, sans doute, et même des besoins très-impérieux; tout cela est productif d'utilité, d'agrément, mais [II-50] non de richesse : l'emploi qu'on en fait n'ajoute rien aux ressources et aux forces de la société [35] .
J'avoue que ceci m'affecte comme une erreur des plus évidentes. Il m'est absolument impossible d'admettre que la partie de ses moyens qu’un manufacturier emploie à l'entretien de son usine fasse partie de son capital productif, et que celle qu'il emploie à s'entretenir lui-même, lui qui est le chef de l'usine et le premier agent de la production manufacturière, n'en fasse pas partie; il m'est impossible d'admettre que les bâtimens, les fourrages, qu'un agronome emploie à la conservation de ses animaux de labour fasse partie de son capital productif, et que sa maison d'habitation, ses meubles, ses vêtemens, ses comestibles et toute la portion de sa richesse qui est employée à le conserver, lui, le chef et le premier agent de la production agricole, n'en fasse pas partie. Il y a probablement dans la société un certain nombre d'hommes absolument nuls; il y en a qui, sans être nuls, sont fainéans, et qui peuvent être considérés comme un capital qui chôme et qui chômera toujours. Il y en a qui consacrent le peu qu'ils ont d'activité uniquement à se faire vivre, à se faire jouir, à se procurer des sensations agréables. Que l'on retranche du capital productif de la société toute la partie de son [II-51] fonds général qui est employée à entretenir de tels êtres, je le veux bien. Mais s'il y a, de par le monde, beaucoup de gens qui ne vivent que pour jouir, il y en a heureusement beaucoup d'autres qui vivent pour agir, qui placent leur bonheur à faire quelque bon emploi de leurs forces, et qui font en effet de leurs forces l'usage le plus utile à l'humanité. Or, je ne puis comprendre, encore un coup, comment on peut retrancher du capital productif de la société la partie de son fonds qu'elle emploie à entretenir convenablement ces hommes, eux qui sont assurément de tous ses produits le plus précieux, le plus noble, le plus fécond, celui sans lequel il n'en existerait aucun autre. Tout ce qu'un homme nul dépense pour la satisfaction de ses besoins est perdu ; il n'en résulte que l'entretien d'un homme inutile. Tout ce qu'un homme utile donne à ses plaisirs sans profit pour la conservation ou l'accroissement de ses facultés est également perdu; il ne reste rien de cette dépense. Mais ce que le même individu consacre à l'entretien ou à l'extension de ses forces, pour peu que les forces conservées ou acquises vaillent plus que la dépense faite pour les acquérir ou les conserver, est employé reproductivement et fait partie de ses moyens de production, cela est incontestable [36] .
[II-52]
Dans cette masse de moyens de toute sorte dont se compose le fonds productif général de la société, Smith avait déjà discerné un grand nombre de moyens et de forces : il y avait vu des matières premières plus ou moins brutes, plus ou moins travaillées; des instrumens de métier et des machines de toute sorte destinés à faciliter et à abréger le travail; des bâtimens consacrés à toute espèce de travaux; des terres mises dans l'état le plus propre à la culture et au labourage; une multitude de talens et de connaissances utiles acquises par les membres de la société; un certain ensemble de monnaies destinées à faciliter les échanges, etc.; et, de tous ces moyens, il avait formé deux classes de capitaux, le capital fixe et le capital circulant, destinés l'un et l'autre à entretenir ce fonds de consommation dans lequel les hommes puisent tous les moyens de conserver et de perfectionner leur existence.
M. Say a été plus loin que Smith et a mieux fait à quelques égards. Il divise d'abord le fonds productif de la société en deux grandes parts, dont l'une se compose des facultés industrielles des travailleurs, et l'autre de leurs instrumens. Puis [II-53] il distingue, parmi les facultés industrielles, celles des savans, celles des entrepreneurs, celles des ouvriers ; et, parmi les instrumens, les agens naturels non appropriés, tels que la mer, l'atmosphère, la chaleur du soleil et toutes les lois de la nature physique ; les agens naturels appropriés, tels que les terres cultivables, les cours d'eau, les mines, etc. ; et les capitaux, parmi lesquels il distingue des capitaux improductifs, des capitaux productifs d'utilité ou d'agrément, et des capitaux vraiment productifs; divisant encore ces derniers en capitaux fixes et en capitaux circulans, et donnant une attention particulière à ceux qui existent sous forme de machines et à ceux qui existent sous forme de monnaie, tandis que Smith n'a décrit que les fonctions de la monnaie, et n'a pas parlé de l'influence des machines.
Telle est l'analyse de M. Say.
C'est sûrement avoir fait un progrès dans la décomposition de ce vaste amas de leviers et de forces dont se compose le fonds général de la société, que d'avoir distingué des instrumens de l'industrie les facultés industrielles elles-mêmes. Mais en maintenant cette distinction essentielle entre l'industrie et ses instrumens, ou plutôt en formant deux classes bien séparées des forces que l'homme possède en lui-même, et de celles qu'il puise dans [II-54] les choses, je crois qu'il y a une nouvelle analyse à faire des unes et des autres.
Parlons d'abord de celles qui existent dans l'homme même.
M. Say ne remarque ici qu'un fonds de facultés industrielles. Nous verrons bientôt qu'il y a, et que, dans l'intérêt de la production, il importait d'y voir autre chose que de l'industrie. Mais ne nous occupons d'abord que du fonds industriel. M. Say ne distingue, dans le fonds industriel, que les trois capacités du savant, de l'entrepreneur et de l'ouvrier, ou bien de la théorie, de l'application et de l'exécution. J'observe qu'il confond ici deux ordres de facultés très-distinctes, et qu'il était on ne peut plus essentiel de distinguer: celles qui tiennent aux affaires, et celles qui tiennent à l'art.
L'esprit des affaires se compose de plusieurs genres de facultés que M. Say n'a point décrites, ni même désignées.
L'ordre qu'il assigne à la science dans les facultés qui tiennent à l'art, n'est pas, je crois, le véritable : les choses, dans ce monde, n'ont pas commencé par la théorie ; une certaine connaissance pratique du métier a devancé l'instruction scientifique. On a commencé par agir empiriquement; puis sont venues les connaissances théoriques; puis [II-55] le talent des applications, que M. Say place dans les attributions de l'homme d'affaires, et qui est bien plus dans le domaine des gens de l'art; enfin l'exécution a suivi la pensée, et a été plus ou moins habile selon que la pensée elle-même a été plus ou moins éclairée.
Dans tout cela, comme on voit, il n'est question que d'adresse, d'habileté, de science, de capacité.
Mais, quoi ? n'y a-t-il donc que cela dans l'homme, et ne lui faut-il, pour produire, aucun autre ordre de facultés? N'existe-t-il pas en lui des vertus aussi-bien que de la science, et n'est-il pas essentiel que le savoir-faire soit un peu aidé par le savoir-vivre? Un fonds de bonnes habitudes morales est-il moins qu'un fonds de facultés industrielles nécessaire à l'œuvre de la production? Je signale ici, ce me semble, dans l'analyse de M. Say, une grande et bien fâcheuse lacune.
On peut apercevoir déjà combien cette analyse laisse à désirer en ce qui touche à la première partie du fonds social, c'est-à-dire à celle qui se compose de toutes les forces que les travailleurs possèdent en eux-mêmes.
Passons à la description des forces que les travailleurs puisent dans les choses.
J'ai dit que M. Say distingue ici des agens naturels non appropriés, des agens naturels appropriés et des capitaux.
[II-56]
J'observe d'abord que les forces qu'il désigne par le nom d'agens naturels non appropriés, telles que toutes les lois de la nature physique, ne sauraient être considérées comme des instrumens de l'industrie, tant que l'homme ne s'est pas emparé de leur puissance. Ces agens n'existent réellement pour lui que dans les ouvrages, que dans les machines par lesquelles il les a subjugués. Je crois, avoir rendu plus haut cette vérité palpable.
Du moment qu'il n'y a pour l'homme d'agens naturels que ceux dont il s'est emparé, que ceux dont il dispose à l'aide de ses machines, il est clair qu'il n'y a pas à distinguer des agens non appropriés et des agens appropriés. Il n'existe réellement pour l'industrie que des agens appropriés.
Dans le nombre des agens appropriés, je ne puis découvrir absolument aucune raison pour faire deux classes séparées des capitaux et des fonds de terre. Rien, en effet, ne me semble distinguer la terre végétale ou minérale des autres objets de la nature dont l'homme s'est emparé et qu'il a pliés à son service. La distinction entre la terre et les capitaux: serait donc encore à écarter.
Dans la masse des capitaux, M. Say en distingue d'improductifs, de productifs d'utilité et d'agrément et de productifs de richesse, ou simplement de productifs.
Des capitaux improductifs (et par là M. Say [II-57] entend tout trésor enfoui et tout capital qui chôme), des capitaux improductifs, dis-je, ne méritent guère de figurer dans une analyse des instrumens de la production.
Toute la partie des capitaux productifs d'utilité et d'agrément qui est employée à des dépenses frivoles ou pernicieuses, mérite encore moins d'êtrecomprise dans la masse des instrumens de l'industrie. Celle, au contraire, qui sert à élever des hommes utiles, à conserver, à étendre, à perfectionner leurs facultés, est éminemment productive, comme je l'ai montré plus haut, et demande à être rangée parmi les instrumens de la production.
Restent donc simplement les capitaux productifs, dans lesquels M. Say ne comprend ni les agens naturels, ni les fonds de terre, ni les mines, ni les cours d'eau; dans lesquels il ne fait entrer ni le matériel de l'administration publique, ni les maisons d'habitation des particuliers, ni leurs meubles, ni leurs vêtemens, ni leurs livres, ni rien de ce qui sert à l'éducation et à la conservation de l'espèce, et dans lesquels je réunirais au contraire tous les instrumens de l'industrie, toutes les forces extérieures dont elle s'est emparée, tous les moyens d'action qu'elle puise hors d'elle-même, soit qu'elle veuille agir sur les hommes, soit qu'elle travaille sur les choses.
[II-58]
J'observe seulement que, même en comprenant ainsi sous le nom de capital tous les instrumens de l'industrie, je lui donnerais encore une signification trop restreinte; qu'il convient de réunir sous ce inot toutes les forces quelconques que l'homme a amassées et qu'il peut employer à en acquérir de nouvelles; que le capital d'une nation se compose des forces qu'elle possède en elle-même, aussi-bien que de celles qu'elle puise dans les choses; qu'on peut dire un capital de connaissances ou de bonnes habitudes, tout comme on dit un capital d'argent, et que M. Say devrait répugner d'autant moins à ce langage, qu'il appelle l'homme un capital accumulé, et qu'il donne le nom de capital accumulé au talent d'un ouvrier, d'un administrateur, d'un fonctionnaire.
§ 4. Voici maintenant, d'après toutes ces remarques, comment me paraît se décomposer le fonds productif général de la société, quels sont les divers ordres de moyens que j'y découvre, et quel est l'ensemble des causes auxquelles se lie, selon moi, la puissance et la liberté de tous les arts.
D'abord, le fonds ou le capital social se partage, à mes yeux, en deux grandes classes de forces : celles que le travail a développées dans les hommes, et celles qu'il a réalisées dans les choses. La [II-59] puissance de tous les travaux se compose de la réunion des unes et des autres.
Dans le nombre de celles qui existent dans les hommes, la première qui me frappe, celle que je vois à la tête de toutes autres, celle qui me paraît la plus indispensable au succès de toute espèce d'entreprises et à la libre action de tous les arts, c'est le génie des affaires, génie dans lequel je démêle plusieurs facultés très-distinctes, telles que—la capacité de juger de l'état de la demande ou de connaître les besoins de la société, celle de juger de l'état de l'offre ou d'apprécier les moyens qu'on a de satisfaire ces besoins,-celle d'administrer avec habileté des entreprises conçues avec sagesse,—celle enfin de vérifier, par des comptes réguliers et tenus avec intelligence, les prévisions de la spéculation.
Après cette suite de facultés relatives à la conception et à la conduite des entreprises, et dont se compose le génie des affaires, se présentent celles qui sont nécessaires pour l'exécution, et dont est formé le génie des arts. Telles sont la connaissance pratique du métier,—les notions théoriques,—le talent des applications,—l'habileté en fait de main-d'œuvre.
Toutes ces facultés sont industrielles ; mais je remarque aussi dans les travailleurs des qualités morales.-- Je distingue en eux tout un ordre [II-60] d'habitudes qui les dirigent dans leur conduite à l'égard d'eux-mêmes, et qui n'intéressent en quelque sorte que l'individu. — J'y distingue aussi des habitudes d'un autre ordre, qui président à leurs relations mutuelles, et qui intéressent plus particulièrement la société. — La puissance et le libre exercice de toutes les professions dépend, au plus haut degré, de la perfection des unes et des autres. Je mets le plus grand soin à les noter.
Enfin, en dehors de ces divers ordres de facultés que le travail a fait naître dans les hommes, et qui forment en quelque sorte le capital personnel de la société, j'aperçois une multitude d'utilités, de forces, de puissances, qu'il est parvenu à fixer dans les choses, et qui forment, si l'on veut, son capital réel.
Dans cette partie de son fonds général, je vois des routes, des canaux, des cours d'eau, des terres labourées, des clôtures, des constructions, des bâtimens, des machines, des outils, des matières premières, des denrées, des monnaies, etc.
Tout cela, diversement aggloméré, forme des multitudes d'établissemens, d'ateliers de travail ; et, en observant très-attentivement ces ateliers, je remarque que, pour qu'ils soient véritablement propres à leur destination, il est essentiel qu'ils soient—bien situés,—bien organisés, que le travail y soit bien réparti, et qu'ils soient pourvus [II-61] d'un bon choix et d'une quantité suffisante d'ustensiles et de provisions de diverses sortes.
Telles sont les décompositions dont me paraît susceptible ce fonds général de la société, où sont en dépôt toutes nos facultés et toutes nos ressources. Voilà les divers élémens de puissance que j'y aperçois. Je vais consacrer le reste de ce chapitre à montrer comment ces élémens agissent, comment chacun d'eux contribue à la liberté de l'industrie en général. Il y en a, dans le nombre, dont on a souvent exposé l'influence, et dont je parlerai très-brièvement. Il y en a d'autres dont le rôle n'a pas été décrit, et sur lesquels j'appuierai un peu davantage. Puis, dans les chapitres qui suivront celui-ci, je chercherai comment tous ces moyens d'action s'appliquent en particulier à chaque ordre de travaux. Ma tâche, qui a été quelquefois nouvelle, le sera davantage alors, et elle le deviendra surtout lorsque j'aurai à montrer comment les divers agens de la production sont mis en œuvre par les arts qui agissent directement sur l'homme.
§ 5. Parlons d'abord des moyens que le travail a développés dans les travailleurs, et, avant tout, voyons ce qu'il puise de forces dans les facultés que j'ai réunies sous le nom de talent des affaires.
[II-62]
Nécessité de connaître l'état de la demande. La première chose dont tout homme industrieux ait besoin pour agir d'une manière fructueuse, c'est de savoir ce qu'il est possible de faire avec avantage, et de connaître les besoins de la société pour laquelle il entreprend de travailler. Je sais que ceci est difficile, que les besoins de la société sont sujets à varier, que celui qui les connaît le mieux aurait souvent grande peine à connaître le nombre et les moyens des concurrens qui travaillent avec lui à les satisfaire, et que, par conséquent, il est très-rare qu'il puisse savoir au juste dans quelle direction il doit s'étendre et dans quelle limite il lui convient de se renfermer. Mais ce genre d'instruction, pour être d'une acquisition difficile, n'est pas pour cela moins indispensable. Qu'on soit agriculteur, fabricant, homme d'État, homme de lettres ; qu'on veuille faire du blé, de la toile, des tableaux, des livres; qu'on songe à émettre des doctrines politiques ou à enfanter quelque ouvrage de poésie, celui qui veut produire est obligé, avant toutes choses, d'examiner attentivement si le produit qu'il veut faire répond à quelque besoin, s'il y a chance qu'il se vende, et dans quelle proportion il pourra se vendre.
Sans cela, tous les talens et tous les moyens imaginables ne sauraient lui tourner à profit: il ne travaillerait utilement ni pour lui, ni pour les autres; [II-63] car il y a cela de remarquable que les entreprises qui ne sont pas de nature à profiter à ceux qui les font, ne peuvent pas servir beaucoup plus à la société pour qui elles sont faites. Quand le public ne consent pas à acheter un produit, c'est qu'il en sent faiblement le besoin. On lui donnerait pour rien ce qu'il ne désire pas, qu'il n'en tirerait qu'un médiocre avantage, et l'entreprise la plus philanthropique ne vaut pas pour lui celle qui est dans l'ordre de ses besoins, et dont il consent à payer généreusement les frais : celle qui rapporte le plus est en général celle dont il profite le mieux; en d'autres termes, il n'y a guère que les travaux utiles à leurs auteurs qui soient vraiment utiles à la société, comme il n'y a que ceux qui répondent aux besoins de la société qui soient vraiment profitables à ceux qui les entreprennent.
Il est donc indispensable, pour pouvoir produire, de savoir d'abord ce que la société des mande, ce qu'elle est en état et en disposition d'acheter. Il n'y a, dans chaque pays, à chaque époque, qu'une certaine nature et une certaine quantité de marchandises qui puissent se vendre. Tout ce qui s'y fait, hors de ces limites, s'y fait inutilement, et peut être considéré comme perdu. Allez publier des livres de science parmi des peuplades sauvages; créez de quoi vêtir plusieurs millions d'hommes dans un monde de quelques milliers [II-64] d'habitans, vous serez sûr, dans les deux cas, d'avoir gaspillé une partie de vos ressources, d'avoir fait des choses inutiles, et diminué la masse des richesses, au lieu de l'avoir accrue.
A la vérité, de ce qu'il faut s'accommoder aux besoins de la société, il ne s'ensuit pas qu'on doit s'en rendre esclave. Si l'on avait voulu s'asservir aveuglément à ses goûts, on ne lui eût jamais offert de nouveaux produits, on n'eût fait naître en elle aucun nouveau besoin ; elle serait restée avec sa pauvreté, sa grossièreté et ses vices. Le premier intérêt de toutes les industries est de la porter à renoncer à des plaisirs bornés, ou vulgaires, ou dangereux, et de lui inspirer le goût de jouissances plus variées, plus étendues, plus nobles et plus judicieuses. Mais je dis qu'il faut partir de ses goûts actuels pour le conduire à des goûts meilleurs; qu'il faut que les idées qu'on lui présente rentrent dans les idées qu'elle a, et que toute production qui s'écarte trop de ses besoins, ou qui en excède la somme, est une destruction de richesses plutôt qu'une création d'utilités.
Je ne sais si cette règle, que la production, pour être réelle, doit être en rapport avec les besoins, est généralement comprise ; mais combien core elle est observée! Combien peu il y a de personnes qui, dans le choix de leur profession, du lieu où elles vont l'exercer, de la nature et de la [II-65] quantité des produits qu'elles entreprennent de faire, prennent la peine de s'informer des besoins du public, et d'étudier la nature et l'étendue des débouchés ! Ici on obéit à la routine; là on est emporté par la fureur des innovations. Il y a des temps où certains sujets de spéculation deviennent tout à coup à la mode, où de certains genres d'entreprises dégénèrent şubitement en manie. Arrive-t-il à quelqu'un de faire avec succès une chose nouvelle? c'est à qui se hâtera le plus de l'imiter, et la chose nouvelle n'est pas lâchée jusqu'à ce qu'on ait fait une sottise. Lorsqu'on eut commencé à creuser des canaux en Angleterre, dit un écrivain anglais, la mode en devint telle qu'en peu d'années le pays en fut sillonné dans tous les sens, et qu'on en ouvrit jusque dans les districts où il n'y avait rien à transporter [37] . On se souvient de cette rage de bâtir qui avait saisi dernièrement les habitans de la capitale. Paris avait l'air d'une ville prise d'assaut par des architectes et des maçons. On épuisait les anciennes carrières; on en ouvrait une multitude de nouvelles; on avait l'air de craindre que la place ne vînt à manquer aux constructions : on se disputait les terrains ; on les achetait à des prix décuples de leur valeur véritable [38] . On [II-66] entreprenait à la fois, non-seulement plusieurs rues, mais plusieurs quartiers, plusieurs villes : on élevait une ville dans la plaine des Sablons, une autre dans celle de Grenelle...
Au milieu de cette ardeur fiévreuse pour de certains genres d'entreprises, dont une multitude d'hommes est quelquefois saisie, ainsi que dans beaucoup d'autres spéculations dont la manie est moins générale, la société est plus ou moins perdue de vue. Mais si les spéculateurs sont sujets à l'oublier, elle sait bien les forcer à se ressouvenir d'elle, de ses besoins, de ses ressources, de sa véritable situation. Il n'y a jamais en résultat que ee qui lui convient qui réussisse, que ce qu'il lui faut qu'elle accepte. Les agioteurs ont beau faire hausser entre eux le prix de certaines choses, le prix s'en règle en définitive d'après la quantité qui en existe et les demandes qu'elle fait. On a beau multiplier de certains produits, il n'y a que ce qu'elle en peut acheter qui trouve à se vendre. Pendant qu'on se livrera avec le plus d'ardeur à de certaines fabrications, à celle des maisons, par exemple, il arrivera un moment où l'on commencera à s'apercevoir que les besoins sont dépassés, que les locataires [II-67] n'arrivent pas, que les nouvelles constructions restent invendues. Les entrepreneurs, ayant compté sur des rentrées qui manquent, seront obligés de faillir : d'énormes capitaux seront perdus; les travaux seront abandonnés, et des milliers d'ouvriers resteront tout à coup sans ouvrage.
L'histoire de ces derniers temps est pleine d'exemples de la fausse direction que l'industrie peut donner à ses moyens et des pertes effrayantes qu'elle peut faire, faute d'avoir pris en suffisante considération les besoins réels de la société. Des quatre-vingts compagnies de canaux qui existent en Angleterre, il y en avait vingt-trois, en 1825, qui avaient déjà dépensé au-delà de 91 millions, et qui n'avaient pas encore donné un schelling de dividende à leurs actionnaires [39] . Telle a été, en 1825, la masse de cotons que des spéculateurs anglais ont fait venir dans leur pays, dans la supposition que cette denrée manquerait cette année-là, tandis qu'elle existait en quantité surabondante, que, sur cet article seul, il y a eu des pertes pour plus de 62 millions. Lorsque la reconnaissance des nouveaux États de l'Amérique méridionale eut permis à l'Angleterre de commercer directement avec le Brésil, la seule ville de Manchester envoya à RioJaneiro, dans l'espace de quelques mois, plus de [II-68] marchandises que le Brésil entier n'en avait consommé dans le cours des vingt années précédentes [40] . Une lettre de Sidney, reçue à Londres au commencement de 1826, annonçait qu'il avait été expédié d'Angleterre dans cette colonie des sels purgatifs d'Epsom en quantité suffisante pour purger la colonie pendant cinquante ans, quand il en serait administré à chaque habitant une dose ordinaire par semaine [41] . Dans sa session de 1824-1825, le parlement anglais, en moins de six mois, a autorisé deux cent soixante-dix compagnies diverses, qui avaient émis ensemble pour plus de quatre milliards d'actions; mais telle était la sagesse de plusieurs de ces entreprises et d'une multitude d'autres pour lesquelles on n'avait pas eu besoin de l'autorisation du parlement, que, dans le cours de l'année 1825, au dire du journal The Star, il y a eu trois mille deux cents faillites, qu'il a été rendu cent trente-sept mille arrêts de prise de corps, qu'il en a été exécuté soixante-quinze mille, et que les frais judiciaires qui ont précédé, accompagné ou suivi ces banqueroutes se sont élevés à la somme énorme de 960,000 liv. sterl. (24 millions de francs) [42] .
Et il ne faut pas croire, comme on le dit [II-69] communément, que toute entreprise, quel qu'en soit l'objet, et quel qu'en puisse être le résultat, est utile au moins en ce sens qu'elle a le bon effet de procurer du travail aux classes ouvrières ; car les classes ouvrières sont précisément celles qui souffrent le plus des entreprises légèrement formées. Si la solidité et la durée d'un établissement quelconque importent à toutes les classes de personnes qui y sont attachées, elles importent surtout à celles qui ont le moins d'avances et qui vivent au jour la journée. Le plus grand tort qu'on puisse faire à ! de pauvres ouvriers, c'est de les attirer dans des entreprises destinées à périr. Mieux vaudrait en quelque sorte pour eux absence de secours, que des secours précaires et sujets à leur manquer. Sur la foi des moyens d'existence que leur présentent les entreprises dans lesquelles on les a témérairement engagés, ils contractent des mariages, ils élèvent des troupes d'enfans; et puis, quand les catastrophes arrivent, ils se trouvent, avec des familles nombreuses, en présence d'établissemens dont on a fermé les portes, et qui n'ont plus ni ouvrage à leur faire faire, ni secours à leur donner. Aussi, quoique la déconfiture du maître ne leur fasse perdre ordinairement aucune avance, et qu'il n'en résulte pour eux qu'une cessation de travail, sont-ils, je le répète, la classe qui souffre le plus de cette sorte de désastres. Extrêmement funeste à [II-70] l'entrepreneur et au capitaliste, une entreprise qui tombe est meurtrière pour les ouvriers [43] .
On ne peut donc pas trop dire combien il importe, avant de rien entreprendre, de s'informer exactement des goûts, des besoins, des ressources de la société.
Cependant, éclairé sur l'état de la demande, il n'est pas moins essentiel de connaître l'état de l'offre, c'est-à-dire de savoir les moyens qu'on a déjà de satisfaire les besoins éprouvés.
Il est possible que tel produit que j'aurais envie de faire fût de nature à être goûté du public. Mais n'y a-t-il pas déjà quelqu'un qui le fasse? Est-il en mon pouvoir de le mieux faire que ceux qui le créent? Combien existe-t-il d'établissemens consacrés à ce genre d'entreprise ? Quels sont les procédés qu'ils. emploient? Quelle est leur dépense? A combien reviennent leurs produits dans le pays où je voudrais m'établir, et dans un rayon de tant de lieues autour du point où je suis obligé de fonder ma fabrique ? A quel prix reviendront les miens, parvenus [II-71] à l'extrémité du rayon jusqu'où je suis obligé de les répandre pour trouver un nombre suffisant de consommateurs ? Quel genre d'avantage aurai-je sur les producteurs qui existent? Paierai-je un moindre intérêt de mes capitaux? Mon entreprise sera-t-elle mieux conçue, mieux montée, mieux administrée? Gagnerai-je quelque chose sur la matière première ? Aurai-je des moteurs plus puissans, des machines plus expéditives, des ouvriers plus intelligens ou moins chers? Disposerai-je de moyens de transport plus économiques ? Sur quoi y a-t-il mieux à faire que ce que l'on fait? Rassemblons tous les élémens de mon compte ; vérifions, les scrupuleusement; assurons-nous que j'ai pourvu à tous les frais nécessaires ; faisons ensuite une ample part au chapitre des erreurs possibles et des contre-temps imprévus. Si, tout calcul fait et refait, il m'est bien démontré que le public n'est pas servi comme il devrait l'être, si je vois nettement comment il pourrait l'être mieux, si je possède bien mon affaire, si je me sens la tête assez ferme et assez active pour la diriger convenablement.... je puis entreprendre ; j'ai la conscience acquise que je vais faire une chose bonne pour les autres et pour moi, une chose vraiment utile, voire même une chose morale, encore bien qu'elle doive nuire à mes concurrens, puisque je vais affranchir le publie du tribut illégitime que lèvent sur loi des [II-72] producteurs négligens ou malhabiles qui lui font payer le produit qu'ils font au-dessus de sa valeur véritạble, c'est-à-dire au-dessus du prix auquel il peut être fait.
Mais ce n'est qu'après m'être ainsi bien assuré de ce que l'on fait, et du mieux qu'il y aurait à faire, que je peux agir avec honneur et sûreté; car si je n'ai pas pris des précautions suffisantes, si j'ai entrepris légèrement, si je me suis mis dans la nécessité de vendre à perte, si je ne sers le public qu'en détruisant ma fortune et en nuisant à celle des producteurs établis avant moi, il est clair qu'il eût été plus sage et plus moral tout à la fois de ne pas entreprendre.
En général, ce qu'il faut surtout recommander aux entrepreneurs, c'est d'étudier l'état de l'offre, et de voir s'ils peuvent réellement y introduire quelque amélioration. Il y a en effet bien moins de gens qui se ruinent pour avoir mal choisi le produit à faire, que pour n'avoir pas fait un calcul assez juste du prix auquel il leur serait possible de le livrer. Il est peu de produits qui ne soient bons à entreprendre, quand on peut les fournir à un prix tel qu'il soit presque impossible qu'ils ne trouvent pas des acheteurs. Mais c'est ce prix auquel on pourra produire qu'on ne prend pas assez la peine d'étudier. Si, dans bien des cas, l'on met peu de soin à s'instruire de l'état des besoins, on en met [II-73] encore moins à rechercher les bons moyens de les satisfaire, et rien n'est comparable à la légèreté avec laquelle les plans les moins raisonnables sont fréquemment adoptés. C'est principalement à ce peu d'attention qu'on apporte à l'étude et au choix des moyens d'exécution qu'il faut attribuer la chute de tant d'entreprises, dans le cours desquelles il se fait une si grande déperdition de forces, et dont la ruine finale est accompagnée de tant de souffrances pour la société [44] .
Après les deux genres de capacité nécessaires pour apprécier convenablement l'objet et les moyens d'une entreprise, l'art de la diriger est un autre [II-74] talent faisant également partie du génie des affaires, et qui n'est pas moins indispensable que les deux autres au succès de toute espèce d'industrie.
Ce moyen se distingue parfaitement de ceux que je viens de décrire. Il est fort possible, en effet, qu'un homme peu capable de juger de l'opportunité de créer un certain produit, ou de dresser le compte des frais auxquels il est possible de le produire, soit d'ailleurs en état d'administrer avec intelligence et avec sagesse un établissement monté pour l'obtenir. Mais si cette dernière faculté ne doit pas être confondue avec les précédentes, elle ne peut pas, sous un autre rapport, en être [II-75] séparée : il faut qu'elle concoure avec elles, et nul n'est véritablement homme d'affaires, s'il n'est en même temps administrateur. Ce talent de l'administrateur est d'une si grande conséquence, que rien ne saurait en tenir lieu ; et l'entreprise la plus excellente, celle où l'on obtiendrait par les meilleurs procédés les produits les plus susceptibles de se vendre, n'aurait aucune chance de se soutenir si, d'ailleurs, elle n'était pas convenablement gérée, s'il y régnait peu d'ordre, si les heures de travail y étaient mal réglées, les dépenses mal faites, les ressources gaspillées, etc.
Le petit nombre d'économistes dont j'ai lu les ouvrages sont loin, à ce qu'il me semble, d'accorder à cet élément de force l'attention dont il sen rait digne. Je ne me souviens pas que Smith en dise un seul mot. L'auteur du Traité d'économie politique s'y arrête à peine. Il est juste. de reconnaître pourtant qu'il en a parlé plus expressément dans ses leçons du conservatoire, et qu'il a mis plus de soin à en signaler l'importance qu'il ne l'avait fait dans son Traité.
« Dans le voyage que je viens de faire en Angleterre, disait-il à la fin de 1825 en ouvrant son cours, j'avais principalement en vue d'observer les causes qui font en général réussir les entreprises d'industrie dans un pays renommé pour ses succès en ce genre, et j'ai été confirmé dans la persuasion que la manière [II-76] d'administrer ces entreprises contribue à leur succès beaucoup plus encore que les connaissances techniques et les procédés d'exécution pour lesquels, cependant, on vante avec raison les Anglais. »
On peut juger, par cette seule remarque, à quel point les talens administratifs méritent de figurer dans une analyse exacte des causes générales auxquelles se lie la puissance du travail [45] .
Enfin, à ce talent de bien conduire une entreprise bien conçue et bien montée, il est indispensable que l'homme d'affaires, pour être complètement digne de ce nom, réunisse une dernière faculté: c'est celle de tenir des livres en règle; c'est de savoir demander compte à chaque partie de son entreprise et à l'ensemble de son établissement de toutes les avances qu'ils reçoivent, de tous les remboursemens qu'ils effectuent, et de pouvoir, pour ainsi dire, les contraindre à déposer pour ou contre lui, à rendre témoignage de la justesse de ses calculs, ou bien à l'avertir des erreurs qu'il a commises. Sans celte vérification continuelle de ce qu'il s'était promis par le compte toujours présent [II-77] et la balance toujours facile de ce qu'il a dépensé et de ce qu'il a obtenu, il ne saurait où il en est, il ignorerait s'il est en profit ou en perte, il serait hors d'état de dire par où il gagne et par où il perd, ce qui est bien et ce qui est mal dans son entreprise, et il ne verrait point, par conséquent, ce qui mérite d'être maintenu et ce qui demande à être réformé. C'est encore là un de ces moyens généraux du travail qu'on a peu pris en considération dans les livres de théorie, quoiqu'ils dussent jouer un rôle considérable dans la pratique. J'aurai occasion de montrer avec plus de détail combien ce moyen est puissant, lorsque je ferai voir comment il peut s'appliquer à de certaines classes de travaux dans lesquels on n'est pas encore accoutumé à soumettre ses spéculations à l'épreuve d'une comptabilité régulière.
Ainsi, connaître les besoins, savoir s'ils sont satisfaits, être en état d'apprécier les moyens qu'on emploie à les satisfaire, avoir le talent de juger si ces moyens peuvent être remplacés par de meilleurs, être capable de conduire les établissemens qu'on a été capable de concevoir et de monter pour cela, savoir s'assurer enfin, par une bonne comptabilité, si les résultats viennent réaliser les promesses que la spéculation avait faites, voilà ce qui constitue le génie des affaires, et tel, est le premier ordre de facultés sur lequel se fonde [II-78] la puissance et la liberté de toute industrie.
§ 6. Cependant ce serait peu de savoir ce qu'il convient d'entreprendre, si l'on n'était en état de l'exécuter, et si au talent de la spéculation on ne réunissait les connaissances techniques. On ne conçoit pas même comment il serait possible de former de bonnes spéculations sans ces connaissances, puisqu'on serait incapable d'apprécier les moyens qui sont communément employés à créer le produit qu'on aurait dessein de faire, et qu'on ne pourrait juger s'il est possible de substituer à ces moyens de meilleurs procédés. Il faut donc nécessairement qu'à l'intelligence des affaires se joignent les talens qui ont rapport à l'art.
Le premier de ces talens, celui qu'il me paraît essentiel d'acquérir avant aucun autre, c'est la connaissance pratique du métier. Je sais qu'ici je m'écarte beaucoup des idées qui ont cours dans les classes de la société les plus aisées et les plus instruites. Lorsque, dans ces classes, on veut préparer un jeune homme à une pratique élevée et éclairée des arts, on commence par lui donner une éducation littéraire. En Europe, en France surtout, la rhétorique est la base fondamentale de toutes les professions. C'est donc par devenir rhétoricien que commence tout jeune homme qui veut exercer un art quelconque d'une manière un peu distinguée ; [II-79] puis on fait son éducation scientifique; il passe après dans les écoles d'application, et finalement il arrive à la pratique. Un petit nombre de bons esprits pensent au contraire qu'il faudrait commencer par la pratique ; que la théorie et ses applications devraient venir après, et qu'il serait toujours temps d'arriver à la rhétorique.
On a pourtant des raisons pour procéder ainsi qu'on le fait. Reste à savoir si ces raisons sont bonnes. On croit que l'homme a d'abord raisonné, et qu'ensuite il a agi; on pense que le genre humain ne procède que par principe et par raison démonstrative; on suppose que notre espèce est restée plus ou moins long-temps sans faire les choses, sans se vêtir, sans se loger, sans faire l'amour, sans se réunir en société, et qu'elle ne s'est avisée de tout cela que par la suite, à mesure que la réflexion est venue l'avertir qu'elle pourrait y trouver quelque plaisir ou quelque avantage. Il a donc paru conforme à la nature de l'esprit humain de faire marcher la théorie devant la pratique, et d'enseigner la raison des choses avant d'apprendre à les exécuter.
Je crois qu'en procédant de la sorte on a complètement méconnu cette nature de l'esprit humain, sur laquelle on avait le très-louable désir de régler sa marche. Ce qui est, en effet, dans la nature de l'homme, c'est d'agir d'abord et de [II-80] réfléchir après. La réflexion éclaire, rectifie, perfectionne l'exercice de nos forces; mais l'homme fait tout naturellement, et il n'est rien que l'instinct n'ait commencé. C'est par instinct que l'homme choisit ses premiers alimens, c'est par instinct qu'il vit en société, c'est par instinct qu'il a commencé à se vêtir et à se construire des demeures. La raison n'a servi qu'à lui apprendre ensuite à mieux faire ce qu'il avait fait d'abord sans raisonner et par la simple impulsion du besoin. Pour procéder conformément aux indications de la nature, il faudrait donc commencer par faire les choses et chercher ensuite la raison de ce qu'on fait.
La vérité est que tous les arts ont commencé d'une manière empirique. La plupart de leurs découvertes ont été faites empiriquement, et les sciences, qu'on met à leur tête, ne sont venues expliquer, la plupart du temps, que ce qu'ils avaient trouvé sans elles. En principe, c'est là la bonne manière d'aller : il faut apprendre l'art avant la science et la pratique avant la théorie. On ne profite bien de la science que lorsqu'elle vient rendre raison des procédés de l'art auquel on est déjà rompu. Le savant qui n'est que savant ne sait que faire de sa science; elle ne lui peut servir à rien. Il y a de l'inexpérience des savans, de leur maladresse, de leur impuissance pour tout ce qui tient à l'action, les exemples les plus étranges. Tel homme profondément [II-81] dans les théories de la mécanique ne saurait souvent comment s'y prendre pour faire des choses dont le plus grossier manœuvre vient aisément à bout. Pour se rendre propre à l'exercice d'un art, pour devenir homme d'action, il faut donc commencer par agir, et ne s'occuper de la théorie que pour lui demander d'éclairer et de fortifier la pratique.
Il paraîtrait qu'on a compris cela de l'autre côté de la Manche mieux que de ce côté-ci. Les hommes qui se destinent à la pratique d'un art en Angleterre, et qui aspirent à y obtenir un rang élevé, commencent par s'instruire de ses détails les plus techniques, et par mettre d'abord la main à l'ouvrage. C'est l'observation que faisait un jour un des professeurs les plus distingués du Conservatoire des arts et métiers de Paris, M. Clément.
« Les plus grands ingénieurs de l'Angleterre, disait-il, ont été d'abord de simples ouvriers. Watt était ouvrier horloger; Woolf, charpentier; Telford, maçon; John et Philip Taylor, fabricans de produits chimiques; enfin Maudslay, simple forgeron. Tous les officiers des mines, ajoutait le professeur, ont commencé par être mineurs; tous ont brisé le rocher et roulé la brouette : ce sont de vrais officiers de fortune qui connaissent à fond les détails de leur art, qui en savent toutes les difficultés. Des [II-82] conversations avec quelques hommes habiles, quelques livres, quelques leçons de physique et de chimie données par des professeurs ambulans et chèrement payées, voilà quels ont été d'abord tous leurs moyens d'instruction scientifique. »
Je ne veux pas finir sans ajouter que ces remarques s'appliquent indistinctement à toutes les professions. Le métier en tout serait la première chose à apprendre, et quel que soit l’art auquel on se destine, c'est par l'art lui-même qu'il faudrait commencer [46] .
Cependant, en reconnaissant qu'il importe de commencer par la pratique, hâtons-nous de dire que sa marche ne devient sûre et son action vraiment puissante que lorsque la théorie la suit et lui prête le secours de ses lumières. Sans l'intervention des sciences, l'industrie, livrée à l'empirisme et à la routine, ne ferait des forces de la nature qu'un [II-83] usage aveugle et borné. Le propre des sciences est de lui apprendre à s'en servir avec discernement et avec étendue. J'ai déjà dit que la nature laissée à elle-même ne travaillait pas de préférence pour l'homme : les sciences, en lui découvrant comment elle agit, lui offrent les moyens de lui dérober ses forces et de les plier à son usage. Elles lui dévoilent les propriétés des corps, leur action physique, leur action chimique, et elles lui livrent une multitude de secrets et de leviers dont il peut tirer ensuite les plus grands secours. Qui peut dire tout ce que les arts ont emprunté de vérités fécondes à la chimie, à la physique, à l'astronomie, à l'histoire naturelle? Quelquefois un seul des faits observés par ces sciences a suffi pour leur faire faire d’immenses progrès. Quel parti, par exemple, n'a-t-on pas tiré de la connaissance des propriétés de l'aimant et de celle de l'élasticité des fluides ? La boussole, pour me servir de la belle expression de Montesquieu, a ouvert au commerce l'univers. On a calculé que la machine à vapeur, qui n'est qu'un moyen de se servir alternativement de la force expansive de la vapeur d'eau et de la pression de l'atmosphère, a assez augmenté les produits de l'industrie en Angleterre pour couvrir les intérêts de la dette, montant annuellement à plus d'un milliard. La puissance de l'industrie est donc étroitement liée à celle des sciences. Plus les sciences [II-84] ont fait de progrès et plus l'industrie a de moyens, plus elle est libre.
Il faut dire pourtant que la liberté, sous ce rapport, paraîtrait moins dépendre de l'avancement des sciences que de leur diffusion. « L'expérience, disait encore le professeur éclairé que j'ai cité tout à l'heure, l'expérience me prouve chaque jour que les plus simples élémens des sciences peuvent suffire aux plus grands développemens de l'industrie. » Sûrement il ne faut pas inférer de là que l'industrie n'est pas intéressée aux progrès très-élevés des sciences. De ce qu'on ne voit pas à quoi pourront lui servir de certaines vérités, il serait bien téméraire de prétendre qu'elles ne lui serviront jamais à rien. Combien de découvertes, qui ne semblaient d'abord que curieuses, ont fini par conduire à d'importantes applications. « Lorsque le Hollandais Otto-Guérike tira les premières étincelles électriques, eût-on prévu, demande M. Say, qu'elles mettraient Franklin sur la voie de diriger la foudre et de la détourner de nos édifices, entreprise qui semblait dépasser de si loin le pouvoir de l'homme ?» Je suis donc loin de condamner aucun genre de recherches; je dis seulement que ce qui fait la puissance des arts ce n'est pas tant l'existence d'un petit nombre d'hommes très-savans que celle d'un très-grand nombre d'hommes passablement instruits; et les faits déposent avec éclat de la vérité [II-85] de cette remarque. C'est ainsi, par exemple, que l'industrie est incomparablement plus puissante en Angleterre qu'en France, quoique le premier corps savant de l'Europe soit en France, et que le seul avantage de l'Angleterre, sous le rapport des sciences, soit de compter un nombre plus considérable d'hommes qui en possèdent les élémens. Non-seulement il s'est formé en Angleterre, pour la direction de toutes les entreprises industrielles, une classe nombreuse d'ingénieurs privés que nous n'avons pas; mais il faut remarquer en outre que dans ce pays beaucoup de chefs d'ateliers, de contre-maîtres et même de simples ouvriers, possèdent des notions élémentaires de physique, de chimie et de mécanique qui manquent généralement parmi nous à cette classe de travailleurs.
Si la puissance des arts tient à l'avancement et à la diffusion des sciences, elle est surtout liée au progrès de leur application. L'application d'une science est une science particulière, plus difficile peut-être que la science même, et dont l'objet est de la mettre en valeur. Il est possible, on le conçoit, que de certaines sciences, assez avancées, assez répandues, aient encore été peu utilisées. Dans cet état, elles sont propres, si l'on veut, à satisfaire la curiosité, à entretenir l'activité de l'esprit, à lui fournir le sujet et à devenir pour lui l'occasion d'un exercice favorable; mais il est évident [II-86] qu'elles n'ajoutent rien aux pouvoirs du travail. Relativement à l'industrie, les sciences n'existent que lorsque le talent des applications est venu la faire profiter des vérités qu'elles ont trouvées. C'est ce talent qui réalise pour elle le bienfait de leurs découvertes; c'est à ce talent qu'elle doit tout ce qu'elles peuvent lui procurer de puissance et de liberté.
Enfin la liberté de l'homme qui exerce une industrie ne tient pas seulement à la connaissance qu'il a des procédés de son art, aux notions scientifiques qu'il possède, à son talent pour les applications; elle tient aussi à son habileté en fait d'exécution et de main-d'œuvre . Les découvertes de la science, utilisées par le génie des applications, ne se réalisent, ne prennent un corps, ne produisent un résultat utile que par le travail de l'ouvrier. Sans ce travail, les plus belles conceptions seraient vaines et toute industrie impuissante. C'est de la main-d'œuvre , à proprement parler, qu'elles reçoivent l'être et la vie. La liberté de l'industrie dépend donc encore essentiellement du talent que l'artiste, déjà distingué comme savant et comme ingénieur, possède encore comme ouvrier. Mieux il conçoit ce qu'il s'agit de faire, plus il est adroit à l'exécuter, plus il peut apporter de soin à son ouvrage, plus il est capable de lui donner de la précision et de la perfection, plus il est maître, en [II-87] un mot, de cette dernière partie de son art comme de celles que j'ai déjà décrites, et plus il est libre à lui de l'exercer.
J'insiste peu sur ces derniers moyens, dont on a souvent exposé l'influence, et sur lesquels d'ailleurs j'aurai plus d'une occasion de revenir lorsque j'arriverai, dans les chapitres qui vont suivre, à l'application des principes énoncés dans celui-ci.
J'ai parlé des élémens de puissance que je viens d'analyser dans les deux précédens paragraphes, comme s'ils étaient tous réunis dans une même personne, quoiqu'ils soient nécessairement distribués, pour peu qu'une entreprise ait d'importance, dans un assez grand nombre de mains. Il arrive toujours, en effet, que le fondateur d'une telle entreprise a au-dessous de lui, pour ce qui tient à la gestion de son affaire, un administrateur, un économe, un caissier, un ou plusieurs teneurs de livres; et, d'un autre côté, pour ce qui tient plus particulièrement à l'art, un ingénieur, des chefs d'ateliers, des contre-maîtres, des ouvriers. Cependant il est du plus haut intérêt que le chef d'entreprise ait l'intelligence parfaite des diverses tâches que remplissent tous ses sous-ordres; que sa pensée préside à tout; qu'il puisse partout mettre la main à l'ouvrage, approuver ou blâmer avec connaissance de cause, donner les ordres les plus éclairés. Et non-seulement [II-88] il est bon que l'entrepreneur réunisse en lui tous les genres de capacité qui concourent au succès de son entreprise; mais il serait heureux, si la chose était possible, que ces divers genres de capacité fussent communs à tous ses agens; car il est clair que chacun ferait d'autant mieux sa tâche qu'il serait plus en état de comprendre quel est l'objet général de l'établissement, de quelle manière chacun concourt au but de l'entreprise, et quelle est au juste la tâche particulière qui lui est assignée dans ce travail commun. Enfin, quoiqu'il soit assez rare de trouver réunies dans un même individu toutes les facultés industrielles que j'ai décrites dans les deux paragraphes qui précèdent, il est certain que toutes ces facultés sont nécessaires au succès de toutes les professions, et qu'un homme exerce sa profession avec d'autant plus de puissance qu'il réunit mieux dans sa personne tout ce qui constitue l'artiste habile et l'homme d'affaires intelligent.
§ 7. Après cela, hâtons-nous de dire que le plus haut développement de ces facultés, dans un pays, ne pourrait y assurer le libre exercice d'aucune profession si ce progrès n'y était accompagné de celui des meurs, et si la population, à mesure qu'elle formerait son génie pour les arts et pour les affaires, ne travaillait aussi à se perfectionner, [II-89] tant dans cette portion de ses habitudes qui ont pour effet de conserver et d'accroître les facultés de chaque individu, que dans celles qui tendent à rendre plus sûres, plus paisibles et plus faciles les relations des hommes entre eux.
Telle est l'influence que les bonnes habitudes morales exercent sur la liberté de toute industrie, que je suis à comprendre comment les économistes ont pu oublier de tenir compte d'un élément de puissance aussi considérable; comment Smith, par exemple, après avoir compris les talens acquis dans son inventaire des moyens du travail n'y a pas compris aussi les bonnes habitudes acquises ; comment M. Say, après avoir fait entrer dans sa nomenclature du fonds général de la société les facultés industrielles des travailleurs a pu négliger d'y faire entrer ce que les travailleurs possèdent de bonnes habitudes morales. Existe-t-il, je le demande, dans l'ensemble des moyens qu’emploie l'industrie, quelque élément de force dont l'influence sur sa liberté soit plus décisive? Je sais tout ce qu'elle peut puiser de puissance dans le talent des affaires, dans les connaissances techniques, dans les secours de la théorie, dans le génie des applications, dans l'habileté en fait de main-d'œuvre ; mais l'activité, la prudence, l'ordre, l'économie, la tempérance, la simplicité des goûts, une certaine continence; mais l'esprit de justice qui porte les travailleurs à s'abstenir de [II-90] tout esprit de monopole, et le courage civil qui ne leur permet de tolérer un pareil esprit dans qui que ce soit, sont-ils pour elle d'un secours moins efficace? Comment, dans l'énumération des moyens qu'elle fait concourir à l'œuvre de la production, n'a-t-on pas signalé la bonne morale personnelle et la bonne morale de relation comme deux des plus puissans et des plus indispensables [47] .
§ 8. Et d'abord, pour parler de cette partie de la morale qui se rapporte à notre conduite à l'égard de nous-mêmes, n'est-il pas certain qu'un homme vicieux serait à peu près aussi incapable qu'un homme ignorant d'exercer avec succès une profession quelconque ? Le vice, il est vrai, n'agirait pas sur lui de la même façon que l'inexpérience [II-91] ou l'incapacité naturelle; mais il produirait à peu près les mêmes effets; et, avec tous les moyens intellectuels et manuels d'agir, cet homme pourrait très-bien n'en avoir pas la puissance, asservi qu'il serait à de mauvais penchans.
Qu'ai-je besoin, par exemple, de dire que la paresse est un obstacle au libre exercice de toute industrie? N'est-il pas évident que l'activité est la première condition de toute liberté, et que, pour pouvoir user de ses forces, il faut d'abord être capable de surmonter l'indolence naturelle qui nous empêcherait de nous en servir? Tant que l'homme reste inactif, il ne développe aucun de ses organes; la passion du travail est la première vertu dont il a besoin pour tirer quelque parti de ses facultés, et il est visible qu'à égalité de ressources et de capacité naturelles le peuple le plus laborieux devra être bientôt le plus industrieux, celui dont l'industrie sera la plus puissante et la plus libre.
Si la paresse est un obstacle à la liberté de l'industrie, on en peut dire autant de l'avarice, de la prodigalité, de l'ostentation, et en général de tous les vices. L'avarice, moins funeste à l'industrie que l'oisiveté, ne laisse pas de lui être encore contraire. Un producteur qui, par lésinerie, ne voudrait pas faire à la production les avances nécessaires, qui aimerait mieux manquer de gagner 6 fr. que risquer un écu, qui, au lieu de joindre ses [II-92] épargnes à son capital et d'étendre de plus en plus ses spéculations, enfouirait ses profits pour être sûr de ne pas les perdre, un tel homme, dis-je, ne saurait devenir ni très – puissant dans son art, ni très-riche. Il se pourrait bien que son industrie ne déclinât pas, mais il ne ferait pas non plus de progrès ; elle resterait nécessairement stationnaire. Moins donc un homme industrieux est esclave de cet esprit étroit, de cet instinct sordide, qui porte l'avare à enterrer ses trésors; moins il laisse de capitaux inactifs, mieux il sait les dépenser, toutes les fois qu'il peut le faire avec avantage, et plus il est capable d'étendre les pouvoirs de son industrie, plus elle devient forte et libre.
Si l'avarice restreint la puissance de l'industrie, à plus forte raison la prodigalité. L'avare soustrait des capitaux à la reproduction, mais il ne les détruit pas; le prodigue, au contraire, les dissipe: l’un peut empêcher que la richesse ne croisse, mais l'autre la fait décliner. Le prodigue dépense en superfluités, en folies, en débauches, les accumulations de ses devanciers; il ne cesse d'enlever au travail quelque portion du capital qui fait sa puissance, et chaque jour il lui ôte ainsi quelque chose de sa liberté. Moins donc un peuple a de cet orgueil puéril, de cette sotte vanité qui porte les hommes à dissiper leurs richesses en prodigalités fastueuses, plus il sait les dépenser sagement [II-93] et utilement, et plus ses moyens de production augmentent, plus son industrie acquiert de pouvoir et de liberté.
Dans les pays où règne le faste, il n'y a presque pas d'intermédiaires entre les arts indispensables à la vie et ceux qui fournissent aux raffinemens de la volupté; c'est une chose facile à remarquer chez la plupart des nations orientales.
« Les manufactures, chez ces nations, observe un écrivain anglais, sont dans un état pitoyable; les choses favorables au développement de l'esprit y sont absolument inconnues. On n'y possède d'habileté que pour la la joaillerie, l'orfèvrerie, la fabrication des draps d'or, des riches soieries, des armes de luxe, et pour la construction des pagodes et des palais. En Europe, au contraire, nous fabriquons, indépendamment des objets de luxe, des vêtemens et des meubles commodes pour tout le monde, des livres et des garde-temps pour les savans [48] . »
Cette différence tient surtout à celle des mœurs. Si nous sommaccroissementes mieux pourvus que les Asiatiques de toutes les choses nécessaires à la vie, de tout ce qui peut la rendre douce, agréable et noble tout à la fois, c'est que, dépensant moins pour la satisfaction des besoins factices, il nous reste davantage [II-94] pour la satisfaction des besoins réels; c'est que des goûts plus simples, en rendant l'épargne possible, nous ont permis de faire ces accumulations de moyens de toute espèce, d'où sont venus les développemens de l'industrie et tous les moyens de jouissance qu'elle nous procure.
La supériorité de l'industrie anglaise sur la nôtre tient en partie à la même cause. Nous fabriquons, en général, tout ce que fabriquent les Anglais, et il est peu d'articles que nous ne soyons capables de confectionner aussi bien qu'eux; mais il en est un certain nombre que nous ne pouvons pas produire dans la même quantité et au même prix. Pourquoi cela? parce que les producteurs, chez nous, ont moins de moyens de produire, parce que moins de consommateurs ont les moyens d'acheter, parce qu'on est en général moins riche, et l'on est moins riche par cette raison, entre beaucoup d'autres, que les dépenses sont peut-être moins judicieuses. Nous sommes plus enclins au luxe que nos voisins; nous avons moins d'attrait pour ce qui est utile et commode ; nous en avons plus pour ce qui est somptueux ou brillant; nous aimons davantage les palais, les monumens fastueux, les mets et les vêtemens recherchés. Ce que cette disposition ajoute inutilement à nos consommations publiques et particulières, ce qu'elle nous ôte d'aisance, ce qu'elle fait perdre à notre industrie [II-95] de ressources et de moyens, ce que, par conséquent, elle oppose d'obstacles à ses progrès et à sa liberté est assurément très-considérable.
Je passerais successivement en revue toutes nos mauvaises habitudes particulières, que je les trouverais toutes plus ou moins contraires au libre exercice de tous les arts. Si l'avarice s'oppose à l'accroissement de nos capitaux, si la prodigalité les fait décroître, l'intempérance use notre santé la débauche abrutit notre intelligence, l'envie, en nous irritant contre nos rivaux, ne fait que nous rendre plus incapables de les atteindre ou de les devancer. Il n'est pas de vice qui n'ait pour effet de diminuer notre puissance, de réduire nos moyens d'action. L'un ruine nos forces corporelles, l'autre nos facultés mentales, celui-ci notre fortune, celui-là notre considération, la plupart plusieurs de ces biens ensemble, quelques-uns toutes nos facultés à la fois.
Autant donc, pour exercer librement une industrie quelconque, il est nécessaire que nous ayons l'habitude des affaires et beaucoup d'acquis sous le rapport de l'art, autant il est nécessaire que nous sachions faire, relativement à nous-même, un usage moral de nos facultés. La liberté de l'homme industrieux dépend de ce moyen au moins autant que d'aucun autre; et, si sa puissance est fort accrue par l'adresse, l'intelligence, [II-96] l'habileté, la science, elle ne l'est pas moins par l'activité, le zèle, l'application, l'économie, la régularité, et par toutes les vertus individuelles favorables à la conservation et à l'accroissement de ses forces.
De toutes les vertus privées, celle que je regarderais comme la plus nécessaire à l'homme industrieux, celle qui lui donne successivement toutes les autres, c'est la passion du bien-être, c'est un désir violent de se tirer de la misère et de l'abjection, c'est cette émulation et cette dignité tout à la fois qui ne lui permettent pas de se contenter d'une situation inférieure, toutes les fois que, par un travail honorable, il voit la possibilité de s'élever à un meilleur état.
Ce sentiment, qui semble si naturel, est malheureusement beaucoup moins commun qu'on ne pense. Il est peu de reproches que la très-grande généralité des hommes méritent moins que celui que leur adressent les moralistes ascétiques d'être trop amis de leurs aises, de se donner trop de soins pour augmenter leurs moyens de jouissance et de bonheur. On leur adresserait le reproche contraire avec infiniment plus de justice. Ils n'ont en effet que trop de disposition à se contenter de peu, à s'accoutumer à une existence chétive, à croupir, à vieillir dans l'ignorance, la crasse, le dénuement, et en général dans des états fort mal assortis à cette [II-97]dignité du genre humain dont ne cessent de les entretenir les mêmes moralistes. Il y a même dans la nature des hommes cela de très-remarquable que moins ils ont de lumières et de ressources, et moins ils éprouvent le désir d'en acquérir. Les sauvages, les plus misérables et les moins éclairés des hommes, sont précisément ceux à qui il est le plus difficile de donner des besoins, ceux à qui l'on inspire avec le plus de peine le désir de sortir de leur état; de sorte qu'il faut que l'homme se soit déjà procuré par le travail un certain bien-être, avant qu'il éprouve avec quelque vivacité ce besoin d'améliorer sa condition, de perfectionner son existence, que j'appelle amour du bien-être.
Cependant, tant qu'il n'est pas animé de cette passion, il est impossible que son industrie fasse des progrès rapides. Il conduit ses travaux sans zèle, sans affection, sans intelligence, sans aucune des dispositions morales qui sont indispensables pour les bien exécuter. Il use assez mal aussi de ses ressources. S'il consent à passer sa vie dans un état de misère et de médiocrité, ce n'est de sa part ni modération, ni simplicité de moeurs : c'est grossièreté, paresse, incurie, absence de dignité, de goût, de délicatesse. Loin d'avoir des penchans modérés, il serait volontiers dissolu ; il est fort enclin à l'intempérance, à la luxure, au [II-98] luxe; il a le goût de toutes les jouissances désordonnées ; il n'a pas l'amour du bien-être.
Supposez-le, au contraire, animé d'un vif désir d'améliorer sa condition, et de ce sentiment, comme de leur source, naîtront les habitudes privées les plus favorables aux progrès de l'art qu'il exerce, comme au bon emploi des biens qu'il possède. L'activité succèdera à la paresse; à l'insouciance, l'émulation ; l'ordre et l'épargne, au gaspillage; il dépensera peu pour l'ostentation ; il fera beaucoup pour le bonheur véritable; il voudra voir sa demeure devenir chaque jour plus saine, plus commode, plus riante; il voudra être mieux vêtu, mieux nourri, plus instruit, mieux gouverné; il ne négligera aucune partie de son bonheur, et plus sa condition deviendra bonne, plus il éprouvera le désir et plus il aura les moyens de la rendre meilleure encore.
C'est à cet amour du bien-être, passion des peuples très-cultivés, qu'il faut attribuer les beaux développemens que l'industrie a pris chez quelques peuples ; c'est à l'absence de ce sentiment qu'il faut demander compte des retards qu'elle éprouve en d'autres pays. Je ne doute point que la distance où elle peut être encore parmi nous du point où elle est parvenue chez une nation rivale, ne tienne en bonne partie à la différence de l'énergie avec laquelle ce sentiment agit chez les deux nations. [II-99] Nul peuple ne paraît plus possédé que le peuple anglais du besoin d'accroître son aisance, ses commodités, de se procurer, comme il dit, une existence comfortable, c'est-à-dire une existence douce et fortifiante. Cette passion domine chez lui les hommes laborieux de toutes les classes; c'est elle qui préside à tous leurs travaux, qui en accélère de plus en plus le mouvement et l'activité, qui les dirige constamment vers un but utile; elle est l'âme de leur industrie et la principale cause des progrès immenses qu'elle a faits.
Ce n'est donc pas sans raison que je place la passion du bien-être au nombre des premières vertus privées de l'homme industrieux.
Il en est une pourtant qui me paraîtrait plus nécessaire encore à ses progrès, surtout dans les classes inférieures : c'est cette sorte de prudence, de retenue, de continence dont il a besoin, non pour s'interdire le mariage, car je ne pense point que, dans aucune classe, on soit obligé de s'abstenir de se marier, mais pour user du mariage avec circonspection, pour empêcher qu'il ne devienne funeste en devenant trop fécond.
J'écarte l'idée qu'un homme ne doive se marier que lorsqu'il a, comme on dit, les moyens d'élever une famille. Je ne sais point d'abord ce qu'on entend par ces mots. Une famille n'est pas la conséquence forcée du mariage, quoiqu'elle en [II-100] soit la conséquence ordinaire : n'a pas toujours des enfans qui veut. Puis tout le monde n'en a pas le même nombre: il est possible de n'en avoir qu'un, comme il est possible d'en avoir dix, d'en avoir douze, d'en avoir quinze : veut-on qu'un homme attende pour se marier qu'il ait de quoi élever quinze enfans, de quoi élever la plus nombreuse famille possible? Je voudrais savoir à quel terme on s'arrête, et quelle fortune on exige qu'un homme acquière avant qu'il puisse songer à se marier. Enfin, je tiens que l’union conjugale est la première association qu'aient besoin de former, alors même qu'ils manquent de fortune, un jeune homme et une jeune fille honnêtes et laborieux, ayant chacun un état et le désir de se tirer d'affaire. Une telle association est pour l'un et pour l'autre une source d'avantages nombreux; elle calme leur imagination, elle fixe leurs idées, elle les détourne du vice, la dépense de chacun devient moindre, ils se servent mutuellement d'aide et d'appui: c'est la meilleure ligue qu'ils puissent former contre l'infortune.
Mais, pour que cette ligue ait de bons effets, il faut qu'ils l'aient formée dans de bonnes vues, et surtout qu'ils veillent attentivement sur ses conséquences; car s'ils ne prenaient soin d'en régler, d'en maîtriser les conséquences, elle pourrait devenir pour eux une cause de découragement et de [II-101] ruine, tout aussi bien qu'elle est, alors qu'elle est bien entendue et sagement conduite, un principe très-fécond de force et de prospérité.
Entendons bien ceci: l'essentiel n'est pas de différer le mariage jusqu'à ce qu'on ait de quoi élever un nombre indéfini d'enfans; l'essentiel est de n'avoir d'enfans, même dans le mariage, que lorsqu'on est en position de les élever, lorsqu'on peut croire qu'en les appelant à la vie on ne va faire une chose funeste, ni pour eux, ni pour soi-même : l'essentiel est de ne pas rendre son mariage plus prolifique que son industrie. Ce besoin d'en limiter la fécondité, ce soin de proportionner toujours l'étendue de sa famille à la grandeur de sa fortune, est un soin dont nul ne peut sensément se dispenser, et dont heureusement peu de personnes se dispensent, au moins dans les rangs un peu élevés de la société. A cet égard, comme à plusieurs autres, la morale de la portion instruite de la société vaut mieux que celle des casuistes. Ce n'est que dans les classes indigentes et peu éclairées que l'on continue à user du mariage sans discrétion, sans retenue, sans s'imposer aucune gêne, sans vouloir se soumettre le moins du monde à l'espèce de contrainte morale qui est nécessaire pour en régler les effets. De tous les désordres de la société, celui-ci est peut-être le plus funeste. Il n'y a point de véritable amélioration à attendre pour les classes [II-102] inférieures tant que ces classes continueront, non pas à se marier, mais à faire un si déplorable abus du mariage, tant que chaque nouvel accroissement de la richesse sera rendu vain par un nouvel accroissement de la population, tant que le nombre des ouvriers allant toujours croissant, les capitaux et les travaux pourront se multiplier sans qu'il en résulte aucun accroissement dans les salaires. La place me manque ici pour montrer de combien de manières l'abus de l’union conjugale nuit aux progrès de la société et au développement des pouvoirs du travail. Je me borne à dire que rien n'énerve plus un homme, ne lui ôte davantage l'activité, l'émulation, le courage, ne le rend plus incapable de songer à perfectionner son art et à en étendre la puissance, que de se voir entouré de plus d'enfans, qu'il n'est en état d'en élever, que de sentir que la misère le gagne, le déborde, et qu'il fait de vains efforts pour l'écarter de lui et des siens. Reconnaissons donc qu'il est peu de vertus dont l'homme industrieux ait plus besoin, surtout dans les conditions inférieures, que de celle qui est nécessaire pour régler sagement le principe de la population.
§ 9. Si la liberté des arts tient essentiellement au progrès des mœurs individuelles, elle se lie d'une manière non moins étroite au développement des bonnes habitudes civiles. Pour pouvoir exercer [II-103] librement un art quelconque, il ne suffit pas que nous fassions un usage prudent de nos facultés, que nous soyons de bons économes de nos forces, il faut encore que nous sachions nous en servir sans préjudice pour autrui; il faut que nous ayons appris à en renfermer l'usage dans les limites de la justice.
Nous pouvons sortir de ces limites d'une multitude de façons. Il est en effet mille façons de nous attaquer, de nous faire mutuellement violence. Nous pouvons nous attaquer dans nos personnes par des diffamations, des outrages, des blessures, des meurtres ; nous pouvons nous attaquer dans nos fortunes par des fraudes, des escroqueries, des vols, des extorsions, des pillages ; nous pouvons nous attaquer dans l'exercice de nos facultés par des prétentions exclusives, des prohibitions injustes, des accaparemens, des monopoles, des usurpations de privilèges, etc.
Or, de quelque manière que nous entreprenions les uns et les autres; que nous nous attaquions dans nos personnes, dans nos fortunes, dans l'exercice de nos facultés, les attaques que nous nous livrons ont pour effet inévitable de restreindre notre pouvoir d'agir; et elles le restreignent d'autant plus, que les excès auxquels nous nous portons les uns envers les autres sont plus graves et plus multipliés.
Il est bien superflu de dire, par exemple, que [II-104] nous diminuons les pouvoirs de l'industrie en nous attaquant dans nos personnes. Non-seulement, par des violences de cette sorte, nous pouvons nous réduire plus ou moins à l'impossibilité physique d'agir, mais nous nous en ôtons la faculté morale; nous répandons l’alarme dans la société, nous détruisons cette sécurité sans laquelle il est impossible de se livrer avec zèle et avec fruit à aucun travail. Il n'est pas plus nécessaire d'ajouter que nous détruisons les pouvoirs de l'industrie en nous attaquant dans nos fortunes. Pour pouvoir exercer l'industrie, en effet, les biens que nous possédons ne nous sont pas moins nécessaires que les facultés à l'aide desquelles nous les faisons valoir, et les attentats à la propriété nous ôtent le pouvoir physique d'agir, tout aussi bien que les entreprises contre les personnes. Ajoutez que ces attentats, de même que les précédens, ne nous ôtent pas seulement le pouvoir physique, mais encore le pouvoir moral de travailler; ils paralysent notre activité en même temps qu'ils nous enlèvent nos ressources. Nul ne veut se donner une peine dont il n'est pas assuré de recueillir le fruit; loin de songer à s'enrichir, à peine soigne-t-on ce qu'on possède ; on s'abandonne à l'oisiveté; on tombe dans l'ignorance et la misère, ou, si l'on tendait à sortir de cet état, on fait moins d'efforts pour s'en tirer.
[II-105]
Enfin, il est tout aussi inutile de dire que nous détruisons la liberté de l'industrie en nous attaquant dans l'exercice de nos facultés, en cherchant à mettre des limites à l'activité les uns des autres, en voulant accaparer, chacun de notre côté, quelque genre de fabrication, quelque branche de commerce ou quelque autre mode d'activité. La conséquence nécessaire de ces mutuelles usurpations, c'est que, de toutes parts, nous sommes plus circonscrits et plus gênés dans l'usage de nos forces, que nous en usons avec infiniment moins d'intelligence et d'émulation, que nous en dépensons infructueusement une portion considérable, que nous en tirons en général moins de profit [49] .
Pour exercer les arts avec facilité et avec puissance, nous n'avons donc pas moins besoin de nous respecter les uns les autres, que de savoir faire, par rapport à nous-mêmes, un bon emploi de nos facultés. Ce progrès, différent des précédens, est tout aussi indispensable ; et, de même que l'industrie croît avec la capacité pour le travail et les affaires, avec le perfectionnement des [II-106] habitudes privées, de même elle croît avec le perfectionnement de la justice sociale, et devient d'autant plus libre que nous savons mieux nous respecter mutuellement dans nos personnes, dans l'exercice de nos facultés, dans les produits de nos facultés.
Il me reste à faire une remarque importante : c'est qu'il ne suffit pas que nous sachions nous respecter comme individus, et qu'il faut encore, pardessus tout, que nous sachions nous abstenir de toute violence comme citoyens. Il est fort possible en effet que nous fassions ou que nous laissions faire politiquement des choses dont nous rougirions, et dont nous savons très-bien nous défendre lorsque nous agissons comme individus. Non-seulement cela est possible, mais cela est fort ordinaire, ei rien, n'est moins difficile à trouver que des sociétés, des corps de nation dont les membres, en leur capacité politique, commettent ou tolèrent bien des choses que très-assurément ils réprouvent, et dont en général ils s'abstiennent dans leur qualité d'hommes privés.
Quoique la conduite des hommes, dans leurs relations particulières, même chez les peuples de l'Europe les mieux policés, ne soit pas toujours, à beaucoup près, exempte d'iniquité et de violence, il est pourtant vrai de dire qu'il y a peu d'excès qu'ils ne condamnent en principe, et qu'en pratique [II-107] que il en est beaucoup dont ils savent communément s'abstenir. Eu égard à la masse d'hommes qui s'est développée sur la terre que nous habitons, par exemple, il est sûrement peu d'individus qui, dans leur conduite individuelle, attentent habituellement aux propriétés, ou fassent violence aux personnes; il en est encore moins qui s'avisent, comme individus, de vouloir déterminer l'usage que les autres pourront faire de leurs facultés; je ne sache pas en avoir jamais vu qui, de leur autorité privée, osassent s'arroger des privilèges et s'attribuer le droit exclusif de faire ce qui naturellement est permis à tous.
Mais, si telle est notre réserve lorsque nous agissons comme individus, il s'en faut que, il s'en faut que, politiquement, nous soyons aussi timides. Dès que nous agissons comme membres du corps politique, ou comme chargés d'une portion quelconque de ses pouvoirs, nous ne sommes plus les mêmes hommes; nous ne connaissons plus de bornes à notre volonté; on dirait que les actions changent de nature, parce que nous avons changé de rôle, et que ce qui serait crime de la part des individus est chose louable, ou tout au moins permise, de la part de l'autorité. Notre conscience, qui tantôt était craintive, scrupuleuse, délicate, circonspecte, devient tout à coup entreprenante et hardie. Nous attentons de mille manières à la personne et à la [II-108] fortune des particuliers : nous dépouillons les uns pour enrichir les autres; nous accordons à ceux-ci des privilèges que nous refusons à ceux-là; nous les entravons tous, et surtout les faibles, dans l'exercice légitime de leurs forces.
A la vérité, comme la société n'agit jamais collectivement et en masse, on ne saurait dire que nous prenons simultanément une part active à ces excès ; mais un très grand nombre d'hommes s'en rendent coupables chacun à leur tour, à mesure que le cours des événemens les appelle à l'exercice de la puissance sociale; et, quoique parmi nous, comme en d'autres pays, tous les partis politiques ne manquent pas au même degré de lumières et de modération, nous sommes encore à en connaître un qui, une fois investi des pouvoirs de la communauté, ait voulu, ou pu, ou su en renfermer l'usage dans les limites de la raison et de la justice.
Ensuite, quoique la société tout entière ne participe pas activement aux excès qui se commettent en son nom, on peut dire qu'elle y concourt d'une manière indirecte, par cela seul qu'elle ne les empêche pas. Il suffirait en effet qu'elle eût la volonté de les empêcher pour qu'elle en eût la puissance; et l'on sent assez que les dépositaires de ses forces et de ses ressources n'auraient pas le moyen de les mal employer, si elle ne consentait à [II-109] les prêter pour de mauvais usages. Les hommes investis du pouvoir n’exercent aucune sorte de magie; ils n'ont pas plus que d'autres le don des miracles; et lorsque, dans une société de trente millions d'hommes, il arrive qu'un petit nombre d'individus peuvent entreprendre sur les facultés de la plupart des autres, et gêner l'exercice de toutes les professions, on peut affirmer hardiment que ces individus ont le grand nombre pour complice, et que les excès qu'ils se permettent ont leur raison véritable dans l'état des idées et des mœurs politiques qui prévalent dans la société.
Or, avec des idées et des mœurs politiques qui comportent de tels excès, il n'y a pour aucun ordre de travaux de vraie liberté possible. Que sert, en effet, de nous abstenir individuellement d'attenter aux propriétés, de faire violence aux personnes, de les troubler dans l'usage innocent de leurs facultés, si nous commettons politiquement de telles violences, ou si nous souffrons que les dépositaires de la puissance sociale les commettent en notre nom ? Est-ce que les attentats politiques n'opposent pas à la libre action du travail d'aussi grands obstacles que les délits particuliers ? Ils lui en opposent de bien plus graves. Les délits privés n'atteignent que les individus; les crimes publics attaquent les masses. Les premiers, commis par des hommes isolés, peuvent être facilement [II-110] réprimés; les seconds, commis par des corps constitués, forts de l'ignorance, de la dépravation ou de la faiblesse du grand nombre, doivent rester nécessairement impunis. On n'en peut voir le terme que lorsque le grand nombre, devenu assez éclairé pour les réprouver, est en même temps assez courageux pour ne plus souffrir qu'ils se renouvellent.
Si donc, pour que l'industrie soit libre, il faut que nous nous défendions, comme individus, de toute violence, il est encore plus nécessaire que nous tenions la même conduite comme citoyens. La dernière condition, et la plus essentielle, c'est que nous sachions réprouver comme hommes publics tout ce que nous réprouvons comme hommes privés; que nous ne reconnaissions pas plus de droits à la société, sur les facultés naturelles ou acquises des particuliers, que nous n'en reconnaissons aux particuliers eux-mêmes sur les facultés les uns des autres; que, bien loin de reconnaître à la société ou à ses représentans, vrais ou faux, aucun pouvoir sur la personne ou les facultés d'aucun individu, nous regardions comme le premier intérêt de la société et comme le premier devoir de ses mandataires de mettre la personne et les facultés de chaque homme à l'abri de tout excès; qu'enfin chacun de nous sente que le bon sens, l'honnêteté et le courage du public le protègent véritablement [II-111] dans la possession de tous ses biens, et qu'il ne serait au pouvoir de personne de lui en ravir, en tout ou en partie, le légitime usage. Voilà un dernier progrès qu'il faut avoir fait pour que l'industrie jouisse d'une vraie liberté. Je ne dis pas que ce progrès soit facile; mais je dis qu'il est indispensable, et qu'un peuple n'est vraiment industrieux ou que son industrie n'est complètement libre que lorsqu'il en est arrivé là.
§ 10. C'est beaucoup sans doute, pour le libre exercice de toutes les professions qu'embrasse la société, que de supposer développées dans les hommes dont elle se compose les divers ordres de facultés que je viens d'analyser. Cependant tout ce capital de force, d'intelligence et de bonnes habitudes, quand il serait possible que les hommes l'eussent développé en eux-mêmes sans exercer en même temps une grande action sur la nature, ne suffirait point encore à la liberté de l’industrie. Pour que l'industrie soit libre, en effet, il faut que l'homme, en même temps qu'il s'est rendu propre à l'exercer, ait aussi approprié le monde extérieur à son exercice. Il faut qu'il ait su discerner les lieux les plus favorables à chaque espèce d'établissement, qu'il ait fait subir à ces lieux un certain nombre de modifications préalables, qu'il y ait élevé des constructions, qu'il y ait réuni un certain ensemble [II-112] d'objets, propres à un certain nombre d'usages, et dont il ne peut se passer pour agir. A toute industrie, il faut nécessairement un atelier, et j'ai dit que, pour que cet atelier fût propre à sa destination, il fallait qu'il fût convenablement situé, qu'on l'eût construit et monté d'une manière logique que le travail y fût bien divisé, et, finalement, qu'il fût pourvu d'un certain ensemble de machines, de matières premières, de monnaies, de denrées.
La nécessité de toutes ces conditions est aisée à comprendre. Il y en a plusieurs d'ailleurs dont on a souvent décrit les effets. Néanmoins, je vais exposer, en peu de mots, comment chacune d'elles concourt à la liberté du travail, comment chacune est nécessaire.
Il faut, dis-je, dans tout atelier, une certaine quantité de provisions, de denrées, de choses fongibles. Il y existe, en effet, un certain nombre d'agens, hommes, bestiaux ou machines, à l'entretien desquels il faut nécessairement pourvoir, et c'est en pourvoyant à la conservation de ces agens indispensables que la portion du capital réel dont je parle ici concourt à la production.
Il faut une certaine quantité de monnaies. Il y a à faire en effet, dans tout établissement d'industrie, un certain nombre d'achats tous les jours, tous les mois, lous les ans, et la monnaie concourt au but de l'entreprise en facilitant tous ces échanges [II-113] indispensables, qu'il serait à peu près impossible d'exécuter sans son secours. La monnaie se place ainsi parmi les agens de la production; cependant, comme elle ne la seconde qu'indirectement, et en servant d'instrument aux échanges multipliés que toute production nécessite, il sera plus convenable de ne parler de sa fonction et des conditions auxquelles elle parvient à la bien remplir, que lorsqu'il sera question des échanges qui jouent un si grand rôle dans toute l'économie de la société, et dont elle est l'agent véritable.
Il faut des matières premières. En effet, l'objet même de tout établissement d'industrie étant de faire subir de certaines modifications à des êtres quelconques., organiques ou inorganiques, animés ou inanimés, hommes ou choses, il est clair qu'on ne peut se passer de ces êtres qui sont la matière même du produit qu'on se propose d'effectuer. Il faut à l'hospice des malades, à l'école des écoliers, au pénitentiaire des criminels à guérir de leur penchant au crime; comme il faut à la filature du coton, à la forge du minerai, au haras des étalons, des jumens, des fourrages, etc. Je pourrais remarquer que quelquefois l'homme industrieux va chercher la matière première et la vend ensuite avec la façon qu'il lui a donnée, tandis que d'autres fois la matière première vient le trouver et le paie pour recevoir de certaines façons; mais 159.cette remarque, [II-114] quoique juste, ne conduirait à rien d'utile. Je me contente d'observer que la matière première, de quelque nature qu'elle soit, concourt à la production en fournissant ses propriétés à la chose qu'il s'agit de produire, et j'ajoute qu'elle remplit d'autant mieux sa fonction, qu'elle a été mieux appropriée d'avance aux façons qu'elle est destinée à recevoir.
Le travail qu'un art se propose d'exécuter sur des hommes ou sur des choses, pour les faire passer de l'état où il les prend à celui où il doit les rendre, ne se compose pas d'un acte simple et indivisible ; il se compose presque toujours, au contraire, d'une certaine suite d'actes, assez distincts des uns des autres pour exiger des outils différens, une inain-d'œuvre particulière. Il est essentiel, pour que l'atelier soit vraiment propre à son objet, de faire subir au travail qu'on y exécuté toutes ces coupures, toutes ces divisions dont il est naturellement susceptible, et de confier l'exécution de ces actes élémentaires du travail composé d'où résulte la production, à autant d'agens séparés qui aient constamment la même chose à faire, et qui ne soient jamais obligés de se déranger pour changer d'occupation. Tels sont les avantages qui résultent de cet isolement des fonctions et de la consécration permanente de chaque agent à une fonction spéciale, qu'il serait fort difficile de dire à [II-115] quel point la puissance du travail en est accrue. On: sait bien qu'il est tel genre de fabrique où, par l'effet de cette division du travail, la puissance de chaque travailleur est plusieurs fois centuplée ; mais il serait impossible de dire en général ce que eet heureux artifice permet d'épargner de temps, ce qu'il fait acquérir de précision et de rapidité dans l'exécution d'une multitude d'ouvrages, ce qu'il a fait découvrir de procédés ingénieux et inventer de machines nouvelles [50] .
C'est un des plus heureux effets de l'extrême division du travail qui s'opère dans l'intérieur de chaque atelier d’en simplifier assez les opérations pour qu'il devienne souvent facile de substituer des moteurs inanimés à l'être humain qui les exécute. Les moteurs et les machines sont encore un des agens dont le concours est indispensable à la bonne constitution de l'atelier. Sans machines, l'homme ne dispose que de ses propres forces; avec des machines, il dispose de celles de la nature. C'est par l'intermédiaire des machines qu'il s'empare de ces [II-116] forces, qu'il se les approprie, qu'il les anime en quelque sorte de son intelligence, et les contraint, tandis qu'il se repose ou qu'il se borne à surveiller leur ouvrage, à exécuter avec docilité, avec énergie, avec adresse, tous les desseins que son intelligence a conçus. Ce que les machines lui donnent de puissance, ce qu'elles peuvent pour la multiplication, pour la beauté, pour le bas prix de ses produits, n'est susceptible d'aucune estimation même approximative.
On s'est souvent élevé contre les machines, et il n'en faut pas être surpris. L'effet le plus immédiat de leur intervention est de mettre quelqu'un à la réforme, et de priver, ce semble, de travail les ouvriers qu'elles sont appelées à remplacer. Mais elles ne les dépouillent qu'en apparence, et le seul tort réel qu'elles leur fassent est de les obliger momentanément à changer d'occupation; encore ce tort est-il racheté par d'immenses avantages.
En effet, indépendamment du service qu'elles leur rendent, comme à tout le monde, de faire baisser le prix des produits qu'elles sont employées à créer, elles ont pour eux le triple avantage, 1° de multiplier la demande du travail, 2° d'en élever le prix, 3o de rendre leur tâche moins pénible et moins subalterne.
Elles augmentent la demande du travail, en étendant dans une proportion quelquefois [II-117] immense les diverses fabrications auxquelles elles sont employées, ainsi que les fabrications accessoires, et en donnant presque toujours naissance à de nouvelles industries. Elles élèvent le prix du travail par cela même qu'elles en augmentent la demande. Enfin elles allègent et ennoblissent la tâche de l'ouvrier en l'affranchissant plus ou moins du travail manuel, en l'élevant de la condition de machine à celle de surveillant de machines. Si donc elles suppriment de certaines occupations, elles réparent amplement ce dommage qu'elles ont l'air de causer aux ouvriers, en remplaçant ces tâches bornées, grossières et mal payées, par des fonctions plus nombreuses, mieux rétribuées et plus nobles.
Aussi, quoiqu'elles améliorent le sort de toutes les classes de travailleurs, est-il peut-être vrai de dire qu'elles sont, toute proportion gardée, plus utiles à la classe ouvrière qu'à aucune autre. Tel est le bien qu'il est en leur puissance de faire à cette classe, que si elle n'abusait pas, comme elle le fait, de la prospérité qu'elles lui procurent, elles seraient capables, à elles seules, d'opérer une révolution dans son état, et de lui faire avoir dans le partage des produits une part beaucoup mieux proportionnée à l'importance de sa tâche.
Supposez en effet que, dans le temps où les machines font baisser le prix des produits, étendent [II-118] la production et multiplient la demande d'ouvrage, la classe ouvrière, de son côté, évitât prudemment de trop multiplier le nombre des ouvriers : ne vous est-il pas évident que, du concours de ces deux circonstances, il devrait résulter une grande augmentation dans le prix de ses services, et une notable amélioration dans son état?
M. Say observe, dans son dernier ouvrage [51] , que dans les dix années qui suivirent, en Angleterre, l'introduction de la machine d’Arkwright, de 1777 à 1787, le nombre des ouvriers employés à la filature et au tissage du coton s'éleva de sept mille neuf cents à trois cent cinquante--deux mille, et que, dans le temps où le nombre des ouvriers employés à ce travail prit cette extension singulière, le prix de leur travail devint une fois et demie plus considérable, qu'il s'éleva de cent cinquante pour cent. Comparant ensuite la quantité de coton travaillée aujourd'hui en Angleterre à celle qu'on y fabriquait en 1787, M. Say ajoute que le nombre des personnes occupées maintenant au même ouvrage doit être de plus de deux millions. Il convient, il est vrai, que les salaires ont décliné, à cause du très-grand développement qu'a pris la classe ouvrière. Mais supposez que cette classe, au lieu d'abuser, comme elle l'a fait, [II-119] du principe de la population, eût eu assez de prévoyance et d'empire sur elle-même pour en régler convenablement les effets; supposez que, dans le temps où l'emploi de méthodes plus perfectionnées allait multipliant d'une manière presque infinie les occupations et la demande d'ouvrage, elle eût su mettre quelque borne à la multiplication des ouvriers, et vous concevrez aisément ce que, dans cette supposition, les machines eussent fait pour l'accroissement de son bien-être.
Si la perfection de l'atelier dépend à un très-haut degré de la puissance des instrumens dont il est pourvu, elle tient beaucoup aussi au plan sur lequel il est construit et à la manière dont il est organisé. La bonne organisation de l'atelier est un des moyens généraux du travail dont les économistes n'ont encore tenu que très-peu de compte, quoique cet élément de force ne fût peut-être pas beaucoup moins digne de leur attention que plusieurs autres, et peut-être que les machines et la division du travail. Plus les ateliers sont construits sur de bons plans, plus les machines y sont placées, plus les ouvriers y sont distribués, plus, en un mot, tout y est disposé dans l'ordre suivant lequel doit s'exécuter l'ouvrage, et plus l'ouvrage doit s'y faire librement. Je citerai, quand nous arriverons à l'application, quelques exemples de ce que peut donner de puissance au travail une [II-120] bonne disposition de bâtimens et de machines.
Enfin, la liberté de l'industrie ne tient pas seulement à une bonne distribution des choses dans l'intérieur de chaque atelier, elle se lie également à la manière dont les ateliers sont placés et distribués dans le inonde. Dans l'immense laboratoire que présente la société humaine, comme dans chaque établissement particulier, plus on sait éviter les faux mouvemens, les détours et les stations inutiles, et plus l'industrie acquiert de pouvoir et de liberté. Il est assez rare qu’un produit subisse dans un seul atelier toutes les transformations par lesquelles il doit passer avant d'arriver à la forme sous laquelle il servira enfin aux besoins de l'homme. Ordinairement cela ne se peut point; mais ce qui est possible, c'est qu'il passe plus ou moins rapidement de l'atelier où il a reçu une première façon dans celui où il doit en recevoir une seconde, de celui-ci dans un troisième, et ainsi de suite. Or, plus cette circulation peut s'opérer avec rapidité, et moins l'industrie perd de temps et de peine ; moins elle fait de frais, plus elle est libre.
Supposez qu'après avoir récolté le coton au Brésil, on voulût le filer en Europe, le tisser en Afrique, l'imprimer en Asie, et d'Asie le reporter en Amérique pour le répandre de là dans tous les quartiers du globe qu'il aurait déjà parcourus : n'est-il pas évident que l'industrie perdrait sans [II-121] fruit, dans tous ces trajets, une grande partie de ses moyens et de ses forces, et qu'elle serait moins libre de fabriquer le coton que si elle pouvait le filer, le tisser, l'imprimer dans les lieux mêmes où elle l'aurait recueilli, et le répandre de là partout où la demande lui en serait faite? Si donc, pour que ses mouvemens ne soient pas embarrassés, pour qu'elle ne perde rien de ses forces, il importe que ses agens et ses outils soient convenablement placés dans l'intérieur de chaque atelier; il importe encore davantage que ses ateliers soient convenablement placés et distribués dans le monde ; car plus est grande l'échelle sur laquelle s'exécutent ses mouvemens, et plus son action est ralentie par de fausses manœuvres.
Ainsi les pouvoirs du travail s'étendent à mesure que l'homme accommode mieux les objets extérieurs à son exercice, de même qu'ils s'étendent à mesure qu'il développe davantage en lui-même les facultés dont il a besoin pour travailler.
§ 11. Je dois ajouter, en finissant, que sa liberté est d'autant plus grande non-seulement, que ses pouvoirs sont déjà plus développés, mais qu'ils ont crû avec plus d'ensemble. Quoique les progrès de chacun d'eux influent sur le développement des autres, il est extrêmement rare qu'ils marchent tous du même pied. Il y a toujours quelqu'une de [II-122] nos facultés qui reste en arrière. Certains moyens d'action sont plus développés dans de certains pays, d'autres dans d'autres. « A l'époque de la renaissance des lettres en Italie, observe M. Say, les sciences étaient à Bologne, les richesses à Florence, à Gênes, à Venise. » La population de Genève, distinguée sous bien des rapports, excelle surtout par l'esprit de spéculation et le talent des affaires : vingt des principales maisons de commerce de Paris ont des Genevois pour chefs. Nous brillons moins par le génie des applications que par celui des sciences: nous ne sommes pas assez gens d'affaires pour que la science nous tourne à profit. Les Anglais, au contraire, s'entendent surtout à faire de la science un instrument utile. Il est donc possible que les divers pouvoirs du travail soient très-inégalement développés dans chaque pays. Or, c'est là sûrement une chose fâcheuse. Il arrive presque toujours que lorsque de certaines facultés nous manquent, une partie de celles que nous possédons se trouve annulée. C'est ainsi qu'en de certains lieux le manque de capitaux paralyse l'industrie, comme en d'autres endroits le défaut d'industrie avilit les capitaux; ou, pour parler un autre langage, c'est ainsi qu'un peuple est impuissant avec un grand capital réel, lorsqu'il n'a pas un capital suffisant de facultés personnelles, ou qu'il est encore impuissant avec un [II-123] grand capital de facultés personnelles, lorsqu'il n'a pas un capital assez considérable d'objets réels. Un peuple qui aspire à s'avancer doit donc s'appliquer surtout à perfectionner ceux des agens de la production qui sont le moins développés chez lui : non-seulement, en dirigeant ainsi ses efforts, il se procure des facultés nouvelles, mais il donne de la vie et de la valeur à celles qu'il possédait déjà [52] .
§ 12. Voilà, autant que je puis le comprendre, à quel ensemble de causes tient la liberté du travail. Quoique cette analyse de ses pouvoirs soit sûrement fort imparfaite encore, je crois sincèrement qu'elle est plus exacte, et, dans son ensemble, beaucoup plus complète que celles qu'on en avait faites jusqu'ici.
Il me reste à chercher comment et dans quelle mesure les principes qu'elle renferme s'appliquent aux divers ordres de travaux et de fonctions [II-124] qui entrent dans l'économie du corps social. Ce sera l'objet des chapitres qui vont suivre.
On prévoit aisément que, dans ce travail, plusieurs moyens dont je n'ai pu qu'indiquer l’influence dans un exposé général, recevront une partie des développemens qui leur manquent. Cet exposé deviendra ainsi moins imparfait.
J'ajoute qu'en montrant comment les principes de la liberté s'appliquent aux principales branches de l'activité sociale, j'aurai soin de dire en quoi consiste chacune de ces branches d'activité, et comment elle influe sur tout le reste. Ainsi je commencerai par dire, sur chacun des ordres de travaux et de fonctions dont je me propose de parler, quelle est proprement sa nature. J'entrerai ensuite dans quelques détails sur ses effets. Je finirai toujours par analyser ses moyens. Cette dernière partie, qui est l'objet essentiel de l'ouvrage, sera ordinairement aussi celle sur laquelle j'insisterai le plus.
[II-125]
CHAPITRE XV.
Application de ces moyens de liberté aux diverses industries, et d'abord aux industries qui agissent sur les choses.—De la liberté de l'industrie qui se borne à exécuter de simples déplacemens des choses, ou de l'industrie improprement appelée commerciale. ↩
§ 1. Les principes analysés dans le précédent chapitre s'appliquent indistinctement à tous les arts qu'embrasse la société ; à ceux qui s'exercent sur les hommes comme à ceux qui travaillent sur les choses; à l'enseignement comme à la fabrication; à la politique, aux beaux-arts comme au labourage. Il n'en est point dans lesquels il soit possible de réussir sans les talens qui se rapportent au génie des affaires; sans les connaissances qui tiennent à l'art; sans bonne morale personnelle; sans bonne morale de relation. Il n'en est point qui ne requière, indépendamment d'un certain capital d'industrie et de bonnes habitudes, un autre capital en objets réels, en bâtimens, en denrées, en matériaux, en ustensiles. La puissance et la liberté de tous tiennent également à un certain ensemble d'utilités fixées dans les choses et de facultés développées dans les personnes.
A la vérité ces élémens de puissance ne s'appliquent [II-126] pas de la même manière à tous les arts. On sent aisément qu'à l'application ils doivent se modifier suivant la nature particulière de l'art auquel on les rapporte. Toute industrie demande de certaines connaissances ; mais toutes les industries ne requièrent pas le même genre d'instruction. Il faut, pour toutes, des vertus individuelles et sociales; mais toutes n’exigent pas précisément les mêmes vertus. Elles n'emploient pas toutes les mêmes outils et les mêmes matières, quoiqu'elles aient toutes besoin de machines et de matériaux.
On comprend fort bien aussi que ces moyens ne s'appliquent pas à tous les arts avec la même latitude : tous ne paraissent pas également susceptibles d'être exercés scientifiquement; tous ne procèdent pas avec le même degré de précision et de rectitude ; tous ne se prêtent pas avec la même facilité à une bonne division du travail ; il n'est pas, dans tous, également aisé de remplacer le travail de l'homme par celui des machines; il n'est pas possible, dans tous, de faire valoir une même somme de moyens: il arrive que dans quelques-uns la puissance de l'entrepreneur est naturellement plus limitée que dans quelques autres.
Mais, enfin, les principes sur lesquels se fonde la liberté du travail, considérée d'une manière générale, ont beau s'appliquer inégalement à chaque [II-127] industrie prise en particulier, il n'en est pas moins vrai qu'aucune industrie ne peut être libre que suivant ces principes, et qu'on peut dire de chacune ce que j'ai dit de toutes, savoir: qu'on l'exerce avec d'autant plus de puissance et de facilité qu'on réunit mieux les notions, les habitudes, les matériaux, les instrumens nécessaires à son exercice. C'est ce que la suite de cet ouvrage fera voir, j'espère, clairement. Je vais parler d'abord des arts qui s'efforcent d'approprier les objets extérieurs aux besoins de l'homme.
§ 2. Si je commence par ceux-ci, c'est qu'ils sont le fondement de tous les autres. J'en suis fâché pour les esprits élevés qui aiment à ne considérer l'homme que par ses facultés les plus nobles ; mais, avant tout, il faut exister. Avant d'être un homme moral, éclairé, poli, distingué, il faut être. Avant de pouvoir songer à vivre noblement, il faut vivre. La vie morale, au moins dans ce monde-ci, a ses fondemens dans l'entretien de la vie organique; et l'intelligence la plus vive et la plus épurée est obligée, sous peine de défaillir, de commencer par pourvoir aux besoins de son enveloppe. Ce sont là de ces vérités qu'il n'est pas possible de méconnaître, quelque peine qu'on puisse avoir à se les avouer.
Voici d'ailleurs une chose qu'il faut comprendre, [II-128] et qui pourra réconcilier les esprits purs qui font profession de mépriser tout ce qui tient à la vie animale avec les arts qui ont pour objet de l'entretenir : c'est que le vrai moyen de parvenir à une existence élevée c'est de commencer à se faire, par le travail, une existence confortable. Les industries qui s'occupent d'approprier les choses à nos besoins, en même temps qu'elles nous conduisent à la fortune, sont un acheminement aux acquisitions intellectuelles et morales les plus faites pour honorer l'humanité. C'est une vérité que j'avais énoncée il y a plusieurs années dans la première partie de cet ouvrage [53] , et qui a trouvé, depuis, d'habiles interprètes ailleurs.
« Là où nulle richesse n'est amassée, dit un économiste anglais, l'homme constamment occupé du soin de pourvoir aux besoins les plus urgens du corps, ne peut donner aucun temps à la culture de son intelligence. Ses vues, ses sentimens sont étroits, personnels, illibéraux. Pour voir le cercle de ses idées s'agrandir, pour que ses mœurs deviennent douces et libérales, il faut qu'une certaine aisance lui permette de s'occuper d'autre chose que du soin de se nourrir. Il ne peut se civiliser qu'en devenant riche. Sans le loisir et les ressources que la richesse lui procure, on ne le [II-129] verrait point se livrer à ces études élégantes qui purifient le goût, qui étendent et ennoblissent les pensées, qui placent notre espèce plus haut dans l'échelle des êtres. Le degré de civilisation ou de barbarie où se trouve une nation dépend souvent de l'état de sa richesse. A vrai dire, un peuple misérable n'est jamais civilisé; une nation opulente, jamais barbare. On ne connaît point de nation indigente qui se soit distinguée dans les sciences et les beaux-arts. Le commerce fleurissait en Grèce dans le siècle de Périclès et de Phidias; il prospérait en Italie dans celui de Raphaël et de Pétrarque. C'est sous l'influence de la richesse que Venise sort du sein des eaux; que la Hollande se dégage de ses marais; que l'une et l'autre deviennent le siège des arts, de la littérature et de la science. On a vu, dans les îles Britanniques, le nombre et la supériorité des savans, des gens de lettres, des poètes, des artistes, se proportionner constamment aux progrès de la richesse sociale, c'est-à-dire aux moyens de récompenser et d'honorer leurs travaux [54] . »
Je puis ajouter qu'il n'y a nulle raison pour considérer les arts qui agissent sur les choses comme inférieurs à ceux qui s'occupent directement de l'éducation de l'espèce. C'est de la [II-130] conservation, du bonheur, de la dignité de l'espèce qu'il s'agit également pour tous. Approprier le monde extérieur aux besoins de l'homme n'a rien de moins utile, ni de moins noble que de façonner l'homme lui-même. Combien d'ailleurs ne faut-il pas que l'homme reçoive de façons pour devenir capable d'agir sur la nature avec intelligence et avec force ? Il y a place ici pour le développement de toutes ses facultés; et quand on ne ferait pas de son perfectionnement l'objet propre et direct de son existence; quand on voudrait attacher ses regards et toutes ses pensées à la terre, et n'assigner à sa vie d'autre but que d'accommoder ce bas monde à ses besoins, il ne pourrait négliger encore aucune des connaissances, aucune des vertus qu'il cultive.
Enfin, l'homme s'est occupé des choses avant de replier son activité sur lui-même. Les industries qui agissent sur la nature extérieure sont les premières qu'il a exercées, et c'est encore une raison pour que celles-ci soient les premières qui nous arrêtent.
§ 5. Dans le nombre de ces industries, il en est qui n'agissent sur les choses que pour les déplacer, qui ne leur donnent d'autre façon que de les rapprocher des personnes qui les demandent, qui ne les approprient à vos besoins qu'en les [II-131] mettant à notre portée. On leur a donné, assez à tort comme on va le voir un peu plus bas, le nom d'industries commerciales.
Il en est d'autres dont la tâche est plus compliquée, qui modifient les choses en elles-mêmes, qui leur font subir les transformations les plus variées; mais qui, pour opérer ces transformations, comme les premières pour effectuer leurs transports, n’emploient que des forces chimiques ou mécaniques. On les a nommées industries manufacturières.
Enfin, il en est d'autres qui opèrent des métamorphoses d'un ordre plus élevé, qui créent une multitude de productions végétales et animales; mais qui emploient à cet effet, indépendamment des forces chimiques et mécaniques dont les premières font usage, un agent d'une nature particulière appelé la vie. On a nommé ces dernières industries agricoles.
Je vais m'occuper d'abord de celles qui n'agissent sur les choses que pour les déplacer, pour les mettre sous la main des travailleurs. Je parlerai ensuite de celles qui les transforment. Je traiterai en dernier lieu de celles qui, pour opérer leurs transformations, ont besoin du secours de la vie. J'arriverai ainsi tout naturellement à la seconde division des arts qui entrent dans l'économie sociale, c'est-à-dire à ceux qui agissent sur le genre humain, qui l'élèvent, le dressent, le façonnent, [II-132] et qui, pour cela, ont également besoin du secours de la vie, non de la vie végétative, mais de la vie animale, et non-seulement de la vie animale, mais encore de la vie intellectuelle et de la vie morale, de la vie considérée dans ses modes d'action les plus élevés.
Si, à la différence de la plupart des économistes, qui commencent par l'industrie agricole et finissent par l'industrie commerciale, je commence au contraire par le commerce et n'arrive à l'agriculture qu'en troisième lieu, c'est que l'objet du commerce est infiniment plus simple que celui de l'agriculture, et que d'ailleurs c'est par des opérations commerciales, c'est-à-dire par des transports, par de simples déplacemens des choses, que la production semble avoir commencé.
Je crois que l'homme a opéré des déplacemens avant des transformations. Il me paraît naturel de supposer, par exemple, qu'avant de créer des objets propres à sa nourriture, il a dû songer à s'emparer de ceux que la nature avait formés. Il y avait du fruit sur l'arbre, du poisson dans l'eau, du gibier dans la garenne. Mais il manquait une façon à ces produits pour être propres à son usage : c'était d'être mis à sa portée. Il a arrêté l'oiseau dans son vol et le chevreuil dans sa course, il a extrait le poisson de la mer, il a fait tomber le fruit de l'arbre; et ces produits qui étaient sans [II-133] valeur, qui n'existaient pas pour lui là où ils se trouvaient, il les a créés en quelque sorte en les faisant seulement changer de place, en les faisant arriver sous sa main. Il semble donc que l'industrie à laquelle on donne le nom de commerciale, a commencé d'agir avant aucune autre.
Cette industrie est d'ailleurs celle dont l'objet est le plus simple et le plus circonscrit. Tandis que la fabrication et même l'agriculture font subir aux choses les modifications les plus variées, le commerce ne leur en fait jamais subir qu'une seule, qui est de les changer de place. Il les transporte d'un temps à un autre, d'un pays à un autre, des temps d'abondance aux temps de disette, des pays où elles sont communes aux lieux où elles sont rares: il est sans cesse occupé à les distribuer avec réflexion et discernement dans le temps et dans l'espace. Il les fait passer du dedans au dehors; du dehors au dedans; des lieux où elles se fabriquent, dans les entrepôts où elles se vendent par grosses parties; des magasins où elles se vendent en gros, dans les boutiques où on les distribue en détail, Mais, dans ses mouvemens les plus limités, comme dans ses expéditions les plus lointaines, il ne fait jamais que les déplacer; et, depuis l'action du détaillant, qui se borne à tirer ses marchandises des rayons de sa boutique pour les placer sous la main de l'acheteur, jusqu'à celle de l'armateur qui est [II-134] allé chercher ces marchandises en Amérique, aux Indes, à la Chine, il n'y a jamais d'exécuté qu'une seule chose, des transports. L'action de l'armateur et celle du détaillant sont absolument de même nature; l'un et l'autre travaillent à approcher la marchandise de l'acheteur: l'armateur a commencé l'opération ; d'autres agens de commerce l'ont continuée jusqu'au détaillant; celui-ci la termine.
Ainsi, tandis que cette industrie semble avoir commencé la première, il se trouve encore qu'elle est celle dont l'objet est le moins compliqué, et c'est une nouvelle raison pour qu'elle nous occupe avant aucune autre : le véritable ordre logique est d'aller du simple au composé.
En indiquant les motifs qui ne déterminent à parler d'abord du commerce, je viens de faire connaître en quoi consiste cette industrie, et quelle est proprement sa nature. Il ne me reste rien à dire sous ce rapport. J'ai seulement, avant de terminer ce paragraphe, quelques remarques à faire sur le nom qu'on lui a donné.
Je serais fort embarrassé de dire pourquoi l'on a qualifié de commerciale l'industrie qui déplace, qui transporte, qui distribue ainsi dans le monde les choses nécessaires à la satisfaction de tous les besoins et à l'exécution de tous les travaux. Il est évident qu'on n'a pu lui donner le nom de commerce sans faire violence à ce mot, sans le détourner [II-135] de son acception véritable. En effet, le sens naturel et étymologique du mot commerce, COMMERCIUM, mot formé de cum et de MERX, c'est échange. Commercer, c'est échanger; c'est, au lieu de ravir une chose, l'obtenir au moyen d'une autre, cum merce. Évidemment, il n'y a aucune raison pour appliquer ce mot à l'acte industrieux, au fait productif de l'homme qui exécute des transports.
Le comte de Verri, et, après lui, M. Say, ont sûrement eu raison d'observer que, dans le nombre des personnes qui vendent et qui achètent, il y en a toute une classe, et une classe fort nombreuse, qui exécute des transports, et qui concourt ainsi à la production d'une manière très-directe. Ils auraient pu donner le nom d'industrie voiturière à cette action de transporter, comme on donne à l'action de transformer le nom d'industrie manufacturière. Ils auraient encore pu dire le voiturage, comme on dit le labourage. Mais certainement ces écrivains ont eu tort d'appliquer le nom de commerce à l'art des transports. Il n'y a pas plus de raison pour appeler ainsi l'industrie des gens qui voiturent les choses, que pour donner ce nom à l'industrie des gens qui les façonnent. Nous faisons tous des échanges dans la société, nous sommes tous marchands de quelque chose, nous sommes tous commerçans; mais commercer n'est [II-136] proprement un métier pour personne. Il y a des hommes qui labourent, d'autres qui fabriquent, d'autres qui voiturent, d'autres qui enseignent, qui prêchent, qui peignent, qui chantent, qui déclament : ce sont là autant d'arts particuliers. Commercer, échanger, obtenir, avec ce qu'on fait, une partie de ce que font les autres est un acte commun à toutes les classes de travailleurs.
Je suis donc très – fâché qu'on ait appliqué le nom de commerce à l'art des transports, au voiturage, à l'industrie voiturière. Mais enfin, puisqu'on est parvenu à donner à ce mot une entorse assez vigoureuse pour lui faire signifier l'art de voiturer, de transporter, il faudrait au moins savoir le consacrer à cet usage, et ne pas dire, après cela, que le commerce consiste à acheter dans un lieu pour revendre dans un autre, à acheter en gros pour revendre en détail, à acheter pour revendre [55] ; car, bien visiblement, l'art de transporter ne consiste pas plus à acheter pour revendre, que l'art de fabriquer ou de labourer ne consiste à vendre et à acheter. Je sais bien que le commerçant, c'est-à-dire le colporteur, le voiturier, l'armateur, commencent par acheter, et finissent par revendre ; mais quelle est l'industrie qui n'en fait pas autant? [II-137] Le manufacturier achète des marchandises sous une forme pour les revendre sous une autre, de même que le commerçant en achète dans un lieu pour
les revendre dans un autre lieu : cependant peut-on dire que l'art du fabricant consiste à acheter pour revendre? non : l’art du fabricant consiste à opérer des transformations, comme l'art du commerçant à exécuter des transports: c'est en transportant que le commerce produit : voilà, comme art, ce qui le caractérise; et non l'action d'acheter, de vendre, d'échanger.
Je veux donc bien, quoiqu'à regret, consentir à laisser le nom de commerciale à l'industrie qu'on aurait dû nommer voiturière, c'est-à-dire à l'industrie qui se charge de porter, de voiturer, partout où besoin est, les choses nécessaires à la vie et à l'activité des hommes. Mais j'avertis que, dès ce moment, je n'entends plus par commerce que l'art des transports, et qu'il ne sera pas plus question ici d'achats ou de ventes, qu'il n'en sera question dans les chapitres où je traiterai de la fabrication de l'agriculture, de l'enseignement ou de tout autre ordre quelconque de professions. J'attendrai, pour m'occuper de l'action de vendre, d'acheter, d'échanger, d'avoir parlé des arts qui produisent les choses destinées à l'échange, c'est-à-dire d'avoir parlé de toutes les classes de professions qui entrent dans l'économie sociale; puisqu'il n'en est pas une [II-138] qui ne fasse quelque produit avec lequel elle se présente sur le marché.
§ 4. L'industrie commerciale, ai – je dit, est celle dont l'objet est le plus simple. Il n'en faudrait pas conclure qu'elle est celle dont le rôle est le moins important.
Sans l'intervention du commerce nul travail ne serait possible; car nul travailleur ne possède naturellement sous sa main toutes les choses dont il a besoin pour agir. Il est indispensable que l'industrie voiturière commence par réunir autour de lui, des points les plus divers et quelquefois les plus éloignés, tout ce qu'il lui faut, pour exécuter ses travaux, de matériaux, de machines, de denrées, de monnaies. Il est indispensable aussi que cette industrie renouvelle ses provisions à mesure qu'il les consomme. La nécessité du commerce est une conséquence forcée de l'éloignement où les choses sont les unes des autres, et de l'obligation où se trouvent toutes les professions à poste fixe de réunir sur un seul point, pour pouvoir travailler, des choses disséminées ordinairement dans une multitude de lieux divers [56] .
[II-139]
Sans l'intervention du commerce nul travailleur ne pourrait vivre, alors même qu'il lui serait possible d'exercer son arl; car, chaque travailleur ne créant ordinairement qu'une sorte de produits, et en consommant d'une multitude d'espèces, il est clair que chacun resterait privé de tous ceux qui lui manquent, si l'art des transports, en les rapprochant de lui, ne lui offrait les moyens de les échanger contre ceux qu'il crée. La nécessité de l'industrie commerciale est donc encore une conséquence forcée de la séparation des métiers, et de la nécessité de rapprocher de chaque travailleur ce qu'une multitude d'autres travailleurs produisent.
Le commerce commence par seconder toutes les industries en rapprochant d'elles tout ce que demande leur travail; et il complète ensuite les produits de chacune en mettant ces produits à la portée de quiconque en a besoin. Il conduit au marché les produits de chaque travailleur, et lui rapporte toutes les choses que réclament l'entretien de sa maison et celui de sa fabrique. Il est également indispensable pour la création et pour le débit de tous les produits.
[II-140]
Il y a une autre manière de sentir l'importance de l'industrie commerciale : c'est de considérer tout ce qu'elle peut donner de valeur aux choses et aux hommes en les déplaçant à propos.
Que valent les meilleures choses, là où elles sont dans une extrême abondance, et combien n'acquièrent-elles pas de prix en passant des lieux où elles surabondent dans ceux où la disette s'en fait sentir? Que valent les choses les plus susceptibles de devenir utiles, loin des arts capables de tirer parti de leurs propriétés, et combien le commerce n'ajoute-t-il pas à leur prix en les rapprochant des arts qui peuvent rendre leurs propriétés utiles? Combien n'accroît-il pas leur valeur à mesure qu'il les fait arriver sous la main de nouveaux travailleurs qui leur donnent tous quelque façon nouvelle ? Qui sait pour combien l'art des transports est entré dans la création des richesses qui existent dans un pays, sur une seule place de commerce, dans les mains d'un seul individu?
Mêmes remarques à faire sur ce que le commerce peut donner de valeur aux hommes. Que valent les talens les plus utiles là où les hommes qui les possèdent sont infiniment trop nombreux? ? Combien le commerce n'ajoute-t-il pas à la valeur de ces talens en transportant les hommes qui les possèdent des lieux où ils surabondent dans ceux où ils manquent? Que vaut à l'artiste le plus [II-141] distingué l'art dans lequel il excelle, loin des circonstances où il lui serait possible d'en tirer parti? Combien le commerce n'ajoute-t-il pas à la valeur de ses facultés en le faisant arriver sur un théâtre plus favorable à leur exercice? Qui pourrait dire ce que l'art des transports ajoute à la valeur de ce qu'il y a dans un pays de facultés de toute espèce par la manière dont il distribue les hommes en qui résident ces facultés ?
M. Say observe que l'industrie commerciale ne peut s'appliquer qu'à des objets matériels [57] . Je comprends fort bien qu'on ne peut pas voiturer des talens, des connaissances, séparés des hommes dont ils sont la propriété. Mais, de même qu'on transporte les utilités fixées dans les choses en transportant les choses en qui existent ces utilités, de même on peut faire voyager les idées, les talens, en faisant voyager les hommes qui les possèdent. Le commerce s'applique ainsi aux facultés que l'art a développées dans les hommes, comme aux utilités qu'il a réalisées dans les choses, et il ajoute également à la valeur des unes et des autres par la manière dont il distribue dans le monde les hommes et les choses en qui le travail les a fixées.
Il y a même cela de remarquable que le commerce [II-142] peut ajouter plus à la valeur des hommes en les déplaçant, en les faisant voyager, qu'il n'ajoute par là à la valeur des choses. Il ne suffit point, en effet, de faire subir des transports à une chose pour qu'elle se trouve changée, pour qu'elle ait reçu de nouvelles façons, tandis que l'homme, dont les sens sont constamment ouverts à l'impression des objets extérieurs, se modifie en quelque sorte par cela seul qu'il voyage. Il serait fort difficile de dire tout ce que l'industrie commerciale a fait pour l'éducation des hommes en les déplaçant, en les portant d'un pays dans un autre, en les faisant communiquer entre eux.
Montesquieu observe que le commerce a procuré la connaissance des mœurs de tous les peuples, qu'on les a comparées entre elles, et qu'il en est résulté de grands biens [58] .
Robertson attribue en partie la renaissance des lettres et de la civilisation en Europe au puissant moyen d'instruction que les croisades offrirent à ses habitans en les déplaçant, en leur faisant traverser des contrées mieux cultivées, plus civilisées que les leurs.
« Il était impossible, observe-t-il, que les croisés parcourussent tant de pays, qu'ils vissent des lois et des coutumes si diverses sans acquérir de l'instruction et des connaissances [II-143] nouvelles. Leurs vues s'étendirent; leurs préjugés s'affaiblirent; de nouvelles idées germèrent dans leurs têtes; ils virent en mille occasions combien leurs moeurs étaient grossières en comparaison de celles des Orientaux policés; et ces impressions étaient trop fortes pour s'effacer de leur mémoire lorsqu'ils étaient de retour dans leur pays natal... C'est à ces bizarres expéditions, l'effet de la superstition et de la folie, que nous devons les premiers rayons de lumière qui commencèrent à dissiper les ombres de l'ignorance et de la barbarie [59] . »
« Le voyager me semble un exercice proufitable, dit Montaigne. L'ame y a une continuelle exercitation à remarquer des choses incogneues et nouvelles, et je ne sache point, comme j'ay dict souvent, meilleure eschole à façonner la vie que de lui proposer incessamment la diversité de tant d'aultres vies, fantaisies et usences, et de luy faire gouster une si perpétuelle variété des formes de nostre nature... On dict bien vrai, ajoute-t-il plus loin, parlant encore des voyages, qu'un honneste homme c'est un homme meslé [60] . »
Il veut dire sans doute un homme qui s'est beaucoup mêlé aux autres.
Or, le propre de l'industrie commerciale est de mêler beaucoup les hommes, de les remuer beaucoup, [II-144] et en les mettant continuellement en rapport avec de nouveaux objets et de nouveaux visages, de leur offrir des moyens d'instruction qui manquent aux professions à résidence. Les hommes que le commerce fait voyager voient alternativement des populations actives et des populations paresseuses; ils en voient de fastueuses et d'économes, de soigneuses et de négligentes; ils peuvent remarquer dans l'état matériel des lieux que ces populations habitent, les effets différens de ces mœurs différentes. Partout où règnent l'activité et l'économie ils aperçoivent le bien-être; ils trouvent constamment la misère aux lieux qu'habitent le faste et l'oisiveté, et ils reçoivent ainsi des faits les leçons de morale les plus propres à faire sur leur esprit une impression utile et durable.
Ils n'ont pas moins d'occasions d'observer les effets des bonnes habitudes publiques que ceux des bonnes habitudes privées. Ils visitent tour à tour des peuples bien polices et des peuples mal policés; des peuples chez qui règne la justice, et d'autres peuples chez qui domine la violence. Ils sont d'autant plus excités à observer cette partie de leurs mœurs qu'ils en sont personnellement affectés. Ils trouvent, chez les uns, sûreté et facilité pour l'exercice de leur industrie; chez les autres, dangers et entraves de toute espèce ; et l'expérience qu'ils font ainsi continuellement de l'effet des bonnes [II-145] et des mauvaises habitudes civiles est sûrement l'une des choses les plus faites pour leur démontrer l'utilité et leur inspirer la passion de la justice.
J'aurais fort à faire si je voulais décrire avec quelque étendue les effets de l'industrie voiturière, et indiquer de combien de manières elle peut augmenter la valeur et favoriser les progrès des hommes et des choses par les déplacemens qu'elle leur fait subir. J'espère que le peu que j'ai dit suffira pour faire comprendre l'importance de son rôle. Assez éclairés maintenant sur sa nature et son influence, hâtons-nous d'arriver à ses moyens, et voyons comment s'appliquent ici les principes généraux développés dans le précédent chapitre. Examinons rapidement ce qu'elle peut puiser de force dans les facultés des hommes et dans la disposition des choses; dans le talent des affaires, dans les connaissances relatives à l'art, dans les habitudes morales d'un côté, et d'une autre part, dans l'état des lieux où elle travaille et dans la possession de tous les objets matériels nécessaires à son action.
§ 5. Il semble que je devrais avoir peu de chose à dire ici pour faire sentir l'importance du génie des affaires. L'industrie commerciale en effet est celle de toutes où l'on paraîtrait comprendre le [II-146] mieux la nécessité de ce moyen. Cela va si loin que, dans la pratique, le mot commerce est presque synonyme d'affaires; qu'entreprendre d'approvisionner un marché de certaines marchandises, entreprendre un commerce et faire des affaires sont presque une seule et même chose; qu'on dit d'un commerçant qu'il est dans les affaires, tandis qu'on le dit à peine d'un fabricant, qu'on le dit moins encore d'un agriculteur, et qu'on ne le dit pas du tout de beaucoup d'autres industrieux; qu'enfin l'on confond habituellement les spéculations commerciales avec le commerce même, quoique le talent de spéculer ne soit qu'un des moyens généraux sur lesquels se fonde la puissance de toute industrie, et que ce moyen ne soit pas plus nécessaire à l'art qui se charge de transporter les choses qu'à ceux qui entreprennent de les transformer. Malgré tout cela cependant, il s'en faut que le talent des affaires préside toujours aux entreprises de l'industrie commerciale. Quelques exemples vont faire connaître à la fois combien ici ce moyen serait nécessaire, et combien souvent il est négligé.
J'ai dit que le premier besoin de toute industrie, avant d'entreprendre de produire, était d'étudier la nature et l'étendue des besoins éprouvés, et de prendre en mûre considération l'état de la demande. Partant, le commerce, qui produit les [II-147] choses dans un pays en les y transportant, ne peut se dispenser d'examiner, avant de les y transporter si la demande y en est faite, et jusqu'à quel point elles y sont demandées. On ne saurait douter que les crises douloureuses qu'a éprouvées l'industrie dans ces derniers temps ne soient venues, en bonne partie, du peu de soin qu'ont eu les commerçans d'user de cette précaution, en apparence si simple. Les arts qui transforment les choses ont sûrement fait beaucoup de fausses spéculations; mais celui dont la fonction est de les répandre dans le monde n'a peut-être pas mis dans ses entreprises beaucoup plus de prudence et d'habileté, et je ne sais si, par la manière dont il a dirigé ses opérations, il n'a pas autant contribué que les autres aux souffrances communes.
« Leith, et plusieurs autres villes manufacturières de l'Angleterre, observait il y a quelques années un écrivain de ce pays, ne sont pas encore relevées des banqueroutes qui ont suivi les expéditions de marchandises dont elles avaient encombré les marchés du continent en 1814 et 1815. Mais les premières expéditions qui eurent lieu lorsque nous fûmes admis pour la première fois à commercer directement avec le Brésil, Buenos-Aires et Caracas furent peut-être plus ruineuses encore. Les hommes pratiques se livrèrent alors sans aucune réserve à l'esprit de spéculation. Un voyageur fort intelligent, [II-148] M. Mawe, qui résidait à cette époque à Rio de Janeiro, nous apprend que, dans l'espace de quelques semaines, Manchester envoya plus de marchandises que le Brésil n'en avait consommé dans le cours des vingt années précédentes. Il y en avait une telle quantité, qu'il était impossible de trouver dans la ville des magasins assez vastes pour les loger, et que les articles les plus précieux étaient étalés sur le rivage. Ce qui était surtout curieux, c'était la manière dont ces habiles gens avaient composé leurs expéditions. On offrait d'élégans services en porcelaine et en cristal à des populations qui n'avaient jamais bu que dans la corne ou dans des noix de cocos. On avait également envoyé une immense quantité d'outils qui avaient à l'une de leurs extrémités un marteau, et à l'autre une petite hache, comme si les habitans n'avaient autre chose à faire que de casser toutes les pierres qu'ils rencontreraient, et d'en extraire l'or et les diamans qui devaient s'y trouver. Un de ces spéculateurs, encore plus avisé, avait envoyé une cargaison de patins à l'usage des habitans de Rio-Janeiro, qui n'ont jamais vu de glace, et à qui même il est fort difficile de faire comprendre que l'eau se puisse glacer [61] .»
Je n'ai pas besoin de dire que ces faits accusent particulièrement l'industrie commerciale. Je ne sais [II-149] si les fabricans anglais avaient eu tort de créer les objets dont il s'agit dans les exemples que je viens de citer; mais très-assurément le commerce britannique, en les dirigeant comme il vient d'être dit, en avait fait une distribution vicieuse. Il est clair, par exemple, que, dans quelques-uns des envois qu'il avait faits au Brésil, il n'avait tenu nul compte de la nature des besoins de ce pays; que, dans d'autres, il n'avait pas mieux considéré l'étendue de ces besoins; qu'en tout, il avait fort mal étudié l'état de la demande. Aussi l'on sait quelles ont été les suites de ces expéditions. Pendant des années entières, les marchandises expédiées sont restées enfermées dans les magasins des négocians à la consignation de qui on les avait envoyées, quoique les expéditeurs consentissent à perdre les frais de nolis, de commission, de douanes, d'assurance, et qu'ils eussent donné l'ordre de vendre à des prix inférieurs à ceux des marchés d'Europe, et au moment où j'imprime ces lignes (août 1829), l'engorgement au Brésil commence à peine à diminuer [62] .
Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples des fausses spéculations auxquelles s'est livré, dans ces derniers temps, le commerce de l'Angleterre. Un des plus fameux est celui des énormes envois de fonds que les capitalistes de ce pays ont faits aux [II-150] nouveaux États de l'Amérique du sud. Jamais, observe l'écrivain que je citais tout à l'heure, l'avidité des spéculateurs de la Grande-Bretagne ne les avait plus complètement fourvoyés. Prenant les nouveaux États reconnus pour autant d’Eldorado, et ne doutant pas que des capitaux confiés aux gouvernemens de semblables pays ne dussent rapidement s'accroître, ils leur ont envoyé successivement jusqu'à la somme de 31 millions 570 mille liv. st., au-delà de 789 millions de francs. Mais les guinées anglaises, au lieu de croître et de multiplier en Amérique, s'y sont pour ainsi dire fondues; les valeurs envoyées se sont bientôt trouvées réduites de plus de soixante pour cent; les titres des créanciers du Pérou, par exemple, sont descendus de 85 à 22 1/2; et il y a eu un moment, tant on s'était formé une juste idée des ressources de ce pays et des emprunts que raisonnablement il pouvait faire, il y a eu, dis-je, un moment où les marchands d'argent qui avaient envoyé les 789 millions en Amérique en perdaient au-delà de 480 [63] .
Une autre entreprise du commerce anglais digne de figurer à côté de celle que je viens de décrire, est celle qu'il fit sur les cotons en 1825. L'idée s'était répandue que la dernière récolte des cotons serait insuffisante pour les besoins de l'année. [II-151] Là-dessus chacun se hâte de faire des demandes. On en fait deux fois plus que l'année d'avant. Ces demandes extraordinaires amènent aussitôt une hausse. L'impulsion à la hausse étant une fois donnée, de nouveaux acheteurs se présentent; les prix continuent à s'élever; ils deviennent presque doubles de ceux de l'année précédente; ce qui s'était vendu dix en 1824, on l'achète dix-huit en 1825; ce qui s'était vendu sept et un quart se paie treize et demi; lorsque enfin on vient à s'apercevoir que la denrée que l'on croyait rare avait été produite en quantité surabondante. Aussitôt un mouvement en baisse se déclare; ce qui était monté de dix à dix-huit redescend jusqu'à sept; ce qui était monté de sept et un quart à treize et demi tombe à cinq; et les commerçans qui, dans la supposition d'une disette qui n'existait pas, avaient fait venir des quantités doubles de celles de l'année précédente, éprouvent ou font éprouver à leurs vendeurs une perte de 62 millions 500 mille francs [64] .
Je pourrais citer d'autres faits, car les exemples de ce genre abondent; mais en voilà assez, et peut-être plus qu'il ne faut, pour ce que je cherche à faire sentir. Si dans un pays qui est la terre classique du commerce on peut faire des entreprises comme celles que je viens de citer; si les commerçans [II-152] de ce pays sont capables d'envoyer des patins au Brésil, ou des services de cristal et de porcelaine à des populations à demi sauvages, ou près de 800 millions d'argent à des gouvernemens à peine établis dans des pays où tout est à créer, ou en une seule fois de quoi purger amplement pendant cinquante ans tous les habitans d'une colonie nombreuse [65] , on peut juger de quelles bévues l'industrie commerciale est encore capable, et l'on sent combien j'ai raison de présenter le talent de spéculer comme une des facultés dont cette industrie peut le moins se passer. Reconnaissons donc bien que la chose la plus nécessaire à un commerçant, c'est de connaître les besoins auxquels il entreprend de pourvoir : tout ce que j'ai dit de cette première partie du talent des affaires trouve ici sa pleine et entière application.
J'ajoute qu'après s'être soigneusement informé des besoins, il doit examiner avec la même attention si ces besoins ne sont pas déjà satisfaits, et s'il dépend de lui de les mieux satisfaire. La chose qu'il voudrait porter dans un pays est du nombre de celles qui s'y vendent; mais cette chose n'y est-elle pas déjà produite par l'industrie locale ou par des commerçans moins éloignés, plus diligens ou plus habiles que lui? si déjà d'autres industrieux [II-153] l'y créent ou l'y transportent, à combien y revient-elle? à quel prix est-il en état de l'y faire parvenir ? quels seront ses frais d'achat, d'emballage, de douanes, d'assurances, de roulage, de nolis, de commission? a-t-il quelque moyen de mieux faire que les autres, et de se rendre utile, avec fruit pour lui-même, au pays qu'il entreprend d'approvisionner? Voilà des questions qu'il lui faut indispensablement résoudre, et plus la concurrence sera grande, plus il aura besoin de mettre de l'exactitude et de la rigueur dans ses solutions. Il est donc nécessaire qu'il soit aussi capable d'apprécier l'état de l'offre que l'état de la demande, et cette seconde faculté de l'homme d'affaires est également de celles dont il ne peut se passer.
Telle est la nature des entreprises commerciales, qu'il semble que la gestion de ces sortes d'affaires ne doit pas requérir autant de talens administratifs que celle de beaucoup d'autres, et par exemple, que la conduite d'une grande fabrique, d'une ferme considérable, d'un vaste établissement d'instruction, etc. Cela tient à ce que l'entrepreneur d'un commerce n'a sous ses ordres qu’une très-petite partie des agens qui concourent à l'exécution de ses entreprises, tandis que la plupart des autres entrepreneurs sont obligés de réunir tous leurs agens autour d'eux, et de présider à l'opération tout entière. Qui sont les agens d'un commerçant? Ce sont, [II-154] indépendamment du petit nombre de commis et d'hommes de peine qu'il a près de lui, les commissionnaires de roulage et les armateurs qu'il charge du transport de ses marchandises ; ce sont les rouliers qui dirigent les voitures; ce sont les capitaines qui conduisent les bâtimens et les matelots qui exécutent la manœuvre ; ce sont les négocians à la consignation de qui les marchandises sont envoyées. Est-ce que tous ces agens de la production commerciale sont sous ses ordres? non : la seule besogne qu'il dirige véritablement est celle qui se fait près de lui, et l'on en peut dire autant de celle que font le commissionnaire de roulage, l'armateur, le capitaine de navire : chacun de ces agens a sa gestion séparée, et la tâche de chacun est sûrement plus simple que celle, par exemple, d'un fabricant, qui peut avoir autour de lui plusieurs centaines d'ouvriers à conduire et un matériel considérable à entretenir ou à renouveler. Cependant, malgré ces différences, qui peuvent rendre en effet la conduite d'une fabrique ou d'une vaste exploitation agricole plus difficile que celle d'une maison de roulage, de commission, de banque, de vente en gros ou en détail, ou bien que celle d'un navire, d'un bateau, d'une voiture, il n'est pas douteux que, dans la plus simple de ces entreprises, il n'y ait des hommes à conduire, des travaux à surveiller, des dépenses à faire, un matériel à conserver, [II-155] et que pour tout cela un certain talent d'administration ne soit absolument nécessaire [66] .
Enfin, quoiqu'une comptabilité régulière ne soit pas ici plus indispensable que dans toute autre industrie, la nécessité d'une semblable comptabilité dans toute entreprise de commerce a été si bien sentie qu'elle est devenue l'objet d'une prescription légale, et que tout commerçant est obligé de tenir à la fois un livre-journal où il inscrit, jour par jour, toutes les opérations de son commerce, tout ce qu'il paie, tout ce qu'il reçoit, à quelque titre que ce puisse être, où il énonce même mensuellement les dépenses de sa maison, [II-156] et un second livre, sur lequel il copie tous les ans l'inventaire complet de ses effets mobiliers et immobiliers, et de toutes ses dettes actives et passives. Encore, un commerçant habile, et qui veut voir clair dans ce qu'il fait, ne se contente-t-il pas de ces livres, les seuls dont la tenue régulière lui soit ordonnée, et a-t-il grand soin d'ouvrir des comptes particuliers à toutes ses opérations un peu considérables, de débiter chacune de ces opérations de tout ce qu'elle coûte, de la créditer de tout ce qu'elle rapporte, et de se ménager ainsi les moyens de reconnaître celle qui procure des profits, celle qui donne de la perte, et par conséquent celles qu'il peut continuer avec avantage et celles qu'il doit abandonner.
Ainsi, l'on trouve à faire ici l'application de toutes les facultés qui constituent le génie des affaires. On va voir qu'il en est de même des divers genres de capacités qui tiennent à l'art.
§ 6. Il ne suffit pas plus dans l'industrie commerciale que dans toute autre de savoir ce qu'il convient d'entreprendre: il faut encore être en état de le mettre à exécution. La première chose sans doute est bien de savoir ce qu'on peut porter utilement dans un pays, et ce qu'on en peut rapporter avec avantage; mais il faut en outre être en état d'effectuer ces transports, de les effectuer d'une manière [II-157] sûre, commode, rapide, peu dispendieuse. Or, c'est là un art, et un art immense, un art qui en renferme beaucoup d'autres. Pour devenir capable de porter chaque chose des lieux d'où on pouvait la tirer, partout où la demande en pouvait être faite, il a fallu connaître la position respective de tous les points du globe, et apprendre à se diriger de chacun de ces points vers tous les autres ; il a fallu savoir créer des voies pour se conduire, et inventer les machines les plus propres au transport des fardeaux. Ce sont là autant d'arts, et des arts qui demandent, pour être bien exercés, ce que demandent tous les arts, c'est-à-dire des connaissances pratiques, des notions théoriques, des talens d'application et d'exécution.
Il fut un temps où l'on n'était capable ni de se diriger, ni de créer des voies, ni de construire des voitures. Toutes les communications étaient difficiles et bornées. Sur mer, on ne pouvait perdre de vue les côtes sans courir le risque de s'égarer. C'était, dans les âges qu'on a qualifiés d'héroïques, une grande et périlleuse entreprise que de passer des côtes de l'Asie mineure à celles d'Italie, ou seulement aux îles Ioniennes; et de tels voyages parurent long-temps assez extraordinaires pour que de grands poètes en aient fait, plus tard, le sujet de leurs épopées. Sur terre, à une époque [II-158] infiniment plus rapprochée de nous, il n'était pas rare qu’on ignorât l'existence de lieux considérables dont on n'était que peu éloigné. Paris et ses environs, vers la fin du dixième siècle, étaient une région étrangère et inconnue pour les moines de Clugny en Bourgogne, qui n'en étaient pas à cent lieues, et l'abbé de ce couvent refusait au comte Bouchard, qui avait fondé un monastère à SaintMaur-des-Fossés, d'y envoyer des religieux, à cause, disait-il, des dangers et des fatigues que ne pourrait manquer d'entraîner un si grand et si pénible voyage. Deux siècles plus tard, les moines de Ferrières et de Saint-Martin de Tournay, séparés par un espace beaucoup moindre, ignoraient réciproquement l'existence des villes qu'ils habitaient, et ayant eu besoin de se mettre en communication, ils furent long-temps à la recherche les tins des autres, et ne parvinrent que par hasard à se trouver. On était encore plus ignorant sur la situation des lieux éloignés. Il existe une carte du moyen âge où Jérusalem se trouve au beau milieu de la terre, et Alexandrie aussi près de la ville sainte que Nazareth [67] .
On sent qu'à des époques où le monde était si [II-159] mal connu, les moyens de le parcourir ne devaient pas être bien perfectionnés. Pendant le cours du moyen âge, on ne voyage guère que par caravanes, et la plupart des transports ne s'exécutent qu'à dos d'homme et à dos de mulet. Tandis que par terre il ne se fait que du colportage, il ne se fait que du cabotage par mer. La grande navigation, les grandes découvertes géographiques ne commencent que vers la fin du quinzième siècle. La multiplication et le perfectionnement des routes, l'ouverture des canaux, sont des choses plus récentes encore. Le premier canal un peu important qu'on ait exécuté en Europe, le canal de Briare, n'a été commencé qu'en 1605; celui de Languedoc que soixante-deux ans plus tard. Des mille lieues de canaux que possède l'Angleterre, il n'en existait pas un pouce avant 1755. Quoique le progrès de certains véhicules ait devancé l'exploration de certaines voies, quoique le perfectionnement des vaisseaux ait précédé et préparé celui de la navigation, ce n'est pourtant que vers le milieu du quatorzième siècle que les constructions nautiques commencent à devenir meilleures. Le perfectionnement des voitures est d'une date encore plus rapprochée de nous. Les premiers carrosses sont du commencement du quinzième siècle ; les premières messageries, les premiers coches par terre et par eau, de la fin du seizième. La navigation par [II-160] la vapeur n'est que d'aujourd'hui ou d'hier ; elle ne fait que de naître [68] .
Peu à peu cependant la terre et la mer ont été parcourues, explorées, reconnues; on a mieux su la position respective des diverses contrées et de leurs villes principales; on a appris à se mieux diriger d'un point à un autre ; on s'est appliqué à multiplier et à perfectionner les voies destinées à mettre tous les points un peu importans en communication ; on s'est également évertué à chercher les instrumens les plus propres à parcourir ces voies, à faire parvenir un objet d'un point à un autre ; et dans le cours des trois ou quatre derniers siècles, l'art des transports a suivi le mouvement de tous les autres et s'est perfectionné comme eux.
J'observe seulement que, dans cet art comme dans tous, les premiers et les principaux progrès se sont faits d'une manière empirique ; c'est-à-dire qu'on a avancé en tâtonnant, en expérimentant, en se conduisant, non par des vues générales, mais par des observations particulières propres à chaque cas, non par les principes arrêtés de la science, mais par ces raisons mal démêlées, par ces inspirations de l'instinct qui sont les guides habituels de l'homme encore inculte. C'est ainsi que, longtemps, pour se diriger, on a vaguement consulté [II-161] le vent, le soleil, les étoiles, plus qu'on n'a mesuré géométriquement la grandeur de l'angle que faisait avec le méridien la ligne parcourue. C'est ainsi que, pour construire des routes, des chariots, des navires, on a moins pris conseil de la physique et des mathématiques que des indications que fournissait l'expérience en présence des difficultés qu'on avait à surmonter. On a cherché empiriquement quelle était la forme la plus propre à rendre une route solide et viable, quelle était la coupe qui rendait un navire plus stable et meilleur marcheur, comment une voiture voulait être placée sur ses roues pour se mouvoir avec aisance, de quelle manière les roues elles-mêmes devaient être formées, etc.; et j'ajoute qu'on a exercé l'art comme on l'avait trouvé, c'est-à-dire qu'on s'est dirigé sur terre et sur mer, qu'on a construit les voies et les voitures, et qu'on s'en est servi d'une manière purement empirique.
Je vais plus loin, et je dis que c'est encore ainsi qu'il serait raisonnable de commencer; c'est-à-dire que, pour devenir bon marin, par exemple, il vaudrait beaucoup mieux aller tout de suite à bord d'un navire, voir faire la manœuvre , y prendre part, et se mettre à naviguer sous la direction d'un pilote habile, que de commencer par aller faire ce qu'on appelle un cours de navigation à l'école de marine d’Angoulême, et apprendre là, [II-162] in genere demonstrativo, comment on manœuvre un navire et comment on se dirige sur mer, sauf à s'instruire plus tard de l'art auquel on devra faire l'application de sa science. C'est encore ainsi que, pour diriger la construction d'une route, il vaudrait peut-être mieux avoir l'expérience réunie d'un pionnier et d'un postillon que de sortir tout frais émoulu de l'école Polytechnique et de celle des Ponts-etChaussées.
« Les méthodes analytiques, observe un écrivain judicieux, sont applicables au roulage comme à toute autre opération mécanique ; mais cet art se complique de tant de données minutieuses impossibles à soumettre au calcul, que l'analyse séparée de la pratique ne donnera jamais 235.que des lumières trompeuses. Le rôle de l'analyse doit être de coordonner et d'expliquer des expériences directes, répétées à diverses reprises par des personnes et sur des localités différentes, telles que l'artillerie en fait dans ses écoles avant d'adopter les améliorations les plus sûres en apparence : il faut mettre l'ingénieur et le savant en contact avec le simple roulier, avec le postillon ; et si l'on prend jamais ce parti, on sera surpris de trouver dans cette classe d'hommes grossiers les remarques les plus sensées et souvent les plus délicates sur ce qui fait l'objet perpétuel de ses observations, et l'on pourrait même dire de ses sensations, en tenant compte de l'espèce de rapport magnétique [II-163] qui existe entre le cheval et l'homme habitué à le conduire [69] . »
Ainsi, pour la construction et la direction des vaisseaux, pour la construction des canaux et des routes, pour celle des voitures et des bateaux, la connaissance pratique du métier est, il n'en faut pas douter, la première chose nécessaire.
Toutefois on ne saurait douter non plus que la pratique ne puisse recevoir ici les plus puissans secours de la théorie. D'une part, les sciences peuvent répandre sur la construction des voies et des machines propres au transport, autant de lumières que sur aucune autre sorte de constructions; et d'un autre côté, elles ont réduit l'art de se diriger, hors de toute voie tracée, à des principes simples et in, faillibles : les sciences ont permis de déterminer avec une précision mathématique la forme de la planète que nous habitons, et la position respective de tous les points connus de sa surface ; par elles on a pu lier les lieux les plus éloignés par les routes les plus directes; par elles le navigateur, au milieu des mers, peut toujours dire le chemin qu'il suit, le point de l'Océan où il se trouve, et aller toucher, sans se méprendre, un but qu'il ne connaît pas et dont il est séparé par plusieurs [II-164] milliers de lieues; grace à leur secours enfin, il n'est plus un lieu dont on ne puisse déterminer la position véritable, et l'Océan, qui était comme une barrière impénétrable entre les divers continens, est maintenant le lien qui les unit tous.
S'il y a des connaissances scientifiques, et il y en a beaucoup, qui peuvent seconder l'action du voiturage, il va sans dire que les talens d'application et d'exécution doivent trouver ici matière à s'exercer, A quoi serviraient, en effet, ces connaissances sans le talent de les appliquer, et comment seraient possibles les applications sans l'art de la mise en œuvre ? Je dois seulement observer qu'ici comme partout, le vrai moyen de rendre les applications faciles et nombreuses, ce serait de rattacher le plus possible à la pratique l'étude de la théorie; de donner la science au praticien, plutôt que de former des savans pour la pratique ; et, par exemple, de rapprocher l'instruction scientifique des marins, des constructeurs de vaisseaux, plutôt que de destiner des savans à la marine ou aux constructions nautiques. Il n'y a nulle comparaison entre le parti que peuvent tirer de la science les gens qui ont commencé par se rompre aux procédés de l'art et celui qu'en peuvent tirer les hommes qui n'ont pensé à l'art qu'après avoir terminé leur éducation scientifique.
Ainsi, toutes les facultés relatives à l'exécution, [II-165] comme toutes celles qui se rapportent à la conception el à la conduite des entreprises, sont ici d'incontestables moyens de force et de liberté.
§ 7. Il faut dire des bonnes habitudes morales ce que je dis du talent des affaires et des moyens qui tiennent à l'art. De même que les agens du commerce étendent leurs pouvoirs en perfectionnant leurs facultés spéculatives et industrielles, de même ils accroissent leur liberté en perfectionnant leurs habitudes personnelles et leur morale de relation.
Non-seulement les vertus du commerçant sont une partie de ses moyens, mais elles en sont la partie essentielle. Comment, en effet, pourrait-il acquérir les autres sans ceux-là, et à quoi lui serviraientils ? A quoi, par exemple, lui servirait le savoirfaire sans la volonté de faire, sans l'activité ? A quoi lui serviraient l'intelligence et l'activité sans la prudence?
La prudence, dont il est si nécessaire d'user dans la pratique de toutes les industries, est peut-être dans le commerce plus indispensable encore que dans aucune autre. Il est, en effet, plus facile dans celle-ci que dans aucune autre, de s'engager dans de mauvaises spéculations. L'entreprise d'une nouvelle culture, d'une nouvelle fabrication exige ordinairement la réunion préalable de nouveaux [II-166] moyens; il y a toujours à faire quelque opération préparatoire, pendant laquelle la réflexion a le temps d'agir; tandis qu'une spéculation commerciale peut être consommée par un simple acte, par un achat ou même par un ordre d'acheter, et que, l'ordre expédié, l'achat fait, il n'est plus temps de s'aviser et de prendre une résolution meilleure. Il paraît donc plus nécessaire encore dans le commerce que dans les autres industries de se défier d'une première idée, de se tenir en garde contre les séductions de l'esprit d'entreprise, et j'ai, il me semble, raison de dire qu'elle est, de toutes, celle qui requiert le plus de prudence et de sang-froid.
Peut-être aussi est-elle celle qui requiert le plus de soin et de propreté; du moins est-elle celle chez qui ces bonnes habitudes semblent avoir à s'exercer sur un champ plus vaste. La propreté du fabricant peut, à la rigueur, se renfermer dans l'intérieur de son atelier, tandis qu'il ne suffit pas au commerçant de bien tenir ses magasins et ses boutiques; il lui importerait d'étendre ses soins à la voie publique qui fait aussi partie de son atelier, et qui en est la partie la plus essentielle. Les autres industries sans doute ne peuvent pas être indifférentes à la bonne tenue des rues, des routes, des canaux; mais il est sensible qu'aucune n'est plus intéressée que le commerce à voir les voies commerciales en bon état. C'est surtout aux marchands [II-167] et commerçans que la propreté et la bonne tenue de la voie publique se recommandent comme un grand moyen de liberté.
Ce que les soins et la propreté peuvent, comme nous le verrons, pour la puissance de l'agriculture et de la fabrication, ils le peuvent pour celle du commerce. Dans cet art, comme dans les autres, l'effet de ces habitudes morales est de prévenir, par de petites précautions, des pertes et des dépenses considérables, de tenir les hommes dispos, de conserver aux choses le pouvoir de rendre, à chaque instant, tout le service pour lequel elles ont été faites. C'est à leur esprit soigneux, à leur amour de la propreté, presque autant qu'à leur industrie et à leur richesse, que les Anglais doivent le bel état de leurs chemins, de leurs chevaux, de leurs voitures, de tous leurs moyens de communication et de transport, et par suite les grands pouvoirs de leur industrie commerciale. Ils n'attendent pas, pour réparer une route, qu'elle ait eu le temps de se dégrader sensiblement ; ils ont soin de fermer les ornières à mesure qu'elles se forment; ils font disparaître de la surface jusqu'aux moindres inégalités. C'est par esprit de propreté, plus que par crainte des amendes, qu'ils s'abstiennent, dans leurs cités, de salir la voie publique. Eussent-ils, comme nous, une police qui leur permît de déposer dans les rues des ordures de toute espèce, il [II-168] est douteux qu'ils voulussent user de cette faculté. Ils ne donnent pas moins de soins à l'entretien de leurs moyens de transport qu'à celui de leurs voies commerciales. Les navires, les bateaux, les chevaux, les harnais, les voitures, soit particulières, soit publiques, sont de la propreté la plus recherchée. Ce goût se manifeste jusque dans les chariots qu'ils emploient au transport des engrais, dans les exploitations rurales : ces chariots, soigneusement peints, ont, comme les voitures, dit un de nos ingénieurs, des essieux en fer, des boîtes en cuivre parfaitement tournées, et dans ces boîtes un réservoir pour l'huile qui en adoucit le frottement [70] .
Autant la bonne habitude morale que nous désignons par le nom de propreté peut influer utilement sur la liberté du commerce, autant cette industrie trouve de moyens de développement et de puissance dans le goût de la simplicité. Il est aisé d'apercevoir que le commerce ouvre un champ plus vaste à son activité en se tournant vers le transport des choses d'un usage général qu'en se restreignant à celui des choses chères. Un commerçant qui apporte des choses utiles à tout le monde, et à la portée de toutes les fortunes, est sûr de trouver plus d'acheteurs et de faire plus [II-169] d'affaires que celui qui ne fait venir que des choses peu nécessaires et d'un prix très-élevé. Il se fait un plus grand commerce de calicots que de cachemires; il arrive du Brésil moins de valeurs en pierres précieuses qu'il n'en arrive en coton et en peaux de bœufs. Les Espagnols, lorsqu'ils commencèrent à tirer de l'or et de l'argent d'Amérique, n'ouvrirent pas au commerce une branche d'affaires à beaucoup près aussi importante, que le firent plus tard les Hollandais lorsqu'ils s'avisèrent seulement d'apporter de la Chine la petite feuille sèche à laquelle nous donnons le nom de thé. Le commerce en effet transporte en Europe pour plus de 300 millions de thé par an [71] , tandis que, suivant l'auteur de la Richesse des nations, la quantité de métaux précieux que l'Europe importe annuellement d'Amérique ne se monte pas à plus de 6 millions sterling, ou environ 150 millions de notre monnaie [72] . On peut juger, par ce seul fait combien le goût de la simplicité, en tournant le commerce vers la recherche et le transport des choses d'un usage commun lui ouvre une plus vaste carrière que ne le fait le goût du faste en donnant une autre direction à son activité.
Une autre qualité morale bien essentielle au [II-170] commerçant, c'est l'estime de son art, c'est le sentiment éclairé de son utilité, c'est la juste appréciation du bien qu'il opère. Le commerce est peut-être de toutes les professions celle qui a le plus souffert des préjugés contraires à l'industrie. Il s'attachait, si je ne me trompe, dans les anciennes idées, moins de défaveur à l'exercice de l'agriculture, et même de la fabrication, qu'à celui du commerce. On pouvait à la rigueur, sans déroger, cultiver son champ, faire aller son moulin et en vendre les produits, mais non porter des marchandises d'un lieu à un autre, mais non commercer. Les familles engagées dans une industrie si fâcheuse en sortaient le plus tôt qu'elles pouvaient. Les nobles qui avaient fait le commerce se faisaient relever de l'état de dégradation où ils croyaient être tombés.
Si l'on voulait juger, par quelques faits isolés, de nos mœurs actuelles, on pourrait croire que ces sottises ne sont pas encore entièrement usées. On se souvient d'avoir vu, il y a quelques années, un habitant de Saint-Chaumont s'imaginer qu'il avait perdu la noblesse parce que son père et son aïeul avaient exercé avec honneur une profession utile, la profession de commerçans; et le ministère, reconnaissant qu'en effet la chose lui pouvait êtreimputée à dérogeance, lui accorder, sur sa demande, des lettres de réhabilitation, des lettres de relief, [II-171] pour me servir du jargon barbare en usage à la commission du sceau. Heureusement cette insulte au bon sens et à la morale du pays reçut, dans le même temps, une réparation éclatante. Tandis qu'on relevait un noble qui avait failli parce qu'il avait fait le commerce, on tentait d'agréger à la noblesse un industrieux distingué, qui avait toujours été commerçant : on envoyait le titre de baron à M. Ternaux. C'était presque l'avertir qu'il devait abdiquer sa profession, sous peine de dérogeance. L'honorable négociant pensa que la vraie dérogeance serait de se laisser faire baron : il conserva au travail sa dignité, et n'accepta point un titre qui, dans la pensée de ceux qui délivraient des lettres de relief, semblait impliquer le mépris des arts utiles. Ce trait de M. Ternaux me paraît digne d'être rappelé: c'est, à mon avis, une des belles et bonnes actions qui aient été faites depuis quinze ans, et des plus caractéristiques. En mettant la considération que donne le travail au-dessus de celle que donnent les titres, M. Ternaux a exprimé la pensée dominante de son temps. Peu de personnes aujourd'hui s'aviseraient de demander si un Montmorency peut faire le commerce ; ou bien, comme Chamfort, presque tout le monde répondrait : Pourquoi pas ? si ce Montmorency a les qualités requises, s'il possède les facultés intellectuelles et morales qui sont nécessaires pour [II-172] exercer cette profession comme elle aime à être exercée. On aurait beau multiplier les lettres de noblesse et celles de relief, on ne parviendrait qu'avec peine à nous fausser le sens sur les sources de la considération et les vrais titres à l'estime. Il y a bien toujours par-ci par-là quelques roturiers qui dérogent, mais il y a peut-être plus encore de gens titrés qui s'ennoblissent : pour un industrieux qui se fait baron, vingt barons se font hommes d'industrie; on pourrait citer une multitude d'anciens grands seigneurs qui sont intéressés dans des entreprises de fabrique ou de commerce. La vraie honte aujourd'hui, c'est de n'être bon à rien; mais personne ne rougit de faire quelque chose d'utile. Tout le monde, au contraire, honore le travail, et cette estime dans laquelle chacun tient toute profession naturellement bonne et estimable est sûrement l'une des vertus privées les plus favorables à l'industrie commerciale comme à toute espèce d'industrie.
Ces remarques sur la force que le commerce puise dans de bonnes habitudes privées de ses agens seraient susceptibles d'être fort étendues. Il serait aisé de faire voir ce que peuvent pour lui le courage, la modération, l'économie, et plusieurs autres vertus dont je ne détaille point ici les effets. Mais il s'agit moins de savoir comment chacune de ces vertus contribue à l'extension de ses pouvoirs [II-173] que de montrer qu'elles sont toutes des élémens essentiels de sa puissance; et le peu que j'ai dit fera, j'espère, suffisamment comprendre cette vérité. Voyons l'influence qu'exercent sur la liberté les bonnes habitudes sociales.
§ 8. Plus la morale de relation est perfectionnée, plus on est ennemi de l'injustice, et disposé tout à la fois à s'en abstenir et à la repousser, et plus le commerce doit être libre. Cela est évident de soi.
Ainsi, par exemple, le commerce est d'autant plus libre qu'on sait mieux se défendre de toute injuste prétention sur les voies commerciales, qu'on se garde davantage de les dégrader, qu'on empiète moins sur elles, que chacun s'y tient mieux à sa place, etc.
Il est d'usage à Paris de faire en quelque sorte de la voie publique sa voirie particulière : on y jette des animaux morts; on y répand des eaux corrompues; on y dépose les balayures de son appartement et les débris de sa cuisine; on y secoue la poussière de ses tapis ; on y dirige sur les passans les gouttières de ses toits; on en fait comme le réceptacle de tout ce qu'on a chez soi d'incommode ou d'immonde : est-il besoin de dire que ce peu de respect des habitans pour les rues de leur ville, nuit à la liberté de les parcourir ; que plus [II-174] chacun les dégrade et les salit et moins elles sont praticables pour tout le monde ?
Si l'on craint peu de les salir, on craint encore moins de les usurper. Chacun envahit, pour des usages particuliers, l’étroit espace qu'elles livrent à la circulation générale : l'épicier y fait griller son café ; le marchand de vin y dépose ses tonneaux; le roulier y remise ses voitures ; l'un y fait scier son bois; l'autre y emballe ses marchandises; des colporteurs sans nombre y établissent leur marché; la plupart des marchands en boutique luttent à qui y fera le plus avancer ses étalages; le passage, l'air, la lumière, y sont également interceptés : je ne crois point que j'exagère en disant qu’un dixième de la voie publique est habituellement enlevé à la circulation par toutes ces usurpations particulières : la circulation y est donc d'un dixième moins libre qu'elle ne le serait sans ces empiétemens [73] .
Elle y est peut-être encore plus embarrassée par le peu d'équité avec lequel on s'y partage la place. Chacun prétend avoir à sa disposition toute la [II-175] largeur de la rue : les cavaliers et les voitures veulent aller sur les côtés comme au milieu ; les gens à pied, au milieu comme sur les côtés. Tout le monde y court donc pêle-mêle; et cette confusion, qui ne laisse pas de gêner beaucoup la circulation des voitures et des cavaliers, rend la marche des piétons excessivement pénible et même dangereuse. D'après des relevés faits dans les recherches statistiques publiées par M. le préfet de la Seine, on peut porter à quinze personnes, terme moyen, le nombre d'individus annuellement écrasés par des voitures dans les rues de Paris. Deux règles bien simples pourraient mettre un peu d'ordre dans la confusion qui y règne : la première serait qu'il se fît un partage de la rue entre les gens à pied et les gens à équipage ; que ceux-ci passassent au milieu
à et les piétons sur les côtés ; la seconde, que toute personne prît sa droite à la rencontre d'une autre. C'est l'ordre qu'on observe en Angleterre, et il y contribue infiniment à la liberté de la circulation. Il est vrai que les rues anglaises s'y prêtent infiniment mieux que les nôtres; mais, moins nos rues sont convenablement disposées pour la marche, et plus l'ordre serait nécessaire pour y circuler sans trop d'embarras.
On voit combien la justice dans l'usage des voies commerciales peut contribuer à la liberté du commerce. Cependant ce ne serait pas assez de s'abstenir [II-176] de toute entreprise sur ces voies, si l'on ne savait se défendre en même temps du désir d'accaparer les moyens de transport, ou les marchandises à transporter, ou les pays à pourvoir de ces marchandises. A quoi servirait, en effet, que les routes fussent libres si quelques hommes voulaient s'emparer de tous les moyens de les parcourir; ou même qu'ils laissassent libre l'usage de ces moyens s'ils voulaient s'emparer de tous les transports à y faire ; ou enfin qu'ils permissent d'y exécuter des transports si, se partageant entre eux le monde, ils prétendaient s'arroger le droit exclusif d'en approvisionner chacun une partie.
La ferme générale des messageries avait seule avant M. Turgot, le pouvoir d'établir des coches de terre et d'eau sur la plupart des grandes routes et des rivières navigables: dès lors, à quoi eût servi pour pouvoir former de telles entreprises, que ces voies commerciales fussent belles, et que rien n'empêchât d'y aller et venir?
La même compagnie prétendait avoir le droit exclusif de transporter les voyageurs, ballots, marchandises, paquets, matières d'or et d'argent, etc. A côté d'une telle prétention, qu'eût importé, pour pouvoir effectuer ces transports, que les routes fussent libres, et que chacun y pût établir des voitures ?
D'autres associations ont joui seules, pendant [II-177] long-temps, de la faculté de commercer avec l'Inde, la Chine et d'autres pays éloignés : en présence d'un semblable privilège, à quoi eût servi, pour pouvoir commercer avec ces pays, que les mers fussent ouvertes à tout le monde, que chacun y pût lancer des, navires, et que sur ces navires on pût transporter toute sorte d'objets ?
Le commerce, pour être libre, demande done que l'on s'abstienne de toute injuste entreprise, non-seulement sur ses voies, mais sur toutes les parties de son domaine. Que des commerçans veuillent accaparer le marché, les marchandises, les voitures ou les voies, la liberté du commerce sera également détruite; elle le sera d'autant plus que le monopole sera concentré dans moins de mains, et qu'il s'étendra à plus de choses; et elle le sera non-seulement parce que les monopoleurs empêcheront matériellement tout le monde d'agir, mais encore parce qu'ils se seront ôté à eux-mêmes tout intérêt à bien faire, tout motif d'émulation, par conséquent tout ressort, et bientôt toute capacité.
On sait que les commerçans avec privilège ne sont pas plus habiles dans l'exercice de leur industrie que les fabricans privilégiés. L'ancienne ferme des messageries, qui ne permettait à personne d'établir des voitures, était elle-même si peu capable d'en établir de bonnes, qu'il fallait à ses coches dix jours pour faire le voyage de Lyon, qu'on fait [II-178] maintenant en moins de trois, et trois pour faire celui de Rouen, qu'on fait maintenant en douze heures [74] . La fameuse compagnie anglaise à qui appartient le commerce de l'Inde fait ce commerce avec si peu de succès, malgré son privilège, ou plutôt à cause de son privilège, qu'au dire de M. Say, qui puise à cet égard ses renseignemens dans les meilleurs économistes de l'Angleterre et dans les comptes mêmes de la compagnie, elle est annuellement en perte de plus de dix millions, et qu'elle est obligée d'emprunter pour payer le dividende de ses actionnaires [75] . Je pourrais citer vingt autres exemples de l'incapacité des commerçans privilégiés. Le monopole produit dans le commerce absolument les mêmes effets que dans les autres industries. Débarrassant de toute concurrence, [II-179] il dispense de tout effort ; il amortit l'activité de ceux qu'il favorise, en même temps qu'il fait violence à ceux qu'il dépouille'; et il détruit ainsi doublement la liberté.
Cependant il ne suffirait pas, pour que le commerce fût libre, que ses agens s'abstinssent, les uns à l'égard des autres, de tout esprit d'accaparement; il faut encore que les autres industries ne veuillent pas lui imposer des gênes. Or, il est beaucoup moins entravé par les injustes prétentions de ses propres agens, que par celles des autres industries.
Il est à remarquer que le commerce est infiniment plus libéral envers les autres arts qu'ils ne le sont envers lui. Par sa nature, le commerce est porté à souhaiter que toutes les industries prennent le plus grand développement possible, sentant fort bien que plus elles feront d'ouvrage et plus il aura de transports à effectuer; que plus elles multiplieront leurs produits, et plus il pourra multiplier ses voyages ; que plus elles varieront leurs productions, et plus il lui sera facile de mettre chaque chose en présence d'une autre contre laquelle elle trouve à s'échanger. Il doit donc désirer naturellement que rien ne limite leur essor, que leurs mouvemens ne soient gênés par aucune entrave.
Il s'en faut qu'elles manifestent les mêmes sentimens à son égard. Il n'est pas de producteurs, au [II-180] contraire, qui ne prétendent régler ses mouvemens au gré de leur avarice : n'importez pas de fer, lui disent les maîtres de forges; n'introduisez pas de blé, de laine, de bestiaux, lui crient les agriculteurs ; gardez-vous, lui disent à leur tour les gens de fabrique, de conduire sur notre marché les produits des manufactures étrangères; ne faites pas violence à notre paresse, à notre impéritie; nous sommes perdus si nous ne pouvons vendre nos produits à un prix de monopole, si vous allez nous imposer l'obligation de lutter d'adresse et d'activité contre l'industrie du dehors.
Ces réclamations contre le commerce, ces efforts que font, dans tous les pays, la plupart des producteurs pour l'empêcher d'importer ceci ou d'exporter cela, nous forcent d'examiner brièvement si la liberté de cette industrie est naturellement incompatible avec celle des autres; si les autres industries ne peuvent convenablement se développer, dans l'intérieur de chaque pays, qu'en comprimant les mouvemens de l'industrie commerciale, et en lui interdisant un certain nombre d'importations ou d'exportations. Voici, ce me semble; ce qu'on pourrait alléguer de plus plausible pour résoudre cette question d'une manière affirmative.
Il est fâcheux pour un peuple, dirait-on, d'avoir ses fabriques ou ses greniers loin de lui, de [II-181] tirer du dehors les produits qu'il consomme : cela. l'oblige à des frais de transport qui seraient épargnés s'il faisait ces produits lui-même; en cas de guerre, cela l'expose à se voir privé tout à coup d'objets indispensables, et qu'il ne parviendra qu'avec peine à remplacer. Il est donc désirable qu'on produise dans chaque pays tout ce que naturellement il est possible d'y produire, que toute industrie qui a la chance d'y prospérer s'y établisse. Or, dans bien des cas, cela ne serait pas possible sans le secours des prohibitions. Les lois qui président au développement de l'espèce n'ont pas permis que les arts naquissent partout en même temps : l'industrie manufacturière était née en Flandre et en Italie avant de se développer en Angleterre ; elle est née en Angleterre plus tôt qu'en France. Nos casimirs coûtaient encore 25 fr. à l'époque où les Anglais donnaient les leurs pour 12; nos percales et nos calicots nous revenaient, mal fabriqués, à 7 ou 8 fr. l’aune, quand les Anglais donnaient les leurs pour 3 fr. Si, dans cet état de choses, nous eussions laissé librement entrer les casimirs et les calicots anglais, la fabrication de ces produits n'aurait jamais pu se soutenir en France, où cependant elle a les plus grands moyens de réussir. Pour qu'une industrie nouvelle se puisse établir dans un pays, il faut donc d'abord la protéger [II-182] par des douanes contre la concurrence des pays plus avancés.
Cette argumentation en faveur des prohibitions aurait un défaut grave: ce serait de prouver beaucoup trop. S'il était vrai que toute industrie nouvelle dût être protégée contre la concurrence des pays plus avancés, il ne suffirait pas de la garantir contre la concurrence du dehors, il faudrait la défendre aussi contre celle du dedans; car, au dedans comme dehors, il peut y avoir des pays plus avancés que ceux où s'établit actuellement une industrie nouvelle. Il faudrait poser des barrières, non-seulement entre les royaumes, mais entre les provinces; non-seulement entre les provinces, mais entre les villes. Il faudrait, par exemple, protéger telle de nos villes où commencerait à s'établir la fabrication du coton, non-seulement contre la concurrence des fabricans anglais, mais contre celle des fabricans de Rouen ou de Mulhouse, qui pourrait aussi l'écraser. Nul cependant, dans l'intérieur, ne prétendra que les villes en retard ont besoin d'être défendues contre les villes avancées; nul ne niera que la fabrication des soieries ne puisse s'établir ailleurs qu'à Lyon sans l'appui du monopole. Pourquoi donc une industrie déjà établie à l'étranger ne pourrait-elle se naturaliser en France sans le secours des prohibitions? Qu'est-ce qui [II-183] empêcherait des filateurs de Manchester de porter leur industrie à Paris, comme des fabricans de Lyon d'aller s'établir à Londres?
Tant qu'il en coûte moins pour porter une chose dans un pays que pour l'y fabriquer, il est bon qu'on l'y transporte ; sitôt que la fabrication l’y peut produire à meilleur marché que le commerce, elle n'a pas besoin pour s'y faire du secours des prohibitions.
Les prohibitions ont ces deux effets également désastreux, qu'elles font naître dans un pays des industries qui ne sauraient s'y soutenir d'elles-mêmes, et qu'elles y retardent le développement de celles qui pourraient le mieux s'y établir.
Il est telles industries qui auraient en France toute sorte d'élémens de succès, et qui s'y trouvent fort retardées, précisément à cause de ce qu'on a fait pour elles. J'ai cité des exemples ailleurs [76] . On a voulu affranchir nos fabricans de toute concurrence redoutable; ils n'ont eu à lutter qu'entre eux; ils ont trouvé un débit suffisant sans se donner trop de peine, et en conséquence leur art est demeuré imparfait. On a eu beau, depuis trente ans, les exciter, les encourager, leur donner des primes, leur distribuer des prix, tout cela n'a rien fait: en les délivrant de la concurrence étrangère, [II-184] on leur a ôté le seul stimulant capable de les tirer de leur apathie. Ce n'est que par le procédé contraire qu'on aurait pu donner un peu d'essor à beaucoup de fabrications, qui sont infiniment moins avancées qu'elles ne devraient l'être.
Je suis persuadé, par exemple, que s'il est un moyen d'apprendre à nos fileurs de coton à filer fin, comme à nos potiers à faire de la bonne faïence, ce serait de les menacer de la concurrence des Anglais.
Je ne dis pas qu'il fallût lever brusquement les prohibitions; mais je dis que le plus grand service qu'on pût rendre à l'industrie, la meilleure chose qu'on pût imaginer pour l'activer, ce serait d'annoncer qu'au bout d'un certain temps, on retirera tel appui à la paresse, tel privilège à la médiocrité, et qu'il faudra, sous peine de mort, être en état de soutenir le régime de la concurrence.
On a assez d'exemples de ce que peut, pour stimuler l'activité, la crainte d'un rival dangereux. En 1823, les fabricans de Lyon niaient la possibilité de fabriquer à meilleur compte qu'ils ne font. Vers cette époque, des ouvriers expatriés les avertirent de ce qui se passait en Angleterre, et du développement considérable qu'y avait pris la fabrication des soieries. L'éveil fut donné dans la ville, et les mêmes fabricans, qui avaient nié jusqu'alors la possibilité des économies, reconnurent [II-185] bientôt qu'on pourrait faire, seulement sur les frais de tissage, une épargne de 50 ou 60 pour 100.
C'est par la crainte de la concurrence que le gouvernement britannique, sous le ministère de M. de Canning, cherchait à aiguillonner l'indus-, trie de ses sujets, et à la rendre plus habile et plus active. Au lieu d'établir de nouvelles prohibitions, il commençait à lever les anciennes; et c'étaient précisément les industries les plus faibles qu'il soumettait les premières au régime fortifiant de la liberté; c'était aux fabricans de soieries, les moins avancés de tous, les moins capables de lutter contre nous, qu'il retirait d'abord le funeste appui du monopole.
Encore une fois, s'il y a quelque moyen d'animer, de fortifier dans un pays les industries qui y languissent et qui pourraient y prospérer [77] , c'est de les mettre dans la nécessité de se préparer au régime de la concurrence, c'est de permettre graduellement au commerce de faire concourir avec leurs produits les produits des pays étrangers. Bien loin donc que la liberté du commerce soit contraire à celle des autres industries, on peut dire qu'elle leur est indispensable, qu'elle est leur stimulant le plus actif, et qu'elles ne deviennent tout [II-186] ce qu'elles peuvent être que lorsque le commerce peut les forcer continuellement à lutter de puissance contre leurs rivales du dedans et du dehors.
Au surplus, quoi qu'il en soit de l'influence que la liberté de l'industrie commerciale exercerait sur celle des autres industries, il n'en reste pas moins vrai, comme je l'ai dit avant de me livrer à cette digression, que la liberté du commerce est incompatible avec la prétention des autres industries de lui faire la loi, et que, pour être libre, il demande tout à la fois que ses propres agens renoncent à l'accaparer, et ceux des autres industries à le restreindre.
J'ajoute, en terminant ce paragraphe, qu'il ne suffit pas qu'on s'abstienne de ces excès comme individu, et qu'il faut encore savoir s'en défendre comme public. Il est bien vrai qu'ils supposent tous de mauvaises dispositions individuelles; mais 277.ils ne sont pas tous commis par des individus. Ce n'est pas individuellement que les fabricans et les agriculteurs imposent des restrictions au commerce. Ce n'est pas individuellement que certains commercans accaparent le commerce de certains pays, ou celui de certaines marchandises, ou l'usage de certains moyens de transport, ou la navigation de certaines rivières.
Dans l'industrie commerciale, ainsi que dans les [II-187] autres, les excès que les hommes commettent isolément sont toujours peu de chose en comparaison de ceux auxquels il se livrent en commun. Pour quelques empiètemens furtifs que se permettent des commerçans isolés, des corps politiques se livreront ouvertement aux usurpations les plus vastes. Chaque peuple de l'Europe, par exemple, entreprendra de mettre la main sur quelque portion de l’Asie, de l'Afrique, de l'Amérique, et fera défense au reste du monde de commercer avec les régions qu'il aura envahies. A côté d'individus qui essaieront d'empiéter sur quelque chemin, quelque cours d'eau, on verra des corps de nation essayer d'usurper des mers entières. Les Ottomans, à cheval sur le Bosphore et les Dardanelles, ne voudront pas laisser le passage libre entre la mer Noire et la Méditerranée. Les Danois, placés sur le Sund, prétendront interdire toute communication entre l'Océan et la Baltique. Les Anglais, dans leurs chants populaires, s'appelleront insolemment les maîtres de la mer, et souvent ils se conduiront comme si, en effet, la nature avait fait de l'Océan la propriété particulière des Iles Britanniques.
Si telle est, des uns aux autres, la violence des corps politiques, on pense bien qu'ils ne se conduiront pas avec plus de justice envers les individus. La société, la personne publique, s'emparera, dans quelques pays, de la navigation des [II-188] rivières : elle ne permettra d'y naviguer en long qu'en lui payant tribut; elle se réservera le droit exclusif d'y naviguer en large, et d'établir des bacs pour les passages d'eau. Elle se réservera aussi le droit d'entretenir des relais sur les routes ; elle seule pourra porter des lettres, des journaux; elle voudra connaître tous les mouvemens des agens de commerce; elle leur défendra de circuler sans laissez-passer, de séjourner sans permis de résidence; ils ne pourront ouvrir des marchés, tenir des foires, se réunir dans une Bourse qu'avec son autorisation; elle ne leur permettra de conduire de certaines marchandises que sur de certains marchés; elle aura, pour certaines denrées, des entrepôts, où ils seront violemment contraints de les déposer en attendant qu'ils trouvent à s'en défaire; ce sera enfin de complicité avec elle et avec son appui que les agriculteurs et les manufacturiers imposeront toute sorte de gênes aux commerçans. Bref, les plus grandes violences faites à l'industrie commerciale lui seront faites politiquement, socialement.
Sans doute, la société tout entière ne prendra pas une part effective à ces excès; mais ils seront commis en son nom, par ses représentans vrais ou faux; et quoique plusieurs de ses membres les réprouvent, tant que la raison du grand nombre n'en sera pas assez choquée pour y mettre un terme, [II-189] tant que la majorité consentira à les tolérer, on pourra, avec raison, dire qu'ils sont selon son esprit ou selon ses moeurs, et les considérer comme son ouvrage. Il ne suffit donc pas, pour qu'ils cessent, que chacun s'en abstienne comme individu, il faut que, politiquement, on ne consente plus à les commettre, ou à souffrir qu'ils se commettent. Cette condition, qui est la plus difficile, est aussi la plus nécessaire, et ce que le commerce demande surtout, pour être libre, c'est que la société s'abstienne d'entraver ses mouvemens; c'est qu'à son égard elle s'interdise et qu'elle interdise aux pouvoirs chargés d'agir pour elle tous les excès qu'elle réprimerait dans des individus.
Ainsi la liberté de l'industrie commerciale tient aux progrès de la morale de relation comme aux progrès des habitudes individuelles, comme aux progrès des connaissances relatives à l’art, comme aux progrès du génie des affaires, et elle est d'autant plus grande que, dans leur application au commerce, toutes ces facultés ont acquis plus de développement. On va voir que la même industrie profite des pouvoirs que l'homme puise dans les choses, non moins que de ceux qu'il possède en lui-même.
§ 9. J'ai dit que tout art, pour agir, avait besoin d'un emplacement, d'un théâtre, d'un atelier, [II-190] et que son action était d'autant plus forte et plus libre que cet atelier était mieux approprié à son objet, qu'il était mieux situé, mieux construit, mieux disposé, mieux pourvu des instrumens nécessaires. Il n'est pas difficile de reconnaître que ceci s'applique au commerce comme à tout autre art.
Les ateliers du commerce, ce sont les mers, les golfes, les baies, les rades, les ports, les bassins, les rivières, les canaux, les ponts, les routes, les rues, les entrepôts, les magasins, les boutiques. Voilà, en effet, les lieux où il exécute sa fonction, celle qui le caractérise, l'action de déplacer, de transporter, de rapprocher les choses de quiconque en a besoin. Est-il nécessaire de dire que la liberté de ses mouvemens dépend au plus haut degré de ces choses et de ce qu'on a fait pour les approprier à son action?
Il serait aussi impossible de faire le commerce sans chemins, que d'exercer un métier sans établi. Il est au contraire d'autant plus facile de commercer, qu'il y a plus de voies ouvertes au commerce. Plus il existe dans un pays de routes, de canaux, de rivières navigables, et plus il y a dans ce pays de liberté commerciale. Plus, entre ce pays et les autres, on a créé de moyens de communication, plus on a jeté de ponts sur les fleuves, pratiqué de routes à travers les montagnes, parcouru, exploré, [II-191] reconnu les mers qui les séparent; plus, en un mot, il existe, dans chaque pays et entre tous les pays, de chemins ouverts et frayés, et plus il y a partout de liberté commerciale.
On a calculé que l'Angleterre, sur un territoire dont l'étendue n'est guère que le tiers de celle de la France, possédait quarante-six mille lieues de routes ordinaires, cinq cents lieues de routes en fer, près de mille lieues de canaux ; et, comparant ce développement de voies commerciales à celui des voies de même nature que la France possède sur une étendue de terrain trois fois aussi considérable, on a calculé que ce dernier pays avait, toute proportion gardée, trois cents fois moins de routes en fer, vingt fois moins de canaux, onze fois moins de routes ordinaires [78] . En supposant ces estimations exactes, la France, sous le rapport de l'étendue des voies commerciales, n'aurait donc, d'un côté, que la onzième, d'un autre côté, que la vingtième, et d'un autre côté, que la trois-centième partie de la liberté commerciale de l'Angleterre.
Mais la liberté du commerce n'est pas seulement en raison de l'étendue de l'atelier, elle est aussi en raison de sa nature. On conçoit, en effet, que, pour opérer des transports, il n'est pas indifférent [II-192] d'avoir à sa disposition une route ou un canal, la mer ou la terre.
Le commerce est plus puissant, par exemple, sur un chemin à ornières de fer que sur un chemin ordinaire : il y peut traîner de plus lourds fardeaux avec une moindre force; il y peut confier plus aisément la direction de ses véhicules à des moteurs inanimés, etc.
Le commerce est aussi plus puissant sur un canal que sur la plupart des rivières. Les rivières, que Pascal appelle des chemins qui avancent et qui portent où l'on veut aller [79] , peuvent tout aussi-bien être appelées des chemins qui reculent et qui éloignent du point qu'on veut atteindre: cela dépend de la direction dans laquelle on veut aller. Si elles poussent au but quand on se dirige vers leur embouchure, elles en écartent quand on veut naviguer contre le courant. D'ailleurs, alors même qu'on s'abandonne à leur pente, elles ne conduisent pas directement au but; elles font de longs détours dans lesquels on est obligé de les suivre ; il faut aller vite ou lentement, selon qu'elles dorment ou se précipitent; et ces chemins, qui marchent, ne marchent que comme il leur plaît, et rarement comme il plairait à ceux qu'ils portent. Enfin, leur utilité est sujette à de fréquentes [II-193] intermittences, et la circulation y est ordinairement très-difficile, et quelquefois même impossible pendant une portion de l'année.
On n'a pas les mêmes inconvéniens à reprocher aux canaux. Ces chemins ne sont pas de ceux qui marchent, mais de ceux sur lesquels on peut le mieux marcher. S'ils n'aident pas à aller dans un sens, ils n'empêchent pas d'aller dans le sens inverse. Ils sauvent en partie les détours des rivières, et abrègent sensiblement leur cours. Ils ne sont pas sujets à s'enfler outre mesure, ou à décroître au point de ne pouvoir servir. Ils offrent, en toute saison, une quantité d'eau suffisante, et une eau parfaitement tranquille, sur laquelle les bateaux glissent également bien dans les deux directions; enfin, ils ne vont pas seulement au fond des vallées comme les rivières : on peut les conduire sur des collines élevées, leur faire traverser des montagnes par des souterrains, des rivières et des vallons sur des arcades, et, par leur moyen, lier entre eux des fleuves qui n'avaient de communication que par la mer.
Enfin, le commerce a plus de puissance et de liberté sur la mer que sur aucune autre espèce de voie commerciale. La mer, considérée comme atelier de commerce, a bien sans doute ses inconvéniens; mais ces inconvéniens, tout graves qu'ils [II-194] sont, se trouvent rachetés par de tels avantages, qu'ils ne détruisent aucunement sa supériorité. La mer, comme les fleuves, présente à la fois un support et un moteur qui ne coûtent rien; mais elle a sur les eaux courantes cet avantage que le même vent y peut faire marcher les navires dans une multitude de directions différentes, tandis que le courant des fleuves n'entraîne les bateaux que dans une seule direction. D'ailleurs, elle porte des fardeaux si immenses, qu'alors même qu'on n'y peut naviguer qu'en louvoyant, aucune autre voie ne lui saurait être comparée.
Veut-on juger à quel point la liberté des transports dépend de la nature de l'atelier sur lequel on les opère ? Il n'y a qu'à considérer comment elle varie suivant la nature des chemins sur lesquels on veut les opérer. Sur un chemin de pied un homme ne peut faire porter à un cheval que trois ou quatre quintaux; sur une route à voitures, il peut lui en faire traîner de quinze à vingt; sur une route de fer, il lui en fera traîner près de deux cents ; sur un canal, plus de six cents ; sur une rivière, le même homme en transportera plusieurs milliers ; et sur mer plusieurs dizaines de milliers sans l'emploi d'aucun moteur qui lui soit propre. Enfin, le prix moyen des transports, par tonneau et par lieue, sera sur mer infiniment moindre [II-195] que sur canal, et sur canal infiniment moindre que sur une route ordinaire de terre [80] .
Il est donc certain que, si la liberté commerciale d'un pays dépend beaucoup de l'étendue de ses chemins, elle ne dépend pas moins de leur nature. L'Angleterre peut commercer plus librement que nous, non-seulement parce qu'elle a plus de voies, mais encore parce qu'elle en a plus de la bonne espèce, parce qu'elle a surtout plus de celles qui sont économiques. Observez, en effet, que tandis que l'étendue de ses routes ordinaires, comparée à celle des nôtres, n'est que dans la proportion de onze à un, celle de ses canaux est dans la proportion de vingt à un, et celle de ses chemins de fer dans la proportion de trois cents à un. Observez surtout que la mer, la plus puissante des voies, l'embrasse presque tout entière; que les nombreuses et profondes découpures de ses côtes, que le peu de pente de plusieurs de ses rivières, permettent aux eaux de la mer de pénétrer, en beaucoup d'endroits, fort avant dans le pays, et qu'elle en dispose en quelque façon jusque vers le milieu des terres.
[II-196]
A la vérité, de ce que de certaines voies sont naturellement plus puissantes que d'autres, il ne s'ensuit pas que ce soient là celles qu'il faut chercher à obtenir partout, et, par exemple, qu'il faut faire venir la mer à Paris, quoi qu'il en coûte. Les meilleures voies en général ne sont pas les meilleures dans telle circonstance donnée. Il est des lieux où le parti le plus économique est de se servir de la navigation fluviale, d'autres où il vaut mieux ouvrir des canaux, d'autres où des routes à ornières seraient préférables : cela dépend absolument des localités; il est impossible de rien décider à cet égard d'une manière générale. Mais de ce que les mêmes voies ne peuvent pas s'établir partout, il ne s'ensuit pas non plus que de certaines voies ne sont pas naturellement plus puissantes que d'autres, et il reste constant que la liberté du commercé dépend essentiellement de la nature des voies qu'on peut employer. Mais il faut envisager ce sujet sous une face nouvelle.
La liberté du commerce n'est pas seulement en raison de la nature des voies commerciales, elle est encore en raison de leur forme, en raison de ce qu'on a fait pour les approprier à son action.
L'Angleterre a modifié par de forts grands travaux les bords de la mer qui l'entoure : elle a éclairé par des phares nombreux, placés aux endroits les plus essentiels, les points de son littoral [II-197] les plus dangereux; sur une étendue de mille lieues de côtes, elle a creusé plus de cent ports de mer; dans les plus importans de ces ports, à Londres, à Hull, à Liverpool, à Bristol, elle a ouvert aux navires des bassins spacieux où ils sont mouillés dans une eau tranquille, où ils se trouvent à l'abri des déprédations et peuvent être chargés et déchargés avec facilité et économie, etc. La France est loin d'avoir fait subir à ses côtes d'aussi importantes modifications, elle ne les a pas éclairées d'autant de feux; elle n'a pas protégé par autant de môles et de jetées les abris qu'elles présentent; elle n'y a pas construit autant de ports ; elle n'a pas creusé dans ces ports autant de bassins, ni élevé sur les bords de ces bassins des hangars et des magasins aussi vastes et aussi commodes. N'est-il pas évident que cette différence dans les travaux que les deux pays ont exécutés sur leurs côtes maritimes en doit mettre une grande dans la liberté qu'ils ont de se servir de la mer?
Nos voisins se dirigent dans la construction de leurs canaux par d'autres principes que nous : ils les font étroits, nous les faisons larges ; ils les construisent avec simplicité, nous les construisons avec luxe ; ils en font de grands et de petits pour se proportionner partout aux besoins de la circulation, nous n'en avons encore fait que d'une seule sorte ; ils mettent les petits et les grands dans un [II-198] tel rapport que les mêmes bateaux peuvent, en s'accouplant ou en marchant isolés, être employés sans perte sur tous, nous les avons faits grands sans les faire uniformes, et les bateaux qui servent sur les uns ne peuvent que rarement être employés sur les autres... Est-il besoin de dire que le mode de construction adopté de l'autre côté du détroit est plus favorable que le nôtre à la liberté des transports ? Les Anglais emploient à prolonger leurs canaux, à les multiplier, ce que nous dépensons à les faire trop larges ; ce que nous donnons au faste, ils le font servir à vaincre les difficultés du sol; et c'est ainsi qu'ils ont pu lier par des voies hydrauliques des points entre lesquels un système aussi dispendieux que le nôtre ne leur eût pas permis d'en établir. Construisant leurs canaux avec plus d'économie, la navigation y peut être moins chère; les faisant plus étroits, ils y emploient des bateaux d'une moindre dimension; et comme de plus petits bateaux ont moins de peine à trouver leur charge, la circulation, par cela seul, y peut être plus active; enfin, le rapport existant entre les écluses des grands et des petits canaux, rapport qui permet d'aller sur tous avec les mêmes barques, est encore une circonstance favorable à l'économie et à la célérité.
Si nous comparons nos routes à celles de l'Angleterre, nous verrons encore mieux à quel point [II-199] la liberté de commerce dépend de la forme des voies commerciales.
Nos routes sont de grandes avenues, généralement droites, larges de quarante-cinq à soixante pieds, pavées ou ferrées au milieu, mais sur une ligne tellement étroite que deux voitures ont quelquefois peine à s'y croiser. Cette ligne, qui est la meilleure partie de la route, manque fréquemment de solidité et d'égalité : ferrée, elle est remplie d'ornières; pavée, elle est dure et cahotante; elle a d'ailleurs le défaut d'être trop élevée au-dessus des bas-côtés, et souvent les voitures ne peuvent, sous peine de verser, y monter ou en desendre qu'avec beaucoup de précaution. Les bas-côtés sont pires encore : ordinairement formés d'argile, et traversés par la pluie qui se rend du milieu de la route dans les fossés, ils ne présentent, suivant la saison, qu'un amas de poussière ou de boue. Presque toujours, la voie se termine, des deux côtés, par une rangée d'arbres, lesquels en général sont d'autant plus grands et plus touffus que le sol où ils sont plantés est plus gras et plus humide, et que la route aurait plus besoin d'être aérée. Dans les descentes et les montées, on a mal ménagé la pente, et rien n'est plus ordinaire que d'être obligé d'enrayer pour descendre et d'aller au pas en montant. Enfin, la route est livrée tout entière aux cavaliers et aux voitures ; et les piétons, [II-200] sur une largeur de soixante pieds, n'ont pas une petite place qui leur soit propre, et sont obligés, pour se garantir de la poussière ou de la boue, des chevaux et des voitures, d'aller, des deux côtés de la route, chercher un passage dans les champs.
Les routes anglaises sont moins droites que les nôtres, mais peut-être sont elles moins monotones. Elles sont aussi moins horizontales; mais les montées et les descentes y sont, dit-on, plus adoucies. Elles sont surtout moins larges; mais, avec une largeur beaucoup moindre, elles offrent, en réalité, une voie plus spacieuse à la circulation. Elles sont viables en effet dans toute leur largeur : au lieu d'être divisées longitudinalement en trois parties sur lesquelles toutes les classes de voyageurs sont confondues, et dont aucune n'est complètement praticable, elles ne sont partagées qu'en deux sections, un trottoir pour les gens de pied, et une chaussée pour les cavaliers et les voitures, qui sont l'un et l'autre pleinement appropriés à leur destination. Le trottoir est élevé au-dessus de la route et défendu par des poteaux; la route, dans toute sa longueur, est parfaitement unie et solide; les fondemens, la tranchée, le profil, sont disposés de manière à assurer le prompt écoulement des eaux ; d'ailleurs la voie tout entière, au lieu d'être plantée d'arbres, n'est ordinairement bordée que de haies basses et bien taillées, qui y laissent librement [II-201] circuler l'air et permettent au vent de les balayer ou de les sécher suivant la saison ; des poteaux plantés à chaque embranchement de route indiquent, en caractères lisibles, le lieu où conduit cet embranchement, et l'intervalle qui en sépare; des pierres milliaires indiquent l'espace parcouru et celui qui reste à parcourir; les piétons, sur le trottoir qui leur est réservé, trouvent des sièges de distance en distance... On s'est visible, ment appliqué à ne rien omettre de ce qui pouvait rendre la route plus complètement propre à son objet.
Il est indubitable que sur de telles voies, la circulation doit être plus facile que sur les nôtres. Quoique infiniment mieux construites, il est possible, comme elles absorbent beaucoup moins de terrain, qu'elles aient moins coûté à établir, et qu'on en paie moins cher la jouissance [81] , On y chemine avec moins de confusion, avec plus de . sûreté, avec moins de fatigue. Les voitures y vont partout au trot de chevaux; la poste y marche avec [II-202] une rapidité presque double de celle qu'elle peut déployer sur nos routes. A la vérité, cette vitesse plus grande est due en partie à la supériorité des chevaux et des voitures ; mais le bon état des chevaux vient en partie de celui des chemins, et la perfection des voitures se lie aussi à celle des routes, qui permet de les construire avec une légèreté et une délicatesse qu'il serait difficile de leur donner sur des voies moins fermes et moins unies.
Les rues de nos villes offrent de nouvelles preuves de la vérité que j'expose. Si nous avons des routes beaucoup trop larges, nous avons, par compensation, des rues infiniment trop étroites. Nos grandes lignes de poste, qui ont quelquefois vingt mètres au milieu des campagnes les plus désertes, aboutissent, dans nos villes les plus populeuses, à des rues qui n'ont pas vingt pieds; et, par un guignon, nos rues, qui ne manquent pas toujours de largeur à l'entrée des villes, se resserrent vers le centre où, tout afflue, et deviennent plus étroites à mesure qu'elles auraient plus besoin de s'élargir. C'est à croire qu'on y a mis de la malice, et qu'on a visé à faire les choses précisément à rebours du bon sens [82] .
[II-203]
Cette sorte d'inconséquence est, dit-on, moins sensible en Angleterre. Si les routes y sont peu larges, les rues y sont plus spacieuses, et se trouvent plus en rapport avec les besoins de la circulation. Ce n'est pas leur seul avantage; en même temps qu'elles sont plus larges, elles sont aussi mieux disposées : elles possèdent des trottoirs, qui manquent aux nôtres ; elles n'ont pas les portes-cochères, les goutières, les ruisseaux, les égoûts, que les nôtres ont. Or, ces différences contribuent toutes à y rendre la circulation plus libre. On ne voit pas à Londres, par exemple, de ces embarras inextricables que le peu de largeur de la voie publique rend si fréquens dans les rues de Paris ; on n'y voit pas toutes les classes de passans aller pêle-mêle au milieu de la rue, et se faire continuellement obstacle. La marche des gens qui longent à pied les maisons n'y est pas sans cesse interrompue par celle des chevaux et des voitures qui en sortent ou [II-204] qui y rentrent. Ces personnes n'y sont pas exposées à recevoir sur la tête toute la pluie qu'amassent les toits. Cette pluie n'y forme pas, au milieu des rues, des rivières qu'on ne peut franchir que sur des planches, et l'on n'y court pas le risque d'être entraîné par ces rivières dans des égoûts hideux, qui, de distance en distance, infectent et obstruent la voie publique. Les allans et venans de toute espèce y peuvent circuler avec infiniment plus de facilité, de rapidité et de sûreté qu'à Paris.
Je ne finirais pas si je voulais montrer avec détail à quel point la liberté du commerce dépend de la forme des voies commerciales. Souvent une seule modification heureuse suffit pour les rendre beaucoup plus propres à leur objet. La mer, dans les ports d'Angleterre, a été rendue plus disponible par cela seul qu'on y a donné aux murs des quais une forme concave qui permet aux navires d'en approcher de très-près. De simples balises, indiquant les bonnes passes, suffisent pour rendre beaucoup plus facile la navigation de certaines rivières. Une invention dont le seul effet serait d'accélérer le jeu des écluses, pourrait améliorer beaucoup la navigation des canaux. Nos routes, et surtout nos rues, seraient rendues plus viables par tout amendement qui tendrait seulement à y faire circuler avec moins de confusion, etc.
[II-205]
Mais la liberté du commerce ne dépend pas seulement de l'étendue, de la nature, de la forme, des voies commerciales : elle dépend aussi de la manière dont elles sont distribuées. Il ne suffit pas pour lui qu'elles existent, il faut qu'elles existent là où son intérêt les réclame, qu'elles soient dirigées au gré de ses besoins, que les meilleures et les plus multipliées se trouvent entre les lieux qui ont le plus de sujet de correspondre. A quoi lui serviraient des routes, pour si magnifiques qu'elles fussent, si elles ne liaient que des lieux sans intérêt pour lui, si elles n'établissaient de communications qu'entre les châteaux des grands seigneurs, entre les palais des rois et de leurs maîtresses. Leur utilité ne dépend pas tant du mérite de leurs for mes que de celui de leur emplacement.
La France, sous l'empire, avait trente routes commercialement plus importantes que celle du Simplon, quoique, sous le rapport de l'art, elle n'en eût pas d'aussi remarquable. Elle a plusieurs canaux plus fréquentés et plus productifs que celui de Languedoc, quoique celui-là soit indubitablement le plus beau qu'elle possède. Mais, pour que les voies commerciales se distribuent ainsi que le demande l'intérêt du commerce, il ne faut pas . que ce soit l'ambition, la vaine gloire ou l'intérêt particulier de quelques hommes puissans qui décident de leur direction. Il ne faut pas non plus [II-206] qu'elles soient ouvertes sur un calcul fait à priori de leur utilité, et avant d'être averti par les besoins du commerce des points entre lesquels il est essentiel qu'elles s'établissent. Comment, par exemple, ne seraient-elles pas mal distribuées dans un pays où, comme chez nous, on décrèterait, d'un seul coup, et avant de savoir quelle direction prendra l'activité commerciale, la confection de près de neuf cents lieues de canaux? N'est-il pas évident que, sur une telle étendue de voies, il devrait nécessairement s'en trouver de mal situées et de peu utiles [83] .
Quoique nos voisins n'aient pas mis une extrême sagesse dans l'établissement de leur système de canalisation, ce n'est pourtant pas tout-à-fait ainsi qu'ils [II-207] ont procédé : ils n'avaient pas décrété tous leurs canaux d'avance ; ils n'avaient pas prétendu faire la loi au commerce, et lui tracer d'en haut le chemin qu'il devrait tenir. Au lieu de lui prescrire sa marche, ils se sont souvent contentés de la suivre ; ils ont attendu plus ou moins ses indications; ils n'ont ouvert ses routes que les unes après les autres, à mesure que le besoin s'en est fait sentir, et c'est ainsi qu'ils sont parvenus à créer chez eux le meilleur ensemble de voies commerciales, et, à tout prendre, le mieux distribué qu'il y ait probablement en aucun pays du monde. Dans ce système, qui se compose de cinq sortes de voies, les routes ordinaires sont réservées aux communications rapides ; les canaux les remplacent, en très-grande partie, [II-208] pour le transport des objets lourds et encombrans; les chemins de fer font le même office là où il n'a pas été possible d'établir de canaux. Ces trois sortes de voies unissent toutes les mines et tous les établissemens d'agriculture à tous les centres de fabrication et à tous les chefs-lieux de commerce intérieur et maritime. La chaîne de montagnes qui partage l'Angleterre, dans la direction du nord au sud, se trouve franchie par vingt-une lignes de navigation artificielle, qui font communiquer la côte occidentale avec l'orientale, et par elle avec tout le continent d'Europe; la côte orientale avec l'occidentale, et par elle avec tout le continent d'Amérique. Les meilleures voies et les plus multipliées se trouvent groupées autour des villes industriellement les plus actives, autour de Manchester et de Birmingham, de Londres et de Bristol, de Hull et de Liverpool. La seule ville de Birmingham possède, dans un rayon de huit lieues, un développement de quatre-vingt-sept lieues de canaux, avec une quantité très-supérieure de routes, et plusieurs rivières. Enfin ces voies, aboutisşant de toutes parts à la mer, communiquent par cent cinq ports avec toutes les îles et tous les continens du globe. Peut-on douter que cette belle distribution des voies commerciales de l'Angleterre ne soit un de leurs principaux mérites, et que le commerce n'en profite autant que de leurs autres qualités?
[II-209]
On voit de combien de manières les voies du commerce contribuent à sa puissance. Elles y contribuent par leur étendue, leur variété, la bonté de leur distribution, la perfection de leurs formes. Je répète qu'il n'est pas d'industrie dont la liberté paraisse dépendre autant de l'état de ses ateliers. C'est peut-être là qu'est son principal élément de force, comme celui de la fabrication paraît être dans les machines. : Les machines n'ont pas à exécuter dans le commerce des fonctions aussi variées que dans les autres industries, notamment que dans les manufactures : leur rôle s'y borne uniquement à mouvoir des fardeaux. Mais ce rôle est immense, et la liberté de l'industrie commerciale dépend aussi beaucoup de la perfection des moteurs et des machines qu'elle emploie.
C'est ainsi, par exemple, que le commerce devient plus libre à mesure qu'on améliore les animaux propres au transport. Les Anglais, par cela seul qu'ils ont de meilleurs chevaux que nous, ont plus de liberté commerciale : la poste anglaise fait, moyennement, sept milles à l'heure, tandis que la nôtre n'en fait que cinq.
C'est encore ainsi que le commerce devient plus libre lorsqu'on parvient à remplacer, avec économie, les moteurs animés par des moteurs physiques. Combien la substitution du vent aux rameurs [II-210] n'a-t-elle pas accru ses pouvoirs! Les voiles furent pour lui comme des ailes puissantes au moyen desquelles il put faire mouvoir avec rapidité les masses les plus colossales [84] .
La machine à vapeur promet de faire plus encore pour sa liberté. L'application de ce moteur aux navires commence dans la navigation une révolution au moins aussi importante que celle qui y fut opérée par l'invention des voiles. « Les distances s’abrègent, observe un auteur éloquent [85] ; il n'y a plus de courans, de moussons, de vents contraires, de ports fermés en de certaines saisons de l'année; » et cette phrase poétique n'est que l'expression précise des faits réels.
«Grace aux bateaux à vapeur, ajoute un autre écrivain, Lisbonne n'est plus qu'à cinq ou six jours de Londres ; il n'en faut pas davantage au voyageur anglais qui se trouve au fond des vallées de la Suisse, pour revenir dans sa patrie, s'il se confie au paquebot qui descend le cours du Rhin. Les flots de la Baltique, soulevés par la tempête, cèdent également à la toute-puissance de la vapeur, et s'ouvrent devant les [II-211] navires qu'elle entraîne sur cette mer orageuse. Le voyageur parti de Londres peut y être de retour au bout de six semaines, après avoir passé huit jours à Pétersbourg et autant à Moscou [86] . »
Le même moteur appliqué aux voitures prépare dans le système des communications intérieures une révolution encore plus étonnante que celle qu'il est en train d'effectuer dans la navigation. Il paraît devoir faire, tôt ou tard, des routes ordinaires et des voitures à vapeur le moyen le plus général des communications par terre. Déjà un habile mécanicien anglais, M. Gurney, est parvenu à construire une diligence qu'on peut mettre en mouvement par la vapeur, sur les routes de toute espèce, sans le dispendieux appareil des rainures en fer; et tels paraissent être la simplicité de ce véhicule, la sécurité qu'il présente, l'aisance avec laquelle on le conduit, la rapidité de sa marche, la facilité qu'on a de la ralentir ou de l'accélérer, et finalement le peu de dommage qu'il cause aux routes, qu'il serait difficile, n'était la masse d'intérêts privés que menace son établissement, qu'il ne prît pas bientôt [II-212] en Angleterre, où le charbon est à très bas prix, la place de ceux qui existent. Par cette application de la vapeur aux voitures, on pourrait aller sur les routes ordinaires avec une vitesse d'un à douze milles à l'heure, au gré du conducteur, et avec une économie dans la dépense plus grande encore que celle qui serait faite sur le temps [87] .
On voit, par ce peu de faits, à quel point le commerce peut accroître sa puissance en perfectionnant ses moteurs.
Il dépend également de lui d'étendre ses pouvoirs en perfectionnant ses véhicules, alors même que les voies et les moteurs resteraient dans le même état.
Il paraît que nos chevaux et nos routes ne sont pas meilleurs aujourd'hui qu'ils n'étaient il y a cinquante ans; cependant les communications sont infiniment plus rapides et plus économiques : on va, par exemple, de Paris à Lyon en soixante-six heures, et pour le prix moyen de 72 fr. ; tandis qu'au milieu du dernier siècle, on ne pouvait faire ce voyage qu'en dix jours, et pour la somme de 50 fr., accrue des frais de route pendant les dix jours que durait le voyage. On va à Rouen pour [II-213] 15 fr., en douze heures, tandis qu'il en coûtait la même somme, et qu'on n'y pouvait aller qu'en trois jours. On a d'un côté trois fois, et de l'autre cinq fois plus de puissance [88] .
Or, comment s'est-on procuré ce surcroît de liberté ? Principalement en améliorant la forme des voitures; en les rendant plus douces, plus commodes, plus roulantes. Ce que le commerce peut ob- . tenir de pouvoir, seulement en modifiant ses véhicules, est très-considérable. On sait à quel point les communications ont été récemment perfectionnées et accrues dans Paris par le système des voitures dites Omnibus [89] . Une différence peu sensible dans les instrumens employés au transport suffit [II-214] quelquefois pour en mettre une grande dans le degré de liberté qu'ils procurent. Les Hollandais, suivant la remarque de M. Say, durent long-temps la supériorité de leur marine, et par suite la prospérité de toutes leurs affaires, à une circonstance qui semble à peine digne d'attention, à la meilleure qualité de leurs cordages [90] . C'est encore une observation de M. Say que le mouvement des voitures, avant qu'on découvrît la nouvelle manière de les suspendre, avait été fort adouci par la simple invention de ce ressort en spirale qu'on avait imaginé de placer entre les courroies de leurs soupentes. Quand on ne ferait à nos charrettes d'autre amendement que de leur enlever une partie de cet énorme moyeu, qui fait de chaque côté un pied de saillie, on rendrait sûrement un grand service au commerce. Il est évident, en effet, que les rues de nos villes et le pavé de nos routes acquerraient par cela seul plus de largeur, et que les voitures pourraient s'y croiser avec plus d'aisance.
Je m'en tiens à ces remarques sur les instrumens du commerce. On voit que si sa puissance croît avec les facultés industrielles et morales de ses agens, elle n'est pas moins accrue par le perfectionnement des lieux sur lesquels il travaille, et par celui des ustensiles qu'il emploie. Il me reste [II-215] à dire quelques mots de l'influence de toutes ces choses considérées ensemble, et des développemens que prend le commerce à mesure que tous ses moyens se perfectionnent et que s'accroît en général le capital de la société.
§ 10. Ce que les progrès du capital social peuvent pour la liberté de l'industrie voiturière n'est susceptible d'aucune estimation. Plus les ressources de la société s'accroissent, et plus les mouvemens du commerce se multiplient; plus on a de voyages à faire, plus on a de marchandises à à envoyer au marché et à en faire venir. La tâche du commerce devenant plus grande, ses travaux se partagent mieux, ses spéculations s'étendent davantage, l'administration des entreprises commerciales se régularise et se simplifie. En même temps, tous les moyens de communication et de transport se perfectionnant, toutes les communications deviennent plus économiques et plus actives : il y a à la fois plus de voies, de voitures, de voitureurs, de choses et de personnes voiturées.
Voyez comment, chez nous et ailleurs, se sont accrus, avec les ressources de toute espèce, et les moyens de commercer, et l'activité commerciale. Paris, en 1766, ne comptait que douze établissemens de roulage; il en compte six fois ce nombre maintenant. Il ne partait de cette ville, à [II-216] la même époque, que vingt-sept coches par jour, contenant environ deux cent soixante-dix places; il en part aujourd'hui trois cents voitures et trois mille voyageurs : la différence est de vingt-sept à trois cent [91] . Je lis dans un voyage en Angleterre, que le port de Leith n'avait encore que quarante-sept navires en 1740 : en 1752, il en eut soixante-huit; en 1800, cent trente-quatre ; en 1820, deux cent treize. Liverpool, qui, au commencement du dernier siècle, n'avait que quelques bateaux de pêche, possède aujourd'hui plus de onze cents bâtimens. La Grande-Bretagne tout entière, qui n'en avait pas un millier, en a environ vingt-quatre mille. L'activité du commerce s'est accrue dans la même proportion que ses moyens.: En 1760, il n'était entré dans le port de Liverpool que douze cent quarante-cinq navires : en 1770, il y en entra deux mille soixante-treize; en 1780, deux mille deux cent soixante-onze ; en 1790, quatre mille deux cent trente-trois; eni 1800, quatre mille sept cent quarante-six; en 1810, six mille neuf cent vingt-neuf : le mouvement du port s'était presque sextuplé en quarante ans [92] . Qu'on juge, par ce peu de faits, de l'influence que [II-217] le capital social, à mesure qu'il s'accumule, exerce sur les moyens d'action du commerce et sur son activité. On n'est pas moins frappé de cette influence en comparant les pays qu'en rapprochant les époques. L'Angleterre, qui possède un capital infiniment plus considérable qu'aucune autre contrée de l'Europe, a aussi beaucoup plus de ports, de canaux, de routes, de voitures, de navires, de moyens de communication et de transport de toute espèce. Elle a aussi un commerce beaucoup plus actif et plus étendu. Je lis, dans un article de la Revue d'Édimbourg, que sur mille navires entrés, en 1818, dans les ports de la Russie, il s'en trouvait neuf cent quatre-vingt-un d'anglais [93] . "J'ai sous les yeux un état duquel il résulte que, sur treize mille cent quarante-six bâtimens qui ont passé le détroit du Sund en 1825, il y en avait au-delà de cinq mille qui appartenaient à l'Angleterre seule; tandis que le surplus était sorti des ports de quinze États différens de l'Europe ou de l'Amérique. Pendant qu'il n'entre annuellement que de six à huit cents navires au Havre, qui est notre port le plus fréquenté, il en entre au-delà de vingt mille dans le port de Londres [94] . Pendant que, sur une égale [II-218] étendue de route, prise en France et en Angleterre sur les deux points les plus fréquentés des deux pays, il ne passe, en France, dans un temps donné, que deux cavaliers, cinq voitures publiques et sept voitures particulières, il passe, en Angleterre, dans le même temps, vingt-six voitures publiques, cent une voitures particulières et cinquante-deux cavaliers [95] . L'activité des communications est incomparablement plus grande là où un plus grand capital accumulé donne lieu à un mouvement d'affaires plus considérable.
[II-219]
CHAPITRE XVI.
De la liberté de l'industrie manufacturière.↩
§ 1. Deux choses distinguent essentiellement la fabrication du voiturage, du commerce : la première, c'est que ses agens sont autrement distribués; la seconde, qu'ils n'agissent pas de la même manière. D'une part, tandis que les agens du voiturage sont errans, ceux de la fabrication travaillent à poste fixe; et, d'un autre côté, tandis que les voituriers ajoutent à la valeur des choses en les déplaçant, sans d'ailleurs rien changer en elles, les manufacturiers augmentent leur valeur, sans pour ainsi dire les déplacer, mais en leur faisant subir en elles-mêmes d'innombrables modifications.Le propre de l'industrie manufacturière est d'agglomérer ses agens dans les villes et les fabriques; et, en concentrant ainsi leurs forces, de les employer, non point à transporter les choses, mais à les transformer, à les faire changer, non de lieu, mais de figure ou de manière d'être intrinsèque, de les approprier d'un million de manières à nos [II-220] besoins, en les faisant varier d'un million de manières dans leur forme extérieure par des moyens mécaniques, ou dans leur contexture intime par des moyens de physique ou de chimie.
Voilà ce que c'est que l'industrie manufacturière. Ce qui la caractérise, c'est cette manière d'ordonner et de faire travailler ses agens; c'est en cela que sa nature consiste, et en agissant ainsi qu'elle concourt à la production.
§ 2. Les services qu'elle peut rendre à tous les ordres de travaux et à toutes les classes de travail leurs, par ces transformations alternativement chimiques et mécaniques qu'elle fait subir aux choses, sont infinis.
Nous avons vu, dans le précédent chapitre, que l'industrie voiturière concourait à la libre action de tous les arts en conduisant auprès d'eux, d'une multitude de points divers, une multitude d'objets sans lesquels nulle action ne leur serait possible. L'industrie manufacturière a aussi sa manière de les seconder tous : c'est elle qui se charge de construire les ateliers où ils travaillent, de façonner les innombrables instrumens dont ils se sérvent, de composer, en bonne partie du moins, les ingrédiens non moins nombreux qu'ils emploient.
D'un autre côté, nous avons vu que, dans le [II-221] temps où le commerce voiture auprès de chaque travailleur les objets épars qui lui sont indispensables pour l'exercice de sa profession, il lui conduit aussi d'autres objets dont il a besoin pour son entretien propre. L'industrie manufacturière ne fait pas moins pour la satisfaction des besoins personnels des travailleurs. Pendant qu'elle crée les usines, les bâtimens, les machines, les ingrédiens, qui doivent leur servir à exécuter leurs travaux, on voit sortir de ses mains une multitude d'habitations, de meubles, de vêtemens, de comestibles, qui leur serviront à se conserver et à s'entretenir eux-mêmes. Comme tous les ordres de travaux, elle remplit le double office de fournir à toutes les classes de travailleurs des moyens d'action et des moyens de jouissance, des produits pour eux-mêmes en même temps que des objets pour leur art.
Tels sont les effets de l'industrie manufacturière, ils sont, d'une part, si évidens, et, d'un autre côté, si multipliés, qu'il semble être à la fois impossible et superflu de les décrire. Qui n'est frappé de l'étendue des biens qu'elle fait? et, d'un autre côté, qui se chargerait d'énumérer les métamorphoses qu'elle opère ? Qui pourrait dire ce qu'elle fournit à tous les arts de constructions, d'ateliers, de moteurs, de machines, d'outils, de compositions chimiques et de préparations de toute sorte; [II-222] et d'une autre part, qui pourrait dire ce qu'elle livre à ceux qui les exercent, c'est-à-dire à tous les membres de la société, de maisons d'habitation, d'ustensiles, d'ameublemens, de parures, et en général d'objets propres à se conserver, à s'embellir, à se perfectionner eux-mêmes?
Son influence, d'ailleurs, ne s'arrête pas à ces effets immédiats. Pendant qu'elle travaille directement à modifier les choses, elle produit indirectement une révolution dans les hommes qui l'exercent : elle les pousse, dans le seul intérêt de ses travaux, à acquérir une multitude de connaisances et de bonnes habitudes dont ils ne peuvent se passer pour les bien exécuter; et, quoiqu'il n'entre aucunement dans son objet de faire leur éducation, elle contribue infiniment à leur culture.
Il y a plus ; c'est que, dans le temps où elle leur demande de s'instruire, elle leur en fournit les moyens : elle leur donne la richesse, en effet; avec la richesse, le loisir; et avec le loisir, le désir et tous les moyens de s'éclairer, le désir et tous les moyens d'ennoblir et de perfectionner leur existence.
Ces deux effets indirects que l'industrie manufacturière a sur les hommes, elle les a en commun avec les autres industries qui travaillent directement sur les choses; mais elle a aussi sa manière particulière d'agir indirectement sur eux, et l'on a déjà [II-223] compris que cette industrie, en ramassant et en consignant pour ainsi dire ses agens dans les villes et les fabriques, doit influer sur eux autrement que le labourage sur les laboureurs en les disséminant et en les isolant dans les campagnes, ou le voiturage sur les voituriers en les faisant perpétuellement voyager.
Nous avons vu que le commerce, en faisant voyager ses agens, pouvait produire sur eux des effets considérables : comment la fabrication tend-elle à modifier les siens en les réunissant en grand nombre et à demeure dans les lieux resserrés où elle exécute ses fonctions ?
Il semblerait, au premier aspect, que cette situation particulière dans laquelle elle les place ne doit être favorable ni à leur santé, ni à leurs mœurs , ni à leurs habitudes civiles.
D'abord, il paraît difficile que cet extrême rapprochement où elle les oblige de se tenir, et cette vie sédentaire qu'elle leur impose ; que le défaut d'exercice d'une part, et d'un autre côté l'air souvent vicié des ateliers et les émanations souvent délétères des matières sur lesquelles on y travaille, n'aient pas pour effet d'énerver leur corps et de nuire à l'entretien de leurs forces physiques.
Par cela même que cette situation semble tendre à diminuer leurs forces, on dirait qu'elle doit aussi [II-224] les livrer davantage à l'empire de l'imagination et des sens; il semble que, dans ce contact perpétuel où ils vivent, leurs passions doivent être plus vivement excitées, qu'ils doivent être plus enclins à l'intempérance, à l'ivrognerie, à la luxure, au luxe, et donner plus fréquemment dans des écarts de régime et de conduite.
Enfin, cette même situation, qui les expose davantage à contracter de certains vices, semble des voir aussi les exciter davantage à recourir à la violence pour s'enrichir. On pourrait croire que leur réunion en plus ou moins grand nombre dans des espaces peu étendus doit avoir pour effet de les disposer à l'injustice, et peut-être ne faut-il attribuer qu'à l'extrême facilité qu'ils ont de s'entendre et de se liguer, cette multitude de prétentions exclusives qu'on les a vus former dans tous les temps. Les agens de l'industrie agricole, que la nature de leur art tient beaucoup plus écartés les uns des autres, sont loin d'avoir manifesté le même esprit de monopole et d'usurpation. Ce sont surtout les agens de l'industrie manufacturière qui ont donné l'exemple de cette sorte d'excès ; et comme les hommes qui fabriquent ne sont pas de pire espèce que ceux qui labourent, il semble qu'une différence de conduite si remarquable ne peut être raisonnablement expliquée que par la différence des situations. Cela paraît d'autant plus probable [II-225] que lorsque des possesseurs de terre se sont trouvés dans la même situation que les gens de fabrique, ils ont rarement manqué de se conduire de la même façon. C'est ainsi qu'on a vu des assemblées législatives, formées en majorité de propriétaires fonciers, profiter de leur réunion et des pouvoirs dont elles étaient investies pour faire prohiber l'importation des denrées agricoles, et manifester pour le monopole autant d'ardeur qu'en avaient pu jamais montrer les artisans réunis dans les cités.
Je conviens qu'il est dans la nature de l'industrie manufacturière de commencer par produire tous les effets qui viennent d'être indiqués. Cependant il ne faudrait pas juger par ces premiers effets de son influence ultérieure. Si, au sein d'une population très-compacte, comme l'est ordinairement celle des villes manufacturières, la maladie, le vice, l'injustice sont plus contagieux, les lumières y sont aussi plus contagieuses, on y acquiert plus rapidement de l'expérience, on y est plus tôt instruit des conséquences bonnes ou mauvaises d'une certaine manière d'être ou d'agir, et ceci est un avantage qui fait plus que compenser les inconvéniens dont il vient d'être parlé.
Si la fabrication place ses agens dans une situation peu favorable à l'entretien de leurs forces, elle les excite davantage, par cela même, à obvier aux inconvéniens de cette situation, et vous verrez [II-226] qu'en effet la population des villes commencera long-temps avant celle des campagnes à adopter ces habitudes de propreté et d'ordre et à faire ces réglemens de police et de salubrité qui ont pour objet et pour effet de tenir en bon état les lieur qu'on habite.
Si la même industrie place ses agens dans une situation où leurs passions sont plus excitées, elle doit par cela même leur faire comprendre plus tôt le danger qu'on court à leur céder, la nécessité qu'il y a de se tenir en garde contre elles ; et l'on verra encore qu'en effet les lieux où la population est le plus compacte sont ceux où les moeurs sont le plus tôt réglées. On sait que l'extrême agglomération des individus n'est pas toujours ce qui tend le plus à les corrompre. La population est ordinairement plus serrée dans les villes très-industrieuses et très-actives que dans celles où l'on travaille peu; cependant les premières ne sont certainement pas celles où les meurs sont le plus mauvaises. La population est plus pressée dans les quartiers de Paris spécialement affectés aux classes laborieuses que dans ceux habités, par des gens riches et peu occupés; cependant ceux-ci ne paraissent pas être, au moins sous un certain rapport, ceux où les habitudes sont le plus morales : des recherches récentes sur la population de Paris ont donné ce résultat, peu honorable pour la richesse [II-227] oisive, qu'il y a plus de naissances illégitimes, et surtout d'enfans naturels abandonnés, dans les arrondissemens qu'elle habite que dans ceux occupés par la médiocrité laborieuse, quoique la population dans ceux-ci soit incomparablement plus ramassée [96] .
Enfin, si l'industrie manufacturière, en mettant tous ses agens plus en contact, en les faisant rivaliser de plus près, les excite plus vivement à se nuire et leur en fournit davantage les moyens, j'observe qu'elle doit leur faire éprouver de meilleure heure tous les inconvéniens des prétentions injustes, que par suite elle doit plus tôt les conduire au point de sentir le besoin de se respecter mutuellement; et l'on verra en effet que les cités sont encore les lieux où les hommes se plient le plus tôt au joug des bonnes habitudes civiles. Si, comme je l'observais tout à l'heure, l'extrême agglomération des individus n'est pas la circonstance la plus propre [II-228] à relâcher leurs mœurs , elle n'est pas non plus la plus propre à les faire persévérer dans l'injustice. Il se peut bien que le régime prohibitif ait pris naissance dans les villes; mais certainement il у sera plus tôt usé que dans les campagnes. Je crois les entrepreneurs de manufactures moins éloignés que les possesseurs de terre de comprendre que les prohibitions injustes sont contraires à leur véritable prospérité. Il est à remarquer que le projet d'abolir les prohibitions établies au profit des fabriques avait devancé, en Angleterre, sous le ministère de M. Huskisson, celui de réduire les monopoles accordés à l'agriculture. Plusieurs autres faits que je pourrais citer donnent également à connaître que le système de la libre concurrence a fait plus de progrès dans l'esprit des fabricans que dans celui des cultivateurs.
En somme, il paraît impossible que les lieux où l'intelligence a le plus de sujet et de moyeņs de s'exercer, les lieux les plus favorables à l'expérience ne soient pas aussi les plus favorables à nos progrès. Si, au sein des villes et des fabriques, si, dans les lieux où la population est très-ramassée, les infirmités du corps et de l'âme sont plus sujettes à se répandre, il semble que la bonne santé, les bonnes qualités, les qualités vivifiantes doivent y être aussi plus promptes à se communiquer. C'est, à tout prendre, une circonstance extrêmement [II-229] favorable à notre culture que de nous trouver réunis en grand nombre sur de certains points; et l’industrie manufacturière, celle de toutes peut-être qui nous rapproche le plus, doit être considérée, pour cela même, comme une des plus propres à hâter notre développement.
§ 3. S'il est peu d'ordres de travaux qui remplissent, dans l'économie sociale, un rôle plus considérable que la fabrication, un rôle plus étendu, plus varié, plus influent, plus fécond en résultats utiles, il n'en est point, à ce qu'il semble, auquel s'appliquent mieux tous les moyens généraux sur lesquels se fonde la puissance du travail. C'est ici l'industrie par excellence; la seule qu'on croie assez désigner en l'appelant simplement l'industrie; celle où se manifestent au plus haut degré l'art et toutes les qualités qu'il réclame; celle où l'on fait des forces chimiques et mécaniques de la nature un usage si universel qu'on a pu désigner tous les arts qu'elle embrasse par les noms d'arts chimiques et mécaniques; celle aussi où l'on fait de ces forces les emplois les plus ingénieux et les plus savans ; celle, par conséquent, où l'on a le plus besoin de connaître les lois qu'elles observent, où l'on voit le mieux ce que peuvent les talens d'application et d'exécution, où les moteurs physiques sont d'une application plus facile, où les machines remplissent [II-230] des fonctions plus variées, où le travail paraît le mieux se prêter à ces divisions et à ces subdivisions qui en rendent l'exécution plus rapide et plus correcte, où il semble le plus aisé de faire valoir de grands capitaux, où il est le plus commun de travailler, comme on dit, en fabrique; celle, en un mot, sur laquelle les économistes raisonnent de préférence lorsqu'ils veulent exposer l'influence de quelqu'un des moyens généraux du travail, parce qu'en effet elle paraît être celle de toutes, où l'influence de tous ces moyens se laisse le mieux apercevoir.
Examinons d'abord comment et jusqu'à quel point s'y appliquent ceux de ces moyens qui consistent dans les facultés personnelles des travailleurs, et, avant tout, voyons ce qu'elle puise de forces dans cet ensemble de facultés que je réunis sous le nom de génie des affaires.
Deux causes sembleraient rendre cet ordre de facultés, si nécessaire dans tous les travaux, plus indispensable encore dans la fabrication que dans les autres industries. La première, c'est que la concurrence paraît y être plus vive, plus active, que les gains y sont plus disputés, moins considérables, plus chanceux, et que, par cela même, il est plus essentiel de s'y montrer spéculateur et administrateur habile [97] .—La seconde, c'est qu'une grande [II-231] partie des besoins auxquels cette industrie entreprend de pourvoir sont extrêmement sujets à varier, et que ces variations peuvent devenir une grande cause d'erreur dans les entreprises.
Sans doute il y a bien ici un fond de produits sur lesquels les goûts du public restent assez constamment les mêmes ; mais autour de ceux-là, il en existe une multitude d'autres sur lesquels ces mêmes goûts éprouvent de perpétuels changemens. Une très-grande partie de ce qui tient à l'habillement des individus, à la décoration et à l'ameublement des habitations est soumis à l'empire de la mode, et comme elle sujet à varier. Il y a de la mode dans l'arrangement intérieur et extérieur des maisons, dans la forme d'une multitude de meubles et d'ustensiles, dans la matière, la couleur, le dessin de la plupart des étoffes qui servent à [II-232] nous vêtir, dans la coupe des habits, dans la façon des bijoux et des parures; et les producteurs de ces innombrables objets sont obligés, sous peine d'éprouver les plus graves dommages, de savoir comment la mode les veut et de les lui fournir tels qu'elle les demande.
Ce n'est pourtant pas qu'ils doivent lui obéir servilement. S'il est vrai qu'ils sont obligés de consulter ses caprices, il est vrai aussi qu'ils contribuent à les faire naître. En la suivant, ils pourraient, jusqu'à un certain point, la guider; et il y aurait telle manière de la guider qui pourrait avoir sur le goût, sur les moeurs, sur les besoins, sur les consommations, sur la richesse, et par suite sur le développement des pouvoirs de la fabrication une influence des plus salutaires [98] .
Mais si le fabricant, par le caractère qu'il donne à ses produits, peut influer sur la nature des besoins, la nature des besoins doit exercer à son tour une immense influence sur le caractère de ses produits : s'il peut guider la mode en la suivant, en la guidant il est obligé de la suivre; elle n'adopte pas tout aveuglément; il ne la ferait pas passer à son gré d'un extrême à un autre; malgré ses [II-233] caprices apparens, elle obéit dans sa marche à de certaines lois, et il y a, ici comme partout, un art des transitions dont on n'enfreint pas impunément les règles. D'ailleurs, la mode, ce n'est pas lui seul qui la fait; elle est le résultat d'une multitude d'influences qui dominent souvent la sienne, et il est bien des cas où il ne réussit à la faire varier qu'en abondant dans le sens où la poussent les meurs, les événemens et jusqu'aux révolutions de la politique.
Le fabricant, même alors qu'il est assez éclairé pour viser à donner au public des goûts judicieux, à réformer les modes extravagantes et ruineuses, est donc obligé de connaître les goûts, les modes qui règnent, et, jusqu'à un certain point, de s'y conformer, d'observer leur tendance, d'épier leurs mouvemens, et cela, non-seulement dans les lieux où il travaille, mais partout où doivent parvenir ses produits. Or, on sent combien il lui faut de précautions pour spéculer avec quelque sûreté sur un fonds si vague, si étendu, si mobile, et, malgré toutes les précautions possibles, combien il lui est aisé de faire de fausses spéculations. On pense bien que, dans cette innombrable variété d'étoffes, de meubles, d'ajustemens, de parures et d'objets de toute espèce qui sortiront de ses ateliers, tout ne sera pas reçu avec la même faveur. A côté de produits qui obtiendront la vogue, il y en aura d'autres [II-234] qui ne réussiront qu'à demi, d'autres qui ne réussiront pas du tout; il en sera des créations de son industrie comme de celle de toutes les autres; et de même qu'il y a chez le libraire des livres que tout le monde achète et d'autres que personne ne lit, de même il y aura chez le marchand d'étoffes des tissus qui n'auront aucun débit parmi plusieurs autres qui s'écouleront avec une vitesse extrême.
S'il est facile au fabricant de se méprendre sur la nature des besoins, il lui est encore plus aisé de se tromper sur leur étendue. Je ne sais si leur étendue est aussi sujette à varier que leur nature, mais certainement elle est plus difficile à déterminer. Quelle est la quantité d'un certain produit que la fabrication doit faire ? Cela dépend de circonstances qui n'ont rien de fixe et de défini; cela dépend du nombre de personnes qui en ont besoin [99] ; en supposant qu'il réponde à un besoin universel, cela dépend encore du prix auquel elle peut le faire et du nombre de personnes qui, à ce prix, auront les moyens de l'acheter. C'est ce nombre d'acheteurs qu'il lui est difficile, qu'il lui [II-235] est presque impossible de connaître, et que pourtant il lui serait indispensable de savoir; car elle peut ruiner ses agens en faisant trop d'une bonne chose tout aussi-bien qu'en en faisant de mauvaises. On voit donc combien elle a besoin de chercher à découvrir, au moins d'une manière approximative, l'étendue de son marché.
Je sais bien qu'en général on se conduit comme si c'était chose absolument impossible à connaître: que l'on procède comme au hasard ; que chacun règle son activité non sur l'étendue des besoins, qu'il ne connaît pas, mais sur celle des capitaux dont il dispose. Aussi ne faut-il pas demander si l'on se trompe, et si la somme des produits dépasse souvent le nombre et les moyens des acheteurs. On en peut juger par cette difficulté de vendre, par cet engorgement des marchés, sujet si fréquent et si réel des plaintes de toutes les industries, et plus particulièrement de l'industrie manufacturière. Rien assurément n'atteste mieux que ce fait presque permanent de l'encombrement des marchés le peu de soin que chaque classe de producteurs met à s'informer de l'étendue des débouchés que toutes les autres lui présentent, et les tristes suites qui peuvent résulter de son incurie ou de son impuissance sur ce point [100] .
[II-236]
S'il y a tant de produits manufacturés qui ont de la peine à se placer, ou qui ne se placent que lentement et avec perte, c'est beaucoup moins encore parce qu'on néglige d’étudier la nature des besoins que parce qu'on ne met pas assez de soin à se proportionner à leur étendue. Si, par exemple, on a vu à Paris, dans ces dernières années, tant d'entrepreneurs de bâtimens faire de mauvaises affaires, ce n'est pas que cette multitude de nouveaux logemens qu'ils ont créés ne fussent une chose de bon débit, mais c'est que le nombre qu'ils en ont construit excédait de beaucoup celui des personnes qui pouvaient en acheter la jouissance. Je lis dans les Recherches statistiques du préfet de la Seine que, [II-237] du commencement de 1822 à la fin de 1824, le nombre des portes et fenêtres, à Paris, s'est élevée de neuf cent vingt mille deux cent-trente-huit à neuf-cent quatre-vingt-cinq mille cent soixante-dix-sept, qu'il s'est accru d'environ soixante-cinq mille; c'est-à-dire dans le cours de ces trois années, le nombre des logemens a dû être augmenté d'environ un quinzième, tandis que, d'un autre côté, je vois dans les mêmes documens et dans l'Annuaire du bureau des longitudes que, durant la même période, la population de la ville ne s'est augmentée que d'environ douze mille habitans, qu'elle s'est à peine accrue d'un soixantième, [101] d'où il suivrait que l'industrie manufacturière a multiplié les logemens, pendant ces trois années, dans une proportion quatre fois à peu près aussi considérable que celle suivant laquelle la population s'est accrue [102] . Je ne cite que ce fait, parce [II-238]
que c'est le seul sur lequel j'aie en ce moment des données un peu précises. Mais si, dans un lieu comme Paris, où l'on a tant de moyens de s'éclairer et où l'on devrait être si rompu aux affaires, une classe d'entrepreneurs a pu se proportionner si mal à la véritable étendue du marché, on sent qu'ailleurs et dans beaucoup d'autres fabrications l'esprit d'entreprise n'a pas dû être beaucoup plus sage. Cela d'ailleurs est assez établi par un fait qui les renferme tous, par le fait dont j'ai déjà parlé, et que je rappelle encore, de ces engorgemens périodiques auxquels sont sujets les marchés de la fabrication.
On voit donc à quel point il importe à tout fabricant d'étudier la nature et l'étendue des besoins auxquels est chargée de pourvoir la branche d'industrie qu'il exerce. Et encore ne serait-ce rien pour lui, en quelque façon, de savoir que la chose qu'il fait répond à de vrais besoins, et de connaître approximativement la quantité qui s'en peut débiter sur les marchés qu'il fréquente, s'il ne cherchait à s'instruire en même temps du nombre et des moyens des fabricans qui concourent avec lui à l'approvisionnement de ces marchés. Une des [II-239] choses que tout manufacturier a le plus besoin d'étudier c'est, relativement à l'art qu'il exerce, la carte industrielle du pays où il est établi, le nombre d'établissemens que cet art y possède, leur importance, leurs moyens, les lieux où ils envoient leurs produits, et le prix auquel ils peuvent les donner, parvenus à leur destination.
Un entrepreneur de ma connaissance, fort exercé tout à la fois comme homme d'affaires et comme ingénieur, dans une localité et dans des circonstances à lui connues, avait à résoudre ce problème :
« Pouvons-nous entreprendre avec profit de fabriquer vingt mille quintaux de soude ? Avec la concurrence des fabricans de Marseille trouverons-nous à les placer? Jusqu'où pourrons-nous les porter avec avantage ? Sur quels marchés nous sera-t-il possible de nous présenter ? A quel prix, tous frais faits, notre produit reviendra-t-il parvenu sur telle place, et puis sur telle autre, et puis sur telle autre encore ? Comment sur ces divers marchés, soutiendra-t-il la concurrence des producteurs contre lesquels nous avons à lutter, etc.? »
Et cet entrepreneur était parvenu, la carte sous les yeux, à déterminer, avec une précision très-satisfaisante, les lieux où le produit pourrait être porté, les quantités qu'il serait possible d'y en vendre, et finalement à reconnaître s'il y avait ou s'il n'y avait pas lieu d'entreprendre le produit projeté.
[II-240]
En général, il est singulièrement difficile, il faut l'avouer, de connaître avec quelque exactitude, d'une part la nature et l'étendue des besoins, et d'un autre côté le nombre et les moyens des fabricans qui travaillent à les satisfaire. Mais il est deux choses qu’un entrepreneur peut savoir, et qui, lorsqu'elles sont soigneusement vérifiées, peuvent suffire jusqu'à un certain point pour éclairer ses déterminations et le diriger dans ses entreprises : c'est le prix moyen auquel se vend, dans une certainė étendue de pays, le produit qu'il aurait dessein de faire, et le prix auquel lui-même est capable de l’y.créer. Il ne sait point ce que ses concurrens en font; il ne sait pas mieux ce qu'il leur coûte; mais il peut savoir ce que moyennement ils le vendent, et, s'il connaît bien sa situation et les ressources de son art, il peut parvenir aussi à déterminer assez approximativement le prix auquel il lui sera possible de le livrer. Or, s'illui est suffisamment démontré qu'il peut le faire en bonne qualité au-dessous du prix coûtant, il est clair qu'il peut l'entreprendre: il n'a point à craindre d'exposer sa fortune, puisqu'il se croit sûr de produire à un prix qui doit lui donner des acheteurs, et d'une autre part il ne saurait encourir moralement aucun blâme puisqu'il ne supplantera ses concurrens qu'en faisant un meilleur usage de ses forces et en servant mieux la société.
[II-241]
Cependant la difficulté, réduite à ces termes, ne laisse pas d'être fort grave encore; et il ne faut pas croire que ce soit chose aisée que de dresser d'avance le compte d'une entreprise, et de déterminer avec quelque sûreté le prix le plus bas auquel, dans une situation donnée, il sera possible d'obtenir un produit. D'ailleurs il est bien des cas où la question n'est pas si simple, et où il ne suffirait pas, pour se décider avec sagesse, de savoir qu'on peut créer ce produit au-dessous du prix courant. Il faut savoir encore si les producteurs établis n'ont pas, de leur côté, le moyen d'introduire dans leurs prix des améliorations sensibles. Alors même qu'on se croirait assuré de conserver une partie de ses avantages, il faut savoir s'il se fait du produit qu'on veut créer une consommation assez considérable et si l'on peut compter sur un débit assez étendu pour rentrer avec profit dans ses avances. Restent d'ailleurs tous les cas où l'on veut entreprendre quelque chose de nouveau, et où il faut nécessairement savoir pressentir les goûts de la société sur cette création nouvelle. Bref, le jugement des entreprises est entouré dans la fabrication des mêmes difficultés que partout ailleurs, et, comme je l'ai dit d'abord, ces difficultés s'y compliquent de celles que peuvent ajouter une concurrence plus grande, une industrie plus développée, des rivalités plus actives, plus redoutables, et [II-242] des variations continuelles dans les goûts du public sur une portion considérable des produits qu'il s'agit de créer. Non-seulement donc on y a besoin, comme dans tous les ordres de travaux, du genre de talent nécessaire pour spéculer avec habileté, pour juger sainement d'avance de la bonté des entreprises, mais il faut, ce semble, que ce genre de talent y soit infiniment plus exercé.
Les mêmes causes paraissent y rendre les talens de l'administrateur également plus indispensables. Plus le concours y est grand et animé, plus on s'y évertue à bien faire, et moins on y doit négliger un moyen de succès si puissant. On peut, à la rigueur, dans les industries peu avancées, et où l'on n'a à hutter que contre des travailleurs malhabiles, se permettre dans la conduite des entreprises un peu de mollesse et de laisser-aller; mais dans les arts où les pouvoirs du travail ont été poussés très-loin, et où l'on ne fait plus que de petits bénéfices, oni est obligé, sous peine de ruine, de ne se négliger sur rien. Il ne faut pas perdre un instant de vue que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dépense est autant d'avancé à la production, que toute avance est placée à intérêt et à intérêt composé, que toutes les fautes se paient, que les faux calculs, les distractions, les pertes de temps, que toutes les pertes en un mot viennent grever le produit entrepris et diminuer le bénéfice attendu ; qu'ainsi l'on ne peut appliquer [II-243] à l'administration de son affaire des soins trop éclairés, trop sévères, trop assidus. D'ailleurs les talens administratifs semblent plus réclamés dans l'industrie manufacturière à cause de la nature même de cette industrie. Les grandes fabriques sont les établissemens de travail où se trouvent ordinairement réunis le plus grand nombre d'ouvriers, et où, si l'on n'y prend garde, il est le plus aisé de perdre de la main-d'œuvre ; où les ouvriers sont le plus ramassés, et où par conséquent le désordre a le moins de peine à s'introduire; où l'on a réuni un plus grand attirail de machines, et où par cela même plus de choses sont exposées à se détériorer faute de soin; où il se fait une consommation plus continue et plus considérable de matières premières et de provisions de diverses sortes, et où, sous ce rapport encore, le coulage et le gaspillage sont le plus aisés; où l'on a le plus d'achats à faire, et où il est le plus facile de perdre sur les achats s'ils ne sont faits avec intelligence, etc. Les manufactures paraissent donc être le genre d'entreprises où doit se faire le plus sentir le besoin d'ordre, de police, de surveillance, d'économie éclairée, et où par conséquent les talens administratifs semblent le plus nécessaires. M. Chaptal n'hésite point à considérer ces ta lens comme plus propres que ceux de l'artiste à [II-244] faire prospérer ces sortes d'établissemens, et des expériences nombreuses semblent prouver qu'ils leur sont en effet plus indispensables. Rien n'est moins rare que de voir des entreprises excellentes périr dans les mains des artistes les plus distingués, et des entreprises presque ruinées se relever sous la main d'administrateurs habiles qui, privés de connaissances industrielles, n'ont que le mérite de savoir faire un judicieux emploi de celles des autres. C'est surtout dans les fabriques, d'après les récits de personnes bien informées, que brillent, de l'autre côté du détroit, ces talens administratifs qui y concourent si puissamment au succès de toutes les entreprises; et il paraît qu'en effet rien n'est comparable à la simplicité des principes d'après lesquels y sont montés les établissemens les plus vastes; à la police, à l'ordre, au silence, à la propreté qui y règnent, et à l'application que les ouvriers paraissent y apporter à leur travail [103] .
Finalement, les mêmes causes qui paraissent demander à l'entrepreneur, dans l'industrie manufacturière, de se montrer spéculateur et administrateur [II-245] plus habile, semblent exiger de même qu'il soit plus capable de tenir des comptes avec intelligence et régularité. S'il est vrai qu'il n'est pas d'ordres de travaux où la concurrence soit plus grande et les pouvoirs du travail plus développés, il s'ensuit qu'il n'en est pas où il soit moins permis de demeurer stationnaire, où l'on ait plus besoin de perfectionner ses procédés, où l'on soit plus obligé de faire des essais, de tenter des choses nouvelles, et, en même temps, qu'il n'en est pas où il soit plus nécessaire de savoir ce que l'on fait. Partant, il n'en est pas où l'on puisse moins se dispenser de savoir tenir des comptes en règle. Un fabricant qui ne tiendrait pas de comptes, ou qui tiendrait mal ses comptes, ne saurait ce qu'il ferait. Il serait sujet à se passionner pour des entreprises ruineuses et à négliger des entreprises lucratives. Quelquefois des inquiétudes mal fondées le décourageraient et paralyseraient ses forces quand il aurait besoin d'agir, et qu'il pourrait le faire avec sûreté. D'autres fois une aveugle confiance lui donnerait une activité intempestive qui [II-246] tournerait encore plus à son préjudice. Il ne saurait jamais s'il gagne ou s'il perd, ou du moins ce qu'il perd ou ce qu'il gagne. Il finirait bien par voir, en gros, si telle entreprise est ou n'est pas fructueuse; mais, avant qu'il ait acquis cette connaissance, des années se seraient écoulées pendant lesquelles peut-être il aurait travaillé laborieusement à s'appauvrir, ou aurait manqué de faire des bénéfices qui lui eussent été faciles, si, dès l'origine, il s'était rendu un compte exact de la dépense et du produit de chaque chose.
A la différence de ce manufacturier aventureux, celui qui tient des comptes en règle sait toujours positivement ce qu'il fait. Il n'est sujet à éprouver ni fausses terreurs, ni folle confiance. Il connaît l'ensemble et le détail de ses opérations. Il peut voir à chaque instant les avances qu'il a faites à chacune, et ce qu'elle lui a déjà rapporté. Il lui suffit de deux additions au bout de l'année pour savoir exactement ce que chacune lui a donné de profit ou de perte. Il a les moyens de savoir si la perte est venue de la nature de l'entreprise ou des vices de la gestion, ou de l'imperfection des procédés. Il sait par conséquent, s'il doit abandonner l'opération, ou s'il peut la continuer en tâchant de diminuer la dépense. Peu à peu il est conduit à reconnaître quel est le genre de fabrication auquel [II-247] il lui convient le mieux de se livrer, quels sont les modes d'exécution les plus économiques, et il parvient ainsi à faire à la fois de ses forces l'usage le plus sûr et le plus avantageux.
Ainsi toutes les facultés dont se compose le génie des affaires trouvent ici à s'exercer, et y sont d'autant plus indispensables que les concurrens y sont plus nombreux, les succès plus contestés, les affaires plus difficiles. Voyons comment s'y appliquent les facultés qui tiennent à l'art.
§ 4. Que le manufacturier ait, comme toutes les autres classes de travailleurs, commencé par des tâtonnemens, par de l'empirisme ; qu'il ait agi sur des observations isolées, incomplètes, et sans avoir aucune connaissance des lois générales qui gouvernaient les forces dont il se servait, c'est une chose tellement certaine, qu'il serait tout-à-fait superflu de s'arrêter à la démontrer.
Je ne puis être de l'avis des économistes qui croient que l'art est né de la science et que les premiers procédés de l'industrie n'ont été que des applications de découvertes faites d'avance par les savans. Il n'y a que très-peu de temps que la routine manufacturière a consenti à s'éclairer de la théorie des hommes instruits, comme il n'y a que peu de temps que l'orgueil scientifique a consenti à descendre de la hauteur de ses spéculations pour [II-248] s'abaisser jusqu'à l'étude des faits, qui sont le seul guide de l'ouvrier dans la pratique. La science et l'industrie allaient chacune de leur côté, sans prendre garde l'une à l'autre; la science faisant ses théories sans trop s'inquiéter de l'observation des phénomènes, et l'industrie observant les phénomènes sans se donner le temps de remonter aux principes généraux dont ils n'étaient que des corollaires et qui leur auraient servi d'explication et de lien. ll n'est donc guère possible d'admettre que l'industrie est issue des sciences; et quand on posséderait toutes les théories scientifiques des anciens, il n'est nullement certain qu'on y retrouverait l'explication des procédés de leurs arts qui se sont perdus. Rien ne prouve en effet que les procédés de l'art antique fussent des applications de la science antique. Il est, au contraire, fort probable que l'art avait trouvé ses procédés sans le secours de la science, comme la science ses théories sans le secours des expériences industrielles; et, à la différence de M. Say, qui attribue la décadence de l'industrie des anciens, pendant la barbarie du moyen âge, à l'abandon des études scientifiques [104] , je croirais qu'on doit l'attribuer surtout à l'abandon où étaient tombés les arts eux-mêmes.
Sans doute les premiers artisans n'ont pas agi [II-249] sans motifs. Il a bien fallu que les arts, même dans leurs premières et leurs plus grossières ébauches, fussent conduits par quelque raison, qu'ils eussent observé que tel fait pouvait avoir tel résultat, que les choses se passaient d'une certaine façon dans de certaines circonstances. Mais je dis qu'ils ont été guidés par des expériences et non par des théories, par des observations particulières et non par la connaissance des lois générales qui régissent les forces dont ils se servaient.
Et non-seulement c'est ainsi qu'ils ont procédé, mais ils ont pu aller fort loin en cheminant de la sorte, et il est probable qu'une portion très-considérable de leurs progrès ont été faits sans aucune intervention de la théorie.Que les connaissances scientifiques soient destinées à exercer et même qu'elles aient déjà exercé une grande influence sur les procédés de la fabrication, cela ne peut souffrir de doute. Cependant il est difficile de ne pas trouver quelque exagération dans ce qu'on dit souvent des services qu'elles lui ont déjà rendus.
M. Chaptal, dans son livre sur l'Industrie française, présente, comme autant d'applications de la science de la mécanique à la fabrication, beaucoup d'inventions de machines nouvelles ou d'améliorations des machines anciennes faites par des hommes qui, pour la plupart, très-probablement, [II-250] n'étaient que peu ou point versés dans la théorie de cette science [105] .
« Je manifestais mon étonnement auprès d'un savant ingénieur anglais, observait un jour un professeur du Conservatoire, de la rapidité des progrès que l'Angleterre avait faits dans la mécanique. Loin de s'en glorifier il me répondit: ces progrès sont beaucoup moins dus aux connaissances théoriques des savans qu'à l'habileté pratique des ouvriers, qui réussissent toujours' mieux que les esprits élevés à vaincre les difficultés [106] . »
Arkwrigth, l'auteur de la machine à filer, l'une des plus ingénieuses et des plus puissantes qui aient été inventées depuis cinquante ans, le barbier Arkwrigth n'avait aucune instruction scientifique, et ne jugeait qu'en tâtonnant, en essayant, en expérimentant, de l'effet que produirait chacune des pièces de son admirable métier.
Newcomen et Cawley, deux mécaniciens qui : ont contribué sensiblement aux progrès de la [II-251] machine à vapeur, et les premiers qui aient cherché et qui soient parvenus à en tirer des effets utiles, étaient, l'un quincailler, l'autre forgeron, et ne pouvaient passer pour savans ni l'un ni l'autre [107] .
Watt lui-même, l'illustre Watt, lorsqu'il commença à faire à la machine à vapeur cette série de perfectionnemens qui en ont fait un moteur si puissant, ne devait pas posséder beaucoup de connaissances scientifiques. Né de parens pauvres, il n'avait pu étudier que jusqu'à seize ans dans l'une de ces écoles élémentaires et gratuites qui existent en Ecosse sous le nom de Grammar school, et il n'est pas probable qu'il y eût acquis une instruction bien élevée. Il avait été mis ensuite en apprentissage chez un fabricant de balances, puis chez un fabricant d'instrumens de mathématiques ; et lorsque, en 1764, il fut chargé par l'université de Glascow, qui l'avait nommé conservateur de sa collection de modèles, de réparer une machine de Newcomen, ce fut simplement à titre d'ouvrier.
Ainsi les deux instrumens les plus admirables peut-être que possède l'industrie humaine, la machine [II-252] à filer et la pompe à feu, ont pu être, le premier inventé par un homme absolument privé d'instruction scientifique, et le second très-perfectionné par des hommes peu ou point versés dans la théorie [108] . Après cela on doit comprendre qu'il est peu de machines qu'on n'ait pu découvrir en procédant d'une manière empirique.
On est arrivé par la même méthode à la connaissance d'une multitude de procédés de chimie. Je pourrais remarquer ici, par exemple, qu'une des dernières, des plus belles et des plus utiles découvertes de la chimie moderne, celle qui nous apprend qu'on peut empêcher le cuivre de s'oxider en le mettant en contact avec une certaine quantité de fer ou de zinc, était connue depuis longtemps des paysans de ma province, qui l'ont faite je ne sais quand ni comment; mais fort antérieurement, toutefois, à l'invention de l'appareil voltaïque. Il est d'usage dans ma province, qui est un pays de vignobles, de recevoir dans des vases de cuivre le vin qu'on tire des cuves pour le placer dans des tonneaux ; et il arrive fréquemment qu'on l'y laisse séjourner assez long-temps sans qu'il en résulte rien de fâcheux; on se contente, pour prévenir [II-253] les accidens, de déposer quelques morceaux de fer au fond de ces vases. Nul ne saurait dire la raison du résultat qu'on obtient en procédant ainsi; on sait seulement par expérience que lorsqu'il y a du fer au fond d'un chaudron rempli de vin, on n'a pas à craindre que le vert-de-gris s'y mette. C'est, comme on voit, une application de l'idée de Dawy. Cette application diffère de celle que lui-même a faite de sa découverte au doublage des vaisseaux; mais elle est fondée sur les mêmes principes; et il se trouve que des paysans sans instruction étaient arrivés, il y a long-temps, à un résultat que la science n'a obtenu que par un de ses derniers et de ses plus heureux efforts.
Au reste il ne faut pas être surpris que le simple artisan, procédant empiriquement, arrive à de nombreuses découvertes. Toujours placé en présence des faits, toujours occupé des difficultés qu'il a besoin de vaincre, toujours agissant, toujours expérimentant, il est impossible que ses essais, encore bien qu'ils soient souvent mal dirigés, demeurent complètement stériles, et que de sa pratique il ne résulte pas, à la longue, une instruction assez étendue et assez variée. Je répète que la plus grande partie des procédés des arts ont été trouvés de cette manière, et que, pour devenir capable de les exercer et de les faire avancer, la meilleure marche à suivre est de les apprendre [II-254] d'abord tels qu'on les pratique, et de se rendre leurs procédés parfaitement familiers.
En même temps cependant, il faut avouer que tous ces procédés ne sont qu'un recueil de recettes tant qu'on ne sait pas la raison des résultats qu'ils produisent, et que l'homme le plus rompu à la pratique d'un art ne saurait tirer que des effets incomplets, petits, imparfaits, des forces chimiques ou mécaniques dont il fait habituellement usage, tant qu'il n'a pas découvert les lois générales qui président à leur action. Que la connaissance de ces lois soit éminemment propre à éclaircir sa vue, à l'étendre, à l'élever, à l'affermir; qu'elle répande sur son art la plus vive et la plus utile lumière ; qu'elle lui révèle bien des choses dont il ne se doutait pas; qu'en lui apprenant la raison de ce qu'il fait, elle doive le rendre infiniment plus capable de bien faire, c'est une chose incontestable, et qui est universellement sentie.
Il faudrait à la fois être pleinement instruit de la théorie des sciences et des procédés des arts, et savoir parfaitement leur histoire pour pouvoir montrer, non ce que les sciences sont capables de faire our la fabrication : les plus savans et les plus habiles l'ignorent; mais pour pouvoir raconter simplement ce qu'elles ont déjà fait, et quels sont les perfectionnemens de la pratique qui sont réellement dus à des notions de théorie. M. Chaptal, [II-255] dans son livre sur l'Industrie française, essaie de le montrer pour les progrès que la fabrication a faits en France depuis le commencement de la révolution, et des juges sévères trouvent qu'il n'y réussit que bien incomplètement. Il paraît qu'on peut lui reprocher d'avoir dépassé le but d'un côté, et d'être resté fort en-deçà de l'autre ; d'avoir fait honneur aux sciences de beaucoup de perfectionnemens que l'art a trouvés sans elles, et d'un autre côté, de n'avoir fait qu'une description très-insuffisante des progrès dont l'industrie manufacturière leur est réellement redevable.
Pour moi, qui ne possède ni l'instruction théorique, ni les connaissances techniques de l'auteur du livre que je viens de citer, je ne puis que m'abstenir prudemment d'aborder cette matière. Je sens que le très-petit nombre de choses exactes que je pourrais dire là-dessus, ne ferait qu'affaiblir l'idée que les hommes instruits se font des services réels que les sciences ont rendus à la fabrication.
Je me borne à faire remarquer que, par la nature même des choses, les sciences ont dû recevoir dans cette industrie des applications infiniment plus variées que dans le voiturage, où il ne s'agit jamais que de fardeaux à mouvoir, de transports à effectuer, et des applications infiniment plus sûres que dans l'agriculture, attendu que les lois de la mécanique sont beaucoup mieux connues [II-256] que celles de la vie, et que nous pouvons faire des forces de la nature un usage plus éclairé dans les transformations purement manufacturières que dans la création de produits végétaux ou animaux.
J'ajoute que dans le temps où les sciences peuvent intervenir ici avec plus d'étendue el de sûreté, on, peut moins s'y passer qu'ailleurs de leur assistance, et qu'au point où l'industrie manufacturière a été poussée, dans un grand nombre de directions, par, un très grand nombre d'entrepreneurs habiles, le fabricant qui voudrait s'en tenir à la routine, qui ne chercherait pas à connaître la raison de ses procédés, qui emploierait de certaines forces sans prendre la peine d'étudier les lois suivant lesquelles elles agissent, éprouverait un immense désavantage, et serait infailliblement écrasé par ses concurrens plus instruits.
Plus l'intervention des sciences dans les travaux de la fabrication est nécessaire et susceptible de s'opérer avec étendue, et plus le talent des applications est appelé à jouer ici un rôle considérable. Cela n'a pas besoin d'être prouvé. J'ai seulement deux remarques à faire.
La première, c'est qu'on ne peut appliquer la science qu'on a apprise qu'à l'art dont on sait les procédés. De quoi s'agit-il, en effet, dans toute application de la science à l'art ? de substituer à des procédés vicieux des procédés meilleurs que [II-257] la science indique. Et comment opérer cette substitution, si l'on ne connaît les procédés qu'il s'agit de remplacer ou de perfectionner? Comment même avoir l'idée de procédés meilleurs, si l'on ne connaît les procédés qui existent? Visiblement, l'instruction scientifique ne peut servir qu'à ceux qui savent le métier : eux seuls sont capables d'ajuster convenablement la théorie à la pratique. Il ne s'agit pas de former des ouvriers d'un côté et des savans pour les diriger de l'autre. Il faut instruire les gens qui travaillent, voilà tout. Quand on ouvre l'intelligence à celui qui avait déjà une certaine habileté, le talent de tirer parti de cette nouvelle ressource lui vient tout naturellement de celle qu'il possédait déjà.
Ma seconde remarque c'est que, s'il faut être praticien pour pouvoir faire à la pratique de bonnes applications de la théorie, il faut également être spéculateur et homme d'affaires. Songeons, en effet, qu'il s'agit moins de travailler savamment que de travailler d'une manière utile. Le manufacturier le plus habile, dans telle situation donnée, n'est pas précisément celui qui travaille par les méthodes les plus perfectionnées, les plus correctes, les plus savantes : c'est, puisque enfin il s'agit de produire, celui qui fait de ses forces l'usage en résultat le plus productif. A vrai dire, il n'y a pas de méthode absolument préférable. La [II-258] meilleure, c'est la meilleure dans la circonstance où l'on se trouve, et celle-là, c'est le talent de spéculer, de compter qui enseigne à la choisir. Ce talent, si nécessaire pour former une entreprise, est également indispensable pour la modifier, pour juger s'il y a de l'inconvénient ou de l'avantage à y faire l'application de tel procédé nouveau, de telle nouvelle découverte.-Passons de l'application à l'exécution.
Il faut du talent de main-d'œuvre dans tous les ordres de travaux; mais il en faut dans la fabrication peut-être plus que dans l'agriculture et le voiturage, et les produits de l'industrie manufacturière sont en général ceux où se manifeste le plus le mérite de l'exécution.
Cette industrie est celle de toutes où il paraît le plus difficile d'élever des ouvriers habiles, et, en même temps, celle de toutes dont les succès et la puissance paraissent le plus dépendre du mérite des ouvriers.
J'ai déjà cité, d'après M. Clément, les paroles d'un ingénieur anglais qui reconnaissait que l'Angleterre était plus redevable à ses ouvriers qu'à ses savans des progrès qu'elle a faits dans la mécanique.
Telle est ici l'importance de la main-d'œuvre , que le développement des autres moyens est étroitement lié aux progrès de celui-là, et qu'il est des [II-259] époques où de certaines inventions seraient en quelque sorte impossibles, par cela seul qu'on ne trouverait pas des ouvriers assez habiles pour les exécuter. M. Arago, dans sa notice sur les machines à vapeur, ne croit pas que l'Espagnol Blasco de Garay ait inventé, vers le milieu du seizième siècle, quelque chose de semblable à la machine à vapeur actuelle, par cette bonne raison, entre autres, que la plus simple des machines à vapeur d'aujourd'hui exige dans sa construction une précision de main-d'œuvre fort supérieure à tout ce qu'on aurait pu obtenir au seizième siècle [109] .
Le talent de la main-d'œuvre est d'une si grande conséquence dans la fabrication, qu'il est une multitude de localités où, au milieu des circonstances d'ailleurs les plus favorables, il serait impossible, par la difficulté de se procurer des ouvriers, d'élever de certaines fabriques.
Ce talent est d'une telle conséquence que l'Angleterre, qui laissait émigrer ses laboureurs, avait interdit l'émigration à ses artisans, et que, jusqu'à ces derniers temps, les lois anglaises ont puni, et les mœurs, d'accord avec les lois, qualifié de criminel et de traître l'artisan qui portait son talent en pays étranger [110] .
[II-260]
Ce talent est d'une telle conséquence que, dans l'enquête qui fut faite, il y a quelques années, par ordre du parlement d'Angleterre, sur l'état de notre industrie, une des choses qu'on s'appliqua le plus à déterminer, ce fut le point où nous en étions sous le rapport de la main-d'œuvre .
Ce talent est d'une telle conséquence qu'une des choses qui paraissent donner le plus aux Anglais l'espoir de conserver long-temps leur prépondérance industrielle, c'est l'idée qu'ils ont de beaucoup meilleurs ouvriers que nous; et telle est, en effet, la différence qu'il peut y avoir, sous ce rapport, entre les hommes d'un pays et ceux d'un autre, que, si l'on doit s'en rapporter à l'enquête dont je parlais tout à l'heure, on consentirait communément en France, dans les pays de fabrique, à donner à un bon ouvrier anglais le double de ce qu'on paie à un Français bon ouvrier; que l'on paie 10 fr. la journée d'un bon forgeron anglais, tandis qu'on ne paie que 4 fr. celle d'un bon forgeron français ; que les fabricans trouvent du profit à avoir des ouvriers anglais en leur payant des salaires beaucoup plus considérables; qu'un constructeur de machines anglais, grace à la perfection de ses outils, et surtout à son habileté plus grande, travaille avec deux ou trois fois plus de célérité, etc. [111] .
[II-261]
On voit comment agissent et jusqu'à quel point sont nécessaires ici la connaissance pratique du métier, les notions théoriques, les talens d'application et d'exécution. Voyons l'influence qu'y. exercent les bonnes habitudes morales.
§ 5. J'ai parlé plus haut (§ 2) du reproche qu'on fait à l'industrie manufacturière d'agir d'une manière fâcheuse sur la morale de ses agens. Quoi qu'il en soit de l'influence de cette industrie sur les moeurs, il est au moins une chose qui n'est pas douteuse, c'est que les bonnes habitudes morales sont indispensables à ses succès. Plus elle ramasse ses agens, plus elle les expose à contracter de certains vices, et plus, par cela même, elle leur rend nécessaires de certaines vertus. C'est ainsi qu'on semble avoir plus besoin de propreté dans les fabriques que dans les fermes, dans les villes que dans les campagnes. C'est ainsi que, dans les villes, le mélange continuel des sexes et la facilité de certains plaisirs, rendent peut-être plus nécessaires les précautions et les habitudes [II-262] favorables à la continence. C'est ainsi que l'activité, l'économie, la simplicité des goûts semblent plus impérieusement requises dans les lieux circonscrits, où la fabrication accumule ses agens, que dans les espaces étendus où l'agriculture dissémine les siens, par cela seul que, dans les premiers, la paresse est plus favorisée, qu'on y a plus d'occasions de fêtes, plus de sujets de dissipation, qu'on y est plus excité au luxe, aux folles dépenses, etc.
On trouve dans l'enquête faite en Angleterre sur l'état de notre industrie, quelques preuves de ce que peuvent pour la puissance de la fabrication certaines habitudes morales. On pourrait inférer de ce document, par exemple, que le défaut d'activité et d'application de nos ouvriers est une des causes qui nous empêchent de soutenir la concurrence de nos voisins. La commission d'enquête interroge les déposans sur ce qui fait que les ouvriers anglais obtiennent dans nos fabriques des salaires du tiers et de moitié plus forts que les nôtres. L'un répond que nous n'aimons pas à nous donner trop de peine, que nous voulons mêler l'industrie aux plaisirs ; l'autre, que nos ouvriers sont distraits, nonchalans, qu'ils n'ont pas le coeur à l'ouvrage, qu'ils font moins de travail en douze heures que n'en fait en huit un [II-263] bon ouvrier anglais [112] . Je n'examine pas la vérité de ces accusations générales, faites à l'occasion de quelques faits particuliers. Il n'est pas douteux qu'une certaine exagération ne s'y mêle. Cependant il reste vrai que nos fabricans donnent, en général, de plus forts salaires aux ouvriers anglais qu'à ceux du pays, et il faut bien qu'ils travaillent plus ou mieux, puisque l'on consent à les payer davantage. Ce ne serait donc pas tout-à-fait sans raison que l'enquête placerait l'inapplication de nos ouvriers au nombre des causes qui nous empêchent de lutter avec succès contre la concurrence de la Grande-Bretagne.
Une autre cause que le même document assigne à notre infériorité, c'est le peu de soins et de propreté avec lesquels nous tenons quelquefois nos ateliers et nos machines.
« Quelle était, demande le comité à un contre-maître qui avait passé deux ans dans l'une des manufactures de l'Alsace les plus considérables et les mieux montées, quelle était donc la cause qui vous empêchait de faire d'aussi bon coton filé qu'en Angleterre ? Le défaut de soins d'abord, répond le témoin: on n'entretenait pas les machines aussi propres; elles n'étaient pas aussi bien réglées ; on ne maintenait pas dans les ateliers une chaleur aussi égale, [II-264] aussi uniforme [113] .
Il y a dans l'enquête d'autres dépositions analogues. J'ignore jusqu'à quel point elles sont vraies; mais il reste que dans nos meilleures filatures on n'a pu filer encore que du n°150, correspondant au 200 anglais, tandis qu'en Angleterre on file jusqu'au no 300 [114] . Or, il faut bien qu'une différence si notable tienne à quelques causes, et il est fort possible que le défaut de soins soit une de ces causes. Ce ne serait donc pas sans raison que l'enquête la placerait au nombre de celles qui donnent ici aux Anglais l'avantage sur nous.
Quoique nos voisins nous jugent ordinairement avec une hauteur qui n'encourage pas à leur rendre justice, je ne fais pas difficulté de citer les choses où ils paraissent nous avoir devancés. Il ne faut pas que ce qu'il y a chez un peuple de sentimens fâcheux nous empêche de profiter de ce que nous pouvons y puiser d’utiles exemples. Prenons aux Anglais les bonnes applications qu'ils ont faites de nos inventions et des leurs; adoptons leurs meilleures machines, imitons-les dans l'ordonnance judicieuse de leurs ateliers, dans l'ordre et la propreté remarquables qui y règnent, et laissons-leur la morgue dédaigneuse avec laquelle ils se plaisent trop souvent à parler des autres [II-265] nations: ce n'est pas là ce qui en fait pour nous des concurrens redoutables.
Si le défaut de zèle, d'application, de soins, prive la fabrication de beaucoup de forces, le manque de prudence ne lui fait guère moins de mal. Un fabricant qui se ruine ne lui cause pas du dommage seulement parce qu'il détruit une partie de ses moyens, mais encore parce qu'il est d'un mauvais exemple. Les dissipateurs lui sont peut-être moins nuisibles que les spéculateurs trop aventureux. Les uns et les autres attaquent ses ressources; mais ces derniers ont le tort particulier de la discréditer. Il ne faut qu'un petit nombre d'essais imprudens et malheureux pour décrier une industrie nouvelle qui, sagement pratiquée, aurait pu devenir très-productive, et attirer utilement à elle beaucoup de bras et de capitaux. Aussi les hommes les plus ennemis des arts utiles, ce ne sont pas tant peut-être ceux qui dépensent leur fortune en fêtes, en plaisirs, que ceux qui la dissipent dans des entreprises mal conçues et mal conduites, où, en prétendant encourager l'industie, ils n'enseignent aux industrieux que le secret de se ruiner. Un grand seigneur russe, connu par la libéralité de ses sentimens, demandait à un de nos chimistes de lui enseigner à distiller la pomme= de terre; il désirait vivement, disait-il, exciter par son exemple les habitans de ses terres à se livrer à ce [II-266] genre de fabrication : du reste, il déclarait qu'il n'y voulait faire aucun profit, et que même il consentirait à beaucoup y perdre.
« A Dieu ne plaise, répondit le savant, que je vous enseigne un art dans lequel vous pourriez consentir à essuyer des pertes; c'est mal servir l'industrie que de faire un tel usage de ses moyens; il n'y a d'entreprises dont l'exemple lui soit favorable que celles qui sont lucratives, et pour en former de pareilles il y faut apporter une attention et une prudence qu'on ne prend guère la peine d'y mettre quand on n'a ni le besoin, ni le désir d'obtenir des profits. »
Autant la prudence peut ajouter aux pouvoirs de l'industrie manufacturière, autant cette industrie puise de force dans le gout de la simplicité. C'est un effet de ce goût de diriger principalement son activité vers la production des objets d'un usage commun, et de la placer ainsi sur la voie dans laquelle elle peut acquérir le plus de puissance. Les objets dont tout le monde a besoin sont, par leur nature, ceux dont la demande est la plus étendue, la plus certaine, la moins variable ; ceux qui comportent le mieux l'emploi des moyens expéditifs et économiques de fabrication ; ceux dans lesquels les moindres économies donnent les bénéfices les plus considérables : ils sont donc ceux dans lesquels l'industrie [II-267] manufacturière peut acquérir et déployer le plus de force, ceux où elle obtient le plus de liberté d'action.
Une des causes qui ont le plus retardé chez nous les progrès de cette industrie, c'est que peut-être elle n'a pas été assez dominée dans ses trayaux par la simplicité des goûts et des mœurs; c'est que, dans tous les temps, elle a mieux aimé travailler pour la cour que pour le peuple. Il y a plus de deux siècles que nous fabriquons des étoffes de soie, et il n'y a pas trente ans que nous savons faire des limes. Jusqu'à ces derniers temps, nous avons tiré des fabriques étrangères une multitude d'objets de première nécessité. Il est vrai que, depuis la révolution, notre industrie a pris une tendance beaucoup meilleure; mais elle est loin d'avoir entièrement abandonné son ancienne direction : elle s'applique toujours de préférence à la production des objets de luxe. Tandis que Paris, suivant les recherches statistiques publiées par M. le Préfet de la Seine, exporte, année moyenne, pour plus de 2 millions de bijouterie et d'orfèvrerie, pour près de 3 millions d'ouvrages de mode, il exporte à peine pour 173,000 fr. de toiles de coton imprimées, pour 119,000 fr. de machines et de mécaniques, pour 65,000 fr. de fer ouvré, pour 26,000 fr. de coutellerie [115] . Il [II-268] règne encore, sous le rapport du caractère, un contraste marqué entre les industries française et anglaise : l'une excelle surtout dans la joaillerie, l'orfèvrerie, les bronzes dorés et ciselés, les albâtres, les cristaux, les porcelaines, les riches soieries, les draperies fines; l'autre dans la fabrication du fer, de l'acier, du coton, de la laine, dans la production de tous les objets d'un usage très-étendu ; la première est encore particulièrement appliquée à satisfaire les besoins des classes élevées; la seconde travaille de préférence pour les masses.
La différence de ces directions n'est pas à l'avantage de celle des deux industries qui tient à honneur de travailler pour les classes élevées. Cette tendance a retardé le développement de ses branches de production les plus importantes ; et ce qu'elle lui a fait acquérir de pouvoirs, ce qu'elle obtient de bénéfices dans la fabrication des objets de luxe, n'est rien en comparaison de ce que peut et de ce que gagne sa rivale dans la production des choses d'un usage universel et journalier. L'Angleterre, avec une population qui n'est pas la moitié de celle de la France, fabrique annuellement deux fois plus de lainages, trois fois plus de cotonades, six fois plus de fer ou de fonte [116] . Un [II-269] brasseur de Londres, M. Perkins, vend, à lui seul, pour à peu près autant de bière que les trois cent soixante-seize bouchers de Paris achètent annuellement de viande aux marchés de Sceaux et de Poissy : tandis que nos bouchers, suivant la statistique officielle, que j'ai déjà citée, n'achètent que pour 45 millions de viande [117] , le brasseur, dont je parle, vend pour 40 millions de bière. Joignez que notre supériorité dans la production des choses de luxe ne compense aucunement notre infériorité dans la masse des productions nécessaires. Le produit de nos fabriques de luxe n'est d'aucune importance à côté de ce qu'il se fait, même en France, de produits usuels, et surtout à côté de ce qu'il s'en fait de l'autre côté de la Manche. Ce que toutes les aristocraties de l'Europe et du monde nous peuvent acheter d'objets de luxe équivaut à peine à ce que l'Angleterre [II-270] vend, chaque année, de marchandises communes à tel petit pays qui se pourvoit chez elle d'objets de première nécessité. On voit ainsi combien le goût de la simplicité, en tournant l'activité de la fabrication vers la production des choses usuelles, peut faire prendre d'extension à ses travaux et contribuer à lui procurer de puissance.
Il faut ajouter que ce goût n'est pas moins favorable à sa liberté par l'influence qu'il exerce sur la qualité des produits que par celle qu'il a sur la masse des productions. Le fabricant dont l'industrie a pour principal objet de satisfaire les besoins de luxe, néglige ordinairement dans ce qu'il fait la chose essentielle pour s'occuper de ce qui doit plaire aux yeux, de ce qui est destiné à flatter la vanité. Dans une étoffe, il songe à la finesse plutôt qu'à la bonté du tissu, à l'éclat des couleurs plutôt qu'à leur solidité; il exécute avec soin les ornemens d'une pendule et en laisse le mécanisme imparfait ; il polit, il finit toute la partie ostensible d'un meuble, et ne donne qu'une façon grossière à la partie qui doit servir et qui ne se voit point : il ne considère proprement dans les choses que ce qui est destiné à faire effet.
Tout au contraire, le fabricant que dirigent des goûts simples, dans les produits utiles qu'il fabrique, soigne surtout la chose qui doit servir : dans un chronomètre, par exemple, il s'applique [II-271] particulièrement à bien exécuter la partie chronométrique ; dans un instrument de musique, ce qui doit assurer la bonne qualité des sons; ainsi du reste. Il ne dédaigne pas les ornemens; mais il en use avec réserve, et jamais il ne leur sacrifie le fond même de son sujet. Pour lui, la première qualité des choses c'est qu'elles soient propres à la fin pour laquelle elles sont faites; il s'applique par-dessus tout à leur donner cette propriété, et les efforts qu'il fait dans cette direction intelligente, lui ont bientôt fait acquérir une capacité industrielle très-supérieure à celle du fabricant qui, dans ses productions, vise particulièrement à l'effet. D'ailleurs, il donne ainsi à ses produits des qualités extrêmement précieuses; et la même vertu qui en le tournant vers la production de choses simples, lui assure de vastes débouchés, tend en: core à faciliter le débit de ses marchandises en le portant à leur donner les qualités les plus propres à les faire rechercher [118] .
[II-272]
C'est peu d'imprimer une bonne direction aux travaux des fabriques, la simplicité des goûts excite à porter dans les consommations une économie, peut-être plus favorable encore aux progrès de la fabrication. Moins un peuple dépense pour la satisfaction de ses besoins, et plus il lui reste pour l'avancement de ses travaux. Tout ce qu'il dérobe à ses plaisirs, il peut l'employer à multiplier, à varier, à perfectionner ses manufactures. L'épargne est favorable à tous les genres de fabrication, même à celui des choses chères, dont elle semble naturellement ennemie. Elle a le double effet de multiplier le nombre des fortunes capables d'atteindre à certains objets coûteux, et de permettre à l'industrie de faire descendre ces objets au niveau d'un plus grand nombre de fortunes. Elle n'interdit pas précisément la jouissance des choses, de prix, elle conseille de l'ajourner jusqu'à ce qu'on puisse facilement se la permettre. Un peuple qui veut d'abord consommer des choses chères finit par ne pouvoir même se procurer celles de première nécessité. Un peuple, au contraire, qui sait d'abord se réduire aux choses de nécessité deviendra graduellement assez riche pour pouvoir faire une grande consommation de choses chères. Bien des gens, avant la révolution, portaient des habits de soie qui n'avaient pas de chemises : depuis la révolution, nous avons pensé qu'il était raisonnable [II-273] de commencer par se pourvoir de chemises, et peut-être finirons-nous par porter des habits de soie. On parle de la somptuosité des nations orientales, il faut parler de celle des peuples économes et laborieux : il n'y a vraiment que ceux-là qui parviennent à déployer une grande magnificence. Comparez les villes d'Asie à nos villes d'Europe : nos maisons valent mieux que les palais de ces pays-là : il y a plus de choses utiles, commodes, agréables, élégantes, dans l'habitation d'un riche particulier de Londres ou de Paris que dans le palais du schah de Perse. Ce sont des goûts simples, au sein d'une vie laborieuse, qui ont accru la richesse dans un pays voisin, au point d'y rendre universel l'usage des tapis de pied, qui, partout ailleurs, sont encore un véritable objet de luxe. Bien loin donc que le goût de la simplicité et celui de l'épargne qui en est la suite, s'opposent à la fabrication des choses de prix, il est visible qu'en contribuant beaucoup à multiplier le nombre des grandes fortunes, ils finissent par rendre possibles et faciles toutes les fabrications.
Il faut dire pourtant que le goût des choses simples serait encore plus favorable aux progrès des arts en interdisant tout-à-fait l'usage de certains produits qu'en se bornant à en différer la jouissance. Un peuple qui ne consomme des choses de prix que lorsqu'il possède amplement les moyens [II-274] de les acheter peut arriver sans doute à une grande puissance industrielle; mais celui-là peut devenir bien plus puissant encore, qui sait s'interdire, à quelque degré de fortune qu'il parvienne, l'usage des choses destinées uniquement à satisfaire l'ostentation ou une excessive sensualité. Plus une nation industrieuse conserve, en s'élevant, des goûts simples et sévères, et plus ses pouvoirs industriels deviennent grands. Le fabricant fastueux et sensuel perd, au sein des plaisirs physiques, le goût des jouissances intellectuelles; il se desintéresse de son art; il fait moins d'efforts pour l'améliorer, Celui qui reste simple en devenant riche, au contraire, conserve long-temps l'énergie de ses facultés; il cherche l'accroissement de son bonheur dans un usage toujours plus étendu et plus élevé de ses forces; il emploie à perfectionner des fabrications utiles ce que l'autre consacre à de faux plaisirs ; et tandis que celui-ci corrompt les masses par son exemple et les appauvrit par ses profusions, celui-là, par son exemple, leur enseigne à ne pas se faire de besoins factices, tandis que par ses travaux il leur rend chaque jour plus facile la satisfaction des besoins réels.
Voilà comment l'activité, les soins, la propreté, la prudence, l'économie, la simplicité des gouts, ajoutent aux pouvoirs de l'industrie manufacturière. Je pourrais, si je voulais épuiser le [II-275] catalogue des vertus privées, montrer qu'il n'est pas une de ces vertus qui ne contribue de quelque manière à lui donner plus de force et de liberté d'action; mais l'étendue de mon sujet m'impose l'obligation de me restreindre, et je laisse au lecteur le soin de poursuivre ces applications. Je crois en avoir dit assez d'ailleurs pour lui rendre ce travail facile. Passons maintenant aux mœurs de relation, et voyons comment les habitudes de cet ordre agissent sur l'industrie dont je m'occupe.
§ 6. Il serait difficile de dire à combien d'entreprises se sont portés les uns contre les autres les agens de la fabrication. Leur tendance universelle a été long-temps de s'exclure réciproquement du domaine de l'industrie. Un petit nombre d'individus, dans chaque métier, s'emparait de la chose à faire, et disputait effrontément au reste des hommes le droit de s'en occuper. Les masses étaient réduites sans façon au rôle de manœuvre. Ce n'était qu'avec beaucoup de temps, d'efforts, de patience et de dépenses que quelques ouvriers acquéraient le droit de travailler à leur compte, et de devenir entrepreneurs d'industrie. Les agrégations d'accapareurs étaient sans cesse occupées, entre elles à se borner les unes les autres, en dehors d'elles à prévenir l'établissement de quelque métier nouveau. Nul, hors de leur sein, ne pouvait [II-267] faire, ni la chose dont elles s'occupaient, ni une chose approchante, ni rien qui eût avec cette chose quelque apparence d'analogie [119] . Ce n'était qu'avec des peines extrêmes qu'une industrie nouvelle parvenait à se faire tolérer. Nos fabriques de cotonades, de toiles peintes, et une foule d'autres qui font aujourd'hui l'honneur et la richesse du pays, ont trouvé, chacune à leur tour, dans les industries existantes, une résistance opiniâtre à leur établissement. Les monopoleurs ne se montraient pas moins ennemis des procédés nouveaux que des productions nouvelles : il fallait se garder de mieux faire que son voisin; la chose n'eût pas été soufferte : tout métier avait ses règles de fabrication que nul ne pouvait enfreindre, comme toute science ses théories dont nul ne pouvait s'écarter. Enfin, on ne permettait pas plus d'employer de nouveaux outils que de suivre de nouvelles méthodes : celui qui n'avait qu'un mauvais instrument ne voulait pas qu'on en inventât un meilleur ; celui qui [II-277] n'avait que ses bras ne voulait pas qu'on inventât du tout. L'ouvrier brisait les mécaniques; le maître s'opposait à leur perfectionnement. Combien de temps les propriétaires de martinet n'ont-ils pas réclamé contre l'emploi des laminoirs ? Combien de temps les tricoteurs à l'aiguille n'ont-ils pas lutté contre l'invasion des métiers à bas ? On peut réduire à ces termes la morale que les artisans, dans leurs rapports mutuels, s'efforçaient de mettre en pratique : nul ne pourra faire la chose dont je m'occupe ; nul ne pourra fabriquer un produit nouveau capable de faire négliger le mien; si je n'ai pas seul le droit de tout faire, personne au moins ne pourra mieux travailler que moi; nul nè suivra de meilleurs procédés; nul n'emploiera des machines meilleures, etc.
Si telle était la morale des individus, celle de la société était encore moins conforme à la justice. Quelque entreprenant qu'on pût être comme homme privé, il était bien des choses qu'en cette qualité on n'eût osé se permettre; mais il n'était rien qu'on ne se crût permis dès qu'on agissait au nom de la société et comme dépositaire de sa puissance. Les entreprises les plus criantes devenaient simples dès qu'elles étaient faites politiquement. La société exerçait sur la fabrication la juridiction la plus illimitée et la plus arbitraire; elle disposait sans scrupule de toutes les facultés des fabricans : [II-278] elle décidait qui pourrait travailler, quelle chose on pourrait faire, quels matériaux on devrait employer, quels procédés il faudrait suivre, quelles formes on donnerait aux produits, etc. [120] . Il ne suffisait pas de faire bien, de faire mieux, il fallait faire suivant les règles. Il ne s'agissait pas de consulter le goût des consommateurs, mais de se conformer aux volontés de la loi. Des légions d'inspecteurs, de commissaires, de contrôleurs, de jurés, de gardes, étaient chargés de les faire exécuter ; on brisait les métiers, on brûlait les produits qui n'y étaient pas conformes ; les améliorations étaient punies ; on mettait les inventeurs à l'amende. On soumettait à des règles différentes la fabrication des objets destinés à la consommation intérieure et celle des produits destinés au commerce étranger. Un artisan n'était pas le maître de choisir le lieu de son établissement ni de travailler en toute saison, ni de travailler pour tout le monde. Il existe un décret du 30 mars 1700, qui borne à dix-huit villes le nombre des lieux où l'on pourra faire des bas au métier; un arrêt du 18 juin 1723 enjoint aux fabricans de Rouen de suspendre leurs travaux du 1er juillet au 15 septembre, afin de faciliter ceux de la récolte; Louis XIV, quand il voulut [II-279] entreprendre la colonnade du Louvre, défendit aux particuliers d’employer des ouvriers sans sa permission sous peine de 10,000 livres d'amende, et aux ouvriers de travailler pour les particuliers, sous peine, pour la première fois, de la prison, et pour la seconde, des galères [121] . On croit rêver quand on voit à quelles entreprises se sont portés les agens de la fabrication les uns contre les autres, et surtout la société ou ses fondés de pouvoir contre tous. Il n'est pas de branche d'industrie qui ait été plus tourmentée, plus violentée, et où la violence ait engendré plus d'entraves.
Il n'en est donc pas où l'on puisse mieux voir à quel point la justice est nécessaire à la liberté. C'est surtout à l'industrie manufacturière et à tout ce qu'on a vu s'élever dans son sein de prétentions iniques, ou à tout ce qu'elle a essuyé de réglemens vexatoires, que nous devons de connaître un peu le régime que réclame en général l'industrie. C'est dans cet ordre de travaux qu'on a dû sentir le plus tôt et le plus vivement ce qu'ont d'odieux et de tyrannique les gênes imposées au travail. C'est là aussi qu'on a dû le plus tôt comprendre ce qu'il y a de sottise et de vanité dans la prétention d'apprendre aux travailleurs ce qu'ils ont à faire. Plus cette prétention entraînait des [II-280] suites fâcheuses plus, elle suscitait d'embarras, plus elle occasionait de pertes, et, plus naturellement, on devait être excité à en examiner les effets. Il y a eu des plaintes contre le régime réglementaire dès le commencement du dix-septième siècle [122] , Ce régime fort aggravé plus tard, sous l'administration de Colbert, commença à devenir alors l'objet de réclamations plus vives et surtout plus fréquemment renouvelées. On ne tarda pas à sentir tout ce qu'avait de désavantage une fabrication soumise à des règles invariables, une fabrication uniforme, sans proportion avec la diversité des goûts et celle des facultés. Les fabricans, perdant leurs débouchés au dehors par l'impossibilité de varier et de perfectionner leurs produits, se virent obligés de solliciter chaque jour de nouvelles modifications aux réglemens, et l'autorité, égarée dans une voie qui n'était pas la sienne, ne fut occupée, pendant un siècle, dans cette fausse situation, qu'à avancer, à reculer, à changer d'avis, et à donner de perpétuels démentis à sa prétendue sagesse. Vers le milieu du siècle dernier, la philosophie et l'économie politique commencèrent à lui contester le droit de soumettre le travail à des réglemens. On nia que ces règles pussent être utiles; on n'eut pas de peine à prouver qu'elles étaient souvent [II-281] absurdes et ridicules, et tels étaient les progrès que ces idées avaient déjà fait lorsque Turgot arriva au ministère, que cet homme d'État crut pouvoir proposer à Louis XIV, et qu'il réussit à en obtenir l'abolition des jurandes et l'affranchissement de l'industrie. Enfin cette réforme, qui ne put avoir alors d'effet (en 1776), fut réalisée quinze ans plus tard par la révolution, et elle se trouva assez affermie, sous l'empire, pour se maintenir, en, grande partie, contre l'esprit rétrograde de ce gouvernement. Aujourd'hui l'idée que l'industrie doit être franche d'entraves, au moins dans l'intérieur de chaque pays, est fort généralement reçue; et comme les fabricans sont la classe de travailleurs chez qui le régime réglementaire a été le plus éprouvé, on doit supposer qu'elle est aussi celle qui a le plus de lumières sur les funestes effets de ce régime et dont la morale, relativement à la liberté du travail, est le plus avancée.
Cependant il ne faudrait pas inférer de ces remarques qu'à cet égard l'esprit de la population manufacturière est exempt, dès à présent, de toute erreur et de toute injustice. Il est une chose que l'on commence à bien comprendre: c'est qu'il n'y a pas dans le corps social d'organe dont la fonction soit d'apprendre à tous les autres comment ils doivent fonctionner. Non-seulement les fabricans ne demandent plus à l'autorité d'imposer des règles à [II-282] leur art; mais ils ne supporteraient probablement pas qu'elle voulût se mêler encore de leur enseigner ce qu'elle ignore et de leur donner des leçons de technologie [123] . D'un autre côté, je veux croire qu'on aurait de la peine à trouver des fabricans assez hardis pour oser solliciter le rétablissement des maîtrises. Mais si l'on ne voit plus dans chaque métier un petit nombre d'accapareurs demander insolemment qu'on les érige en corps de maîtres, on voit encore dans chaque pays, des fabricans de toutes les classes demander qu'on écarte par la force la concurrence du dehors et qu'on leur assure le monopole de la consommation intérieure. Chaque classe en particulier convient, tant qu'on veut, de la justice et de l'utilité qu'il y aurait de faire concourir les fabricans étrangers avec les nationaux pour tous les produits qu'elle ne fait pas; mais quant au produit particulier qu'elle fabrique, la justice et l'utilité veulent qu'elle ait le droit exclusif [II-283] d'en pourvoir le pays. Puis, si les maîtres ne prétendent plus défendre aux ouvriers de lever boutique sans leur permission, ils ont encore, jusqu'à un certain point, la prétention de rester arbitres du prix de la main-d'œuvre : ils se concertent fréquemment pour la fixer, et ne veulent pas que les ouvriers se coalisent pour l'élever ou la maintenir à un certain taux. Il est tel pays où ils joignaient, il n'y a pas long-temps, à cette injustice celle de s'opposer à l'émigration des ouvriers, et où, maîtres de porter leurs talens et leurs capitaux partout où il leur plaisait, ils exigeaient que les ouvriers demeurassent attachés à la glèbe de l'industrie nationale [124] . Les ouvriers, de leur côté, ne mettent pas toujours plus de justice dans leurs prétentions. Il est encore assez dans leurs dispositions d'empêcher que les maîtres introduisent des machines propres à économiser l'ouvrage, de s'opposer à ce qu'ils prennent des ouvriers partout où ils pourraient en trouver, d'entraîner de vive force dans leurs coalitions ceux de leurs camarades qui voudraient demeurer neutres. Il est évident que ni la morale des maîtres par rapport aux ouvriers, ni celle des [II-284] ouvriers par rapport aux maîtres, ni celle des maitres à l'égard de la société, ne sont encore bien exemptes d'injustice.
D'une autre part, la société est loin aussi de se renfermer, relativement aux travaux des fabriques, dans la limite de ses devoirs. Il est indubitable qu'elle s'arroge encore, relativement à ces travaux, plus de pouvoirs qu'il ne lui appartient et qu'il ne serait de son intérêt d'en exercer. C'est de complicité avec elle que les fabricans parviennent à s'affranchir de toute concurrence étrangère. C'est avec son appui qu'ils se font payer par les contribuables des primes d'encouragement qu'ils ne devraient recevoir que de leur industrie. C'est de son aveu qu'ils exercent sur les ouvriers une police plus ou moins vexatoire, qu'ils peuvent s'entendre pour fixer le prix du travail, empêcher que les ouvriers se concertent pour le même objet, et, s'ils désertent les ateliers, les rappeler forcément à l'ouvrage. Pendant qu'elle favorise de certaines fabrications plus que ne le voudraient la justice et son propre intérêt, il en est d'autres dont elle s'attribue non moins induement le monopole. Elle limite arbitrairement le nombre de personnes par qui d'autres pourront être exercées. Elle se réserve de déterminer les lieux où d'autres pourront établir leurs usines. Il est un certain nombre de machines dont elle défend de se servir sans son autorisation. [II-285] Il est aussi quelques produits dont elle soumet la fabrication à de certaines règles [125] . Sans doute toutes ces mesures ne sont pas approuvées de la partie de ses membres la plus éclairée. Mais soit qu'en général elles soient mal connues ou qu'elles soient encore plus imparfaitement appréciées; soit, par suite, qu'on n'ait pas l'idée de les blâmer ou qu'on ne puisse diriger contre elles qu’un blâme dénué de conviction et de force, il se trouve, en résultat, que leur véritable appui est dans l'état de l'esprit public à leur égard, et qu'on peut avec fondement les considérer comme son ouvrage.
Or, avec un état de l'esprit public qui comporte une telle intervention de la société dans les travaux de l'industrie manufacturière, il est clair qu'il ne peut pas y avoir encore de liberté véritable pour cette industrie. C'est bien quelque chose sans doute que, dans l'intérieur de chaque pays, elle se trouve plus ou moins débarrassée de la gêne des [II-286] corporations et de celle des réglemens qui avaient pour objet de déterminer ses procédés; mais ce qu'elle porte encore de chaînes au dedans, et les lois restrictives qui' la privent de tout ce qu'elle pourrait puiser de ressources au dehors continuent à opposer de fort grands obstacles à son développement régulier et complet.
Est-il besoin de dire, par exemple, que celles de ses branches dont la société a usurpé le monopole, en même temps qu'elles ne se trouvent enfermées dans ses mains que par une injustice, y sont extrêmement déplacées, et que l'argent que son fisc lève par ce moyen est un impôt dont la perception est excessivement onéreuse?
Est-il nécessaire d'ajouter que le petit nombre de celles qu'elle a remises sous le joug des corporations souffrent considérablement de ce régime, et donnent des fruits moins abondans, moins parfaits et plus chers qu'elles ne feraient si elles étaient laissées, comme les autres, au libre concours de tous les citoyens.
La société nuit à la fabrication, même par les réglemens qu'elle lui impose sous prétexte d'ordre et de police. Ce n'est pas en se réservant d'enseigner de certaines professions délicates, ou de juger d'avance de la capacité des personnes qui les voudraient exercer, qu'elle parviendra à empêcher qu'on ne les exerce quelquefois d'une manière [II-287] nuisible: ce serait bien plutôt en prononçant des peines suffisantes contre tout homme qui, ayant risqué sans les lumières requises d'exercer un métier dangereux, aurait compromis par sa faute la vie ou la santé des personnes qui auraient invoqué son secours. Ce n'est pas en se réservant de déterminer le lieu où l'on pourra élever de certaines fabriques qu'elle fera que ces fabriques ne s'élèvent que là où elles peuvent s'établir sans inconvénient: ce serait bien mieux en déterminant ce qui peut devenir un légitime sujet de plaintes, ce qui peut donner lieu à des réparations, et en laissant aux personnes qui se croiraient lésées par un certain fait la charge de s'adresser aux tribunaux pour empêcher que ce fait ne s'accomplît ou pour le faire cesser s'il était accompli. Je suis convaincu qu'il n'est pas un seul cas où ses mesures préventives, toujours contraires à la liberté, ne pussent, dans l'intérêt de la sûreté et de l'ordre, être avantageusement remplacées par un système éclairé de répression et de réparations. L'esprit qui maintient ces mesures nuit donc, sans fruit, au libre développement des arts manufacturiers.
Mais c'est surtout en maintenant un système oppressif de douanes que cet esprit met obstacle aux progrès de la fabrication. Il serait long de dire ici comment elle est affectée par un tel système. Je me contente d'observer que les prohibitions ne [II-288] protègent un art qu'en opprimant les autres, et qu'en résultat elles sont funestes pour tous. Ecarte-t-on les fers étrangers pour favoriser les maîtres de forges: on opprime tous les arts qui traitent le fer. Veut-on, pour encourager les mécaniciens, repousser les mécaniques étrangères : on opprime tous les arts qui en ont besoin. Favorise-t-on les filatures : on opprime les tisserands. Protège-t-on les fabricans de laine : on opprime les fabricans de drap. Accorde-t-on des privilèges aux fabricans de drap : ce sont les tailleurs qu'on opprime. Il est clair qu'on ne peut élever par des prohibitions le prix d'un produit sans grever tous les arts qui en font usage; et comme il n'est pas un produit qui n'ait en sa faveur quelque prohibition, il se trouve que chaque art ne peut vendre plus cher ce qu'il fait qu'après avoir payé plus cher tout ce qu'il consomme pour produire. L'effet de ces prohibitions établies au profit de chaque classe de produits est d'élever le prix de toutes choses, et, en rendent tout plus cher, de rendre tout plus malaisé. S'il est quelque art que ce système favorise, c'est celui que ne favorise pas la nature des choses dans le pays où l'on veut forcément l'installer, et il n'accorde d'appui à celui-là qu'en écrasant ceux qui pourraient se passer d'assistance. Il excite à produire chèrement sous une forme ce qu'on pourrait obtenir à bon marché sous une autre. En [II-289] outre, il amortit sensiblement l'activité ; car il limite encore infiniment la concurrence ; et tandis qu'il imprime une fausse direction à l'industrie du fabricant, et qu'il rend tous ses travaux plus difficiles en l'obligeant de payer tout plus cher; il lui rend encore le mauvais office de favoriser sa paresse naturelle et de le dispenser de tirer le meilleur parti possible de ses facultés. Ce système des prohibitions a tous les inconvéniens de l'ancien système des corps de métiers : c'est le même système sur une plus vaste échelle ; il n'érige pas en corporations les fileurs, les tisserands, les mécaniciens d'une ville, mais les fileurs, les tisserands, les mécaniciens d'un royaume; il accorde, dans chaque pays, à chaque classe d'artisans, le monopole da marché national; la seule chose qui le distingue, c'est qu'il agit sur un espace plus étendu, et qu'ainsi ses effets paraissent moins sensibles ; mais ils sont encore extrêmement préjudiciables, et ce n'est pas faire un petit mal à un art que de le priver, pour lui assurer le marché d'un pays, de tous les secours qu'il pourrait puiser dans le reste du monde. L'esprit qui fait vivre ce système oppose donc encore de graves obstacles au plein développement de la fabrication.
Ainsi, bien que la manie des réglemens et la rage des exclusions, discréditées par l'abus qu'on en a fait surtout dans l'ordre de travaux dont il s'agit ici, [II-290] aient perdu une partie de leur force, ces passions sont loin encore d'être entièrement usées, et l'industrie manufacturière est toujours celle où l'on peut le mieux observer à quel point les pouvoirs du travail peuvent être gênés dans leur action par de mauvaises habitudes sociales.
§ 7. Après avoir vu comment influent sur cette industrie les habitudes sociales, les incurs privées, les divers genres d'habileté qui tiennent à l’art, ceux dont est formé le génie des affaires, et en général toute cette partie des pouvoirs du travail qui se compose de facultés personnelles voulons-nous examiner comment s'y applique à son tour cette seconde série de moyens dans laquelle il n'entre que des objets réels ? nous découvrirons sans peine que l'influence de ces objets, comme celle des facultés personnelles, y est plus marquée que dans le commerce; et je puis dire d'avance qu'il n'est pas d'industrie où l'on voie mieux à quel point il importe d'avoir un atelier bien situé, bien organisé, où le travail soit convenablement réparti, et où l'on dispose d'un bon système de moteurs et de machines.
Par exemple, l'industrie manufacturière est jusqu'ici la seule où l'on ait commencé à voir combien la perfection de l'atelier dépend de sa situation. Ce n'est pas que l'influence de ce moyen ne [II-291] soit réelle que dans cette industrie : elle se fait sentir dans toutes. Il n'est pas d'art où le genre de service que peuvent rendre les ateliers ne dépende d'abord du degré d'intelligence qu'on a mis dans le choix de leur emplacement. Il n'est pas plus indifférent pour une route, une école, une maison de santé d'être convenablement situées que cela n'est indifférent pour une manufacture. Mais enfin les manufactures sont la seule branche d'industrie où les économistes aient commencé à voir combien le succès des entreprises dépend du choix des lieux, où l'on s'établit; et si cela ne prouve pas que l'influence de ce moyen ne soit réelle que dans cette industrie, on pourrait au moins en inférer qu'elle s'y laisse mieux apercevoir que dans les autres [126] .
Il est sûr que si la situation des magasins, des rues, des chemins, et en général de tous les ateliers [II-292] du commerce influe beaucoup sur le service qu'ils peuvent rendre, la puissance des manufactures semble se lier avec plus d'évidence encore aux lieux qu'on a choisis pour leur établissement. Qui ne sent que la fabrique la plus belle et la plus savamment organisée, placée loin de toutes les circonstances favorables à son action, serait nécessairement impuissante?
Les choses n'ont pas été arrangées dans ce monde de manière que toute industrie pût être exercée indifféremment partout. Elles n'ont pas été arrangées non plus de manière que de certaines localités fussent exclusivement propres à l'exercice de tous les arts. Nul lieu ne réunit tous tes avantages. Nul lieu non plus n'a été complètement déshérité de tout. Mais de certaines localités sont plus propres à de certains travaux, d'autres à d'autres, et l'intérêt de l'espèce aurait voulu que les hommes se fussent toujours placés pour faire les choses dans les lieux qui réunissaient le plus de circonstances favorables à leur exécution.
Il est difficile de croire qu'il en ait toujours été ainsi. Bien des causes ont dû y mettre obstacle. La prétention seule qu'on a eue dans chaque pays de faire tout ce qui se faisait dans les autres, et le système de prohibitions qui s'en est suivi, ont dû être cause que beaucoup d'arts se sont développés hors de leur vraie place; et il est probable que dans [II-293] la somme des allées et venues, des voyages et des transports de toute espèce que le genre humain exécute aujourd'hui sur la surface du globe, il y a une masse énorme de mouvemens qui se fait en pure perte, et uniquement parce que, dans le monde en général, et dans chaque pays en particulier, beaucoup de choses n'ont pas été faites là où elles pouvaient l'être le plus convenablement.
Maintenant que les choses se sont développées d'une certaine façon, ce qui a été fait décide en grande partie de ce qu'il est le plus utile de faire, et les travaux exécutés influent à un haut degré sur le choix des lieux où l'on doit s'établir pour en exécuter de nouveaux. Qui le croirait ? L'Inde, où se récolte le coton, où on le fabrique de temps immémorial, où cette industrie avait acquis un degré de perfection qu'il semblait impossible d'atteindre, où la main-d'œuvre d'ailleurs est à vil prix, l'Inde n'est plus le pays où un Indien peut établir le plus convenablement ses fabriques d'indienne. Il lui vaudrait mieux, s'il a les talens requis et une fortune facilement transportable, laisser là l'Inde avec ses cotonniers, ses ouvriers et tous ses avantages naturels, et venir s'établir en Angleterre, à plus de quatre mille lieues de la matière première, et dans un pays où les ouvriers sont très-chers, sauf à faire faire quatre mille lieues encore à son coton fabriqué, pour le faire retourner dans [II-294] l'Inde, où en effet il pourrait le donner à meilleur marché que s'il l'avait façonné sur place, tant sont ingénieux et puissans les moyens d'action que des hommes d'une autre race ont développés dans le pays éloigné où il serait venu s'établir.
On peut juger par ce seul trait à quel point le travail a pu altérer les situations, changer l'importance relative des localités et modifier les motifs qui sont de nature à influer sur le choix des emplacemens.
Ces motifs sont si variés et si nombreux qu'il est comme impossible de trouver des localités qui réunissent toutes les convenances; et qu'en quelque lieu que se place un manufacturier, il ne doit presque jamais arriver qu'il trouve, sur le lieu même de son emplacement, ses matières premières, ses moteurs, ses ouvriers, ses débouchés, etc.
Quelles sont de ces choses celles dont il lui convient le plus de se rapprocher? C'est une question à laquelle on ne peut répondre d'une manière générale. Il faudrait savoir pour quelle part chacune doit entrer dans ses frais, jusqu'à quel point en se rapprochant de l'une il pourra s'éloigner des autres, quelles sont celles qu'il serait le plus dispendieux de faire voyager. On peut dire qu'il doit se placer au point où il aura le plus sous sa main toutes les choses que son art réclame, qu'il [II-295] doit choisir la situation où il aura à faire le moins de mouvemens inutiles et pourra éviter le plus de frais. Mais cette situation quelle est-elle ? C'est, dans chaque circonstance particulière, ce qu'un grand discernement et des calculs exacts sont seuls capables de lui enseigner.
En général, les points de chaque pays où il convient le mieux de se placer pour exercer un art, ce sont ceux où cet art a déjà fait les progrès les plus considérables; car, outre que de tels lieux possèdent ordinairement des avantages naturels assez marqués, ils sont, par le fait même des progrès que cet art y a faits, ceux où doivent se trouver réunies le plus de circonstances favorables à son exercice; ceux où il doit y avoir eu le plus de travaux exécutés pour faciliter l’arrivage des matières premières et l'écoulement des produits fabriqués; ceux où l'on doit trouver une population plus rompue aux difficultés que l'art présente et aux habitudes qu'il réclame ; ceux où le courage des travailleurs doit être le mieux soutenu et leur émulation le plus vivement excitée; ceux où il est le plus aisé de faire des progrès et de profiter de ceux que font les autres.
Aussi voit-on, en général, les hommes qui veulent faire une chose se rapprocher, comme par instinct, des lieux où on la fait déjà, et, par suite de cette disposition, les fabriques de même ordre [II-296] s'agglomérer, dans chaque pays, sur un petit nombre de points principaux. C'est ainsi qu'en Angleterre la plupart des manufactures de coton se sont concentrées dans le Derbyshire et le Lancashire, les fabriques sur métaux à Birmingham et à Sheffield, c'est ainsi qu'en France on fabrique particulièrement les rubans à Saint-Étienne, les étoffes de soie à Lyon, les draps à Elbeuf, à Louviers, à Sedan. Il résulte de là, a-t-on observé avec beaucoup de justesse, une grande émulation due au voisinage et beaucoup de facilités pour l'imitation, source de toute prospérité. Encore ces avantages sont-ils loin d'être les seuls qui résultent de cet arrangement : tout, comme je l'ai dit, doit se trouver mieux préparé pour l'exercice d'un art là où cet art a déjà pris des développemens considérables. C'est donc surtout dans ces centres d'action qu'il convient de s'établir. Et pourtant tels pourraient être les avantages réunis dans des lieux éloignés de ces foyers d'activité qu'il pourrait arriver qu'on dût les choisir de préférence. Mais le calcul seul peut donner à cet égard des avis éclairés.
Si une manufacture, pour être vraiment pro propre à son objet, demande à être bien située, elle n'a pas moins besoin d'être habilement construite. La bonne organisation de l'atelier est encore un moyen dont l'influence se fait peut-être mieux remarquer [II-297] dans la fabrication que dans le voiturage, quoique les économistes n'en aient pas plus tenu compte dans la première que dans la seconde de ces industries. Il exige plus d'art dans les manufactures, et l'on est plus frappé des effets qu'il y produit.
L'effet d'un bon système de rues ou de routes est de faire qu'on y circule sans embarras, et que le voiturage y exécute ses fonctions avec aisance. L'effet du plan judicieux sur lequel est construite une fabrique est de faire aussi que l'industrie manufacturière s'y meuve et y fonctionne librement. Dans les deux industries, cet effet est de même nature; mais peut-être est-il plus considérable dans la seconde ; et d'ailleurs, comme il y est obtenu avec plus de peine, on remarque davantage la puissance de l'art qui l'y produit.
Il y a dans la suite des transformations qu'on fait subir à un objet dans une manufacture, un ordre moins simple que celui qu'on observe sur une route pour faire avancer un fardeau. Tandis que l'industrie voiturière n'a, pour ainsi dire, qu'à mettre un pied devant l'autre, et à marcher devant elle, en évitant d'accrocher, la fabrication est d'abord obligée de faire une chose, puis une seconde différente de la première, puis une troisième différente de la seconde, etc. L'organisation d'une fabrique est donc plus compliquée que celle d'une route, et il est clair qu'il faut infiniment plus d'art [II-298] pour faire que l'industrie manufacturière se meuve avec aisance dans ses ateliers que pour faire que le voiturage fonctionne librement sur les siens.
Il faut, pour être en état de construire convenablement une fabrique, connaître la nature de chacune des opérations qu'on y doit exécuter, et surtout l'ordre suivant lequel ces opérations s'enchaînent : l'essentiel est qu'elle soit construite de telle sorte que tous les mouvemens qu'on y fait soient dans l'ordre des transformations qui s'y opèrent, de telle sorte qu'on y avance en fabrique simplement, promptement, sans peine perdue, sans manœuvre inutile.
Un homme qui a sur les arts des vues très-justes et très-élevées, et sur lequel je m'appuie le plus souvent que je peux, M. Clément, dans le cours qu'il fait au Conservatoire, a eu quelquefois occasion de remarquer ce que peut, pour la bonne et prompte expédition de l'ouvrage, un atelier bien organisé.
« La différence est extrême, observait-il un jour, entre une fabrique à l'organisation de laquelle a présidé une prévoyance éclairée, et celle qui s'est faite en quelque sorte par hasard et suivant le caprice d'un maître ignorant : j'ai vu telle teinturerie où la main-d'œuvre était quatre fois plus considérable que dans telle autre, uniquement parce que la manufacture était mal organisée, et telle blanchisserie où cinquante brouettes [II-299] roulaient sans cesse pour transporter inutilement des toiles d'une place à une autre, tandis que dans une manufacture toute pareille on ne voyait pas une seule brouette. »
Si nous devons en croire des voisins dont le jugement nous est rarement favorable, la bonne organisation de l'atelier est un des moyens de puissance et de liberté d'action que nous avons le plus négligés dans nos manufactures. On voit dans cette enquête parlementaire que j'ai déjà tant de fois citée, un constructeur de fabriques de Manchester déclarer que, sous le rapport des arrangemens et de la méthode, les usines de fabrication lui ont paru très-défectueuses en France, comparées aux établissemens semblables existans en Angleterre [127] . Si la remarque était juste, elle serait affligeante; car elle signalerait dans nos fabriques l'absence de l'un des moyens les plus propres à contribuer à l'extension de leurs pouvoirs.
S'il importe à l'industrie manufacturière que ses ateliers soient bien situés, bien construits, bien organisés, il n'est pas moins essentiel pour elle que le travail y soit habilement réparti. La bonne division du travail entre les ateliers et dans l'intérieur de chaque atelier est un troisième ou quatrième moyen de puissance dont les effets sont [II-300] encore plus manifestes dans l'industrie manufacturière que dans l'industrie commerciale. Les métiers dans celle-ci sont moins nombreux : il n'y a pas autant d'espèces de commerce que d'espèces de fabrication. De plus, le travail dans un atelier de commerce est infiniment moins divisé que dans une fabrique, et il y produit des effets infiniment moins étendus. Smith a compté que dix ouvriers qui, en agissant isolément, n'auraient produit chacun que vingt épingles par jour, réunis dans une fabrique et se partageant convenablement entre eux les opérations de cette industrie, en produisaient quarante-huit mille, ce qui faisait pour chacun quatre mille huit cents, c'est-à-dire deux cent quarante fois davantage. M. Say a vu une fabrique de cartes à jouer où trente ouvriers qui, en travaillant isolément, n'auraient pas fait chacun deux cartes par jour, pouvaient, en se réunissant et en se partageant artistement la besogne, en faire quinze mille cinq cents, ce qui faisait pour chacun plus de cinq cents, c'est-à-dire deux cent cinquante fois davantage. Certes il serait difficile que dans une boutique, sur un bateau, à bord d'un navire, la division du travail produisît des effets comparables et accrût à ce point la puissance des travailleurs.
Enfin, voulons-nous comparer les effets produits ici par les machines à ceux qu'elles opèrent [II-301] dans l'industrie dont nous avons précédemment traité ? Nous verrons encore que cet ordre de moyens joue un plus grand rôle dans la fabrication que dans le commerce.
Il se trouve d'abord, par la nature même des choses, que le commerce ne peut pas employer la plupart des moteurs physiques, et par exemple la vapeur, le vent, les cours d'eau, d'une manière aussi générale et aussi continue que l'industrie manufacturière. Sur terre, il n'a guère pu jusqu'ici faire mouvoir ses véhicules qu'à l'aide de moteurs animés. Sur eau, il ne peut se servir du courant des' rivières que pour descendre, du vent que lorsqu'il souffle du bon côté, de la force élastique de' la vapeur que pour des navigations peu longues, tandis que la fabrication peut appliquer ces forces à toute sorte de manufactures et s'en servir d'une manière non interrompue. Il n'y a pas d'interruption dans le mouvement qu'une chute d'eau imprime à une fabrique. Un moulin à vent, tournant sur son pivot, peut se servir du vent de quel" que côté qu'il souffle. Une fabrique mue par la vapeur a la même facilité pour renouveler sa provision de combustible que pour la faire, et elle n'a pas à craindre que le feu vienne à lui manquer. Il est évident que, par sa nature, la fabrication se prête mieux que le voiturage à l'emploi de ces divers moteurs.
[II-302]
De plus, elle tire de ces forces des effets plus étendus et surtout plus variés. C'est sans doute un merveilleux spectacle que celui de ces vaisseaux qui peuvent naviguer sans voiles, et aller directement contre le vent et la marée ; ou bien que celui de ces files de voitures qu'on voit en Angleterre, dans le voisinage des mines, s'avancer sur des routes à rainures, sans aucun moteur apparent qui leur donne l'impulsion; ou mieux encore que celui de cette nouvelle diligence que M. Gurney a lancée, sans chevaux, sur les routes ordinaires, et qui y marche avec une sûreté, une précision et une rapidité supérieures à celles des voitures de poste les mieux attelées et les plus habilement conduites. Mais ces applications de la vapeur au voiturage par terre et par eau, qui nous frappent davantage parce qu'elles sont plus nouvelles, ne sont comparables. ni pour l'étendue, ni pour la variété, ni, à quelques égards, pour la singularité à celles que la fabrication a faites de la même force.
On est sûrement très-loin encore de faire dans l'industrie voiturière un usage aussi étendu que dans les manufactures de la puissance de la vapeur, Si l'on ne peut se défendre d'une vive admiration en voyant cet agent aveugle employé à faire marcher les voitures, est-il moins singulier de le voir polir l'acier, tourner la poterie, tailler les cristaux, [II-303] graver un cachet, filer, sans le rompre, un fil que sa finesse rend presque imperceptible, broder les dessins les plus variés sans la moindre confusion, soulever un vaisseau de guerre comme une chaloupe, saisir des arbres énormes aussi légèrement que le fil le plus délié, les placer dans la direction nécessaire à la forme qu'ils doivent recevoir, et en faire les mâts des plus gros navires avec la justesse et la précision qu'un tourneur habile donnerait à une queue de billard ? En tout cas, voilà une variété d'effets bien supérieure à celle que le voiturage tire de la même force; et je ne dis pas la vingtième partie des usages auxquels la fabrication est parvenue à l'employer.
Il y a à ajouter que les effets de la puissance de la vapeur se font plus sentir dans la fabrication que dans le voiturage, encore sous ce rapport peut-être qu'elle y a fait baisser davantage le prix des produits qu'elle est employée à créer, et qu'elle en a plus étendu l'usage, Je doute que l'application de la vapeur à la navigation ait autant diminué le prix du fret que son application aux manufactures le prix de beaucoup de produits manufacturés. Je doute que la machine à vapeur ait autant multiplié les voyages maritimes qu'elle a étendu la fabrication et la consommation des tissus de coton, s'il est possible de comparer entre elles des quantités si disparates.
[II-304]
Au reste, quelle que soit ici l'influence des machines et celle de leur perfectionnement, il ne s'ensuit pas, prenons-y bien garde, que les machines les plus perfectionnées et les plus puissantes sont toujours celles qu'il vaut le mieux employer. Il y a à dire ici des machines ce que j'ai dit plus haut des méthodes, qu'il n'en est pas d'absolument préférables. Les meilleures, absolument parlant, peuvent fort bien ne pas être les meilleures dans telle situation donnée. Il est clair, par exemple, que là où un certain produit ne peut avoir qu'un débit borné, on ne peut songer à faire usage, pour le créer, de machines puissantes et coûteuses dont l'emploi n'est économique que là où l'on peut faire ce produit par grandes masses. Il est telles localités où le vent est le meilleur moteur qu'on puisse employer; dans d'autres, c'est l'eau ; dans d'autres, la vapeur. La première machine à feu qu'on ait appliquée à l'industrie, celle de Newcomen, est encore en usage, malgré son imperfection, dans un grand nombre de lieux où le charbon est peu cher, et où l'on n'a pas trouvé de profit à la remplacer par des machines plus modernes. Dans chaque circonstance particulière, c'est au calcul à enseigner quels sont les moteurs et les machines dont il convient de faire usage ; comme c'est au calcul à décider du plan plus ou moins savant sur lequel on doit monter sa fabrique ; comme c'est au calcul à [II-305] faire connaître le lieu où il vaut le mieux l'établir. Le meilleur système de moteurs et de machines est celui qui se trouve le mieux approprié aux circonstances où l'on se trouve; et toutefois, il n'est pas douteux qu'il ne soit heureux de se trouver dans des circonstances où l'on puisse faire usage des instrumens les plus perfectionnés et les plus puissans.
Ainsi les machines, les moteurs, les bâtimens, la manière dont le travail y est divisé, le plan sur lequel ils sont construits, les lieux où ils sont situés, tout ce qui fait partie de l'atelier et contribue à sa puissance, tout ce qui entre dans la composition du fonds réel, trouve, comme le fonds des facultés personnelles, à s'appliquer à la fabrication comme au voiturage, et, de même que ces facultés, y manifeste son influence d'une manière beaucoup plus marquée. Il me reste à montrer comment du concours simultané de toutes ces causes et de leur développement progressif résultent une puissance, une liberté, une facilité d'action et une confiance dans les pouvoirs du travail de plus en plus grandes.
§ 8. Ce que le capital social, à mesure qu'il prend de l'extension et du volume, peut ajouter aux pouvoirs de la fabrication est immense. On en peut juger par l'extension que prennent en particulier [II-305] quelques industries à mesure que s'accumulent tous leurs moyens, à mesure qu'on y applique un plus grand nombre de mains, des mains plus actives, une activité mieux dirigée, des habitudes plus favorables au succès des entreprises, des instrumens plus puissans, des locaux mieux appropriés. En 1812, l'industrie française ne mettait en @uvre, dans toute l'étendue de l'empire, que trente-cinq millions de kilogrammes de laines françaises: en 1827, elle a employé, dans les quatre-vingt-six départemens de la France actuelle, quarante-deux millions de kilogrammes de laines nationales et huit millions de kilogrammes de laines étrangères. En 1814, la même industrie n'avait fabriqué que cent dix millions de kilogrammes de fer, et en 1825 elle en a fabriqué cent soixante millions de kilogrammes. En 1819, l'industrie parisienne n'avait consommé que quatre cent quarante-neuf mille hectolitres de houille : en 1820, cette consommation s'est élevée à cinq cent treize mille, et en 1821 à cinq cent soixante-trois mille hectolitres. Je vois dans l'enquête faite devant le parlement d'Angleterre, sur l'état de notre industrie, que nos fabriques de coton qui, du temps de l'empire, n'avaient jamais pu employer au-delà de cinquante mille balles de coton, en ont consommé en 1824, sur un territoire d'un tiers moins étendu, deux cent mille balles. J'y vois aussi que, de 1816 [II-307] à 1823, la consommation de la même matière s'est élevée, par semaine, en Angleterre, de sept cent cinquante à douze cents tonneaux. J'y trouve encore, que dans la seule ville de Manchester, le nombre des métiers à tisser est monté, en trois ans, de deux mille à cinq mille sept cents. Il est, en Angleterre, tel comté où il a été construit, en moins d'une année, cent quarante filatures de coton nouvelles, ayant toutes pour moteurs des machines à vapeur. Les fabricans de ce pays ont livré à l'impression, en 1823, plus de trente-quatre millions de livres de coton en tissus, six ou sept fois plus que nous n'en avons fabriqué en France dans le cours de la même année. Il n'est pas très-rare de trouver là des manufacturiers qui versent annuellement dans la consommation trois cent mille pièces d'indiennes, tandis que nos maisons les plus fortes en livrent à peine cinquante mille pièces à la consommation. D'autres établissemens y sont montés sur une échelle plus vaste encore: j'ai déjà dit qu'un seul brasseur de Londres fabriqne tous les ans pour 40 millions de bière. Dans le comté de Stafford, sur un espace de quelques lieues carrées, soixante-huit hauts-fourneaux donnent ensemble près de quatorze cents milliers de fer fondu par jour. Un seul établissement, à Mertyr-Tidwill, en coule et en lamine, chaque jour, au-delà de cent vingt milliers, plus que n'en produisent, en un an, [II-308] un assez grand nombre de nos forges. Enfin la beauté des fabriques, l'excellence de leur arrangement intérieur, la puissance des moteurs et des outils qu'elles emploient, répondent à la grandeur de l'échelle sur laquelle on les a construites [128] .
Et ce serait bien vainement, dans un pays où il y aurait moins de moyens accumulés, que l'industrie voudrait travailler sur un cadre aussi vaste et suivant des procédés aussi parfaits. J'ai vu quelquefois des écrivains s'extasier sur l'immense développement qu'ont pris en Angleterre les moyens de communication, et exprimer naïvement le désir qu'on entreprît en France un pareil ensemble de canaux et de routes. Le souhait était plus patriotique que facile à réaliser. Ce ne sont pas là des choses qui se puissent faire par projet : elles ne sont faisables qu'avec le temps, à mesure que s'accroissent les besoins de l'industrie et que se [II-309] développent ses ressources. Tout peuple est naturellement obligé de renfermer ses entreprises dans la limite de ses moyens. Il est impossible qu'une nation moins avancée et moins riche travaille sur des plans aussi étendus, avec autant de puissance, d'économie, de profit, qu'une nation plus riche et plus avancée. Plus une nation a d'avances, et plus elle a de loisir pour acquérir des lumières, plus elle a d'argent pour faire des essais, plus il lui est aisé d'arriver à d'utiles découvertes, plus elle a le moyen de les appliquer, plus sa consommation est étendue, plus par conséquent ses débouchés sont vastes, plus elle peut fabriquer en grand, plus les moindres économies lui doivent donner des bénéfices considérables. La supériorité de puissance qu'une plus grande accumulation de moyens donne au peuple manufacturier qui la possède se manifeste sous une multitude d'aspects.
Ensuite, avec cette puissance croissante, naît une confiance dans les moyens de l'industrie, qui en augmente encore la force. Cette confiance n'est pas un sentiment qu'on soit le maître de se donner. Pour croire aux pouvoirs de l'industrie, il faut les connaître; il faut les avoir beaucoup éprouvés ; il faut en avoir essayé, varié, étendu, et quelquefois forcé l'usage ; il faut sentir que les effets qu'on en a obtenus, on devait les obtenir, et croire [II-310] fermement qu'on est le maître de les obtenir encore.
Or, cette assurance dans l'emploi qu'on en fait ne peut s'acquérir qu'à mesure qu'on en use, qu'on se les rend familiers, et qu'on les agrandit en les exerçant. Un des grands désavantages des peuples peu avancés est de ne pouvoir se servir des ressources qu'ils possèdent qu'avec hésitation et timidité. Alors même que l'industrie les sert le mieux, ils doutent de ce qu'elle peut faire ; ils semblent considérer le succès de leurs entreprises, moins comme son ouvrage que comme le fruit d'un hasard heureux; ils ne lui font qu'avec parcimonie les avances qu'elle exige ; ils ne lui laissent leurs capitaux qu'en tremblant; ils lui en dérobent le plus qu'ils peuvent.
C'est ainsi que, dans le pays de Saint-Étienne, où plusieurs sortes de fabrications, et notamment celle des rubans, ont répandu une si grande aisance, les habitans, au lieu d'employer leurs économies à rajeunir leurs vieilles usines et à en créer de nouvelles, placent timidement leur argent en fonds de terre, et aiment mieux se contenter d'un mince intérêt d'un et demi ou de deux pour cent, que de risquer de faire de nouvelles avances à des industries de qui ils tiennent tout ce qu'ils ont : tant est faible encore la confiance qu'ils mettent en elles !
[II-311]
Dans les pays peu avancés, les capitaux, comme l'observe un écrivain,
« sont craintifs, moroses, apoplectiques; ils ont peur de tout; ils n'osent pas mettre le nez à la fenêtre. Leur proposez-vous de sortir de leurs coffres, il faut qu'il fasse un temps superbe, et qu'il n'y ait pas un nuage à l'horizon. Les engagez-vous à se fixer dans une usine excellente, sur le bord d'un beau canal, ils vous regardent de travers, et vous demandent une première hypothèque ou un dépôt de rentes d'une valeur triple: encore sont-ce là les plus hardis [129] . »
Sans doute cette défiance, en de tels pays, est à la fois naturelle et salutaire; mais il vaudrait mieux qu'elle ne fût pas obligée, et que les pouvoirs de l'industrie fussent assez développés et assez connus pour qu'on pût avoir foi en elle, et ne pas craindre de lui confier ses économies. Or, cette foi dans sa puissance, si propre à en ac croître l'énergie, ne peut naître que de sa puissance même et des progrès de tous ses moyens: elle en est le complément en même temps que la conséquence.
[II-312]
CHAPITRE XVII.
De la liberté de l'industrie agricole [130] .↩
§ 1. M. de Tracy, dans son Traité d'économie politique, n'a pas consacré de chapitre particulier à l'agriculture. Il a réuni ce qu'il avait à dire des travaux de cet ordre avec ce qu'il se proposait de dire de la fabrication. Il n'en a fait qu'une seule et même chose. Il a déclaré que l'industrie agricole n'était, à ses yeux, qu'une branche de l'industrie manufacturière qui ne se distinguait des autres par aucun caractère spécifique, et qu'il ne [II-313] voyait dans une ferme qu'une fabrique véritable, où tout s'opérait de la même façon que dans les fabriques ordinaires, suivant les mêmes principes et pour la même fin, c'est-à-dire dans la vue d'opérer des transformations utiles.
L'esprit qui a dirigé ici l'auteur du Traité de la volonté est sûrement très-philosophique. M. de Tracy, en confondant entièrement les exploitations agricoles avec les entreprises manufacturières, a voulu achever de détruire le préjugé accrédité par les économistes du dix-huitième siècle, et qui lui semblait n'avoir jamais été bien nettement abandonné, qu'il n'y a que l'agriculture de productive, ou que cette industrie est plus réellement productive que les autres. Il a observé lorsqu'on mettait des grains de blé en contact avec l'air, l'eau, la terre et différens engrais, et que, par la combinaison de ces divers élémens, on [II-314] obtenait du blé, il n'y avait pas plus de création opérée que lorsqu'on prenait ensuite ce blé pour le convertir en farine, ou bien lorsque plus tard on prenait cette farine pour la convertir en pain.
Rien de plus juste que cette remarque : aussi suis-je tout disposé à reconnaître, avec M. de Tracy, que l'industrie agricole n'est pas plus créatrice qu'une autre, qu'il ne lui est pas plus donné qu'à une autre de faire quelque chose de rien, et que toute sa vertu, comme celle de l'industrie manufacturière, consiste purement et simplement à opérer des transformations.
Mais, en convenant que l'agriculture se borne, comme la fabrication, à opérer des changemens de forme, je trouve d'abord, je l'avoue, une si grande différence dans la nature des transformations qu'elle opère, dans la manière dont elle classe ses agens pour les obtenir, et surtout dans la nature de l'une des forces qu'elle emploie pour cet objet, qu'il me paraît impossible, même à ne considérer les manufactures agricoles qu'en elles-mêmes et dans leur nature, de ne pas faire de cette espèce de manufactures une classe tout-à-fait séparée.
Les fabriques agricoles n'opèrent que des transformations; mais leurs produits ont un caractère qui ne permet de les confondre avec ceux d'aucune autre espèce de fabriques: ils sont doués de vie en [II-315] effet, et il existe entre eux et les produits des fabriques ordinaires toute la distance qu'il y a de la matière brute à la matière organisée. Le moyen de voir des produits de même nature dans des fleurs naturelles et dans des fleurs artificielles; dans la pêche qui vient d'être cueillie sur un arbre et dans celle que le confiseur a fabriquée; dans des animaux qui ruminent, qui bêlent, qui mugissent, qui marchent, et dans les mêmes animaux faits de main d'homme avec de l'argile cuite au feu !
Non-seulement l'agriculture crée des produits d'un ordre tout particulier ; mais, pour créer ces produits, elle distribue ses agens d'une tout autre façon que les industries dont j'ai parlé dans les précédens chapitres. J'ai dit que les agens du voiturage étaient toujours par voies et par chemins; que ceux de la fabrication étaient agglomérés dans les villes et les fabriques : ceux de l'agriculture ne sont ni toujours errans comme les premiers, ni réunis par grandes masses comme les seconds : le propre de cette industrie est de les disséminer dans l'étendue des campagnes.
Enfin, tandis que l'agriculture a sa manière particulière de distribuer ses agens, elle emploie aussi des forces d'une nature particulière. J'ai dit que le voiturage, pour faire changer les choses de lieu, et la fabrication pour les faire changer de forme extérieure ou de contexture intime, employaient [II-316] des moyens chimiques ou mécaniques. L'agriculture fait bien usage de ces deux sortes de forces; mais elles ne lui suffisent pas; il lui en faut d'une troisième espèce : après qu'elle a modifié mécaniquement le sol; après que, par des procédés chimiques plus ou moins éclairés, elle a mis ses parties constituantes dans la proportion que l'expérience lui a fait connaître comme la plus favorable au travail de la végétation; enfin après que, par un nouveau travail mécanique, elle a mis convenablement en rapport avec ce sol ainsi préparé la graine qu'elle veut faire germer on le plant qu'elle veut faire croître, il intervient une troisième force, la vie, dont elle ne connaît point la nature, et qui termine son ouvrage sans qu'elle puisse dire comment.
Que cette force soit indispensable à l'agriculteur, c'est une chose tellement notoire qu'il n'y a point à la prouver. Qu'elle soit d'une nature différente de celle des autres agens qu'il emploie, c'est encore une chose indubitable : n'est-il pas évident que le travail qui fait germer ou croître une plante diffère de celui qui a modifié chimiquement ou mécaniquement le sol où elle est plantée? Enfin que cette même force lui soit moins connue que celles dont il a d'abord fait usage, c'est encore une chose qu'il n'est guère possible de mettre en doute : quand un agriculteur expérimenté applique [II-317] mécaniquement à la terre le fer de sa charrue, il sait parfaitement l'effet qu'il va produire ; quand il mêle à cinquante-sept parties d'argile sableuse trente-trois parties d'argile fine, sept parties quatre dixièmes de sable siliceux ou fragmens de quartz, une partie de carbonate de chaux en pierrailles, six dixièmes de carbonate de chaux en poussière, cinq dixièmes de débris ligneux et cinq dixièmes d'humus et de substances solubles à l'eau froide, il sait qu'il va produire cent parties de cette terre franche que les jardiniers regardent comme la plus propre à la végétation, et qu'un chimiste a désignée par le nom de terre normale [131] ; mais lorsqu'il met une graine ou une plante en contact avec cette terre, mais lorsqu'il accouple des animaux, mais lorsqu'il greffe sur un arbre le bois qu'il a pris sur un autre, il est loin de savoir aussi bien l'effet qui va suivre ; il ne sait pas même positivement si son action aura quelque effet; il en attend un sans doute ; mais sans être sûr qu'il aura lieu, et sans savoir de quelle nature il sera.
Aussi, loin de prétendre que l'entrepreneur agricole est plus producteur que l'entrepreneur manufacturier, serais-je fort tenté de dire qu'il l'est moins, et que le produit qui sort de ses mains [II-318] n'est pas aussi complètement son ouvrage. Sans doute les produits de l'agriculture, comme tous les produits possibles, ne naissent, ne se multiplient, ne se perfectionnent que par le fait de l'homme; mais ils ne sont pas l'œuvre de ses mains au même degré que ceux de la fabrication. Un agriculteur ne dit pas c'est moi qui ai fait ces fruits, ces fleurs, ce blé, ces arbres, ces bestiaux, comme un fabricant a coutume de dire c'est moi qui ai fait cet outil, ce meuble, cet alun, ces couperoses. C'est qu'en effet l'agriculteur n'a pas fait ses produits au même point que le fabricant a fait les siens; il ne les a pas, comme lui, construits, composés de toutes pièces; il s'est contenté, pour ainsi dire, de solliciter une puissance occulte, qui a opéré la transformation. Il est vrai qu'il a mis en jeu cette puissance, qu'il l'a excitée et favorisée de son mieux ; mais il est loin d'en avoir disposé aussi pleinement que le fabricant de ses agens chimiques et mécaniques; il n'a pas pu, comme celui-ci, se diriger par des principes fixes de théorie ; il a été obligé de s'en tenir aux conseils de la pratique, et de ne se conduire que par des tâtonnemens. C'est surtout cette différence dans la nature des forces qu'emploient l'agriculteur et le manufacturier, et dans le degré de connaissance avec lequel ils en font usage, qui en met une immense dans leur art.
L'un de nos agronomes, à la fois les plus [II-319] recommandables comme savans et les plus habiles comme praticiens, M. de Dombasle, dans l'examen critique qu'il a fait de la Chimie agricole de Davy, confesse ingénuement qu'il y a ici une force dont il n'est pas encore donné à la science d'expliquer les effets, et qui modifie essentiellement les lois ordinaires de la matière; que vouloir raisonner comme si cette force n'existait pas, et considérer les phénomènes de la vie organique comme de simples faits de physique ou de chimie, ce serait s'exposer à tomber dans les plus graves méprises; qu'une telle erreur ressemblerait à celle où s'était laissée aller la médecine lorsqu'elle a cru pouvoir expliquer les phénomènes que divers agens produisent dans le corps humain, sans tenir compte de la vie, qu'elle ne comprenait pas, et en raisonnant comme elle le faisait relativement à la matière inerte ; que les faits étaient venus de toutes parts accuser une théorie qui avait été formée sans eux, et qu'il avait fallu renvoyer la science à l'étude ; que les faits accuseraient de même toute théorie agricole où l'on voudrait raisonner sur l'agriculture sans tenir compte du rôle que la vie joue dans cet art, et en se conduisant d'après les lois ordinaires de la chimie ou de la physique ; que la connaissance de ces lois, séparée de l'observation des phénomènes vitaux, ne serait ici qu'une source d'erreurs ; qu'elle avait fait faire à M. Davy une [II-320] estimation très-peu exacte de la propriété plus ou moins nutritive d'un certain nombre de substances végétales ; qu'elle ne lui avait fourni aucun bon moyen de reconnaître le degré de fertilité relative des divers terrains; que, relativement aux engrais, elle ne lui avait pareillement appris que peu de chose; qu'en somme elle l'avait entraîné dans un bon nombre d'erreurs de pratique, et qu'elle lui avait fait faire un livre non-seulement peu utile, mais même dangereux.
Ainsi, bien que l'industrie agricole n'ait pas plus qu'une autre le pouvoir de faire quelque chose de rien, bien qu'elle ne soit pas plus créatrice qu'une autre, bien que sa vertu, comme celle de l'industrie manufacturière, se borne à opérer des transformations, elle a une manière si particulière de classer ses agens, elle emploie des forces d'une nature si spéciale et crée des produits si différens des produits faits à la main, qu'il paraît impossible, encore une fois, de ne pas considérer ses établissemens à part des manufactures ordinaires.
§ 2. Si cette industrie diffère des arts dont j'ai déjà parlé par sa nature, elle n'en diffère pas moins par ses effets. Cette différence de ses effets tient à la différence même de sa nature. L'agriculture joue dans l'économie sociale un autre rôle que la fabrication, parce qu'elle y crée des produits d'un autre [II-321] ordre, et que ses agens y sont autrement influencés par la position où leur art les place, et par la nature des forces qu'ils emploient.
On a vu, dans les chapitres qui précèdent, de quelle manière la fabrication et le voiturage concourent au libre exercice de tous les arts. L'agriculture n'intervient pas dans leurs travaux d'une manière moins essentielle. C'est elle, même dans le sens restreint où je l'envisage, qui leur fournit la plupart des matériaux sur lesquels s'exerce leur action. C'est elle qui livre au commerce cette innombrable quantité de substances végétales et animales, ces bois, ces cotons, ces laines, ces chanvres, ces lins, ces huiles, ces peaux écrues qu'il voiture de tous les points du monde dans les ateliers de l'industrie manufacturière, et sans lesquels elle se trouverait à peu près réduite à l'inaction. C'est elle aussi qui pourvoit les autres arts et ses propres agens des moteurs animés dont ils font usage; des chevaux que le voiturier attèle à ses voitures ou le laboureur à sa charrue; de ceux que le fabricant emploie pour mettre en mouvement ses mécaniques, lorsqu'il ne peut employer de meilleurs moteurs; de tous les animaux dont l'homme se sert pour opérer des transports ou pour effectuer quelque autre genre d'ouvrage.
On a vu que, dans le temps où la fabrication et le voiturage fournissent des moyens d'action à tous [II-322] les travaux, ils livrent à tous les travailleurs d'utiles moyens d'agir sur eux-mêmes, et de pourvoir à leur conservation. L'agriculture ne demeure pas plus étrangère que les autres arts à cette seconde classe de bons offices. Tandis qu'elle procure à une multitude d'industries les matériaux sur lesquels leur travail s'opère, et une partie des forces motrices au moyen desquelles il s'effectue, elle livre à ceux qui l'exécutent, et en général à toutes les classes de la société, les substances alimentaires sans lesquelles nul ne pourrait subsister.
Que l'agriculture remplisse un rôle très-important dans l'économie sociale; que, sans elle, le corps social ne pût faire ses fonctions; que la plupart. des arts fussent réduits à l'impuissance d'agir, et les hommes qui les exercent à l'impossibilité de vivre, ce sont là de ces vérités que l'on ne saurait contester. Et, néanmoins, je ne sais s'il y a plus lieu à dire de l'art agricole que de tout autre qu'il est le premier et le plus nécessaire des arts. Si les hommes ont besoin d'être nourris, ils n'ont guère moins besoin d'être logés, vêtus, instruits, façonnés. Si la fabrication ne peut se passer des matériaux que lui fournit l'agriculture, l'agriculture ne peut pas se passer davantage des ustensiles, des meubles, des outils que lui fournit la fabrication, Si le voiturage a besoin que l'agriculture le pourvoie de bêtes de trait ou de somme, l'agriculture [II-323] a besoin que le voiturage exécute pour elle une multitude de transports. S'il n'est pas de classe de travailleurs' à qui l'industrie agricole ne procure des alimens, il n'en est point dont elle ne reçoive quelque genre de services; elle a besoin des autres industries, de même que les autres ont besoin d'elle; et, comme je l'ai déjà observé, il n'y a point d'ordre hiérarchique à établir parmi des arts qui se prêtent un mutuel appui, qui ne peuvent se passer les uns des autres, et qui tous ensemble n'ont qu'un seul et même objet, la conservation et le perfectionnement de l'espèce humaine.
Si l'on ne peut dire de l'agriculture qu'elle est le premier des arts, encore moins peut-on prétendre qu'elle est celui qui exerce sur ses agens l'influence la plus salutaire. Il y a, si je ne me trompe, beaucoup d'exagération dans les effets qu'on est convenu de lui attribuer sous ce rapport. A juger de ces effets par les phrases banales de ses apologistes, il n'y aurait pas d'art plus propre à faire des hommes sains, robustes, intelligens, moraux, sociables, etc. Que ne dit-on pas à la ville de la bonne santé des gens de la campagne? Combien de fois n'a-t-on pas remarqué que les ouvriers des villes étaient exposés à des écarts de conduite dont ceux de la campagne étaient préservés par leur situation? Smith ne doute pas que l'art agricole ne soit plus favorable [II-324] au développement de l'esprit que l'industrie manufacturière, et que l'ouvrier des champs n'ait l'intelligence plus ouverte et plus exercée que celui des villes et des fabriques. Il ne doute pas non plus que les agens de l'agriculture n'aient de meilleures habitudes civiles que ceux de la fabrication :
« Non-seulement, dit-il, il n'a jamais existé de corps de métiers parmi les gens de la campagne, mais l'esprit de corporation ne s'est pas même manifesté chez eux [132] . »
J'ai quelque peine à convenir de tous ces bons effets qu'on veut attribuer à l'industrie agricole. Loin de la considérer comme la plus propre à hâter notre développement, je serais tenté de croire au contraire qu'elle est de toutes la moins favorable aux progrès des hommes, et je n'en voudrais pour preuve que l'état même de cet art, qui, de tous ceux qui agissent sur les choses, est incontestablement le moins avancé.
On veut que l'industrie agricole soit particulièrement favorable à la santé des hommes, parce qu'elle fait travailler ses agens en plein air. Cela pourrait être vrai si les hommes vivaient de l'air qu'ils respirent, quoique les voituriers, les matelots et d'autres industrieux ne soient pas moins exposés que les laboureurs aux influences atmosphériques, [II-325] et qu'il y ait peu d'industrieux dont on puisse dire que les agens dépérissent et se meurent faute d'exercice ou faute d'air. Mais, comme ce qui décide surtout de la santé, de la force, de la longévité des diverses classes de travailleurs, c'est le degré de bien-être dont elles jouissent [133] , je ne sais si les ouvriers des champs n'ont pas encore moins de sujet de se bien porter que ceux de la ville. Il me semble, du moins, qu'ils sont encore plus mal nourris, plus mal vêtus, plus mal logés, que les lieux qu'ils habitent sont plus mal tenus, et que l'ensemble de leur régime est moins sain et moins confortable encore que celui des artisans.
Je ne veux pas nier que la pratique de l'agriculture ne soit propre à exercer l'esprit, et qu'elle ne fournisse à ceux qui s'y livrent l'occasion d'observer beaucoup de phénomènes ; cependant de ce que la besogne d'un artisan est quelquefois plus circonscrite que celle d'un cultivateur, il n'en faudrait pas conclure que son intelligence est moins ouverte et moins développée. L'ouvrier d'une fabrique ne fait qu'une seule chose; mais il voit comment celle-là se lie à beaucoup d'autres, et son esprit s'étend ordinairement à tout un ordre de faits entre lesquels il existe bien plus d'enchaînement et d'ensemble qu'il n'y en a dans les opérations de l'agriculteur.
[II-326]
Ce que l'on dit de l'innocence des mœurs rustiques n'est guère bon que pour le théâtre et les romans. Quand on veut voir les choses comme elles sont, on est obligé de reconnaître que les mœurs des campagnards sont plus grossières que celles des citadins sans être pour cela plus pures. Et quant à l'éloignement des classes agricoles pour tout esprit du monopole et d'usurpation, il n'y a qu'à les placer dans des circonstances où cet esprit se puisse manifester pour voir si elles en sont plus exemptes que les classes manufacturières.
Il y a dans l'agriculture une chose qui doit mettre le plus grand obstacle aux progrès de ses agens : c'est l'état d'isolement où elle les force de vivre. Sans doute, dans cet état, leurs mauvais penchans semblent devoir être moins excités; mais leurs bonnes passions doivent l'être beaucoup moins aussi ; leurs facultés de toute espèce doivent demeurer plus inertes; ils doivent avoir moins d'émulation, moins d'activité, moins de penchant à l'imitation, et aussi moins de facilités pour observer et faire ce que font les autres : il est impossible que leur industrie ne demeure pas en arrière de celle des villes; leurs moeurs doivent être aussi plus lentes à se polir, leurs relations à se perfectionner; ils doivent avoir moins d'expérience de la vie civile; ils n'ont pas pu aussi bien apprendre à sentir et à agir collectivement: il résulte, il est vrai, de la qu'ils [II-327] ne se sont pas livrés d'aussi bonne heure que les manufacturiers à l'esprit d'accaparement et de monopole ; mais s'ils sont demeurés plus long-temps étrangers à cet esprit, ils en sont aussi moins corrigés, et il est aisé de reconnaître qu'à cet égard comme à beaucoup d'autres, ils sont en arrière des classes qui se sont trouvées dans des situations plus favorables à leur avancement.
Je conviens, par exemple, qu'à l'époque où il existait des corps de métiers on n'a pas vu de cultivateurs élever la prétention de se livrer seuls à de certains genres de culture. On n'en a pas vu non plus s'opposer à l'introduction d'une culture nouvelle pour le profit de celle à laquelle ils se livraient: il n'y a pas eu de réclamations pour les navets contre les pommes-de-terre, pour l'olivier contre le colza, pour le prés naturels contre les prairies artificielles, pour les moutons de Berri contre les moutons mérinos : il a manqué aux cultivateurs, pour se montrer aussi iniques que les fabricans, de se trouver dans une situation où ils pussent former aussi commodément les mêmes entreprises ; mais aujourd'hui qu'il existe des corps politiques où ils peuvent figurer comme toutes les professions, il n'y a qu'à former une assemblée législative de cette classe de personnes dont les revenus consistent surtout en denrées agricoles, et l'on verra si cette classe se montrera plus accessible que les autres aux idées [II-328] et aux sentimens libéraux, moins ennemie de la liberté du commerce, moins ardente à repousser la concurrence étrangère et à s'assurer le monopole du marché national.
Si les agens de l'agriculture souffrent de l'isolement où leur art les place, ils sont loin d'être heureusement influencés par la nature des forces qu'ils emploient. Ces forces sont telles qu'elles échappent presque entièrement à leur direction. Nous avons déjà remarqué combien la vie, qui est celle dont ils font principalement usage, leur est imparfaitement connue, et combien, dans l'usage qu'ils en font, ils procèdent souvent à l'aveugle. D'autres agens naturels, tels que la chaleur, le froid, la sécheresse, l'humidité, dont le concours peut leur être extrêmement utile ou contraire, sont encore moins à leur disposition. Ils ne gouvernent donc que très-incomplètement les causes sous l'influence desquelles leurs produits se développent, et ils se trouvent, par cela même qu'ils sont beaucoup moins dominés par les idées de causalité que les fabricans, qui disposent pour ainsi dire de toutes leurs circonstances, qui connaissent beaucoup mieux la nature des forces dont ils se servent, et qui sont infiniment plus maîtres d'en régler l'emploi et d'en déterminer les effets.
Aussi, tandis que le fabricant ne cherche à assurer le succès de ses travaux qu'en perfectionnant ses [II-329] procédés et en visant à faire un usage toujours plus éclairé des agens qu'il met en œuvre , verra-t-on souvent l'agriculteur employer pour réussir des procédés absolument étrangers à l’art, croire à l'influence des astres, les consulter avant d'entreprendre de certaines opérations, avoir égard aux diverses phases de la lune, demander au prêtre de bénir ses bestiaux et ses champs, faire sonner les cloches pour la conservation des biens de la terre, faire dire des messes pour obtenir du soleil ou de la pluie, se rendre processionnellement dans les champs avec la croix et la bannière. Je n'ai pas besoin de dire que tous ces actes sont autant de marques de l'imperfection de son art et de la tendance qu'il a à lui faire chercher ses succès dans des moyens étrangers à l'art même. Quelque religieux que puisse être le chef d'une filature, on ne le verra pas invoquer le ciel et faire dire des messes pour obtenir que ses bobines tournent bien et que sa pompe à feu exécute ses fonctions avec précision et avec force. Il sait que l'action de ses moteurs et de ses machines dépend du degré d'intelligence avec lequel on les a construits, et il s'appliquera purement et simplement à les bien construire. Il n'y a que les industrieux qui, comme l'agriculteur, emploient des forces occultes et ont besoin de l'intervention d'agens sur lesquels ils ne peuvent rien, qui aient l'idée de recourir à des pratiques superstitieuses, et qui [II-330] cherchent à assurer leurs succès par ces pratiques, faute de pouvoir les garantir suffisamment par leurs travaux.
§ 3. Si l'industrie agricole diffère des autres par le rôle qu'elle joue dans la société en général, et par l'influence qu'elle exerce sur ses propres agens en particulier, elle n'en diffère pas moins par la manière dont s'appliquent à ses travaux les élémens de force sur lesquels se fonde la liberté du travail. Nul doute qu'ici comme partout la puissance des travailleurs ne soit formée d'un double fonds de facultés personnel. les et d'objets réels; que la partie de leur puissance qui naît de leurs facultés, ne dépende de leur talent pour les affaires, de leur habileté comme artistes', des progrès qu'ont faits, relativement à leur art, leurs habitudes privées et la morale sociale; que celle qui a son fondement dans les objets réels dont ils disposent ne résulte de tout ce qui peut rendre ces objets plus propres au genre de service qu'ils en doivent tirer, c'est-à-dire de la situation de l'atelier agricole, de ses bonnes dimensions, de la manière dont il est monté, de la perfection des instrumens dont il est pourvu, etc. ; qu'enfin leur liberté ne soit d'autant plus étendue que la somme de tous ces moyens a pris un accroissement plus considérable. Mais, encore un coup, il y a une différence assez grande entre la manière dont ces [II-331] moyens peuvent figurer ici et le rôle qu'ils jouent dans l'industrie manufacturière.
Et d'abord, pour parler de ceux de ces élémens de liberté qui consistent en facultés personnelles, et pour commencer par celles de ces facultés que je place toujours au premier rang, il y a, ce semble, des raisons pour que le talent des affaires se développe ici avec plus de difficulté que dans les fabriques ordinaires. Les spéculations agricoles, indépendamment des difficultés qu'elles ont en commun avec les spéculations de tout genre, en offrent de particulières qui tiennent à la nature de l'instrument dont se servent les agriculteurs.
Il y a des terrains dont les propriétés relativement à l'agriculture sont tellement bornées, qu'on ne peut les employer qu'à produire de certaines récoltes, quelque besoin qu'on eût d'en obtenir d'autres, et sur lesquels il n'y a pour ainsi dire point à spéculer.
Il n'y en a pas dont la fécondité ne soit limitée. à un certain nombre de produits agricoles, et sur lesquels la spéculation ne soit obligée de se renfermer dans des bornes plus ou moins resserrées.
Sur tous les terrains possibles, rien n'est moins facile à déterminer que l'usage qu'il est le plus utile: de faire d'une certaine étendue de fonds.
« Il ne suffit pas, observe M. de Dombasle, de connaître une ferme en masse, il faut avoir étudié pendant [II-332] long-temps et tous les jours chacun des champs qui la composent, les avoir observés dans toutes les saisons de l'année, dans toutes les circonstances de sécheresse et d'humidité et couverts de plusieurs espèces de récoltes; il faut avoir arrêté son attention sur cent autres circonstances, qui ne peuvent être connues que par des observations de chaque instant, pour déterminer les améliorations que l'agriculture peut y recevoir, les espèces de récoltes qu'on y peut cultiver avec profit, les assolemens qu'on doit adopter, les époques auxquelles doivent être faits les labours, la profondeur relative qu'on doit donner à chacun, les instrumens qu'on doit employer, etc., etc. [134] .»
Enfin, indépendamment de la difficulté de reconnaître le meilleur parti à tirer de chaque nature de terrain, il y a telle destination donnée à la terre qui l'enchaîne pour un certain nombre d'années, et qui, une fois décidée, ne permet pour ainsi dire plus de spéculer sur elle. Un cultivateur provençal spécule bien sans doute au moment où il se décide à planter son terrain en mûriers, en vigne, en oliviers; mais il est clair que lorsqu'il a fait cette spéculation, il n'a plus faculté d'en faire une différente l'année d'ensuite, et que la vigne, les mûriers, les oliviers une fois plantés, la culture se trouve [II-333] immobilisée pour un temps plus ou moins long. Il s'écoulera en effet assez de temps avant qu'il sache si sa spéculation est bonne, avant que son champ soit en plein rapport; et s'il s'aperçoit alors que ce genre de culture lui est peu profitable, il hésitera encore beaucoup à donner une nouvelle destination à sa terre, puisqu'il ne le pourra qu'en sacrifiant des plantations qui auront été très-longues à venir et qui lui auront coûté fort cher.
Ainsi la difficulté de bien spéculer, qui est très-grande dans toutes les industries, se complique encore ici de difficultés particulières, qui tiennent à la nature de l'art agricole et à celle du principal instrument dont il se sert.
Aussi n'est-il peut-être pas d'ordre de travaux où le talent de la spéculation ait moins fait de progrès que dans l'agriculture. A vrai dire même il n'y a pas en général de speculation dans cette industrie. Il est une multitude de pays où les cultivateurs se livrent de temps immémorial au même genre d'opérations, et font venir perpétuellement les mêmes récoltes sans examiner le moins du monde s'il n'y aurait pas d'utiles changemens à introduire dans le choix des produits qu'ils créent. Bien plus, ils voudraient varier leurs produits, et se livrer à l'esprit de spéculation, qu'ils ne le pourraient pas avec l'ancien système de culture auquel le sol reste soumis, système inflexible où tout est déterminé d'avance, [II-334] et où il n'y a place que pour la culture de quelques céréales et l'éducation d'un petit nombre de bestiaux. Toute l'habileté des cultivateurs consiste à faire ponctuellement ce que faisaient leurs devanciers, et toute leur énergie à tâcher d'obtenir, par les procédés accoutumés, le plus possible d'un petit nombre de denrées agricoles d'autant plus difficiles à placer que la production en est plus chère et que d'ailleurs elles sont moins variées.
Aussi ne peut-on pas douter que l'état d'avilissement où sont tombés les produits de l'agriculture ne vienne surtout de ce qu'on ne spécule pas assez dans cet art, de ce qu'on n'y cherche pas assez à faire des affaires, et par suite de ce qu'on ne s'y évertue pas autant qu'il le faudrait à varier les produits, à les mettre en rapport avec la nature et l'étendue des besoins, et principalement à diminuer ses frais de production en perfectionnant les procédés de la culture.
Comment être surpris, par exemple, de l'état de souffrance où se trouvent si fréquemment les producteurs de grains quand on songe au caractère d’universalité qu'a reçu la culture des céréales, à l'effet des années d'abondance sur une denrée déjà si commune, à la difficulté de la conserver, à celle de la transporter des lieux où elle abonde à ceux où elle manque, à toutes les causes qui concourent à en avilir le prix; et quand on considère d'une autre [II-335] part l'état d'imperfection grossière où est resté l'art qui la crée, et l'obligation où l'on se trouve de la vendre cher pour ne pas perdre?
Comment être surpris de la détresse de nos pays de vignoble quand on pense à l'extension irréfléchie que nous avons donnée à la culture de la vigne, quand on songe à l'abondance des dernières années, et quand on rapproche de ces deux causes d'avilissement du prix des vins les frais d'une culture naturellement dispendieuse, ou que du moins on n'a pas encore eu l'art de rendre économique, et qui demanderait en conséquence que les vins se soutinssent à un bon prix ? M. Chaptal, dans son livre sur l'Industrie française, publié en 1819, ne croit pas se tromper en disant qu'en France, depuis trente ans, la culture de la vigne s'est accrue d'un quart [135] . Depuis l'époque où il a écrit, cette culture a continué à s'étendre, et dans une progression peut-être plus rapide. Il est à ma connaissance que dans plusieurs de nos départemens méridionaux, notamment dans ceux du Gard, de l'Hérault et de l'Aude, faisant partie de l'ancien Bas-Languedoc, elle a envahi des espaces considérables; qu'elle est descendue des coteaux dans les plaines, et s'est établie dans les meilleures terres à blé. Ajoutez que dans le cours des-sept ou huit années qui ont précédé celle où [II-336] j'imprime ceci ( 1829), la nature a eu l'air de s'entendre avec les cultivateurs pour multiplier et avilir les produits de la vigne, et vous comprendrez aisément comment il se fait que les pays vinicoles souffrent; surtout si vous considérez que dans le temps où les producteurs de vin ont fait tomber le prix de leur denrée en la multipliant sans mesure, ils n'ont introduit dans la culture de la vigne aucun perfectionnement propre à diminuer leurs frais de production. Il ne suit pas de là sans doute qu'ils ont tort de se plaindre de l'impôt sur les boissons et de la législation des douanes; mais si les obstacles très-réels et très-graves que ces deux causes mettent à l'écoulement de leurs produits ont pour effet de prolonger leur état de détresse, on ne peut pas dire qu'ils l'ont fait naître, au moins entièrement; et il est sûr que le mal qu'ils éprouvent doit être attribué, en bonne partie, au peu de réflexion avec lequel a été étendue la culture de la vigne, surtout quand les frais de cette culture demeuraient les mêmes.
Si donc il n'est pas d'art où l'on spécule moins que dans l'agriculture, il n'en est pas non plus où l'on eût plus besoin de spéculer; car il n'en est pas où l'on fasse moins bien ses affaires, et où, par cela même, on eût plus besoin de s'aviser et de s'évertuer pour tâcher de les faire mieux.
J'ajoute qu'il n'en est pas où la spéculation dût [II-337] être plus fructueuse, puisqu'il n'en est pas où elle ait été moins poussée. Précisément parce que cette industrie est très en retard, il semble qu'il doit y avoir plus à faire que dans les autres, et que l'agriculteur qui voudrait l'exercer d'après de meilleures méthodes, surtout dans les pays où elle est le moins avancée, aurait plus de chances d'y faire des profits qu'on n'en a dans d'autres branches d'industrie où une concurrence très-étendue et très-active a fait prendre de très-grands développemens aux pouvoirs du travail.
Sans doute on ne parviendrait jamais à y faire des bénéfices bien considérables, parce que l'étendue de terre qu'un homme peut faire valoir est nécessairement limitée. Mais s'il est établi que l'agriculteur le plus habile ne peut pas exploiter convenablement au-delà de quelques centaines d'arpens, on ne sait pas encore quelles valeurs il est possible d'accumuler avec profit sur cette étendue de terre, quelle puissance de production il est possible d'y développer, et par conséquent quels profits il est possible d'y faire. Tandis qu'en France, dans les pays encore soumis à l'assolement triennal, un fermier se charge d'une ferme avec quelques chevaux, quelques chariots, quelques charrues et une certaine quantité de semences, un cultivateur en Angleterre ne se livre pas à une entreprise de ce genre [II-338] sans un capital égal à huit fois la rente de la terre [136] . Tandis qu'en France, suivant M. de Laborde, l’arpent de terre ne rapporte moyennement que 15 francs, il rapporte 37 fr. 50 en Angleterre [137] . M. de Dombasle estime qu'en France l'agriculture pourrait aisément, par l'adoption de meilleures méthodes, produire des substances suffisantes pour une population triple de celle que le sol nourrit [138] . M. Cordier a vu dans le département du Nord des terrains de même nature, dont les uns, encore en fôrets, ne donnaient annuellement que 10 francs par hectare, tandis que les autres, livrés à une culture très-perfectionnée, produisaient, par an, jusqu'à 3,200 francs [139] , On voit qu'il y a de la distance entre les pouvoirs qu'il est possible de déployer et les profits qu'il est possible de faire sur un même terrain, et que l'esprit de spéculation ne laisse pas d'avoir ici un champ encore assez vaste.
Déjà, ce serait une fort grande spéculation que d'essayer de substituer, partout où la chose serait [II-339] possible, le système de culture alterne à l'ancien mode d'assolement; et cette speculation, qui ne pourrait manquer d'être fructueuse, là où elle serait faite avec prudence et habileté, en rendrait praticables beaucoup d'autres. Non-seulement, en effet, le système de culture alterne est infiniment plus productif que l'assolement triennal, mais la spéculation y est beaucoup plus facile, parce que les produits y sont beaucoup plus variés, et qu'il se plie incomparablement mieux aux besoins d'une population nombreuse et déjà avancée dans les arts.
Ainsi, bien que le talent de spéculer paraisse avoir plus de peine à se développer dans l'industrie agricole que dans les autres, et qu'il y ait fait infiniment moins de progrès, il y serait indispensable comme dans toutes, et comme dans toutes il pourrait y porter sur la nature des produits à créer, sur les quantités à produire et sur le choix des procédés à employer pour obtenir les produits.
Comme le talent de la spéculation, la capacité administrative est ici d'une acquisition plus difficile, et elle n'y est pas d'un emploi moins nécessaire.
Les exploitations agricoles paraissent être par leur nature d'une gestion beaucoup moins simple et moins aisée que les établissemens manufacturiers: les travailleurs y étant moins ramassés, la surveillance y est moins facile ; les travaux y étant moins uniformes, l'impulsion a besoin d'y être plus variée; [II-340] enfin les accidens de température et les changemens de temps viennent compliquer encore la gestion en introduisant un nouvel ordre de difficultés dans la conduite des travaux, en obligeant d'accélérer les uns, d'ajourner ou de ralentir les autres, et en causant quelquefois dans la fabrique agricole de soudaines et de générales perturbations. Ainsi point de doute que la conduite de cette sorte de manufactures ne soit moins aisée que celle des fabriques ordinaires, où les travailleurs, réunis dans un même bâtiment, et pouvant être beaucoup plus facilement inspectés, n'exécutent ordinairement qu'une seule sorte de travaux, et des travaux dont les changemens de saison et les variations de l'atmosphère ne dérangent jamais le cours.
Point de doute, non plus, qu’une bonne administration ne soit ici autant et plus nécessaire que dans tout autre genre d'entreprises. Elle y semble plus nécessaire par cela même qu'elle y est plus difficile de pareils établissemens sont plus loin de marcher tout seuls. M.de Dombasle observe que de toutes les dispositions de l'agriculteur, celle qui contribue à ses succès de la manière la plus décisive, c'est la tournure de caractère qui le porte à maintenir avec fermeté l'ordre dans la gestion de son établissement. Lorsque dans l'agriculture ordinaire, dit-il, où il n'y a pour ainsi dire point d'administration, on regarde de près aux détails, on voit avec [II-341] étonnement quelle perte de temps et quelle imperfection dans les travaux sont le résultat du désordre qui règne parmi les employés — Pour peu qu'une ferme ait d'étendue, il est impossible que le fermier exécute de sa main tous les travaux, et du moment qu'il est obligé d'employer des bras étrangers, ses succès et sa fortune dépendent, en grande partie, du degré d'habileté avec lequel il manie ces forces étrangères.-— Dans toute exploitation rurale un peu considérable, il y a nécessité de confier chaque branche de son affaire à un homme chargé d'en surveiller tous les détails. M. de Dombasle a à Roville un chef d'attelages, un chef de main-d'œuvre, un irrigateur, un berger, un marcaire, un commis pour la comptabilité, le tout indépendamment d'un certain nombre d'aides et des ouvriers payés à la journée. Chaque soir, à une heure fixe, tous ces chefs de service se réunissent auprès du maître, lui rendent compte des travaux du jour et reçoivent des ordres pour le lendemain. Ce petit état-major correspond à celui qu'il est d'usage d'avoir dans les fabriques, et le rôle qu'il remplit n'est pas moins essentiel. M. de Dombasle assure que sans les chefs d'atelier et les contre-maîtres qu'il emploie, il n'est pas de mois où il ne perdit beaucoup plus par le mauvais emploi du temps qu'il ne perd par ce que ces employés lui coûtent. — Si le chef d'une vaste exploitation rurale voulait se mettre à diriger [II-342] lui-même les diverses branches de travail, il ne pourrait être à une sans négliger en même temps les autres, et il serait sujet à faire des pertes sur toutes. Son premier besoin est d'avoir un second auprès de chacune, et la bonté de son administration dépend d'abord du plus ou moins d'habileté avec lequel il partage les détails de sa tâche entre ses subordonnés. Elle dépend ensuite de la manière dont il les gouverne, du plus ou moins d'art qu'il met à les intéresser à son affaire et à tirer parti de leurs facultés. Elle dépend enfin du degré d'attention et de jugement qu'il apporte à toutes ses dépenses, c'est-à-dire aux frais spéciaux de chaque culture, et surtout à ces frais généraux qui ne sont faits pour aucune récolte en particulier, mais que l'ensemble de l'exploitation nécessite, et qui, dans toutes espèces d'entreprises, sont ceux sur lesquels il est le plus essentiel de veiller. On trouve sur ces diverses conditions d'une bonne administration, et sur l'influence qu'elle exerce, les détails les plus instructifs dans les Annales agricoles de Roville [140] .
Si l'entrepreneur agricole ne peut se passer de talens administratifs, il ne saurait se passer davantage de l'espèce d'habileté qui est nécessaire pour bien tenir ses comptes. On sait qu'il n'est pas de système de culture absolument bon. Telle manière de faire [II-343] valoir ses terres, qui est excellente dans telle situation donnée, pourrait fort bien être vicieuse dans des circonstances différentes. Tel instrument coûteux d'agriculture qu'il peut y avoir de l'économie à employer dans une grande exploitation, serait d'un usage onéreux dans une petite ferme où il n'aurait pas assez d'ouvrage à faire pour payer l'intérêt de son prix d'achat. Tel perfectionnement propre à accroître sensiblement les produits sans augmenter considérablement les frais, et qu'il est sage d'adopter là où la production est au-dessous de la demande, ne serait pas bon à introduire là où l'on récolte déjà plus de produits qu'il n'est possible d'en débiter. La bonté d'un système de culture dépend donc en grande partie de la situation où l'on se trouve. Le meilleur, pour chaque cultivateur, est celui qui, dans sa position particulière, lai permet de tirer de sa terre le produit net le plus étendu. Or, comment un cultivateur reconnaîtra-t-il celui qu'il lui convient d'adopter, s'il ne tient pas de comptes en règle? Doit-il cultiver des céréales ou élever des beștiaux? faut-il qu'il élève des bêtes à laine ou des bêtes à graisse ? Lui convient-il de convertir son lait en beurre, ou lui vaut-il mieux le transformer en fromage? Quelle est l'espèce de produits qu'il doit chercher à obtenir? Quelle est la quantité qu'il en doit faire? Quels sont les procédés, les moteurs, les instrumens qu'il doit préférablement [II-344] adopter? A ces questions et à beaucoup d'autres, il n'y a qu'une exacte comptabilité qui puisse fournir des réponses satisfaisantes. A l'aide de comptes en partie double bien tenus, un agriculteur voit à chaque instant ce que coûte et ce que rapporte chaque branche de son exploitation; il peut juger quelle est celle qui donne du profit, celle qui présente de la perte, et par conséquent celle qu'il lui importe de corriger ou de changer. Il tend ainsi continuellement à perfectionner son système de culture, et il travaille avec d'autant plus de courage et d'activité qu'il voit plus clair dans toutes ses opérations, et qu'il peut agir avec plus de confiance.
Une bonne comptabilité n'est donc pas d'un moindre secours dans l'agriculture que dans les autres industries. Et néanmoins il n'est peut-être pas d'art où le genre de talent nécessaire pour tenir des comptes en règle soit moins développé que dans celui-ci. M. Simond, auteur de plusieurs Voyages estimés, avoue qu'il fut fort surpris en Angleterre de voir des fermiers faire banqueroute comme des d'affaires et avoir des livres régulièrement tenus. En France, dit-il, le bilan d'un fermier paraîtrait presque aussi extraordinaire et aussi ridicule que celui d'une marchande de pommes ou d'un ramoneur [141] . Il est sûr qu'en France, et presque partout, rien n'est plus rare encore que [II-345] de voir des fermiers cultiver, comme on dit, en fabrique, et tenir une note exacte de leurs opérations et des résultats de leurs opérations. Il paraîtrait même que cela n'a pas toujours lieu en Angleterre, et que les entrepreneurs de culture sont encore loin dans ce pays d'appliquer à leurs exploitations un système bien exact et bien éclairé de comptabilité. Or, comme les agriculteurs ne sont pas des hommes d'une autre espèce que les commerçans et les manufacturiers, il y a lieu de croire que leur infériorité sur ce point et sur plusieurs autres tient à la nature de leur art, qui paraît moins propre que d'autres à développer dans ses agens les facultés nécessaires à son exercice.
Ainsi, deux choses dans ce paragraphe, paraissent bien établies : la première, c'est que les talens de spéculer, d'administrer, de compter, et toutes les facultés dont se compose le génie des affaires, sont aussi indispensables dans l'industrie agricole que dans les autres; et la seconde, que la nature de cette industrie n'a pas permis que ces moyens de puissance y fissent les mêmes progrès.
§ 4. Même remarque à faire sur les facultés qui se rapportent à l'art. Il est pareillement indubitable que ces facultés y seraient aussi nécessaires, et qu'elles y sont moins perfectionnées.
Cela est vrai surtout de celles de ces facultés qui [II-346] se rapportent à la partie spéculative de l'agriculture; car, quant à ses procédés et à la partie purement technique, les connaissances de ses agens, sans être peut-être aussi développées et surtout aussi généralement développées que celles de plusieurs autres classes d'industrieux, sont pourtant passablement avancées; et si la nature du principal agent qu'ils emploient (la vie), agent dont on ne connaît pas encore les lois générales, n'a pas permis de ramener leur art à des principes fixes de théorie, l'expérience l'a incontestablement enrichi d'un très-grand nombre d'observations propres à éclairer sa marche, et qui ont prodigieusement accru sa liberté.
Combien, par exemple, tout ce qu'il a été recueilli de faits positifs et de bonnes directions de pratique sur les assolemens, les engrais, les irrigations, le choix et le perfectionnement des espèces n'a-t-il pas contribué à faciliter ses travaux et à rendre son action plus puissante et plus libre? ?
Après plusieurs récoltes semblables, la terre se refusait à produire. D'année en année, elle payait avec moins de largesse les soins que lui donnait le laboureur. A force de lui redemander les mêmes produits, on finissait par la rendre complètement stérile. On a remarqué qu'en alternant les cultures, en faisant succéder les améliorans aux épuisans, les récoltes sarclées à celles qui ne reçoivent [II-347] pas de binage, on pouvait non-seulement soutenir, mais encore accroître sa fertilité; on est parvenu ainsi à doubler, à tripler sa puissance productive : n'est-il pas évident que, par cet artifice, le cultivateur a doublé et triplé le pouvoir et la liberté de son art?
C'était peu, pour entretenir l'activité de la terre, que de lui donner chaque année de nouvelles plantes à nourrir; il fallait lui restituer annuellement par des engrais la substance nutritive que lui enlevaient annuellement les récoltes. On a remarqué qu'en faisant consommer une partie de ces récoltes par des bestiaux, on pouvait non-seulement les recouvrer avec bénéfice sous la forme de produits animaux, de lait, de beurre, de laine, de viande grasse, mais encore obtenir des engrais suffisans pour tenir son domaine dans un état permanent et même croissant de fécondité. Par là le sol est devenu en quelque sorte inépuisable, et le cultivateur s'est trouvé avoir vaincu l'un des plus grands obstacles que la nature avait mis à l'exercice de son art : n'est-il pas visible que, par ce moyen, il en a rendu l'exercice infiniment plus libre?
Une eau courante passait sans fruit dans le voisinage d'une exploitation rurale. Le propriétaire, la prenant à son point le plus élevé, a examiné quelle était la partie la plus élevée de son domaine où il pouvait la conduire. Par des irrigations [II-3487] habiles, il l'a fait descendre de la dans les parties inférieures de sa propriété. En même temps, il est resté maître absolu du point où il l'était allé prendre; il s'est ménagé les moyens de l'introduire et de l'évacuer en quelque sorte à commandement; il peut ainsi, à tous les instans, procurer à son terrain le degré d'humidité désirable: peut-on douter que, par ce nouvel art, il ne soit devenu beaucoup plus libre de le féconder? Il dépend peut-être de lui de faire plusieurs récoltes où auparavant il n'en faisait qu'une; de faire croître une herbe touffue où l'on ne voyait qu'un sable aride; il est possible qu'il ait décuplé le pouvoir productif de son terrain, qu'il lui ait donné toute la fertilité qu'il possède.
Combien encore le cultivateur n'a-t-il pas accru son pouvoir par les notions que l'expérience lui a fournies sur les moyens de multiplier, de varier, de perfectionner les espèces d'animaux et de végétaux que l'objet de son art est de produire? Il peut par des semis, par des entes, par des croisemens de races, par une suite de soins intelligens et assidus, obtenir des variétés nouvelles, perfectionner les espèces anciennes, les rendre toutes plus propres aux divers services qu'il en veut tirer. Doutera-t-on qu'un tel pouvoir ne rende son industrie plus libre? N'est-il pas évident qu'à égalité de dépense le cultivateur qui sait faire porter à ses [II-349] troupeaux de la laine superfine, à ses arbres des fruits savoureux, est plus libre que celui qui ne peut tirer de ses troupeaux que de la laine grossière, et de ses arbres que des fruits amers ? N'est-il pas évident que celui qui, pour les mêmes frais, peut élever pour la boucherie des bœufs du poids de mille livres est plus libre que celui qui n'en peut élever que du poids de huit cents? On dit qu'à force de soins et d'intelligence les Anglais, depuis un siècle, sont parvenus à doubler le poids de leurs bêtes à graisse : n'est-ce pas dire que, sous ce rapport, ils ont moitié plus de liberté qu'ils n'en avaient il y a cent ans? On lit dans une histoire curieuse qu'aux quatorzième et quinzième siècles les jardiniers de la banlieue de Paris n'avaient à vendre aux Parisiens que des poires de caillot, de hartiveau, de Saint-Rieul, d'angoisse, toutes connues par leur âcreté; de méchantes pommes rouges, dites blanduriau d'Auvergne; un fruit appelé jorraise, fort aigre, et qui n'est plus en usage; des cormilles, des nèfles, des alises, des prunelles de haie, dès gratte-culs, comme s'exprime l'Académie française, et quelques fruits à peu près aussi savoureux [142] : est-il besoin, pour voir ce que leurs successeurs ont acquis de puissance, de comparer ces fruits à ceux qui couvrent maintenant les marchés de Paris?
[II-350]
Il n'est donc pas douteux que nous n'ayons recueilli sur l'art agricole une masse de notions très-propres à en diriger l'exercice et à le rendre plus fructueux. Mais ces notions, comment les avons-nous acquises? Est-ce théoriquement? Les avons-nous puisées dans la connaissance des lois générales qui gouvernent les phénomènes de la vie animale et végétative? Non; l'agriculteur s'est dirigé sur l'observation de faits partiels, isolés, dont il ignorait les causes, et l'industrie agricole a été, plus qu'aucune autre, un art créé empiriquement.
C'est empiriquement qu'on a découvert dans quel ordre les plantes aimaient à se succéder, et quel était, dans chaque nature de terrain, l'assolement le plus favorable. C'est empiriquement qu'on a appris que l'eau favorisait le travail de la végétation, que telle eau était plus fécondante que telle autre, que le procédé de l'irrigation n'était pas également utile dans tous les terrains, dans tous les temps, à toutes les heures du jour. C'est empiriquement que les Anglais ont obtenu tant de bons types d'animaux et de végétaux; qu'ils ont réussi à créer des espèces si variées et si précieuses de pommes de terre, de carottes, de navets, de turneps; qu'ils ont recueilli jusqu'à deux cents variétés de froment; qu'ils sont parvenus à faire d'excellens chevaux pour la selle, et d'autres trait; des vaches pour le lait, et d'autres pour [II-351] donner des veaux de grosse taille; des moutons à suif, d'autres à laine, d'autres à petits os et à membres charnus; des cochons bas, mais longs et larges, paissant l'herbe des prés comme des moutons, et s'engraissant presque sans dépense; en un mot des bestiaux non-seulement très-appropriés à leurs destinations diverses, mais très-faciles à élever, et pouvant donner souvent, pour les mêmes frais, des profits trois fois plus considérables [143] .
Bakewell et Culley ont opéré leurs prodiges sans connaître les lois générales que la vie observe dans la production des animaux; et les physiologistes qui les ont aidés de leurs lumières auraient eux-mêmes très-probablement été fort embarrassés de ramener à des principes généraux les observations particulières sur lesquelles étaient fondés leurs conseils. Les uns et les autres n'ont réussi à obtenir tant d'utiles perfectionnemens dans les diverses races d'animaux domestiques sur lesquels ils ont agi que par une suite d'expériences, faites sans doute d'après des indications fournies par la nature, d'après des faits observés, mais d'après des faits dont ils ignoraient la cause génératrice, et dont ils auraient eu grand peine à écrire la loi.
On en peut dire autant de la plupart des améliorations qui ont été opérées dans les diverses [II-352] branches de l'art agricole: elles ont été obtenues par les expériences de la pratique bien plus que par les spéculations de la théorie.
Suivant M. de Dombasle, l'analyse chimique ne fournit les moyens de déterminer avec sûreté ni la valeur nutritive des diverses substances végétales qui sont employées à la nourriture des bestiaux, ni celle des divers engrais qui servent à la nourriture des plantes, ni en général les propriétés du sol relativement à l'agriculture et les moyens d'accroître sa fertilité.
De ce qu'on a découvert par l'analyse, dit-il, que telle substance contient tant d'amidon, de mucilage, de sucre, de gluten, d'albumine, on n'en peut pas conclure qu'elle est nutritive à tel ou tel degré; de ce que telle substance reste insoluble lorsque nous la soumettons, dans une capsule, à l'action de l'eau ou de tout autre agent chimique, il ne s'ensuit pas qu'elle se conduira de la même manière quand elle sera soumise à l'action des organes digestifs.
Plusieurs faits, poursuit M. de Dombasle, peuvent faire présumer que certains engrais forment pour les plantes un aliment bien plus nutritif que d'autres; mais l'étendue de cette différence nous est entièrement inconnue; nous manquons de faits pour déterminer, même vaguement, la propriété nutritive de presque tous ces composés.
L'analyse chimique, continue le même agronome, [II-353] en déterminant la nature et les proportions des parties constituantes d'un sol, apprend peu de choses sur ses propriétés relatives à l'agriculture. La physique offre des moyens un peu plus sûrs de juger de sa fécondité. Mais un cultivateur expérimenté, par une observation attentive sur le terrain, en juge beaucoup plus sûrement encore, et l'emploi de ce moyen lui en apprendra plus sur la bonté d'une ferme en une demi-journée, que n'en apprendront au chimiste et au physicien six mois d'expériences faites dans le laboratoire [144] .
Il paraît qu'en général les services que l'agriculture a reçus de la chimie et de la physique sont loin de répondre à ceux qu'elle en avait attendus. Ces sciences, qui ont été si éminemment utiles aux arts qui créent des produits inorganiques, l'ont été bien moins à celui qui se propose d'obtenir des produits végétaux et animaux. Celles qui s'occupent de la structure et des fonctions des corps vivans n'ont pas mieux réussi que celles qui étudient les lois de la matière inerte à rattacher les procédés de l'art agricole à des principes fixes de théorie. Toutes lui ont fourni quelque secours sans doute : M. de Dombasle cite un certain nombre de cas où les recherches analytiques sur la nature du sol peuvent être utiles au cultivateur en lui [II-354] offrant le moyen de reconnaître s'il y a dans son terrain de certains élémens dont la présence exigerait qu'il le soumît à un traitement particulier, Je vois ailleurs que la découverte du système sexuel des plantes par Linnée, qui a permis d'opérer entre elles des croisemens en faisant tomber le pollen qui se détache des organes mâles d'une espèce dans les organes femelles d'une autre, a offert par cela même à l'agriculteur un moyen d'obtenir des variétés importantes et nombreuses. Il est sûrement beaucoup d'autres cas où la science a fourni d'utiles inspirations à l'art. Mais le nombre de ces inspirations est petit en comparaison de celles qu'il a puisées dans ses propres expériences; et.il y a même à ajouter que ce n'est qu'en partant des faits positifs de l'art que les hommes instruits ont pu faire de bonnes applications de la science, et qu'ici comme partout la bonne méthode est d'aller de la pratique à la théorie, et non de la théorie à la pratique.
§ 5. Si, poursuivant le cours de nos observations, nous voulons examiner maintenant comment agissent ici les habitudes morales, nous aurons occasion de remarquer que cet ordre de moyens, de même que les précédens, y est aussi essentiel que dans les autres industries, et tout à la fois qu'il s'y développe avec plus de peine. On observera pourtant [II-355] que la difficulté que les mœurs de l'agriculteur éprouvent à se former tient à une cause différente de celles qui ont été signalées dans les deux derniers paragraphes comme contraires à ses progrès dans ce qui tient à l'art et aux affaires. Ce qui retarde le progrès de ses moeurs, ce n'est ni la nature de l'instrument dont il se sert, ni celle des for. ces spéciales qu'il emploie, c'est l'isolement où son art le force de vivre, circonstance que nous avons déjà présentée plus haut (§ 2) comme mettant obstacle à ses progrès de toute espèce. Au reste, il peut être vrai que la situation des cultivateurs retarde le perfectionnement de leurs moeurs sans qu'il soit moins certain que le perfectionnement de leurs mœurs est indispensable aux succès de l'art qu'ils exercent. Ainsi, par exemple, il n'est pas douteux que la distance où ils sont les uns des autres ne soit peu propre à stimuler leur activité. Il n'est personne qui n'ait remarqué combien les ouvriers de la ville ont leur temps mieux rempli que ceux de la campagne; combien leurs mouvemens sont plus vifs, leurs travaux plus accélérés; combien, dans un temps donné, ils font plus de besogne. Cette différence, dans le degré de diligence et de célérité que déploient ces deux classes de travailleurs, est d'autant plus frappante qu’on passe d'une campagne plus arriérée et plus déserte dans une ville plus populeuse [II-356] et plus avancée. Cependant, de ce que l'ouvrier des champs, qui n'est pas excité comme celui de la ville par la présence d'une population nombreuse et animée au travail, fait ordinairement son ouvrage avec un peu de lenteur et de nonchalance, il ne s'ensuit sûrement pas que l'ardeur et l'activité de la ville ne fussent très-bonnes à introduire dans les travaux de la campagne.
Il est pareillement indubitable que la situation où l'agriculture place ses agens n'est pas faite pour éveiller et entretenir entre eux l'émulation. Elle les éparpille en effet, tandis que la fabrication ramasse, concentre les siens, et en les rapprochant, en les mettant en contact, fait qu'ils rivalisent entre eux et qu'ils s'excitent mutuellement à donner à leur industrie tout le développement, toute la perfection dont elle est susceptible. Mais si l'agriculture est peu favorable à l'émulation, il n'y a pas moyen de douter que l'émulation ne fût très-favorable à l'agriculture, et qu'un des meilleurs moyens de pousser cette industrie ne fût de mettre ses agens en communication, et de leur inspirer le désir de s'imiter, de se surpasser les uns les autres dans tout ce qu'ils font de bien. On sait à quel point les fêtes et réunions agricoles en usage dans. . plusieurs comtés de l'Angleterre y ont favorisé la propagation des bonnes méthodes de culture. Le même usage, récemment introduit dans l'un de [II-357] nos départemens par M. de Dombasle, commence à y produire les effets les plus heureux [145] .
Les personnes qui ont vécu alternativement aux champs et à la ville, parmi des campagnards et des citadins, ont pu remarquer que dans les maisons de la ville les provisions de toute espèce sont ordinairement mieux ménagées, les meubles et les vêtemens mieux tenus, les dépenses mieux réglées, qu'il y règne en général plus d'économie et d'ordre. Et, néanmoins, peut-on dire que l'habitant de la campagne ait moins besoin d'ordre et d'économie que celui de la ville? Ne semble-t-il pas, au contraire, que moins l'art que le cultivateur exerce est propre à l'enrichir, et plus il aurait besoin de mettre à profit toutes ses ressources ?
La campagne n'est pas ordinairement le séjour de l'élégance et du goût. La même cause qui y prévient le développement de l'activité et de plusieurs autres qualités morales empêche aussi qu'on y ressente avec une certaine vivacité ce désir d'être bien, de plaire, d'attirer l'attention, qui est à la ville la source de tant de perfectionnemens, et par suite qu'on y donne beaucoup de soins, non-seulement [II-358] à sa personne, mais à son habitation, à sa ferme ; qu'on y rivalise à qui aura les champs les mieux tenus, les plus propres, les mieux ornés. Et pourtant qui ne sent combien ce sentiment serait fait pour hâter les progrès de l'agriculture ? Qui sait pour combien il est entré dans ceux qu'elle a déjà faits, et pour combien il entrera dans ceux qui lui restent à faire ? N'est-ce pas en bonne partie à ce désir de se distinguer qu'il faut attribuer l'industrie, la méthode, le bon ordre, la propreté recherchée, qui sont si sensibles, dit-on, dans les fermes anglaises [146] ? les magnifiques plantations d'arbres dont les fermiers flamands entourent leurs champs et enveloppent leurs maisons ? les fleurs si recherchées et si variées qu'ils cultivent auprès de leurs demeures [147] ?
Je n'ai pas noté un vice ou une vertu propre à étendre ou à restreindre les pouvoirs du travail en [II-359] général, qui ne manifeste les mêmes effets dans l'agriculture.
Combien, par exemple, ne lui a pas nui le mépris que de certaines classes ont si long-temps affecté pour les professions utiles ? Si ce travers de mœurs a mis de grands obstacles aux progrès de tous les arts, il en a opposé de particuliers à l'industrie agricole. C'est par lui que cette industrie a été si long-temps livrée à la misère, à l'ignorance et à l'apathie. Ce vice a été cause que les détenteurs du sol, au lieu de le faire valoir par eux-mêmes, se sont déchargés du soin de le cultiver d'abord sur des esclaves, puis sur des métayers, puis sur des fermiers, et qu'ainsi la terre s'est trouvée placée presque en tous lieux entre des propriétaires qui n'étaient pas cultivateurs et des cultivateurs qui n'étaient pas propriétaires. Par-là, l'agriculture a été, pour ainsi dire, réduite à l’impossibilité de faire des progrès. Par qui, en effet, aurait-elle pu être avancée? Par les propriétaires ? ils.ne s'en occupaient point. Par les cultivateurs ? outre qu'ils manquaient des ressources et des connaissances nécessaires, ils n'avaient que peu ou point d'intérêt à la perfectionner : esclaves, leur intérêt évident était de travailler le moins possible; métayers, leur intérêt, en tâchant de tirer le plus possible du sol, était de ne pas lui faire sur leurs épargnes des avances qu'ils perdraient [II-360] entièrement s'ils étaient renvoyés, et dont le profit, dans tous les cas, irait par moitié au propriétaire; fermiers, leur intérêt était de ne lui faire que les avances dans lesquelles ils pouvaient se promettre de rentrer avec bénéfice avant l'expiration du bail: Il est vrai qu'en étendant la durée des baux, en rendant la condition des fermiers moins précaire, il était possible de les intéresser à faire de plus grandes améliorations; mais quel système de fermages pouvait les exciter à faire à la terre toutes les améliorations qu'elle était susceptible de recevoir; quel système de fermages pouvait leur inspirer, pour un bien qui devait tôt ou tard leur être retiré, l'intérêt et l'affection du propriétaire ?
Pour se faire une idée du mal que le mépris du travail a fait à l'agriculture en séparant l'intérêt de l'exploitation de celui de la propriété, il n'y a qu'à considérer un peu où en seraient les industries manufacturière et commerciale, si, à l'exemple des possesseurs de terre, les propriétaires de fabriques et de maisons de commerce avaient voulu se décharger sur des fermiers, sur des métayers, sur des esclaves, du soin de faire prospérer leurs établissemens. Il y avait, il est vrai, dans la nature de l'industrie agricole des raisons pour qu'elle ne fît pas les mêmes progrès que la fabrication et le voiturage; mais si cette industrie est restée autant en arrière des deux [II-361] autres, c'est en grande partie par l'effet du vice que je signale; c'est parce que la terre, moins heureuse que les fabriques et les maisons de commerce, a eu généralement pour maîtres des hommes voués d'abord à la guerre, plus tard à l'intrigue, et dans tous les temps à l'oisiveté et à la dissipation, lesquels hommes, en prenant toutes les précautions imaginables pour que jamais elle ne sortît de leurs mains, ont toujours dédaigné de la faire valoir, et en ont abandonné la culture à des gens pauvres, ignorans, sans intérêt à bien faire, et dont, par-dessus le marché, ils ont découragé de mille manières l'industrie à l'activité.
Après le mépris du travail, peu de vices ont été plus funestes à l'art agricole que l'amour du faste. Ce vice a diverses manières de nuire à la culture du sol : il s'oppose à la division des propriétés trop grandes ; il soustrait à l'agriculture d'immenses terrains ; il lui enlève des capitaux non moins considérables; il est cause à la fois que beaucoup de terres restent en friche, et que beaucoup d'autres sont mal cultivées. Un propriétaire fastueux ne vise pas à avoir l'étendue de terrain qu'il est capable de mettre en rapport, il vise à avoir le plus de terre possible ; il ne s'agit pas pour lui de culture, il s'agit d'ostentation, de domination. Il aimerait mieux ne régner que sur des landes que d'avoir un domaine trop circonscrit. Le vice de cet homme [II-362] ne s'oppose pas seulement à ce que la terre se divise ainsi que le demanderait l'intérêt de l’art, sa manie le pousse à dérober beaucoup de terres au travail de la charrue. Il sacrifie à la représentation la partie la meilleure et quelquefois la plus considérable de sa propriété ; il convertit ses champs en avenues, en cours d'honneur, en parcs et en jardins de luxe ; il laisse, pour le seul plaisir de la chasse, des espaces immenses en forêts. Sa passion ne lui permet pas de faire de son argent un usage plus judicieux que de sa terre; dans ses dépenses, il vise surtout à l'effet; il décore à grands frais son château, et laisse tomber en ruines ses bâtimens d'exploitation ; il a des statues dans ses jardins, et manque d'instrumens de culture dans ses fermes; il fait sabler les allées de son parc, et ses fermiers ne communiquent avec la voie publique que par des ravins. Sous l'influence de la passion qui le domine, la terre prend un aspect de tristesse et de stérilité. Pour quelques parties qui sont plantées, bâties, cultivées avec quelque soin, tout le reste est dans un état de nudité, de délabrement et de misère.
Si le faste des grands propriétaires cause de si notables dommages à l'agriculture, l'insouciance des petits cultivateurs ne lui fait pas quelquefois moins de mal; tandis que les premiers sacrifient tout à l'ostentation, les seconds ne font presque rien [II-363] pour le bien-être. Le marquis d'Argenson remarquait particulièrement deux choses dans nos campagnes, il y a près d'un siècle : l'extrême malpropreté des particuliers, et la négligence encore plus grande avec laquelle on entretenait les choses à l'usage du public.
« Sur le fait de la propreté, di. sait-il, il est à naître que vous voyiez une seule maison que l'habitant se soit avisé de tenir nette, où il mette en ordre et approprie chaque chose, comme cela se pratique en Hollande. En nos pays taillables, je n'en ai pas vu une seule; tout a un air déguenillé. Il semble que ce soit une chose bien abstraite que l'ordre et la netteté.... Pour ce qui est de l'indifférence à la chose publique, à laquelle on est soi-même si fort intéressé, c'est encore un plus grand sujet de surprise : cela va jusqu’à hair le bien général. »
Ce qui étonnait surtout M. d'Argenson, c'était l'état où les habitans de chaque village consentaient à laisser leurs chemins.
« Comment, se demandait-il, un bourgeois ne s'avise-t-il pas de rétablir un pavé devant sa porte, au lieu d'une mare où il se noie ? Comment ne débarrasse-t-il pas la rue des épines et des ordures ? Comment cinq ou six manans ne se disent-ils pas sAccommodons proprement, à nos heures perdues, cette place, ce passage, ce petit pont [148] ? »
[II-364]
Ces réflexions judicieuses, écrites en 1735, auraient encore en 1829 le mérite de l'à-propos. Il est toujours à naitre dans nos communes rurales, surtout dans quelques départemens du centre de la France, que vous voyiez des maisons que les habitans s'avisent de tenir nettes. Les meilleures et les plus apparentes sont encore indignement tenues; on y manque des meubles les plus indispensables; nulle commodité, nul goût, nulle propreté; des jardins à peine clos, à peine tracés; aucune plantation, point d'ombrage ; des cours où les chardons, les ronces, les orties croissent parmi des pierres, des copeaux, de la paille, du fumier, des ordures, des troncs d'arbres qui y sont confusément épars, et parmi lesquels se dessinent irrégulièrement d’étroits sentiers qui s'y sont frayés par l'usage. Au dehors, et pour communiquer de maison à maison, non pas des rues, mais des cloaques; pour chemins vicinaux, des ravins, des précipices, de vrais casse-cou. Voilà, dans une bonne partie de ce que nous appelons la belle France, l'aspect général des communes rurales et des maisons qu'elles renferment.
Du temps du marquis d'Argenson, les habitans des campagnes, pour s'excuser d'être si sales, disaient que la propreté leur donnerait un air d'aisance qui ferait bientôt doubler la taille; et ce ministre honnête homme avait la bonne foi de [II-365] convenir qu'ils pouvaient bien avoir raison. Il les trouvait en conséquence excusables. C'était peut-être sé montrer bien indulgent. Des hommes ne semblent-ils pas impardonnables, qui, par crainte des impôts, n'osent se tirer de l'ordure et se mettre en une situation moins indigne de l'humanité? Des hommes dignes de ce nom savent s'affranchir de la misère, et défendre leur aisance contre les impôts exorbitans; de tels hommes travaillent sans relâche à s'arranger, à se décrasser; ils purifient leurs demeures; ils en écartent les reptiles venimeux, les insectes incommodes, et ils apprennent aussi à se défendre contre cette autre espèce bien plus redoutable de vermine qui se nourrit de rapines et d'extorsions.
Mais ce n'est pas seulement, il faut en convenir, la crainte des taxes injustes qui empêche l'habitant des campagnes, en de certains pays, de tenir proprement ses champs, son jardin, sa demeure, ainsi que les choses dont il jouit en commun avec ses voisins; c'est aussi l'incurie, la paresse, le défaut de goût, l'absence de dignité morale. Né dans l'ordure, il s'est accoutumé à cet état, ou, s'il lui répugne, il lui répugne moins que les efforts qu'il lui faudrait faire pour en sortir. Il ne sent point, ou ne sent que très-faiblement ce besoin d'améliorer sa condition, dont j'ai fait ailleurs [II-366] l'apologie, et que j'ai appelé amour du bien-être. (V. ch. xiv, p. 96 et suiv.)
Cette passion, si favorable au progrès de toutes les industries, est de nature à exercer sur celle de l'agriculteur l'influence la plus salutaire. Le propriétaire qui en est animé ne se décharge pas sur des étrangers du soin de cultiver son héritage : il le fait valoir de ses propres mains. Il ne vise pas à s'agrandir outre mesure : il ne veut avoir que l’étendue de terrain qu'il se sent en état de bien exploiter. Il n'est pas ennemi de ce qui peut rendre son domaine agréable, car son premier désir est d'être bien : mais, par cela même qu'il aspire à le rendre agréable, il veut d'abord qu'il soit productif, et, dans ses efforts pour l'embellir, il tend tou. jours à l'améliorer. En même temps qu'il décore ses bâtimens, il s'efforce de les approprier à l'objet de son entreprise; ce qui contribue à l'ornement de ses jardins tend presque toujours à les rendre plus productifs ; il consent qu'on y sème des gazons, mais 530.à condition de les faire servir de pâturages; il n'en exclut pas les arbres d'agrément, mais il y admet de préférence les arbres fruitiers ; les sentiers qu'il trace pour se promener servent en même temps à la commodité de la culture ; les plantations d'arbres forestiers qu'il exécute autour de ses champs lui permettent de défricher ses forêts. [II-367] Comme le propriétaire fastueux, il ne cherche, si l'on veut, que sa satisfaction, mais il calcule mieux ses jouissances; et, tandis que le dernier se ruine pour de faux plaisirs, il sait, en faisant son bonheur, travailler encore à sa fortune. Non-seulement la passion qu'il éprouve imprime une meilleure direction à l'usage de ses forces et de ses ressources, mais elle stimule son activité, elle éveille son intelligence, elle anime son courage; elle lui inspire des idées d'ordre, d'économie et de propreté : il lui suffit' en quelque sorte de ce sentiment pour éprouver tous ceux que l'exercice de son art réclame.
On voit comment les habitudes privées tendent à accroître les pouvoirs de l'industrie agricole. Si cette industrie paraît peu propre à hâter le progrès de ces habitudes, il est indubitable que ces habitudes sont très-propres à accélérer le développement de cette industrie. Il se peut bien que toutes ne lui soient pas également nécessaires; qu'elle ne réclame pas précisément les mêmes que tel autre ordre de travaux; qu'elle n'exige pas autant de frugalité que les professions littéraires, le même genre de courage que le métier de marin, de mineur, de couvreur, etc. Mais si elle ne met pas également à contribution toutes les vertus privées, ou si elle ne les emploie pas toutes de la même manière, il n'en est probablement pas dont [II-368] elle ne puisse tirer quelque parti, et qui ne soit de nature à devenir pour elle un élément de puissance.
§ 6. On peut dire de même qu'il n'est pas de bonne habitude sociale qui n'ait pour effet d'étendre sa liberté. Il est vrai qu'elle n'a pas été plus favorable au développement de ce nouvel ordre de moyens qu'à celui de tous les autres; que, bien que l'isolement de ses agens ait pu les préserver long-temps de la contagion de certaines injustices, il s'en faut qu'il ait contribué à avancer leur éducation comme citoyens; que le seul effet de cet isolement a été de les laisser şans esprit public, sans sympathies communes; que lorsqu'ils ont été appelés à exprimer des vœux collectifs, ils ont été loin de se montrer plus avancés que les autres classes de travailleurs ;. qu'ils paraissent au contraire avoir toujours été, politiquement comme sous les autres rapports, en arrière de la plupart des professions qui entrent dans l'économie sociale... Mais, s'il est certain que la morale de relation, comme les habitudes privées, comme les connaissances techniques, comme l'esprit de spéculation et le talent des affaires, est plus retardée parmi les agriculteurs que dans les autres classes d'industrieux, il est pareillement indubitable que, pour cet ordre de travailleurs comme pour tous, [II-369] elle est un des moyens de liberté les plus indispensables.
J'ai dit qu'il n'y avait pour nulle industrie de vraie liberté possible que là où les hommes, dans leurs rapports mutuels, savaient s'abstenir de toute entreprise frauduleuse ou violente contre la personne, la fortune ou les facultés les uns des autres. Cette proposition est vraie pour l'art agricole comme pour tous les arts. Qu'ai-je besoin de dire, par exemple, qu'il n'y aurait pas d'agriculture possible là où l'appropriation des terres ne serait pas respectée, là où chacun voudrait s'emparer du champ qui serait à sa convenance? N'est-il pas évident que la liberté de cultiver le sol serait matériellement détruite par les violences continuelles auxquelles on serait exposé, qu'elle le serait moralement par le découragement qui résulterait de ces violences, et par l'état de barbarie où l'agriculture tomberait? Il n'est pas douteux que l'on ne perdît à la fois la volonté et la capacité de féconder un champ qu'on n'aurait pas la certitude de conserver. L'infaillible moyen de rendre la terre inculte et de faire du monde une solitude serait de mettre en vigueur, si la chose était humainement possible, la fameuse maxime de Rousseau, que les fruits sont à tous, et que la terre n'est à personne. De l'action de s'entre-dépouiller violemment de [II-370] ses propriétés à celle de commettre furtivement sur les champs les uns des autres quelque dégât ou quelque larcin, la distance est grande sans doute, et l'on sent que la liberté de la culture ne serait pas également attaquée par des actes d'une gravité si différente. Cependant, de quelque manière qu'on attente réciproquement à ses propriétés rurales, il est clair que l'on s'ôte plus ou moins les uns aux autres la faculté de les faire valoir, et que l'impuissance d'agir à laquelle on se réduit est d'autant plus grande, que le mal que l'on se fait est plus grave, et qu'il en résulte pour chacun plus de découragement.
Ainsi la liberté de l'agriculture n'existe point ou n'existe que d'une manière fort imparfaite là où les récoltes ne sont pas en pleine sûreté dans les champs; là où les propriétaires voisins cherchent à empiéter les uns sur les autres; là où l'on ne se fait pas scrupule de franchir ou d'enfoncer les clôtures, et de se frayer, à travers champs, un chemin pour abréger sa route; là où la terre est sujette à des droits de parcours et de vaine pâture, et où l'on n'est pas maître de son bien pendant une portion de l'année [149] ; là où certains propriétaires, [II-371] pour se donner le plaisir de la chasse, prétendent avoir le privilège d'élever dans leurs bois des animaux malfaisans, et ne pas même laisser aux cultivateurs dont les récoltes sont dévastées par ces animaux la faculté de les détruire. On sait que nos anciennes lois sur la chasse défendaient aux roturiers de tuer les bêtes noires et rousses qui entraient dans leurs héritages. Ils pouvaient bien les chasser avec des pierres ; mais ils devaient soigneusement éviter de leur faire aucun mal : risquer de les tuer eût été commettre un délit grave [150] . Les choses, de nos jours, ont fait à cet égard quelques progrès. Il paraît qu'à cette heure les paysans logés dans le voisinage des forêts peuvent, sans encourir de punition, tirer sur les loups qui viennent égorger leurs troupeaux, et même sur les sangliers qui dévastent leurs récoltes. Cependant ce que nous avons gagné sur ce point n'est peut-être pas aussi considérable qu'on pourrait le supposer: on a vu, en 1817, sept communes rurales de l'arrondissement de Senlis réclamer [II-372] vainement la faculté de faire des battues pour repousser l'invasion d'une multitude de sangliers logés dans les forêts d’Alatte et de Chantilly, et qui venaient commettre dans leurs champs d'horribles dégâts [151] . On sent que la liberté de l'agriculture se concilie assez mal avec ce reste de respect pour les bêtes noires et rousses, et en général avec tous les excès particuliers que je viens d'énumérer.
Elle ne s'accommode pas mieux de la prétention élevée par la généralité des cultivateurs d'exclure les agriculteurs étrangers du marché national, et de vendre leurs produits à un prix de monopole. Outre qu'une telle prétention les expose à une multitude de représailles fâcheuses, et ne leur permet de vendre plus cher leurs produits qu'en les obligeant à payer plus cher tous les objets de leur consommation, elle a pour effet de ralentir, sous tous les rapports, le développement de leur activité et de leur intelligence. Ce n'est pas sans regret que nous voyons M. de Dombasle prêter l'appui de sa haute raison et de son caractère honorable à un ordre de demandes qui semble à la fois si peu juste et si peu éclairé [152] . Suivant lui, notre agriculture, [II-373] arriérée comme elle l'est, n'a de moyens de se soutenir et d'avancer qu'en écartant la concurrence étrangère et en nous vendant ses produits au-dessus de leur vraie valeur. Mais la question, à part même toute idée de justice, est précisément de savoir si cette pratique est favorable à ses progrès. J'avoue que cette question me semble peu approfondie par M. de Dombasle. Cel habile agronome se borne, pour ainsi dire, à poser : en fait ce qui est en question, savoir que, dans l'état où la production agricole se trouve parmi nous, les prohibitions sont un encouragement indispensable. Mais les agriculteurs se procurent-ils par les prohibitions un véritable encouragement? S'encouragent-ils en s'exposant à des représailles? S'encouragent-ils en faisant écarter des marchés étrangers ceux de leurs produits qu'ils pourraient y vendre avantageusement? S'encouragent-ils en autorisant tous les producteurs nationaux à former des prétentions pareilles aux leurs et à leur vendre leurs produits plus qu'ils ne valent? S'encouragent-ils en se mettant dans le cas de payer le fer, les outils, la main-d'ouvre et tout ce dont ils ont besoin beaucoup plus qu'ils ne feraient hors d'un système dont l'effet est de tout enchérir? S'encouragent-ils en se délivrant des seules concurrences qui pourraient les tirer de leur sommeil léthargique? En écartant d'eux cet utile aiguillon font-ils autre [II-374] chose que s'encourager à la paresse, à la routine, à la persistance dans de fausses directions et dans des procédés vicieux? N'est-il pas honteux que notre agriculture ne puisse soutenir la concurrence de pays placés, sous le rapport de la production agricole, M. de Dombasle l'avoue [153] , dans des situations analogues à la nôtre, souvent moins favorables, et chez plusieurs desquels l'agriculture sé trouve grevée d'impôts beaucoup plus onéreux que chez nous ? Doit-on des encouragemens à des éleveurs de bestiaux qui, malgré l'appui de droits très-forts, ne peuvent lutter contre ces pays qu'avec désavantage? Ou plutôt l'encouragement qu'on leur doit n'est-il pas celui d'un régime de liberté qui fasse à leur apathie une salutaire violence, et qui les force enfin de songer à perfectionner leur industrie ? Comment un homme qui a cherché à introduire dans notre agriculture tant d’utiles perfectionnemens semble-t-il écarter comme fâcheux celui d'un système de liberté et de justice? Il importe sans doute d'apporter dans l'adoption de ce système la même réserve que dans celle de tout autre ordre d'innovations; mais s'il n'y faut avancer qu'avec prudence, il y faut pourtant avancer, et de toutes les acquisitions qu'ont besoin de faire les cultivateurs, ainsi que les autres classes d'industrieux, [II-375] l'une des plus urgentes est sans contredit celle d'un ordre d'idées et d'habitudes civiles qui, en leur faisant désirer l'établissement progressif d'un système général de concurrence, tende à les placer dans une situation où ils soient plus stimulés à bien faire, et où ils en aient davantage lési moyens.
Si donc la liberté des cultivateurs se lie étroitement à la bonté de leur morale privée, elle ne dépend pas d'une manière moins immédiate du perfectionnement de leurs habitudes sociales, et en général des progrès qu'a faits en eux et parmi tous les hommes le respect des droits et de la propriété d'autrui. Plus ce respect est grand et universel, plus les propriétés rurales sont à l'abri d'atteinte; plus chacun, en s'efforçant de tirer le meilleur parti possible de son champ, est disposé à laisser les autres en agir de même, et à admettre la concurrence générale des autres cultivateurs, et plus il y a de liberté agricole.
Ajoutons néanmoins que, pour que cette liberté soit entière, il ne suffit pas d'éprouver comme individu le respect dont je parle ici, et qu'il faut encore s'être accoutumé à le sentir comme public. II peut y avoir en effet, et il y a ordinairement une différence assez grande entre les sentimens que manifestent à cet égard les habitans d'un pays, quand ils sont isolés, et quand ils agissent en commmun. [II-376] Isolément, des cultivateurs ne concevraient pas même la pensée de contraindre leurs voisins à acheter leurs denrées plutôt que des denrées de provenance étrangère, tandis que, réunis en assemblée législative, ils ne feront probablement aucune façon d'exclure du commerce intérieur les laines, les grains, les bestiaux étrangers. Individuellement, nous ne nous permettons aucune entreprise violente sur la terre d'autrui ; tandis que, socialement et en nom collectif, nous nous arrogeons encore une autorité fort étendue sur les possessions particulières. La société s'est long-temps attribué le droit de prononcer des confiscations. Il lui est quelquefois arrivé de dépouiller des classes entières de leurs héritages. A plus forte raison ne craint-elle pas de commettre de moindres attentats. En France, par exemple, et de notre temps, elle trouve tout simple de s'emparer des mines, des carrières, des salines, des salpétrières, qu’un particulier peut posséder dans son fonds; elle en adjuge l'exploitation à qui il lui plaît; elle la refuse au propriétaire si bon lui semble; elle défend au propriétaire d'un champ d'ouvrir sans sa participation la mine qu'il a sur son propre fonds, et, sans la participation du propriétaire, elle fait fouiller, elle fait bouleverser son terrain pour y chercher une mine [154] . Si je possède un terrain [II-377] tourbeux, je n'en peux extraire la tourbe qu'avec son autorisation [155] . Veut-elle ouvrir ou continuer, un canal, une route; plutôt que de faire le moindre détour, elle coupe en deux mon enclos; elle abat mes arbres, mes bâtimens, mes clôtures. C'est elle qui préside à l'exploitation de mes bois, à l'éducation de mes troupeaux, au choix de mes récoltes. Elle me fait défense de défricher ma forêt sans sa permission, d'y abattre des arbres de haute futaie sans prévenir ses agens forestiers six mois à. l'avance. Dans l'intervalle, elle choisit ceux de ces, arbres qu'il lui plaît de réserver pour sa marine; et si, un an après les avoir fait couper, équarrir et porter en un certain lieu, il ne lui convient plus de les garder, elle me permet d'en disposer, et, me laisse le soin de m'en défaire [156] . Où j'aurais voulu semer de la luzerne, elle m'ordonnait il n'y a pas long-temps de faire du blé [157] . Où j'avais, envie de faire du blé, elle m'a prescrit un peu [II-378] plus tard de semer des betteraves [158] . Il m'est encore sévèrement défendu de planter mon champ de tabac sans qu'elle m'y ait autorisé. Si je veux faire châtrer mes béliers [159] ou hongrer mon cheval [160] , il faut que j'appelle ses commissaires. Je ne peux destiner mon étalon à la monte si je ne l'ai fait approuver par eux, ni l'employer plus d'un an à ce genre de service sans le soumettre à une inspection nouvelle [161] . Voilà comment la société en agit à l'égard de mes biens ruraux. Le respect que nous avons pour ces biens comme individus, nous nous en dispensons cavalièrement comme corps politique. A la différence d'autres sociétés, et par exemple de la société anglaise, qui ne prend point de ces licences à l'égard des biens des particuliers, qui laisse chaque propriétaire cultiver son champ, élever ses troupeaux, planter, défricher, couper ses futaies, exploiter ou vendre ses mines sans exercer le moindre contrôle sur ses opérations, nous nous regardons, quand nous agissons collectivement, comme plus maîtres des propriétés des [II-379] particuliers que les propriétaires eux-mêmes.
Ce n'est pas qu'il n'y ait parmi nous des hommes, même en assez grand nombre, qui blâment ces entreprises du public ou de ses délégués; mais il y en a probablement plus encore qui les approuvent, ou du moins qui les voient avec une sorte d'indifférence; car si la majorité seulement de la partie politiquement active de la société avait le sentiment un peu vif de ce qu'elles offrent d'injuste, de ridicule, de pernicieux, si elle les condamnait comme elles méritent de l'être, on ne comprend pas trop comment elles pourraient avoir lieu. Si donc il est possible de les effectuer, c'est qu'apparemment elles sont dans la mesure de ce qu'il y a parmi nous de capacité politique, d'intelligence de la propriété et de ses avantages, de disposition commune à la respecter.
Or, avec des dispositions politiques qui rendent possible une telle série d'excès contre les possessions rurales, on comprend que l'agriculture aurait grand'peine à agir avec liberté. Qu'importe',' en effet, que les particuliers respectent isolément ma propriété, si collectivement ils m'en dépouillent ou souffrent que j'en sois dépouillé par les dépositaires de l'autorité collective ? A quoi me sert de n'avoir rien à craindre des individus si j'ai tout à craindre de la société ou de ses fondés de pouvoir ? Les fonctionnaires, les corps constitués, [II-380] les citoyens actifs qui attentent ou laissent attenter à la propriété de mon champ en troublent-ils moins la culture parce qu'ils s'appellent électeurs, députés, ministres, agens forestiers, inspecteurs de haras ? Non, sans doute; le mal qu'ils me font est le même; il est même plus grave et plus décourageant, car il m'est plus difficile de m'y soustraire : il y a possibilité de se défendre contre des malfaiteurs isolés; mais quelle défense faire contre des excès qui naissent de l'état moral des masses? Il est clair qu'on ne peut attendre que de leurs progrès la cessation de violences dont la vraie cause est dans leur état.
Non-seulement la société, par les droits qu'elle s'arroge ou qu'elle laisse prendre à ses délégués sur mes biens ruraux, m'empêche matériellement de les faire valoir, mais elle m'ôte le désir de les améliorer. L'effet direct de ses empiètemens est de me faire perdre l'émulation et le courage. Gardetoi, semble-t-elle me dire, d'élever de beaux étalons; car tu auras affaire à mes inspecteurs de haras. Si ton champ recèle des richesses minérales, évite de le faire soupçonner; car tu vas attirer sur ton terrain mes ingénieurs des mines. Respecte tes landes, ne plante point d'arbres dans tes bruyères, ou du moins coupe tes bois jeunes, et avant qu'ils aient vingt ans; car après vingt ans tu n'en seras plus le maître. Tu voudrais peut-être faire croître de belles [II-391] futaies dans tes bois, autour de tes champs, le long de tes avenues : ne cède point à ce désir, hâte-toi d'abattre tes arbres avant qu'ils aient quatre pieds de tour; car dès qu'ils auront acquis cette dimension tu ne seras plus libre d'en disposer. Malheur à toi, si tu laisses venir tes plantations trop belles : on les remarquera, elles seront notées comme bonnes à être soumises au martelage, et une fois sujettes à ce genre de conscription, tu n'y pourras plus couper un arbre que sous le bon plaisir de mes agens forestiers.
Telle est, au vrai, la manière dont la société m'encourage. Aussi l'effet répond-il à ses recommandations. Il suffit, pour s'en convaincre, de considérer l'état où se trouvent parmi nous l'exploitation des mines, l'éducation des bestiaux, la culture des arbres, surtout si l'on juge ces choses par comparaison avec l'état où elles sont en d'autres pays où il n'y a ni ingénieurs des mines, ni inspecteurs des haras, ni conservateurs des forêts. Telle est l'influence de notre régime forestier que, dans le temps où un huitième du sol de la France est encore couvert de bois de toute catégorie, il se trouve que dans un grand nombre d'arrondissemens on manque de bois de chauffage, et que partout on manquera bientôt de bois de service. Les anciens chênes disparaissent, observe un agronome éclairé; les bois se dépeuplent, les propriétaires [II-382] abattent leurs beaux arbres, transforment leurs forêts en taillis, et réduisent du tiers, de moitié, la durée des aménagemens : le tout par l'influence de notre administration forestière. Il y a dans le seul titre que porte cette administration quelque chose de sauvage qui fait peur à la culture et en prévient les progrès. Conservation des forêts : conservation de repaires pour les loups et les voleurs, obstacles à l'extension des défrichemens et à la culture des beaux arbres, voilà ce que veulent dire ces paroles, sinon d'intention au moins d'effet. Il est, par exemple, bien certain que l'effet des pouvoirs que la société remet à ses conservateurs des forêts est d'empêcher qu'on exécute des plantations là où le bois manque, et de faire détruire les beaux arbres partout où il y en a. A cet égard, je ne demande pas à être cru sur parole. J'engage le lecteur à lire ce qu'un de nos ingénieurs les plus distingués publiait, il y a quelques années, sous le voile de l'anonyme, sur le Code forestier alors en projet. Il verra dans cet écrit, où de hautes lumières se trouvent unies à une grande connaissance des faits, l'influence réelle qu'exerce sur la culture des bois notre administration forestière [162] .
Je sais fort bien, du reste, qu'il ne suffirait pas [II-383] de supprimer les entraves multipliées que la société met ou souffre qu'on mette à l'exercice de l'art agricole pour que cet art fût exercé avec un plein succès. De ce que nous aurions politiquement la liberté d'exploiter nos biens ruraux, il ne s'ensuit pas que nous posséderions toutes les facultés qui font le cultivateur habile. La capacité politique n'implique pas nécessairement tous les autres genres de capacité. Cet ordre de facultés ne fait pas non plus qu'on se puisse passer des autres. Mais si celui-là ne dispense pas des autres, aucun, à coup sûr, ne dispense de celui-là ; et il est certain qu'une nation ne possède point de vraie capacité pour l'agriculture, et qu'elle n'est que très-incomplètement libre de l'exercer, tant qu'elle n'a pas acquis les habitudes sociales que réclame la pratique de cet art.
§ 7. On vient de voir à quel point sont essentiels dans l'agriculture les divers ordres de moyens qui se composent de facultés personnelles, et tout à la fois combien ces moyens y sont encore peu avancés, combien, par sa nature, cette industrie a été peu favorable aux progrès des classes qui l'exercent. Nous allons avoir à faire des observations du même genre sur l'ordre de pouvoirs dans lequel il n'entre que des objets réels. Nous verrons de même combien l'état de ces objets est de nature à [II-384] influer sur la puissance de l'art agricole, et tout à la fois combien il est difficile d'approprier ces objets à leur destination, combien on a plus de peine ici qu'ailleurs à leur donner les qualités d'où résulte leur force et qui permettent d'en tirer un grand parti.
Ainsi, par exemple, il n'est pas douteux, à considérer l'atelier agricole dans son ensemble, que la liberté du travail, dans l'agriculture comme dans les autres industries, ne dépende beaucoup de la situation de l'atelier. C'est à tort, si je ne me trompe, que M. Say dit des entrepreneurs de culture qu'ils n'ont pas, comme les entrepreneurs de fabriques, le pouvoir de choisir le siège de leur industrie [163] . Sans doute un cultivateur ne peut pas déplacer sa ferme; il ne le peut pas plus qu'un fabricant ne peut déplacer sa manufacture; mais de même qu'un manufacturier, avant d'élever sa fabrique, peut choisir le lieu où il la construira, de même un agriculteur, avant de fonder son exploitation agricole, est très-fort le maître de choisir son terrain et de chercher l'emplacement le plus favorable. On est porté à chercher les bonnes places pour les établissemens agricoles comme pour tous les genres d'établissemens, et celui dont la ferme est bien située en peut tirer par cela seul [II-385] un parti beaucoup plus considérable. Il va sans dire qu'une exploitation rurale à plus de valeur aux portes d'une ville, sur le bord d'un canal, d'une route, que placée au milieu des terres, loin de toute communication et de tout débouché [164] .
Non-seulement il y a possibilité en agriculture de choisir le siège de son industrie, mais il est des cas où ce choix est de nécessité absolue, et il est beaucoup de cultures pour lesquelles il faut nécessairement avoir égard au climat, à l'exposition, à la nature du terrain, etc. Les raisons qui peuvent faire préférer un emplacement à un autre ne sont pas moins nombreuses ici qu'ailleurs. Cependant, comme une fabrique agricole couvre infiniment plus d'espace qu'une manufacture ordinaire, il est clair que le nombre des bonnes places doit être moins grand pour les exploitations rurales que pour les entreprises manufacturières, et que, par cela même, il doit être plus difficile de bien placer une ferme que de bien situer une fabrique.
Il faut ajouter qu'en agriculture cette difficulté de choisir le lieu de son établissement se complique [II-386] de celle de déterminer l'étendue qu'il convient de donner à l'atelier. On fait ici une question qui n'a été élevée, que je sache, dans aucun autre ordre de travaux : c'est de savoir s'il faut travailler en grand ou en petit, et quelle est la bonne agriculture de la petite ou de la grande. Y a-t-il de l'avantage à exercer l'industrie agricole sur un vaste théâtre ? L'exerce-t-on avec plus de bénéfice sur un terrain très-circonscrit? Faudrait-il, pour l'intérêt de l'art, que la terre fût partagée en exploitations de dix perches? Vaut-il mieux qu'elle se divise en exploitations de cinq cents ou de mille arpens? Voilà sur quoi l'on dispute, et ce qu'il n'est guère possible de décider d'une manière absolue. A cet égard, comme à beaucoup d'autres, les choses suivent les lois de leur nature et s'arran, gent au gré des circonstances, sans se laisser enchaîner par de vains débats. Ainsi, quoi que l'on décide, les terres seront naturellement plus divisées dans le voisinage des grandes villes qu'au milieu des campagnes et dans l'éloignement des habitations; elles se partageront autrement pour la culture des plantes potagères que pour celle des céréales; elles se morcelleront davantage dans les pays où le sol est très-fertile que dans ceux où le sol est très-ingrat. Ensuite on les verra constamment se distribuer dans les mains de la population, de la même manière que s'y trouvent distribués les [II-387] capitaux et les connaissances agricoles; c'est-à-dire qu'elles iront, comme toutes les choses propres à produire, chercher les personnes les plus capables d'en tirer parti, et par cela même les plus disposées à les bien payer. Si, comme en Angleterre, il existe une classe de cultivateurs qui soient à la fois très-riches et très-habiles, les petits entrepreneurs de culture seront hors d'état de lutter con. tre eux, et les terres tendront naturellement à se réunir en grands corps de fermes. Si, comme ailleurs, l'attribut le plus général des possesseurs de terre est l'ignorance et la disette d'argent; s'il arrive que les petits cultivateurs aient à appliquer à la culture, toute proportion gardée, plus de valeurs et de savoir-faire que les classes élevées; s'il se trouve que les terres produisent plus dans les mains des petites gens que dans celles des grands propriétaires, on les verra immanquablement sortir par lambeaux des mains des grands propriétaires pour aller se caser dans celles des petites gens. Et ce sera bien vainement que la grande propriété prendra des mesures iniques pour empêcher qu'elles ne lui échappent; car elle sera toute la première à aller contre l'esprit de ses propres lois et à vendre ses champs à parcelles. C'est ainsi que parmi nous, depuis fort long-temps, elle donne elle-même l'exemple du morcellement dont elle se plaint. Ce n'est pas le Code civil qui est cause que [II-388] la terre se partage. Ce ne serait pas le rétablissement du droit d'aînesse qui l'empêcherait de se diviser. Les terres se morcellent, en France, parce qu'elles ont généralement plus de valeur dans les mains des petits cultivateurs que dans celles des gros fermiers et des grands propriétaires; de même qu'elles restent agglomérées en Angleterre par la raison opposée. Leur tendance universelle, je le répète, est de se répartir comme les moyens propres à les faire valoir. Dans la concurrence entre les acheteurs de toutes les classes, elles vont, comme l'observe judicieusement M. de Dombasle, à ceux qui peuvent en tirer les plus grands produits, parce que ce sont eux qui peuvent y mettre le prix le plus considérable [165] . On voit ainsi qu'il n'est pas possible de déterminer d'une manière absolue comment les terres doivent être divisées : ce sont les circonstances qui en décident.
Cependant ces circonstances mêmes peuvent servir de règle; et l'on peut dire d'abord, en termes généraux, que le sol est d'autant mieux réparti et l'action de l'agriculture d'autant plus libre, que la grandeur des exploitations rurales est plus en rapport avec la nature du terrain, avec l'espèce de culture, et surtout avec les facultés de chaque cultivateur. De sorte que les terres seront également bien divisées dans les pays de petite, de moyenne [II-389] et de grande culture, si dans chacun de ces pays elles se trouvent distribuées comme les ressources propres à les faire valoir. Ce qui importe, avant tout, en effet, c'est qu'elles soient aux mains les plus capables d'en tirer parti, et qu'elles se divisent comme les moyens que leur culture réclame [166] .
Après cela, il serait heureux peut-être que ces moyens fussent répartis de manière à provoquer telle distribution du sol plutôt que telle autre. Il semble en effet que toutes les manières de le distribuer ne doivent pas être également favorables à sa bonne exploitation. Il y a des raisons de croire qu'à égalité proportionnelle d'intelligence, d'activité et de moyens pécuniaires, trois cultivateurs, dont l'un exploitera cent perches, l'autre cent arpens et l'autre mille arpens, d'un terrain de même nature, ne tireront pas de ce terrain le même revenu proportionnel. Un atelier très-étendu, un atelier très-circonscrit, un atelier formé de lambeaux de terre très-petits et très-écartés les uns des autres, paraissent être également défavorables à l'exercice libre et fructueux de l'agriculture.
Si l'atelier est trop petit, on n'y peut point appliquer les méthodes de culture perfectionnées; il devient impossible d'adopter un bon système d'assolement; il n'y a pas moyen d'élever les troupeaux [II-390] et d'avoir les engrais nécessaires; il n'y a presque point de machines qu'on puisse employer; il faut tout faire à bras, c'est-à-dire plus mal, plus chèrement et avec plus de peine ; ne pouvant occuper habituellement plusieurs ouvriers, on est obligé de tout faire soi-même; on perd son temps à changer dix fois par jour d'occupation; on n'acquiert de dextérité pour aucune; on fait pour plusieurs choses la même dépense que dans de plus grandes exploitations : il faut un berger pour une vache comme pour trente; il faut aller au marché pour un sac de blé comme pour vingt, etc., etc.
Si l'atelier est trop étendu, on éprouve d'autres désavantages : on est sujet à perdre beaucoup de temps en allées et venues; les transports éloignés entraînent des dépenses considérables ; la surveillance est plus coûteuse et n'est pas aussi exacte; certaines pièces peuvent se trouver tellement distantes du chef-lieu de l'exploitation, que la culture en devient impossible à force d'être dispendieuse, et alors il arrive qu'on paie pour des terres qu'on est obligé de laisser en jachère ou en pâturages, la même rente et les mêmes contributions que pour les portions les mieux cultivées de son domaine ; ayant beaucoup plus à faire sans avoir plus de temps, on est sujet à laisser une partie de sa besogne imparfaite, ou bien il faut, dans les momens de presse où le travail est très-demandé, avoir [II-391] beaucoup d'ouvriers supplémentaires, et l'on s'écrase alors de frais; etc.
Enfin, si l'atelier est composé de pièces très-morcelées et très-éparpillées, on peut éprouver à la fois les inconvéniens des ateliers trop circonscrits et des ateliers trop étendus. Il est possible que certaines pièces soient tellement petites qu'on n'y puisse faire entrer la charrue, et d'autres tellement écartées qu'il y ait plus de perte que de profit à les faire valoir. De tous les modes de répartition, celui-ci est sans contredit le plus défavorable.
Un pays où les exploitations rurales, composées de pièces bien réunies, ne sont ni trop grandes ni trop petites, paraît donc avoir, pour la bonne culture, un grand avantage sur ceux où le sol est autrement distribué. Il faut, pour pouvoir cultiver d'après les bonnes méthodes, avoir un atelier d'une certaine grandeur; mais à mesure que l'atelier s'étend, tous les inconvéniens des grandes exploitations deviennent plus sensibles, et il est certainement un point où les économies qu'il est possible d'obtenir par un meilleur mode de culture sont absorbées par les pertes et les frais proportionnellement plus considérables qu'entraîne l'agrandissement de l'exploitation. C'est ce point qu'il faut savoir reconnaître et ne pas dépasser. La meilleure dimension pour une exploitation rurale est [II-392] celle qui permet d'adopter, dans le cadre le plus resserré, le meilleur système de culture, et de tirer un certain, bénéfice de la moindre étendue possible de terrain.
S'il paraît difficile dans l'industrie agricole d'assigner de bonnes dimensions à l'atelier, il n'est pas plus aisé de lui donner une bonne organisation intérieure. Une manufacture proprement dite offre à cet égard beaucoup moins de difficultés qu'une exploitation rurale. Dans une exploitation rurale, en effet, on se propose un objet et l'on emploie des moyens beaucoup plus compliqués que dans une manufacture ordinaire. Il ne s'agit souvent dans une fabrique que de la confection d'une seule sorte de produits, tandis qu'on vise dans une ferme à obtenir des produits extrêmement divers. Ensuite les travaux d'une manufacture peuvent être soumis à un mode d'action précis, régulier, presque invariable; tandis que ceux d'une ferme, quoique bien loin d'être arbitraires, sont susceptibles, comme je l'ai déjà dit, d'être modifiés par une multitude de circonstances, et ont, par leur nature, quelque chose d'indéterminé, qui ne permet pas de les assujettir à une marche aussi constante. Il ne paraît donc pas possible de monter un atelier de culture sur un plan aussi simple et aussi arrêté qu'une filature de coton, une fabrique de toile ou tel autre atelier de fabrication. Cependant [II-383] on peut sûrement dans une exploitation rurale placer et disposer les bâtimens, diviser le terrain, établir des moyens de communication de toutes les parties de la ferme avec le chef-lieu, et du chef-lieu avec le dehors, d'une manière plus ou moins appropriée à l'objet de l'exploitation ; et il n'est pas douteux que le travail ne s'y exécute avec d'autant plus d'aisance et de liberté, que tout cela y est ordonné avec plus de discernement et de prévoyance [167] .
Une nouvelle remarque à faire, c'est qu'il est infiniment moins aisé dans l'agriculture que dans les autres industries de remplacer le travail de l'homme par celui des machines. Ceci tient encore à la nature de l'art agricole, qui oblige celui qui l'exerce à se transporter successivement avec ses outils sur toutes les parties d'un terrain plus ou moins vaste et inégal. Il en résulte qu'à la différence de la fabrication, par exemple, qui agit sans [II-394] se déplacer, et qui peut faire exécuter ses travaux par une chute d'eau, un courant d'air, un fluide élastique, l'agriculture ne peut adapter aucune de ces forces à ses ustensiles aratoires, et n'en tire presque aucun parti [168]. Aussi n'y a-t-il pas de comparaison entre la puissance des moteurs et des machines dont l'une et l'autre se servent. La plus grande force motrice qu’emploie ordinaire- ment l'agriculture, est un attelage de quelques che- vaux, tandis qu'il arrive fréquemment à la fabrication d'employer dans ses ateliers des moteurs à vapeur d'eau de la force de cent chevaux et de cent cinquante. La différence entre les effets produits n'est pas moins grande qu'entre les moyens employés. L'action des chevaux que le laboureur attèle à sa charrue n'est sensible, dans un moment donné, que sur un seul point de sa ferme, tandis que celle des moteurs que le fabricant adapte à ses métiers se fait sentir en même temps et d'une manière continue dans toute l'étendue de sa fabrique. S'il y a cette inégalité entre les ma- chines qui produisent le mouvement, il n'y en a pas moins entre celles qui le reçoivent et qui produisent l'effet utile. Quel est l'instrument d'agriculture [II-395] dont on peut comparer les effets à ceux de la grue, du laminoir, de la machine à filer, et de cent autres à l'usage de l'industrie manufacturière ? Il est évident que pour la force, l'étendue, la rapidité, la précision, la délicatesse, l'effet des instrumens aratoires n'approche point de celui de la plupart des outils qui servent à la fabrication.
Et toutefois, malgré cette infériorité des instrumens dont l'agriculture fait usage, il n'est pas douteux que, dans cet art comme dans tous, le travail ne devienne d'autant plus libre qu'on peut employer à le faire des outils plus perfectionnés et plus puissans. Il est incontestablement plus aisé de labourer la terre avec la charrue qu'avec la bêche, de l'ameublir avec la herse qu'avec le râteau, de l'ensemencer avec le semoir à brouette qu'avec le plantoir, et avec le semoir de Ducket ou de Fellenberg qu'avec le semoir à brouette. Tout ce qui épargne au laboureur le temps, la peine, la dépense, augmente évidemment sa liberté. M. Cordier observe qu'avec un cheval des plus faibles, attelé à la charrue appelée le brabant, on laboure en Flandre, à la profondeur de six à huit pouces, et dans un terrain dur et argileux, un demi-hectare ou quarante-sept mille quatre cent quinze pieds carrés par jour; tandis que dans la plupart de nos autres provinces, on ne laboure par jour avec une charrue attelée de quatre bœufs ou de deux chevaux [II-396] que quinze mille pieds carrés, et seulement à une profondeur de quatre à six pouces [169] . Il a été constaté dans un concours public, d'après le même auteur, qu'une charrue placée dans les mêmes circonstances que d'autres, c'est-à-dire labourant le même terrain et tirée par le même nombre de chevaux, pouvait, dans le même espace de temps, exécuter six fois plus d'ouvrage [170] . M. de Dombasle estime que la machine de Meikle pour battre les grains, qui est en usage, en Angleterre, dans toutes les fermes de quelque étendue, augmente d'un dixième environ le produit brut, et d'un tiers au moins le produit net de la culture des grains [171] . On voit par ce peu d'exemples, que la puissance du cultivateur peut être fort accrue par l'intervention des machines, encore bien qu'elle soit loin de l’être au même degré que celle du fabricant.
L'agriculture a encore un désavantage : c'est que le travail ne se divise pas aussi bien dans ses ateliers que dans ceux de l'industrie manufacturière, et que, par conséquent, elle ne peut pas jouir, au même degré que cette industrie, des facilités qui résultent d'une bonne division du travail pour la bonne et rapide exécution de l'ouvrage. La production des denrées agricoles exige bien une certaine [II-397] suite d'opérations comme celle des produits manufacturés ; mais ces opérations ne peuvent pas s'exécuter d'une manière continue et simultanée comme les travaux des fabriques. On ne voit pas dans un atelier de culture un certain nombre d'hommes constamment et simultanément occupés les uns à semer le blé, d'autres à le sarcler, d'autres à le moissonner, d'autres à le battre, à le vanner, à le cribler, comme on voit dans une fabrique d'épingles, par exemple, un certain nombre d'ouvriers constamment et simultanément occupés, les uns à passer le laiton à la filière, d'autres à le couper, d'autres à aiguiser les pointes ou à façonner les têtes : non; dans une manufacture de grains il arrive assez souvent que presque tous les travailleurs s'occupent à la fois d'une même opération, et de plus il s'écoule toujours un temps assez long avant que l'on puisse passer d'une opération à une autre, comme du labour aux semailles ou des semailles à la moisson. Il est donc certain que le travail ne se prête pas ici à une aussi bonne division que dans les fabriques. Cependant l'industrie agricole ne laisse sûrement pas d'admettre dans ses travaux une assez grande division. Le régisseur, le teneur de livres, le chef d'attelages, le chef de main-d'œuvre , le berger, les valets de charrue, remplissent tous des fonctions particulières dans une exploitation rurale; et, pour peu que l'exploitation [II-398] soit considérable, il n'est pas douteux que tout n'y marche d'autant mieux que ces fonctions y sont plus distinctes et mieux séparées. Ensuite si chacune des grandes opérations de la culture, telles que le labour, les semailles, la moisson, le battage des grains, ne peut pas être exécutée d'une manière continue par autant d'agens séparés, chacune d'elles, au moment où elle s'exécute, peut être partagée entre un certain nombre d'ouvriers qui .y concourent de diverses manières, et il est certain qu'elles s'accomplissent toutes d'autant plus librement que ces divisions y sont plus habilement effectuées.
Ainsi, il est bien certain, comme je l'annonçais en commençant ce paragraphe, que le fonds d'objets réels trouve dans l'agriculture le même obstacle à son perfectionnement que le fonds de facultés personnelles, et tout à la fois que le perfectionnement de cet ordre de moyens y contribue à la liberté des travailleurs, comme dans les autres industries. Il est avantageux ici comme partout d'avoir un atelier situé d'une manière favorable, organisé sur un bon plan, pourvu de machines puissantes, et où le travail soit bien divisé, encore bien qu'ici tout cela soit beaucoup moins aisé à obtenir que dans l'industrie manufacturière. On voit à quel point les fabriques agricoles diffèrent des manufactures ordinaires, et combien [II-399] cette classe d'établisseinens avait besoin d'être con: sidérée à part. L'agriculture se distingue de la fabrication proprement dite, par l'isolement où elle place les hommes qui l'exercent, par la nature des forces qu'elle emploie, par la grandeur du théâtre sur lequel elle travaille, par la diversité des produits qu'elle y crée, par la difficulté de reconnaître ceux qu'il est le plus avantageux d'y produire, par celle qu'il y a de trouver de bonnes places pour un genre d'établissemens si étendus, par celle d'organiser ces établissemens d'une manière convenable par l'impossibilité d'y introduire les moteurs aveu gles et d'y faire usage d'instrumens très-puissans, par celle d'y faire subir au travail d'aussi bonnes divisions que dans les fabriques, par le trouble continuel que l'intempérie des saisons et les variations de l'atmosphère y apportent dans les travaux... Tout cela fait, comme on l'a vu, que cet art n'avance que lentement et avec peine, et que les pouvoirs du travail y ont fait infiniment moins de progrès que dans les deux industries dont j'ai traité précédemment; ce qui n'empêche, pas, comme on l'a vu aussi, que la liberté des travail, leurs n'y devienne plus grande à mesure que chacun de ces pouvoirs s'y développe; et que le talent des affaires, les connaissances relatives à l'art, la perfection des meurs privées et sociales, le bon emplacement des ateliers, et tout ce qui peut [II-400] les rendre plus propres à leur destination, n'y soient autant d'élémens de puissance. Nous avons observé comment agit chacun de ces élémens en particulier; terminons en ajoutant quelques mots sur l'effet qui résulte de leur concours et de leur ensemble.
§ 8. Plus le capital appliqué à l'agriculture a fait de progrès; plus les classes qui exercent cette industrie ont accru la somme des talens, des connaissances, des habitudes qu'elle réclame; plus elles ont ajouté à la masse de leurs moyens matériels; plus elles ont répandu de valeurs sur les terres en plantations, en bâtimens, en clôtures, en travaux de dessèchement ou d'irrigation; plus elles sont riches en bestiaux, en ustensiles aratoires, en semences, en denrées pour nourrir les ouvriers, et en argent pour les payer et pour faire face aux dépenses nécessaires : et plus, évidemment, elles possèdent de force et de liberté d'action, Comme tous les autres industrieux,'le cultivateur trouve dans l'accroissement progressif de ses pouvoirs de moyen de les accroître encore : il travaille plus en grand; il monte mieux son atelier; il l'administre avec plus d'ordre et de méthode; il y introduit des outils plus puissans ;.it rapproche, autant que la nature des choses le permet, sa fabrique agricole des véritables établissemens manufacturiers; [II-401] il fait plus d'essais et d'expériences; il sacrifie davantage aux progrès de son art : on a vu souvent, en Angleterre, donner vingt-cinq guinées pour faire saillir une seule brebis par un beau bélier; il est arrivé à des fermiers anglais de payer jusqu'à mille guinées ( 24,000 francs) le loyer d'un bélier pour une seule saison de monte [172] .
Les effets que l’art produit sont en raison des moyens qu'il emploie. On ne sait pas jusqu'à quel point il est possible d'accroître les produits du sol en perfectionnant les moyens appliqués à la culture. Arthur-Younk, traversant la Champagne-Pouil leuse, jugeait, d'après la connaissance qu'il avait des pouvoirs de l'art agricole, qu'il serait aisé de faire rapporter 72 francs par an à tels arpens de terre qui n'étaient affermés que 20 sous. J'ai déjà parlé, d'après M. Cordier, de certains terrains situés dans le département du Nord, dont les produits, par hectare, sont, relativement à ceux d'autres terrains, de même nature, comme 3,200 est à 10 [173] . Cet auteur observe que la culture a fait assez de progrès en Flandre pour que le prix moyen locatif des fonds de terre y soit plus de quatre fois aussi élevé que dans le reste de la France [174] . D'après les calculs de certains écrivains anglais, l'Angleterre, [II-402] avec un atelier agricole moins grand que le nôtre de plus de moitié, obtiendrait des produits de près du quart plus considérables [175] . L'Angleterre et l'Écosse, suivant M. Cordier, ont infiniment plus de bétail que la France, quoique ces deux pays n'aient en superficie que les deux cinquièmes du nôtre [176] . M. Dupin estime qu'en Angleterre et en Écosse, la totalité des forces animales est égale à onze fois la totalité des forces humaines, tandis qu'en France elle n'est égale qu'à quatre fois la totalité des mêmes forces. Je vois dans M. Cordier [177] que l'arrondissement de Lille, où la culture se fait avec des chevaux, a cinq fois plus de boeufs ou de vaches que les autres départemens du royaume, dans la plupart desquels on n'a que des bœufs pour labourer la terre. Toutes ces évaluations ne sont peut-être pas rigoureusement exactes, mais elles le sont assez pour faire comprendre à quel point peuvent s'accroître les produits de l'agriculture à mesure que s'étendent et s'accumulent ses moyens.
[II-403]
CHAPITRE XVIII.
Application des mêmes moyens de liberté aux arts qui agissent sur les hommes, et d'abord aux arts qui agissent sur le corps de l'homme. De la liberté des arts qui ont pour objet la conservation et le perfectionnement de l'homme physique.
§ 1. Après avoir traité successivement, dans les précédens chapitres, des arts qui s'exercent sur les choses, sur les corps bruts, sur les plantes, sur les animaux, nous allons, suivant le cours progressif des idées, nous occuper maintenant de ceux qui portent directement leur attention et leur activité sur les hommes.
Les premiers, sûrement, ne sont étrangers ni par leur objet, ni par leurs effets, à l'éducation de l'espèce humaine. Ils lui procurent les moyens de vivre, de croître, de multiplier, de devenir plus saine, plus belle, plus intelligente, plus morale. On a assez pu voir quels développemens ils lui permettent de prendre, quel concours de facultés ils lui imposent l'obligation et lui fournissent les moyens d'acquérir.
Mais pendant que le voiturage, la fabrication, [II-404] l'agriculture, exercent indirectement sur elle une si immense influence, il est une multitude d'autres arts qui font de son éducation et de sa culture leur objet propre et immédiat, qui se proposent expressément de perfectionner sa nature physique, intellectuelle, affective, et c'est de ceux-ci que je dois à cette heure entretenir le lecteur.
Ces derniers, jusqu'à ce jour, n'avaient pas trouvé place dans les ouvrages des économistes. Ils n'étaient point entrés dans les classifications qu'ils ont faites des industries diverses, et n'étaient pas de ceux dont ils ont exposé la nature et les fonctions. C'était là, j'ose le dire, une très-grande lacune. On peut affirmer que nous n'avons pas d'idée véritable de l'économie de la société, tant qu'on ne nous a pas montré comment ces arts y figurent ; quel ordre de produits-ils y créent et comment y s'appliquent à leurs travaux les divers élémens de puissance dont se forme la liberté du travail. On devrait les faire entrer dans une bonne exposition de l'économie sociale, alors même qu'on n'assignerait à cette science, ainsi qu'on l'a fait jusqu'ici, d'autre objet que de rechercher suivant quelles lois la société devient riche. Où sont, en effet, les arts qui versent dans la société des produits de meilleure nature et une plus grande somme de produits que ceux qui s'occupent directement de la culture de l'espèce humaine, et qui s'en occupent [II-405] convenablement ? Ces produits, il est vrai, ne sont attachés à aucune sorte de choses; ils sont réalisés dans les personnes : mais qu'importe ? En sont-ils moins des produits pour cela ? Les produits si improprement appelés matériels consistent-ils dans la matière dont ils sont formés ? Y a-t-il jamais, en fait de produits, autre chose que des utilités produites ? et peut-il exister d'utilités plus réelles, plus susceptibles de conservation, d'accroissement, d'échange, de transmission, que celles que parviennent à mettre dans les hommes les arts qui s'occupent de leur éducation ?
Encore un coup, il faudrait donc traiter de ces arts alors même qu'on ne voudrait parler que de ceux qui concourent immédiatement à la production des richesses, à la production des valeurs échangeables; et à plus forte raison doit-on s'en occuper lorsque, prenant les mots d'économie sociale dans une acception plus juste et plus complète, on veut déterminer, non pas seulement de quelle manière le corps social devient riche, mais suivant quelles lois il parvient à exécuter librement toutes ses fonctions, par quels moyens les hommes parviennent à user de leurs forces avec le plus de facilité, d'étendue et de plénitude.
Ainsi, ce qu'on n'avait fait que pour les industries qui agissent sur les choses, pour l'art agricole, les manufactures, le commerce, j'ai à le faire [II-406] pour l'art médical, la gymnastique, l'enseignement, le sacerdoce, le gouvernement, et en général pour toutes les professions qui s'exercent immédiatement sur les hommes. J'ai à chercher en quoi consistent ces professions, quel rôle elles jouent dans l'économie sociale, de quelle manière chacune d'elles concourt au mouvement de la société, à quelles causes se lie sa puissance, et comment s'y appliquent les principes généraux de la liberté.
Considérés en eux-mêmes et dans leur nature, les arts dont il s'agit ici ont une certaine analogie avec celui dont il a été question dans le dernier chapitre, et qui s'occupe de la culture des plantes et des animaux. Ils font usage, en effet, de la même puissance occulte, et, comme l'art agricole, ils ne peuvent opérer leurs transformations qu'avec le secours de la vie. Ils ont, il est vrai, mille moyens d'agir chimiquement et mécaniquement sur l'homme, d'affecter ses organes extérieurs et intérieurs; mais il n'est pas d'agens chimiques ou mécaniques dont l'action puisse suffire aux résultats qu'ils se proposent d'obtenir. Le seul effet de ces agens est de stimuler les forces que l'homme porte en lui-même, et ce n'est qu'à l'aide de ces forces qu'ils parviennent à le façonner. Ils ont besoin, pour perfectionner ses membres et ses organes, du secours de la vie organique; ce n'est que par l'intervention de ses [II-407] facultés affectives qu'ils parviennent à modifier ses penchans, et ils ne trouvent que dans ses forces intellectuelles le moyen de former son intelligence. Ils se servent ainsi, pour élever les hommes, d'agens analogues à ceux dont le cultivateur fait à usage pour dresser les animaux. Seulement, comme dans l'homme, ces agens, et surtout ceux qui constituent la vie intellectuelle et affective, sont d'une nature infiniment plus forte et plus épurée: on en obtient des résultats infiniment plus considérables. De tous les arts qu'exerce le genre humain, ceux qu'il exerce sur lui-même sont peut-être les plus féconds en grands et en bons effets.
§ 2. Quand on ne voudrait considérer les arts qui agissent sur les hommes que dans leur rapport avec les industries qui travaillent sur la matière, on ne pourrait se refuser à leur reconnaître un très-haut degré d'importance. On sait en effet que la première condition de liberté pour ces industries, c'est que les hommes qui les veulent exercer soient aptes à cet exercice, qu'ils aient de la santé, de la vigueur, de l'adresse, de l'intelligence, de l'instruction, des lumières, des moeurs, de bonnes habitudes civiles, et voilà proprement ce que travaillent à leur procurer les professions élevées et nombreuses dont nous avons maintenant à nous occuper.
[II-408]
Autant les industries qui s'exercent sur la nature morte sont favorables à la culture des hommes, autant celles qui s'occupent directement de leur culture contribuent à l'avancement de celles qui ont pour objet l'exploitation du monde matériel. Alors même qu'on voudrait tout subordonner aux progrès de celles-ci, il faudrait donc encore attacher le plus grand prix au perfectionnement de celles-là.
Mais ce n'est pas seulement parce qu'elles nous rendent capables d'agir sur la nature avec plus de puissance, que les industries qui s'occupent de l'éducation physique, intellectuelle et morale de l'homme, méritent de nous intéresser : elles le méritent pour elles-mêmes et pour les biens directs dont elles nous font jouir.
Il y aurait plaisir à se sentir fort, dispos, adroit, agile, alors même que le bon état de nos facultés corporelles ne serait pas, dans toute profession, un élément essentiel de succès.
Il-y aurait honneur et gloire à posséder un esprit cultivé, quand on ne voudrait faire servir ses connaissances à l'exercice éclairé d'aucune espèce d'industrie.
Il y aurait élévation, dignité, bonheur dans la pratique de la vertu, quand même il ne serait pas indispensable pour réussir dans un art quelconque, pour l'exercer avec honneur et avec fruit, d'être [II-409] en état de réprimer ses mauvais penchans et de s'abstenir de toute entreprise injuste.
En un mot, le perfectionnement de nos facultés est par lui-même un bien véritable; il est le premier et le dernier des biens; il est l'objet final de tous nos efforts; les industries qui agissent sur les choses ne sont importantes que parce qu'elles concourent à la conservation et au perfectionnement de l'espèce humaine; et, par conséquent, celles qui ont l'homme pour objet immédiat et direct, quand même elles ne seraient pas aussi indispensables qu'elles le sont au succès de toutes les autres, devraient être encore l'objet de l'intérêt le plus vif et le plus élevé:
Parlons d'abord de celles qui: agissent sur le corps de l'homme.
§ 3. Si je ne voulais accorder dans cet ouvrage aux industries qui s'occupent du perfectionnement de l'homme physique qu'une place proportionnée à l'intérêt qu'y attache en général la société, j'aurais, il me semble, assez peu de chose à en dire. Il est digne de remarque, en effet, que la partie de nous-même que nous aimons ordinairement le plus est précisément celle que nous cultivons le moins. Quelque imparfaite que puisse être encore l'éducation que nous donnons à nos facultés affectives, et même celle que reçoit notre intelligence, [II-410] ces deux sortes d'éducation sont pourtant fort supérieures à celle dont en général notre corps est l'objet.
Il y a dans la société des professions qui se proposent expressément de nous apprendre à régler nos sentimens; il y en a plus encore qui entreprennent de perfectionner notre esprit : à peine peut-on dire qu'il y eri ait qui aient véritablement pour objet la culture et le perfectionnement de notre nature physique. La médecine se propose plutôt de réparer nos maux, qu'elle ne songe à les prévenir en nous soumettant à un sage régime et en travaillant de bonne heure à nous donner une bonne constitution. La danse, l'escrime, l'équitation, sont des arts peu généralement cultivés; et qu'on apprend plutôt pour se distinguer, ou pour obéir à l'usage, ou pour être à même de se procurer de certains plaisirs, que dans la vue de perfectionner ses facultés corporelles.
Il arrive ainsi que notre corps, qui est pourtant de notre part l'objet d'une affection si partiale, pour lequel il nous arrive si souvent de sacrifier nos plus nobles facultés, aux appétits duquel nous faisons tant de sacrifices, pour qui nous mettons en mouvement tant d'industries, qui est pour notre ame un sujet si constant de trouble, de souci, d'inquiétude, d'agitation, de perplexité, se trouve, d'une autre part, et sous les rapports les [II-411] plus essentiels, l'objet de l'incurie la plus complète et véritablement la plus étrange.
On ne peut nier, sans doute, qu'il ne soit mieux traité, à beaucoup d'égards, qu'il ne l'était aux époques antérieures de la civilisation, qu'il ne soit mieux pourvu des choses nécessaires à son existence, que nous n'ayons écarté de lui une foule de causes de souillure et d'altération, qu'il n'ait infiniment plus de chances de vie et de durée qu'il n'en avait dans l'état sauvage; mais il faut avouer en même temps que, faute d'exercer et de développer comme il conviendrait les facultés qui lui sont propres, nous lui faisons perdre en grande partie les avantages d'une si heureuse position. On dirait que la civilisation ne tend à le délivrer de l'excès du travail que pour le faire tomber dans l'excès de la mollesse.
Il est digne de remarque, en effet, que dans le temps où nous rendons notre esprit capable des exercices les plus forts et les plus difficiles, nous n'apprenons à tirer de notre corps presque aucun parti : nous ne pouvons nous soutenir à une hauteur de quelques pieds sans éprouver des vertiges; nous nous noyons dans le moindre courant d'eau; nous serions réduits, dans une multitude de cas, à voir périr les êtres qui nous sont les plus chers' sans être en état de leur porter utilement aucune assistance. Monier à l'extrémité d'une échelle un [II-412] peu haute, grimper au sommet d'un arbre ou d'un mât, glisser le long d'une perche ou d'une corde, franchir un précipice sur une poutre mal assurée, traverser un fleuve à la nage, sauver une personne qui se noie : voilà des actions qui, chez les peuples cultivés, dépassent les forces de la très-grande généralité des hommes; il y a même comme une sorte de honte attachée à la recherche des talens qui nous permettraient d'exécuter ces actions; et je ne sais si la vie civile, qui nous perfectionne et nous fortifie sous tant de rapports, ne nous a pas fait perdre sous celui-ci, au moins jusqu'à ce moment, une partie des pouvoirs que nous avions à des époques d'une culture beaucoup moins parfaite [178] .
Il est vrai que d'abord cela ne pouvait guère manquer d'arriver ainsi. Tant que l'homme fut environné d'obstacles, et que, pour les vaincre, il se trouva réduit à l'usage de ses seules forces musculaires, il dut nécessairement exercer beaucoup ces forces et en faire un usage très-étendu. Mais [II-413] à mesure que les obstacles furent aplanis, ou que les moyens artificiels de les surmonter devinrent moins rares, on sent qu'il dut se servir moins de ses membres, et remplacer graduellement leur usage par celui des instrumens qu'il s'était procurés.
Ce n'est pas par choix qu'un sauvage franchit de longs intervalles à pied, ou qu'il passe à la nage le fleuve qui barre sa route, c'est parce qu'il n'a pas de meilleurs moyens de se transporter. S'il avait un canot, il ne passerait pas le fleuve à la nage ; s'il avait une monture, il ne prendrait pas la peine d'aller à pied; s'il avait une échelle, il ne se fatiguerait pas à grimper sur l'arbre dont il veut
à cueillir le fruit. Il n'est pas dans la nature de l'homme de se donner une peine inutile : on sait qu'il est déjà assez malaisé d'obtenir de lui les efforts nécessaires.
On doit donc peu s'étonner.qu'il exerce moins ses forces physiques à mesure qu'il y est moins obligé; et l'on comprend comment la civilisation, écartant les dangers et les difficultés de sa route, multipliant devant lui les moyens d'action, l'entourant d'aisances et de facilités de toute espèce, a pu lui faire négliger la culture de ses facultés corporelles, et le faire tomber à cet égard dans une sorte d'infériorité, ou du moins empêcher qu'il ne fît sous ce rapport les mêmes progrès que sous beaucoup d'autres.
[II-414]
Cependant, c'est là un mal considérable et indubitablement contraire aux résultats que la civilisation se propose d'obtenir. Il ne saurait entrer dans ses vues de sacrifier une partie de notre être au développement de l'autre, et de ne perfectionner nos facultés morales qu'au détriment de nos forces physiques. Si nous laissons notre corps s'énerver, si nous tombons dans la langueur et la mollesse, c'est par un abus évident des biens qu'elle nous donne, et contrairement à ses vœux et à ses besoins les plus certains. Il est dans ses vœux que l'homme cultivé se distingue de l'homme inculte par la beauté, la vigueur, la grace, l'harmonie de ses traits et de ses formes, non moins que par la supériorité de ses facultés intellectuelles.
J'ajoute qu'il est dans ses besoins que l'homme demeure robuste, en même temps qu'il devient intelligent et moral. Les conquêtes de la civilisation ne peuvent être conservées que par les moyens qui ont servi à les faire. Quand tous ses ennemis auraient été vaincus, le courage serait nécessaire pour empêcher qu'il ne s'en élevât d'autres. Quand tous les procédés imaginables auraient été trouvés, l'intelligence qui aurait présidé à leur invention serait encore indispensable pour en régler l'usage. Quand nous n'aurions plus besoin de force musculaire pour faire ce que nos machines font, nous en aurions besoin pour faire nos machines.
[II-415]
Et puis, nous avons eu beau perfectionner nos moyens d'agir, nous sommes loin encore d'avoir écarté de tous les travaux le péril et la fatigue. Il est une multitude de professions dans lesquelles le sang-froid., l'aplomb, l'agilité, l'adresse, le cou-, rage, sont toujours des qualités indispensables. Il en est beaucoup d'autres qui demandent une grande vigueur de corps. Il n'en est pas qu'on n'exerce mieux, avec des organes fermes et sains qu'avec une constitution faible et languissante. Moins certaines classes sédentaires de travailleurs font usage de leurs forces corporelles, et plus elles auraient besoin de les entretenir, afin d'éviter que la nature de leurs travaux ne les dégrade.
D'ailleurs, quand on n'aurait pas besoin de ces forces pour l'exercice de sa profession, ne seraient-elles pas encore à rechercher comme une ressource bonne à tenir en réserve contre les dangers et les accidens imprévus ? Quelles que soient les précautions qu'a imaginées notre prévoyance et les moyens de conservation dont nous nous sommes entourés, il n'est que trop possible encore de voir notre vie ou celle de nos semblables exposée à des périls plus ou moins graves; et personne n'est assuré de ne pas se trouver, d'un moment à l'autre, dans une situation où il serait heureux d'avoir un bon fond de vigueur ou d'adresse. corporelle à mettre à son service ou au service d'autrui.
[II-416]
Après cela, on n'aurait ni travaux à faire, ni périls à redouter, ni services à rendre ; il ne resterait qu'à jouir des biens que la civilisation fait naître, qu'il serait encore, et pour cela seul, fort avantageux de posséder un corps robuste et sain. Plus la vie devient bonne, et plus il importerait de l'avoir dure. Il faut d'ailleurs de la force et de la santé pour jouir des biens que procure la civilisation. Il en faut plus encore pour user de ces biens avec mesure : notre corps, qui languit dans les privations, n'est guère moins sujet à s'énerver au sein d'un trop grand bien-être; et l'on a remarqué dès long-temps que s'il fallait de la vigueur pour résister aux fatigues de la guerre, il n'en fallait pas moins pour supporter les loisirs de la paix.
Enfin, ces facultés méritent d'être cultivées pour elles-mêmes; pour le plaisir qu'on trouve à les sentir, à les exercer; parce qu'elles forment une partie des perfections dont notre être est susceptible; parce qu'elles servent d'instrument à l'activité, au dévouement, au courage, et qu'elles sont comme le support et la base de nos facultés les plus élevées.
On observera peut-être qu'il n'est pas possible de développer à la fois à un haut degré nos forces physiques et nos facultés intellectuelles. On dira que, n'étant doués que d'un certain degré d'énergie totale, nous ne pouvons diriger cette énergie vers [II-417] nos membres, sans la dérober à notre intelligence; qu'il est très-rare de voir un athlète homme de génie; qu'Hercule n'a pas l'esprit d'Apollon, Apollon la force d'Hercule, etc.
Il faut s'entendre : sûrement, si l'on voulait diriger l'éducation de manière à perfectionner pardessus tout les forces musculaires, il serait fort à craindre qu'on ne nuisît au développement des facultés affectives et mentales. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nul doute qu'il ne faille conserver à l'esprit et au sentiment leur prééminence; nul doute que notre intelligence et nos penchans ne soient de nos facultés celles qu'il importe le plus de développer et d'apprendre à bien conduire'; mais loin qu'une bonne éducation physique s'oppose à la culture de nos autres facultés, il est certain qu'elle la favorise. Il s'agit moins de dérober du temps aux exercices de l'esprit que de mieux employer les intervalles de repos qu on lui accorde, que de savoir faire servir ces heures de relâche à l'éducation du corps.Ce n'est qu'en exerçant alternativement les organes de la locomotion et ceux de la pensée que nous pouvons donner à ces deux ordres de facultés le degré de développement et de perfection dont elles sont naturellement susceptibles.
En effet, chacune d'elles ne profite pas seulement de l'éducation particulière qu'elle reçoit : elles se fortifient les unes par les autres. Si [II-418] l'énergie morale ajoute aux forces corporelles, les forces corporelles à leur tour soutiennent l'énergie morale. S'il faut exercer son esprit pour savoir tirer parti de son corps, nul doute qu'en entretenant les forces de son corps, on ne facilite beaucoup l'action de ses facultés intellectuelles.
Quoi de plus propre, par exemple, je ne dirai peut-être pas à donner du courage, mais à stimuler le courage qu'on a, que le sentiment d'une grande vigueur physique, unie à beaucoup d'adresse et d'agilité ? Et quant à l'intelligence, combien d'exemples n'a-t-on pas d'individus dont les facultés mentales, troublées par une excitation trop vive ou trop soutenue, ou bien devenues inactives par suite du dépérissement général du corps, ont été ramenées à l'état normal en détournant vers les organes de la locomotion la vie qui s'y portait avec trop de force, ou bien ranimées par des exercices qui rendraient au corps la vigueur et la santé?
Ainsi, en admettant, comme de raison, qu'il faut surtout faire de l'homme un être intelligent et aimant, nul doute qu'il ne faille s'occuper aussi d'en faire autant que possible un être sain, beau, bien fait, agile, adroit, vigoureux, et que les soins à donner à cette partie de son éducation ne puissent très-bien se concilier avec ceux que réclament les autres.
Parlons donc ici des industries qui se chargent de la culture de l'homme physique, et ne craignons [II-419] pas d'accorder dans cet ouvrage quelque place à des arts qui en occupent ou du moins qui devraient en occuper une très-considérable dans la société.
§ 3. Toutes les industries, quelles qu'elles soient, concourent'à la perfection de toutes les facultés de l'homme. Par conséquent, toutes concourent à la perfection de ses facultés physiques, même celles qui n'agissent pas directement sur lui, celles qui s'exercent sur la matière, et dont l'objet immédiat est d'approprier les choses à ses besoins. On sait à quelles causés de dégradation et d'infirmité il peut se soustraire, quelles sources de vigueur et de santé il peut s'ouvrir seulement en modifiant les lieux qu'il habite, les alimens dont il se nourrit, les vêtemens dont il se couvre. Il en est de l'espèce humaine comme des autres espèces animales, qui deviennent plus belles par cela seul qu'elles sont mieux soignées. Il arrive toujours qu'une population gagne en force et en beauté à mesure qu'elle acquiert plus de bien-être. On sait combien, en général, il est plus rare de trouver parmi les classes pauvres, que dans les familles aisées, des personnes distinguées par la délicatesse des traits ou la régularité des formes. M. Simond dit avoir remarqué en Angleterre, que la classe des gentlemen est plus belle et plus forte que celle du bas peuple, et non-seulement du bas peuple des [II-420] villes, mais de celui des campagnes [179] . On a observé qu'en France, depuis cinquante ans, l'espèce humaine s'était singulièrement embellie, qu'on n'y, voyait presque plus d'enfans naître difformes ou contracter des difformités en bas âge; et l'on a trouvé surtout la raison de ce changement dans la prospérité croissante de la population, qui lui a permis d'avoir des habitations plus salubres, des vête-, mens plus propres, des alimens plus sains, de mener, sous tous les rapports, une vie plus hygiénique [180] . Mais j'ai suffisamment parlé des arts auxquels l'homme doit tous ces moyens extérieurs d'aisance; qui contribuent d'une manière, si puissante à sa conservation et à son perfectionnement. Je n'ai à m'occuper ici que de ceux qui agissent immédiatement sur sa personne, et parmi ceux-ci même, les seuls dont je veuille parler en ce moment sont ceux qui ont sa personne physique pour objet.
Ces derniers sont fort nombreux et fort divers, et il serait également difficile d'en faire une énumération exacte et de trouver un nom qui les embrassât tous. En désignant les arts du médecin, du chirurgien, de l'oculiste, du pédicure', du dentiste, [II-421]
du gymnasiarque, du maître d'escrime, de natation, de danse, d'équitation, je ferais une énumération fort longue, et ne serais pas sûr d'avoir fait une énumération complète.
Il est, en effet, des moyens puissans d'agir sur le corps de l'homme qui ne paraissent pas compris au nombre des arts que je viens de nommer! 1. La médecine, par exemple, qui est très-généralement exercée comme art de guérir, ne l'est que très-peu dans ses rapports avec l'objet particulier de ce chapitre, c'est-à-dire comme moyen d'élever et de maintenir le corps de l'homme à son meilleur état de conformation et de santé. De toutes les parties de l'art médical, l'hygiène, qui pourrait être la plus efficace, est sans contredit la moins "pratiquée.
Elle ne l'est pas surtout dans celui de ses moyens qui paraîtrait susceptible de donner les résultats les plus favorables. Si l'on a quelquefois recours à elle pour agir sur les générations déjà nées, on ne lui demande pas encore comment il serait possible d'agir sur les générations à naître. Quelques parens la consulteront peut-être sur les moyens de corriger dans leur progéniture certains vices de conformation, de modérer l'action trop vive de quelques organes, d'accélérer le jeu trop lent de quelques autres, d'établir entre toutes les fonctions cet équilibre et cette harmonie d'où résulte la santé [II-422] parfaite; mais un homme ne lui demandera pas, ayant de se marier, comment il doit diriger son choix pour améliorer sa race, à quel tempérament il lui importe d'unir le sien, par quelle alliance il pourrait éviter de transmettre à sa postérité certaines prédispositions fâcheuses. Après nous être, on ne peut plus curieusement occupés, observe un illustre physiologiste [181] , des moyens de rendre plus belles et meilleures les races des animaux ou des plantes utiles et agréables; après avoir remanié cent fois celle des chevaux ou des chiens; après avoir transplanté, greffé, travaillé de toutes les manières les fruits et les fleurs, nous n'avons absolument rien fait pour améliorer la race de l'homme.
Et pourtant, il est impossible de ne pas considérer le croisement des races comme un des moyens les plus énergiques que l'espèce ait d'agir sur elle-même.
Telle est l'influence de cette pratique, qu'un petit nombre de familles qui voudraient ne s'allier qu'entre elles, concentrant par là dans leur sein toutes les infirmités héréditaires qu'elles pourraient avoir, ou que le temps les exposerait à contracter, et faisant entre elles un échange continuel de leurs difformités et de leurs vices, seraient infailliblement [II-423] dégénérées au bout de très-peu de générations.
C'est même là, pour l'observer en passant, une des causes qui minent le plus profondément le système monarchique de notre vieille Europe, système dans lequel un petit nombre de maisons souveraines, pour se mieux séparer du reste de l'humanité, ont adopté l'usage de ne s'allier qu'entre elles, et par cela même se sont exposées à rendre communes à tous leurs membres les imperfections naturelles dont quelques-uns d'entre eux pourraient naître accidentellement affectés.
Tels sont, pour ces augustes familles, les inconvéniens d'un tel usage, qu'il a fallu qu'elles fussent douées dans l'origine d'une constitution physique et morale bien particulièrement distinguée, pour que, sans jamais aller puiser une nouvelle vie à la source commune, et sans aucune infusion frauduleuse de sang plébéien, elles aient pu se conserver belles, nobles, intelligentes, dignes en un mot de la haute situation où elles sont placées. Il n'eût pas été possible sans cela que la loi qui préside à leurs alliances ne leur fît pas subir de profondes altérations [182] .
[II-424]
Il a été facile de voir, dans des rangs moins élevés, à quelle dégénération inévitable on est exposé sous l'influence d'une telle loi. On ne peut douter que le préjugé qui, de tous temps en Europe, a défendu aux races aristocratiques de rechercher en mariage des personnes qui ne seraient pas de condition, ne soit une des causes qui ont le plus nui à la durée de ces races. A force de vouloir ne s'allier qu'à des familles de son rang, on circonscrivait tellement le nombre de celles dans lesquelles on pouvait faire un choix, qu'il devenait à peu près impossible d'en faire un bon, au moins pour tout ce qui ne tenait pas à la naissance ou aux richesses.
Aussi l'on sait combien de grandes familles se [II-425] sont éteintes avec tous les moyens de fortune propres à les soutenir; combien d'autres ne se sont soutenues que par des unions illégitimes ou à la faveur de mariages roturiers. Certains grands seigneurs étaient intéressés sous plus d'un rapport à contracter de ces utiles alliances. Perdus de dissipation et de débauches, également ruinés dans leur fortune et dans leur santé, ils avaient pour le moins autant besoin de renouveler leur sang que de fumer leurs terres.";
Chez les peuples orientaux, les maîtres, qui ne se dirigent pas dans leurs mariages par les préjugés de l'aristocratie d'Europe, et qui ne dédaignent pas de faire des femmes de leurs esclaves, quand elles sont belles, paraissent avoir par là agi très utilement sur leur postérité. On assure que chez les Turcs et les Persans, cette coutume, observée depuis plusieurs siècles, à en quelque sorte change l'espèce; et peut-être la même cause avait-elle contribué jusqu'à un certain point à donner aux anciens Grecs cette beauté presque idéale de formes que nous sommes disposés à croire qu'ils avaient en les jugeant d'après leurs statues.
Quoique la physiologie n'ait pas encore dirigé ses recherches vers les effets qu'il nous est possible de produire sur nous-mêmes par le mélange des couleurs, des formes, des tempéramens, on croit savoir pourtant que la fusion d'une certaine quantité [II-426] de sang indien et même africain avec le nôtre peut opérer de bons effets. Des voyageurs assurent que les Hispano-Américains, dont les pères se marie. rent d'abord à des femmes indiennes, et mêlèrent quelque temps leur sang à celui de la race cuivrée, forment aujourd'hui, sous le rapport de la blancheur du teint et de l'élégance des formes, une race supérieure à celle des Espagnols. D'autres ont observé qu'il était peu de races plus belles que les races produites par un mélange de sang blanc avec du sang noir déjà coupé à plusieurs reprises.
Il paraît que les diverses nuances de notre race pourraient aussi s'allier entre elles avec beaucoup de profit pour leur commune amélioration. Il serait difficile, dit-on, de voir de plus belles créatures que les femmes de certaines villes du midi de l'Es, pagne, venues d'un mélange du sang espagnol avec celui d'hommes blonds du nord de l'Europe que le commerce a attirés dans ces villes à diverses époques, et qui ont fini par s'y établir [183] ) .
Enfin, il y aurait peut-être autant d'avantages à marier entre eux les tempéramens divers que Jes couleurs diverses ; et des physiologistes éclairés pensent que l'alliance des humeurs contraires, et, par exemple, des tempéramens lymphatiques avec les tempéramens bilieux, serait le meilleur [II-427] moyen d'effacer ce qu'il y a d'excessif daps les prédominances qui les distinguent. Il n'y a donc pas moyen de douter que le croisement des races, que l'art médical n'a pas encore compris au nombre de ses moyens pratiques d'agir sur le corps humain, ne soit un des plus puissans qu'il y eût de modifier et de perfectionner sa nature.
J'en pourrais dire autant de l'exercice, qui a été beaucoup mieux apprécié, et dont néanmoins on est encore loin de tirer autant de parti qu'on le pourrait faire.
Si nous sommes fondés à supposer que les peuples militaires de l'antiquité devaient quelque chose de la beauté de leurs formes à la faculté que leur donnait la victoire d'épouser les plus belles femmes qui pouvaient se trouver parmi les peuples vaincus, il y a lieu de croire qu'ils étaient encore plus redevables de cet avantage aux exercices du gymnase et à l'habileté avec laquelle ces exercices étaient dirigés.
L'effet de l'exercice, suivant les physiologistes, est d'appeler le sang et la vie dans les parties du corps qui sont le siège des contractions muscu lạires qu'il provoque, de faire prendre du volume à celles qu'il met ainsi en action, d'en faire perdre à celles qu'il laisse en repos, et d'influer par là très-sensiblement sur les proportions des unes avec les autres. On peut, en quelque sorte, par [II-428] la manière de le diriger, développer telle partie du corps que l'on veut, les muscles des jambes ou des bras, ceux des épaules ou de la poitrine. On à observé que, chez les danseurs de profession, les jambes, les cuisses et surtout les fesses prennent un accroissement marqué aux dépens du torse, du cou, du bras et de l'avant-bras ; que, chez les marins, les forgerons et les forts des balles, au contraire, les bras, les épaules et la poitrine sont très-développés aux dépens des fesses et des membres abdominaux; qu'enfin, chez les hommes qui, sans exercer spécialement aucun de leurs membres, s'occupent avec soins de l'éducation de tous, chaque partie du corps se développé de manière à contribuer aux proportions régulières de l'ensemble.
Ensuite, si l'exercice peut agir à ce point sur la forme des parties qu'il affecte, il n'influe pas moins-sur-leur vigueur. Il n'est pas rare de voir, dans des gymnases, des hommes qui, d'abord, ne pouvaient rester que quelques secondes suspendus par les mains à une corde ou à une perche, acquérir par l'exercice le pouvoir de soutenir ainsi le poids de leur corps, avec les seules phalanges de leurs doigts, pendant vingt-cinq, trente et trente-cinq minutes; on en voit devenir graduellement capables de sauter par-dessus des cordes tendues à sept et huit pieds d'élévation ; de s'élancer sans échelle, sur des murailles hautes de dix pieds ; [II-429] de franchir, d'un bond, des fossés de dix-huit et vingt pieds de large.
Enfin, un dernier effet de la même cause est de développer la souplesse et l'agilité dans les muscles où elle peut ainsi faire naître la force. Il n'est personne qui ne sache par expérience qu'en répétant plusieurs fois, et avec des intervalles de repos, un certain mouvement, on développe dans le muscle où ce mouvement s'opère une facilité d'action qui n'y était pas auparavant. Les effets qu'il est possible d'obtenir par-là semblent quelquefois tenir du prodige. Il ne faut que voir un danseur agile executer ses, pas, un subtil escamoteur faire ses tours d'adresse, un pianiste exercé jouer un air sur son instrument, pour juger du degré de précision, de sûreté, de rapidité d'action que l'exercice peut faire acquérir à nos muscles.
Et ce n'est pas seulement sur les parties extérieures du corps que l'exercice agit avec une grande puissance ; c'est aussi sur nos organes intérieurs, Il est dans la vie organique beaucoup de désordres, surtout dans la classe de ceux qui tiennent à des vices extérieurs de conformation, qu'on ne peut faire cesser que par un usage éclairé de l'exercice. On l'a vu produire des effets presque miraculeux sur des jeunes personnes menacées de phthisie, par suite d'une mauvaise, conformation de la poitrine, et pour la guérison desquelles on avait [II-430] épuisé sans fruit toutes les recettes de la thérapeutique et toutes les ressources de la pharmacie. Il est considéré comme un des plus sûrs moyens de guérir les affections scrofuleuses, lymphatiques, rachitiques, atoniques, etc.
Il est vrai que, pour opérer tout le bien qu'il est en son pouvoir de produire, il a besoin d'être employé avec beaucoup d'art et de précautions; qu'il exige plusieurs sortes de connaissances ; qu'il veut que l'on tienne compte de l'âge, du sexe, du tempérament, des habitudes du sujet auquel ill s'agit d'en faire l'application, de l'état actuel de ses forces, du lieu, de la saison, des heures de la journée où l'on veut le faire agir.
Mais enfin, employé comme il est susceptible de l'être, l'exercice est, après le mélange des races, sans contredit le plus puissant moyen dont l'homme puisse user pour améliorer sa nature physique, pour donner à ses membres de la grace, de la vigueur, de la flexibilité, de l'adresse, de l'agilité, et aussi pour perfectionner ses organes intérieurs; car, outre que ses viscères se développent par une sorte de gymnastique, ainsi que ses membres, la structure et le jeu de ces organes dépend beaucoup, comme nous venons de l'observer, des formes extérieures du corps sur lesquelles il peut influer très-puissamment par l'exercice [184] .
[II-431]
Il est plus aisé de perfectionner nos facultés ou d'empêcher qu'elles ne se détériorent, que de les ramener à l'état sain une fois qu'elles sont altérées : la médecine proprement dite ne procède pas avec autant de sûreté que l'hygiène. Elle n'obtient pas non plus des résultats aussi satisfaisans : car, s'il est heureux de guérir, il serait plus "heureux encore de ne pas devenir malade, et l'art qui écarte de nous la maladie est indubitablement plus précieux que celui qui essaie seulement de nous en délivrer.
Aussi, quand ce dernier remplirait son objet mieux qu'il n'est en son pouvoir de le faire ; quand il aurait moins varié dans l'explication des désordres qui peuvent survenir dans notre machine, et dans le choix des moyens les plus propres à les réparer; quand ses connaissances seraient plus [II-432] certaines et, dans bien des cas, ses procédés moins hasardeux, semblerait-il difficile, au premier abord, de le comprendre au nombre des arts qui s'occupent de la culture et du perfectionner ment de notre nature physique.
Cependant, d'un autre côté, l'art médical peut réparer tant de défectuosités naturelles ou accidentelles; il a contre certains maux très-graves, et à peu près inévitables, des préservatifs şi assurés; il contribue à soulager et même à guérir tant de souffrances, qu'il serait impossible de ne pas le ranger parmi ceux qui agissent le plus utilement sur le corps de l'homme, et qui aident le plus à le mettre et à le maintenir en bon état. Il ne faut, pour faire sentir son importance, qu'indiquer quelques-uns des principaux effets qu'il produit.
L'art médical réussit, par des opérations mécani. ques, à guérir la cécité qui provient de la cataracte, la surdité qui résulte de l'épaississement de la membrane du tympan, le mutisme qui tient à la division congéniale de la lèvre supérieure, du palais de la bouche et de la luelté ; il parvient à faire disparaître les courbures vicieuses de nos os les plus forts, même, celles de la colonne vertébrale ; jl restitue à leur état naturel les membres fracturés ou luxés; il va briser dans l'intérieur de la vessie les calculs urinaires qui s'y développent; il [II-433] remédie, par le procédé de l'invagination, aux plaies transversales des intestins, etc. [185] .
Médicalement, il a trouvé moyen de nous dérober à la contagion du virus variolique; il a modifié nos tempéramens de telle sorte que la syphilis semble n'avoir plus sur nous une influence aussi meurtrière et ne pouvoir plus sévir avec la même fureur; il a des spécifiques à peu près infaillibles contre les fièvres intermittentes, et des remèdes plus ou moins efficaces contre beaucoup d'autres maladies, etc. Or, lorsqu'il peut produire sur notre corps des effets si diversement salutaires, comment serait-il possible de ne pas l'admettre au nombre de ceux qui ont pour objet de le conserver et de le perfectionner ?
En somme, il ne faut que rappeler quels étaient, il y a quelques siècles, la fréquence des pestes, les ravages périodiques de la petite-vérole, les traces plus ou moins profondes de son passage que cette cruelle maladie laissait successivement sur la face de toutes les générations, les dévastations non moins grandes et les mutilations encore plus hideuses qu'opérait le mal vénérien, le nombre immense des malheureux qui étaient atteints de rachitisme, de ceux que dévorait la lèpre, de ceux que des humeurs froides faisaient tomber en [II-434] lambeaux, et d'une multitude d'autres dont une multitude d'autres maladies variaient les difformités et les souffrances; il ne faut que mettre en parallèle l'état où la population se trouvait alors et celui où elle se trouve aujourd'hui, pour sentir de quoi sont capables les arts qui se chargent de la culture et du perfectionnement de l'homme physique. Tout nous autorise à croire que les générations présentes sont plus belles et plus saines que les générations passées [186] ; la durée moyenne des existences est plus longue; il faut moins de naissances pour entretenir une certaine population.
Sans doute, ces résultats ne sont pas dus uniquement aux arts qui agissent sur le corps de l'homme. Je sais que beaucoup d'autres ont puissamment concouru à les produire ; mais ceux-là y ont aussi contribué, et ils y ont contribué, quoique le perfectionnement physique de l'espèce n'ait [II-435] jamais été un but qu'ils se soient formellement proposé. On a obtenu jusqu'à un certain point, sans les chercher, et par cela seul que les mariages se sont formés en général entre des personnes mieux portantes et mieux conformées, les bons effets qui résultent du croisement des races. L'exercice a contribué de diverses façons à l'entretien et au développement des forces, quoiqu'on ne lui ait pas demandé de produire cet effet. La vie a été plus hygiénique, sans qu'on ait pensé à se conformer aux préceptes de l'hygiène. L'art médical a embelli l'espèce, en travaillant seulement à soulager ses maux : qu'on songe à l'influence qu'il a exercée sur sa beauté, seulement par la découverte de la vaccine et par le succès avec lequel il a combattu le mal vénérien [187] .
[II-436]
Or, si ces arts ont pu produire de tels effets, pour ainsi dire à leur insu, ou du moins sans qu'on songeât à les faire servir au perfectionnement de notre nature physique, on sent combien, dirigés à cette fin avec intention, avec habileté, avec concert, ils réussiraient mieux à l'atteindre. Aujourd'hui, chaque homme, en ce qu'il a de particulier, n'est en quelque sorte que ce que le font les circonstances fortuites au milieu desquelles il se développe : la diversité des tempéramens, les différences dans la taille, les proportions du corps, les traits du visage, ne sont en général que de purs accidens. Pourtant, en ceci comme en toutes choses, nous pourrions sûrement chercher à diriger à notre plus grand bien les forces de la nature; et il n'est pas douteux que les arts sur lesquels roule ce chapitre ne pussent le tenter avec succès..... Mais j'en ai dit assez pour donner une idée de leur importance et inspirer le désir de chercher les causes générales auxquelles leur puissance est liée.
[II-437]
Ces causes nous sont déjà connues. Elles sont les mêmes que celles d'où dépend la liberté des autres industries. On n'exerce avec facilité et avec succès les arts qui agissent sur le corps humain que par les mêmes moyens généraux qui facilitent, étendent, affermissent la pratique de tous les arts possibles. Il y faut une certaine capacité pour les affaires, de l'aptitude à entreprendre, à fonder, à conduire, à administrer; il y faut de l'instruction pratique, des connaissances théoriques, du talent pour les applications et pour l'exécution; on ne peut douter que le succès n'y dépende beaucoup de l'état des habitudes morales; il est essentiel que les ateliers y soient bien situés et bien montés. Il n'y a de différence que dans l'espèce particulière de notions, d'habitudes, d'instrumens que réclament les travaux de cet ordre, et en général dans la manière dont la nature de ces travaux permet qu'on y applique les divers élémens de puissance que je viens d'énumérer.
§ 3. Ainsi, par exemple, nul doute que, pour le fondateur d'un gymnase ou d'une maison de santé, tout comme pour le chef d'une fabrique, le talent de spéculer ne soit un moyen de succès indispensable.
Qu'un médecin veuille établir un hospice dans un lieu où chacun aura son domicile et les moyens [II-438] de se faire traiter chez soi; qu’un danseur de l'Opéra aille tenir école de danse dans un village et apprendre à des paysans à battre des entrechats ; qu'un maître d'escrime entreprenne d'ouvrir une salle d'armes dans une société de quakers; qu’un professeur de gymnastique s'avise d'offrir des leçons de pugilat à des familles nobles et polies: il est clair que les uns et les autres feront des entreprises absurdes et qui ne pourront manquer d'échouer.
En ceci, comme en tout, l'essentiel d'abord est de savoir ce qu'on peut raisonnablement entreprendre, et quel genre de produits ou de services il est possible de faire accepter à la société. Il ne suffit pas toujours de lui proposer des choses utiles: il faut lui en proposer qu'elle agrée; et pour cela il est essentiel qu'elles rentrent jusqu'à un certain point dans ses goûts, qu'elles tiennent plus ou moins à ses idées et à ses usages.
La gymnastique, telle qu'une philosophie judidicieuse s'est efforcée, depuis quelque temps, de l'accréditer, est sûrement une bonne chose; elle répond à un besoin fondamental de la société; elle tend à développer tout un ordre de facultés que les systèmes établis d'instruction publique et privée laissaient absolument incultes ou ne développaient que très-imparfaitement; et néanmoins combien les personnes qui ont essayé de restaurer parmi nous cette branche essentielle de l'éducation, [II-439] n'ont-elles pas eu de peine à la faire prendre ? La gymnastique, disait-on, était une chose renouvelée des Grecs, sans nul rapport avec nos idées et nos habitudes modernes; et quoique les exercices de M. Amoros fussent fondés sur les mêmes bases que les jeux des enfans, et n'en différassent que par la direction plus éclairée et le plus grand développement qu'il leur avait donnés, il n'avait encore, après dix ou douze ans d'efforts et de soins, réussi que très-imparfaitement à leur concilier la faveur publique.
Quel plus grand service pouvait-on proposer aux hommes que de leur offrir de les préserver des ravages de la petite vérole ? et néanmoins combien le principal inventeur de la vaccine ne trouva-t-il pas d'abord d'obstacles à l'application de sa découverte, et combien, depuis Jenner, n'a-t-on pas eu de peine à la propager ? Je pourrais faire la même remarque sur la pratique de l'inoculation, et sur une foule d'autres procédés utiles, pris parmi ceux qui se rapportent aux arts dont je m'occupe ici.
L'industrieux dont la profession consiste à agir sur le corps humain est donc obligé de rechercher, avant toutes choses, quelles sont les façons que les hommes veulent recevoir, quelles sont les qualités corporelles qu'ils désirent acquérir, et pour cela quels sont les exercices, les procédés, les traitemens [II-440] auxquels ils consentiront à se soumettre. En un mot, il y a ici un ordre de demandes dont il faut nécessairement qu'il connaisse l'état.
Il y a pareillement nécessité qu'il soit instruit de l'état des offres qui sont faites; qu'il sache le nombre et les moyens des concurrens qu'il a; qu'il juge si ce nombre est insuffisant, ou si les moyens qu'ils emploient sont inférieurs à ceux qu'il pourrait mettre en œuvre; qu'il soit en état de déterminer, finalement, s'il y a des chances de succès pour l'officine de pharmacien, pour la maison de santé, pour l'école d'escrime, d'équitation, de gymnastique qu'il aurait dessein d'établir.
J'ai à peine besoin d'ajouter que ces sortes d'établissemens demandent, comme d'autres, à être habilement conduits, et qu'il est iel hospice qui n'exige pas moins de capacité administrative et de talent pour la comptabilité que la fabrique la plus considérable.
Les diverses facultés qui font le véritable homme d'affaires trouvent donc, dans une certaine mesure, le moyen de s'appliquer ici, et peuvent y être considérés comme un élément de puissance très-réel et très-nécessaire.
§ 4. On en peut dire autant des facultés qui se rapportent à l'art.
Nulle part, par exemple, no se vérifie mieux ce [II-441] que j'ai dit de l'importance des connaissances pratiques. Ces connaissances sont ici d'autant plus nécessaires que les secours de la théorie y sont plus bornés et plus douteux. De même que l'industrie agricole, les arts qui agissent sur le corps humain ne peuvent opérer leurs transformations, j'en ai déjà fait la remarque, qu'avec l'aide de la vie, agent mystérieux dont ils ignorent absolument là nature, dont ils ne connaissent que très-imparfaitement les fonctions, et dont, par cela même, il leur est impossible de soumettre l'usage à des principes fixes de théorie.
Dans cet état d'ignorance, ce qu'ils ont de mieux à faire, c'est sans doute d'observer attentivement les faits extérieurs par lesquels cet agent secret se manifeste, de regarder comment il agit dans la santé et dans la maladie, de voir comment son aca tion peut être modifiée par celle des excitans de toute espèce auxquels il est possible de le soumettre, par la chaleur, par le froid, par l'air, par les alimens, par les remèdes, par l'exercice, et d'agir conséquemment à ces indications. Cet empirisme raisonné, tant qu'on n'aura pas trouvé la véritable explication des phénomènes vitaux, sera incontestablement le meilleur guide que l'on puisse suivre.
Cela est si vrai que toute la science médicale des anciens, chez qui pourtant la médecine fut [II-442] exercée avec une grande distinction, se réduisait à des connaissances de cet ordre. Hippocrate, dont les écrits, de l'aveu des médecins les plus éclairés, offrent encore une lecture si profondément instructive, Hippocrate ignorait les sciences que l'on l'on regarde aujourd'hui comme la base de la médecine, et n'avait sur l'organisation et les fonctions du corps humain que des notions peu exactes et peu étendues. Il ne savait en quelque sorte de l'homme que ce qu'en manifestent les phénomènes extérieurs; mais il avait profondément étudié ces phénomènes; il avait attentivement examiné l'action des causes, par lesquelles il est possible de les influencer; et quoique ses connaissances anatomiques fussent au-dessous du médiocre, sa pratique, observe Cabanis, excite encore aujourd'hui l'admiration des plus grands médecins [188] .
Il paraît qu'on en pourrait dire autant de celle de beaucoup de médecins de l'antiquité, qui, à une époque où l'anatomie et la physiologie n'étaient pas encore nées, ne devaient pas être plus anatomistes et plus physiologistes qu’Hippocrate:
« La vraie pathologie, écrit encore Cabanis, se trouve surtout dans les livres des anciens, auxquels un petit nombre d'observateurs modernes ont fait quelques heureuses additions. Hippocrate, Arétée, Alexandre [II-443] de Tralles, Aëtius, Paul d'Egine, Galien, et deux ou trois médecins arabes, nous ont laissé les tableaux les plus exacts que l'art possède encore : aucun homme de bonne foi ne peut en disconvenir ; et leurs règles générales de traitemens, tirées, du moins en général, du sein même de la nature, n'ont pas moins droit de nous étonner par les grandes vues qu'elles supposent que par leur sagesse et par leur éternelle vérité [189] . »
« Les explications des anciens, ajoute le même auteur, quoique formées sur la simple observation de l'homme sain ou malade, sans le secours de l'anatomie, des connaissances physiologiques qui lui sont dues, des expériences, dont l'art était presque entièrement ignoré de leur temps, et des sciences collatérales, qui nous prêtent sans cesse ou des lumières directes, ou des instrumens nouveaux : ces explications n'ont pas toujours été remplacées d'une manière fort heureuse. Il en est plusieurs qui reparaissent de temps en temps avec éclat, et qui semblent devoir survivre à toutes celles qui les ont renversées ; il en est où le sceau de la nature paraît si fortement empreint que chaque nouveau progrès de la science les confirme ; il en est enfin que le bon esprit des pères de la médecine avait laissé dans le vague, et.qu'après tant d'efforts inutiles pour leur donner plus [II-444] de précision, l'on doit peut-être considérer comme devant y rester toujours [190] . »
On peut juger par ces remarques, de l'importance qu'offrent les connaissances pratiques dans les arts qui agissent sur le corps humain. Moins la théorie de ces arts est avancée, et plus on a besoin d'y prendre conseil de l'expérience. Les bons esprits, observe à ce sujet le médecin philosophe que je viens de citer, ne peuvent trop se hâter de se mettre aux prises avec les objets mêmes de leurs travaux. Les médecins de Cos étaient bien loin de penser que la médecine pût s'enseigner du haut d'une chaire, et loin des objets sur lesquels elle doit agir. La vraie manière de l'enseigner est de l'enseigner au lit des malades. Sous les yeux du professeur, et presque sans sa participation, se forment de jeunes médecins dont l’instruction est d'autant plus solide que la nature en fait presque tous les frais. Dans cet exercice continuel de leur sagacité et de leur jugement, à l'aspect de tableaux tout composés de faits, ils contractent l'habitude de les mieux voir, et le dégoût de tout raisonnement qui ne s'y renferme pas [191] .
Si Hippocrate acquit dans la médecine une réputation si élevée, il le dut surtout à une éducation [II-445] médicale toute pratique. Ce fut au milieu des jeux de l'enfance, dit Cabanis, qu'Hippocrate, dont les ancêtres avaient constamment exercé la médecine, depuis dix-sept générations, reçut, de la bouche même de ses parens, les notions élémentaires de cet art. Ce fut à l'aspect des maladies qu'il apprit à les reconnaître; ce fut en voyant préparer et mettre en usage les remèdes qu'il se rendit également familiers leur préparation et leur emploi. Il fut entouré dès le berceau de tous les objets de ses études et suça les principes de son art pour ainsi dire avec le lait maternel [192] .
Au lieu de procéder comme le fit Hippocrate, nous suivons une méthode en quelque sorte opposée. L'observation des faits est la dernière chose à laquelle nous arrivons, et c'est surtout par l'étude des théories médicales qu'on se prépare parmi nous à la pratique de l'art de guérir. La fréquentation des hôpitaux n'est sûrement pas défendue, mais elle n'est pas non plus exigée, et il peut très-bien arriver qu'un jeune homme reçoive le diplôme de médecin sans avoir vu un malade, sans avoir assisté à une opération, sans avoir préparé ou administré un remède, sans avoir appris à connaître une maladie ailleurs que dans des cours ou dans des livres.
Cette manière de préparer à la pratique de la [II-446] médecine est-elle faite pour inspirer une grande sécurité? Ne vaudrait-il pas mieux avoir affaire à une sœur d'hôpital, bien ignorante sous le rapport de la théorie, mais qui aurait vu et soigné beaucoup de malades, qu'à un jeune gradué qui n'aurait vu ni traité de maladies, pour si riche qu'il fût d'ailleurs de connaissances théoriques ? On impose aux étudians l'obligation de suivre les écoles, et on leur laisse la faculté de fréquenter les hôpitaux : il semble que l'inverse serait plus sage, et que si la société devait exiger quelque chose des hommes qui se destinent à donner des soins aux malades, ce serait surtout que d'avance ils eussent observé et vu traiter beaucoup de maladies. Entre l'étude de la pratique et telle de la théorie, c'est évidemment le premier travail qu'il faudrait rendre obligatoire, et le second qu'on pourrait laisser facultatif.
Au reste, quelque importante que puisse être ici la connaissance pratique du métier, il n'est pas douteux que les notions de théorie n'y soient un élément très-réel de puissance. Il est impossible qu'il n'y ait pas quelque avantage pour les industrieux qui agissent sur le corps de l'homme, à posséder des notions exactes sur l'organisation de la machine humaine, et sur les fonctions que cette machine accomplit, ignorât-on d'ailleurs la nature du principe qui la fait agir et la manière dont cet agent procède.
[II-447]
Il est vrai que les gymnastes grecs formaient de très-bons coureurs, quoiqu'ils ne fussent pas physiologistes : cependant il paraît que la physiologie fournit, relativement aux mouvemens dont se compose la course, quelques notions propres à bien diriger cet exercice et à en augmenter la vitesse et la durée.
La médecine d'observation, l'empirisme philosophique peut guérir beaucoup de maux sans le secours de la physiologie : et néanmoins les médecins les moins disposés à exagérer l'importance de cette science avouent que la médecine doit aux progrès des connaissances anatomiques et physiologiques la marche plus hardie et plus ferme qu'elle a suivie depuis que ces progrès ont commencé.
On en peut dire autant de la chirurgie.
« Ce ne fut, observe Cabanis, qu'à la naissance de l'anatomie, à l'époque où Vessale secoua le joug du galénisme et des écoles, qu’aidée de la physique, qui se frayait elle-même alors des routes nouvelles, la chirurgie prit ce vol hardi qui l'a conduite depuis de découvertes en découvertes et de sucċès en succès. L'anatomie, ajoute le même écrivain, servant de base à l'art de guérir, surtout à sa partie chirurgicale, paraît maintenant inséparable de la pratique de cet art, dont elle assure souvent les succès [193] . »
[II-448]
A la vérité, il serait assez difficile de dire dans quelle mesure elle a contribué à en affermir, à en faciliter l'exercice. Il paraît qu'il n'existe point d'ouvrage où l'on ait tenté de déterminer d'une manière détaillée et précise l'influence que l'anatomie, la physiologie, et plusieurs sciences collatérales, ont exercée sur la pratique des arts qui ont le corps de l'homme pour objet. Mais cette influence, quoiqu'elle n'ait pas été exposée ex professo, ne laisse pas d'être très-réelle, et il n'est pas de médecin ou de chirurgien un peu instruit qui ne pût aisément citer des cas où elle se fait utilement sentir.
Il est, par exemple, des circonstances où il devient très-essentiel de pouvoir faire la ligature d'une artère; et cependant la chirurgie n'osait tenter autrefois cette opération, de peur que le sang n'allât plus vivifier le membre où cette artère se rendait : la découverte anatomique du système capillaire et de la propriété que les vaisseaux capillaires ont de se dilater, a permis d'exécuter cette opération que jusqu'alors on avait regardée comme impraticable.— Il se développe quelquefois dans de certaines parties du corps des tumeurs fongueuses causées par l'engorgement des canaux par où les glandes exécutent leurs secrétions : avant que l'on connût ces canaux et leur usage, on ne savait à quoi attribuer ces tumeurs, ni par quels moyens [II-449] les guérir : l'anatomie et la physiologie, en découvrant la cause du mal, ont mis sur la voie du remède. — On supposait faussement autrefois que les phénomènes de la nutrition ne pouvaient s'accomplir au sein de l'inaction et de l'immobilité, et, en conséquence, on condamnait le repos dans le traitement des difformités du système osseux, et spécialement dans celui des courbures vicieuses de la colonne vertébrale ; on se fondait sur ce prétexte spécieux que la maladie provenant de faiblesse, il ne fallait pas augmenter cette faiblesse par une inaction prolongée, et, par suite de cette erreur, on plaçait derrière le tronc une croix de fer dont la tige verticale descendait de l'occiput au sacrum, tandis que la tige horizontale s'étendait d'une épaule à l'autre ; c'était un nouveau poids ajouté à celui dont on voulait soulager la colonne vertébrale, et l'état de station devenait plus pénible encore pour le malade, chargé de ce poids additionnel, et gêné dans ses mouvemens par les liens nécessaires pour y attacher solidement le tronc et la tête : des idées plus saines sur les effets de l'immobilité relativement à la nutrition et à l'accroissement des forces, ont fait abandonner ce procédé; au lieu d'ajouter à la charge de la colonne vertébrale, on la débarrasse maintenant du poids du corps, et l'on remédie à la déviation par une [II-450] traction lente et graduée, dont l'action est infiniment plus efficace [194] . – La physiologie ne sait pas comment le chagrin peut provoquer la formation de tubercules dans les poumons: mais ces tubercules une fois formés, elle expliqué fort bien la gêne qu'ils causent dans la respiration et dans la circulation.—La même science ne peut pas dire en quoi consistent les nombreuses variétés des affections du cœur: mais ces affections une fois déclarées, elle sait pourquoi dans certains cas les extrémités sont habituellement froides, pourquoi la face est tantôt bleuâtre, tantôt livide et pâle, etc. – La physiologie ignore également ce que c'est qu’un squirre au pylore : mais ce squirre existant, elle sait rendre raison des désordres qui surviennent dans la digestion, et finalement dans la nutrition. – La physique ne sait pas comment le nerf optique peut recevoir l'impression des objets extérieurs : mais si le cristallin vient à perdre sa transparence, elle n'a aucune peine à expliquer comment le phénomène ne peut plus avoir lieu. – La mécanique aurait grand’peine à dire comment notre volonté a le pouvoir de remuer nos membres : mais si nos os viennent à se luxer ou à se rompre, elle rend compte sans difficulté de l'impuissance où nous sommes d'exécuter les mêmes mouvemens. [II-451] – La chimie ne sait point comment se fait la bile, ni comment elle agit dans le phénomène de la digestion : mais s'il vient à manquer un des élémens dont la bile se compose, elle peut éclairer le médecin sur les suites de cette altération, etc., etc.
Voilà quelques exemples des services que peuvent rendre à la pratique de l'art médical l'anatomie, la physiologie, la physique, la chimie ; et il n'est pas douteux que les hommes versés dans cet art n'en pussent citer beaucoup d'autres et probablement de plus frappans.
Evitons pourtant de tomber dans une exagération assez commune, et en reconnaissant que l'art peut recevoir ici de grands secours de la science, ne croyons pas que pour l'exercer avec distinction il soit nécessaire de pousser très-loin l'instruction théorique. Ici, comme partout, ce qui importe particulièrement aux succès de l'art, c'est l'étude de l'art même. J'ai vu des chirurgiens, anatomistes très-habiles, avouer qu'une grande partie de leurs connaissances anatomiques ne leur étaient, à l'application, que d'une médiocre utilité.
« L'anatomie thérapeutique, celle dont l'art fait une application journalière, se renferme dans les limites les plus resserrées. La structure, la situation et les connexions des viscères, la distribution des principaux troncs des vaisseaux et des nerfs, la forme et la disposition des os, les attaches des [II-452] muscles, les expansions des aponévroses, et peut-être encore quelques menus objets non moins faciles à saisir : voilà ce que le médecin a besoin de bien connaître. Peut-être même serait-il permis d'ajouter que la délicate anatomie est bien rarement utile pour les opérations chirurgicales : j'oserais en appeler sur ce point à la bonne foi des chirurgiens anatomistes les plus éclairés. »
Voilà ce qu'écrit un auteur judicieux que j'ai déjà cité plusieurs fois dans le cours de ce chapitre [195] . Il paraît certain que dans les arts qui agissent sur le corps de l'homme, comme dans ceux qui travaillent sur la matière inanimée, il s'agit moins, pour réussir, d'acquérir des connaissances scientifiques très-étendues que d'apprendre à bien tirer parti d'un petit nombre de notions élémentaires. C'est dans le bon emploi de ces simples notions que les progrès de l'art consistent, et sa puissance est d'autant plus grande, qu'il en a fait des applications plus heureuses et plus multipliées.
Ainsi la connaissance pratique du métier, les notions théoriques, le talent des applications, sont ici des moyens de liberté tout aussi réels que dans les arts qui travaillent sur la matière.
Il en est de même des talens d'exécution. Il y a dans les industries qui agissent sur le corps de [II-453] l'homme, ainsi que dans les autres arts, une main-d'œuvre indispensable, au moyen de laquelle se réalise le produit qu'on se propose d'obtenir. L'écuyer, le gymnaste, le maître d'armes exercent une action matérielle sur l'homme qu'ils entreprennent de modifier : ils lui font prendre de certaines postures, ils lui font exécuter de certains mouvemens. Le chirurgien agit d'une manière plus sensible encore sur le corps du malade qu'il opère, l'orthopédiste sur celui du patient dont il veut redresser les os, le pharmacien sur celui de l'homme à qui il fait avaler ses drogues : tous exécutent quelque opération chimique ou mécanique sur le corps humain, et il n'est pas douteux que la puissance de leur art ne dépende beaucoup du plus ou moins d'habileté qu'ils peuvent appliquer à cette main-d'œuvre.
Il est seulement à remarquer que dans ces industries, c'est ordinairement la même personne qui conçoit et qui exécute, et que les fonctions de l'ouvrier s'y trouvent réunies dans la même personne que celles de l'ingénieur, du savant et de l'entrepreneur. C'est le maître d'escrimer qui apprend à ses élèves à faire des armes ; c'est le professeur de danse qui les instruit à danser; le chirurgien ne fait pas faire son opération, il l'exécute lui-même : c'est surtout sa main-d'œuvre que l'on recherche, et le principal mérite est ici dans l'exécution. [II-454] De tous les artistes qui agissent sur le corps humain, il n'y a guère que le médecin qui se borne à donner des prescriptions et qui agisse par intermédiaire. On conçoit néanmoins que l'écuyer, le danseur, le gymnaste, puissent avoir des ouvriers, des professeurs qui agissent sous leurs ordres et qui exécutent pour eux. C'est même là ce qui arrive à ceux de ces artistes qui possèdent de grands établissemens et qui sont parvenus à y réunir beaucoup d'élèves.
§ 5. Je crains qu'on ne trouve bien imparfaits les détails dans lesquels je viens d'entrer dans les deux précédens paragraphes. On pourrait sûrement montrer beaucoup mieux que je ne l'ai fait comment les arts dont je m'occupe se prêtent à l'application des divers ordres de facultés que je viens d'énumérer. J'espère pourtant en avoir assez dit pour convaincre le lecteur que toutes ces facultés sont ici, non-seulement très-applicables, mais très-nécessaires, et que, pour devenir véritablement puissant dans les arts qui agissent sur l'homme physique, comme dans tout autre ordre de professions, il est indispensable de réunir les divers moyens qui font le spéculateur habile et l'artiste expérimenté.
Je ne crois pas qu'il soit plus difficile de montrer le besoin qu'on y a de bonnes habitudes morales. [II-455] Il va presque sans dire que la médecine, l'hygiène, la gymnastique ne peuvent rien sans le secours d'une vie sagement réglée. Hippocrate demande que le médecin soit patient et sobre, qu'il ait des manières graves et une conduite modérée. On voit dans l'histoire des Grecs que les anciens athlètes vivaient ordinairement d'une manière très-frugale, et que plusieurs s'interdisaient l'usage des femmes et du vin. Il paraît qu'en Angleterre les boxeurs de profession, les maîtres en fait de pugilat observent à peu près le même régime. M. Simond [196] fait la remarque que ces athlètes sont obligés de vivre régulièrement et sobrement, et que, surtout avant un grand combat, ils passent plusieurs semaines en préparations, s'abstenant de toutes liqueurs fortes, même de bierre, et s'exerçant continuellement, quoique sans excès de fatigue.
Des habitudes de sobriété, de modération, de tempérance, sont également nécessaires à l'artiste qui agit sur le corps d'autrui et au sujet sur lequel son industrie s'exerce. Il y a entre les arts qui s'exercent sur les choses et ceux qui travaillent sur les hommes cette différence essentielle, que dans ceux-ci la matière première de l'artiste, l'homme sur lequel il agit ne peut pas être et n'est presque jamais entièrement passif : il faut qu'il se prête à [II-456] l'action dont il est l'objet, et la plupart du temps qu'il y concoure lui-même. Sans doute celui qui entreprend de le modifier a dû commencer par agir sur sa propre personne; il a fallu qu'il se rendît capable de donner l'exemple des actions que son élève doit faire pour se perfectionner. Mais il n'est pas moins essentiel que celui-ci l'imite ; il est en quelque sorte son second, et peut être considéré comme un athlète qui travaille sur lui-même, et qui aspire à perfectionner son propre corps.
Or, pour réussir dans ce travail, la chose peut-être dont il a le plus besoin, est de mener une vie régulière. La santé, la vigueur, la beauté, ne se peuvent obtenir ou conserver qu'à ce prix. Les meilleurs remèdes seraient impuissans contre des erreurs habituelles de régime. Il n'est pas d'exercice qui pût faire un homme robuste d'un homme enclin à la volupté et incapable de résister à ses amorces. Un peuple livré à la crapule est presque toujours un peuple laid, malsain, mal portant; comme une population sobre et tempérante est : ordinairement une saine et belle population. Dé tous les exercices auxquels se livre l'homme qui s'occupe de l'amélioration de ses facultés corporelles, un des meilleurs qu'il puisse faire est donc d'apprendre à régler ses appétits, à subordonner ses plaisirs aux lois de l'hygiène et de la morale.
Si en France, depuis un demi-siècle, l'espèce [II-457] humaine s'est physiquement améliorée, ce résultat est dû pour le moins autant au progrès des meurs qu'à celui de l'aisance et du bien-être. M. Simond, après avoir observé, dans son Voyage en Angleterre, que la classe des gentlemen lui a paru plus belle et plus forte que celle du bas peuple des villes et des campagnes, ajoute, je ne sais si c'est avec fondement, qu'en France c'est tout l'opposé, que les messieurs y sont inférieurs aux paysans en facultés corporelles, et il en donne cette raison, qu'en France la vie des jeunes gens aisés est loin d'être aussi active qu'en Angleterre, que les amusemens athlétiques entrent pour beaucoup moins dans leur éducation et qu'ils sont jetés beaucoup plus tôt dans la société des femmes : si c'est des femmes honnêtes, dit-il, il en résulte des habitudes sédentaires peu favorables au développement de la constitution et des belles formes ; et dans le cas contraire, c'est bien pis [197] .
Pour peu que je voulusse examiner l'influence qu'exercent sur l'homme celles de ses vertus qui se rapportent particulièrement à lui-même, la propreté, l'activité, le courage, la sobriété, la continence, etc., il me serait aisé de montrer qu'il n'est pas un ordre de moyens dans lesquels les arts qui agissent sur le corps humain puisent des secours plus réels et plus efficaces.
[II-458]
Quels heureux effets, par exemple, n'a-t-on pas obtenus de la propreté, c'est-à-dire de ce respect pour soi-même, de cette sorte de dignité qui porte les hommes à écarter toute souillure de leur corps,, de leurs vêtemens, de leurs demeures, et que les anciens cultivaient sous le nom de pureté ? Cette bonne habitude, à laquelle on a refusé récemment le nom de vertu, quoique, à voir combien elle est rare et imparfaite encore, il soit permis de penser qu'elle ne s'acquiert pas sans beaucoup d'efforts ; cette bonne habitude, dis-je, est peut-être de toutes les vertus individuelles celle qui a le plus contribué à l'amélioration physique du genre humain; qui a le plus affaibli l'influence contagieuse de plusieurs maladies plus ou moins meurtrières ; qui a le plus aidé à faire disparaître, ou du moins à rendre très-rares un bon nombre d'autres maladies plus ou moins hideuses; qui préserve les générations présentes de la teigne, de la gale, de la lèpre, filles impures de la malpropreté, qui dévorèrent si long-temps les générations passées; qui a réellement le plus fait pour les progrès de la santé et de la beauté de notre espèce.
Qui ne sait, d'une autre part, à quel point une certaine activité est favorable à l'entretien des forces et combien de certains exercices sont propres à développer nos membres dans de justes proportions? Qui ne trouverait dans sa propre [II-459] expérience quelque bonne raison de reconnaître que l'intempérance est funeste à la santé? Qui n'a vu ou pu voir des hommes énervés, abrutis par la débauche, et des femmes que le même vice avait flétries avant le temps?
Les arts qui s'occupent du perfectionnement de l'homme physique, peuvent puiser des moyens de puissance jusque dans les vertus privées qu'on pourrait croire les plus étrangères à leur objet. L'amour de la simplicité, par exemple, qui nous a paru si favorable à d'autres industries, semble exercer ici Ja même heureuse influence. Il est dans la nature de ce sentiment de nous faire renoncer à une multitude d'ornemens bizarres et de pratiques qui ne tendent qu'à déformer, à défigurer le corps en prétendant l'embellir; à l'usage d'étrangler la taille, de faire saillir les hanches, de raccourcir le pied, d'allonger les lèvres, les oreilles, de perforer les narines, de se raser la tête, de l'ensevelir dans d'énormes perruques, d'élever la chevelure des fem, mes de manière à leur placer le visage à peu près au milieu du corps. On lui doit d'avoir fait passer la mode du tatouage, des mouches, des figures plâtrées, des cheveux poudrés. Il nous porte enfin à écarter l'exagération et le mauvais goût des formes que nous donnons au corps de l'homme, comme de celles que nous imprimons aux produits dont il se sert, et à nous faire rechercher, [II-460] en général, les manières, les postures, les attitudes les plus aisées, les plus naturelles et les plus vraies.
§ 6. Si les vertus personnelles sont nécessaires au succès des arts qui s'exercent sur le corps humain, reconnaissons que ces arts ne peuvent pas mieux se passer de bonnes habitudes civiles. Il est clair, par exemple, qu'il n'est pas plus possible ici qu'ailleurs d'élever des prétentions exclusives, sans s'entraver mutuellement. Or, il est peu de ces arts dans lesquels on n'ait formé quelques prétentions de ce genre.
Dans la gymnastique, par exemple, on a vu de certains exercices interdits long-temps à de certaines classes d'individus. Les classes dominatrices, sous le régime féodal, s'étaient réservé le monopole de l'art de l'escrime et de l'équitation ; elles seules pouvaient apprendre à faire des armes; elles seules pouvaient se livrer à l'exercice de la chasse et figurer dans les tournois ; elles seules, dans les combats judiciaires, pouvaient combattre à cheval armées de l'épée ou de la lance. Les serfs, les vilains ne combattaient qu'à pied et ne s'escrimaient qu'avec le bâton : tous les exercices propres à donner au corps de la vigueur, de la grace, un certain air de noblesse, leur étaient interdits [198] .
[II-461]
Les prétentions exclusives n'ont pas manqué non plus dans d'autres arts de la classe de ceux qui font le sujet de ce chapitre. Il y a eu autrefois, par exemple, des confréries de chirurgiens auxquelles il fallait nécessairement appartenir pour pouvoir exercer la chirurgie. Non-seulement ces chirurgiens interdisaient l'exercice de l'art à tout ce qui était en dehors de la corporation; mais ils se faisaient violence même entre eux : il n'était pas permis à l'un de se montrer plus habile que l'autre; la théorie, la manière d'opérer, étaient établies par des réglemens invariables et dont nul ne pouvait s'écarter.
Il existait d'ailleurs des confréries de barbiers-chirurgiens, ou chirurgiens de robe courte, avec lesquels les chirurgiens de robe longue étaient perpétuellement en débat. Ceux-ci contestaient notamment aux autres le droit d'envoyer leurs étudians à la Faculté de médecine; et la Faculté ayant accordé aux élèves des barbiers-chirurgiens la permission de suivre ses cours, cette concession de la Faculté devint, entre la confrérie des chirurgiens de robe longue et celle des chirurgiens de robe courte, la source de soixante ans de procès [199] .
Il est rare, aujourd'hui, de voir élever des [II-462] prétentions de la nature de celles que je viens de décrire. Cependant, la mode n'en a pas encore entièrement passé. En Angleterre, par exemple, on a vu récemment le collège royal de Londres se prévaloir contre le docteur Harrisson d'une charte de Henri VIII qui défendait à tout médecin, quelle que fût l'université où il aurait pris ses grades, de venir exercer la médecine à Londres et dans un rayon de sept milles autour de la capitale, sans avoir reçu une licence du collège royal, laquelle s'accorde toujours, dit-on, après un léger examen fait de vive voix, et sans exiger du candidat, pour preuve de sa capacité, d'autre pièce qu'une somme de cinquante-sept guinées. Le docteur Harrisson, fort des titres qui lui avaient été accordés par l'école d'Édimbourg, avait négligé de se soumettre à ce réglement, et néanmoins il venait exercer son art dans le rayon privilégié et jusque dans la ville de Londres. A cette nouvelle, grande rumeur au collège royal. Le docteur est sommé de comparaître devant les censeurs du collège. Il résiste et refusé de reconnaître leur autorité. C'est en 1827 que la chose était en litige [200] . J'ignore comment elle a été décidée.
Il n'y a plus, parmi nous, ni individus, ni établissemens particuliers, qui osassent former des [II-463] prétentions pareilles. Mais la société en élève encore qu'il ne serait peut-être pas plus facile de justifier. Il ne lui arrive pas, il est vrai, de s'ingérer, comme autrefois, par l'intermédiaire de ses corps de magistrature, dans l'enseignement ou la pratique de l'art médical. Ses cours royales ne prétendent pas, comme les anciens parlemens, dé terminer, dans certains cas, le traitement qu'on fera ou ne fera pas subir aux malades : on ne les voit pas rendre des arrêts contre l'emploi de l’émétique ou la pratique de l'inoculation. Mais son administration et sa législature font encore des choses qui ne semblent guère moins étranges et moins en dehors du sens et du droit communs.
Il est des pays où la personne publique est assez prudente pour ne pas vouloir se porter caution de la capacité de quiconque prétend exercer un art, et assez juste tout ensemble pour ne pas soumettre l'étude et la pratique de cet art à des réglemens arbitraires. A Genève, si je suis bien informé, est médecin qui veut. La république n'impose à personne l'obligation de prendre des grades et de payer des diplômes. Elle laisse aux particuliers le soin de chercher à bien placer leur confiance, et veut que ceux qui ont besoin de l'obtenir se donnent la peine de la mériter. Pourtant elle ne refuse pas de délivrer des certificats de capacité; mais elle n'accorde ces certificats [II-464] qu'à bonnes enseignes; et quand un médecin vient lui demander d'attester qu'il est digne de la confiance des citoyens, il est soumis à des examens d'autant plus rigoureux qu'ils ne lui étaient pas imposés, que c'est une distinction qu'il demande, et qu'on a pris soin d'ôter à ses juges tout motif de le traiter avec faveur.
Les choses, chez nous, se passent d'une autre façon. Les examens, au lieu d'être facultatifs, sont obligatoires: la société ne souffre pas qu'un homme devienne médecin, chirurgien, officier de santé, pharmacien, herboriste, sans s'être assurée, soi-disant, qu'il a les connaissances requises. Bien plus, ne croyant pas qu'il lui suffise de s'assurer de sa capacité, elle prétend l'endoctriner elle-même, et elle décide d'avance de tout ce qu'il lui faudra faire pour devenir habile dans son art. Ainsi un jeune homme ne peut se livrer à l'étude de la médecine s'il n'a un répondant, s'il ne produit son acte de naissance, le consentement de ses parens, un certificat de bonne vie et meurs, le diplôme de bachelier ès-lettres, celui de bachelier ès-sciences. La société lui choisit elle-même des professeurs ; elle détermine ce qu'ils devront lui apprendre, et règle jusqu'au costume qu'ils devront porter en l'instruisant. Il est obligé de suivre ces professeurs et non point d'autres; de se faire graduer par eux et non par d'autres : ceux-là seuls ont la vertu de [II-465] faire des médecins, qu'elle a revêtus du bonnet carré et de la simarre. Qu'il ait peu ou beaucoup de moyens, il lui faut toujours, avant de pouvoir être reconnu capable d'exercer, tant d'années d'étude, tant d'inscriptions, tant d'examens, tant d'examen's en latin, tant d'examens en français, tant de thèses, ni plus ni moins. Les règles pour faire un officier de santé, un pharmacien, sont un peu différentes, un peu moins rigoureuses. Par exemple, la société ayant jugé qu'il fallait être moins habile pour pratiquer la médecine dans un seul département que pour l'exercer dans la France entière, l'officier de santé, qui n'a le droit d'exercer sa profession que dans le département où il a été reçu, est soumis à cause de cela à des épreuves un peu moins longues, moins multipliées et moins coûteuses, etc. [201] .
Que de tels réglemens entravent l'enseignement et l'étude de l'art médical, c'est une chose qui n'est pas contestable. Mais une autre chose non moins certaine, quoiqu'elle ne soit pas aussi reconnue, c'est qu'ils l'entravent sans profit, qu'ils ne présentent que des garanties illusoires, et qu'au lieu de répondre de l'habileté des médecins, ils ont pour effet direct d'empêcher qu'on ne se prépare [II-466] convenablement à la pratique de la médecine et des diverses professions qu'elle embrasse.
Il est superflu d'observer d'abord que les connaissances médicales ne sont pas de celles que la société a besoin de propager à ses frais. Ces connaissances sont sûrement assez demandées pour qu'on pût être certain qu'il s'élèverait des établissemens particuliers pour les répandre. Toute la question est donc de savoir si des écoles libres, dont les succès seraient entièrement subordonnés au mérite de l'instruction qu'elles répandraient, ne répandraient pas une instruction aussi forte et aussi saine que peuvent le faire des facultés privilégiées, qui n'ont point de concurrence à craindre, qui sont sûres d'avoir des élèves par cela même qu'elles ont seules le droit de créer des médecins, où l'intrigue fait les professeurs autant que le mérite, où les maîtres les plus habiles ne sont pas mieux traités que les plus ignorans. Or je ne pense pas que cette question en puisse faire une. J'ai eu occasion autrefois d'examiner nos facultés de droit et de médecine, et je crois avoir solidement établi que ces écoles, par leur nature, étaient la partie la plus vicieuse d'un système d'instruction que vicie dans son ensemble l'intervention illégitime de la société [202] .
Non-seulement l'existence d'établissemens ayant [II-467] le privilège exclusif de faire des médecins doit empêcher que l'art médical soit bien enseigné, mais il doit empêcher aussi qu'il soit bien appris. Quand c'est le diplôme qui crée le médecin, on se borne naturellement à faire ce qu'il faut pour obtenir le diplôme. Or, je demande si ce titre, même justement accordé, offre une véritable garantie de la capacité de celui qui le porte ? J'ai déjà observé qu'il était possible de l'obtenir sans avoir vu un malade, sans avoir fait soi-même aucune observation sur l'homme vivant, sans avoir la moindre connaissance pratique ni des maladies, ni de l'art de les guérir.
Supposez, au contraire, qu'il fût impossible de devenir médecin par brevet. Il est clair qu'alors il faudrait tâcher de le devenir par ses connaissances. L'aspirant n'ayant plus le moyen de prouver par titres qu'il possède son art, serait bien obligé d'établir sa capacité d'une autre manière, et la seule qu'il eût, serait de travailler d'abord à se rendre vraiment capable, et de montrer ensuite par ses actes qu'il l'est devenu. Comme toutes les autres classes d'artistes, il tâcherait d'offrir pour garantie de sa capacité sa pratique, ses succès, sa bonne renommée, et celle-là vaudrait bien celle du diplôme.
Le véritable effet des diplômes et des brevets est de permettre à ceux qui en sont munis de commettre impunément les bévues les plus meurtrières. [II-468] Dans ce système, on peut se rendre coupable en exerçant sans titre, en négligeant de se conformer à quelque réglement; mais une fois en règle avec l'Université et la police, une fois toutes les formalités ponctuellement remplies, on n'a plus rien à redouter de sa légèreté ou de son ignorance, et les plus grossières erreurs, les méprises les plus fatales ne sauraient exposer celui qui les commet à aucune espèce de châtiment. Il n'en serait pas ainsi dans un système où l'on serait médecin, chirurgien, pharmacien à ses périls et risques ; et celui qui, s'étant donné pour capable d'exercer ces professions délicates, aurait, par étourderie ou par ignorance, causé quelque grand mal, pourrait être puni avec toute justice. Or, je ne doute point que de tels châtimens, exactement appliqués, ne protégeassent mieux les citoyens que toutes les mesures préventives; et qu’un ordre de choses où la société, renonçant enfin à ces mesures, laisserait à chacun la pleine responsabilité de ses actes, n'offrît aux hommes qui voudraient se livrer à la pratique de l'art médical plus de moyens et de motifs de s'y bien préparer qu'aucune autre espèce de régime.
Si donc il importe au bon exercice de l'art médical que chacun s'abstienne de l'accaparer, de le gêner, il ne serait pas moins essentiel que la société s'imposât la même contrainte, et qu'elle sût imposer aux pouvoirs chargés d'agir pour elle l'obligation [II-469] de donner, à cet égard comme à tout autre, l'exemple de la réserve et de la justice qui sont prescrites à chaque individu.
§ 8. Il n'est, comme on voit, aucun ordre de facultés personnelles qui ne puisse être, dans les arts qui s'exercent sur le corps humain comme dans ceux qui travaillent sur la matière morte, une source de puissance et de liberté d'action. Poursuivons notre analyse, et nous découvrirons de même, sans beaucoup d'efforts, que tout ce qui entre dans le fonds d'objets réels peut devenir également ici un moyen de liberté et de force.
A peine, par exemple, ai-je besoin d'indiquer que la situation de l'atelier n'y est pas une chose indifférente, et que les hommes dont la profession consiste à soigner, à perfectionner nos facultés corporelles, ont besoin de choisir avec intelligence le lieu de leur établissement. Il va presque sans dire qu'un médecin, un pharmacien, un gymnaste, un maître de danse, d'escrime, d'équitation, ne peuvent pas s'établir indistinctement partout, et qu'à cet égard leur principal objet doit être de se rapprocher, autant que possible, de la matière première, c'est-à-dire de se placer dans les lieux où se trouvent réunis en plus grand nombre les hommes qui ont besoin de leurs services, qui recherchent [II-470] les divers ordres de facultés que chacun d'eux est particulièrement apte à développer.
Il semble qu'ici la bonne organisation de l'atelier ne soit pas autant à considérer que le choix d'une bonne place. Un médecin, un chirurgien, ont souvent tous leurs malades en ville ; un maître de danse ou d'escrime peuvent avoir de même tous leurs élèves éparpillés. En pareils cas, ces artistes ont en quelque sorte autant d'ateliers qu'il y a de maisons où ils vont exercer leur art, ou plutôt on peut dire qu'ils n'en ont point. Mais il n'en est pas toujours de même : ils n'agissent pas toujours sur des individus isolés ; il peut arriver qu'un médecin ait la plus grande partie de ses malades agglomérés dans une maison de santé, dans un hospice ; il est possible qu’un maître de danse réunisse la plupart de ses élèves chez lui ; un écuyer, un gymnaste, au lieu d'aller donner leurs leçons en ville, ont d'ordinaire un établissement où ils rassemblent leurs élèves. Tous ont alors un atelier. Une école de gymnastique, un hôpital peuvent, en quelque façon, être considérés comme des fabriques. Un hospice est une fabrique où l'on entreprend de restituer des corps malades à l'état sain. Un gymnase est une fabrique d'hommes hardis, vigoureux, agiles, etc. Or, il n'est pas douteux que le succès de ces entreprises ne dépende à un haut degré de la bonne disposition, [II-471] de l'organisation intelligente des lieux où elles sont mises à exécution.
Les machines ne jouent pas ici un rôle à beaucoup près aussi important que dans les industries qui ont fait l'objet des précédens chapitres. On peut encore moins que dans l'agriculture y faire usage de moteurs inanimés. Les arts qui travaillent sur le corps humain n'exécutent pas des mouvemens assez simples pour qu'il soit possible d'en confier la direction à des forces aveugles ; ils ne font pas un travail assez continu, ils n'ont pas à vaincre des résistances assez fortes pour avoir besoin d'agens très-puissans : je ne crois pas qu'il leur arrive jamais d'agir par l'intermédiaire d'une machine mue par la vapeur ou par quelque autre pouvoir physique. Un chirurgien, un pharmacien, un dentiste, un oculiste n’emploient que des outils en général trèssimples et conduits à la main. On en peut dire autant du gymnaste, encore bien que ses instrumens soient d'une plus grande dimension et occupent beaucoup plus de place. Une échelle, un mât, une corde à nœuds ou sans nœuds, une balançoire, un trapèze sont des outils peu compliqués, que l'élève en gymnastique applique à ses membres pour les former à certains mouvemens et développer leur vigueur ou leur adresse; etc.
Cependant, tout en reconnaissant que, par leur nature, les arts dont je m'occupe en ce moment [II-472] reçoivent peut-être moins de pouvoir que d'autres de l'influence des machines, il n'est certainement pas douteux que leur puissance ne dépende en grande partie de la perfection des instrumens qu'ils emploient. Quelle heureuse révolution n'a pas produite, dans le traitement de certaines maladies, la découverte de certains instrumens? Combien, par exemple, n'a pas été perfectionnée, par l'invention des instrumens tithontripteurs, l'extraction des calculs urinaires, qu'on ne pouvait effectuer auparavant que par des procédés" si cruels et si périlleux ? Avec quel avantage les lits mécaniques sur lesquels on couche les jeunes personnes contrefaites, n'ont-ils pas remplacé la croix de fer dont on les chargeait autrefois, et à laquelle on liait leur épine dorsale? A l'aide de bons instrumens, des cancers réputés jadis inaccessibles ont été poursuivis jusque dans les profondeurs de la plèvre et l'excavation du bassin. Il est reconnu parmi les gens de l'art que le bistoury falciforme du professeur Dubois facilite singolièrement le débridement des hernies. Au moyen de la sonde à double courant, inventée par Hales et réinventée par M. J. Cloquet, on peut pratiquer une sorte d'irrigation dans la vessie et y faire passer plusieurs tonnes d'eau s'en fatiguer le malade [203] . Les instrumens [II-473] gymnastiques et orthopédiques peuvent être conçus de manière à exercer précisément le muscle qu'on veut, dans la mesure qui est convenable, et le colonel Amoros a fait faire, sous ce rapport, des progrès véritables à la gymnastique et à l'orthopédie. Il serait aisé de citer d'autres exemples; mais en voilà assez pour être autorisé à conclure que les machines contribuent essentiellement à la liberté des arts qui agissent sur le corps humain.
On en peut dire autant de la division du travail. Je sais bien qu'il y a encore des raisons pour que cet élément de force ne puisse être employé ici avec le même succès que dans d'autres industries,, Il n'en est pas des arts qui travaillent sur l'homme comme de ceux qui agissent sur des corps bruts, et qui emploient des forces chimiques et mécaniques. Partout où l'on ne peut opérer qu'avec le secours de la vie, les procédés du travail doivent être nécessairement imparfaits. La force vitale agit d'une manière lente et souvent irrégulière; on n'est le maître ni de hâter, ni de maîtriser sa marche; il faut attendre qu'elle ait opéré; il faut la suivre dans ses écarts : ce sont autant de raisons pour que les arts qui en font usage ne se prêtent pas à une bonne division du travail.
Il bien, probablement, un certain ordre à suivre dans le traitement de chaque espèce de maladies ; mais l'état des malades est sujet à tant [II-474] de variations qu'on ne pourrait, sans extravagance, s'aviser de les soumettre à une certaine suite de façon's toujours la même, toujours uniforme, et les faire passer de main en main, comme la matière morte, jusqu'à l'exécution complète du traitement qui devrait opérer la guérison. Il est bon, au contraire, que, du commencement à la fin de la maladie, le corps du malade reste soumis à l'inspection du même individu, et cet individu, au lieu d'adopter une marche uniforme, est obligé de subordonner ses procédés aux incidens qui surviennent et à toutes les variations que le corps du malade peut subir sous l'influence du principe qui l'anime et de toutes les causes qui ne cessent d'agir sur ce principe.
Le meilleur médecin, dit-on, est celui qui sait le mieux individualiser, qui est le plus capable de discerner ce qu'il y a de particulier dans chaque cas qui se présente, qui peut le mieux dire, à chaque instant, quelle est la situation véritable du malade et la manière spéciale dont il est à propos d'agir. Il n'y a donc pas de marche qu'on puisse rigoureusement déterminer d'avance dans le traitement des maladies, ni, par conséquent, de division régulière et symétrique qu'il soit possible d'introduire dans le travail qu'on exécute sur les malades.
Cependant, reconnaissons qu'il y a encore [II-475] moyen d'adopter un certain ordre à cet égard et de classer les malades de manière à rendre à la fois plus faciles et plus fructueuses les fonctions des hommes appelés à leur donner des soins. Tous les malades ne sont pas confondus dans un hospice; on a grand soin, au contraire, de les distribuer suivant la nature du mal dont ils sont affectés, et il n'est pas douteux que cet odre ne soit très-favorable aux opérations intellectuelles et matérielles de l'art [204] .
La médecine, d'ailleurs, n'est pas la seule profession qui agisse sur le corps de l'homme ; il n'est pas toujours question de traiter des malades; il s'agit bien plus souvent de développer de certaines facultés physiques dans des corps sains; et comme la vie procède ici d'une façon plus régulière, il paraît que ce travail peut être soumis à une marche plus uniforme, et qu'il est plus aisé de le partager entre un certain nombre d'individus. Il y a [II-476]un ordre rigoureux dans la suite des mouvemens qu'un jeune homme doit exécuter pour apprendre la danse, l'équitation, la gymnastique. Il faut que les mouvemens simples précèdent les mouvemens composés, que les exercices aisés devancent les exercices difficiles. Partant, ces exercices peuvent se diviser, d'une manière permanente, en un certain nombre de classes, et être confiés à un pareil nombre d'ouvriers par les mains de qui on fera successivement passer les élèves. C'est même ainsi que l'on procède dans un gymnase bien monté; les élèves y sont soumis à l'action d'une suite de pédotribes, et ils passent des mains de l'un dans celles de l'autre jusqu'à ce que leur éducation phyșique est achevée. On peut ajouter que le travail ne se divise pas seulement entre ces professeurs : il y a ordinairement dans un gymnase un directeur qui est à la tête de l'entreprise, des physiologistes qui dirigent scientifiquement les exercices, et des ouvriers, des pédotribes qui les font exécuter; de même qu'il y a dans un hospice des administrateurs qui en ont la gestion matérielle, des médecins qui en sont les savans, et des pharmaciens, des aides de toute espèce qui exécutent les prescriptions de la science. Enfin, ces divisions ne sont pas les seules qu'on puisse utilement introduire dans les professions dont il s'agit ici, et ces professions où le travail se partage avec fruit entre [II-477] tant de personnes, se divisent elles-mêmes, et non sans profit, en une multitude d'arts particuliers dont j'ai fait plus haut l'énumération.
Je ne pousse pas plus loin ces remarques. En voilà assez pour faire comprendre que la division du travail, les machines, l'organisation méthodique de l'atelier, le choix éclairé des emplacemens, sont aussi de quelque effet dans les arts. qui agissent sur le corps de l'homme, et qu'en somme il n'est pas un des élémens dont se forme, en général, la puissance du travail qui ne trouve plus ou moins son application dans celui-ci.
Peut-être, faute d'avoir suffisamment connu la nature particulière de ces arts qui font leur objet spécial de la culture et de l'amélioration de nos facultés physiques, n'ai-je pas assez marqué les différences qu'il y a dans la manière dont s'y appliquent les principes de la liberté. Mais ce que je voulais surtout faire sentir, c'est qu'ils remplissent dans la société des fonctions d'une haute importance, qu'ils créent un ordre de produits très-précieux, et qu'ils deviennent libres et puissans par les mêmes moyens généraux que tous les autres. J'espère que cet objet se trouve à peu près rempli. Parlons maintenant de ceux qui s'occupent de l'éducation des intelligences.
[II-478]
CHAPITRE XIX.
De la liberté des arts qui travaillent à l'éducation de nos facultés intellectuelles.↩
§ 1.Quelle est la force secrète qui nous rend capables de sentir, de percevoir, de comparer, de juger, de raisonner, de nous souvenir ? Comment ces fonctions immatérielles peuvent-elles s'accomplir par l'intermédiaire d'organes matériels ? Ces organes agissent-ils par eux-mêmes, ou cèdent-ils à l'impulsion d'une force particulière et distincte d'eux ? L'intelligence n'est-elle, ainsi que la vie, qu'une manière d'être de la matière; faut-il dire, avec certains physiologistes, que le cerveau pense, comme ils disent que l'estomac digère, parce que telle est la loi de son organisation, parce que cela est dans sa nature: ou bien, avec les psychologistes, faut-il admettre que, par eux-mêmes, les organes encéphaliques sont destitués de toute force, et qu'il existe, sous le nom d'esprit, d'ame, un être d'une nature particulière dont ils ne sont que les instrumens? Voilà un problème que tous nos moyens naturels d'investigation nous laissent dans l'impuissance [II-479] de résoudre; mais dont heureusement nous n'avons ici aucun besoin de donner la solution.
Quoi qu'il en soit, en effet, de l'hypothèse des matérialistes ou de celle des spiritualistes ; que le système nerveux exécute ses fonctions en vertu d'une force qui lui est propre, ou bien qu'il soit l'instrument passif d'un agent immatériel dont il reçoit l'impulsion : toujours est-il qu'il nous est absolument impossible de sentir sans le secours des nerfs ; que notre intelligence ne fait aucune opération que par l'intermédiaire de l'encéphale; qu'elle paraît se proportionner dans tous les individus au plus ou moins de perfection de cet appareil ; qu'elle se développe avec lui; qu'elle se dérange quand il s’altère ; qu'elle s'affaiblit quand il se dégrade ; que tout ce qui influe sur le cerveau agit sur l'intelligence ; que tout ce qui le trouble la trouble; qu'elle sommeille quand il dort; qu'elle déraisonne quand il est ivre ; qu'elle cesse subitement d'agir lorsqu'en le comprimant on neutralise son action; qu'elle se ranime et renaît sitôt que la compression cesse; enfin qu'elle dépend de lui pour toutes ses manifestations, pour tous ses actes, et qu'elle le suit invariablement dans toutes ses variations [205] .
[II-480]
Le seul moyen que nous ayons de perfectionner l'intelligence, c'est donc, d'agir sur les instrumens par l'intermédiaire desquels l'intelligence s'exerce; et c'est proprement à cela que se consacrent les hautes industries dont l'intelligence est l'objet ; c'est en cela que leur nature consiste. Elles diffèrent de celles qui travaillent sur le corps de l'homme, seulement sous ce rapport qu'elles s'exercent sur des appareils différens; que les premières agissent surtout sur les organes de la locomotion, tandis que celles-ci agissent sur l'organe qui leur donne le mouvement, sur l'encéphale. Du reste, elles agissent sur le cerveau absolument de la même façon que la gymnastique sur les membres, c'est-à-dire en l'exerçant, en le faisant agir : c'est une véritable gymnastique cérébrale.
L'encéphalé, en effet, est aussi susceptible d'éducation [II-481] que tous les organes du corps sur lesquels s'étend son empire, que l'organe de la voix, que les doigts de la main. L'exercice le modifie de la manière la plus profonde. N lui rend faciles des actes qu'il n'exécutait d'abord qu'avec une extrême difficulté. Il lui fait acquérir de la souplesse, de la dextérité, de la force, de l'agilité, tout comme aux organes du corps.
A la vérité, le travail du cerveau, et en général du système nerveux, ne frappe pas la vue comme celui des muscles; mais, quoiqu'il ne soit aucunement apparent, ce travail n'en est pas moins réel. . Il est si indispensable de faire agir le cerveau pour développer ses forces, qu'un instituteur qui se bornerait à pérorer devant ses élèves, et qui les laisserait recevoir passivement ses idées, sans jamais les obliger à les rendre, à les reproduire, quelque force et quelque ordre qu'il mît d'ailleurs dans ses déductions, ne formerait que très-imparfaitement leur intelligence, Un tel instituteur ressemblerait au maître de danse qui, pour instruire ses élèves, se bornerait à décomposer sous leurs yeux chacun de ses pas, et à leur montrer la chaîne des mouvemens élémentaires dont ils seraient formés, mais sans jamais leur en faire répéter aucun. Ne sent-on pas qu'un tel maître devrait faire des élèves assez mal habiles ? Eh bien! il en serait absolument de même de l'instituteur qui se bornerait à [II-482] produire devant ses disciples la série d'actes cérébraux auxquels il voudrait former leurs organes encéphaliques.
De même que le maître à danser, pour faire de bons élèves, est obligé de rompre leurs membres aux mouvemens variés dont son art se compose, de même l'instituteur est obligé d'accoutumer les organes de leur intelligence à la suite d'actes intellectuels dont est formée chacune des sciences qu'il leur enseigne, de leur rendre ces actes et leur enchaînement familiers, de les leur faire répéter jusqu'à ce qu'ils les exécutent, comme lui, sans effort et sans fatigue [206] .
Ce qu'on appelle progrès des idées, progrès des sciences, n'est autre chose, si je ne me trompe, que les progrès de l'éducation du cerveau, que l'aptitude plus grande que les organes de l'intelligence humaine acquièrent à remplir les fonctions qui leur sont propres. Une science, considérée dans l'individu qui la possède, n'est que l'aptitude de son cerveau à passer par une certaine filiation d'idées, comme l'air que sait chanter cet individu n'est que l'aptitude de son larynx à moduler une certaine suite de sons sous la direction de son encéphale ; comme la danse qu'il a apprise n'est que l'aptitude des muscles de ses pieds et de ses jambes [II-483] à exécuter, toujours sous la direction de son cerveau, une certaine série de mouvemens. La science est d'autant plus parfaite, que le cerveau qui la possède, c'est-à-dire qui est en état de la rendre, peut observer dans ce travail un ordre plus conforme à sa propre nature et à celle des choses qu'il réfléchit, et qu'il est plus accoutumé, plus rompu à cet exercice.
Encore une fois, le propre des industries qui font leur objet de l'éducation et des perfectionnemens de l'intelligence est donc d'agir sur les instrumens matériels par l'intermédiaire desquels l'intelligence exécute ses fonctions, et de perfectionner ces instrumens par les mêmes moyens que toutes nos autres facultés, c'est-à-dire par l'action, par l'exercice.
§ 2. Je n'ai point à examiner ici quelle est la partie des organes encéphaliques qui est plus spécialement affectée aux fonctions de notre faculté de connaître. Y a-t-il dans le cerveau des organes pour la science, d'autres pour l'imagination, d'autres pour les passions, etc.? Savoir, imaginer, se passionner, sont-ils des fonctions différentes d'un même organe, ou bien existe-t-il un ordre particulier d'organes pour chacun de ces ordres de facultés; un ordre d'organes pour les connaissances positives, et un organe particulier pour chaque branche de [II-484] connaissances; un ordre d'organes pour les arts de l'imagination, et un organe particulier pour chacun des beaux-arts; un ordre d'organes pour les affections de toute espèce, et un organe particulier pour chacun de nos penchans ?
On peut consulter sur cette question, sans se promettre pourtant d'y trouver des lumières bien sûres, les derniers travaux de la physiologie. Je me contente d'observer, sans rien affirmer sur la pluralité des organes, qu'il paraît impossible de nier la pluralité des facultés; que l'esprit humain n'agit pas, quand il observe et raisonne, comme lorsqu'il se repaît d'images fantastiques ou qu'il est ému par quelque passion ; ni quand il se livre à son imagination et à ses passions, comme lorsqu'il les règle el les maîtrise ; que par conséquent les arts qui s'occupent de la culture de l'entendement humain peuvent le considérer sous trois grandes faces, ou, si l'on veut, qu'il peut être soumis à l'action de trois grandes classes d'industries :
Celles qui cultivent sa faculté de connaître;
Celles qui se chargent de l'entretien de son imagination et de ses affections;
Celles enfin qui travaillent à la formation de ses habitudes morales.
Je me borne, dans ce chapitre, à parler de celles qui s'exercent sur l'intelligence proprement dite, c'est-à-dire sur notre faculté de savoir.
[II-484]
§ 3. Je n'ai pas besoin de dire à quel point ces dernières industries sont importantes. Il suffit, pour le comprendre, de considérer que nos organes extérieurs n'exécutent absolument rien que par l'impulsion et sous la direction de nos facultés intellectuelles. Ces facultés sont la base et l'âme de tous les arts. Les arts ne font jamais que rendre ce que la pensée a conçu. Le chant, la danse, le travail des mains, celui des machines, depuis les plus simples jusqu'aux plus compliquées, depuis les plus faibles jusqu'aux plus puissantes, ne sont que des manifestations diverses de mouvemens divers qui ont eu lieu d'abord dans le cerveau et dans les nerfs. Nos membres, au milieu de leurs évolutions les plus rapides, ne font pas un mouvement qui ne résulte d'une impulsion particulière de l'encéphale, qui ne soit l'expression distincte d'un mouvement d'une autre nature exécuté premièrement dans le système nerveux.
Sûrement il ne suffit pas d'avoir une pensée pour être en état de la produire. S'il est difficile de concevoir, il n'est guère moins difficile d'exprimer. On sait quelles peines nous avons besoin de nous donner pour accoutumer nos sens externes à rendre d'une manière convenable les mouvemens intérieurs de l'âme, ou plutôt les mouvemens de l'organe délicat et mobile au moyen duquel l'âme agit. Mais c'est surtout l'éducation de cet organe qui [II-486] importe : le bon emploi de tout le reste en dépend.
L'esprit humain est le premier moteur des arts que l'homme pratique. C'est la force qui donne l'impulsion à toutes les autres. Cette force est susceptible d'une extension prodigieuse, et lorsqu'elle est développée dans une direction conforme aux arts qu'exerce la société, elle produit des résultats qui étonnent. C'est ce qu'on a pu remarquer, à toutes les époques où l'éducation de l'intelligence a été appropriée à la nature des arts qui étaient le plus en honneur, même avant que la culture de l'esprit eût fait des progrès bien considérables. Si, dans l'antiquité et le moyen âge, par exemple, les dominateurs de profession se montraient si propres à la guerre, c'est que toutes leurs idées se rapportaient à l'exercice de l'art militaire, comme toutes leurs actions, et qu'il y avait accord parfait entre l'éducation de leur esprit et celle de leurs membres.
Il n'en est malheureusement pas de même, à l'époque de transition où nous vivons. L'éducation intellectuelle de la société n'a presque aucun rapport avec les arts que la société cultive. Tandis que la grande masse des hommes par qui ces arts sont exercés ne reçoit intellectuellement aucune culture, ceux dont l'esprit est plus soigné n'apprennent presque rien de ce qu'ils auraient besoin de savoir pour les pratiquer avec intelligence et avec force. [II-487] La plus grande partie de l'éducation intellectuelle, dans toute la race européenne, est consacrée à enseigner deux langues mortes, et à former des artistes littéraires dans le goût des Grecs et des Romains.
Je ne veux certainement pas nier que l'étude des langues ne soit une bonne chose. Je ne disconviendrai même pas que l'intelligence des langues mortes, et notamment celle du grec et du latin, ne présente un certain degré d'utilité. Tout homme qui, à la connaissance de l'art qu'il exerce; veut joindre celle de l'histoire de cet art, a san's contredit quelque intérêt à savoir ce qu'en ont écrit deux peuples chez qui la plupart des arts ont pris naissance, chez qui surtout les beaux-arts, et notamment la poésie et l'éloquence, ont été cultivés avec une grande distinction ; et quoiqu'il existe des traductions de leurs ouvrages, il n'est sûrement pas indifférent pour lui de pouvoir faire śes observations et ses recherches dans les auteurs originaux.
Mais, il faut le dire, au-delà de cet intérêt', presque tout d'érudition, il paraît difficile de concevoir quel avantage peut offrir la connaissance des langues grecque et latine. Considérée comme moyen direct d'instruction, elle est, si je ne me trompe, d'un intérêt bien inférieur à celle des langues que nous parlons. Il est plusieurs des langues [II-488] vivantes de l'Europe dans lesquelles on trouve infiniment plus à lire que dans le latin et dans le grec. Toutes les richesses littéraires de l’une ou l'autre de ces deux langues peuvent être renfermées dans une cinquantaine de volumes, tandis qu'il y a des milliers de bons ouvrages à lire dans le français, l'anglais, l'italien, l'allemand. Nous pouvons puiser dans ces ouvrages des connaissances, en général, bien plus sûres, bien plus étendues, et surtout bien mieux appropriées à nos mœurs , à nos goûts, à nos arts, que dans les livres grecs et latins. Les langues dans lesquelles ces mêmes ouvrages sont écrits peuvent être lues et parlées, tandis que le latin et le grec ne peuvent être que lus. Les premières de ces langues sont celles de nations vivaces avec lesquelles nous sommes perpétuellement en relation d'affaires ou de plaisirs, tandis que les secondes sont celles de deux peuples qui ont pour jamais disparu de la scène du monde. Nous ne pouvons pas faire l'amour en grec, ni parler d'affaires en latin. Dans quelque pays que nous allions, ces langues ne sauraient être pour nous d'aucune ressource; et lorsque nous nous trouvons parmi des peuples dont nous n'entendons pas l'idiôme, chez qui nous sommes, en quelque sorte, sourds et muets, et où l'on peut impunément se jouer de nous, c'est, comme on l'a dit, une singulière façon de nous consoler de cette position humiliante, que [II-489] de penser que nous pouvons traduire une églogue de Virgile, ou scander tant bien que mal une ode d'Horace [207] . Lors même qu'on devrait faire de l'étude des langues l'objet essentiel de l'éducation, les langues mortes ne seraient donc pas celles qu'il faudrait préférablement étudier. La connaissance de ces langues paraît être, sous tous les rapports, infiniment moins avantageuse que celle des langues vivantes.
Mais, s'il semble peu sensé de préférer l'étude des premières à celle des secondes, il est peut-être moins raisonnable encore de faire de l'enseignement des langues, en général l'objet fondamental de l'éducation.
L'enseignement des langues, tel qu'il se pratique universellement, est, sans contredit, l'un des moyens les plus imparfaits qu'on puisse employer pour former l'esprit des hommes. Outre que la logique a rarement présidé à leur formation que leur syntaxe, leur orthographe, leur prononciation, leur prosodie sont pleines d'irrégularités et d'inconséquences, la manière dont on les enseigne, ajoute aux vices qui leur sont propres, et contribue à faire de cette étude un moyen plus imparfait encore d'exercer et de développer l’esprit. [II-490] Il suffit d'ouvrir la première grammaire'à l'usage de nos collèges, pour reconnaître qu'il n'est peut-être aucune espèce de livres élémentaires dans lesquels on donne des explications plus vicieuses de ce que l'on prétend enseigner, et où l'on accoutume davantage l'esprit des élèves à se payer de mauvaises raisons. Ce genre d'enseignement a donc, jusqu'à un certain point, lé défaut de fausser l'intelligence, et cet inconvénient, qui est déjà très-grave, n'est pourtant pas le seul ni peut-être le plus grand.
Dans un système d'instruction où l'on se piquerait de logique, et où l'on aurait à coeur de former de bons esprits, il semble qu'on songerait à donner des idées avant d'enseigner à les rendre, et qu'on chercherait d'abord à faire des hommes instruits, éclairés, sauf à travailler plus tard à former des écrivains. Il n'en est point ainsi dans le système qui considère l'étude des langues comme l'objet naturel de l'éducation et le meilleur moyen de développer les intelligences. Dans ce système, en effet, on s'évertue à former le style des jeunes gens, avant qu'on ait songé à leur rien apprendre, avant qu'en réalité ils aient rien appris, avant qu'ils sachent aucune science, avant qu'ils aient éprouvé aucune passion, et dans un âge où ils ne peuvent avoir aucune expérience ni des hommes, ni des choses, ni des affaires. Aussi, tandis que la [II-491] manière dont on leur explique les règles du langage tend à en faire des esprits faux, l'habitude qu'on leur fait contracter d'écrire avant qu'ils aient des idées, tend à en faire des esprits vains, des discoureurs à vide, des hommes dont la disposition la plus naturelle sera de parler avant d'avoir appris, et qui, toute leur vie, considèreront l'art d'aligner des mols et d'enfiler des phrases comme le premier de tous les mérites. Convenons donc que l'enseignement des langues, tel que nous le voyons pratiqué dans les collèges, est un exercice peu propre à donner à l'esprit de la rectitude, de la force, et à le bien former en général.
Il faut ajouter que cet exercice a encore le désavantage de ne le rendre propre à aucun art en particulier. Il n'est sûrement pas douteux que la capacité d'entendre, de parler, d'écrire une langue ne soit une chose précieuse ; elle l'est d'autant plus que cette langue est celle d'un peuple plus cultivé, qu'elle est plus répandue, qu'on a plus d'occasions d'en faire usage. Mais enfin la langue qu'on a le plus d'intérêt à savoir, alors même qu'on la possède le mieux, ne peut-être considérée que comme un moyen, comme le moyen d'entrer en relation avec les hommes qui la parlent, ou avec les livres que ces hommes ont écrits. Les langues, en général, sont moins une connaissance que l'un des instrumens au moyen desquels [II-492] toutes les connaissances s'acquièrent; et il est clair qu'on n'acquiert pas les connaissances, tant qu'on ne fait que se mettre en possession de l'instrument.
Combien donc n'est pas déraisonnable un système d'instruction qui consacre les dix-huit ou vingt premières années de la courte durée de la vie humaine, beaucoup plus de temps que le commun des hommes n'en peut accorder à l'éducation tout entière de son esprit, beaucoup plus même qu'il n'en faudrait, dans un meilleur système, pour, se préparer aux professions les plus élevées, uniquement à apprendre deux langues, et précisément à apprendre celles qu'il importe le moins de savoir, celles que les érudits de profession ont presque seuls intérêt à connaître; deux langues qu'on ne parle plus, dans lesquelles il y a beaucoup moins à lire que dans plusieurs de celles qu'on parle, et dont tous les bons ouvrages ont été traduits dans les langues que nous parlons; deux langues qu'on apprend d'ailleurs assez mal, que presque tout le monde oublie après les avoir apprises, et dont l'étude, que son défaut d'objet, sa durée et le vice des méthodes employées tendent à rendre si rebutante, n'a souvent d'autre résultat que de faire prendre en aversion toute espèce de travail intellectuel ? Quelle extravagance n'est-ce point de donner à l'étude de ces langues une importance si [II-493] follement exagérée ; d'en faire, sinon l'objet unique, du moins l'objet le plus fondamental et le plus considérable de l'éducation; de vouloir non-seulement qu'on entende le latin, mais qu'on soit en état de le parler, de l'écrire, de l'écrire en vers aussi bien qu'en prose! Quoi de plus inconséquent que de préparer les hommes aux professions les plus diverses par un seul genre de travail, et par un travail qui n'a de rapport bien direct avec aucune de ces professions ! Nous avons dans l'Inde, observe un écrivain anglais, cent mille de nos compatriotes qui s'étaient préparés à ce voyage en faisant des vers barbares sur Apollon, Mars, Mercure, et qui du reste n'avaient appris aucune des langues que parlent les cent millions d'individus sur lesquels s'exerce leur domination [208] . Nous pourrions dire de même que nous avons dans nos champs, dans nos ateliers, dans nos comptoirs, dans nos études, dans nos laboratoires, des milliers d'individus qui se sont préparés à la pratique de l'agriculture, de la fabrication, du commerce et d'une multitude d'autres professions, en employant leur jeunesse à faire des versions et des thèmes, ou à enfiler dans un certain ordre des dactyles et des spondées.
Des exercices littéraires en grec et en latin ne [II-494] sont une préparation convenable à aucune sorte d'industrie, peut-être pas même aux industries littéraires, auxquelles pourtant ces exercices sein. blent servir plus naturellement de préparation. Je n'examine point si la connaissance des litteratures de l'antiquité a été favorable ou contraire aux littératures modernes. C'est une question sur laquelle il peut y avoir beaucoup à dire et à contester. Mais ce qui semble moins contestable, c'est que nous n'apprenons pas à écrire notre langue en faisant des vers latins ou des thèmes grecs.
Ce qui est aussi moins contestable, c'est que les longues années que nous passons à nous occuper de grammaire, de syntaxe, de discours, de vers, de formes de style et de figures de rhétorique, sont des années perdues pour l'étude pratique de presque tous les arts, comme pour l'acquisition des connaissances de toute espèce que leur exercice réclame, et qu'en sortant à vingt ans du collège nous ne sommes encore bons à rien, si ce n'est peut-être à faire de la littérature pure, c'est-à-dire de la littérature sans idées.
Il arrive ainsi qu'il n'y a pas le moindre rapport entre ce que nous apprenons étant enfans et ce qu'il nous faudra faire étant hommes, entre les études de l'adolescence et les professions de l'âge viril. Nous sommes destinés aux professions les plus diverses, et l'éducation commune ne tend à [II-495] faire de nous que des lettrés; et encore des lettres dans des littératures mortes depuis quinze ou vingt siècles, et qui ont absolument cessé d'être l'expression de la société ; de sorte que cette éducation toute littéraire ne semble pas même propre à former des littérateurs, je veux dire des hommes habiles à rendre par la parole écrite les idées et les impressions de leur temps.
Ainsi les facultés dont nous aurions le plus grand besoin, nous les laissons incultes; nous en développons d'autres dont nous ne pourrons tirer aucun parti; nous faisons si bien que notre éducation intellectuelle, au lieu de nous préparer à la pratique de la profession que nous exercerons un jour, ne tend, le plus souvent, qu'à nous en distraire, qu'à nous rendre moins capables de l'exercer, et que nous nous affaiblissons précisément par le moyen qui devrait le plus contribuer à l'accroissement de notre force.
Mais il faut se garder de juger par ce que font les arts chargés de la culture de notre entendement de ce qu'ils seraient en état de faire. Si les systèmes d'instruction en vigueur sont loin d'être les plus propres à former l'intelligence, il n'est pas douteux que des systèmes mieux entendus ne pussent mieux développer ses forces en général, et les [II-496] développer en particulier dans une direction plus conforme aux besoins de la société actuelle.
Il ne faut sûrement pas tout blâmer dans le système reçu. Je conviens que, dans le nombre des choses qu'on fait apprendre aux enfans, aux adolescens, il en est dont l'utilité n'est pas douteuse. Je regarde nommément comme indispensable tout ce qui a pour objet de les familiariser avec la connaissance pratique du langage, avec l'art usuel de la parole, avec l'habitude de parler, d'écrire, et même de rendre par écrit leur pensée. Les langues ne sont pas seulement des moyens de communication, mais encore des moyens d'acquérir des idées, elles sont des instrumens indispensables pour la formation de l'intelligence. Il n'est pas plus possible de penser sans le secours des mots, que de calculer sans le secours des chiffres. Tant que nos idées ne sont pas revêtues des formes du langage, elles sont confuses et fugitives. Nous avons besoin de les rédiger pour nous en saisir, pour nous en rendre maîtres. Plus nous sommes rompus à ce travail, plus nous avons l'habitude de formuler, de rendre par écrit nos idées acquises, et plus il nous est aisé d'acquérir de nouvelles idées.
Il n'est donc pas douteux qu'un des besoins les plus fondamentaux de l'éducation de l'esprit ne [II-497] soit de nous former à l'usage écrit et parlé de la parole.
Mais, par cela même que nous avons besoin du langage pour penser, il est clair d'abord que la langue qu'il faudrait surtout nous apprendre, c'est celle dans laquelle nous pensons, celle dont nous faisons habituellement usage, et non des langues dont nous n'aurons jamais occasion de nous servir. Ensuite, par cela même que le langage ne nous sert à acquérir de nouvelles idées qu'en exprimant les idées acquises, il est clair que l'étude de la langue ne devrait pas devancer l'acquisition des idées, mais la suivre, ou mieux encore l'accompagner.
La bonne marche serait de s'instruire, et, à mesure qu'on acquerrait des idées, de s'exercer empiriquement à les exprimer, de les rendre plus sûres, plus précises, plus disponibles en les formulant, et par là de se donner le moyen d'étendre encore ses connaissances. On conçoit à peine la possibilité de séparer l'étude des choses de celle des signes destinés à les exprimer; mais il est particulièrement absurde de vouloir commencer par l'étude des signes, et la grammaire, qui est la première chose qu'on s'évertue à nous apprendre, est peut-être la dernière que nous devrions étudier.
L'essentiel est d'étudier les choses, toujours les choses, et de ne se servir du langage que pour faciliter ce travail, de s'exercer à l'emploi des mols en [II-498] apprenant les idées. Ce n'est qu'en nous familiarisant avec les choses, en les observant attentivement en elles-mêmes et dans leur action, en regardant bien ce qu'elles sont et les lois qu'elles suivent, que nous pouvons nous préparer d'une manière convenable aux arts que nous sommes destinés à pratiquer.
Tout art n'est que l'application à un certain travail d'un certain ensemble de connaissances. Pour être en état de l'exercer, la première chose dont nous avons besoin, c'est de nous former à ce travail; à la seconde, d'acquérir ces connaissances.
De quelle puissance d'action ne serait pas doué un peuple chez qui les hommes, au lieu d'employer sans fruit tout leur jeune âge à des études sans utilité, se mettraient de bonne heure à voir. faire et à faire eux-mêmes la chose pour laquelle ils se sentiraient le plus d'attrait; où à ces exercices pratiques se joindraient bientôt des études de théorie, propres à les éclairer et à les rendre plus faciles ; où on leur enseignerait les élémens des sciences qui se rattacheraient le plus directement à la pratique de leur art; où on les exercerait surtout à faire à leur travail d'utiles applications de ces connaissances ; où l'on aurait soin de les former en même temps aux habitudes morales que réclamerait l'exercice de leur profession; où, finalement et après les avoir instruits de tout ce qui pourrait [II-499] en rendre la pratique plus facile et plus fructueuse, on leur montrerait la place qu'elle occupe dans la société, les autres travaux auxquels elle se lie, la manière dont tous les travaux s'enchaînent, et les conditions générales de leur commune prospérité !
Malheureusement, il s'en faut que les choses soient arrangées dans la société pour préparer ainsi les hommes aux affaires de la vie, pour développer leur intelligence dans le sens des fonctions qu'ils auront à remplir ou des travaux qu'ils auront à faire. La société n'ayant pas encore un caractère nettement déterminé, n'étant point organisée dans l'intérêt des professions utiles, il est difficile que l'éducation soit bien appropriée à ces professions. Mais, plus l'avenir de la société se découvrira à elle, plus elle comprendra sa vraie vocation, plus elle verra que sa destinée est de prospérer par une pratique forte et savante de tous les arts paisibles, et plus elle sentira le besoin de donner à ceux qui ont pour objet spécial la culture de l'entendement une direction mieux accommodée aux besoins de tous les autres, plus elle sentira qu’une éducation éclairée de l'intelligence est la condition la plus fondamentale du succès de tous les arts.
Les arts qui s'occupent de l'éducation de l'esprit sont indispensables au succès des autres, [II-500] non-seulement parce qu'ils en éclairent la pratique, mais encore parce qu'ils mettent dans des dispositions morales plus favorables à leurs progrès. Plus il se. mêle d'instruction à la pratique d'un art quelconque, et plus on l'exerce avec élévation, avec désintéressement, avec affection; plus on le cultive pour lui-même; plus on est occupé de ses progrès; on est moins sensible aux bénéfices qu'on fait comme spéculateur; on l'est davantage aux succès obtenus comme artiste ; on est touché de ses gains, moins parce qu'ils sont un moyen de bien-être, que parce qu'ils rendent témoignage du pouvoir qu'on exerce, parce qu'ils sont un moyen d'acquérir un pouvoir plus grand; et, au lieu de dissiper ses profits dans les jouissances du luxe, ainsi que le font d'ordinaire les industrieux dont l'esprit est peu cultivé, on en emploie la meilleure partie à étendre utilement ses entreprises, à perfectionner ses procédés, et en général à devenir plus puissant dans sa profession, à y obtenir des résultats plus considérables.
Au surplus, les industries scientifiques n'auraient pas la vertu de nous rendre plus propres, sous une multitude de rapports, à l'exercice de toutes les autres, qu'elles seraient encore, pour elles-mêmes et pour les avantages immédiats qu'elles procurent, dignes de nous inspirer la plus haute considération. Nous trouvons à nous instruire un plaisir dégagé de tout autre intérêt que le plaisir même de nous [II-501] instruire. Une découverte nous charme avant que nous sachions à quoi elle pourra nous servir, et par cela seul qu'elle satisfait notre désir de connaître, qu'elle fait agir notre esprit, qu'elle lui donne le sentiment de sa force, qu'elle contribue plus ou moins à l'augmenter.
Nous aimons tout ce qui a pour effet d'accroître nos facultés, quelles qu'elles soient, mais surtout nos facultés mentales. Si nous sommes heureux quand nous ajoutons à la vigueur ou à l'adresse de notre corps, nous le sommes bien plus encore lorsque nous développons les pouvoirs de notre esprit. La culture de l'intelligence a toujours été regardée comme une des plus nobles et des plus douces occupations de l'homme. Quel est le voluptueux dont les jouissances approchent de celles de l'homme studieux qui cultive avec fruit son entendement, qui sent ses forces intellectuelles s'accroître, qui pénètre chaque jour un peu plus avant dans la connaissance du monde sensible ou dans celle du monde moral ? Quel est le plaisir sensuel qui aurait pour. lui le charme divin de ces découvertes ? Qui n'aimerait mieux être à la place de Newton, au moment où sa puissante intelligence s'élève de la chute d'une pomme à la connaissance de la gravitation universelle, qu'à celle de l'épicurien qui savoure un mets délicat, ou qui découvre le moyen de se donner quelque sensation nouvelle ?
[II-502]
En même temps que les plaisirs de l'esprit sont plus purs et plus relevés que ceux des sens, ils paraissent aussi plus durables et sont surtout moins dispendieux. L'intelligence ne se blase pas aussi vite que les sens sur les jouissances qu'elle éprouve : par suite, elle n'a pas aussi souvent besoin de les renouveler. Nos sens sont naturellement insatiables. A peine ils ont goûté d'un plaisir qu'ils s'en lassent et qu'ils sollicitent un plaisir nouveau. Pour peu qu'on cède à leurs importunités, elles s'accroissent, et la fortune la plus considérable est bientôt trop petite pour suffire à toutes leurs fantaisies. Ils sont ruineux à la fois parce qu'ils détruisent une multitude de choses qu'il faut renouveler sans cesse, et parce qu'ils demandent que ces choses soient toujours plus recherchées et plus variées. Sans doute, la curiosité de l'esprit n'est pas aisée à satisfaire. L'esprit aspire aussi, comme les sens, à multiplier, à étendre, à varier ses plaisirs. Mais, outre qu'il jouit plus long-temps de ses impressions, il est plus aisé de lui en procurer de nouvelles; il faut peu de chose le mettre en action ; les matériaux et les instrumens de son travail et de ses jouissances sont comparativement peu chers, et il est rare de voir des hommes ruinés pour avoir trop accordé à leur intelligence, tandis que le monde est plein de gens qui sont tombés [II-503] dans la misère pour n'avoir pas su résister aux demandes de leurs sens.
J'ajoute qu'en accordant beaucoup à ses sens, on ne compromet pas moins sa santé que sa fortune; on court le risque de s’abrutir, de se dégrader, et il n'y a pas, à beaucoup près, les mêmes inconvéniens à céder aux sollicitations de ses facultés intellectuelles. Sûrement ces facultés veulent être aussi ménagées : il ne faut abuser d'aucunes. Si l'on doit se garder de dire avec Rousseau que l'homme qui médite est un animal dépravé, il est certain que l'homme qui ne ferait que méditer nuirait, sous plusieurs rapports, à la perfection de sa nature. Un exercice immodéré de nos facultés rationnelles peut nuire à la fois à toutes nos facultés, à celles du corps et à celles de l'âme. Il est difficile notamment d'exercer beaucoup sa faculté de connaître, sans diminuer un peu sa faculté d'imaginer et de sentir. S'il arrive rarement que les poètes se distinguent par une grande force de raison et de logique, il n'est pas ordinaire que les philosophes pèchent par un excès d'imagination et de sensibilité. Mais, en reconnaissant que les plaisirs de l'intelligence peuvent avoir aussi leurs inconvéniens, il faut convenir qu'il est moins facile et moins commun d'en abuser que des jouissances physiques, et que l'abus d'ailleurs n'en paraît pas à beaucoup près aussi fâcheux.
[II-504]
Enfin, ces plaisirs ont encore cet avantage qu'ils peuvent tenir lieu, jusqu'à un certain point, de ceux que donne la fortune. Chaque homme jouit surtout par celles de ses facultés qu'il a particulièrement exercées. Plus on a cultivé son esprit, et moins on cherche à être heureux par ses sens. La culture de l'intelligence simplifie les besoins, diminue l'âpreté pour le gain, ôte à la richesse matérielle une partie de son importance.
Elle est, d'ailleurs, quand elle devient un peu générale, extrêmement favorable à l'égalité ; elle détruit dans les basses classes ce qui les fait le plus invinciblement repousser par les classes élevées, à savoir, la grossièreté, la rudesse ; elle élève les hommes en les polissant; elle les élève encore en ajoutant à leurs forces; car, si la fortune est une puissance, l'esprit en est bien une aussi. Rien, en un mot, ne paraît si propre que la culture de l'esprit à bien faire disparaître l'inégalité d'entre les hommes.
En même temps qu'elle polit leurs moeurs, elle les adoucit. Ils vivaient d'abord sous l'empire de l'imagination et des passions ardentes : l'étude a graduellement tempéré cette chaleur de sang; elle a dissipé les illusions, refroidi l'enthousiasme, éteint le fanatisme, et mis fin, par cela seul, à une multitude de désordres hideux et de crimes plus atroces les uns que les autres. Quand la culture patiente de [II-505] l'entendement n'aurait fait autre chose qu'amortir cette chaleur âcre de l'imagination et des passions qui les rendit pendant long-temps si destructives, on pourrait dire qu'elle a puissamment contribué à la civilisation et au salut du genre humain.
On voit donc que les industries qui s'occupent de l'éducation de l'intelligence, déjà très-importantes, en ce sens qu'elles développent un ordre de moyens indispensable à l'exercice de tous les arts, le sont encore sous ce rapport que les moyens qu'elles créent sont par eux-mêmes des produits infiniment précieux, des produits destinés à satisfaire l'un des besoins les plus impérieux de notre nature, et qui sont pour nous une source inépuisable d'avantages et de plaisirs.
Mais, comment ces nobles industries deviennent-elles puissantes, et quelle application y a-t-il à faire ici des principes généraux que nous n'avons cessé de présenter, dans le cours de cet ouvrage, comme la source de toute force et de toute liberté ? C'est ce qu'il me reste à faire connaître.
§ 4. Je prie qu'on ne s'étonne point si je considère encore ici le talent des affaires, c'est-à-dire, le talent de juger ce qu'il convient d'entreprendre et de conduire ses entreprises avec habileté, comme le premier élément de puissance. Il ne suffit point de se proposer un but louable, de songer [II-506] à propager de bonnes idées; il faut encore pouvoir se promettre que ces idées trouveront des esprits disposés à les recevoir, qu'il y aura des consommateurs du produit intellectuel qu'on se propose de répandre.
Avant de fonder une école, avant d'entreprendre un journal, avant de publier un ouvrage quelconque, il y a toujours à se demander si l'action qu'on veut exercer sur les intelligences répond à un besoin senti, et lorsqu'on a la preuve que ce besoin existe, s'il n'est pas déjà satisfait, ou si l'on a les moyens de le mieux satisfaire. Alors même qu'on ne compterait son intérêt pour rien, qu'on n'aurait d'autre but que d'être utile, il faut réussir; il faut faire une école où l'on vienne, un journal qui ait des abonnés, un ouvrage que le public veuille lire, et pour cela il faut entrer dans les goûts du public.
Je ne dis sûrement pas qu'il faut prendre conseil de ses erreurs et spéculer sur les travers de son intelligence : quand on ne serait pas porté par honneur à ne répandre qu'une instruction saine, on devrait l'être encore dans l'intérêt bien entendu de son art; mais je dis que, pour trouver le débit d'une telle instruction, il faut l'assortir avec soin au goût du public à qui on en fait l'offre ; je dis que, pour conduire ce public à des idées meilleures, il faut partir des bonnes idées qu'il a, et [II-507] que l'instituteur qui sait s'accommoder à l'état de son intelligence, et éviter également de la heurter et de la trop dépasser, est à la fois celui qui la sert le mieux et celui qui fait les meilleures affaires.
Je conçois fort bien qu'un homme qui est très en avant des idées communes n'ait pas toujours la patience d'attendre, pour publier ses découvertes, que le grand nombre soit en état d'en profiter; mais, par cela même qu'il ne travaille pas pour le grand nombre, il ne peut raisonnablement espérer que le grand nombre recherche ses écrits, et il doit nécessairement se contenter des suffrages des esprits cultivés et des intelligences d'élite à qui s'adressent plus particulièrement ses productions. Aussi, tout en reconnaissant qu'un instituteur, un écrivain, un journaliste, même à ne considérer que l'intérêt de leur industrie, doivent travailler de toutes leurs forces à perfectionner la raison du public, à étendre, à agrandir son intelligence, il faut se bien pénétrer de cette idée, que celại qui veut répandre une certaine instruction, comme celui qui se propose de mettre dans la circulation un autre produit quelconque, doit, avant tout, avoir égard aux besoins éprouvés, et prendre en considération l'état de la demande.
Il n'est pas moins essentiel qu'il connaisse l'état de l'offre, c'est-à-dire, la nature et l'étendue des moyens employés à satisfaire le besoin d'instruction [II-508] existant. Quel est le nombre des établissemens déjà consacrés à la propagation des idées qu'il s'agit de répandre ? Quels sont leurs procédés? Quelle est leur dépense ? Le service qu'ils font peut-il être mieux fait ou à moins de frais ? Voilà des questions qu'il faut d'abord résoudre. C'est un compte préliminaire à dresser. Il serait insensé de rien entreprendre avant d'avoir réuni les élémens de ce compte, de les avoir attentivement examinés, et de s'être assuré, autant que possible, qu'il y a, en effet, quelque chose d’utile à tenter, et qu'on ne va pas gaspiller son temps, ses capitaux, son intelligence, sans fruit pour le public et avec grand dommage pour les gens à qui on va faire concurrence, et surtout pour soi.
Enfin, à cette capacité de juger ainsi, par anticipation, de la bonté de l'entreprise qu'on se propose de faire, il est également indispensable de joindre le talent de la bien administrer. Un journal, une librairie', une école, sont des entreprises industrielles qui ont un besoin tout aussi grand d'être bien conduites que tout autre genre d'établissement industriel.
Il faut donc ici, avant tout, les divers talens qui constituent l'homme d'affaires, c'est-à-dire, les talens de spéculer, d'administrer, de compter; et plus un écrivain, un libraire, un instituteur ont la passion d'être utiles, plus il importe, par cela [II-509] même, qu'ils sachent ce qui peut réussir, quel genre d'enseignement peut être reçu, quel ordre d'idées raisonnables on peut essayer de répandre, et par quels moyens le succès d'une telle entreprise sera le mieux assuré. Il n'y a, en aucun genre, de bien à attendre d'un établissement mal conçu et mal conduit, et l'on sert toujours mal les intérêts du public lorsqu'on ruine ses propres affaires.
Ainsi, le talent des affaires a sa place marquée à la tête des industries qui agissent sur l'intelligence comme à la tête des autres industries. Il est, dans ces arts comme dans tous, la condition de succès la plus fondamentale.
§ 5. A leur tour, la connaissance du métier, les notions théoriques, le talent des applications et de l'exécution, et, en général, les divers genres de capacité qui constituent le génie de l'artiste plutôt que celui du spéculateur, et qui se rapportent à l'exécution plutôt qu'à la direction des entreprises, y sont pareillement de nécessité.
Parmi les moyens de ce second ordre, la connaissance pratique du métier est celui que je place en première ligne; c'est-à-dire que, pour former les intelligences à quelque genre d'exercice que ce soit, l'habitude de l'enseignement est le genre de capacité qui me paraît le plus nécessaire ou le premier nécessaire. Il est très-possible, en effet, [II-510] qu'un homme ayant sur une science des connaissances plus étendues ou plus approfondies qu'un autre, soit pourtant moins en état de la professer.
Il y a dans le fait de transmettre un ordre quelconque de connaissances, un talent particulier différent de ces connaissances mêmes, et qui constitue l'art de l'enseignement. Cet art, comme tous, s'est formé par une suite de tâtonnemens et d'expériences. Il faut, pour le posséder, avoir agi soi-même sur les esprits et sur beaucoup d'esprits, s'être habitué à en distinguer les diverses trempeś, avoir observé les difficultés qu'on éprouve communément à les faire passer par une certaine série d'idées, savoir celles de ces idées qu'il faut leur inculquer les premières, celles qui doivent venir ensuite, et l'ordre dans lequel elles doivent toutes leur être présentées. Il faut avoir noté surtout les points devant lesquels la plupart des esprits s'arrêtent, les intervalles qu'ils ont le plus de peine à franchir, et les moyens par lesquels on réussit le mieux à leur faire surmonter ces obstacles. Or, la pratique, et une longue pratique, est nécessaire pour tout cela, et les meilleures théories sur la nature de l'esprit humain, sur l'ordre dans lequel ses connaissances s'enchaînent, ne sauraient tenir lieu des moyens que procurent l'habitude et l'expérience de l'enseignement.
[II-511]
Cependant, dans une classe d'industries dont le principal objet est de mettre les esprits en possession des connaissances acquises, il n'est pas douteux que la perfection de ces connaissances ne soit un grand moyen de puissance et de liberté d'action. La perfection des sciences, en effet, dépend beaucoup de celle de leurs méthodes, c'est-à-dire de la bonté des procédés, suivant lesquels elles se sont formées et suivant lesquels elles continuent à s'étendre. Or, il est aisé de concevoir que plus elles se sont formées d'après de bonnes méthodes, et plus il doit être aisé de les enseigner. Les idées se transmettent en effet par les mêmes moyens qu'elles s'acquièrent, et plus les moyens employés pour les acquérir sont de nature à en rendre l'acquisition facile, plus les mêmes moyens évidemment doivent en faciliter la transmission. Il y a, dit-on, beaucoup de manières différentes d'enseigner une même chose : sans doute, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises manières de la savoir ; mais comme il n'y a qu'une bonne manière de la savoir, il semble qu'il ne peut y avoir non plus qu'une bonne manière de l'apprendre, et que la bonne manière de l'apprendre est absolument la même que la bonne manière de la savoir.
Si donc, pour être en état d'enseigner une science, la première chose requise est de s'y être beaucoup exercé, la seconde est que cette science soit bien [II-512] faite, et la pratique, ici comme ailleurs, reçoit les plus grands secours de la perfection des théories. Avant la rénovation de la chimie, il fallait, d'après Lavoisier [209] , trois ou quatre ans pour faire un chimiste, ou ce qu'on appelait alors un chimiste : aujourd'hui un cours de chimie exige à peine une année; et, dans un espace de temps trois fois moindre, on parcourt, d'un pas facile et ferme, une chaîne de connaissances peut-être dix fois plus étendue. On peut juger par ce seul fait à quel point l'acquisition et la transmission des idées deviennent plus faciles à mesure que les méthodes sont plus perfectionnées, c'est-à-dire à mesure qu'on est parvenu à mieux classer les objets dans les sciences descriptives, et à découvrir dans les sciences expérimentales le fait qui peut le mieux rendre raison de tous les autres.
Il est aisé de voir dans la géographie, la botanique, la zoologie et dans d'autres sciences descriptives, quelle puissance les bonnes méthodes de classification donnent à l'esprit pour embrasser et retenir un grand nombre d'objets à la fois. Ces méthodes, à la vérité, ne font pas connaître la nature des choses ; mais en introduisant un certain ordre dans leur distribution, en formant des groupes distincts de toutes celles qui se ressemblent, en [II-513] observant dans la dénomination de ces groupes la même analogie que dans leur formation, elles empêchent que l'esprit en soit accablé, et lui permettent d'en saisir, d'une seule vue, des quantités infiniment plus considérables. Combien, par exemple, notre puissance de concevoir des nombres n'est-elle pas accrue par le système de numération décimale, et par la manière simple et admirable dont les unités dans ce système se trouvent groupées ! Quelle multitude d'objets un naturaliste ne parvient-il pas à caser dans son esprit par des procédés analogues [210] !
D'une autre part, il n'est pas moins aisé de voir dans la chimie, la physique, l'astronomie, et dans d'autres sciences expérimentales, quelle puissance la découverte de certains faits donne à l'esprit pour l'explication de tout un ensemble de phénomènes. Combien, par exemple, la découverte de la loi de la gravitation n'a-t-elle pas donné de facilités pour l'intelligence des phénomènes astronomiques ! Il y a une force qui fait graviter tous les corps les uns vers les autres en raison directe de leur masse, et en raison inverse du carré de leurs distances respectives. C'est cette force qui fait tomber ici-bas les corps graves. C'est elle qui fait aller vers la terre le fruit qui se détache de cet arbre. [II-514] Elle agirait sur ce fruit quand il serait élevé à trois mille toises, quand il le serait à dix mille. Elle doit donc agir de l'endroit où est placé le globe de la lune. Elle peut donc être la même que celle qui fait graviter la lune vers la terre, que celle qui fait peser les satellites de Jupiter sur Jupiter, que celle qui fait rouler les lunes de Saturne autour de Saturne, que celle qui contraint toutes ces planètes secondaires, roulant autour de leur planète centrale, à rouler en même temps avec elle autour dų soleil. Cette force agit partout de la même manière et suivant les mêmes lois. Il n'y a aucune variété dans le cours de la lune, dans ses distances de la terre, dans la figure de son orbite, tantôt approchant de l’ellipse et tantôt du cercle, qui ne soit une suite de la gravitation en raison de la distance à la terre et de la distance au soleil. Les moindres variations dans le cours des astres sont un effet nécessaire de la même cause... Voilà comment, à l'aide d'un seul fait, on parvient à connaître le plus vaste des systèmes. De proche en proche, on s'élèvera à des connaissances qui semblaient placées pour jam mais hors de la portée de l'entendement humain. Newton osera calculer, par exemple, quelle doit être la pesanteur des corps dans d'autres sphères que la nôtre ; il osera dire ce que doit peser, dans Saturne ou dans le soleil, ce que nous appelons ici une once, une livre, et ces calculs extraordinaires ne seront que des déductions rigoureuses de cette [II-515] observation générale que les corps pèsent les uns sur les autres en raison directe de la masse et en raison inverse du carré des distances. Il serait aisé de montrer par beaucoup d'autres exemples ce que la bonté des méthodes donne de puissance à l'enseignement, et combien il devient plus aisé d'apprendre et de professer une sience à mesure que s'en perfectionne la théorie.
Si le perfectionnement des théories est d'une grande importance, le talent des applications ne peut pas être indifférent. A quoi servirait en effet qu'une science fût mieux faite si l'on continuait à l'enseigner par les anciens procédés ? Qu'importerait que Bacon eût découvert, il y a deux siècles, une meilleure méthode de philosopher, si la logique, dans nos écoles, se réduisait encore à l'art du syllogisme, et si l'on bornait l'étude de la nature à celle d'Aristote et de ses.catégories ? Il est évident que les industries qui s'occupent de l'éducation de l'intelligence ne peuvent tirer quelque profit du progrès des méthodes et de la réformation des sciences, qu'à mesure que ces utiles perfectionnemens se font sentir dans la pratique, et qu'ils servent à améliorer les formes de l'enseignement.
Enfin il y a ici, comme dans tous les arts, un talent de main-d'œuvre différent de la connaissance du métier, des notions théoriques, du génie des applications, et qui n'est pas moins nécessaire que [II-516] ces divers genres de capacités à la liberté des industries qui agissent sur l'intelligence. Ce talent n'est ni celui du savant qui trouve de nouvelles méthodes, ni celui de l'instituteur qui entreprend de les appliquer : il est celui des professeurs que cet instituteur attache à son entreprise. Ces professeurs sont les ouvriers de son établissement. Ce sont eux qui agissent immédiatement sur les intelligences et qui leur donnent les diverses façons qu'elles sont destinées à recevoir.
J'observe pourtant une différence assez notable entre ces ouvriers-ci et ceux de beaucoup d'autres fabriques : c'est qu'ici un seul ouvrier crée à la fois un grand nombre de produits, tandis qu'ailleurs un seul produit est ordinairement l'ouvrage d'un grand nombre de personnes. Dans une fabrique d'épingles, par exemple, dix-huit ou vingt personnes concourent à la confection de chaque épingle, tandis qu'il arrive souvent dans une école qu’un professeur donne la même façon à plusieurs centaines d'intelligences à la fois. Je pourrais observer également qu'il est beaucoup plus malaisé de façonner l'esprit que la matière, et qu'il faut infiniment plus de temps pour plier nos organes intellectuels à de certains exercices que pour imprimer à un corps brut telle forme déterminée. Mais je ne sais si ces remarques nous mèneraient à quelque chose d'utile et je ne m'y arrête point. La seule chose sur [II-517] laquelle j'insiste, c'est qu'il y a une main-d'œuvre dans les arts qui agissent sur l'intelligence, encore bien que l'intelligence ne se façonne pas à la main, et que la puissance de ces arts est d'autant plus grande,, que les hommes chargés de cette main-d'œuvre sont plus habiles à l'exécuter.
Toutes les facultés qui tiennent à l'art, comme celles qui se rapportent aux affaires, trouvent donc ici leur application. Voyons l'influence qu'y exercent à leur tour les habitudes morales, et d'abord cherchons comment s'y appliquent celles de ces habitudes qui tendent plus particulièrement à la conservation et au perfectionnement de l'individu.
§ 6. La première chose qui me frappe, c'est que les hommes qui font leur profession de la culture des intelligences sont appelés, par cela même, à faire de leurs facultés intellectuelles un usage plus habituel, plus soutenu et tout à la fois plus énergique, plus fin, plus délié que la plupart des autres travailleurs. Partant, ils semblent avoir plus besoin que les autres d'éviter toute erreur de régime qui tendrait à émousser ces facultés délicates ou à les troubler dans leurs fonctions. La gourmandise, l'ivrognerie, l'incontinence, auraient pour eux des effets particulièrement fâcheux. Plus ils demandent d'efforts à leur intelligence, et moins ils peuvent en demander à tel autre ordre de facultés. Plus leur [II-518] système nerveux est excité, sollicité, fatigué par le travail habituel de leurs facultés mentales, et plus ils doivent s'interdire l'abus de tous les plaisirs qui ont particulièrement pour effet d'ébranler et d'user le système nerveux.
Il n'est pas sans exemple, il est vrai, que des hommes de génie, très-enclins à de certains vices, soient tombés dans des excès de plus d'un genre, sans paraître rien perdre de la vigueur de leur esprit; mais outre qu'ici on a très-bien pu être trompé par les apparences, apparences, il ne faut rien conclure pour le commun des hommes, de ce qui est possible à de certaines organisations tout-à-fait privilégiées. N'hésitons donc point à reconnaître qu'un des premiers besoins des artistes qui font profession de cultiver leur esprit et de former celui des autres hommes, est de ne céder aux appétits du corps qu'avec beaucoup de discernement et de retenue. Plus ils useront de régime, plus ils sauront régler l'exercice de leurs facultés, de manière à donner et à conserver habituellement à leur intelligence le degré d'énergie, de netteté, de sensibilité dont elle est naturellement susceptible, et plus ils seront forts et libres dans l'exercice de leur art.
On sait quel rôle ces industrieux jouent dans l'économie sociale. Ils sont comme l'âme de la société ; ils la corrigent de ses erreurs ; ils la polissent, l'éclairent, la dirigent. Plus ces fonctions [II-519] sont élevées, et plus il est désirable que ceux qui les remplissent se trouvent placés dans une situation qui ne contraste pas trop avec la dignité de leur ministère, qui les préserve de toute lâcheté, de toute bassesse, de toute complaisance contraire aux intérêts de la vérité. Ils ont donc encore plus besoin que d'autres professions de jouir d'une certaine fortune, et plus ils possèdent les qualités morales nécessaires pour l'acquérir et la conserver, plus ils sont appliqués, actifs, économes, et plus ils se ménagent, relativement à l'exercice de leur art, de puissance et de liberté.
Un de leurs premiers besoins, dis-je, est de se faire une existence indépendante. Toutefois, s'il serait à souhaiter qu'ils possédassent une certaine fortune, il leur conviendrait moins qu'à d'autres de céder à des goûts dispendieux. Le luxe, qui nous a paru si contraire aux progrès de toutes les industries, est particulièrement funeste à celles qui travaillent pour l'intelligence. Plus une nation éprouve d'attrait pour les plaisirs des sens, de la vanité, du faste, et moins elle en a pour ceux de l'esprit, moins elle recherche les produits destinés à le satisfaire, moins les créateurs de ces produits sont considérés, moins il leur est aisé de trouver à faire un bon emploi de leurs facultés productives.
Paris, la ville la plus lettrée de ce royaume, et [II-520] peut-être du monde ; Paris, qui fait la fortune de plusieurs milliers de marchands de vin et de comestibles, d'environ quinze cents épiciers, de mille sept cent soixante-sept marchands de fruits ou de légumes, de sept cent quatre-vingt-sept limonadiers, de six cent quatre-vingt-dix fabricans de bijouterie et joaillerie [211] , Paris n'a de travail que pour quatre-vingts imprimeurs, et compte deux ou trois fois plus de restaurateurs que de libraires. Encore les libraires et les imprimeurs de Paris ne travaillent-ils pas seulement pour Paris, mais pour la France entière, et même un peu pour l'étranger. On voit que la ville lettrée est surtout la ville gourmande, la ville fastueuse.
Au reste, il en est à peu près ainsi de toutes les villes du monde. Partout encore les hommes les plus sûrs de faire fortune sont ceux qui travaillent pour les sens et pour la vanité. Parmi les productions de l'esprit, les plus frivoles, celles qui s'adressent à l'imagination ou aux passions, trouvent partout infiniment plus d'acheteurs que celles qui parlent directement à l'intelligence : la scène française fait à peine des recettes aussi considérables que le théâtre de Brunet; il se lit dix mille fois plus de romans que de livres de science; madame Pasta gagnera à Londres cinq ou six mille guinées en [II-521] quelques mois, et le publiciste le plus renommé aura grand'peine à s'y faire par an deux ou trois cents livres sterling de rente.
On sent donc combien il importe aux industrieux qui travaillent pour l'intelligence, même à ne regarder que l'intérêt de leur art, de répandre le goût des jouissances intellectuelles, de faire la guerre au faste, à l'ostentation, à la sensualité, et d'être les premiers à donner l'exemple de cette simplicité de mœurs qui n'exclut ni le bien-être, ni les commodités, ni une certaine élégance, mais qui laisse l'esprit libre pour des plaisirs plus élevés [212] .
Les industrieux dont je m'occupe sont appelés, par la nature même de leurs travaux, à rectifier [II-522] beaucoup d'idées, à en introduire un grand nombre de nouvelles. Par-là, ils préparent sans cesse la réforme d'établissemens ou d'institutions fondés sur des erreurs précédemment accréditées, et par suite ils ne cessent de menacer l'état des individus ou des classes dont l'existence est attachée à celle de ces erreurs. Aussi n'est-il pas de professions qui soulèvent plus de haines et soient exposées à plus de persécutions. Depuis le commencement du monde, la destinée habituelle des hommes qui se sont consacrés à la culture et à l'avancement de l'intelligence a été d'être persécutés. Il est donc peu de professions qui requièrent plus de courage, non pas de celui qu'il faut pour enlever une batterie, ni pour affronter une mer orageuse, mais de cette tranquille fermeté d'esprit qui est nécessaire pour dire, quand il le faut, des vérités qui blessent, pour attaquer des abus en crédit, pour ne consentir à affaiblir l'expression de sa pensée qu'autant que l'intérêt de la vérité l'exige, pour dévouer hardiment sa vie à la défense de la vérité. De toutes les qualités morales que demandent les industries dont il s'agit dans ce chapitre, celle-ci est peut-être celle dont il est le moins possible de se passer; et plus un écrivain est en même temps homme de courage, plus il exerce son art avec puissance et avec fruit. Mais ceci me conduit à parler des habitudes civiles que les mêmes [II-523] industries réclament, car on n'a besoin de courage pour publier la vérité, que parce que celui qui la dit est exposé à des agressions injustes.
§ 7. Si, pour être forts, les hommes qui font profession d'agir sur les intelligences ont besoin comme les autres classes d'industrieux, et peut-être plus qu'aucune autre classe, de se soumettre, dans leur vie particulière, à un bon régime moral; si leur puissance est plus ou moins accrue par une pratique habituelle de la sobriété, de la tempérance, de l'économie, du courage, de la simplicité des goûts et des moeurs, et par tout un ensemble de bonnes habitudes personnelles, il n'est pas douteux que l'existence, relativement à leur art, de bonnes habitudes civiles ne soit pour le moins aussi propre à en faciliter l'exercice et à en étendre le pouvoir.
Plus les individus, les partis, les autorités constituées, la société tout entière, savent se renfermer dans les bornes du droit commun, relativement à l'action de parler, d'écrire, d'imprimer, de professer, et plus les hommes qui écrivent et qui professent peuvent exercer leur industrie avec facilité et avec liberté.
Il y a deux manières de sortir à cet égard des limites de la justice : la première est de faire de [II-524] ces industries un usage pernicieux; la seconde, d'en accaparer l'usage.
D'une part, il peut fort bien arriver que des écrivains, des professeurs se rendent coupables, dans l'exercice de leur art, d'actions nuisibles et punissables. Il est possible qu'ils commettent directement des délits, qu'ils outragent la morale publique, qu'ils insultent ou qu'ils diffament des individus, des pouvoirs constitués, des partis, même des corps de nation. Il est possible également qu'ils se rendent complices de délits auxquels ils ne participeraient pas d'une manière directe, qu'ils excitent à commettre ces délits, qu'ils provoquent au vol, au meurtre, à la rébellion, à d'autres crimes.
Qu'un tel abus des arts, dont la mission est de former les intelligences, ait pour effet d'en paralyser l'action, c'est une chose si évidente qu'il est à peine nécessaire de s'arrêter à la démontrer. Au milieu des haines et des discordes que tend naturellement à faire naître un débordement de diffamations ou de prédications séditieuses, on ne jouit bientôt plus d'assez de sécurité et de tranquillité d'esprit pour se livrer à l'étude, pour composer de bons écrits, pour songer à ouvrir des écoles: on n'ose pas plus fonder des entreprises scientifiques que des entreprises commerciales ou manufacturières.
D'ailleurs la recherche paisible de la vérité perd alors beaucoup de son intérêt. Dès qu'une fois les [II-525] fureurs de l'esprit de parti ont envahi la chaire, la tribune, le barreau, les écoles, les journaux, les ouvrages, on peut dire que le mouvement des idées est interrompu, que le travail des intelligences est arrêté: les passions seules occupent la scène, et seules elles sont en progrès, parce que seules elles agissent. Il n'est personne qui n'ait remarqué que les temps de crise et de grande fermentation sont précisément ceux où l'on lit et où l'on médite le moins, où l'on fait le moins de recherches, d'observations, d'expériences scientifiques.
Enfin, un dernier effet des excès dont je parle est de fournir aux partis en possession du pouvoir des prétextes plus ou moins spécieux pour asservir les arts qui servent à les commettre. Cela est si vrai, que la tactique la plus ordinaire du despotisme, toutes les fois qu'il a été forcé de laisser quelque latitude aux industries littéraires et scientifiques, a été de fomenter en secret l'abus de ces industries pour s'autoriser à les envahir de nouveau et à s'en rendre encore le maître.
Cette usurpation est, comme je l'ai dit, une seconde manière de sortir, relativement à ces industries, des limites de la justice. Tandis que certains hommes peuvent s'en servir pour mal faire, il est possible que d'autres entreprennent de les accaparer. Il peut arriver que de hardis monopoleurs [II-526] élèvent la prétention de jouir, à l'exclusion de tout le monde, de la faculté d'énoncer, de publier, de faire circuler leurs idées; de la liberté d'écrire, de professer, de prêcher, etc.
A la vérité, ce ne seront pas de simples individus qui formeront jamais des prétentions pareilles. Je ne pense pas qu'on en ait vu d'assez esfrontés pour oser dire à d'autres hommes : Vous n'imprimerez que ce qu'il nous plaira ; vous ne professerez que sous notre bon plaisir; vous n'enseignerez que ce que nous voudrons; nul ne pourra savoir que ce qu'il nous conviendra que l'on sache; on ne lira que nos gazettes, on ne recevra de leçons que de nos professeurs; on n'enverra ses enfans que dans nos écoles; on n'entendra de discours que ceux de nos orateurs, de sermons que ceux de nos prêtres, etc.
Mais ce que des particuliers n'oseraient jamais se permettre, des hommes en possession de la puissance publique se le sont de tout temps permis. A toutes les époques, la première pensée des ligues, des sectes, des factions victorieuses a été d'enchaîner l'esprit des populations vaincues, de les empêcher de se servir de leur intelligence. Le détail de ce qui a été tenté pour cela, seulement chez nous, dans le cours des trois derniers siècles, suffirait pour remplir une longue suite de volumes. Depuis cette ordonnance du 13 janvier 1535, par [II-527] laquelle un roi, surnommé le père des lettres, supprima toutes les imprimeries du royaume et défendit d'imprimer aucun ouvrage sous peine de la hart, jusqu'au projet de loi par lequel un ministère fameux essayait encore, il n'y a pas trois ans, d'étouffer en France toute publicité, on trouverait des milliers d'actes de toute nature, édits, ordonnances, arrêts, lois, décrets, jugemens, déclarations, lettres de cachet, dirigés contre la faculté de publier des opinions, de répandre des idées, d'agir oralement ou par écrit sur les intelligences.
En ce moment encore, la législation qui nous régit est pleine de dispositions violentes contre la faculté d'établir des écoles et contre celle d'imprimer, de vendre et de distribuer des écrits.
On sait d'abord, quant à la première de ces facultés, qu'elle est entièrement sous la main de la puissance publique. Il est impossible de former un établissement d'instruction quelconque sans la permission de l'autorité. L'autorité tient sous sa dépendance, depuis l'enseignement des connaissances spéciales les plus élevées jusqu'à celui de l'instruction primaire la plus inférieure. Un père de famille qui voudrait réunir chez lui les enfans d'un ami à ses propres enfans, sous la direction d'un précepteur à ses gages, serait accusé d'empiéter sur les privilèges de l'Université [213] . On ne [II-528] peut faire un cours public, gratuit ou payé, sur le sujet le plus indifférent, sans l'autorisation du ministère. On a vu des professeurs tourmentés, menacés de poursuites, pour quelques leçons données à domicile à des individus isolés [214] . En même temps, des branches très-importantes de l'enseignement, telles que la politique, la morale, l'économie politique, sont exclues à peu près de tou. tes les écoles que le gouvernement tolère ou paie. On lève, sous le nom de rétribution universitaire, une capitation annuelle de 60 fr. sur tout enfant auquel ses parens veulent donner l'instruction vulgairement appelée secondaire. L'accès des connaissances spéciales est rendu plus difficile encore par les perceptions, les taxes et les réglemens gênans auxquels il est assujetti. A tous les degrés de la hiérarchie universitaire, le sort des établissemens, des maîtres et des élèves, est soumis à l'arbitraire le plus décourageant. Supprimer les écoles, destituer les professeurs, chasser les étudians, les exclure de toutes les écoles du pays, leur faire perdre des inscriptions, des mois et des années d'étude, ont été, depuis quinze ans, des actes, sinon habituels, du moins assez frequens de l'administration.
A ces entraves contre la faculté d'instruire les hommes dans des écoles, se joignent celles contre [II-529] la faculté de les former par des écrits. On ne tolère qu'un certain nombre d'imprimeurs et de libraires, on les peut dépouiller arbitrairement de leur état. Il fallait encore, il y a à peine deux ans, l'autorisation du gouvernement pour établir une feuille périodique. Aujourd'hui encore, ces sortes d'entreprises ne sont possibles qu'aux individus mâles majeurs, régnicoles, qui peuvent fournir un cautionnement élevé, qui peuvent justifier d'une certaine fortune et qui consentent à faire de certaines déclarations. Le prix des feuilles qu'ils publient est élevé par diverses taxes de trente à quarante pour cent. L'administration, maîtresse des postes, se trouve maîtresse, par cela même, d'arrêter ou de suspendre la circulation des écrits, et plus d'une fois il lui est arrivé d'abuser à cet égard des facilités que lui offrait son privilège [215] .
Une chose qui pourrait surprendre, si l'on ne [II-530] savait à quel point nous pouvons nous laisser imposer par l'appareil de la force et de l'autorité, c'est que de telles entreprises, qui, de la part de particuliers, sembleraient le comble de l'audace ou de la démence, formées par des hommes en possession du pouvoir, trouvent une multitude d'esprits disposés à les tolérer, à les excuser, à les approuver même. On serait universellement révolté que de simples individus voulussent mettre le moindre obstacle au légitime exercice de l'esprit et à la juste manifestation de ses actes ; et, comme si les actions changeaient de nature suivant le caractère ou le nombre des hommes qui les commettent, le même excès, compris par des partis, des sectes, des pouvoirs constitués, n'offre plus rien dont de certaines gens s'étonnent. Ce n'est en quelque sorte que de hier que la masse des hommes honnêtes et sensés se montre décidément contraire au brigandage de la censure. Bien des personnes même, dont l'esprit se révolte à l'idée de cette tyrannie, voient d'un cil beaucoup plus tranquille d'autres entreprises, presque aussi criantes, contre la faculté de publier des écrits; et, quant à celle de former des écoles, presque personne encore ne s'avise de demander que l'autorité cesse d'y mettre obstacle : le nec plus ultra des prétentions libérales, c'est, non que tout le monde en jouisse, mais que les jésuites n'en jouissent pas, que tout soit réduit à la servitude [II-531] commune, que tout subisse le joug de l'Université.
Ai-je besoin de dire que la liberté des arts chargés de faire l'éducation des intelligences, est incompatible avec ces dispositions du public, avec une telle imperfection de ses habitudes civiles ? Si, pour que l'exercice de ces arts soit possible, on doit éviter de les employer à nuire; si l'on doit s'abstenir avec le même soin de les accaparer, il est pour le moins aussi essentiel d'empêcher que personne ne les accapare. Il faut que l'on sache, il faut que l'on sente généralement qu'une telle tentative n'est tolérable de la part de personne ; qu'elle est criminelle par elle-même, indépendamment de la manière dont on la forme, et du nombre ou de la qualité des personnes qui la font, qu'elle est même d'autant plus condamnable que ceux qui la font jouissent d'une plus grande somme de forces; et que, s'il est désirable qu'elle soit punie dans tous les cas, il serait bon surtout qu'elle le fût lorsqu'elle est formée par des pouvoirs dont la première obligation est de réprimer toutes les entreprises injustes.
Sûrement, nous devons tous désirer que la société emploie une partie de sa force ou de celle des pouvoirs qu'elle institue à réprimer les diffamations, les outrages, les excitations au vice et au crime; mais une chose que nous devons désirer peut-être encore plus vivement, c'est qu'elle s'impose et qu'elle [II-532] impose impérieusement à ses délégués le devoir de laisser tout homme exercer en paix, tant qu'il ne se rend coupable d'aucun délit, son intelligence et celle d'autrui sur quelque espèce de sujet que ce soit et par quelque moyen que ce puisse être. Les restrictions que les pouvoirs institués par elle mettent à cette faculté sont une des causes qui en gênent le plus l'exercice, qui en ralentissent et qui en faussent le plus le développement. C'est une vérité que j'ai exposée ailleurs [216] avec détail, et qu'au surplus, il suffit presque d'énoncer pour la faire comprendre.
Aussi, tant que les mœurs de la société comportent cette sorte d'excès, tant qu'elle peut voir de sang-froid les partis qui arrivent successivement au pouvoir se permettre, chacun à leur tour, de régler, au gré de leurs passions ou des intérêts de leur politique, l'usage qu'il sera permis de faire de la faculté de parler, d'écrire, d'imprimer, de professer, peut-on dire qu'il n'y a pas de vrais progrès, de vraie liberté possible pour les arts qui travaillent à l'éducation de l'entendement humain.
Si donc la liberté de cette classe de professions exige de ceux qui les exercent qu'ils perfectionnent leur morale personnelle, qu'ils adoptent le genre de vie et contractent les habitudes les plus propres à conserver et à accroître la puissance de leur esprit, [II-533] elle demande surtout que la généralité des citoyens aient assez appris à vivre, assez perfectionné leur morale de relation pour ne pas se gêner mutuellement dans l'usage inoffensif de leurs facultés intellectuelles.
§ 8. Il n'est donc pas un ordre de moyens personnels qui ne s'applique sans difficulté aux arts qui agissent sur l'intelligence. On en peut dire autant des divers ordres de pouvoirs qui entrent dans la composition du fonds réel; nous allons voir, en effet, que cette classe d’industries ne peut pas plus se passer que toutes les autres d'un atelier bien situé, bien monté, pourvu des ustensiles nécessaires et où les occupations se trouvent convenablement séparées.
On sent aisément, par exemple, que la situation de l'atelier n'est pas ici une chose indifférente. Il est clair qu'une école a plus de chances de succès là où les circonstances favorables à son établissement se trouvent réunies en plus grand nombre; là où il lui est plus aisé de se procurer les professeurs, les livres, les instrumens nécessaires à ses travaux; là surtout où est plus généralement demandé le genre d'instruction qu'elle a pour objet de répandre. Ainsi, une école de minéralogie peut se trouver très-convenablement placée dans le voisinage de mines considérables et au milieu d'une [II-534] nombreuse population de mineurs; une école de mécanique et de chimie, au sein d'une ville toute manufacturière, etc. Il est rare sans doute, pour ce genre d'établissemens comme pour tous, que toutes les circonstances favorables se trouvent réunies dans un même lieu; mais il est peut-être plus rare encore qu'il n'y ait pas un lieu qui mérite d'être préféré aux autres; et il est certain que l'instituteur, qui sait choisir le plus convenable, ajoute par là à ses moyens de puissance et de liberté d'action.
Si cet instituteur augmente ses forces par le discernement avec lequel il choisit le lieu de son élablissement, il semble qu'il les accroît encore plus par la manière dont il l'organise. Les écoles d'enseignement mutuel offrent un exemple frappant des résultats avantageux qu'il est possible d'obtenir par là. Leur supériorité sur les écoles ordinaires, en effet, ne tient pas tant à la bonté des méthodes qu'on y suit, à la perfection de leurs tableaux et de leurs livres élémentaires, qu'à la disposition matérielle des lieux, à l'ordre suivant lequel on y classe, on y range, on y fait agir les élèves, et en général à ce que j'appelle la bonne organisation de l'atelier.
Or, telle est ici l'influence de ce moyen qu'un seul maître, dans une école d'enseignement mutuel, peut suffire à l'éducation élémentaire d'un millier d'enfans; que l'instruction qu'il leur donne est à [II-535] la fois plus prompte, plus complète, moins fatigante, moins nuisible à leur santé, recevraient dans les écoles ordinaires; qu'elle ne revient qu'à sept où huit francs par an, pour chaque enfant, tandis qu'elle revient à dix-sept ou dix-huit francs dans les autres écoles, et finalement qu'avec les dix-sept millions de francs que les familles ou les communes dépensent annuellement chez nous pour l'éducation d'un million de garçons,, on pourrait aisément en instruire deux millions et pourvoir à l'enseignement si négligé des jeunes filles [217] . On resterait donc au-dessous de la vérité en disant que, par le fait de l'organisation supérieure de l'atelier, dans les écoles d'enseignement mutuel, la puissance de l'enseignement se trouve plus que triplée.
Peut-être cette puissance est-elle encore plus sensiblement accrue par l'intervention des machines.
Il est vrai qu'il est moins facile encore de se servir de moteurs physiques pour former l'intelligence de l'homme que pour agir sur le corps humain; et il n'est pas probable que le génie, qui est parvenu à faire exercer tant de métiers divers à d'aveugles machines, réussisse jamais à transformer la pompe à feu en habile démonstrateur. Cependant, [II-536] outre qu'il n'est pas de mécanisme qui, de lui-même, n'agisse jusqu'à un certain point sur notre esprit, et dont la vue ne puisse nous apprendre quelque chose, on peut dire qu'il n'est pas de machines qui, dans les mains de l'homme, ne servent à expliquer de certains effets, et de plus, qu'il est beaucoup d'effets qu'on ne saurait expliquer sans machines.
Sans le secours des machines, il est une multitude de phénomènes qui se déroberaient à toute espèce d'investigation, et qui resteraient éternellement hors de la sphère de l'intelligence, parce qu'ils sont placés hors de la portée des sens. Les uns nous échappent par leur extrême petitesse, d'autres par leur excessif éloignement, d'autres par l'obscurité qui les environne, d'autres par la difficulté de les dégager des objets qui frappent notre vue, etc.
Comment, par exemple, raisonner sur la pesanteur et la température de l'atmosphère, sans le secours du baromètre et du thermomètre ? Comment traiter de l'électricité, sans le secours de la machine électrique ? Quels progrès le microscope n'a-t-il pas fait faire à l'histoire naturelle, et le télescope à l'astronomie! Combien de découvertes de doit-on pas à la machine pneumatique, à la pile de Volta, ct à cent autres espèces d'instrumens qu’emploient les sciences physiques ! A l'aide de [II-537] ces instrumens, un monde nouveau s'est révélé à nous; des milliers de vérités cachées sont devenues ostensibles ; et les arts chargés de l'éducation de l'intelligence ont pu lui donner des façons nombreuses et importantes qu'elle n'eût jamais reçues sans ce secours.
Non-seulement l'esprit humain a besoin de machines pour pénétrer les secrets de la nature, pour se former, pour acquérir des idées ; mais il en a besoin pour transmettre les notions qu'il a acquises, et les arts dont je m'occupe sont d'autant plus puissans et plus libres qu'ils sont munis pour cela d'instrumens plus perfectionnés. Les premiers de ces instrumens, ce sont les langues. Plus les langues ont fait de progrès, et plus il est facile aux esprits cultivés de communiquer leur savoir à d'autres.
Le langage articulé est un meilleur instrument que le langage par signes : on est donc plus libre d'exprimer sa pensée et de l'imprimer dans l'intelligence d'autrui par la parole que par des gestes. La parole écrite est un instrument plus puissant que la parole articulée : on est donc plus libre d'agir sur l'esprit de ses semblables, lorsqu'on sait figurer la parole aux yeux, que lorsqu'on sait l'articuler seulement. La presse est un instrument deux ou trois cents fois plus puissant que la plume : on est donc deux ou trois cents fois plus libre d'entrer [II-538] en relation d'idées avec les autres hommes, lorsqu'on peut répandre ses idées par l'impression, que lorsqu'on ne peut les publier que par l'écriture.
Il y a ensuite des degrés infinis dans la puissance de la presse et de ses modes de publication. Les écrits périodiques sont un instrument de publication plus puissant que les livres isolés. Les publications quotidiennes sont un instrument plus puissant que les écrits périodiques. Les journaux eux-mêmes sont un instrument plus ou moins puissant, selon qu'ils sont formés sur un système plus ou moins bien conçu, selon qu'ils sont de nature à mettre en rapport un nombre de professions plus ou moins considérable, selon qu'ils sont plus ou moins rapidement imprimés, selon qu'ils sont plus ou moins promptement répandus.
On ne peut nier, par exemple, que ces divers moyens ne soient employés en Angleterre de manière à en tirer plus de parti qu'ailleurs. Les gros livres y sont réservés à l'avancement des doctrines. Les revues servent à leur diffusion. Quant aux journaux, ils remplissent une autre tâche : ils ne dissertent que très-peu ; mais ils informent régulièrement chaque profession des offres et des demandes de toutes les autres; ils les instruisent toutes des nouvelles qui peuvent les intéresser; ce sont d'immenses recueils de faits et d'annonces ; ils servent [II-539] d'intermédiaires à toutes les relations. D'un autre côté, on les imprime et on les répand avec une rapidité si grande, que tel discours de tel orateur des Communes, à peine prononcé à six heures après midi, se trouve imprimé, distribué et lu dans toute la ville de Londres avant dix heures du soir. Trente heures après la clôture d'une discussion au Parlement, le compte rendu en est déjà public dans la ville d'York, à quatre-vingts lieues de Londres. Il est vrai de dire, à la lettre, qu'un membre du Parlement parle à toute la nation [218] . La presse, poussée à ce degré de perfection,
« devient pour l'homme comme un nouvel et puissant organe au moyen duquel il se fait entendre à toutes les distances et de tous les côtés en même temps. Par lui, les peuples sont en conversation permanente. Les sentimens, les idées, les opinions se propagent avec la rapidité du fluide électrique, et la commotion ne s'arrête qu'au point où l'on ne sait plus lire [219] . »
Cependant, ce moyen de communication entre les intelligences n'est pas encore le plus rapide de tous. Les produits immatériels de l'esprit ont cet avantage qu'ils peuvent être transmis par de simples [II-540] signes à de grandes distances, de telle sorte qu'en transmettant le signe on transmet la pensée signifiée. La télégraphie est donc un moyen de communication encore plus prompt que la presse. A l'aide des lignes télégraphiques, la pensée humaine traverse les airs sur les ailes de la lumière, et franchit l'espace en un clin d'oeil. Les télégraphes sont, en quelque sorte, un moyen de converser à de grandes distances. A la vérité, ce moyen ne peut pas être employé à des usages aussi étendus que l'imprimerie. Mais, pour transmettre rapidement des faits, il n'est ni estafette, ni voiture à vapeur qui l'égale. Paris peut avoir des nouvelles de Lille, distant de soixante lieues, en deux minutes; de Strasbourg, distant de cent vingt lieues, en cinq minutes cinquante-deux secondes ; de Brest, distant de cent cinquante lieues, en six minutes cinquante secondes ; de Bayonne, distant de plus de deux cents lieues, en moins de quatorze minutes... Mais en voilà assez pour donner une idée des secours que peuvent tirer des machines les arts qui agissent sur l'esprit humain.
Peut-on douter qu'à son tour la division du travail ne leur communique un grand surcroît de puissance ? Qui ne serait frappé de l'usage étendu qu'ils font de ce moyen ? Qui pourrait compter tous les rameaux de l'arbre encyclopédique ? Qui pourrait dire les divisions et subdivisions qu'on a fait subir [II-541] aux études et à l'enseignement ? Il y a des écoles pour l'instruction primaire ; il y en a pour un enseignement plus élevé; il y en a pour les connaissances spéciales ; il y en a pour l'application de ces connaissances; il existe des écoles particulières pour chaque branche d'enseignement spécial, et les spécialités sont presque sans nombre.
Dans l'intérieur de chaque établissement particulier le travail se subdivise encore, l'enseignement se partage ordinairement en huit classes dans une école d'enseignement mutuel, c'est-à-dire que, pour apprendre à lire aux enfans dans une telle école, on donne successivement huit sortes de façons à leur intelligence. Dans les écoles secondaires, dans les collèges, dans les écoles spéciales, l'enseignement subit de même de nombreuses subdivisions.
« Dans une manufacture académique bien organisée, observe un écrivain anglais, un jeune docteur n'est achevé qu'après avoir passé de main en main, comme l'épingle dans les ateliers consacrés à ce genre de fabrication. Ébauché par le professeur d'anatomie, il faut qu'il livre successivement toutes les parties de son intelligence et de sa mémoire à une série d'opérations qui est terminée par le professeur de matière médicale [220] . »
En un mot le travail qu'on fait sur l'esprit est sujet aux mêmes divisions et subdivisions que celui qu'on [II-542] fait sur la matière, et ces divisions produisent ici les mêmes résultats que partout ailleurs : économie de temps, célérité et perfection plus grande de l'ouvrage, progrès plus rapides de l'art, voilà ce qu'on leur doit. Grace à ce partage, les hommes voués à la culture de l'entendement humain, renfermés chacun dans leur spécialité, en acquièrent une connaissance plus profonde, deviennent beaucoup plus habiles à l'enseigner, et agissent en masse avec infiniment plus de puissance [221] .
Ainsi le bon emplacement de l'atelier, son organisation, les instrumens qu'on y emploie, la manière dont le travail s'y divise, tout ce qui contribue à la perfection du fonds d'objets réels, de même [II-543] que tout ce qui accroît le fonds de facultés personnelles est un moyen de force dans les arts qui agissent sur l'entendement comme dans ceux qui travaillent sur la matière brute. Il ne me reste plus qu'à dire quelques mots de l'effet qui résulte du progrès simultané de tous ces moyens.
§ 9. Indépendamment des effets qui lui sont propres, chacun des pouvoirs du travail en a qu'il obtient par le concours des autres pouvoirs collatéraux, et l'influence que chacun exerce est d'autant plus grande, non-seulement qu'il est plus perfectionné, mais que tous les autres le sont dan vantage. J'ai déjà montré plusieurs fois combien l'action d'un ordre quelconque de travaux se manifestait par des effets plus considérables à mesure que s'accroissait la somme capitale de tous ses moyens. Ce résultat général ne se laisse pas moins apercevoir ici que dans la plupart des arts dont j'ai traité dans les précédens chapitres.
Il n'y avait à Paris, vers la fin du quatorzième siècle, que quarante maîtres et vingt maîtresses d'école : il y a probablement aujourd'hui plusieurs milliers d'établissemens d'instruction. On ne comptait en France, il y a quarante ans, que sept millions d'hommes qui sussent lire : on y en compte à présent au-delà de seize millions. En 1770, il n'y avait à Londres que quatre loueurs de livres : [II-544] il y en a aujourd'hui plus de deux cents. On n'y trouvait alors aucune société ni cabinet de lecture: il y en a plus de deux mille aujourd'hui. En 1814, les produits de la presse non-périodique ne s'élevaient pas annuellement, chez nous, à quarante-six millions de feuilles : dès 1815, ils passèrent cinquante-cinq millions; en 1820, ils montèrent à près de quatre-vingt-un; en 1825, ils excédèrent cent vingt-huit, et, en 1826, cent quarante-quatre millions de feuilles. En 1817, il n'avait été timbré pour journaux, que trente-huit mille deux cent quarante rames de papier : en 1820, ou en timbrait déjà cinquante mille sept cent soixante-dix-sept rames. Suivant un document publié par la Chambre des communes, il n'y avait en Angleterre, en 1782, que soixante-dix-neuf journaux : ce nombre s'était élevé à cent quarante-six en 1790, et, en 1821, il était de deux cent quatre-vingt-quatre : il avait quadruplé dans l'espace de quarante ans. Les publications périodiques ont suivi, aux États-Unis, une progression plus rapide encore. En 1720, il n'y avait que sept journaux : quatre-vingt-dix ans plus tard, en 1810, il y en a eu trois cent cinquante-neuf; de 1810 à 1823, ce nombre s'est élevé à cinq cent quatre-vingt-huit; et de 1823 à 1826, il est monté à six cent quarante [222] .
[II-545]
On voit quelle progression croissante suivent les produits des arts qui cultivent l'entendement humain, à mesure qu'on y applique un capital plus perfectionné ou plus considérable : les idées provoquent les idées; les livres enfantent les livres; les lecteurs engendrent les lecteurs; les journaux multiplient les journaux; les écoles font naître les écoles.Plus ce capital augmente et plus il est, comme tous les capitaux possibles, susceptible d'être augmenté. Là où sa diffusion est plus grande, des choses sont faisables qui ne le seraient pas là où elle l'est moins. Telle sera chez les Anglo-Américains, par exemple, l'universalité d'une certaine instruction secondaire, le besoin de propager encore davantage cette instruction, et les facilités que laisseront pour cela de bonnes habitudes publiques et l'absence de taxes et d'entraves résultant de ces habitudes, que ce peuple, avec ses dix millions d'ames, publiera plus de journaux que l'Europe tout entière avec ses cent soixante millions d'habitans. L'Angleterre, en partie par les mêmes raisons, [II-546] comptera plus de journaux, de librairies, de cabinets de lecture que la France. Il n'y aura pas, en Angleterre, de hameau qui n'ait son école ; et, chez nous, sur quarante mille communes, vingt mille manqueront d'écoles pour les garçons, et vingt-cinq mille n'en auront pas pour les filles. Nos meilleurs écrits périodiques ne compteront pas au-delà de douze à quinze cents abonnés, et trois Revues, aux États-Unis, se tireront chacune à quatre ou cinq mille exemplaires. Il ne se publiera chaque jour, à Paris, qu'un exemplaire de journal pour trois cent quatre-vingt-huit personnes, et il s'en publiera à Londres un exemplaire pour quarante-trois. Il ne s'écrira journellement, à Paris, qu'une lettre pour soixante-douze personnes, et il s'en écrira une pour neuf personnes à Londres. Quatre-vingt-dix Anglais recevront dix lettres par jour, et quatre-vingt-dix Français n'en recevront qu'une [223] . Il y aura un plus grand mouvement idées, [II-547] les communications intellectuelles seront plus actives là où l'instruction sera plus répandue, comme il se fera des actes intellectuels plus élevés là où l'instruction sera plus haute. Le peuple chez qui de certaines connaissances seront plus développées, pourra arriver à des conceptions auxquelles les autres ne pourront encore atteindre, et créer des produits intellectuels que les autres ne feront qu'après lui.
En somme, il n'y aura pas un progrès qui ne serve; un peuple n'aura pas perfectionné un seul des moyens du travail dans son application à la culture des intelligences sans que l'on voie cette culture agir avec plus de pouvoir, et nulle part elle ne produira des effets aussi étendus et aussi rapides que là où la masse totale de ses moyens, l'entier capital de ses forces aura acquis plus de perfection et d'accroissement.
FIN DU TOME SECOND.
[II-549]
TABLE ANALYTIQUE DES CHAPITRES CONTENUS DANS LE TOME II.
CHAPITRE XIII. Des divers ordres de travaux et de fonctions qu'embrasse la société industrielle.
On a vu, dans le premier volume, que la liberté dépendait, 1° de la race ; 2° des circonstances extérieures; de la culture, 1.Cette dernière remarque a été confirmée par une revue progressive des divers états sociaux par lesquels parait être passée l'espèce humaine : on s'est assuré que les hommes étaient d'autant plus libres qu'ils étaient parvenus à un état de culture plus perfectionné, ibid. Parvenu à la vie industrielle , l'auteur a constaté que ce mode d'existence était le mieux approprié à la nature de l'homme et le plus favorable au plein développement de ses facultés, 3. - Après avoir considéré cet état dans son en: semble il lui reste à l'envisager dans ses détails; il lui reste à dire quels sont les divers ordres de travaux et de fonctions qu'il embrasse, et à déterminer la nature, les moyens, l'influence de chacun de ces modes d'activité : c'est l'objet de ce volume et de celui qui doit suivre, ibid. — Quels sont les divers ordres de travaux qu'embrasse la société industrielle ? 3. — On est loin de s'entendre à cet égard, 4. – Diverses classes de professions, qui sont regardées comme improductives par Smith, ibid. ; – par M. de Tracy , 6; - par M. de Sismondi, 7; - par Malthus, 8; - par Mill, ibid. - M. Say, qui a essayé de rectifier cette doctrine, n'y a point réussi : ses producteurs de produits immatériels ne sont pas plus producteurs d'après lui que d'après Smith, 9.- A quoi a tenu l'erreur de Smith et de ses disciples, 14.- Que toutes les classes qualifiées par Smith d'improductives, sont réellement productives, et comment elles le sont, 15. —Classes qu'il y a à faire entrer, en conséquence, dans la société industrielle, 27. Lenteur avec laquelle les idées se développent, et peine que la science éprouve à se former, 29. - si toute profession peut être productive, exercée d'une certaine façon aucune ne l'est : erreur étrange où l'on tombe à ce sujet, 31.- De ce que les hommes d'industrie font de mauvaises actions, il ne s'ensuit pas que les mauvaises actions sont des actes d'industrie, 32.— En quoi un homme est producteur et en quoi il ne l'est pas , ibid. - En aucun sens, le crime ne peut être considéré comme productif d'utilité, 35 et la note. - Il n'y a de place dans la société industrielle pour aucun ordre privilégié; paroles énergiques et judicieuses de Sieyes à ce sujet, 36. — Ensemble des organes qui entrent dans l'économie sociale et qui concourent à la vie du corps social, 39. - Il n'y a pas d'ordre à assigner aux diverses professions de la société, pas plus qu'aux divers organes du corps humain : toutes concourent à l'entretien de la vie commune, 39. - Si quelqu'une doit être subordonnée, c'est celle qui agit pour le compte de toutes les autres et sur leur mandat, 41. Toutes les professions ont l'homme pour objet, mais toutes n'ont pas l'homme pour sujet; les unes s'exercent sur les choses, les autres sur lui : l'auteur parlera d'abord des premières, puis des secondes, ib.- En dehors de toutes les professions, il est des actes qui se font partie d'aucune, mais qui sont nécessaires à la liberté de toutes : l'auteur en parlera après, ib.- Il doit chercher d'abord à quel ensemble de causes se lie la puissance de toutes les professions et de toutes les fonctions, 42.
CHAPITRE XIV. Des conditions auxquelles toute industrie peut être libre.
Si les économistes n'ont pas assez fait voir quel est l'ensemble des professions et des fonctions qui entrent dans l'économie sociale, ils n'ont pas non plus suffisamment montré par quels moyens les diverses professions produisent, 43.- L'analyse que M. Say a faite des pouvoirs du travail, inexacte à quelques égards, est, å plusieurs autres, incomplète , ibid. On ne saurait, avec M. Say, attribuer plusieurs causes primitives à la production , ibid. L'activité humaine n'est pas la seule force qu'il y ait dans la nature, mais elle est la seule qui ait agi primitivement pour lui, et c'est avec celle-là qu'il a plié toutes les autres à son service, 45. - Il y a donc à rejeter les forces que M. Say fait agir dans l'origine conjointement avec l'homme parmi les moyens de production qu'il s'est créés, ibid. M. Say a, en commun avec Adam Smith, le tort de ne pas comprendre parmi ces moyens toute la partie du fonds social qui est employée à satisfaire des besoins : on regarde en général comme improductifs tous les capitaux employés à l'entretien des hommes, comme tous les arts qui agissent directement sur eux, 49. - Réfutation de cette doctrine, 50. Analyse que Smith a faite du fonds productif général de la société, 52. Analyse du même fonds par M. Say, ibid. L'analyse de M. Say est supérieure à celle de Smith, 53. - Détail des imperfections qu'elle paraît renfermer encore, ibid. Nouvelle décomposition que je proposerais de faire du fonds social, 58. Application des divers élémens de force que j'y découvre, 61. Comment le talent des affaires et toutes les facultés dont ce talent est formé contribuent à la liberté de l'industrie en général, ibid. - Secours qu'elle reçoit des connaissances relatives à l'art, et des divers pouvoirs dont cet ordre de moyens se compose, 78. - Force qu'elle puise dans les bonnes habitudes privées, 88; – Et dans le progrès des habitudes sociales, 102. - Nécessité qu'à tout ce fonds de facultés personnelles se joigne un fonds d'objets réels, 111. Besoin que l'industrie a de provisions, de denrées, de choses fongibles, 112; Fonction des monnaies', ibid., Rôle de la matière première , 113; — Importance d'un atelier où le travail soit bien divisé, 114; - Qui soit pourvu de bonnes machines, , 115; - Qu'on ait construit sur un bon plan, 119; - Et situé dans un lieu convenable , 120. - La liberté de l'industrie est d'autant plus grande non- seulement que tous ces pouvoirs sont plus développés, mais qu'ils ont cru avec plus d'ensemble, 121. - Comment l'absence de certains pouvoirs paralyse souvent ceux qu'on possède, 122. - Après avoir montré, d'une manière générale, à quel ensemble de causes tient la liberté du travail, 121. il reste à chercher comment et dans quelle mesure ces moyens s'appliquent aux divers ordres de travaux et de fonctions qui entrent dans l'économie sociale, 123. Dans cette recherche, plusieurs moyens dont l'influence a été seulement indiquée , recevront une partie des développemens qui leur manquent, 124. Avant de montrer comment les moyens du travail s'appliquent à une classe de travaux, l'auteur commencera toujours par dire quelle est sa nature , quelle place elle occupe dans la société, et quelle influence elle y exerce, ibid.
CHAPITRE XV. Application de ces moyens de liberté aux diverses ind tries, et d'abord aux industries qui agissent sur les choses. De la liberté des industries qui se bornent à exécuter de simples déplacemens des choses, ou de l'industrie improprement appelée COMMERCIALE.
Les principes analysés dans le précédent chapitre s'appliquent in distinctement aux arts qui travaillent sur les choses et à ceux qui s'exercent sur les hommes, 125. Pourtant ils ne s'appliquent pas à tous de la même manière, ni avec la même latitude, 126. Voir d'abord comment ils secondent les arts qui approprient les objets extérieurs aux besoins de l'homme, ib. – Pourquoi l'auteur commence par ceux- ci, 127. - Division et nomenclature des arts qui agissent sur les choses, 130.- L'auteur traite d'abord de l'industrie commerciale; pourquoi, 131.- Vice de la dénomination de commerciale qu'on a donnée à l'industrie qui transporte les choses: on aurait dû l'appeler industrie voiturière, et dire le voiturage, comme on dit le labourage, 134.- Si l'auteur lui laisse le nom de commerce c'est à condition qu'on détachera de ce mot toute idée de vente et d'achat, 137. — Il n'y a pas plus lieu à parler d'achat, de vente, d'échanges à propos de l'industrie qui à exécute des transports qu'à propos de tout autre : les échanges sont une matière particulière dont il sera traité après avoir parlé de toutes les industries qui produisent les choses destinées à l'échange, ibid. - Fonctions du commerce : leur importance, 138. - Le commerce s'exerce indistinctement sur les produits de toute sorte, sur ceux qui sont fixés dans les hommes comme sur ceux qui sont réalisés dans les choses , 141. — Application que reçoivent dans le commerce les divers pouvoirs du travail , et d'abord ceux qui se composent de facultés personnelles, et parmi ceux- ci - le talent des affaires, 145; - les connaissances relatives à l'art, 156; - les bonnes habitudes personnelles, 165; - la bonne morale de relation , 173. — Forces que le commerce puise dans le fonds d'objets réels, et d'abord dans la possession de bons ateliers, 189. En quoi consistent les ateliers du commerce, 199. Combien sa liberté dépend de leur étendue , 191; - de leur nature forme , 196; – de leur situation, 205; de la puissance des instrumens qu'on y emploie, 209. - Influence du concours simultané de toutes ces causes, et combien la liberté du commerce, c'est- à- dire du voiturage, devient plus grande à mesure que s'accroît le capital de tous ses moyens, 215.
CHAPITRE XVI. De la liberté de l'industrie manufacturière.
Ce qui distingue la fabrication du commerce; nature et caractère de cette industrie, 219. - Son influence : services qu'elle rend à tous les ordres de travaux, 220; et à toutes les classes de travailleurs, ibid.- Comment elle agit sur les classes qui l'exercent, 222. - S'il est vrai qu'en ramassant, en agglomérant ses agens, elle nuit à leur santé, à leurs moeurs, à leurs habitudes civiles, 223. Les lieux où l'intelligence a le plus de sujets et de moyens de s'exercer, les lieux plus favorables à l'expérience, sont aussi les plus favorables à tous nos progrès, 228. Il n'est pas d'industrie où les divers moyens sur lesquels se fonde la puissance du travail reçoivent une application plus directe et plus complète, 229. — Influence qu'exerce ici le génie des affaires , 230; — les divers talens qui constituent l'artiste, 247; - la bonne morale privée, 261;. les bonnes habitudes civiles , 275; et en général les divers élémens de force qui se composent de facultés personnelles, 290. Application qu'y reçoivent les moyens pris dans le fonds d'objets réels, ibid. Combien il lui importe que ses ateliers soient situés dans des emplacemens convenables, ibid.; - qu'ils soient habilement construits, 296; – que le travail y soit bien divisé, 299; - qu'ils soient pourvus de bons instrumens: rôle qu'y jouent les machines, 300. Ce que du concours simultané de tous ces moyens, et de leur développement progressif, il résulte pour elle de puissance, 305. – Ce qu'il en résulte de confiance en ses propres pouvoirs, 109. Surcroît de force que cette confiance lui donne, ibid.
CHAPITRE XVII. De la liberté de l'industrie agricole.
Il s'agit ici de l'agriculture proprement dite, de celle qui crée des produits végétaux ou animaux, et non des industries du chasseur, du pêcheur, du mineur, que l'on confond' à tort avec elle, 312 en M. de Tracy a réuni ce qu'il avait à dire de l'agriculture avec ce qu'il se proposait de dire de la fabrication, 312. Motifs qui l'ont déterminé à confondre ces deux ordres de travaux, 313.- Pourquoi j'ai cru devoir les considérer séparément, 314. – Nature spéciale de l'industrie agricole: forces particulières qu'elle emploie, manière dont elle distribue ses agens, et produits spéciaux qu'elle crée, ibid. - Loin que l'agriculteur soit plus producteur que le fabricant, on pourrait en quelque sorte dire qu'il est moins; pourquoi, 317. Fonctions que l'agriculture remplit dans l'économie sociale : services qu'elle rend aux autres travaux, 321 ; - et aux autres classes de travailleurs, ibid. Si l'on peut dire de cette industrie, plutôt que des autres, qu'elle est le premier des arts, 322. Influence qu'elle exerce sur ses propres agens, 323.- Si elle est particulièrement favorable à leur santé, 324; aux progrès de leur intelligence, 325; à ceux de leurs moeurs, 326. L'isolement où elle les force de vivre nuit, sous tous les rapports, à leur avancement, ib.- La nature des forces qu'ils emploient exerce également sur eux une fâcheuse influence': ils sont moins dominés que d'autres classes d'industrieux par les idées de causalité , 328. - Comment s'appliquent à l'agriculture les divers élémens de force sur lesquels se fonde la liberté du travail, 330; - les divers talens dont se compose le génie des affaires, 331; les diverses facultés qui se rapportent à l'art, 345; les bonnes habitudes personnelles , 354; - la bonne morale de relation, 368. — Application qu'y reçoivent, d'un autre côté, les divers moyens qui tiennent au fonds d'objets réels, 383; et d'abord les considérations relatives à la situation de l'atelier, 384; — à ses dimensions, 385; – à son organisation intérieure, 392.- Influence qu'y peuvent exercer les machines, 393; - et la division du travail, 396. Combien, en somme, les fabriques agricoles différent des manufactures ordinaires , et combien il était nécessaire de les considérer à part; que tous les pouvoirs du travail ont plus de peine à s'y développer que dans les fabriqués, et néanmoins que plus ils s'y développent, et plus le travail y acquiert de liberté, 398. ~ Effets qui y résultent du concours de tous les moyens qui viennent d'être analysés, 400.
CHAPITRE XVIII. Application des mêmes moyens de liberté aux arts qui agissent sur les hommes, et d'abord aux arts qui agissent sur le corps de l'homme. De la liberté des arts qui ont pour objet la conservation et le perfectionnement de l'homme physique.
Après avoir traité des arts qui s'exercent sur les corps bruts, sur les plantes, sur les animaux, l'ordre des idées conduit l'auteur à parler de ceux qui portent directement leur activité sur les hommes , 403. - Les premiers ne sont étrangers ni par leur objet, ni par leurs effets, à l'éducation de l'espèce humaine; mais ceux- ci font de son éducation et de sa culture leur objet propre et immédiat, ibid. Jusqu'ici ces arts n'avaient pas trouvé place dans les livres des économistes : c'était une grande lacune : importance des produits qu'ils créent, 404. – Impossible, tant qu'on ne traite pas de ces arts, de se faire une véritable idée de l'économie sociale, 405. - Quelle est, en général, leur nature, 406. — Quelle influence ils exercent, 407. - L'auteur s'occupe d'abord de ceux qui agissent sur le corps de l'homme, 409.- Peu d'importance qu'ont dans la société les arts qui s'occupent du perfectionnement de l'homme physique, ibid. A quoi il a tenu qu'on y ait fait si peu d'attention , 412.- C'est là un mal considérable, 414. - L'homme cultivé doit se distinguer de l'homme inculte par la beauté, la vigueur, la grace, l'harmonie de ses traits et de ses formes , non moins que par la supériorité de ses facultés intellectuelles, ibid. - Il est dans les besoins de la civilisation que l'homme demeure robuste, ibid. - Elle nous laissera toujours assez de périls et de fatigues pour que la vigueur ne puisse être à dédaigner, 415.- Cette force est nécessaire, ne fût- ce que pour supporter les loisirs de la paix et jouir avec modération des biens que la civilisation procure, 416. - Les facultés physiques méritent d'être cultivées pour elles- mêmes, pour le plaisir qu'on trouve à les sentir, à les exercer, ibid. — Il y a moyen de les cultiver sans nuire au développement des facultés intellectuelles et morales , ibid.; - même avec profit pour ces dernières facultés, 417. — Toutes les industries concourent au perfectionnement de l'homme physique, 419; mais il y en a qui agissent directement sur sa personne, et c'est de ceux- ci qu'il s'agit, 420. Difficulté qu'il y a d'en faire une énumération complète, ibid. - Moyens puissans d'agir sur le corps de l'homme, qui ne sont pas compris dans les arts désignés, 421. Influence du croisement des races, ibid. - Influence de l'exercice, 427.Influence de la médecine proprement dite, 431.- Résultats obtenus par le concours de tous ces arts, 433. — Applications qu'il est possible de faire ici des moyens généraux sur lesquels se fonde la puissance de tout art et de tout travail, et d'abord du talent des affaires, 437; - des connaissances pratiques, théoriques, des talens d'application, d'exécution , et en général de tout ce qui se rapporte à l'art, 440; des bonnes habitudes morales, soit privées, 454, – soit publiques, 460. Service qu'on y peut retirer des divers moyens qui entrent dans le fonds d'objets réels, 469. — Qu'il n'y est pas indifférent d'avoir un atelier bien situé, ibid.; et convenablement organisé, 470. Rôle qu'y jouent les machines, 471. Parti qu'on y peut tirer de la division du travail, 473; et, en somme, de tous les moyens sur lesquels se fonde sa puissance, 477.
CHAPITRE XIX. De la liberté des arts qui travaillent l'éducation intellectuelles.
Comment pensons-nous ? Le cerveau pense- t- il par sa propre force, ou par la vertu d'un agent immatériel dont il reçoit l'impulsion ? Question insoluble , 478; mais heureusement superflue , au moins pour l'objet dont il s'agit ici; car, que le cerveau commande ou serve, qu'il soit agent ou instrument, il est indispensable aux fonctions de l'intelligence, 479. C'est donc sur le cerveau qu'il faut agir pour faire l'éducation de nos facultés intellectuelles, 480. L'encéphale est aussi susceptible d'éducation que tous les organes du corps sur lesquels s'étend son empire, ibid. Le travail du système nerveux , quoique non apparent, est tout aussi réel que celui des muscles, 481. Nécessité de faire agir les organes de l'intelligence pour les former, ib. - Le progrès des sciences consiste dans le progrès de l'éducation des organes intellectuels, 482. Le propre des arts qui font l'éducation de l'intelligence est de perfectionner ses instrumens, 483. — Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas plusieurs ordres d'organes y dans le cerveau, toujours est- il qu'il y a plusieurs ordres de facultés : division des arts qui s'occupent de la culture de l'entendement humain; il ne s'agit , dans ce chapitre, que de ceux qui cultivent notre faculté de connaître, ib. - Importance de ces derniers, 485. — L'esprit humain , premier moteur de tous les travaux de l'homme, 486. — Extension prodigieuse que cette force peut recevoir lorsqu'elle est développée dans une direction conforme aux arts qu'exerce la société, ibid. Désaccord qu'il y a entre les arts que nous exerçons et l'éducation que reçoit notre intelligence, ibid. - Espèce d'avantage que présente l'étude des langues mortes, 489.- Combien moins avantageuse que celle des langues vivantes , ibid. Combien peu il est raisonnable de faire de l'étude des langues l'objet fondamental de l'éducation , 489.- Ce qu'il y a de bon dans les systèmes d'instruction en vigueur, 496. Utilité qu'il y a de se familiariser avec l'art usuel de la parole: besoin que nous avons du langage pour penser, ibid. - L'étude de la langue doit accompagner l'acquisition des idées, 497. — Cette étude pourrait d'abord être empirique, ibid. Que l'essentiel est d'étudier les choses, ibid. Puissance que nous donnerait, pour l'exercice de la profession à laquelle nous sommes destinés, une éducation bien dirigée, 498. - Effets indirects de la culture de l'intelligence : disposition d'esprit où elle nous met relativement à l'art que nous exerçons, 499. — Plaisirs qu'elle nous procure , 500. Combien les plaisirs de l'intelligence sont supérieurs à ceux des sens, 501. Combien moins coûteux, plus durables, moins dangereux , moins susceptibles d'abus, 502. Peuvent tenir lieu, jusqu'à un certain point , de ceux que donne la fortune, 504. - Combien la culture des intelligences est favorable à l'égalité , ibid. Combien elle a contribué à adoucir les meurs, ibid. — Application que peuvent recevoir dans les arts qui s'occupent de l'éducation de l'intelligence les divers pouvoirs dont se compose la liberté du travail, et d'abord le fonds de facultés personnelles , 505; - le talent des affaires, ibid.; - les connaissances relatives à l'art, 509; les vertus individuelles , 517; – les moeurs de relation, 523. - Parti qu'on y peut tirer des divers moyens qui tiennent au fonds d'objets réels, de la situation de l'atelier, 533; de son organisation, 534; de l'intervention des machines, 535; de la division du travail, 540. Résultats produits dans cette classe d'arts par le développement simultané de ses moyens de toute nature, 543.
FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE DES CHAPITRES CONTENUS DANS LE TOME SECOND.
Notes↩
[1] Voy. ci-dessus, ch. XI.
[2] Richesse des nations, liv. 2, ch. 3.
[3] « Le vrai est, tout uniment, que tous nos travaux utiles sont productifs. » (M. de Tracy, Traité d'éc. polit., édit. de 1823, in-18, p. 85.)
[4] Ibid., p. 267.
[5] Ibid., p. 268.
[6] Ibid., p. 244.
[7] Commentaire sur Montesquieu, édit. de 1822, in-18, p. 307, en note, et 21.8.
[8] Nouveaux principes d'écon. polit., deux. édit., t. I, p. 141, 144, 145, 147.
[9] L'ouvrage de Malthus, dont il s'agit ici, me manque, et je ne le cite que d'après ce qu'en dit M. Say dans ses Lettres à Malthus, etc., in-8°, p. 32 à 46.
[10] Écon. polit. de J. Mill, auteur de l’Hist. de l'Inde, sect. IV, p. 261 et suiv. de la trad. Paris, 1823.
[11] Au moment de mettre ce volume sous presse, je découvre que M. Storch a fait le même essai, et avec plus de bonheur. Je montrerai, dans une autre note, comment il a été plus heureux.
[12] Catéchisme d'écon. polit., trois. édit., p. 52; Traité d'écon. polit., cinq. édit., t. I, p. 147.
[13] Catéchisme d'écon. polit., trois. édit., p. 53; Traité d'écon. polit., cinq. édit., t. I, p. 144 et suiv.
[14] (3) Traité d'éc. pol., t. I, p. 148.
[15] Ibid., p. 149.
[16] Ibid., t. III, p. 26.
[17] Catéch. d'éc. pol., p. 174 et 175; Traité, t. III, p. 66 et 67.
[18] Traité, t. III, p. 188, 69 et 293.
[19] Cette distinction importante entre le travail opéré et l'utilité produite, que je croyais parfaitement neuve la première fois que je l'ai publiée (dans la Rev. Encyclop. d'avril 1827, en rendant compte du Traité d'éc. pol. de M. Say), M. Storch eñ avait eu l'idée quelques années avant moi, en répondant à certaines critiques que M. Say avait faites de son ouvrage; et il avait fort bien démêlé par où péchait la doctrine de l'auteur du Traité d'éc. pol. sur les produits immatériels. M. Storch avait compris que l'erreur de M. Say était venue de ce qu'il avait pris la cause pour l'effet, l'arbre pour le fruit; de ce qu'il avait placé les produits du savant, de l'avocat, du médecin, du fonctionnaire dans les services de ces classes de travailleurs, et non dans les résultats de leurs services. Toutefois il ne me semble pas que M. Storch eût réussi à montrer bien nettement dans quoi venaient se réaliser ces résultats et ce que produisaient véritablement les classes dont il s'agit ici. V. le tom. V de son ouvrage, où il a tâché de réduire ses idées à cet égard à leur expression la plus simple.
[20] Les choses se passent autrement dans les pays où il y à des esclaves. Tout le monde sait que dans ces pays on n'achète pas seulement les services, mais même les personnes qui sont en état de les rendre, lorsque ces personnes sont possédées par d'autres. C'est ainsi que, dans les colonies, on achète un charpentier, un maçon, un menuisier, comme chez les anciens on achetait un rhéteur, un grammairien, un philosophe. Chez nous, au lieu d'acheter un philosophe, on paie pour acquérir de la philosophie, comme on achète de la menuiserie, au lieu d'acquérir l'homme qui la fabrique.
[21] Ce qu'il y a du désavantage à multiplier, dis-je, c'est le travail nécessaire pour obtenir un produit quelconque, Partant, M. Garnier a visiblement tort, dans son Abrégé élément des princ. de l'éc, pol. et dans les notes qu'il a jointes à sa traduction de Smith ( note xx), de penser qu'on pourrait multiplier utilement le travail du médecin, de l'avocat, du fonctionnaire, etc. Mais M. Say, qui le blâme (Traité d'éc. pol., t. 1, p. 149, cinq, éd.) de croire que le travail de ces professions peut être aussi avantageusement multiplié que tout autre, n'a-t-il pas tort lui-même de donner à entendre par ces mots que tout autre travail pourrait être avantageusement multiplié? Arracher son blé pour tailler de la besogne au laboureur serait-il plus avantageux que compliquer ses lois pour donner plus à faire au juge? Il est clair qu'il n'y a pas plus de profit à multiplier le travail nécessaire à un produit qu'à multiplier le travail nécessaire à un autre; mais il est certain aussi qu'il y a de l'avantage à multiplier, à perfectionner tous les produits, aussi bien ceux du juge qui travaille, en appliquant les lois, à faire germer de bonnes habitudes dans les hommes, que ceux de l'agriculteur qui cherche, en labourant sa terre, à augmenter la quantité du blé propre à les nourrir.
[22] M. Say a sûrement bien raison de dire que le gouvernement ne restitue pas l'argent qu'on lui donne, eu le dépensant: s'il rend l'argent, il reçoit, à la place, d'autres valeurs, des denrées, du temps, des services, qu'il consomme et ne restitue point. Mais, pour prix de ces valeurs qu'on lui livre et qu'il consomme, il exerce sur la société une action qui, lorsqu'elle est bien dirigée, laisse après elle des produits véritables et du plus haut prix. Ces produits, ce sont, non pas du blé, du vin, des bestiaux, choses qui ne sont point de son fait, mais des hommes corrigés de leurs mauvais penchans, des hommes rendus plus propres à la vie civile: de bons citoyens, voilà surtout ce qu'un bon gouvernement crée et multiplie : le vrai titre de ce grand producteur est celui d'AMPLIATOR CIVIUM, que les Romains donnaient, dans un sens beaucoup moins juste, à certains de leurs empereurs.
[23] Richesse des nations, liv. 2, ch. I.
[24] Traité d'éc. pol., cinq. éd., t. I, p. 151, et t. II, p. 277.
[25] Nouveaux princ. d'éc. pol., deux. éd., t. I, p. 147.
[26] Traité d'éc. pol., t. I, p. 144, de la cinq. éd.
[27] M. Say, dans des notes manuscrites en réponse aux observations que j'avais faites sur son Traité, dans la Revue encyclopédique, notes qu'il a bien voulu me communiquer, dit que le sens de toute sa doctrine sur les produits immatériels est que c'est le travail de ceux qui les créent qui s'évanouit, et non le résultat de leur travail, et non leurs produits eux-mêmes. Je lui en demande bien pardon, mais le titre seul du chapitre où il traite de ces produits résiste à cette explication. Ce titre est : des Produits immatériels, ou DES VALEURS QUI SONT CONSOMMÉES AU MOMENT DE LEUR PRODUCTION. D'ailleurs, tout ce qu'il dit pour caractériser ces produits tend à les représenter comme s'évanouissant à mesure qu'ils naissent. Il dit expressément qu'ils n'ont de durée que le temps de leur production ; qu'ils doivent nécessairement être consommés au moment même qu'ils sont produits ; qu'il résulte de leur nature qu'ils ne peuvent s'accumuler, et qu'ils ne servent point à augmenter le capital national, etc, Voy. les passages que j'ai cités plus haut; et M. Say dit les mêmes choses dans trente endroits de ses ouvrages.
[28] C'était une doctrine que soutenait le Censeur européen, et que depuis le Producteur a reproduite.
[29] Raynal, t. X, 1. 19, p. 140, de son Hist. philos. Genève, 1781.
[30] La vérité de cette doctrine que le crime ne saurait être productif d'utilité ne peut pas souffrir la plus légère contradiction. Voici pourtant une objection qu'on m'a faite. Supposez, m'a-t-on dit, qu'au lieu de faire la traite des noirs, on se mit à faire la traite des pirates de la Méditerranée : l'action serait évidemment criminelle, car il n'est pas permis de faire le commerce des hommes même les plus coupables; cependant nierez-vous, ajoute-t-on, que cette action criminelle ne fût en même temps une action fort utile ? Je réponds sans hésiter que cette action serait utile en ce qu'elle aurait de licite, et funeste dans ce qu'elle offrirait de criminel. Je réponds qu'il serait utile de réprimer la piraterie, et que cela de plus serait tout-à-fait licite; mais j'ajoute que, pour réprimer la piraterie, il ne serait nullement nécessaire de faire la traite des pirates, et que ce fait très-condamnable serait en même temps très-pernicieux. Je dis, en un mot, qu'une action utile à l'humanité ne saurait être une action immorale, et que tout fait criminel est un fait désastreux; ou bien qu'un même fait n'est jamais immoral dans ce qu'il a de vraiment utile, ni jamais utile dans ce qu'il offre de criminel.
[31] Qu'est-ce que le tiers-état? p. 224, édit. nouv. Paris, 1822.
[32] Rev. encyclop., avril 1827, p. 76.
[33] Commentaire sur l'esprit des lois, liv. 13, p. 261, de l'édit. in 18.
[34] A la différence de Smith, qui regarde simplement comme improductive celte partie du fonds social, M. Say la déclare productive d'agrément, productive d'utilité, mais non productive de richesse.
[35] V. le Traité d'écon. pol., notamment au liv. 1, ch. 11 et 13, et au liv. 3, ch. 5 et 6.
[36] Une maison d'habitation, pourvue des meubles, des vêtemens, des denrées, des livres et de tous les instrumens nécessaires pour élever convenablement une famille d'hommes utiles, peut être considérée comme une fabrique où se forme le premier, le plus noble et le plus important de tous les produits.
[37] Rev. brit., prem. cah., t. I, p. 15.
[38] Il est à la connaissance de l'auteur de ce livre que, dans la plaine de Grenelle, une ferme qui ne rapportait pas 7,000 francs de rente a été vendue douze cent mille francs; et ce marché n'est pas le plus extraordinaire qui ait été fait. On trouve des exemples plus curieux encore dans les journaux et les écrits du temps. V. notamment les Mémoires d'Ouvrard, trois. part., p. 96.
[39] Rev. brit., trois. cah., t. II, p. 34.
[40] Id., t. VII, p. 197 et suiv.
[41] Rev. brit., t. VI, p. 188 et 189.
[42] Id., ib.
[43] Qu'on juge, après cela, de ce qu'il y a de sagesse et de bon sens dans des phrases comme celles-ci, que j'emprunte à une Revue anglaise : « Tout ce qu'on peut demander aux spéculateurs, c'est que leur passion soit dirigée de manière à ce que les classes laborieuses aient du travail; car alors, quels que soient les résultats des spéculations, elles ont toujours contribué au bien public. » (Article du Quarterly Rew., trad. par la Rev. brit., t. I, p. 12 et 13.)
[44] Les deux facultés que je viens de décrire, celle de juger des besoins de la société, et celle d'apprécier les moyens qu'il y a déjà de satisfaire les besoins qu'elle éprouve, facultés tellement importantes que sans elles un entrepreneur ne sait absolument ce qu'il fait, ces deux facultés, dis-je, n'avaient pas jusqu'ici été prises suffisamment en considération par les économistes; on ne s'était pas assez efforcé de tenir les spéculateurs en garde contre la facilité d'entreprendre; on ne leur avait pas assez dit ce qu'avant d'entreprendre ils étaient raisonnablement et honorablement obligés d'examiner. Bien loin de là, certains principes des plus répandus, des plus recommandés de l'économie politique, avaient pu contribuer à exalter encore l'esprit déjà trop aventureux des faiseurs d'entreprises. Tel avait pu être notamment l'effet du principe que la production ouvre des débouchés aux produits: principe très-juste sans doute, mais qui a besoin d'être bien compris pour ne pas pousser à beaucoup d'extravagances. M. de Sismondi a été le premier à signaler l'abus qu'il était possible de faire des pouvoirs du travail, et il faut convenir que les faits ne justifiaient que trop une partie de ses plaintes. Il a été impossible, en présence des désastres multipliés qu'ont amené, dans ces derniers temps, une suite de spéculations plus hasardées les unes que les autres, de ne pas comprendre que le talent de spéculer était le premier dont on avait besoin pour produire; et c'est cet enseignement de l'expérience qui m'a suggéré l'idée de placer le génie des affaires à la tête des pouvoirs de l'industrie.
Au milieu des crises commerciales que l'absence de ce gépje a contribué à faire naître, il y a quelques années, et dont les effets se font sentir encore, deux publicistes célèbres, M. Say et M. de Sismondi, ont été long-temps en discussion sur la question de savoir s'il était possible de trop produire. J'ose croire que cette question, assez mal posée, a été convenablement résolue dans l'analyse que j'ai faite des ouvrages des deux auteurs. V. la Rev. encyclop., cah. d'avril 1827, p. 79 et suiv., et cah. de juin 1827, p. 606 à 622.
[45] M. Say, dans son Traité, n'avait parlé de ce moyen, et en général des qualités nécessaires à l'entrepreneur, que très-incidemment et hors de la place où il devait le plus naturellement en être question. Ce moyen est considéré avec plus de soin et plus en son lieu dans le Cours complet, etc. V. le tom. I, p. 191 et suiv., et le tom. II, p. 199 et suiv.
[46] « La nature ou les objets, observe Cabanis, sont nos véritables maitres; leurs leçons, à la différence de celles des hommes ou. des livres, se proportionnent toujours à nos facultés : ce sont les seules qui ne soient presque jamais infructueuses, les seules qui ne nous égarent jamais. Il faut donc, en général, se fa ariser de bonne heure avec les images qui doivent fournir par la suite les matériaux de tous les jugemens; et, par rapport à chaque art en particulier, l'homme qui s'y destine ne saurait se placer trop tôt au milieu des objets de ses études, et dans le point de vue convenable au genre, au caractère et au but de ses observations. » ( Révolutions de la Médecine; t. I, p. 62, des OEuvres complètes de l'auteur.)
[47] Smith, M. Say et la plupart des économistes, parlent bien de l'action du gouvernement et de l'influence qu'elle exerce sur toutes les professions; mais ils ne parlent point de la conduite des individus; ils ne montrent pas comment leurs travaux sont aidés ou contrariés par l'usage qu'ils font de leurs facultés relativement à eux-mêmes et dans leurs rapports mutuels; ils ne voient pas que la conduite du gouvernement n'est elle-même qu'une conséquence de celle des individus, et que les actes de la puissance publique ne sont que l'expression des habitudes qui gouvernent la société. Bref, après avoir rangé fort judicieusement les talens et les sciences parmi les pouvoirs du travail, ils omettent d'y comprendre les mœurs , les meurs privées, civiles, politiques, qui sont, comme on va le voir, l'un de ses élémens de puissance les plus importans.
[48] Voy., dans la Rev. d'Édimb., cah. d'oct. 1819, un article sur les industries comparées de la France et de l'Angleterre.
[49] Voy. ce que Smith et M. Say disent de l'influence que le régime réglementaire, dans toute son étendue, exerce sur la production; c'est une des plus belles et des meilleures portions de leurs travaux. Je regrette seulement qu'au lieu d'attaquer ce régime dans le gouvernement, ils ne l'aient pas attaqué à sa base, c'est-à-dire dans les moeurs de la société.
[50] Si la division du travail a de grands effets dans l'intérieur de chaque établissement, elle en a probablement de plus considérables encore dans le vaste atelier où toute une nation travaille. Qui pourrait dire ce que la séparation des professions procure de puissance à la société, et combien les professions elles-mêmes deviennent plus puissantes à mesure qu'elles se subdivisent, que les occupations deviennent plus spéciales, et que chaque classe de travailleurs concentre ses forces sur des objets moins compliqués ?
[51] Cours complet d'écon. polit. prat., t. I, p. 414 et suiv.
[52] Il est clair, par exemple, que, chez nous et ailleurs, c'est surtout l'industrie qu'il faudrait accroître. Il suffit de voir à quel prix est l'argent, et quel est le cours des effets publics, sur toutes les places de l'Europe, pour sentir à quel point le fonds des facultés personnelles doit être inférieur à celui des objets réels. Certes, il faut que l'industrie soit bien impuissante et bien chanceuse pour que tant de gens mettent leur argent dans les fonds publics, et consentent ainsi à devenir créanciers, au taux de trois ou quatre pour cent, et pour des entreprises qui presque toutes ont été condamnables, de gouvernemens qui presque tous ont élé plusieurs fois banqueroutiers.
[53] V. L'INDUSTRIE ET LA MORALE, etc., pag. 104 à 107, et 333 et suivantes,
[54] J. R. Mac Culloch, Discours sur l'écon. polit.
[55] C'est ainsi que M. Say définit le commerce. V. son Traité d'écon. polit., t. I, ch. 9, cinq. édit., et le Cours complet, t. II, ch. 14.
[56] C'est ainsi que Paris, pour ses fabriques de verre et de cristal, est obligé de faire venir de la potasse de la Russie, de l’Allemagne et de l'Amérique, de la soude de Marseille, du sable de Fontainebleau, de la glaise de Forges, etc.; que, pour ses fabriques de bière, il tire de l'orge de la Champagne, du houblon des Pays-Bas et de l'Angleterre; que, pour ses fabriques d'encre, le commerce lui voiture du sulfate de fer de Picardie, des noix de galle du Levant, de la gomme du Sénégal, etc.
[57] Cours complet d'éc. polit. pratique, t. II, ch. 13, p. 116.
[58] Esp. des lois, liv. 20, ch. prem.
[59] Introd. à l'Hist. de Charles-Quint.
[60] Essais, liv. 3, ch. 9.
[61] Rev. brit., t. VII, p. 197 et suiv.
[62] V. la Rev. brit. de juin 1829, t. XXIV, p. 380.
[63] Rev. brit, t. VII, p. 197 et suiv.
[64] Rev. brit., ib.
[65] V. ci-dessus, ch. 14, p. 68, ce que j'ai dit de l'envoi de sels purgatifs d'Epsom fait à la ville de Sidney en Australie.
[66] On voit à quoi il tient que la gestion d'une maison de commerce est plus simple que celle d'une fabrique. Cela tient uniquement à ce que, dans la production commerciale, plusieurs établissemens concourent, à la suite l'un de l'autre, à une même opération, à un même envoi de marchandises. Si M. Chaptal avait fait cette remarque, il n'aurait pas dit que, dans le commerce, quelques commis peuvent produire ce qui exige plusieurs centaines d'ouvriers dans la fabrication (V. son livre sur l'industrie française, t. II, p. 418). La production commerciale, en ef. fet, n'est pas seulement le fait du petit nombre de commis qu'on voit groupés autour du commerçant expéditeur, elle est aussi le fait des commissionnaires, des rouliers, des armateurs, des matelots, qui concourent à son entreprise, et qui travaillent, pendant un temps donné, à faire parvenir à leur destination les marchandises expédiées. Il y a tout lieu de croire que la production d'une certaine valeur n'exige pas, ordinairement, moins de main-d'œuvre et d'avances de toute espèce dans le commerce que dans la fabrication.
[67] (1) V. l’Introduction à l'Histoire de Charles-Quint, volume des notes, note xxix.
[68] V. le Mémorial universel, aux mots Canaux, Navigation, Carrosses, Messageries.
[69] V., dans la Rev. encyclop. d'oct. 1827, p. 36 et suiv., un article de M. Baude sur la construction des routes, rempli d'excellentes réflexions.
[70] Cordier, Mém. sur l'agricult. de la Flandre française ; discours prélim.
[71] V. le Traité d'économie politique de M. Say, tom. I, pag. 60, cing. édition.
[72] Richesse des nations, liv, I, ch. 11.
[73] Ces remarques, que je publiais dans un journal, au mois de juin 1828, en appelant sur ce sujet intéressant la sollicitude de M. de Belleyme, avaient perdu, sous l'administration de cet honorable magistrat, une partie de leur vérité. Je les conserve comme monument des habitudes publiques sur ce point, au moment où je les ai imprimées.
[74] Mém. sur l'application de la Dynamique aux divers moyens de transport, lu à l'Académie des sciences, le 21 juin 1824. Voltaire, établi à Rouen au commencement de 1723, écrivait à son ami Thiriot, à Paris : « Venez, mon cher ami; ne nous donnez pas de fausses espérances de vous voir. Vous serez à Rouen en deux jours, etc. » On voit qu'à cette époque les communications avec cette ville s'étaient déjà un peu perfectionnées.
[75] Essai histor. sur la souveraineté des Anglais dans l'Inde, extrait de la Rev. encyclop. — Il n'est question dans ces dix millions que des pertes qu'elle fait dans son commerce: celles qu'elle fait sur son administration sont bien autrement considérables. Tels. sont, en tout, les résultats de son commerce et de sa souveraineté, que, d'après ses propres aveux et d'après ses comptes, elle est endettée de près de douze cents millions de notre monnaie.
[76] V. t. I, p: 438 à 441.
[77] Il est assez clair, sans que je le dise, que celles qui, naturellement, ne peuvent pas y prospérer ne méritent pas qu'on les y soutienne.
[78] M. Charles Dupin, Forces commerciales de la Grande-Bretagne.
[79] Pensées, prem. part., art. 10, pensée 38.
[80] J'aurais voulu pouvoir déterminer ici le prix moyen des transports sur chaque nature de voies; mais ce prix dépend de circonstances si multipliées et si variables, qu'il m'a paru impossible de rien établir d’un peu juste à ce sujet, et je suis obligé de m'en tenir aux expressions générales de plus et de moins.
[81] La longueur totale de nos routes étant de douze mille lieues et leur largeur moyenne d'environ cinquante pieds, c'est-à-dire de quinze à vingt pieds de plus qu'il ne serait rigoureusement nécessaire, on peut dire qu'elles enlèvent inutilement à l'agriculture un ruban de douze mille lieues, large de quinze à vingt pieds, lequel, réduit en hectares, ne laisserait pas, comme on voit, de faire une assez belle ferme, et de rapporter un assez beau revenu.
[82] Il n'en est pourtant rien. Si nos rues sont trop étroites, c'est qu'elles ont été construites à des époques de barbarie, dans des villes entourées de murailles, et où, faute de place, on était obligé de se mettre les uns sur les autres. Les rues sont trop étroites, par la même raison que les maisons sont trop hautes : il n'y a sûrement que le défaut d'espace qui ait pu décider les habitans de Paris à se ranger par couches, à s'encaquer, pour ainsi dire, comme des harengs dans des maisons de cinq, six, sept étages, plus ou moins ; et quant à nos grandes routes, si elles sont ridiculement larges, c'est qu'elles ont été tracées sous la direction de l'orgueil et du faste monarchiques; c'est qu'elles s'appellent Routes * Royales, et que des routes royales ne peuvent ni envahir trop d'espace, ni avoir un caractère trop majestueux, trop monumental.
[83] C'est en 1821 qu'ont été décrétées ces neuf cents lieues de canaux à faire, et qu'on a voté pour cela un emprunt de 240 millions. Neuf cents lieues de canaux d'un coup! Il semble qu'il y avait là de quoi contenter l'administration la plus entreprenante. Cependant la nôtre crut qu'elle resterait au-dessous de ses devoirs si elle bornait ses vues à une entreprise si mesquine; et, en conséquence, pendant qu'elle faisait voter les neuf cents lieues à exécuter de suite, elle proposa des plans pour un supplément d'environ cinquante-quatre mille lieues à faire ultérieurement. Elle observait pourtant que cette partie de son plan paraitrait peut-être renfermer un trop grand nombre de navigations à créer; mais, ajoutait-elle, dans l'intime conviction des bienfaits précieux qui seront pour la France la suite nécessaire, incontestable d'un grand développement de navigation intérieure, on a dů proposer des canaux sur tous les points où le commerce et l'industrie réclament l'existence de ces ouvrages, et où la nature donne les moyens de les établir... On n'a pas eu toutefois la prétention d'indiquer tous les travaux possibles, et l'administration accueillera tous les renseignemens qu’ou voudra lui transmettre pour l'ouverture d'un canal utile qui aurait échappé à ses recherches. » (Rapp. de M. Becquey au roi sur la navig. intér., p. 29 et 54 à 70.)-Croira-t-on, après cela, qu'il y eut des députés qui se plaignirent de la trop grande spécialité des plans du gouvernement, et qui l'accusèrent de ne pas présenter des projets assez généraux, assez vastes ? Voilà pourtant ce qui eut lieu, et M. le directeur-général des ponts-et-chaussées fut obligé de se défendre, comme il put, en disant qu'il avait présenté l'ensemble d'un système général de canalisation, et provoqué des soumissions pour des projets à exécuter sur tous les points du royaume. (V., dans les journaux du temps, la séance de la Chambre des députés, du 2 juillet 1891.)
[84] L'auteur du Mémorial univ. donne le poids da vaisseau le Duc de Bordeaux, en construction sur les chantiers de Cherbourg: ce poids, lorsque le bâtiment sera sous voiles, lesté et armé, sera de 5,200 tonneaux: on a, dans les voiles, le moyen de faire faire, par un bon vent, trois lieues à l'heure à cette énorme masse.
[85] M. de Châteaubriand.
[86] J'emprunte ces remarques à M. Saulnier, traducteur élégant et annotateur éclairé de la Rev, brit., qui puise dans sa propre Revue les faits qu'elles énoncent. V. une excellente préface dont il a fait précéder son cah. de janv. 1829.-- Je suis si redevable à la Rev. brit., elle m'a fourni tant de faits importans ou curieux, que je suis heureux de trouver l'occasion d'adresser mes remerciemens à l'éditeur estimable de cet excellent recueil.
[87] V., dans la Rev. brit., no. 30, t. XV, p. 218 et suiv., un article intéressant sur la diligence à vapeur de M. Gurney.-- Il a souvent été question de cette voiture dans nos journaux. V. notamment le Courrier français, numéros des 29 juin et 1er octobre 1827.
[88] Mém. sur l'application de la dynamique aux divers moyens de transport; déjà cité.
[89] Il parait qu'il existe déjà (au mois d'août 1829) plusieurs centaines de ces voitures, contenant chacune de quatorze à vingt places, et faisant perpétuellement la navette entre les points de la ville qui sont liés par les rues les plus fréquentées. La multiplication de ces voitures et le succès qu'elles obtiennent est une nouvelle preuve de ce que j'ai dit plus haut, p. 168 et 169, de l'avantage qu'on trouve à travailler pour le grand nombre. Celle de ces voitures qu'on désigne plus spécialement par le nom d'Omnibus, a donné aux entrepreneurs, dans les six premiers mois de son établissement, 89 pour 100 de leurs fonds. V., dans la Revue commerc. du 10 janvier 1829, le compte rendu par l'administration de cette entreprise, Je doute qu'aucun loueur de carrosses ait jamais tiré un tel intérêt de ses avances. On voit qu'il vaut mieux travailler pour les petites bourses que pour les grandes, et établir des voitures à 15 c. la course, que des carrosses à 20 fr. la journée.
[90] Cours complet d'écon. polit. prat., t. II, p. 271.
[91] Mém. sur l'applic. de la dynam. aux divers moyens de transport; déjà cité.
[92] M. Ch. Dupin, Forces commerciales de la Grande-Bretagne, t. II.
[93] Industries comparées de la France et de l'Angleterre; Rev. d'Édimb., cah. d'oct. 1819.
[94] M. Dupin, Forces comm. de la Grande-Bretagne.
[95] Rev. d'Édimb., no et article déjà cités. — J'ignore jusqu'à quel point sont dignes de confiance les faits avancés dans cet article, ouvrage d'un esprit distingué sans doute, mais qui a été dicté par un sentiment très-subalterne et très-peu déguisé de jalousie contre la France,
[96] V., dans les Archives générales de médecine, févr. 1826, un excellent rapport de M. Willermé à l'Académie de médecine, sur une série de tableaux statistiques très-curieux et très-instructifs, relatifs à la population de Paris, dressés par M. Villot.— Il résulte encore de ces tableaux que les causes qui paraissent influer sensiblement à Paris sur la santé publique et la durée de la vie, ce ne sont ni l'exposition des logemens, ni la qualité des eaux qu'on boit, ni celle des vents auxquels on est plus particulièrement exposé, ni l'agglomération plus ou moins grande des maisons et de la population, mais la fortune, l'aisance, l'activité et toute la manière d'être qui en résulte. Les quartiers les plus riches, et, parmi les plus riches, les plus occupés sont ceux où la mortalité est la moins grande.
[97] Il y a peut-être bien dans l'industrie commerciale un aussi grand concours d'entrepreneurs que dans l'industrie manufacturière; mais, comme dans le commerce une multitude de personnes se servent des mêmes voies, des mêmes voitures, et en général des mêmes moyens d'exécution, il se trouve que la spéculation ne peut guère porter que sur le choix des entreprises, et que les affaires y sont ainsi moins difficiles que dans la fabrication, où la lutte entre les entrepreneurs s’établit non-seulement sur le choix des entreprises à faire, mais encore, et par-dessus tout, sur les moyens d'exécution. Dans le commerce, la lutte pour l'exécution ne s'établit qu'entre ceux qui effectuent les transports, entre les voituriers, entre les armateurs, et comme ceux qui transportent les marchandises ne sont presque jamais ceux qui les expédient, il s'ensuit que la tâche des uns et des autres est plus simple.
[98] V., plus loin, paragraphe 5, ce que la simplicité des gouts peut ajouter aux pouvoirs de l'industrie manufacturière, en dirigeant son activité vers la production des objets d'un usage très-général.
[99] Il n'est pas nécessaire d'observer que par personnes ayant besoin, je n'entends ici que celles qui ont quelque chose à offrir en échange des produits que leurs besoins réclament. Il est clair que, pour tout producteur, il ne peut y avoir que celles-là qui comptent. Les personnes qui n'ont rien à offrir ne peuvent avoir rien à demander. Aux yeux du spéculateur, elles n'ont pas ou ne sont pas sensés avoir des besoins.
[100] A mon avis, les explications que l'on donne de ce fait ne justifient point les producteurs du reproche qui leur est adressé ici. Si l'on a de la peine à vendre, dit-on, ce n'est pas que certaines classes produisent trop, c'est que d'autres ne produisent pas assez ; c'est que les impôts, en élevant les frais de production, rendent les produits chers et leur écoulement difficile; c'est que le système prohibitif, en fermant beaucoup de débouchés, met à cet écoulement de nouveaux obstacles, etc. Il est fâcheux pour un producteur, sans aucun doute, de voir son marché limité par la pauvreté des populations pour qui il travaille, par les taxes qui renchérissent ses produits, par les prohibitions commerciales qui l'empêchent de chercher au loin des acheteurs; il doit vivement désirer de voir disparaître ces obstacles qui enchainent son activité et circonscrivent ses travaux; mais, tant qu'ils existent, son devoir est d'en tenir compte; et lorsqu'il agit comme s'ils n'existaient pas, lorsqu'il produit plus qu'il n'est possible de rendre dans les circonstances où il se trouve, dans l'état du monde et du marché, il est clair qu'il doit s'attribuer en grande partie les maux qu'il souffre.
[101] En supposant la population de la ville de sept cent treize mille habitans, conformément au recensement de 1820.
[102] V., pour le nombre des maisons construites à Paris pendant les trois années dont il s'agit, le volume des Recherches statistiques, publié en 1826 par M. de Chabrol, tableau no 130; et, pour l'accroissement de la population pendant le même temps, le même volume, tableaux nos 23, 27, 33, 37, et l'Annuaire du bureau des longitudes des années 1824, 1825 et 1826. Je dois faire observer qu'il ne s'agit ici que de l'accroissement de population qui a eu lieu par le fait des naissances; mais quand on y ajouterait celui qui a pu résulter d'une immigration un peu plus considérable, on ne trouverait pas de quoi justifier l'énorme accroissement que la ville a reçu pendant ces trois années, accroissement que les Recherches statistiques évaluent à deux mille maisons, ou à sept fois et un tiers la grandeur de l'ile Saint-Louis, et qui est devenu plus rapide encore pendant l'année qui a suivi.
[103] Il parait que ce moyen, qui est l'un des plus perfectionnés en Angleterre, est l'un des moins avancés parmi nous. M. Clément, que j'ai déjà eu occasion de citer, racontait à ses auditeurs, à l'ouverture de son cours de 1824, qu’un savant manufacturier anglais de ses amis, qui avait récemment visité les plus importantes de nos fabriques, et les avait comparées avec le plus grand soin, et entrant dans les plus minutieux détails, à des fabriques analogues de son pays, était constamment arrivé à ce résultat : « La chimie « en France est excessivement en avant; les machines, et surtout l'administration, y sont très en arrière. »
[104] V. le Cours complet d'écon. polit. prat., t. I, p. 193 et 194.
[105] On voit, t. II, p. 3, de l'ouvrage de M. Chaptal, qu'il se propose de faire connaitre les progrès et l'état actuel de l'application de la chimie et de la mécanique à l'industrie ; et, p. 112, qu'il a voulu se borner à ce qui est l'effet immédiat de l'application de ces sciences. Ainsi tous les perfectionnemens qu'il signale sont dus, suivant lui, au progrès de l'application des théories chimiques et mécaniques; or, je ne doute pas que, dans le nombre, il n'y en ait pas beaucoup qui ont été obtenus sans le secours de ces théories.
[106] M. Clément, ouverture de son cours de 1823 à 1824.
[107] M. Arago, à qui j'emprunte ce fait, et les particularités qui suivent sur Watt, dit pourtant que Newcomen possédait quelque instruction, et était en commerce de lettres avec Hooke, secrétaire de la Société royale. V., dans l'Annuaire du bureau des longitudes de 1829, sa belle notice sur les machines à vapeur. p. 184, en note.
[108] Je ne dis pas que Watt ne soit devenu plus tard un savant très-distingué, j'observe seulement qu'il ne parait pas qu'il le fût à l'époque où il a fait ses premiers perfectionnemens à la machine à vapeur.
[109] V. l’Almanach du bureau des longitudes pour 1829, p. et 156.
[110] Cette législation n'a été réformée que sous le ministère de M. Huskisson.
[111] Enquête faite par ordre du parlement d'Angleterre pour constater les progrès de l'industrie en France, etc. Paris 1825, p. 5, 43, 66, 78, 168, et passim. On peut voir, dans ce document, tout ce que les Anglais attachent d'importance à l'habileté de cette dernière classe de travailleurs, et en général tout ce que la supériorité en fait de main-d'œuvre peut donner au peuple qui la possède d'avantage sur le marché.
[112] V., p. 279, 315, 319, et passim,
[113] Ib., p. 314.
[114] Ib.,, p. 287, 301, 314.
[115] V. Rech. statist. sur Paris. Paris, 1823, tableaux n. 79,85 et 86.
[116] La production du fer fondu, en Angleterre, en 1824, a été de sept cent mille tonneaux, et en France, seulement de cent vingt mille tonneaux. Dans la même année, la quantité de coton en laine importée en Angleterre a été de 175 millions de livres, et la quantité importée en France, seulement de 50 millions de livres. M. Clément, dans son cours du Conservatoire, à la fin de 1823, portait la quant de toiles de coton, livrées cette année-là à l'impression par les fabriques anglaises, au sextuple de la quantité des mêmes étoffes qui avaient été fabriquées en France cette année-la.
[117] Réch. statist. sur Paris. Paris, 1821, tableau n. 52. Encore faut-il observer qu'une petite partie de cette viande est achetée par des bouchers des départemens voisins.
[118] Je pourrais observer ici qu'un des meilleurs effets de la simplicité des goûts, relativement aux produits de l'industrie manufacturière, serait d'étendre l'usage de l'étalonage, c'est-à-dire l'habitude d'exécuter tous les produits d'une certaine espèce sur un même patron, circonstance qui permet de les faire en fabrique, sur une échelle étendue, par les procédés les plus expéditifs, et de les exécuter avec infiniment plus de régularité, de précision, et surtout d'économie. V., sur les avantages de l'étalonage en manufactures le Cours complet d'éc. pol. prat., t. II, p. 151, et les Vues de M. Christian sur les arts industriels, citées par l'auteur.
[119] Par exemple, les tailleurs, marchands d'habits neufs, accusaient les fripiers d'empiéter sur leur domaine en vendant de vieux habits ; les cordonniers contestaient aux savetiers le droit de faire leurs propres souliers et ceux de leurs enfans et de leurs femmes; Argan, inventeur des lampes à courant d'air, était cité devant le parlement par les ferblantiers, serruriers et taillandiers, qui revendiquaient le droit exclusif de faire des lampes, etc., etc.
[120] Voy. dans Chaptal, t. II, p. 250 à 280, le détail des réglemens auxquels étaient assujettis une multitude de métiers.
[121] Dulaure, Hist. de Paris, t. IV, p. 443.
[122] Aux États de 1614. Voy. Chaptal, Iodustrie française, t. II, pag. 323.
[123] Chacun son métier, dans la vie sociale comme dans la vie organique. Il n'y a pas plus, dans le corps social, de profession qui soit chargée de tracer des règles à toutes les autres, qu'il n'y a dans le corps humain d'organe dont la fonction soit d'apprendre aux autres comment ils doivent fonctionner. Autant j'aimerais voir les poumons entreprendre d'enseigner à l'estomac comment il doit remplir ses fonctions digestives, ou le cerveau vouloir en remontrer au cour sur la manière de faire circuler le sang, que de voir l'autorité publique entreprendre de tracer des règles à une multitude d'états dont elle n'a pas la plus légère idée.
[124] On peut voir dans l'enquête anglaise sur l'état de notre industrie, avec quelle naïveté d'honnêtes chefs de fabrique anglais venaient demander qu'on exécutât les lois contre l'émigration des ouvriers, et qu'on les rendit, s'il le fallait, plus sévères. Je renvoie le lecteur aux pag. 100, 101, 171, 172, 199, 201, etc.
[125] On peut consulter le décret du 10 mai 1804, sur la guimperie et la fabrication des étoffes d'argent, des velours, etc. ; l'arrêté du 24 mars 1801, sur l'usage des presses, moutons, laminoirs, etc.; celui du 1er décembre 1803, sur la police des livrets que sont obligés d'avoir les ouvriers. On connaît les dispositions du Code pénal sur les coalitions ; dispositions beaucoup plus sévères contre les ouvriers que contre les maîtres, et qui d'ailleurs n'ont jamais été appliquées à ces derniers. On connait aussi les décrets de l'empire qui ont limité le nombre des imprimeurs, des boulangers, des bouchers.
[126] V. Chaptal, de l'Industrie Française, t. II, p. 232 et suivantes.- M. Say, qui n'avait pas parlé de ce moyen dans son Traité d'écon. polit., répare cette omission dans le Cours complet, etc., t. II, p. 137 et suivantes, Ce n'est pas le seul point sur lequel le second ouvrage de l'auteur justifie les observations que j'avais pris la liberté de faire sur le premier ( Revue encyclopédique, cahier d'avril 1827). Il me semble cependant qu'ici la correction est incomplète, et que le choix des emplacemens, dont M. Say ne parle que comme d'un moyen de succès propre aux manufactures, aurait dû être considéré comme favorable à toutes les industries, et rangé, dans son premier volume, parmi les moyens généraux sur lesquels se fonde la puissance du travail.
[127] Enquête du parlement anglais, etc., p. 303.
[128] Pour ne pas hérisser de notes cet alinéa, j'ai évité de mettre un renvoi à la suite de chacun des faits qu'il renferme. Je me contente d'avertir que j'ai puisé ces faits partie dans les Recherches statistiques du préfet de la Seine, partie dans l'Enquête Anglaise sur notre industrie, partie dans des notes prises sur le cours que M. Clément fait au Conservatoire et, pour un ou deux faits, dans les ouvrages de M. Ch. Dupin. Je ne voudrais pas répondre que tout cela est d'une exactitude absolue. On sait que les données de la statistique sont, par leur nature, assez sujettes à être fautives. Mais l'exactitude ici est plus que suffisante pour constater le mouvement progressif que je voulais faire remarquer.
[129] De Laborde, Esprit d'assoc., p. 260 de la première édition.
[130] Je dois avertir qu'il ve s'agit, dans ce chapitre, que de l'agriculture proprement dite, c'est-à-dire de celle qui a pour objet de créer des substances végétales el animales, et qui emploie pour cela, indépendamment des forces chimiques et mécaniques dont la plupart des arts font usage, un agent particulier et peu connu que nous nommons la vie. Par conséquent, il ne peut être question ici des industries du chasseur, du pêcheur, du mineur, etc., que les économistes confondent ordinairement avec l'agriculture. Ces industries sont essentiellement distinctes de l'art de multiplier et de perfectionner les végétaux et les animaux: elles n'ont pas le même principe; elles ne font aucun usage de la vie, qui est le principal agent de l'agriculteur: le chasseur n'a nul besoin de cet agent pour attraper du gibier, ni le pêcheur pour extraire du poisson de la mer, ni le mineur pour tirer du métal de la mine: ce sont là des arts purement mécaniques. Ces arts paraissent avoir devancé tous les autres, et peut-être aurais-je dů les réunir, sous le nom d'industries extractives, dans un chapitre à part, qui aurait précédé celui où j'ai traité du voiturage. Il est sûr qu'il y a dans le fait de prendre du gibier, du poisson, ou de détacher du minerai du sol auquel il est adhérent, un art différent de celui du voiturage, qui git uniquement dans le transport. Mais si j'ai eu tort de n'en pas parler d'abord, j'aurais plus tort encore de m'en occuper ici, où il s'agit uniquement de l'art qui multiplie les animaux et les plantes, art difficile, qui ne se développe qu'après ceux dont j'ai déjà parlé.
[131] V. le Bon Jardinier, édit. de 1829, p. 10.
[132] Richesse des nations, liv. 1, ch. 10, deux. section..
[133] V. plus haut, ch. 16, p. 227, la note.
[134] Annales agricoles de Roville, t. I, p. 73.
[135] Tom. I, p. 174.
[136] V. les Annales agricoles de Roville, t. I, p. 111 et ļla.
[137] Esprit d'association, p. 271, en note, prem. édit.
[138] « Il est bien certain, dit cet habile agronome, que si toute la surface du sol français était cultivée comme l'arrondissement de Lille, le pays de Waes, la Campine ou le comté de Norfolk, cent millions d'hommes y vivraient beaucoup plus aisément que la population qui l'habite aujourd'hui. o Annales agricoles de Roville, t. I, p. 26.
[139] Agriculture de la Flandre française, p. 405 et 335.
[140] V.. notamment le t. I, p. 127 et suiv., et le t. II, p. 180 à 204.
[141] Voyage en Angleterre, t. II, p. 64, deuxième édition.
[142] Hist. de Paris par Dulaure, t. II, p. 420, prem. édit.
[143] . Cordier, Agric. de la Flandre franç., Disc. prél. et p. 467. Rev. Brit., t. XIV, p. 171.
[144] V. l'Examen critique des Élémens de chimie agricole de Davy, in-8; Paris, 1820.
[145] V. les Ann. agric. de Roville, t. III, p. 234 et suiv, « Les Anglais, observe l'auteur, considèrent les fêtes agricoles comme ayant remédié en partie à l'isolement des agriculteurs, et puissamment contribué aux progrès de l'art par l'émulation qu'elles ont excitée parmi ceux qui l'exercent. » T. I, p. 144.
[146] V. Simond, Voyage en Angleterre, deux, édit., t. I, p. 19, et passim.
[147] Le goût passionné des fermiers flamands pour la belle agriculture, observe M. Cordier, les porte à cultiver des fleurs autour de leurs habitations, et à tenter dans ce genre de culture, comme dans tous les autres, des espèces de tour de force. Ils sont parvenus, par beaucoup de persévérance et de soin, à multiplier à l'infini, au moyen des semis, les variétés d'oeillets, de primevères, d'oreilles d'ours et de roses; et ils obtiennent chaque année des espèces nouvelles très-recherchées. » Agric. de la Flaod. française, P. 450 et suiv.
[148] Extraits de mémoires inédits.
[149] Ce droit de vaine pâture, qui rend impossible tout bon système d'assolement, existe, suivant M. de Dombasle, dans les neuf dixièmes de la France. (v. le Calendrier du bon cultivateur, pag. 387 et 308.)
[150] V. l'Ordonn. d'Orléans, art. 137.- La chasse, suivant un ancien et honnête juriste (Ferrière, Dict. de droit, au mot chasse.), est un plaisir très-noble et très-utile à la santé, mais qui ne doit être permis qu'aux rois, aux princes et à quelques autres personnes qui, seules, sans doute, ont le droit de se bien porter. L'ordonnance de 1669, rédigée d'après ces principes, interdisait la chasse au roturier, de quelque état et qualité qu'il fût, sous peine de cent francs d'amende pour la première fois, de deux cents pour la seconde, du carcan et du bannissement pour la troisième.
[151] Une pétition signée des cent quarante-six principaux habitans de ces communes, présentée à la Chambre des pairs, fut écartée par l'ordre du jour. Il en fut de même d'une autre pétition du même genre adressée, la même année, à la Chambre des députés.
[152] V. les Annales agric. de Roville, t. V, p. 92 à 176.
[153] Ibid., p. 124.
[154] V. la loi du 26 avril 1810 sur les mines, minières, carrières, etc. -- Dans notre ancien droit le roi était propriétaire de toutes les mines; par cette raison, dit Laurière, que les mines sont une fortune d'or, et que les fortunes d'or sont un bénéfice qui fait essentiellement partie de la souveraineté.
[155] Loi du 26 avril déjà citée.
[156] V. la loi du 29 avril 1803, un décret du 11 avril 1811, et, le Code forestier voté en 1826 par les chambres.
[157] On sait qu'il y a eu, pendant la terreur, des personnes conduites à l'échafaud pour avoir transformé des terres à blé en prairies artificielles.
[158] Un décret du 15 janvier 1811 charge le ministre de l'intérieur de prendre des mesures pour faire semer, dans l'étendue de l'empire, cent mille arpens métriques de betteraves, et ordonne qu'un état de répartition sera imprimé et envoyé aux préfets.
[159] Décret du 8 mars 1811. Amende de cent à mille francs contre les contrevenans; le double en cas de récidive.
[160] Décret du a1 avril 1806.
[161] Idem.
[162] Inconvéniens, etc., du nouveau projet de Code forestier; in-8, Paris, 1826, chez Delaunay.
[163] Cours complet d'Écon. polit. prat., t. II, p. 138.
[164] « La terre que j'ai prise, écrit un jeune fermier écossais à son ancien maître, contient trois cents acres d'Ecosse, divisés en six enclos, assez bien situés, à portée de la chaux et de la marne, et dans une localité telle qu'on peut y espérer de vendre les produits de toute sorte et à un prix avantageux. » (V. tes Ann. agric. de Roville, t. III, p. 266.)
[165] V. les Ann. agric. de Rov., t. III, p. 205 et suiv.
[166] Nous verrons ailleurs que, sur cette question, l'intérêt politique s'accorde parfaitement avec l'intérêt agricole.
[167] Voici, d'après M. Cordier ( Agric. de la Fl. franç.), comment sont organisées en Flandre la plupart des exploitations rurales : la ferme est close par un fossé rempli d'eau et que les bestiaux ne peuvent franchir ; les bâtimens sont placés au centre, et forment une cour carrée; ils sont entourés de vergers plantés d'arbres fruitiers et forestiers, où on laisse les bestiaux ; les champs sont bordés d'arbres. On se défend contre l'intempérie des saisons par la variété des cultures. Par là aussi on s'assure du travail pour tous les temps de l'année. Pendant dix mois, on laboure, on sème, on plante, on récolte presque chaque jour. Il se trouve ainsi qu'on n'est jamais ni oisif ni pressé.
[168] Elle se trouve, à cet égard, dans une situation plus défavorable que le voiturage, qui se prête encore à l'emploi de ces forces, quoique à un moindre degré que la fabrication (V. plus haut p. 301). Elle est des trois industries dont il a été question jusqu'ici celle qui en profite le moins.
[169] Agric. de la Fl. franç., p. 149.
[170] Id., p. 223.
[171] Ann. agric. de Rov., t.1, p. 39.
[172] Ann. agric. de Rov., t. I, p. 41.
[173] V. plus haut, p. 338 de ce volume.
[174] Agric. de la Fl. franc., p. 99.
[175] v. dans l'Édimb. Rev., cahier d'oct. 1819, un article sur les industries comparées de la France et de l'Angleterre.
[176] Agric. de la Fl. franç., p. 120.
[177] Id., p. 94 et 96.
[178] « Il a existé jusqu'à présent une grande erreur, observe M. de Laborde, c'est de ne répandre l'instruction que parmi les classes qui ont déjà toutes les lumières, et de reléguer les travaux du corps parmi celles qui en sont surchargées. Les lumières seraient utiles, au contraire, aux individus que leurs occupations tendent à rendre grossiers, tandis que les travaux du corps, introduits dans l'éducation des familles aisées, leur donneraient les forces physiques qu'avaient leurs pères avec les lumières qu'ils ont de plus qu'eux. »
[179] Voyage en Angleterre, deux. édit., t. I, p. 33 et 34.
[180] V., relativement à l'influence que tout cela exerce sur l'homme physique, un mémoire très-curieux de' M. Villermé sur la taille de homme en France, inséré dans le deuxième n° des Annales d'hig. pub. et de méd. lég., p. 351 et suiv.
[181] Cabanis, Rapport du physique et du moral, etc., t. III, p. 433 de ses œuvre s complètes.
[182] Les familles dont il s'agit ici suivent, le plus qu'elles peuvent, dans leurs mariages, la méthode dite de la propagation en dedans, méthode que quelques agronomes regardent, dans certains cas, comme la plus favorable à la conservation des bonnes races. Backevell pensait que lorsqu'une espèce d'animaux approchait de la perfection sous le rapport des formes, on devait en marier entre eux les individus. Sa maxime était qu'il fallait unir les animaux les plus parfaits, sans examiner s'ils étaient ou n'étaient pas de la même famille : tel père tel fils, disait-il. Sur quoi sir John Sebright observe qu'il n'est pas douteux qu'on ne doive unir entre eux les sujets les plus parfaits ; mais que la question est justement de savoir combien de temps, en suivant la méthode de la propagation en dedans, une famille pourrait conserver des qualités qu'elle n'aurait acquises que par une suite de croisemens judicieux. V. les Ann. agric. de Roville, t. IV, p. 362 et suiv.- Les membres de certaines maisons régnantes ont peut-être raison de ne se marier qu'entre eux; mais il semble qu'ils auraient fait sagement, avant d'adopter cette méthode, d'examiner s'ils étaient, au physique et au moral, les plus parfaits des hommes, et s'ils n'avaient pas à craindre, en la suivant, de perdre une partie de cette perfection.
[183] On cite surtout les femmes de Malaga.
[184] Je ne veux pas terminer ces réflexions sur l'exercice sans rendre un juste hommage à un Espagnol distingué, naturalisé parmi nous, à qui nous devons d'avoir appelé l'attention du public français sur l'importance de l'éducation physique, et d'avoir introduit la gymnastique en France. En créant chez nous cette branche précieuse de l'enseignement, M. Amoros a rendu au pays qui l'avait adopté un service véritable, et d'autant plus digne de reconnaissance, qu'il était d'abord moins compris, et qu'il lui a fallu, pour le faire agréer, plus de zèle et plus de constance.
On peut voir dans beaucoup d'écrits, et notamment dans ceux qu'a publiés le colonel Amoros, des exemples nombreux et frappans des résultats que peut produire une éducation physique bien dirigée.
[185] V. l'histoire des progrès récens de la chirurgie, par M. Richerand.
[186] « Je me suis toujours étonné, observe un historien, des fausses idées qu'on a laissées dans notre esprit sur le siècle de Louis XIV. Il semble que les hommes et les femmes y fussent des êtres privilégiés. On ne suppose rien que d'agréable et de parfait dans leur taille ou dans leur visage. Les poètes, en parlant surtout des princes et des princesses du sang, ne trouvent pas de couleurs assez flatteuses pour peindre la beauté de ces enfans des dieux, Voyons donc le rare assemblage qu'offrait cet Olympe.
« Marie-Thérèse d'Autriche, femme de Louis XIV, était maigre, sèche et fort petite; Henriette d’Angleterre, si séduisante par son esprit, était un peu hossue; et La Vallière, comme on sait, un peu boiteuse. Le grand Dauphin avait eu le nez cassé dans sa jeunesse en jouant avec le prince de Conti. Le duc de Bourgogne, qui eût été l'idole des Français, n'en avait pas moins une épaule plus haute que l'autre. Sa femme, dont la malice faisait les délices de la cour, n'avait pas une seule dent saine dans la bouche. M. le duc du Maine était boiteux. Mademoiselle de Bourbon, petite-fille du grand Condé, était manchotte; et Henri de Bourbon, qui fut ministre après la régence, était borgne. Quant au roi lui-même, il exhalait une odeur dont aucun courtisan ne s'aperçut jamais, comme de raison, mais qu’osa lui reprocher un jour une mais tresse irritée, etc.» (La cour et la ville sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, cu Révélations historiques tirées de manuscrits inédits, par F. Barrière).
[187] Ce mal était si commun, vers la fin du quinzième siècle, qu'il avait fallu prendre les mesures de police les plus sévères pour s'opposer à ses progrès; et les marques en étaient si apparentes qu'on reconnaissait, à la simple vue, les malheureux qui en étaient infectés. On les arrêtait, à Paris, dans l'intérieur de la ville et aux barrières. L'entrée de la ville était défendue, sous peine de la hart, à ceux du dehors. Quant à ceux de l'intérieur, ils étaient consignés dans leurs demeures, et s'ils étaient pris, on les conduisait dans des hôpitaux où on leur appliquait les étrivières avant et après le traitement. V. Dulaure, Hist de Paris, t. II, p. 515; III, p. 79 et suiv.; VI, p. 24.
[188] Révolutions et réforme de la méd., t. I. des ouvres complètes de l'auteur, p. 60 et suiv., et p. 258 et 318.
[189] Ibid., p. 288.
[190] Ibid., p. 270.
[191] Ibid., p. 288, 289 et 295.
[192] Ibid., p. 60 et suiv.
[193] Révolut. et réf. de la méd., p. 305 et 306.
[194] V. Richerand, Hist. des progrès récens de la Chirurgic.
[195] Cabanis, Révolut. et réform. de la médecine,' p. 363 et suiv.
[196] Voyage en Anglet., t. I, p. 175, deuxième édit.
[197] Voyage en Anglet., t. I, p. 33 et 34, deuxième édit.
[198] V. l'Esprit des lois, liv. XXVIII, chap. 20, 14 et 25.
[199] Dulaure, Hist. de Paris, t. II, p. 104, 227, 228, 661, 662, première édit,
[200] V. la Rev. Brit. t. XIV, p. 164 et 165.
[201] Loi du 19 ventose an xi (18 mars 1803), art. 15, 26 et 29. TOM. II.
[202] V. le Censeur européen, t. VI, p. 50 à 121, et notamment p. 110 et suiv.
[203] V., sur ces instrumens et sur une multitude d'autres, ce que dit M. Richerand dans son Hist. des progrès récens de la chirurgie.
[204] Les médecins arabes, observe Cabanis, regardaient une vaste infirmerie comme un laboratoire nécessaire aux observations et aux expériences des praticiens; comme une espèce de galerie où les jeunes élèves trouvaient exposés des tableaux instructifs que les livres retracent toujours imparfaitement. Ils ne croyaient pas plus pouvoir se passer, dans leurs écoles, d'une réunion de malades que d'une collection de remèdes, ou d'un laboratoire de chimie ou de pharmacie, ou d'un jardin des plantes usitées pour les traitemens. » ( Rev. et réf. de la méd., t. I des œuvre s complètes de l'auteur, p. 291.)
[205] En voyant ainsi l'état de l'intelligence correspondre constamment à l'état de l'organe par lequel elle s'exerce, certains physiologistes seraient fort disposés à conclure que c'est l'organe lui-même qui est intelligent. Mais cette conclusion serait tout aussi forcée que celle des psychologistes qui affirment que l'intelligence tient à un principe distinct de l'organe. La vérité est que l'observation ne nous fournit aucun moyen de savoir si la pensée et l'itastrument par lequel l'homme pense, sont une seule et même chose ou deux choses différentes, et qu'il est également hors de nolre pouvoir, à parler scientifiquement, d'être matérialistes et d'être spiritualistes. Nous pouvons, scientifiquement, nous occuper de l'organe et de ses fonctions; mais quant à savoir si le cerveau fonctionne par lui-même ou par la vertu d'un agent immatériel, c'est ce qui passe les forces de la science et que la foi seule peut enbeigner. Bornons-nous donc ici à dire que l'organe est indispensable à la fonction, et que pour influer sur la fonction il est indispensable d'agir sur l'organe.
[206] Il est bon qu'il les fasse trotter devant lui, pour juger de leur train. (MONTAIGNE.)
[207] V., dans la Revue britannique, 7e livraison, un excellent article sur l'instruction publique, traduit de la Revue de West-minster.
[208] V., dans la 7e livraison de la Revue britannique, l'article déjà cité.
[209] Traité élémentaire de chimie, disc. prélim., p. 12.
[210] V. les Elém. d'hist. nat. de M. Duméril, t. I, p. 183 et suiv.
[211] Recherches statistiques sur Paris, année 1823, tabl. nos 81, 85, 91.
[212] Il est aisé d'observer qu'à mesure que les habitudes deviennent plus régulières et plus sensées, le caractère des publications s'améliore; que les ouvrages utiles sont plus demandés, et que les livres frivoles le sont moins. C'est une chose qui a été bien constatée par le précieux travail que M. Daru publia, il y a quelques années, sur les mouvemens du commerce de la librairie en France depuis la restauration. On a pu voir dans ce travail que, de 1814 à 1826, le nombre de toutes les publications s'était accru, mais que les rapports avaient sensiblement changé; que les livres de pur agrément, qui avaient été au premier rang sous l'empire, n'étaient plus maintenant qu'au second, et que des publications plus sérieuses et plus importantes, telles, d'une part, que les voyages, l'histoire ancienne et surtout l'histoire contemporaine, et d'un autre côté les livres de jurisprudence et de législation étaient passés du troisième rang au premier, et du cinquième au quatrième.
[213] V., dans le Courrier Français du jer juillet 1822, un article extrait de l'Écho de l'Ouest.
[214] Idem.
[215] Je viens de dire qu'en France le prix des journaux est élevé par des taxes de quarante pour cent. Quelque exorbitante qu'une telle contribution puisse paraître, on est forcé d'avouer qu'elle est légère en comparaison de l'impôt écrasant auquel est soumis en Angleterre le même moyen d'instruction. Dans ce pays, une feuille de journal, qui ne coûterait que quatre sous, est portée, taxes, à quatorze sous, c'est-à-dire à trois fois et demie la même somme, ce qui fait une augmentation de prix de deux cent cinquante pour cent. (Revue Brit., t. V, p. 41 et 42). On voit que ce n'est pas seulement chez nous que l'instruction a paru la matière imposable par excellence, et qu'on s'est appliqué à mettre hors de la portée des masses le moyen le plus puissant de la propager.
[216] Tom. VI du Censeur Européen, p. 50 à 121.
[217] V., dans les journaux de Paris des premiers jours de février 1828, les détails publiés à ce sujet par la Société our l'instruction élémentaire.
[218] V. les lettres de M. de Staël sur l'Angleterre, p. 198 et 200.
[219] C'est le général Tarayre, l'un des hommes qui entendent le mieux la civilisation de notre temps, qui a caractérisé la presse avec ce rare bonheur.
[220] V. la Revue brit. no 12, p. 247 à 249.
[221] Cependant, il faut reconnaitre que l'extrême spécialisation des études et de l'enseignement ne laisserait pas, à la longue, de nuire à l'étendue et même à la justesse des esprits si l'on ne s'efforçait de remédier aux inconvéniens qu'elle présente par l'établissement d'une spécialité nouvelle, qui consisterait à montrer les relations et l'enchaînement de toutes les connaissances, à résumer les principes propres à chacune d'elles en un moindre nombre de principes communs, à généraliser d'un côté tandis qu'on analyserait de l'autre, et finalement à empêcher qu'on ne perdit de vue l'ensemble pendant qu'on pénétrerait toujours plus avant dans les détails. Tel est l'un des principaux objets que parait se proposer un ancien élève de l'École polytechnique, M. Aug. Comte, dans un cours important qu'il vient d'ouvrir à l'Athénée, sous le titre de Cours de philosophie positive. La nature et le but de cet enseignement élevé se trouvent exposés avec talent dans le discours d'ouverture du professeur, inséré dans la Rev. encyclop. de nov. 1829, p. 273 et suiv.
[222] Pour les faits cités dans cet alinéa et dans celui qui suit, voir M. Monteil, Histoire des Français des divers états aux cinq derniers siècles, t. I, p. 407; M. Ch. Dupin, Situation progressive des forces de la France depuis 1814;.— le Courrier Français du 2 février 1828, p. 4, col. 2; - la Revue Britannique, t. X, p. 172 et 373; les Notices statistiques sur la librairie en France, publiées en 1827, par le comte Daru ; – et, dans la Rev. d'Edimbourg d'octobre 1819, un article sur les industries comparées de la France et de l'Angleterre.
[223] Cette comparaison entre l'étendue et l'activité des communications intellectuelles en France et en Angleterre, prise dans l'article de la Revue d'Édimbourg, qui est cité de l'autre part, date de 1819. J'ignore si alors elle était bien exacte; mais certainement elle ne l'est plus aujourd'hui. On peut voir, dans des documens officiels de la direction des postes de France, publiés dans les journaux de Paris des 9 et 10 janvier 1830, combien s'est accrue en France, et notamment à Paris, depuis quinze ans, l'activité du commerce épistolaire. D'autres renseignemens montrent à quel point se sont multipliés, nos journaux. Il est vrai qu'une progression correspondante a dû avoir lieu en Angleterre. Je ne sais si elle a été plus ou moins rapide, et si les rapports sont toujours les mêmes ou bien s'ils ont changé.