
GUSTAVE DE MOLINARI,
Notions fondamentales d'économie politique et programme économique (1891)
 |
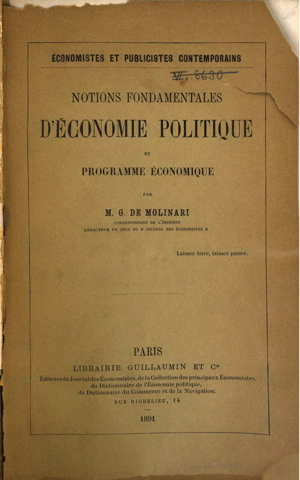 |
| Gustave de Molinari (1819-1912) |
[Created: 22 March, 2004]
[Updated: 29 May, 2024 ] |
The Guillaumin Collection
 |
This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |
Source
, Notions fondamentales d'économie politique et programme économique (Paris: Guillaumin, 1891).http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Molinari/Books/1891_NotionsFondamentales/index.html
Gustave de Molinari, Notions fondamentales d'économie politique et programme économique (Paris: Guillaumin, 1891).
This title is also available in a facsimile PDF of the original and various eBook formats - HTML, PDF, and ePub.
This book is part of a collection of works by Gustave de Molinari (1819-1912).
Table of Contents↩
- INTRODUCTION A L'ÉTUDE DE L'ÉCONOMIE POLITIQUE
- I. LOIS ET PHÉNOMÈNES ÉCONOMIQUES
- CHAPITRE PREMIER Les lois naturelles.
- CHAPITRE II Le capital.
- CHAPITRE III Le capital personnel. — La production de l'homme.
- CHAPITRE IV Le capital immobilier. — La production de la terre.
- CHAPITRE V L'analyse de la production.
- CHAPITRE VI L'analyse de la production (Suite et fin).
- CHAPITRE VII La distribution. — La part du capital mobilier.
- CHAPITRE VIII La distribution. — La part du capital immobilier.
- CHAPITRE IX La distribution. — La part du capital personnel.
- CHAPITRE X La consommation.
- CHAPITRE XI La propriété et la liberté. — Accord de l'économie politique avec la morale.
- CHAPITRE XII L'organisation naturelle des sociétés. — Les lois positives et les lois naturelles.
- II. PROGRÈS ET OBSTACLES
- CHAPITRE PREMIER La localisation naturelle de la production. — Le libre échange.
- CHAPITRE II Les progrés de l'outillage et des procédés de la production.
- CHAPITRE III Le progrès de la constitution des entreprises.
- CHAPITRE IV L'abaissement de la rétribution nécessaire du capital d'entreprise.
- CHAPITRE V L'abaissement de la rétribution nécessaire du capital d'exécution.
- CHAPITRE VI L'accroissement de la mobilisabilité des produits.
- CHAPITRE VII L'accroissement de la mobilisabilité des capitaux.
- CHAPITRE VIII La mobilisabilité du travail et les causes qui l'entravent.
- CHAPITRE IX Le bilan de l'émancipation des classes ouvrières.
- III. PROGRAMME ÉCONOMIQUE
- CHAPITRE PREMIER Programmes et remèdes socialistes
- CHAPITRE II L'objectif et le mécanisme de la production du progrès.
- CHAPITRE III PROGRAMME ÉCONOMIQUE
- CHAPITRE IV L'unification des marchés. — La mobilisation du travail
- CHAPTIRE V Le self government. — La tutelle.
- CHAPITRE VI Portée limitée du programme économique.
- CHAPITRE VII Les méthodes socialistes et la méthode économique.
- APPENDICE. L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE AFRICAIN
- TABLE DES MATIÈRES
[v]
PRÉFACE↩
Des progrès de toute sorte ont augmenté, depuis un siècle, la puissance productive de l'homme et provoqué un accroissement extraordinaire de la richesse. Mais soit que les résultats de la production des matériaux du bien-être se trouvent amoindris par un emploi improductif ou nuisible, soit que la distribution s'en trouve viciée, il est manifeste que la condition du plus grand nombre des producteurs ne s'est pas améliorée dans la proportion de l'augmentation des produits. De là, des souffrances et un mécontentement qui ont donné naissance à ce qu'on est convenu d'appeler la « question sociale ».
Cette question, les socialistes ont pris la voie la plus courte sinon la plus sûre pour la résoudre. S'arrêtant aux causes apparentes du mal, sans s'attarder à l'étude difficile et compliquée de l'organisme de la société, des lois qui gouvernent la production, la distribution et la consommation des forces vitales de cet organisme, des causes profondes qui agissent [vi] pour troubler ses fonctions et provoquer ses maladies, convaincus d'ailleurs que le génie peut dispenser de la science, ils ont inventé, pour la guérison des plaies sociales les plus invétérées, des spécifiques simples et d'une efficacité souveraine, tels que la suppression du salariat, la subordination du capital au travail, la nationalisation du sol, l'abolition de la propriété individuelle, etc., etc. Les économistes ne pouvaient évidemment lutter de vitesse avec des concurrents si peu embarrassés de bagages. Il ne leur a pas fallu moins d'un siècle d'observation assidue des phénomènes de la vie des sociétés, pour découvrir les lois qui les régissent et fonder sur la connaissance du sujet celle des remèdes applicables à ses maux.
Nous avons essayé, dans cet ouvrage, de résumer les notions fondamentales de la science qui a été le produit de ce labeur déjà séculaire, et de montrer comment les lois naturelles qu'elle a mises en lumière ont gouverné de tout temps les sociétés et déterminé leurs progrès, comment encore l'ignorance ou la méconnaissance de ces lois a été et n'a pas cessé d'être la source des maux qui affligent l'espèce humaine. Nous avons formulé ensuite un « programme économique, » appuyé sur les données de la science et adapté aux conditions actuelles d'existence des sociétés, sans prétendre toutefois qu'il ait la vertu de guérir, d'une manière instantanée, tous les maux de l'humanité.
[vii]
En cela, notre « programme économique » diffère essentiellement des programmes socialistes. Il en diffère aussi par plusieurs autres points. En premier lieu, il n'implique pas seulement la réforme du gouvernement de la collectivité, il implique encore celle du self government de l'individu. En second lieu, il n'exige point la conquête préalable du pouvoir et n'offre à ceux qui entreprendraient de le réaliser qu'une satisfaction purement morale. C'est pourquoi nous convenons volontiers qu'il ne répond point aux tendances actuelles des esprits, et nous ne nous dissimulons pas qu'il n'aura quelque chance de conquérir l'opinion qu'après que l'expérience aura fait justice des programmes socialistes. En supposant même que l'appât d'une récompense simplement platonique suffise à stimuler le zèle de ses adhérents, il sera, selon toute apparence, froidement accueilli aussi bien par les classes conservatrices que par la multitude. Les classes conservatrices se trouvent bien comme elles sont, et elles ont autant de répugnance sinon davantage pour les réformes possibles que pour les utopies impossibles. La multitude va de préférence aux officines où on lui promet la guérison immédiate et radicale de ses maux; sa faveur est d'ailleurs acquise d'avance à ceux qui lui affirment qu'elle supporte uniquement la peine des vices d'autrui et non des siens, et que l'amélioration de son sort n'exige de sa part aucun effort, aucun sacrifice.
Cependant, si ce « programme économique » [viii] ressort de la connaissance exacte des lois et des phénomènes de la vie des sociétés, s'il est fondé sur la nature de l'homme et sur ses conditions d'existence et de progrès, il s'imposera tôt ou tard, comme se sont imposées de tout temps des réformes devenues nécessaires.
[1]
INTRODUCTION
a l'étude de l'économie politique↩
I. Les lois naturelles. Les lois de l'économie des forces et de la concurrence. Comment les lois naturelles pourvoient à la conservation des espèces inférieures et maintiennent l'équilibre entre elles. La concurrence entre l'espèce humaine et les espèces inférieures. La concurrence entre les différentes variétés de la race humaine. Nécessité de la guerre et de l'esclavage. — II. La formation des états. Qu'ils se constituent et s'organisent sous l'impulsion des lois naturelles. Comment leur constitution et leur organisation politique et militaire se perfectionnent sous l'impulsion des mêmes lois. Organisation primitive de l'exploitation des pays conquis et des populations assujetties. Causes déterminantes des progrès de cette exploitation. La substitution du servage et de la sujétion a l'esclavage. Les communautés et les corporations. Conséquences de ces progrès. Les étapes de la servitude à la liberté. — III. Comment les progrès réalisés sous l'impulsion des lois naturelles ont agi pour mettre fin à la guerre. Que les profits de la guerre sont d'abord illimités. En quoi consistent ces profits. Pourquoi la guerre entre les peuples civilisés était nécessaire. Comment elle a cessé de l'être. Conséquences des progrès du matériel et de l'art de la guerre. Reflux de la civilisation sur la barbarie. Insuffisance originaire de la concurrence productive. Comment elle est née et s'est développée de manière à remplacer la guerre comme moteur du progrès. Résultats comparés de ces deux modes d'opération de la concurrence. Les profits directs de la guerre. Qu'ils ont fini par faire place à une perte. Le bilan actuel de la guerre. Pourquoi la guerre entre les peuples civilisés a cessé d'avoir sa raison d'être. — IV. Que l'organisation politique et économique des nations, ainsi que leur politique extérieure et intérieure sont demeurées adaptées à l'état de guerre. Les servitudes politiques. Les servitudes économiques. Le système protecteur. Raison de l'établissement de ce système sous le régime de l'état de guerre. Ses effets utiles et ses effets nuisibles. Causes qui ont agi pour lui enlever sa raison d'être. L'internationalisation croissante des [2] échanges. Comment elle assure la sécurité des approvisionnements. Que le système protecteur n'est plus qu'un obstacle au progrès. Pourquoi les institutions adaptées à l'état de guerre sont devenues nuisibles après avoir été utiles. — V. Causes de la prolongation artificielle de l'état de guerre. Les sentiments engendrés par l'état de guerre. Les intérêts. Bénéfices que la guerre n'a pas cessé de procurer aux classes gouvernantes, malgré les pertes qu'elle occasionne aux classes gouvernées. Pourquoi elle ne peut se perpétuer. Causes qui agissent pour y mettre fin. — VI. Le processus de la naissance et des progrès des sciences morales et politiques. Leur ordre chronologique naturel. La politique. La morale. Le droit des gens. L'économie politique. Causes déterminantes de leur éclosion et de leurs progrès. — VII et VIII. L'économie politique et l'importance croissante de son rôle.
I
Nous ignorons la raison d'être de l'innombrable multitude des espèces vivantes, végétales et animales, nous n'avons aucune idée des fonctions qu'elles remplissent dans l'ordre universel, nous pouvons conjecturer seulement qu'elles jouent un rôle nécessaire. Cette conjecture s'appuyerait au besoin sur la connaissance que nous avons acquise des lois au moyen desquelles la nature pourvoit à la conservation et au progrès des espèces.
Ces lois naturelles qui gouvernent l'existence de toutes les espèces vivantes sont celles de l'économie des forces et de la concurrence, agissant sous l'impulsion d'un mobile organique: la crainte de la peine et l'appât du plaisir. En quoi consistent-elles et quels sont leurs modes d'action?
L'observation et l'expérience nous apprennent que la vie ne peut se conserver et se développer que par une assimilation continuelle de forces: ces forces vitales, la nature n'en fournit gratuitement qu'une portion à ses créatures; elle leur impose la nécessité d'agir pour s'emparer des matériaux qui contiennent les autres et les approprier à sa consommation. Cette action indispensable à la conservation de la vie, c'est le travail. Tout travail implique une dépense de forces, et toute dépense des forces nécessaires à l'accomplissement des fonctions vitales de l'organisme implique une [3] souffrance, de même que toute assimilation de ces mêmes forces procure une jouissance. Tel est le mobile de la peine et du plaisir. Or à quelque degré que se trouve placé un être vivant dans l'échelle de la création, il est gouverné par ce mobile. Il fuit la peine et cherche le plaisir. En conséquence, il applique l'énergie et l'intelligence, consciente ou inconsciente, dont la nature l'a pourvu, à acquérir la plus grande somme de forces vitales en échange de la moindre dépense: c'est la loi de l'économie des forces. Cependant, l'énergie et l'intelligence sont inégalement distribuées non seulement entre les espèces, mais encore entre les individus de la même espèce. De cette inégalité naturelle il résulte que les plus forts et les plus capables l'emportent sur les moins forts et les moins capables dans l'acquisition de la subsistance, et, lorsque celle-ci est insuffiante pour tous, qu'ils survivent seuls: c'est la loi de la concurrence. Cette loi coopère ainsi à l'œuvre assignée à la précédente, en déterminant la survivance et la reproduction des plus forts et des plus capables, c'est-à-dire de ceux qui, étant pourvus de la plus grande somme de forces, sont les plus aptes à remplir la fonction dévolue à l'espèce.
Dans l'ordre de la nature, toutes les espèces vivent aux dépens les unes des autres. Les végétaux qui forment le premier anneau de la chaîne des êtres trouvent leur subsistance dans les matériaux qu'ils puisent dans le sol et l'atmosphère terrestres, les animaux vivent aux dépens des végétaux, les animaux supérieurs aux dépens des inférieurs, et tous fournissent les matériaux nécessaires à la satisfaction des besoins de l'homme. Il faut donc que chaque espèce produise assez de germes et de rejetons pour se perpétuer, tout en alimentant l'espèce ou les espèces supérieures dont la subsistance est à sa charge. La nature a pourvu à cette double nécessité en dotant toutes les espèces d'une fécondité exubérante, mais qui va décroissant à mesure qu'elles s'élèvent dans l'échelle des êtres. Toutes les espèces végétales et animales ont un pouvoir de reproduction qui répond à deux objets: leur [4] propre conservation et celle des espèces supérieures auxquelles elles servent de nourriture. Ce pouvoir existe au plus haut degré dans les espèces inférieures, qui servent à alimenter toutes les autres. Les individus qui les constituent ne tardent pas, en conséquence, à entrer en concurrence pour la recherche des matériaux dont ils se nourrissent, tandis qu'ils s'efforcent de se dérober à la consommation des espèces qu'ils alimentent. Dans cette double lutte, pour la conservation de la vie, les plus faibles, les moins capables de se procurer la subsistance et de se dérober à la poursuite des espèces qui vivent aux dépens de la leur, succombent. Les plus forts, les plus agiles, en un mot, les plus capables, seuls, survivent et assurent ainsi la conservation et l'accroissement utile de l'espèce. Cependant, chaque espèce a des limites que la nature lui a assignées, et vers lesquelles elle est incessamment ramenée. Si elle se multiplie de manière à les dépasser, aussitôt les espèces auxquelles elle sert d'aliment, se multiplient à leur tour, et entament l'excédent en détruisant les individus les moins capables de se dérober à leur poursuite, tandis que cet excédent est entamé, d'un autre côté, par l'élimination des moins capables de s'emparer d'une subsistance devenue insuffisante. Si, au contraire, le contingent de l'espèce vient à être réduit, soit par la diminution de ses matériaux alimentaires, sort par la multiplication excessive des espèces auxquelles elle paie tribut, cette réduction a pour effet d'encourager la reproduction des uns et de décourager celle des autres jus-qu'à ce que l'équilibre se trouve rétabli.
C'est ainsi que la nature maintient l'équilibre nécessaire entre la population et la subsistance des espèces inférieures, végétales et animales. Sa loi est dure et cruelle: elles les condamne à produire un excédent qui sert à alimenter les espèces placées à un degré supérieur. Dans cette échelle de la vie, la jouissance des uns est achetée par la souffrance des autres. Nous ne connaissons pas la raison de cet ordre de la nature. Nous pouvons constater seulement qu'il existe.
L'espèce humaine est soumise à la même loi d'équilibre [5] entre sa population et sa subsistance, mais avec cette différence essentielle que les espèces inférieures ne possèdent qu'un « pouvoir de destruction » et sont incapables de multiplier les aliments dont elles vivent, tandis que l'homme y joint un « pouvoir de production. » Il peut multiplier ou favoriser la multiplication des espèces aux dépens desquelles il vit, soit en les plaçant dans des conditions favorables à leur reproduction, soit en les protégeant contre les autres espèces, végétales ou animales, auxquelles elles servent d'aliment, Au lieu d'être limité dans son nombre et dans la satisfaction de ses besoins, par la fécondité des espèces qui pourvoient à sa subsistance et à son entretien, il peut, en exerçant et en augmentant son pouvoir de production, accroître sa population et satisfaire d'une manière de plus en plus complète à ses besoins.
Cependant, comme les espèces inférieures, l'espèce humaine débute par employer exclusivement son pouvoir de destruction. L'homme primitif vit de la recherche des fruits naturels du sol, de la pêche et de la chasse; il détruit végétaux et animaux, sans s'aviser de les multiplier. Il applique même son pouvoir de destruction à sa propre espèce: il pratique l'anthropophagie. Il ne sort de cet état d'animalité que sous la pression de la concurrence.
La concurrence se manifeste d'abord entre l'espèce humaine et les espèces animales qui subsistent aux dépens des mêmes variétés alimentaires, végétales et animales. Elle procède par la guerre, c'est-à-dire par la mise en œuvre du pouvoir de destruction des concurrents, et nous allons voir qu'elle ne pouvait procéder autrement.
Lorsque, dans un canton, où les hommes étaient en quête de gibier, en concurrence avec des animaux carnassiers, le nombre des concurrents s'augmentait, le gibier devenait plus rare et plus difficile à atteindre. Un moment devait arriver où les plus forts trouveraient plus d'advantage à expulser ou à détruire leurs concurrents plus faibles, qu'à supporter leur concurrence. Supposons, par exemple, qu'aux temps préhistoriques, [6] des hommes vinssent à apparaître dans une localité où vivait un mammouth ou un ours des cavernes. Aussi long-temps que cette concurrence ne diminuait pas sensiblement la quantité des subsistances, et n'obligeait point l'animal à faire une dépense plus grande de force et de peine pour se les procurer, il pouvait ne pas s'inquiéter de la présence des nouveaux venus et vivre en paix avec eux. Mais les hommes commençant à se multiplier et les subsistances à se raréfier, l'antagonisme des intérêts naissait et allait croissant entre les deux espèces concurrentes. L'homme avait intérêt à se débarrasser de l'ours ou du mammouth, et celui-ci à se débarrasser de l'homme. Ce travail de destruction exigeait, à la vérité, une dépense de forces, — ainsi détournées de la recherche des subsistances. Mais si l'homme ou l'animal estimait que la somme de forces et de peine qu'il lui fallait dépenser d'abord pour supprimer son concurrent, en admettant même qu'il ne pût se nourrir de sa chair et utiliser sa dépouille, ensuite pour s'emparer du gibier devenu plus abondant, était inférieure à celle qu'exigeait l'acquisition du gibier raréfié par la concurrence, il était naturellement poussé par le mobile organique de la peine et du plaisir à réaliser cette économie de force. De là, la guerre dans sa manifestation primitive, — guerre entre l'homme et les animaux en quête des mêmes subsistances. Dans cette guerre, l'homme était physiquement le moins fort et le moins pourvu d'armes naturelles.
Mais précisément parce qu'il était le moins fort, il était excité à remédier à cette infériorité, en faisant appel à son intelligence qui était supérieure à celle de ses concurrents, et desservie par des organes qui lui étaient appropriés. Sous cette excitation, il inventa les armes et les procédés de destruction qui lui permirent à la longue de détruire, de refouler ou d'asservir les espèces concurrentes.
Entre l'homme et les espèces concurrentes, la guerre était donc inévitable. Quelle qu'eut été, en effet, la pression de la concurrence, elle n'aurait pu déterminer et développer chez les animaux concurrents de l'homme, le pouvoir de multiplier [7] les subsistances. Ils vivaient de chasse et ne possédaient point l'intelligence nécessaire pour renouveler et augmenter l'approvisionnement de gibier. L'homme venant à apparaître et à se multiplier, le canton habité et exploité par les grands carnassiers ne devait pas tarder à être insuffisant pour subvenir à la nourriture des anciens occupants et des nouveaux. En supposant que les animaux dont la subsistance se trouvait ainsi raréfiée, n'eussent pas pris l'initiative de la guerre à un concurrent qui rendait leur existence plus pénible et précaire, l'homme eut été, à la longue, obligé de la prendre. Si même il avait renoncé à la chasse pour éviter tout conflit, et s'il avait demandé sa subsistance à la culture du sol, il aurait simplement retardé une lutte devenue inévitable: un moment serait toujours arrivé où, en se multipliant et en étendant ses cultures, il aurait empiété sur le domaine des occupants primitifs du sol. C'est ainsi que les colons agriculteurs du Far West empiètent incessamment sur les terrains de chasse des Indiens, et que ceux-ci sont fatalement destinés à périr, à moins d'adopter l'industrie de leurs concurrents, ce qui est difficile à des tribus arriérées de chasseurs, ce qui eût été impossible aux animaux carnassiers. A l'origine, ceux-ci étaient incontestablement les plus forts et ils se seraient hâtés, sans doute, de détruire la race humaine, dès son apparition, s'ils avaient eu la prévision de l'avenir. Mais le dommage qu'elle leur causait ne se manifestant que graduellement, l'homme eût le temps nécessaire pour suppléer par un armement artificiel à l'insuffisance de son armement naturel, Les grandes espèces carnassières détruites ou refoulées, il pût occuper seul les terrains de chasse, dont il partageait auparavant avec elles l'exploitation.
La horde ou la tribu de chasseurs, débarrassée de ses concurrents, pût se multiplier davantage. Mais à mesure qu'elle croissait en nombre, elle avait besoin d'un supplément de territoire propre à l'exercice de son industrie. Certes, les terres disponibles ne manquaient point: encore aujourd'hui, après des centaines et peut-être des milliers de siècles, notre [8] globe ne contient qu'une faible partie des habitants qu'il pourrait nourrir. Mais la productivité du sol est bien moins à considérer en cette matière que celle de l'industrie humaine. Tandis qu'une superficie exploitable de 10 kilomètres carrés, cultivée en plantes alimentaires, peut nourrir un millier d'individus, c'est à peine si elle fournit une subsistance suffisante à un seul chasseur. Un moment ne devait donc pas tarder à arriver où la population de la tribu de chasseurs dépasserait les moyens de subsistance que contenait son habitat. Alors, elle se trouvait dans la nécessité d'en sacrifier le surcroît, — et telle fût probablement l'origine de l'infanticide et des sacrifices humains, — ou de perfectionner son industrie alimentaire, de manière à tirer une plus grande quantité de subsistances de la même étendue de territoire, ou bien enfin d'envahir le domaine des tribus voisines et de chasser celles-ci comme tout autre gibier. Les tribus primitives employèrent l'un ou l'autre de ces deux derniers procédés selon que la nature de leurs facultés et de leurs aptitudes le leur rendait plus ou moins avantageux. Or ces facultés et ces aptitudes étaient essentiellement inégales et diverses. Quoique les hommes, dans la multitude de leurs variétés, appartiennent à la même espèce, on peut distinguer parmi eux les différents types et les aptitudes caractéristiques des espèces inférieures, et peut-être cette observation fournirait-elle l'explication de leur origine. Parmi nos contemporains, nous pouvons aisément reconnaître ceux qui participent de la nature des animaux de proie, le lion, le tigre, l'aigle, le loup, le renard, et ceux qui tiennent plutôt des espèces paisibles ou industrieuses, le cheval, le bœuf, le mouton, le castor. Les différences étaient, sans aucun doute, plus marquées avant que les croisements eussent mélangé les variétés et modifié leurs types. Il y a apparence aussi que les individus issus des mêmes souches se réunissaient en groupes séparés, de même que les bœufs ou les bisons à l'état sauvage ne s'associent point avec les chevaux, et les loups avec les renards. Dans cette variété de tribus d'aptitudes inégales et diverses, [9] les plus fortes, les plus aptes à la lutte et à la destruction devaient recourir de préférence à la chasse et au pillage des plus faibles. Les plus industrieuses, au contraire, étaient excitées plutôt à mettre en œuvre leurs facultés d'observation et d'invention pour multiplier leurs subsistances. Lorsque la chasse et la récolte des fruits naturels du sol, dans le canton qu'elles occupaient, devinrent insuffisantes à les nourrir, elles créèrent l'industrie incomparablement plus profitable de l'élève de bétail, et, plus tard, celle de la culture des céréales et des autres plantes alimentaires. Ces tribus industrieuses purent croître alors rapidement en nombre: le travail auquel elles demandaient leur subsistance, devenu productif de destructif qu'il était auparavant, leur procura une abondance croissante de richesses.
Mais entre les hordes, particulièrement aptes à la destruction, qui continuaient à vivre de chasse et les tribus progressives de pasteurs et d'agriculteurs, la guerre n'était-elle pas inévitable comme elle l'avait été, à l'origine, entre les grandes espèces animales et l'homme primitif? Elle l'était d'autant plus que les tribus en progrès devenaient moins habiles à la pratique de l'art de la destruction en s'adonnant aux travaux paisibles de la production, par conséquent aussi, moins capables de résister aux hordes sauvages qui continuaient à pratiquer cet art, aux dépens des animaux et des hommes. Tandis qu'à l'époque primitive de lutte entre les grandes espèces animales et l'espèce humaine, la victoire appartenait aux plus capables de progrès, c'étaient maintenant les moins capables qui avaient le plus de chances de la remporter. Ainsi s'explique la destruction des civilisations préhistoriques, dont on retrouve les traces sur différents points de l'ancien et du nouveau monde. Si cet état de choses s'était perpétué, la civilisation n'eût été, sur notre globe, qu'un phénomène passager et intermittent, et l'humanité serait incessamment revenue à son premier état de sauvagerie, voisin de l'animalité. Mais la civilisation fut sauvée par une institution qui est devenue aujourd'hui, comme la guerre dont elle est issue, [10] nuisible après avoir été utile, nous voulons parler de l'esclavage. Soit que les populations adonnées à l'agriculture et aux autres industries productives eussent fait appel, pour se défendre contre les hordes de chasseurs et d'anthropophages, à d'autres tribus de forts chasseurs, tels que le Nemrod assyrien et ses compagnons, en se soumettant de plein gré à leur domination, soit que les plus intelligentes de ces hordes destructives eussent compris qu'au lieu de massacrer les vaincus et d'en faire leur pâture, elles trouveraient plus de profit à les asservir et à les obliger à travailler pour elles, l'objectif de la guerre changea: aux incursions temporaires en vue du pillage et de l'anthropophagie succédèrent l'occupation permanente du territoire envahi et la mise en exploitation régulière de sa population, réduite en esclavage. Dès ce moment, l'avenir de la civilisation fut assuré.
Sans doute, l'humanité aurait gagné à n'être point obligée de passer par une longue période de guerre et de servitude. Supposons que les sociétés primitives après avoir inventé leur armement et s'en être servi pour détruire ou refouler leurs concurrents des espèces animales inférieures, eussent pu laisser se rouiller cet appareil de destruction et qu'à mesure que leur population allait croissant, elles eussent demandé au progrès de leur pouvoir de production, sous un régime de liberté du travail, un supplément de moyens de subsistance; qu'elles se fussent uniquement appliquées à développer leur industrie et à établir entre elles une communauté d'intérêts mutuellement avantageuse par l'échange de leurs produits et de leurs services, il est clair que l'espèce humaine se serait multipliée et civilisée plus vite, qu'elle aurait accru davantage, en échange d'une dépense et d'une déperdition moindres, la quantité et la qualité de ses forces vitales. Mais ce processus de la civilisation par la paix et la liberté, tel que nous le rêvons aujourd'hui pour l'avenir de l'humanité, était-il possible dans son passé? Du moment où l'intelligence créatrice et ordonnatrice de notre monde avait arrangé les choses de manière à rendre nécessaire la guerre [11] entre les espèces animales qui occupaient primitivement le globe et l'espèce humaine, n'avait-elle pas rendu, par là même, inévitable la guerre entre les hommes? Cette forte et courageuse élite de l'humanité qui engageait une lutte mortelle avec des animaux monstrueux et pourvus d'un armement redoutable, ne devait-elle pas développer avant tout sa puissance destructive? Pour détruire des animaux de proie ne fallait-il pas des hommes de proie? Lorsque cette œuvre nécessaire cut été accomplie, les races guerrières dont la victoire avait assuré à l'humanité la possession du globe ne devaient-elles pas trouver plus de profit à exercer, aux dépens des variétés plus faibles et moins courageuses, l'industrie destructive, dans laquelle elles excellaient, qu'à demander leur subsistance à des industries productives auxquelles elles n'étaient point aptes? La guerre entre les hommes apparaît donc comme la conséquence de la lutte primitivement engagée entre l'espèce humaine et les espéces animales, ses concurrentes; lutte inévitable puisqu'elle était déterminée par la loi naturelle de l'économie des forces, et qui entrait ainsi, visiblement, dans le plan de la création.
II
L'espèce humaine se partageait en variétés différentes de types et d'aptitudes, et chaque société se constituait dans la variété à laquelle elle appartenait: les hommes dont la nature participait de celle des animaux de proie s'associaient entre eux, et demandaient leur subsistance à la chasse aux hommes des variétés moins fortes et moins belliqueuses, quoique peut-être plus industrieuses, aussi bien qu'à la recherche des fruits naturels du sol et à la poursuite des animaux comestibles. L'homme était le gibier de l'homme. Il en alla ainsi jusqu'à ce que la découverte et la mise en culture des plantes alimentaires, et les autres progrès qui augmentaient la productivité du travail humain eussent rendu l'exploitation régulière des populations industrieuses, plus profitable que le pillage et [12] l'anthropophagie. Ce fut le début d'une ère nouvelle dans laquelle la civilisation naissante, assurée désormais contre la destruction par ses destructeurs eux-mêmes, pût se développer, et, finalement, de progrès en progrès, acquérir la prépondérance sur le monde barbare.
Sous des formes diverses, tous les états en voie de civilisation nous apparaîssent alors constitués d'éléments analogues et organisés de la même manière: une société conquérante ou dominante possède le territoire avec la population vouée aux travaux de la production, et elle exploite ce domaine comme une vaste ferme tantôt indivise, tantôt, et le plus souvent, divisée en parcelles appropriées individuellement aux associés, sans établir d'ailleurs aucune différence de traitement entre les hommes et les animaux qui composent le cheptel vivant du domaine. Comme la tribu primitive, cette société propriétaire et exploitante d'un état se constitue et s'organise sous l'impulsion des lois de la concurrence et de l'économie des forces. Elle est exposée, d'une part, à la concurrence des tribus arriérées, mais belliqueuses et redoutables, qui continuent à vivre de chasse et de pillage, d'une autre part, à celle des autres sociétés propriétaires et exploitantes d'états, qui sont intéressées, comme elle l'est elle-même, à agrandie leurs domaines, soit pour fournir un débouché au croît de leur population, soit simplement pour augmenter les profits de leur exploitation. Sous la pression de cette double concurrence, elle est incessamment excitée, en premier lieu, à développer au maximum la puissance militaire, qui est l'instrument nécessaire de sa conservation et de son agrandissement, en second lieu, à créer et perfectionner l'appareil de gouvernement le plus propre à maintenir l'accord entre ses membres et à assurer leur coopération efficace aux entreprises d'intérêt commun; enfin, à créer et perfectionner de même l'appareil de domination et d'exploitation de la population assujettie, de manière à en tirer la plus grande somme possible de ressources, applicables à la défense et à l'agrandissement de l'état. Plus la concurrence est continue et pressante, plus la [13] société propriétaire est excitée à perfectionner ce triple appareil de combat, de gouvernement et d'exploitation, afin d'en obtenir le plus grand effet utile.
C'est sous la pression de cette concurrence que se réalisent successivement les progrès de la constitution des armées, du matériel et de l'art de la guerre. La constitution de cet appareil de destruction, aussi bien que celle des appareils de production, a ses règles naturelles et nécessaires qui dérivent de la loi de l'économie des forces. Ces règles concernent le commandement, la hiérarchie, la discipline, le recrutement, l'armement, l'approvisionnement et l'application à la lutte. Une armée doit être commandée par le chef le plus capable et obéir passivement à ses ordres, par voie hiérarchique, elle doit être recrutée parmi les individus qui possèdent l'aptitude et les qualités requises pour l'exercice du métier de la guerre, pourvue d'un matériel efficace et d'une avance suffisante de subsistances et d'entretien; enfin, elle ne peut conserver toute sa valeur qu'à la condition de ne point demeurer inactive. De même que des ouvriers, qui n'auraient qu'à de rares intervalles l'occasion d'exercer leur métier, perdraient à la longue leurs aptitudes et leurs qualités professionnelles, les hommes de guerre se rouillent dans l'inaction et ils deviennent de moins en moins capables de lutter avec des adversaires, occupés en tous temps. La conservation et à plus forte raison l'accroissement de la puissance militaire d'une nation nécessite done une pratique fréquente et, mieux encore permanente de la guerre. L'histoire tout entière confirme cette observation. C'est aux sociétés qui se sont le plus fréquemment adonnées à la pratique de la guerre et pendant qu'elles s'y adonnaient que sont dus principalement les progrès de la constitution des armées, de l'armement et de l'art militaire. Nous verrons plus loin quelles ont été les conséquences de ces progrès.
C'est encore à la pression de la concurrence, sous sa forme destructive, que sont dus les progrès dans la constitution des gouvernements et dans l'art de la politique. Avant tout, les gouvernements avaient à pourvoir à la nécessité prédominante [14] de la conservation et de l'accroissement de la puissance militaire de la société, de laquelle dépendait, du moins à l'origine, l'existence de tous les associés. Si nous étudions leur constitution et leur politique intérieure et extérieure aux différentes époques de la civilisation et dans toutes les régions du globe, nous trouverons qu'elles répondent à cette nécessité. Elles y répondent, à la vérité, d'une manière plus ou moins complète: il y a des gouvernements dont la constitution est grossièrement défectueuse et dont la politique est mal adaptée à son objet essentiel, savoir l'augmentation de la puissance de l'état et l'affaiblissement de celle des états concurrents. Ces défectuosités apparaissent et s'aggravent surtout aux époques et dans les régions où la concurrence est peu active, où les états en voie de civilisation, demeurent en paix. Mais aussitôt que la pression de la concurrence se fait sentir, la nécessité du salut commun détermine une réforme des parties défectueuses et faibles de la constitution du gouvernement et un perfectionnement de son mécanisme, qui lui permet de concentrer davantage et de mobiliser plus rapidement les forces et les ressources dont il peut disposer. La politique intérieure se propose pour objet d'augmenter et d'unifier les forces de l'état et d'accroître ses ressources disponibles, tandis que la politique extérieure agit parallèlement pour le fortifier par des alliances utiles et pour affaiblir les états concurrents par la division et l'antagonisme qu'elle sème entre eux. C'est au moyen de l'observation et de l'expérience que s'accomplissent ces progrès de l'art de gouverner les états, et c'est aux époques et dans les pays où la concurrence, sous sa forme primitive de guerre, est la plus active et la plus continue, qu'ils se multiplient et que l'état arrive à être constitué et gouverné de la manière la plus conforme à la loi de l'économie des forces.
C'est enfin, aux époques et dans les pays où la concurrence guerrière est la plus pressante que s'améliorent principalement les procédés d'exploitation des populations assujetties à la société propriétaire de l'état. Si nous consultons l'histoire [15] de la fondation de la généralité des états politiques aux époques et dans les régions où les premiers accroissements de la puissance productive de l'homme ont rendu l'occupation et l'exploitation permanentes des pays conquis plus profitables que le simple pillage, nous trouverons que les conquérants emploient partout les mêmes procédés et établissent un régime à peu près uniforme: 1° Ils se partagent le butin immobilier et mobilier, la terre, les bâtiments, les hommes, les animaux domestiques, les approvisionnements de toute sorte, en raison de la contribution en personnel et en matériel qu'ils ont apportée à l'entreprise de la conquête; 2° Chacun des co-partageants, ordinairement un chef de bande avec ses compagnons, est investi du domaine qui lui est échu en partage, à la condition de contribuer pour sa part proportionnelle à la défense et, au besoin, à l'agrandissement de l'établissement commun, d'obéir en cas de guerre à l'appel du chef suprême de l'armée, roi ou empereur, et de se placer sous son commandement. Ce chef obtient naturellement la plus grosse part du butin, le domaine le plus important, et ses descendants, comme ceux des autres co-partageants, héritent à la fois de sa fonction et de son domaine. En temps de paix, les liens de la hiérarchie se relâchent, les grands propriétaires qui sont en même temps les grands officiers de l'armée conquérante s'efforcent de se rendre indépendants, parfois même ils se liguent contre leur chef souverain, mais lorsque l'état de guerre s'impose de nouveau, lorsque les conquérants sont menacés de dépossession par la concurrence du dehors, la nécessité de l'unification et de la coordination rigoureuse des forces, en vue d'obtenir un maximum d'effet utile, resserre les liens de la hiérarchie, assure et fortifie le pouvoir du chef souverain. Celui-ci profite communément de cet accroissement de sa puissance soit pour déposséder les propriétaires désobéissants ou rebelles, soit pour restreindre les droits de gouvernement et d'exploitation qu'ils possèdent sur la population de leurs domaines particuliers, en y substituant les siens; 3° Dans chaque domaine approprié à un des membres [16] qualifiés de la société conquérante, le propriétaire exerce d'abord un pouvoir sans limites sur la population assujettie. Cette population, il l'exploite de la manière qui lui paraît la plus profitable: il en emploie la plus grande partie à la production des subsistances nécessaires à sa consommation, ainsi qu'à celle de ses compagnons et de son cheptel vivant d'hommes et d'animaux; une autre partie à la confection des vêtements, à la construction et à l'entretien des habitations et des bâtiments d'exploitation, à la fabrication des armes, des outils, des meubles, etc., enfin, une dernière partie aux services domestiques. Il commence par exiger d'elle la plus grande somme possible de travail, le plus souvent même une somme excessive, en ne lui laissant que le strict nécessaire, autrement dit, un minimum de subsistance: n'est-il pas assuré de la coopération de la société conquérante toute entière pour réprimer les révoltes de la population conquise et asservie? Cependant, l'observation et l'expérience agissent pour lui démontrer qu'en surmenant ses esclaves aussi bien que ses bêtes de somme et en ne leur fournissant point une subsistance et un entretien suffisants, il nuit à son propre intérêt, car des esclaves, surmenés et mal nourris, produisent moins que des esclaves bien entretenus et bien traités. L'observation et l'expérience lui font faire encore successivement d'autres découvertes. Lorsque la capacité intellectuelle et morale de ses esclaves dépasse celle de ses autres bêtes de somme, il s'aperçoit qu'il peut réaliser une économie et se débarrasser du souci de leur entretien, en leur laissant le soin d'y pourvoir eux-mêmes. En conséquence, il divise entre eux une partie de son domaine, et il leur en concède la jouissance, en échange de la somme de travail dont il a besoin pour l'exploitation de la partie qu'il se réserve ainsi que pour ses services domestiques ou autres. Les esclaves, passés à l'état de serfs, forment d'habitude une commune qui opère la distribution et, plus tard, la redistribution des terres en raison des forces de chaque famille et de la contribution en travail qu'elle est apte à fournir. Lorsque l'assemblée des serfs de la commune [17] possède la capacité morale nécessaire pour opérer cette répartition suivant les règles de l'équité, ce système, tel qu'il existait en Russie, par exemple, était plus avantageux aux deux parties et moins exposé à être vicié par la faveur ou la corruption que ne pouvaient l'être la distribution et la redistribution opérées par le propriétaire lui-même ou par ses agents. D'autres progrès, suscités de même par l'observation et l'expérience, dérivent de celui-là: c'est la redevance en nature ou en argent qui remplace la redevance en travail, au double avantage du propriétaire et du corvéable; c'est le rachat partiel et finalement total de la redevance en nature ou en argent. L'ancien esclave se trouve alors affranchi des derniers liens de la servitude. Des progrès analogues s'accomplissent dans la condition des esclaves voués aux professions et aux arts industriels. Ces progrès sont même plus rapides, l'exercice des « arts et métiers » exigeant la mise en œuvre d'une somme d'intelligence supérieure à celle que demande la culture du sol, et ayant pour effet de développer davantage les facultés nécessaires au gouvernement de soi-même. Le seigneur trouve profit à se décharger du fardeau de l'entretien, de la direction et de la surveillance de ses ouvriers industriels lorsqu'ils sont capables de lui fournir régulièrement une redevance supérieure au produit net de l'exploitation de leur travail, et, de leur côté, les ouvriers trouvent plus d'avantage à travailler pour une clientèle, avec laquelle ils traitent de gré à gré, qu'à continuer à fournir exclusivement leurs produits au seigneur, aux conditions qu'il lui plaît de fixer. Comme les ouvriers agricoles, les ouvriers d'art ou de métiers forment des communautés ou corporations qui garantissent collectivement les redevances de leurs membres. En échange de leur garantie, le seigneur concède à ces communautés industrielles le droit exclusif d'exercer leur art ou leur métier et de vendre leurs produits dans l'enceinte de son domaine. A la longue, les redevances se rachètent, et le seigneur ou le souverain qui s'est substitué à lui cessant alors d'être intéressé au maintien du monopole nécessaire pour en [18] assurer le paiement, l'industrie et le commerce deviennent libres, malgré les efforts des corporations pour perpétuer un monopole qui a perdu sa raison d'être.
Or, à mesure que les hommes primitivement réduits en esclavage ont été affranchis des liens de la servitude, et qu'ils ont pu, par conséquent, conserver une part plus forte des fruits de leur travail, ils ont été excités davantage à produire et à perfectionner leur industrie, car ils profitaient eux-mêmes des progrès qu'ils réalisaient. Lorsque leur liberté est devenue plus complète, lorsque la plupart des branches de travail ont été ouvertes par la suppression du monopole des corporations, cette excitation s'est accrue sous l'impulsion d'une autre forme de la concurrence: la concurrence productive ou industrielle. La production s'est augmentée alors avec une rapidité auparavant inconnue, les produits, à commencer par ceux qui contenaient une grande valeur sous un petit volume, ont franchi les frontières du domaine seigneurial, et plus tard celles de l'état, et on a vu se créer un marché international d'échanges. Une ère nouvelle s'est ouverte dans la la vie de l'humanité. L'esclavage, le servage, les communautés, les corporations ont été autant d'étapes par lesquelles la multitude vouée aux travaux de la production a dû passer avant d'arriver à ce régime de liberté sous lequel l'homme est excité à développer au maximum ses forces productives, parce qu'il peut recueillir entièrement le fruit de son travail. Mais sans la servitude qui a intéressé les hommes de combat et de proie à la conservation des races paisibles d'hommes de labeur, celles-ci auraient-elles pu échapper aux périls qui menaçaient leur existence? Cette protection nécessaire leur a couté cher, sans doute, mais si élevé qu'en ait été le prix n'a-t il pas été inférieur à la valeur du service rendu?
En résumé, si l'on observe comment s'est opéré l'affranchissement des classes asservies, on trouve: 1° Que les classes propriétaires ont vendu la liberté aux classes asservies, lorsque l'observation et l'expérience ont démontré, aux unes et aux autres, que la liberté était plus productive que la servitude, [19] et par conséquent que celles-là en la vendant et celles-ci en l'achetant réalisaient un profit; 2° Que les classes propriétaires ont été d'autant plus empressées à conclure ce genre de marché, que la concurrence, sous sa forme primitive de guerre, leur rendait plus nécessaire l'augmentation de leurs forces et de leurs ressources. Telles ont été les causes économiques de l'abolition graduelle de la servitude. Les autres causes, telles que les révoltes d'esclaves ou de serfs, les libérations opérées sous l'influence de la politique, de la religion ou de la philanthropie n'ont agi que d'une manière secondaire pour amener ce résultat, et, le plus souvent, elles l'ont précipité au détriment des affranchis eux-mêmes.
III
Si nous examinons maintenant les résultats de ces progrès, réalisés sous la double impulsion des lois de l'économie des forces et de la concurrence, dans les arts de la destruction, du gouvernement et de la production, nous reconnaîtrons qu'ils ont concouru à mettre fin à la guerre, en établissant un ordre de choses dans lequel la guerre est devenue improductive et nuisible, après avoir été productive et nécessaire.
Commençons par les progrès réalisés dans l'art de la destruction. Nous avons constaté qu'entre les hommes primitifs et les grandes espèces animales qui occupaient le globe avant eux, la guerre était la forme la plus utile et la plus productive de la concurrence. C'était par la guerre seulement que les espèces concurrentes de l'homme pouvaient conserver leurs moyens de subsistance, c'est par la guerre que l'homme a pu détruire ou refouler ces espèces concurrentes et acquérir la propriété paisible du domaine nécessaire à l'exercice de son activité. Or, ce profit de la guerre aux espèces concurrentes pouvait être considéré comme illimité. De même, pour les hommes de combat et de proie qui avaient soutenu cette lutte et remporté la victoire au profit général de l'humanité, la guerre faite aux variétés de l'espèce les moins aptes à la [20] lutte, demeurait plus productive que ne l'eût été tout autre moyen de se procurer la subsistance. Le profit qu'elle rapportait augmenta encore lorsque les premiers progrès agricoles et industriels eurent rendu l'asservissement et l'exploitation de ces variétés inférieures en force et en courage plus avantageux que le pillage et l'anthropophagie. Alors, soit pour les tribus de chasseurs et de pillards restés à l'état de primitive sauvagerie, soit pour les tribus plus avancées qui exploitaient et préservaient de la destruction en les exploitant, les variétés paisibles et industrieuses de l'espèce, la guerre continuait d'être plus productive qu'aucune autre branche de travail. Aux chasseurs et aux pillards, la guerre pouvait procurer une masse d'approvisionnements et d'articles de nécessité ou de luxe, bien supérieure à celle qu'ils auraient obtenue dans l'état rudimentaire de leur industrie et avec leur défaut d'aptitude aux arts de la production, en échange de la même somme de travail et de peine. C'était, à la vérité, un mode d'acquisition des subsistances essentiellement aléatoire, mais qui n'en devait pas moins demeurer pour eux le plus productif de tous, aussi longtemps que les peuples en voie de civilisation ne possédèrent point une puissance défensive assez efficace pour les préserver sûrement des agressions et des razzias des barbares. A ces peuples plus avancés, la guerre avec les tribus sauvages ne rapportait point communément un profit direct, à moins qu'ils ne s'emparassent des régions occupées par les vaincus et ne les missent en exploitation, mais elle leur valait des profits indirects de deux sortes: elle sauvegardait leurs moyens d'existence, en empêchant le pillage et la destruction de leur exploitation, et ce profit pouvait encore être considéré comme illimite; elle conservait et développait par l'exercice les qualités physiques et morales qui leur étaient nécessaires pour soutenir des luttes inévitables et contribuaient à déterminer les progrès de l'art et de l'outillage de la guerre. — Entre les sociétés en voie de civilisation, la guerre n'avait pas alors une utilité moindre. Elle procurait au vainqueur un accroissement du [21] débouché de son industrie d'exploitation et de gouvernement, en augmentant l'étendue de son territoire et le nombre de ses esclaves ou de ses sujets. A la vérité, ce profit impliquait une perte pour le vaincu, et il pouvait arriver même que l'opération se soldât par une perte pour le vainqueur; mais si la guerre entre les peuples civilisés ne procurait pas toujours un profit direct, elle rapportait invariablement un profit indirect aux belligérants et même aux neutres, en ce qu'elle avait pour résultat d'exercer et d'améliorer les aptitudes et l'outillage nécessaires à leur défense. Ces aptitudes se seraient dégradées et perdues, cet outillage se serait rouillé ou tout au moins ne se serait point perfectionné dans une trop longue période de paix, comme a été par exemple la paix romaine, et une invasion de barbares belliqueux aurait mis brusquement fin à une civilisation devenue incapable de se protéger. Entre les sociétés civilisées, la guerre était un sport nécessaire, aussi longtemps que la civilisation était exposée aux invasions destructives du monde barbare.
Ce danger a été conjuré grace aux progrès que l'exercice de cette sorte de sport a déterminés, d'une part, dans l'art et l'outillage de la guerre, de l'autre, dans le gouvernement et l'industrie des sociétés en voie de civilisation.
A l'origine, c'étaient la vigueur et le courage physiques des combattants qui décidaient principalement la victoire. Ces qualités se rencontraient et se développaient plutôt parmi les hordes de chasseurs et de pillards que chez les nations adonnées aux travaux de l'agriculture et de l'industrie. Même, lorsque les variétés paisibles et industrieuses de l'espèce eurent été assujetties et protégées par des sociétés guerrières, le danger des invasions barbares subsista, et, presque toujours, ces sociétés amollies et rendues moins belliqueuses par l'abus des jouissances de la civilisation, finissaient par être vaincues et dépossédées. Il en alla ainsi jusqu'à ce que les progrès de l'art militaire et du matériel de guerre, et, en particulier, l'invention des armes à feu eussent fait passer la suprématie que procurait aux barbares la supériorité de leurs [22] qualités physiques, aux nations civilisées mieux pourvues de science, de capitaux et de force morale. Cette suprématie, après avoir été longtemps disputée, s'établit et se consolida à mesure que l'outillage de la guerre, en se perfectionnant, exigea plus de science et de capital dans sa construction, plus d'intelligence et de force morale dans sa mise en œuvre. Grâce à ce progrès qui diminuait et finalement supprimait les chances de profit des entreprises d'invasion et de conquête des peuples barbares sur le domaine de la civilisation, ces entreprises s'arrêtèrent, comme il arrive chaque fois qu'une industrie cesse d'être profitable. Les nations civilisées après être demeurées généralement sur la défensive, dans la portion limitée du globe où elles étaient retranchées, à l'abri de leurs forteresses, refluèrent peu à peu sur les régions occupées par les barbares et en commencèrent la conquête. Au moment où nous sommes, cette conquête est sinon achevée, du moins en voie de l'être. Les nations appartenant à notre civilisation sont maîtresses de l'Europe, de l'Amérique et de l'Océanie; elles possèdent la prépondérance en Asie et elles se partagent l'Afrique. Elles n'ont donc plus à redouter, comme autrefois, d'être expropriées et asservies par les barbares; elles exproprient et subjuguent les barbares. Le profit indirect qu'elles tiraient de la guerre à titre d'agent nécessaire de conservation a cessé ainsi d'exister.
Restent le second profit indirect provenant de l'excitation au progrès que produit toute concurrence, guerrière ou industrielle, et le profit direct que la guerre peut procurer à la nation victorieuse.
L'expérience démontre que le mobile de la peine et du plaisir sous l'impulsion duquel l'homme, comme l'animal, satisfait à ses besoins, est impuissant à produire, seul, l'excitation nécessaire au progrès. Il faut qu'à l'action de ce mobile de la loi de l'économie des forces se joigne la pression de la concurrence pour déterminer la production de l'effort inusité et extraordinaire qu'exige tout progrès. Mais la concurrence se manifeste sous deux formes, l'une destructive, c'est la [23] guerre; l'autre productive, c'est la concurrence industrielle. La guerre a pour objet de détruire le concurrent, en vue de monopoliser la subsistance au lieu de la partager avec lui, tandis que la concurrence industrielle se propose simplement pour but de le devancer dans l'acquisition de la subsistance. Nous avons reconnu que le premier de ces deux modes de concurrence était le plus profitable aux hommes de combat et de proie des temps primitifs, lorsqu'ils disputaient leur subsistance aux grandes espèces animales, et, plus tard encore, lorsqu'ils se disputaient entre eux, soit le gibier et les produits naturels du sol, qu'ils ignoraient l'art de multiplier, soit la possession et l'exploitation des populations industrieuses qu'ils avaient asservies. Nous ajouterons que la concurrence sous forme de guerre, était alors la seule possible.
La concurrence industrielle ne pouvait naître, en effet, qu'après que l'homme, s'élevant au-dessus de l'animalité, eut appris à multiplier les subsistances, en mettant le sol en culture et en produisant les autres articles nécessaires à la satisfaction de ses besoins. Mais, même alors, la concurrence industrielle se trouvait circonscrite dans un rayon étroit, et elle y était le plus souvent étouffée en germe. Les marchés où les producteurs des articles de consommation encore en petit nombre, se faisaient concurrence, étaient limitéstant par la difficulté naturelle des communications, que par les nécessités de la défense des états, et dans ces marchés resserrés, les concurrents trouvaient communément plus de profit à s'unir pour exploiter leur clientèle qu'à se la disputer. Dans cet état des choses, la concurrence industrielle n'apportait au progrès qu'un faible excitant, et la civilisation aurait couru le risque de s'immobiliser dans la routine, si la guerre n'avait point obligé les sociétés propriétaires des états à accroître leurs forces et leurs ressources, en perfectionnant, peu à peu, leurs procédés primitifs et grossiers de gouvernement et d'exploitation des populations assujetties. Garanties chaque jour plus sûrement contre l'invasion et le pillage, et affranchies successivement de la servitude, celles-ci ont été de plus en [24] plus excitées à produire et à perfectionner leurs procédés de production, tant par l'assurance de conserver une part plus forte du produit de leur travail, que par la concurrence que le développement de leur industrie faisait naître et grandir. D'abord confinée dans des marchés isolés et étroits où elle était le plus souvent enrayée par les privilèges ou les coalitions des producteurs, la concurrence industrielle s'est étendue sur une aire de plus en plus vaste, grâce aux progrès combinés de la sécurité, de la liberté et des moyens de production et de communication. A l'exception d'une minorité de professions et d'industries nationalisées ou monopolisées, toutes les branches de l'activité humaine subissent aujourd'hui sa pression salutaire. Elle donne partout la victoire aux plus capables, c'est-à-dire à ceux qui se conforment le plus diligemment à la loi de l'économie des forces, et elle remplace ainsi la guerre, comme stimulant du progrès.
Or, si l'on étudie le mode d'opération de la concurrence industrielle, on trouve qu'elle est un stimulant incomparablement moins coûteux que la guerre. Il suffit, pour s'en convaincre, de comparer les résultats des deux modes d'opération. Dans la guerre, les concurrents sont excités, sans aucun doute, au plus haut point, à développer et à mettre en œuvre toutes leurs forces et toutes leurs ressources pour remporter la victoire, mais cette victoire entraîne nécessairement la destruction ou la ruine partielle ou totale du vaincu. C'est une déperdition de forces inévitable, et par conséquent un dommage pour la généralité de l'espèce. Ce dommage peut être compensé et au delà par le profit qu'elle tire de l'excitation à acquérir et à accroître les forces requises pour la lutte, mais il ne diminue pas moins le profit. Dans la concurrence industrielle, la lutte n'implique nécessairement aucune déperdition de forces. Si tous les concurrents déploient une capacité et une activité égales, ils peuvent réaliser un profit égal, et, dans ce cas, le stimulant de la concurrence n'est acheté par aucune perte. Si même, ils déploient une capacité et une activité inégales, il se peut encore que cette [25] inégalité ait simplement pour conséquence une différence dans le taux de leurs gains, — les plus capables obtenant une récompense plus forte, une rétribution plus élevée que les moins capables. — Cependant, lorsque la concurrence a toute sa pression utile, les plus capables seuls, — ceux qui produisent avec le plus d'économie, — peuvent obtenir leur rétribution nécessaire; et, dans ce cas, les moins capables subissent une perte égale à la différence des frais de production des uns et des autres. S'ils persistent à concourir, ils s'exposent sans doute à la faillite et à la ruine; et il en résulte une déperdition de forces pour eux-mêmes et pour la généralité, mais cette perte, ils peuvent sinon l'éviter du moins la réduire, en abandonnant une industrie ou un emploi qui excède leur capacité et leurs ressources pour en exercer un autre qui n'exige qu'une capacité et des ressources inférieures. En résumé, la guerre est un stimulant au progrès qui implique toujours une déperdition de forces, tandis que le stimulant de la concurrence industrielle n'implique point nécessairement une perte et s'achète, en tout cas, au prix d'une perte moindre.
Reste enfin le profit direct que la guerre peut procurer. Si l'on veut se rendre compte des sources de ce profit et des causes qui l'ont successivement diminué, puis remplacé par une perte, il faut soumettre à l'analyse économique l'opération de la guerre. Toute guerre a ses frais de production et se solde par un profit, lorsque le produit de l'opération dépasse les frais, par une perte lorsqu'il demeure au-dessous.
Or, les frais de production de la guerre se sont accrus et s'accroissent tous les jours dans une proportion de plus en plus considérable, sous l'influence des progrès de l'art et de l'outillage de la guerre d'une part, de l'industrie et de la richesse de l'autre. Dans l'enfance de la guerre, on ne possédait pas les moyens d'organiser et de mettre en œuvre utilement de grands ateliers de destruction: les armées nombreuses étaient des masses confuses, dont venaient aisément à bout de petites troupes bien commandées, outillées et disciplinées. [26] Les progrès de l'art militaire, aidés des moyens rapides et presque instantanés de transmission des informations et des commandements, ont permis de manier aisément des multitudes armées et placé ainsi définitivement les probabilités de succès du côté du nombre. Ces multitudes, les progrès des sciences physiques, chimiques et mécaniques dans leurs applications à la guerre, les ont pourvues d'un matériel de plus en plus puissant et efficace. Enfin, l'accroissement extraordinaire de la production et de la richesse, depuis la naissance de la grande industrie, et, en particulier, le développement du crédit, ont donné les moyens de pourvoir à l'entretien, à l'armement et à la mise en opération de centaines de milliers et même de millions d'hommes. C'est, par milliards que se comptent désormais les frais de production d'une guerre entre les nations civilisées.
En dressant le bilan d'une guerre, il faut done évaluer d'abord les dépenses qu'elle a coûtées, ainsi que les dommages qu'elle a causés, et rechercher par qui les unes ont été payées et les autres supportés, ensuite faire le compte de ses produits et de leur répartition. Les dépenses et dommages consistent: 1° Dans l'entretien, le transport, la destruction ou l'usure du personnel et du matériel des armées; 2° Dans l'intérêt et l'amortissement du capital levé par voie d'impôt ou d'emprunt, pour faire l'avance des frais des opérations militaires; 3° Dans la perte causée par le manquement aux emplois productifs des hommes requis et des capitaux levés pour la guerre; 4° Dans les déprédations et les ravages commis par les armées; 5° Dans la crise générale que toute guerre entre les peuples civilisés occasionne par les craintes qu'elle suscite et la perturbation qu'elle jette dans la multitude croissante des branches de la production, en surexcitant temporairement les unes, en déprimant les autres. Ces dépenses et ces dommages sont supportés ordinairement dans une proportion presque égale par les belligérants; en outre quelques-uns et non les moindres, ceux qui résultent du détournement des travailleurs et des capitaux des emplois productifs, ainsi que [27] de la crise de guerre se répercutent sur les neutres. C'est une perte qui s'augmente pour la nation vaincue de la contribution en territoire ou en argent qu'elle paie à la nation victorieuse. En quoi consistent les produits de l'opération pour la nation victorieuse et comment se distribuent-ils? Ils consistent matériellement dans la contribution payée, moralement, dans l'ascendant et la satisfaction que procurent la victoire. Or, tels sont les frais de production des guerres modernes qu'aucune contribution si élevée qu'elle soit, ne peut suffire à les couvrir, et que toute guerre se solde par une perte matérielle pour le vainqueur lui-même. La satisfaction et l'ascendant moral ne sont pas susceptibles d'évaluation, mais si l'on songe combien la satisfaction est fugitive et l'ascendant précaire, on se convaincra qu'ils ne valent pas ce qu'ils coûtent.
Ainsi, après avoir été la plus productive des industries, après avoir procuré, en sus des profits directs qu'en tirait le vainqueur, des bénéfices indirects qui compensaient et au delà les pertes qu'elle infligeait aux neutres et an vaincu lui-même, la guerre a cessé aujourd'hui de couvrir ses frais. Elle se solde par une perte directe qui est supportée par le vaincu, les neutres et le vainqueur lui-même, et qui n'est plus compensée par aucun bénéfice indirect. Car le monde civilisé n'est plus menacé par le monde barbare et la concurrence industrielle est un stimulant au progrès moins coûteux que la guerre.
Ce changement radical dans les effets de la concurrence sous sa forme destructive deviendra plus sensible encore si l'on examine l'influence désastreuse que la continuation de l'état de guerre exerce aujourd hui sur le monde civilisé.
IV
Les pertes et dommages causés par la guerre ne se produisent pas seulement pendant sa durée; ils se perpétuent dans la paix. Quoique la guerre ait cessé, depuis deux ou trois siècles d'être nécessaire à la sécurité du monde civilisé, [28] les nations entre lesquelles il se partage ne se sont pas bornées à conserver leurs armements, elles les ont, pour la plupart, continuellement accrus et elles persistent à s'imposer les servitudes et à pratiquer les unes à l'égard des autres, la politique adaptée à l'état de guerre. On pourrait faire un calcul approximatif de ce qu'ont coûté, dans cette période de l'histoire, la construction et l'entretien des forteresses, le personnel et le matériel des armées, et dresser le bilan de chacune des guerres inutiles qui ont désolé le domaine de la civilisation, mais ce qu'il serait impossible d'évaluer, ce sont les pertes et dommages causés par les servitudes et la politique de l'état de guerre, sans parler des crises qu'engendre périodiquement l'appréhension plus au moins fondée de la rupture de la paix.
Malgré tant de progrès qui ont multiplié les rapports pacifiques des nations civilisées et associé leurs intérêts, l'organisation politique, administrative et financière des états, aussi bien que leur politique intérieure et extérieure sont demeurées, au moins en grande partie, adaptées à l'état de guerre, et déterminées par les nécessités qu'il implique. La première de ces nécessités c'est la conservation et l'accroissement de la puissance militaire de la nation. Les éléments de la puissance militaire consistent d'abord dans une population nombreuse et bien pourvue des qualités et des aptitudes de combat, ensuite dans l'abondance de ses capitaux, l'étendue et la solidité de son crédit. Ce dernier élément a acquis même une importance prépondérante depuis que les progrès de l'art et de l'outillage de la guerre ont accru, dans des proportions énormes, les avances nécessaires pour recruter, instruire, outiller, approvisionner et mettre en œuvre, ces colossales machines de destruction que sont devenues les armées modernes. Mais il ne suffit pas qu'une nation possède en abondance ces éléments de la puissance militaire, il faut encore que le gouvernement chargé de pourvoir à sa sécurité puisse en disposer sans résistance ni délai, qu'il soit le maître d'exiger, au besoin, qu'elle lui livre jusqu'à son dernier homme et son [29] dernier écu, et qu'il possède les moyens de l'y contraindre. Ce pouvoir souverain et ces moyens de contrainte efficace et rapide, le despotisme et la centralisation seuls peuvent les fournir. C'est pourquoi le despotisme et la centralisation sont les institutions fondamentales du régime adapté à l'état de guerre. Ce régime implique encore l'établissement d'une série de servitudes qui restreignent la liberté des individus et placent les personnes et les propriétés à la disposition du pouvoir souverain. Sans doute, en abusant du pouvoir de restreindre la liberté des individus et d'appesantir sur leurs propriétés le fardeau des taxes, un gouvernement court le risque de décourager l'initiative et l'activité industrieuse de la population, de ralentir l'accroissement de ses ressources et par là même d'affaiblir la puissance militaire de l'état. Mais, d'un autre côté, s'il laisse libre carrière à l'esprit d'examen et d'opposition, s'il autorise la constitution de partis hostiles, ou même de groupes d'intérêts assez forts pour lui résister, s'il s'abstient d'assujettir la population au fardeau et aux gênes de la conscription et de la taxation, s'il n'accoutume point, pour tout dire, la nation à être menée comme un régiment, il s'expose, le risque de guerre venant à échéance, à ne point trouver chez elle l'obéissance passive qui est la condition nécessaire du succès. Sous le régime de l'état de guerre, toutes les libertés individuelles et, en particulier, la liberté de la parole, de la presse, de l'association, de la propriété doivent être limitées par des servitudes qui assurent au gouvernement, chargé du salut commun, avec l'obéissance des esprits, la disposition entière des forces et des ressources de la nation. La conservation de son pouvoir souverain, le maintien et au besoin l'augmentation des servitudes indispensables à l'exercice de ce pouvoir, tel est l'objectif essentiel de la politique intérieure des gouvernements aussi longtemps que la guerre s'impose à eux comme une nécessité. Et c'est parce que les populations ont le sentiment que cette nécessité a cessé d'exister qu'elles subissent avec une impatience croissante ces servitudes qu'elles acceptaient jadis avec docilité.
[30]
La politique extérieure adaptée à l'état de guerre a pour objet l'augmentation de la puissance de la nation, et, autant que possible, l'affaiblissement de celle des nations concurrentes. Ce but implique d'abord la nécessité de conclure des alliances politiques et militaires avec certaines puissances et de semer la division parmi les autres; ensuite de rendre la nation indépendante de l'étranger en concentrant et en développant chez elle, au moyen d'un système de fortifications contre l'industrie des autres nations, toutes les branches essentielles de la production, et, en particulier, celles qui pourvoient à sa subsistance et à son armement. Tel a été, à l'origine, l'objet de l'établissement du système protecteur, qu'une observation superficielle a fait attribuer à un simple préjugé économique.
Comme la plupart, on pourrait dire même comme toutes les institutions du passé, ce système a eu sa raison d'être, et s'il subsiste encore, après l'avoir perdue, cela tient aux causes qui ont prolongé artificiellement l'existence de l'état de guerre, depuis que la nécessité de la guerre a disparu.
Nous avons remarqué qu'aux premières époques de la civilisation, les échanges se trouvaient, en presque totalité, concentrés dans l'intérieur de chaque état politique. Le commerce extérieur ne consistait qu'en un petit nombre d'articles de luxe que ne produisaient point les populations des pays importateurs. L'interruption des communications en temps de guerre ne les privait done point des produits nécessaires à leur subsistance ou à leur défense, et ne causait qu'un dommage limité aux producteurs peu nombreux des articles d'échange, et une faible privation aux consommateurs. Mais à mesure que l'industrie se développa et que les communications devinrent plus faciles, le commerce déborda de plus en plus des frontières des états et il s'étendit à une plus grande variété d'articles. Alors se manifesta l'incompatibilité naturelle du commerce extérieur avec la guerre. Si les nations incessamment exposées à la guerre avaient commis l'imprudence d'acheter à l'étranger, au lieu de les produire elles-mêmes, [31] les articles nécessaires à leur subsistance et à leur défense, l'interruption des communications, qu'il est dans la nature de la guerre de causer, n'aurait pas manqué de compromettre leur alimentation et leur sécurité. Il pouvait, en conséquence, être utile d'empêcher cette sorte de commerce de naître et de se développer pendant les intervalles de paix. Cet empêchement les obligeait, à la vérité, à payer plus cher les articles que les producteurs étrangers leur fournissaient à meilleur marché que les producteurs nationaux, mais la différence se résolvait en une prime d'assurance de leur subsistance et de leur sécurité, et dans un état de guerre presque continuel cette prime demeurait inférieure au risque qu'elle avait pour objet de couvrir. D'un autre côté, le système protecteur suscitait la création ou le développement d'industries qui fournissaient de l'emploi, des profits et des salaires au capital et au travail disponibles, à une époque et dans des circonstances où l'étranger ne leur offrait qu'un débouché peu accessible et peu sûr. Si les restrictions opposées au commerce extérieur diminuaient la production générale des articles de consommation, elles augmentaient, du moins à l'origine, la production intérieure de ces articles. Ceci, en sus de la sécurité qu'elles assuraient à la nation, en cas de guerre. Enfin, il pouvait être avantageux d'interdire l'exportation des produits nécessaires à l'armement des états concurrents ou à la subsistance de leurs populations, si cette interdiction leur causait un affaiblissement ou un dommage supérieur à la perte ou au manque à gagner qui en résultait pour les producteurs nationaux. La politique commerciale dont le système protecteur était l'instrument servait ainsi d'auxiliaire à la politique de l'état de guerre. Elle n'excluait pas cependant les alliances commerciales ou les traités de commerce, mais elle les subordonnait aux alliances politiques. On accordait, par ces traités, un régime de faveur à l'industrie des nations amies, avec lesquelles on voulait resserrer ses rapports politiques par une communauté plus étroite d'intérêts, non toutefois sans réciprocité, c'est-à-dire sous la condition d'obtenir [32] chez elles des faveurs analogues, et, s'il se pouvait même, plus grandes. Car ces faveurs étaient considérées comme des sacrifices que s'imposaient les nations qui les accordaient et elles l'étaient, en effet, dans quelque mesure. Si elles permettaient aux consommateurs d'acheter à meilleur marché les articles favorisés, elles infligeaient un dommage aux producteurs indigènes de ces articles, qui étaient désormais obligés de partager le monopole du marché national avec leurs concurrents de la nation avantagée. Quand l'alliance politique venait à se rompre, on ne renouvelait point le traité de commerce, ou bien encore on le déplaçait avec l'alliance.
Le résultat général de ce système était certainement d'augmenter les charges de l'ensemble des peuples civilisés et de diminuer leur puissance productive. Il augmentait leurs charges, en obligeant les consommateurs à payer aux producteurs investis du monopole du marché national et à leurs co-partageants des nations alliées un prix plus élevé que celui qu'ils auraient payé si le commerce avait été libre; il faisait obstacle aux progrès de l'industrie, en limitant artificiellement l'étendue de son marché et en l'excitant à se placer dans des conditions moins favorables à son développement économique, il émoussait l'aiguillon de la concurrence, enfin il exposait toutes les branches de la production à un risque artificiel d'instabilité qui venait à échéance chaque fois que le régime douanier d'une des nations en relations d'affaires était modifié, dans un sens restrictif ou même libéral. Mais l'état de guerre imposait aux populations bien d'autres fardeaux et d'autres dommages, et ceux que leur infligeait le système protecteur en échange de la sécurité qu'il contribuait à leur assurer, et de l'emploi qu'il procurait à l'excédent de leurs capitaux et de leur travail, n'étaient pas les plus lourds.
Cependant, en dépit des restrictions nécessitées par l'état de guerre, la sphère des échanges s'est agrandie, et elle a dépassé, chaque jour davantage, les frontières de chaque état particulier. L'accroissement de sécurité résultant de [33] l'augmentation de la puissance défensive et offensive du monde civilisé, manifestée par l'extension de ses conquêtes et de sa domination sur le monde barbare, la diminution sensible des périodes de guerre, devenues moins longues désormais que les périodes de paix, les progrès extraordinaires qui ont donné naissance à la grande industrie et aplani l'obstacle naturel des distances, ont eu pour résultat de décupler depuis un siècle la masse des échanges internationaux. Il s'est créé, à travers toutes les frontières politiques et douanières, un « état économique » où chaque nation apporte son contingent à léchange. Dans cet état nouveau qui s'étend sur la plus grande partie du globe et qui finira par l'embrasser tout entier, les produits, les capitaux et le travail circulent, pour s'échanger, les uns contre d'autres produits, les autres contre un profit, un intérêt ou un salaire. Les produits manufacturés des grandes nations industrielles de l'Europe, les produits agricoles des autres nations, les céréales des Etats-Unis, de la Russie, de l'Inde, les laines de la Plata, du Cap, de l'Australie, les cafés du Brésil, des Antilles, des îles de l'océan Indien, les capitaux anglais, français. hollandais, suisses, les travailleurs anglais, allemands, italiens, indous, chinois, pour ne citer que les principaux éléments de l'échange international, se répandent en masses croissantes dans cet immense marché que le progrès leur a rendu accessible. Dans ce nouvel état des choses, les nations ont cessé d'être indépendantes de l'étranger; mais la solidarité d'intérêts que les échanges ont établie entre elles, les préserve gratuitement du péril contre lequel le système protecteur les garantissait à grands frais en les obligeant à produire elles-mêmes, parfois en quantité insuffisante et à haut prix, les articles de première nécessité que les autres nations pouvaient leur fournir en abondance et à bon marché. L'Angleterre, par exemple, reçoit de l'étranger, depuis l'abolition des corn laws la moitié de la quantité totale des denrées nécessaires à la subsistance de sa population. Ces denrées lui sont fournies par quarantecinq nations différentes. Supposons qu'une guerre éclate [34] entre elle et quelque grande puissance militaire et navale, ses approvisionnements n'en seront point compromis. Si son adversaire émettait la prétention d'interrompre son commerce par un blocus des Iles britanniques, les nations qui lui vendent des denrées alimentaires et lui achètent, en échange, des produits manufacturés, seraient intéressées à se liguer pour conserver un commerce duquel dépendent chez elles les moyens d'existence de plusieurs millions d'individus. La sécurité des approvisionnements de l'Angleterre se trouve donc assurée en cas de guerre par la solidarité d'intérêts que son commerce extérieur a établie entre elle, ses fournisseurs et ses clients, et cette assurance gratuite sera d'autant plus complète et efficace que ce commerce acquerra plus d'importance. Or, en entravant et en retardant le développement des relations internationales, sans pouvoir toutefois les empêcher de naître et de croître, que fait le système protecteur? Il fait obstacle à la création et à l'extension de cette solidarité d'intérêts qui le remplace économiquement comme un agent de sécurité. Au moment où nous sommes, ce sont les nations dont le commerce extérieur est le moins développé qui courent en cas de guerre le plus de risques de voir interrompre leurs relations avec l'étranger, car leurs fournisseurs et clients des pays neutres ne sont que faiblement intéressés à empêcher cette interruption.
De même, après avoir contribué à assurer, au prix du renchérissement artificiel des articles de consommation protégés, un débouché aux capitaux et au travail disponibles, le système protecteur est devenu, dans le nouvel état de choses, que l'extension du marché international a créé pour les produits, les capitaux et le travail, un obstacle au progrès et au développement de l'industrie, et une cause d'appauvrissement et de décadence des nations qui persistent à le maintenir.
Dans l'ancien état des choses, le renchérissement des articles de consommation occasionné par le système protecteur avait une double compensation: 1° Dans la sécurité des approvisionnements que procurait l'indépendance de l'étranger à [35] une époque où le commerce extérieur ne pouvait s'étendre assez pour solidariser d'une manière efficace les intérêts des nations; 2° Dans l'emploi qu'il assurait aux capitaux et au travail disponibles, en réservant le marché intérieur aux produits de l'industrie indigène. Nous venons de voir que la sécurité des approvisionnements est assurée aujourd'hui, sans frais, par les liens de solidarité que crée le commerce extérieur, devenu indéfiniment extensible; en sorte qu'en ralentissant l'extension des rapports d'intérêts internationaux, le système protecteur agit plutôt comme un obstacle à la sécurité des approvisionnements. De même, il agit pour diminuer les emplois ouverts aux capitaux et au travail au lieu de les accroître. S'il réserve le marché intérieur à l'industrie indigène, il lui rend en effet le marché étranger de moins en moins accessible. A l'époque où le débouché extérieur n'avait qu'une faible importance et ne s'accroissait qu'avec une extrême lenteur, la perte ou le manque à gagner que l'industrie indigène subissait de ce chef était insignifiant en comparaison du gain qui lui valait la jouissance exclusive du marché intérieur. La possession entiè re de ce marché lui permettait d'ouvrir aux capitaux et au travail disponibles un débouché plus large qu'elle n'aurait pu le faire si elle l'avait partagé avec l'industrie étrangère. Mais la situation a changé du tout au tout depuis que l'accroissement de la sécurité extérieure, les progrès de l'industrie et le développement des moyens de communication ont accru dans des proportions auparavant inconnues l'importance du marché international. Sur ce marché où toutes les nations offrent concurremment leurs produits, lesquelles ont le plus de chances de l'emporter sur leurs rivales? Celles qui produisent au meilleur marché, c'est-à-dire de la manière la plus conforme à la loi de l'économie des forces. Or, le système protecteur a, d'une part, pour effet d'affaiblir la pression de la concurrence, en réservant à l'industrie un marché où la concurrence extérieure n'a point accès ou n'arrive que ralentie par le poids des droits et des formalités de la douane, et par conséquent d'exonérer les [36] industriels de la nécessité de réduire leurs frais de production, en perfectionnant leurs procédés et leur outillage; d'une autre part, il augmente les prix de revient de tous les produits de l'industrie en renchérissant les matériaux et les agents de la production. Il place, en conséquence, sur le marché international, les industries des nations protectionnistes dans une situation d'infériorité vis-à-vis des industries concurrentes des nations libre-échangistes, et les expose à être expulsées de ce marché. Mais des industries, condamnées à un arrêt de développement par la limitation de leur débouché, ne peuvent fournir aux capitaux et au travail une rétribution aussi élevée que celle qu'ils trouvent dans les industries dont le marché est illimité. Au lieu d'attirer les capitaux et le travail disponibles, le système protecteur, dans ce nouvel état des choses, agit au contraire pour les repousser, en les faisant affluer et avec eux la population et la richesse dans les contrées où le progrès industriel n'est point enrayé par la limitation de la concurrence et l'exhaussement artificiel des frais de production.
C'est ainsi que les institutions politiques, économiques et autres adaptées à l'état de guerre, et dont le maintien était nécessaire aussi longtemps que la guerre elle-même était indispensable à la sécurité du monde civilisé, menacé par les invasions du monde barbare, ont perdu leur raison d'être et sont devenues des obstacles à l'accroissement des forces et du bien-être de l'espèce humaine. On pourrait les comparer aux fortifications qui entouraient tous les foyers de population, aux époques où la sécurité n'existait qu'imparfaitement dans l'intérieur des états en voie de civilisation. Autant ces fortifications étaient nécessaires et bienfaisantes, malgré les frais et les gênes qu'elles occasionnaient, autant il eut été imprudent de les démolir, autant, lorsque la sécurité intérieure eut été établie, elles sont devenues nuisibles à la prospérité et au développement des cités qu'elles protégeaient auparavant. Celles qui se sont néanmoins obstinées à les conserver, ou auxquelles on en a imposé la conservation ont [37] été délaissées pour les villes ouvertes, et les mêmes appareils de défense qui sauvegardaient leur existence et leur richesse, ont causé leur abandon et leur ruine.
V
Nous venons de voir par quel processus de progrès, la guerre est devenue, de nécessaire et productive qu'elle était à l'origine, nuisible et improductive. Comment donc s'expliquer qu'elle continue à subsister et même qu'elle semble, au moment où nous sommes, plus que jamais menaçante?
La raison de ce phénomène est facile à découvrir. Les idées et les sentiments de l'homme sont déterminés par les faits qui gouvernent son existence. Lorsque ces faits viennent à changer, il lui faut toujours un certain temps pour reconnaître ce changement et y adapter ses idées et ses sentiments. Cette reconnaissance et cette adaptation sont d'autant plus lentes que les faits sont plus anciens et qu'ils semblent ainsi avoir un caractère d'immuabilité. Tel est le phénomène de la guerre. Depuis son origine, et pendant des milliers d'années, l'humanité a vécu sous le régime de l'état de guerre. Elle s'est accoutumée à l'idée que la guerre resterait toujours ce qu'elle avait été de tout temps: inévitable et nécessaire; qu'elle était inhérente à la nature de l'homme et, pour tout dire, d'institution divine. Les sentiments sont restés à l'unisson des idées. Pendant ces milliers d'années, la guerre a développé entre les hommes qu'elle mettait aux prises des sentiments d'hostilité qui ne pouvaient disparaître d'une manière instantanée. Il est dans la nature de l'homme, comme de toutes les créatures vivantes, de haïr ceux qui lui font du mal et d'aimer ceux qui lui font du bien. Or, dans l'état de guerre, le profit du vainqueur provient du dommage qu'il inflige au vaincu. La haine de l'ennemi, c'est-à-dire de celui qui cause ou veut causer un dommage pour en profiter, surgit donc comme une conséquence naturelle de la guerre. Et cette haine, elle-même, est utile, en ce qu'elle porte au plus haut [38] point l'excitation à employer toutes les forces et à s'imposer tous les sacrifices nécessaires pour vaincre, subjuguer ou détruire l'ennemi. Pour que la sympathie succède à la haine, il faut que l'opposition des intérêts que l'état de guerre a créée entre les peuples soit remplacée par la communauté des intérêts; il faut que les peuples, unis et solidarisés par les liens multiples de l'échange, soient intéressés non plus à l'affaiblissement et à l'appauvrissement les uns des autres, mais à leur prospérité mutuelle. Cependant les liens de l'échange ne s'improvisent pas, et leur accroissement n'a pas cessé d'être entravé par les servitudes et les restrictions imposées par l'état de guerre. Leur influence ne s'exerce encore, avec quelque ênergie, que sur la partie de la population dont les intérêts sont directement internationalisés; la multitude a conservé ses sentiments séculaires de méfiance et d'hostilité à l'égard de l'étranger, et ces sentiments, devenus nuisibles après avoir été utiles, sont incessamment ravivés par les excitations d'une classe demeurée prépondérante, qui tire profit de l'état de guerre et se croit intéressée à le perpétuer.
Il faut remarquer, en effet, qu'en dépit des progrès qui ont modifié plutôt en apparence qu'en réalité les institutions politiques adaptées à l'état de guerre, la population de tous les états civilisés a continué d'être partagée en deux classes: l'oligarchie gouvernante et la multitude gouvernée. L'oligarchie gouvernante se compose principalement des familles au sein desquelles s'est recruté depuis un temps immémorial et à travers toutes les révolutions, le personnel militaire, politique et administratif des états. Ce personnel, comme tout autre, est immédiatement intéressé à conserver et à accroître le débouché d'où il tire ses moyens d'existence, et ce débouché ne peut être sauvegardé et accru que par le maintien de l'état de guerre. C'est l'expectative toujours menaçante d'une guerre qui provoque le développement continu des armements et par conséquent l'extension du débouché ouvert aux familles, en possession de fournir la hiérarchie militaire à appointements, depuis le sous-lieutenant jusqu'au général. [39] La guerre survenant, l'avancement devient plus rapide, la solde s'élève, les campagnes comptent double dans le règlement des pensions. De leur côté, les politiciens qui gouvernent l'état voients' augmenter leur puissance et se consolider leur situation. En temps de guerre, le gouvernement est investi d'un pouvoir dictatorial, et ce pouvoir, en supprimant toute opposition, assure la possession de ceux qui le détiennent. Le monde administratif a sa part dans cet accroissement de puissance et de sécurité. En outre, lorsque la guerre est heureuse, — et on se flatte toujours qu'elle le sera, — le débouché des fonctionnaires s'élargit et devient plus productif; ils débordent dans le pays conquis, et ils y récoltent une moisson supplémentaire de profits et de prestige. A ces catégories d'intéressés au maintien de l'état de guerre, viennent se joindre les financiers, intermédiaires des emprunts, les industriels, fournisseurs des armées, avec leurs attenants et leurs subordonnés. C'est dans cette partie de la nation que subsistent les idées et les sentiments adaptés à l'état de guerre: c'est elle qui les entretient dans la multitude, en identifiant le patriotisme avec la haine de l'étranger.
Cette oligarchie dont les intérêts sont attachés à l'état de guerre n'est qu'une minorité sans doute, mais sa puissance et son influence ne se mesurent pas à son nombre. Comme elle est en possession du gouvernement, même dans les états réputés démocratiques, elle possède le pouvoir de déchaîner la guerre et de contraindre la nation tout entière à y contribuer. En vain, la nation voudrait conserver la paix; en vain elle répugnerait à envoyer ses enfants à l'abattoir des champs de bataille et à supporter les frais d'une entreprise de destruction, désormais frappée de stérilité, elle se trouve prise dans les engrenages du mécanisme de centralisation dictatoriale, adapté à l'état de guerre, et obligée de livrer à ceux qui le mettent en œuvre ses ressources et sa chair. Peut-être ses répulsions seraient-elles plus difficiles à vaincre si l'on exigeait d'elle la totalité du capital que la guerre dévore, mais, grâce au développement du crédit public, la plus grande [40] partie de ce capital est communément fournie par des emprunts dont la dépense lui profite tandis que le poids en est principalement supporté par les générations futures.
Cependant, il est dès à présent visible qu'entre ces deux catégories d'intérêts en lutte, la victoire, maintenant encore indécise, finira par se fixer du côté des intérêts pacifiques.
A ne consulter que les apparences actuelles, il en serait tout autrement. Depuis un demi-siècle, notre vieux monde est devenu un vaste camp. Toutes les nations de l'Europe se tiennent sur le pied de guerre: loin de disparaître, la servitude militaire s'est étendue à tous les hommes capables de supporter le poids d'une arme, tandis que les budgets de la guerre vont grossissant chaque jour. Mais c'est le propre des intérêts qui se sentent menacés d'employer ce qu'ils ont de pouvoir et d'influence à soutenir ce qui est près de tomber, et l'extension effrénée du militarisme pourrait être à bon droit considérée comme un signe de sa fin prochaine. Il est permis de craindre sans doute que l'état de guerre ne disparaisse point sans une dernière et cruelle convulsion, mais la violence même de cette convulsion et l'énorme sacrifice de capitaux et de vies que les progrès réalisés dans l'art et le matériel de la destruction ne manqueront pas d'infliger aux nations engagées dans la lutte, détermineront une réaction universelle contre un régime qui est devenu le fléau du monde civilisé après en avoir été le salut.
D'ailleurs, quoi qu'il arrive, deux causes agissent, avec une intensité croissante, pour mettre fin à ce régime. La première, mais à la vérité celle sur laquelle il faut le moins compter, c'est la conversion de la classe dirigeante à la réforme des institutions et des pratiques adaptées à l'état de guerre. Si aveuglée qu'elle soit par ses intérêts actuels et immédiats, cette classe ne peut, sans quelque inquiétude, envisager l'avenir. Les nations sur lesquelles s'appesantit le lourd fardeau du militarisme et du protectionnisme ne serontelles pas tôt ou tard devancées dans l'arène de la concurrence économique, et leur décadence n'entraînera-t-elle pas celle [41] de leur oligarchie gouvernante, sans parler du danger grandissant de subversion dont elle est menacée par la multitude que ce fardeau accable?
La seconde cause, et celle-ci la plus puissante, qui agit pour mettre fin à l'état de guerre, c'est l'accroissement continu des échanges internationaux. Ils ont décuplé depuis un siècle. Ils décupleront encore. En vain, on leur oppose l'obstacle artificiel des barrières douanières, les progrès généraux de l'industrie et les progrès particuliers des moyens de communication aplanissent tous les jours dans une mesure plus forte et d'une manière définitive, les obstacles naturels qui empêchaient leur développement. Dejà, au moment où nous sommes, la moitié de la population de l'Angleterre dépend de l'étranger pour ses moyens d'existence, et toutes les autres nations civilisées se trouvent, à des degrés divers, sous la même dépendance. D'ici à un siècle, cette communauté et cette solidarité d'intérêts que le commerce des produits, des capitaux et du travail est en voie d'établir entre tous les peuples aura réalisé de nouveaux progrès et rendu encore plus nécessaire la permanence de la paix. Les jours de l'état de guerre sont désormais comptés, et il deviendra aussi impossible de le maintenir qu'il l'eût été de le supprimer, pendant la longue série de siècles où il a été nécessaire. Au règne de la concurrence politique et guerrière succèdera celui de la concurrence économique. Après avoir passé par une longue et douloureuse période de guerre et de servitude, l'humanité entrera dans une période de paix et de liberté.
VI
En étudiant ce processus de la civilisation, on peut se rendre compte de l'ordre chronologique naturel dans lequel sont nées et se sont développées toutes les sciences et, en particulier, les sciences politiques et morales. Chacune s'est produite dès qu'elle a été « demandée », c'est-à-dire dès que le besoin a commencé à s'en faire sentir. La science de [42] la constitution des sociétés et des gouvernements apparaît la première; elle répond à la nécessité manifeste où se trouvaient les individualités humaines de s'associer pour se défendre contre leurs concurrents plus forts et mieux armés de l'animalité inférieure. Mais leurs associations ne pouvaient atteindre le but essentiel en vue duquel elles s'étaient formées qu'à une condition: c'était de combiner les forces des associés et de les diriger de manière à en obtenir un maximum d'effet utile. Car, lorsque chacun combattait à sa guise, sans obéir à un commandement et à une discipline, suivant le mode préconisé de nos jours par les anarchistes, l'expérience démontrait que le risque de défaite et de destruction s'élevait au plus haut degré. Les individualités les plus intelligentes s'ingénièrent alors à chercher le moyen de diminuer ce risque et elles découvrirent, probablement par l'observation des sociétés animales, que ce moyen consistait dans l'institution d'un gouvernement chargé d'ordonner et de diriger les forces de l'association. L'art de constituer ce gouvernement, et, lorsqu'il était constitué, l'art de combiner et d'employer les forces dont il avait la direction, ces deux arts de première nécessité, — car la conservation de la vie des associés en dépendait, — devaient donc naître les premiers, et, à l'origine, ils ne pouvaient être qu'empiriques. La pratique seule pouvait faire découvrir les règles qui leur étaient propres, et la connaissance de ces règles fut l'objet des sciences de la politique et de la guerre. Après avoir ainsi engendré la science, l'art devint l'application des règles utiles qui formaient la matière de la science. Cependant, il ne suffisait pas de constituer un gouvernement et une armée et de les mettre en œuvre pour préserver la société des périls extérieurs qui menaçaient son existence, à laquelle celle de chacun de ses membres se trouvait attachée, il fallait encore que les associés ne tournassent point, sous l'impulsion de leurs intérêts égoïstes ou de leurs passions désordonnées, leurs forces les uns contre les autres, il fallait, au contraire qu'il s'établit parmi eux un régime de concorde et d'assistance mutuelle. Or ce [43] régime nécessaire à la conservation de l'association et des associés ne pouvait s'établir que par la mise en œuvre de certaines pratiques et l'exclusion de certaines autres. Ces pratiques utiles ou nuisibles à l'association, partant à ses membres, l'observation empirique les faisait d'abord reconnaître, et l'expérience confirmait ensuite leur caractère d'utilité ou de nuisibilité. Il fallait autoriser et encourager les pratiques utiles, interdire les pratiques nuisibles et rendre cette interdiction efficace. Ce fut l'objet d'un nouvel art: l'art de la législation et de la morale qui institua avec les règles de conduite imposées à chacun dans l'intérêt commun, les sanctions de ces règles: règles et sanctions s'investirent dans les lois ou les coutumes, et devinrent la matière des sciences du droit et de la morale.
A ces sciences nées de la pratique des arts de la politique et de la guerre, ainsi que des rapports du gouvernement avec les membres de la tribu ou de la nation et de ceux-ci entre eux, s'en joignirent d'autres, à mesure que se produisaient des phénomènes nouveaux qui faisaient surgir le besoin de pratiques nouvelles. Tel fut, par exemple, le droit des gens, lorsque les sociétés, tribus ou nations, d'abord isolées commencèrent à entrer en relations, à conclure des alliances politiques et des traités de commerce. Alors, les règles du droit et de la morale qui ne s'appliquaient primitivement qu'aux membres de la société, furent appliquées à ceux des sociétés alliées, l'expérience ayant démontré que les rapports d'alliance, de paix et d'assistance réciproque ne pouvaient subsister qu'à cette condition. Toutefois, cette extension des règles du droit et de la morale à des étrangers ne durait qu'autant que les rapports qui l'avaient rendue nécessaire continuaient d'exister. La rupture des alliances ou des traités déterminait le retour à l'état de choses primitif, dans lequel l'étranger, considéré comme un ennemi naturel, se trouvait hors la loi. A la suite des temps, l'observation et l'expérience démontrèrent encore l'utilité d'appliquer, au moins d'une manière partielle, le droit et la morale en vigueur dans la société, aux [44] étrangers inoffensifs, et lorsque le commerce eut commencé à s'étendre et à internationaliser les intérêts, on vit apparaître la tendance à les universaliser. Enfin, l'expérience démontra l'utilité de les appliquer à la guerre elle-même. Ainsi naquirent les « usages de la guerre » consistant dans un ensemble de règles morales reconnues conformes à l'intérêt des belligérants et qui constituèrent la science du droit des gens en temps de guerre.
L'économie politique, c'est-à-dire la connaissance des phénomènes de la production, de la distribution et de la consommation des richesses et des lois naturelles qui régissent ces phénomènes, apparut et devait apparaître seulement après les sciences du gouvernement, de la guerre, du droit et de la morale. Car les sociétés humaines, comme les sociétés animales ont commencé par se livrer à des industries purement destructives; et, plus tard, lorsque l'outillage primitif de la production, eût été inventé, les sociétés les plus fortes se proposèrent pour objectif d'asservir les plus faibles et de les exploiter comme un bétail. Cependant, de même que la constitution des sociétés, le gouvernement et la guerre ont leurs règles, l'exploitation a les siennes. Ces règles, les sociétés gouvernantes et exploitantes étaient intéressées à les connaître, et d'autant plus qu'elles se trouvaient exposées davantage à la pression de la concurrence politique et guerrière, Le problème qu'elles avaient à résoudre consistait à extraire de la population asservie la plus grande somme de produits, sans affaiblir les producteurs et sans les décourager à produire, en les encourageant, au contraire. Ce problème était l'objectif de l'art des administrateurs et des financiers, et la connaissance des solutions qu'ils en trouvaient au moyen de l'observation et de l'expérience, constitua la science de l'administration et des finances privées et publiques, souche primitive de l'économie politique. Mais l'exploitation d'un domaine politique n'impliquait pas seulement la nécessité de mettre en œuvre les méthodes les plus efficaces d'administration domestique ou publique et de finances, elle impliquait [45] encore celle de joindre à la garantie de la sécurité de la population assujettie, une protection économique, à la fois intérieure et extérieure. Dans un domaine politique isolé tant par l'état de guerre que par l'insuffisance des moyens de communication, la plupart des branches de la production étaient en possession d'un monopole naturel. La concurrence ne pouvait agir, comme elle l'a fait plus tard, pour régler utilement le prix des produits ou des services. Il fallait les régler par la coutume ou la loi, de manière à empêcher le producteur de surtaxer le consommateur, tout en lui attribuant sa rétribution nécessaire, autrement l'abus du monopole n'aurait pas tardé à ruiner les populations, partant à tarir la source des revenus des propriétaires du domaine. Tout en protégeant le consommateur contre le producteur, en possession d'un monopole naturel, il fallait aussi protéger le producteur contre la concurrence de l'étranger. Lorsque les communications avec le dehors pouvaient être brusquement et longtemps interrompues par la guerre, il était indispensable de garantir, dans l'intérieur du domaine, la production régulière des articles nécessaires à la subsistance de la population et à la défense de l'état, avec celle des articles qui servaient à les acheter, et cette production régulière aurait été troublée et découragée dans les intervalles de paix par l'importation intermittente d'articles produits dans des conditions plus favorables au dehors. L'économie politique avait donc alors, comme son nom l'indique [1] , un caractère purement national, elle était l'économie [46] de « l'état isolé », et elle consistait dans la connaissance des méthodes utiles d'administration, de finances, de réglementation intérieure et de protection extérieure.
Ainsi étaient nés, à mesure qu'ils avaient été « demandés », et s'étaient développés conformément aux nécessités de l'état de guerre, les arts, puis les sciences de la politique, de la guerre, du droit, de la morale et de l'administration privée et publique, souche de l'économie politique.
VII
Cependant des progrès de toute sorte sont intervenus pour rendre la guerre d'utile et productive, nuisible et improductive, et avec elle les institutions et les lois qui y étaient adaptées. Ce sont d'abord les progrès de l'art et du matériel de la guerre combinés avec ceux de la constitution des états et de l'exploitation des populations assujetties. En accroissant la puissance des sociétés civilisées, ces progrès ont fini, après une lutte demeurée longtenps indécise, non seulement par les mettre à l'abri des invasions du monde barbare, mais encore par établir leur prépondérance sur le globe. La guerre a cessé alors d'être nécessaire à la sécurité de la civilisation. En même temps, elle a cessé d'être directement et indirectement productive: directement, car ses produits n'ont plus couvert ses frais progressivement accrus, et si elle est demeurée profitable à une minorité de politiciens et d'hommes de guerre, ses profits ont été achetés par des charges et des dommages disproportionnés et croissants, infligés à la généralité des producteurs; indirectement, car, d'une part, l'accroissement de la puissance défensive qu'elle procurait et qui était nécessaire à la communauté civilisée, lorsque sa sécurité était menacée par les barbares, est devenu inutile dans l'état présent du monde, d'une autre part, la fonction de propulseur du progrès que remplissait cette forme destructive de la concurrence est remplie désormais avec plus d'efficacité et à moins de frais par la concurrence productive.
[47]
Ce sont, ensuite, les progrès qui, en accroissant la puissance productive de l'homme civilisé en même temps que sa puissance destructive, ont développé et internationalisé la concurrence dans la généralité des branches de la production et solidarisé les intérêts des peuples. Sous ce nouveau régime, la prospérité et l'existence même des nations ont cessé de dépendre de l'extension de leur puissance militaire, — cette puissance ne leur servant plus qu'à exercer une industrie maintenant en perte, — elles dépendent de l'extension de leur puissance industrielle. Cela étant, l'objectif de la politique des nations se trouve changé. Cet objectif n'est plus la guerre, c'est l'industrie. Mais, dans la sphère qui lui est propre, l'état ne peut contribuer à la conservation et à l'accroissement de la puissance industrielle de la nation que d'une seule manière: en garantissant à l'intérieur, par une justice exacte et une police vigilante, à l'extérieur par une entente avec les autres états, la liberté et la propriété individuelles.
De même, l'évolution de l'état de guerre à l'état de paix implique une évolution correspondante dans le droit et la morale. Sous le régime de l'état de guerre, chaque société isolée a son droit et sa morale, dont les étrangers sont exclus. De plus, la guerre impliquant pour chacune la nécessité de nuire aux autres, cette nécessité engendre une « raison d'état » qui ne tient compte ni du droit ni de la morale dans toutes les matières qui concernent l'existence de l'état, l'accroissement de sa puissance et l'affaiblissement des états concurrents. La raison d'état justifie le mensonge, l'espionnage, la trahison dans les choses de la politique et de la guerre, elle provoque et encourage les sentiments de haine à l'égard de l'étranger, car l'étranger est un ennemi naturel, et la haine est un excitant à la lutte. Mais du moment où la guerre a cessé d'être nécessaire et où les progrès de l'industrie et du commerce ont solidarisé les intérêts des peuples, l'étranger n'a plus été un ennemi, il est devenu un client: au lieu d'avoir intérêt à son affaiblissement et à sa ruine, on a été intéressé à sa prospérité, et par conséquent au respect de ses [48] droits et à l'accomplissement, à son égard, des obligations prescrites par la morale.
Enfin, les progrès de la sécurité, de l'industrie et, en particulier, des moyens de communication ont agi pour déterminer un changement non moins radical dans le régime financier et économique des nations. Lorsque la guerre s'imposait comme une nécessité vitale, il n'y avait point de limites aux charges de l'impôt, car le besoin auquel il pourvoyait était illimité: jamais la puissance militaire d'un état n'atteignait un degré de développement qui lui assurât la suprématie dans la guerre, et ne pût être utilement dépassé. Le seul frein à l'accroissement de l'impôt résidait alors dans la diminution de son rendement, lorsqu'il s'élevait de manière à tarir la source même de la production en affaiblissant le mobile qui poussait à produire. Mais du momen to ù la guerre cessait de s'imposer, il devenait inutile de maintenir et d'accroître une puissance défensive et offensive, désormais sans objet: à l'impôt illimité, on pouvàit substituer une contribution limitée aux frais de la garantie intérieure de la liberté et de la propriété de chacun des membres de la nation, avec un simple supplément pour la garantie extérieure, réduite à un minimum par la suprématie définitivement acquise du monde civilisé sur le monde barbare. De même, la réglementation intérieure de l'industrie, qui était nécessaire lorsque la plupart des branches de la production constituaient des monopoles naturels, est devenue inutile, partant nuisible, lorsque l'extension des marchés a permis à la concurrence d'agir sans obstacles pour régler les prix et les abaisser au niveau des frais de la production. De même encore, le régime de la protection extérieure a perdu sa raison d'être, lorsque l'extension du commerce international et la solidarisation des intérêts qui en a été la conséquence, ont assuré l'approvisionnement des populations en temps de paix et en temps de guerre.
Cela étant, il est devenu nécessaire de réformer les institutions et les lois politiques, morales et économiques, pour les accorder avec les nouvelles conditions d'existence que la disparition [49] de la raison d'être de l'état de guerre a faites aux sociétés civilisées. Cette œuvre de réforme est principalement du ressort de l'économie politique.
VIII
Sous le régime adapté à la nécessité de l'état de guerre, l'économie politique ne figurait qu'en dernière ligne parmi les sciences dont l'objet était le gouvernement de la société et de l'individu. Ces sciences étaient alors demandées uniquement par la société propriétaire de l'état, et la source immédiate et visible de la richesse de cette société était la guerre qui lui procurait des esclaves, des serfs et des sujets à exploiter. Ce qui l'intéressait avant tout, c'était la connaissance des méthodes les plus propres à assurer la conservation et l'agrandissement de son domaine, à maintenir les populations assujetties dans l'obéissance, à tirer d'elles, sous forme de corvées ou d'impôts, la somme la plus considérable de redevances, et tels étaient les objets des sciences de la politique, de la guerre, de l'administration et de la finance. Mais à mesure que la sécurité générale s'est accrue, que l'industrie s'est développée et diversifiée, que les échanges se sont multipliés, les classes auxquelles l'agriculture, l'industrie et le commerce fournissaient leurs moyens d'existence, dégagées des liens de la servitude, ont demandé à leur tour à connaître les sources de leur richesse, et les causes qui agissaient pour les féconder ou les tarir. Cette demande a eu pour effet d'appeler dans cette direction l'esprit d'examen: on a observé les phénomènes de la division du travail, de l'échange, du crédit, on a cherché à se rendre compte des causes de la valeur de la monnaie et de ses fluctuations, on a reconnu les effets nuisibles des institutions et des lois de protection et de réglementation, sans toutefois remonter aux causes qui les avaient rendues auparavant utiles; enfin l'étude des phénomènes de la production, de la distribution et de la consommation [50] de la richesse a amené la découverte des lois naturelles qui les régissent. En mettant ces lois en lumière, l'économie politique, ainsi étendue et renouvelée, a éclairé, du même coup, l'objectif des autres sciences morales, c'est-à-dire l'intérêt général et permanent de l'espèce humaine.
Au moment où nous sommes, des faits nouveaux, d'une importance considérable, ont rendu particulièrement active la demande de la connaissance des phénomènes et des lois économiques.
Ce sont d'abord les perturbations occasionnées, d'un côté, par la substitution progressive de l'appareil perfectionné de la production et des échanges à l'ancien appareil demeuré presque stationnaire depuis la naissance de l'industrie, d'un autre côté, par la conservation des institutions politiques et économiques du régime adapté à la nécessité de l'état de guerre et qui cessaient d'être utiles pour devenir nuisibles, à mesure que les conditions d'existence des sociétés se modifiaient sous l'influence de l'accroissement de la puissance destructive et productive de l'homme.
C'est encore l'insuffisance et l'inégalité de développement des rouages distributeurs de la richesse, sous le nouveau régime de la concurrence que les progrès de l'industrie et de l'échange ont substitué à celui du monopole refrené par la coutume ou la loi, soit que ce développement se trouve entravé ou troublé par le maintien d'une réglementation devenue surannée ou par tout autre cause.
C'est enfin l'incapacité des classes émancipées à gouverner utilement leur consommation.
Ces phénomènes perturbateurs ont déterminé une déperdition de forces vitales qui a sinon balancé du moins fortement entamé l'accroissement extraordinaire de ces mêmes forces, et occasionné une somme de souffrances proportionnée à cette déperdition. De là, une demande d'information des causes du mal d'autant plus pressante et une recherche des remèdes, d'autant plus active que l'accroissement prodigieux de la puissance productive et de ses produits avait fait [51] concevoir l'espérance d'une amélioration équivalente de la condition de la généralité des producteurs [2].
Sans doute, tous les phénomènes de la vie économique sont loin d'être entièrement élucidés, mais, dans son état actuel d'avancement, la science peut déjà fournir des notions positives sinon complètes sur les lois naturelles qui régissent ces phénomènes, sur les causes qui agissent pour entraver l'opération utile de ces lois, sur les maux qui en découlent et sur les remèdes applicables à ces maux.
Telle est la tâche qui incombe aujourd'hui à l'économie politique aussi bien qu'aux autres sciences dont l'objet est le gouvernement de l'individu et de la société.
Il convient de remarquer toutefois que les problèmes économiques, politiques et moraux que pose l'établissement de l'état de paix se résoudraient même sans l'intervention de la science, comme se sont résolus dans les premiers âges de l'humanité, ceux que posait l'état de guerre. Sous l'impulsion des lois de l'économie des forces et de la concurrence, l'homme est, en effet, continuellement excité et obligé au [52] progrès, mais, en l'absence de la science, il procède par tâtonnements, et il n'accomplit le progrès qu'au prix d'écoles nombreuses et coûteuses. Ces écoles, la science les lui épargne, au moins en partie, en recueillant les fruits de l'observation et les leçons de l'expérience. En l'empèchant de retomber toujours dans les mêmes erreurs, elle lui permet d'avancer plus vite et en dépensant moins de forces, elle lui procure le progrès à meilleur marché.
Ainsi, les sociétés civilisées finiraient par sortir de l'état de guerre, et se débarrasser des institutions qui y étaient adaptées, comme aussi par établir le régime adapté à l'état de paix, quand même les sciences politiques et morales n'existeraient point, mais elles s'attarderaient plus longtemps dans le politicianisme, le militarisme, et le protectionnisme, et elles se livreraient à des expériences socialistes ou communistes qui leur causeraient une déperdition irréparable de forces vitales.
I
LOIS ET PHÉNOMÈNES ÉCONOMIQUES
[55]
CHAPITRE PREMIER
Les lois naturelles.↩
I. L'homme et ses éléments constitutifs. Le besoin. L'utilité. — II. La valeur. — III. La loi de l'économie des forces. — IV. L'association, la division du travail et l'échange. — V. L'échange. La loi de l'offre et de la demande. — VI. La concurrence. — VII. La loi de progression des valeurs.
I. l'homme et ses éléments constitutifs. — Le besoin. — L'Utilité. — L'homme est un composé de matière et de forces vitales de différentes sortes, physiques, intellectuelles et morales. En vertu de leur nature, ces matériaux constitutifs de l'être humain doivent être continuellement réparés et renouvelés par l'assimilation ou la consommation d'éléments qui leur conviennent, sinon ils dépérissent et la vie qui les anime finit par s'éteindre.
De là, la notion du besoin. L'homme éprouve des besoins physiques, intellectuels et moraux, correspondant aux matériaux et aux forces qui le constituent. Le besoin, c'est l'appétit propre à chacune des parties composantes de son être. Quand on le satisfait, on éprouve une jouissance, quand on ne le satisfait point, on ressent une souffrance.
La souffrance et la jouissance sont les mobiles naturels et nécessaires de l'activité de l'homme, comme de toutes les autres créatures pourvues de vie. Il agit pour éviter la [56] souffrance (douleur ou peine) et se procurer la jouissance (satisfaction ou plaisir).
Les choses matérielles ou immatérielles, propres à satisfaire les besoins de l'homme sont utiles et constituent des utilités.
La nature fournit gratuitement à l'homme un certain nombre d'utilités, telles que la chaleur et la lumière du soleil, mais la plupart doivent être produites.
La production, la distribution et la consommation des utilités sont l'objet de l'économie politique.
II. La Valeur. — Les utilités que la nature ne fournit point gratis sont produites par le travail de l'homme et des agents qu'il s'approprie et assujettit à son service. En quoi consiste le travail de l'homme? En une dépense de ses forces physiques, intellectuelles et morales, appliquées à la production des utilités. Cette dépense implique, comme toute dépense ou déperdition des forces vitales, une souffrance. Les agents que l'homme s'approprie et met en œuvre, forces naturelles, animaux, machines, travaillent comme lui, mais à son profit, et à charge par lui de pourvoir à leur entretien et à leur renouvellement, s'il y a lieu.
Toute utilité produite contient done deux éléments:
1° L'utilité ou le pouvoir de satisfaire l'un ou l'autre des besoins de l'homme ou de contribuer directement ou indirectement, à leur satisfaction;
2° Le travail, c'est-à-dire la quantité de forces dépensées pour produire l'utilité, travail de l'homme et travail des agents qui lui servent d'auxiliaires.
L'utilité produite est, en résumé, un pouvoir de réparation et de renouvellement des matériaux et des forces constitutifs de l'homme et de ses auxiliaires, acquis en échange d'une dépense préalable de ces mêmes matériaux et forces.
Si le pouvoir dépensé dépasse le pouvoir acquis, il y a perte de forces, partant excédent de la souffrance sur la jouissance.
Si le pouvoir acquis dépasse, au contraire, le pouvoir dépensé, il y a accroissement de forces, bénéfice, profit ou gain, partant excédent de la jouissance sur la souffrance.
[57]
Ce pouvoir d'utilité produit par le travail, c'est la valeur.
III. La Loi De L'économie Des Forces. — Conserver et, s'il se peut, accroître ses forces vitales, afin de se procurer des jouissances et d'éviter des souffrances, tel est le mobile de l'activité de l'homme. C'est dans ce but qu'il produit les choses dont l'assimilation ou la consommation conserve et accroît ses forces vitales, autrement dit les choses utiles ou les utilités. Mais ces utilités réparatrices de ses forces vitales, il ne peut les produire que par le travail, et tout travail implique une dépenses de forces, partant une souffrance.
Cela étant, l'homme, — et non seulement l'homme, mais tous les êtres pourvus de vie, — sont intéressés à obtenir toujours la plus grande somme d'utilités en échange de la moindre somme de travail. C'est la loi de l'économie des forces.
Comment peuvent-ils atteindre ce but que la nature les invite incessamment à poursuivre? De deux manières: 1° En augmentant la puissance productive de leur travail, en perfectionnant leur industrie; 2° En s'emparant par violence ou par ruse des utilités produites par autrui, lorsque la mise en œuvre de la violence ou de la ruse leur coûte une dépense de forces moindre, partant moins de'souffrance ou de peine que ne leur en coûterait la production des utilités qu'ils dérobent.
Les deux procédés ont été employés de tout temps. Mais le premier a, seul, pour résultat d'augmenter d'une manière permanente la somme des forces vitales de l'espèce humaine, partant de ses jouissances. Le second peut être temporairement utile à un individu ou à plusieurs, mais il est nuisible à la généralité, car il n'augmente pas la somme des forces vitales existantes, il la déplace en la diminuant, soit par la déperdition de forces occasionnée par les luttes inévitables qu'il provoque, soit par les risques qu'il engendre, les frais et dommages qui proviennent de ces risques et qui se traduisent encore par des forces perdues.
Enfin, l'emploi de ce second et vicieux procédé d'acquisition des utilités est subordonné au premier, en ce qu'il ne peut être mis en œuvre qu'après que les utilités ont été [58] produites; à quoi il faut ajouter que la productivité en est subordonnée encore à celle du travail qui produit les utilités.
Comment l'homme produit-il les utilités dont il a besoin? Comment augmente-t-il sa puissance productive?
IV. l'association, la division du travail et l'échange. — L'homme produit des utilités en mettant en œuvre les forces physiques, intellectuelles et morales que la nature a investies dans sa personne, les agents et les éléments que lui fournit le milieu où il vit. Il augmente progressivement sa puissance productive par les procédés de l'association, de la division du travail et de l'échange.
L'homme ne peut vivre solitaire. Sa destinée est naturellement associée à celle d'un nombre plus ou moins grand de ses semblables, ne fut-ce qu'en raison du penchant qui le pousse à perpétuer son espèce et de la nécessité d'élever sa progéniture. De plus, dès son origine, l'espèce humaine a dû, comme beaucoup d'autres, se réunir en troupeaux pour se défendre contre les animaux individuellement supérieurs en forces, aussi bien que pour s'emparer de ceux qui étaient propres à la nourrir ou à lui servir d'auxiliaires. Sous l'impulsion de la loi de l'économie des forces, l'association s'est imposée à elle, — les individus associés se défendant ou attaquant avec plus d'efficacité et une moindre dépense de forces que les individus isolés. La division du travail s'est opérée, sous la même impulsion, entre les associés, et, ensuite, entre les membres d'associations différentes. Chacun s'est livré au travail le mieux adapté à ses forces et à ses aptitudes, et, en s'y livrant d'une manière continue, il l'a rendu plus productif. Mais la division du travail implique l'échange. Chacun a dû échanger l'utilité qu'il produisait pour autrui contre les utilités produites par autrui.
Au point de développement où l'économie des sociétés civilisées est maintenant parvenue, l'association des forces productives, la division du travail et l'échange sont les phénomènes caractéristiques et prépondérants de cette économie. Quel spectacle nous présente la production de la multitude des utilités destinées à la satisfaction des besoins de l'homme? [59] Nous la voyons partagée en branches nombreuses que la statistique a classées selon leur nature et celle des besoins qu'elles ont pour objet de satisfaire: l'agriculture, l'industrie proprement dite, le commerce, les professions libérales, les fonctions qualifiées de publiques. Chacune de ces branches est partagée en rameaux et chacun de ces rameaux comprend un nombre plus ou moins considérable d'ateliers de production. Dans chacun de ces ateliers, fermes, manufactures, magasins, comptoirs, bureaux, où sont associées et combinées des forces productives de différentes sortes, on produit ou, pour mieux dire, on contribue à la production d'une ou de plusieurs utilités investies dans des choses matérielles ou des services immatériels; enfin, si nous considérons à l'œuvre le personnel qui s'y trouve rassemblé, nous constaterons qu'il se partage l'ensemble des opérations de la production, de telle façon que les mêmes opérations sont continuellement accomplies par les mêmes individus. Cette division du travail est plus ou moins développée selon le degré d'avancement de l'industrie: elle a acquis de nos jours son plus grand développement dans l'industrie manufacturière, mais elle existe dans toutes les branches de la production et elle s'accroît à mesure que l'industrie progresse. Elle augmente la productivité du travail ou, ce qui revient au même, elle économise les forces et permet d'obtenir au prix de la même force dépensée une somme d'utilité de plus en plus grande.
Mais si chacun, au lieu de produire isolément toutes les utilités dont il a besoin, n'en produit qu'une seule ou une fraction d'une seule, c'est par l'échange de cette utilité ou de cette fraction d'utilité qu'il devra se procurer toutes celles qu'il emploie ou consomme. Il offrira l'utilité ou la fraction d'utilité qu'il produit ou contribue à produire, et il demandera, en échange, toutes les utilités dont il a besoin. Et le bénéfice ou gain qu'il tirera de ce mode indirect de production sera d'autant plus considérable que la somme d'utilités que lui procurera la même quantité de travail ou la même dépense de forces dans la production associée et divisée dépassera davantage celle qu'il aurait obtenue dans la production isolée. Cette différence va naturellement croissant à mesure que la production associée et divisée se perfectionne. Quoiqu'on [60] puisse affirmer que l'industrie humaine n'est encore qu'à l'A, B, C de ses progrès, elle est déjà énorme.
Cependant, ici se pose un problème d'une importance capitale.
Supposons un million de Robinsons travaillant isolément, ils n'obtiendront qu'une faible somme d'utilités en échange de leur travail. Supposons les replacés sous le régime de la protection associée et divisée, ils obtiendront en échange de la même quantité de travail, de la même force dépensée, une somme d'utilités infiniment plus grande. Mais leur condition ne serait point améliorée ou ne le serait que fort inégalement si chacun ne recevait point dans cet excédent d'utilités une part proportionnelle à sa dépense. Il faut donc que chaque producteur obtienne, sous le régime de la production associée et divisée, toute la somme d'utilités qu'il aurait obtenue sous le régime de la production isolée. — plus la totalité du bénéfice ou gain provenant de l'emploi du mécanisme de l'association et de la division du travail et des progrès qu'il a permis de réaliser et qui ont augmenté, de siècle en siècle, la puissance productive de l'espèce humaine. S'il n'en était pas ainsi, qu'arriverait-il? C'est que les uns recevraient une partie du produit du travail des autres et qu'il s'ensuivrait une déperdition générale des forces productives, tant par l'insuffisance de gain qui obligerait ceux-ci à surmener et épuiser leurs forces que par l'excès de gain qui permettrait à ceux-là de ne point employer suffisamment les leurs, tant encore par les luttes inévitables qu'engendrerait cette distribution vicieuse des utilités produites.
Ce problème de l'attribution à chaque producteur sinon de la totalité des utilités qu'il a produites ou contribué à produire, du moins d'une somme d'utilités équivalente, se résout, sous le régime de la production associée et divisée, par l'opération des lois naturelles, qui gouvernent l'échange.
V. L'échange. La Loi De L'offre Et De La Demande. — Si l'on suppose un homme isolé, il produira pour lui-même toutes les utilités propres à réparer et à augmenter ses forces vitales, mais, en échange de son travail, il ne pourra obtenir qu'un pouvoir de réparation ou un pouvoir d'utilité à peine [61] supérieur à celui qu'il aura dépensé. Il en sera autrement sous le régime de la production associée et divisée. Il pourra, sous ce régime, en échangeant l'utilité produite, obtenir un pouvoir de réparation ou d'utilité bien plus grand, en raison de l'augmentation de productivité que le procédé de l'association et de la division du travail apporte à son industrie.
Dans le premier cas, le producteur ne considère dans les utilités qu'il produit que le pouvoir qu'elles ont de réparer ses forces vitales ou de satisfaire ses besoins; c'est ce que l'on a appelé la valeur en usage. Dans le second cas, au contraire, le producteur ne se préoccupe point de la valeur en usage des utilités qu'il produit, il ne considère que le pouvoir qu'elles ont de lui procurer par voie d'échange les utilités produites par autrui; c'est ce qu'on a appelé la valeur en échange ou le pouvoir d'achat (power of purchasing), et plus tard, simplement la valeur, en se bornant à désigner la valeur en usage sous le nom d'utilité.
La valeur en échange n'en est pas moins fondée sur la valeur en usage, savoir sur le pouvoir que possède l'utilité produite de satisfaire sinon les besoins du producteur, du moins les besoins des consommateurs de cette utilité.
On échange donc pouvoir contré pouvoir, valeur contre valeur. On offre la valeur que l'on a produite, et on demande, en échange, la valeur dont on a besoin.
C'est la loi ou plutôt le phénomène de l'offre et de la demande.
Analysons ce phénomène. Examinons sous quelles formes se présentent à l'échange les pouvoirs d'utilité ou les valeurs, quelle est la situation respective de ceux qui les apportent et à quelle condition ils peuvent s'accorder pour conclure l'échange.
Les pouvoirs d'utilité ou les valeurs se présentent à l'échange sous les formes les plus variées. Ils sont investis dans la généralité des produits matériels et des services immatériels, propres à satisfaire l'un ou l'autre des multiples besoins des hommes. La quantité de ces produits et de ces services s'exprime selon leur nature particulière, par le volume, le poids, la superficie, le nombre ou la durée. Mais la valeur qu'ils contiennent n'est nullement en rapport avec cette [62] quantité physique. Le blé et le diamant, par exemple, ne s'échangent pas en raison de leur volume et de leur poids; ils s'échangent en raison de leur valeur. Si la valeur est grande, on ne fournira qu'une petite quantité du produit ou du service dans lequel elle est investie, et plus elle grandira, plus cette quantité diminuera; plus elle décroîtra, au contraire, plus la quantité du produit ou du service devra être augmentée.
La situation des individus qui apportent à l'échange des pouvoirs d'utilité ou des valeurs est caractérisée par l'opposition de leurs intérêts. Chacun est intéressé à offrir la moindre quantité possible du produit ou du service qu'il veut échanger, car le pouvoir d'utilité ou la valeur qu'il a investi dans ce produit ou ce service lui a coûté une certaine dépense de forces, partant une certaine somme de souffrance; en même temps il est intéressé à demander la plus grande quantité du produit ou du service qu'il veut se procurer par l'échange, car le pouvoir d'utilité investi dans ce produit ou ce service représente pour lui une jouissance: plus grande sera la quantité qu'il en obtiendra, plus grande aussi sera la somme de jouissance qu'il en tirera.
A quelle condition ces deux intérêts opposés parviendrontils à s'accorder? Il convient de remarquer qu'ils ne s'accordent pas nécessairement et toujours. Ils ne peuvent s'accorder qu'à la condition que l'échange rapporte à chacun des échangistes un bénéfice ou gain, consistant dans la différence entre la somme de force qu'il a dépensée ou dépensera pour créer le produit ou le service qu'il offre et celle que peut lui procurer le pouvoir d'utilité contenu dans le produit ou le service qu'il demande. L'échange peut être plus avantageux à l'une des deux parties qu'à l'autre, mais il doit être, dans quelque mesure, avantageux à toutes deux, sinon l'une ou l'autre n'aura aucun intérêt à le conclure et il ne se conclura point.
Comment se conclut-il? Qu'est-ce qui décide de la quantité des produits ou des services que chacun fournit en échange de la quantité qu'il obtient? C'est l'intensité respective de la demande de chacun des échangistes, en supposant bien entendu que cette demande soit effective, c'est-à-dire appuyée sur une offre réelle. Si l'intensité de la demande est égale des deux [63] parts, le bénéfice ou gain procuré par l'échange se partagera également entre les deux échangistes. Si elle est inégale, le bénéfice se partagera inégalement, mais il y aura toujours partage. Si nous figurons la somme du bénéfice par 1,000, la part de l'un pourra s'élever jusqu'à 999, mais ne pourra atteindre 1,000, sinon l'échange ne se conclurait point, l'autre n'ayant plus aucun intérêt à le conclur.
Cependant, soit que le partage se fasse également ou inégalement, du moment où il y a partage, du moment où l'échange est, dans quelque mesure, avantageux aux deux parties, il finit par se conclure. Ce n'est point, parfois, sans de longs et vifs débats, chacun s'efforçant de donner moins de la marchandise qu'il offre et d'obtenir plus de celle qu'il demande, chacun, en un mot, s'efforçant de « marchander », afin de conclure l'échange à un taux qui augmente sa part de bénéfice aux dépens de celle de la partie adverse. Enfin, l'accord 'se fait, l'échange se conclut. Chacune des deux parties livre une certaine quantité de produits ou de services et reçoit, en échange, une autre quantité de produits ou de services. Ces deux quantités ordinairement inégales sous le rapport de leurs qualités physiques, poids, volume, superficie, durée, ont en ce moment une valeur égale, puisqu elles se font équilibre. Cette valeur s'exprime par le prix. Le prix, c'est le rapport de valeur existant, au moment de l'échange, entre les produits ou les services échangés.
En résumé, tout échange implique chez les deux échangistes une demande et une offre. Chacun demande le produit ou le service dont il a besoin, et offre en échange celui qu'il possède. L'échange ne peut se conclure et ne se conclut qu'à la condition d'être profitable aux deux parties, c'est-à-dire d'attribuer à chacune une portion quelconque du surcroît d'utilité que crée la production associée et divisée en comparaison de la production isolée. La proportion dans laquelle se partage ce profit est déterminée par l'intensité respective des besoins manifestés par la demande. Elle peut être égale ou inégale, mais nous allons voir qu'il existe un régulateur naturel qui agit incessamment pour l'égaliser. Ce régulateur naturel, c'est la concurrence.
[64]
VI. La Concurrence. — Si nous voulons nous rendre compte du mode d'action de la concurrence, transportonsnous sur un marché, savoir dans un endroit ou les producteurs d'utilités se rencontrent, sous le régime de la production associéc et diviséc, pour en opérer l'échange.
Ces producteurs sont plus ou moins nombreux et ils apportent à l'échange des quantités plus ou moins considérables d'utilités.
Afin de rendre notre démonstration moins compliquée et plus claire, supposons l'existence d'un instrument qui a été inventé pour faciliter les échanges et même, le plus souvent, pour les rendre possibles, nous voulons parler de la monnaie. grâce à cet instrument, l'échange s'est divisé en deux parties: la vente et l'achat. On échange l'utilité que l'on produit contre la monnaie: c'est la vente, et la monnaie contre les utilités dont on a besoin: c'est l'achat.
Les échangistes qui ont besoin de l'utilité produite sous forme de blé par exemple, la demandent en offrant de la monnaie en échange; les échangistes qui l'ont produite en vue de se procurer des utilités sous d'autres formes, l'offrent en demandant de la monnaie, laquelle possède un pouvoir général d'achat de toutes sortes d'utilités.
Les uns se font concurrence pour demander le blé; les autres pour demander la monnaie. Comment les choses se passent-elles? Chacun commence par demander, celui-là la plus grande quantite de blé en offrant en échange la plus petite somme de monnaie, celui-ci la plus grande somme de monnaie, en offrant la plus petite quantite de blé. Ce sera, d'une part, la demande d'un quintal de blé contre une offre de 10 francs; d'une autre part, une demande de 40 francs contre l'offre de ce même quintal de blé. Alors, de deux choses l'unc, ou chacun maintiendra son offre et l'échange ne se conclura point, ou chacun augmentera de son côté, graduellement la quantité offerte, et un moment viendra ou les deux offres se rencontrant, l'échange se conclura. En supposant que le détenteur de monnaie double son offre de monnaie, et le détenteur de blé son offre de blé, le quintal de blé s'échangera contre 20 francs et l'on dira que 20 francs est le prix d'un quintal de blé. Ce qui signifiera que la valeur de la [65] quantité de blé contenue dans un quintal est égale à la valeur de la quantité d'or monnayé contenue dans une pièce de 20 francs.
Cependant, au lieu d'augmenter leur offre d'une quantité égale, il se peut que les échangistes l'augmentent d'une quantité inégale, et que le prix du quintal de blé se fixe soit à 15 francs soit à 30 francs. Qu'est-ce qui aura déterminé cette inégalité de l'augmentation des deux offres? C'est l'inégalité de l'intensité moyenne du besoin de monnaie des détenteurs de blé, d'une part, du besoin de blé des détenteurs de monnaie, de l'autre.
Supposons que l'intensité moyenne du besoin de blé dépasse celle du besoin de monnaie, qu'arrivera-t-il? C'est que les détenteurs de monnaie se feront une concurrence plus forte pour acquérir le blé, que les détenteurs de blé pour acquérir la monnaie. Comment se traduira cette inégalité de pression de la concurrence? Elle se traduira par une augmentation de l'offre de la monnaie, supérieure à celle du blé; d'où il résultera que le point de rencontre des deux offres sera plus rapproché du point de départ de l'offre du blé que de celui de la monnaie, qu'au lieu d'échanger un quintal de blé contre 20 francs on l'échangera, par exemple, contre 30 francs.
Le prix se fixe d'après le rapport des quantités réciproquement offertes, mais ces quantités sont offertes d'après le rapport d'intensité des besoins en présence. Le besoin le plus intense, celui par conséquent pour lequel le produit ou le service demandé a l'utilité la plus grande, offre en échange la quantité la plus grande aussi de l'utilité qu'il apporte au marché [3].
[66]
Or la concurrence agit incessamment, comme un régulateur, pour égaliser l'intensité des besoins en présence et répartir ainsi entre eux, d'une manière égale, le bénéfice ou gain résultant de l'échange.
Ce bénéfice ou gain, en quoi consiste-t-il? Nous avons vu qu'il consiste dans la différence entre le pouvoir dépensé et le pouvoir acquis. Sous le régime de la production isolée, la faible productivité du travail réduit cette différence à son minimum. Seulement, sous ce régime, le producteur faisant avec lui-même l'opération de l'échange en recueille nécessairement le bénéfice tout entier. Il obtient la totalité du pouvoir d'utilité ou de réparation de ses forces vitales qu'il a créé, en échange du pouvoir qu'il a dépensé pour le créer.
Mais la production isolée est devenue de plus en plus exceptionnelle et rare. Le fait général c'est la production associée et divisée, déterminant à mesure qu'elle se développe, un accroissement progressif de la puissance productive de l'homme, chacun produisant en échange de la même dépense de force une somme croissante de pouvoir de réparation et de renouvellement de ces mêmes forces; d'ou l'augmentation progressive du bénéfice ou gain réalisé par l'échange. Seulement, sous ce régime, chacun n'obtient plus nécessairement la totalité de ce bénéfice. Dans la production isolée, l'individu est assuré de l'obtenir puisqu'il consomme lui-même l'utilité qu'il a produite. Dans la production associée et divisée, l'individu consommant les utilités produites par autrui et autrui consommant les siennes, c'est uniquement par l'échange qu'il peut entrer en possession de son bénéfice.
Sans doute, l'échange ne peut se conclure qu'à la condition de procurer un bénéfice aux deux échangistes, mais ce bénéfice peut être égal ou inégal; pour qu'il soit égal, que faut-il? Il faut que les besoins des échangistes soient égaux en [67] intensité; sinon celui des deux dont le besoin est le plus intense, demandant plus vivement l'utilité propre à satisfaire ce besoin, offrira en échange une proportion plus forte de l'utilité qu'il aura produite, de la force qu'il aura dépensée, et il réalisera un gain moindre, sans que ce gain puisse cependant s'annuler tout à fait. L'échangiste dontle besoin est le moins intense obtiendra ainsi en sus de son bénéfice, une portion de celui de l'échangiste dont le besoin est le plus intense. L'équilibre de la répartition des bénéfices de la production associée et divisée sera rompue à l'avantage de l'un, au détriment de l'autre.
Comment la concurrence agit-elle pour établir cet équilibre ou le rétablir quand il vient à être rompu, et conférer ainsi à chacun des coopérateurs de la production associée et divisée, la totalité du bénéfice provenant de l'accroissement de leur puissance productive?
Il suffit, pour résoudre cette question, de se rappeler à quel mobile obéissent toutes les créatures pourvues de vie. Ce mobile universel est celui de la jouissance et de la souffrance, du plaisir et de la peine. Se procurer la plus grande somme de plaisir en échange de la moindre somme de peine, tel est l'objectif qu'elles poursuivent. Or, qu'est-ce que le bénéfice ou gain que l'on réalise par l'échange? C'est l'excédent d'un pouvoir acquis sur un pouvoir dépensé, et, en dernière analyse, l'excédent d'un plaisir sur une peine. Quelle sera donc l'impulsion naturelle à laquelle obéiront tous les producteurs ou coopérateurs de la production, si toutefois ils sont libres d'y obéir? Ce sera de produire l'utilité qui leur procure le bénéfice ou gain le plus élevé. Cela étant, si l'intensité moyenne du besoin des échangistes, détenteurs de monnaie dépasse celle du besoin des détenteurs de blé, si, en conséquence, le prix du blé s'élève de manière à augmenter le bénéfice des producteurs de blé, en diminuant celui des producteurs de la généralité des utilités en échange desquelles la monnaie s'acquiert, qu'arrivera-t-il? C'est qu'on produira plus d'utilités sous la forme de blé, et moins d'utilités sous les autres formes. D'où il résultera que les producteurs d'utilités sous la forme de blé se feront une concurrence croissante, et les producteurs d'utilités sous les autres formes, une concurrence [68] décroissante. Il en ira ainsi jusqu'à ce que la pression de la concurrence s'égalise des deux parts et avec elle le mouvement des deux offres dans l'échange.
Telle est l'opération régulatrice de la concurrence. L'efficacité de cette opération est portée au plus haut degré possible par le concours de la loi de progression des valeurs.
VII. La Loi De Progrèssion Des Valeurs. — C'est l'inégalité de la pression de la concurrence qui fait monter ou descendre la valeur des produits et des services dans l'échange: plus grande est la pression de la concurrence que se font entre eux les détenteurs de la monnaie pour demander le blé, plus s'élève en conséquence la quantité de monnaie qu'ils offrent en échange d'une quantité de blé, et plus on voit hausser la valeur du blé relativement à celle de la monnaie. Mais cette hausse de la valeur du blé ne se développe pas seulement en proportion de l'augmentation de la quantité de monnaie offerte en échange d'une quantité de blé; elle se développe d'une manière progressive; d'où cette formule:
Lorsque le rapport des quantités de deux produits ou services offerts en échange varie en progression arithmétique, le rapport des valeurs de ces deux produits ou services varie en progression géométrique.
Telle est la loi de progression des valeurs.
Toutefois, il y a une différence dans le développement de cette progression, suivant que le produit ou le service répond à un besoin plus ou moins nécessaire. En cas de disette, la diminution des quantités de blé offertes au marché en fait croître le prix dans une progression presque géométrique, parce que la demande de blé ne diminue que faiblement sous l'influence de la hausse. S'il s'agit d'un article moins nécessaire, d'oranges par exemple, la hausse du prix agit au contraire sensiblement pour diminuer la demande, et la progression du prix des oranges se trouve ainsi ralentie; mais qu'il s'agisse de blé, d'oranges ou de tout autre article, l'impulsion produite par la différence de pression de la concurrence des vendeurs et des acheteurs est la même. L'augmentation ou la diminution de la quantité offerte d'un produit ou d'un service détermine toujours une baisse ou une hausse, non pas [69] simplement proportionnelle, mais progressive de la valeur de ce produit ou de ce service.
La loi de progression des valeurs agit, disons-nous, pour porter au plus haut degré possible, le pouvoir régulateur de la concurrence. Reprenons l'exemple de l'échange du blé contre la monnaie. Quand la pression de la concurrence des détenteurs de blé pour demander la monnaie dépasse celle des détenteurs de monnaie pour demander le blé et provoque par conséquent l'offre d'une quantité supplémentaire de blé, la valeur du blé diminue dans une progression supérieure à celle de l'augmentation de la quantité. Le prix baisse avec une rapidité croissante. Jusqu'où peut-il baisser? Il y a une limite qu'il ne peut dépasser au moins d'une manière permanente; c'est la limite des frais de production. Lorsque les frais de production cessent d'ètre couverts, les agents productifs ne pouvant plus être entièrement rétablis ou renouvelés, la production diminue, la pression de la concurrence des détenteurs de blé s'affaiblit et le prix remonte. Il remonte notons-le bien, dans une progression plus rapide que la diminution de la quantité produite. S'il vient à dépasser la limite des frais de production en y comprenant le profit ordinaire de l'industrie, qu'arrive-t-il? C'est que les agents productifs sont attirés de préférence dans la production du blé, que la pression de la concurrence s'y accroît et que le prix baisse de nouveau. La somme des frais de production, qu'Adam Smith désignait sous le nom de prix naturel apparaît donc comme le point central vers lequel gravite par une impulsion analogue à celle qui détermine la chute des corps, la valeur de la généralité des produits et des services échangés ou leur prix courant. Mais que représente la somme des frais de production ou le prix naturel? Il représente la dépense de forces qu'il a fallu faire pour créer le pouvoir d'utilité investi dans le produit ou le service. Sous le régime de la production isolée, le pouvoir acquis ne dépasse que faiblement le pouvoir dépensé. Sous le régime de la production associée et divisée, il le dépasse, au contraire, dans une proportion de plus en plus considérable, grâce à l'augmentation croissante de la puissance productive de l'homme.
Or il s'agit de savoir — et c'est le problème que nous avons [70] posé — à qui revient l'excédent du pouvoir acquis sur le pouvoir dépensé. Sous le régime de la production isolée, il revient directement au producteur de l'utilité. Sous le régime de la production associée et divisée, il lui revient indirectement par la voie de l'échange. Et il lui revient de même en totalité. Car s'il obtient plus ou moins que l'excédent d'utilité qu'il a produit, aussitôt la concurrence agit pour enlever le surplus ou combler le déficit, et, sous l'impulsion de la loi de progression des valeurs, cette opération régulatrice s'accomplit avec une rapidité croissante et une précision merveilleuse.
[71]
CHAPITRE II
Le capital↩
I. Les procédés et les agents de la production. L'association des forces productives et la division du travail. Le capital. — II. La genèse du capital. — III. L'entreprise. 1° La réunion du capital d'entreprise. 2° L'opération de la production. 3° Les frais de production et le produit net. — IV. Comment la production peut s'accroitre.
L'homme est obligé de produire la plupart des choses nécessaires à l'entretien de son existence. La production consiste à découvrir, à tranformer et à transporter dans l'espace et le temps, les éléments bruts, fournis par la nature, de manière à les approprier aux besoins des hommes. Ces diverses opérations se résolvent en une création d'utilités. Produire, c'est créer des utilités.
I. Les Procédés Et Les Agents De La Production. — Mais l'individu réduit à ses propres forces ne pourrait produire qu'une quantité d'utilités, tout à fait insuffisante pour satisfaire aux nombreux besoins physiques, intellectuels et moraux qui le sollicitent. Supposons un homme isolé et sans autres outils que ses membres, comment pourra-t-il se défendre contre les animaux mieux pourvus d'armes naturelles, se nourrir, se vêtir, se loger, élever ses enfants, cultiver son intelligence et la leur? Il ne peut travailler, d'une manière régulière et suivie plus de 12 heures par jour, à moins d'épuiser ses forces. Même en supposant qu'il trouve dans le milieu ambiant une abondance de substances animales et végétales, que le climat soit doux, que sa sécurité ne soit point [72] continuellement menacée, il devra se contenter pour sa nourriture des subsistances à sa portée, il ne pourra se construire qu'une habitation informe et incommode et se fabriquer que des vêtements grossiers. La satisfaction imparfaite de ces besoins de première nécessité absorbera toute la quantité de travail que ses forces limitées lui permettent de fournir, si laborieux et actif qu'il soit, dans la partie non moins limitée de la journée où il peut les mettre en œuvre. Telle a été cependant la situation primitive de l'espèce humaine. Or, si nous observons sa condition actuelle, quel spectacle frappera nos regards? Nous trouverons qu'elle s'est progressivement accrue en nombre, et que l'immense majorité civilisée ou pour mieux dire en voie de civilisation, se procure, en échange d'une quantité de travail qui ne dépasse pas en moyenne 12 heures par jour, sans compter le repos hebdomadaire, une somme d'utilités incomparablement supérieure à celle qu'obtenaient les premiers hommes; elle est mieux nourrie et sa subsistance est plus assurée, mieux vêtue et logée, plus efficacement protégée dans son existence et ses biens; elle peut satisfaire d'une façon de plus en plus ample non seulement ses appétits matériels, mais encore ses besoins intellectuels et moraux; elle a étendu et assaini son domaine, et l'a couvert d'un réseau de voies de communication qui enserre le globe tout entier. Comment ces résultats ont-ils été obtenus? Par deux procédés:
1° Par l'association des forces productives et la division du travail. — Au lieu de produire isolément toutes les utilités appropriées à la satisfaction de ses besoins, l'homme a associé ses forces productives à celles de ses semblables, et il a divisé et spécialisé son travail; chacun a produit ou contribué à produire avec une économie croissante de forces, une des utilités demandées par autrui et obtenu en échange l'ensemble des utilités produites par autrui. Et nous avons vu que les lois naturelles de la concurrence et de la progression des valeurs agissent incessamment pour régler cet échange de manière à procurer à chacun des coopérateurs de la production, l'équivalent des utilités qu'il produit pour autrui comme s'il les avait produites isolément pour lui-même, en [73] le faisant bénéficier ainsi de tout l'accroisement de productivité qui résulte de l'emploi du procédé de l'association des forces productives et de la division du travail.
2° Par l'augmentation progressive des pouvoirs de production des utilités. — A l'origine, l'homme ne mettait en œuvre, comme les animaux inférieurs, que ses forces, ses armes ou ses outils naturels pour produire les utilités appropriées à la satisfaction de ses besoins. Mais, peu à peu, il a asservi les animaux et s'est emparé des forces de la nature; il les a dressés à travailler pour lui, en se bornant à les diriger, à les entretenir et à les renouveler. Il a ainsi créé et accumulé une quantité croissante de pouvoirs de production, investis, les uns en lui-même, sous forme de connaissances et de procédés qui ont accru la puissance de ses facultés productives, les autres dans le milieu ambiant, sous forme de terres exploitables, d'outils, de machines, de constructions et de matériaux de tous genres. Grâce à cette accumulation de pouvoirs de production, employés avec la plus grande efficacité possible par le procédé économique de l'association des forces productives et de la division du travail, l'homme a pu obtenir, en échange d'une dépense de travail quotidien ne dépassant pas celle à laquelle il était primitivement obligé et même inférieure, l'énorme quantité d'utilités qui constitue, sous des formes infiniment variées et incessamment multipliées, la richesse des peuples civilisés.
Ces pouvoirs de production des utilités que l'homme a créés et accumulés en lui-même et hors de lui-même, c'est le capital.
II. La Genèse Du Capital. — Afin de nous rendre compte, aussi clairement que possible, de la manière dont le capital se forme et s'accumule, analysons la production dans la première période de développement de l'industrie humaine, lorsque les hommes produisent directement la plus grande partie des articles qu'ils consomment, lorsque l'échange qui est aujourd'hui le phénomène prédominant de l'économie des sociétés civilisées ne joue encore qu'un rôle secondaire.
Comment procède alors l'individu pour satisfaire les besoins qui le sollicitent et auxquels il ne peut s'abstenir de pourvoir sous peine de souffrir et de périr?
[74]
Il commence par se transformer lui-même en un agent productif. De quelle façon? En employant, sous l'excitation de la douleur causée par un besoin de première nécessité, — le besoin de nourriture, — la puissance de sa volonté à s'emparer des autres pouvoirs que la nature a investis dans sa personne et à les appliquer à la production des utilités propres à satisfaire ce besoin. C'est le premier effort, c'est le premier travail. Les pouvoirs de production des utilités que ce travail lui acquiert constituent son capital personnel. Ce capital, il l'emploie à la production des utilités demandées par ses besoins, à commencer par les intenses. C'est l'entreprise. Il entreprend la recherche et la récolte des végétaux, la chasse ou la pêche des animaux comestibles. Si cette entreprise échoue ou si elle ne lui procure point une somme d'utilités suffisante pour réparer entièrement ses pouvoirs de production, elle se solde par une perte. Cette perte, en se renouvelant, entraîne la destruction des pouvoirs de production et finalement la mort du producteur. Si, au contraire, — et c'est le cas le plus fréquent, l'augmentation du nombre des hommes et le progrès de leur richesse l'attestent, — l'entrepreneur obtient une quantité d'utilités plus que suffisante pour réparer et renouveler ses pouvoirs de production, autrement dit pour rétablir son « capital personnel », l'entreprise se solde par un surplus d'utilités ou un produit net. Ce surplus ou ce produit net, à quoi l'entrepreneur l'emploiera-t-il? Il peut l'employer d'abord à satisfaire plus amplementses besoins actuels. Il peut se nourrir davantage et mieux. Il peut encore le réserver à la satisfaction de son appétit à venir, et se ménager ainsi une épargne de temps. Cette épargne de temps, il pourra la consommer improductivement, en demeurant oisif. Il pourra encore, grâce à la réserve alimentaire, qui lui servira à réparer ses forces dans cet intervalle, entreprendre la production d'utilités propres à satisfaire ses autres besoins, se construire une butte, se fabriquer des vêtements, ou bien encore inventer et façonner des armes et des outils, s'emparer des animaux propres à l'aider dans la production de sa subsistance et les réduire à l'état de domesticité. S'il consacre à ce dernier emploi le temps que le surplus de subsistances, qui constitue le produit net de sa première entreprise, lui a permis d'épargner, [75] il pourra à l'aide des armes et des outils qu'il aura inventés et façonnés, des animaux qu'il aura assujettis, produire une quantité plus considérable d'utilités sous forme de subsistances, en échange d'une moindre dépense du travail et de temps. Au lieu d'être obligé de travailler 12 heures par jour pour produire sa nourriture, il pourra se la procurer par un travail de 6 heures ou, ce qui revient au même, consacrer seulement le travail d'une journée sur deux à sa production alimentaire. Il réalisera donc une épargne d'un jour sur deux, ou de la moitié du temps dont il peut disposer pour la satisfaction générale de ses besoins. S'il emploie cette épargne de temps à découvrir de nouvelles et plus abondantes ressources alimentaires et à inventer des procédés et des instruments d'exploitation plus efficaces, il pourra l'augmenter encore, et ne plus consacrer, par exemple, qu'une journée sur trois à la production de ses aliments. Les deux journées épargnées de ce chef, il pourra les employer à produire les utilités demandées par ses autres besoins. D'abord, il y sera peu habile. Les deux journées qu'il aura épargnées y suffiront à peine; mais, peu à peu, il perfectionnera ses procédés et son outillage, et chaque progrès lui vaudra une nouvelle épargne de temps qu'il pourra consacrer à un surcroît de production. Grâce à l'emploi et à la généralisation du procédé économique de l'association des forces productives et de la division du travail ces épargnes du travail et du temps nécessaires à la production de chaque utilité se multiplieront, et, au bout d'un certain nombre de siècles, l'homme civilisé obtiendra en échange de la même dépense de travail et de temps, mille fois plus d'utilités que n'en obtenait l'homme primitif.
Mais quelle a été la cause premièe de ces progrès successifs? C'est l'épargne d'une partie du surplus des utilités produites par le travail de l'homme primitif. Au début, il met exclusivement en œuvre son capital personnel. Peu à peu, grâce au procédé de l'épargne, il augmente ce capital, en développant ses aptitudes productives et il y joint un capital immobilier et mobilier composé de pouvoirs de production, sous forme de terres cultivables, de bâtiments d'exploitation, d'outils, de machines, de matières premières et d'approvisionnements de toute sorte. Grâce à la mise en œuvre de ces [76] auxliaires animés ou inanimés, il obtient en échange de la même dépense de travail et de temps, une somme croissante d'utilités.
Sous le régime de la production isolée, tout producteur recueille à la fois le fruit de la mise en œuvre de son capital personnel et celui de l'emploi de son capital mobilier et immobilier. Sous le régime de la production associée et divisée, qui se substitue progressivement à celui-là, et qui est aujourd'hui prédominant, la séparation se fait entre ces trois sortes de capitaux: un certain nombre de producteurs arrivent à posséder des quantités considérables de capitaux mobiliers et immobiliers, tandis que la multitude en est à peine pourvue. Parfois même cette multitude est réduite en esclavage, et elle est comprise alors avec les bêtes de somme dans le capital mobilier de ses propriétaires. Lorsque l'esclavage cesse d'exister, la multitude affranchie recouvre la possession de son capital personnel; elle l'exploite pour son propre compte et recueille elle-même le profit de cette exploitation, que s'attribuait auparavant le propriétaire d'esclaves. Or, quelle que soit la nature des capitaux, personnels, immobiliers ou mobiliers, les parts qui leur reviennent utilement dans la production associée et divisée, tendent incessamment à s'équilibrer, par l'opération des lois naturelles de la concurrence et de la progression des valeurs.
III. L'entreprise. 1° La réunion du capital d'entreprise. — Toute production, quelle qu'en soit la nature, s'effectue au moyen d'une entreprise. Les entreprises se présentent sous des formes, des dimensions et avec des modes d'opération différents, mais elles ont deux caractères généraux qui leur sont communs: elles exigent la réunion et la mise en œuvre d'un capital et elles sont constituées en vue d'un profit.
Si nous nous reportons au premier âge de l'industrie lorsque l'homme produit directement la totalité ou la presque totalité des utilités qu'il consomme, lorsque la production indirecte par voie d'échange qui est maintenant la règle dans les sociétés civilisées, n'existe encore qu'à l'état d'exception, les entreprises nous apparaîtront, comme aujourd'hui, constituées par la réunion, en proportions diverses, de capitaux personnels, [77] immobiliers et mobiliers. Si l'homme entreprend de produire sa subsistance, en exerçant l'industrie de la chasse, il devra avoir à sa disposition un espace de terrain, peuplé de gibier, être pourvu d'armes et d'engins appropriés à son industrie et d'une avance de subsistances plus ou moins considérable selon que la capture du gibier exige un temps plus ou moins long et se trouve exposée à des chances plus ou moins aléatoires. S'il demande sa subsistance à l'agriculture, son entreprise exigera la possession d'un domaine cultivable, d'outils et d'animaux de travail, de subsistances, de semences, etc. Ces agents, ces instruments et ces matériaux joints aux forces et aux aptitudes productives de l'entrepreneur se partagent, selon leur nature, en trois catégories: les pouvoirs de production, investis dans l'entrepreneur lui-même, dont il s'est emparé et qu'il a appliqués à la production, par un effort de sa volonté excitée par le besoin, c'est le capital personnel. l'étendue de terre qui est le siège de son industrie et l'atelier agricole ou autre qu'il y a établi, c'est le capital immobilier; les outils, les armes, les matières premières et les provisions qu'il met en œuvre ou dont il a besoin pour subsister, lui et ses auxiliaires jusqu'à ce que le produit soit obtenu, c'est le capital mobilier.
Sous le régime actuel de la production associée et divisée, le capital mis en œuvre dans les entreprises est formé des mêmes éléments, le mode de constitution de ce capital, seul, est différent. Il est constitué, d'abord, au moins pour une part, sous forme de monnaie ou d'instruments d'échange.
Quelle que soit la production, agricole, industrielle, commerciale, artistique, politique, etc., qu'il s'agit d'entreprendre, il faut, avant tout, que l'entrepreneur réunisse un capital proportionné à la nature et à l'importance de l'entreprise qu'il veut fonder. Ce capital, l'entrepreneur en possède une partie: celle qui consiste dans les pouvoirs de production investis dans sa personne: il se peut qu'il possède aussi des terres, des bâtiments d'exploitation, des matières premières, etc., mais s'il veut entreprendre une industrie dont il ne possède point le matériel spécial et qui exige l'emploi d'un personnel auxiliaire, il sera obligé de constituer d'abord sous forme de monnaie, c'est-à-dire d'un instrument ayant un pouvoir général [78] et permanent d'acquisition de toute sorte de produits et services, le capital nécessaire pour acquérir ce matériel et rétribuer ce personnel. L'entrepreneur réunit donc communément le capital dont il a besoin sous forme de monnaie ou de valeurs qu'il puisse aisément et promptement échanger contre de la monnaie. Mais cette monnaie ou ces valeurs monnayables où les a-t-il prises? Il a pu les acquérir lui-même, en accumulant un capital sous une forme ou sous une autre, par une épargne sur sa consommation, et en échangeant les produits dans lequels ce capital est investi contre de la monnaie; mais s'il s'agit d'une entreprise de quelque importance, il en aura demandé la plus grande partie à des capitalistes, qui ont investi leurs capitaux en monnaie ou en valeurs monnayables, en vue de les engager dans une entreprise soit comme associés soit comme prêteurs. Le capital ainsi réuni, qu'en va faire l'entrepreneur? Selon la nature de l'entreprise, il emploiera une partie de la monnaie dans laquelle ce capital est investi à acheter ou à louer des terres, des bâtiments d'exploitation, des machines, etc., et une autre partie à acheter des matières premières, à rétribuer son personnel auxiliaire, à entretenir son matériel, et à pourvoir à sa propre subsistance jusqu'à ce que le produit soit réalisé. S'il achète la terre et fait construire les bâtiments d'exploitation dont il a besoin, il devra, dans la plupart des industries, immobiliser sous cette forme, une portion considérable de son capital. Mais, au lieu d'acheter la terre et de faire construire une ferme ou une usine, il pourra se contenter de les louer. Dans ce cas, il lui suffira de posséder un capital d'entreprise beaucoup moindre, savoir la somme simplement nécessaire pour payer le loyer des immeubles, l'achat des matières premières, les salaires du personnel, etc., encore une partie de cette somme pourra-t-elle être empruntée, dans le cours de la production, à mesure quelle sera exigée par les besoins de l'entreprise. Le capital de l'entrepreneur peut done n'avoir qu'une faible importance, et ne former que la moindre fraction du capital réellement employé dans l'entreprise. Celui-ci se compose de la totalité des capitaux personnels, immobiliers et mobiliers réunis par voie d'achat, de location, d'emprunt, ou possédés par l'entrepreneur lui-mème.
[79]
2° L'opération de la production. — Le capital réuni et investi sous les formes appropriées à la nature de l'entreprise, l'entrepreneur procède à l'opération de la production. S'il s'agit d'un entreprise agricole, il labourera et ensemencera la terre, extirpera les mauvaises herbes et lorsque le blé sera mur, fera la moisson et engrangera le produit. S'ils s'agit d'une entreprise industrielle, il transformera des matières premières en produits fabriqués. S'il s'agit d'une entreprise commerciale, il transportera les produits qui font l'object de son commerce dans l'espace et le temps, de manière à les mettre à la portée du consommateur. S'il s'agit enfin d'une entreprise affectée à la création de produits immatériels ou de services, tels que la sécurité, il mettra en œuvre un capital investi dans le personnel et le matériel appropriés à ce genre de production; il créera le produit ou le service et le fournira; — de gré ou de force, — à ceux qui en ont besoin. Il en sera de même pour chacun des produits ou des services multiples qui sont demandés par les besoins matériels, intellectuels et moraux de l'espèce humaine. Les industries qui les produisent ont chacune leur technologie particulière. Mais toutes exigent invariablement la réunion et la mise en œuvre d'un capital investi dans un personnel et un matériel qui leur soient adaptés, et ce capital doit être rétabli au bout de chaque opération productive. S'il ne l'est point la production ne peut être continuée ou du moins elle ne peut l'être qu'en partie. S'il l'est exactement, elle peut être poursuivie mais sans aucun accroissement. S'il l'est et au-delà, et dans la mesure de l'excédent qu'elle procure, elle peut, au contraire, être accrue.
On a partagé, au point de vue de l'opération de la production, le capital employé dans une entreprise en deux catégories: le capital fixe et le capital circulant. Ce qui caractérise le capital fixe, c'est qu'il n'est consommé qu'en partie dans l'opération de la production et ne doit par conséquent être renouvelé que partiellement. Les facultés ou les pouvoirs productifs investis dans l'entrepreneur, par exemple, s'usent sans aucun doute, et doivent être d'abord réparés, ensuite renouvelés par la génération qui remplace l'entrepreneur vieilli, par un sucesseur en possession de l'intégrité de ses pouvoirs productifs, mais cette usure est successive; elle se [80] répartit sur un nombre plus ou moins considérable d'opérations. Il en est de même pour la terre s'il s'agit d'une entreprise agricole; ses pouvoirs productifs ne sont pas épuisés par une seule récolte et ne doivent être renouvelés que successivement; il en est de même encore pour les bâtiments d'exploitation, les animaux, les outils et les machines. C'est ce qui les a fait ranger sous la dénomination commune de capital fixe. Mais il en est autrement pour les matières premières et les approvisionnements destinés à la création du produit et à l'entretien du personnel et du matériel de l'entreprise. Ceux-ci sont entièrement consommés pendant la durée de l'opération productive et doivent être entièrement renouvelés pour qu'une nouvelle opération puisse être commencée. C'est ce qui les a fait désigner sous le nom de capital circulant.
3° Les frais de production et le produit net. — Pour que l'entreprise puisse subsister, dans son intégrité, il faut donc que le produit soit suffisant pour rétablir la portion du capital fixe qui a été usée dans l'opération productive et la totalité du capital circulant: l'une et l'autre réunies constituent les frais de production. Quel est l'intérêt de l'entrepreneur? C'est d'obtenir le plus grand produit possible en échange de la moindre somme de frais de production, car la différence constitue le produit net qui lui revient sous forme de profit. C'est en vue de ce résultat qu'il établit son entreprise dans le localité et les conditions les plus favorables, sous les dimensions, la forme et avec le mode d'organisation les plus économiques; qu'il emploie les outils, les machines et les méthodes les plus efficaces. En toutes circonstances, il y est excité par la loi de l'économie dos forces. De plus, les lois de la concurrence et de la progression des valeurs, lorsque aucun obstacle naturel ou artificiel n'entrave leur opération, l'y contraignent sous peine de ruine.
Comment se reconstitue le capital qui a été employé à créer le produit; comment encore les frais de production étant couverts, se réalise l'excédent, si excédent il y a, et à qui va cet excédent?
Examinons de quelle manière les choses se passent à ces divers égards, sous le régime de la production isolée, lorsque l'entrepreneur crée le produit pour le consommer lui-même. [81] Supposons un colon, éloigné de tout marché d'échanges, et produisant directement la totalité ou la presque totalité des articles de sa consommation. Il ne peut guère subvenir qu'à ses besoins de première nécessité: il produit sa subsistance, se fabrique des outils, des vêtements et des meubles, pourvoit à leur entretien et à leur renouvellement, élève et protège sa famille, etc., etc. S'il est établi dans une région fertile, il peut, en ne cultivant qu'une faible étendue de terre et en ne consacrant, par conséquent, qu'une partie de son temps à la production des aliments nécessaires à lui et à sa famille, employer le reste à la satisfaction plus ou moins ample de ses autres besoins. Si la terre est peu féconde, il devra en cultiver une étendue plus grande, et employer la presque totalité de son temps à la production alimentaire; dans ce cas, il ne pourra produire qu'une petite quantité des utilités appropriées à ses autres besoins. Si le sol est stérile et s'il ne peut joindre à la culture quelque autre industrie alimentaire, telle que la chasse ou la pêche, il sera obligé d'émigrer ou il finira par périr. Mais, en supposant qu'il obtienne toute la quantité de subsistances qui lui est nécessaire en consacrant les trois quarts de son temps utilisable à la production alimentaire, il réalisera sur cette production, un produit net équivalant au quart restant, soit de 25 %. Ce produit net, calculé d'après une moyenne, en tenant compte de l'inconstance des saisons et de l'inégalité des récoltes, il le recueillera comme producteur et en jouira comme consommateur.
Dans cette hypothèse, il rétablira entièrement le capital personnel, immobilier et mobilier investi dans ses forces et aptitudes productives, sa terre, ses animaux domestiques, ses outils, ses semences, etc., au moyen des utilités qu'il aura produites sous forme de subsistances, et il disposera d'un excédent d'un quart de ces mêmes utilités. Mais comment procédera-t-il pour rétablir son capital et comment employe-ra-t-il les utilités excédentes? Il rétablira son capital en employant les trois quarts de son temps utilisable à préparer une nouvelle récolte, en labourant et ensemençant la terre, en renouvelant son cheptel d'animaux domestiques, en réparant son matériel, et il couvrira ainsi ses frais de production. [82] Quant à son produit net d'utilités excédentes, il pourra le consommer soit en demeurant oisif pendant le quart de son temps disponible, soit en utilisant ce temps pour se fabriquer des outils, des habits, des meubles ou n'importe quels autres articles de consommation. Si le temps qu'il emploie à la production de chacune de ces utilités lui en procure un excédent, il pourra réduire d'autant cet espace de temps et l'appliquer à la production d'utilités répondant à des besoins moins urgents. Et chaque fois qu'il parviendra à réduire les frais de production d'une utilité, il réalisera de même un supplément de produit net, se traduisant par une épargne de temps applicable soit à un surcroît de repos, soit à un surcroît de production.
En résumé, le montant du produit net dépend: 1° de la quantité et du degré de productivité du capital personnel, immobilier et mobilier employé à la production; 2° de l'espace de temps pendant lequel le producteur l'a employé. S'il l'a mis en œuvre pendant toute la durée de son temps utilisable, que nous supposons de 12 heures par jour, il obtiendra le maximum de produit net que comporte le degré de productivité du capital dont il dispose. Si, au contraire, il ne met, son capital en œuvre que pendant le temps rigoureusement nécessaire à l'entretien et au renouvellement de ce capital, il couvrira simplement ses frais de production, et ne recueillera aucun produit net. Dans ce cas, il ne pourra augmenter son capital sous aucune forme ni par conséquent accroître sa production. Bref, le montant du produit net est proportionné au degré de productivité du capital que le producteur met en œuvre et à la durée du temps pendant lequel il le met en œuvre.
Mais dans l'hypothèse de la production isolée, l'entrepreneur partage son temps utilisable entre plusieurs industries; il produit successivement des aliments, des outils, des vêtements. il construit, meuble et entretient son habitation. Cela fait cinq industries distinctes, auxquelles on peut supposer qu'il consacre toute la durée de son temps utilisable, soit 12 heures par jour, en partageant inégalement entre elles cette durée, selon les exigences naturellement inégales des besoins auxquels elles répondent. Il emploiera par exemple [83] 8 heures à la production des aliments; autrement dit il sera agriculteur pendant 8 heures, et il exercera pendant 1 heure seulement chacun de ses autres métiers. Si au bout d'une année pendant laquelle il aura ainsi employé les 8/12 de son capital et de son temps à la production agricole et 1/12 à chacune des quatre autres industries qu'il a pratiquées, il a consommé toutes les utilités ainsi produites, il aura simplement couvert ses frais de production; s'il a obtenu de chacune un surplus qui lui permette de disposer de son temps utilisable pendant un mois de plus, son produit net sera d'un douzième, et il pourra l'employer à augmenter sa production ou la consommer dans l'oisiveté. Mais il peut arriver que sa production agricole lui donne un surplus d'un douzième et celle des outils deux douzièmes, tandis que la fabrication de ses vêtements ne lui donne aucun surplus; dans ce cas, il y aura insuffisance de produit net dans une industrie, surabondance dans une autre, et il devra augmenter la durée du temps qu'il consacre à l'une et diminuer celle qu'il consacre à l'autre, s'il veut équilibrer sa production avec sa consommation. Comme il connaît, d'une part, ses besoins, d'une autre part, la quantité d'utilités que chacun d'eux réclame, il pourra sans difficulté diviser aussi exactement que possible sa journée de travail, de manière à les satisfaire pendant un espace de temps égal. S'il n'opérait point cette division utile de sa journée, son besoin de vêtements n'étant point satisfait pendant un mois, il éprouverait du fait de cette privation une souffrance sans compensation, puisqu'il aurait deux fois plus d'outils qu'il n'en peut employer dans la durée de ce mois. Cette souffrance l'exciterait à employer un surcroît de temps à la production des vêtements, en diminuant d'autant celui qu'il emploie à la production des outils jusqu'à ce que l'équilibre se trouvât rétabli, c'est-à-dire jusqu'à ce que les différentes branches de sa production lui donnassent un produit net égal.
On voit que, sous le régime de la production isolée, le produit net tend naturellement à s'égaliser dans chacune des industries entre lesquelles le producteur partage son capital et son temps. En le supposant d'un douzième il représente un gain de temps d'un douzième. Ce qui signifie que les utilités qui composent le produit net, permettent à celui qui les a [84] produites de subsister dans l'oisiveté pendant un mois ou de les employer à augmenter sa production d'un douzième, de manière à satisfaire plus amplement ses besoins. Supposons qu'il demeure oisif, il aura la jouissance des utilités qu'il consommera pendant ce mois; supposons qu'au lieu de consommer ces utilités, il les capitalise et les emploie à la production, il sera privé de cette jouissance. Or il ne s'en privera qu'à la condition que la mise en œuvre de ce capital lui procure une jouissance supérieure, c'est-à-dire une plus grande somme d'utilités, par exemple une somme qui suffise à sa consommation de deux mois. Sinon, il préférera consommer les utilités contenues dans son produit net plutôt que de les capitaliser et de les employer à un surcroît de production. Il faut donc que la capitalisation de son produit net et l'emploi de ce capital lui rapporte dans la durée d'un mois une somme d'utilités supérieure à celle que contient le produit net. La différence constitue l'intérêt du capital, et ce mot intérêt explique par lui-même pourquoi, au lieu de consommer ou de conserver pour une consommation ultérieure, le produit net, on le capitalise pour l'employer à un surcroît de production.
Poursuivons maintenant cette analyse en passant à la production associée et divisée. Sous ce régime, l'entrepreneur qui produisait auparavant pour lui-même des utilités sous des formes variées, aliments, outils, vêtements, habitation, mobilier ne produit plus des utilités que d'une sorte, et c'est en échangeant ces utilités produites non pour lui-même mais pour autrui, qu'il se procure toutes celles dont il a besoin. Supposons qu'il mette en œuvre comme auparavant son capital personnel, immobilier et mobilier pendant toute la durée de son temps utilisable, soit pendant 12 heures par jour, le même capital produira dans cet espace de temps beaucoup plus d'utilités. S'il l'applique à la production alimentaire pendant 12 heures au lieu de 8, au lieu d'obtenir seulement un surplus proportionnel de quatre mois, il obtendra un surplus de six mois et davantage [4]En échangeant ses [85] produits, il pourra en conséquence se procurer, en sus des utilités nécessaires pour rétablir son capital, une somme d'utilités applicable à la satisfaction de la généralité de ses besoins pendant six mois. Il en sera de même pour les autres productions. Si, au lieu d'employer son capital personnel. immobilier et mobilier pendant 1 heure à la production des outils, l'entrepreneur l'affecte à cet emploi pendant la totalité des 12 heures de son temps utilisable, il produit, non pas seulement douze fois plus d'utilités sous forme d'outils, mais peut-être vingt-quatre fois plus, et à mesure qu'il perfectionnera son matériel et ses procédés, cent fois et mème mille fois plus. Bref, le même capital employé pendant la même durée de temps produit infiniment plus d'utilités sous le régime de la production associée et divisée que sous le régime de la production isolée.
Mais ces utilités, le producteur ne les consomme pas lui-même. Il est obligé de les échanger pour obtenir celles dont il a besoin. Chacun apporte à l'échange les utilités qu'il a produites directement ou indirectement. Le taux auquel se conclut l'échange est déterminé par l'intensité réciproque des besoins, partant de la demande des échangistes; mais nous avons vu que la demande tend perpétuellement à s'égaliser en intensité, du moins sous un régime de libre concurrence. Cela étant, chacun obtient, sous ce régime, une part proportionnelle du produit net réalisé dans la production générale des utilités. Supposons en effet, qu'une industrie, celle de la fabrication des outils par exemple, obtienne un produit net supérieur à celui qui est réalisé par une autre, aussitôt les capitaux se détourneront de celle-ci pour s'engager dans [86] celle-là jusqu'à ce que l'égalité soit rétablie. Ainsi done, dans l'immense et multiple atelier de la production associée et divisée, toutes les industries entre lesquelles elle se partage produisent une masse d'utilités incomparablement supérieure à celle qui était produite dans les ateliers morcelés de la production isolée, une portion de ces utilités sert à couvrir les frais de la production, en rétablissant le capital employé pendant l'opération productive, et le surplus ou produit net se distribue, sous forme de profit, entre les producteurs, en proportion du capital employé, de la productivité de ce capital et du temps pendant lequel il est employé.
Le capital se compose d'utilités que l'opération productive a rétablies ou dù rétablir intégralement. Que rétribue done le profit? Il rétribue le temps pendant lequel les utilités capitalisées ont été employées à la production, au lieu de rester à la disposition de celui qui les possède. Cette rétribution est plus ou moins élevée selon le degré de productivité du capital. Elle s'accroît nécessairement sous l'influence du progrès de l'industrie et avec elle, la valeur du temps utilisable. Le temps utilisable d'un homme vivant dans un pays avancé en industrie a plus de valeur que celui d'un homme vivant dans un pays où l'industrie est arriérée. Car, dans le même espace de temps, le capital personnel, mobilier ou immobilier dont il dispose peut produire une somme plus grande d'utilités.
IV. Comment La Production Peut S'accroitre. — On voit par ce qui précède quel est le processus de l'accroissement de la production. Toute production s'opère par voie d'entreprise. Toute entreprise exige la réunion d'un capital investi dans un personnel et un matériel. Si l'opération productive ne donne que juste la quantité d'utilités nécessaire pour rétablir le capital, la production peut subsister, mais non s'accroître; si elle donne moins, la production diminue et finit par cesser; si elle donne plus, l'excédent ou produit net peut recevoir deux destinations: 1° Le producteur peut le consommer improductivement, en laissant chômer son capital pendant un espace de temps proportionné à la grandeur de son produit net; au lieu de continuer à le mettre en œuvre [87] pendant toute la durée de son temps utilisable, soit pendant 12 heures par jour, il peut ne plus l'employer que pendant 11 heures et s'accorder ainsi une heure de repos supplémentaire; 2° Il peut capitaliser ce produit net, l'investir dans un supplément de personnel et de matériel et l'employer à créer un supplément de production. Mais il ne prendra ce dernier parti qu'à une condition, c'est qu'il trouve un profit à le prendre; c'est que la quantité d'utilités qu'il obtiendra en capitalisant son produit net et en l'employant à la production pendant une heure, dépasse celle qu'il a obtenue et qui lui permet de consacrer cette même heure an repos. Et son excitation à capitaliser sera d'autant plus forte que la productivité du capital sera plus grande, qu'une heure d'emploi d'un capital produira une plus grande somme d'utilités; partant que la somme de jouissances que peut procurer une heure de temps utilisée dépassera davantage celle d'une heure laissée improductive.
L'accroissement successif de la valeur du temps utilisé, tel est done le phénomène caractéristique qui se manifeste dans une société en progrès et qui a pour effet d'encourager la capitalisation, et l'application croissante du capital à la production, sous les formes et dans les proportions requises par la nature des entreprises. Quel est le processus de ce développement de la production? A quelles branches d'industrie s'applique le croît du capital? Il s'applique naturellement à celles qui lui procurent le profit le plus élevé, et successivement aux autres. Les rapports entre elles demeurant les mêmes, le même équilibre subsiste entre la production et la consommation, avec un accroissement de la richesse, proportionné au supplément de capital mis en œuvre. Mais cet accroissement de richesse n'implique pas nécessairement une augmentation de jouissances ou de bien-être. L'augmentation des jouissances ou du bien-être ne peut provenir que d'un progrès de la productivité du capital, dû à de nouvelles inventions et découvertes. La productivité du capital augmentant, les frais de la production diminuent, et cette diminution détermine un accroissement de produit net, qui peut être consacré, soit à un supplément de loisir soit à la formation et à l'emploi d'un nouveau supplément de capital, destiné [88] à satisfaire plus amplement des besoins qui ne pouvaient jusqu'alors être qu'incomplètement desservis. Ces besoins peuvent l'être davantage désormais puisque le progrès réalisé en abaissant les frais de production, partant le prix d'un produit ou d'un service a rendu disponible une partie des moyens d'échange qui servaient à l'acheter.
Ainsi la production peut s'accroître dans deux cas: 1° Par la capitalisation et l'emploi productif du produit net capitalisé, sans l'auxiliaire d'aucun autre progrès. Alors la richesse s'accroît, mais sans augmentation de jouissances et de bienêtre, c'est ce qui arrive dans les pays où l'industrie demeure immobile, tels que la Chine; 2° Par la capitalisation et l'emploi productif du produit net, avec l'auxiliaire du progrès industriel. Alors, il ne se produit pas seulement une augmentation de richesse, il se produit un accroissement général de jouissances ct de bien-être, en supposant bien entendu qu'aucun monopole ne trouble la répartition naturelle des résultats du progrès.
[89]
CHAPITRE III
Le capital personnel. — La production de l'homme.↩
I. Conditions économiques de la production de l'homme. La production des esclaves. — II. La production des hommes libres. — III. L'émigration et l'immigration. — IV. Les obstacles et les encouragements legaux à la production de l'homme. — V. Résumé et conclusion.
La production se diversifie selon la nature des besoins qu'elle a pour objet de satisfaire, ses procédés et ses conditions varient, mais elle a des caractères généraux qui se retrouvent dans toutes ses branches: 1° Toute production s'effectue au moyen d'entreprises; 2° Les entreprises, quels que soient leur forme, leurs dimensions et leur objet exigent la constitution et la mise en œuvre d'un capital investi dans un personnel et un matériel; 3° Toute opération productive s'accomplit dans un certain espace de temps, déterminé par la nature du produit; 4° Le capital employé dans l'opération productive doit être entièrement rétabli, sinon la production ne peut être entièrement continuée; 5° La production ne peut être augmentée qu'à la condition que l'opération productive donne, en sus du capital rétabli, un produit net; 6° Ce produit net se proportionne naturellement au montant du capital employé, à la productivité de ce capital et au temps pendant lequel il est mis en œuvre; 7° Sous un régime de concurrence libre, le produit net tend incessamment à se niveler dans toutes les branches de la production. Enfin, sous ce régime, la production tend, de même, à se mettre en équilibre avec [90] la consommation, au niveau des frais de production, augmentés d'une part proportionnelle de produit net.
Ces caractères généraux se retrouvent, disons-nous, dans toutes les branches de la production, soit qu'il s'agisse des agents et des matériaux qui sont mis en œuvre dans l'immense atelier de l'industrie humaine, ou de la multitude des articles de consommation qu'ils servent à produire. On les observe dans la production de l'homme comme dans toute autre.
I. Conditions économiques De La Production De L'Homme. La Production Des Esclaves. — La vie humaine étant limitée dans le temps, l'homme considéré simplement comme un agent productif doit non seulement être entretenu et réparé, mais encore incessamment renouvelé. Plus la durée de son existence est courte, plus considérable est le capital nécessaire au renouvellement des générations qui fournissent le personnel de la production. Tout accroissement de la durée de ce personnel, de mème que toute augmentation de sa productivité, toute diminution du nombre des individus improductifs par le fait de défectuosités physiques ou morales, procure à la généralité une économie du capital employé à la production de l'homme et en rend disponible une portion qui peut être appliquée à la création d'autres produits.
Comme toute autre production, celle de l'homme exige la réunion d'un capital, et ce capital doit être augmenté à mesure que l'industrie humaine, en se perfectionnant, exige chez l'individu qui la dirige ou la dessert des aptitudes productives d'un ordre plus élevé et des connaissances plus étendues. L'homme qui entreprend de fonder une famille est obligé de trouver soit dans un capital préalablement accumulé soit dans le produit de son travail les ressources nécessaires pour élever ses enfants jusqu'à ce qu'ils soient en état de pourvoir eux-mèmes à leur subsistance; de plus, l'homme ou tout au moins la femme doit consacrer à cette élève une partie de son temps utilisable. Nous retrouvons done ici, comme dans les, autres branches de la production, la réunion et la mise en œuvre d'un capital sous la forme d'un personnel et d'un matériel, appliqués à une entreprise [91] productive. Cette entreprise doit couvrir ses frais pour que la production puisse être continuée, et donner un produit net pour qu'elle puisse être augmentée. Ceci est manifeste lorsque la production de l'homme s'opère sous le régime de l'esclavage. Dans les états à esclaves de l'Union américaine par exemple, la production des esclaves était une branche importante de l'industrie agricole; elle avait fini par se spécialiser et se concentrer dans les régions où elle pouvait s'opérer avec le plus d'économie et de profit.
Les états à esclaves, écrivions-nous quelques années avant l'émancipation, se divisent en deux catégories: les pays de production et ceux de consommation. Dans les premiers on élève les esclaves; dans les seconds on les applique à la culture du sol. On évalue à 80,000 environ le nombre des esclaves qui sont annuellement transportés des états éleveurs (breeding states) dans le-états consommateurs.
Les états éleveurs sont le Delaware, le Maryland, la Virginie, la Caroline du Nord, le Kentucky, le Tennessee et le Missouri. Le sol de ces états n'étant point propre aux grandes cultures du sucre et du coton, et les denrées qu'on y cultive, le tabac, le chanvre et les céréales n'exigeant en comparaison qu'un nombre peu considérable de travailleurs, les esclaves y sont nourris principalement eu vue de l'exportation. L'élève de cette espèce particulière de bétail est devenue une branche importante de la production. Les éleveurs l'ont organisée sur une grande échelle. Non seulement ils s'attachent à la développer de manière à proportionner leurs approvisionnements aux demandes croissantes des états du Sud, mais encore ils donnent une attention toute spéciale à l'amélioration de leurs produits. Ayant remarqué que les mulâtres se vendent mieux que les nègres, ils ont encouragé, même par des primes, le mélange des races. Le meilleur sang de la Virginie coule dans les veines des esclaves, dit un des témoins cités dans l'enquête, le révérend M. Paxton, et l'on rencontre fréquemment des esclaves entièrement blancs . . . L'élève des esclaves donne communément des profits élevés. Au témoignage des intéressés eux-mêmes, aucune propriété n'est d'un meilleur rapport que celle des jeunes négresses lorsqu'elles sont saines [92] et fécondes [5]La valeur d'un esclave adulte est, en moyenne, de 600 dollars. Toutefois le prix des esclaves est sujet à des variations considérables: ces outils vivants de la production se vendent plus ou moins cher selon l'état du marché du coton et du sucre; lorsque ces articles sont très demandés, le prix des esclaves s'élève; lorsqu'ils le sont peu, les esclaves se vendent à vil prix. Comme tous les autres producteurs, les éleveurs d'esclaves s'efforcent d'augmenter leurs débouchés et de se préserver de la concurrence étrangère. Ce sont les éleveurs de la Virginie et de la Caroline qui ont été les plus ardents à demander l'annexion du Texas et qui se sont montrés, en toute occasion, les chauds adversaires de l'importation des nègres d'Afrique [6]
Au point de vue économique, cette production ne différait point des autres, et notamment de celle du bétail, dont elle n'était, dans l'esprit des éleveurs, qu'une branche particulière. Elle s'opérait dans des exploitations agricoles, comprenant un capital immobilier sous forme de terres, de bâtiments et de reproducteurs, un capital mobilier sous forme d'approvisionnements, enfin un capital personnel, investi dans l'éleveur lui-même et dans les employés de son exploitation, surveillants, comptables, médecins, etc. La vente ou la location des « produits » servait d'abord à couvrir les frais de production. Si ces frais n'avaient pas été couverts, si la réalisation des produits n'a vait pas suffi pour entretenir la terre, les bâtiments et les reproducteurs, renouveler ceux-ci, rétablir les approvisionnements et le personnel de l'exploitation, la production n'aurait pu être continuée. Elle n'aurait pu se développer, si l'entreprise n'avait point donné un produit net et elle aurait été abandonnée si ce produit net, réalisé sous forme de profit, avait été inférieur à celui des autres branches de la production.
Remarquons encore que les profits des éleveurs s'élevaient d'autant plus que leur exploitation était organisée et gérée [93] avec plus de soin et d'économie, qu'ils se préoccupaient davantage de l'amélioration de la qualité de leurs produits, qu'ils réussissaient mieux à les préserver des épizooties; enfin qu'ils disposaient d'un marché plus avantageux. Comme les autres producteurs, ils s'efforçaient à la fois d'agrandir ce marché et de le préserver de la concurrence étrangère; enfin, ils s'appliquaient à proportionner leur production à l'étendue de leur débouché. Les lois naturelles de la concurrence et de la progression des valeurs les y obligeaient d'ailleurs. Lorsque l'élève des esclaves, ne suffisait pas à la demande, — et il en était ainsi lorsque la production du coton et du sucre était en voie d'accroissement. — le prix des esclaves s'élevant dans une progression plus rapide que celle du déficit, l'augmentation du taux des profits ne tardait pas à attirer la concurrence et à provoquer l'augmentation de la production, jusqu'à ce que l'équilibre se fût rétabli au niveau des frais de production avec adjonction d'un profit proportionné à celui de la généralité des autres industries. Si l'élève des esclaves continuait à s'accroître de manière à excéder la demande, le phénomène opposé se manifestait, le prix des esclaves baissait dans une progression analogue et la production diminuait jusqu'à ce que l'équilibre se trouvât de nouveau rétabli. Dans les deux cas, le déficit ou l'excédent de la production ne pouvait jamais constituer qu'une fraction assez faible de la quantité utilement produite; en d'autres termes, la population esclave ne pouvait ni demeurer sensiblement insuffisante, ni dépasser sensiblement le débouché qui lui était ouvert. Alors même que l'intérêt des éleveurs ne leur aurait pas commandé, de régler strictement leur production sur l'étendue de leur débouché, les lois naturelles de la concurrence et de la progression des valeurs y auraient pourvu.
II. La Production Des Hommes Libres. — Au point de vue du droit, la condition de l'homme libre diffère absolument de celle de l'esclave: au lieu d'être la propriété d'un maître, il est son propre maître, il dispose à sa volonté de sa personne et de ses biens. Il peut les employer notamment et il les emploie généralement à fonder une famille. Mais cet emploi comme les autres est soumis aux lois économiques: [94] ces lois gouvernent la production de l'homme libre aussi bien que celle de l'esclave.
Nous nous en convaincrons en nous reportant à l'époque où une population esclave vient d'être émancipée.
Les exploitations consacrées à l'élève des hommes réduits à la condition de bêtes de somme ont disparu. Les anciens esclaves devenus libres ont cessé de pourvoir à leur reproduction aux frais et au profit d'un éleveur. Cependant, sous le nouveau régime comme sous le précédent, la production de l'homme continue d'exiger la réunion et la mise en œuvre d'un capital: l'atelier de production n'est plus le même, il s'est individualisé et la petite industrie a remplacé la grande. Mais il faut un abri, si étroit et pauvre qu'il soit, pour élever une famille: capital immobilier; il faut que l'enfant soit nourri, entretenu, éduqué, jusqu'à ce qu'il puisse pourvoir lui-même à sa subsistance, c'est une avance qui doit absolument lui être faite: capital mobilier; enfin l'élève et l'éducation, fussent-elles rudimentaires, exigent tout au moins les soins de la mère pendant une partie de son temps utilisable: capital personnel. La somme de ces avances constitue les frais de production de l'homme, qu'il soit libre ou esclave. Ces frais s'élèvent plus ou moins haut, d'abord suivant le prix des subsistances, des vêtements, du logement, de l'éducation, la valeur du temps utilisable de la mère, etc., ensuite, suivant les frais des maladies et les risques de la mortalité infantile, ces frais et risques augmentant d'autant le coût de chaque génération, et, dans chaque famille, les dépenses faites pour les morts devant être ajoutées aux frais de production des survivants. N'oublions pas que les dépenses de l'éducation et, en particulier, de l'instruction professionnelle sont naturellement diverses et inégales, suivant la situation que l'enfant, devenu homme, est destiné à occuper et l'industrie ou la profession pour laquelle il est préparé. A cet égard, les différences sont sensibles: un enfant destiné à exercer un métier qui n'exige guère que la mise en œuvre de la force physique et qui lui permettra de pourvoir de bonne heure à sa subsistance, tel que le métier de manœuvre ou de terrassier, ne nécessitera qu'une faible avance de capital. Cette avance pourra, au contraire, s'élever très haut si l'enfant est destiné [95] à exercer une profession libérale, la médecine, le barreau, l'enseignement, les beaux-arts, surtout si cette profession exige un long apprentissage ou un long stage avant que celui qui la pratique puisse en vivre. Ajoutons qu'à mesure que l'industrie se perfectionne, elle exige du personnel qui la dessert à tous les degrés une culture plus développée, et par conséquent plus coûteuse; en un mot, les frais de production de l'homme vont croissant pour ainsi dire dans la mesure des progrès de l'industrie.
Ces frais de production, l'éleveur d'esclaves de la Virginie ou de la Caroline du Nord s'en remboursait avec adjonction d'un profit, par la vente ou la location de ses « produits », dès que ceux-ci avaient acquis leur pleine valeur marchande, et nous avons vu aussi qu'il augmentait ou diminuait sa production selon les besoins du marché, de manière à couvrir ses frais et à réaliser le profit le plus élevé possible.
Comment les choses se passent-elles, à ces divers égards, sous un régime de liberté? C'est toujours en vue d'un profit, impliquant une somme plus ou moins grande de jouissances que s'opère la production de l'homme; seulement la nature de ce profit se modifie. Au profit industriel que l'éleveur avait uniquement en vue se substitue en totalité ou en partie un profit physico-moral. Nous disons en totalité ou en partie, car nous allons voir que la perspective d'un profit industriel ne cesse point d'exercer, dans la classe la plus nombreuse de la population, une influence déterminante sur la production de l'homme. En effet, cette production est incomparablement plus abondante dans la classe ouvrière, c'est-à-dire dans la partie la moins aisée de la population que dans les classes moyenne et supérieure. A quoi tient cette différence? Sans doute, les frais de production d'un enfant destiné à l'exercice d'un métier qui peut être entrepris de bonne heure et n'exige que peu de frais d'éducation et d'apprentissage, sont moindres que ceux d'un enfant destiné à une profession libérale, mais il faut bien remarquer que la différence entre les ressources qui peuvent être appliquées à l'élève d'une famille dans les régions moyennes ou supérieures de la population et dans les régions inférieures, est bien plus forte encore et que l'avance du capital nécessaire à la production d'un homme représente [96] de bien moindres privations dans celles-là que dans celles-ci. Il semblerait done que la production de l'homme dût y être plus abondante. Cependant, c'est le phénomène contraire que l'on observe dans la généralité des pays civilisés. Tandis que la production de l'homme est parfois surabondante dans les classes inférieures, elle demeure insuffisante et le devient de plus en plus dans les classes supérieures. C'est au point que, même dans les pays où la population est en voie de rapide accroissement, les classes supérieures finiraient par disparaître si elles ne se recrutaient pas incessamment dans les régions qui s'étagent au-dessous d'elles [7]. Quelle est la raison [97] de ce phénomène? Cette raison n'est nullement du ressort de la physiologic comme on s'est plu à l'affirmer, c'est une raison purement économique. C'est que, dans les classes inférieures la production de l'homme rapporte un profit, à la fois industriel et physico-moral, — un profit industriel provenant de l'exploitation aussi hâtive et aussi prolongée que possible du travail des enfants, un profit physico-moral, consistant dans les jouissances de la famille, tandis que dans les classes supérieures où, soit par le fait d'un plus grand développement du sentiment et des devoirs de la paternité ou de l'absence d'un débouché approprié au travail des enfants, soit par l'influence de l'opinion et des mœurs, le profit physico-moral résultant des jouissances de la famille est le seul mobile qui détermine la production de l'homme. Or, l'insuffisance de plus en plus notoire de cette production n'atteste-t-elle pas celle du mobile unique qui pousse à l'entreprendre?
A ce propos, on a taxé d'immoralité ce qu'on a appelé le malthusianisme de la bourgeoisie, c'est-à-dire la limitation volontaire du nombre des enfants dans le mariage. Que cette limitation soit poussée à l'excès, et qu'elle accuse la prédominance des appétits matériels, du goût du luxe et de l'ostentation, du désir égoïste de s'épargner les privations et les soins que nécessite l'élève d'une famille nombreuse, nous ne le contestons pas. Lorsque le profit physico-moral que procure l'accomplissement bonâ fide du précepte: croissez et multipliez, n'équivaut pas à la somme des sacrifices, partant des souffrances que représentent les frais non remboursables d'une production non limitée, on la limite au-dessous du point où le profit physico-moral est balancé par une somme correspondante de souffrances. Ajoutons toutefois qu'aux considérations purement égoïstes qui déterminent d'habitude cette limitation s'en joignent d'autres tirées de l'intérêt même des enfants, surtout dans les pays où le débouché ouvert à la population est étroitement limité ou bien encore où les [98] ressources que l'on peut employer à l'élève d'une famille sont précaires.
Sans excuser les tendances trop restrictives de la production de l'homme dans les régions supérieures de nos sociétés civilisées, on peut cependant les considérer comme moins nuisibles que les tendances opposées, qui prévalent dans les régions inférieures. Ici, le mobile qui détermine la production de l'homme n'est pas seulement un profit physico-moral, c'est encore un profit industriel, résultant de l'exploitation du travail des enfants. Dans les branches de la production agricole où les enfants peuvent être utilisés de bonne heure et surtout dans les foyers de l'industrie manufacturière, où ils remplacent économiquement les adultes dans un grand nombre d'emplois, on trouve profit à les multiplier. Il n'est pas rare de rencontrer des familles d'ouvriers, où la femme et les enfants employés dans les manufactures, nourrissent le père de famille adonné à l'oisiveté et à la débauche, qui les exploite comme des esclaves. Quoique ces produits humains, mal soignés, insuffisamment nourris et écrasés sous le faix d'un labeur dépassant leurs forces, subissent un déchet considérable, quoique la mortalité des enfants de la classe ouvrière dans les centres manufacturiers soit relativement énorme, le profit que procure le travail des survivants compense et au-delà la perte des frais de production des morts. En diminuant ce profit, les restrictions opposées au travail des enfants dans les manufactures ne peuvent manquer d'agir pour diminuer la production de l'homme, au sein de la classe ouvrière. Si elle venait à ne plus rapporter qu'un simple profit physico-moral, on peut prédire à coup sûr qu'elle ne tarderait pas à y être encore plus étroitement limitée qu'elle ne l'est aujourd'hui dans les couches supérieures. Car n'en déplaise aux courtisans de la démocratie, le sentiment de la paternité et l'amour de la famille sont moins développés en bas de l'échelle sociale qu'ils ne le sont en haut.
En résumé, la production de l'homme, comme toutes les autres, est limitée: 1° par le capital qui peut y être appliqué; 2° par le profit qu'elle peut rapporter, et dont le montant, comparé à celui des autres branches de la production, détermine et règle l'apport du capital. Ceci est de toute évidence [99] dans le cas de la production des esclaves. Dans les breeding states de l'Union américaine, l'apport du capital dans l'industrie de l'élève était visiblement déterminé par le taux des profits de cette industrie. Lorsque ce taux dépassait celui des profits des plantations de sucre ou de coton, les capitaux étaient attirés de préférence dans la production de l'homme; ils s'en éloignaient, au contraire, lorsque le taux de ses profits descendait au-dessous du niveau commun. L'observation atteste que les choses se passent de la même manière dans le cas de la production des hommes libres. Dans ce cas, la nature du profit subit, à la vérité, une modification. Ce profit n'est plus seulement industriel; il réside encore dans la satisfaction donnée à un instinct physique et à un sentiment moral. Or si, dans les régions supérieures de la société, où le profit physico-moral agit seul, il demeure généralement insuffisant pour déterminer l'apport du capital nécessaire à la reproduction utile de l'espèce, dans les régions inférieures, où le profit industriel s'ajoute au profit physico-moral et peut même être considéré comme prépondérant, ce double profit est assez élevé pour attirer le capital nécessaire à la production du nombre d'hommes, demandé non seulement par les emplois ordinaires de la classe ouvrière, mais encore par ceux auxquels la production des classes en possession de les recruter ne suffit point.
C'est donc le taux du profit qui détermine l'apport du capital dans la production de l'homme comme dans toute autre. Mais qu'est-ce qui détermine ce taux? Dans l'industrie de l'élève des esclaves, il dépendait de l'état du marché ou de la « demande ». Lorsque la demande des esclaves s'augmentait, on voyait s'élever leur prix de vente ou de location, et, par conséquent, le profit que procurait leur élève. Lorsque la demande venait à diminuer, le prix baissait, et, avec le prix, le taux du profit. Et ce mouvement de baisse se continuait jusqu'à ce que l'offre se fût remise en équilibre avec la demande, au niveau des frais de production, augmentés d'un profit équivalent à celui des autres branches d'industrie. Les choses ne se passent pas autrement, à les bien observer, dans la production des hommes libres. Quand la demande des hommes vient à dépasser l'offre, après une épidémie ou une [100] guerre par exemple, ou bien encore quand de nouvelles inventions, le développement des moyens de communication, l'abaissement des barrières douanières, étendent les débouchés de l'industrie, et par conséquent ceux du travail, on voit s'élever le taux des profits du » capital personnel ». La multitude reçoit des salaires plus élevés, et la diminution de la concurrence dans les emplois supérieurs de la production, augmente de même la rémunération qu'ils procurent. L'augmentation de cette nombreuse catégorie de profits permet d'en capitaliser une plus forte part, et ce supplément de capital est naturellement attiré vers les emplois les plus avantageux. Parmi ces emplois, figure, en première ligne, l'élève d'un supplément de population. Dans les rangs inférieurs de la société, le travail mieux payé des enfants augmente le taux du profit industriel; dans les rangs supérieurs, les difficultés du placement d'une famille nombreuse diminuant, les satisfactions qu'elle procure s'accroissent d'autant et font taire les objections habituelles de la prévoyance. Au contraire, lorsque les débouchés viennent à se rétrécir par une cause ou par une autre, les salaires baissent, la capitalisation diminue, le profit que rapporte un capital employé à la production de l'homme va décroissant, et le mouvement de la population se ralentit jusqu'à ce que l'équilibre de l'offre et de la demande des hommes se soit rétabli au niveau des frais de production augmentés d'un profit équivalent à celui des autres emplois du capital.
III. L'émigration Et L'Immigration. — Comme toutes les autres branches de la production, celle de l'homme peut être insuffisante pour subvenir aux besoins du marché intérieur ou excéder les besoins de ce marché. Dans le premier cas, le déficit attire l'immigration; dans le second cas, l'excédent tombe à la charge de la charité publique et privée ou s'écoule par l'émigration.
Les pays d'immigration peuvent être partagés en deux catégories: 1° Ceux, tels que la France, où les frais de production de l'homme sont artificiellement surélevés par des impôts excessifs, frappant principalement les articles nécessaires à la subsistance et à l'élève d'une famille, et où, d'une autre [101] part, le profit qui procure la production d'une famille nombreuse n'est point considéré comme suffisant pour compenser les privations et les sacrifices qu'elle impose. L'émigration des pays où l'élève est moins coûteuse et plus abondante vient alors combler le déficit; 2° Les pays où la proportion du capital immobilier dépasse celle du capital personnel et mobilier nécessaire aux entreprises de toute nature; tels sont la plupart des pays du nouveau monde, où la terre est offerte en abondance et à vil prix, où les gouvernements vont même jusqu'à allouer une prime aux colons qui apportent le capital personnel et mobilier indispensable pour la mettre en valeur. Dans ces pays neufs, la production de l'homme demeure active, malgré la concurrence de l'immigration, aussi long-temps que la disproportion entre les agents nécessaires de la production, — capitaux immobiliers, personnels et mobiliers, — subsiste, mais à mesure que cette disproportion va diminuant, surtout si, comme il arrive aux états-Unis, l'élève d'une famille est renchérie par un tarif ultra-protectionniste, si les frais de production de l'homme sont artificiellement surélevés, si par conséquent la différence entre ces frais et ceux des pays où l'élève est à bon marché se trouve accrue, on voit apparaître et grandir la tendance à repousser l'immigration.
Les pays d'émigration sont ceux où la proportion du capital personnel nécessaire aux entreprises dépassant celle du capital immobilier et mobilier, l'excédent ne peut être employé.
Les gouvernements sont intervenus tantôt pour empêcher l'émigration et l'immigration, tantôt pour les favoriser, de même qu'ils ont empêché ou favorisé l'importation et l'exportation des produits de l'industrie. Autrefois, l'émigration était généralement entravée ou même prohibée; aujourd'hui, la tendance prédominante est plutôt de faire obstacle à l'immigration.
Que l'intervention des gouvernements dans l'importation et l'exportation des hommes ne se justifie pas mieux que dans celle des produits de leur industrie, c'est ce qui ressort visiblement de l'examen de l'intérêt particulier de chaque nation aussi bien que de l'intérêt général de la communauté des nations.
[102]
L'émigration peut consister dans une exportation d'esclaves ou d'hommes libres. Dans le premier cas, qui ne se présente plus de nos jours qu'à titre d'exception, l'élève et le commerce des esclaves ne different pas, au point de vue économique, de la généralité des autres branches de la production. L'exportation des esclaves procure aux pays d'élève des profits analogues à ceux qui proviennent de l'élève du bétail, par exemple. Plus le débouché intérieur et extérieur qui lui est ouvert s'étend, plus l'élève se développe et plus s'augmente, avec la somme des profits qu'elle peut rapporter, la richesse dont elle est la source. La Virginie, la Caroline du Nord et les autres breeding states comptaient l'élève des esclaves au nombre de leurs industries les plus productives, et l'on conçoit qu'en se plaçant au point de vue de la richesse et de la puissance de l'état, les hommes politiques s'accordassent avec les éleveurs pour réclamer l'annexion du Texas, c'est-à-dire d'une région où cette industrie pouvait trouver un ample supplément de débouchés.
Toutefois, la situation est différente à certains égards lorsqu'il s'agit de l'exportation des hommes libres. Tandis que le prix de la vente des esclaves exportés rembourse leurs frais de production avec adjonction d'un profit, de manière à rétablir et au-delà le capital employé à les produire, en accroissant ainsi directement la richesse nationale, l'émigration des hommes libres ne comporte aucun remboursement analogue. L'émigrant représente le capital que son élève et son éducation ont absorbé, et ce capital est perdu pour la nation au sein de laquelle il a été élevé. Si l'on évalue à 5,000 francs [8]le prix de revient d'un adulte, arrivé à l'âge où [103] l'émigration commence d'habitude, on trouvera que 100,000 émigrants infligent à la nation exportatrice une perte d'un demi-milliard. Il semblerait, d'après cela, que des mesures destinées à entraver ou même à prohiber l'émigration dussent être conformes à l'intérêt de la nation, en empêchant la déperdition de sa richesse et l'enrichissement à ses dépens des pays d'immigration. Mais la question est plus compliquée qu'elle ne le paraît au premier abord. Les pays d'émigration sont ceux où, d'une manière accidentelle ou permanente, la production de l'homme partant l'offre de ses services excèdent la demande du marché intérieur. Quoique, sauf des circonstances exceptionnelles, telles que la maladie des pommes de terre en Irlande, l'excédent ne puisse jamais dépasser une fraction relativement faible de la population, cet excédent constitue une lourde charge pour la communauté. Si réduits que soient ses frais d'entretien, ils forment cependant un total considérable. En les évaluant à 250 francs par tête seulement [9]c'est pour 100,000 individus, une dépense annuelle de 25 millions représentant au taux de 500, une somme d'un demi-milliard, c'est-à-dire une somme égale à la perte que causerait l'émigration de ces 100,000 individus. [104] Ajoutons que la présence d'un excédent de population, en rompant l'équilibre de l'offre et de la demande de travail, a pour effet d'abaisser le taux de la rétribution des capitaux personnels au profit de celle des capitaux immobiliers et mobiliers; en sorte que l'entretien de cet excédent retombe, par une répercussion inévitable, à la charge de la multitude qui vit du produit de son travail. Enfin, si l'émigration cause la perte directe et immédiate du capital que représente l'émigrant, elle est une source de bénéfices indirects et ultérieurs pour la nation exportatrice. Sans parler des émigrants qui, après avoir accumulé un capital à l'étranger, le rapportent avec eux dans la mère-patrie, ceux-là même qui ont émigré d'une manière définitive conservent et propagent le goût des produits qu'ils avaient l'habitude de consommer dans leur ancienne métropole, et ils fournissent ainsi à son industrie un débouché bien autrement avantageux que celui qu'ils lui procuraient lorsqu'ils se trouvaient chez elle à l'état d'excédent paupérisé de la population.
Au point de vue de l'intérêt de la richesse d'une nation, les mesures prohibitives de l'immigration ont un caractère encore plus clairement nuisible soit qu'il s'agisse d'une importation d'esclaves ou d'une immigration d'hommes libres. Sans doute, on conçoit que les éleveurs des breeding states, en se plaçant au point de vue étroit et actuel de leur industrie se soient accordés avec les philanthropes négrophiles pour réclamer la prohibition de l'importation des nègres d'Afrique; car cette importation avait pour effet d'abaisser le taux de leurs profits. Mais, en procurant en plus grande abondance et à meilleur marché le travail nécessaire à la culture du coton et du sucre, elle encourageait le développement de ces deux productions, probablement dans une plus forte mesure qu'elle ne décourageait celle de l'élève. D'un autre côté, les producteurs de sucre et de coton de l'Union américaine se trouvant en concurrence avec les planteurs du Brésil et de Cuba, où les importations des nègres d'Afrique continuaient à être tolérées, la hausse artificielle causée par la prohibition ne pouvait manquer à la longue de les mettre hors d'état de soutenir cette concurrence. Leur production aurait diminué et la décadence de leurs plantations aurait entraîné, comme une [105] inévitable conséquence, celle de l'industrie des éleveurs, partant une diminution générale dela richesse des états à esclaves de l'Union.
En ne tenant même aucun compte des maux inhérents au régime de l'esclavage, l'importation des hommes libres est encore bien autrement profitable que celle des esclaves. Nous avons vu plus haut qu'en évaluant à 5,000 fr. la valeur d'un adulte, — et l'immense majorité des immigrants se compose d'adultes, — une immigration de 100,000 individus libres représente l'apport d'un capital d'un demi-milliard, sans compter le montant, insignifiant en comparaison, du capital mobilier qu'ils apportent avec eux. Or, tandis qu'il faut acheter les esclaves et exporter le capital représenté par leur prix d'achat, l'importation des hommes libres est gratuite. Ce fait suffirait seul à expliquer le rapide et prodigieux développement de la richesse dans les contrées où les émigrants affluent de préférence. Aux états-Unis, par exemple, où l'immigration européenne a déversé depuis un siècle environ 15 millions d'individus [10] , pour la plupart physiquement et moralement supérieurs à la moyenne, elle représente un apport de capital de 75 milliards de francs, auquel il faut joindre le capital mobilier importé par les immigrants. En France, les 1,100,000 étrangers [11]que relève le dénombrement le plus récent représentent une adjonction de plus de 5 milliards au capital national.
Comment done s'expliquer la tendance restrictive de l'immigration qui se manifeste aujourd hui dans un grand nombre de pays, particulièrement même dans ceux qu'elle a le plus contribué à enrichir?
[106]
Cette tendance n'est, il faut bien le remarquer, qu'une des manifestations du protectionnisme, actuellement en pleine recrudescence. Les ouvriers invoquent contre l'immigration du travail étranger les mêmes arguments que les industriels font valoir contre l'importation des produits similaires de leur industrie, et le but que poursuivent les uns et les autres est identique: c'est l'exhaussement des profits et des salaires au-dessus du niveau naturel de la concurrence. Avons-nous besoin de dire que cet exhaussement artificiel, en supposant que la protection réussisse à le produire, est également nuisible, soit qu'il s'agisse des profits ou des salaires? Pour ne parler que de ces derniers, une industrie qui paie des salaires artificiellement exhaussés par la protection se trouve dans une situation d'infériorité vis-à-vis de ses concurrentes qui paient des salaires naturels, et ses débouchés ne manquent pas de se rétrécir à la longue. Le rétrécissement des débouchés de l'industrie amène celui des emplois du travail et la baisse des salaires avec la diminution générale de la richesse, Le même résultat se produit, quoique dans une mesure moindre, lorsque les ouvriers dont on prohibe l'immigration ne font dans le pays qu'un séjour temporaire et remportent comme les Chinois, dans leur mère-patrie, les économies qu'ils ont faites sur leur salaire. En effet, on ne leur a payé ce salaire qu'à la condition d'obtenir une valeur supérieure à celle qu'on leur a fournie en échange de leur travail, et la différence s'ajoute à la richesse nationale. Dira-t-on encore que l'importation des « produits » de l'élève étrangère décourage l'élève indigène? Que si cette importation était interdite, la production intérieure serait plus abondante? Mais, d'une part, il faut considérer qu'au point de vue de l'accroissement général de la richesse, une importation gratuite d'un produit quelconque procure un bénéfice incontestable et qu'en admettant même qu'elle décourage les capitaux de se porter dans la branche d'industrie qui subit cette concurrence inégale, ces capitaux subsistent et peuvent s'engager dans les autres industries dont le débouché se trouve accru de tout le montant de l'économie réalisée. D'une autre part, il faut considérer qu'en exhaussant artificiellement le taux des salaires, on provoque un accroissement de l'élève, qui finit par dépasser [107] les besoins du marché et les dépasse d'autant plus vite que la hausse est plus forte, par conséquent qu'elle agit plus efficacement pour rétrécir les débouchés de toutes les industries qui paient des salaires que là protection a élevés au-dessus du niveau naturel de la concurrence.
Cependant, il est douteux que ces considérations touchent les ouvriers protectionnistes plus qu'elles n'ont touché les industriels. Les uns et les autres n'envisagent d'habitude que leur intérêt actuel et borné, et ils emploient leur influence à le faire prévaloir sur l'intérêt général et permanent de la nation. Or, tel est le vice de l'organisation politique des états modernes que les nations se trouvent aujourd'hui, plus qu'elles ne l'ont été à aucune autre époque, à la merci des convoitises égoistes et aveugles des intérêts particuliers. Il y a donc apparence qu'à mesure que croîtra l'influence politique de la multitude des salariés, le protectionnisme ouvrier réussira à opposer à l'immigration des obstacles analogues à ceux que le protectionnisme industriel a dressés contre l'importation des produits étrangers.
IV. Les Obstacles Et Les Encouragements Légaux A La Production De L'Homme. — Mais les gouvernements n'interviennent pas seulement pour empêcher ou encourager l'émigration et l'immigration; ils sont intervenus de tout temps, tantôt pour activer tantôt pour ralentir la production de l'homme, dans les limites de leur juridiction. S'ils abandonnaient généralement, dans le passé, aux éleveurs et aux propriétaires d'esclaves et de serfs, le soin d'en régler la production sur les besoins du marché, ils se préoccupaient fréquemment d'augmenter celle des hommes libres, lorsque le profit qu'elle procurait n'y suffisait point. Mais ni les primes qu'ils accordaient à la production des familles nombreuses, ni les pénalités qu'ils édictaient contre les célibataires ou les impôts dont ils les frappaient ne produisaient un résultat appréciable. Plus tard, lorsque les classes inférieures eurent été émancipées de l'esclavage et du servage, on entreprit, selon les intérêts dominants, tantôt de limiter leur reproduction, tantôt de l'encourager. Dans les localités où le débouché de la population était particulièrement resserré et demeurait [108] stationnaire, et où l'excédent tombait à la charge de la communauté, faute de pouvoir s'écouler par l'émigration, la coutume et les règlements interdisaient le mariage, à moins que les conjoints ne prouvassent qu'ils avaient des moyens suffisants pour élever une famille [12]. Ces coutumes et ces règlements se trouvaient renforcés par les pénalités matérielles et la reprobation morale qui atteignaient les unions illégitimes et leurs produits. Dans les localités, où, au contraire, comme en Angleterre au XVIIIc siècle, les progrès de l'industrie accroissaient rapidement la demande du travail et en faisaient hausser le prix, les intérêts prépondérants des industriels et des propriétaires agissaient pour encourager l'élève d'un supplément de travailleurs, en mettant une partie des frais de cette élève à la charge de la communauté. Mais qu'arriva-t-il? C'est que cet encouragement artificiel eut à la fois pour effet d'augmenter bientôt à l'excès la production de l'homme et d'en abaisser plus encore la qualité, en développant particulièrement la production de la classe dégradée qui s'était accontumée à demander ses moyens d'existence à la charité publique et privée. Alors les chefs d'industrie et les propriétaires s'aperçurent que la taxe des pauvres, dont ils avaient favorisé d'abord l'extension, ne leur procurait qu'une économie illusoire tout en leur imposant un fardeau de plus en plus lourd à titre de membres de la communauté, et ils employèrent leur influence à restreindre, aussi rigoureusement que possible, ce mode d'encouragement de la production de l'homme.
V. Résumé Et Conclusion. — En résumé, la production de l'homme exige comme toute autre, la réunion et la mise en œuvre d'un capital, et elle s'opère sous la forme d'une entreprise. Cette entreprise se constitue, encore comme toute autre, en vue d'un profit. Dans le cas de la production des esclaves, ce profit est purement industriel, et il tend incessamment à se mettre au niveau des profits de la généralité des branches de la production. Lorsqu'il dépasse ce niveau, les capitaux sont attirés dans l'industrie de l'élève, lorsqu'il [109] tombe au-dessous, ils s'en éloignent jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli; en d'autres termes, l'élève de l'homme dans l'état d'esclavage, tend à se mettre en équilibre avec la demande, au niveau du prix nécessaire pour couvrir ses frais de production augmentés d'une part proportionnelle de produit net. La production de l'homme, dans l'état de liberté, est soumise à la même loi, sauf une différence dans la nature du profit qui détermine l'apport du capital nécessaire à l'élève d'une famille. Dans les classes inférieures, ce profit est à la fois physico-moral et industriel, l'exploitation du travail des enfants couvrant, parfois même au-delà, les frais de leur production. Dans les classes supérieures, les jouissances de la famille constituent seules le profit. Sous l'excitation du double profit que leur vaut la production de l'homme, les classes inférieures ont une tendance à accroître d'une manière surabondante leur population, tandis que les classes supérieures sont plutôt portées à restreindre à l'excès la leur. Ces deux tendances opposées se compensent en partie, mais peut-être au détriment de la qualité de la population. En tout cas, sauf dans des circonstances exceptionnelles, la production de l'homme ne peut comporter qu'un faible excédent ou un faible déficit, — la loi de progression des valeurs ayant pour effet soit de faire tomber rapidement la rétribution du « capital personnel [13]« au-dessous du taux [110] nécessaire pour le rétablir intégralement soit de la faire monter jusqu'à ce que le déficit soit comblé. Lorsque l'élève vient à dépasser les besoins du marché intérieur, ou elle se ralentit sous l'influence de l'abaissement des salaires ou l'excédent s'écoule par l'émigration; lorsqu'elle demeure insuffisante, la hausse des salaires appelle l'immigration; d'où une tendance générale à l'équilibre de la production et de la demande du » capital personnel « dans les différentes et multiples sections de l'immense atelier de l'industrie humaine. Les gouvernements n'ont pas manqué d'intervenir tantôt pour empêcher l'émigration et l'immigration, tantôt pour les favoriser, en obéissant en cela comme en tout le reste aux intérêts presque toujours égoïstes et à courte vue de la classe politiquement dominante; ils sont intervenus de même tantôt pour accélérer tantôt pour ralentir l'élève intérieure, mais sans que leur réglementation artificielle ait eu la puissance d'empêcher l'opération des lois naturelles qui gouvernent la production de l'homme.
On voit par là qu'il n'existe point, à proprement parler, de « loi de la population ». Il y a des lois naturelles qui régissent la production de l'homme, exactement comme celle de la généralité des branches de l'industrie humaine.
[111]
On voit aussi combien sont peu fondées et imaginaires les prévisions ordinaires des statisticiens sur l'accroissement probable de la population. Parce que cet accroissement a été général et considérable dans la plupart des pays civilisés, sous l'influence des progrès extraordinaires des sciences appliquées à l'industrie, de la sécurité, etc., qui se sont accomplis depuis un siècle, il ne s'ensuit nullement qu'il doive se continuer. Comme le remarquait déjà Adam Smith, qui a résumé en quelques lignes toute la théorie de la population [14] , la production de l'homme est gouvernée par la demande, c'est-à-dire par le nombre des emplois disponibles. Ce nombre dépend du taux d'accroissement ou de diminution du produit net et de la capitalisation du produit net. Dans les pays où l'industrie est en voie de développement, ce taux s'accroît, dans les pays où l'industrie décline, — et ce déclin est inévitable dans ceux où le militarisme, le protectionnisme et les autres formes du gaspillage et du monopole exhaussent artificiellement les frais de la production, — le produit net et la capitalisation diminuent. Or, la production de l'homme, à son tour, diminue nécessairement avec le capital indispensable pour l'opérer. La hausse temporaire qui en résulte dans la rétribution du travail accélère encore la décadence de l'industrie, en surélevant ses frais de production. L'immigration intervient alors, à la vérité, pour ramener la rétribution du travail au taux du marché général. Mais si l'immigration est entravée, et surtout si elle est particulièrement découragée dans les régions supérieures de la société, — et tel est l'effet du monopole des emplois publics au profit des nationaux, combiné avec la multiplication de ces emplois, — la décadence s'accélera, et à une période d'accroissement de la population, en nombre et en qualité, succède une période de ralentissement, et finalement de décroissance. Bref, il serait aussi oiseux et [112] peu scientifique de déduire du taux actuel d'accroissement de la production de l'homme, le taux de l'accroissement futur, que de vouloir prédire ce que sera dans l'avenir la production du blé, du fer ou des cotonnades, en se fondant sur la progression qu'elle a suivie depuis un siècle.
Cependant, il est une probabilité qui se dégage de l'observation des faits actuels: c'est que la production de l'homme est destinée à s'affaiblir successivement dans les pays appartenant à notre civilisation, à moins que cet affaiblissement ne soit prévenu par quelque progrès dans la constitution économique de la famille. Nous avons constaté la diminution de l'élève dans les régions supérieures de la société par suite de l'insuffisance du profit physico-moral. Or, à mesure que le niveau des classes inférieures va s'élevant, et que les lois et les mœurs opposent un obstacle plus efficace à l'exploitation du travail des enfants, à mesure aussi que les frais de production de l'homme s'augmentent, le profit industriel que procure l'élève va diminuant; le jour où il aura disparu, on peut prévoir que le même déficit qui s'observe aujourd'hui dans la reproduction des classes supérieures se manifestera dans celle des classes inférieures. A moins de se recruter dans les races moins civilisées, au détriment de la qualité de leur population, les peuples qui forment aujourd'hui l'élite de l'humanité, loin de supplanter les autres, seraient donc destinés à diminuer graduellement en nombre et finalement à disparaître, comme ont disparu sous l'influence de la même cause, les peuples dominateurs de l'antiquité.
[113]
CHAPITRE IV
Le capital immobilier. — La production de la terre.↩
I. La propriété foncière est-elle légitime? — II. Les industries qui contribuent à la production de la terre. — III. La découverte. — IV. La conquête et l'occupation. — V. Le gouvernement et ses profits. — VI. Les profits futurs de la création d'un domaine territorial. — VII. Plus value et moins value: 1° La plus value; 2° La moins value. — VIII. Le processus de la création et du developpement de la valeur foncière. — IX. La nationalisation du sol.
I. La Propriété Foncière est-elle Légitime? — De toutes les propriétés, la propriété foncière a été et continue d'être la plus attaquée. L'argument capital de ses adversaires, socialistes, communistes ou anarchistes, est celui-ci: la terre a été donnée gratuitement à l'humanité; de quel droit quelques-uns se sont-ils emparés de ce domaine qui est la propriété naturelle de tous, pour s'attribuer d'une manière exclusive, les fruits de son exploitation [15] ? On conçoit, dit M. Henry [114] George, qu'un individu soit propriétaire de la maison qu'il a construite ou acquise, mais le sol sur lequel cette maison a été bâtie n'a pas été fait de main d'homme, c'est l'œuvre de la nature. En confisquant à son profit cette œuvre qui a été produite pour l'humanité tout entière et non pour une minorité de privilégiés, le propriétaire ne commet-il pas un vol, au détriment de la multitude des non propriétaires? A cet argument, les jurisconsultes, défenseurs de la propriété foncière, n'ont opposé qu une raison insuffisante, en fondant le droit de propriété sur la loi, instituée elle-même dans l'intérêt de la société. C'était admettre implicitement que la société [115] peut être intéressée à dépouiller le grand nombre au profit du petit. C'était encore asseoir la propriété sur une base précaire, car si l'utilité sociale commande aujourd'hui de sacrifier l'intérêt du grand nombre à celui du petit, ne pourra-t-elle pas commander demain tout le contraire? En attendant, ne convient-il pas de restreindre et de réglementer, aussi étroitement que possible, ce monstrueux privilège accordé à une classe particulière sur le domaine de la communauté? Enfin le progrès ne consiste-t-il pas à remplacer la production individualiste qui l'a rendu nécessaire par un régime de production communiste qui le supprime?
[116]
L'utilité sociale ne suffit donc pas à justifier la propriété foncière. Locke lui a trouvé une base plus solide, — celle qui fonde le droit de propriété sur le travail, — en remarquant que la terre ne fournit à l'homme dépourvu d'industrie qu'une quantité presque infinitésimale d'utilités; encore ces utilités investies dans les plantes et les animaux comestibles, l'homme ne les obtient-il pas gratis. Il est obligé de découvrir les plantes alimentaires, de poursuivre le gibier, de façonner les matériaux du vêtement et de l'habitation. Or, ces diverses opérations exigent toujours une certaine dépense de forces et de temps, et c'est cette dépense qui transforme en utilités produites, ou, ce qui est synonyme, en valeurs, les matériaux utilisables fournis par la nature.
Il n'en est pas autrement pour le sol qui contient ces matériaux dans son sein ou à sa surface. L'homme ne crée pas le sol, mais, en se livrant au travail nécessaire pour l'approprier, il crée la valeur qui et l'objet et l'étoffe de la propriété foncière, et cette valeur il la possède à un titre aussi légitime que tout autre. N'en déplaise à M. Henry George, il n'y a aucune différence entre la valeur d'une maison et celle du sol sur lequel la maison est bâtie. L'une et l'autre ont également leur source dans le travail de l'homme et dans son épargne. L'erreur dans laquelle est tombé M. Henry George provient d'une insuffisance d'analyse et cette erreur est d'autant moins excusable que le socialiste américain était mieux placé que personne pour se rendre compte des causes de la valeur du sol. Dans les contrées de notre vieux monde, où la terre est occupée et exploitée depuis un temps immémorial, nous pouvons nous méprendre sur la manière dont s'est créée la propriété foncière; il n'en est pas de même en Amérique. Sans doute, le sol américain était approprié, au moins en partie, avant l'arrivée des Européens, mais cette appropriation ils l'ont considérée comme non avenue. Sauf en de rares circonstances, ils n'ont tenu aucun compte des droits des indigènes, et on peut, au surplus, en dire autant des races conquérantes de notre ancien monde, à commencer par les hommes qui ont conquis le sol sur l'animalité inférieure.
L'analyse économique justifie, comme on le verra, pleinement la légitimité de la propriété foncière; elle met à néant [117] les accusations d'usurpation et de privilège que l'on a élevées contre elle, en démontrant que la terre est appropriée en raison de la valeur qui s'y trouve investie, et que cette valeur c'est l'homme qui l'a produite, comme il a produit et comme il produit chaque jour, toutes les valeurs dont se compose la richesse; enfin, que l'exploitation du sol approprié ne procure point, en sus des profits ordinaires de l'industrie, une « rente » qui scrait le fruit du travail de la nature, confisqué et accaparé par le propriétaire.
II. Les Industries Qui Contribuent A La Production De La Terre. — Comme la plupart des autres productions, celle de la terre exige plusieurs opérations successives et différentes. De même qu'il faut, pour produire un vêtement et le mettre à la portée du consommateur, élever des moutons, filer et tisser la laine, confectionner le tissu et le transporter dans l'espace et le temps, il faut découvrir la terre, la conquérir et l'occuper pour la rendre habitable et exploitable. Ces opérations constitutives de l'appropriation du sol font l'objet d'entreprises distinctes, tantôt séparées et tantôt réunies dans les mêmes mains: 1° Les entreprises de découverte; 2° les entreprises de conquête et d'occupation; 3° les entreprises de gouvernement. En les étudiant dans leur ordre naturel, nous constaterons, en premier lieu, que chacune de ces entreprises a exigé l'emploi d'un capital investi dans un personnel et un matériel; en second lieu que ce capital a été attiré dans cette direction comme dans toute autre par l'appât d'un profit, mais que ce profit ne pouvait dépasser régulièrement celui de la généralité des emplois du capital; enfin, en troisième lieu, que les frais de la première opération ou de la première façon donnée au produit-terre, frais consistant dans le rétablissement du capital augmenté du profit, ont dû être remboursés par la seconde, comme les frais de l'élève des moutons doivent l'être par la filature et le tissage de la laine, ceux de la seconde par la troisième, et que l'ensemble de ces frais de production de la terre a dû être finalement couvert par la valeur réalisée ou réalisable du sol ainsi rendu habitable et exploitable.
[118]
III. La Découverte. — En prenant comme exemple l'appropriation du sol du nouveau monde, nous trouverons que la première des opérations qu'elle a nécessitées, celle de la découverte, a été incontestablement la moins coûteuse. Les expéditions de découvertes dans le nouveau monde ont été faites généralement pour le compte ou avec les subventions des gouvernements qui se sont chargés d'en rembourser les frais et d'en rétribuer les auteurs. Ce remboursement et cette rétribution servaient à couvrir les frais de production et les profits de l'industrie de la découverte. Si l'on tient compte des risques et des aléas de cette industrie, on se convaincra, en consultant l'histoire des découvreurs, à commencer par celle de Christophe Colomb lui-même, que la découverte de l'Amérique n'a pas rapporté à ceux qui l'ont entreprise un profit industriel équivalent à celui de la généralité des autres branches de la production. Seul, ce profit n'aurait certainement pas suffi pour les engager à entreprendre l'industrie de la découverte, s'il ne s'y était joint un profit moral, consistant dans les satisfactions particulières qu'il est dans la nature de cette industrie de procurer.
IV. La Conquête Et L'occupation. — Cependant, la découverte ne suffit point pour rendre une terre habitable et exploitable. Cette terre, il faut la conquérir sur l'animalité et sur les hommes, et l'occuper, en soutenant les procès auxquels son appropriation manque rarement de donner lieu. Ces opérations indispensables exigent l'emploi d'un capital bien autrement considérable que celui qui a été appliqué à la découverte. Elles ne peuvent, en conséquence, être entreprises que par des associations puissantes ou par des états. Ces associations ou ces états, après avoir acquis, ordinairement à peu de frais, la terre simplement découverte, matière première de leur industrie, donnent à cette terre une seconde façon non moins nécessaire que la première, celle de la conquête et de l'occupation. Dans le nouveau monde, la conquête a été généralement peu coûteuse, surtout lorsque les gouvernements cessionnaires des découvreurs, l'ont abandonnée à l'initiative privée. Les Fernand Cortez et les Pizarre ont conquis le Mexique et le Pérou avec un personnel de quelques [119] centaines d'hommes et le capital engagé dans ces deux expéditions ne dépassait pas celui que comporte l'établissement d'un réseau de tramways dans une ville de second ordre. Mais lorsque les gouvernements Européens eureut pris possession des terres conquises par leurs aventuriers, après avoir désintéressé ceux-ci, soit en leur abandonnant une part du butin, soit en leur confiant des emplois et des honneurs, la situation changea. Les terres nouvelles devinrent l'objet de nombreux procès, portant sur leurs limites ou sur les titres mêmes de leur possession, et ces procès vidés parle procédé coûteux et grossier de la guerre, absorbèrent d'énormes capitaux, pendant le cours de l'occupation. Ces capitaux dépensés avec leurs intérêts accumulés doivent naturellement être portés au compte des frais d'occupation des terres du nouveau monde.
V. Le Gouvernement Et Ses Profits. — Comment les états Européens qui avaient acquis par la série d'opérations que nous venons de décrire, la propriété de cet immense domaine pouvaient-ils couvrir leurs frais et réaliser les profits en vue desquels ils avaient engagé leurs capitaux dans cette lointaine et aléatoire entreprise? Ces frais, les gouvernements ne pouvaient les couvrir, ces profits ils ne pouvaient les réaliser en exploitant eux-mêmes les terres qu'ils avaient acquises et qu'ils occupaient, car ils ne possédaient ni les capitaux ni la capacité spéciale qu'exigait cette exploitation, et, comme les doctrines du socialisme d'état n'étaient pas encore nées de leur temps, ils curent la sagesse de le comprendre. Que firent-ils? Ils concédèrent ou vendirent successivement en détail à des particuliers le sol qu'ils avaient acquis en bloc, en demandant simplement le remboursement de leurs avances, avec les profits et l'amortissement des capitaux avancés, à l'exploitation de l'industrie qui leur était propre, savoir au gouvernement de leurs nouveaux domaines. Les revenus qu'ils tiraient de cette industrie provenaient de deux sources: d'abord de la vente des terres colonisables et des impôts qu'ils prélevaient sur les colons, ensuite de l'augmentation de revenus que l'exploitation du domaine colonial procurait à leur industrie dans la métropole. La vente des terres colonisables ne leur donnait [120] qu'un revenu insignifiant, mais, il en était autrement de celui qui provenait de la participation qu'ils se réservaient dans le produit de ces terres après les avoir vendues ou concédées: la couronne d'Espagne, par exemple, percevait un cinquième du produit des mines. Il en était autrement encore du revenu des impôts de toute sorte qu'ils établissaient sur l'industrie et le commerce des colons, impôts de consommation, droits de douane, etc. A ces revenus tirés des colonies s'ajoutait la plus-value que procurait aux impôts métropolitains, le commerce colonial. Ces deux sortes de revenus servaient à couvrir: 1° Les frais d'acquisition des colonies; 2° ceux de leur gouvernement et de leur defense. Couvraient-ils entièrement ces deux sortes de frais, et donnaient-ils, en sus, aux états propriétaires des colonies, des profits supérieurs à ceux de la généralité des industries? Pouvait-on dire, en conséquence, que la valeur du domaine foncier qu'ils avaient acquis, dans le nouveau monde, représentait, au moins pour une part, le produit du travail de la nature et non de l'emploi de leurs capitaux? En d'autres termes, qu'ils en tiraient une « rente » qui n'était point la rétribution légitime et nécessaire de leur industrie?
Lorsqu'on considère l'ensemble des acquisitions que les états Européens ont faites dans le nouveau monde, des frais qu'elles leur ont coûtés et des revenus qu'ils en ont tiré pendant la durée de leur possession, on trouve que si quelques unes ont été de bonnes affaires, d'autres, et peut-être le plus grand nombre, en ont été de mauvaises. Parmi ces dernières ne faut-il pas ranger les entreprises coloniales de l'Espagne? L'Espagne a occupé et gouverné pendant trois siècles la portion la plus étendue et la plus riche du nouveau monde. S'il était vrai que l'industrie de l'appropriation du sol fût plus productive qu'aucune autre, l'Espagne aurait dû en tirer des profits extraordinaires, sa puissance et sa richesse devraient dépasser aujourd'hui celles de toutes les autres nations civilisées. Elles ont diminué, au contraire, et la cause principale sinon unique de la décadence du vaste empire de Charles-Quint a été l'extension disproportionnée de son domaine colonial. Sans doute, la gestion de ce domaine a été une source abondante de profits pour la classe gouvernante, mais [121] ces profits, en y joignant même ceux des marchands investis du privilège exclusif du commerce des colonies, étaient loin de compenser les frais généraux que la nation avait à supporter pour la conservation de ses possessions coloniales, incessamment attaquées ou menacées par les puissances rivales. Ce qui le prouverait au besoin, c'est que l'Espagne n'a commencé à se relever de sa décadence qu'après avoir perdu la plus grande partie de son domaine du nouveau monde, malgré la dépense stérile que lui ont coûtée les tentatives infructucuses qu'elles a faites pour le conserver.
Enfin, depuis que nous assistons à une recrudescence des entreprises de découverte et d'occupation des régions notre globe qui sont demeurées en dehors de notre civilisation, pouvons-nous constater que ces entreprises soient particulièrement profitables? S'il s'agit de l'industrie des découvreurs, peut-on dire que les courageux explorateurs qui ont ouvert le « continent noir », les Mungo Park, les Caillé, les Speke, les Grant, les Livingstone, les Stanley, les Brazza aient réalisé des bénéfices hors de proportion avec les difficultés et les risques de cette industrie essentiellement dangereuse et insalubre? S'il s'agit de l'occupation, remarque-t-on que les capitaux mettent un empressement extraordinaire à répondre à l'appel des compagnies qui se sont constituées, en Allemagne et en Belgique pour occuper les régions nouvellement découvertes et en exploiter les richesses? Ils sont si peu attirés dans cette direction que les gouvernements se croient obligés de suppléer au défaut d'initiative ou de confiance des particuliers. La conquête et l'occupation des régions demeurées en dehors de notre civilisation sont presque exclusivement entreprises par les gouvernements qui y trouvent un débouché pour le surcroît de leurs fonctionnaires civils et militaires, mais les nations qui en supportent les frais tireront-elles de l'exploitation de ce domaine chèrement acquis, des revenus suffisants pour rétablir avec adjonction des profits ordinaires les capitaux qu'elles y auront investis?
Que ressort-il de cette analyse? C'est que les premières façons qu'exige la terre pour être transformée en un domaine exploitable, savoir la découverte et l'occupation, le gouvernement et la défense, loin de procurer des bénéfices [122] extraordinaires à ceux qui les entreprennent, se soldent le plus souvent par une perte finale. Remarquons encore qu'en Amérique, et il en sera probablement de même dans le continent noir, la conquête et l'occupation Européennes ont été temporaires: que les états colonisateurs du nouveau monde n'ont possédé que pendant deux ou trois siècles les domaines qu'ils y avaient conquis et occupés à grands frais, qu'il ne leur en reste aujourd'hui que des lambeaux, qu'ils sont, selon toute apparence, destinés à perdre dans un avenir prochain; que cette possession temporaire n'a pas été grevée seulement des indemnités accordées aux découvreurs et des frais qu'il a fallu faire pour soumettre et trop souvent pour détruire les populations autochtones, établir des moyens de communication et de défense; qu'elle a occasionné des guerres qui ont absorbé des capitaux considérables et qu'elle a été perdue à la suite d'autres guerres non moins coûteuses. Certes, le nouveau monde est devenu un riche débouché pour la population, l'industrie et le commerce de l'ancien, mais les nations qui ont fait particulièrement les frais d'acquisition de ce débouché dont les autres ont profité comme elles et même plus qu'elles, sont-elles rentrées dans leurs déboursés et y rentreront-elles jamais?
VI. Les Profits Futurs De La Création D'Un Domaine Territorial. — Cependant, aux états Européens, aujourd'hui presque entièrement dépossédés, ont succédé des états américains auxquels la possession de leur domaine territorial n'a coûté que les frais des guerres d'émancipation; encore ces frais ont-ils été supportés, en partie, par les états Européens qui les ont aidés à s'émanciper sans réclamer aucune rétribution pour leur concours (la France, par exemple, a dépensé 1,800 millions pour aider les colonies anglaises de l'Amérique du Nord à s'affranchir de la domination de leur métropole et cette dépense a été la cause occasionnelle d'une révolution qui lui a coûté autrement cher), en partie encore par les capitalistes du vieux monde souscripteurs des emprunts des états en voie d'émancipation, dont la plupart ont fait banqueroute. D'où l'on peut conclure que les états actuels du nouveau monde ont acquis leur domaine territorial moyennant [123] une somme hien inférieure au capital dépensé par leurs prédécesseurs pour le créer. On pourrait les comparer à ces compagnies minières qui succèdent aux premiers exploitants et profitent des dépenses que ceux-ci ont faites sans en recueillir le fruit. Mais, quand on fait le bilan de l'industrie minière, ne faut-il pas tenir compte de tous les capitaux qu'elle a absorbés, pour établir la moyenne de ses profits? N'en est-il pas de même pour l'industrie de l'appropriation de la terre?
Cependant, bien que les états actuels du nouveau monde aient acquis à bon marché et certainement fort au-dessous du prix de revient, les 3 milliards 200 millions d'hectares qui composent leur domaine territorial, l'exploitation politique de ce domaine suffit-elle pour couvrir les frais d'acquisition de cette matière première de leur industrie et leur procurer des bénéfices équivalents à ceux de la généralité des branches de la production? Nous allons voir que loin de réaliser des bénéfices, leur industrie se trouve au contraire continuellement en perte.
Il convient de remarquer d'abord que les terres qui forment le domaine de ces différents états se partagent en deux catégories: 1° les terres du domaine public appartenant à l'état; 2° les terres appropriées aux particuliers, individus ou associations. Le domaine public, contrairement à ce qui existe dans les contrées anciennement appropriées, dépasse beaucoup en étendue le domaine privé. Il comprend au moins les neuf dixièmes du sol américain, et il est généralement improductif. Loin de donner une rente, en sus des profits ordinaires de l'industrie, il constitue plutôt une charge pour l'état propriétaire. C'est pourquoi celui-ci vend d'habitude à vil prix les terres publiques ou même les concède gratuitement aux colons qui se présentent pour les exploiter. Les revenus de son industrie proviennent en presque totalité des impôts directs ou indirects qu'il prélève sur la population établie sur son territoire. Ces revenus lui procurent-ils un profit, en sus de la somme nécessaire pour couvrir ses frais d'acquisition et de gouvernement? Si l'on ne considérait que la classe gouvernante de chaque état, politiciens et fonctionnaires civils et militaires, on reconnaîtrait certainement que cette classe [124] réalise des profits égaux et même supérieurs à ceux des autres classes de la population, et l'on en trouverait la preuve dans l'affluence extraordinaire des candidats aux fonctions publiques: mais il ne faut pas oublier que les gouvernements appartiennent de nos jours aux nations comme une entreprise industrielle ou commerciale appartient à ses actionnaires. Or, aussi bien dans le nouveau monde que dans l'ancien, les recettes des gouvernements suffisent rarement à couvrir leurs dépenses, et ils comblent régulièrement leurs déficits en contractant des dettes qu'ils accroissent tous les jours. Seul le gouvernement des états-Unis est en train d'amortir la sienne, mais il suffirait de la moindre guerre pour l'obliger à l'augmenter de nouveau. En supposant donc que les gouvernements au lieu d'être constitués en Régies pour le compte des nations fussent exploités comme les autres branches de l'assurance, les mines, etc., par des compagnies particulières, non seulement ces compagnies ne pourraient distribuer aucun dividende à leurs actionnaires, mais elles seraient promptement réduites à faire banqueroute, à moins toutefois qu'une salutaire concurrence ne les contraignît à diminuer les dépenses désordonnées, inutiles ou nuisibles, auxquelles se livrent les régies actuelles, exploitées, sous la responsabilité des nations nominalement souveraines par des compagnies irresponsables de politiciens qui s'en disputent perpétuellement le monopole.
On ne peut donc pas dire que la production d'un domaine territorial, rendu habitable et exploitable, soit gratuite: comme toute autre, cette production exige à ses différentes étapes, découverte, conquête, occupation, défense, gouvernement, l'application d'un capital plus ou moins considérable, sous la forme d'un personnel et d'un matériel. On ne peut pas dire davantage que les industries successives qui contribuent à la production d'un domaine territorial réalisent des profits supérieurs à ceux des autres branches de la production; le contraire serait plutôt vrai.
Cependant, quand la population et la richesse se sont multipliées dans le cours du temps, sur un domaine territorial bien situé et pourvu d'abondantes ressources naturelles, la valeur de ce domaine va croissant. Déjà, au moment où nous [125] sommes, la valeur du domaine territorial des états-Unis se compte par milliards, et l'on peut affirmer non seulement qu'elle couvre l'ensemble des frais qui ont été faits pour le produire, avec adjonction des profits nécessaires des producteurs, mais encore qu'elle procure aux « consommateurs » auxquels ils ont fourni ce domaine, un excédent énorme de profit. Mais ce profit, est-ce la classe particulière des propriétaires fonciers qui l'a recueilli et la recueille? peut-on dire même que cette classe en obtienne une part supérieure à celle des autres, et qu'elle jouisse ainsi d'une « rente » qui serait, selon l'expression de M. Henry George, le fruit du travail de la nature?
S'il était vrai que le propriétaire qui entreprend l'exploitation d'une terre soit en y appliquant ses capitaux et son industrie, soit en la louant, après l'avoir acquise ou même après en avoir obtenu gratuitement la concession, réalisât des profits supérieurs à ceux que procurent les autres emplois du capital, que se passerait-il? C'est que dans les pays neufs, il n'y aurait pas d'autre industrie que celle de l'appropriation privée et de l'exploitation des terres. Or il n'en est ainsi nulle part. Même dans les contrées où le gouvernement concède gratuitement les terres publiques, une partie de la population applique de préférence ses capitaux à d'autres emplois. La conclusion qu'il faut tirer de ce fait, n'est-ce pas, de toute évidence, que l'exploitation du sol ne procure point des profits supérieurs à ceux de la généralité des branches de la production? On observe, au contraire, que les profits fonciers sont sensiblement inférieurs, dans leur ensemble, aux profits industriels, et cette différence provient de la plus-value.
VII. Plus-Value Et Moins-Value. — Nous arrivons ici au phénomène qui a fait croire à des observateurs superficiels que la possession du sol confère un privilège particulier, source d'un surcroît de revenu ou d'une rente, savoir obtenir la chance, à mesure que la population s'augmente et que la richesse se développe, un accroissement de valeur ou une plus-value.
Cette chance qui s'attache particulièrement mais non [126] uniquement à la propriété foncière, tient à deux circonstances physiques: 1° à ce que le sol est durable; 2° à ce qu'il n'est point transportable. Ces deux circonstances produisent, selon les lieux et les époques, des effets opposés: ou elles procurent au sol un accroissement progressif de valeur, ou elles font, au contraire, décroître sa valeur jusqu'à l'annuler tout à fait, en créant tantôt une chance de plus-value, tantôt un risque de moins-value.
Étudions d'abord la chance de plus-value. D'où provient la plus-value et comment se distribue-t-elle?
§ Ier. La plus-value. — La plus-value provient de l'augmentation progressive de la demande du sol soit pour l'habitation et l'industrie, soit pour la culture. Cette demande s'accroît rapidement dans les localités où la population se porte de préférence, et où, par le fait de la non-transportabilité de la terre, la quantité du sol disponible ne peut être augmentée comme le serait celle de tout autre article transportable dans la mesure de l'accroissement de la demande. C'est pourquoi on voit la valeur du sol des foyers d'habitation et d'affaires atteindre une élévation extraordinaire dans les parties des grandes et riches cités, telles que Londres, Paris et New-York où la demande dépasse considérablement l'offre possible de ces terrains bénéficiaires de la chance de plus-value. Mais outre que cette plus-value se produit d'une manière essentiellement inégale et incertaine, elle entre dans les calculs des acheteurs et elle s'escompte. En investissant leurs capitaux dans des terrains qu'ils supposent devoir être demandés tôt ou tard pour la construction d'habitations, les acheteurs se contentent d'en tirer un revenu moindre ou même se résignent à n'en pas tirer de revenu dans l'attente du profit éventuel que leur procurera la plus-value. Cependant, leurs prévisions ne sont pas toujours justifiées. Il arrive fréquemment que la plus-value attendue ne se réalise point ou qu'elle se réalise trop tard pour compenser la perte des intérêts du capital engagé. L'industrie de la spéculation sur les terrains enrichit, sans doute, un certain nombre de spéculateurs, mais elle en ruine beaucoup d'autres, et ce qui atteste que la moyenne de ses profits ne dépasse pas celle de la généralité des industries, c'est que les capitaux ne s'y dirigent pas de [127] préférence ou que s'il leur arrive d'y affluer, l'excès de leur concurrence, en déterminant une hausse artificielle des terrains, ne manque pas d'occasionner aux spéculateurs des pertes qui rétablissent l'équilibre des profits. D'où l'on peut conclure que la plus-value des terrains à bâtir ne confère pas aux propriétaires successifs de ces terrains des bénéfices supérieurs à ceux des autres emplois qu'ils auraient pu donner à leurs capitaux.
Il en est de même de la plus-value des terres cultivables. Ces terres sont de nature diverse: les unes sont plus propres à la culture de certaines denrées dont la demande va croissant avec la population et la richesse, les autres le sont moins, quelques-unes même ne le sont pas du tout. La plus-value naît et s'accroît en conséquence, mais en se distribuant d'une manière inégale. Les terres propres à la production de certains vins de qualité supérieure, par exemple, pourront acquérir une plus-value énorme, tandis qu'à côté d'autres terres moins favorisées par la nature n'obtiendront qu'une plus-value insignifiante. Il arrivera encore, si la population vient à se multiplier, et si des obstacles naturels ou artificiels empêchent ou limitent l'apport des subsistances du dehors, que les terres propres à la production du blé et des autres denrées alimentaires acquerront une plus-value croissante, mais qui se distribuera inégalement entre elles, selon leur plus ou moins d'aptitude à produire les subsistances les plus demandées. Les propriétaires des terres les plus aptes tireront alors de leur exploitation ou de leur location un profit supérieur à celui des autres branches de la production; la différence constituera ce qu'on a appelé la « rente de la terre », et cette rente se proportionnera, d'une part, à l'aptitude de la terre à produire les subsistances les plus demandées, de l'autre, à sa situation plus ou moins rapprochée des centres de consommation.
Il s'agit maintenant de savoir si cette rente ne mérite pas les anathèmes des socialistes, en conférant au propriétaire un bénéfice de monopole, c'est-à-dire un bénéfice qui excède la rétribution nécessaire des capitaux investis dans le sol. Pour résoudre cette question, il faut se reporter au moment où le domaine territorial découvert et occupé par un état ou une [128] société a été vendu ou concédé en détail à des particuliers, disposés à investir leurs capitaux dans ce genre d'exploitation. Nous avons vu que ces propriétaires primitifs ne réalisent pas et ne peuvent pas réaliser des profits supérieurs à ceux des autres colons, adonnés à l'industrie ou au commerce. Sans doute, les profits qu'ils tirent de l'exploitation du sol sont inégaux: le taux de ces profits dépend de la situation et des aptitudes spéciales des terres qu'ils ont acquises ou qui leur ont été concédées. Les uns ont obtenu des lots, destinés à croître rapidement en valeur; les autres ont été moins heureux. Ceux-là ont déployé plus d'intelligence dans leur choix ou ont été plus favorisés par la chance, à l'exemple des pêcheurs de perles ou des chercheurs d'or qui trouvent des pépites d'une grosseur extraordinaire, sans qu'on puisse attribuer leur bonne fortune à un monopole. C'est la moyenne des hauts et des bas profits qu'il faut considérer, et cette moyenne ne peut dépasser d'une manière persistante celle des autres industries sinon celles-ci seraient abandonnées pour la pêche des perles ou la recherche de l'or, jusqu à ce que le niveau se trouvât rétabli. Il en est de même pour l'exploitation d'un domaine territorial, lorsque ce domaine a été vendu ou concédé en détail. Elle ne peut procurer, dans son ensemble, des profits supérieurs à ceux de la généralité des branches de la production et ceux-ci représentent la rémunération nécessaire des capitaux employés à produire, ni plus ni moins. — Dira-t-on, que cet état des choses se modifie dans la suite des temps, que l'accroissement progressif de la demande des terres, en développant successivement leur plus-value permet de tirer, des capitaux qui y ont été investis, une rente, en sus des profits ordinaires? Mais les colons primitifs et leurs successeurs n'ont-ils pas spéculé sur cette plus-value? La chance de l'obtenir n'est-elle pas entrée dans leurs calculs? N'a-t-elle pas agi pour les déterminer à investir leurs capitaux dans la terre plutôt que dans les autres agents productifs, en se contentant d'un profit actuel moindre, en vue d'un plus grand profit futur? De deux choses l'une, ou leurs prévisions ne sont qu'incomplètement réalisées ou elles sont dépassées. Dans le premier cas, qu'arrive-t-il? C'est que l'industrie de l'exploitation des [129] terres se trouve découragée et ralentie; c'est que les capitaux cessent de s'y porter jusqu'à ce que ses profits actuels et éventuels atteignent le niveau commun. Dans le second cas, cette industrie est, au contraire, encouragée et elle attire de préférence les capitaux jusqu'à ce que ses profits descendent à ce niveau commun, qui est le point d'équilibre vers lequel gravitent incessamment les profits de toutes les branches de la production.
§ 2. La moins-value. — Ce n'est pas tout. Si la propriété foncière a des chances particulières de plus-value, en vertu de la durabilité et de la non-transportabilité du sol, elle est exposée, en revanche, sous l'influence de ces deux mêmes circonstances physiques, à un risque particulier de moins-value, et même à la disparition parfois indéfinie de sa valeur.
S'agit-il du sol affecté à l'habitation ou à l'exercice d'une industrie ou d'un commerce? Si la population et les affaires viennent à se déplacer, non seulement ce sol cesse d'acquérir une plus-value, mais il subit une moins-value croissante, tandis que les capitaux personnels et mobiliers échappent à ce risque en s'en allant. Il en est de même encore lorsque les progrès des moyens de communication urbaine, la suppression des fortifications ou des murs d'octroi augmentent la superficie des terrains propres à l'habitation et au commerce. Les terrains anciennement bâtis subissent alors une moins-value tandis que les terrains à bâtir acquièrent une plus-value. Les propriétaires des anciens terrains ne manquent pas d'employer leur influence à empêcher la destruction des obstacles qui protégeaient la valeur de leurs propriétés, mais s'ils réussissent parfois à retarder la chute de cette valeur, c'est pour la rendre plus profonde et moins remédiable. La population, à l'étroit dans les vieux quartiers, finit toujours par se porter dans les nouveaux, et elle y est d'autant plus attirée que la différence du prix des loyers est plus forte. Pour avoir été retardé, l'exode n'est que plus complet. De nouveaux centres d'affaires se créent et font abandonner les anciens, tandis que ceux-ci auraient subsisté s'ils avaient été mis plus tôt en communication avec les nouveaux foyers de population. Les obstacles que les propriétaires des vieux quartiers se sont efforcés de maintenir, se retournent ainsi contre cux, et lorsqu'ils veulent [130] les abattre, il est trop tard: la population suburbaine s'est accoutumée à travailler et à s'approvisionner chez elle, dans des locaux plus vastes et mieux installés, et elle ne retourne plus à ceux qu'elle a quittés.
S'agit-il du sol employé à l'agriculture? Aussi longtemps que la population se multiplie avec la richesse, tandis que le défaut ou la cherté des moyens de communication entrave l'apport des substances du dehors, on voit s'élever le prix des produits agricoles, et, par suite le taux des profits fonciers et la valeur du sol. Mais cet exhaussement des profits et de la valeur de la propriété terrienne ne manque pas d'encourager le développement et le progrès des moyens de communication. Car les entreprises de transport par terre et par eau voient s'augmenter d'autant plus leur clientèle et s'élever leurs profits que la différence est plus forte entre les prix des produits de toute sorte au dehors et au dedans. C'est ainsi qu'à la suite de l'augmentation progressive des prix des subsistances et des matières premières dans les pays où l'avènement de la grande industrie avait accru la population et la richesse, l'esprit d'entreprise et d'invention s'est porté vers la multiplication et le perfectionnement des moyens de transport devenus l'emploi le plus profitable des capitaux. Le monde s'est couvert en moins d'un demi-sièele, d'un réseau à mailles de plus en plus serrées de voies de communication rapides et à bon marché.
Dans l'intérieur de chaque pays, ce progrès a eu pour résultat d'augmenter la valeur des terres éloignées des foyers de population, et de frapper, au contraire, de moins-value les terres qui en étaient proches, quoique la multiplication de la population et de la richesse ait atténué la baisse, en accroissant le débouché général des produits agricoles. Mais les propriétaires atteints par la moins-value étaient, en tout cas, obligés de la subir, car ils n'avaient à leur disposition aucun moyen d'empêcher l'apport des produits des régions éloignées du territoire national. Il en était autrement pour les produits agricoles de l'étranger, dont le perfectionnement des moyens de communication facilitait l'importation et qui affluaient en masses de plus en plus compactes dans tous les foyers de consommation. On pouvait leur interdire l'accès du marché [131] national et on n'y a pas manqué. De là, ce phénomène bizarre dont nous sommes actuellement témoins, du relèvement des barrières douanières destinées à empêcher l'importation des denrées alimentaires, succédant à l'établissement des voies de communication destinées à la faciliter. La raison de ce phénomène est tout entière dans la moins-value dont l'apport des subsistances produites sur les terres nouvelles frappe les anciennes terres, et dans l'influence de la propriété foncière, demeurée partout prépondérante, sauf en Angleterre. Mais qu'adviendra-t-il de ces obstacles artificiels de la douane, substitués à l'obstacle naturel des distances? Atteindront-ils le but que se proposent ceux qui les élèvent? Réussiront-ils à empêcher la moins-value de succéder à la plus-value que le sol avait acquise, grâce aux progrès de la population et de l'industrie? De deux choses l'une, ou l'influence de la multitude des consommateurs, prévalant sur celle des propriétaires fonciers, parviendra à les abattre, ou ils continueront de subsister, mais dans ce dernier eas, malheureusement le plus probable, qu'arrivera-t-il? C'est que la population et l'industrie des vieux pays grevés, en sus des charges croissantes de l'état, d'un lourd tribut au profit de la propriété foncière, tendront de plus en plus à se porter dans les pays neufs, et que leur émigration sera encouragée précisément dans la mesure de l'aggravation artificielle du prix des subsistances; c'est que les aliments à bon marché ne pouvant plus arriver aux consommateurs, les consommateurs iront trouver les aliments à bon marché. La chute de la valeur du sol ne manquera pas alors de se précipiter, et la ruine de la propriété foncière sera sans remède.
VIII. Le Processus De La Création Et Du Développement De La Valeur Foncière. — L'analyse qui précède montre comment naît et se développe la valeur du sol. La terre, telle que la nature l'a faite et mise à la disposition de l'homme, est dépourvue de valeur. Elle est simplement utilisable. C'est en l'utilisant, c'est-à-dire en la transformant en un instrument de production que l'homme lui donne une valeur. Comment procède-t-il? Il commence par la découvrir et l'occuper. Ces opérations préliminaires de la production de [132] l'instrument-terre sont accomplies par deux catégories particulières d'entrepreneurs qui y appliquent leurs capitaux et leur industrie. Les dépenses qu'elles nécessitent constituent les frais de production d'un domaine territorial. Ces frais sont couverts successivement tant par la vente en détail de ce domaine à la population qui vient s'y établir et l'exploiter que par les impôts que la société ou l'état occupant prélève sur cette population, et qui servent à rembourser avec les dépenses courantes du gouvernement et de la défense, les dépenses primitives de la découverte et de l'occupation. A mesure que la population et la richesse se multiplient, les terres comprises dans le domaine territorial, ainsi créé, sont de plus en plus demandées pour l'exploitation, et elles acquièrent une plus-value croissante. Seulement, cette plus-value se distribue d'une manière inégale. Elle s'attache principalement aux lots de terre sur lesquels la population se porte de préférence et sur ceux qui sont propres à la production d'articles dont la demande dépasse l'offre. En sus des profits ordinaires des capitaux appliqués à leur exploitation, ces lots favorisés donnent un excédent; mais cet excédent n'est autre chose que la compensation nécessaire de l'insuffisance des profits des lots moins bien situés ou moins propres à la production; il ne diffère point de celui qu'obtiennent certains producteurs heureux dans les industries aléatoires, telles que la recherche de l'or ou la pêche des perles, et qui compense simplement la malchance des autres.
Cependant, si la population et la richesse continuent à se multiplier, il peut arriver et il arrive que la moyenne des profits réalisés par l'exploitation du sol dépasse celle des autres emplois des capitaux. Si le domaine territorial est exploité tout entier, au moins dans ses parties exploitables, on voit alors les capitaux se porter vers quelque domaine de nouvelle création, appartenant à un état qui le débite à vil prix ou même gratis, en vue des profits éventuels que le peuplement lui promet. Et plus grande est la différence entre la valeur des terres de l'ancien domaine et celle des terres du nouveau, plus rapidement se développe le mouvement d'émigration des capitaux personnels et mobiliers de l'un vers l'autre. Le résultat final c'est, là, une diminution de la demande des terres [133] partant une moins-value, ici, un accroissement de la demande partant une plus-value, jusqu'à ce que la valeur des deux sols, toutes choses étant égales, s'établisse an même niveau.
Cet excédent accidentel des profits de l'exploitation du sol, en comparaison des autres emplois du capital auquel on a donné le nom de rente, apparaît donc comme le véhicule nécessaire de l'extension de la production de l'instrument-terre. C'est la rente qui excite l'esprit d'entreprise et les capitaux à créer de nouveaux domaines territoriaux, à mesure que les anciens deviennent insuffisants: plus elle s'élève, et plus ce mouvement d'expansion s'accélère, quels que soient les obstacles qu'il rencontre. Ces obstacles peuvent bien le ralentir un moment, mais pour le précipiter ensuite. Il ne s'arrêterait que si le sol utilisable venait à être occupé et exploité dans toute son étendue. Mais, au moment où nous sommes, les terres pleinement occupées et exploitées ne forment même pas la dixième partie de notre globe, et à moins que la population ne viennent à pulluler, chose qui nous apparaît comme de moins en moins probable, l'humanité aura toujours à sa disposition un excédent de sol utilisable.
Il faut remarquer enfin que la création des domaines territoriaux est devenue de moins en moins coûteuse; que les terres du nouveau monde ont coûté infiniment moins à découvrir, à occuper que celles de l'ancien continent, que le domaine territorial de l'Australie est revenu moins cher encore que celui des deux Amériques, et que l'occupation éventuelle du continent africain ne paraît pas devoir entraîner des frais extraordinaires, à moins que les états Européens ne s'avisent de s'en disputer la possession à main armée, comme ils se sont disputé pendant trois siècles celle du continent américain. Ces nouveaux domaines territoriaux pourront donc être offerts à l'exploitation, à meilleur marché que ne l'ont été les anciens; d'où résultera un abaissement général de la valeur du sol, au niveau des frais de la production de la terre dans les portions du globe où elle a coûté le moins cher à découvrir et à occuper. Comme toute autre, la production de la terre devient plus économique sous l'influence du progrès, et le produit-terre tend, en conséquence, comme tout autre aussi, à être mis à la disposition des consommateurs, au prix [134] simplement nécessaire pour couvrir ses frais de production les plus bas.
IX. La Nationalisation Du Sol. — Cela étant, que faut-il penser de la théorie de la nationalisation du sol? Dans les anciens domaines territoriaux de l'Europe, où la terre est en voie de perdre la plus-value extraordinaire qu'elle avait acquise sous l'influence de l'avènement de la grande industrie, le rachat des terres par le gouvernement fondé de pouvoirs de la nation, pourrait, sans aucun doute, être avantageux aux propriétaires, mais il mettrait à la charge de la nation le risque de moins-value, et la progression inévitable de ce risque serait ruineuse pour l'acheteur. A moins de réduire la population en esclavage, on ne pourrait empêcher la portion la plus riche et la plus énergique de cette population de se soustraire par l'émigration à l'acquittement d'une dette que la diminution successive de la plus-value rendrait de plus en plus lourde et qui deviendrait écrasante pour la multitude demeurée sur un sol racheté au-dessus de sa valeur en voie de diminution. Mais n'en serait-il pas autrement dans les nouveaux domaines territoriaux, tels que les états-Unis, où la valeur de la terre est actuellement en voie d'augmentation? En cessant de vendre les terres publiques et en rachetant la portion du sol de l'Union qui appartient aux particuliers la nation ne ferait-elle pas une bonne affaire? Ne bénéficierait-elle pas de tout le montant de la plus-value que les progrès futurs de la population et de la richesse procureront à l'un des plus vastes et des plus féconds domaines territoriaux de notre globe? Telle est du moins l'opinion de M. Henry George. Mais le bénéfice de cette colossale opération serait-il aussi assuré que se plaît à le supposer l'auteur de Progrès et Pauvreté? Sans parler de l'inconvénient de livrer la propriété du sol à la gestion d'une bande de politiciens faméliques et de faire dépendre la généralité des consommateurs de terre d'un monopole politique et administratif, n'arriverait-il pas un moment où la concurrence des terres nouvelles de l'Amérique du sud, de l'Australie et de l'Afrique ferait succéder, sur le domaine agricole de l'Union, la moins-value à la plus-value? A ce moment, la redevance destinée à couvrir les frais du rachat [135] n'excéderait-elle pas le montant du profit foncier, et la différence ne s'ajouterait-elle pas aux charges de la nation? Soit qu'elle la fit supporter par les exploitants du sol, au risque de déterminer leur exode vers les terres concurrentes, ou par la généralité de ses contribuables, ne serait-ce pas une perte au lieu d'un bénéfice? Comme la plupart des inventions du socialisme, la nationalisation du sol aboutirait fatalement à une augmentation des charges publiques ou à une banqueroute.
[136]
CHAPITRE V
L'analyse de la production.↩
I. La production de l'homme et de la terre. — II. Les autres productions. — III. Les besoins. — IV. Les entreprises: 1° Leurs conditions naturelles d'existence; 2° Les formes et les dimensions des entreprises; 3° La quantité et les proportions du capital nécessaire aux entreprises: 4° Le rétablissement du capital.
I. La Production De L'homme Et De La Terre. — Nous avons commencé l'étude de la production en analysant celle de ses deux agents principaux: l'homme et la terre.
La production de l'homme apparaît la première, l'espèce humaine et ses conditions d'existence étant l'objet même de l'économie politique. Considérée dans le temps, l'humanité se compose d'une série de générations successives. Chaque génération produit celle qui lui succède. Cette production exige, comme toute autre, l'application d'un capital. Tout individu, arrivé à l'âge où il prend place dans le grand atelier de la production et pourvoit lui-même à ses besoins, a exigé, pour être élevé, entretenu et éduqué, une dépense de capital, dont le montant constitue ses frais de production. Cette dépense est subordonnée à deux conditions: 1° à la quantité de capital dont la génération existante dispose; 2° à la puissance des mobiles qui l'excitent à appliquer une portion de ce capital à la production de l'homme plutôt qu'à une autre destination, ou, pour nous servir de l'expression économique, au montant [137] du profit que cette branche particulière de la production peut lui procurer. Ce profit est de deux sortes: industriel et physico-moral. Lorsqu'il est simplement industriel, comme dans le cas de l'esclavage, la vente ou la location du « produit » rembourse les frais de la production avec adjonction d'un profit équivalent à celui des autres emplois du capital. Lorsque, dans un état plus avancé de civilisation, le capital investi dans la production de l'homme ne rapporte qu'un profit physico-moral, cette espèce de profit n y attire de même les capitaux qu'autant que la somme de jouissances qu'il contient est équivalente à celle qui se trouve contenue dans le profit industriel. Lorsque le profit industriel ou physico-moral que procure la production de l'homme est inférieur à celui des autres emplois du capital, on la voit diminuer, alors même que les capitaux qui peuvent y être appliqués existent en abondance. Tel est, comme nous l'avons remarqué, le cas qui se présente dans les régions supérieures de nos sociétés civilisées, par suite de l'insuffisance du profit physico-moral, quand il n'est accompagné d'aucune compensation pour les frais d'élève. Lorsque, au contraire, le profit est à la fois industriel et physico-moral, et dépasse celui de la généralité des emplois du capital, la production de l'homme s'augmente et tend à devenir surabondante, jusqu'à ce que son excès, en diminuant le profit qu'elle procure, la ramène à l'équilibre.
La production de la terre apparaît, en second lieu, comme une autre nécessité dérivant de la nature de l'homme et de ses conditions d'existence. L'homme ne peut subsister qu'à la condition d'avoir à sa disposition, pour y établir sa demeure et son atelier de production, soit individuellement, soit par voie d'association, une portion de l'enveloppe terrestre. Ce lot de terre habitable et exploitable, il doit le découvrir, le conquérir sur l'animalité inférieure, le défendre après l'avoir conquis, l'occuper et l'approprier à son habitation et à son exploitation. Ces différentes opérations nécessaires à la production d'un domaine territorial exigent la réunion et la mise en œuvre d'un capital investi, pour une part, sous forme de forces physiques, d'aptitudes morales et de connaissances techniques, dans le personnel qui entreprend ce genre de production, pour une autre part, dans un matériel composé [138] d'armes, d'outils, d'avances de subsistances, etc. Ce matériel faisant défaut aux habitants primitifs de notre globe, il y a apparence qu'ils occupaient seulement l'étendue de terre qui se trouvait à leur portée immédiate. Tantôt elle ne leur fournissait point de quoi subsister et ils périssaient misérablement; tantôt, au contraire, ils en tiraient non seulement un produit suffisant pour couvrir leurs frais d'existence, mais encore un excédent qui leur permettait de se multiplier et de satisfaire plus amplement à leurs besoins. Alors, qu'arrivait-il? C'est que l'étendue de leur domaine territorial finissait par devenir insuffisante; c'est que le capital immobilier représenté par la terre se trouvait en déficit, par rapport au capital personnel et mobilier, et qu'il donnait, en sus de son profit nécessaire, une rente qui était prise sur les profits des deux autres catégories de capitaux. Dans cette situation, la constitution d'un supplément de capital immobilier par la découverte et l'occupation de terres nouvelles devenait la plus profitable des industries; elle ne manquait pas d'être entreprise et poursuivie jusqu'à ce que la concurrence de ces terres nouvelles eût fait disparaître la rente des anciennes et avec elle le mobile qui poussait à l'agrandissement du domaine territorial. C'est sous l'impulsion de ce mobile que le sol de notre globe a été successivement découvert et occupé par les races les plus aptes à la production et à la capitalisation. Ces races progressives ont incessamment accru leurs capitaux personnels et mobiliers et lorsque la proportion du capital immobilier nécessaire à leurs entreprises devenait insuffisante, elles étendaient leur domaine territorial, soit en découvrant et en occupant des terres encore vacantes, soit en conquérant celles qui étaient possédées par des races inférieures ou décadentes, auxquelles manquaient les aptitudes et les ressources requises pour la conservation de cette sorte de capital.
Quelques chifres suffiront pour donner une idée de l'importance de la production de l'homme. Si l'on évaluait seulement à 1,000 francs par tête les frais d'élève, d'instruction et d'éducation des 500 millions d'hommes environ qui appartiennent à notre civilisation ou s'y rattachent, on trouverait que chaque génération a coûté à celle qui l'a appelée à l'existence, [139] la somme énorme de 500 milliards. Or, cette estimation du prix de revient d'un être humain jusqu'à l'âge où sa subsistance et son entretien cessent de lui être avancés par la génération précédente est fort inférieure à la réalité. C'est à 1,000 milliards au moins qu'il faudrait la porter d'après les calculs des statisticiens les plus accrédités, et cette dépense est destinée à s'accroître encore à mesure que la production. en se perfectionnant, exige un personnel de qualité supérieure. A la vérité, elle va, d'un autre côté, en diminuant, à mesure que les progrès de l'hygiène et de la civilisation générale augmentent la durée de chaque génération. En supposant que la durée moyenne de la vie humaine ne fût que de 25 ans, le renouvellement d'une population de 500 millions d'hommes ne coûterait pas moins de 4,000 milliards en un siècle; si cette durée s'élevait à 33 ans, la dépense s'abaisserait à 3,000 milliards, et à 2,000 milliards seulement avec une longévité de 50 ans. On voit par là quelle énorme économie procure à la population les progrès qui ont pour effet de prolonger la vie humaine.
Au moment où nous sommes, on peut évaluer à 3,000 milliards par siècle les frais de production ou le prix de revient de notre population de 500 millions d'hommes civilisés, en calculant le prix de revient à raison de 2,000 francs par individu, et de 1,000 milliards par génération ou de 30 milliards environ par année. C'est approximativement ce que coûte à cette population son lourd appareil de gouvernement et de protection. Cette dépense sert à constituer un « capital personnel », très inégalement distribué entre les individus, en raison de leurs aptitudes productives, mais dont le montant est incontestablement supérieur à la somme de leurs frais de production. Ce qui le prouve, c'est que la population de notre monde civilisé est en voie d'accroissement. Or, elle ne peut s'accroître qu'à deux conditions: 1° Que le produit qu'elle tire de l'exploitation de ses forces productives suffise à couvrir ses frais d'entretien et de renouvellement; 2° qu'à ce produit s'ajoute un excédent ou produit net, et qu'une portion de ce produit net capitalisé soit employée à la production d'un supplément de population. Il convient de remarquer, toutefois, qu'au revenu que procure l'emploi du capital personnel vient [140] s'ajouter celui qui provient de la mise en œuvre des capitaux mobiliers et immobiliers et qui consiste dans l'excédent que les détenteurs de ces capitaux recueillent après les avoir rétablis dans l'opération productive. Une partie de cet excédent, après avoir été capitalisé, peut être investi par eux dans un supplément de population, mais, en fait, il ne l'est d'habitude que dans une très faible mesure, la classe de la population qui possède la plus forte part du capital mobilier et immobilier ayant une tendance à diminuer plutôt qu'à s'accroître.
La production de la terre a créé dans notre monde civilisé un capital immobilier dont l'importance ne le cède guère qu'à celle du capital personnel, investi dans la population. Seulement cette valeur produite, en premier lieu, par la découverte et l'occupation du domaine territorial, en second lieu, par l'amélioration de la qualité du sol et le développement de ses aptitudes productives, cette valeur, disons-nous, a été créée dans le cours des siècles, et la dépense qui s'ajoute annuellement à celle qui a été faite antérieurement pour accroître le domaine territorial de notre civilisation et l'améliorer, est relativement faible. Mais la valeur de ce domaine dépasse-t-elle le montant de ses frais de production ou demeure-t-elle au-dessous? Il serait impossible d'évaluer ce qu'il a coûté à produire depuis son origine. En revanche, on peut constater qu'il va s'étendant et s'améliorant tous les jours. La conclusion qu'il est permis de tirer de ce fait, n'est-ce pas que la valeur actuelle du domaine territorial de notre monde civilisé dépasse, sinon le montant des frais qui ont été faits pour le produire pendant le cours des siècles, du moins la somme qu'exigerait sa production dans l'état actuel de l'industrie humaine?
II. Les Autres Productions. — Sur cette double tige de l'arbre de la production ont poussé successivement une multitude de branches et de rameaux. Mais l'inventaire et la classification de la production ne concernent pas l'économie politique; c'est l'affaire de la statistique. Au point de vue économique, on peut partager les résultats de la production, suivant leur nature, en produits matériels et en produits immatériels, suivant leur destination, en produits utiles ou [141] nuisibles, quoique cette classification n'ait rien de précis et ne présente aucune utilité scientifique. Les produits matériels sont créés par la recherche, la transformation ou le transport de la matière dans l'espace et le temps: tels sont les produits de l'agriculture, de l'industrie minérale et manufacturière, de l'industrie des transports, du commerce; on leur attribuait naguère exclusivement la qualité de richesse, mais cette qualité convient tout autant aux produits ou services immatériels, tels que les services de la sécurité, de l'hygiène, de la médecine, de l'enseignement, qui s'incorporent dans les personnes dont ils augmentent la valeur physique, intellectuelle et morale. Le produit immatériel ou le service d'un médecin, par exemple, augmente le capital personnel d'un malade en rétablissant sa santé et ses forces. Les uns et les autres, cet exemple suffirait au besoin à l'attester, sont également échangeables et capitalisables. Suivant leur destination, et selon qu'ils contribuent à l'augmentation ou à la diminution de la richesse, les produits matériels ou immatériels peuvent être considérés comme utiles ou nuisibles. On peut qualifier de produits ou de services nuisibles ceux qui alimentent les vices physiques et moraux, l'ivrognerie, l'incontinence, la vanité; s'ils enrichissent parfois ceux qui les créent, ils diminuent toujours, dans une proportion plus forte, la richesse de ceux qui les consomment. Seulement, à part l'industrie du vol, il n'est guère de branches de l'activité humaine qui soient en opposition absolue avec l'intérêt général, et l'on s'expose, en entravant par des règlements ou des taxes celles mêmes qui, d'habitude, alimentent le vice, à empêcher des consommations utiles beaucoup plus qu'à supprimer des consommations nuisibles.
Mais, quelles que soient la nature et la destination de leurs produits, toutes les branches de la production naissent sous l'excitation d'un besoin et s'exercent au moyen d'entreprises.
III. Les Besoins. — Les besoins des hommes ont été partagés suivant leur nature, en trois catégories: physiques, moraux et intellectuels. Ils sont essentiellement inégaux en volume et en intensité, et cette inégalité se répercute dans les industries qui ont pour objet de les satisfaire. Si nous examinons l'atelier [142] d'une société civilisée, nous constaterons que la plus grande partie de cet atelier est employée à la production des articles destinés à la satisfaction des besoins physiques, et, en particulier, du besoin de nourriture. La preuve de ce fait apparaît dans la distribution économique de la population: partout elle est, en majorité, engagée dans la production des subsistances, soit directement par l'exercice de l'agriculture, soit indirectement par l'exercice d'industries qui lui fournissent, au moyen de l'échange, des produits alimentaires. Toutefois, la répartition des industries diffère d'une époque et d'une société à une autre. Si la statistique était d'une date moins récente, elle nous montrerait que, dans la généralité des pays civilisés, la portion de la population occupée dans les industries qui pourvoient à l'alimentation physique a diminué, tandis que la portion employée à l'alimentation intellectuelle et morale a augmenté. Mais si la statistique ne peut encore nous fournir aucune indication bien positive sur l'ordre et la quotité de la satisfaction des besoins à deux périodes de la vie d'une société civilisée, elle peut, en revanche, nous renseigner suffisamment sur les différences qui existent, à cet égard, entre les sociétés civilisées de l'époque actuelle; elle nous montre, par exemple, dans le recensement des professions, que la satisfaction des besoins intellectuels emploie, en Russie, une fraction de la population, bien moindre qu'en France et en Angleterre. A quoi tient cette inégalité? A deux causes: en premier lieu, à ce que les besoins intellectuels de la population sont plus nombreux et intenses en France et en Angleterre qu'en Russie, en second lieu, à ce que l'industrie y est plus productive. Ces deux causes ont une action à peu près égale. En supposant que les besoins intellectuels fussent égaux en volume et en intensité dans les trois pays, ils ne pourraient être satisfaits qu'à un moindre degré en Russie, à cause de l'infériorité de la productivité de l'industrie russe. En effet, dans l'état actuel des choses, la masse de la population de la Russie obtient à peine, en mettant en œuvre les moyens de production dont elle dispose pendant la durée de son temps utilisable, la quantité de produits nécessaires pour subvenir imparfaitement à la satisfaction grossière de ses besoins physiques et au paiement des impôts dont elle est [143] surchargée. D'un autre côté, en supposant que l'industrie devînt aussi productive en Russie qu'en France et en Angleterre, les besoins intellectuels continueraient d'y recevoir une satisfaction inférieure, si ces besoins étaient moins volumineux et intenses. Le peuple russe employerait, en ce cas, le surcroît de productivité de son industrie soit à une satisfaction plus complète de ses besoins physiques soit à une diminution de la durée de l'emploi productif de son temps utilisable.
Les besoins apparaissent donc comme les générateurs de la production. Chaque besoin suscite la création des industries propres à le satisfaire. Cependant, suffit-il qu'un besoin existe pour que les industries qui y correspondent prennent naissance et lui fournissent, sous forme de produits ou de services, toute la quantité d'utilités qu'il est capable de consommer? Non sans doute. Si nous observons les sociétés au sein desquelles le bien-être est le plus répandu, nous trouverons qu'une faible minorité seulement y satisfait, avec une ampleur suffisante, la généralité de ses besoins, tandis que la multitude ne pourvoit aux siens que dans une mesure extrêmement étroite. La consommation actuelle des sociétés les plus riches du globe devrait être au moins décuplée, pour atteindre le niveau de leur consommation possible et elle ne tarderait probablement pas à l'être si les produits et services qu'elle exige étaient fournis gratis par la Providence. Qu'est-ce donc qui empêche tous les besoins d'être satisfaits dans toute leur étendue? C'est l'insuffisance de la production. Tandis que la quantité des utilités, sous forme de produits et de services, demandés par l'ensemble des besoins des membres d'une société civilisée peut être considérée sinon comme illimitée du moins comme n'ayant point de limites assignables, la quantité d'utilités que peuvent produire ceux qui éprouvent ces besoins est plus ou moins limitée. Elle l'est par le fait de la limitation de la quantité et de la puissance des moyens de production dont ils disposent. Elle l'est encore par celle de la durée de leur temps utilisable, l'homme ne pouvant produire dans l'espace de temps applicable à la production autant d'utilités qu'il peut en consommer dans l'espace de temps applicable à la consommation. Toutefois, la limite de la production est mobile: Chaque progrès de [144] l'industrie la rapproche de celle de la consommation possible. Mais s'il est permis de prévoir le jour où les progrès de l'industrie fourniront les moyens de pourvoir, dans la mesure utile, à tous les besoins de la consommation, ce jour est encore bien éloigné. En attendant, les besoins de la généralité des membres des sociétés les plus progressives continueront de n'être satisfaits que d'une manière insuffisante quoique de plus en plus ample.
Essayons maintenant de nous faire une idée de la manière dont naît et se développe la multitude des branches de la production.
La production s'établit dans un ordre et dans des proportions déterminés par l'intensité et le volume des besoins auxquels elle est destinée à satisfaire. Les besoins les plus intenses, c'est-à-dire ceux dont la satisfaction procure la plus grande jouissance et dont la non-satisfaction cause la souffrance la plus forte, — besoins de sécurité, de nourriture, appétit sexuel, abri contre les intempéries, — déterminent d'abord la création d'entreprises qui y correspondent: réunion et constitution d'un troupeau humain en vue de la défense commune, expéditions individuelles ou collectives de chasse ou de recherche des fruits naturels du sol, production et élève des enfants dans le troupeau et, plus tard, dans la famille. Lorsque ces entreprises, qui répondent à des besoins dont la satisfaction est indispensable à l'entretien de la vie, ne couvrent pas leurs frais, lorsque le produit qu'elles donnent ne suffit pas à rétablir les agents productifs, la production ne peut être entièrement continuée, le troupeau diminue en nombre et finit par périr. Lorsque, au contraire, la production donne un excédent, le capital employé étant rétabli, cet excédent peut recevoir trois destinations: 1° Il peut permettre aux producteurs de consacrer à la production une moindre quantité de leur temps utilisable, et de se reposer pendant la durée du temps épargné; 2° Il peut être employé à satisfaire mieux les besoins de première nécessité en vue des-quels les entreprises ont été créées; 3° Enfin, il peut être employé à satisfaire d'autres besoins d'une intensité moindre et auxquels jusqu'alors il n'avait pu être pourvu, la satisfaction de leurs besoins de première nécessité ayant absorbé [145] toute la durée du temps utilisable des producteurs. La première de ces destinations est celle que donnent à leurs excédents, les peuples inférieurs. Ces peuples, voisins de l'animalité s'ils ne se confondent point avec elle, se contentent de la satisfaction grossière et au jour le jour, de leurs besoins physiques; ils n'emploient à y pourvoir qu'une partie de leur temps utilisable et passent le reste dans l'oisiveté. Il en résulte que leur existence est extrêmement précaire: ils sont continuellement exposés soit à être expropriés et détruits par des concurrents plus nombreux et plus actifs, soit à périr faute de subsistances, lorsque la chasse, la pêche ou la récolte des fruits naturels du sol présente un déficit au lieu d'un excédent, — Des races mieux douées, mais chez lesquelles cependant prédominent les besoins purement physiques s'appliquent à y pourvoir plus amplement et à en mieux assurer la satisfaction; elles mettent en culture une plus grande étendue de terre, élèvent un plus grand nombre d'enfants, se construisent des habitations plus vastes, plus solides, se fabriquent des vêtements plus confortables. Elles obtiennent ces résultats: 1° en épargnant une partie de leurs excédents au lieu de les consommer et en les appliquant à la création de nouvelles entreprises ou à l'agrandissement des anciennes; 2° en consacrant à ces entreprises nouvelles ou accrues le temps utilisable qui leur reste disponible. — Enfin apparaissent des races supérieures pourvues de besoins physiques, intellectuels et moraux sinon illimités, au moins sans limites assignables, mais auxquels l'insuffisance originaire de leurs moyens de production ne leur permet de donner qu'une satisfaction étroitement limitée, bien qu'elles les mettent en œuvre pendant toute la durée de leur temps utilisable. Que font-elles? Elles s'appliquent incessamment à augmenter leur puissance productive, en perfectionnant leur industrie, Le résultat de chaque progrès, c'est de leur procurer une épargne de temps, toute augmentation de la puissance productive permettant de créer une plus grande quantité de produits dans le même espace de temps. Ce temps épargné, elles peuvent l'employer soit à pourvoir plus amplement à leurs besoins de première nécessité, soit à donner satisfaction à d'autres besoins auxquels l'insuffisance de leur puissance [146] productive ne leur permettait pas de pourvoir; enfin elles peuvent le dépenser dans l'oisiveté. Mais elles ne lui donneront cette dernière destination qu'après que l'ensemble de leurs besoins physiques, intellectuels et moraux auront pu être assez amplement satisfaits pour que la jouissance que leur satisfaction procure n'équivale pas à celle du temps dépensé dans l'oisiveté. Jusque là, elles continueront à appliquer à la production toute la durée de leur temps utilisable. C'est en cela qu'elles se distinguent des races inférieures et à cela qu'elles sont redevables de leur richesse et de leur civilisation progressives.
Ajoutons quelques mots sur l'ordre chronologique de la satisfaction des besoins.
Nous avons dit que la masse des besoins d'une société civilisée peut être considérée comme une quantité illimitée, tandis que la masse des moyens de production est une quantité limitée. Si tous les besoins étaient égaux, ils obtiendraient une satisfaction égale, bien qu'insuffisante. Mais ils sont naturellement inégaux, ils le sont en intensité et en volume, avec ce caractère commun que leur satisfaction procure une jouissance et que leur non-satisfaction cause une souffrance, proportionnelles, l'une et l'autre, à leur degré d'intensité.
D'un autre côté, les moyens de production peuvent être indifféremment appliqués à la satisfaction de tous les besoins; seulement avec une dépense inégale, représentant une somme inégale de peines ou de souffrances. Auxquels pourvoira-t-on de préférence? évidemment à ceux qui, après avoir couvert la dépense, procureront un plus grand excédent de jouissances.
Représentons par A le besoin le plus intense, par B, C, D et la série des autres lettres de l'alphabet les besoins de moins en moins intenses. Tous veulent néanmoins être satisfaits et se font concurrence pour demander les produits ou les services propres à les satisfaire. Mais la demande de A étant la plus intense, celle, par conséquent, dont la satisfaction procure le plus grand excédent de jouissances, les moyens de production seront attires d'abord dans l'industrie propre à y pourvoir. Cependant, à mesure que le besoin A est pourvu, sa demande diminue d'intensité et un moment arrive où elle [147] se trouve dépassée par celle du besoin B. Alors celle-ci attire à son tour les moyens de production et ainsi de suite jusqu'à une lettre dont la demande demeure quand même inférieure en intensité à celle de la lettre précédente. Ce sera, par exemple, la lettre N. La production nécessaire pour subvenir à sa demande ne sera point entreprise; le besoin N ne recevra aucune satisfaction et à plus forte raison les besoins O, P, Q, R, etc.
Cependant, dans une société en progrès, les moyens de production vont croissant en quantité et en puissance. Ils peuvent créer, dans la même durée de temps, une plus grande quantité de produits ou de services. Ce surplus est offert d'abord aux besoins représentés par les premières lettres de la série, en raison de l'intensité de leur demande. Mais cette intensité diminuant à mesure que les satisfactions offertes vont en augmentant, la demande de la lettre N et successivement des lettres suivantes, naguère inférieure à celle des précédentes, la dépasse maintenant, et attire, à son tour, une part des moyens de production. Ainsi tous les besoins finissent par recevoir satisfaction dans la mesure de leur intensité et d une manière de plus en plus approchante de leur consommation possible.
IV. Les Entreprises. § Ier Leurs conditions naturelles d'existence. — Toute production, qu'elle ait pour objet la satisfaction d'un besoin physique, intellectuel ou moral, s'effectue au moyen d'entreprises. Aucune ne peut subsister qu'à la condition que les entreprises entre lesquelles elle se partage, rétablissent intégralement le capital personnel, immobilier et mobilier qui s'y trouve engagé, autrement dit couvrent leurs frais, et réalisent un profit équivalent à celui des autres branches de la production. Sans doute, il y a des entreprises qui ne réalisent qu'un profit inférieur au niveau général, il y en a même qui ne couvrent pas leurs frais; mais l'industrie à laquelle ces entreprises appartiennent cesserait bientôt d'attirer les capitaux et finirait par être abandonnée si, dans son ensemble, elle ne procurait pas un profit égal à celui des autres. Qu'observe-t-on, par exemple, dans les industries où l'aléa est considérable, soit en vertu de la [148] nature même de la production (recherche de l'or, pêche des perles, etc), soit par l'incertitude et la variabilité des débouchés' (commerce extérieur), soit par les difficultés spéciales que présentent la conduite des entreprises et la création du produit ou du service, la rareté et l'inégalité des aptitudes de ceux qui s'y appliquent (institutions de crédit, production littéraire et artistique)? C'est qu'un bon nombre d'entreprises, parfois même le plus grand nombre ne couvrent pas leurs frais et finissent par succomber, c'est que d'autres ne réalisent que des profits insuffisants et précaires, tandis que quelques-unes en obtiennent de bien supérieurs au niveau général. Mais l'excédent des uns compense l'insuffisance des autres, en sorte que la moyenne des résultats de l'ensemble est approximativement équivalente à celle de la généralité des industries. Est-il nécessaire d'ajouter qu'elle ne peut pas ne pas l'être? Si elle était inférieure, les capitaux ne se porteraient-ils pas de préférence dans les industries plus profitables? Si elle était supérieure, les capitaux n'afflueraient-ils pas, au contraire, dans cette branche privilégiée jusqu'à ce que l'équilibre des profits se trouvât rétabli? Toutes les industries, sinon toutes les entreprises doivent donc donner des résultats équivalents, sauf l'action perturbatrice des obstacles qui empêchent les capitaux de se distribuer librement entre elles.
§ 2. Les formes et les dimensions des entreprises. — Les entreprises présentent, dans leurs formes et leurs dimensions aussi bien que dans leurs résultats, une extrême diversité. Mais ces formes et ces dimensions n'ont rien d'arbitraire. Elles dépendent: 1° de l'étendue du débouché qui est ouvert aux entreprises; 2° du degré d'avancement du personnel et du matériel; 3° de la grandeur des obstacles qu'il faut surmonter pour créer le produit ou le service. Si le débouché est peu étendu, les entreprises ne comporteront que des formes rudimentaires et des dimensions étroites. Ce qui dominera, ce sera l'entreprise individuelle. Un individu pourvu des aptitudes, des connaissances et des garanties nécessaires se procurera, s'il ne le possède pas en totalité lui-même, le capital requis par l'entreprise, et se mettra à l'œuvre, seul ou avec [149] un petit nombre d'auxiliaires. Il produira, par exemple, une petite quantité de grains ou d'autres substances alimentaires qu'il ira porter lui-même au marché voisin, ou bien il fabriquera de la toile sur un métier grossier; il ouvrira une boutique ou une auberge. Si le débouché dont il dispose vient à s'agrandir, il trouvera profit à accroitre, en proportion, l'étendue de son exploitation. Il agrandira sa ferme, son atelier, sa boutique ou son auberge de manière à pourvoir à la demande accrue des consommateurs devenus plus nombreux ou plus riches. Cependant, si les aptitudes, les connaissances et les garanties morales, qu'exige la gestion d'une exploitation plus vaste, partant plus compliquée, font défaut à l'entrepreneur et à ses auxiliaires, si le personnel employé à la petite entreprise n'a pas réalisé les progrès requis par la grande, si le matériel n'a pas progressé davantage, les dimensions et la forme des entreprises demeureront les mêmes; et toute tentative faite pour les modifier échouera; on en verra seulement augmenter le nombre, et il en sera ainsi jusqu'à ce que l'acquisition d'aptitudes, de qualités morales et de connaissances supérieures se joignant à la transformation de l'outillage, rendent les grandes exploitations décidement plus économiques que les petites.
Il existe toutefois des industries qui ne peuvent être exercées que sur une échelle étendue, en comparaison des autres branches de la production, telle est celle de la création et de l'exploitation politique d'un domaine territorial. Mème aux époques où les aptitudes, les connaissances et le matériel nécessaires à ce genre d'industrie étaient encore peu avancés, on a vu se fonder de vastes empires, les petits états ne pouvant, que dans des circonstances exceptionnelles, soutenir la concurrence des grands et finissant par devenir leur proie. Il y a toujours eu néanmoins et il y a encore à l'agrandissement des états une limite qui ne peut être utilement dépassée. Les progrès du matériel de guerre, du mécanisme administratif, des moyens de communication ont reculé cette limite et il existe de nos jours des états, tels que la Russie, qui eussent été jadis inévitablement démembrés comme l'ont été l'empire d'Alexandre et la monarchie de Charles-Quint. L'étendue excessive d'un établissement politique n'en [150] demeure pas moins une cause permanente d'affaiblissement. L'administration se relâche et se corrompt, surtout à mesure qu'elle se complique en multipliant ses attributions, et ce vice intérieur bien plus encore que la concurrence extérieure, agit incessamment pour dissoudre un état devenu trop vaste et le ramener à des proportions économiques. Il en est de même pour les entreprises industrielles proprement dites, lorsqu'elles dépassent, par leur étendue, les possibilités d'une gestion et d'un contrôle efficaces.
§ 3. La quantité et les proportions du capital nécessaire aux entreprises. — Toute entreprise exige la réunion d'un capital investi dans un personnel et un matériel. La quantité de ce capital varie suivant les dimensions de l'entreprise et la durée de l'opération productive; la proportion des éléments qui le constituent n'est pas moins diverse et variable. Cette proportion est déterminée par la nature de l'industrie et son degré d'avancement. Si l'on considère l'ensemble des industries au moyen desquelles l'homme pourvoit à la multitude de ses besoins physiques, intellectuels et moraux, on constatera que la proportion de leurs éléments constitutifs diffère plus ou moins selon leur nature. Ainsi les industries agricoles exigent sous forme de terre, une plus forte proportion de capital immobilier que les industries manufacturières, et relativement moins de capital personnel et mobilier sous forme de travailleurs, de matières premières, etc.; les industries commerciales (transport des produits dans l'espace et le temps) exigent surtout un capital mobilier sous forme de marchandises. Mais ces proportions varient avec l'état d'avancement de l'industrie. La proportion des éléments constitutifs de la production alimentaire, par exemple, a varié, dès l'origine, en sens divers. Lorsque l'homme demandait sa subsistance à la récolte des fruits naturels du sol et à la chasse, la production des aliments nécessaires à la consommation d'un millier d'individus, exigeait la mise en œuvre d'un personnel comprenant au moins la moitié de ce nombre et l'exploitation d'un domaine territorial, dont l'étendue, même dans les régions les plus abondantes en gibier et en productions naturelles, ne pouvait guère être inférieure à 1,000 kilomètres carrés. En [151] revanche, cette industrie, encore à l'état embryonnaire, n'employait qu'un capital mobilier relativement peu considérable, sous forme d'armes ou d'engins grossiers et d'approvisionnements que la faible durée des opérations de cueillette et de chasse permettait de renouveler à court délai. Il en a été autrement lorsque l'agriculture a remplacé ces modes primitifs de production des subsistances. Il n'a plus fallu alors qu'un personnel et une étendue de terre infiniment moindres pour produire les aliments nécessaires à un millier d'individus, mais la proportion du capital mobilier, notamment sous forme d'approvisionnements a dû être augmentée, à raison de l'accroissement de la durée de l'opération productive, le grain ne pouvant être moissonné que plusieurs mois après avoir été semé tandis qu'un lièvre ou un chevreuil pouvait être capturé après une poursuite de quelques heures. La proportion des éléments constitutifs de la production alimentaire se modifie encore aujourd'hui, sensiblement, sous l'influence des progrès de la science et de l'outillage agricoles. La culture perfectionnée n'exige qu'un petit nombre de bras et une faible étendue de terre, mais avec la coopération d'un capital mobilier de plus en plus considérable sous forme de machines, d'engrais et d'amendements. La même observation s'applique à la généralité des autres industries. La proportion de leurs éléments constitutifs se modifie d'une manière incessante le plus souvent sous l'influence du progrès, mais parfois aussi de la dégénérescence du personnel et du recul des procédés et de l'outillage.
Quelle conclusion faut-il tirer de ces observations? C'est qu'il n'est pas indifférent de constituer un capital sous une forme ou sous une autre. Chaque entreprise exigeant, dans des proportions déterminées par sa nature et son degré d'avancement, la réunion d'un capital investi sous forme de valeurs personnelles, immobilières et mobilières, il y a, dans toute société, considérée à un moment donné de son existence, une proportion formelle et nécessaire entre les capitaux personnels, immobiliers et mobiliers applicables à la production. Lorsqu'une de ces catégories de capitaux surabonde, l'excédent ne pouvant être employé, demeure inactif, s'use et se détruit jusqu'à ce que la proportion requise par la production [152] se trouve rétablie; lorsqu'elle est au contraire à l'état de déficit, l'excédent des deux autres ne peut de même être utilisé. Alors, la rétribution des catégories surabondantes diminue tandis que celle de la catégorie en déficit s'accroît, et le résultat final est une tendance naturelle à l'équilibre entre les agents et les éléments nécessaires à la production.
§ 4. Le rétablissement du capital. — Aucune industrie ne peut subsister qu'à la condition que le capital investi dans l'ensemble de ses entreprises soit entièrement et indéfiniment rétabli sous ses trois formes: personnelle, immobilière et mobilière. Or, nous avons vu que toute opération productive consomme ou détruit partiellement une partie du capital employé, entièrement une autre partie. Le capital personnel et immobilier, investi sous forme de travailleurs, de terres ou de bâtiments est simplement usé et n'exige, pour être rétabli, que la somme nécessaire à son entretien et à son renouvellement. Il en est de même pour la portion du capital mobilier, qualifié communément d'immobilier par destination, investi sous forme de machines et d'outils. En revanche, le capital mobilier, investi sous forme de matières premières et d'avances d'entretien du personnel et du matériel est entièrement consommé et doit être entièrement rétabli à chaque opération.
Comment s'opère ce rétablissement du capital employé à la production? Il s'opère par l'attribution à chacun des agents et des éléments constitutifs de l'entreprise, d'une somme de valeurs égale à celle qui a été consommée dans l'opération productive. Si le produit obtenu demeure inférieur à cette somme, le capital employé ne pouvant être entièrement rétabli, la production ne peut être indéfiniment continuée.
Cependant, il importe de distinguer le capital effectivement employé à produire ou capital d'exécution du capital d'entreprise. Le premier comprend le personnel, — entrepreneur ou directeur de l'exploitation, employés, ouvriers, — et le matériel, — terres, bâtiments, machines, outils, matières premières, — en d'autres termes, il se compose de valeurs personnelles, immobilières et mobilières, associées dans les proportions requises par la nature et l'entreprise; et c'est la mise en œuvre de ce capital qui, dans un espace de temps plus ou [153] moins long et avec des chances de profit et des risques de perte, donne naissance au produit. Le second se compose exclusivement de valeurs mobilières, et il a pour fonction d'avancer la valeur du produit aux coparticipants de la production, en l'assurant aussi complètement que possible contre les risques. L'un et l'autre sont également nécessaires, mais le capital d'entreprise, au lieu d'être concentré entre les mains de l'entrepreneur, pourrait fort bien demeurer épars dans celles des différents coopérateurs de la production. Les directeurs, employés et ouvriers représentant le capital personnel, les propriétaires, les industriels et les négociants auxquels appartiennent les terres, les bâtiments, les machines, les outils et les matières premières, pourraient attendre que le produit fût créé et réalisé pour se le partager. Mais, dans ce cas, chacun d'eux, devrait posséder une portion du capital indispensable à la fois pour subvenir à l'entretien du personnel et du matériel dans l'intervalle et pour couvrir les risques de la production. Or, ce capital d'avance et d'assurance, les uns ne le possèdent pas et n'offrent pas les garanties requises pour l'emprunter, les autres le possèdent, mais ne se soucient pas de l'avancer et de participer aux risques de l'entreprise. Que fait l'entrepreneur? Cette avance que les autres coopérateurs de l'entreprise, travailleurs, propriétaires, industriels, négociants ne peuvent ou ne veulent pas faire, ces risques qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas courir, il s'en charge au moyen d'une sorte de marché à forfait. Sans attendre que le produit soit créé et réalisé, il achète au comptant ou à des termes fixes et rapprochés, les services des uns et les matériaux des autres. en cumulant ainsi avec ses fonctions d'entrepreneur celles de banquier et d'assureur, au moins vis-à-vis de ceux des coopérateurs de l'entreprise qui n'en attendent pas les résultats et n'en courent pas les risques. Dans ce but, il réunit un capital d'entreprise dont le montant doit être proportionné à la grandeur et la durée de l'opération productive ainsi qu'à l'élévation des risques dont elle est grevée. Ce capital, tantôt il le possède lui-même, tantôt et le plus souvent, il en emprunte une partie. On peut supposer une organisation de l'industrie dans laquelle l'entrepreneur ne remplirait pas les fonctions de banquier et d'assureur, mais, n'en déplaise aux socialistes qui [154] dénoncent l'entrepreneur-capitaliste comme un tyran doublé d'un parasite, le capital nécessaire à l'avance et à l'assurance des résultats de l'entreprise n'en devrait pas moins exister et recevoir sa part de ces résultats pour que la production fût possible.
[155]
CHAPITRE VI
L'analyse de la production (Suite et fin).↩
I. Le produit brut, le produit net et le profit. — II. L'accroissement et la diminution de la production. — III. L'équilibre de la production et de la consommation. — IV. Résumé du processus de la production. La gravitation économique.
I. Le Produit Brut, Le Produit Net Et Le Profit. — Le produit brut, c'est le résultat total de l'opération productive, Il peut être inférieur, égal ou supérieur aux frais de la production. Dans le dernier cas, l'excédent constitue le produit net. Aucune entreprise ne peut rapporter un profit à l'entrepreneur qu'à la condition de donner un produit net. Mais le profit, sous le régime de la production divisée, ne comprend jamais la totalité du produit net. Il n'en comprend qu'une fraction généralement minime, mais variable. Le produit net peut s'accroître sous l'influence du progrès de l'industrie sans que le profit s'élève, et, d'un autre côté, le profit peut s'élever sous l'influence d'un monopole ou de toute autre circonstance, sans que le produit net s'accroisse.
Sous le régime de la production isolée, en supposant que ce régime ait jamais existé, le profit se confondait naturellement avec le produit net, le producteur, sous ce régime, ne se séparant point du consommateur. Le montant du produit net dépendait du degré de productivité de l'industrie et de la durée du temps employé à la production. Supposons [156] qu'un producteur isolé, en employant toute la durée de son temps utilisable à la production alimentaire récoltât le double de la quantité nécessaire pour couvrir ses frais de production, en y comprenant, avec sa subsistance, l entretien et le renouvellement de ses outils et de ses materiaux pendant la durée de l'opération productive, il recueillait un produit net de 100%. Le produit net ne se séparant pas du profit, celui-ci atteignait done un taux fort élevé. En revanche le produit brut était à son minimum. Surviennent les progrès de l'industrie alimentaire, la division du travail et l'échange. Aussitôt le produit brut s'accroît. En consacrant à la production des subsistances la même durée de temps, l'agriculteur succédant au chasseur obtient au lieu d'une quantité double une quantité décuple. Mais, sous ce régime, il ne produit plus pour lui-même, il produit pour autrui, et il réalise par l'échange les résultats de sa production. Il offre ses produits au marché et demande, en échange, la généralité de ceux dont il a besoin, ou, ce qui revient au même, la monnaie qui a le pouvoir de les lui procurer dans la mesure, et au moment où il en a besoin. Tous les autres producteurs, auxquels il a directement on indirectement affaire, se trouvent dans une situation analogue à la sienne. En passant du régime de la production isolée à celui de la production divisée, ils ont accru dans des proportions considérables quoique diverses et inégales la productivité de leur industrie: au lieu d'un produit net double, ils obtiennent un produit net décuple, vingtuple ou même centuple. Mais chacun conserve-t-il comme sous le régime de la production isolée, la totalité de son produit net, en jouissant ainsi de tout le fruit des progrès réalisés dans sa branche particulière d'industrie? Non. Avec le régime de la production divisée et de l'échange est apparue la concurrence. Les producteurs de substances alimentaires se font concurrence pour offrir leurs denrées, en échange des articles dont ils ont besoin et qu'ils demandent.
Ils s'efforcent naturellement, dans cet échange, de retenir pour eux la totalité de leur produit net; mais, en admettant même que la demande des consommateurs s'élevât aussi haut que possible, et que la concurrence n'existât point entre les producteurs ils ne le pourraient point. En effet, si la production [157] isolée des denrées alimentaires donnait un produit brut double des frais, et la production divisée un produit brut décuple, c'est-à-dire dans le premier cas un produit net de 100% et dans le second de 1,000% les consommateurs trouveraient autant de profit à produire eux-mêmes les aliments dont ils ont besoin qu'à les payer un prix qui laisserait au producteur la totalité du produit net. Le prix des subsistances ne peut done monter, du moins d'une manière régulière et permanente, sous le régime de la production divisée, à un taux qui laisse au producteur un profit supérieur au montant de son produit net, déduction faite du produit net de la production isolée, c'est-à-dire à 1,000-100. Mais les producteurs de denrées alimentaires se multiplient et ils se font une concurrence de plus en plus vive et serrée. Le prix baisse. Jusqu'à quelle limite peut-il baisser? Jusqu'au point où il ne leur laisse plus qu'une part de produit net égal à la totalité qu'ils obtiendraient sous le régime de la production isolée, c'est-à-dire à 1,000-900.
Voilà les limites entre lesquelles se fixe le prix des choses sous le régime de la production divisée, au moins quand l'industrie est libre, quand on peut produire indifféremment pour soi ou pour autrui. Ce prix laisse toujours au producteur à titre de profit, une fraction du produit net qui, si petite qu'elle soit, est au moins égale à la totalité du produit net de la production isolée, mais qui, si grande qu'elle soit, ne peut jamais dépasser le montant du produit net de la production divisée, déduction faite de celui de la production isolée. A mesure que la productivité de l'industrie augmente et par conséquent que le produit net s'accroît, cette fraction qui constitue le profit, et que la concurrence abaisse incessamment à son taux nécessaire, va diminuant jusqu'à ne plus comprendre qu'une portion presque infinitésimale du produit net; la masse du produit net va ainsi au consommateur. Toutefois, il en est autrement sous un régime de monopole ou d'obstruction de la concurrence. Dans ce cas, le producteur peut obtenir et il obtient au-delà de sa part nécessaire de produit net, mais cet accroissement anormal de son profit est obtenu aux dépens de la généralité des consommateurs.
Nous savons maintenant dans quelles limites se meut le [158] profit sous le régime de la production divisée. Il nous reste à connaitre le point vers lequel il tend à se fixer. Ce point est marqué par le prix nécessaire pour couvrir les frais de la production avec adjonction: 1° d'une portion de produit net suffisante pour couvrir les risques de l'entreprise; 2° d'une autre portion de produit net suffisante pour déterminer les détenteurs de capitaux, soit personnels, soit mobiliers ou immobiliers à les employer à la production au lieu de les laisser inactifs, et, par conséquent, à consacrer leur temps utilisable à la production plutôt qu'à la consommation. Le taux des risques s'abaisse sous l'influence des progrès du mécanisme de la production et de l'échange: mais il en est autrement de la valeur du temps utilisable. A mesure que la richesse s'accroît et avec elle la somme des jouissances que peut procurer le temps consacré à la consommation, la portion qui en est prise pour être employée à la production représente une privation de jouissances actuelles plus grande, laquelle doit être compensée par un profit plus élevé, c'est-à-dire contenant une plus grande somme de jouissances futures.
On voit, en résumé, que le profit ne doit point être confondu avec le produit net. Il ne peut exister qu'à la condition que l'industrie donne un produit net, mais il n'en est jamais qu'une fraction. On voit aussi que le produit net n'est point, comme le croyaient les physiocrates, l'apanage exclusif de la production agricole. Il apparaît, sous l'influence du progrès, dans toutes les industries et c'est même dans l'industrie alimentaire, demeurée jusqu'à ces derniers temps la moins progressive, qu'il est resté au niveau le plus bas, exception faite peut-être des services monopolisés par les gouvernements. Ce qui a donné naissance à l'erreur des physiocrates, c'est que la production agricole procure, en sus des frais de production et du profit de l'exploitant, un revenu au propriétaire foncier, mais, comme nous l'avons constaté en remontant aux causes de la valeur du sol, ce revenu n'est autre chose que la rétribution nécessaire du capital employé à découvrir, conquérir of occuper la terre de manière à la rendre habitable et exploitable.
II. L'accroissement Et La Diminution De La Production.— [159] La production peut s'accroître, diminuer ou demeurer stationnaire. 1° Elle demeure stationnaire quand elle couvre seulement ses frais, en y comprenant le profit nécessaire. Dans ce cas, cependant, il y a toujours des entreprises qui sont en perte et d'autres qui donnent un excédent; mais si les excédents compensent exactement les pertes, la production ne progresse ni ne recule. 2° La production diminue lorsqu'une industrie cesse de couvrir ses frais, c'est-à-dire de rétablir intégralement le capital qui y est employé sous forme de valeurs personnelles, immobilières et mobilières, et de donner un profit équivalent à celui des autres industries. 3° La production s'augmente sous l'influence immédiate de l'accroissement du profit, mais elle ne peut s'augmenter d'une manière générale et permanente que par le fait de l'accroissement du produit net. Lorsqu'une industrie, grâce à l'adoption d'un outillage plus puissant et de procédés plus économiques. diminue ses frais et par conséquent accroît son produit net, que se passe-t-il? D'abord, son profit s'élève de tout le montant de la réduction des frais ou de l'exhaussement du produit net. Ensuite, les capitaux venant à affluer dans une industrie dont le profit dépasse le niveau commun, leur concurrence abaisse le prix partant le taux du profit, et l'accroissement du produit net va alors an consommateur. La baisse du prix permet au consommateur de réaliser une économie qu'il applique à une satisfaction plus complète de ses besoins, en sorte que le progrès accompli dans une branche d'industrie a pour effet d'augmenter la demande des produits de la plupart des autres. Cette augmentation de la demande ne manque pas de stimuler le progrès dans ces branches et de déterminer chez elles un exhaussement du produit net bientôt suivi d'un abaissement du prix. On s'explique ainsi la prodigieuse impulsion qu'a reçue la production du monde civilisé sous l'influence des progrès qui ont commencé, dans la seconde partie du siècle dernier, la transformation de l'industrie. On s'explique, en revanche, aussi, que dans un pays où l'augmentation des charges publiques et la protection accordée à certaines industries aux dépens des autres, élèvent les frais généraux de la production et diminuent le produit net, la décadence devienne inévitable.
[160]
III. L'équilibre De. La Production Et De La Consommation. — Il ne suffit pas de produire, il faut ajuster la production aux besoins. Si l'on suppose un homme isolé produisant lui-même tous les articles nécessaires à sa consommation, il pourra aisément résoudre ce problème, en réglant l'emploi de ses capitaux et de son temps de manière à obtenir de chaque sorte de produits et de services, la quantité requise pour chacun de ses besoins, en raison de leur intensité et de lèur volume. Mais comment proportionner la production à la consommation lorsque l'atelier de la production occupe le globe tout entier, et fournit une masse énorme et diverse de produits et de services qui les uns sont destinés à une consommation immédiate et sur place, les autres à une consommation parfois fort éloignée dans l'espace et le temps. Dans de pareilles conditions, ne doit-il pas arriver incessamment que l'on produise trop d'un article et trop peu d'un autre, et le problème de l'établissement de l'ordre économique ne peut-il pas sembler insoluble? Cependant ce problème se résout avec une exactitude mathématique par l'opération des lois naturelles de la concurrence et de la progression des valeurs, lorsque ces lois ne sont pas entravées, d'une manière ou d'une autre, dans leur action régulatrice. Comment agissent-elles?
Sous le régime de la production divisée comme sous celui de la production isolée, c'est la demande d'un besoin qui provoque la creation d'un produit ou d'un service quelconque. Mais cette demande ne peut être satisfaite qu'à deux conditions: 1° Qu'il existe des capitaux disponibles dans la quantité etles proportions nécessaires pour constituer et mettre en œuvre les entreprises de production; 2° Que le besoin qui fait la demande possède et soit disposé à fournir en échange du produit ou du service une somme de valeur suffisante pour rétablir les capitaux employés, avec adjonction d'un profit équivalent à celui de la généralité des branches de la production. Jusqu'à ce que ces deux conditions soient remplies, le besoin ne sera point satisfait, sa demande ne provoquera aucune offre. Mais du moment où elles viennent à l'être, les entreprises naissent et se multiplient pour y répondre. Trois cas peuvent se présenter alors. Ou bien la quantité offerte du [161] produit ou du service répond exactement à la demande, et obtient en échange la somme de valeur requise pour rétablir les capitaux employés avec adjonction du profit nécessaire, ou elle est inférieure ou elle est supérieure. Dans le premier cas, et en supposant qu'il en soit ainsi dans toutes les branches de la production, l'ordre le plus complet règnera dans le monde économique, chaque demande étant satisfaite dans la mesure de son intensité et de son volume et chaque branche d'industrie obtenant la rétribution qui lui est nécessaire pour subsister et se développer proportionnellement aux autres, ni plus ni moins. Mais supposons que dans une branche quelconque de la production, l'équilibre se trouve rompu, supposons que l'offre d'un produit ou d'un service soit inférieure ou supérieure à la demande au niveau de la rétribution nécessaire. Si elle est inférieure, le prix du produit ou du service s'élèvera, et cette hausse sera plus ou moins forte, d'une part, selon l'importance du déficit, d'une autre part, selon le degré de nécessité de l'article et, par conséquent, selon l'influence plus ou moins restrictive que le déficit de l'offre et la hausse du prix exerceront sur la demande. Dans ce cas, que se passera-t-il? C'est que la rupture de l'équilibre en faveur de l'offre d'un article déterminera la rupture générale de l'équilibre au détriment de l'offre de la plupart des autres articles et au profit de quelques-uns. S'il s'agit de blé, par exemple, dans une année où la récolte est insuffisante et où le prix s'élève, les consommateurs, obligés de fournir ce supplément de prix pour une denrée dont ils ne peuvent se passer, se trouvent dans la nécessité de réduire la demande d'un grand nombre d'articles de luxe ou de confort. Cette réduction de leur demande détermine une surabondance de l'offre de ces articles jusqu'à ce que la production en ait été proportionnellement réduite. En revanche, les producteurs de blé, réalisant un profit extraordinaire, peuvent augmenter leur demande habituelle, mais l'accroissement de cette demande ne se produisant pas communément pour les mêmes articles et dans le même endroit, l'équilibre général ne se trouve pas moins rompu au détriment de certaines industries, à l'avantage de certaines autres. Supposons enfin que l'offre d'un produit ou d'un service vienne à être supérieure à la demande, qu'il y ait, pour nous servir [162] de l'expression que les socialistes ont mise à la mode, « surproduction », que l'on ait produit, par exemple, une telle quantité de cotonnades que le marché en soit encombré et que le prix tombe au-dessous du taux rémunérateur, qu'arrivera-t-il? L'équilibre se trouvera de nouveau rompu, cette fois au détriment de l'offre des cotonnades, et immédiatement, en faveur de celle de la plupart des autres articles. Les consommateurs de cotonnades pourront, en effet, employer et emploieront l'économie que leur aura procurée la baisse du prix à augmenter leur demande d'un certain nombre d'autres produits ou services, dont les prix, et avec eux les profits des producteurs, s'élèveront jusqu'à ce que la production ait pu être accrue en proportion de l'augmentation de la demande. En revanche, les profits de l'industrie des cotonnades ayant baissé, ceux qui l'exercent diminueront leur demande d'un certain nombre d'articles, d'où une surabondance momentanée de ces articles; enfin, si la surproduction des cotonnades a occasionné la ruine des entreprises les moins solides, la diminution de capital qui en résultera créera un déficit dans les moyens d'achat, partant dans la demande de toute sorte de produits et services, jusqu'a ce que la capitalisation et l'emploi productif des capitaux de nouvelle formation aient comblé ce déficit. On voit donc que l'équilibre général de la production et de la consommation est essentiellement instable, et qu'il suffit pour le rompre d'un excédent ou d'un déficit dans l'offre ou la demande d'un seul produit ou service. Il semblerait d'après cela que le monde économique dût être continuellement livré à l'anarchie, et il est, en effet, continuellement troublé par des accidents naturels ou artificiels qui agissent tantôt pour diminuer, tantôt pour augmenter à l'excès l'offre ou la demande de l'un ou l'autre des milliers d'articles qui contribuent à la satisfaction de nos besoins. Mais le désordre ne peut se perpétuer ni même se prolonger. Aussitôt que l'ordre est troublé, les lois naturelles de la concurrence et de la progression des valeurs interviennent avec une irrésistible puissance pour le rétablir. Dès qu'un déficit se manifeste dans un compartiment quelconque de l'immense atelier de la production, dès que l'offre d'un produit ou d'un service ne suffit plus à la demande effective, c'est-à-dire appuyée sur l'offre [163] d'un prix rémunérateur, ces deux lois agissent de concert pour déterminer l'exhaussement en progression géométrique du prix et du profit, attirer ainsi promptement dans l'industrie en déficit un supplément de capital ety provoquer la création d'un supplément de produits. Dès, au contraire, qu'il y a surproduction, dès que l'offre dépasse la demande, les mêmes lois déterminent la baisse du prix et du profit, de manière à provoquer, sous peine de destruction, le retrait des capitaux surabondamment employés et la diminution de la production. En sorte que l'équilibre constamment troublé par des causes partielles de désordre est non moins constamment rétabli par des lois générales d'ordre.
Cependant, on s'est demandé s'il ne pouvait pas se produire une rupture universelle de l'équilibre entre la production et la consommation; s'il ne pouvait pas arriver que l'on produisît trop peu ou que l'on produisît trop et, dans ce dernier cas, qu'il en résultât un encombrement général, a general glut. occasionnant la ruine non moins générale des producteurs. Cette question que des économistes tels que M. de Sismondi ont posée à une époque où les lois naturelles qui gouvernent le monde économique étaient encore imparfaitement connues, les socialistes n'ont pas manqué de la reprendre, et de la résoudre par l'affirmative; d'où ils ont conclu que la production étant abandonnée à l'anarchie, il était indispensable de l'organiser.
Que l'on produise trop peu pour satisfaire à tous les besoins, c'est malheureusement un fait incontestable, mais qui est dû à l'insuffisance de la productivité de l'industrie, et auquel on ne peut remédier qu'à la longue, au moyen de découvertes et d'inventions qui augmentent la puissance productive de l'homme. Mais que l'on produise trop peu pour satisfaire à la demande effective, c'est-à-dire appuyée sur l'offre d'un prix rémunérateur, c'est, comme nous venons de le voir, un phénomène qui ne peut être qu'accidentel et temporaire. Tout déficit dans une branche quelconque d'industrie déterminant une augmentation instantanée du prix, partant du profit, les capitaux affluent aussitôt dans cette direction jusqu'à ce que le déficit soit comblé. Que si les capitaux font défaut, l'élévation extraordinaire du profit ne manque pas d'encourager la [164] capitalisation et l'apport de ses résultats dans l'industrie en déficit jusqu'à ce que l'équilibre se trouve rétabli.
Il suffit de même d'un peu de réflexion pour se convaincre qu'une surproduction ne peut devenir générale. Toute surproduction commence nécessairement par être partielle. Eh bien! supposons que l'on produise trop d'un ou même de plusieurs articles (et n'oublions pas que les articles de consommation se comptent par milliers) pour répondre à la demande effective, on a vu plus haut ce qui arrive. Les consommateurs des articles surproduits réalisent une économie qui leur permet de demander une plus grande quantité de l'ensemble des produits et services. En revanche, les producteurs subissent une perte de profit ou même de capital qui diminue leur demande. En supposant même qu'elle se réduise de ce côté plus qu'elle ne s'accroît de l'autre, quel sera le résultat? Il pourra y avoir un encombrement partiel et temporaire des articles dont la demande se trouvera diminuée, mais cet encombrement prendra naturellement fin sous l'influence de la baisse du prix, — et d'autant plus vite qu'il sera plus considérable, la baisse du prix s'opérant en raison géométrique et occasionnant promptement, non seulement une réduction de profit, mais encore une perte de capital, partant une contraction en quelque sorte mécanique qui met fin à la surproduction.
IV. Résumé Du Processus De La Production. La Gravitation éConomique. — Essayons maintenant de résumer dans ses traits essentiels le processus de la production. L'homme est soumis à des besoins nombreux et divers qu'il est obligé de satisfaire sous peine de souffrir et de périr. Ces besoins exigent l'assimilation ou la consommation d'éléments qui leur conviennent. Ces éléments sont fournis, les uns par la nature; ce sont les utilités naturelles, les autres en plus grand nombre doivent être produits par l'homme: ce sont les utilités artificielles. Naturelles ou artificielles, les utilités ont le pouvoir de satisfaire les besoins de l'homme, en réparant et en accroissant ses forces physiques, intellectuelles et morales. Ce pouvoir, l'utilité naturelle le contient par elle-même et le fournit gratis; l'homme l'acquiert en créant l'utilité [165] artificielle. Comment l'acquiert-il? Par une dépense de forces et de temps. Il dépense une portion des forces et du temps dont il dispose pour acquérir la force ou le pouvoir contenu dans l'utilité artificielle. Si le pouvoir acquis est supérieur au pouvoir dépensé, celui-ci se trouve non seulement rétabli, mais encore augmenté, et l'opération se solde par un bénéfice; si le pouvoir acquis est inférieur au pouvoir dépensé, l'opération se solde par une perte. Or, toute perte de force utile occasionnant une souffrance et toute acquisition de force procurant une jouissance, l'homme est naturellement intéressé à obtenir le plus grand pouvoir en échange du plus petit. De là la loi de l'économie des forces sous l'impulsion de laquelle l'homme s'applique incessamment à augmenter sa puissance productive. Dans ce but, il se crée un outillage de plus en plus perfectionné et substitue à la production isolée la production combinée et divisée impliquant l'échange. Chacun produit pour tous et tous produisent pour chacun. La production s'opère au moyen d'entreprises réunissant et mettant en œuvre les pouvoirs nécessaires à la création des utilités artificielles. Ces pouvoirs sont investis dans les personnes et dans les choses, et ils constituent les valeurs personnelles, immobilières et mobilières. Ces valeurs accumulées et employées à la production forment des capitaux. Les capitaux mis en œuvre dans les entreprises créent des utilités artificielles sous forme de produits ou de services. Les produits ou services créés dans chaque entreprise s'échangent, par l'intermédiaire de la monnaie, contre ceux des autres entreprises. La valeur des produits ou des services se mesure dans l'échange et s'exprime par le prix. Elle s'élève ou s'abaisse selon l'intensité comparée des besoins auxquels répondent les produits ou les services. Chaque besoin demande le produit ou le service propre à le satisfaire et offre, en échange, le produit ou le service propre à satisfaire le besoin d'autrui. Offre et demande sontréciproques. Mais chacun, obéissant à la loi de l'économie des forces, demande la quantité la plus grande et offre la quantité la plus petite. Qu'est-ce qui décide de la proportion dans laquelle les produits ou les services seront échangés? C'est l'intensité comparée des besoins. Les deux besoins commencent par offrir la quantité la plus petite en échange de la plus grande, mais le plus intense augmente la sienne plus [166] vite que le moins intense, et l'échange s'opère au moment où, dans l'opinion des échangistes, la satisfaction que peut procurer à l'un la plus petite quantité offerte est égale à celle que peut procurer à l'autre, la quantité la plus grande. A ce moment le pouvoir d'utilité ou la valeur contenu dans l'une de ces quantités inégales, apparaît comme égal au pouvoir d'utilité ou à la valeur de l'autre, et le prix exprime à la fois le rapport d'égalité des valeurs et d'inégalité des quantités échangées. Cependant si aucune loi naturelle n'intervenait pour égaliser sinon l'intensité de la demande des besoins, du moins celle de l'offre que la demande provoque, l'échange s'opérerait au détriment des besoins qui exigent la satisfaction la plus prompte, à l'avantage des autres, et il en résulterait une déperdition générale et permanente de forces. Cette loi régulatrice de l'échange c'est la concurrence. Comment agit-elle? Sous le régime de la production combinée et divisée, comme sous celui de la production isolée, chacun entreprend de préférence l'industrie qui, en échange de la plus petite quantité de force dépensée, lui rapporte la quantité la plus grande, la différence constituant pour lui un bénéfice ou un excédent de jouissance sur sa peine. Cela étant, les capitaux affluent dans les entreprises qui ont pour objet de satisfaire aux besoins les plus intenses, et qui obtiennent en conséquence, en échange des quantités les plus petites, les quantités les plus grandes. Alors la production et l'offre augmentent. Dans les entreprises qui répondent aux besoins les moins intenses, au contraire, et qui obtiennent des quantités plus petites en échange des plus grandes, l'affluence des capitaux diminue, la production et l'offre se ralentissent. Ce double mouvement se continue, jusqu'à ce que les deux offres soient égales en intensité. Le résultat, c'est un partage égal des bénéfices de l'échange entre les échangistes. L'action régulatrice de la concurrence est corroborée par la loi de progression des valeurs, toute diminution et augmentation, en progression arithmétique d'une quantité offerte d'un produit ou d'un service, déterminant une hausse ou une baisse, en progression géométrique, de la valeur de ce produit ou de ce service.
Ces trois lois naturelles, lois de l'économie des forces, de [167] la concurrence et de la progression des valeurs, gouvernent la production de toutes les utilités artificielles requises par les besoins des hommes, et l'objet de ce gouvernement naturel ou providentiel du monde économique, c'est la conservation et l'accroissement des forces des producteurs-consommateurs, conservation et accroissement qui sont la condition nécessaire du maintien et de l'extension de l'espèce dans l'espace et le temps, et qui, par conséquent, répondent à son intérêt général et permanent.
Comment ce résultat final est-il obtenu? Par le progrès continu de la puissance productive de l'homme, impliquant l'augmentation croissante du produit net. Sous le régime de la production isolée, la loi de l'économie des forces agit seule pour susciter le progrès. Alors le progrès ne s'accomplit qu'avec lenteur car il n'est point commandé par la nécessité: l'homme s'applique simplement à augmenter sa puissance productive en vue d'épargner sa peine et d'accroître ses jouissances. Mais, sous le régime de la production combinée et divisée, et à mesure que ce régime s'étend davantage, les lois de la concurrence et de la progression des valeurs se joignent à la loi de l'économie des forces pour accélérer le progrès en le rendant nécessaire, sous peine de ruine et de mort industrielle. En effet, dans chaque industrie qui offre à l'échange ses produits ou ses services, la concurrence et la loi de progression agissent pour abaisser leur valeur à mesure que les quantités offertes s'augmentent et dans une proportion plus forte. Mais il y a un point au-dessous duquel cette valeur ne peut descendre, au moins d'une manière régulière et permanente: c'est celui qui est marqué par les frais de production et le profit nécessaire. Or, les frais de production n'ont point partout le même niveau. Ils sont plus élevés dans les entreprises, dont la direction et la gestion sont inhabiles et négligentes, les procédés et l'outillage arriérés, moins élevés dans celles où les procédés et l'outillage les plus perfectionnés sont mis en œuvre par un personnel actif et capable. En faisant descendre avec une rapidité accélérée par la loi de progression, la valeur du produit ou du service au niveau des frais de production les plus has, la concurrence laisse sans une couverture suffisante les frais de production les plus [168] élevés et oblige, en conséquence, sous peine de ruine, les producteurs arriérés à adopter les procédés et l'outillage perfectionnés de leurs concurrents. Toutes les industries sont ainsi irrésistiblement poussées à réduire leurs frais de production, partant à augmenter leur produit net.
Sous l'impulsion des mêmes lois naturelles, les producteurs sont contraints à abandonner cet accroissement du produit net aux consommateurs présents et futurs, c'est-à-dire à la généralité de l'espèce, qui bénéficie ainsi de tous les progrès réalisés de génération, en génération, en ne conservant que la couverture de leurs frais et la portion du produit net strictement nécessaire pour rétribuer leur temps. Cette fraction du produit net qui constitue le profit s'élève plus ou moins selon que le temps a plus ou moins de valeur, c'est-à-dire selon le pouvoir qu'il possède de procurer plus ou moins de jouissances. A mesure que la richesse s'accroît la valeur du temps s'élève. Dans un pays riche, on ne se prive du temps que l'on pourrait employer à la consommation et aux jouissances nombreuses et variées qu'elle procure, qu'à la condition d'obtenir en le consacrant à la production, un surcroît de moyen de satisfaction qui représente des jouissances futures supérieures aux jouissances actuelles. Dans les pays pauvres, au contraire, où le temps employé à la consommation ne procure qu'un minimum de jouissances, le temps n'a qu'une faible valeur et il suffit, en conséquence, d'un faible profit pour déterminer l'homme à sacrifier ses jouissances actuelles pour obtenir des jouissances ou s'épargner des peines futures que son état de pauvreté rend particulièrement redoutables et intenses. Prix du temps utilisé, le profit s'élève done avec la valeur du temps utilisable, sans dépasser cependant la fraction du produit net nécessaire pour déterminer l'apport des capitaux à la production. Car si ce taux nécessaire vient à être dépassé, l'affluence des capitaux ne tarde pas à y ramener le profit par l'opération des lois naturelles de la concurrence et de la progression des valeurs.
C'est ainsi que, sous l'influence des lois naturelles, les producteurs de chaque branche d'industrie sont obligés d'augmenter incessamment leur puissance productive en perfectionnant leur outillage et leurs procédés, et, en même temps, [169] d'abandonner à la généralité les fruits du progrès qu'ils sont contraints de réaliser, en n'en retenant qu'une faible part, à titre de compensation pour l'accroissement de jouissances que le progrès procure et dont ils se privent pendant la durée du temps qu'ils emploient à la production au lieu de le consacrer à la consommation.
Enfin, ces mêmes lois qui suscitent le progrès et en généralisent les fruits établissent dans le monde économique l'ordre et la justice, en ajustant la production avec la consommation, et en attribuant à chacune de ses branches, sa rétribution nécessaire ni plus ni moins. Comment les choses se passent-elles? Chacun demande les produits et les services dont il a besoin et offre en échange les produits et les services demandés par autrui. Qui se charge d'ajuster la demande de chacun des milliers d'articles qui entrent dans la consommation de l'homme civilisé avec l'offre de ces mèmes articles? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas incessamment surabondance des uns et disette des autres? Quelle est la règle et comment cette règle est-elle établie et maintenue? La règle c'est l'utilité générale et permanente de l'espèce, qui commande de satisfaire d'abord les besoins les plus intenses, ceux dont la non-satisfaction entraîncrait la destruction la plus prompte des forces qui demandent à être réparées. Les besoins demandent et appuient leur demande sur une offre proportionnée à leur degré d'intensité.
Cependant pour que les produits ou les services puissent être offerts, il faut qu'il soient créés et ils ne peuvent l'être, qu'à la condition que leurs frais de production soient couverts avec adjonction du profit nécessaire. Alors, mais alors seulement il peut être satisfait à la demande L'article demandé est produit et offert. Si la quantité offerte dépasse la demande du besoin, le prix baisse et finit par cesser de couvrir les frais de la production. Celle-ci diminue, jusqu'à ce que l'équilibre entre l'offre de la demande s'établisse au niveau du prix nécessaire pour rétablir le capital avec adjonction du profit. Si la quantité offerte est inférieure à la demande, le prix hausse et la production s'accroît jusqu'à ce que l'équilibre s'établisse encore au même niveau. Dans chaque branche d'industrie, la production tend ainsi à s'ajuster avec la consommation au [170] niveau du prix nécessaire. De même, si inégale que soit l'intensité des besoins auxquels les diverses branches de la production répondent, aucune ne peut procurer un profit supérieur à celui de la généralité. En effet, si le besoin le plus intense attire d'abord les capitaux dans les industries qui y répondent, la concurrence croissante de ces capitaux détermine la baisse des prix jusqu'à ce que les profits de ces branches particulières de la production tombent au niveau de ceux de la généralité. C'est une gravitation économique qui s'opère sous l'impulsion des lois de la concurrence et de la progression des valeurs et qui a pour résultat de déterminer à la fois l'accroissement continu et l'emploi le plus utile de la puissance productive de l'homme.
[171]
CHAPITRE VII
La distribution. — La part du capital mobilier.↩
Resumé de l'analyse de la production. — Que les lois naturelles déterminent la distribution utile des produits. — équivalence de l'emploi des capitaux. — Le taux nécessaire de la rétribution du capital mobilier. — La privation et le risque. — Les capitaux immobilisés et les capitaux mobilisables. — Le taux courant. — L'offre et la demande. — Causes qui déterminent le montant de l'offre. — L'accroissement de la production des capitaux. — L'extension et l'unification des marchés. — La gravitation du taux courant vers le taux nécessaire. — Raison d'être de l'intérêt. — Origine du préjugé contre le prêt à intérêt. — La fonction du capitaliste.
L'analyse de la production nous a montré: 1° que toute production exige la mise en œuvre d'un capital comprenant trois catégories d'agents productifs, savoir des entrepreneurs, des employés et ouvriers (capital personnel), des terres, des bâtiments, des machines et outils (capital immobilier), des matières premières et des avances de subsistances et d'entretien (capital mobilier); 2° que ces trois catégories d'agents productifs sont associées dans des proportions diverses mais formelles selon la nature de la production, et que ces proportions se modifient sous l'influence du progrès; 3° que toute production s'opère au moyen d'entreprises; 4° qu'aucune entreprise ne peut subsister qu'à la condition de rétablir dans leur intégrité les agents productifs qui y coopèrent; 5° que la production ne peut s'accroître qu'à la condition que les entreprises ne rétablissent pas simplement leurs agents productifs, [172] mais donnent un excédent ou produit net; 6° que la plus grande part de ce produit net va au consommateur; 5° que la part restante est retenue par le producteur après que les agents productifs ont été rétablis et constitue son profit; 8° que le montant de ce profit est proportionné à la valeur du temps utilisable; enfin, 9° que les lois naturelles de l'économie des forces, de la concurrence et de la progression des valeurs agissent à la fois pour susciter le progrès dans les différentes branches de l'industrie humaine et régler dans chacune la production de manière à la mettre en équilibre avec la consommation, au niveau du prix nécessaire, c'est-à-dire du prix qui couvre les frais de la production avec adjonction du profit.
Les mêmes lois gouvernent la distribution des utilités produites ou ce qui est synonyme des valeurs, entre les agents productifs, en attribuant à chacun de ces agents, capitaux personnels, immobiliers, et mobiliers, la rétribution nécessaire: 1° pour le rétablir intégralement; 2° pour lui conférer une part proportionnelle à l'importance et à la durée de sa coopération, dans le profit des entreprises.
En d'autres termes, les lois naturelles qui agissent pour déterminer la production utile de la richesse agissent de même pour en déterminer la distribution utile.
Si l'on veut se rendre clairement compte de la manière dont cette distribution s'opère entre les capitaux personnels, immobiliers et mobiliers, il faut remonter à la source même du capital. Tout capital est le produit d'une épargne faite sur la consommation. Au lieu de consommer immédiatement les valeurs crées par la production, on en épargne une partie soit en vue de pourvoir à la consommation future, soit en vue de les multiplier en les appliquant à la production. Mais quelle que soit la destination que l'on se propose de donner aux valeurs épargnées, on commence par les réaliser sous une forme mobilière, ordinairement sous la forme de monnaie, c'est-à-dire d'un instrument pourvu d'un pouvoir général et permanent d'acquisition de toute sorte de produits et services. Un agriculteur pourra bien, à la vérité, opérer son épargne sous forme de blé, en conservant une partie de sa récolte soit pour l'appliquer à sa consommation à venir, soit pour ensemencer une plus grande étendue de terre et nourrir un plus grand [173] nombre d'ouvriers; mais dans l'état actuel d'avancement de l'industrie, chacun recevant d'habitude en monnaie sa part des valeurs qu'il contribue à produire, c'est aussi en monnaie qu'il réalise son épargne.
Seulement, l'épargne ne demeure que provisoirement sous cette forme, car on ne s'est imposé la privation et la peine nécessaires pour la former qu'en vue de réaliser un profit, en l'appliquant soit à la consommation future soit à la production. Cet état provisoire peut toutefois se prolonger. Aux époques où la sécurité faisait défaut, ou tout emploi du capital était exposé à des risques excessifs, on conservait fréquemment son épargne sous forme de monnaie ou d'autres produits, durables faciles à dérober aux atteintes des voleurs publics ou privés. Grâce à l'accroissement général de la sécurité dans le domaine de la civilisation, ce vieux mode de conservation de l'épargne est tombé en désuétude et tend à disparaître. Dès qu'une parcelle de capital est formée on lui donne un emploi immédiat, quelle que soit la destination finale, à laquelle on se propose de l'affecter. Mais, aussi longtemps que des capitaux demeurent inactifs sous forme de monnaie ou d'autres articles durables et dissimulables, entre les mains de ceux qui les ont produits, on peut affirmer qu'il y a équivalence entre l'avantage que l'on tire de la conservation d'un capital disponible et le profit que procure un capital employé. Si cette équivalence n'existait point, ou la totalité des capitaux serait conservée disponible ou la totalité en serait employée.
La même équivalence apparaît entre les différents emplois auxquels on peut destiner le produit de l'épargne, consommation à venir ou production dans l'une ou l'autre de ses branches mutiples, car si l'un de ces emplois est plus avantageux que les autres, les capitaux ne manquent pas d'y affluer, du moins sous un régime de liberté de l'industrie, jusqu'à ce que la concurrence ait rétabli l'équilibre. Même équivalence encore et pour la même cause, que le capital soit investi dans le personnel de la production ou dans le matériel sous forme d'objets mobiliers ou d'immeubles. Même équivalence enfin dans le mode d'emploi des capitaux, participation rémunérée par un profit ou un dividende, prêt ou location rémunéré par un intérêt, un loyer, un fermage ou un salaire. Seulement, le [174] taux de l'intérêt, du loyer, du fermage ou du salaire, est toujours inférieur au taux du profit ou du dividende, car la rétribution d'un capital emprunté ou loué est garantie par le capital employé en vue d'un profit ou d'un dividende. Toute-fois, cette assurance n'est jamais entière. Elle vaut ce que vaut la garantie offerte par l'entrepreneur capitaliste. Si l'entrepreneur fait de mauvaises affaires, il peut être hors d'état de payer, à l'échéance, l'intérêt, le loyer, le fermage ou le salaire, et, s'il s'agit d'un capital mobilier, de rembourser le capital même.
Mais quelle que soit la forme sous laquelle le capital se trouve investi, personnes ou choses, quels que soient sa destination et le mode de sa participation aux entreprises, la loi naturelle de la distribution des résultats de la production entre les différentes catégories de capitaux personnels, immobiliers et mobiliers, c'est l'équivalence.
Cela étant, examinons quels sont les éléments constitutifs de la rétribution du capital mobilier, profit ou intérêt. Cette rétribution a son taux nécessaire et son taux courant.
§ Ier. Le taux nécessaire. — Les éléments du taux nécessaire sont, dans les entreprises où le capital est immobilisé, la privation et le risque; dans celles où le capital est mobilisable, ils se réduisent au risque. La privation exige une compensation et le risque une prime. La compensation et la prime sont les véhicules indispensables pour amener le capital à la production. Quand elles font défaut ou sont insuffisantes, il y a plus d'advantage à conserver le capital inactif et disponible pour la consommation ou la production éventuelle qu'à l'engager actuellement dans la production, et on le conserve de préférence.
A quel mobile obéit-on, en effet, en s'imposant la privation qu'implique l'épargne? On obéit au mobile de la prévoyance. On a en vue les besoins de l'avenir; on prévoit que ces besoins ne pourront être satisfaits si l'on ne conserve pas à leur disposition une partie de son revenu, et qu'on s'exposera ainsi à des souffrances futures dépassant les jouissances que la consommation actuelle peut procurer. On épargne donc, on crée un capital pour s'assurer contre les risques de l'avenir. [175] Ces risques sont nombreux et quelques-uns viennent inévitablement à échéance. Pendant la durée de ses maladies et de sa vieillesse, par exemple, l'homme devient incapable de produire les utilités nécessaires à sa consommation; il ne peut subsister qu'en consommant celles que lui ou les siens ont épargnées, à moins de vivre aux dépens d'autrui. Un second mobile, mais qui se rattache au premier, c'est d'accroître son revenu par l'emploi d'un supplément de capital, et par conséquent d'augmenter avec ses ressources, ses jouissances futures, ou de mieux se garantir contre les revers et les souffrances.
Or, les risques en vue desquels le capital a été constitué ne peuvent être couverts qu'à la condition que le capital soit disponible au moment où ils viennent à échéance.
Sous l'ancien régime de l'industrie, tout capital engagé d'une manière ou d'une autre dans une entreprise cessait aussitôt d'être disponible soit pour la consommation soit pour d'autres entreprises. Il se trouvait immobilisé et frappé d'indisponibilité. Cet état d'immobilisation et d'indisponibilité n'était pas complet sans doute. On pouvait réaliser avec plus ou moins de facilité, de frais et de dommages un capital engagé en vue d'un profit, et on recouvrait la disponibilité d'un capital prêté à l'échéance du prêt. Mais, en attendant, on était privé de la disposition de ce capital, par conséquent exposé aux risques qu'il était destiné à couvrir et au manquement des bénéfices que sa disponibilité pouvait procurer. De là, la nécessité et la raison d'être d'une compensation, inesurée sur le nombre et la gravité des risques à couvrir, sur la probabilité et l'importance des bénéfices à réaliser. Dans l'état actuel de l'industrie, presque toutes les entreprises agricoles, industrielles ou commerciales, de petite et de moyenne dimension, comportent encore, à des degrés divers, l'immobilisation des capitaux qui y sont engagés, et la compensation n'a pas cessé d'y apparaître comme un élément du taux nécessaire du profit ou de l'intérêt.
Il en est autrement dans les entreprises à capital mobilisable que le progrès a fait surgir, et qui vont se multipliant avec une rapidité croissante depuis l'avènement de la grande industrie. Dans ces entreprises, chemins de fer, canaux, lignes de [176] navigation à vapeur, mines, etc., le capital engagé et le capital emprunté sont divisés en coupures régulières, actions et obligations. Ces actions qui donnent droit à une part du profit éventuel, désignée sous le nom de dividende, ces obligations qui sont garanties par le capital-action et donnent droit à en intérêt fixe, payable à des échéances déterminées, sont essentiellement mobilisablés. Toute fraction de capital, représentée par une action ou une obligation peut être, du jour au lendemain ou même à l'heure où le besoin se fait sentir, portée au marché des valeurs et immédiatement réalisée sous forme de monnaie, c'est-à-dire de cet instrument d'échange, qui est pourvu du pouvoir général et permanent d'acquisition de toute sorte de produits et services. Le capital représenté par l'action ou l'obligation conserve ainsi la même disponibilit que si le capitaliste l'avait gardé dans son coffre-fort sous forme de monnaie. On ne subit. donc aucune privation en l'employant à la production, et, dans ce cas, la compensation disparaît du taux nécessaire de la rétribution du capital mobilier. A la vérité, on court un risque de perte sur la vente de l'action ou de l'obligation, au moment où le besoin de disposer du capital se fait sentir, mais ce risque, qui peut d'ailleurs être atténué au moyen d'un emprunt provisoire sur le gage de l'action ou de l'obligation, se trouve compensé en totalité ou en partie par la chance de plus value.
Le second élément du taux nécessaire de la rétribution du capital mobilier, c'est la prime des risques, et celui-ci se rencontre dans tous les placements. Le taux de la prime se proportionne naturellement au nombre, à la gravité, et à l'imminence des risques. Il y a des risques généraux qui pèsent sur l'ensemble des industries d'un pays et des risques spéciaux à chacune. La prime doit couvrir les uns et les autres, sinon ils finissent par dévorer le capital. Elle doit rétribuer en outre la gestion du capitaliste-assureur, et constitue ainsi une part nécessaire de la rétribution du « capital personnel ».
§ 2. Le taux courant. — Mais le taux nécessaire de la rétribution du capital mobilier, aussi bien que du capital immobilier et personnel n'est qu'un point idéal vers lequel gravite, sous l'impulsion des lois naturelles de la concurrence et de la [177] progression des valeurs, le taux effectif et courant du profit et de l'intérêt. Celui-ci est déterminé par l'état du marché des capitaux mobiliers; il s'élève ou s'abaisse selon les mouvements de l'offre et de la demande.
Le montant de l'offre est déterminé avant tout par l'abondance de la production du capital. Celle-ci, à son tour dépend, d'une part, de la masse du produit net recueilli soit par le producteur soit par le consommateur, d'une autre part, de l'activité de l'épargne. Le produit net est la matière première sur laquelle agit l'épargneur pour former le capital. Or le produit net se multiplie en raison des progrès de l'industrie. A l'origine, l'homme, armé d'instruments et de procédés imparfaits, et n'ayant à sa disposition qu'un petit nombre de matériaux de production, ne recueille qu'un faible produit net en sus de la somme nécessaire à la reconstitution de ses agents productifs; mais, à mesure qu'il perfectionne ses instruments et ses procédés, qu'il découvre et exploite des matériaux plus nombreux et abondants, son produit net s'augmente: en développant dans des proportions extraordinaires la puissance productive de l'homme, la grande industrie a accru dans les mêmes proportions et continue à accroître d'une manière progressive, cette matière première de l'épargne.
D'un autre côté, l'abolition de la servitude et l'obligation que la liberté impose à l'individu de pourvoir lui-même à sa destinée ont stimulé l'épargne. La production du capital s'est développée en conséquence. Elle est aujourd'hui particulièrement féconde dans les principaux foyers de la grande industrie, l'Europe occidentale et centrale et les états-Unis, où le produit net abonde et où le sentiment de la responsabilité et l'esprit de prévoyance sont éveillés dans la masse de la population. La statistique ne fournit toutefois que des données incomplètes sur la quantité de capital annuellement produite. Une portion considérable de cette production échappe aux investigations et ne peut être évaluée. que d'une manière très approximative. Tels sont les capitaux que l'on conserve inactifs et ceux qui sont engagés dans l'industrie même des épargneurs ou prêtés sous forme de marchandises livrées à crédit, tels sont encore et surtout ceux que l'on applique au renouvellement de la population et qui sont transformés, [178] d'une manière presque immédiate, en capitaux personnels. On ne peut guère avoir un compte exact que des capitaux mobiliers qui sont déposés dans les institutions de crédit et de prévoyance et portés au marché.
A l'époque encore récente où les communications étaient difficiles, le marché des capitaux comme celui des produits était partagé en compartiments presque entièrement isolés. Les capitaux ne s'offraient que par exception en dehors de leur lieu d'origine, et il en résultait une extrême diversité dans le taux de leur rétribution. Il y avait autant de taux différents que de marchés. Cet état de choses primitif s'est successivement modifié sous l'influence de l'élargissement de l'aire de la sécurité et du développement des moyens de communication. Les marchés ont tendu à s'unifier. Sans doute, il existe encore entre eux des différences considérables de niveau. Dans les pays neufs, où les ressources naturelles sont abondantes, mais où la production naissante ne fournit encore qu'une provision insuffisante de matériaux d'épargne, où d'ailleurs l'esprit d'entreprise est plus développé que l'esprit d'économie, les capitaux sont rares et chers. Ils sont abondants et à bon marché, au contraire, dans les vieux pays où l'abondance de la production multiplie les matériaux de l'épargne et où l'esprit d'économie l'emporte sur l'esprit d'entreprise. Mais, à mesure que les communications deviennent plus faciles entre les vieux pays et les nouveaux, les capitaux émigrent les uns vers les autres, et le niveau tend à s'établir, sauf les différences provenant des frais d'émigration et de l'inégalité des risques. Cette émigration et cette internationalisation des capitaux sont efficacement aidées par la multiplication des intermédiaires. A l'origine, les intermédiaires étaient de simples banquiers ou usuriers, combinant le plus souvent le commerce des capitaux avec quelque autre industrie et opérant exclusivement dans l'enceinte étroite d'un marché isolé. A mesure que les débouchés des capitaux se sont élargis, le commerce des banquiers a pris une extension correspondante, et, en s'agrandissant, il s'est diversifié des besoins de l'offre et de la demande: il s'est fondé des banques de dépôt, de circulation, de crédit foncier, mobilier, etc. Ces intermédiaires [179] qui reçoivent d'une main les produits de l'épargne pour les remettre de l'autre à ceux qui en ont besoin se font naturellement payer leur service, et le prix qu'ils en exigent s'ajoute au taux nécessaire, partant au taux courant de la rétribution des capitaux; mais ce service épargne à ceux qui le demandent et qui sont d'ailleurs libres de ne pas le demander, des frais et dommages supérieurs au prix dont ils le paient. S'il n'existait point d'intermédiaires dans le commerce des capitaux, les épargneurs seraient fréquemment obligés de laisser pendant longtemps leur capital inactif avant de le faire fructifier, ils n'en pourraient trouver le placement que dans le cercle limité de leurs relations et seraient exposés, faute de notions spéciales sur la sécurité des entreprises, à l'engager ou à le prêter à l'aventure.
Mais, quelle que soit l'étendue du débouché des capitaux mobiliers, le taux courant de leur rétribution gravite incessamment vers le taux nécessaire. S'il demeurait au-dessous de ce taux, ou les capitaux ne s'offriraient point à la production ou ils seraient dévorés par le risque; dans les deux cas, l'offre diminuerait relativement à la demande, et le taux courant de la rétribution ne tarderait pas à remonter au niveau du taux nécessaire. Si, au contraire, il s'élevait au-dessus, l'apport des capitaux mobiliers à la production serait encouragé, l'épargne annuelle y serait engagée sous forme de capitaux mobiliers plutôt que de capitaux immobiliers et personnels, jusqu'à ce que le niveau se fût rétabli entre leur rétribution. Or, le niveau général et commun ne peut excéder, que d'une manière accidentelle et temporaire, le montant des frais qui doivent être couverts pour conserver les agents productifs, matériel et personnel, les renouveler et les maintenir au service de la production, ni plus ni moins. Si ces frais n'étaient point couverts, la production diminuerait par le fait de la disparition d'une partie des agents productifs; s'ils l'étaient avec surabondance, la concurrence des capitaux offerts, sous toutes les formes, ne tarderait pas davantage à ramener le taux courant de la rétribution au niveau du taux nécessaire.
En résumé, les lois naturelles n'agissent pas seulement pour susciter le progrès et maintenir l'ordre dans la production; elles agissent avec la même puissance pour établir [180] l'équivalence dans la rétribution des agents productifs, et ramener cette rétribution au taux nécessaire pour les engager et les conserver au service de la production.
Comment donc se fait-il que l'on ait pu contester et que l'on conteste encore la légitimité de quelques-unes de ces rétributions et, en particulier, de celle qui rémunère le prêt du capital mobilier, quoique l'intérêt soit l'équivalent du profit, du loyer et du salaire?
L'intérêt est la rétribution d'un capital mobilier prête sous forme de monnaie. Mais, après avoir été empruntées sous cette forme, les valeurs qui constituent le capital sont échangées contre d'autres valeurs investies soit dans des agents productifs, soit dans des articles de consommation. On n'emprunte donc de la monnaie qu'à titre d'équivalent, comme un instrument pourvu du pouvoir de procurer une quantité égale en valeur, de produits ou de services. On pourrait tout aussi bien emprunter directement ces produits ou ces services sans l'intermédiaire de la monnaie, si l'emploi de cet intermédiaire ne présentait point un avantage spécial, d'une importance considérable: eclui de mettre à la disposition de l'emprunteur les produits et les services dans les quantités dont il a besoin et au moment où il en a besoin, tandis qu'il serait obligé autrement d'emprunter chaque sorte de produits et de services soit en totalité et immédiatement, soit au fur et à mesure de leur emploi; ce qui serait difficile, parfois même impossible et, en tous cas, plus coûteux. Il faut remarquer toutefois qu'il a toujours le choix d'emprunter des capitaux sous forme de produits et de services, ou de leur équivalent: la monnaie. S'il choisit la monnaie de préférence c'est évidemment qu'il y trouve un avantage. Si les prêteurs prétendaient lui faire payer cet avantage plus qu'il ne vaut, c'est-à-dire à un prix supérieur à l'économie de frais que l'emploi de la monnaie lui permet de réaliser, il emprunterait directement les produits et les services dont il a besoin. Cependant, sans élever le taux du prêt d'un capital sous forme de monnaie jusqu'au montant de l'avantage que procure un emprunt sous cette forme, les prêteurs ne peuvent-ils pas porter ce taux au-dessus de la somme nécessaire pour couvrir la privation et le risque, impliqués dans le prêt, avec la rémunération de leur industrie? [181] Sans doute, mais dans ce cas, l'appât d'un profit qui dépasse celui des autres emplois des capitaux ne manque pas d'attirer la concurrence dans l'industrie du prêt en monnaie, jusqu'à ce que le taux courant de l'intérêt soit descendu au niveau du taux nécessaire.
Seulement, il faut que la concurrence puisse se développer et agir librement. Si le marché du prêt est étroitement limité par des obstacles naturels ou artificiels, si, dans ce marché, les prêteurs sont peu nombreux et s'ils ont affaire à des emprunteurs faméliques (notons d'ailleurs qu'il est rare que le besoin d'emprunter ne soit pas plus intense que le besoin de prêter), le taux courant de l'intérêt pourra s'élever et demeurer longtemps au-dessus du taux nécessaire. Telle était la situation des prêteurs avant que l'extension des moyens de communications et la multiplication des intermédiaires eussent agrandi le marché monétaire: ils jouissaient d'une sorte de monopole naturel et peut-être alors les coutumes et les lois limitatives du taux de l'intérêt avaient-elles leur raison d'être en suppléant, quoique avec une efficacité insuffisante, à l'opération régulatrice de la concurrence. On conçoit aussi que le défaut de concurrence en permettant aux prêteurs d'abuser de l'inégale intensité des besoins de prêter et d'emprunter, sans parler de l'imprévoyance des emprunteurs, ait attiré sur eux la flétrissure de l'opinion et les anathèmes de la religion. Quand on remonte à l'origine de la plupart des préjugés populaires, on reconnaît qu'ils ont eu leur raison d'être dans un état de choses qui a changé, sans que les idées et les sentiments de la multitude, toujours en retard sur les faits, aient accompli la même évolution: tel a été le préjugé contre le prêt à intérêt.
Cependant, à mesure que les marchés se sont agrandis et que le développement de l'industrie et du commerce a exigé une quantité croissante de capitaux mobiliers, le préjugé s'est affaibli. Si les socialistes ont entrepris de le raviver, c'est parce qu'ils ne se rendent compte ni du rôle essentiel que joue le capital mobilier dans la production, ni de l'importance économique de la bonne gestion du capital, ni des qualités intellectuelles et morales dont cette gestion exige la mise en œuvre.
[182]
C'est le capital mobilier qui constitue dans toutes les branches de l'industrie humaine le capital d'entreprise et qui supporte à ce titre la plus forte part des risques de la production. S'il est engagé en vue d'un profit ou d'un dividende, c'est sur lui que retombe d'abord toute la responsabilité effective de l'entreprise: si elle laisse une perte au lieu de donner un profit, cette perte est supportée par le capital de l'entrepreneur, des coparticipants ou des actionnaires; en cas de faillite, ce capital peut être entièrement détruit. Il en est de même pour le capital emprunté, après que le capital engagé qui lui sert de garantie a disparu, tandis que les propriétaires des capitaux immobiliers et personnels ne sont exposés à perdre qu'une portion plus ou moins considérable du loyer ou du salaire. Dans le capital mobilier engagé ou emprunté, le risque atteint le principal; dans les deux autres catégories de capitaux, il n'atteint communément que la rétribution.
Or, il ne faut pas oublier que ce capital sur lequel pèse la plus grande partie des risques de la production, en est un des trois facteurs indispensables, et qu'aucune entreprise ne peut se passer de sa coopération. Lorsqu'une portion quelconque du capital mobilier, investi dans les entreprises, vient à être détruite par l'échéance des risques, une portion correspondante du capital immobilier et du capital personnel est aussitôt et demeure privée d'emploi jusqu'à ce que le déficit soit comblé.
On voit par là quelle est l'importance de la bonne gestion des capitaux mobiliers. A quoi on peut ajouter que cette gestion est devenue de nos jours plus difficile que jamais. Des entreprises de toute sorte, politiques, industrielles, commerciales, se font concurrence sur toute la surface du globe pour demander des capitaux. Il faut donc, pour discerner les bonnes d'avec les mauvaises, tout un ensemble de qualités intellectuelles et morales, et de connaissances spéciales. Si elles font défaut, si les capitaux se: trouvent entre les mains d'une classe d'hommes ignorants, crédules et avides, qui demandent avant tout un profit ou un intérêt élevé, sans paraître se douter que les risques sont, dans tout placement, en proportion de l'élévation du profit ou de l'intérêt, le capital sera exposé à subir un déchet considérable.
[183]
Le capitaliste remplit donc une fonction essentielle: la première consiste à former le capital, la seconde à le conserver. Si la formation d'un capital n'implique la nécessité d'aucune rétribution, car l'épargneur est rétribué par les peines futures que son capital lui permet d'éviter ou par les jouissances qu'il lui permet de se procurer, il en est autrement de la conservation du capital, du moment où l'épargneur s'en dessaisit pour le mettre au service de la production. La conservation du capital peut être considérée comme une branche, — et même comme la branche principale, — de l'industrie des assurances. Tout capitaliste qui engage, d'une manière ou d'une autre, son capital dans une entreprise de production, s'expose à des risques. Le profit ou l'intérêt est la prime qui sert à couvrir ces risques, et cette prime comprend la rétribution nécessaire de l'industrie de l'assureur. Qui voudrait, en effet, s'exposer à perdre son capital sans aucun espoir de bénéfice? A son tour, la rétribution de l'assureur a son taux nécessaire déterminé par les facultés et les connaissances spéciales qu'exige son industrie. Peut-on dire que ce taux nécessaire soit habituellement dépassé, et que l'industrie des capitalistes qui alimente la production des capitaux mobiliers soit mieux rétribuée que toute autre? Sans doute, les capitalistes réalisent de grandes et rapides fortunes lorsqu'ils ont assez de jugement et d'habileté pour choisir les placements qui conservent et accroissent les capitaux au lieu de les détruire, mais, en ce cas, ne rendent-ils pas à la production le plus important des services? On peut constaten, au surplus, que si quelques-uns s'enrichissent, d'autres se ruinent, tant les risques qui menacent cette sorte de capitaux sont nombreux, et tant les qualités nécessaires pour l'en préserver sont rares!
On voit, en résumé, combien il est important que les capitaux (et cette observation s'applique surtout aux capitaux mobiliers, en raison de la supériorité des risques de leur emploi) soient placés entre les mains les plus capables de les gérer de manière à en assurer la conservation. Or, les difficultés de la gestion s'augmentent avec l'importance du capital, et elles exigent alors, chez le capitaliste, une capacité plus grande, et par là même moins répandue. Cette capacité n'étant point héréditaire, il est rare que les grandes fortunes édifiées par [184] l'emploi judicieux des capitaux se conservent pendant plusieurs générations. Les capacités moyennes sont naturellement plus nombreuses; d'où il résulte que la répartition des capitaux qui en assure le mieux la conservation, et qui est par conséquent la plus favorable à l'accroissement de la production et de la richesse, est celle qui en attribue la masse à cette classe intermédiaire et moyenne, que l'on a désignée sous le nom de bourgeoisie. Ce n'est pas à dire certes qu'il ne soit point à souhaiter que la multitude acquière une part de plus en plus large dans la possession des capitaux. Mais au point de vue de leur conservation (à laquelle la multitude qui vit de son travail quotidien est plus intéressée que la classe même des capitalistes, puisque toute diminution du capital mobilier ou immobilier engendre nécessairement la hausse du profit, de l'intérêt et du loyer, et la baisse du salaire) il est à souhaiter que cette acquisition soit graduelle; qu'elle se fasse dans la mesure du développement des facultés intellectuelles et morales et des connaissances qu'exige la bonne gestion du capital, sinon elle ne pourrait être que temporaire et elle ne manquerait pas d'être suivie d'une période d'inévitable appauvrissement. Supposons, par exemple, qu'une révolution socialiste dépossède la grande et la moyenne propriété pour la distribuer en portions égales aux masses ouvrières au sein desquelles n'existe qu'à un faible degré la capacité de gestion des capitaux mobiliers et immobiliers (c'est à peine si elles sont capables aujourd'hui de gérer et de conserver intact leur capital personnel), le résultat immédiat serait une énorme dilapidation de ces agents indispensables de la production La proportion nécessaire entre les capitaux mobiliers et immobiliers et les capitaux personnels se trouverait rompue à l'avantage des premiers; le taux du profit, de l'intérêt et du loyer s'élèverait tandis que s'abaisserait la rétribution du travail, et l'inégalité que la révolution aurait prétendu détruire reparaîtrait plus saillante que jamais.
[185]
CHAPITRE VIII
La distribution. — La part du capital immobilier.↩
I. La rétribution du capital immobilier sous forme d'immeubles bâtis. Que la location n'implique pas la vente. Que l'amortissement s'ajoute au loyer et se proportionne à la durce de la propriété immobilière. — II. La rétribution du capital immobilier sous forme d'agents naturels appropriés. Causes qui abaissent le taux courant de cette rétribution au-dessous du taux nécessaire et qui l'élèvent au-dessus. Lés éléments de la rétribution du capital-terre. La rétribution de l'association ou de l'état producteur d'un domaine territorial. La colonisation d'état. Le système colonial, Pourquoi la production des domaines territoriaux doit être abandonnée a l'industrie privée. La rétribution des intermédiaires de la propriété foncière. Le commerce des terres. Utilité de la speculation. — III. La naissance et l'accroissement du revenu du propriétaire foncier. La théorie de la rente. Que la part de la terre est incessamment ramenée à son taux nécessaire. — IV. Résumé.
Les capitaux immobiliers peuvent être partagés en deux grandes catégories: 1° ceux qui résident dans le sol et le sous-sol et sont communément désignés sous le nom d'agents naturels appropriés; 2° ceux qui sont investis dans les bâtiments d'habitation ou autres, dans les constructions, amendements, etc., immobilisés sur ou dans le sol.
La rétribution de ces deux catégories de capitaux immobiliers gravite comme celle des capitaux mobiliers vers le point marqué par leurs frais de production et leur profit nécessaire.
C'est au moyen d'entreprises que les agents naturels sont appropriés et transformés en domaines territoriaux publics ou privés, et que les maisons, usines et autres immeubles sont [186] construits et mis à la disposition des consommateurs. Ces entreprises exigent la mise en œuvre, dans des proportions déterminées par leur nature, de capitaux personnels, mobiliers et immobiliers que le produit — terres, maisons, usines, etc., doit rétablir avec adjonction d'un profit équivalent à celui des autres emplois du capital.
Comment les choses se passent-elles : 1° pour les maisons, usines et autres immeubles; 2° pour la terre?
I. La Rétribution Du Capital Immobilier Sous Forme D'Immeubles Batis. — Si nous observons l'industrie de la construction des maisons d'habitation, et il en est de même pour les industries qui produisent les autres immeubles, nous constaterons que les entreprises entre lesquelles elles se partagent peuvent couvrir leurs frais et réaliser un profit par trois procédés différents: 1° par l'usage de l'immeuble; 2° par la vente; 3° par la location. Or il est clair que ces trois procédés doivent donner des résultats équivalents. Si l'un d'entre eux était plus profitable que les autres, on y recourrait de préférence jusqu'à ce que l'équilibre se fut rétabli. Ajoutons que l'usage et la location peuvent être rangés sous le même chef, car lorsqu'on construit ou achète un immeuble en vue d'en user pour l'habitation ou l'industrie, c'est comme si on se le louait à soi-même.
La vente réalise d'une manière immédiate tantôt avec profit, tantôt avec perte, selon l'état du marché, le produit-immeuble, tandis que la location le réalise seulement d'une manière successive, pendant la durée exploitable de l'immeuble. Des socialistes ont prétendu que la location implique la vente, autrement dit que toute location devrait être une vente partielle. C'est une erreur que démontre l'analyse des éléments constitutifs du loyer. Il faut, pour produire un immeuble, dépenser un capital aussi bien que pour produire un sac de blé ou une pièce de cotonnade. Ce capital, le produit doit le reconstituer avec un profit, sinon la production ne sera point entreprise. La location le reconstitue au moyen d'un amortissement compris dans le loyer. Si le loyer ne comprenait point d'amortissement, ou ne comprenait qu'un amortissement insuffisant, les capitaux ne se dirigeraient point [187] vers la production des immeubles, ou s'ils s'y dirigeaient, ils finiraient par être détruits. Alors l'industrie dite du bâtiment subirait un ralentissement jusqu'à ce que la diminution de sa production provoquât un relèvement du taux du loyer de manière à comprendre l'amortissement nécessaire. Le montant annuel de cet amortissement est naturellement proportionné à la durée de la productivité de l'immeuble, aussi longtemps du moins qu'il demeure propre à l'usage. Mais elle peut être artificiellement réduite et elle l'est même fréquemment, pour certaines catégories d'immeubles, dont les propriétaires sont dépossédés, au bout d'une période plus ou moins longue de jouissance, au profit prétendu de la communauté. Il en est ainsi généralement pour les chemins de fer et les autres moyens de communication, dont la propriété n'est point garantie à perpétuité, ou, pour nous servir de termes plus exacts, dans toute l'étendue de leur durée naturelle ou exploitable. Mais que résulte-t-il de cette pratique communiste? Simplement que le montant annuel de l'amortissement, et par conséquent le prix nécessaire du service des transports, se trouve artificiellement surélevé dans la proportion du raccourcissement de la durée de la jouissance, au profit éventuel et hypothétique des consommateurs futurs, au détriment positif et certain des consommateurs actuels.
Tel serait aussi le cas pour le loyer des habitations si, comme le prétendent les socialistes, toute location impliquait un achat partiel de l'immeuble. Dans ce cas, la durée de la jouissance se trouvant raccourcie, le montant de l'amortissement, partant le taux du loyer, ne manquerait pas de s'élever en proportion. A la vérité, les locataires des immeubles en deviendraient propriétaires, qu'ils le voulussent ou non. Mais il reste à savoir s'ils ne préféreraient pas payer un loyer moindre et donner un autre emploi à l'épargne réalisée de ce chef. Bref, comme toutes les conceptions prétendues progressives du socialisme. celle du loyer-achat a sa source dans la méconnaissance des lois naturelles qui gouvernent la production et la distribution de la richesse.
Avec l'amortissement nécessaire pour reconstituer le capital employé dans l'industrie de la production des immeubles, le loyer doit contenir le profit non moins nécessaire de ce capital, [188] c'est-à-dire le profit qui en détermine l'apport dans cette industrie comme dans toute autre. Les immeubles ayant généralement une longue durée, l'amortissement n'entre que pour une faible part dans le loyer. D'un autre côté, l'industrie de la location des immeubles ne comportant que des risques inférieurs à ceux des autres branches d'industrie, le taux nécessaire du loyer demeure généralement au-dessous du taux commun des profits.
L'amortissement et le profit des capitaux employés à la production des immeubles sont les éléments constitutifs du prix nécessaire vers lequel gravite incessamment, sous l'impulsion des lois de la concurrence et de la progression des valeurs, le prix courant des loyers. Mais des circonstances de toute sorte, en créant des monopoles naturels ou artificiels, accidentels ou durables, agissent pour faire descendre ce prix au-dessous du prix nécessaire, ou le faire monter au-dessus, sans qu'il puisse cependant s'en écarter d'une manière permanente. En effet, si le prix courant des loyers tombe au-dessous du prix nécessaire, la production des immeubles se trouve découragée, et le loyer hausse; s'il s'élève au-dessus du taux nécessaire, la production s'accroît et le loyer baisse jusqu'à ce que les deux prix se confondent.
II. La Rétribution Du Capital Immobilier Sous Forme D'Agents Naturels Appropriés. — La rétribution de cette portion du capital immobilier, qui est communément désignée sous le nom de terre ou d'agents naturels appropriés, est régie par les mêmes lois, avec cette différence que le prix de vente, le taux du loyer ou du fermage de la terre peuvent demeurer plus longtemps que ceux des autres immeubles au-dessous ou au-dessus du prix nécessaire.
Ils peuvent demeurer au-dessous, et c'est ce qui arrive d'habitude dans la première période de la création d'un domaine territorial: 1° parce que la terre a une durée d'exploitation sinon perpétuelle, du moins sans limites assignables; 2° parce que les associations ou les états qui créent ce domaine par la voie de la découverte, de la conquête sur les espèces inférieures ou plus faibles et de l'appropriation à l'habitation et à l'industrie, sont constitués pour une durée illimitée. Cela [189] étant, les producteurs d'un domaine territorial peuvent se contenter, dans la première période de l'exploitation, d'une rétribution qui ne couvre pas leur frais, s'ils estiment que ce déficit sera compensé et au delà par l'excédent de la période suivante.
Le prix de vente, le taux du loyer et du fermage peuvent s'élever au-dessus du prix nécessaire, lorsque, sous l'influence des difficultés extraordinaires que présente l'appropriation de nouvelles terres ou de la demande excessive des anciennes, cet excédent vient à dépasser le déficit originaire, grossi de la rétribution du capital d'appropriation.
De là, les phénomènes de la quasi-nullité du prix de vente ou de location de la terre dans les pays neufs et de l'élévation extraordinaire de ce prix dans les vieux pays, pendant des périodes parfois très longues. Seulement, lorsque les obstacles naturels ou artificiels qui empêchent l'accroissement de la population et de la richesse dans les uns et qui les accumulent à l'excès dans les autres viennent à s'abaisser, comme il arrive aujourd'hui entre l'ancien monde et le nouveau, on voit les capitaux personnels et mobiliers des vieux pays où leur part est diminuée au profit du capital-terre affluer vers les pays neufs où il n'entre pas encore ou n'entre que pour une part minime en partage avec eux. En sorte que la gravitation du prix de vente, du taux du loyer ou du fermage autour des frais de production et du profit nécessaire, règle en définitive la rétribution du capital-terre comme celle des autres catégories de capitaux.
Si l'on veut se rendre clairement compte des éléments de la rétribution du capital-terre, il faut distinguer les deux catégories d'industries qui contribuent à le former et à le mettre au service de la production, savoir: 1° l'industrie des associations ou des états qui créent un domaine territorial et trouvent leur rétribution dans l'exploitation politique de ce domaine; 2° l'industrie ou le commerce des spéculateurs et des propriétaires, exploitants ou non, auxquels l'association ou l'état concède, vend ou loue en détail, le sol de son domaine territorial.
§ Ier. La rétribution de l'association ou de l'état producteur [190] d'un domaine territorial. — Au point de vue de la rétribution, on peut partager en deux périodes l'exploitation des entreprises qui ont pour objet la production de la terre par la découverte, la conquête et l'appropriation d'un domaine territorial. Dans la première, l'entrepreneur, association particulière ou état politique, débourse les frais de la découverte s'il s'agit d'une contrée inconnue, de la conquête et de l'occupation, sans rentrer dans ses frais, mais avec l'espoir plus ou moins fondé de les couvrir avec adjonction d'un profit amplement rémunérateur dans la seconde. Cependant, dans le cas de la conquête d'une contrée déjà peuplée et riche, il se peut que le pillage de la richesse personnelle et mobilière qui s'y trouve accumulée couvre la dépense, en partie, parfois même en totalité ou au delà. Dans ce cas, les conquérants se contentent d'habitude des fruits du pillage et ils s'en servent pour continuer l'exercice de leur industrie, aux dépens d'autres contrées peuplées et riches. La conquête n'est alors que temporaire et se résout en un simple brigandage. Telles étaient les entreprises des peuples demeurés à l'état nomade, chasseurs ou pasteurs, sur les domaines des nations fixées au sol par la pratique de l'agriculture. Mais si le pillage de la richesse mobilière ne suffit pas pour couvrir les frais de la conquête et si les conquérants sont parvenus à un degré de culture assez avancé pour exploiter le domaine conquis, ils demandent de préférence à cette exploitation la rétribution des capitaux engagés dans leur entreprise. La société conquérante se superpose à la population autochtone ou auparavant immigrée; elle s'approprie non seulement le capital mobilier, mais encore le sol et la population du territoire qu'elle a conquis et elle les distribue entre ses membres, ordinairement en proportion des services qu'ils ont rendus à la conquête et à la charge par eux de contribuer à la défense du domaine collectif et au besoin de l'étendre. Alors, si le pays conquis possède un sol fertile avec une population nombreuse et industrieuse, les profits de l'entreprise peuvent être considérables et excéder la rétribution nécessaire des capitaux mis en œuvre. Tel a été le cas, par exemple, lorsque l'Angleterre a été conquise par Guillaume de Normandie et ses compagnons d'aventure. Cette conquête qui a valu à ceux qui l'ont entreprise à la fois la propriété [191] politique d'une contrée populeuse et riche, et la propriété foncière des domaines confisqués à l'aristocratie saxonne, a été pour eux une source immédiate et abondante de profits. En revanche, il est douteux que les états européens qui ont entrepris la découverte, la conquête et l'exploitation du nouveau monde soient rentrés dans leurs frais. Si l'on faisait le compte de ce que ces entreprises ont coûté en frais de tous genres, on trouverait que la plupart ont laissé un déficit et que les bénéfices réalisés dans quelques-unes ont été loin de couvrir les pertes occasionnées par l'ensemble. L'entreprise de la découverte, de la conquête et de l'occupation du nouveau monde ne serait devenue une bonne affaire pour les états européens qu'à la condition qu'ils en conservassent la propriété jusqu'à ce que leur capital d'établissement eût été amorti, et il n'aurait pu l'être qu'à cette autre condition que les revenus annuels des colonies en dépassassent les frais de conservation et de gouvernement. Or, comme ces revenus demeuraient généralement inférieurs aux dépenses, on s'explique que l'émancipation des colonies, au lieu d'être dommageable aux métropoles, leur ait été plutôt profitable. Elle l'a été, d'un autre côté, aux colonies qui ont acquis, en échange des sommes relativement modiques que l'émancipation leur a coûtées, des domaines territoriaux, dont les frais d'établissement avaient été supportés par les métropoles. Elles ont fait, comme nous l'avons remarqué déjà, une opération analogue à celle des Compagnies qui acquièrent à vil prix des mines dont les travaux préparatoires et le coûteux aménagement ont ruiné les premiers entrepreneurs.
On peut se demander si les entreprises actuelles de production des domaines territoriaux seront plus avantageuses pour les états producteurs que ne l'ont été les anciennes; si, par exemple, après avoir dépensé 3 milliards 1/2 [16] , grossis chaque année par les intérêts accumulés de ce capital et le déficit de ses recettes coloniales, pour conquérir et exploiter le domaine territorial de l'Algérie, la France peut se flatter de l'espoir de rentrer dans cette grosse avance de capital et de réaliser un [192] profit équivalent à celui que ce même capital aurait obtenu si les contribuables qui ont été obligés de le fournir, l'avaient conservé et affecté, suivant leur convenance, à d'autres emplois. On ne peut s'empêcher de craindre, eu égard aux errements dispendieux de la politique coloniale, que l'affaire ne se solde par une lourde perte. Il est possible, toutefois, si ces errements se modifient économiquement, chose à la vérité peu vraisemblable, et si la population et la richesse se développent sans trop de retard en Algérie, enfin si la France conserve la possession de ce coûteux domaine, à l'époque où le budget annuel des recettes algériennes couvrira le budget des dépenses, y compris l'amortissement du capital d'établissement, il est possible, disons-nous, que cette entreprise devienne rémunératrice; mais dans l'état actuel des choses, les risques de perte ne dépassent-ils pas visiblement les chances de bénéfice?
Cette analyse nous montre que l'entreprise de la production d'un domaine territorial comporte deux sortes de frais: 1° frais de premier établissement (découverte, conquête, occupation); 2° frais annuels de production des services de gouvernement (sécurité intérieure et extérieure, moyens de communication, etc.) nécessaires pour rendre le domaine habitable et exploitable, et y attirer les « consommateurs de terre ». Comment procèdent les associations ou les états producteurs de domaines coloniaux pour obtenir un revenu qui couvre ces deux sortes de frais et leur procure les profits afférents anx capitaux d'entreprise? Ils ne peuvent demander ce revenu à la vente ou à la location du sol, car le prix de vente ou de location ne serait rémunérateur qu'à un taux infiniment trop élevé pour attirer les consommateurs. Que font-ils? Ils morcèlent leur domaine de manière à en adapter les parcelles aux besoins et aux convenances de la consommation, et ils mettent ces parcelles en vente ou en location à vil prix, ou bien encore ils les concèdent gratuitement, et même en accordant aux concessionnaires des allocations, dont le montant s'ajoute à leurs frais annuels. Grâce à cet appât du bon marché, de la gratuité et même de la plus que gratuité d'un des agents indispensables de la production, les « consommateurs de terre, » affluent, le sol est mis en prompte exploitation, la population [193] se multiplie, la richesse se développe. Alors l'état producteur et exploitant du domaine territorial tire un revenu croissant des impôts qu'il établit sur sa clientèle. A mesure que la population et la richesse s'augmentent, ces impôts rendent naturellement davantage. En supposant que le domaine soit aisément accessible et abondant en ressources exploitables, que ses frais de premier établissement et ses frais annuels de gouvernement ne soient point exagérés, la Société ou l'état producteur peut couvrir ainsi ces deux sortes de frais et réaliser un profit. Si l'état appartient à une nation, c'est-à-dire aux consommateurs de services politiques et administratifs de la métropole, il peut leur attribuer ce profit en réduisant les impôts qui rétribuent ses services, et, dans ce cas, la fondation d'une colonie devient pour la nation métropolitaine une source directe de bénéfices. Si la colonie s'est rendue indépendante, son gouvernement peut attribuer ces bénéfices à la population en usant du même procédé. Les impôts peuvent être, dans ce cas, successivement réduits jusqu'au minimum indispensable pour amortir les frais d'établissement et couvrir les frais annuels de gouvernement réduits, à leur tour, au strict nécessaire. Mais est-il besoin d'ajouter que cet idéal n'a été encore nulle part atteint? Tel est le vice de la constitution des états politiques qu'ils peuvent augmenter et qu'ils augmentent incessamment leurs dépenses dans une progression plus rapide que leurs recettes ne s'accroissent. Au lieu d'amortir leurs frais d'établissement et de couvrir leurs frais annuels, ils s'endettent, en sorte que la plupart des entreprises de production et de gouvernement des domaines territoriaux actuellement existants aboutiraient à une faillite inévitable, si les nations nominalement propriétaires de ces domaines n'étaient point, en vertu du droit public moderne, rendues responsables des déficits et des dettes de leur état politique.
Cependant, si élevés que soient les frais d'établissement et de gouvernement d'un domaine territorial et en admettant que ces frais ne soient pas couverts, que l'entreprise se solde par une perte pour les producteurs au lieu de se solder par un profit, on peut se demander si elle n'est pas quand même profitable. L'intérêt des producteurs n'est pas, en effet, seul [194] à considérer dans cette sorte d'entreprises, l'intérêt des consommateurs doit aussi entrer en compte. Quand un état entreprend la fondation d'une colonie et crée ainsi un supplément de capital immobilier, il ouvre un nouveau débouché aux capitaux personnels et mobiliers. Or, si ceux-ci surabondent, dans la métropole en comparaison du capital immobilier, la fondation d'une colonie permet de créer dans ce nouveau domaine territorial des entreprises qui ne peuvent plus naître dans l'ancien. Ces entreprises procurent à la population de l'état colonisateur des profits de plusieurs sortes: 1° profits réalisés par les colons émigrés de la métropole, du chef de leurs capitaux personnels et mobiliers, dans les entreprises agricoles, industrielles, commerciales et autres de la colonie; 2° profits réalisés dans la métropole même par les propriétaires des capitaux personnels et mobiliers dont la rétribution se trouvait déprimée par la pression d'un excédent sans emploi de ces agents productifs; 3° économie des frais d'entretien des capitaux personnels non employés; 4° profits des agriculteurs, industriels, commerçants et autres qui trouvent dans la colonie un supplément de débouchés; enfin, 5° profits des consommateurs si, — chose à la vérité assez rare — la colonie leur fournit des produits qu'ils ne pouvaient se procurer ailleurs ou qu'ils devaient payer à un prix plus élevé.
Il se peut que ces divers profits compensent et au delà non seulement la diminution de revenus que la concurrence des terres nouvelles inflige à la classe des propriétaires de l'ancien domaine territorial, mais encore la perte que subit la généralité des contribuables, du chef des frais de premier établissement et de gouvernement des colonies, lorsque ces frais ne sont pas couverts. En revanche, si ces frais sont excessifs et si la colonie ne procure qu'un étroit débouché à la population métropolitaine, il se peut aussi, et c'est l'éventualité malheureusement la plus probable, eu égard à l'incapacité économique des états politiques, que l'opération se solde par une perte finale. En tous cas, c'est le vice radical de la colonisation d'état, de rendre obligatoire la participation des contribuables aux entreprises coloniales, au lieu d'abandonner cette industrie comme les autres à l'initiative libre des [195] particuliers. En vain, on objecterait que les particuliers n'ont pas les ressources et la puissance nécessaires pour créer de nouveaux domaines territoriaux. Lorsque le besoin d'un supplément de capital immobilier se fait sentir, les entreprises de colonisation deviennent profitables, et l'expérience atteste qu'elles ne manquent pas de se créer, dans les proportions et avec les ressources nécessaires. Que ces entreprises réussissent ou qu'elles échouent, les contribuables n'ont point à en supporter les frais et risques, et ils en profitent quand même à titre de consommateurs.
Remarquons encore que le système de la colonisation d'état, en obligeant les contribuables à participer, qu'ils le veuillent ou non, aux entreprises de production de nouveaux domaines territoriaux, a engendré le système d'exploitation exclusive des colonies par la métropole, connu sous le nom de « système colonial ». Ce système semble, en effet, la conséquence nécessaire de la colonisation d'état. Si l'on oblige les contribuables d'une nation à supporter les frais d'établissement et de gouvernement d'un nouveau domaine territorial, en les exposant ainsi à une perte presque certaine, à titre de producteurs de colonies, n'est-il pas juste qu'on leur réserve exclusivement les profits de cette sorte d'entreprises, à titre de consommateurs? Autrement, qu'arriverait-il? C'est que les peuples colonisateurs supporteraient les pertes de la colonisation tandis que les peuples non colonisateurs en recueilleraient les profits. Cette raison a paru décisive aux états conquérants du nouveau monde qui ont fermé, tantôt absolument, tantôt partiellement leurs colonies aux étrangers, et elle est invoquée encore aujourd'hui par les protectionnistes qui préconisent le retour au système colonial.
Ce n'en est pas moins un système anti-économique. Un état qui exclut les étrangers de ses colonies ou qui établit des droits différentiels en faveur des produits de la métropole, en accordant un privilège analogue aux produits coloniaux agit comme une Compagnie de chemins de fer qui transporterait, uniquement ou à prix réduit, ses actionnaires et leurs produits, et réserverait à ces mêmes actionnaires le monopole de la fourniture de son personnel et de son matériel. Quelques-uns d'entre eux, fabricants de locomotives, producteurs de [196] charbon, etc., réaliseraient probablement de gros bénéfices grâce à ce système, mais ce serait aux dépens de la prospérité et de la durée de l'entreprise. Il y a apparence qu'un chemin de fer ainsi exploité ne couvrirait pas ses frais et que la Compagnie exploitante finirait par être mise en faillite. Les nations européennes étaient assez riches pour supporter indéfiniment les pertes que leur causaient le « système colonial », mais, en étudiant le fonctionnement et les effets de ce système, on s'explique que l'affranchissement des colonies qui y a mis fin ait pu être aussi avantageux aux métropoles qu'aux colonies elles-mêmes. Les unes ont cessé d'avoir à combler les déficits d'établissements stérilisés par le monopole, tandis que les autres, débarrassées de ce fardeau, ont pris un essor extraordinaire. Parfois même, leur prospérité s'est tellement accrue qu'elles ont fourni, après leur émancipation, à l'industrie et au commerce de la métropole, un débouché plus large et plus fructueux qu'à l'époque où leur marché était réservé aux privilégiés du système colonial. [17]
En résumé, la production des domaines territoriaux, comme toute autre industrie, peut procurer un profit aux producteurs ou se solder par une perte. Lorsqu'elle est abandonnée à l'initiative privée, ceux qui l'entreprennent n'y engagent d'habitude leurs capitaux qu'autant que le besoin d'un supplément de terres exploitables se fasse sentir assez vivement pour rendre les entreprises de colonisation suffisamment rémunératrices. Les états fondateurs ou conquérants de colonies obéissent, au contraire, communément à des mobiles et adoptent des pratiques qui n'ont rien d'économique et leurs entreprises se soldent d'habitude par des déficits et une perte finale. Mais soit que la création d'un nouveau domaine territorial procure un bénéfice aux producteurs, soit qu'elle leur inflige une perte, elle est toujours profitable aux consommateurs, agriculteurs en quête de terres, industriels, ouvriers, négociants, en quête de débouchés. Enfin, lorsque la production des domaines territoriaux est libre au lieu d'être [197] imposée, le profit que l'on en peut tirer à titre de consommateur n'est point compensé ou dépassé par la perte que l'on est exposé à supporter à titre de contribuable d'un état producteur de colonies.
§ 2. La rétribution des intermédiaires de la propriété foncière. — Cependant une Société ou un état qui a produit un domaine territorial par voie de conquête, de découverte et d'occupation ne dispose point généralement de la masse de capitaux personnels et mobiliers nécessaires pour fonder et exploiter les entreprises de toute sorte, agricoles, industrielles et commerciales, dont le capital immobilier est l'un des trois facteurs indispensables. D'ailleurs, l'expérience démontre que le cumul de ces entreprises avec l'industrie qui lui est propre — celle du gouvernement — ne lui serait point profitable. Que fait-il? Il ne conserve de ce domaine que la portion qu'il croit pouvoir exploiter lui-même avec profit ou dont il a besoin pour exercer son industrie, ou bien encore dont il ne peut se défaire, les fleuves et rivières, les forêts, les marais, etc., et il met successivement l'autre portion au marché des terres, après l'avoir préalablement morcelée pour l'approprier à la demande. Comme tout autre commerce, celui de la terre comporte une série d'intermédiaires, Pas plus qu'aucun autre, le produit-terre ne va d'habitude directement du producteur au consommateur, et c'est une erreur économique de s'imaginer que ces intermédiaires soient des parasites. Ils ont leur raison d'être, et quand ils cessent de l'avoir, ils disparaissent d'eux-mêmes. Les conditions auxquelles la Société ou l'état producteur d'un domaine territorial l'offre, par parcelles plus ou moins étendues, au marché des terres, sont fort diverses. Tantôt il concède gratuitement ou même en allouant une prime aux concessionnaires, la propriété perpétuelle de ces parcelles, sous la condition de les exploiter dans un délai déterminé; tantôt il les vend à des prix plus ou moins élevés; tantôt il se réserve la propriété du sous-sol en concédant ou en vendant le sol, sauf à accorder plus tard à ceux qui découvrent des mines, le droit de les exploiter avec ou sans partage des profits; tantôt, au contraire, il joint, dans la concession ou la vente, la propriété du sous-sol à celle du sol. Tantôt enfin, il concède [198] ou loue le sol d'une manière temporaire, en stipulant même que toutes les constructions, améliorations, etc., que le concessionnaire ou le locataire aura pu faire lui demeure cont acquises à l'expiration du contrat. L'expérience ayant démontré que la concession ou la vente à perpétuité attire de préférence la demande, c'est ce mode de cession qui a fini par prévaloir.
Quand un nouveau domaine territorial vient à être offert au marché des terres, que se passe-t-il? Si ce domaine est abondant en ressources naturelles et facilement accessibles, si encore et surtout la sécurité des personnes et des propriétés y est suffisamment garantie, la demande ne tarde pas à répondre à l'offre. Parmi les démandeurs du produit-terre, les uns se proposent simplement d'en acquérir des lots pour les revendre, sans y appliquer aucun capital sous forme de défrichements, de bâtiments d'exploitation, etc., ce sont de simples spéculateurs, et, à ce titre, dénoncés comme des vampires par les philanthropes et les socialistes; d'autres acquièrent un lot défrichent le sol et l'enclosent, abattent les arbres, construisent une habitation et revendent le tout ou le donnent en location aux agriculteurs: ce sont les pionniers. Ou bien encore s'il s'agit de terrains propres à l'établissement de foyers d'habitation, d'industrie ou de commerce, ceux qui en ont obtenu la concession gratuite ou qui les ont acquis, les revendent, les louent ou les appliquent eux-mêmes à cette destination finale. Ces divers intermédiaires acquéreurs et revendeurs, les uns simples commerçants en terres (les spéculateurs), les autres à la fois commerçants et industriels (les pionniers) se trouvent, au point de vue de la rétribution, dans la même situation que la généralité des commerçants et des industriels. Car le commerce des terres et l'industrie qui s'y ajoute par le défrichement et les autres facons données au sol ne peuvent procurer, au moins d'une manière quelque peu durable, des profits supérieurs à ceux des autres commerces et industries. Remarquons que, parmi ces intermédiaires, les plus utiles au début, ce sont les spéculateurs qui « accaparent » les terres pour les revendre. C'est la perspective des bénéfices extraordinaires qu'ils se promettent de cet accaparement du sol d'un pays neuf qui les décide à y porter leurs capitaux. Mais lorsqu'ils [199] ont « accaparé » les terres, ils sont intéressés à y attirer une nombreuse clientèle d'acheteurs ou de locataires, et ils s'appliquent à atteindre ce but aussi promptement que possible. Un « marché de terres » se crée ainsi où chacun peut trouver, avec un minimum de formalités, de frais et de pertes de temps, les lots qui lui conviennent et où la concurrence des accapareurs, comme toute concurrence, ne manque pas d'abaisser les prix aux niveau du taux nécessaire, souvent même au-dessous. Sans doute, les acquéreurs définitifs ont à rembourser les frais des intermédiaires, mais, d'une part, en cédant ou en vendant les terres en gros, la Société ou l'état propriétaire du domaine territorial économise les frais et délais que lui aurait coûtés la cession en détail, et, d'une autre part, les acquéreurs traitent avec les intermédiaires à des conditions mieux appropriées à leurs besoins et à leurs convenances.
III. La Naissance Et L'accroissement Du Revenu Du PropriéTaire Foncier. — A quelle destination cet acquéreur définitif que l'on désigne particulièrement sous le nom de propriétaire, applique-t-il le produit-terre? Il peut le mettre en œuvre lui-même, l'affermer ou le louer à un entrepreneur agricole ou autre. Le produit-terre devient alors un des facteurs du capital d'exécution de l'entreprise, et c'est le produit de cette entreprise qui lui fournit sa rétribution comme il fournit celle du capital personnel et du capital mobilier.
Si nous analysons une entreprise agricole, par exemple, nous trouvons que l'entrepreneur, propriétaire exploitant ou fermier, doit couvrir une série de frais de production consistant: 1° dans les salaires du travail employé à l'exploitation; 2° dans une part du prix d'acquisition des bâtiments, clotures, engrais, amendements, bestiaux, outils, machines, part calculée sur la durée de ces agents et instruments nécessaires de la production; 3° dans la totalité du prix des matières premières consommées, telles que les semences, les frais de nourriture et d'entretien du bétail, d'achat du combustible et de la graisse nécessaire aux machines, de réparation aux bâtiments et clôtures; 4° dans le fermage de la terre, si la terre ne lui est pas gratuitement fournie; enfin, 5° dans l'intérêt du capital d'entreprise qu'il a emprunté à autrui ou à [200] lui-même pour effectuer l'avance et l'assurance d'une partie de ces frais de production jusqu'à ce que le produit soit réalisé. Si le produit couvre et au delà ces différents frais, l'excédent constitue le profit de l'entrepreneur; s'il ne les couvre point, l'entrepreneur subit une perte. Or, il est bien clair que les entreprises agricoles doivent, dans leur ensemble, couvrir leurs frais de production et donner un profit qui équivale à ceux des autres industries, sinon elles n'attirent point les capitaux, et la terre, fût-elle mise gratuitement à la disposition des entrepreneurs, demeure en friche.
Il en est ainsi jusqu'à ce que les produits agricoles soient assez demandés pour que le prix auquel les consommateurs consentent à les payer s'élève au niveau des frais de production augmentés du profit nécessaire. Mais aussitôt que ce niveau est atteint, les entreprises se créent, l'exploitation commence. Si nous l'observons au début, c'est-à-dire quand un nouveau domaine territorial vient d'être ouvert, nous constaterons que les entrepreneurs de culture, d'industrie, de commerce, qui ont besoin d'un lot de terre, s'appliquent naturellement à choisir celui dont l'exploitation leur paraît la plus profitable. L'offre des terres étant alors supérieure à la demande, ils obtiennent à bas prix ou même gratis ce lot de choix. Dans cet état des choses, les premiers entrepreneurs et leurs coopérateurs, capitalistes et ouvriers, peuvent réaliser des profits extraordinaires. C'est entre le capital mobilier et le capital personnel (du moins sous un régime de liberté du travail) que se partage la totalité ou la presque totalité du produit des entreprises. Mais, précisément à cause de l'élévation de leurs profits, les capitaux personnels et mobiliers affluent dans le nouveau domaine territorial et ils se font une concurrence de plus en plus vive pour acquérir on louer le lot de terre dont la coopération leur est nécessaire. Or, les lots disponibles sont inégaux sous le double rapport de la productivité et de la situation. Les plus profitables, ceux que les auteurs de la théorie de la rente, Anderson, West, Malthus et Ricardo, ont désignés sous la dénomination de terres de première qualité, lorsqu'il s'agit de la culture, et de terrains de premier choix, lorsqu'il s'agit de l'habitation ou de l'exploitation industrielle et commerciale, ont généralement [201] trouvé des preneurs parmi les premiers colons. Il ne reste bientôt plus disponibles que les terres de seconde qualité ou de second choix; puis viennent ceux de troisième, de quatrième et ainsi de suite, jusqu'à ce que la totalité du sol cultivable ou exploitable soit allotie. Alors on voit s'élever successivement, quoique inégalement, les prix de vente, d'affermage ou de location du sol. Aussi longtemps que des terres de première qualité restent disponibles et qu'on peut les obtenir au prix ordinairement modique auquel le propriétaire du domaine territorial ou les intermédiaires les cèdent aux acquéreurs définitifs, on ne demande pas les autres; elles restent sans preneurs et ne peuvent être vendues ou louées à aucun prix. Mais dès que les terres de première qualité viennent à être occupées en totalité, la situation change. Les terres de deuxième qualité commencent à être demandées: le propriétaire du domaine territorial ou les intermédiares auxquels il en a cédé les parcelles et qui les ont acquises en vue de les revendre ou de les louer peuvent en obtenir un prix de vente ou de location. Dès ce moment aussi, on voit hausser le prix de vente ou de location des terres de première qualité. Dans quelle mesure? Dans la mesure de la différence de productivité qui existe entre les terres de première et de deuxième qualité. En effet, les entrepreneurs de culture ou autres qui ont besoin de terre trouvent autant d'avantage à acheter ou à louer des terres de deuxième qualité au prix du marché. Les prix de vente et de location s'échelonnent ainsi suivant le degré de productivité ou les avantages de situation des terres, et ils vont s'élevant dans chaque catégorie à mesure que les terres de qualités de plus en plus basses commencent à être demandées. Cependant elles ne peuvent l'être qu'autant que le produit obtenu sur les terres les moins productives couvre ses frais de production et donne à l'entrepreneur un profit équivalent à ceux de la généralité des industries. Lorsque le profit de l'entrepreneur tombe au-dessous de ce niveau, la mise en exploitation des terrains inférieurs s'arrête et elle ne peut être reprise et se continuer que si les frais de production diminuent ou si les prix des produits viennent à hausser.
[202]
La première de ces deux éventualités se réalise toujours dans de certaines proportions. A mesure que les capitaux personnels et mobiliers affluent dans un nouveau domaine territorial, la concurrence croissante qu'ils se font entre eux agit pour diminuer leur rétribution. Le taux de l'intérêt et des salaires s'abaisse. Au début, lorsque la concurrence était à son minimum de pression, les salaires et l'intérêt étaient à leur taux maximum. A mesure que la pression de la concurrence augmente, ils vont diminuant jusqu'à ce qu'ils tombent au niveau de leur taux nécessaire. Alors leur chute s'arrête, la portion des frais de production qui forme leur rétribution cesse de diminuer et si le prix des produits ne s'est pas élevé, la demande des terres reste stationnaire. Si toutes les terres de deuxième qualité sont déjà en culture, on ne demande pas celles de la troisième. Celles-ci et à plus forte raison les terres de qualités inférieures demeurent en friche.
Cependant, les prix des produits agricoles n'ont-ils pas haussé dans l'intervalle? D'après les auteurs de la théorie de la rente, c'est même à cette hausse qu'est due la mise en culture des terres de qualité de plus en plus basse. Ils ont pu hausser, sans doute, si la demande des produits de la culture s'est augmentée plus rapidement que l'offre; mais ils ont pu tout aussi bien baisser, car dans un pays naturellement ouvert à la culture comme dans tout autre, l'offre peut devancer la demande. Dans ce cas, c'est uniquement la diminution des frais de production qui détermine la continuation de la mise en culture. C'est seulement lorsque la rétribution des capitaux personnels et mobiliers étant descendue à son taux nécessaire, les frais de production ont cessé de s'abaisser. que la hausse du prix des produits devient le facteur indispensable de la continuation de la mise en culture. Si la demande vient à dépasser l'offre d'une façon continue, et à provoquer la hausse permanente des prix; si, en même temps, le progrès de l'outillage et des méthodes agricoles se joint à la baisse des salaires et de l'intérêt pour diminuer les frais de production, la mise en culture se poursuit jusqu'à ce que toutes les terres cultivables ou exploitables du domaine territorial soient cultivées ou exploitées. L'ascension de la rente continue d'une manière parallèle : après avoir été nulle ou moins que [203] nulle au début de l'exploitation, elle peut s'élever au-dessus du taux nécessaire du profit du capital foncier. Mais, dans ce cas, l'excédent agit comme une prime d'encouragement à la production et à la mise en exploitation de nouveaux domaines territoriaux. On voit alors les capitaux personnels et mobiliers abandonner les anciens domaines pour les nouveaux, où ils commencent naturellement par mettre en exploitation les terres les plus productives. Les produits de ces terres de première qualité des nouveaux domaines arrivent au marché, où ils viennent faire concurrence aux produits des terres de première, deuxième, troisième, quatrième qualité des anciens. Au début, la différence existant entre le taux des salaires et de l'intérêt dans les deux domaines concurrents compense, parfois même au-delà, cette inégalité: mais à mesure que les capitaux personnels et mobiliers affluent et se multiplient dans le nouveau domaine en se raréfiant dans l'ancien, la différence s'efface, les produits recueillis sur les terres de première qualité du nouveau domaine font une concurrence de plus en plus serrée à ceux des terres de première, deuxième, troisième et quatrième qualité de l'ancien. Cette concurrence détermine la baisse des prix. Si les terres de première qualité existent en quantité assez grande pour suffire aux besoins du marché, les prix qui tendaient auparavant à s'élever au niveau des frais de production et du profit nécessaire de l'exploitation des terres inférieures tendent au contraire à s'abaisser au niveau des frais d'exploitation des terres de première qualité. L'exploitation des terres de qualité inférieure cesse de couvrir ses frais; elle est abandonnée et la rétribution du capital foncier se réduit au taux nécessaire de cette rétribution sur les terres de première qualité. Il en est ainsi jusqu'à ce que la demande des produits de la culture, en devançant de nouveau l'offre, provoque l'exhaussement des prix. Si, alors, les terres de première qualité deviennent encore une fois insuffisantes, on a recours aux terres de deuxième, et ainsi de suite; mais, dans l'état présent du monde, cette éventualité apparaît comme de moins en moins probable; en sorte qu'il est douteux que la rente se relève au taux excessif où elle avait été portée naguère, dans l'Europe occidentale, sous l'influence combinée des progrès de la population et de [204] l'industrie et des obstacles qui s'opposaient à l'extension du domaine territorial de la civilisation.
IV. Résumé. — L'analyse de la « production de la terre » nous montre, en définitive, que cette production s'opère au moyen de trois catégories d'industries et que la rétribution de ces industries comme celle de toutes les autres gravite incessamment vers son taux nécessaire.
L'industrie de la production des domaines territoriaux par la découverte, la conquête et l'occupation apparaît la première. Elle est exercée par des Sociétés ou des états politiques qui se proposent pour objet, en créant un domaine territorial, de l'exploiter, de le concéder, de le vendre ou de le louer en détail, en se réservant le droit exclusif de produire les services politiques et administratifs nécessaires à ses habitants. Le produit qu'une Société ou un état peut tirer soit de l'exploitation directe, soit de la vente ou de la location d'un domaine territorial, n'est que secondaire; c'est à l'industrie du gouvernement qu'il demande principalement la couverture de ses frais avec son profit. C'est pourquoi il cède d'habitude à vil prix ou gratis, parfois même avec adjonction d'une prime d'immigration, la portion de son domaine qu'il ne pourrait exploiter lui-même et il demande la rétribution de son industrie aux impôts dont il frappe la population attirée par le bon marché ou la gratuité des terres. Le produit de ces impôts doit couvrir: 1° l'intérêt et l'amortissement du capital employé à la production du domaine; 2° les frais des services du gouvernement avec adjonction des profits ordinaires. S'il ne couvre point d'habitude ces deux sortes de frais, cela tient à ce que les gouvernements qui entreprennent la production de nouveaux domaines territoriaux obéissent pour la plupart, à des mobiles qui n'ont rien d'économique.
En second lieu apparaît l'industrie des spéculateurs et des pionniers qui achètent et défrichent la terre pour la revendre. Lorsque cette industrie est libre, la concurrence ne manque pas d'agir pour en réduire les profits au taux nécessaire.
Enfin, en troisième lieu, apparaît l'industrie des propriétaires proprement dits qui acquièrent la terre de la Société ou de l'état producteur, ou des intermédiaires, spéculateurs et [205] pionniers pour l'exploiter eux-mêmes, la louer ou l'affermer. C'est une industrie essentiellement aléatoire. Ceux qui l'exercent obtiennent des rétributions inégales et variables: 1° selon qu'ils ont choisi des terres plus ou moins propres à la culture des denrées les plus demandées ou plus ou moins favorablement situées; 2° selon que ces terres acquièrent dans le cours du temps une plus-value plus ou moins grande et qu'elles sont, de même, plus ou moins exposées au risque de moins-value. Mais il importe de remarquer que ces chances de plus-value et ces risques de moins-value entrent dans les calculs des acquéreurs de la propriété foncière. Ils n'y portent leurs capitaux qu'autant que le revenu probable qu'ils espèrent en tirer, en tenant compte de ces circonstances accessories, équivaut à celui qu'ils peuvent se procurer dans la généralité des placements. Quand ce revenu dépasse celui des autres branches de la production, les capitaux affluent dans les placements fonciers jusqu'à ce que le niveau soit rétabli. Lorsque cette affluence est arrêtée par le manque de terres disponibles, lorsque les capitaux investis dans la terre, réalisent. en conséquence, des profits dépassant le niveau commun, la « rente » qu'ils obtiennent du chef de ce monopole agit comme une prime pour encourager la production de nouveaux domaines territoriaux. Alors, la concurrence des terres de ces nouveaux domaines abaisse au taux nécessaire les profits fonciers des anciens, en faisant ainsi disparaître la rente.
On voit donc que la part de la terre est incessamment ramenée, comme celle des autres agents productifs, au taux nécessaire pour rétribuer les industries qui la mettent au service de la production. Elle ne pourrait dépasser ce taux que dans un seul cas; savoir si les capitaux personnels et mobiliers venaient finalement à se trouver à l'état d'excédent vis-à-vis du capital-terre, mais cette rupture d'équilibre ne pourrait être durable: la rétribution des agents productifs à l'état d'excédent tomberait, par une progression développée en raison géométrique, au-dessous du taux nécessaire, et la production en diminuerait jusqu'à ce que les rétributions des différentes catégories de capitaux personnels, mobiliers et immobiliers fussent revenues à ce taux nécessaire auquel les lois naturelles tendent incessamment à les établir.
[206]
CHAPITRE IX
La distribution. — La part du capital personnel.↩
I. Les frais de production du travail. La hiérarchie naturelle des fonctions productives. Que le progrès industriel a pour effet d'élever les frais de production du travail. — II. La part proportionnelle des profits afférents au travail. Le prix courant du travail. Analyse d'une entreprise. — III. La rétribution du capital d'entreprise et celle du capital d'exécution. Causes de l'abaissement du taux courant des salaires au-dessous du taux nécessaire. Comment il peut y être remedié.
La coopération du capital personnel à la production est communément désignée sous le nom de « travail », quoique cette expression soit aussi bien applicable à celle du capital immobilier et mobilier.
I. Les Frais De Production Du Travail. — Nous avons constaté qu'aucune entreprise de production ne peut subsister d'une manière régulière et permanente qu'à la condition de rétablir intégralement les agents productifs qu'elle met en œuvre. En effet, si l'un ou l'autre de ces agents n'est pas complètement rétabli, une portion correspondante des deux autres ne pourra être employée et la production diminuera dans la mesure du déficit du premier. Il s'agit done de savoir en quoi consistent les frais de rétablissement du capital personnel.
Le capital personnel est celui qui se trouve investi sous forme de forces physiques, intellectuelles et morales et de [207] connaissances techniques dans les individus qui coopèrent à la production, les uns comme entrepreneurs ou directeurs, les autres comme employés et ouvriers. Ce personnel de la production aussi bien que le matériel qu'il met en œuvre, doit être produit, entretenu et renouvelé, et les sommes qu'il coûte à produire, à entretenir et renouveler constituent ses frais de production. Lorsque ces frais ne sont pas entièrement couverts, le personnel de la production diminue en qualité et en nombre. Alors, les entreprises auxquelles il coopère subissent inévitablement une déchéance correspondante.
Prenons pour exemple un simple ouvrier, employé dans une entreprise de production quelconque et voyons quels frais sa rétribution doit couvrir. Ces frais comprennent en premier lieu la somme dépensée pour le nourrir, l'entretenir et le dresser à la production jusqu'à ce qu'il soit en état de pourvoir lui-même à sa subsistance: si cette somme lui est fournie par ses parents sans qu'ils en exigent le remboursement, il devra les fournir à son tour pour former un ouvrier capable de le remplacer. En second lieu, sa rétribution devra couvrir ses frais d'entretien nécessaires pendant sa période d'activité et pendant celle où, par le fait de la maladie, des chômages, de la diminution de ses forces, il ne peut coopérer à la production. Tel est l'ensemble des frais que la rétribution du travail doit nécessairement couvrir pour que le capital personnel investi dans l'ouvrier puisse être produit, conservé et renouvelé.
Ces frais diffèrent selon la nature du travail requis par la production. Il y a une hiérarchie naturelle des fonctions productives. Les degrés de cette hiérarchie sont établis par les quantités inégales de forces physiques, intellectuelles et morales d'une part, de connaissances et d'expérience techniques de l'autre. dont la fonction exige la mise en activité. Un médecin, un ingénieur, un artiste, coûtent plus cher à produire qu'un simple manœuvre. Ils coûtent aussi plus cher à entretenir. les forces intellectuelles et morales qu'ils dépensent exigeant une réparation plus variée et raffinée partant plus coûteuse que celle qui suffit pour maintenir en état la force physique dépensée par le manœuvre. A cette première cause naturelle d'inégalité des rétributions s'en joignent d'autres, [208] d'un ordre secondaire, qui tiennent aux conditions, aux circonstances et au milieu dans lesquels les industries s'exercent; tels sont les dangers inhérents à l'exercice de certaines branches de travail et qui abrègent la durée de la période d'activité des travailleurs, les chômages, etc.
Ces inégalités naturelles, dont ne tiennent aucun compte les théoriciens communistes de l'égalité des salaires, dé-déterminent l'inégalité nécessaire des rétributions du personnel de la production. Seulement, elles ne sont point fixes et invariables, et toutes les modifications qu'elles subissent dans un sens ou dans un autre se répercutent dans l'échelle des rétributions. La diminution de la durée des chômages, les remèdes apportés à l'insalubrité de certains travaux ont pour effet d'abaisser le taux nécessaire des salaires tandis, au contraire, que les progrès qui substituent le travail des bêtes de somme ou des machines au travail humain ont pour effet de l'élever. Si ces progrès diminuent la proportion du capital personnel employé à la production pour augmenter celle du capital immobilier et mobilier, en revanche, ils élèvent l'échelle de sa rétribution, en exigeant, dans une proportion plus forte, la mise en œuvre des forces intellectuelles et morales des travailleurs, et, dans une proportion moindre, celle de ses forces physiques. Telle a été la cause déterminante de l'exhaussement successif des salaires dans l'industrie manufacturière et dans les autres branches de la production à mesure que leur matériel et leurs procédés se sont perfectionnés. Les ouvriers se montrent généralement hostiles à la substitution du travail mécanique au travail physique, parce que les machines en remplaçant une partie du personnel de la production leur enlèvent momentanément les emplois que les faisaient vivre. C'est un mal, sans doute, mais un mal temporaire, et dont ils pourraient se garantir en s'assurant contre le risque du progrès. En compensation, ils recueillent la meilleure part du profit de l'emploi des machines, car c'est grâce à cette substitution d'une force mécanique à leur force physique que leur salaire peut s'élever d'une manière permanente [18].
[209]
Le capital personnel, avons-nous dit, ne peut être mis et demeurer au service de la production qu'à la condition que ses frais nécessaires de formation, d'entretien et de renouvellement soient complètement couverts, mais ils peuvent l'être d'une manière directe ou indirecte. Ils le sont directement lorsque le salaire de l'ouvrier suffit à son entretien, à la fois pendant sa période d'activité et de non activité ainsi qu'à son renouvellement. Ils le sont indirectement, lorsque le salaire étant insuffisant pour subvenir à cette double nécessité, il y est suppléé soit par une taxe des pauvres, soit par des subventions allouées par l'état ou les entrepreneurs d'industrie aux caisses de retraites et aux sociétés de secours mutuels, mais ce supplément indirect, ajouté au salaire, a pour effet inévitable d'en abaisser le taux, la rétribution nécessaire, augmentée d'une part proportionnelle [210] de profit, marquant, comme nous le verrons plus loin, le point vers lequel gravite, sous l'impulsion des lois naturelles de la concurrence et de la progression des valeurs, la rétribution effective du travail. Ce sont les ouvriers eux-mêmes qui font les frais de la charité publique et privée que les philanthropes et les socialistes s'évertuent à solliciter pour eux.
II. La Part Proportionnelle De Profit. — Les frais de production, d'entretien et de renouvellement du capital personnel constituent le premier et le plus important élément de sa rétribution; le profit est le second. Comme nous l'avons remarqué, le profit est la rétribution nécessaire du temps utilisé. Le temps dont tout individu dispose pouvant être employé à la consommation ou à la production, que faut-il pour le décider à l'appliquer à celle-ci plutôt qu'à celle-là? Il faut que les jouissances futures que lui procurera la production ou [211] les peines qu'elle lui épargnera excèdent les jouissances actuelles qu'il trouve dans la consommation. Dira-t-on que la nécessité ne lui laisse pas la liberté du choix? Que s'il n'emploie pas une partie de son temps à la production, dût sa rétribution ne pas dépasser les frais d'entretien et de rétablissement de son capital personnel et même demeurer au-des-sous, il est exposé à périr à bref délai? Soit! mais dans ce cas même, s'il applique son temps à une destination productive au lieu de le consommer dans l'oisiveté, c'est parce qu'il estime que cette première destination lui épargnera plus de peine que la seconde ne lui procure de jouissances. Cependant, il se peut aussi qu'il ne soit point esclave de la nécessité, il se peut qu'il soit libre de choisir l'emploi de son temps. Dans ce cas, il n'appliquerait évidemment son capital personnel à la production qu'à la condition de recueillir en sus du rétablissement de ce capital un excédent suffisant pour compenser la privation des jouissances qu'il aurait pu obtenir en employant son temps à la consommation. Cet excédent, c'est le profit nécessaire. Nous avons constaté encore que le taux de ce profit n'est point invariable, qu'il va s'élevant à mesure que la productivité de l'industrie augmente et avec elle la somme de jouissances que peut procurer le temps employé à la consommation.
Ce profit nécessaire que retient le producteur se partage proportionnellement entre les différents coopérateurs de la production. Qu'arrive-t-il, en effet, lorsque l'un d'entre eux obtient au-delà de sa part proportionnelle? C'est qu'il y a avantage à investir de préférence les capitaux dans les agents ou les matériaux qui obtiennent une part de profit supérieure à celle des autres, et que cet apport ne manque pas de la faire baisser jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli. La même loi qui nivelle le taux des profits entre les différentes branches de la production agit de même pour en niveler les parts entre les différents coopérateurs de chacune: capitaux personnels, immobiliers et mobiliers.
Il y a donc une rétribution nécessaire du capital personnel. Cette rétribution doit couvrir: 1° les frais nécessaires pour le former, l'entretenir et le renouveler; 2° sa part proportionnelle dans le profit des entreprises.
[212]
Mais la rétribution nécessaire du capital personnel, comme celle des deux autres catégories de capitaux n'est qu'un point idéal vers lequel gravite la rétribution effective. Comment celle-ci s'établit-elle?
III. La Rétribution Effective Du Capital Personnel Ou Le Prix Courant Du Travail. — Si l'on veut savoir comment le produit d'une entreprise se distribue entre ses coopérateurs, il faut revenir à l'analyse de la production, et à la distinction que nous avons établie entre le « capital d'exécution » et le « capital d'entreprise ». Prenons pour exemple une manufacture de cotonnades et faisons-en l'inventaire. Qu'y trouverons-nous? D'abord, des bâtiments, des machines et un approvisionnement de matières premières: coton, charbon de terre, graisses, etc., nécessaires les uns à la fabrication du fil et des tissus (en supposant que cette double fabrication soit réunie dans la même manufacture), les autres à l'alimentation et à l'entretien des machines; ensuite, un personnel dirigeant et dirigé, directeur, comptables, contremaîtres, ouvriers; bref, d'une part, un capital immobilier et mobilier, et, d'une autre part, un capital personnel, réunis dans des proportions déterminées par la nature de l'entreprise. De quoi s'agit-il? De transformer le coton brut en fils et les fils en tissus, puis de vendre ces tissus à un prix qui couvre les frais de la production et donne un profit. Tel est le but de l'entreprise. Mais ce but ne peut être atteint qu'au bout d'un certain espace de temps et avec certains risques. L'espace de temps comprend: 1° la durée de l'opération qui transforme le coton brut en fils et en tissus; 2° la durée de la réalisation, durée qui varie avec l'état du marché. Les risques dépendent de même, principalement, de l'état du marché. Il se peut que les cotonnades soient vendues à un prix qui couvre les frais de la production avec adjonction d'un profit, mais il se peut aussi qu'au lieu de donner un profit, ce prix laisse une perte. D'où il résulte que les capitaux personnels, immobiliers et mobiliers nécessaires pour transformer le coton brut en cotonnades, ne peuvent obtenir leur rétribution qu'après que le produit a été réalisé et qu'ils subissent les risques attachés à sa réalisation. De plus, qu'il soit réalisé avec perte ou avec [213] bénéfice, ils doivent se partager, en proportion de leur apport, cette perte aussi bien que ce bénéfice.
Dans cette situation, trouverait-on des propriétaires d'ateliers, des constructeurs de machines, des producteurs de coton brut, de charbon de terre, de graisse, etc., des directeurs techniques, des employés, des ouvriers, disposés à s'associer pour coopérer à une entreprise de fabrication de fils et de tissus de coton? Nous ne disons pas qu'une telle association soit impossible, mais l'expérience atteste qu'il n'y en a point d'exemple, et voici pourquoi: c'est que parmi les coopérateurs nécessaires de la production des cotonnades, les uns ne veulent pas attendre les résultats et courir les risques d'une telle entreprise, les autres ne le peuvent pas, faute de posséder une avance de subsistance suffisante pour attendre que le produit soit réalisé, faute aussi, voulussent-ils courir les risques de la réalisation, de présenter à leurs associés la garantie du payement de leur part de perte. Cependant, les cotonnades sont demandées et le prix que les consommateurs sont disposés à y mettre peut non seulement couvrir les frais de la production, mais encore donner un ample profit. Que se passe-t-il alors? Un homme se présente et fait le calcul suivant: il évalue d'abord approximativement la quantité de cotonnades que le marché peut absorber et à quel prix. Ce sera, par exemple, en une année, 100,000 pièces donnant à raison de 30 francs la pièce, un produit de 3 millions de francs. Il évalue ensuite le coût des bâtiments, des machines, des matières premières qu'il devra louer ou acheter, et celui des travailleurs de tout ordre qu'il devra engager et salarier. Si le résultat de cette évaluation se résout en une somme annuelle de 2,700,000 francs à dépenser en achat de matières premieres et de travail, en location de bâtiments et en frais de matériel, et s'il estime que dans cet intervalle d'une année, il pourra réaliser quatre fois son produit, soit 25,000 pièces par trimestre, il lui suffira d'un capital de 750,000 francs pour entreprendre la production des cotonnades, à raison de 100,000 pièces par an, avec la marge nécessaire pour couvrir les risques de la réalisation. En supposant que ses calculs soient exacts et qu'aucun risque ne vienne à échoir, il obtiendra, ses frais de production remboursés, [214] un profit de 300,000 francs, soit, pour un capital d'entreprise de 750,000 francs, de 40%. S'il possède ce capital, il n'hésitera pas à l'engager dans l'entreprise; s'il ne le possède pas, il cherchera des associés, des commanditaires ou des prèteurs qui consentent à le lui fournir, moyennant une participation éventuelle dans ses bénéfices ou une part fixe, et s'il présente de bonnes garanties, il ne manquera pas de les trouver. L'entreprise qui était impossible lorsqu'il s'agissait d'en associer les coopérateurs, se réalise grâce à l'intervention de cet entrepreneur-capitaliste.
Voyons maintenant comment se règlent: 1° la rétribution de l'entrepreneur et de son capital d'entreprise; 2° la rétribution des capitaux d'exécution qu'il achète, loue ou salarie.
C'est le produit de l'entreprise, évalué annuellement à 3 millions qui pourvoit à ces diverses rétributions, en rétablissant avec adjonction d'un profit le capital d'entreprise et les capitaux d'exécution. Sur ce produit de 3 millions, nous avons supposé que le capital d'entreprise reçoit 300,000 fr. Comment ces 300,000 francs se partagent-ils? L'entrepreneur s'en attribue une part pour la rétribution du capital personnel de forces, d'aptitudes et de connaissances qu'il a appliqué pendant un an à la gestion de l'entreprise; il s'en attribue encore le restant s'il a fourni lui-même le capital d'entreprise, ou bien il le distribue à ses associés, à ses commanditaires ou à ses prêteurs. La proportion dans laquelle s'opère cette répartition dépend des conventions faites entre les parties, et ces conventions à leur tour sont déterminées par la concurrence des capitaux personnels et des capitaux mobiliers sur le marché des entreprises. Si les entrepreneurs sont rares et les capitaux mobiliers abondants, la part du capital personnel sera relativement forte et celle du capital mobilier faible, mais dans ce cas la production de l'un sera encouragée et celle de l'autre découragée, jusqu'à ce que leurs rétributions soient ramenées à l'équivalence. Sans doute, il se peut que cette équivalence se produise à un taux supérieur à celui de la rétribution nécessaire de l'un et de l'autre; mais dans ce cas encore qu'arrive-t-il? C'est que la multiplication des entreprises est encouragée ou découragée jusqu'à ce que les [215] rétributions du capital personnel et du capital mobilier d'entreprise soient ramenées à leur taux nécessaire.
Comment se partagent les 2,700,000 francs employés à rétribuer les capitaux d'exécution? Mais d'abord peut-on dire, comme le font les socialistes, que la rétribution du capital d'entreprise soit percue aux dépens des capitaux d'exécution et, en particulier, aux dépens du capital personnel des ouvriers? Il en serait ainsi certainement si cette rétribution était inutile, si elle ne servait point à pourvoir à une fonction indispensable, qui devrait être remplie et rétribuée sous n'importe quel régime de production, sous celui des associations ouvrières collectivistes comme sous celui des entrepreneurs-capitalistes. Il est évident qu'une association ouvrière ne pourrait entreprendre la production des cotonnades qu'à la condition: 1° de confier la gestion de cette entreprise à un directeur ou gérant, chargé d'en réunir les éléments, de les mettre en œuvre, et de rétribuer ce directeur au prix du marché de cette sorte supérieure de travail, qui exige des capacités particulières et hors ligne; 2° de posséder un capital mobilier suffisant pour attendre la réalisation des produits et couvrir les risques de la production. Or, ce capital, l'association ne pourrait se le procurer et l'employer, sans lui fournir une rétribution. On ne peut donc pas dire que la rétribution du capital d'entreprise soit perçue aux dépens des ouvriers. Elle est le prix d'une fonction nécessaire, à laquelle les ouvriers associés devraient pourvoir à leurs frais, si l'entrepreneur et le capital d'entreprise n'y pourvoyaient point. Les ouvriers associés y pourvoiraient-ils à meilleur marché? Il serait facile de démontrer que le capital d'entreprise leur reviendrait plus cher, et ce qui suffirait, au surplus, à le prouver, c'est que nulle part, le régime de la production collectiviste n'a prévalu sur le « régime capitalistique ».
Revenons maintenant à l'analyse de la rétribution du capital d'exécution, — capital immobilier, mobilier et personnel. A première vue, il semble que ce capital ne participe point aux profits de l'industrie. L'entrepreneur achète ou loue au meilleur marché possible les bâtiments, les machines, les matières premières et le travail. Les détenteurs de ces éléments et de ces agents de la production s'efforcent d'en obtenir le [216] prix le plus élevé, tandis que l'entrepreneur s'applique, au contraire, à les payer au prix le plus bas. C'est l'état de l'offre et de la demande qui décide du taux d'achat ou de location des matières premières, du travail, des bâtiments et des machines. Mais la location conclue ou l'achat fait, les planteurs ou les marchands qui ont vendu le coton, les propriétaires qui ont loué les bâtiments de l'usine, les ouvriers qui fournissent le travail en échange d'un salaire, n'ont plus rien à prétendre. Leur compte est réglé.
Cependant, on va voir que ces différents coopérateurs de la production des cotonnades n'en reçoivent pas moins la part proportionnelle de profit afférente à leur rétribution. C'est grâce au prix d'achat que reçoit du manufacturier le producteur de coton brut qu'il peut rétablir le capital engagé dans ses plantations, et il en est de même pour les autres matières premières acquises; c'est grâce au loyer que perçoit le propriétaire des bâtiments de l'usine qu'il peut reconstituer à la longue le capital employé à les construire et à les réparer; c'est grâce enfin aux appointements et aux salaires que reçoivent les employés et ouvriers qu'ils peuvent subsister et pourvoir à leur renouvellement. Toutes ces rétributions sont fournies par le produit brut de l'entreprise, et elles constituent par leur réunion la somme des frais de production, évaluée à 2,700,000 francs. Or, si nous les analysons à leur tour, que trouverons-nous? Nous trouverons qu'elles contiennent, elles aussi, des frais de production, tantôt avec un excédent, tantôt avec un déficit, tantôt avec un profit, tantôt avec une perte. Cela dépend du prix auquel les matières premières ont été achetées, du taux auquel les immeubles ont été loués et les ouvriers salariés. Il est bien clair que l'intérêt de l'entrepreneur a été d'obtenir au taux le plus bas possible, dût ce taux n'être nullement rémunérateur, ces divers éléments et agents productifs, car plus s'abaissent ses frais de production plus s'élève son profit. C'est ainsi que l'on a pu dire que le taux du profit de l'entrepreneur est en raison inverse du taux des salaires des ouvriers. On peut dire encore, d'une manière plus générale, que tout abaissement du prix des matières premières, du loyer des bâtiments aussi bien que du taux des salaires a pour effet d'élever le taux du profit de [217] l'entrepreneur et vice versa; enfin, que toute augmentation ou diminution du prix des cotonnades produit un résultat analogue. Mais on ne doit pas oublier que l'entrepreneur d'industrie n'est pas le maître de fixer à sa guise le prix des matières premières qu'il achète, des immeubles et du travail qu'il loue non plus que le prix des produits qu'il vend. Ces prix sont déterminés par les lois naturelles qui gouvernent la production et l'échange, et ils tendent continuellement à s'établir, en vertu de ces lois, au niveau de leur taux nécessaire.
Supposons, par exemple, que le producteur de cotonnades achète ses matières, premières, loue ses bâtiments d'exploitation et salarie ses ouvriers à des taux réduits de telle sorte que ses frais de production descendent de 2,700,000 à 2,500,000 francs et, par conséquent, que son profit s'élève de 300,000 à 500,000 francs, que se passera-t-il? C'est que, d'une part, la baisse de leur rétribution aura pour effet de diminuer la production des agents et des éléments constitutifs du capital d'exécution, et d'en faire hausser le prix, tandis que l'augmentation de la rétribution du capital d'entreprise, en encourageant l'apport des capitaux dans cette direction, détermineral une baisse dans le prix des cotonnades.
La hausse des agents et éléments constitutifs du capital d'exécution se trouvera déterminée à la fois par la diminution de leur offre et par une augmentation de la demande des nouvelles manufactures dont la hausse du profit aura suscité la création. Par cette double opération, les frais de production remonteront à leur ancien niveau de 2,700,000 francs, peut-être même plus haut, tandis que la baisse du prix des cotonnades fera descendre le produit de la manufacture à 2,800,000 francs et peut-être plus bas. Alors, le profit du capital d'entreprise descendra de 500,000 à 100,000 francs. Mais ce produit étant inférieur à celui des autres emplois du capital, les capitaux d'entreprise prendront une autre direction, jusqu'à ce que l'équilibre se soit rétabli entre les différentes catégories de profits. Ainsi l'opération des lois naturelles qui gouvernent la production et l'échange ramène perpétuellement, à travers toutes les fluctuations, le taux courant des rétributions du capital d'entreprise aussi bien que du capital d'exécution, au [218] niveau du taux nécessaire comprenant le profit avec les frais de production, ni plus ni moins.
N'en déplaise aux socialistes, la rétribution des ouvriers salariés n'échappe point à l'action de ces lois régulatrices. Seulement ici se manifeste une cause particulière de perturbation, à laquelle toutefois il dépend des ouvriers de porter remède.
C'est l'état du marché qui détermine le prix auquel, dans l'exemple que nous venons de citer, l'entrepreneur achète le coton brut et les autres matières premières, ainsi que le taux du loyer des immeubles et du salaire des ouvriers. Mais l'achat des matières premières et la location des immeubles s'opèrent dans des conditions d'égalité qui ne se présentent point d'habitude pour l'enrôlement des ouvriers. Si les prix d'achat et de location offerts par l'entrepreneur paraissent insuffisants aux détenteurs des matières premières et des immeubles, ils peuvent attendre que l'état du marché s'améliore en leur faveur, car il possèdent ordinairement les ressources nécessaires pour subsister dans l'intervalle. Il n'en est pas de même pour la généralité des ouvriers. Il est rare qu'ils puissent attendre pour offrir leur travail aussi longtemps que l'entrepreneur pour le demander; en conséquence, l'offre du travail étant plus intense que celle du salaire contre lequel il s'échange, il peut descendre, en ces circonstances, à un prix inférieur à sa rétribution nécessaire. Sans doute, si ce prix est tel que les frais de production du travail ne soient pas couverts, en y comprenant ses frais de renouvellement, le nombre des travailleurs doit diminuer. Il semblerait même qu'il dût diminuer lorsque la rétribution du capital personnel, investi dans cette catégorie de forces productives n'équivaut pas à celle des capitaux mobiliers et immobiliers, puisque l'onu une autre forme de capitalisation. Mais il faut considérer ici qu'au mobile commun qui pousse les coparticipants de la production à investir leur épargne dans un capital mobilier ou immobilier, s'ajoute un mobile particulier quand il s'agit de la formation du capital personnel: an mobile du profit industriel se joint alors celui du profit physico-moral. Il se peut que le profit industriel que rapporte [219] la constitution de l'épargne sous la forme d'un capital personnel soit inférieur à celui qu'elle rapporterait sous la forme d'un capital mobilier et immobilier, mais si le profit physico-moral est assez élevé pour combler la différence et au-delà, la production du capital personnel s'augmentera plus vite que celle du capital mobilier et immobilier, et le taux de sa rétribution tombera au-dessous de celle de ces deux autres agents productifs. Ce phénomène perturbateur est, remarquons-le bien, imputable à l'ouvrier lui-même. S'il se produit, c'est parce que l'ouvrier tire à la fois de sa reproduction, avec un profit physico-moral, un profit industriel provenant de l'exploitation du travail de ses enfants. Si, comme dans les classes supérieures, l'élève des enfants était, au contraire, une charge pour les parents au lieu de leur rapporter un profit industriel, on verrait, selon toute apparence, se produire le phénomène opposé, savoir une reproduction insuffisante de la classe ouvrière et une hausse des salaires, qui en ferait monter le taux courant au-dessus du taux nécessaire.
Mais, dans l'état actuel des choses, le fait habituel c'est l'abaissement du taux courant des salaires au-dessous du taux nécessaire, se traduisant par une durée excessive de la journée de travail en échange d'une rétribution insuffisante. Cet état de choses, dommageable aux ouvriers, est-il en revanche, comme on le croit d'habitude, avantageux aux entrepreneurs? Si l'abaissement du taux des salaires a d'abord pour effet d'augmenter le taux de leur profit, cette augmentation n'est pas durable, car, du moment où ce taux dépasse le nécessaire, un supplément de capital est attiré dans les entreprises, et les produits baissent de prix de manière à enlever aux entrepreneurs l'excédent du profit, parfois même quelque chose de plus. C'est alors le consommateur qui profite de l'abaissement anormal du prix du travail. Mais cet accroissement du profit du consommateur n'est pas davantage durable. Avant de diminuer en quantité, ce qui est le terme inévitable mais lent à atteindre d'une réparation insuffisante, le travail se détériore et baisse en qualité. Sa rémunération, si réduite qu'elle soit, finit ainsi par équivaloir à la rémunération plus élevée d'un travail de qualité supérieure et même par la [220] dépasser. Le résultat final, c'est une déperdition de forces productives, qui entraîne la décadence de l'industrie.
Où est le remède à ce mal? Est-il comme le supposent les socialistes, dans un changement de la forme des entreprises et de la rétribution du travail? Dans l'association des coopérateurs de la production et dans la substitution des parts de profit aux salaires? En supposant même que cette substitution fût désirable et possible, la situation de l'ouvrier vis-à-vis des autres coopérateurs de la production se trouverait-elle changée? Aussi longtemps que la production du capital personnel dépasserait celle du capital mobilier et immobilier, sa rétribution ne demeurerait-elle pas proportionnellement inférieure? Ce qu'il faut changer ou modifier, ce n'est pas la forme de la rétribution, ce sont les circonstances qui placent l'ouvrier à la merci de l'entrepreneur, ce sont encore et surtout les appétits déréglés et les calculs sordides qui le poussent à se multiplier avec excès. En supposant que l'ouvrier disposât du temps dans la même mesure que le producteur des matières premières ou le propriétaire d'immeubles, il se trouverait vis-à-vis de l'entrepreneur dans une situation analogue à la leur. Le taux de son salaire cesserait de subir l'influence perturbatrice de l'intensité inégale du besoin de vendre et d'acheter, dans un marché particulier et étroit, il se réglerait sur l'état du marché général du travail. Tel serait l'effet du développement d'un régime de publicité et de transport du travail, avec l'auxiliaire du crédit, analogue à celui qui existe pour les capitaux mobiliers. Cependant, même en supposant que le travail fût rendu aussi mobilisable que les capitaux mobiliers, si les appétits et les calculs qui poussent l'ouvrier à se multiplier avec excès continuaient d'agir, le marché universalisé du travail finirait toujours par être encombré et le taux courant du salaire y tomberait au-dessous du taux nécessaire. Le remède serait dans une diminution du profit de l'exploitation du travail des enfants, qui ramenât la puissance des deux mobiles de la création des capitaux personnels au niveau de celle du mobile unique qui détermine la création des capitaux mobiliers et immobiliers.
Mais, à part l'action des causes perturbatrices que nous venons de signaler et auxquelles il peut être remédié par un [221] progrès économique joint à un progrès moral, on voit que la rétribution du travail tend incessamment à être ramenée à son taux nécessaire par l'opération des lois naturelles qui gouvernent la distribution aussi bien que la production de la richesse. Or, qu'est-ce, en dernière analyse, que ce taux nécessaire? C'est le juste prix des services du capital personnel. Au-dessous, il ne peut être suffisamment rétabli et renouvelé; au-dessus, il l'est d'une manière surabondante, et dans les deux cas, le résultat est une déperdition de forces, au détriment de l'intérêt général et permanent de l'espèce.
[222]
CHAPITRE X
La consommation.↩
Objet de la consommation. — La conservation et l'accroissement du capital. — La reconstitution du capital personnel. Comment elle s'opère par le partage entre les besoms actuels, les besoins futurs et le besoin de reproduction. — La reconstitution des capitaux immobiliers et mobiliers. — La consommation nécessaire du propriétaire et du capitaliste.
Les utilités produites ou les valeurs se distribuent entre les coopérateurs de la production, en raison de l'apport des capitaux de chacun aux entreprises, et elles constituent leurs revenus. Les uns apportent les capitaux personnels, forces physiques, intellectuelles et morales, connaissances techniques; les autres, les capitaux mobiliers et immobiliers, matières premières, subsistances, produits fabriqués, terres, bâtiments, outils, machines. Le revenu des uns et des autres se compose, soit d'une part éventuelle dans le produit des entreprises, soit d'une part fixe et assurée. Qu'il s'agisse d'un capital personnel, mobilier ou immobilier, la part éventuelle se nomme profit, ct, dans les entreprises à capital mobilisable, la part éventuelle du capital mobilier et immobilier est désignée sous la dénomination moderne de dividende. La part fixe et plus ou moins assurée, c'est le salaire pour le capital personnel, le loyer ou le fermage pour le capital immobilier, l'intérêt pour le capital mobilier. Toutes ces parts ont une tendance naturelle à l'équivalence, mais il y a entre les parts du capital personnel et du capital immobilier et celle du [223] capital mobilier une différence essentielle, en ce que les premières comprennent la somme nécessaire à la reconstitution du capital, tandis que cette somme n'est pas comprise dans la dernière. Le directeur d'une entreprise qui n'y apporte que son capital personnel, l'employé ou l'ouvrier, le propriétaire d'un immeuble reçoit, sous forme de profit, de salaire, de loyer ou de fermage: 1° la somme nécessaire pour reconstituer son capital avec une part équivalente à celle du capital mobilier, tandis que le profit, le dividende ou l'intérêt d'un capital mobilier ne comprend qu'un seul élément: la somme nécessaire pour couvrir la privation et les risques de son emploi et déterminer son apport à la production.
Tout revenu a sa destination utile, c'est-à-dire conforme à l'intérêt général et permanent de l'espèce humaine. Cet intérêt consiste dans la conservation et l'accroissement du capital, sous les formes et dans les proportions requises par les besoins de la production. Conserver et accroitre les valeurs investies dans le personnel et le matériel de la production, tel est donc le but utile de la consommation, et ce but elle tend incessamment à l'atteindre, sous l'impulsion des mêmes lois naturelles qui gouvernent la production et la distribution de la richesse.
Considérons d'abord la conservation et l'accroissement du capital personnel. Les forces physiques, intellectuelles et morales dans lesquelles ce capital se trouve investi, sont inégalement réparties dans la multitude des individualités humaines. Inégalité et diversité, telle est la loi suivie par la nature dans la distribution de ses dons. Entre l'homme de génie et l'idiot, il existe un énorme intervalle, que l'on peut supposer divisé en une infinité de degrés de capacités productives. Ces capacités constituées par une certaine quantité proportionnelle de forces physiques, intellectuelles et morales sont diverses en même temps qu'inégales. On peut les partager, dans leur diversité, en supérieures, moyennes et inférieures. Chaque catégorie de capacités répond, dans sa spécialité, à une catégorie d'emplois de la production.
Or, la production, dont elles sont les agents nécessaires ne peut se maintenir et s'accroître qu'à la condition qu'elles soient incessamment réparées, renouvelées et accrues. Comment [224] peuvent-elles l'être? Par la reconstitution de leurs forces composantes, impliquant l'assimilation ou la consommation d'éléments conformes à leur nature, en raison de la quantité de force dépensée. Si la réparation n'est pas suffisante, la force se trouve diminuée et, avec elle, la capacité productive, dont elle est un des facteurs. Mais nous avons constaté que toute dépense de force utile est accompagnée d'une souffrance, et toute acquisition d'une jouissance. Cela étant, qu'arrive-t-il? C'est que les forces qui constituent la capacité productive demandent incessamment, sous l'aiguillon de la souffrance et l'appât de la jouissance, les éléments réparateurs dont elles ont besoin, et se font concurrence pour les obtenir. Celles qui ont fait la dépense la plus forte et dont le besoin de réparation est, par conséquent, le plus intense, devancent les autres, et c'est seulement lorsqu'elles ont obtenu un premier apaisement que leur concurrentes peuvent, à leur tour, être satisfaites, dans la mesure de leur dépense et de leur besoin. La consommation nécessaire à la conservation de la capacité productive tend ainsi à se régler d'elle-même par l'opération de la loi naturelle de la concurrence.
Mais la consommation, considérée sous le rapport de la quantité des utilités qu'elle exige, diffère selon la nature et la grandeur des forces dépensées. Si un emploi n'exige qu'une dépense de force physique, il suffira pour réparer et reconstituer cette force, d'une alimentation et d'un entretien purement physiques. Si l'emploi requiert une dépense de forces intellectuelles et morales, la réparation comportera, outre les éléments d'entretien des forces physiques, ceux qui sont nécessaires à la reconstitution des forces intellectuelles et morales. De là, une échelle des rétributions, graduée d'après la nature et la quantité des forces dépensées dans chacun des emplois de la production et des consommations que leur reconstitution exige. Cette échelle naturelle des rétributions a une multitude de degrés correspondant chacun à l'échelon de la consommation nécessaire. Comme nous l'avons remarqué déjà, ces degrés ne sont pas fixes. La substitution de la force mécanique à la force physique dans l'œuvre de la production a pour résultat de modifier la nature du travail de l'ouvrier et, par conséquent, celle des forces qu'il [225] dépense. Tandis que la dépense de 'ses forces physiques diminue, celle de ses forces intellectuelles et morales s'accroît. Sa consommation nécessaire ne comprend plus seulement alors les articles propres à la reconstitution de ses forces physiques, mais encore les produits et les services bien autrement nombreux, variés et raffinés que demande la reconstitution de ses forces intellectuelles et morales. L'étalon de sa consommation nécessaire s'élève sous l'impulsion des progrès de son industrie, et provoque un exhaussement correspondant de sa rétribution.
Cependant, la rétribution du capital personnel ne doit pas seulement pourvoir à la conservation actuelle de ce capital, elle doit encore pourvoir à sa conservation future pendant toute sa durée possible ainsi qu'à son renouvellement. Il faut donc qu'elle se partage entre trois destinations également nécessaires, car si l'une ou l'autre est négligée et ne reçoit pas son contingent de consommation, le capital court le risque d'être détruit ou, tout au moins, diminué. Comment s'opère ce partage?
La même impulsion naturelle, causée par l'aiguillon de la souffrance et l'appât de la jouissance, qui détermine et règle la consommation actuelle en raison de la force dépensée, agit pour déterminer et régler le partage entre la consommation actuelle et la consommation future. C'est sous cette impulsion que l'homme épargne sur celle-là la somme qu'il estime nécessaire à celle-ci. Il évalue les peines que lui causent les privations impliquées dans l'épargne et les compare à celles qu'il éprouverait en s'abstenant de pourvoir aux besoins et aux risques de l'avenir, — risques de maladie, d'accidents, de chômage, déclin naturel de ses forces productives. Sans doute, il peut se tromper dans cette estimation, il peut évaluer trop haut les jouissances actuelles dont la prévoyance lui commande de se priver, trop bas les jouissances futures qu'elle lui permettra d'obtenir ou les peines qu'elle lui donnera les moyens d'éviter, ou bien encore, son calcul sera faussé dans un sens opposé, mais ce calcul déterminera en tous cas, avec plus ou moins d'exactitude, le partage entre la consommation actuelle et la consommation future, nécessité par la conservation du capital personnel.
[226]
Enfin, la même impulsion agit pour assurer le renouvellement du capital personnel par la satisfaction du besoin physico-moral de la reproduction et du sentiment de la paternité. Suivant que ce besoin est plus ou moins intense en comparaison des besoins actuels et futurs de la consommation, il leur enlève une part plus ou moins forte du revenu que le consommateur répartit entre eux. De même qu'il a comparé, au point de vue de la peine et du plaisir, ses besoins actuels avec ses besoins futurs et imposé une privation aux premiers afin d'épargner aux seconds une privation, partant une peine supérieure, il compare les jouissances qu'il tire de la satisfaction de ses besoins individuels, actuels et futurs, à ceux que peut lui procurer l'élève d'une famille et il fait au besoin physico-moral de la reproduction sa part nécessaire, en assurant ainsi, à la fois, la conservation actuelle et future de son capital et le renouvellement de ce capital. Cependant, telle est l'imperfection de la nature humaine que l'impulsion du besoin physico-moral demeure généralement insuffisante pour assurer le renouvellement du capital personnel quand un autre mobile ne vient pas s'y joindre: celui du profit matériel que peut rapporter l'élève d'une famille. Dans les classes inférieures de la population où ces deux mobiles sont associés, la reproduction est non seulement suffisante, mais elle tend même à devenir excessive, tandis que dans les classes supérieures où le mobile physico-moral agit seul, le renouvellement du capital personnel se trouve, au contraire, habituellement en déficit. La population dans laquelle est investi le capital personnel n'en est pas moins incessamment amenée ou ramenée à son contingent nécessaire, c'est-à-dire à un contingent proportionné à la quantité du capital mobilier et immobilier applicable à la production. Lorsque cette proportion est dépassée, lorsque la population se multiplie avec excès, la rétribution du capital personnel baisse dans une progression de plus en plus rapide, tandis que celle des capitaux mobiliers et immobiliers s'élève et attire de préférence l'épargne. Lorsque, au contraire, la population est en déficit, il devient plus profitable d'investir l'épargne sous forme de capital personnel. C'est ainsi que l'équilibre, continuellement troublé par des appétits déréglés, est continuellement rétabli [227] par l'opération des lois naturelles, entre la population et les emplois qui lui fournissent ses moyens de subsistance.
C'est sur l'échelle de la réparation du capital personnel que s'établit celle de sa reconstitution ou de son renouvellement. Le montant de la réparation doit nécessairement être proportionné à la quantité de forces productives investies dans le capital et à la dépense qui en est faite, et il en est de même pour sa reconstitution. Plus le capital s'élève, plus s'élève aussi la somme qu'exige la formation d'un capital équivalent. Or, les enfants héritent communément des facultés et des aptitudes de leurs ascendants, et ils sont destinés à exercer, soit la profession de leur famille, soit une fonction productive d'un rang égal. Il convient donc de leur donner une éducation qui y soit appropriée. Le sentiment de la paternité assure d'habitude, avec l'accomplissement de cette obligation, la reconstitution utile du capital personnel.
Mais ce capital n'est pas le seul qu'il soit nécessaire de conserver et de reconstituer. La même nécessité existe pour les capitaux mobiliers et immobiliers qui constituent le matériel de la production, non moins indispensable que le personnel. Les revenus qui proviennent de leur emploi doivent, en conséquence, être partagés entre deux destinations: une partie doit être consacrée à leur conservation et à leur reconstitution, et une autre partie à celles du capital personnel de leurs détenteurs et employeurs. La nécessité de ce partage est évidente.
Supposons, en effet, que le propriétaire d'un capital immobilier, terres, maisons, bâtiments d'exploitation, machines ou autres immeubles par destination, applique à la satisfaction de ses besoins personnels, la totalité du revenu provenant de ses profits, de ses fermages ou de ses loyers, sans pourvoir à l'entretien et au renouvellement des instruments de production qui lui fournissent ce revenu, il est clair que le capital investi dans ces agents productifs finira par être détruit. Si c'est une terre, elle perdra successivement les matériaux qui constituent sa fécondité, si c'est une maison ou un bâtiment d'exploitation, il tombera en ruines, si c'est une machine, elle finira par s'user et être hors de service. En tout cas, il faudra, au bout d'un temps plus ou moins long, remplacer le [228] bâtiment ou la machine, non sans avoir pourvu aux risques inhérents à ces modes d'investissement du capital, risques de moins-value, de chômage, d'incendie ou de destruction par toute autre cause. S'il s'agit d'un capital mobilier. le capitaliste n'aura point à pourvoir à l'entretien et à la reconstitution de ce capital puisqu'on lui en restitue l'équivalent à l'échéance de l'engagement ou du prêt; mais quel qu'en soit l'emploi, cet emploi comporte des risques. Si ces risques ne sont pas couverts, ils dévorent le capital. On ne peut donc conserver un capital mobilier qu'à la condition de consacrer une partie du revenu que l'on en tire à pourvoir à la couverture des risques, auxquels, en raison de sa nature et de sa fonction particulière, il est plus que tout autre exposé dans la production. Il faut apprécier, aussi exactement que possible, l'importance de ces risques et y proportionner la prime d'assurance, en soustrayant le montant de cette prime à la consommation personnelle.
Cette part défalquée de leur revenu pour assurer la conservation du capital, quelle est la consommation nécessaire du propriétaire et du capitaliste?
Dans tous les emplois de la production, l'étalon de la consommation nécessaire est déterminé par la nature des forces mises en œuvre et la dépense qui en est faite. Or, la gestion d'un capital mobilier ou immobilier, surtout quand il atteint de grandes proportions, exige des facultés intellectuelles et morales, égales ou même supérieures à celles que demandent les emplois les plus élevés du capital personnel, un jugement sûr, une volonté prompte et ferme, la connaissance des hommes, bref, l'ensemble des qualités qui constituent la capacité gouvernante, en même temps qu'une application aux affaires, partant une dépense de forces et de temps, proportionnée à l'importance du capital qu'il s'agit de gérer. Une grande fortune exige une gestion attentive et compliquée. Quand le propriétaire d'un capital investi, soit en terres ou en bâtiments, soit en objets mobiliers, matières premières ou produits fabriqués, en néglige la gestion ou l'abandonne à des subalternes, il est rare que ce capital, grand ou petit, demeure longtemps intact. Il faut donc que le propriétaire foncier ou le capitaliste applique au soin de la conservation de sa [229] fortune, ses facultés gouvernantes, autrement dit qu'il se voue à ce genre de travail pendant un espace de temps déterminé par l'importance de ses capitaux et la nature de l'emploi qu'il en fait. Remarquons, à ce propos, qu'il y a dans le chiffre des fortunes, une limite utile qui est marquée par l'étendue de la capacité gouvernante du propriétaire et la durée du temps qu'il peut consacrer à la gestion de ses capitaux immobiliers ou mobiliers. Quand cette limite se trouve dépassée, quand la fortune excède la capacité et le temps nécessaires à sa bonne gestion, elle subit un déchet inévitable.
Ajoutons toutefois que la gestion des grandes propriétés immobilières ou mobilières, en exigeant l'application continue de la capacité gouvernante, contribue à développer les facultés constitutives de cette sorte de capacité. Ces facultés se transmettent par l'hérédité et il se crée ainsi une aristocratie naturelle, particulièrement propre au gouvernement des grandes entreprises, parmi lesquelles figurent, au premier rang, les états politiques. C'est de la classe des grands propriétaires et des grands capitalistes que sont sortis la plupart des hommes d'état qui se sont distingués par leur aptitude à la gestion des affaires publiques. Mais ici encore apparaît la nécessité de l'intervention de la concurrence. Lorsqu'une aristocratie de propriétaires fonciers ou de capitalistes se constitue comme un corps privilégié, elle tarde rarement à négliger la gestion de ses biens, et malgré les précautions artificielles qu'elle prend pour les conserver, en constituant des majorats ou des substitutions, en se réservant des monopoles industriels ou commerciaux, elle s'appauvrit et tombe en décadence. Alors, une classe inférieure prend sa place. Si ce changement s'opère brusquement, par la dépossession violente de la classe privilégiée, il est à craindre que celle qui la remplace, sans être mûre pour le gouvernement du capital, n'en compromette davantage encore l'existence. Si, au contraire, le changement s'effectue à mesure que la capacité gouvernante se développe dans les régions inférieures de la société, grâce à l'aiguillon et à la sélection de la concurrence, tandis qu'elle diminue dans la région supérieure, sous l'influence énervante du monopole, ce changement s'opère à l'avantage de la communauté, non moins intéressée à la [230] conservation des capitaux immobiliers et mobiliers qu'à celle des capitaux personnels.
En résumé, la consommation a pour but utile la conservation des capitaux personnels, immobiliers et mobiliers. Ce but utile ne peut être atteint que par un partage proportionnel des revenus que leur emploi procure entre leurs besoins de réparation et de reconstitution.
La réparation et la reconstitution du capital personnel s'opèrent par le partage du revenu du consommateur entre la consommation actuelle, la consommation future et la reproduction. Ce partage implique la nécessité d'une épargne, destinée à pourvoir aux besoins du consommateur dans la période d'improductivité ou de moins productivité de son capital personnel et à reconstituer ce capital par la formation d'une nouvelle génération qui continue l'ancienne. Sous quelle impulsion s'opère-t-il? Sous l'impulsion de la demande des besoins en concurrence, besoins actuels, besoins futurs et besoin physico-moral de la reproduction. L'offre des parts du revenu répond à cette demande, en raison de l'intensité comparative des besoins concurrents. La satisfaction des plus intenses déterminant la jouissance la plus vive ou épargnant la peine la plus forte, il y est satisfait d'abord, et c'est seulement lorsqu'ils sont apaisés de manière à procurer une jouissance inférieure à celle de la satisfaction des besoins moins urgents qu'il est pourvu à ceux-ci dans la proportion de leur volume et de leur intensité. Tous les besoins sont ainsi satisfaits dans l'ordre et la mesure nécessaires pour réparer ou reconstituer les forces dépensées. Il peut arriver, sans doute, et il arrive même trop souvent que le revenu demeure insuffisant pour les satisfaire tous dans la mesure des forces dépensées ou bien encore que les besoins soient déréglés, que quelques-uns demandent au-delà de leur part nécessaire; en ce cas, les besoins dont la demande est la moins active restent sans aliment, et les forces dépensées auxquelles ils répondent ne sont point réparées. Mais alors la souffrance causée par l'absence de réparation devient de plus en plus vive et il résulte de cette excitation croissante que ce qu'on pourrait appeler le taux courant de la satisfaction de chaque besoin, partant de la reconstitution de chaque force dépensée, gravite incessamment [231] vers le taux nécessaire à la conservation du capital personnel.
La conservation des capitaux immobiliers et mobiliers implique, de même, le partage du revenu entre les besoins de réparation et de reconstitution de ces capitaux, et les besoins de consommation de ceux qui les possèdent et les emploient à la production. Les uns et les autres sont en concurrence pour demander leurs parts du revenu, et l'on peut constater encore que le taux courant de chacune de ces parts gravite vers leur taux nécessaire. Quand la part de la consommation personnelle du capitaliste empiète sur celle qu'exige la conservation du capital, celui-ci diminue et le revenu diminue avec lui. Alors la demande de conservation devient plus intense et elle agit avec plus d'efficacité pour rétablir la proportion nécessaire du partage. Quand, au contraire, la part faite à la conservation du capital est surabondante et réduit à l'excès la part de la consommation personnelle, les besoins qui provoquent celle-ci réclament avec une vivacité croissante jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur rétribution nécessaire.
Sans doute, les lois naturelles qui gouvernent la consommation, aussi bien que la production et la distribution de la richesse, en la ramenant continuellement au taux nécessaire à la conservation des capitaux personnels, immobiliers et mobiliers, ces lois sont fréquemment troublées dans leur opération régulatrice. Mais ce qui atteste qu'elles agissent, c'est que la somme de ces capitaux va toujours croissant. Cet accroissement, aujourd'hui plus rapide et plus considérable que jamais, est dû certainement pour une forte part à l'augmentation énorme du produit net. résultant des progrès extraordinaires que la production a réalisés depuis un siècle, ainsi qu'au développement de l'épargne et à son application de plus en plus générale et prompte à la production, mais il est dû encore, pour une autre part, au partage utile du revenu entre les besoins de la consommation.
[232]
CHAPITRE XI
La propriété et la liberté. — Accord de l'économie politique avec la morale.↩
Que chaque espèce remplit une fonction nécessaire. — Que la nature assure la conservation et le progrès des espèces au moyen des lois de l'économie des forces et de la concurrence. — Que ces lois sont universelles. — La sphère d'activité des espèces inférieures et celle de l'homme. — Que l'animal ignore les lois naturelles tandis que l'homme peut les connaître et régler sa production et sa consommation de manière à acquérir un maximum de forces vitales en échange d'un minimum de dépense. — Conditions nécessaires pour atteindre ce but. — Le respect de la propriété et de la liberté d'autrui. — L'usage utile de la propriété et de la liberté. — L'accomplissement des devoirs. — Les obstacles à l'accroissement de la production des forces vitales. — Les obstacles provenant du milieu. — Les obstacles provenant de l'homme. — Déperditions de forces causées par les atteintes au droit et le non accomplissement des devoirs. — Le gouvernement de l'homme par lui-même. — Qu'il doit s'accorder avec les lois naturelles. — Objet de l'économie politique. La connaissance des lois naturelles et des phénomènes qui se produisent sous leur impulsion et sous celle des obstacles qui contrarient leur opération. — Objet de la morale. La connaissance du Droit et du Devoir,
Autant que nous en pouvons juger dans l'état actuel de nos connaissances, chaque espèce pourvue de vie remplit une fonction nécessaire qui lui est assignée par la nature. Cette fonction, elle l'accomplit en mettant en œuvre les forces vitales qui lui sont échues en partage, à charge de les entretenir incessamment et de les renouveler par l'assimilation de matériaux qui contiennent des forces de même sorte. Ces matériaux, les êtres vivants doivent les rechercher et se les [233] rendre assimilables, en d'autres termes, les approprier à leur consommation, quand ils n'y sont point naturellement appropriés. Cette recherche et cette appropriation exigent une dépense préalable des forces qu'il s'agit d'entretenir et de renouveler. Plus la force acquise excède la force dépensée, plus l'espèce a de chances de se conserver et de s'accroître dans l'espace et dans le temps, et, par conséquent, mieux est assuré l'accomplissement de la fonction nécessaire qui lui est dévolue.
Comment la nature agit-elle pour assurer ainsi la conservation et le progrès des espèces? Elle agit en mettant en œuvre les lois de l'économie des forces et de la concurrence. Toute dépense de forces utiles, provoquant une souffrance et toute acquisition une jouissance, tous les êtres vivants s'appliquent d'une manière consciente ou inconsciente, à ne dépenser que la somme de forces la plus petite, pour obtenir la plus grande en échange. C'est la loi de l'économie des forces. A l'opération de cette loi pour conserver et augmenter les forces vitales vient se joindre celle de la concurrence. Les matériaux qui contiennent les forces dont l'assimilation est nécessaire à chaque espèce sont limités en quantité; de plus, leur acquisition présente des difficultés et rencontre une résistance impliquant une dépense de forces plus ou moins grande. Les individus qui constituent l'espèce se font concurrence pour les acquérir; lorsque les matériaux assimilables abondent, les individus les moins forts comme les plus vigoureux et les plus aptes peuvent se procurer la subsistance nécessaire, mais il en est autrement à mesure qu'ils se multiplient et que les matériaux assimilables deviennent en comparaison plus rares. Alors les plus forts et les plus aptes, seuls, peuvent s'emparer de toute la quantité de matériaux dont ils ont besoin. Ils subsistent tandis que les plus faibles succombent. Toutefois, avant de succomber, et, à mesure que le péril de la destruction et les souffrances qu'il implique s'accroissent, ils mettent en œuvre toute la force, l'activité et l'intelligence dont ils sont pourvus, pour perfectionner leurs procédés d'acquisition, car il y va pour eux de la vie ou de la mort. Ainsi, la concurrence agit dans chaque espèce à la fois pour déterminer la survivance des plus forts en éliminant [234] les plus faibles, et exciter ceux-ci à accroître leur pouvoir d'acquisition des matériaux de la vie. Le résultat, c'est une augmentation de ce pouvoir qui assure la conservation la plus longue et le développement le plus complet de l'espèce. Quand l'espèce a accompli sa fonction nécessaire, elle décline et périt, soit que le milieu où elle vit se moditie et ne lui fournisse plus les matériaux dont elle a besoin, soit que ces matériaux lui soient enlevés par une espèce concurrente, plus apte à remplir sa fonction.
Ces lois naturelles ont un caractère d'universalité elles régissent la vie des espèces inférieures aussi bien que celle des espèces supérieures, et nous pouvons conjecturer que leur action n'est pas limitée à notre globe. Les végétaux et les animaux comme les hommes obéissent aux lois de l'économie des forces et de la concurrence. Les végétaux portent invariablement leurs brindilles dans la direction où ils trouvent la plus grande quantité de subsistance en échange du moindre effort, et les animaux sont excités de même par l'aiguillon de la souffrance que provoque toute force dépensée et l'appât de la jouissance qui accompagne toute force acquise, à employer les procédés les plus économiques pour l'acquisition de leur subsistance: les herbivores choisissent de préférence les pâturages les plus gras, les carnivores, les localités les plus abondantes en gibier, et ce gibier, les plus intelligents lui tendent des pièges pour s'en emparer avec une moindre dépense de force et de peine. Certaines espèces pratiquent, sous l'impulsion de la même loi, l'association, la division du travail et même l'épargne. La loi de la concurrence se joint à la loi de l'économie des forces, pour assurer la conservation et le progrès des espèces. La puissance de reproduction de chaque espèce est surabondante, et il est nécessaire qu'il en soit ainsi, tant pour la préserver de la destruction par les espèces ennemies et les maladies épidémiques, que pour l'empêcher de dégénérer par la reproduction des germes les plus faibles. Les individus produits en nombre surabondant se font concurrence: les plus forts, les plus capables de conserver l'espèce seuls réussissent à se procurer une alimentation suffisante et à échapper à leurs ennemis. Ils se font encore concurrence pour transmettre leurs qualités à leurs [235] descendants: les plus forts ou les plus beaux l'emportent sur leurs rivaux. La sélection naturelle et la sélection sexuelle produites par cette double concurrence sont les agents de la conservation et du progrès de l'espèce. Cependant ce progrès est-il sans limites? Peut-il aller jusqu'à opérer la transmutation des espèces végétales et animales par une sorte d'alchimie analogue à celle qui prétendait opérer la transmutation des espèces minérales? Voilà ce qui demeure encore obscur, quoiqu'il semble probable que chaque espèce animale ou végétale comme chaque espèce minérale, ait une nature et des propriétés conformes à sa destination et qu'elle ne puisse les changer. Ce qui semblerait l'attester, c'est que l'hybridation et le métissage sont frappés de stérilité.
Suivant la destination assignée aux espèces, la sève vitale s'y répand et y monte dans des organismes plus compliqués et plus parfaits, adaptés à une tâche plus étendue et plus haute. Les espèces inférieures n'ont à accomplir qu'un petit nombre d'actes différents pour entretenir et perpétuer leur existence: elles doivent se nourrir, se reproduire, se défendre contre les espèces ennemies ou se dérober à leur poursuite, chercher et parfois façonner un gîte pour s'abriter et élever leur progéniture. Leurs progrès sont limités autant par les objets de leur activité que par la nature des forces et des instruments dont elles disposent. La sphère d'activité de l'espèce humaine est bien autrement étendue: d'abord la conservation da sa vie physique exige des opérations plus nombreuses et variées que celle d'aucune espèce inférieure: aux besoins de l'alimentation, de la reproduction, de la défense, du logement, se joignent ceux du vêtement; ensuite, au moins dans les variétés moyennes et supérieures, les besoins de la vie intellectuelle et morale, besoins sinon illimités, du moins indéfiniment extensibles, s'ajoutent à ceux de la vie physique. Pour satisfaire à ces divers besoins, l'homme possède une intelligence progressive, desservie par des organes que la nature y a adaptés. En la mettant en œuvre, il découvre les matériaux qui lui sont nécessaires, invente les outils, les machines, les procédés propres à façonner ces matériaux; il associe et combine ses forces, divise son travail, perfectionne son industrie et réussit à pourvoir, d'une manière de plus en plus complète, [236] à l'ensemble des besoins de conservation et de développement de sa vie physique, intellectuelle et morale.
Cette œuvre, l'espèce humaine l'accomplit, comme les espèces inférieures, sous l'impulsion des lois de l'économie des forces et de la concurrence, auxquelles se joint dans l'opération de l'échange, la loi de progression des valeurs. Mais avec cette différence que l'homme peut connaître ces lois, prévoir et calculer leurs effets, et régler en conséquence sa production et sa consommation, tandis que les espèces inférieures les ignorent. Supposons qu'il possède complètement cette connaissance avec la puissance d'agir de manière à produire toujours un maximum de forces en échange d'un minimum de dépense, l'espèce humaine arrivera au summum de progrès que les pouvoirs qui sont en elle et dans le milieu où elle est placée lui permettent d'atteindre.
Tel est le but auquel l'espèce humaine doit s'efforcer sinon d'arriver du moins de s'approcher, et en vue duquel elle doit diriger et régler sa conduite et ses actes. Si elle consistait en un seul être dont l'existence pourrait se prolonger et s'étendre indéfiniment dans le temps et l'espace, ce serait la direction et la règle que son intérêt lui commanderait de s'imposer, car en les suivant elle acquerrait un maximum de forces vitales et de jouissances en échange d'un minimum de dépense et de peine. Mais une espèce se composant d'un nombre illimité d'individus successifs, c'est la direction et la règle qui doivent être imposées à chacun ou que chacun doit librement s'imposer.
Tous les actes des individus sont compris dans ces deux catégories économiques: production et consommation. Comment donc l'individu doit-il gouverner sa production et sa consommation pour se conformer à l'intérêt général et permanent de son espèce?
La première règle que l'individu doit s'imposer dans l'emploi des forces dont il dispose, sous forme de valeurs personnelles, immobilières et mobilières, c'est de ne point contrarier l'opération des lois naturelles, soit en affaiblissant le mobile qui pousse chacun à mettre en œuvre ses forces pour les réparer et les accroître, soit en empêchant ceux qui produisent la plus grande somme de forces en échange de la moindre [237] dépense d'entrer en concurrence avec ceux dont la production est moins économique. Comment cette règle nécessaire peut-elle être établie? Par la reconnaissance de la sphère naturelle de l'activité de chacun, et l'obligation de n'en point franchir les limites. Que contient cette sphère d'activité naturelle? Elle contient les valeurs que chacun a investies dans sa personne et dans le milieu où il vit. Ces valeurs sont sa propriété puisqu'elles représentent des forces qu'il a dépensées: il les produit et les consomme pour satisfaire à ses besoins; mais chez l'homme sinon chez les espèces inférieures, cette satisfaction n'est point fatale et aveugle: l'homme a le pouvoir de dominer et de régler les impulsions de ses besoins, ce pouvoir constitue sa liberté. La sphere d'activité de chacun contient donc sa propriété et sa liberté, elle a ses limites naturelles qui sont marquées par la propriété et la liberté d'autrui. Or, ces limites, on peut les dépasser de deux manières: en s'emparant de la propriété d'autrui, en diminuant ou en supprimant sa liberté. Mais, dans ces deux cas, on entrave l'opération utile des lois naturelles. En portant atteinte à la propriété et à la liberté d'un individu ou d'une collection d'individus, on affaiblit la puissance du mobile qui l'excite à agir pour réparer et augmenter ses forces vitales et par conséquent celles de l'espèce. En effet, si en dépensant les forces et en s'infligeant la peine qu'implique toute production, on n'est pas assuré de recueillir le produit et la jouissance qu'il représente, si ce produit et cette jouissance sont attribués à d'autres, on ne produira point, ou on produira moins, et d'autant moins qu'on courra davantage le risque d'être frustré, en tout ou en partie, du fruit de ses efforts. Le mobile qui excite à mettre en œuvre les forces dont on dispose sera affaibli de même si l'on n'est pas libre d'exercer l'industrie la plus profitable (celle dans laquelle on peut obtenir la plus grande quantité de forces, en échange de la moindre dépense), si l'on est empêché d'employer les procédés les plus économiques, et d'utiliser à son gré les fruits de ses efforts, de les échanger, de les prêter, de les léguer, etc., etc. Ces diverses atteintes portées à la propriété et à la liberté de l'individu ont pour effet inévitable et, en quelque sorte, mécanique, de ralentir l'opération de la loi de l'économie des forces, et de diminuer [238] ainsi la somme des forces vitales qu'elle excite à produire. Elles contrarient, par une conséquence naturelle, l'opération utile de la concurrence. Si les plus capables sont découragés de produire, ou empêchés d'employer leurs forces productives de la manière la plus économique, leur concurrence sera moins efficace qu'elle n'aurait pu l'être, et le résultat sera une diminution ou un moindre accroissement des forces de l'espèce.
Les lois naturelles de l'économie des forces et de la concurrence n'agissent donc avec toute leur énergie pour déterminer la production d'un maximum de forces vitales en échange d'un minimum de dépense, et procurer ainsi à l'espèce la chance la plus élevée de durée et de progrès, qu'à une première condition; c'est qu'aucune atteinte ne soit portée à la propriété et à la liberté de chacun des individus successifs qui composent l'espèce. La propriété et la liberté de l'individu, dans leurs limites naturelles, constituent son droit. Le respect du droit d'autrui est donc la première règle que l'individu doit s'imposer ou qui doit lui être imposée dans l'intérêt de l'espèce.
Mais il ne suffit pas de respecter le droit d'autrui, il faut encore faire de sa propriété et de sa liberté l'usage le plus conforme à l'intérêt de l'espèce et gouverner en vue de ce but, sa production et sa consommation. Ce gouvernement utile implique l'accomplissement d'une série d'obligations ou de devoirs envers soi-même et envers autrui.
En quoi consistent ces obligations? La première consiste à mettre en œuvre toutes les forces dont on dispose de manière à produire la plus grande somme de forces vitales, en échange de la moindre dépense. Si chacun remplissait pleinement cette obligation, le résultat serait pour l'espèce l'acquisition d'un maximum de forces en échange d'un minimum de dépense. A cette première obligation qui concerne la production des forces vitales, s'en joint une série d'autres qui concernent l'emploi de ces mêmes forces. Elles doivent être employées de la manière la plus utile, c'est-à-dire de manière à conserver et accroître, au maximum, la vitalité de l'espèce. Cet emploi utile implique le partage des forces acquises entre des obligations diverses, les unes envers soi-même, les autres en dehors de soi. Les [239] obligations envers soi-même, consistent dans la satisfaction utile des besoins actuels et futurs. L'individu doit employer les produits de son industrie à réparer les forces qu'il dépense dans la mesure de cette dépense et épargner le surplus pour subvenir à ses besoins futurs, dans la période où les maladies, les accidents et la vieillesse paralysent ou affaiblissent ses forces productives. Il doit encore employer une portion de ses forces acquises à produire, dans la proportion utile, la génération qui remplace la sienne, assister ses parents s'ils n'ont pas pourvu eux-mêmes à l'entretien de leur vieillesse. A ces devoirs envers soi-même et envers les siens se joignent d'autres devoirs envers ses semblables: en premier lieu il doit respecter la propriété et la liberté d'autrui. C'est un devoir purement passif en ce qu'il n'implique aucune dépense, aucun sacrifice, mais une simple abstention d'empiéter sur le droit d'autrui. A ce devoir passif s'ajoutent des devoirs actifs: devoir de contribuer à la conservation et au progrès de la société politique et des autres sociétés particulières dont l'individu est membre, devoir de charité ou d'assistance envers la généralité de ses semblables, pratiqué de manière à ne point affaiblir les mobiles qui les excitent à déployer leur activité. On peut signaler encore les devoirs de l'homme envers les espèces inférieures: devoir d'en user seulement dans la mesure de ses besoins, en s'abstenant de leur causer des déperditions de forces et des souffrances inutiles; enfin les devoirs religieux. Ceux-ci n'ont pas sans doute une utilité directe et vérifiable au moyen du critérium de l'intérêt de l'espèce, mais ils contribuent à l'accomplissement de tous les autres, en développant les forces morales qui servent à les accomplir.
En supposant que tous les individus dont les générations successives constituent l'espèce, usent de leur propriété et de leur liberté dans les limites de leur droit et remplissent exactement tous leur devoirs, quel serait le résultat? Ce serait la production de la plus grande quantité de forces vitales en échange de la moindre dépense, et ce résultat serait conforme à l'intérêt général et permanent de l'espèce.
Mais pour que cette hypothèse devînt une réalité, il faudrait que tous les hommes eussent la connaissance des lois [240] naturelles qui gouvernent leur activité, et qu'ils possédassent la capacité et la volonté de s'y conformer. Or, cette connaissance, cette capacité, et cette volonté, ils ne les possèdent qu'à un faible degré et en doses inégales; ils ne les ont acquises qu'à la longue par l'expérience des maux, — déperdition de forces et souffrances — qui résultent de leur incapacité et de leur impuissance à agir toujours de manière à obtenir la plus grande quantité de forces vitales en échange de la moindre dépense. Les obstacles qu'ils rencontrent pour atteindre ce but résident dans le milieu où ils vivent et surtout en eux-mêmes.
§ 1er. Les obstacles provenant du milieu. — En supposant que le globe, échu en partage à l'humanité, fût librement accessible et exploitable dans toutes ses parties, et que l'homme possédât la science et la puissance nécessaires pour maîtriser les agents et les éléments contenus dans ce milieu, qu'il pût régler toujours sa production conformément à ses besoins et à ses moyens de les satisfaire, il obtiendrait, toujours aussi, la plus grande somme de forces en échange de la moindre dépense, — cette somme allant d'ailleurs croissant avec les progrès de son industrie. Mais les hommes, disséminés sur la surface du globe, étaient séparés par l'obstacle des distances demeuré longtemps infranchissable et obligés d'associer leurs forces et de concentrer leur production dans un rayon étroit. — Ce n'est qu'à la longue qu'ils ont pu entamer l'obstacle des distances, choisir les localités les plus favorables à l'exercise de leurs industries, celles où ils peuvent produire au meilleur marché, c'est-à-dire de la manière la plus conforme à la loi de l'économie des forces, et échanger les fruits de cette production économique contre d'autres produits obtenus dans des conditions analogues. De plus, dans le cercle resserré où se concentrait leur activité, la concurrence ne pouvait agir avec toute son énergie: chaque branche d'industrie ne possédant qu'un débouché étroit ne comportait qu'un nombre restreint d'entreprises et par conséquent qu'une concurrence limitée, à laquelle un accord ou une fusion entre les entreprises concurrentes finissait communément par mettre fin. Cessant alors d'être nécessaire, le progrès ne s'opérait plus [241] qu'avec une extrême lenteur, sous l'inpulsion unique de la loi de l'économie des forces. Enfin, les principales industries, notamment celles qui avaient pour objet la production des denrées alimentaires, se trouvaient à la merci des circonstances climatériques et ne pouvaient ajuster leurs rendements aux besoins de la consommation.
Cependant, ces obstacles, les lois mêmes dont ils entravaient l'opération, ont agi incessamment pour les aplanir: l'obstacle des distances a été successivement entamé sous l'impulsion des lois de l'économie des forces et de la concurrence. Cette impulsion a poussé les hommes à découvrir et à mettre en exploitation les régions où ils pouvaient produire et satisfaire leurs besoins plus amplement et à meilleur marché. L'extension des débouchés qui a été la conséquence de cet agrandissement de l'aire de la production a permis à la concurrence de se déployer et d'agir avec plus d'efficacité. D'un autre côté, l'impulsion des mêmes lois, en déterminant le progrès continu des instruments et des procédés de toutes les industries, a fourni les moyens de combattre sinon de maîtriser entièrement les causes perturbatrices du milieu et de régler d'une manière de plus en plus exacte la production sur les besoins de la consommation.
§ 2. Les obstacles provenant de l'homme. — Mais c'est dans l'homme surtout qu'ont résidé, dès l'origine, les obstacles à l'opération utile des lois naturelles qui agissent pour assurer la conservation des forces vitales de l'espèce et en déterminer l'accroissement. Ces obstacles, causés par son ignorance et son imperfection naturelles, se manifestent à la fois dans la production, la distribution et la consommation des forces vitales.
L'homme est excité par l'aiguillon de la souffrance et l'appât de la jouissance à se procurer les choses nécessaires à la satisfaction de ses besoins, mais ces choses, il peut les acquérir de deux manières: en les produisant lui-même ou en faisant main basse sur les produits du travail d'autrui.
Si les hommes n'avaient, de tout temps, employé que le premier procédé, le résultat eût été, pour la généralité, l'acquisition d'un maximum de forces vitales en échange d'un [242] minimum de dépense. Mais l'emploi exclusif de ce procédé était subordonné à deux conditions: 1° la connaissance précise des limites de la propriété et de la liberté de chacun; 2° la volonté de ne pas empiéter sur la propriété et la liberté d'autrui. Or, l'homme est naturellement ignorant et imparfait: il n'apprend que par l'observation et l'expérience à connaître les limites de sa propriété et de sa liberté, et il est, naturellement aussi, excité à les franchir chaque fois qu'en les franchissant il croit obtenir une jouissance supérieure à celle qu'il obtiendrait, ou subir une peine moindre que celle qu'il subirait en ne les dépassant point. Comme la plante ou l'animal, il obéit à l'impulsion mécanique de la loi de l'économie des forces, en premier lieu jusqu'à ce qu'il ait compris qu'en portant atteinte à la propriété et à la liberté de ses semblables, il diminue chez eux l'énergie impulsive de cette loi et leur cause un dommage auquel il s'expose lui-même, en second lieu, jusqu'à ce qu'il ait acquis la force morale nécessaire pour résister à cette impulsion contraire à l'intérêt général et permanent de son espèce.
Qu'en portant atteinte à la propriété et à la liberté de ses semblables, l'homme affaiblisse chez eux l'énergie du mobile qui les excite à produire, cela ressort suffisamment de l'analyse que nous avons faite de ce mobile. Quel est l'objectif que l'homme a en vue, en s'imposant la peine qu'implique toute dépense de force et toute production? c'est d'obtenir une jouissance, supérieure à cette peine. S'il n'est pas assuré de recueillir cette jouissance, s'il court le risque d'en être frustré par autrui, il sera moins encouragé à se donner la peine nécessaire pour l'acquérir, et d'autant moins que le risque qu'il court d'en être dépossédé sera plus grand. Une portion plus ou moins considérable des forces utilisables n'est donc pas employée ou l'est moins activement sous l'influence du risque créé par le procédé du « vol »: ce sont autant de forces perdues. Ce même procédé occasionne une autre perte de forces, par les conflits qu'il suscite entre ceux qui défendent leur propriété et leur liberté et ceux qui les attaquent. Ces conflits seraient incessants si les hommes ne respectaient point dans quelque mesure la propriété et la liberté de chacun. Aucune association, aucune combinaison de forces, [243] aucune division du travail, aucun échange, partant aucun progrès ne seraient alors possibles. C'est pourquoi dès que les hommes ont senti le besoin d'associer et de combiner leurs forces, ils ont construit, d'une façon plus ou moins grossière, un appareil de gouvernement, destiné à reconnaître les limites de la propriété et de la liberté de chacun des membres de leurs associations, et à les faire respecter. Cet appareil d'abord rudimentaire, s'est perfectionné à la longue tout en demeurant insuffisant pour empêcher complètement les hommes d'empiéter sur la propriété et la liberté les uns des autres, et en enlevant à la production une masse de forces utilisables. Mais si imparfait et coûteux qu'il soit, il épargne aux Sociétés une perte supérieure à celle qu'il leur cause. N'en déplaise aux anarchistes, il ne deviendrait inutile que le jour où les hommes connaîtraient les limites naturelles de leur propriété et de leur liberté, et posséderaient avec la volonté de ne point les dépasser, la force nécessaire pour contenir les impulsions déréglées qui les poussent à attenter à la propriété et à la liberté d'autrui.
La même ignorance et la même incapacité qui ralentissent et amoindrissent la production, en déterminant une énorme et constante déperdition de forces, vicient la distribution et la consommation des forces produites. L'effet naturel de tout empiétement sur la propriété et la liberté d'un individu, c'est de diminuer sa part légitime et nécessaire des forces acquises, et par là même de vicier la consommation, les uns obtenant plus que n'exige la réparation de leurs forces dépensées, les autres moins. A cette cause de perturbation s'en joint une autre, savoir l'incapacité de répartir utilement entre les besoins, les matériaux de la consommation. Si cette répartition est viciée par l'excroissance maladive de certains besoins ou par le défaut de prévoyance, si l'individu accorde une satisfaction excessive à ses besoins actuels sans se préoccuper de ses besoins futurs, s'il satisfait de même sans prévoyance le besoin qui le pousse à se reproduire, le résultat sera encore une déperdition de forces au détriment de l'espèce.
En résumé, l'espèce humaine, comme les espèces inférieures, est gouvernée par des lois naturelles, qui assurent sa conversation et ses progrès, en l'excitant à économiser ses [244] forces, et en donnant la survivance aux plus forts et aux plus capables, c'est-à-dire à ceux qui ont le mieux obéi à la loi de l'économie des forces. Mais, avec cette différence que les espèces inférieures, végétales ou animales, ne peuvent connaître les lois qui gouvernent leur existence, et ne peuvent intervenir que dans une faible mesure dans leur opération: végétaux et animaux naissent, se reproduisent et meurent sous l'empire des lois de l'économie des forces et de la concurrence, qui protègent l'existence de leur espèce, mais en leur faisant acheter cette protection au prix d'une déperdition continue de forces accompagnée de souffrances. L'homme, au contraire, peut reconnaître ces lois, et se gouverner de manière à n'en ressentir que les effets bienfaisants. Il peut proportionner sa population à ses moyens de subsistance et régler de même sa production et sa consommation des choses nécessaires à l'entretien de son existence, en évitant les déperditions et les souffrances que la nature inflige aux espèces inférieures.
Cependant, ce gouvernement de l'homme par lui-même ne peut être utile qu'à la condition de s'accorder avec celui de la nature et de lui servir d'auxiliaire. S'il contrarie ou paralyse l'opération des lois naturelles, il a pour effet inévitable d'enrayer les progrès de l'espèce, en affaiblissant l'impulsion qui les détermine. Laisser agir ces lois, sans diminuer leur énergie, aplanir les obstacles qui entravent leur opération, régler la conduite de chacun en vue de l'objectif de conservation et de progrès que la nature assigne à l'espèce, tel est le but de la science du gouvernement de l'homme par lui-même. Cette science comprend, en premier lieu, la connaissance des lois naturelles et de leur opération dans la production, la distribution et la consommation des forces vitales, en second lieu, la connaissance et la délimitation de la sphère d'activité naturelle de chacun des individus dont la collection et la succession constituent l'espèce, et des objets nécessaires de cette activité. Ces deux branches maîtresses de la science du gouvernement de l'homme par lui-même sont l'économie politique et la morale, celle-ci partagée à son tour en deux branches: la connaissance du Droit et celle du Devoir.
Ainsi donc, l'objet de l'économie politique, c'est d'abord la [245] connaissance des lois qui gouvernent la production, la distribution et la consommation des forces vitales ou des valeurs investies dans les produits et les services nécessaires à la conservation et au progrès de l'espèce humaine; c'est ensuite la connaissance des phénomènes qui se produisent sous l'impulsion de ces lois, association et combinaison des forces, division du travail, échange, crédit, circulation, etc.; c'est enfin la connaissance des nuisances causées par les obstacles que l'imperfection de l'homme et du milieu opposent à l'opération utile des lois naturelles et qui se manifestent par des déperditions de forces et de souffrances infligées à l'espèce; c'est, en d'autres termes, la connaissance de ce qui est conforme à l'intérêt général et permanent de l'espèce et de ce qui est contraire à cet intérêt, en un mot, la connaissance de l'Utile. Tel est l'objet et telles sont les limites de l'économie politique.
L'objet de la morale, c'est, en premier lieu, la connaissance de la sphère naturelle d'activité de chacun des individus successifs qui composent l'espèce. Cette sphère d'activité est limitée par celle d'autrui. Elle contient les forces vitales ou les valeurs que chacun a créées ou acquises, et qui constituent sa propriété. Cette propriété, selon les objets dans lesquels sont investies les valeurs auxquelles elle s'applique, se partage en trois catégories: personnelle, immobilière et mobilière. Chacun est libre d'en user à sa guise à la condition de ne pas empiéter sur la liberté d'autrui. La connaissance de la propriété et de la liberté, dans leurs limites naturelles est l'objet de cette partie de la science de la morale qui est désignée sous le nom de Droit. En second lieu, la morale concerne l'usage que chacun doit faire de sa propriété et de sa liberté, dans les limites de son droit. Cette seconde partie de la morale, comprend la connaissance de la série des obligations envers soi-même et envers autrui, et de la mesure dans laquelle chacun doit les remplir pour se conformer à l'intérêt général et permanent de l'espèce, et contribuer ainsi à la fin qui lui est assignée. C'est la connaissance du Devoir. Considérée dans ses deux branches, la morale est la science de ce qui appartient à chacun et de ce que chacun doit à soi-même et à autrui, en un mot, c'est la science de la justice.
[246]
L'économie politique et la morale s'accordent en ce que rien n'est utile que ce qui est juste. D'où cette conséquence que la règle utile des actions humaines c'est la justice, et que l'homme n'arrive aux fins de l'économie politique que par la pratique et la morale.
[247]
CHAPITRE XII
L'organisation naturelle des sociétés. — Les lois positives et les lois naturelles.↩
Que les sociétés primitives se sont constituces sous l'impulsion des lois naturelles de l'économie des forces et de la concurrence. — Necessité des coutumes et des lois positives. — Les coutumes et les lois politiques ont pour objet la constitution du gouvernement de la société. — Les coutumes et les lois morales et économiques règlent la conduite utile de ses membres. — Comment se constitue le gouvernement et se règlent ses rapports avec les membres de la société. — Comment s'établissent les règles du droit et du devoir. — La tutelle. — Les sanctions des règles établies. — L'opinion. — Les lois pénales. — La sanction religieuse. — Que les lois positives sont plus ou moins utiles selon qu'elles se rapprochent ou s'écartent de la loi naturelle de l'économie des forces, et qu'elles progressent sous l'impulsion de la concurrence.
L'étude des lois naturelles fournit l'explication des phénomènes de la constitution des sociétés et de leur civilisation progressive; elle donne, en même temps, la raison des lois et coutumes de diverses sortes, politiques, morales, économiques, auxquelles elles se sont soumises. Les hommes ont formé leurs sociétés sous l'impulsion des lois de l'économie des forces et de la concurrence. Comme les espèces inférieures végétales et animales, l'espèce humaine avait à pourvoir à deux besoins de première nécessité: celui de se défendre contre la concurrence des autres espèces, et celui de subvenir à sa subsistance. Or, l'observation et l'expérience ne devaient pas tarder à démontrer aux hommes, comme [248] elles l'avaient démontré au plus grand nombre des espèces inférieures qu'en s'associant, ils pouvaient pourvoir à leur sécurité d'une manière plus efficace et en échange d'une moindre dépense de force qu'en demeurant isolés; elles leur enseignaient ensuite que la division du travail leur procurait une autre économie dans la satisfaction de la généralité de leurs besoins. De là, le phénomène de la constitution des sociétés primitives. Comme nous l'avons remarqué ailleurs, le nombre des associés et l'étendue du territoire qu'ils occupaient étaient déterminés par la nature des industries auxquelles ils demandaient leurs moyens d'existence. Un troupeau ou une tribu de chasseurs ne pouvait dépasser un petit nombre d'individus et il avait besoin d'occuper un territoire relativement fort étendu. La mise en culture des plantes alimentaires modifia profondément cet état de choses, en permettant à un millier d'individus de tirer une subsistance suffisante et mieux assurée d'un territoire où la chasse et la récolte des fruits naturels du sol ne nourrissaient auparavant qu'un petit groupe de sauvages faméliques. Mais que ces sociétés se composassent d'un petit nombre d'individus ou d'un grand nombre, elles ne pouvaient subsister qu'à la condition que leurs membres s'assujettissent eux-mêmes ou fussent assujettis à des coutumes ou à des lois, ayant pour objet d'assurer l'existence et l'accroissement de leur association, en nombre et en puissance. Et cette nécessité était d'autant plus manifeste qu'ils étaient exposés davantage à la concurrence des autres espèces animales ou des autres autres sociétés humaines. Aucune des innombrables sociétés qui se sont formées parmi les hommes depuis la naissance de l'espèce n'a existé et n'existe sans coutumes ou sans lois. Ces coutumes et ces lois, soit qu'on les observe chez les tribus qui apparaissent aujourd'hui comme des débris du monde primitif ou des restes dégénérés de civilisations détruites, ou chez les nations en voie de civilisation, se diversifient selon les objets auxquelles elles s'appliquent et les besoins auxquels elles pourvoient. Les coutumes et les lois politiques et religieuses sont d'abord unies et elles ont pour objet la constitution de l'organisme dirigeant de l'association et le développement de sa puissance, les lois morales et économiques sanctionnées par le pouvoir [249] civil et religieux, sinon toujours émanées de lui, déterminent les règles de conduite envers eux-mêmes et envers autrui, que les membres de l'association doivent suivre pour la conserver et la faire prospérer, partant pour se conserver et prospérer eux-mêmes. N'oublions pas qu'à l'origine, du moins, leur existence était indissolublement liée à la sienne, chaque société se constituant isolément et se trouvant exposée incessamment à la concurrence des autres espèces et des autres sociétés, concurrence qui, dans cet état primitif, se manifestait exclusivement par la guerre, et avait pour conséquence la destruction ou l'asservissement des vaincus. Les coutumes et les lois qui avaient pour objet la constitution du pouvoir dirigeant de l'association apparaissaient d'abord comme les plus nécessaires. De quoi s'agissait-il en effet? Il s'agissait, avant tout, de mettre les membres de l'association à l'abri du péril de destruction et d'asservissement dont les menaçait la concurrence des autres espèces et des autres sociétés, et ce but essentiel ne pouvait être atteint que par la création d'un organisme spécial qui associât et combinât toutes les forces individuelles de manière à en obtenir un maximum d'effet utile en échange d'un minimum de dépense. Il était encore nécessaire, pour obtenir ce résultat, que cet organisme de gouvernement fût dirigé par les plus forts et les plus capables, et desservi par une hiérarchie, constituée de telle sorte que la série des fonctions qu'il comportait fût occupée par une série correspondante d'aptitudes et de capacités.
L'organisation politique et la hiérarchie se constituèrent, selon toute apparence, par les preuves que chacun des membres des sociétés naissantes donnait de ses forces et de ses capacités: l'individu qui l'emportait sur tous ses compagnons dans les luttes contre les animaux et les hommes était choisi pour commander les expéditions de chasse ou de guerre; il choisissait à son tour ses auxiliaires d'après le degré de capacité que l'observation et l'expérience lui avaient fait reconnaître: la permanence des luttes déterminait celle de l'organisation qu'elles avaient nécessitée. Enfin l'observation et l'expérience attestant, d'une part, que les aptitudes physiques et morales se transmettent généralement par l'hérédité, et d'une autre part, que l'hérédité épargne les conflits pour la [250] possession du pouvoir et les déperditions de forces qui en sont les conséquences, les fonctions de la hiérarchie devinrent héréditaires. Ainsi constitué, l'organisme politique pouvait produire le maximum d'effet utile en échange de la moindre dépense de force. Mais il ne suffisait pas de le constituer, il fallait encore régler ses rapports avec la généralité des membres de l'association, et tel fut l'objet des lois et des coutumes qui définirent les droits et les devoirs respectifs du pouvoir dirigeant et des individus soumis à ce pouvoir. Si nous interrogeons l'histoire, nous trouverons qu'à l'origine, les droits du pouvoir dirigeant sur les membres de la société étaient pour ainsi dire illimités, et si nous nous rendons compte de la situation des sociétés à leur naissance et pendant la longue période d'enfantement de la civilisation, nous reconnaîtrons que cela était nécessaire. Chaque société, tribu ou nation, se trouvait dans la situation où serait aujourd'hui un établissement d'émigrants au milieu d'une contrée inexplorée, et en butte aux attaques incessantes de hordes de pillards et d'anthropophages. Il est clair que l'intérêt de la défense commune devrait prévaloir sur tous les intérêts individuels, et qu'il serait nécessaire que le chef et l'état-major chargés de cette défense eussent un droit absolu de réquisition sur la vie, le travail et les biens de chacun des membres de la société. Toutefois, il est clair aussi que ce droit devrait s'exercer seulement pour ce qui se rapporterait à la protection contre le péril extérieur: et de manière à proportionner les sacrifices imposés à chacun aux forces et aux ressources dont il pourrait disposer. Des lois ou des coutumes s'établiraient, en conséquence, pour empêcher les chefs, chargés de la défense commune, d'abuser de leur pouvoir sans cependant l'affaiblir.
En poursuivant cette analyse de l'organisation naturelle des sociétés, nous trouvons encore que l'intérêt de tonte société n'exige pas seulement que ses membres contribuent, dans la mesure de leurs moyens, à sa défense et à l'accroissement de sa puissance, mais qu'il exige, de plus, qu'ils puissent user de leurs forces et de leurs ressources dans les limites de leur sphère naturelle d'activité, et qu'ils remplissent envers eux-mêmes et envers autrui une série de devoirs nécessaires à la conservation et au développement des forces de chacun. De [251] là, la nécessité de définir les droits et les devoirs individuels, d'en fixer les limites, d'en graduer l'importance d'après le critérium de l'intérêt commun, de réprimer ou de prévenir la violation des uns et d'assurer l'accomplissement des autres. Tel est l'objet des règles, coutumes ou lois, morales et économiques. C'est encore l'observation et l'expérience qui les font reconnaître et en déterminent l'adoption. L'observation reconnaît les limites de la propriété et de la liberté de chacun, l'expérience démontre les nuisances qui résultent de leur violation: affaiblissement du mobile qui pousse les hommes à utiliser leurs forces et leurs ressources avec un maximum d'énergie, déperdition causée par les conflits que suscitent les empiètements sur les droits d'autrui. Avec les droits, l'observation et l'expérience reconnaissent les devoirs de chacun envers soi-même et envers autrui, et démontrent la nécessité de leur accomplissement dans l'intérêt commun: devoir d'employer à la production les forces et les ressources dont on dispose, devoir de répartir les résultats de sa production entre ses besoins actuels et ses besoins futurs, devoir d'appeler à l'existence dans la proportion utile la génération destinée à remplacer la sienne, de l'élever, de l'éduquer et de pourvoir à son entretien jusqu'à ce qu'elle soit en état d'y pourvoir elle-même, devoir d'assister les faibles et les nécessiteux, pratiqué de manière à suppléer aux forces qu'un accident, un revers, une maladie leur a fait perdre, et à leur donner les moyens de les récupérer, sans affaiblir le mobile de leur activité, etc., etc. Mais ces règles, dont le sentiment de l'intérêt commun provoque l'établissement, sous forme de lois ou de coutumes, et qui atteignent plus ou moins exactement leur objet, selon que les effets des actes individuels ont été bien ou mal observés, selon, surtout, que les observateurs ont su discerner ou non les effets immédiats des effets ultérieurs, enfin qu'ils ont eu en vue, en les appréciant, l'intérêt général et permanent de la communauté plutôt qu'un intérêt temporaire de classe ou de personnes, ces règles, tous les membres de l'association ne possèdent pas la capacité intellectuelle et morale nécessaire pour les suivre. L'intérêt commun exige donc qu'il soit établi entre eux des catégories: que ceux qui sont capables d'observer les règles établies [252] prennent sous leur direction et leur tutelle ceux qui en sont incapables, et, au besoin, les leur imposent dans la mesure et avec les procédés nécessaires; que d'autres règles interviennent pour fixer les conditions utiles de cette tutelle, les droits et devoirs respectifs des tuteurs et des pupilles, de manière à éviter les déperditions de forces provenant de l'oppression et de l'exploitation des incapables ou de leur refus d'obéir à une autorité nécessitée par leur incapacité.
Ce n'est pas tout. Ces règles, lois ou coutumes, que l'observation et l'expérience ont fait établir en vue de l'intérêt commun, dans chacune des sociétés entre lesquelles s'est partagée originairement l'espèce humaine, il était nécessaire que l'obéissance en fût assurée. Comment pouvait-elle l'être? Ici encore l'observation et l'expérience démontrèrent qu'elle ne pouvait l'être que par l'infliction d'une souffrance supérieure à la jouissance que procurait la violation de la règle. De là, la nécessité d'un système de pénalités physiques et morales destinées à sanctionner l'obéissance aux règles établies. Ce système, trois pouvoirs ont concouru à l'instituer et à le faire fonctionner, en se guidant toujours sur l'observation et l'expérience: le pouvoir de l'opinion, le pouvoir du gouvernement et le pouvoir de la religion.
Toutes les manifestations de l'activité d'un individu peuvent être utiles ou nuisibles à la société dont il fait partie. Il s'agit donc de reconnaître ceux de ses actes qui sont utiles, c'est-à-dire qui sont de nature à augmenter le bien-être commun, et ceux qui sont nuisibles, c'est-à-dire qui causent des souffrances à la communauté. Chacun, ressentant une portion du bien que produit un acte utile et une portion du mal que produit un acte nuisible, est naturellement porté à l'apprécier ou à le juger. Cependant cette appréciation ou ce jugement des actes n'est pas toujours une opération facile: un acte peut être utile en apparence et nuisible en réalité. La dépense que fait un prodigue, par exemple, augmente visiblement la prospérité actuelle de certaines industries tandis qu'elle agit comme une source d'appauvrissement futur pour la société. Il faut une capacité particulière pour bien juger les actes dans leurs effets immédiats et ultérieurs. Quand l'expérience a fait reconnaître la supériorité des plus capables en cette matière, [253] leur jugement s'impose aux autres. Les actes sont jugés, approuvés s'il sont reconnus utiles, désapprouvés s'il sont reconnus nuisibles, et le jugement porté par les individualités les plus capables ou réputées telles se propage et suscite un sentiment général d'amour pour les uns, de haine pour les autres, sentiments gradués d'ailleurs sur le degré d'utilité ou de nuisibilité que l'on attribue aux actes. Ainsi se forme l'opinion. Cette opinion est plus ou moins juste; elle peut être faussée et elle l'est même communément par l'intérêt particulier de ceux qui sont considérés comme les plus capables de juger, mais elle ne peut l'être que dans une certaine mesure, car il faut que le jugement qui la détermine ne soit pas en opposition avec le sentiment obscur peut-être, mais vivace, que la multitude a de l'intérêt commun, pour être accepté par elle et provoquer la création d'une loi ou d'une coutume qui soit généralement obéie. A cette condition, la loi ou la coutume s'établit mais elle demeurerait inefficace si elle n'était pas sanctionnée par des pénalités suffisantes pour en assurer l'observation. Ces pénalités consistent d'abord dans la réprobation de ceux qui estiment que la loi ou la coutume est utile à la généralité, partant à eux-mêmes, et, par conséquent, que tout acte qui l'enfreint est nuisible: ils s'écartent de l'infracteur et, par ce mouvement naturel de répulsion ou de méfiance, lui causent une peine morale et. le plus souvent aussi, un dommage matériel. L'expérience démontre cependant que cette pénalité est insuffisante pour plier à la loi des natures grossières, incultes et rebelles. Il est nécessaire d'en joindre d'autres qui aient une efficacité plus générale et plus certaine: telles sont les pénalités matérielles, les corrections, les supplices et les amendes qui font souffrir le coupable dans sa chair ou dans ses intérêts; telles sont encore les pénalités religieuses qui se fondent sur un sentiment inné chez la plupart des hommes: celui de l'existence d'un ou de plusieurs êtres surhumains, bienfaisants ou malfaisants, qui interviennent dans les affaires humaines, s'occupent du gouvernement des sociétés et en particulier de chacune, se communiquent à certaines individualités favorites, leur révèlent leurs volontés et les chargent de les transmettre à la multitude et d'en exiger l'obéissance, moyennant la promesse de récompenses et la [254] menace de châtiments actuels ou futurs. Plus le sentiment religieux est répandu et profond, plus la croyance à l'existence d'êtres dont la puissance est supérieure à celle de l'homme et qui exigent de sa part une soumission absolue à leurs volontés, est enracinée dans les âmes, plus efficace est la sanction que la religion apporte à la loi, plus redoutées sont les pénalités dont elle menace les infracteurs de cette loi et plus agissant est l'espoir des récompenses qu'elle promet. Il est bien clair que la « loi révélée » n'est autre chose qu'un produit de l'opinion des individualités auxquelles les dieux se communiquent, mais il est bien clair aussi que cette opinion des individualités qui forment l'élite intellectuelle de la tribu ou de la nation est la plus propre à produire des lois utiles. Sans doute, les intermédiaires des divinités peuvent exploiter à leur profit et au détriment de l'intérêt général, le privilège que la croyance religieuse leur attribue, ils peuvent encore révéler une loi en opposition avec le sentiment que la tribu ou la nation a de son intérêt, mais dans l'un et l'autre cas ils courent le risque de la voir abondonner des dieux avides ou incapables et se placer sous la protection d'autres dieux dont la loi répond mieux à leur intérêt et qui lui coûtent moins cher.
Ces lois ou ces coutumes et leurs sanctions que l'observation et l'expérience font établir, en vue de la conservation et du progrès de chaque société, répondent plus ou moins à leur objet, selon qu'elles sont plus ou moins conformes à la loi naturelle de l'économie des forces. Il suffit pour s'en convaincre de considérer les différentes catégories de phénomènes politiques, moraux, économiques auxquels elles s'appliquent.
Le premier besoin des hommes dans cet état primitif où la vie se trouve incessamment menacée, c'est de pourvoir à leur sécurité mutuelle. L'expérience leur enseigne qu'ils ne peuvent satisfaire ce besoin qu'à la condition de se réunir en troupeaux aussi nombreux que le comportent les moyens de subsistance qu'ils peuvent se procurer, et de constituer un organisme qui associe et combine leurs forces. Cet organisme se constitue au moyen de lois ou de coutumes qui établissent la hiérarchie des fonctions par voie d'élection ou d'hérédité, et d'autres lois ou coutumes qui obligent les membres [255] de la société, troupeau, tribu ou nation, à mettre leurs forces et leurs biens, dans la mesure nécessaire, à la disposition du pouvoir ainsi établi, à charge par lui de pourvoir à la sécurité commune. Lorsque ces « lois politiques » sont établies et obéies de telle manière que toutes les forces de la société soient employées avec un maximum d'effet utile, en échange d'un minimum de dépense, c'est-à-dire conformément à la loi naturelle de l'économie des forces, l'organisme politique acquiert toute la puissance que comporte la somme plus ou moins grande de forces et de ressources de l'ensemble des membres de la société.
Cependant, ces forces et ces ressources qui sont les matériaux de la puissance nécessaire de l'association peuvent augmenter ou décroître. Si elles vont décroissant, l'organisme politique aura beau être solidement construit et habilement mis en œuvre, un moment viendra où il succombera sous l'effort d'une puissance concurrente, disposant de forces et de ressources croissantes; et sa chute, dans la phase primitive de la concurrence animale et guerrière, entraînera la destruction ou l'asservissement des membres de l'association. Après la nécessité de lois politiques qui réunissent et combinent les forces de la société pour créer et maintenir l'organisme de la défense commune, apparaît donc et s'impose celle d'autres lois qui assurent la conservation et le développement de ces forces. Telles sont les lois morales qui établissent le droit et le devoir de chacun, les unes en délimitant la sphère d'activité de l'individu et en garantissant dans ces limites sa propriété et sa liberté, les autres en définissant les obligations de chacun envers lui-même et autrui, et en assurant leur accomplissement. A ces lois se rattachent celles qui placent les incapables d'exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs sous la tutelle des individus pourvus de la capacité nécessaire. Telles sont encore les lois économiques destinées à empêcher l'abus de la force dans les rapports des individus entre eux, et particulièrement à limiter la puissance des détenteurs de monopoles naturels. Telles sont, enfin, les lois et les coutumes pénales destinées à sanctionner les autres. Ces lois morales, économiques et pénales doivent être établies de manière à assurer la conservation et le plus grand développement [256] possible des forces et des ressources de la société, et cet objectif elles ne peuvent l'atteindre qu'à la condition d'être conformes à la loi naturelle de l'économie des forces.
Si maintenant on veut savoir comment et pourquoi les lois faites par l'homme, ou les lois positives, tendent incessamment à se conformer à cette loi naturelle, il faut se rappeler que toute déperdition de forces utiles produit une souffrance, et toute acquisition de forces une jouissance. Or, le mobile de l'activité de l'homme comme de tous les êtres pourvus de vie, c'est la crainte de la souffrance et l'appât de la jouissance. Le mobile de l'individu est naturellement aussi celui d'une collectivité d'individus. Le mobile déterminant des actes d'une société c'est d'obtenir la plus grande somme de jouissances et de subir la moindre somme de souffrances. et ce but ne peut être atteint que par l'acquisition d'un maximum de forces, en échange d'un minimum de dépense. Elle considère donc comme utiles tous les actes qui ont pour résultat d'augmenter la somme des forces collectives, comme nuisibles tous ceux qui ont pour résultat de la diminuer. Comment arrive-t-elle à distinguer les uns des autres? Nous l'avons dit: par l'observation et l'expérience. Le plus grand péril auquel se trouvât exposée une société, dans les temps primitifs, celui qui impliquait pour elle le maximum de souffrances, c'était le péril de la destruction, car il avait pour conséquence le massacre ou l'asservissement des associés. Il fallait donc y pourvoir avant tout, et dans ce but créer un organisme politique aussi résistant que possible. Si grande que fût la somme de forces qu'elle dépensait pour le constituer et le mettre en œuvre, cette somme était toujours inférieure à celle dont elle avait pour but d'épargner la destruction, et par conséquent aussi, elle épargnait toujours à la société plus de souffrances qu'elle ne lui en coûtait. Mais une société exposée à un péril qui menace son existence n'est pas seulement intéressée à mettre en œuvre toutes les forces nécessaires pour le conjurer, elle est intéressée encore à ce que oes forces soient combinées et dirigées de manière à surmonter le péril, en échange de la moindre dépense. Si l'organisme politique est défectueux, s'il ne déploie pas les forces nécessaires, ou s'il occasionne des déperditions inutiles de forces, l'observation et l'expérience font reconnaître ses [257] défectuosités et y porter remède, en le rendant plus conforme dans sa structure et son fonctionnement à la loi de l'économie des forces. Les lois morales et économiques et les lois pénales se perfectionnent sous l'excitation du même mobile et par l'emploi des mêmes procédés. Lorsqu'elles s'écartent de la loi naturelle de l'économie des forces, les nuisances qui résultent de cet écart causent à la société une perte de forces, et des souffrances qui sont ressenties à des degrés divers par tous ses membres. Ils sont excités alors à observer de plus près l'opération de leurs lois et ils s'appliquent à les réformer. C'est ainsi que s'opère le progrès en matière de législation: il consiste toujours à rapprocher les lois positives, politiques, morales, économiques ou pénales de la loi naturelle de l'économie des forces.
Cependant, même dans les sociétés composées des individualités les plus intelligentes et morales, les lois positives ne répondent jamais entièrement à cette loi naturelle; elles demeurent toujours plus ou moins imparfaites, quoiqu'elles n'aient pas été aussi vicieuses et barbares dans les anciennes sociétés que nous le supposons d'habitude, faute de nous rendre compte des nécessités auxquelles elles pourvoyaient, et particulièrement de celles qui provenaient de la permanence de l'état de guerre. Mais il est évident que les sociétés où il y avait le plus de forces produites et le moins de forces perdues, devaient acquérir la plus grande somme de puissance. Dans la concurrence avec les autres sociétés, elles devaient obtenir la victoire et cette victoire des sociétés les plus fortes et les plus capables était conforme à l'intérêt général et permanent de l'espèce.
Ces deux lois naturelles: l'économie des forces et la concurrence, ont déterminé la production de tous les progrès dont l'ensemble constitue la civilisation: l'économie des forces. par l'appât d'une augmentation de jouissances et d'une diminution de souffrances, la concurrence par la menace de la destruction, suspendue sur les sociétés et les individus qui n'emploient et ne règlent pas leur activité d'une manière conforme à la loi de l'économie des forces.
II
PROGRÈS ET OBSTACLES
[261]
CHAPITRE PREMIER
La localisation naturelle de la production. — Le libre échange.↩
La diversité du sol, du climat, des aptitudes, cause déterminante de la localisation naturelle de la production. — Obstacles qu'elle rencontre dans le milieu et dans l'homme. — Obstacle provenant de l'état de guerre. — Progrès qui ont contribué à créer et à étendre le commerce international. — Causes qui ont déterminé le maintien des obstacles dont l'état de guerre avait nécessité l'établissement. — L'intérêt fiscal. — Limite naturelle des droits fiscaux. — L'intérêt protectionniste. — Les industries qui exploitent exclusivement le marché intérieur. — Les rings et les corners. — Les industries d'exportation. Dommage que leur cause la protection. — Leur exclusion inévitable du marché universel. — Conséquences de cette exclusion. — Que l'homme est libre d'obéir ou non aux lois naturelles, mais qu'en leur desobéissant il s'expose à une pénalité certaine. — Les pertes temporaires causées par la suppression des obstacles aux échanges. — Les compensations de ces pertes. — Nécessité vitale de la suppression des douanes au double point de vue de l'intérêt particulier des nations et de l'intérêt général de l'espèce. — Causes qui la retardent.
L'analyse des lois naturelles qui gouvernent le monde économique, nous a montré qu'elles agissent pour conserver l'espèce et déterminer ses progrès, en l'excitant incessamment, sous l'impulsion du mobile organique de la peine et du plaisir, à augmenter la somme de ses forces vitales, et à diminuer la dépense nécessaire à leur acquisition. Ces forces vitales l'espèce humaine les puise dans les matériaux que la nature a mis à sa disposition, mais qui sont diversement et inégalement distribués sur le globe. Elle emploie pour les extraire de ces matériaux les facultés dont elle est douée, mais qui sont [262] de même diversement distribuées dans les variétés ou les races entre lesquelles elle se partage [19]. De là, une localisation [263] naturelle de la production. En 'supposant que chacune des variétés de l'espèce produise les articles de consommation que le sol, le climat de la région qu'elle occupe, la nature de ses facultés et de ses aptitudes, la rendent la plus apte à produire, et qu'elle les échange contre les articles produits ailleurs dans des conditions analogues, toutes les choses nécessaires à la satisfaction des besoins de l'homme seront obtenues avec un maximum d'abondance et un minimum de dépense, et ce résultat sera conforme à l'intérêt de chacun des producteurs et des consommateurs, finalement aussi à l'intérêt général et permanent de l'espèce.
Mais cette localisation naturelle de la production a rencontré, dès l'origine, des obstacles provenant du milieu et de l'homme lui-même: obstacle de la difficulté naturelle des communications entre les différentes régions où la localisation pouvait s'opérer et l'échange s'établir utilement, obstacle du défaut de sécurité, qui grévait le transport des produits et l'échange d'un risque supérieur à l'économie que la localisation permettait de réaliser. A ces obstacles se sont ajoutés ceux que nécessitait l'état de guerre pour assurer la subsistance et l'industrie des populations, continuellement exposées à une interruption soudaine de leurs communications avec l'étranger. Sous l'influence de ces obstacles combinés, la production ne s'est localisée pendant longtemps et les échanges ne se sont, pour la plus grande partie du moins, opérés que dans l'intérieur des frontières de chaque État. Sauf dans un petit nombre de pays auxquels des fleuves navigables et la mer procuraient des moyens de communication particulièrement faciles avec le dehors, le commerce extérieur n'avait qu'une faible importance et se restreignait aux articles pourvus d'une grande valeur sous un petit volume. Cependant, les progrès qui ont assuré la sécurité des peuples civilisés, [264] étendu leur domination sur le globe, augmenté dans des proportions énormes leur puissance productive, diminué ou même supprimé l'obstacle des distances, ont changé complètement cet état de choses et imprimé un essor extraordinaire au commerce international [20]. Il semblait que ces progrès dussent déterminer l'abandon de l'appareil de protection que l'état de guerre avait rendu nécessaire, et qui demeurait désormais sans objet. Un mouvement général d'opinion s'est produit, en effet, au début de l'ère de la grande industrie en faveur de la liberté des échanges, et il a provoqué la suppression des douanes intérieures et l'abaissement des douanes extérieures; mais ce mouvement a été bientôt suivi d'une récation qui est, au moment où nous sommes, presque générale [265] et qui serait peut-être durable s'il était au pouvoir des législateurs protectionnistes d'entraver ou de suspendre l'opération des lois naturelles. Comment ces lois agissent pour contraindre, sous peine de ruine, les nations civilisées à supprimer les barrières qui entravent l'essor de leur industrie et de leur commerce, c'est ce qui ressortira de l'analyse des facteurs de la réaction protectionniste et de l'opération des lois naturelles, en matière de localisation et d'échanges.
Le maintien et même l'accroissement des obstacles artificiels à la localisation économique de la production et à la liberté des échanges ont pour premier facteur l'intérêt fiscal des gouvernements. Les droits de douane constituent une des branches les plus productives des impôts indirects, et ils ont, au point de vue de la fiscalité, l'avantage, très apprécié par les gouvernements, d'être perçus sans que les consommateurs qui en supportent définitivement le poids sachent de combien ils renchérissent les articles taxés et même, le plus souvent, s'ils les renchérissent. Or, comme les besoins des gouvernements vont sans cesse croissant, comme, d'une autre part, les appareils constitutionnels et parlementaires qui ont été inventés pour protéger les nations contre les exigences financières de leurs gouvernements n'ont qu'une efficacité illusoire, la tendance à multiplier les droits de douane et à en élever le taux est devenue de plus en plus prononcée. Cependant, l'expérience a démontré qu'en matière de douanes deux et deux ne font pas toujours quatre, qu'en multipliant les droits et en les exhaussant on en diminue parfois le produit au lieu de l'accroître, qu'il y a, en un mot, un taux fiscal qui représente le maximum de rendement possible de la tarification, et que les gouvernements sont intéressés à ne pas dépasser ce taux. Les douanes fiscales ont ainsi une limite naturelle. En revanche, les douanes protectionnistes n'en ont point, à moins qu'on ne considère comme une limite l'encouragement qu'un tarif prohibitif donne à la contrebande.
Aussi longtemps que les douanes ont été des fortifications économiques nécessitées par l'état de guerre, elles étaient établies dans l'intérêt général, en vue d'assurer en tout temps les approvisionnements des populations. Le renchérissement qu'elles occasionnaient n'était autre chose qu'une prime [266] d'assurance de la consommation et cette prime était communément inférieure au risque qu'elle servait à couvrir. Au temps où nous sommes, cette prime est sans objet, les relations commerciales avec le dehors étant assurées en temps de guerre par la facilité des communications, l'intérêt et le droit des neutres. Si elle continue à être imposée aux consommateurs, sans qu'ils tirent aucun avantage, c'est en vue de donner satisfaction aux intérêts particuliers des producteurs qui en touchent, du moins en partie, le montant.
Il y a, dans chaque pays, deux catégories de producteurs: ceux dont la clientèle est uniquement concentrée dans le pays même, et ceux qui exportent une partie de leurs produits. Au premier abord, la première semble avoir un intérêt indiscutable à ce que le marché national lui soit réservé. Il en serait ainsi peut-être si l'industrie demeurait immobile, et telle était, en effet, sa situation à l'époque où les corporations privilégiées interdisaient à leurs membres l'emploi de procédés ou d'instruments nouveaux et perfectionnés; mais à défaut de la concurrence extérieure, la concurrence intérieure agit aujourd'hui, quoique avec une efficacité et une rapidité moindres, pour imposer le progrès des procédés et des instruments de production aux producteurs les plus routiniers. A mesure que s'accroît la puissance productive des industries auxquelles le marché intérieur est réservé, elles se font, dans ce marché, une concurrence plus vive; cette concurrence fait disparaître les entreprises les moins progressives, et détermine la concentration de l'industrie dans un petit nombre de grands établissements. La tendance naturelle de ces établissements est de se coaliser pour élever leurs prix, en limitant leur production, jusqu'au point marqué par les prix des articles similaires de l'étranger augmentés du droit de douane. Si les co-participants de ces rings ou de ces corners, comme on les nomme aux états-Unis, jouissent d'une influence prépondérante, et si l'entente se maintient entre eux, ils réussissent pendant une période plus ou moins longue à imposer aux consommateurs les prix du monopole, et à provoquer ainsi un renchérissement artificiel des articles monopolisés. Si ces articles constituent les matières premières des industries d'exportation, les prix de revient de celles-ci s'en trouvent exhaussés, et elles [267] deviennent moins capables de soutenir sur les marchés du dehors, la concurrence des industries des autres pays; elles perdent une partie de leur clientèle étrangère, et, en même temps, une partie de leur clientèle intérieure par le fait de la diminution de la consommation, déterminée par l'exhaussement des prix. Les intérêts lésés par les rings ou les corners se soulèvent alors contre un monopole qui surélève ses profits aux dépens des leurs. Une lutte s'engage entre les industries coalisées et celles qui leur paient tribut. Si les premières l'emportent et réussissent à conserver leur monopole, cette victoire provoque la décadence des industries tributaires, et par contre-coup leur propre ruine. Si les secondes parviennent au contraire à faire ouvrir le marché à la concurrence étrangère, les industries coalisées ou non qui ne s'étaient point mises en mesure de l'affronter, en se fiant à l'abri précaire du monopole, courent le risque d'être expulsées d'un marché dont la possession perpétuelle leur paraissait assurée.
Les industries qui appartiennent à la seconde catégorie, celles qui sont pleinement adaptées au sol, au climat et aux aptitudes particulières de la population, qui ne se bornent point à approvisionner le marché intérieur, mais qui exportent une partie plus ou moins considérable de leurs produits ont, comme on vient de le voir, un intérêt immédiat à l'établissement de la liberté des échanges. Deux cas peuvent toutefois se présenter ici: ou le débouché de ces industries est plus considérable à l'intérieur qu'à l'étranger ou il est moindre. Dans le premier cas, il peut sembler avantageux de leur réserver le marché intérieur, ce marché ayant plus de valeur pour elles, que le marché étranger. Cependant si étendu que soit le marché intérieur, il l'est toujours moins que le marché universel. Or, dans les pays où le marché est réservé à l'industrie indigène, la plupart des éléments de la production subissant de ce chef un renchérissement artificiel, l'élévation du prix de revient agit à la fois pour empêcher l'extension du débouché extérieur et du débouché intérieur. De plus, en supposant même que celui-ci demeure intact, la concurrence des pays de libre-échange, où les prix de tous les éléments de la production sont réduits à leur taux [268] naturel ne manque pas, à la longue, d'entamer celui-là et de finir par l'enlever en totalité à l'industrie des pays de protection. Dans le second cas, le dommage ultérieur que cause la protection est plus étendu encore tandis que ses avantages actuels sont moindres. S'il y a des pays où certaines industries sont particulièrement favorisées par la nature, il n'en est point qui possèdent seuls le monopole de ses faveurs, et où les industries privilégiées soient assurées de conserver à jamais l'approvisionnement exclusif du marché universel. Les bénéfices extraordinaires que ces industries réalisent provoquent, dans d'autres régions du globe, placées dans des conditions analogues, l'éclosion d'industries similaires et stimulent leurs progrès, la concurrence s'établit entre elles, et ce sont finalement celles dont le prix de revient n'est point surélevé par la protection qui s'emparent du marché universel, en réduisant leurs rivales à l'exploitation du marché réservé.
A mesure que la puissance productive de l'industrie s'augmente, que les communications entre les diverses régions du globe deviennent plus faciles et que l'aire de la sécurité s'étend, qu'il se crée un marché sur lequel toutes les nations versent leurs produits en concurrence, cette concurrence y réduit les prix au niveau des frais de production les moins élevés. Or, la protection ayant pour effet d'exhausser le niveau des frais de production, les produits des nations protectionnistes doivent inévitablement finir par être expulsés de ce marché, dont l'importance va croissant chaque jour.
En assurant sur le marché universel, la victoire aux plus capables, c'est-à-dire à ceux qui produisent aux moindres frais, les lois naturelles rendent donc nécessaire la suppression des obstacles artificiels, que l'esprit de fiscalité et de monopole oppose à la localisation économique des industries et à la liberté des échanges. Mais ce progrès inévitable peut être accéléré ou retardé, selon que l'opération des lois naturelles est secondée ou non par ceux qu'elles régissent. Comme nous l'avons remarqué déjà, dans le gouvernement de la nature, une part est laissée à l'activité libre des sujets de ce gouvernement. Si cette part est faible ou même nulle chez les espèces inférieures qui sont incapables de connaître [269] les lois auxquelles la nature a assujetti leur existence, afin d'assurer leur conservation, leur expansion et leur durée utiles, il n'en est pas de même pour l'espèce humaine. L'homme peut connaître les lois qui régissent l'existence de son espèce, et il est libre de leur obéir ou de les enfreindre. Une fraction de l'humanité, une nation peut, sous l'impulsion d'intérêts égoïstes et à courte vue, dérober son industrie à la pression de la concurrence, mais elle ne peut éviter la pénalité qui frappe cette désobéissance à une loi nécessaire. Expulsée du marché universel, condamnée à exploiter un débouché de plus en plus restreint par l'appauvrissement et la désertion de sa clientèle, l'industrie protégée ne peut échapper à la décadence et à la destruction, et sa chute, en entraînant la ruine de ceux qui en vivent. occasionne une déperdition inévitable de forces vitales. C'est pourquoi il est utile de travailler à démolir les obstacles que l'ignorance, l'imprévoyance et l'avidité sans scrupules élèvent contre l'opération des lois qui assurent la conservation et déterminent les progrès de l'espèce. Sans doute, l'intervention des réformateurs n'est pas indispensable, en ce sens que l'opération des lois naturelles finit par éliminer ce qui est nuisible, mais cette opération est brutale, et elle ne va point sans une déperdition, souvent énorme, de forces vitales. Cette déperdition, elle peut être en partie épargnée par une réforme qui accélère la destruction d'institutions ou l'abandon de pratiques devenues nuisibles après avoir été nécessaires, et tels sont les obstacles artificiels que les états opposaient, dans l'intérêt de leur sécurité, à la liberté des échanges.
A la vérité, il y a une perte que la suppression des obstacles naturels ou artificiels opposés à l'extension universelle des échanges rend inévitable: c'est celle des industries mal adaptées au sol, au climat ou aux aptitudes des populations que ces obstacles protégeaient, et dont l'existence était une condition de sécurité pour l'état et la nation. Mais tout progrès occasionne une perte de ce genre, en détruisant ce qu'il remplace, et celle-ci est largement compensée par le profit que la suppression de ces mêmes obstacles procure aux industries adaptées aux aptitudes productives du pays en étendant leurs débouchés.
Ajoutons que de toutes les réformes que le changement des [270] conditions d'existence des sociétés civilisées exige au moment où nous sommes, celle qui a pour objet la suppression des douanes et l'établissement du libre-échange le plus complet en tre les peuples est peut-être la plus urgente. Car les obstacles que les douanes, qu'elles soient protectionnistes ou simplement fiscales, opposent à l'extension du marché des échanges, ont à la fois pour effet d'affaiblir l'action propulsive de la concurrence et de la troubler. Elles l'affaiblissent en l'empêchant de s'universaliser, elles la troublent par les changements continuels de la tarification qui tantôt élargissent et tantôt rétrécissent sa sphère d'opération. On a entrepris de diminuer ces perturbations par la conclusion de traités de commerce qui interdisent pendant une période arbitrairement limitée à dix ans ou cinq ans, l'exhaussement des tarifs, mais ce n'est là qu'un palliatif insuffisant et dont les inconvénients ne balancent pas les avantages. Les traités de commerce impliquent, en effet, l'établissement d'un double tarif: général et conventionnel, l'un maximum et constamment variable, l'autre minimum et temporairement fixe. Mais ce dernier n'étant accordé qu'en échange d'un abaissement équivalent du tarif général de la nation avec laquelle on traite, que fait celle-ci? Elle élève le niveau de son tarif général, en établis-s ant des droits dits de combat qu'elle se réserve de réduire en échange de réductions équivalentes. L'exhaussement du tarif maximum détermine ainsi celui du tarif minimum, l'obstacle de la protection est surélevé dans l'un et abaissé seulement en apparence dans l'autre. Quant à la fixité de la tarification, elle n'est guère moins illusoire: si les traités épargnent à l'industrie les relèvements partiels qui auraient pu être opérés pendant leur durée, la coalition des intérêts protectionnistes se dédommage amplement de cette trève à leur expiration, en déterminant un remaniement complet et un exhaussement général du tarif.
Cependant, si nécessaire que soit aux nations, considérées individuellement, l'établissement du libre échange, devenu une condition d'existence pour chacune, si utile qu'il puisse être à la généralité en lui épargnant la déperdition d'une masse croissante de forces vitales, on ne peut s'attendre à ce qu'il s'établisse de sitôt. Si l'on considère, en effet, les forces [271] en lutte sur le champ de bataille de la protection et du libre-échange, on ne peut se dissimuler qu'au moment où nous sommes, les probabilités de succès sont en faveur des premières.
Les promoteurs des réformes douanières sont des théoriciens qui réclament l'établissement du libre-échange, en se fondant sur l'intérêt général et permanent de la nation et de l'humanité. Ils sont peu nombreux, et s'ils peuvent invoquer des intérêts futurs d'un poids décisif, ils n'ont pour auxiliaires que deux catégories d'intérêts actuels, l'un naturellement peu actif sinon inerte, l'autre peu influent, car il est presque partout en minorité: l'intérêt permanent de la généralité des consommateurs et l'intérêt actuel des producteurs pour lesquels le marché intérieur a moins d'importance que le marché étranger. Les consommateurs sont intéressés sans doute à être exonérés de l'impôt que la protection fait peser sur eux en renchérissant artificiellement tous les articles qui servent à la satisfaction de leurs besoins, mais cet impôt, ils ne le voient point, ils en ignorent le montant, le plus souvent même l'existence: et ceux d'entre eux qui tirent leur revenu des industries protégées sont naturellement portés à croire que la suppression de la protection diminuerait ce revenu dans une proportion supérieure an montant de l'impôt, si mème il ne le leur enlevait point. L'intérêt des industries et du commerce d'exportation est plus sensible et plus actif; mais, sauf dans les pays les plus avancés, tels que l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, la Suisse, les industries pour lesquelles le marché intérieur a plus d'importance que le marché étranger, l'emportent encore sur les autres en nombre et en influence. Ces industries n'envisagent les questions de la protection et du libre-échange qu'au point de vue de leur intérêt actuel. Elles s'inquiètent peu de leur avenir, encore moins de celui de la nation et de l'espèce. Elles n'ignorent point que le marché national est limité, tandis que le marché du monde est en comparaison illimité, mais elles préfèrent conserver le premier sans partage plutôt que de faire les efforts nécessaires pour prendre une part croissante dans le second, dût cette part dépasser celle qu'elles trouvent dans le marché protégé. Il convient de remarquer encore que dans un pays neuf, [272] où l'industrie manufacturière n'existe qu'à l'état embryonnaire, la protection peut procurer des profits immédiats et extraordinaires. Aussitôt qu'un droit d'importation vient à être établi, le prix s'élevant du montant de ce droit, ceux qui entreprennent la protection de l'article protégé, jouissent d'une prime égale à la différence de leurs frais de production et du prix artificiellement surélevé. A la vérité, la concurrence intérieure, en se développant, abaisse peu à peu le prix au niveau des frais de production augmentés du profit ordinaire, mais, dans l'intervalle, les premiers bénéficiaires de la protection peuvent réaliser des fortunes colossales. On ne doit pas s'étonner si la protection trouve des partisans fanatiques parmi les hommes d'affaires et les capitalistes qui veulent avant tout s'enrichir vite, fut-ce aux dépens d'autrui, et si ces individus peu scrupuleux se servent de leur influence politique pour arriver à leurs fins. Cependant, c'est dans les pays neufs que la protection est particulièrement dommageable en détournant les capitaux encore peu abondants des industries naturelles pour les attirer dans des branches artificielles, qui ne peuvent subsister qu'en serre chaude et sont condamnées finalement à périr.
On ne peut donc s'attendre à unc victoire prochaine de la cause du libre-échange. Selon toute apparence, cette victoire sera due à l'opération toujours lente et onéreuse quoique certaine des lois naturelles bien plutôt qu'à l'action des réformateurs. C'est seulement quand il deviendra manifeste que l'industrie des nations libre-échangistes expulse du marché général celle des nations protectionnistes, et les condamne à un arrêt mortel que la pression de l'opinion agira avec une efficacité suffisante pour déterminer l'abolition d'un système devenu nuisible. Alors, la localisation économique des industries s'opérera d'elle-même, mais non sans que la prolongation de ce système ait causé à généralité de l'espèce une déperdition de forces que la connaissance des lois naturelles et la volonté de les faire prévaloir auraient pu lui épargner.
[273]
CHAPITRE II
Les progrés de l'outillage et des procédés de la production.↩
Que les progrès de l'outillage et des procédés de la production sont subordonnés a l'étendue du marché. — Comment l'extension du marche ou l'augmentation de la capacité de consommation suscite le progrès en le rendant profitable. — Causes naturelles et artificielles de la limitation de la capacité de la consommation sous le régime de l'état de guerre. — Comment elle s'est accrue et a provoqué une demande de plus en plus active du progrès industriel. — Que les inventions se sont multipliées à mesure qu'elles sont devenues plus productives. — Que l'industrie de l'invention s'est perfectionnée en se spécialisant. — Nécessité de la garantie de la propriété des inventions. — Limite naturelle du progrès industriel.
Nous venons de voir comment les lois naturelles agissent pour déterminer la localisation la plus économique des entreprises. Nous avons vu aussi quels obstacles ont entravé de tout temps cette localisation, conforme à l'intérêt général et permanent de l'espèce humaine: c'était d'abord l'obstacle naturel des distances et du peu d'étendue de l'aire de la sécurité qui rendait plus économique la production locale de la plupart des articles de consommation, que leur importation des régions où ils pouvaient être produits dans des conditions naturelles plus favorables; c'étaient ensuite les obstacles artificiels que les nécessités de l'état de guerre faisaient établir pour assurer la production et l'approvisionnement de ces articles en temps de guerre au prix de leur renchérissement en temps de paix; c'est enfin, depuis que l'obstacle des distances a été [274] entamé et presque annulé par les merveilleux progrès de la locomotion maritime et terrestre, depuis que l'aire de la sécurité s'est étendue sur la plus grande partie du globe, et que les fortifications économiques nécessitées par l'état de guerre ont cessé d'avoir leur raison d'être, c'est, disons-nous, l'obstacle de la fiscalité et de l'esprit de monopole; mais nous avons constaté, en même temps, que cette prolongation artificielle d'un régime qui est devenu nuisible après avoir été utile ne saurait se perpétuer; qu'à défaut de l'action de l'intelligence et de la volonté de l'homme, les lois naturelles agissent pour y mettre fin, en condamnant à la décadence et à la ruine les industries que la protection entreprend de soustraire à l'obligation de se placer dans les conditions de production les plus économiques.
A la localisation naturelle qui est la première de ces conditions, s'en joignent toutefois beaucoup d'autres, à commencer par les progrès de l'outillage et des procédés de la production.
Ces progrès sont subordonnés à l'étendue du marché et, en conséquence, déterminés ou accélérés par la suppression des obstacles naturels ou artificiels que rencontre l'échange.
Quand le producteur ne se séparait point du consommateur, quand il n'avait point d'autre marché que celui de sa propre consommation, il devait mesurer la puissance de son outillage à la petite quantité de produits dont il avait besoin. L'emploi d'une charrue avec un attelage de bœufs ou de chevaux eut renchéri sa production au lieu de la rendre plus économique. Les frais de production et d'entretien de la charrue et de l'attelage employés à la culture de cette faible quantité de blé, — supposons 100 hectolitres — eussent dépassé ceux de la culture à la bêche, autrement dit, il aurait dû dépenser plus de travail pour construire la charrue, élever et dresser les bœufs ou les chevaux, pourvoir à leur entretien et les employer à la production de 100 hectolitres de blé, qu'il ne lui en fallait pour confectionner la bêche et s'en servir pour cultiver l'étendue de terrain nécessaire à la production de ces 100 hectolitres. Dans cet état primitif du débouché, la charrue, bien que plus productive que la bêche, eut été d'un emploi moins économique. En conséquence, le producteur n'était point excité [275] à réaliser l'épargne du temps et à faire la dépense du travail intellectuel et matériel nécessaires pour l'inventer et la construire: elle n'était point « demandée. » Mais il en a été autrement aussitôt que le débouché s'est agrandi, aussitôt que les hommes se sont multipliés et qu'ils ont, sous l'impulsion du mobile de l'économie des forces, divisé leur travail, c'est-à-dire employé la totalité de leur temps disponible non plus à produire toutes les choses dont ils avaient besoin, mais un petit nombre de ces choses ou une seule et même une fraction d'une seule, en se procurant par l'échange de ce produit ainsi accru de leur travail divisé et spécialisé, une plus grande quantité des divers articles nécessaires à leur consommation. Alors, disons-nous, la situation a change: en employant exclusivement son temps et son travail à la culture du blé, au lieu d'en consacrer une partie à d'autres productions, l'agriculteur a pu en produire 200 hectolitres. Déduction faite de la quantité nécessaire à sa consommation, il a donc pu mettre 100 hectolitres au marché. Cependant les consommateurs devenus plus nombreux et mieux pourvus de moyens d'échange, grâce à l'accroissement de leur industrie sous le régime de la division du travail, les consommateurs, disons-nous, en demandaient bien davantage. Au lieu de 100 hectolitres, notre producteur de blé pouvait en porter 1,000 de plus au marché et en obtenir un prix rémunérateur. Mais pour produire ces 1,000 hectolitres, il lui fallait 10 auxiliaires munis de 10 bêches, en supposant qu'ils produisissent comme lui 200 hectolitres chacun. Ces auxiliaires, il devait les outiller et pourvoir à leurs frais de nourriture et d'entretien, tout en subissant les risques de l'entreprise. Dans ce nouvel état de choses, il était visiblement intéressé à chercher quelque procédé qui lui permit d'augmenter son profit, en diminuant ses frais. Ce procédé, un cultivateur ingénieux le découvre: il consiste à encastrer la bêche, après en avoir légèrement modifié la forme, dans un véhicule trainé par une paire de bœufs ou de chevaux conduits par un laboureur, et à s'en servir pour creuser un sillon. L'expérience démontre, d'une part, qu'avec cet appareil nouveau on peut cultiver la même étendue de terre et obtenir la même récolte qu'avec le travail à la bêche de dix hommes, d'une autre part, que les frais de production et d'entretien d'une charrue, [276] de deux bœufs et d'un laboureur sont sensiblement moindres que ceux de ces dix auxiliaires. D'où un accroissement notable du bénéfice. Ce bénéfice, le cultivateur qui a substitué la charrue à la bêche le retient d'abord pour lui tout entier, mais la concurrence de ceux qui l'ont imité ne tarde pas à l'obliger à abaisser le prix de son blé, du montant de l'économie qu'il a réalisée. Le prix du marché baissant au niveau des frais ainsi diminués de la production, les cultivateurs routiniers qui ont conservé la bêche sont contraints ou de renoncer à la culture du blé ou de subir la nécessité du progrès en adoptant la charrue, tandis que le bénéfice de ce progrès va finalement au consommateur.
L'extension du débouché apparaît donc comme la première condition du progrès de l'outillage. Ce progrès qui augmente la puissance productive de l'homme ne devient profitable et par conséquent il n'est demandé qu'au moment où le surcroît de produits qu'il permet de créer et de mettre au marché peut être échangé à un prix rémunérateur, c'est-à-dire à un prix qui couvre avec adjonction d'un profit, les frais de production et d'emploi de l'outil perfectionné. C'est ainsi que la charrue eut été un instrument moins économique que la bêche, lorsque le marché du blé n'en pouvait absorber que 100 hectolitres, et que son emploi a été subordonné à l'augmentation de la capacité du marché. C'est ainsi encore qu'une diligence ou une patache est un véhicule plus économique qu'un train de chemin de fer dans une contrée où les voyageurs et les marchandises sont rares, tandis qu'elle l'est moins dans celles où ils abondent. Sans doute, l'abaissement des prix de transport que l'établissement du chemin de fer rend possible a pour effet d'augmenter la capacité de consommation, mais cette augmentation n'est pas toujours suffisante pour rémunérer le service de l'instrument perfectionné. Dans ce cas, le déficit, qu'il soit supporté par les actionnaires ou par la communauté constitue une déperdition de forces, et au lieu d'être profitable, l'introduction hâtive de l'instrument perfectionné a été dommageable. Elle ne cesse de l'être qu'au moment où l'accroissement de la capacité de la consommation rend rémunérateur l'emploi de cet instrument.
Sous le régime de la petite industrie et de l'état de guerre, [277] la capacité de la consommation était limitée par plusieurs causes, les unes naturelles, les autres artificielles. Les causes naturelles résidaient, sauf de rares exceptions, dans le petit nombre et l'insuffisance de la capacité productive des consommateurs locaux; 2° dans le défaut de sécurité et de moyens de communication, qui empêchaient la généralité des échanges de s'effectuer au delà d'un rayon très limité. Les causes artificielles consistaient principalement dans les mesures de défense et de protection que l'état de guerre rendait nécessaires. D'autres causes de retard se joignaient à celles-là: d'une part, les sciences applicables à l'industrie étaient encore dans l'enfance, d'une autre part, les inventions nouvelles, en supprimant les vieux métiers et les vieux procédés qu'elles remplaçaient, occasionnaient une perte et une dépense extraordinaires que les producteurs, investis le plus souvent d'un monopole naturel ou artificiel, étaient peu disposés à supporter et qu'ils ne s'imposent d'ailleurs aujourd'hui qu'à la dernière extrémité, lorsqu'ils y sont contraints sous peine de ruine par la pression de la concurrence. Enfin, l'introduction d'une nouvelle machine privait de leur travail, c'est-à-dire de leurs seuls moyens d'existence, une partie des ouvriers employés aux vieux métiers, sans qu'il leur fut possible de trouver dans la localité même d'autres emplois ou d'aller en chercher ailleurs. Ils étaient réduits alors à vivre misérablement aux dépens de la charité publique ou privée, et cet état de choses explique suffisamment l'existence de ce qu'on a nommé « le préjugé contre les machines », en l'attribuant uniquement à l'ignorance, tandis qu'il avait en réalité sa source dans un dommage actuel qu'aggravaient les circonstances, et que ne balançait point, chez ceux qui en souffraient, la perspective d'un profit dont la jouissance était réservée aux générations futures.
Cependant, l'accroissement lent mais continu de la capacité productive, les progrès de la sécurité et des moyens de communication ont augmenté la capacité de consommation, agrandi les marchés et commencé à les unifier. Dans ce nouvel état de choses, l'emploi d'un outillage perfectionné est devenu de plus en plus profitable, le progrès industriel a été chaque jour plus demandé, et à mesure que les [278] inventions se sont multipliées, la concurrence les a imposées.
Deux causes ont particulièrement concouru depuis un siècle, à les multiplier: l'une c'est l'augmentation progressive de la consommation des produits de l'industrie des inventeurs; l'autre, c'est le progrès même de cette industrie, désormais spécialisée.
L'augmentation de la consommation des produits de l'industrie des inventeurs est attestée par le nombre sans cesse croissant des brevets d'invention et de perfectionnement, et elle est déterminée par ce fait que tout progrès réalisé dans une industrie a pour effet d'agrandir non seulement le marché de cette industrie, mais encore celui des autres branches de la production, et d'y stimuler la demande du progrès en le rendant plus profitable.
Supposons qu'un fabricant de cotonnades, pourvu du vieil outillage des métiers à la main, produise annuellement 100,000 mètres d'étoffes qu'il vend à raison de 50 centimes. Aussi longtemps que son marché n'en pourra absorber une quantité plus grande, il ne trouvera probablement aucun profit à transformer son outillage. Mais que ce marché vienne à s'étendre, sous l'influence d'une cause ou d'une autre, accroissement de la capacité productive des consommateurs, progrès de la sécurité ou des moyens de communication, de telle sorte que le fabricant y puisse trouver aisément le placement d'un million de mètres, aussitôt il aura intérêt à remplacer ses métiers à la main par des métiers mécaniques, et la concurrence ne tardera pas d'ailleurs à l'y contraindre. Alors aussi, sous la pression de cette même concurrence, le prix des cotonnades ne tarde pas à descendre au niveau de leurs frais de production, que nous supposons diminués de moitié, soit à 25 centimes. Grâce à cette diminution, les consommateurs réalisent une économie de 25 centimes par mètre, qu'ils appliquent en partie à l'achat d'un supplément de cotonnades, en partie, et selon toute apparence en plus grande partie, à l'achat d'autres articles. Le débouché des industries qui produisent ces articles s'agrandit en conséquence: cet agrandissement de leur débouché rend profitable la transformation progressive de leur outillage, et celle-ci contribue encore à étendre leur [279] débouché. On s'explique ainsi le développement énorme et sans précédent de la production dans toutes ses branches depuis que l'extension et l'unification des marchés de consommation ont stimulé le progrès industriel en le rendant de plus en plus profitable, et depuis que le progrès industriel, à son tour, a agi pour agrandir les marchés, en provoquant par là même une augmentation sans cesse croissante de la demande des produits de l'invention.
Cette augmentation de la demande a eu pour effet naturel de stimuler le progrès de l'industrie de l'invention, en déterminant l'accroissement de l'offre, et ce progrès s'accomplit dans cette industrie comme dans les autres par la division du travail et la spécialisation. Aussi longtemps que le peu d'étendue et de profondeur des marchés rendait inapplicables la plupart des inventions qui auraient augmenté d'une manière disproportionnée, la productivité des industries qu'elles concernaient, l'invention et l'exploitation de ses produits n'eurent point un marché suffisant pour leur permettre de se spécialiser. Elles étaient exercées accessoirement par des industriels ou des ouvriers qui se réservaient soigneusement le secret de leur trouvaille, ou la cédaient à leur corporation quand elle était profitable; souvent même une invention était le fruit d'une observation purement accidentelle [21]. Mais il en [280] alla autrement, lorsque l'extension des débouchés de la généralité des branches de la production eut permis d'écouler le surcroît des produits que l'on obtenait en employant un outillage perfectionné. Alors, la demande des inventions s'accroissant, l'industrie qui les produisait tendit à se spécialiser. Cependant le secret ne suffisait plus pour assurer aux inventeurs la rétribution nécessaire du fruit de leur travail Car, ce secret, les progrès des sciences appliquées à l'industrie, le rendaient chaque jour plus facile à pénétrer. C'est pourquoi les inventeurs, à l'exemple des littérateurs et des artistes, réclamèrent pour leurs œuvres, et en invoquant les mêmes motifs, les garanties de la propriété.
Que ces garanties soient indispensables, il est presque superflu de le démontrer. Comme toute autre industrie, celle de l'invention a ses frais de production, elle est de plus particulièrement aléatoire. Toute invention exige des avances de capital et de travail, parfois considérables et qui demeurent trop souvent stériles. Pour attirer les capitaux et les intelligences à l'égal des autres branches de la production, il faut non seulement que les inventions exploitables couvrent leurs frais avec adjonction du profit ordinaire, mais encore ceux de toutes les expériences demeurées stériles, de même que la recherche de l'or, la pêche des perles doivent procurer des profits assez élevés pour compenser les risques extraordinaires qui sont attachés à ces industries naturellement aléatoires. Or, ce résultat ne peut être obtenu qu'à la condition que la propriété des inventeurs, comme celle des littérateurs et des artistes, soit entièrement garantie dans l'espace et dans le temps. Elle ne l'est encore, au moment où nous sommes, que d'une manière incomplète, et de même que toutes les autres limitations de la propriété, celle-ci a pour effet d'entraver [281] l'apport des capitaux et du travail dans l'industrie de l'invention, par conséquent de ralentir, au détriment de l'intérêt final de l'espèce, la transformation économique de l'outillage de la production [22].
Une dernière question se pose au sujet du progrès de l'outillage: ce progrès est-il destiné à s'opérer d'une manière indéfinie et illimitée, ou bien a-t-il un terme naturel? Il est facile de se convaincre que ce terme existe et qu'il se trouve dans le maximum possible de productivité d'un instrument ou d'un procédé, en échange d'un minimum de dépense. On a inventé par exemple un outillage de locomotion qui a augmenté d'une façon prodigieuse la rapidité du transport des hommes, des marchandises et des communications écrites ou même verbales, tout en en abaissant le prix; mais ce double progrès a ses limites naturelles. On ne peut trouver un agent de transport plus rapide que l'électricité, et il y a, de même, une limite à l'abaissement de ses frais de production. On ne peut dépasser une certaine vitesse et une certaine économie dans le transport des hommes, on ne peut pas davantage augmenter d'une manière indéfinie les rendements agricoles, et en diminuer les frais. Un moment viendra où la limite maximum de la productivité et la limite minimum des frais de production seront atteintes dans toutes les branches de l'activité humaine, comme elles le sont déjà dans quelques-unes. Alors les aptitudes qui constituent le génie de l'invention devront se porter dans d'autres directions. où elles opéreront des conquêtes, dont nous n'avons pas plus la notion que nos ancêtres n'avaient celle de nos acquisitions dans le domaine de l'industrie.
Est-il nécessaire d'ajouter que nous sommes encore loin du terme du progrès industriel? En attendant, toutes les industries dont il transforme l'outillage demeureront exposées au risque inévitable qu'il crée en détruisant ce qu'il remplace. Toutefois, on peut s'assurer contre ce risque, qui atteint à la fois le matériel et le personnel de la production. C'est l'affaire de la prévoyance et de l'épargne.
[282]
CHAPITRE III
Le progrès de la constitution des entreprises.↩
Comment la pression de la concurrence agit pour déterminer le progrès de la constitution des entreprises. — L'entreprise individuelle et la corporation. — Raison d'être du régime des corporations. — Vice de ce régime. — En quoi l'abolition des corporations a été défectueuse. — La protection de l'entreprise individuelle. — Que l'entreprise individuelle a cessé d'être adaptée aux conditions actuelles d'existence de la production. — Son imperfection et son insuffisance croissante. — La société impersonnelle a capital mobilisable. — En quoi elle est plus économique que l'entreprise individuelle. — Obstacles que les législations protectrices des entreprises individuelles opposent à son perfectionnement. — Qu'elle n'en est pas moins destinée à remplacer l'entreprise individuelle.
Toute industrie s'exerce au moyen d'entreprises que suscite l'appât d'un profit. Ces entreprises se font concurrence pour offrir leurs produits ou leurs services. Or, il est clair que celles-là doivent l'emporter sur leurs concurrentes qui peuvent fournir ces produits ou ces services au meilleur marché et en meilleure qualité, c'est-à-dire qui produisent aux moindres frais. Lorsque la concurrence est limitée, soit naturellement, soit artificiellement, le taux auquel s'opère l'échange des produits ou des services peut demeurer assez élevé pour couvrir les frais de production des entreprises les moins économiquement localisées, constituées, outillées et mises en œuvre. Alors, la différence des frais se résout simplement en une différence de profits. Il en est autrement à mesure que la concurrence devient plus générale et plus pressante. Alors, les [283] prix baissent et finissent par couvrir simplement les frais des entreprises établies et mises en œuvre de la manière la plus conforme à la loi de l'économie des forces; les autres font faillite et disparaissent, à moins de réaliser des progrès devenus nécessaires.
En quoi consistent ces progrès? Ils consistent d'abord dans la localisation économique des entreprises, ensuite dans leur outillage, leur constitution, leur approvisionnement de capitaux et leur fonctionnement. Nous avons vu que l'ancienne localisation, appropriée à la situation primitive de l'industrie et aux nécessités de l'état de guerre, doit se modifier pour s'adapter aux nouvelles conditions d'existence qu'ont faite à l'industrie l'extension de l'aire de la sécurité et des moyens d'échange et la généralisation de la concurrence. Il en est de même pour leur constitution.
Sous l'ancien régime de la production, que nous avons désigné sous le nom de régime de la petite industrie [23] , la constitution des entreprises était déterminée par l'étendue plus ou moins limitée des marchés, lesquels étaient généralement isolés. Chaque industrie locale était, en conséquence, maîtresse exclusive de son marché, quand même il ne lui était point réservé par la loi ou la coutume. L'expérience avait suscité et imposé la constitution appropriée à cet état de choses, c'est-à-dire la constitution la plus économique, la plus conforme à la loi de l'économie des forces: c'étaient l'entreprise individuelle et la corporation. Chaque industrie avait son domaine borné par des frontières plus ou moins exactement délimitées et elle se partageait selon l'étendue du marché entre un nombre plus ou moins grand de maîtrises. Chaque maîtrise était la propriété d'un entrepreneur et la réunion des entrepreneurs ou des maîtres constituait la corporation. La corporation protégeait ses membres contre toute agression ou oppression, mais en leur imposant les règles qu'elle jugeait conformes à l'intérêt commun: elle exigeait d'eux qu'ils connussent aussi complètement que possible la pratique de leur industrie ou de leur métier, qu'ils enssent fait un apprentissage dont elle fixait la durée et exécuté un « chef-d'œuvre »; elle [284] leur imposait en outre l'emploi des procédés et de l'outillage qu'elle jugeait les plus économiques et les plus efficaces, et veillait à ce qu'ils n'altérassent point la qualité de leurs produits.
Le vice de ce système, c'était le monopole, mais ce vice était originairement le fait de la nature, il tenait au peu d'étendue de la sphère où les échanges étaient possibles; le monopole des corporations ne devint artificiel que lorsque l'accroissement de la sécurité et des moyens de communication eurent agrandi cette sphère, et alors les nécessités de l'état de guerre motivèrent les obstacles artificiels à l'aide desquels on compensait la disparition ou l'abaissement des obstacles naturels. Cependant, qu'il fut naturel ou artificiel, le monopole des corporations avait, comme tout monopole, ses nuisances qui ne pouvaient être qu'imparfaitement corrigées: si la coutume, expression de l'opinion et de la volonté de la communauté des consommateurs, limitait au taux nécessaire les prix des produits ou des services des industries incorporées; si les sociétés de compagnonnage et les confréries empêchaient les maîtres associés des corporations d'abaisser de même les salaires au-dessous du taux nécessaire, en revanche, l'absence du stimulant de la concurrence encourageait au sein de chaque corporation l'esprit de routine et y immobilisait les procédés et l'outillage.
Les progrès de la sécurité, de la puissance productive et des moyens de communication, combinés, ont agi, surtout depuis un siècle pour changer les conditions d'existence de la production; les monopoles naturels ont disparu pour la plupart, les marchés agrandis se sont ouverts à la concurrence, en dépit des obstacles artificiels au moyen desquels les intérêts engagés dans l'ancien régime ont essayé d'enrayer son essor. Il aurait suffit de supprimer les entraves opposées à la liberté du travail et des échanges pour que l'industrie transformât d'elle-même sa constitution et l'adaptât à ses nouvelles conditions d'existence. Malheureusement, la science et les arts du gouvernement des sociétés n'avaient pas progressé du même pas que ceux de la production. C'était une maxime de gouvernement qui avait eu pendant longtemps sa raison d'être, qu'on ne doit pas tolérer l'existence d'un état dans l'état, et [285] que tout groupement de forces, toute association doit être, sinon interdit du moins étroitement réglementé et surveillé. Cette hostilité des gouvernements contre les associations, les abus du monopole des corporations avaient fini par la faire partager à la multitude. On ne se contenta donc pas de supprimer les entraves opposes à la liberté de l'industrie et des échanges, on supprima les associations sous la forme corporative et même sous toute autre forme, en spécifiant qu'elles ne pourraient se reconstituer qu'avec l'autorisation de l'état et sous les conditions qu'il lui conviendrait de leur imposer. Seules, les entreprises individuelles ou constituées par un petit nombre d'associés en nom collectif furent laissées libres d'entraves. Même aujourd'hui et chez tous les peuples civilisés, toutes les autres formes des entreprises sont soumises à un régime plus ou moins restrictif de leur liberté, en sorte que l'entreprise individuelle y jouit d'une sorte de droit protecteur, dont le montant peut être évalué d'après les charges et restrictions imposées aux autres. Or, qu'a démontré l'expérience? Elle a démontré et elle démontre tous les jours plus clairement, que cette forme primitive des entreprises a cessé d'être adaptée aux nouvelles conditions de la production.
Il suffit d'une courte analyse de l'entreprise individuelle et de son fonctionnement dans les conditions actuelles de la production pour se rendre compte de l'étendue et de la gravité des nuisances que cause la prolongation artificielle de ce mode arriéré de constitution des entreprises.
Tandis que les associations constituées en vue de la production sont soumises à une réglementation spéciale, aggravée encore fréquemment par une taxation différentielle, tout individu est libre de fonder et de diriger une entreprise, soit qu'il possède ou non les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'industrie qu'il juge à propos d'entreprendre. Il y investit ses capitaux et ceux qu'il emprunte à court ou à long terme, en argent ou en marchandises, moyennant un intérêt ou une part de profit; il enrôle des ouvriers moyennant un salaire. S'il a choisi une industrie dont le marché n'est pas encombré, son entreprise peut réussir et rémunérer amplement ses capitaux et son travail, mais il n'est guidé dans ce choix que par des données vagues et incertaines, car les [286] opérations des entreprises individuelles sont secrètes, et les entrepreneurs cachent, à la fois, leurs profits pour ne point attirer la concurrence, et leurs pertes pour ne point diminuer leur crédit. Exposé, en outre, aux dépressions et aux crises, auxquelles toutes les branches de la production sont sujettes, l'entrepreneur possède rarement les ressources supplémentaires dont il aurait besoin pour les traverser. Il est à la merci du crédit. Selon que les établissements qui le dispensent et qui sont encore généralement pourvus d'un monopole, l'étendent ou le resserrent, il étend ses opérations, les resserre ou même est obligé de les suspendre. Bref, il se trouve trop souvent à la merci des événements et réduit aux expédients en face de ses échéances. Dans cette situation précaire, toute son attention se concentre sur les nécessités présentes et urgentes auxquelles il doit pourvoir. Il n'a pas le loisir de s'occuper de l'avenir. Il s'efforce de réaliser promptement des bénéfices aussi élevés que possible, de s'enrichir vite plutôt que de fonder un établissement durable. Comme il n'est soumis à aucun contrôle, comme il est libre dans le choix des moyens d'accroître ses profits, il use à cet égard de toute la large marge que lui laisse le code pénal. Il spécule sur l'ignorance des consommateurs, falsifie ses produits, trompe sur la mesure et le poids, et cette dernière pratique est facilitée dans certains pays par l'imposition d'un système plus mathématique qu'économique [24].
Sans doute, en altérant la qualité de ses produits, en trompant sur la mesure ou le poids, il s'expose à compromettre sa réputation et à perdre à la longue sa clientèle. Mais une partie de cette clientèle est flottante, et d'ailleurs la fraude est ingénieuse: elle conserve les apparences et embellit même la forme en détériorant le fond. En admettant même qu'elle finisse par éloigner la clientèle, elle procure un surcroît immédiat de bénéfices qui compense ce risque et au delà, car l'entreprise individuelle est viagère, souvent même moins que viagère. Les entrepreneurs, pour la plupart, n'aspirent qu'à se retirer des affaires après avoir fait une fortune [287] aussi rapide que possible. Ajoutons qu'en France par exemple la législation intervient pour abréger la durée des entreprises ou en réduire l'importance en rendant le partage des fonds d'industrie ou de commerce obligatoire entre les héritiers. Ces maux et ces abus que l'intervention répressive de l'état, en matière de falsifications et de fraudes n atténue que faiblement, une observation superficielle en a rendu la concurrence responsable; d'où la conclusion que le remède consistait dans la limitation de la concurrence. Une observation plus attentive démontre qu'ils proviennent simplement de ce que l'entreprise individuelle est une « vieille machine », et que le remède consiste non dans la limitation de la concurrence qui se limite elle-même, mais dans un progrès de la constitution des entreprises, qui adapte cette constitution aux nouvelles conditions d'existence de l'industrie.
Cependant, en dépit des obstacles qu'une législation surannée n'a point cessé de lui opposer, ce progrès nécessaire n'a pu être entièrement arrêté. Il s'est accompli d'abord dans les industries qui exigent une concentration de forces productives, dépassant la capacité de l'entreprise individuelle, industrie des transports agrandie et perfectionnée par l'application de la vapeur et de l'électricité à la locomotion, industrie minérale etc., et il pénètre peu à peu dans les autres, en substituant aux individus des sociétés impersonnelles. Nous avons analysé ailleurs [25]cette forme progressive des entreprises, qui est destinée à remplacer, dans toutes les branches de l'activité humaine, l'entreprise individuelle, comme le métier mécanique a remplacé le métier à la main et pour la même cause: parce qu'elle est plus économique. Nous nous bornerons à résumer cette analyse.
1° Tandis que l'entreprise individuelle ne peut se constituer et se développer que dans la mesure des forces et du crédit d'un individu et n'a que des chances incertaines de lui survivre, la société impersonnelle peut adapter son capital à l'importance de l'œuvre qu'elle se propose d'accomplir, s'étendre indéfiniment dans l'espace et subsister indéfiniment dans le temps. 2° Elle peut constituer son capital avec plus de [288] rapidité et de facilité tout en le rétribuant moins que l'entreprise individuelle, grâce à la divisibilité et à la « mobilisabilité » des titres de propriété de ce capital. 3° Tandis que l'entreprise individuelle fonctionne secrètement, en s'appliquant à dérober sa situation à tous les yeux, la société impersonnelle est obligée par sa nature même de publier les résultats de ses opérations, d'accuser ses pertes et ses bénéfices, en rendant régulièrement ses comptes à ses actionnaires. Dans une industrie exercée exclusivement par des sociétés impersonnelles, il suffit d'examiner leurs comptes rendus annuels ou même de jeter un coup d'œil sur la cote de leurs actions pour savoir si les profits de cette industrie sont supérieurs ou inférieurs à ceux des autres; s'il y a lieu, en conséquence. d'y porter ses capitaux ou de les en retirer; la concurrence s'y limite ainsi d'elle-même, et les prix ne s'y écartent que d'une manière accidentelle et temporaire du taux nécessaire. 4° Une société impersonnelle constituée pour une durée illimitée est moins intéressée à grossir ses bénéfices actuels qu'à s'en assurer la continuation indéfinie. Son intérêt lui commande de s'abstenir des pratiques vicieuses, falsifications, tromperies sur la qualité et le prix des marchandises, auxquelles un entrepreneur viager peut trouver et trouve même trop souvent profit à se livrer.
Sans parler des autres avantages que présente la société impersonnelle à capital mobilisable sur l'entreprise individuelle à capital immobilisé, ceux que nous venons d'énumérer suffisent pour en démontrer la supériorité. Seulement c'est à une condition, savoir que le mécanisme constitutionnel de la société soit adapté à cette forme des entreprises comme le gouvernement de l'entreprise individuelle l'est à la sienne. Or, si l'on observe la constitution et le fonctionnement des sociétés anonymes et autres, telles qu'elles existent actuellement, on s'aperçoit que cette constitution est encore grossièrement défectueuse, et que les déperditions de forces causées par ces défectuosités, balancent parfois et au delà les avantages inhérents à cette forme perfectionnée des entreprises. Cet état d'imperfection constitutionnelle et de fonctionnement des sociétés de production doit être, en grande partie attribué aux entraves légales qui ont ralenti leur établissement [289] et fait obstacle à leurs progrès, en leur imposant une constitution officielle, qu'il ne leur est point permis de changer. Supposons que le même législateur qui prescrit aux sociétés la manière dont elles doivent se constituer et se gouverner se fut avisé de réglementer, suivant sa fantaisie, la construction des machines nouvelles, et que tout en autorisant par exemple certaines industries à substituer aux anciens moteurs, la machine à vapeur telle qu'elle était sortie des mains de Newcomen, il cut décrété, dans sa sagesse, qu'on n'y pourrait rien changer, que tous les exemplaires qui en seraient construits devraient être exactement conformes à un modèle officiel, décrit dans l'acte d'autorisation et déposé dans les bureaux d'un département ministériel, cette machine primitive et grossière ne pourrait recevoir que des applications fort limitées, et les anciens moteurs continueraient dans bien des cas à lui être préférés. Comme tout autre mécanisme, celui de la société de production n'arrive point d'emblée à être complètement adapté à sa destination, les progrès qui l'y amènent ne s'opèrent qu'à mesure que la pratique montre ses défauts, et à la condition qu'on soit libre de les expérimenter [26]. La société impersonnelle à capital mobilisable est demeurée actuellement au point où se trouvait la machine à vapeur, dans les premiers temps de son invention, et c'est seulement quand elle cessera d'être immobilisée dans des formes réglementaires qu'elle pourra réaliser les progrès qui, en l'adaptant pleinement à sa destination, lui permettront de prendre la place de l'entreprise individuelle. Alors, disparaîtront d'eux-mêmes les abus et les maux que cause aujourd hui la prolongation d'un régime d'entreprises, devenu incompatible avec les nouvelles conditions d'existence de l'industrie.
[290]
CHAPITRE IV
L'abaissement de la rétribution nécessaire du capital d'entreprise.↩
Le capital d'exécution et le capital d'entreprise. — En quoi ils consistent. — Comment leur rétribution peut être réduite. — Que cette reduction ne dépend que pour la plus faible part de l'entrepreneur d'industrie. — Progrès qui la déterminent. — Comment la quantité nécessaire du capital d'entreprise peut être diminuée, sa puissance augmentée et sa rétribution abaissée. — La diminution de l'avance et l'abaissement des risques. — Limite naturelle de la réduction des frais du capital d'entreprise.
Dans toute entreprise de production, il faut distinguer le capital d'exécution et le capital d'entreprise. Le capital d'exécution comprend tous les agents, instruments et matériaux employés à la confection du produit: le personnel des directeurs des travaux, des employés et des ouvriers aussi bien que le matériel: terres, bâtiments, outils, matières premières. Le capital d'entreprise, investi dans les instruments de la circulation ou sous toute autre forme, appropriée à son emploi, sert à avancer la somme nécessaire pour rétribuer le capital d'exécution jusqu'à ce que le produit soit réalisé et à l'assurer contre les risques de la réalisation. Les frais de production se composent de la rétribution du capital d'exécution et de celle du capital d'entreprise.
Ces deux rétributions ont, l'une et l'autre, leur taux nécessaire. Ce taux est celui que le capital d'exécution et le capital [291] d'entreprise doivent obtenir pour subsister et être mis d'une manière continue au service de la production. Si la rétribution demeure inférieure à ce taux, les matériaux et les agents productifs sont successivement entamés et finalement détruits, et la production ne peut être continuée.
En quoi consiste la rétribution du capital d'exécution? Elle consiste dans la somme employée à l'achat des matières premières, à la location des terres, des bâtiments, des outils et du personnel des directeurs, des employés et des ouvriers. Le taux nécessaire d'acquisition des matières premières et de location des autres agents productifs doit comprendre, avec la couverture des frais de leur production et de leur reconstitution, un profit suffisant pour rémunérer leurs détenteurs et les déterminer à investir leur capital sous cette forme et à l'appliquer à la production au lieu de le conserver inactif.
En quoi consiste la rétribution du capital d'entreprise? Elle consiste: 1° dans la compensation d'une privation, — celle que subit le capitaliste en engageant son capital dans la production au lieu d'en conserver la disponibilité; 2° dans la couverture des risques de la production et de la réalisation du produit. — risques dont le capital d'entreprise est responsable; 3° dans un profit rémunérateur de la fonction du capitaliste, à la fois banquier et assureur de l'entreprise. Cette compensation, cette assurance et ce profit doivent être portés à un taux qui permette de conserver intact le capital et de le maintenir au service de la production. C'est le taux nécessaire de la rétribution du capital d'entreprise.
Ainsi, les frais de production consistent, d'une part, dans la somme employée à l'acquisition des matières premières, à la location des autres agents productifs qui constituent le capital d'exécution, — acquisition et location qui ont leur taux nécessaire; d'une autre part, dans la compensation de la privation, la couverture des risques et le profit du capital d'entreprise, — lesquels ont, de même, leur taux nécessaire. Or, nous avons vu que le prix courant de tous les produits ou services gravite incessamment vers leurs frais de production. C'est donc ceux-ci qu'il faut réduire si l'on veut produire à meilleur marché, c'est-à-dire obtenir une plus grande somme de forces vitales en échange d'une dépense amoindrie.
[292]
Comment les frais afférents: 1° au capital d'exécution, 2° au capital d'entreprise peuvent-ils être réduits?
En ce qui concerne le capital d'exécution, ils peuvent être réduits par l'abaissement du taux nécessaire d'achat des matières premières, de location des autres agents productifs, par la diminution de la quantité employée et l'accroissement de la productivité de leur emploi. En ce qui concerne le capital d'entreprise, ils peuvent l'être: 1° par la réduction des frais afférents au capital d'exécution; 2° par la diminution de la durée de l'avance de ces frais; 3° par celle des risques de la production; enfin 4° par l'abaissement du profit nécessaire du capital d'entreprise.
Cette réduction des frais de la production ne dépend, il convient de le remarquer, que pour une bien faible part, des entrepreneurs eux-mêmes. S'il dépend de l'entrepreneur de choisir les matières premières les plus avantageuses sous le double rapport de la qualité et du prix, de louer aux meilleures conditions les terres, les bâtiments, les machines, les outils, d'enrôler les ouvriers les plus capables et de leur faire produire le travail le plus efficace et le moins cher, il est hors de son pouvoir d'abaisser le prix de revient des matières premières, d'augmenter l'efficacité des services des terres, de l'outillage et du travail et d'en réduire les frais. S'il peut activer, dans une certaine mesure, la fabrication et la réalisation de son produit, la rapidité de la fabrication dépend néanmoins, avant tout, du degré de perfection de l'outillage, de l'habileté et de l'assiduité des ouvriers, et celle de la réalisation de l'état des moyens de transport, du marché et du crédit. S'il dépend de lui de se montrer prudent dans le choix de sa clientèle, son industrie est cependant exposée à des risques généraux auxquels il n'est pas en son pouvoir de se soustraire et dont il ne peut pas davantage abaisser le taux. S'il est libre de se contenter d'un faible profit, il faut toutefois que ce profit soit suffisant pour déterminer l'apport du capital d'entreprise à la production.
Ce sont les progrès généraux de l'industrie qui abaissent, sous la pression de la concurrence, les frais du capital d'exécution et ceux du capital d'entreprise. Commençons par ceux-ci.
[293]
A mesure que les progrès réalisés dans la localisation économique et l'outillage de l'industrie ont permis d'obtenir une plus grande quantité de produits en échange d'une dépense moindre, le capital d'entreprise destiné à avancer au capital d'exécution sa part nécessaire dans les résultats de la production et à l'assurer, a pu être réduit. Il faut aujourd'hui, pour produire cent mille pièces de cotonnades dans un pays de libre échange, avec l'outillage perfectionné de la grande industrie, un capital d'entreprise fort inférieur à celui qui était nécessaire il y a un siècle.
D'autres progrès ont contribué à augmenter, en même temps, la puissance productive de ce capital et à diminuer sa rétribution nécessaire, en accélérant la production et la réalisation des produits. Non seulement on produit en moins de temps une pièce de cotonnades, avec un métier self acting mû par la vapeur, qu'on ne le faisait avec un métier à la main; mais, grâce au développement et au perfectionnement du rouage commercial, on en réalise plus promptement la valeur. A l'époque où le producteur était obligé de s'aboucher directement avec le consommateur, faute d'intermédiaires, et plus tard encore lorsqu'un intermédiaire unique, généralement dépourvu de capitaux, n'achetait ses produits que moyennant un crédit assez long pour lui permettre de les réaliser dans l'intervalle, ce producteur qui ne pouvait vendre qu'à crédit devait être muni d'un capital d'entreprise relativement considérable. Les progrès du rouage commercial ont changé cet état de choses. Dans les pays où ce rouage a commencé à acquérir son développement utile, le producteur vend ses produits, à mesure qu'ils sortent de ses ateliers, à de grands établissements, amplement pourvus de capitaux, qui les lui payent comptant ou à court terme. L'avance qu'il fait au capital d'exécution se trouve ainsi notablement réduite. Le capital d'entreprise qui n'était reconstitué qu'au bout de six mois, un an et davantage, l'est maintenant au bout de trois mois, et sa rétribution nécessaire s'abaisse en conséquence. A la vérité, l'intermédiaire qui se substitue au producteur vis-à-vis du consommateur est obligé de faire la même avance de capital jusqu'à ce qu'il ait vendu le produit et qu'il en ait été payé, mais, exerçant spécialement la fonction commerciale, il est [294] plus apte à chercher des consommateurs, et à débiter rapidement le produit que ne l'était le producteur. Il opère une économie de temps dans la réalisation, et abrège ainsi la durée de l'avance du capital d'entreprise employé ici à la production, là, à la vente.
Des progrès d'une autre sorte agissent pour diminuer les risques qui incombent au capital d'entreprise. Tels sont les progrès de la sécurité générale, qui écartent le danger du pillage et du vol, et ceux du rouage de la justice commerciale qui procurent un recouvrement plus rapide et plus assuré des créances; mais ces risques n'en demeurent pas moins nombreux et élevés. Sans parler du défaut de probité et d'exactitude des débiteurs, bien des causes naturelles ou artificielles agissent pour jeter la perturbation dans le domaine de la production et de l'échange, susciter des accidents ou des crises qui se traduisent par des risques: c'est l'instabilité des récoltes qui élève ou abaisse le prix des nécessités de la vie, et réagit sur toutes les autres branches de la production, tantôt en restreignant leur débouché, tantôt en l'accroissant; ce sont les changements brusques et fréquents de la mode: c'est l'imprévoyance et l'incurie des producteurs qui les pousse à abuser des facilités décevantes du crédit pour multiplier leurs produits sans être assurés de pouvoir les réaliser à un taux rémunérateur; ce sont enfin les guerres et les modifications incessantes qui sont introduites dans le régime des douanes et des autres impôts. Et, sous l'influence du rapprochement et de la mise en communication des marchés qui ont agrandi la sphère des échanges et étendu la solidarité des intérêts, ces perturbations se répercutent dans toutes les parties du monde industriel et commercial, y suscitent des risques inévitables, nécessitent une prime d'assurance qui leur soit proportionnée et qui exhausse d'autant la rétribution nécessaire du capital d'entreprise. Les socialistes ne tiennent aucun compte de ces risques lorsqu'ils accusent le capital qui les supporte de s'attribuer la part du lion dans la distribution des produits, ou, comme ils disent, d'exploiter le travail. Mais, en supposant qu'ils eussent le pouvoir d'abaisser arbitrairement cette part, qu'adviendrait-il? C'est que les risques qui incombent au capital d'entreprise cessant d'être couverts, ce capital serait [295] promptement détruit et la production dont il est le moteur s'arrêterait, en laissant le travail sans emploi et sans rétribution. Ce qu'il faut faire pour diminuer la part du capital, c'est abaisser les risques de la production et de l'échange, en éliminant, autant que la chose est possible, les causes qui pro duisent ces risques et nécessitent la prime d'assurance qui élève le taux de la rétribution du capital d'entreprise.
Outre les frais d'avance et d'assurance du capital d'exécution, dans lequel le travail se trouve compris pour une large dart, la rétribution du capital d'entreprise doit couvrir le profit nécessaire des fournisseurs et des metteurs en œuvre de ce capital. En quoi consiste leur industrie? Cette industrie est complexe. Ils contribuent, à la production comme directeurs, associés ou commanditaires des entreprises agricoles, industrielles ou commerciales et comme banquiers et assureurs. Que fait, par exemple, un entrepreneur individuel ou une société qui se livre à la fabrication des cotonnades, en y appliquant un capital d'entreprise? Il remplit une double fonction que l'on peut fort bien diviser en deux parties, et qui est, en effet, divisée dans les entreprises constituées sous la forme de sociétés anonymes. D'une part, il dirige l'opération technique de la production, en mettant en œuvre le capital d'exécution, d'une autre part, il applique le capital d'entreprise dont il dispose à une opération d'avance et d'assurance. Les propriétaires de ce capital peuvent n'avoir aucune notion de l'industrie à laquelle il est appliqué: dans une société anonyme, tel est le cas ordinaire des actionnaires, et même du conseil d'administration auquel ils délèguent leurs pouvoirs. La fonction de ce conseil n'implique nullement la connaissance technique de la production, elle consiste à choisir un personnel pourvu de cette connaissance ou même simplement le directeur de ce personnel, à veiller à la conservation et, s'il se peut, à l'accroissement du capital employé à avancer et à assurer les produits de l'entreprise. En quoi donc se résout, dans le cas d'une société anonyme, la rétribution des actionnaires, propriétaires du capital d'entreprise et de leurs mandataires? Elle se résout, pour les actionnaires, dans la somme nécessaire: 1° pour couvrir les risques de l'entreprise à laquelle ils appliquent leur capital; 2° pour compenser la [296] privation de ce capital et les déterminer à l'engager dans la production au lieu de le laisser inactif; 3° pour rémunérer la peine qu'ils se donnent, en choisissant les mandataires chargés de veiller à sa conservation et en contrôlant leur gestion. Pour les mandataires, une rémunération spéciale s'ajoute à celle qui leur revient lorsqu'ils sont en même temps, comme c'est l'habitude, actionnaires, et cette rémunération a de même son taux nécessaire: elle doit être proportionnée à la capacité intellectuelle et morale qu'exige leur fonction, à la responsabilité qu'elle implique et au temps qu'elle demande pour être utilement remplie.
Nous rappellerons à ce propos que la rétribution nécessaire du capital d'entreprise se trouve sensiblement abaissée dans les sociétés impersonnelles à capital mobilisable. Car la privation qui est un des éléments de cette rétribution se trouve sinon annulée du moins très réduite par la possibilité de dégager du jour au lendemain le capital investi, tandis que dans l'entreprise individuelle le capital investi ne peut être dégagé qu'après un délai plus ou moins long et non toujours sans danger pour l'entreprise. La mobilisabilité du capital transforme la compensation qu'exige la privation en une simple prime, destinée à couvrir le risque de moins-value au moment du dégagement: encore ce risque se trouve-t-il racheté en partie par la chance de plus-value, la part du capital mobilisable, action ou obligation, ayant pu hausser aussi bien que baisser. Le progrès qui substitue les entreprises impersonnelles à capital mobilisable aux entreprises individuelles à capital immobilisé a donc pour effet, comme nous l'avons remarqué, de diminuer la rétribution nécessaire du capital d'entreprise.
Cependant, si cette rétribution peut être diminuée, tant par le progrès de la constitution des entreprises que par l'abréviation de la durée de l'opération productive et l'abaissement des risques, elle ne pourra jamais être supprimée. Car la production exigera toujours une avance de capital, — depuis le moment où la fabrication des produits est commencée jusqu'à celui où il sont réalisés. Elle comportera probablement aussi toujours des risques, partant une assurance; enfin, elle ne cessera point d'exiger une rémunération pour la fonction [297] de banquier et d'assureur exercée par le capitaliste. — Mais ne pourrait-on pas fonder un établissement de production et le faire fonctionner, sans capital d'entreprise? C'est là, comme on le sait, une utopie favorite du socialisme. Arrêtons-nous y un instant. On peut certainement concevoir l'existence d'un établissement de production sans capital d'entreprise; seulement, — et c'est ici que git l'illusion des socialistes, — ce capital ne sera pas supprimé comme ils se l'imaginent, il sera simplement déplacé, et ceux qui l'engageront dans la production recevront la rétribution nécessaire qui lui est afférente, au lieu et place de ceux qui la reçoivent aujourd'hui. Comment les choses se passeront-elles? Les propriétaires et fournisseurs du capital d'exécution, terres, bâtiments, machines, outils, matières premières, travail cesseront d'être rétribués suivant le mode actuel: ils ne toucheront plus, ceux-là, des loyers ou un prix d'achat, ceux ci des salaires. Ils recevront à la place une part du produit de l'entreprise, calculée d'après l'évaluation du capital qu'ils y auront engagé sous forme de terrains, de bâtiments, de machines, de matières premières, de forces physiques, intellectuelles et morales. Ils n'auront donc plus aucune rétribution à payer à cet odieux capital d'entreprise. En revanche, ils devront attendre que le produit soit réalisé pour en toucher leur part et courir les risques de sa réalisation. L'avance que leur fait aujourd'hui le capital d'entreprise, ils seront obligés de se la faire à eux-mêmes: le risque contre lequel il les assure, ils devront l'assurer eux-mêmes. Y trouveront-ils une économie, en admettant même qu'ils possèdent ou qu'ils puissent se procurer le capital nécessaire à cette avance et à cette assurance? Enfin ce capital qui remplira les fonctions dévolues au capital d'entreprise ne devra-t-il pas être rétribué, et sa rétribution ne sera-t-elle pas prise, comme elle l'est aujourd'hui sur celle du capital d'exécution? Le capital d'entreprise sera déplacé, il ne sera pas supprimé, et il en sera de même de sa rétribution. Cela ne veut pas dire que l'organisation actuelle des entreprises ne puisse être modifiée; que la part du travail notamment ne puisse être avancée et assurée autrement qu'elle ne l'est sous le régime des rapports directs de l'entrepreneur avec les ouvriers, et nous verrons plus loin comment elle [298] pourrait l'être, mais, ce qui est une pure utopie, c'est que le résultat de la production puisse être attribué exclusivement au « travail »; c'est que cette portion du capital mobilier qui est employée à avancer et à assurer le produit des entreprises ne reçoive pas, quelles que soient les mains dans lesquelles elle se trouve, la part nécessaire pour la conserver intacte et déterminer ceux qui la possèdent à l'engager dans la production.
[299]
CHAPITRE V
L'abaissement de la rétribution nécessaire du capital d'exécution.↩
Comment le progrès agit pour diminuer la rétribution nécessaire du capital d'exécution. — Changement qu'il opère dans la proportion du personnel et du materiel des entreprises. — Qu'en diminuant la quantité du personnel, il en élève la qualité et la rétribution nécessaire. — Qu'il améliore, en conséquence, la condition des travailleurs. — Qu'il peut aussi la rendre pire. — Dans quel cas. — Erreur des socialistes a cet égard. — Que la suppression du salariat ne remédierait pas au mal de l'avilissement de la rétribution du travail. — Raison d'être du salariat. — Comment les frais d'avance et d'assurance que rembourse le salarié peuvent être réduits. — La mobilisabilité des capitaux et le marchandage. — Causes pour lesquelles la classe ouvrière n'a pas bénéficié du progrès industriel autant qu'elle l'aurait dû. — Son incapacité dans la gestion du capital personnel. — La gestion de ce capital sous le régime de l'esclavage et sous le régime de la liberté. — Nuisances particulières et générales causes par la mauvaise gestion du capital personnel.
Le capital d'exécution se compose, comme nous l'avons vu plus haut, pour une part, des terrains, des bâtiments, des machines, des outils, des matières premières, autrement dit du matériel employé à la confection du produit, pour une autre part, du personnel des directeurs, des employés et des ouvriers qui mettent le matériel en œuvre. La rétribution du matériel comme celle du personnel est avancée et assurée par le capital d'entreprise, et l'une et l'autre consistent dans la somme nécessaire pour assurer la conservation de ces deux sortes d'agents productifs et leur maintien au service de la production.
[300]
De même que le progrès agit pour diminuer la rétribution nécessaire du capital d'entreprise, il agit pour réduire celle du capital d'exécution, et le résultat de cette double économie c'est l'abaissement du prix des produits, et par conséquent l'acquisition progressive d'une plus grande somme de forces vitales en échange d'une moindre dépense.
La réduction de la rétribution nécessaire du capital d'exécution s'opère en premier lieu par la diminution du prix d'achat des matières premières employées et du prix de location des terrains, bâtiments, machines, animaux, outils (en comprenant dans ce prix de location, les frais d'entretien et de renouvellement), et l'augmentation de la puissance productive de cette portion du matériel des entreprises; en second lieu, par le remplacement de la force physique de l'homme par une force plus puissante et moins coûteuse: celle des animaux ou des machines, impliquant une augmentation du matériel de la production, en comparaison du personnel.
Nous avons vu comment le progrès abaisse le prix des produits, soit qu'il s'agisse de matières premières ou d'articles prèts pour la consommation, et diminue la rétribution des capitaux investis dans le matériel des entreprises. Il nous suffira donc d'examiner, les conséquences du changement que le progrès opère dans la proportion du matériel et du personnel de la production.
Que le progrès ait invariablement pour effet de remplacer la force physique de l'homme, soit par une force de même nature, empruntée aux animaux, soit par une force mécanique, l'une et l'autre plus puissantes et moins coûteuses, c'est un fait d'observation. A l'époque où la filature se faisait au rouet et le tissage au métier à la main, la fabrication des cotonnades ou des lainages exigeait l'emploi d'un plus grand nombre de fileuses et de tisserands que n'en exigent aujourd'hui la filature et le tissage à la mécanique. Il en est de même dans l'industrie des transports maritimes et terrestres. Un bateau à vapeur du même tonnage qu'un navire à voiles est desservi par un équipage moins nombreux. Un train de chemin de fer transporte, avec un personnel d'une dizaine de machinistes, chauffeurs, conducteurs, une foule de voyageurs [301] et une quantité de marchandises, auxquelles il aurait fallu cent mille porte-faix dans un espace de temps centuple.
En revanche, si le progrès a diminué la quantité du travail humain nécessaire à la production, il en a élevé la qualité, en substituant l'emploi des facultés intellectuelles et morales à celui de la force physique: un conducteur de locomotive déploie moins de force physique qu'un porte-faix, mais sa fonction exige une application continue de son intelligence, et elle implique une responsabilité morale autrement grande, car le moindre relâchement d'attention dans l'accomplissement de sa tâche peut causer la destruction d'un matériel d'une valeur de plusieurs centaines de mille francs et la perte de plusieurs centaines de vies, tandis que le faux-pas d'un porte-faix ne peut causer que la perte ou l'avarie de sa charge. Or, à mesure que s'élève la qualité du travail, son prix nécessaire s'élève aussi comme celui de toute autre marchandise. Un ouvrier dont les facultés intellectuelles et morales sont mises en œuvre ne peut supporter une tàche aussi longue que celui qui met simplement en œuvre sa force physique, car le cerveau se fatigue plus vite que les muscles; et il a besoin d'une rétribution plus élevée pour couvrir les frais de production d'un travail supérieur en qualité, impliquant, en même temps, une supériorité de productivité.
Cependant l'exhaussement nécessaire de la rétribution du travailleur n'équivaut pas à l'économie résultant de l'emploi d'un matériel perfectionné qui substitue à la force physique de l'homme, une force mécanique plus puissante et moins coûteuse. Les entreprises qui emploient ce matériel perfectionné, desservi par un personnel, dont la rétribution est exhaussée en raison de l'élévation de la qualité de son travail produisent à meilleur marché que celles qui emploient un matériel arriéré, desservi par un personnel moins rétribué. Celles-ci sont obligées de transformer leur outillage et d'augmenter la rétribution de leur personnel, sous la pression de la concurrence, quand elles ne réussissent pas à entraver l'opération de cette loi naturelle.
On voit donc que le progrès est particulièrement favorable à la classe ouvrière en ce qu'il exige l'emploi d'un travail supérieur et détermine l'exhaussement de la rétribution nécessaire [302] du travailleur. Mais, en diminuant la proportion du personnel employé par chaque entreprise n'a-t-il pas pour effet de réduire le nombre total des travailleurs dont la production exige la coopération, en d'autres termes, de rétrécir le débouché ouvert au travail? L'expérience atteste au contraire qu'à mesure que l'industrie se perfectionne, le débouché ouvert au capital personnel, aussi bien qu'au capital mobilier et immobilier s'agrandit. La raison de ce phénomène réside dans l'abaissement du prix des produits qui les rend accessibles à un nombre croissant de consommateurs, et détermine un développement correspondant de la production.
Il n'en est pas moins vrai que si le progrès améliore la condition du travailleur en élevant la qualité de son travail et le taux de sa rétribution nécessaire, il peut aussi la rendre pire.
Si par le fait de circonstances sur lesquelles nous reviendrons plus loin, l'ouvrier employé dans une industrie progressive n'obtient point une rétribution qui couvre entièrement les frais accrus de la production de son travail, s'il est obligé d'accomplir une tâche quotidienne d'une durée excessive, s'il n'obtient, par exemple, que le minimum nécessaire à l'entretien de sa force physique, et s'il fournit une journée de travail intellectuel anssi prolongée que celle que comportait un travail simplement musculaire, l'insuffisance de sa rétribution, ou, ce qui revient au même, le mauvais emploi de cette rétribution et l'excès de la durée de son travail pourront lui causer une déperdition de forces plus grande et le condamner à des souffrances plus graves que celles auxquelles cette insuffisance ou ce mauvais emploi et cet excès exposaient l'ouvrier dans un état moins avancé de l'industrie. Lorsque la force physique seule est mise en œuvre, l'insuffisance de sa réparation et l'excès de la durée de son emploi ont des effets presque immédiats: le travailleur perd rapidement ses forces et succombe à la tàche qui lui est imposée. C'est, au contraire, seulement à la longue que l'insuffisance de réparation et le surmenage affaiblissent les facultés intellectuelles et diminuent leur puissance productive, en sorte qu'une population employée à la grande industrie peut supporter, pendant le cours de plusieurs générations, des privations [303] et un surcroît de travail qui eussent promptement épuisé ses forces dans un état moins avancé de la production.
Cette insuffisance de réparation et ce surmenage de ses forces productives, la classe ouvrière en a ressenti les effets délétères, mais sans en discerner les causes, dans la plupart des pays où le progrès a remplacé le travail des muscles par celui des nerfs. Au lieu de remonter à la source du mal, savoir à l'incapacité générale de la classe ouvrière à gérer économiquement son capital personnel, les socialistes l'ont attribué à la « tyrannie du capital » et au régime du salariat, « dernière transformation de la servitude », suivant une expression qu'ils ont empruntée à M. de Chateaubriand. Ils ont prétendu que le salarié est nécessairement exploité par le salariant, que la portion la plus considérable du produit de son travail lui est enlevée par l'entrepreneur capitaliste, dont elle grossit indûment le profit, qu'il faut, en conséquence, remplacer le salariat par une « association » dont ils ne s'accordent point, au surplus, à spécifier les termes, et que ce sera seulement sous ce nouveau régime que l'ouvrier pourra recevoir l'intégralité du produit de son travail.
Si cette thèse était exacte, s'il était vrai que le salarié fut absolument à la merci du salariant, si celui-ci était le maître de fixer à son gré le taux du salaire, il est clair qu'il le fixerait toujours au niveau le plus bas, et que s'il s'en abstenait sous l'influence d'un sentiment philanthropique, la concurrence ne tarderait pas à l'y obliger. Le salaire ne dépasserait donc jamais un minimum de subsistances et il finirait par y être fixé. Or, les faits sont en désaccord complet avec cette théorie socialiste: les salaires ont haussé d'une manière presque continue depuis l'avènement de la grande industrie, et leur taux varie incessamment comme le prix de toute marchandise. Que ressort-il de ces faits, sinon que le salarié n'est point nécessairement à la merci du salariant, et que le régime du salariat est innocent des maux dont les socialistes le rendent responsable? On peut démontrer, au contraire, que le salariat est non point une forme arriérée et vicieuse de la rétribution du travail, mais une forme perfectionnée, et que si elle s'est généralisée, c'est parce qu'elle est la mieux adaptée à la situation et aux convenances de l'ouvrier. Cette démonstration [304] nous l'avons faite ailleurs [27] , mais, avant d'aborder l'examen de la cause principale, nous ne disons pas unique, des souffrances de la classe ouvrière, nous croyons qu'il n'est pas inutile de la résumer.
Nous avons vu que toute entreprise de production nécessite une avance. Aucun produit ne peut être confectionné et réalisé d'une manière instantanée: il s'écoule toujours un temps plus ou moins long, quelquefois des journées, plus souvent des mois, parfois même des années avant qu'il le soit. Nous avons vu encore que toute production comporte des risques, que s'il arrive communément que le produit soit réussi dans la fabrication et réalisé avec profit, il se peut aussi qu'il soit gâté et invendable, ou qu'il ne soit réalisé qu'à perte. En supposant que le régime du salariat n'existât point, que la production fut entreprise par des associés fournissant, ceux-ci le capital personnel de forces physiques, intellectuelles et morales, ainsi que les connaissances techniques nécessaires à la confection de tout produit, ceux-là le capital mobilier et immobilier, non moins nécessaire, de matières premières, de terrains, de bâtiments, de machines, d'outils, il est évident que ni les uns ni les autres, — qu'ils soient séparés ou réunis, — ne pourraient recevoir leur part des résultats de la production, avant que le produit ne fut achevé et réalisé, et qu'ils auraient à courir les risques de la fabrication et de la réalisation. Ils devraient s'avancer à eux-mêmes leur part comme aussi se l'assurer eux-mêmes, et, par conséquent, employer à cette avance et à cette assurance un capital mobilier, sous forme de subsistances et de moyens d'entretien, en ayant soin d'y ajouter la somme indispensable pour faire face aux risques, dans le cas où le produit ne serait point réussi, ne pourrait être réalisé ou le serait à perte. Ce capital le possèdent-ils, ou s'ils le possèdent, ne peut-il leur convenir mieux de lui donner un autre emploi? S'ils ne le possèdent point, peuvent-ils l'emprunter à un taux moins élevé que celui qu'ils paient actuellement aux détenteurs du capital d'entreprise qui leur avancent et leur assurent leur part du produit? Considérez [305] l'immense majorité des travailleurs salariés, nous pourrions dire la presque totalité et rendez-vous compte de leur situation. Bien rares sont ceux qui possèdent le capital nécessaire à l'avance et à l'assurance de leur part de produit, plus rares encore sont ceux qui pourraient l'emprunter à un taux inférieur à celui qu'ils paient au capital d'entreprise. Dans cette situation, ne leur est-il pas plus avantageux de recevoir la rétribution de leur travail sous la forme d'un salaire, c'est-à-dire sous la forme d'une part actuelle et assurée que sous la forme d'une part d'associé, différée et incertaine? Le salaire est donc une forme perfectionnée et non une forme arriérée de la rétribution du travail, et la mieux adaptée à la situation des travailleurs. Ce qui suffirait, au surplus, à le démontrer, c'est qu'une entreprise qui se bornerait à offrir aux ouvriers, ses coopérateurs, une part différée et incertaine d'associé au lieu de la part actuelle et certaine du salarié, ne parviendrait point à recruter son personnel.
Mais est-ce à dire que les frais de l'avance et de l'assurance que supporte l'ouvrier et qui réduisent d'autant sa part dans le produit ne puissent être diminués?
Ils peuvent l'être, même indépendamment de toute modification dans les rapports du capital d'entreprise avec le travail. Ils le sont chaque fois qu'un progrès dans le mécanisme de la production ou de la réalisation du produit réduit la durée de l'une ou de l'autre, partant celle de l'avance. Ils le sont encore chaque fois qu'un progrès analogue réduit le taux des risques, partant celui de la prime nécessaire pour les couvrir. Dans les pays et aux époques où ces risques sont particulièrement élevés, le taux de la prime à déduire de la part de l'ouvrier est considérable; il s'abaisse avec les risques dans les pays et aux époques où l'industrie est moins exposée aux perturbations et aux pertes causées par la guerre, les changements des tarifs douaniers et des autres impôts, l'improbité et le défaut de capacité de sa clientèle commerciale.
Cependant, la durée de l'avance et le taux des risques ne sont pas les seuls éléments qui déterminent le prix auquel le capital d'entreprise fait payer aux ouvriers salariés ses services de banquier et d'assureur. Ce prix est subordonné encore à celui que le capital d'entreprise est obligé de payer [306] lui-même aux capitalistes qui l'engagent dans la production. Celui-ci dépend à la fois de la forme des entreprises et des garanties morales et matérielles que les entrepreneurs d'industrie offrent aux capitalistes. Dans les branches de la production, qui appartiennent exclusivement à des entreprises individuelles à capital immobilisé, où les entrepreneurs ne possèdent que de faibles ressources et ne jouissent que d'un petit crédit, ils ne peuvent avancer et assurer la part de l'ouvrier que sous la déduction d'un gros intérêt et d'une forte prime d'assurance. Il en est autrement dans les industries exercées par de grandes entreprises à capital mobilisable. Celles-ci peuvent se procurer à meilleur marché leur capital d'entreprise et par conséquent remplir, à meilleur marché aussi, leur office de banquier et d'assureur vis-à-vis de l'ouvrier salarié. D'où cette conclusion que le progrès qui remplace les entreprises individuelles à capital immobilisé par des sociétés à capital mobilisable, a pour premier effet d'élever le salaire de l'ouvrier, en diminuant les frais de l'avance et de l'assurance.
D'autres progrès peuvent encore contribuer à ce résultat. en simplifiant économiquement l'organisation des entreprises. Au lieu d'enrôler individuellement le personnel dont il a besoin, et de le rétribuer de même, avant que le produit soit réalisé, l'entrepreneur pourrait confier à un intermédiaire spécial, soit à une société dite de marchandage, l'exécution des travaux nécessaires à la confection des produits, en reculant le paiement de ces travaux jusqu'à l'époque approximative de la réalisation. Au lieu de recevoir un prix ferme pour sa coopération, cet intermédiaire pourrait même être rétribué simplement au moyen d'une part éventuelle dans le produit. Dans le premier cas l'avance sera faite à l'ouvrier par l'intermédiaire, l'assurance seule resterait à la charge de l'entreprise; dans le second cas, l'intermédiaire se chargerait de l'avance et de l'assurance, et si cet intermédiaire était une société puissante, à capital mobilisable, elle pourrait remplir cet office à meilleur marché que ne peuvent le faire, dans l'organisation actuelle des entreprises, la plupart des entrepreneurs. On peut supposer enfin, qu'aux ouvriers qui préfère raient se faire à eux-mêmes l'avance de leur part de produit [307] et l'assurer eux-mêmes, l'intermédiaire se bornerait à remettre cette part intacte, sous la déduction d'une simple commission. Mais rencontrerait-on beaucoup d'ouvriers disposés à profiter de cette dernière combinaison? Sous ce nouveau régime comme sous le régime actuel, il y a grande apparence que l'immense majorité continuerait à préférer de recevoir sa part dans le produit des entreprises, sous la forme d'une part avancée et assurée, c'est-à-dire d'un salaire, plutôt que sous celle d'une part différée et aléatoire. Ceci pour les mêmes raisons qui font préférer à la grande majorité des capitalistes l'intérêt fixe afférent aux obligations à la part éventuelle de profit afférent aux actions.
Les progrès que nous venons de signaler et qui seront tôt ou tard réalisés, parce qu'ils se résolvent en un progrès économique de la division du travail, auront certainement pour résultat de diminuer les frais de l'avance et de l'assurance de la part du travail, mais il convient de remarquer qu'ils ne profiteront point, sauf peut-être à l'origine, aux ouvriers en tant qu'ouvriers. Car la rétribution des ouvriers ne peut dépasser, d'une manière régulière et permanente, la somme nécessaire pour entretenir et reconstituer leurs forces productives avec adjonction du profit rémunérateur du temps utilisé. S'il arrivait que, par le fait d'une réduction sur les frais de l'avance et de l'assurance, le salaire vint à dépasser le taux nécessaire de la rétribution du travail, la concurrence agirait avec une impulsion progressive pour l'y ramener. Les bénéfices des progrès réalisés dans le régime des entreprises, au chapitre des rapports du capital et du travail, vont ainsi finalement, non à la classe particulière des ouvriers, mais à la généralité des consommateurs.
De cette démonstration, ne ressort-il pas, avec évidence, que le régime du salariat ne peut être rendu responsable des maux de la classe ouvrière? Comment donc se fait-il que cette classe n'ait pas profité, dans une plus large mesure, de l'accroissement énorme de la productivité de l'industrie; que la durée du travail qui lui est imposée soit demeurée excessive et que sa rétribution soit tombée trop souvent au-dessous du taux nécessaire? Sans parler des causes générales qui agissent incessamment pour jeter la perturbation dans le [308] monde économique et ralentir le développement de la richesse, il y a une cause particulière qui empêche la classe ouvrière de profiter autant qu'elle le devrait, du progrès général. Cette cause se résume dans son incapacité à gérer économiquement son capital personnel. Une simple comparaison entre la gestion du capital personnel sous le régime de l'esclavage ou du servage, et sous le régime de la liberté, en montrera toute l'importance.
Dans les contrées où la plupart des industries, agricoles et autres étaient naguère encore exercées par des esclaves, dans les états du sud de l'Union américaine, à Cuba, au Brésil, les propriétaires de plantations de sucre, de coton, etc., considéraient leurs esclaves comme un capital aussi bien que leurs terres, leurs bâtiments, leur bétail, leurs machines, outils et approvisionnements. Chacun de leurs nègres, aptes au travail, représentait une fraction plus ou moins considérable de ce capital, selon la grandeur et la durée probable de sa capacité productive. Comment s'établissait le revenu de ce capital? D'une part, on calculait ce que coûtait l'esclave, en frais d'acquisition ou d'élève et d'entretien (nourriture, vêtement, logement, frais médicaux, etc.), pendant la durée de son existence: d'une autre part, ce que produisait son travail, soit que le propriétaire employât lui-même son esclave, soit qu'il le louât à un planteur ou à tout autre entrepreneur d'industrie. La différence entre les frais de production de l'esclave et le produit de son travail constituait le bénéfice du propriétaire. Ce bénéfice, il était intéressé à le porter au taux le plus élevé possible, par conséquent à abaisser les frais de production du travail esclave et à en prolonger la durée. Cependant, il y avait un minimum au-dessous duquel ces frais ne pouvaient être abaissés et un maximum de durée qui ne pouvait être dépassé sans dommage pour l'esclave et pour le propriétaire lui-même. Il fallait non seulement que l'esclave fut nourri et entretenu d'une manière suffisante, mais encore qu'on évitât de le surmener. Car en lui imposant une tâche trop prolongée, on épuisait ses forces et on abrégeait la durée de son activité productive. Il fallait aussi et surtout qu'on s'abstint d'assujettir les enfants à un travail prématuré, qui empêchât le plein développement de leurs forces. Il fallait, de plus, que l'on [309] prit soin des vieillards, sous peine de décourager les hommes valides et d'affaiblir le ressort de leur activité. Il fallait enfin que l'on proportionnât aussi exactement que possible la reproduction de la population esclave au débouché qui lui était ouvert tant par l'emploi direct que par la location. Quand la reproduction était insuffisante, une partie des ateliers agricoles et autres étaient réduits à chômer faute de bras, quand elle était surabondante, ou il fallait conserver l'excédent inactif, ou, si on le mettait au marché, subir une baisse qui faisait rapidement tomber le prix de vente ou de location de l'esclave au-dessous de ses frais de production, et mettait son propriétaire en perte.
Telles étaient les conditions et les exigences de la gestion économique du capital personnel de la généralité des travailleurs, sous le régime de l'esclavage. Cette gestion impliquait des soins et une surveillance qui étaient rétribués par le profit que les propriétaires d'esclaves tiraient de l'exploitation du travail de la population assujettie.
En devenant libre, le travailleur n'a pas cessé, au point de vue économique, d'être ce qu'il était sous le régime de l'esclavage: un capital. Seulement, il est devenu propriétaire de ce capital et libre d'en user à sa guise. En même temps, il a pu réaliser le profit que s'attribuait auparavant son maître, mais comme lui, à la condition de gérer économiquement sa propriété. De même qu'un propriétaire d'esclaves, avide, négligent et imprévoyant s'exposait à subir une perte sur l'exploitation de leur travail au lieu de recueillir un profit, et à diminuer la valeur du capital investi dans ses esclaves au lieu de l'accroître, en ne leur accordant qu'une subsistance insuffisante, en les laissant, faute de surveillance et de soin, s'adonner à l'ivrognerie et aux autres vices destructeurs de la santé et des forces vitales, en les assujettissant à un travail prématuré et excessif, en les multipliant de manière à encombrer le marché du travail et à en faire baisser le prix, après en avoir amoindri la qualité, l'ouvrier libre qui ne possède pas la capacité intellectuelle et morale nécessaire pour gérer économiquement son capital personnel s'expose non seulement à la perte du profit, mais encore à la dépréciation du capital et aux maux inévitables dont cette dépréciation est la source.
[310]
Ces maux, la classe ouvrière, émancipée de l'esclavage et du servage, les aurait évités si elle avait réglé elle-même, librement, sa production et sa consommation comme les réglaient d'autorité les propriétaires d'esclaves ou de serfs; si elle avait proportionné sa production et son offre à la demande du marché, de manière à empêcher le prix courant de son travail de tomber au-dessous du prix nécessaire; si elle avait reparti utilement sa rétribution entre ses besoins actuels et futurs, si elle s'était abstenue d'assujettir ses enfants à un travail prématuré et excessif. Elle aurait alors, comme le faisaient les propriétaires d'esclaves, capables et soigneux de leurs intérêts, conservé et accru ses forces productives, elle aurait couvert non seulement ses frais de production, mais encore elle aurait recueilli tout le profit que le propriétaire d'esclaves tirait de l'emploi ou de la location de leur travail.
Malheureusement, cette capacité nécessaire à la gestion de la propriété et à l'exercice de la liberté, la classe ouvrière, hâtivement émancipée, ne la possédait qu'à une dose insuffisante, et, d'ailleurs, à l'époque de son émancipation et dans les premiers temps qui l'ont suivie, elle se trouvait dans un milieu et sous un régime économique et légal qui la plaçaient dans un état d'infériorité vis-à-vis de sa clientèle de consommateurs de travail en l'obligeant le plus souvent, à subir leurs conditions. De là des misères et des souffrances que les socialistes ont attribuées au salariat et à la tyrannie du capital, mais qu'une analyse plus exacte fait remonter à des causes qui ne sont pas toutes à l'avantage de la classe ouvrière.
Cependant, la mauvaise gestion du capital personnel n'est pas seulement dommageable à ceux qui le possèdent, elle est une cause d'infériorité pour la production dont le capital personnel est un des coopérateurs indispensables. Dans les pays où les travailleurs n'obtiennent point leur rétribution nécessaire ou bien encore où ils font de cette rétribution un emploi nuisible, les industries qui fournissent à la population ses moyens d'existence sont exposées à succomber sous la concurrence de celles des pays où le capital personnel est économiquement géré, et le péril va s'aggravant à mesure que l'aire de la concurrence s'étend et qu'elle peut s'exercer avec plus d'énergie. Un moment doit donc arriver où le [311] progrès de la gestion du capital personnel s'imposera comme tout autre, sous peine de ruine pour les travailleurs et de destruction pour l'industrie. C'est ainsi que la nature oblige les hommes à faire l'emploi le plus utile des forces qu'elle a déposées en eux ou mises à leur disposition, en éliminant impitoyablement ceux qui refusent d'obéir à ses lois, et que son gouvernement, à défaut de celui de l'individu lui-même, assure la conservation et détermine le progrès de l'espèce.
[312]
CHAPITRE VI
L'accroissement de la mobilisabilité des produits.↩
Diminution successive des frais de production jusqu'à la limite naturelle du progrès. — Que les frais de production ne sont qu'un point idéal vers lequel le prix courant gravite. — Condition nécessaire de cette gravitation. — La mobilisabilité des produits. — Le commerce. — Comment le commerce s'est spécialisé et étendu dans l'espace et le temps. — Progrès qui ont contribué à son extension. — La publicité commerciale. — Les frais de transport des produits dans le temps. — La spéculation. — Son utilité. — Résumé de l'opération des lois naturelles pour déterminer l'équilibre de la production et de la consommation. — Progrès réalisés par la mobilisabilité des produits et l'unification des marchés.
Nous venons de voir que les lois naturelles de l'économie des forces et de la concurrence agissent pour abaisser progressivement les frais de production de la multitude des produits nécessaires à la satisfaction des besoins de l'homme. Cet abaissement s'opère d'abord par l'établissement de la sécurité, qui détermine la création et la multiplication des entreprises, en garantissant aux producteurs la jouissance des fruits de leur industrie, sous déduction des frais et servitudes qu'exige cette sorte d'assurance, ensuite par un ensemble de progrès techniques, tels que l'accroissement de la puissance productive de l'outillage, la localisation et la constitution de plus en plus économique des entreprises, la réduction de la rétribution nécessaire du matériel et du personnel, celle-ci s'accomplissant par l'amoindrissement de la proportion [313] du personnel des entreprises et l'accroissement de sa productivité. A mesure que ces divers progrès se réalisent, les frais de la production vont diminuant, et l'espèce humaine obtient en échange d'une moindre dépense de travail et de peine une plus grande somme de forces vitales et de jouissances. Toutefois, l'abaissement des frais de la production a une limite qui ne peut être dépassée et qui est déterminée par la nature particulière de chaque industrie. L'humanité sera donc toujours obligée d'acheter la satisfaction de ses besoins et l'acquisition de ses jouissances par une dépense préalable de travail et de peine. Cette dépense sera successivement diminuée jusqu'à ce que la limite naturelle du progrès de chaque industrie soit atteinte; elle ne sera jamais entièrement supprimée.
Cependant cette dépense de frais ou ce « prix nécessaire » qu'il faut payer pour entretenir et reconstituer d'une manière permanente les agents et les matériaux de la production et déterminer ceux qui les possèdent à les y engager, n'est qu'un point idéal vers lequel gravite le prix courant du marché, c'est-à-dire le prix réel, auquel les produits sont fournis à ceux qui en ont besoin et qui ont les moyens de les payer. Tantôt le prix courant, le prix réel, descend au-dessous du prix nécessaire, tantôt il s'élève au-dessus, et ses variations en hausse ou en baisse sont incessantes. Mais quelles que soient ces variations, le prix courant est constamment ramené au niveau du prix nécessaire par l'opération combinée des lois naturelles de la concurrence et de la progression des valeurs. Comment les choses se passent-elles? Le prix courant de tout produit ou service est déterminé par le rapport des quantités offertes et demandées, le prix baisse; il hausse dans le cas contraire, mais cette baisse ou cette hausse ne s'opère pas simplement dans la proportion du déplacement des quantités: à mesure que la quantité d'un produit ou d'un service offert au marché augmente ou diminue en raison arithmétique, le prix de ce produit ou de ce service s'abaisse ou s'élève en raison géométrique. (Sauf le ralentissement causé par la diminution de la demande à mesure que le prix s'élève, ralentissement qui varie suivant la nature des besoins auxquels les produits [314] ou les services répondent). Quelle est la conséquence de ce phénomène? c'est, en cas de hausse, que le profit du producteur s'élève avec une rapidité croissante et qu'il s'amoindrit de même et fait bientôt place à une perte, en cas de baisse. Dans le premier cas, la pression de la concurrence, accélérée par la loi de progression, agit promptement pour combler le déficit. Dans le second cas, cette pression se ralentit non moins promptement jusqu'à ce que l'excédent ait disparu. Le résultat, c'est une tendance générale et constante à l'équilibre de la production et de la consommation, de l'offre et la demande au niveau du prix nécessaire, c'est-à-dire du prix que le producteur doit obtenir pour pouvoir créer le produit d'une manière continue et le mettre à la disposition des consommateurs.
Tel est le mécanisme au moyen duquel la nature ajuste la production avec les besoins. C'est sous l'impulsion de ce mécanisme naturel que s'opère la circulation utile des produits et des services dans l'espace et le temps. Elle ne peut s'opérer toutefois qu'à une condition: c'est que les produits ou les services soient circulables ou pour employer une expression plus claire, mobilisables; c'est qu'ils puissent être portés toujours sur le point de l'espace et du temps où ils sont le plus demandés et le moins offerts, où on peut, par conséquent, les réaliser avec le plus grand profit. L'appât de ce profit les y attire jusqu'à ce que la concurrence ramène le prix et le profit au taux nécessaire. Il en est autrement lorsque le produit ou le service n'est point mobilisable ou lorsque des obstacles extérieurs entravent ses mouvements. Alors on voit se succéder, parfois à de courts intervalles de lieu et de temps, la surabondance et la disette, engendrant au détriment tantôt des producteurs tantôt des consommateurs des écarts plus ou moins considérables entre le prix courant ou prix du marché et le prix nécessaire. Telle était la situation sous l'ancien régime de la production. Nous avons vu que la coutume ou la réglementation intervenait alors pour suppléer aux lois naturelles dont l'opération était empêchée par l'impossibilité de mobiliser les produits au delà d'un rayon ordinairement très court. Elle y suppléait, quoique d'une manière imparfaite, en fixant approximativement le prix courant au niveau du prix nécessaire [315] et en obligeant ainsi les producteurs à régler en conséquence les quantités qu'ils offraient au marché. Mais dans les branches de la production agricole où les récoltes sont à la merci des accidents de la température, les prix du marché variaient en dépit de la coutume ou de la loi, tombant au-des-sous du prix nécessaire dans les années de surabondance, s'élèvant au-dessus dans les années de disette.
Des progrès de toute sorte ont mis fin à cet état de choses rudimentaire, en accroissant la mobilisabilité de la généralité des produits. Grâce à l'extension de l'aire de la sécurité, au perfectionnement et au développement des moyens de transport, les marchés les plus éloignés des lieux de production sont devenus accessibles à tous les produits, même à ceux qui étaient considérés jadis comme les moins transportables. Aux marchés étroits et isolés de l'ancien régime a succédé un « marché général » où toutes les entreprises agricoles, industrielles et autres versent continuellement leurs produits. D'un autre côté, grâce aux progrès des procédés de conservation d'un grand nombre de produits, à la consolidation de la sécurité et à la multiplication des capitaux nécessaires à ce genre de transport, la sphère de la mobilisabilité s'est étendue dans la temps comme dans l'espace. Le marché de la généralité des produits et services a reculé déjà et il recule de plus en plus ses limites, il tend à devenir illimité.
Mais le transport des produits et services dans l'espace et le temps exigeait un organe adapté à cette fonction. Cet organe s'est créé comme tous les autres lorsque le besoin s'en est fait sentir, et il s'est développé dans la mesure de ce besoin. C'est le commerce. Réuni originairement à l'industrie, il s'en est séparé, par un progrès de la division du travail accompli sous l'impulsion des lois de l'économie des forces et de la concurrence.
Au début de l'industrie humaine, lorsque les producteurs agricoles et autres approvisionnaient seulement le marché limité qui avoisinait leurs ateliers, ils remplissaient deux fonctions naturellement distinctes: la création ou la confection du produit et l'apport de ce produit à la consommation. Ces deux fonctions impliquaient chacune des facultés spéciales: celles de l'agriculteur ou de l'industriel et celles du [316] marchand, — celles-ci exigeant, avec la connaissance du marché, l'aptitude à choisir l'endroit et le moment où le produit était le plus nécessaire, partant le plus demandé, où il pouvait être échangé avec le plus de profit. Néanmoins, si distinctes qu'elles fussent, elles ne pouvaient être divisées qu'à une condition: c'est que le marché s'étendit assez pour que le producteur trouvât plus de profit à appliquer la totalité de son temps et de ses capitaux à la confection du produit qu'à les partager entre la confection et le placement ou le débit. Supposons, par exemple, un producteur qui emploie une partie de son temps et de ses capitaux à la confection de 500 pièces d'étoffes, et une autre partie à la recherche des consommateurs et au débit en détail de ces 500 pièces qu'il vend à raison de 50 francs, soit 25,000 francs, et sur lesquelles il réalise un profit de 40 p. 100, soit 10,000 francs. Le marché venant à s'étendre de manière à absorber 1,000 pièces, le producteur peut employer avec plus de profit la totalité de son temps et de ses capitaux à la confection de ces 1,000 pièces, en laissant à un marchand auquel il les vendra en bloc, le soin de les débiter en détail. Supposons qu'il se contente d'un profit de 20 p. 100 et qu'il vende ses étoffes à raison de 40 francs, il gagnera encore 10,000 francs, tandis que le marchand gagnera les 10,000 autres, en débitant les étoffes au prix primitif de 50 francs. Ceci, en admettant que les frais de la production et du débit demeurent les mêmes. Mais, d'une part, la production de 1,000 pièces d'étoffes revient proportionnellement moins cher que celle de 500; et cette diminution du prix de revient augmente le profit et le porte, par hypothèse, à 12,000 francs au lieu de 10,000; d'une autre part, le marchand peut remplir la fonction de vendeur, à laquelle il s'adonne exclusivement, avec plus d'économie et d'efficacité que ne le faisait le producteur. La concurrence agit d'abord pour obliger les producteurs à réaliser ce progrès de la division du travail, ensuite, lorsqu'il est accompli, pour en attribuer le profit aux consommateurs.
A mesure que les obstacles qui limitaient la mobilisation des produits ont été aplanis, la fonction du commerce s'est étendue et compliquée. Il ne s'agit plus aujourd'hui comme autrefois de mettre une petite quantité de produits peu variés, [317] à la disposition des consommateurs concentrés dans un marché étroit, et dont la demande ne subit que de faibles changements d'une année à une autre. Il s'agit de distribuer la multitude de produits que l'accroissement de la productivité de l'industrie augmente sans cesse et qui sortent tous les jours de plusieurs millions d'ateliers, entre d'innombrables consommateurs répandus sur toute la surface du globe et dont la demande varie continuellement dans le cours du temps. Mais à mesure que sa tache s'étend et se complique, le commerce se développe et se perfectionne en divisant son travail de manière à y suffire. Cette tache consiste, en premier lieu, dans le transport des produits dans l'espace, et elle implique d'abord, à la fois, la connaissance des foyers de production où le produit est le moins cher et celle des marchés de consommation où il l'est le plus, où, par conséquent, on peut le porter avec le plus d'utilité et de profit. De là, la nécessité de recueillir, au moyen d'une enquête quotidienne, des informations précises sur l'état des foyers de production et des marchés, nécessité à laquelle il a été pourvu par un nouveau progrès de la division du travail, savoir la création d'une industrie spéciale, celle de la publicité commerciale, qui a pour instrument l'électricité et la presse. Grâce à ce progrès, accompli comme tous les autres sous l'impulsion des lois de l'économie des forces et de la concurrence, l'état des approvisionnements, de la demande et des prix a pu être éclairé à giorno dans toute l'étendue du marché agrandi des échanges et mis jour par jour et, pour ainsi dire, heure par heure sous les yeux des intéressés. Cependant, la connaissance du marché acquise, il fallait y transporter rapidement et aux moindres frais les produits. Un autre progrès y a pourvu encore. Une branche spéciale, celle du commerce de transport, s'est détaché du tronc, et elle a apporté, avec une célérité croissante, de tous les points du globe, en se servant du puissant auxiliaire de la vapeur, les articles acquis en gros par les grands établissements commerciaux et mis par le commerce de détail à la disposition des consommateurs. C'est ainsi, qu'à mesure que le marché des échanges s'est agrandi par l'extension de la sécurité et l'aplanissement de l'obstacle des distances, le commerce a suffi aux exigences croissantes de sa tâche de [318] mobilisateur des produits dans l'espace. L'effet de cette mobilisation a été d'équilibrer, dans toute l'étendue du marché, l'offre avec la demande et de déterminer la fixation du prix courant au niveau du prix nécessaire le moins élevé.
La fonction du commerce consiste, en second lieu, à mobiliser les produits dans le temps. La généralité des produits doivent être transportés dans le temps, aussi bien que dans l'espace, car le moment où ils sont acquis pour la consommation est toujours plus ou moins éloigné de celui où ils sortent de l'atelier du producteur. Les frais de ce transport sont proportionnés au temps pendant lequel il s'effectue, et au coût des agents nécessaires pour l'effectuer. Ces agents sont le capital mobilier servant à avancer la valeur du produit, le capital immobilier servant à l'emmagasiner et le capital personnel (le travail) employé à veiller à sa conservation. Les frais de transport dans le temps sont grevés en outre d'un risque, savoir de la baisse du prix du produit dans l'intervalle de l'achat à la vente, risque compensé, à la vérité, par une chance de gain, en cas de hausse. Quand il s'agit d'articles dont la production peut être réglée par la volonté de l'homme et dont la consommation est peu sujette à varier, dont le « marché futur » ne diffère pas sensiblement du marché actuel, cet aléa est insignifiant, et le commerce peut aisément mesurer ses approvisionnements sur les probabilités de la demande. Alors aussi le prix du marché futur se nivelle comme celui du marché actuel avec le prix nécessaire.
Mais il en est autrement lorsqu'il s'agit d'articles dont la production dépend, pour une part, des accidents de la température, tels que les produits agricoles ou dont la consommation est sujette à de fortes variations. Alors il peut se produire et il se produit des différences considérables entre le prix du marché et le prix nécessaire. Si comme il arrive d'habitude les accidents de la température occasionnent une surabondance de production dans certaines contrées et une insuffisance dans d'autres, le commerce nivelle les prix en transportant les excédents des premières dans les secondes. Mais il peut arriver aussi que ce transport effectué il reste un excédent, et que le prix du marché général s'abaisse [319] au-dessous du taux nécessaire. En ce cas, la différence ne peut être comblée que par un transport dans le temps. Cette sorte de transport, ni les producteurs, ni les commerçants, dont la fonction consiste à mettre les produits à la disposition des consommateurs dans les conditions et les délais ordinaires, ne possèdent les capitaux et les aptitudes nécessaires pour l'effectuer. Aussi parviennent-ils rarement à l'accomplir avec succès et profit. Cependant, chaque fois qu'une opération répond à un besoin et peut donner un profit, les lois naturelles agissent pour déterminer la création de l'organe qui y est adapté: cet organe nécessaire au transport, dans le temps, des articles dont la production est exposée à des variations indépendantes de la volonté des producteurs, un progrès de la division du travail le crée, c'est le commerce de spéculation. Cette branche de commerce, comme les autres, exige d'abord la connaissance du marché. Mais il ne s'agit pas seulement de celle du marché actuel, il s'agit encore de celle du « marché futur », c'est-à-dire d'un marché dont la situation ne peut être établie par des informations positives, et dont on ne peut avoir la prévision que par une opération, une « spéculation » de l'esprit. S'il résulte de cette prévision du spéculateur que tel article sera plus demandé et moins offert dans un moment à venir, dans trois mois, six mois, un an qu'il ne l'est au moment présent, il y aura profit à l'y porter et cette opération sera avantageuse à la fois au producteur, au consommateur et au spéculateur: elle empêchera l'avilissement actuel du prix au détriment du producteur et son exhaussement futur au détriment du consommateur, tout en procurant un profit au spéculateur si ses prévisions ont été justifiées. La multitude, qui manque généralement de la notion de la prévoyance, se montre d'habitude hostile à une branche de commerce dont la prévoyance est la base, et elle se scandalise plus encore de l'élévation des profits que recueillent certains spéculateurs. Est-il nécessaire de dire cependant que ces profits sont proportionnés aux risques extraordinaires qui sont inhérents à toute spéculation? Si le spéculateur achète par exemple des grains pendant une année d'abondance dans la prévision que l'année suivante sera moins féconde, il se pourra que cette prévision soit démentie [320] par l'événement, que les années d'abondance se succèdent et que les prix aillent s'avilissant. Dans ce cas. le spéculateur perdra la différence aggravée des frais de transport dans le temps. Il faut donc que cet aléa soit couvert par une prime correspondante sinon les capitaux employés à la spéculation ne pourront être intégralement reconstitués, et cette branche nécessaire de l'appareil de mobilisation des produits disparaîtra au grand dommage des producteurs et des consommateurs que sa disparition laissera exposés aux fluctuations désastreuses de la surabondance et de la disette.
On voit, en résumé, comment les lois naturelles s'associent pour déterminer l'équilibre de la production et de la consommation, de l'offre et de la demande, au niveau du prix nécessaire (c'est-à-dire du prix qu'il faut payer pour assurer la production continue du produit ou du service) et ramener perpétuellement à ce niveau le prix réel auquel s'opère l'échange, le prix courant ou prix du marché. La loi de l'économie des forces agit, sous l'impulsion du mobile de la peine et du plaisir pour déterminer l'apport des forces productives dans la branche d'industrie où elles répondent au besoin le plus intense, où elles sont le plus demandées, où elles obtiennent le prix le plus élevé et le plus grand profit. La loi de la concurrence agit, à son tour, dans le même sens; elle suscite l'augmentation des quantités produites jusqu'à ce que le prix et le profit soient abaissés au taux nécessaire, et son opération est corroborée par la loi de progression qui diminue le prix et le profit en raison géométrique, lorsque l'apport s'accroît en raison arithmétique. Les mêmes effets se manifestent en sens inverse lorsque, au lieu d'un déficit, il se produit une surabondance ou une surproduction. Pas plus que le déficit, la surabondance ou la surproduction ne peut être considérable et durable, car il suffit d'une faible quantité surabondante pour provoquer une baisse progressive du prix courant qui, en le faisant tomber au-dessous du prix nécessaire, détermine la destruction ou le retrait d'une portion des forces productives; de même qu'il suffit d'une faible quantité manquante pour élever progressivement le prix courant au-dessus du taux nécessaire, de manière à attirer avec une rapidité croissante dans l'industrie en déficit un supplément de forces productives.
[321]
Cependant ces mouvements de l'offre et de la demande qui déterminent le prix courant des produits et services et le font graviter continuellement vers le prix nécessaire, ne peuvent s'opérer qu'autant que les produits et services puissent être transportés du lieu et du moment où ils sont créés dans ceux où ils sont demandés, c'est-à-dire qu'autant qu'ils soient mobilisables. Leur mobilisabilité dépend de leur nature et des circonstances du milieu. Mais quelle qu'elle soit, elle exige l'intervention d'un agent de mobilisation, dont la fonction consiste à transporter les produits dans l'espace et le temps en les prenant chez le producteur pour les mettre à la disposition du consommateur dans le lieu et le moment où il en a besoin, où il les demande.
Sous l'ancien régime de la production, la mobilisabilité de la généralité des produits était étroitement limitée par le défaut de sécurité au delà d'un court rayon de l'espace et même du temps, l'insuffisance et la cherté des moyens de transport. Le monde était alors divisé en une multitude de marchés, généralement isolés ou n'ayant entre eux que des communications rares et précaires. Sur ces marchés morcelés l'agent de mobilisation, le commerce était peu développé, souvent même il ne se séparait point de l'industrie. Il se bornait à porter les produits encore peu variés et en petite quantité dans le court rayon de l'espace et du temps où ils étaient mobilisables. Enfin le prix nécessaire de ces produits variait d'un marché à un autre, selon la fécondité du sol, la nature du climat, le degré d'avancement de l'industrie, la rétribution qu'exigeaient les agents de la production. Les lois naturelles n'en agissaient pas moins pour faire graviter le prix courant du marché vers le prix nécessaire, mais leur opération utile était entravée par l'insuffisance de la mobilisabilité des produits, l'équilibre ne s'établissait qu'imparfaitement, et avec une déperdition considérable de forces vitales. S'il s'agissait de produits dont la production pouvait être réglée à la volonté des producteurs, leur tendance naturelle était de limiter les quantités produites de manière à élever le prix du marché au-dessus du prix nécessaire. Il fallait que la pression de l'opinion exercée par l'instrument de la coutume ou de la loi, agit, à défaut de la concurrence, pour fixer le prix [322] courant au niveau du taux nécessaire, en les déterminant par là même à produire et à mettre au marché des quantités suffisantes pour le faire descendre à ce taux. Mais si la coutume ou la loi avait le pouvoir de les obliger à approvisionner le marché au taux nécessaire, elle était impuissante à les contraindre à réaliser des progrès qui eussent abaissé ce taux. S'il s'agissait de produits dont la production ne dépendait que pour une part de la volonté de l'homme, des denrées alimentaires par exemple, la coutume ou la loi demeurait impuissante: dans les années de surabondance, l'équilibre ne s'établissait que par la destruction de l'excédent ou la ruine des producteurs, dans les années de disette, par l'accroissement de la mortalité des consommateurs.
Sous le nouveau régime de la production, tel que l'ont fait l'extension de la sécurité, la multiplication et le perfectionnement des moyens de communication, et le développement du commerce, la mobilisabilité de la généralité des produits s'est accrue dans des proportions extraordinaires, et elle est devenue pour ainsi dire illimitée aussi bien dans l'espace que dans le temps. Grâce à ce progrès, les marchés ont tendu à s'unifier. Aux marchés étroits et morcelés de l'ancien régime a succédé un marché général où les produits de toutes provenances sont versés en concurrence pour toutes destinations. Sur ce marché général qu'éclaire une enquête permanente, la production, en tant qu'elle dépend de la volonté des producteurs, peut être proportionnée à la consommation avec autant de facilité et de sûreté qu'elle l'était sur les marchés de l'ancien régime, et elle tend continuellement à l'être au niveau le plus bas du prix nécessaire. Chaque fois qu'elle s'en écarte, la concurrence et la loi de progression l'y ramènent aussitôt et elles agissent en même temps pour abaisser ce niveau. En ce qui concerne les produits dont il ne dépend pas de la volonté des producteurs de régler exactement les quantités, l'agent mobilisateur, développé et perfectionné en raison de l'extension du débouché qui lui est ouvert, reporte les excédents qui se produisent d'un point de l'espace et du temps sur un autre, de manière à établir l'équilibre avec un minimum de déperdition de forces vitales.
Ce mécanisme naturel détermine avec une précision [323] merveilleuse la production et la distribution utiles des produits, à la seule condition que ses mouvements soient libres; que les produits et les services puissent être portés sans obstacles des lieux et des moments où ils sont produits dans ceux où ils sont demandés, c'est-à-dire, grâce aux progrès qui ont accru leur mobilisabilité, dans toutes les parties du vaste marché du monde. Si l'équilibre qu'il a pour fonction d'établir est encore trop fréquemment rompu, s'il en résulte des crises et des catastrophes qui se répercutent désormais dans toute l'étendue d'un marché devenu illimité, cela tient aux obstacles qui n'ont pas cessé d'entraver la liberté de ses mouvements, et qui occasionnent, dans la production et la distribution des produits, des désordres dont la multitude ignorante rend responsable l'instrument même que la nature emploie pour les réprimer et rétablir l'ordre.
[324]
CHAPITRE VII
L'accroissement de la mobilisabilité des capitaux.↩
La demande des capitaux. — Leur provenance. — Leur mode de réalisation. — Le taux nécessaire de leur rétribution. — Le prêt des capitaux. — La limitation du taux de l'interêt. — Les intermédiaires et leurs fonctions. — Les instruments de la circulation et du crédit. — La monnaie réelle et la monnaie fiduciaire. — Le commerce de banque, agent de la mobilisation des capitaux. — Les marchés des capitaux. — Les capitaux immobilises et les capitaux mobilisables. — La gravitation du taux courant vers le taux nécessaire.
Le même mécanisme naturel qui fait graviter le prix courant des produits vers le prix nécessaire pour en déterminer d'une manière continue la production, et qui suscite la création du rouage intermédiaire dont la fonction consiste à les mettre à la disposition des consommateurs dans le lieu et dans le moment où ceux-ci en ont besoin et les demandent, le même mécanisme disons-nous fait graviter le taux courant de la rétribution des agents productifs, capitaux mobiliers, immobiliers et personnels, qui constituent le matériel et le personnel des entreprises, vers le taux nécessaire pour les mettre et les maintenir au service de la production, et il suscite, de même aussi, la création d'un autre rouage, destiné comme le premier à les distribuer utilement dans l'espace et le temps.
Il y a, comme nous l'avons vu, deux sortes d'agents productifs, ceux qui constituent le matériel des entreprises, matières premières, subsistances et objets d'entretien avancés au [325] personnel, outils, machines, terrains, bâtiments, bétail. etc., et que l'on désigne sous les dénominations de capitaux mobiliers et immobiliers, et ceux qui constituent le personnel des entrepreneurs, directeurs, employés, ouvriers et que nous avons désignés sous le nom de capitaux personnels.
Il ne faut pas perdre de vue que les uns et les autres se composent de valeurs investies dans des produits. Il n'existe point de capitaux qui ne soient point investis dans des produits. On ne peut donc multiplier les capitaux qu'à la condition de multiplier les produits. Seulement les produits ne passent à l'état de capitaux que lorsqu'ils sont mis en réserve ou épargnés en attendant de recevoir un emploi ou engagés dans la production.
Les progrès réalisés dans la plupart des branches de l'industrie humaine, particulièrement depuis un siècle. ont eu pour effet d'augmenter, dans des proportions jusqu'alors sans précédent, la demande des capitaux. Il suffit pour se rendre compte de ce phénomène de jeter un coup d'œil sur la multitude croissante des entreprises dans lesquelles s'opère la production des articles multiples qui servent à la satisfaction des besoins des peuples civilisés: entreprises agricoles, industrielles, commerciales, artistiques, scientifiques, littéraires, politiques. Chaque année, on voit, dans un pays en progrès, s'en créer de nouvelles ou s'accroître les anciennes, et cette création ou cet accroissement exige un supplément de capital et en provoque la demande. S'il s'agit d'une nouvelle entreprise agricole, il faudra un capital investi dans le produit-terre, un autre capital investi dans les produits-bâtiments, outils, machines, semences, un autre encore investi dans la monnaie destinée au paiement des salaires, si le personnel est composé de travailleurs libres ou à l'acquisition et à la subsistance de ce personnel s'il est composé d'esclaves. S'il s'agit d'une manufacture, il faudra acquérir ou louer des bâtiments, des machines, des outils, acheter des matières premières, salarier des employés et des ouvriers. S'il s'agit d'une mine, il faudra creuser des puits et des galeries. S'il s'agit d'un chemin de fer, il faudra acquérir les terrains, faire construire la voie, les bâtiments, et le matériel des transports. S'il s'agit d'une entreprise commerciale, il faudra acheter [326] des marchandises, d'une entreprise de guerre, il faudra se procurer des armes, des munitions, enrôler des officiers et des soldats, salarier les uns, nourrir les autres, pourvoir aux approvisionnements et aux transports. Ces capitaux investis dans la multitude des agents et des matériaux nécessaires aux entreprises, et qu'elles demandent, d'où proviennent-ils et sous quelle forme leur sont-ils offerts? Ils proviennent des entreprises existantes qui ont donné un produit net, en sus des frais de reconstitution de leurs capitaux, et de l'épargne qui a soustrait à la consommation immédiate une portion de ce produit net, en vue de l'appliquer soit à la consommation future soit à un accroissement de production partant de revenu. Ces valeurs issues du produit net et soustraites à la consommation forment des capitaux et, mises au marché, constituent l'offre.
Sous quelle forme se réalisent-elles d'habitude et se présentent-elles au marché des capitaux? Elles se réalisent et s'investissent dans un produit qui remplit la fonction d'intermédiaire universel des échanges, qui possède un pouvoir général et permanent d'acquisition ou de location de toute sorte de produits et services, savoir dans la monnaie. Mais, comme le remarquait Adam Smith, la monnaie n'est qu'un accumulateur et un agent de transport dans l'espace et le temps, elle ne sert qu'à accumuler la valeur dans les mains de celui qui l'épargne, en échangeant contre de la monnaie au lieu de le consommer, le produit dans lequel elle était investie au sortir de l'atelier de production (en admettant que cet échange n'ait pas été préalablement effectué), et à la transporter jusqu'à ce qu'elle arrive aux mains du producteur qui échange à son tour la monnaie contre les produits et services dont il a besoin. C'est donc investies dans le produit-monnaie que les valeurs sont offertes au marché des capitaux. A quelles conditions peuvent-elles y être offertes d'une manière continue? A la condition qu'elles soient perpétuellement reconstituées, et que leurs détenteurs reçoivent en outre une rétribution qui compense le dommage que la privation de leur capital peut leur infliger, et le risque qu'ils peuvent courir en s'en dessaisissant, enfin qui rémunère leur gestion.
Cette compensation de la privation, cette couverture des [327] risques et cette rémunération de la gestion constituent le taux nécessaire de la rémunération des capitaux offerts sous forme de monnaie. Ce taux s'élève plus ou moins selon le degré d'intensité de la privation, et d'élévation des risques, selon les difficultés plus ou moins grandes que présente le choix et la surveillance des placements, partant la gestion du capital. Le prix courant du loyer de cet instrument de transport des capitaux dépend du rapport de l'offre et de la demande, mais il gravite incessamment vers le taux nécessaire. Quand les nouvelles entreprises se multiplient, quand les anciennes s'accroissent, la demande s'élève, et le taux courant du prêt ou loyer de la monnaie, tend à dépasser le taux nécessaire; mais alors aussi l'exhaussement du profit des prêteurs provoque l'accroissement de l'offre, jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli. Si l'offre vient à dépasser la demande, le taux courant, descend au-dessous du taux nécessaire, et celui-ci cessant d'être couvert, une portion du capital se retire du marché jusqu'à ce que l'équilibre soit de nouveau rétabli. Dans le premier cas, on dit que l'argent est abondant et dans le second qu'il est rare.
Ainsi donc le producteur de capitaux, après a voir réalisé, sous forme de monnaie, les produits de son industrie ou en avoir reçu sa part à titre de coopérateur salarié ou intéressé, et transformé en capital par l'opération de l'épargne une portion de cette monnaie, la conserve pour subvenir à ses besoins futurs, ou l'emploie à accroître son industrie, ou l'engage, moyennant une participation éventuelle et aléatoire au profit, dans quelque entreprise, ou la prête, moyennant une part avancée et plus ou moins assurée, autrement dit, un intérêt, dont le taux nécessaire est équivalent à celui du profit, déduction faite du montant de l'avance et de l'assurance. Mais à l'origine, la demande des capitaux, sous forme de monnaie, était extrêmement limitée: chacun produisant la plupart des articles nécessaires à sa consommation, les échanges étaient peu nombreux. Les impôts ou redevances étaient fournis en nature et le prêt des capitaux s'effectuait de même, sous forme de blé, de bétail, etc. Ce fut seulement lorsque la division du travail se développa et que les échanges commencèrent à se multiplier que l'usage de la monnaie se répandit et [328] qu'on l'employa comme intermédiaire des échanges et comme accumulateur de valeur, offices auquel sa durée, son peu de volume et sa divisibilité la rendaient plus propre que le blé ou tout autre produit. Mais le peu de productivité de l'industrie, encore à l'état embryonnaire, rendait l'épargne difficile. Les capitalistes étaient peu nombreux; les capitaux accumulés sous forme de monnaie et offerts au marché restreint de la cité étaient rares. D'un autre côté, ceux qui les demandaient, le plus souvent, pour subvenir à des besoins urgents, ne présentaient qu'une sécurité insuffisante, et l'intensité du besoin qui les poussait à emprunter dépassait celle du besoin de prêter. Dans ces conditions du marché, l'intérêt s'élevait à un taux excessif, et l'on s'explique que la dureté des conditions du prêt ait soulevé l'opinion contre l'usure et déterminé l'établissement des coutumes et des lois limitatives du taux de l'intérêt. Ces coutumes et ces lois avaient sans doute le défaut d'empêcher la création d'un certain nombre d'entreprises, mais elles prévenaient, dans quelque mesure, l'exploitation des gens imprévoyants et des dissipateurs par les usuriers. On conçoit donc qu'Adam Smith leur ait trouvé plus d'avantages que d'inconvénients. Cependant, à la longue, l'industrie est devenue de plus en plus productive, et une quantité croissante de produits ont été échangés contre de la monnaie: l'offre des capitaux s'est accrue sous cette forme, tandis que la multiplication des entreprises en accroissait, d'une autre part, la demande. En même temps, l'extension de la sécurité et le développement des moyens de communication agrandissaient le marché des valeurs capitalisées sous forme de monnaie plus encore que celui des autres produits moins transportables. Alors il y eut profit à séparer les fonctions qui étaient primitivement réunies chez le capitaliste: la production, l'emmagasinage et le commerce des capitaux. Ces fonctions exigeaient, en effet, des facultés distinctes, et la dernière impliquait la connaissance du marché et l'appréciation des garanties que présentaient les emprunteurs, — connaissance et appréciation qui devenaient plus difficiles à mesure que le marché s'étendait. Dans cette nouvelle situation, les producteurs de capitaux trouvèrent plus de profit à les confier à des intermédiaires qui se chargèrent de les [329] conserver et de les placer moyennant rétribution, parfois aussi de garantir la sécurité du placement, qu'à les placer eux-mêmes. Le commerce de banque prit naissance. Les banquiers se bornèrent d'abord à recevoir les capitaux accumulés sous forme de monnaie et à les conserver, moyennant rétribution, dans des caisses où ils se trouvaient plus en sûreté que chez les épargneurs, jusqu'à ce que ceux-ci les retirassent pour subvenir à leurs besoins futurs ou pour les placer. A cette fonction de conservateurs, ils joignirent bientôt celle de placeurs. Mieux en mesure que les épargneurs eux-mêmes de connaître les endroits où les capitaux étaient le plus demandés et le moins offerts, comme aussi de s'informer du degré de solidité des emprunteurs, ils pouvaient placer les capitaux d'une manière plus profitable et plus sûre. Le placement des capitaux par intermédiaires s'est généralisé en conséquence, on a vu les établissements du commerce des capitaux se multiplier, et, à leur tour, se spécialiser et s'échelonner comme ceux des autres branches de commerce. Les uns s'occupent particulièrement de l'escompte des effets de commerce, les autres de la négociation des emprunts d'état, de l'émission des actions et obligations de chemins de fer, de mines et de toute sorte d'entreprises, d'autres encore de prêts hypothécaires. Tantôt les banques sont de simples commissionnaires: elles se bornent à acheter, moyennant une commission, les obligations des états ou les obligations et actions des entreprises particulières que leur désignent les épargneurs eux-mêmes; tantôt elles leur offrent des obligations qu'elles émettent et dont elles emploient le montant en prêts hypothécaires; tantôt enfin, elles reçoivent les épargnes en dépôt sans intérêt, à charge de les rembourser à vue, tantôt avec intérêt et remboursables au bout d'un certain délai, en se chargeant de les faire fructifier: elles trouvent leur profit dans la différence du taux auquel elles empruntent et de celui auquel elles prêtent. Mais il ne faut pas perdre de vue que la monnaie, et, d'une autre part, les titres, qui sont les instruments de leurs opérations, représentent des valeurs réelles incarnées dans des produits existants. La monnaie dite réelle a sa valeur incorporée dans le métal dont elle est faite. La monnaie fiduciaire, papier-monnaie ou billets de banque, n'a de valeur [330] qu'autant qu'elle représente une créance toujours réalisable sur d'autres valeurs incorporées dans des produits existants. Les titres contre lesquels les épargneurs ou les intermédiaires échangent la monnaie, effets de commerce, titres d'emprunts publics, autrement dit obligations des états, des provinces ou des communes, obligations et actions des entreprises privées représentent: les effets de commerce une créance provenant de la vente d'une marchandise à terme, les titres d'emprunt une créance sur le produit des impôts et les autres revenus d'un gouvernement, et ils n'ont d'autre valeur que celle qu'ils puisent dans l'existence des biens qui fournissent ces impôts et ces revenus; les actions et les obligations représentent des valeurs incorporées dans les chemins de fer, les mines, les habitations, les terrains, etc., qui constituent le capital de ces entreprises. De même que le commerce ordinaire est l'agent de mobilisation des produits dans l'espace et le temps, le commerce de banque est l'agent de mobilisation des capitaux. Il va les chercher dans les endroits et dans les moments où ils sont offerts en plus grande abondance et au plus bas prix pour les porter dans ceux où ils sont le plus demandés, où ils peuvent obtenir le prix le plus élevé. L'accomplissement de cette fonction d'intermédiaire implique, avant tout, le besoin de connaître ce marché, et ce besoin a suscité la création de la publicité financière et des Bourses, où les informations viennent se concentrer et où s'opère l'échange des titres représentatifs des capitaux. Grâce à l'instantanéité des communications par l'électricité, tous les marchés de capitaux du monde se trouvent pour ainsi dire réunis, et les informations qui viennent y affluer sont immédiatement recueillies et publiées par la presse. Suivant ces indications, les capitaux disponibles se portent vers les placements que les capitalistes jugent les plus profitables, et il en résulte un nivellement général des intérêts des obligations, des profits ou dividendes des actions, sauf la différence des risques, tels que l'opinion les apprécie et qui est marquée par l'inégalité des cours des titres représentatifs des capitaux. Ce nivellement s'étend au delà des limites de chaque marché, à mesure que les autres sont mieux connus et deviennent plus accessibles. Les capitaux délaissent les placements les moins profitables du marché local [331] ou national pour se porter vers les placements étrangers: ici le revenu des capitaux s'élève, tandis qu'il s'abaisse là. Ce mouvement s'accomplit, en dépit de tous les obstacles, et il a pour résultat, avec la distribution la plus utile du capital, l'égalisation progressive du taux de l'intérêt ou du profit des placements. C'est par l'opération de ce mécanisme naturel que les capitaux des vieux pays où la production et l'épargne sont particulièrement fécondes, où en même temps la demande ne suffit pas à l'offre, se portent dans les pays neufs où l'offre ne suffit pas à la demande. C'est ainsi que l'Angleterre, la Hollande, la France, la Suisse, sont devenues les fournisseurs habituels de capitaux des états-Unis, de l'Amérique du Sud, de l'Australie, de la Russie et des autres pays où la production des capitaux demeure inférieure tant à la consommation productive qu'en font les particuliers, agriculteurs, industriels, commerçants, qu'au gaspillage improductif des gouvernements. Est-il nécessaire d'ajouter que le transport des capitaux d'un pays à un autre ne s'effectue pas seulement sous forme de monnaie, bien que les obligations ou les actions émises soient réalisées sous cette forme: la monnaie absorbée par une émission ou un emprunt étranger sert le plus souvent à acheter, dans le pays exportateur, du matériel destiné aux entreprises agricoles, industrielles, commerciales, politiques et militaires du pays importateur.
Cependant les capitaux représentés par des titres mobilisables tels que les actions des entreprises, constituées sous forme de sociétés anonymes et les obligations de ces mêmes sociétés et des gouvernements, ne forment encore, au moment où nous sommes, que la moindre portion de la généralité des capitaux engagés dans la production. La portion la plus considérable est investie dans les entreprises individuelles ou en nom collectif et elle est représentée par des titres constatant la propriété des capitaux investis sous forme de terres, de bâtiments, de machines, d'outils, de matériaux, soit que ces capitaux se trouvent engagés en vue d'un profit, d'un intérêt ou d'un loyer. Ces titres ne sont qu'imparfaitement mobilisables, et il résulte de là que les capitaux qu'ils représentent ne peuvent être rendus disponibles qu'après des délais et moyennant des frais qui doivent être compensés par un surcroît de [332] profit ou d'intérêt. C'est là, comme nous l'avons remarqué, une cause d'infériorité qui finira par déterminer, en dépit de tous les obstacles, la transformation des entreprises individuelles à capital immobilisé, en entreprises collectives à capital mobilisable. En attendant, les profits ou les intérêts que fournissent les unes ne peuvent dépasser, sauf d'une manière accidentelle et adjonction faite de la compensation pour la privation du capital immobilisé, ceux que fournissent les autres.
Enfin, le taux courant des profits ou des intérêts des capitaux immobilisés ou mobilisables ne peut pas davantage, sauf le cas d'un monopole naturel ou artificiel, s'écarter longtemps ni dans une mesure sensible du taux nécessaire. Quand les capitaux viennent à être plus offerts que demandés sur un marché, de manière à tomber au-dessous du taux nécessaire, ou bien l'excédent s'écoule dans les marchés où ils sont plus demandés et moins offerts, ou bien cet excédent retiré du marché est conservé inactif, dans les caisses des banques ou des particuliers jusqu'à ce que le retrait et l'accroissement de la demande déterminent l'exhaussement du taux courant du profit ou de l'intérêt au niveau du taux nécessaire. Dans le cas contraire, les capitaux disponibles affluent au marché de tous les points des pays producteurs d'épargnes, jusqu'à ce que l'équilibre se trouve de nouveau rétabli. Sauf donc le cas de monopole, c'est-à-dire le cas où la loi naturelle de la concurrence est empêchée d'agir, les capitaux qui constituent le matériel de la production ne reçoivent et ne peuvent recevoir, d'une manière régulière et permanente, que la rétribution nécessaire pour les engager dans la production et les y maintenir; de plus, cette rétribution va s'abaissant à mesure que s'accroît leur mobilisabilité.
[333]
CHAPITRE VIII
La mobilisabilité du travail et les causes qui l'entravent.↩
La mobilisabilité, condition de la mise en équilibre du prix courant du travail avec le prix nécessaire. — Insuffisance de la mobilisabilité du capital personnel. — Qu'elle a diminué par la substitution du servage à l'esclavage. — Le commerce des esclaves dans l'antiquité. — La situation du serf. — Celle du travailleur libre. — Obstacles à l'exploitation utile de son travail. — Inégalité originaire de la situation de l'ouvrier libre vis-à-vis de l'entrepreneur, causée par l'absence des intermédiaires. — Comment cette situation s'est améliorée. — Les coalitions. — Leurs avantages et leurs inconvénients. — Les unions et les syndicats. — La fonction nécessaire du commerce de travail. — Conséquences de son développement futur.
De même que le prix courant des produits et le taux courant du profit, de l'intérêt ou du loyer des capitaux investis dans le matériel de la production, le taux courant du profit ou du salaire du capital investi dans le personnel gravite incessamment vers le taux nécessaire. Mais qu'il s'agisse des produits ou des capitaux, ce mouvement déterminé par l'impulsion des lois naturelles ne peut avoir son plein effet qu'à la condition qu'il ne soit empêché ou ralenti par aucun obstacle, autrement dit qu'à la condition que les produits ou les capitaux soient pleinement mobilisables. Nous avons vu comment la mobilisabilité des produits et des capitaux qui constituent le matériel de la production s'est progressivement accrue grâce, d'une part, au développement de la sécurité et des moyens de transport, grâce, d'une autre part, à la création [334] des agents et des instruments de mobilisation, entreprises commerciales, banques, monnaie réelle et fiduciaire, lettres de change, actions, obligations, etc., grâce enfin à la constitution des marchés d'échange, halles, bourses de commerce, bourses des valeurs mobilières, et à la publicité qui éclaire ces marchés. La multiplication et le perfectionnement de ces agents et de ces instruments de mobilisation, depuis l'avènement de la grande industrie, ont permis de transporter avec une rapidité et un bon marché croissant, produits et capitaux dans l'espace et le temps.
Les capitaux personnels n'ont malheureusement participé que pour une faible part à ce progrès. Ils sont demeurés jusqu'à présent moins mobilisables que la plupart des autres, et leur mobilisabilité a même diminué lorsque les travailleurs ont cessé d'être esclaves pour être attachés au sol à titre de serfs. Il ne faut pas oublier que, sous le régime de l'esclavage, la rétribution du travail se composait de deux éléments distincts, savoir: 1° le minimum de subsistances et d'entretien nécessaire pour maintenir l'esclave en état de travailler et pourvoir aux frais de sa reproduction; 2° le profit nécessaire de la gestion et de l'emploi de ses forces productives. Le minimum de subsistances allait à l'esclave, le profit au maître, et ce profit s'élevait ou s'abaissait avec le prix du marché du travail, soit que le maître vendît, louât ou employât lui-même son esclave. Les propriétaires étaient donc intéressés à porter leurs esclaves sur les marchés où le travail servile était le plus demandé et le moins offert. Et le même progrès qui avait séparé le commerce de la production des autres marchandises était intervenu pour opérer cette mobilisation du travail. Aux époques florissantes de l'antiquité, le commerce des esclaves acquit un développement considérable: des multitudes d'esclaves étaient transportés des lieux où ils étaient produits au meilleur marché dans ceux où ils étaient employés avec le plus de profit. Grâce à l'esprit d'entreprise et aux capitaux investis dans cette branche lucrative de commerce, le travail devint la plus mobilisable de toutes les marchandises. Cet état de choses cessa lorsque le servage se substitua à l'esclavage. Les anciens esclaves transformés en serfs étant attachés au sol, le travail [335] se trouva, au moins en grande partie, immobilisé. Cette substitution de servage à l'esclavage n'en fut pas moins avantageuse au travailleur, en ce qu'au lieu de fournir à son maître la totalité de son travail il n'en fournit plus qu'une partie, que la coutume limitait avec plus ou moins d'efficacité. Sur la portion qui lui restait, il put réaliser, en sus de ses frais d'entretien et de reproduction, la part de profit qui allait auparavant au maître. Lorsqu'il fut émancipé du servage, lorsqu'il acquit la pleine propriété de sa personne et passa à l'état de travailleur libre, il pût recueillir ce profit tout entier. Seulement, ce fut à la charge de pourvoir entièrement lui-même à ses frais d'entretien et de reproduction avec le produit de son travail, soit qu'il l'employât pour son propre compte, soit qu'il le louât à un entrepreneur d'industrie, en échange d'un salaire. Il ne pouvait que par exception entreprendre lui-même une industrie. Il loua donc son travail comme le faisaient d'ailleurs fréquemment les propriétaires d'esclaves en s'attribuant le profit de cette location.
En cumulant ainsi le minimum de subsistances de l'esclave et le profit du propriétaire, le travailleur libre pouvait obtenir dans les résultats de la production une part bien supérieure à celle qui revenait à l'esclave ou au serf et se trouver dans une situation préférable matériellement aussi bien que moralement. Mais c'était à deux conditions: la première qu'il pût, comme le faisait auparavant son propriétaire avec l'auxiliaire du commerce, porter son travail sur le marché le plus avantageux sans être contraint par la nécessité de subir la loi de l'employeur, la seconde qu'il fût capable de pourvoir utilement à son entretien et à sa reproduction. Or la généralité des travailleurs devenus libres ne possédaient point comme les propriétaires ou les marchands d'esclaves les ressources nécessaires pour porter leur travail sur le marché le plus avantageux et en débattre librement le prix, et bien peu d'entre eux étaient capables de gouverner utilement leur consommation et leur reproduction.
Arrêtons-nous d'abord au premier point. Qu'il s'agisse de travail ou de toute autre marchandise, le taux auquel s'opère l'échange est déterminé par l'intensité respective des besoins, déterminant à son tour celle de l'offre et de la demande. [336] Lorsque l'intensité du besoin de vendre dépasse celle du besoin d'acheter, le vendeur augmente la quantité offerte avec une rapidité plus grande que l'acheteur n'augmente la sienne, et l'échange se conclut à un taux plus avantageux à celui-ci qu'à celui-là, c'est-à-dire à un taux dans lequel la plus forte part du profit de l'échange revient à l'acheteur. Mais cette inégalité du partage du profit de l'échange ne peut subsister sur un marché libre, où les produits et les services offerts à l'échange sont également mobilisables dans l'espace et le temps.
Dans ce cas, l'inégalité du partage du profit a pour effet immédiat d'accroître la concurrence des échangistes qui obtiennent la plus grosse part du profit et de diminuer celle des échangistes qui obtiennent la moindre part; l'offre s'accroît ainsi d'un côté et se réduit de l'autre, jusqu'à ce que le partage du profit s'opère sur le pied de l'égalité. Seulement, c'est à la condition que les mouvements de la concurrence ne rencontrent point d'obstacles d'un côté ou de l'autre, que les produits ou les services offerts à l'échange soient également mobilisables dans l'espace et le temps. Or, sous ce double rapport, les ouvriers qui offraient leur travail se trouvaient communément, à l'époque où ils en sont devenus propriétaires, dans une situation d'inégalité manifeste vis-à-vis des entrepreneurs d'industrie qui le demandaient. Ils ne disposaient au même degré ni de l'espace ni du temps. Comme le remarquait Adam Smith, l'homme était alors « de toutes les espèces de bagages la plus difficile à transporter. » Cette difficulté avait sa source d'abord dans la rareté et la cherté des moyens de transport et dans l'insuffisance des ressources des ouvriers, ensuite et surtout dans l'absence d'intermédiaires qui se chargeassent de chercher le marché où le travail pouvait se louer avec le plus de profit, en faisant aux travailleurs les avances nécessaires pour l'y porter. A cet égard, l'ouvrier libre se trouvait dans une situation infiniment moins favorable que celle du propriétaire d'esclaves de l'antiquité. Si la difficulté des communications demeurait à peu près la même, le propriétaire d'esclaves possédait des ressources qui faisaient généralement défaut à l'ouvrier libre. En outre, il avait à son service des intermédiaires au courant de la situation des [337] marchés de travail et bien pourvus de capitaux. S'il ne pouvait employer lui-même ses esclaves à un prix rémunérateur, il pouvait, du moins quand il n'était pas pressé par le besoin, s'en défaire avec profit, en les vendant à des marchands qui se chargeaient de les transporter et de les échanger dans le lieu et dans le moment où leur travail était le plus demandé et le moins offert. Il n'était donc point exposé à conserver inactif un surcroît de travailleurs, en supportant les frais de leur entretien, à les employer ou à les louer à un prix non rémunérateur. L'ouvrier libre était placé dans des conditions bien différentes.
Les intermédiaires ayant cessé d'exister lorsque le travail eût été immobilisé par le servage, l'ouvrier libre se trouvait ordinairement confiné dans la localité où il était né et réduit à y débattre les conditions de la location de son travail avec un petit nombre d'entrepreneurs d'industrie, trop souvent coalisés, comme le remarquait encore Adam Smith, et disposant d'ailleurs à un plus haut degré que lui, de l'espace et du temps. Les entrepreneurs possédaient les ressources nécessaires pour importer au besoin du travail de l'étranger, tandis que les ouvriers manquaient des ressources et des informations indispensables pour exporter le leur. Ils pouvaient encore se passer de travail plus longtemps que les ouvriers ne pouvaient se passer de salaire. De là l'avilissement du prix du travail et l'accroissement excessif de sa durée dans les localités où le marché en était encombré. Les lois d'assistance qui encourageaient la multiplication des classes inférieures, contribuaient encore, à aggraver cet état de choses.
Cependant la situation des ouvriers vis-à-vis des entrepreneurs s'est successivement améliorée sous l'influence de causes diverses: leur travail est devenu plus mobilisable dans l'espace, grâce aux progrès des moyens de transport, et au développement lent, mais appréciable, de la prévoyance et de l'épargne; il l'est devenu aussi davantage dans le temps, sous l'influence de ce dernier progrès, ainsi que de l'abrogation des lois qui interdisaient les coalitions et les unions organisées en vue de maintenir ou de faire hausser le taux du salaire par le retrait temporaire du marché et l'emmagasinage du travail. Des ouvriers coalisés et en possession d'une caisse [338] alimentée par leur épargne collective pouvaient ajourner leur offre et en diminuer l'intensité plus longtemps que des ouvriers isolés et vivant au jour le jour. Les coalitions ouvrières demeurent néanmoins inefficaces dans les localités et les métiers, où le marché est encombré, où l'offre du travail dépasse la demande, car elles laissent subsister l'excédent qui déprime le taux du salaire. C'est la mobilisation dans l'espace qui peut, seule, faire disparaître cet excédent, et celle-ci ne peut s'opérer que par la création d'un rouage intermédiaire qui sépare la production et le commerce du travail. Dans l'état actuel des choses, l'ouvrier libre est encore généralement obligé de cumuler les deux fonctions, naturellement distinctes, de producteur et de marchand de travail. Alors même qu'il possède toute la capacité requise pour exercer la première, il ne dispose ni du temps, ni des ressources, ni des informations nécessaires pour remplir fructueusement la seconde. Comme la généralité des producteurs, comme autrefois le propriétaire d'esclaves, il a besoin d'un intermédiaire pour le placement de sa marchandise. Les ouvriers ont essayé de suppléer eux-mêmes à l'absence ou à l'insuffisance de cet intermédiaire en organisant des unions ou syndicats qui se chargent de remplir ses fonctions. Mais ces unions ou ces syndicats, animés d'habitude d'un esprit d'hostilité à l'égard des entrepreneurs sont peu propres à attirer leur clientèle; les associations ouvrières ne possèdent d'ailleurs ni la capacité spéciale, ni les capitaux et le crédit indispensables pour développer le commerce du travail dans la mesure utile. On peut prévoir cependant que ce progrès ne tardera plus longtemps à s'accomplir. Selon toute apparence, le commerce du travail sera dans un avenir prochain, comme l'est déjà le commerce des grains et celui des grands articles de consommation, comme il l'était sous le régime de l'esclavage, exercé par des entreprises bien pourvues de capitaux et munies de moyens d'information assez prompts et assez sûrs pour porter régulièrement le travail des marchés où il est plus offert que demandé, dans ceux où il est plus demandé qu'offert.
On peut prévoir aussi, dès à présent, quelle sera la conséquence de ce progrès. Lorsque le « capital personnel » sera [339] devenu pleinement mobilisable dans le temps et l'espace, le prix courant du travail ou le salaire sera comme le taux de l'intérêt des capitaux mobiliers ou le prix des marchandises, déterminé uniquement par la proportion des quantités offertes et demandées sur le marché, sans que l'intensité inégale du besoin de vendre ou d'acheter agisse pour faire pencher la balance en faveur du vendeur ou de l'acheteur. Car les deux parties disposeront également de l'espace et du temps, et tout excédent ou tout déficit qui romprait cette balance et avec elle celle du profit de l'échange pourrait être, aussitôt, retiré ou comblé. Il n'y aurait plus, en conséquence, ici encombrement de travail, là insuffisance, comme il arrivait pour les denrées alimentaires à l'époque où l'approvisionnement utile des marchés était empêché par la difficulté et la cherté des transports, les prohibitions douanières et surtout par le défaut d'intermédiaires. Il pourrait se produire, sans doute, une surabondance générale si la reproduction des travailleurs autrement dit la production du « capital personnel » était excessive par rapport à celle du capital mobilier et immobilier. Mais, dans ce cas, l'excédent pèserait sur le prix courant du travail et le ferait descendre au-dessous du taux nécessaire, tandis que la rétribution des deux autres catégories de capitaux s'augmenterait d'une rente. La production du capital personnel se trouverait ainsi découragée et celle des capitaux mobiliers et immobiliers encouragée jusqu'à ce que l'équilibre fut rétabli. La situation inverse se produirait si la production du capital personnel venait à tomber au-des-sous de la proportion déterminée par les besoins des entreprises.
En résumé, le prix courant du travail, ou, en termes équivalents, le taux courant du loyer du capital personnel, comme celui des autres capitaux gravite, sous l'impulsion des lois naturelles, vers le taux nécessaire, comprenant les frais de production et d'entretien du travailleur et sa part de profit. Celle-ci, que s'attribuait jadis le propriétaire d'esclaves, revient aujourd'hui à l'ouvrier libre, propriétaire de son travail. Seulement, elle ne lui revient qu'à deux conditions: la première, c'est qu'il sache comme le faisait le propriétaire d'esclaves avec l'auxiliaire du commerce, mobiliser utilement [340] son capital dans l'espace et le temps et qu'il n'en soit pas empêché, la seconde, c'est qu'il possède la capacité requise pour le conserver en gouvernant utilement, comme le faisait encore le propriétaire d'esclaves, sa consommation et sa reproduction.
[341]
IX
Le bilan de l'émancipation des classes ouvrières.↩
La conservation du capital personnel sous le règime de l'esclavage. — L'insuffisance de la capacité de gestion de l'ouvrier libre. — Difficultés de la gestion du capital personnel. — Les obligations qu'elle implique. — Bilan de l'emancipation des travailleurs. — Que l'actif de ce bilan dépasse le passif. — Amélioration de la condition des ouvriers capables du self government. — Causes qui ont dèprimé la condition des moins capables. — Le self government obligatoire et ses effets. — Le budget de l'ivrognerie. — Le dérèglement de la reproduction. — L'exploitation du travail des enfants et ses conséquences. — Nécessité d'une tutelle qui remédie au défaut de capacité de la gestion du capital personnel.
Sous le régime de l'esclavage, soit que l'on considère ce régime dans les sociétés de l'antiquité ou dans la période de son établissement dans le nouveau monde, le capital personnel investi dans les esclaves constituait la portion principale de la richesse de la classe des propriétaires. C'est pourquoi ils veillaient avec un soin particulier à la conservation et à l'accroissement utile de ce capital. Le mobile auquel ils obéissaient en s'appliquant à subvenir, dans la mesure nécessaire, aux besoins de leurs esclaves, de manière à les conserver vigoureux et sains, en les empêchant de s'adonner aux vices destructeurs de leurs forces et de leur santé, en évitant de les surmener, et surtout de les assujettir, avant l'âge, à des travaux de force, ce mobile n'avait, certes, rien de bien élevé: c'était le même mobile intéressé qui les poussait à veiller à la [342] bonne conservation de leur bétail. Mais il n'en était pas moins efficace et bienfaisant. Il y avait, sans doute, de mauvais propriétaires qui maltraitaient leurs esclaves et les assujettissaient à un labeur excessif; il y avait aussi des propriétaires négligents ou trop indulgents qui ne les surveillaient point et les laissaient s'adonner à l'ivrognerie ou à d'autres vices honteux; mais c'était le petit nombre. La plupart se conduisaient, à l'égard de cette portion importante de leur cheptel, en propriétaires vigilants et soigneux de leur fortune. Ce qui l'atteste, au surplus, c'est la longue durée du régime de l'esclavage et la rareté des révoltes d'esclaves.
En devenant libre, l'esclave acquérait, comme nous l'avons vu, la possibilité de s'attribuer à lui-même le profit afférent à son travail, en revanche, c'était à la charge de pourvoir à la conservation et à l'accroissement utile à son capital personnel. Possédait-il la capacité et les moyens nécessaires pour remplir cette tâche, à l'égal de son ancien propriétaire? Jusqu'à une époque récente, on se serait fait scrupule d'en douter. On était généralement convaincu qu'en s'affranchissant de l'esclavage, par un procédé ou par un autre, en acquérant la liberté, tout homme, quelle que fût sa race ou sa couleur, se trouvait aussitôt et par là même investi de la capacité de se gouverner soi-même. L'expérience a malheureusement dissipé cette illusion. Si l'on étudie, sans parti pris, les causes des maux actuels des classes qui vivent exclusivement de l'exploitation de leur capital personnel, on trouvera que la principale réside dans leur incapacité à gérer utilement ce capital.
Nous avons vu en quoi consiste cette gestion, et quelles conditions elle implique. En premier lieu, elle exige un partage du revenu entre les besoins actuels et les besoins futurs, impliquant l'exercice de la prévoyance et la constitution d'une épargne; en second lieu, l'emploi d'une autre partie de ce revenu à la reproduction du capital personnel, dans la proportion du débouché qui lui est ouvert. Nous venons de voir aussi comment le propriétaire d'esclaves, obéissant à un mobile intéressé, opérait ce triple partage, à son profit et à celui de ses esclaves eux-mêmes.
L'ouvrier libre n'est certainement pas moins intéressé à la conservation de son capital personnel que ne l'était le [343] propriétaire d'esclaves. En revanche, il lui est plus difficile de régler lui-même sa consommation et sa reproduction que cela ne l'était autrefois à son maître. Celui-ci n'avait à faire qu'une opération intellectuelle et une manifestation de sa volonté, déterminées l'une et l'autre par son intérêt, pour imposer à ses esclaves les règles auxquelles ils étaient tenus de se soumettre, en matière de consommation et de reproduction. L'ouvrier qui doit s'imposer librement ces règles, imposées d'autorité à l'esclave, non seulement manque trop souvent de la connaissance exacte de son intérêt, mais encore il est obligé de surmonter des obstacles et des tentations que n'avait point à combattre le propriétaire d'esclaves. Il est intéressé à régler utilement sa production et sa consommation actuelles, soit! Mais il trouve des obstacles dans ses passions et ses vices. Il est obligé de vaincre sa paresse pour s'assujettir à un travail continu et régulier, auquel il a cessé d'être astreint sous peine d'une correction sévère et immédiate. Il doit surmonter son goût pour les liqueurs excitantes, goût qui ne tarde pas à dégénérer en un penchant héréditaire à l'ivrognerie, sans oublier d'autres vices inhérents à la nature humaine. En supposant même qu'il ait la force morale indispensable pour réprimer lui-même ces goûts et ces penchants destructifs de ses forces productives, il lui restera à faire d'abord la répartition nécessaire de son revenu entre sa consommation actuelle et sa consommation future. Possède-t-il assez d'intelligence pour se faire une idée exacte des risques, — risques de chômage, de maladie, risque inévitable de la vieillesse et de l'affaiblissement de ses facultés, — et de la somme qu'il doit mettre en réserve pour y pourvoir, avec la force morale qu'exige l'accumulation de cette épargne, achetée, s'il n'a qu'un revenu faible et précaire, au prix des privations les plus dures? Enfin, il n'a pas à pourvoir seulement au gouvernement de sa propre individualité. Il a acquis le droit de fonder une famille, et sa reproduction a cessé d'être réglée et limitée au gré d'un maître. Il est époux et père, et il a sur sa femme et ses enfants l'autorité que son maître avait jadis sur lui et sur eux. Il est tenu, en même temps, de subvenir à leurs besoins. Il est tenu aussi de régler sa reproduction dans son intérêt comme le propriétaire d'esclaves la réglait [344] dans le sien. Ici encore se dressent des obstacles et apparaissent des tentations qu'il faut vaincre. Si l'inégalité originaire de sa situation vis-à-vis de l'entrepreneur, inégalité que le progrès des agents et des instruments de mobilisation commence seulement à effacer, si, disons-nous, cette inégalité ne lui permet point d'obtenir un salaire suffisant pour subvenir à la fois à la conservation et à la reconstitution de son capital de forces productives, ou s'il est incapable de surmonter les penchants qui font obstacle au règlement utile de sa consommation et de sa reproduction, il devra mettre au marché le travail de sa femme et de ses enfants, en obligeant l'une à négliger l'accomplissement de ses devoirs d'épouse et de mère, en soumettant les autres à une tâche nuisible au développement de leurs forces productives. De plus, cet apport d'un supplément de travail au marché ne manquera pas d'aggraver encore l'inégalité de sa situation vis-à-vis de l'entrepreneur et d'abaisser le niveau général des salaires.
Est-ce à dire que la liberté ait été pour les classes ouvrières un présent funeste, et qu'il faille regretter les progrès qui ont déterminé leur émancipation? Non sans doute. Si l'on pouvait dresser le bilan de la liberté, faire le compte de ce que l'abolition successive de l'esclavage et du servage a rapporté aux classes autrefois assujetties, et de ce que leur a coûté l'insuffisance de leur capacité à user utilement du capital personnel dont elle leur a conféré la propriété, on trouverait certainement qu'au double point de vue de l'intérêt général de la société et de l'intérêt spécial des classes émancipées, l'actif de ce bilan dépasse le passif. Si l'esclavage et, dans une mesure moindre, le servage, assuraient la conservation et la reproduction utiles du capital personnel des classes ouvrières, cette assurance était achetée à un prix qui énervait chez elles, s'il ne le détruisait point, le mobile de leur activité productive, savoir l'espérance de réaliser un profit rémunérateur de leur travail et de leur peine. A défaut de ce profit que s'attribuait le propriétaire d'esclaves ou de serfs, elles n'étaient excitées au travail que par la crainte d'un châtiment ou la pression de la nécessité. Cette crainte du châtiment ou cette pression de la nécessité pouvaient bien les déterminer à exécuter la tâche qui leur était imposée, elle était impuissante [345] à les exciter à faire les efforts nécessaires pour rendre leur travail plus productif, puisqu'elles n'en auraient pas obtenu elles-mêmes le profit. Les maîtres le comprenaient si bien que les plus intelligents d'entre eux abandonnaient un pécule, c'est-à-dire une part de profit à leurs esclaves pour obtenir d'eux un déploiement d'activité que la crainte des châtiments n'avait pas le pouvoir de susciter. Devenues libres, les classes jus-qu'alors assujetties, ont mis en œuvre toute leur énergie productive, elles ont perfectionné leur industrie et développé en elles, les facultés nécessaires à l'exercice du self government, qu'elles n'avaient pas à déployer lorsqu'elles étaient gouvernées d'autorité. Ces progrès ont été laborieux et lents, sans doute, mais on ne saurait les contester et ils ont largement contribué à l'accroissement extraordinaire de la production et de la richesse, dans les pays où la liberté a remplacé l'esclavage et le servage. C'est l'actif du bilan de l'émancipation du travail. Si nous examinons maintenant comment cet actif s'est distribué, nous trouverons encore que les classes émancipées en ont obtenu la plus grande partie: la portion la plus industrieuse et la plus capable du self government s'est élevée à une condition supérieure: elle a constitué la bourgeoisie. Une autre portion forme l'élite de la classe ouvrière. Malgré les obstacles qu'oppose encore, d'une part, à l'accroissement de leur richesse et de leur bien-être, le maintien et même l'aggravation des charges et des servitudes de l'état de guerre, d'une autre part, l'imperfection de leur self government et de celui de la multitude, demeurée en retard, leur condition s'est continuellement améliorée. Quoique les socialistes affirment que la bourgeoisie seule a profité des progrès de l'industrie, il est incontestable que la condition des ouvriers les plus capables du self government est aujour-d'hui bien supérieure à ce qu'elle était il y a un siècle. L'accroissement de la consommation des articles de confort, l'augmentation progressive des 'dépôts des caisses d'épargne et la diffusion des valeurs mobilières jusque dans les couches inférieures de la population, suffiraient à l'attester.
Cependant, en regard de cet actif du bilan de l'émancipation des classes ouvrières vient se placer un lourd passif. Il est impossible de se dissimuler que, même dans les pays les plus [346] avancés en civilisation, la condition de la majorité des classes émancipées ne s'est point élevée d'un mouvement égal à celui de la richesse, et même que cette condition est devenue sinon plus misérable du moins plus précaire. Les causes qui ont agi et n'ont pas cessé d'agir pour la déprimer peuvent être rangées en trois grandes catégories. La première est une cause générale qui ralentit dans l'ensemble du monde civilisé le progrès de la richesse et en trouble la distribution: c'est la prolongation artificielle d'un régime politique et économique qui a cessé d'être adapté aux conditions actuelles d'existence des sociétés, et qui leur inflige des charges et des servitudes dont le poids retombe par une série inévitable de répercussions sur la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. La seconde, c'est la situation inégale où se trouvent encore, fréquemment, les ouvriers vis-à-vis des entrepreneurs, dans le débat du salaire, sous l'influence des obstacles qui entravent la mobilisation du travail dans l'espace et le temps. Cette situation inégale, le développement des moyens de communication et la suppression des entraves légales opposées aux coalitions l'ont toutefois sensiblement atténuée, et elle disparaîtra comme disparaissent celles qui existaient entre les prêteurs et les emprunteurs, les producteurs et les consommateurs de denrées de première nécessité, à mesure que la séparation du commerce du travail d'avec la production et le perfectionnement de ce rouage intermédiaire rendront le travail de plus en plus mobilisable. Enfin, la troisième cause réside dans l'incapacité de la majorité de la classe ouvrière à conserver et à accroître utilement son capital personnel. Cette incapacité, des esprits généreux l'ont niée, en se fondant sur une égalité prétendue des races et même des individualités humaines, d'autres se sont bercés de l'espoir que l'exercise obligatoire des facultés intellectuelles et morales nécessaires au self government aurait la vertu de les développer, et de rendre ainsi la multitude de plus en plus capable de supporter la responsabilité attachée à la liberté. L'expérience n'a répondu, il faut le dire, que partiellement et insuffisamment à ces prévisions optimistes. Si l'élite des classes ouvrières a acquis, par l'exercice de sa responsabilité, une capacité plus grande [347] de self government, il n'en a pas été ainsi de la majorité. Comme il arrive toujours, quand on impose à un individu une tâche dépassant ses forces, le résultat a été non un accroissement, mais un dépérissement et un affaiblissement physique et moral de cette multitude soumise au self government obligatoire, sans posséder encore, à un degré suffisant, les facultés qu'il exige. Elle s'est comportée comme le feraient des enfants que l'on affranchirait de toute tutelle avant l'âge de raison. Au lieu de préparer une génération plus forte, plus intelligente et morale, cet affranchissement hâtif aurait pour résultat inévitable de l'affaiblir et de la corrompre.
Quel a été l'effet de la liberté, rendue obligatoire, sur les hommes-enfants qui formaient la majorité des classes émancipées? Comment ont-ils pourvu aux obligations qu'implique le self government? Comment ont-ils employé leur revenu et l'ont-ils réparti entre leur consommation actuelle et future et leur reproduction? Si l'on examine leur consommation actuelle, on sera frappé de ce qu'elle a d'excessif, en comparaison de la consommation future. Il semble que la multitude qui forme la couche inférieure des sociétés civilisées ne soit guère plus douée que les peuplades encore à l'état sauvage, de la faculté de la prévoyance: elle dépense son revenu au jour le jour, pour satisfaire ses besoins actuels sans se préoccuper des besoins et des risques de l'avenir. Les socialistes prétendent à la vérité que ce revenu suffit à peine à la satisfaction de ses besoins de première nécessité, que telle est la loi d'airain qui régit le salaire. Mais, à défaut d'autres témoignages, l'accroissement de la consommation des liqueurs fortes suffirait à démentir cette affirmation. Depuis que les classes ouvrières sont libres de gouverner leur consommation, elles ont employé une portion croissante de ce revenu réputé insuffisant à l'acquisition des boissons enivrantes. En Angleterre, le budget de l'ivrognerie s'est élevé jusqu'au deux-tiers du montant du budget de l'état, et il n'a pas atteint des proportions moindres aux états-Unis, en Russie, et dans la plupart des autres états civilisés. En supposant que les classes inférieures eussent consacré à la satisfaction des besoins de la « consommation future », les sommes qu'absorbe annuellement ce seul vice, elles se trouveraient pleinement assurées [348] contre les risques du chômage, des accidents et de la vieillesse. Elles se sont montrées plus incapables encore de régler utilement leur reproduction, et de remplir les obligations qu'elle implique. Aussitôt que le servage et les lois ou coutumes restrictives de la reproduction ont disparu ou sont tombées en désuétude, le taux de cette reproduction s'est élevé sans mesure. Tandis que dans les classes supérieures, on voyait se manifester une tendance restrictive de la population, la tendance opposée se manifestait, avec une intensité extraordinaire, dans les classes inférieures. C'est bien moins, il faut le dire, à l'imprévoyance qu'il faut attribuer ce dérèglement de leur population qu'à l'insuffisance du sentiment de la paternité et aux calculs vicieux et sordides dont elle a été la source. L'exploitation égoïste du travail des enfants, telle a été la cause principale sinon unique qui en a déterminé la multiplication, et abaissé, par là même, la condition des êtres faibles, placés sous la dépendance de l'ouvrier père de famille, au-dessous de celle qui leur était faite sous le régime de l'esclavage. L'ouvrier devenu, en même temps que son propre tuteur, celui de sa femme et de ses enfants s'est montré généralement incapable de remplir ses obligations vis-à-vis de ses pupilles. Tandis que le propriétaire d'esclaves, soucieux de son intérêt, s'abstenait d'assujettir le croît de son troupeau humain à un travail hâtif qui aurait eu pour effet de l'affaiblir et de le déprécier, qu'il lui arrivait même fréquemment de faire les avances nécessaires pour développer les facultés productives de ses jeunes esclaves, afin d'eu tirer, plus tard, un profit plus élevé, l'insuffisance de soins d'entretien et l'abus du travail des enfants sont devenus les traits caractéristiques de la tutelle paternelle des ouvriers émancipés.
Ne possédant sur leurs enfants qu'un droit de propriété expirant à la majorité, n'ayant, par conséquent, aucun intérêt à ménager leurs forces naissantes pour les rendre pleinement productives à l'âge d'homme, ils se sont efforcés d'en tirer le profit le plus élevé possible, pendant la période limitée où ils étaient les maîtres d'en disposer. Cette période dont la loi fixait la limite supérieure, ils l'ont allongée en reculant la limite inférieure: sans aucun souci de la santé et de la croissance [349] de leurs enfants, ils les ont contraints à travailler aussitôt qu'ils ont trouvé un débouché pour leur travail. Les socialistes et les philanthropes se sont plu à rendre les entre-preneurs d'industrie responsables de cet abus destructeur des forces des nouvelles générations. Mais cette responsabilité n'appartient-elle pas avant tout aux pères de famille qui exploitent leurs enfants comme un bétail, et les multiplient en raison du profit que leur rapporte cette exploitation? Que l'élève des enfants soit devenue, dans les régions inférieures des classes émancipées, une industrie comme une autre, qu'elle se soit développée en raison des profits qu'elle rapporte, soit que ces profits proviennent du travail ou de la prostitution, c'est un fait qu'il est désormais impossible de dissimuler. Les lois et les pratiques vicieuses de l'assistance publique, particulièrement en Angleterre, ont, à la vérité, encouragé artificiellement cette industrie en mettant à la charge de la communauté une partie des frais de l'élève, et en la rendant ainsi plus profitable pour les éleveurs. Le résultat de cette méconnaissance des obligations de la tutelle paternelle a été la décadence physique et morale des nouvelles générations, appartenant aux couches inférieures des classes émancipées. C'est à cette cause qu'il faut principalement attribuer l'énorme différence de la natalité et de la longévité des couches inférieures et supérieures de la population, l'abaissement de la taille et de la vitalité de la classe ouvrière dans les régions où le travail des enfants a trouvé le débouché le plus large et le plus lucratif, l'augmentation progressive de la criminalité, enfin l'abaissement de la qualité du travail, et la proportion croissante de la population de rebut, dans les grands centres d'industrie.
Tel est le passif de l'émancipation des classes autrefois assujetties à la tutelle obligatoire de l'esclavage et du servage, et placées aujourd'hui sous le régime non moins obligatoire du self government. Que ce régime ait contribué à l'accroissement général de la richesse, qu'il ait élevé et amélioré la condition de la portion supérieure des classes émancipées, de celle qui possédait à un degré suffisant les facultés intellectuelles et morales qu'exige la pratique du gouvernement de soi-même, ou, pour nous servir du langage économique, [350] la conservation du capital personnel, cela ne saurait être sérieusement contesté. En revanche, on ne saurait contester davantage qu'il ait été nuisible à cette seconde portion des classes émancipées qui n'était point mûre pour la liberté, et se trouvait insuffisamment pourvue des facultés nécessaires pour remplir les obligations envers soi-même et envers autrui, qu'implique l'exercice utile de self government. On peut se rendre compte des effets de cette incapacité, en se reportant encore au régime de l'esclavage. S'il y avait dans les sociétés à esclaves des propriétaires soigneux de leurs intérêts qui veillaient à la conservation et à l'accroissement utile du capital investi dans leur troupeau humain, il y avait aussi des propriétaires négligents ou bien encore avides et brutaux qui laissaient dépérir ce troupeau faute d'entretien, de surveillance et de soins, qui le laissaient se multiplier au delà des besoins de leur exploitation ou du débouché ouvert à cette sorte de marchandise, ou bien encore, qui assujettissaient leurs esclaves à un travail prématuré et excessif. A la longue, ces mauvais propriétaires ne manquaient pas de s'appauvrir, et leur décadence devenait inévitable lorsqu'ils se trouvaient en concurrence pour les produits de leur exploitation, la location ou la vente de leurs esclaves mal soignés et surmenés, avec des propriétaires capables et économes. Ils finissaient par se ruiner, après avoir détruit ou laissé dépérir le capital de forces productives investi dans leurs esclaves, non sans que cette ruine et cette destruction n'occasionnassent d'inévitables souffrances à leur troupeau et à eux-mêmes, et sans qu'elle n'agit comme une cause d'appauvrissement et d'affaiblissement pour la société dont ils faisaient partie. Une société composée en majorité de propriétaires d'esclaves, incapables de gérer économiquement leur cheptel humain, aurait inévitablement succombé dans une lutte avec une société composée en majorité de propriétaires capables et économes.
Or, si l'on songe que la suppression des anciens régimes de tutelle de l'esclavage, du servage, des corporations et des communautés, a rendu libres et responsables non seulement de leur destinée, mais de celle des êtres auxquels ils donnent le jour, la généralité des membres des sociétés civilisées; que si l'on compte dans chacune, selon la somme de capacité [351] intellectuelle et morale qui s'y trouve répandue, un nombre plus ou moins grand d'individualités pourvues des facultés du self government, il s'en trouve aussi des millions auxquelles ces facultés font défaut, qui agissent envers elles-mêmes et les êtres placés sous leur autorité comme des propriétaires négligents, vicieux, avides et imprévoyants, on s'expliquera les misères et les souffrances de cette portion inférieure des classes émancipées, et l'on comprendra à quel point leur incapacité et ses conséquences, la dégradation physique et morale, le paupérisme et la criminalité se traduisant par une déperdition croissante de forces, affaiblissent les sociétés dont elles sont membres. Si l'on songe encore qu'à la concurrence destructive de l'état de guerre a succédé une concurrence productive de plus en plus active et non moins inévitable, on arrivera à cette conclusion finale que les sociétés au sein desquelles existe la plus forte proportion d'individus incapables de conserver et d'accroître utilement leur capital personnel, les sociétés les plus chargées de non-valeurs, sont destinées à succomber dans la lutte, et à faire place à celles où la multitude est plus capable du self government, ou, à défaut de cette capacité, se trouve soumise ou se soumet d'elle-même à une tutelle qui y supplée.
III
PROGRAMME ÉCONOMIQUE
[355]
CHAPITRE PREMIER
Programmes et remèdes socialistes↩
La crise actuelle et ses causes. — La demande des remèdes. — Vices des systèmes socialistes qui ont répondu a cette demande. — L'ignorance ou la negation des lois naturelles. — Points sur lesquels les socialistes s'accordent. — Points sur lesquels ils diffèrent. — Le socialisme d'état et ses facteurs. — La philanthropie. — Maux qu'elle a aggravés. — La croyance a la toute puissance de l'état. — L'extension de ses attributions. — L'infériorité de l'état en matière de production et de distribution. — Ce que produirait la substitution de l'état à l'industrie privée. — L'intervention de l'état. — La tutelle gouvernementale et ses vices. — L'assistance publique. — La responsabilité des accidents du travail. — L'assurance obligatoire. — La limitation de la journée. — Conséquences de l'application du socialisme.
La prolongation artificielle d'un régime politique et économique qui a cessé d'être adapté aux conditions actuelles d'existence des sociétés civilisées d'une part, l'insuffisance de la capacité nécessaire au gouvernement de soi-même, dans la multitude émancipée trop hâtivement peut-être de l'esclavage et du servage, d'une autre part, ont suscité la crise qui a donné naissance à la réaction anti-libérale du socialisme. Une observation patiente et une analyse exacte pouvaient seules mettre en lumière ces causes du mal nouveau qui avait atteint les foyers de la civilisation et en signaler les remèdes. C'était l'œuvre de la science. Mais, en attendant que cette œuvre, nécessairement laborieuse et lente, fut accomplie, le mal allait s'étendant et s'aggravant, et il provoquait une [356] demande croissante de remèdes. A défaut de la science, trop scrupuleuse et réservée, l'imagination se chargea de répondre à cette demande. Des systèmes variés d'organisation ou de réorganisation sociale affluèrent au marché, offrant à l'envi de guérir d'une manière radicale et instantanée tous les maux de la société, et, comme toutes les panacées, celles-ci ne manquèrent pas de trouver un accueil empressé auprès de la foule ignorante des malades.
Nous ne pouvons entrer ici dans le détail de ces systèmes. Nous nous bornerons à signaler les traits qui leur sont communs.
Le premier, c'est une vue superficielle et incomplète des phénomènes économiques et de leurs causes. Le socialisme tout entier, dans ses ramifications diverses, communisme, collectivisme, anarchisme, etc., se fonde sur l'ignorance et la négation des lois naturelles qui régissent ces phénomènes. De l'absence de lois naturelles, les socialistes concluent que l'organisation des sociétés dépend entièrement et absolument de la volonté des hommes; qu'ils peuvent régler à leur gré la production et la distribution de la richesse. Jusqu'à présent, c'est une minorité qui l'a réglée à son profit. Cette minorité, en possession du gouvernement, c'est-à-dire de la machine à faire les lois, s'en est servi pour accaparer le sol, les instruments et les matériaux du travail, et mettre ainsi à sa discrétion la multitude des travailleurs, qu'elle s'est assujettis au moyen de l'esclavage, du servage ou du salariat, et auxquels, dans son avidité insatiable, elle impose un maximum de travail en échange d'un minimum de subsistances. Cela étant, n'est-il pas indispensable d'enlever l'instrument de l'exploitation, la machine à faire les lois, à la minorité exploitante pour la remettre à la majorité exploitée? Tel est le point sur lequel toutes les écoles socialistes s'accordent. Elles s'accordent encore sur cet autre point, non moins essentiel, qu'il faut reprendre le sol, les outils, les machines et les matériaux du travail, les capitaux immobiliers et mobiliers à la minorité qui s'en est indûment emparée pour les attribuer à la nation, en supprimant la propriété individuelle ou tout au moins en limitant cette propriété aux articles de consommation.
Mais, lorsque la machine à faire les lois aura été conquise [357] et après qu'elle aura été employée à opérer la liquidation sociale, que fera-t-on de cette machine? La conservera-t-on, en confiant à des mandataires du peuple le soin de la mettre en œuvre, ou bien le peuple lui-même se chargera-t-il de la faire fonctionner, ou bien enfin, la brisera-t-on ou la déposera-t-on dans un conservatoire des vieilles machines à côté du fardier de Cugnot et de la pompe à feu du marquis de Jouffroy? Sur ce point apparaît une première et grave dissidence entre les socialistes autoritaires, les socialistes libertaires et les anarchistes: tandis que les autoritaires manquant de confiance dans la capacité du peuple en matière de législation et d'organisation, convaincus d'ailleurs qu'il y aura toujours des lois à faire ou à perfectionner, sont d'avis que la machine à légiférer doit être conservée et remise entre les mains des mandataires de la nation, incapable elle-même, mais juge souverain et infaillible de la capacité, les libertaires pensent que le peuple ne peut s'en dessaisir sous peine de retomber sous le joug et qu'il possède d'ailleurs toute l'aptitude légiférante que lui refusent les autoritaires, enfin, les anarchistes veulent briser la machine, qui n'a jamais été à leurs yeux qu'un instrument d'exploitation, et laisser les individus se gouverner librement eux-mêmes, sauf à lyncher ceux qui se refuseraient à vivre sous le régime du « communisme anarchique. »
D'autres dissidences, nombreuses celles-là, se manifestent sur l'organisation économique qui devra remplacer le régime actuel: selon les uns, la nation, après avoir confisqué le sol et les capitaux doit les employer directement elle-même à la production, et distribuer soit également soit proportionnellement les produits à la généralité des travailleurs; selon les autres, la nation devra simplement commanditer les associations ouvrières, substituées aux entrepreneurs capitalistes, en leur fournissant le sol et les capitaux; selon d'autres encore (les anarchistes) les travailleurs, après s'être partagé égalitairement et fraternellement le sol et les capitaux confisqués, useront à leur convenance du produit qu'ils en tireront, mais sans pouvoir se les approprier.
Toute cette partie des programmes du socialisme est singulièrement obscure, et les socialistes eux-mêmes conviennent [358] que l'organisation qu'ils se proposent d'établir n'est point encore complètement arrêtée dans leur esprit. Mais peu importe! Il faut d'abord renverser le vieil édifice d'exploitation. Lorsqu'il sera à terre, le peuple guidé par les lumières de la science sociale et maître d'imposer sa volonté, saura bien en construire un autre. Si son œuvre est imparfaite et défectueuse, il pourra toujours la compléter et la corriger; en tout cas, le nouvel édifice élevé à son usage, sera certainement plus vaste, mieux distribué et plus confortable que l'ancien.
Avons-nous besoin de démontrer qu'il le serait moins? En supposant que le socialisme réussit à s'emparer du gouvernement et à employer cet appareil centralisateur des forces sociales à enlever à la classe des propriétaires et des capitalistes les capitaux immobiliers et mobiliers pour les mettre à la disposition de la classe ouvrière, c'est-à-dire d'une classe, intellectuellement et même moralement inférieure, qu'arriverait-il? Quel serait le résultat inévitable de cette confiscation, soit qu'elle fut accomplie par la voie révolutionnaire ou par la voie légale? Ce serait le gaspillage et la prompte destruction des capitaux livrés à une multitude moins capable de les gérer que la classe qui les a acquis, conservés et accrus dans le cours des siècles. Or, comme les capitaux immobiliers et mobiliers sont des facteurs indispensables de la production, comme le capital personnel ne peut être employé qu'à la condition de les avoir pour auxiliaires dans une proportion déterminée par la nature des entreprises, toute diminution de leur quantité aurait pour effet de rétrécir le débouché du capital personnel, partant d'abaisser sa rétribution et d'augmenter la leur. Ainsi le résultat certain de l'avènement du socialisme et de l'établissement d'un régime communiste, collectiviste ou anarchiste, serait d'augmenter la part du capital aux dépens de celle du travail, jusqu'à ce que la destruction par la misère et la faim de l'excédent des travailleurs privès d'emploi eut rétabli l'équilibre.
Si l'on conçoit que ces doctrines grossières et confuses se soient propagées au sein de la multitude ignorante et souffrante, à laquelle elles promettent une amélioration prochaine et infaillible de son sort, comment s'expliquer qu'elles aient [359] trouvé des adhérents parmi les classes éclairées ou soi-disant telles qu'elles menacent de déposséder, et que le socialisme révolutionnaire et subversif ait engendré le socialisme conservateur et gouvernemental, qualifié aujourd'hui de socialisme d'état?
La cause déterminante de ce phénomène est toute à l'honneur de la nature humaine. Elle réside dans le sentiment de sympathie et de pitié que fait éprouver à l'homme le spectacle de la misère et des souffrances de ses semblables, et même des créatures inférieures, parfois aussi dans la révolte du sentiment de la justice contre une inégalité excessive des conditions sociales. Ces sentiments altruistes se développent particulièrement dans les régions supérieures de la société, sous l'influence d'une éducation morale plus raffinée. Malheureusement, ceux qui les éprouvent sont trop enclins à croire que la chaleur du sentiment peut tenir lieu des lumières de l'intelligence et qu'il suffit d'être apitoyé par la souffrance d'autrui et d'avoir la volonté de la soulager pour en trouver le remède. Peut-être aussi, la conscience de leur supériorité morale donne-t-elle aux philanthropes, aux amis des hommes, une confiance extraordinaire en eux-mêmes et leur persuade-t-elle qu'ils possèdent une intuition infaillible en matière de remèdes, sociaux et autres. C'est à ces hommes passionnés pour le bien, mais qui croient que la passion dispense de la science, qu'on peut appliquer le dicton populaire: l'enfer est pavé de bonnes intentions. Car ils ont aggravé le plus souvent les maux qu'ils prétendaient guérir. Les philanthropes religieux ont persécuté les hérétiques et brulé les corps pour sauver les âmes, les philanthropes politiques ont déchaîné la guerre et attisé les haines nationales pour accélérer l'avènement de la fraternité des peuples, les négrophiles ont aggravé les souffrances des victimes de la traite, causé les massacres de Saint-Domingue et provoqué la guerre de la sécession américaine; enfin, les philanthropes socialistes, les derniers venus, mais non les moins redoutables, s'appliquent aujourd'hui à tarir les sources mêmes du travail qui fait vivre la multitude dont ils ont la bonne intention d'améliorer le sort: les uns, convaincus comme leurs devanciers religieux et politiques que la fin justifie les moyens, demandent à l'emploi de la [360] force, à la confiscation des propriétés, et à la suppression violente des propriétaires, l'application de leurs systèmes de régénération sociale: ce sont les socialistes révolutionnaires; les autres, plus modérés ou plus timides, mais non moins ignorants des causes réclles des maux 'des classes inférieures et des remèdes propres à les soulager, veulent confier aux gouvernements établis, la mission de les atténuer sinon d'y mettre fin, et de supprimer le socialisme révolutionnaire en le remplaçant: ce sont les socialistes conservateurs ou les socialistes d'état.
Cette mission, les gouvernements, sans être mus par un sentiment particulier de philanthropie, sont naturellement disposés à l'accepter, en premier lieu parce qu'elle s'accorde avec leur tendance à augmenter leurs attributions et leur influence, en second lieu, parce qu'elle flatte le sentiment de leur toute-puissance et de leur infaillibilité. On disait jadis en Angleterre que le parlement peut tout, hormis de changer un homme en femme. Il n'est pas bien certain que cette restriction fut acceptée aujourd'hui par les sectateurs du Dieu-état, soit que ce Dieu gouverne avec ou sans le concours d'un parlement. Non moins que les socialistes révolutionnaires, les socialistes d'état sont convaincus qu'il dépend du gouvernement de régler, suivant sa volonté, la production, la distribution et même la consommation de la richesse.
Il a, pour accomplir cette tâche, le choix entre deux procédés. Il peut s'emparer de la production ou se borner à la réglementer. Jusqu'à présent les socialistes d'état, moins avancés à cet égard que les socialistes révolutionnaires, ont hésité à confier au gouvernement le monopole de toutes les branches de l'activité humaine. Ils se bornent à réclamer l'extension graduelle de son domaine par la reprise des chemins de fer, des mines, des banques, des assurances, etc. Mais, en cela ne manquent-ils pas de logique et de résolution? Si l'état est plus capable que l'industrie privée de produire et de distribuer la richesse, pourquoi se bornerait-il à ajouter seulement une demi-douzaine d'industries à celles qu'il exerce déjà? pourquoi ne se chargerait-il pas de les exercer toutes? Les socialistes d'état ne peuvent s'arrêter à mi-chemin dans cette voie, la logique leur commande d'aller jusqu'au bout.
[361]
Il s'agit donc de savoir si l'état est plus ou moins capable que l'industrie privée de produire utilement et de distribuer équitablement la richesse.
Or, en matière de production d'abord, l'intériorité de l'état est tellement manifeste que les socialistes eux-mêmes sont obligés de la reconnaître. Les socialistes révolutionnaires prétendent, à la vérité, qu'elle tient à ce que l'état se trouve aujourd'hui entre les mains des classes supérieures, et qu'elle disparaîtra aussitôt que l'état-ouvrier aura remplacé l'état-bourgeois. Mais comment l'attribution de l'état à une classe, moins pourvue d'instruction technique et de connaissances de tout genre que celle qui le possède actuellement, augmentera-t-elle sa capacité productive, voilà ce qu'ils nous laissent ignorer.
Si nous analysons les causes de cette infériorité de l'état, au point de vue de la production de la richesse, nous trouverons qu'elles résident dans la dérogation aux lois naturelles qui régissent toutes les industries. L'état a été originairement et a continué d'être, avant tout, une entreprise d'assurance de la vie et de la propriété contre les risques qui les menacent. Soit qu'il fut fondé et exploité par une société, une caste ou une « maison » comme sous l'ancien régime, ou par les consommateurs de sécurité eux-mêmes, comme sous le régime actuellement en vogue, telle était sa fonction naturelle et l'industrie qui lui était propre. Or, cette industrie est soumise aux mêmes conditions économiques que toutes les autres branches de l'activité humaine. Parmi ces conditions figure, au premier rang, la séparation des entreprises, déterminée elle-même par la diversité et l'inégalité de leurs dimensions utiles. Toute entreprise a des dimensions utiles, mesurées par la nature et le degré d'avancement de l'industrie à laquelle elle appartient. Réunir dans les mêmes mains et étendre dans la même circonscription deux entreprises qui comportent des dimensions inégales, c'est rendre l'une ou l'autre moins économique. Cette jonction de deux ou de plusieurs entreprises de différente nature sous une même direction est encore en opposition avec la loi de l'économie des forces en ce qu'elle implique la dispersion de l'intelligence et de la volonté dirigeantes, tandis que celles-ci ne peuvent déployer un maximum de [362] puissance productive qu'à la condition d'être concentrées sur un seul objet. Enfin les industries d'état pèchent contre la même loi en ce qu'elles ne sont pas soumises à la nécessité de couvrir leurs frais. On peut soutenir, à la vérité, qu'en continuant indéfiniment à travailler à perte et à imposer aux contribuables la charge de leurs déficits accumulés, elles finiraient par occasionner la ruine de la nation et leur propre ruine; qu'elles sont intéressées, en conséquence, à perfectionner leur outillage et leurs procédés, à augmenter leur productivité et à diminuer leurs frais de production; mais cet intérêt est lointain, tandis que celui des industries privées, qui supportent elles-mêmes leurs pertes et n'attirent les capitaux qu'autant qu'elles leur donnent un profit, est immédiat et pressant.
En résumé, la science démontre que les industries d'état pèchent, sous des rapports essentiels, contre la loi de l'économie des forces et d'autant plus qu'elles se multiplient davantage, et cette démonstration théorique est universellement confirmée par la pratique. Nulle part, et en aucun temps, les industries d'état n'ont pu soutenir la concurrence des industries privées. Aussi sont-elles généralement investies d'un monopole, ou protégées par des entraves et des charges imposées aux industries concurrentes. Encore, en dépit du monopole ou de la protection dont elles jouissent, ne parviennent-elles pas toujours à couvrir leurs frais, et les contribuables, parmi lesquels figurent leurs concurrents eux-mêmes, sont-ils obligés de combler leurs déficits. Qu'en faut-il conclure? C'est qu'au point de vue de la production de la richesse, la substitution de l'état à l'industrie privée serait un recul et non un progrès; qu'elle aurait pour résultat d'appauvrir les sociétés au lieu de les enrichir et d'obliger ainsi les hommes à travailler davantage pour obtenir, en échange de leur travail, une moindre quantité de produits, autrement dire à acheter une moindre somme de bien-être au prix d'une plus grande somme de peine.
En revanche, les résultats de la production ne seraient-ils pas plus équitablement répartis? Pour résoudre cette question, ne convient-il pas d'examiner d'abord si, au point de vue de la distribution de la richesse, les industries d'état possèdent [363] quelque supériorité sur les industries privées? En considérant l'ensemble des rétributions que l'état alloue à ses fonctionnaires et à ses employés de tout ordre en échange de leur travail, on peut constater sans doute que ces rétributions mesurées à la quantité de travail effectif que fournit le fonctionnaire ou l'employé sont plus élevées que celles de l'industrie privée: au besoin, l'affluence extraordinaire des candidats à toutes les fonctions publiques suffirait à le démontrer. Mais, comment l'état parvient-il à élever le niveau des rétributions du personnel de ses industries au-dessus de celui du personnel des industries privées? En prélevant la différence sur les consommateurs ou sur les contribuables: en obligeant les consommateurs des articles, dont il monopolise la production, à les payer à un prix supérieur au taux de la concurrence, ou en chargeant les contribuables de combler les déficits de celles de ses industries qui travaillent à perte. Au moins, les rétributions que l'état alloue à son personnel sont-elles mieux proportionnées à la quantité et à la qualité du travail fourni que celles de l'industrie privée? Paye-t-il, en comparaison, moins cher ses hauts fonctionnaires, et plus cher ses petits employés et ses ouvriers? Enfin, les sinécures sont-elles plus rares dans les services publics que dans les autres? Poser ainsi la question n'est-ce pas la résoudre? Mais si l'état d'aujourd'hui distribue plus mal, avec moins d'économie et de justice, la richesse que ne le fait l'industrie privée, pourquoi l'état de demain la distribuerait-il mieux?
La substitution de l'état à l'industrie privée n'augmenterait donc pas la production de la richesse et n'en rendrait point la distribution plus équitable. Au contraire: elle enchérirait la production et vicierait davantage la distribution. Elle aurait, de plus, pour conséquence d'emprisonner les individus dans les limites du territoire national. Nous avons vu, ailleurs [28] , que le premier résultat de l'appropriation de l'état à la nation a été de réserver aux nationaux le monopole des fonctions publiques, à l'exclusion des étrangers et que ce monopole a été successivement étendu à toutes les industries d'état. Lorsque l'état sera devenu le producteur universel, lorsqu'il [364] n'y aura plus, dans chaque pays, que des fonctions publiques, toute émigration, toute circulation internationale de travail deviendra impossible: comme sous le régime du servage, les travailleurs qui forment l'immense majorité de la population demeureront rivés au sol où le hasard les aura fait naître, car ils ne pourront plus trouver d'emploi en dehors des frontières du territoire national. Ils seront réduits, pour tout dire, à la condition de serfs de l'état.
Heureusement, il n'est pas au pouvoir du socialisme de réaliser un tel progrès. Si, comme la science le démontre et comme l'expérience l'atteste, l'état produit moins économiquement que l'industrie privée, les nations, au sein desquelles prévaudra le socialisme d'état, deviendront promptement incapables de soutenir la concurrence de celles qui conserveront le régime de la liberté du travail. Elles auront, à la vérité, la ressource de s'isoler, en prohibant l'importation des produits étrangers, et en se bornant à consommer les produits de leur sol et de leur industrie monopolisés par l'état. Mais il resterait à savoir combien de temps cet état socialiste réussirait à maintenir sa domination sur un peuple de fonctionnaires, voués à la pauvreté, à l'isolement et à la servitude.
Cependant, si l'état ne peut se substituer utilement à l'industrie privée, ne peut-il pas être fondé à intervenir dans ses opérations? Il y intervient déjà en préservant les industries de la concurrence étrangère, en protégeant les enfants et les femmes contre l'abus du travail manufacturier, etc., etc. Pourquoi ne reculerait-il pas davantage les bornes de son intervention? Pourquoi ne limiterait-il pas la durée du travail des adultes comme il a limité celle du travail des enfants? Pourquoi ne réglementerait-il pas le taux des salaires, comme il n'a pas cessé de réglementer le prix du pain et le taux de l'intérêt? Pourquoi n'emploierait-il point la puissance irrésistible dont il dispose à égaliser les conditions de la lutte pour la vie? Pourquoi ne protégerait-il point le faible contre le fort, le travail contre le capital, et finalement l'ouvrier contre son imprévoyance et ses vices? Telle est encore la mission, sinon définitive, au moins transitoire, que le socialisme veut attribuer à l'état, et que les gouvernements civilisés se mettent aujourd'hui en devoir de remplir. Elle consiste, pour tout [365] dire, à placer les classes ouvrières sous la tutelle gouvernementale.
Ce qui vaut une faveur particulière à cette mission tutélaire, conférée à l'état, c'est qu'elle répond à un besoin réel, c'est qu'une portion plus ou moins considérable des classes émancipées de l'antique servitude et livrée au self government, rendu obligatoire, ne possède pas ou ne possède que dans une trop faible mesure la capacité intellectuelle et morale nécessaire pour se gouverner, sans nuire à elle-même et à autrui. Mais parce qu'une partie et, disons même, la majorité de la classe ouvrière a besoin d'une tutelle et la demande, faut-il l'imposer à la minorité qui n'en a pas besoin et ne la demande pas? Si la tutelle est utile aux incapables et dans la mesure de leur défaut de capacité, n'est-elle pas nuisible aux individualités qui ont la capacité et la volonté de se gouverner? En restreignant la liberté d'un individu, dont les facultés intellectuelles et morales sont suffisamment développées et mûries, en paralysant ainsi l'application de ces facultés supérieures à ce qui est leur objet naturel: le gouvernement de soi-même, ne diminue-t-on pas la puissance productive de celui qui les possède, à son détriment et à celui de l'espèce? Le propre du besoin de tutelle c'est d'être individuel, le vice de la tutelle gouvernementale c'est d'être générale.
La tutelle gouvernementale a encore d'autres vices qui tiennent à la constitution même des gouvernements et à leur objet. La tutelle ne doit pas seulement suppléer à l'absence ou à l'insuffisance des facultés gouvernantes de l'individu, elle doit encore agir pour en déterminer l'éclosion et la croissance; elle n'est entièrement utile qu'à la condition de rendre le pupille capable de se passer du tuteur; elle devient au contraire nuisible si elle empêche ou retarde le développement de ses facultés gouvernantes, en ne le mettant point dans la nécessité de les exercer. Elle exige, en conséquence, des aptitudes d'un ordre particulièrement élevé, et, plus encore qu'aucune autre fonction, elle devrait être l'occupation principale sinon unique du tuteur. Or, elle n'est pour un gouvernement qu'une fonction accessoire, et, cette fonction, les gouvernements se sont montrés jusqu'à présent médiocrement capables de la remplir.
[366]
L'assistance publique, par exemple, a-t-elle contribué à diminuer le vice et la misère? La tutelle gouvernementale que le socialisme d'état se propose aujourd'hui d'étendre à la généralité des classes ouvrières sera-t-elle plus efficace? S'agit-il de la responsabilité des accidents du travail que les socialistes d'état veulent rejeter sur l'entrepreneur d'industrie, en l'obligeant à indemniser les ouvriers qui en sont victimes? Le déplacement du « risque » n'aura-t-il pas pour conséquence inévitable le déplacement de la prime qui sert à le couvrir? Qu'y gagnera l'ouvrier? S'agit-il de l'assurance obligatoire de la vieillesse? Si cette assurance est utile aux ouvriers incapables de s'assurer eux-mêmes, l'est-elle aux ouvriers prévoyants, et n'exclut-elle pas d'autres modes d'assurance mieux adaptés à la situation particulière de chacun? N'aura-t-elle pas, en outre, un effet dommageable à la généralité des assurés, en les retenant de porter leur travail en dehors des frontières de l'état assureur? En opposant ainsi un obstacle de plus à la mobilisation du travail, le socialisme, soi-disant protecteur des intérêts des ouvriers, n'accroîtra-t-il pas l'inégalité de leur situation vis-à-vis des entrepreneurs? S'agit-il de la limitation de la durée de la journée de travail, uniformément imposée à toutes les industries? Le travail ne comporte-t-il pas une dépense inégale de forces selon la nature et le degré d'avancement des industries auxquelles il est appliqué? La durée nécessaire du travail ne dépend-elle pas encore, d'une part, du degré de productivité de l'industrie; de l'autre, des obligations et des charges auxquelles l'ouvrier est obligé de pourvoir? Moins l'industrie est productive, moindre est la somme de produits qu'elle peut distribuer entre les agents productifs, plus grande est la quantité de travail que l'ouvrier doit fournir pour obtenir une part qui suffise à ses besoins. Cette quantité ne peut être réduite qu'à la condition que la productivité de l'industrie se trouve accrue ou que les charges auxquelles l'ouvrier doit pourvoir soient diminuées. Si la somme que l'impôt lui enlève, tant pour les dépenses de l'état que pour la protection prétendue de l'industrie, forme le tiers du salaire que lui vaut une journée de douze heures, aussi longtemps que cette charge subsistera, sa journée ne pourra être réduite à huit [367] heures sans que son salaire partant sa consommation ne subisse une réduction proportionnelle. Celle-ci devenant insuffisante, il subira une déperdition de forces vitales qui ne tardera pas à excéder l'économie que lui aura value l'abréviation artificielle de la durée de sa journée. Sa situation en sera-t-elle améliorée? Pour qu'elle le fût, il faudrait qu'en échange d'une journée de travail réduite de douze heures à huit heures, il continuât de recevoir le même salaire. Or, si l'état, en diminuant la durée de la journée, imposait à l'industrie l'obligation de payer huit heures de travail au même prix que douze, ce serait comme s'il la soumettait à un impôt égal au tiers de la somme totale des salaires qu'elle distribue. Serait-elle capable de supporter cet impôt, ajouté à tant d'autres? Pourrait-elle soutenir la concurrence des industries étrangères qui n'y seraient point assujetties? En supposant enfin que la limitation de la journée put être universalisée et la part du travail surélevée aux dépens du capital, celui-ci continuerait-il à couvrir ses frais avec adjonction du profit nécessaire? Ne verrait-on pas le nombre des entreprises diminuer et le débouché ouvert au travail se rétrécir, en déterminant, en dépit de toute réglementation, l'abaissement du taux général des salaires et l'accroissement de la durée de la journée de travail?
En résumé, ce qui caractérise les conceptions du socialisme, soit révolutionnaire, soit conservateur, c'est la méconnaissance des lois naturelles qui gouvernent la production de la richesse. Toutes ces conceptions pèchent invariablement contre la loi de l'économie des forces, et leur application aurait pour conséquence inévitable un renchérissement de la production, une diminution de la richesse produite, ou une augmentation de la quantité de travail nécessaire pour la produire. Si cette application était partielle, elle déterminerait la ruine des industries et des nations soumises aux expérimentations socialistes, au profit de leurs concurrentes, demeurées fidèles aux principes et aux pratiques économiques. Si elle était universelle, elle provoquerait l'appauvrissement général de l'espèce humaine. C'est assez dire que le socialisme est essentiellement antiéconomique.
[368]
CHAPITRE II
L'objectif et le mécanisme de la production du progrès.↩
Objectif du progrès, — L'accroissement des forces vitales de l'espèce. — Mécanisme du progrès. — Que la sécurité est la condition nécessaire du progrès. — Comment elle s'est établie. — La concurrence politique et guerrière. — Ses effets. — Les progrès réalisés par la guerre. — La décadence de la guerre. — Résumé des causes de la prolongation de l'état de guerre. — L'extension des attributions de l'état. — Changement de l'objectif du progrès.
L'objectif des socialistes aussi bien que des économistes, c'est le progrès, mais les uns ignorent les lois naturelles qui déterminent le progrès, ou n'en tiennent aucun compte, et leurs conceptions sont, le plus souvent, en opposition avec elles, tandis que les autres considèrent les lois naturelles comme les moteurs du progrès. D'où il résulte qu'il suffit, pour le réaliser, de supprimer les obstacles qui empêchent les lois naturelles d'agir et de « laisser faire », sous leur impulsion, les forces physiques, intellectuelles et morales, investies dans la multitude des individualités successives dont se compose l'espèce humaine.
Avant d'élaborer un programme ayant le progrès pour objectif, il faut donc connaître les lois naturelles et savoir comment elles agissent pour mettre en mouvement les forces vitales qui produisent le progrès.
Toutefois, il y a encore une question préalable qu'il faut résoudre, c'est celle de savoir quel est l'objet même du [369] progrès. Cette question, l'observation des conditions naturelles d'existence des espèces en donne la solution. Quelle que soit la destination de la multitude des espèces pourvues de vie, quelle que soit la fonction qui leur est assignée dans l'ordre universel, elles ne peuvent recevoir cette destination et remplir cette fonction qu'à la condition de se conserver. Or, elles ne peuvent se conserver qu'à la condition de s'accroître et elles ne peuvent s'accroître qu'en augmentant continuellement la somme de leurs forces vitales. L'augmentation de leurs forces vitales, tel est donc l'objectif que poursuivent d'une manière consciente ou inconsciente, sous l'impulsion du mobile de la peine et du plaisir, toutes les espèces vivantes. Cet objectif qui est celui de tout progrès, elles l'atteignent en produisant une somme de forces de plus en plus grande en échange d'une dépense de plus en plus petite de ces mêmes forces.
Comme toutes les autres, l'espèce humaine est soumise à cette condition naturelle d'existence. C'est pour conserver et accroître ses forces vitales que l'homme produit. Mais il ne peut produire qu'en dépensant préalablement une portion des forces qu'il s'agit de conserver et d'accroître. Cette dépense c'est le mobile de la peine et du plaisir qui l'excite à la faire. Il la fait lorsque la jouissance ou l'épargne de peine que peut lui procurer la force acquise dépasse la peine que lui coûte la force dépensée. C'est sous l'impulsion de ce mobile de l'économie des forces, porté à son maximum de puissance par la loi de la concurrence, que l'homme produit et qu'il s'applique à perfectionner son industrie, de manière à obtenir une somme de plus en plus grande de forces vitales en échange d'une dépense moindre. Tandis que les espèces inférieures ne possèdent point ou ne possèdent qu'à un faible degré la capacité nécessaire pour multiplier les aliments réparateurs de leurs forces vitales et sont obligées de se contenter des produits élaborés par la nature, l'espèce humaine est pourvue de cette « capacité productive ». L'homme est non seulement capable de découvrir, comme les animaux inférieurs, les matériaux nécessaires à la réparation de ses forces vitales et de s'en emparer, mais encore d'inventer les procédés et les instruments propres à les multiplier avec une [370] abondance croissante et en échange d'une dépense de force décroissante. C'est en inventant et en mettant en œuvre ces procédés et ces instruments, qu'il augmente successivement sa capacité productive, que l'espèce humaine peut accroître dans une progression dont on n'aperçoit point la limite, la somme de ses forces vitales et assurer ainsi, d'une manière indéfinie, son expansion dans l'espace et sa durée dans le temps. Tel est le mécanisme du progrès.
Cependant ce mécanisme ne peut fonctionner qu'à une condition, c'est que le moteur qui lui imprime le mouvement, savoir le mobile de la peine et du plaisir, demeure intact; c'est qu'en échange de la peine que lui coûte la production des choses nécessaires à l'entretien et au développement de ses forces vitales, l'individu soit assuré de jouir sinon de la totalité des fruits de sa production, du moins d'une portion de ces fruits, suffisante pour lui procurer un plaisir qui dépasse sa peine. S'il ne possède point cette sécurité, il pourra bien se mettre en quête des aliments nécessaires pour apaiser sa faim, mais il ne fera point les efforts supplémentaires qu'exige l'invention des procédés et des instruments propres à les multiplier: il prendra encore moins la peine de se construire une demeure et de l'embellir, il vivra au jour le jour comme les animaux sauvages, en partageant son temps entre le soin d'éviter les atteintes de ses ennemis et la recherche d'une subsistance toujours précaire. La sécurité apparaît donc comme la condition essentielle de tout progrès, et c'est à acquérir cet article de première nécessité que se sont d'abord appliqués les hommes. Mais la production de la sécurité exigeait des aptitudes spéciales et des qualités qui étaient inégalement distribuées entre les différentes variétés de l'espèce: une force physique supérieure et surtout le courage nécessaire pour affronter les périls d'une lutte mortelle. Or, les hommes qui possédaient ces aptitudes et ces qualités trouvaient plus de profit à subsister aux dépens des variétés plus faibles et moins courageuses de l'espèce qu'à produire eux-mêmes leur subsistance. Ils vivaient de chasse et de rapine, sans distinguer entre les animaux et les hommes qui leur servaient de proie. Il en alla ainsi, comme nous l'avons vu, jusqu'à ce qu'ils eussent reconnu qu'il leur serait plus profitable [371] d'asservir les variétés plus faibles et de les obliger à travailler pour eux que de continuer à les piller et à les massacrer. L'esclavage a été le prix auquel ces variétés de l'espèce, capables de produire, mais incapables de défendre leurs produits et leur vie, ont payé leur sécurité. Si élevé que fût ce prix, il demeurait cependant inférieur au risque qu'il servait à couvrir. C'est pourquoi l'esclavage a été accepté sans résistance, souvent même demandé, aussi longtemps que l'augmentation de la sécurité n'a pas abaissé le risque au-dessous de la prime.
La sécurité des variétés de l'espèce, capables de produire, mais incapables de défendre leurs produits, se trouvant garantie par ceux-là mêmes qui la mettaient auparavant en péril, la production pût se développer et l'industrie se perfectionner. La période de la vie et de l'humanité, que nous avons désignée sous la dénomination d'ère de la petite industrie s'ouvrit, les états politiques se fondèrent: les associations d'hommes forts et courageux qui s'étaient constituées en vue du pillage et de la destruction s'organisèrent en vue de l'exploitation du travail des races asservies, de la défense et de l'agrandissement de leurs établissements. Elles s'établirent à demeure fixe sur un territoire qu'elles partagèrent d'habitude entre leurs membres et qu'elles exploitèrent comme une vaste ferme, en s'appliquant, à la fois, à augmenter le produit de leur « état », à défendre cet état contre les autres sociétés vivant de pillage ou d'exploitation et à l'agrandir. La concurrence politique et guerrière que se faisaient les sociétés propriétaires d'états ou qu'elles subissaient de la part des tribus pillardes devint alors le véhicule le plus puissant et le plus actif du progrès, et c'est au sein des états, qui en ressentaient davantage la pression et pendant qu'ils la ressentaient, que les arts et les industries qui concourent à la production de la sécurité et de la richesse se sont particulièrement développés et que s'est élevé l'édifice de la civilisation.
Mais cet état de guerre que le soin de leur sécurité auquel se joignait l'appât des profits de l'exploitation, imposait à toutes les sociétés propriétaires et exploitantes des états avait ses charges et ses servitudes nécessaires. Chaque état était une forteresse continuellement assiégée ou exposée à l'être [372] et dont la sécurité, toujours précaire, ne pouvait être augmentée que par l'accroissement parallèle de son étendue, du nombre et des ressources de sa garnison. Il fallait donc travailler continuellement à l'étendre et à développer sa puissance défensive et offensive. Il fallait aussi que toutes les forces et les ressources dont disposaient ses propriétaires pussent être appliquées, sous une direction unique, incontestée et souveraine, soit à repousser une invasion, soit à opérer une agression ayant pour objet l'augmentation de la puissance partant de la sécurité de la forteresse. Il fallait enfin, lorsque cette forteresse venait à être assiégée, qu'elle pût se suffire à elle-même pour ses moyens de défense et de subsistance. De là une série de charges et de servitudes politiques, militaires et économiques qui grevaient directement ou indirectement la production et ne laissaient aux producteurs, en échange de leur peine, qu'une somme amoindrie de jouissances en affaiblissant ainsi le mobile qui les poussait à produire et à perfectionner leur industrie, mais auxquelles, cependant, ils avaient intérêt à se soumettre, car, à défaut de ce coûteux appareil de fortifications, de charges et de servitudes, ils eussent été exposés à un risque de pillage, de destruction, ou — dans le cas d'une conquête par une société moins civilisée, — d'asservissement aggravé, qui dépassait la prime dont ils payaient leur sécurité.
Comment cet état de choses s'est successivement modifié par l'opération de la concurrence sous sa forme destructive, comment la sécurité générale du monde en voie de civilisation s'est accrue et a fini par être mise à l'abri des atteintes du monde barbare, comment la guerre, après, avoir été nécessaire et productive, est devenue nuisible et improductive, comment l'appareil de fortifications, de charges et de servitudes qu'elle impliquait, a perdu sa raison d'être, c'est ce que nous avons essayé de mettre en lumière dans le cours de cet ouvrage et de nos études précédentes, et ce que nous allons résumer brièvement.
La pratique continue de la guerre a déterminé les progrès de l'outillage et de l'art de la destruction, et ces progrès ont exigé une avance de capital de plus en plus considérable, des connaissances techniques de plus en plus étendues, tout [373] en donnant à la valeur morale la prééminence sur le courage purement physique. Cette transformation progressive de l'outillage et des procédés de la guerre a permis aux nations qui possèdent la plus grande somme de capitaux, de science et de valeur morale, c'est-à-dire aux nations les plus avancées en civilisation, de déployer une puissance destructive incomparablement supérieure à celle que peuvent mettre en œuvre les peuples barbares ou arriérés. Elles ont pu étendre leur domination sur la plus grande partie du globe et préserver la civilisation des invasions sous lesquelles elle avait succombé aux époques où la puissance destructive des barbares dépassait ou balançait celle du monde civilisé. Telle est aujourd'hui leur supériorité dans la production de la puissance destructive qu'une armée européenne vient aisément à bout d'un nombre décuple de barbares et qu'il suffirait d'une centaine de milliers d'hommes pour sauvegarder les frontières du monde civilisé et même pour assujettir les parties du globe qui échappent encore à sa domination. Dans cet état des choses, la guerre a cessé d'être productive de sécurité et par conséquent d'être nécessaire. Tandis que toute guerre, soit entre les peuples civilisés, soit avec les barbares, contribuait autrefois à augmenter la sécurité présente et à venir, en déterminant un progrès de la puissance destructive et en contribuant à la porter à un point inaccessible aux peuples inférieurs en richesse, en science et en valeur morale, ce point atteint, il devenait inutile d'augmenter encore, à grands frais, une puissance qui suffisait et au delà à remplir sa fonction. Le profit général que la guerre rapportait à l'ensemble des nations civilisées, aux neutres et même aux vaincus aussi bien qu'aux vainqueurs, disparaissait. Restait seul le profit particulier qu'une guerre heureuse pouvait procurer à la nation victorieuse. Or, ce profit qui consistait, soit dans le pillage, soit dans la levée d'un tribut, soit encore dans la conquête d'un territoire et l'exploitation de sa population, a non seulement disparu, mais il a fait place à des pertes directes et indirectes que subissent à la fois les vaincus, les neutres et les vainqueurs eux-mêmes. Toutes les guerres qui ont eu lieu depuis un siècle entre les peuples civilisés se sont soldées par un déficit dont le monde civilisé tout entier a [374] supporté le dommage. On peut aisément se rendre compte des causes de ce changement. En premier lieu, les guerres sont devenues plus coûteuses, non que les frais de production de la puissance destructive se soient augmentés; ils ont diminué, au contraire [29] , mais à mesure que les nations belligérantes ont cru en population, en forces et en ressources, elles ont dû déployer, dans la lutte, une somme croissante de puissance destructive. En second lieu, les effets destructeurs de la richesse que peut causer l'emploi de cette puissance se développent en proportion de son accroissement. En troisième lieu, les progrès de la production, l'extension des débouchés et la multiplication des échanges, en entrecroisant les intérêts des peuples, ont transformé chaque guerre en une nuisance universelle. Tandis que l'interruption des communications et des échanges, les chômages et les destructions qu'il est dans la nature de la guerre de causer n'atteignaient, à l'époque où le commerce international existait à peine, que les nations belligérantes et même les populations des localités qui servaient de théâtre à la lutte, ils se répercutent de nos jours dans toute l'étendue du domaine de la communauté civilisée et lui causent un dommage que ne compense plus l'acquisition d'un supplément de sécurité. En regard de ces frais et de ces dommages qui constituent le passif de toute guerre, que faut-il placer à son actif? Les acquisitions matérielles et morales qu'elle a values au vainqueur? Mais il convient de remarquer [375] d'abord que ces acquisitions constituent un profit particulier, tandis qu'une partie de plus en plus considérable des dommages causés par la guerre, constituent une perte générale. Il convient de remarquer ensuite que le profit d'une guerre heureuse se concentre sur la petite classe des fonctionnaires militaires et civils de l'état vainqueur, auxquels elle procure un accroissement de débouché, — encore cet accroissement est-il temporaire, car le territoire conquis produit, de son côté, des fonctionnaires qui ne tardent pas à faire concurrence à ceux de l'état conquérant, — tandis que la masse de la nation supporte, avec les frais directs que la guerre a coûtés, sa part des dommages indirects qu'elle a occasionnés.
Toute guerre entre les nations civilisées se solde donc aujourd'hui par une perte. Cela étant, comment se fait-il qu'elles n'aient point renoncé à pratiquer cette industrie devenue onéreuse et qu'elles ne se soient point débarrassées de l'énorme et coûteux appareil de la destruction, des charges et des servitudes politiques, militaires et économiques qu'il nécessite? Comment se fait-il, au contraire, que la plupart des états civilisés continuent à développer et à renforcer, à l'envi, cet appareil ruineux?
Nous avons donné un aperçu des causes de ce phénomène. Elles se résument dans les idées, les sentiments et les intérêts adaptés à l'état de guerre et qui ont survécu aux nécessités qui constituaient leur raison d'être. Que la guerre ait cessé d'être nécessaire, que la solidarité des intérêts que crée le commerce entre les nations doive prendre la place de l'antagonisme propre à l'état de guerre, que le dommage des uns ne fasse plus le profit, mais le dommage des autres, ce sont là des idées nouvelles, auxquelles l'observation attentive des causes qui ont transformé, depuis une époque relativement récente, les conditions d'existence des sociétés civilisées a conduit seulement un petit nombre d'intelligences supérieures, encore est-ce le plus souvent d'une manière incomplète et vague, et qui ne peuvent descendre qu'avec lenteur dans l'esprit de la multitude, où elles se heurtent à des idées et à des sentiments enraciné par les siècles. Appuyés sur cette opinion atavique, les intérêts créés par l'état de guerre, sont demeurés prépondérants, et la servitude [376] politique qui était la clé de voûte nécessaire de l'organisme des états de l'ancien régime et qu'ils out réussi à conserver, a maintenu la multitude sous la domination de la classe gouvernante, en dépit des constitutions destinées à limiter son pouvoir. En vain, les révolutions sont survenues, provoquées par la souffrance et le mécontentement de cette multitude, sur laquelle retombait le poids des charges et des servitudes d'un régime suranné; elles n'ont servi qu'à changer ou à agrandir la classe des bénéficiaires de la domination, et, ce changement, au lieu d'alléger le fardeau de la masse gouvernée l'a encore alourdi, car les nouveaux bénéficiaires étaient plus nombreux, plus besoigneux et avides que les anciens. En possession de la machine à faire les lois, la classe gouvernante, tantôt unie, tantôt partagée en sociétés concurrentes pour l'exploitation du monopole des fonctions publiques et des privilèges industriels, s'est servie de cette machine, comme aurait fait tout autre entreprise commerciale, pour agrandir son débouché. Sous l'ancien régime, l'agrandissement de ce débouché s'opérait presque exclusivement par la conquête et l'annexion de nouveaux territoires, dont la population fournissait un supplément de corvées ou d'impôts; mais ce mode d'agrandissement étant devenu plus coûteux et moins productif, a fini par provoquer au sein des associations en possession de l'état ou aspirant à le posséder une scission entre les intérêts belliqueux et les intérêts pacifiques. Sous l'influence de cette scission et de l'accroissement des intérêts pacifiques, la guerre a cessé d'accaparer la faveur des classes gouvernantes, et elles ont demandé l'extension de leur débouché à quelque procédé moins onéreux et aléatoire. En Europe, où les peuples ont conservé intacts l'organisation, le personnel et les traditions de l'état de guerre, où les haines nationales qu'il entretenait ne sont pas éteintes, où il suffit d'un souffile pour en rallumer la flamme, le régime, dit de la paix armée, a remplacé, sous ce rapport sans désavantage, le régime de la quasi permanence de la guerre. Les progrès réalisés dans la production de la puissance destructive, par l'invention et le perfectionnement continus des engins de destruction, joints à ceux de la production de la richesse, en permettant aux nations civilisées de mettre en œuvre, dans [377] leurs conflits, une somme démésurément accrue de cette puissance, ont servi de motifs ou de prétextes à la progression ininterrompue des budgets de la guerre. Ces budgets qu'une portion notable de la classe gouvernante, celle qui fournit les fonctionnaires militaires et civils, est intéressée à grossir, car leur accroissement se traduit par une extension de son débouché, la multitude gouvernée en supporte le fardeau croissant, comme une nécessité inévitable, sans réfléchir qu'il lui en coûterait moins, dans l'état présent des choses, de courir les risques que cette énorme prime d'assurance a pour objet de couvrir.
Cependant, le débouché de la paix armée est naturellement limité; il ne peut dépasser l'effectif possible des armements; en revanche, il y en a un autre qui est sinon illimité du moins indéfiniment extensible: c'est celui des fonctions administratives et industrielles. Celui-ci peut s'étendre à la généralité des fonctions, professions et industries, et il suffit, pour l'agrandir, de mettre en mouvement la machine à faire les lois. Les classes gouvernantes n'y ont pas manqué: dans toute l'étendue du monde civilisé, elles travaillent à augmenter les attributions de l'état, et elles y réussissent d'autant mieux qu'elles ont affaire à une multitude plus ignorante et à des intérêts moins résistants. A quoi il faut ajouter que la lutte engagée pour la possession de l'état, entre les partis des pays constitutionnels, a rendu plus active cette invasion de l'état dans le domaine de l'activité privé, en obligeant l'état-major dirigeant de ces sociétés d'exploitation politique à accroître incessamment le nombre des fonctions qui servent à salarier leur armée. C'est ainsi que l'état a monopolisé les services de la monnaie, de la poste, du télégraphe, etc., qu'il a mis la main sur la plus importante des professions libérales: l'enseignement, qu'il s'empare ou cherche à s'emparer des chemins de fer et des assurances. Et plus la classe qui dispose de la machine à faire les lois devient nombreuse, plus elle sollicite ses mandataires d'élargir un débouché toujours trop étroit. En même temps, les intérêts les plus influents agissent pour obtenir des monopoles ou des privilèges, monopole du crédit, protection douanière, aux dépens de la multitude, qui en ignore les effets cu à laquelle on persuade qu'ils [378] sont établis dans l'intérêt général. L'état devient, en conséquence, une entreprise de plus en plus colossale et onéreuse. Les fonctions qu'il accapare, au détriment de la liberté et de la propriété individuelle, font obstacle à l'accomplissement utile de ses fonctions naturelles, qui consistent précisément à sauvegarder la liberté et la propriété individuelles: les services de sa police et de sa justice sont grossièrement imparfaits, routiniers et coûteux, aussi bien que ceux qu'il dérobe à l'activité privée. Le résultat final, c'est une déperdition croissante des forces vitales de la nation, partant de l'espèce, ou, ce qui revient au même, un empêchement croissant à leur multiplication.
Que ressort-il de cette analyse du mécanisme et des conditions du progrès? C'est que l'œuvre qui s'impose aujourd'hui aux hommes de progrès est précisément l'opposé de celle que leurs devanciers avaient à accomplir dans les phases précédentes de la vie de l'humanité: elle consiste à diminuer sinon à supprimer l'énorme et coûteux appareil qu'ils ont dû établir pour sauvegarder la sécurité des sociétés naissantes. La civilisation, telle qu'elle s'est développée, à l'abri de cet appareil de protection, a été le résultat de l'augmentation successive de la puissance productive de l'homme. Or, cette puissance ne pouvait s'augmenter que par l'impulsion du mobile organique des lois de l'économie des forces et de la concurrence, la crainte de la souffrance et l'appât de la jouissance. C'est pour éviter l'une et acquérir l'autre que l'homme travaille et emploie les facultés supérieures de son intelligence à perfectionner son industrie. Mais ce mobile naturel et nécessaire du progrès se trouve paralysé lorsque l'individu n'est pas assuré de jouir lui-même du fruit de son travail ou du moins d'une portion de ce fruit qui rétribue sa peine, lorsqu'il ne possède pas, dans quelque mesure, la sécurité. C'est la sécurité qui est la première condition du progrès, et c'est à la produire qu'il a fallu d'abord aviser. Nous avons vu comment cette production s'est organisée sous la pression du besoin impérieux qui la demandait: les hommes se sont associés d'abord pour assurer leur sécurité contre les espèces concurrentes; ensuite les plus forts et les plus courageux ont [379] asservi les plus faibles et, en les asservissant, ont trouvé profit à les protéger. Ils ont fondé des établissements, des « états » qu'ils se sont appliqués à défendre et à agrandir dans l'intérêt de leur sécurité et de la conservation des esclaves ou des sujets dont le travail leur fournissait leurs moyens d'existence. Ces états jouissaient d'une sécurité d'autant plus complète et durable que leurs propriétaires pouvaient mettre en œuvre une somme plus grande de puissance destructive. Conserver et augmenter la puissance destructive de l'état, développer les forces et les ressources qui l'alimentaient, assurer la subsistance et le travail des populations assujetties, tout en les excitant à rendre leur industrie plus productive, tel était alors le but que devaient se proposer les hommes de progrès, et dont ils ont approché surtout dans les états le plus exposés à la pression de la concurrence destructive. Ces états ont cru en puissance, en richesse, en civilisation, et leur domination, en s'étendant sur la plus grande partie du globe, a assuré définitivement la civilisation contre tout retour offensif de la barbarie.
Cette œuvre accomplie, l'objectif du progrès politique et économique des nations se trouve changé. L'énorme portion de forces et de ressources qu'elles appliquaient à la conservation et au développement de leur puissance destructive peut être pour la plus grande part, économisée, car le monde barbare n'envahit plus, il est envahi, et la sécurité intérieure n'exige qu'une faible dépense; les servitudes que nécessitait la défense des populations, la sécurité de leurs approvisionnements et de leur travail peuvent être supprimées, bref, la propriété et la liberté de chacun peuvent être assurées au prix d'un minimum de charges et de servitudes.
Dans ce nouvel état de choses, la tâche des hommes de progrès consiste à démolir ce que leurs devanciers avaient construit, c'est-à-dire à démanteler des forteresses devenues inutiles, à supprimer les charges et les servitudes nécessaires à leur défense, enfin à abattre l'informe et lourd édifice d'exploitation que les intérêts engagés dans l'ancien régime se sont efforcés d'élever dans ces vieux abris de la civilisation.
Mais nous allons voir que cette tâche, ils ne peuvent la remplir qu'à la condition d'avoir pour auxiliaire la pression [380] de la concurrence internationale; d'où il résulte que le premier article d'un « programme économique » doit être la suppression des obstacles naturels ou artificiels qui s'opposent au développement de la concurrence entre les producteurs des différentes nations, en un mot, l'établissement du « libre-échange. »
[381]
CHAPITRE III
PROGRAMME éCONOMIQUE.↩
Le libre-échange. — L'assurance contre la guerre. La simplification de l'état.
I. La concurrence véhicule du progrès et régulateur de la production, de la distribution et de la consommation de la richesse. — Ne peut remplir ce double rôle qu'à la condition d'être libre. — Obstacles naturels au libre-échange. — Progrès qui ont contribué à les aplanir. — Exhaussement des obstacles artificiels. — Explication de cette contradiction. — L'intérêt fiscal et l'intérêt protectionniste. — Progrès qui ont augmenté les profits de la fiscalité et de la protection. — Puissance actuelle des intérêts fiscaux et protectionnistes. — Faiblesse et désunion de leurs adversaires. — Progrès qui agissent en faveur du libre-échange. — L'accroissement du marché général. — La nécessité vitale de l'abaissement des prix de revient. — Que le libre-échange s'impose aux nations concurrentes sous peine de ruine. — II. Comment pourra s'établir l'assurance contre la guerre. — Le Droit des gens et ses progrès. — Le Droit des neutres. — Droit et intérêt des neutres à empêcher la guerre. — Conséquences d'une assurance contre la guerre. — III. Les attributions nécessaires de l'état. — Progrès qui ont permis de les diminuer. — Causes qui ont empêché leur diminution. — Charges qu'elles infligent et nuisances qu'elles déterminent. — L'état-gendarme.
I. Le Libre-échange. — Si le mobile organique de la loi de l'économie des forces: la crainte de la souffrance et l'appât de la jouissance est le propulseur de l'activité individuelle, s'il pousse toutes les créatures vivantes à s'infliger la peine au prix de laquelle elles achètent les choses nécessaires à la [382] conservation de leurs forces vitales, l'expérience démontre cependant qu'à défaut de la pression de la concurrence ce propulseur demeure trop faible pour déterminer l'individu à dépenser le supplément de forces, à s'infliger le supplément de peines qu'exige la découverte ou l'invention des procédés et des instruments propres à lui procurer éventuellement, par l'augmentation de sa capacité productive, une somme de forces vitales plus grande en échange d'une dépense plus petite. C'est la concurrence qui pousse les moins capables à faire cet effort, à se donner cette peine, en les exposant à une souffrance portée à son maximum d'intensité: celle de la destruction. La concurrence apparaît ainsi comme le véhicule nécessaire du progrès. Selon que sa pression est plus ou moins intense, le progrès s'accélère ou se ralentit. Tout obstacle à la concurrence est un obstacle au progrès. De plus, à sa fonction de propulseur, la concurrence joint celle de régulateur: c'est elle qui détermine l'équilibre de la production et de la consommation au niveau du prix nécessaire, la répartition proportionnelle des produits entre les agents productifs et l'attribution de ces produits à leur destination utile, actuelle ou future, en sorte que tout obstacle opposé à son jeu naturel et libre occasionne encore une perturbation, dans la distribution et la consommation, laquelle détermine, à son tour, une déperdition de forces vitales.
Ce double rôle de propulseur du progrès et de régulateur de la production, de la distribution et de la consommation des forces vitales, la concurrence ne peut donc le remplir qu'à la condition d'être libre. Si elle s'exerce en vue de la destruction, il faut que les combattants puissent déployer librement leurs forces, et que rien n'entrave leurs mouvements. Si les plus forts sont chargés de liens, ils seront vaincus et détruits par les plus faibles, et l'espèce subira de ce chef une déperdition de forces. Si la concurrence s'exerce en vue de la production, il faut que les concurrents soient libres non seulement de créer leurs produits ou leurs services, mais encore de les échanger. Si les plus capables, ceux qui produisent le mieux et aux moindres frais sont exclus des marchés d'échange, ou n'y sont admis qu'en payant une taxe, les moins capables demeureront, dans le premier cas, les maîtres du [383] marché; dans le second cas, ils pourront continuer à produire avec un excédent de frais égal au montant de la taxe, ou s'attribuer l'excédent du prix et il en résultera encore une déperdition de forces au détriment de l'espèce. Bref, le « libre-échange » est la condition nécessaire de l'exercice utile de la concurrence.
Les obstacles que rencontre le libre échange sont de deux sortes: naturels et artificiels.
Si l'on considère la diversité du sol, du climat et des productions des différentes régions de notre globe, on reconnaît qu'il existe entre elles une division naturelle du travail, que chaque région peut fournir un certain nombre de produits en plus grande abondance et à moins de frais que les autres; que ses habitants doivent par conséquent trouver profit à en entreprendre la production de préférence, et à se procurer par le procédé de l'échange, ceux qu'elle ne peut créer qu'en moindre abondance et à plus grands frais. C'est en employant ce procédé que l'espèce humaine peut obtenir la plus grande somme de pouvoirs réparateurs de ses forces vitales au prix de la plus petite dépense, et, tout en augmentant ses jouissances et en diminuant ses peines, arriver à son plus complet développement.
Mais dès l'origine, l'extension du procédé de l'échange a rencontré des obstacles difficiles et lents à surmonter, dans le défaut de sécurité et de moyens de communication. L'aire de la sécurité ne s'est agrandie que successivement, dans le cours d'une longue suite de siècles, pendant lesquels chaque nation était obligée de vivre dans l'enceinte fortifiée de son établissement politique et réduite à se contenter, presque exclusivement, des articles de consommation qu'elle y pouvait produire. Et nous avons vu qu alors même qu'elle aurait pu se procurer à moins de frais ces articles, en employant le procédé de l'échange, la nécessité d'assurer sa subsistance et son travail à une époque où la guerre était la règle et la paix l'exception, lui aurait commandé de les produire elle-même. A ce défaut de sécurité s'ajoutait l'absence ou l'insuffisance des moyens de communication pour empêcher les échanges en dchors des frontières de l'état et même de la province ou du canton. Nous avons vu aussi, par l'opération de quels progrès [384] la sécurité s'est étendue sur la presque totalité de la surface du globe, comment encore, la paix, après avoir été l'exception est devenue la règle; comment, enfin, dans le cours de ce siècle, l'obstacle des distances a été entamé, jusqu'à disparaître pour les communications immatérielles et, de manière à n'en laisser subsister que la plus faible part pour le transport des produits matériels et de l'homme lui-même. A mesure que ces progrès se sont réalisés, la sphère des échanges s'est agrandie, et l'on a vu approcher l'époque où la division naturelle du travail pourrait s'établir entre les différentes parties du globe, au profit général de l'espèce humaine.
Au moment où nous sommes, cette œuvre de la suppression des obstacles naturels qui s'opposent à l'extension des échanges se poursuit plus activement que jamais: l'aire de la sécurité s'agrandit par l'annexion au monde civilisé des vastes régions du continent africain, et, chaque année, des milliers de kilomètres s'ajoutent au réseau des chemins de fer, des lignes de navigation à vapeur, des télégraphes et des téléphones. Cette œuvre libre-échangiste, il importe de le remarquer, n'est pas seulement entreprise par l'industrie privée aussitôt que l'aplanissement d'un obstacle naturel est assez demandé, partant assez utile pour lui procurer un profit rémunérateur, elle l'est fréquemment par les gouvernements lorsque le profit n'est pas suffisant pour rémunérer l'esprit d'entreprise et les capitaux: alors, les gouvernements, s'érigeant en juges souverains de l'emploi des capitaux de leurs sujets, mettent la main sur ces capitaux pour entreprendre des conquêtes africaines et autres, créer ou subventionner des chemins de fer, des lignes de navigation à vapeur et de télégraphie, et étendre ainsi le domaine de l'échange.
Cependant, par une contradiction singulière, tandis que les gouvernements contribuent d'une main, — et ils s'en font gloire — à aplanir les obstacles naturels qui empêchent les échanges entre les peuples, de l'autre main, ils multiplient et exhaussent l'obstacle artificiel des barrières douanières. Cette contradiction s'explique par les impulsions diverses et opposées, au moins dans leurs résultats, auxquelles les gouvernements obéissent.
Ce n'est point dans l'intention humanitaire de contribuer à [385] l'établissement du libre-échange que les gouvernements agrandissent le domaine de la sécurité, créent ou subventionnent des instruments de communication internationale, c'est tout simplement pour donner satisfaction à des groupes d'intérêts influents: intérêts de la classe, au sein de laquelle se recrute principalement le personnel des fonctionnaires civils et militaires, et qui demande l'accroissement continu de son débouché, intérêts des armateurs et des autres entrepreneurs de l'industrie des transports qui disposent d'une influence électorale dans les pays constitutionnels, d'une influence de cour dans les autres.
Ce n'est pas davantage en vue d'empêcher l'établissement du libre-échange que les gouvernements multiplient et exhaussent l'obstacle artificiel des douanes; c'est pour donner satisfaction d'abord à leur intérêt fiscal, ensuite à la coalition des intérêts protectionnistes. Or, il convient de remarquer que, dans l'état actuel des choses, ces deux sortes d'intérêts exercent sur eux une pression de plus en plus vive.
Chaque fois que les gouvernements entreprennent des guerres devenues improductives et dont le compte se solde en conséquence par une perte que la nécessité de déployer une somme croissante de puissance destructive ne manque pas d'aggraver, chaque fois qu'ils augmentent leurs armements, chaque fois qu'ils empiètent sur le domaine de l'activité libre, individuelle ou collective, et remplacent les services privés par des services publics qui ne couvrent pas leurs frais, ils voient s'élever le chiffre de leurs dépenses et se trouvent dans la nécessité d'élever, en proportion, le chiffre de leurs recettes. Ils ont le choix entre deux sortes d'impôts: les impôts directs et visibles, dont le contribuable connaît le montant et qui excitent par là même son mécontentement chaque fois qu'il les paye, et les impôts indirects et invisibles qui renchérissent sans qu'il s'en doute ses articles de consommation, qu'il paie sans s'en apercevoir et dont il lui est impossible, en tous cas, de connaître la charge. Parmi ces impôts invisibles figurent, au premier rang, les droits de douane, qui ont, en outre, l'avantage de satisfaire, avec l'intérêt fiscal, les intérêts protectionnistes, dont l'appui est acquis d'avance au gouvernement qui les établit ou les exhausse. Il y a, à la [386] vérité, un moment où l'intérêt fiscal et l'intérêt protectionniste se séparent et se trouvent en opposition, c'est lorsque le droit de douane vient à dépasser le point où il a son maximum de rendement, mais comme ce point est communément assez élevé pour satisfaire les industries les plus exigeantes, l'accord entre ces deux intérêts se maintient d'habitude.
Nous connaissons la généalogie des intérêts protectionnistes. Ils sont issus de l'état d'insécurité, d'absence ou d'insuffisance des moyens de communication, qui obligeait chaque nation à produire elle-même les articles nécessaires à sa consommation, quand même elle aurait pu se les procurer plus économiquement ailleurs dans les intervalles de paix. A mesure que la sécurité s'est étendue, que les guerres sont devenues plus rares, que l'obstacle des distances a été surmonté, les industries créées ou protégées sous l'empire de cette nécessité ont été exposées à une concurrence de plus en plus pressante de la part des industries similaires de l'étranger, mieux situées ou plus avancées. Dans ce nouvel état des choses, l'intérêt général de la nation commandait de laisser périr celles qui étaient impropres au sol et au climat, et n'avaient pu subsister que grâce à une protection naturelle qui avait disparu et une protection artificielle qui avait cessé d'avoir sa raison d'être. Quant aux industries en retard mais naturelles au pays, la pression de la concurrence n'aurait pas manqué de les contraindre à renouveler leur outillage et leurs procédés, et ce progrès eut été d'ailleurs secondé par l'accroissement de la demande des moyens d'échange pour les articles qu'il était désormais plus avantageux d'acheter à l'étranger que de produire dans le pays. Mais cette évolution nécessaire exigeait des efforts et des sacrifices actuels auxquels répugnaient les industriels, pour la plupart routiniers et à courte vue. Au lieu de se protéger eux-mêmes en se mettant au niveau des progrès de leurs concurrents, ils employèrent leur influence politique grandissante à faire remplacer les obstacles naturels en voie d'aplanissement par l'obstacle artificiel des douanes et ils trouvèrent dans l'intérêt fiscal un concours sympathique pour l'accomplissement de cette œuvre rétrograde.
Ainsi s'explique la contradiction qui se manifeste entre la destruction des obstacles naturels, que les gouvernements [387] opèrent pour satisfaire des intérêts influents, et la construction de l'obstacle artificiel des barrières douanières, qu'ils élèvent pour satisfaire d'autres intérêts influents, à commencer par le leur.
Il convient de remarquer encore que la construction et l'exhaussement de ces obstacles artificiels sont devenus plus profitables à l'intérêt fiscal aussi bien qu'aux intérêts protectionnistes, à mesure que les progrès de l'industrie se sont multipliés sous l'influence de l'aplanissement des obstacles naturels et que l'accroissement de la puissance productive des nations a déterminé l'accroissement parallèle de leur puissance de consommation. Ces progrès ont provoqué l'augmentation continue de la demande de nombreux articles que le sol et le climat « nationaux » se refusent obstinément à produire et qu'il faut bien tirer de l'étranger. Même dans les pays où la muraille douanière est la plus haute, le commerce extérieur n'a pas cessé de se développer, grâce à la sagesse de la Providence qui a rendu nécessaires la division du travail et l'échange entre les différentes régions du globe, en dépit de l'imbécillité et de la cupidité des hommes. La douane est devenue, en conséquence, un instrument fiscal de plus en plus productif, et une ressource à laquelle les gouvernements sont de moins en moins disposés à renoncer. Elle est devenue en même temps plus productive comme instrument de protection. Malgré le développement extraordinaire du commerce extérieur depuis l'avènement de la grande industrie, le marché intérieur a conservé, dans la généralité des pays civilisés, une importance supérieure à celle du marché étranger. Dans un pays tel que la France, dont la production agricole et industrielle s'élève annuellement à une trentaine de milliards, il n'y a que trois ou quatre milliards de produits qui soient exportés, en échange des articles que la France ne peut produire ou qu'elle produit avec moins d'économie que l'étranger. Ce marché intérieur dont l'importance est prépondérante, les producteurs ont le choix entre deux procédés pour le défendre: le progrès et la protection. Ils sont naturellement portés à choisir celui qui leur coûte le moins de peine et ils sont d'autant plus excités à l'employer qu'il leur rapporte davantage.
[388]
On voit par là combien sont fortes les positions du parti protectionniste, et combien l'avènement du libre-échange peut sembler éloigné. D'une part, les douanes ont pour appui l'intérêt fiscal des gouvernements, intérêt qui devient chaque jour plus exigeant et auquel la douane procure, chaque jour aussi, une satisfaction croissante; d'une autre part, elles sont défendues par les intérêts, demeurés en majorité, des industries pour lesquelles le marché intérieur est demeuré plus important que le marché étranger.
Cependant, malgré la puissance des étais de soutènement des intérêts fiscaux des gouvernements et des intérêts protectionnistes des industries arriérées, les murailles douanières finiront par être démolies. Elles tomberont bien moins sous l'effort de la propagande libre-échangiste que sous la pression continue et irrésistible du progrès industriel, accéléré par l'aplanissement successif des obstacles naturels. Si étendu que soit le marché national, il ne peut suffire aux industries dont le progrès a décuplé, centuplé même parfois, la puissance productive. Ces industries ont dû chercher et elles ont trouvé un accroissement de débouché dans les pays étrangers que l'extension de la sécurité et l'abaissement des prix de transport leur a ouverts. Il s'est créé ainsi un « marché général » où toutes les nations apportent en concurrence, les unes leurs produits agricoles, les autres leurs produits industriels et artistiques. Au début et aussi longtemps que cet apport est demeuré insuffisant pour satisfaire à la demande, les prix de ce marché se sont maintenus à un niveau assez élevé pour couvrir les frais de production les plus hauts, mais à mesure que les apports se sont accrus et que la concurrence est devenue plus serrée, les prix sont descendus, et le jour n'est pas éloigné où ils ne couvriront plus que les frais de production les plus bas. De là, pour les industries concurrentes, la nécessité de plus en plus pressante d'abaisser leurs prix de revient au minimum sous peine d'être exclues du marché général. Or, les droits de douane ont pour effet inévitable d'exhausser artificiellement les prix de revient, soit qu'ils augmentent les frais d'alimentation, d'entretien et de renouvellement du personnel de la production, partant sa rétribution nécessaire, ou qu'ils élèvent le prix des agents, instruments et matières [389] premières qui constituent le matériel. Cette surélévation artificielle des prix de revient n'aurait, toutefois, d'autre inconvénient que de restreindre le débouché commun si toutes les nations concurrentes protégeaient également leurs différentes industries. Dans ce cas, les conditions de la concurrence demeureraient les mêmes sur le marché général, tous les prix de revient se trouvant surélevés dans la même proportion. Mais il n'en est plus ainsi depuis que l'Angleterre a donné l'exemple de la suppression de la douane protectionniste pour ne conserver qu'une douane fiscale, réduite à son expression la plus simple. L'industrie britannique a acquis alors sur le marché général un avantage équivalent à la somme des frais dont la protection grevait les produits de ses concurrents de la France, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, etc.; en un mot, le libre-échange a été pour elle « une machine à produire à meilleur marché. » La réforme accomplie en Angleterre ayant été imitée par la plupart des autres nations industrielles, cet avantage a été en partie neutralisé, et les produits français, allemands et autres ont pu continuer à soutenir la concurrence des produits anglais sur le marché général. Ils la soutiennent plus difficilement depuis que la réaction protectionniste a réussi à faire relever les tarifs continentaux, et l'on peut prédire, à coup sûr, qu'ils finiraient par être exclus du marché général, si cette réaction des intérêts à courte vue demeurait maîtresse du terrain.
Que conclure de là, sinon que le libre-échange s'impose désormais aux nations, sous peine de décadence et de ruine des industries naturelles et progressives qui sont les sources les plus abondantes de leur richesse. Alors même que les économistes s'abstiendraient de faire de la propagande en faveur de l'abaissement ou de la suppression des tarifs de douane, elles seraient forcées de les démolir sous la pression croissante de la concurrence comme elles ont été forcées, sous la même pression et en dépit de toutes les résistances, de mettre leur vieil outillage au rebut et de le remplacer par des machines à produire à bon marché.
Mais en étendant la pression de la concurrence et en rendant ainsi nécessaire l'abaissement général des frais de la production, le libre-échange a des effets bien autrement [390] considérables que ceux de l'introduction d'une machine perfectionnée. Les frais de production ne consistent pas seulement dans la rétribution des agents et dans le coût des matériaux employés à la confection du produit, ils sont grevés encore des charges et des servitudes qui sont les frais généraux de l'établissement national. Ces frais généraux s'ajoutent aux frais particuliers qui constituent le prix de revient de tous les produits et services. En soumettant la généralité des branches de la production à la pression de la concurrence universalisée, le libre-échange a non seulement pour effet d'obliger chaque industrie à abaisser ses frais particuliers, par le perfectionnement continu de son outillage et de ses procédés, mais encore de contraindre chaque nation de diminuer ses frais généraux, en réduisant au strict nécessaire les frais d'assurance de la sécurité extérieure, et en simplifiant économiquement son appareil d'administration intérieure. A quoi on peut ajouter qu'il rend plus nécessaire l'amélioration du gouvernement individuel, dont les défectuosités et les vices se traduisent toujours par une déperdition des forces vitales de la nation.
Voilà pourquoi le libre-échange est le premier article de tout programme économique: c'est parce qu'il est la condition indispensable du progrès de la concurrence, qui est le véhicule de tous les autres progrès.
II. L'assurance Contre La Guerre. — Le second article d'un programme économique, c'est la réduction au strict nécessaire de l'énorme appareil de guerre qu'entretiennent et augmentent sans cesse la plupart des états civilisés et qui impose à leurs populations des charges hors de toute proportion avec le service en vue duquel il est établi. Cependant, ce service qui consiste dans la garantie de la sécurité extérieure des états doit être rempli. On va voir comment il pourrait l'être dès à présent par l'application d'un simple progrès du Droit des gens.
Si, comme nous avons essayé de le démontrer, après avoir été productive et nécessaire, la guerre est devenue improductive et nuisible, si elle cause une perte de forces vitales qui n'est plus compensée par un accroissement de la sécurité [391] commune, l'intérêt général et permanent de l'espèce commande de supprimer cette nuisance comme toute autre. De là un nouveau droit, que l'on pourrait nommer le « Droit de la paix », dont nous allons résumer brièvement l'origine et les progrès.
Aussi longtemps que la guerre a été nécessaire à la sécurité du monde civilisé, le Droit de la guerre est demeuré sans limites, quels que fussent les dommages que l'exercice de ce droit utile à la généralité pût imposer aux intérêts particuliers des neutres. Les belligérants avaient le droit, universellement reconnu, d'imposer aux neutres des servitudes plus ou moins dommageables et gênantes, telles que l'interdiction de fournir à leur adversaire des recrues, du matériel de guerre et même d'autres articles, de continuer leur commerce avec les ports déclarés en état de blocus; ils visitaient les navires suspects de transporter de la contrebande de guerre, et allaient jusqu'à saisir les marchandises neutres sous pavillon ennemi et les marchandises ennemies sous pavillon neutre. La guerre étant conforme à l'intérêt général, par conséquent à l'intérêt des neutres eux-mêmes, ils n'étaient fondés à réclamer aucune indemnité pour les dommages particuliers que leur causaient ces servitudes, et, encore moins, d'en empêcher l'établissement.
Mais, à mesure que la prépondérance croissante du monde civilisé a rendu la guerre moins nécessaire à sa sécurité, et que, d'une autre part, le développement de la production et l'extension du commerce international ont augmenté le chiffre des dommages directs ou indirects que toute guerre inflige à la généralité des peuples désormais unis par les liens multiples de l'échange, une réaction s'est opérée contre le droit de la guerre et les servitudes qu'il impose. Les neutres se sont ligués pour limiter ces servitudes et ils ont réussi, dans le cours des deux derniers siècles, à faire réduire le nombre des articles qualifiés de contrebande de guerre, a interdire la visite de leurs navires de commerce, la confiscation de leurs marchandises sous pavillon ennemi, celle des marchandises ennemies sous leur pavillon, enfin à restreindre le droit de blocus [30]. Cependant, en dépit de ces limitations des servitudes [392] auxquelles les assujettissait le droit de la guerre, l'exercice de ce droit ne leur occasionne pas moins des dommages de plus en plus graves: dommages résultant de la crise financière internationale que suscite désormais toute guerre, dommage causé par l'interruption partielle de leur commerce et, parfois aussi, la privation des matériaux nécessaires à leur industrie: la guerre de la sécession américaine, par exemple, en causant une disette de coton a infligé une perte de plusieurs milliards à l'Angleterre, à la France, à l'Allemagne et aux autres pays manufacturiers et réduit aux plus dures extrémités de la misère les ouvriers auxquels l'industrie cotonnière fournissait leurs moyens d'existence. Ces dommages que le développement des échanges internationaux a rendus inévitables et qui ont cessé d'être compensés par l'accroissement de la sécurité commune, les neutres ont le droit de s'en préserver, et le seul moyen efficace de s'en préserver, c'est d'intervenir pour empêcher les actes nuisibles qui les produisent. Ce droit d'intervention, fondé sur la nuisance qu'elles subissent, ce sont les nations dont les relations internationales ont le plus d'étendue, auxquelles par conséquent la guerre est le plus dommageable, qui sont principalement intéressées à l'exercer. De même qu'elles se sont liguées, à diverses époques, pour faire diminuer ou supprimer les servitudes que leur imposaient les belligérants, elles peuvent se liguer pour supprimer la guerre elle-même. Or, en supposant qu'une « Ligue des neutres », constituée pour le maintien de la paix entre les peuples civilisés, joigne ses forces à celles de tout Etat attaqué par un autre, sous n'importe quel motif ou prétexte, son intervention rendrait la guerre impossible. Cela étant, les lourds appareils de défense et d'agression que les classes intéressées à la prolongation artificielle de l'état de guerre accroissent tous les jours, en invoquant les nécessités de la sécurité extérieure et de la sauvegarde de « l'honneur national», deviendraient, en grande partie, inutiles, et la multitude qui en supporte le poids en exigerait la réduction au strict nécessaire. Ce strict nécessaire ne consisterait plus que dans la force de police destinée à pourvoir à la sécurité intérieure, et dans un contingent apporté à la force internationale, ayant pour mission d'empêcher toute nation civilisée ou non de rompre la paix. La guerre [393] entre les nations étant désormais interdite dans la communauté civilisée comme elle l'est entre les individus dans la communauté nationale, les différends qui surgiraient entre les états seraient vidés, soit par la voie de l'arbitrage, soit par des tribunaux institués ou reconnus par la Ligue, et aux verdicts desquels elle apporterait sa sanction matérielle. Cette » assurance de la paix « procurerait au monde civilisé toute la sécurité extérieure dont il a besoin, en présence de ce qui reste du monde barbare, et elle réduirait dans la proportion des neuf dixièmes au moins, les frais de son appareil de défense, en lui épargnant les dépenses et les dommages de luttes intérieures, devenues nuisibles après avoir été utiles [31].
III. La Simplification De L'état. — Aussi longtemps que » l'état « a été une forteresse continuellement assiégée ou menacée de l'être, le gouvernement chargé de la défendre a eu et dû avoir pour mission principale d'entretenir et de développer la puissance destructive indispensable à sa sécurité. De cette condition nécessaire d'existence de l'état dérivaient, comme nous l'avons vu, le mode de constitution et les attributions du pouvoir dirigeant, les charges et les servitudes de tout genre qu'il imposait à la population, et auxquelles elle se soumettait pour échapper au péril toujours imminent de la destruction ou de l'asservissement. Ce pouvoir dirigeant devait être investi, pour remplir sa mission, d'une autorité souveraine et d'attributions pour ainsi dire illimitées. La nécessité de pourvoir à la sécurité extérieure de l'état impliquait celle de veiller au maintien de la sécurité intérieure, toute atteinte à la vie et à la propriété des individus, à plus forte raison toute rebellion contre le pouvoir, chargé de sauvegarder l'existence de l'état, étant une cause d'affaiblissement nuisible en tous temps et surtout aux époques et dans les régions où cette » forteresse « était exposée aux attaques d'ennemis nombreux et redoutables. Après avoir pourvu à la constitution et au recrutement d'une garnison capable de déployer la puissance destructive nécessaire à la sécurité [394] extérieure, il fallait organiser une police politique et civile qui assurât l'ordre intérieur. Il fallait encore assurer l'approvisionnement permanent de la forteresse, en protégeant l'agriculture et l'industrie contre la concurrence intermittente de l'étranger, et même, dans le cas fréquent où la concurrence demeurait insuffisante à l'intérieur pour régler utilement les prix, il fallait que le pouvoir dirigeant intervint pour y suppléer, soit en établissant un tarif régulateur, soit en apportant sa sanction aux coutumes qui l'établissaient, de manière à empêcher les producteurs, les capitalistes, parfois aussi les ouvriers, d'abuser du monopole naturel que leur valait le défaut de sécurité extérieure et de moyens de communication. Le pouvoir dirigeant était encore fondé à intervenir pour proportionner le nombre des entreprises aux besoins d'un marché limité, se charger de celles auxquelles l'industrie privée ne suffisait point et même pour empêcher, par des lois somptuaires, le gaspillage des revenus des particuliers, source des revenus de l'état. Ces différentes fonctions, il les remplissait avec plus ou moins d'efficacité: l'état, dans lequel elles étaient le mieux remplies, où il était le plus complètement et exactement pourvu à toutes les nécessités qu'impliquait l'état de guerre, avait la plus grande chance de se conserver et de l'emporter sur ses rivaux dans l'arène de la concurrence destructive.
Mais du moment où la sécurité du monde civilisé s'est trouvée assurée, cet appareil de protection pouvait être successivement réduit. Il n'était plus nécessaire de soumettre les » consommateurs de sécurité « aux servitudes politiques et militaires qu'exigeait la production de cet article indispensable, puisqu'ils n'étaient plus exposés au risque de destruction ou d'asservissement que leur faisaient courir les invasions du monde barbare. On pouvait encore renoncer à les soumettre aux servitudes économiques, qui assuraient leurs approvisionnements et leurs moyens d'existence, aux règlements et aux coutumes qui refrénaient des monopoles que l'extension de la sécurité et le développement des communications faisaient disparaître. Tout cet appareil lourd et compliqué devenait nuisible en cessant d'être nécessaire. Les fonctions de l'état pouvaient être simplifiées et réduites à l'assurance de la [395] vie et des biens des individus contre les risques intérieurs et extérieurs, ceux-ci diminués sinon annulés: en même temps la multitude des impôts et charges qu'exigeait la vieille machinery du gouvernement, pouvaient être remplacés par une prime d'assurance que la concurrence entre les assureurs, la servitude politique ayant disparu, aurait fini par abaisser au niveau minimum des frais de production de la sécurité [32]. Nous avons analysé les causes qui ont empêché la réalisation de cette réforme d'un régime qui avait perdu sa raison d'être. Nous avons vu comment les intérêts engagés dans ce régime ont réussi à en conserver les parties essentielles, comment ils ont prolongé artificiellement l'existence de l'état de guerre, maintenu et développé l'appareil de la paix armée, accru au lieu de les réduire les attributions et les fonctions des gouvernements. Mais, nous avons constaté aussi que l'accroissement du nombre des fonctions et des attributions des gouvernements est en opposition avec la loi naturelle de l'économie des forces, que les services publics, l'enseignement, la poste, le télégraphe, etc., etc., sont incapables de soutenir la concurrence des services privés [33]. Non seulement les gouvernements [396] produisent à plus grands frais et en moindre qualité les articles qu'ils ont annexés à celui qui est l'objet naturel de leur industrie, mais la dispersion anti-économique de leurs forces a pour résultat d'enrayer les progrès de cette industrie, les services de la justice et de la police demeurant partout dans un état d'imperfection grossière; enfin, les impôts croissants que nécessite cette prolongation et cette aggravation d'un régime qui a cessé d'avoir sa raison d'être, infligent aux nations civilisées une double charge: celle du tribut qu'ils prélèvent et celle des servitudes fiscales auxquelles ils les assujettissent et qui dépassent fréquemment le poids même du tribut.
Simplifier l'état, réduire les gouvernements au rôle de producteurs de sécurité, en leur enlevant toutes les attributions et fonctions qu'ils ont usurpées et usurpent chaque jour sur le domaine de l'activité privée, en un mot, substituer à l'état socialiste, en voie de devenir le producteur universel, l'état-Gendarme des pères de l'économie politique, tel est le troisième article, et non le moins important, d'un programme économique.
[397]
CHAPITRE IV
L'unification des marchés. — La mobilisation du travail↩
La tendance à l'unification des marchés des produits et des capitaux, en dépit des entraves, servitudes et charges, issues de l'ancien régime. — L'impersonnalisation des prix. — Les marchés régulateurs. — La formation des prix sur un marché limité et sur un marché illimité. — La tendance à l'équilibre du prix courant au niveau des moindres frais de production. — Les causes qui retardent les progrès de la production et troublent la distribution. — La limitation des marchés du travail. — Ses effets sur la condition des ouvriers. — Les obstacles au déplacement des ouvriers. — L'expédient des coalitions et des grèves. — La mobilisabilité du travail et ses effets. — Conditions auxquelles elle est subordonnée. — La multiplication et le bon marché des moyens de transport. — Le développement du rouage intermédiaire du commerce du travail. — Causes qui le retardent. — La mobilisation du travail, solution de la question ouvrière.
I. L'unification Des MarchéS. — Le maintien et l'exhaussement des barrières douanières qui font obstacle à la localisation économique de la production, sans parler des perturbations que causent les changements incessants dans le niveau des tarifs, la prolongation artificielle de l'état de guerre, les frais exorbitants du régime de la paix armée, la multiplication anti-économique des attributions et des fonctions de l'Etat, occasionnent à l'ensemble des nations civilisées une déperdition énorme et continuellement croissante de forces vitales et augmentent certainement dans la proportion d'un quart, peut-être même d'un tiers la durée du temps que la généralité des producteurs, entrepreneurs, capitalistes, ouvriers sont [398] obligés de consacrer à la production des choses nécessaires à la satisfaction de leurs besoins. En supposant que la production fut débarrassée des entraves, des servitudes et des charges de tout genre que lui impose ce régime suranné, les peuples civilisés obtiendraient en échange d'une moindre somme de travail et de peine une somme considérablement accrue de richesses et de jouissances. Cependant, malgré ces entraves, ces servitudes et ces charges, l'industrie, dans toutes ses branches ne cesse point de progresser, les marchés s'étendent, grâce à la généralisation de la sécurité, à l'aplanissement ou même à la suppression de l'obstacle des distances, les rouages commerciaux et financiers qui portent les produits et les capitaux des lieux de production aux lieux de consommation, se développent: produits et capitaux se distribuent d'une manière de plus en plus économique, c'est-à-dire dans les directions où ils sont le moins offerts et le plus demandés. Le résultat de ces progrès combinés, c'est, avec une production toujours croissante, une tendance croissante aussi, en dépit de tous les obstacles, à l'unification des marchés des produits et des capitaux. Les marchés, jadis isolés ou qui n'avaient pour la plupart que des communications rares et intermittentes avec le dehors, sont maintenant en communication régulière et permanente, les produits et les capitaux, devenus de plus en plus mobilisables passent d'un pays à un autre, avec la même facilité et la même rapidité qu'ils passaient jadis d'un quartier à un autre de la même cité. Sans doute, il n'en est pas encore ainsi pour toutes les catégories de produits et de valeurs: si les matériaux et les articles de grande consommation et d'un transport facile, tels que les céréales, les laines, les soies, les cotons, les fers, les métaux précieux, etc., tels encore que les valeurs mobilières, coupons des emprunts d'états, actions et obligations des compagnies de chemins de fer, de navigation, des sociétés industrielles et commerciales, se répandent de plus en plus dans toutes les parties du monde civilisé, sans être arrêtés par les obstacles des douanes, du monopole des banques privilégiées, des règlements restrictifs des bourses, il y a encore beaucoup de produits et de capitaux dont le marché est limité et ne ressent que faiblement l'influence des autres marchés. Mais [399] depuis l'avènement de la grande industrie, et en particulier, depuis l'établissement des chemins de fer et des lignes télégraphiques, ce mouvement d'unification des marchés est général; on peut prévoir le jour où il s'étendra à l'universalité des produits et des capitaux mobilisables. Or, la conséquence de l'unification des marchés c'est l'unification et ce que l'on pourrait appeler l'impersonnalisation des prix.
Sur le marché général des céréales, des cotons, des soies, des autres produits et des valeurs mobilisables, un prix s'établit en raison des quantités disponibles pour l'offre et des prévisions de la demande, et ce prix du marché général devient le régulateur des prix de tous les marchés particuliers qui, se trouvant désormais en communication, ne sont plus que des compartiments du marché général. Ces prix s'augmentent sur certains marchés du montant des droits de douane et des charges locales dont ils sont grevés, mais ils n'en sont pas moins déterminés et réglés par le rapport existant entre les quantités disponibles pour l'offre et prévues pour la demande, sur le marché général. Le prix résultant, de ce rapport est fixé d'une manière impersonnelle, en ce qu'il échappe à l'impulsion plus ou moins intense du besoin de vendre de chacun des vendeurs, du besoin d'acheter de chacun des acheteurs. Tandis que sur un marché limité et étroit, le prix est déterminé le plus souvent par l'impulsion inégalement intense des besoins en présence, sur un marché illimité, où une multitude de vendeurs se font concurrence pour offrir un article, et une multitude d'acheteurs pour le demander, les inégalités d'intensité des besoins de vendre et d'acheter se compensent, s'annulent, et la balance de l'offre et de la demande n'est plus affectée que par les quantités [34]. Cette balance n'en est pas [400] moins d'une sensibilité extrême, l'apport ou le retrait d'une quantité en progression arithmétique déterminant une baisse ou une hausse du prix en progression géométrique. Mais cette hausse ou cette baisse est impersonnelle: elle dérive d'un mouvement du marché, sur lequel chaque vendeur ou chaque acheteur de la marchandise n'exerce qu'une action infinitésimale. Des vendeurs qui détiennent une portion considérable de l'approvisionnement peuvent à la vérité se coaliser pour diminuer l'offre, faire la disette, provoquer par l'impulsion de la loi de progression, une hausse du prix hors de proportion avec la diminution des quantités et réaliser ainsi un bénéfice extraordinaire, surtout s'ils opèrent sur une denrée de première nécessité, dont la demande répond à un besoin particulièrement intense. Mais cette « manœuvre d'accaparement » qui peut réussir sur un marché limité et aisément monopolisable est promptement suivie, lorsqu'elle s'opère dans un marché illimité, de l'apport d'une quantité supplémentaire, attirée par la hausse du prix; d'où une baisse qui occasionne d'habitude la dissolution et la ruine de la coalition, du trust, corner ou syndicat.
C'est donc le mouvement impersonnel de l'offre et de la demande qui détermine le prix du marché général. Mais ce mouvement régulateur du prix courant est déterminé à son tour, quoique d'une façon inaperçue, par les frais de la production et le profit nécessaire des producteurs. N'oublions pas, en effet, qu'aussitôt que le prix courant vient à dépasser les frais de production et le profit nécessaire des producteurs [401] d'un article quelconque, l'esprit d'entreprise et les capitaux sont attirés dans cette direction jusqu'à ce que le prix courant retombe au niveau du « prix naturel », et que le mouvement inverse se produit lorsque le prix courant descend au-dessous des frais de production et du profit nécessaire. La tendance à l'équilibre au niveau des frais les plus bas est, comme nous l'avons constaté, le phénomène dominant du monde économique, et ce phénomène dû à l'action combinée des lois naturelles de l'économie des forces et de la concurrence, détermine à la fois l'abaissement des frais de la production et la distribution utile de ses résultats. Seulement, il n'est pas toujours au pouvoir de l'homme de régler sa production, de manière à réaliser cet équilibre: la production agricole, en particulier, est soumise à des influences qui échappent à la maîtrise de l'homme, mais dont le progrès de ses connaissances et de son industrie peut toujours amoindrir l'action perturbatrice. En revanche, il est toujours le maître de régler sa consommation, et de la proportionner à la production. Il convient de remarquer qu'il obéit communément à cette règle: la hausse des prix a pour effet de restreindre la consommation, la baisse des prix a pour effet de l'augmenter. L'ordre utile qu'établissent les lois naturelles n'en est pas moins incessamment troublé, tantôt du fait de l'homme tantôt du fait de la nature elle-même, mais en dépit de toutes les causes de désordre, le progrès s'accomplit sous l'impulsion de ces lois: l'industrie se perfectionne, les marchés s'étendent, les prix se régularisent.
L'élimination des causes qui retardent les progrès de la production ou qui troublent la distribution des produits, peut fournir encore la matière d'un grand nombre d'articles à ajouter à ceux que nous avons déjà inserits dans notre programme économique. Parmi les causes qui retardent les progrès de la production, nous signalerons par exemple la limitation dans l'espace et le temps de la propriété littéraire, artistique et industrielle (propriété des inventions), la protection accordée aux formes arriérées des entreprises, au détriment des formes progressives, les charges particulières dont celles-ci sont grevées (impôt sur les valeurs mobilières) l'imperfection du mécanisme et du gouvernement des [402] enterprises, notamment des entreprises collectives, les obstacles opposés au développement des rouages distributeurs des produits et des capitaux, l'imperfection des instruments de circulation, résultant de l'attribution à l'état de la fabrication de la monnaie [35]et des privilèges des banques d'émission, le défaut de capacité et de probité dans la gestion des entreprises de tout genre. Parmi ces causes de retard et de désordre, les unes peuvent être immédiatement éliminées, tandis que les autres ne peuvent l'être, — encore est-ce d'une manière incomplète — qu'avec l'auxiliaire du temps. Mais aussi longtemps qu'elles subsisteront, elles produiront des déperditions de forces vitales, partant des souffrances.
II. La Mobilisation Du Travail. — Les progrès qui ont déterminé la mise en communication et l'unification des marchés jadis isolés des capitaux mobiliers et des articles de grande consommation, les céréales, les cotons, les laines, etc., en créant un marché général où le prix se fixe d'une manière impersonnelle, d'après l'estimation des quantités, ces progrès n'ont encore transformé et agrandi que dans une mesure insuffisante les marchés des « capitaux personnels » ou du travail. Ces marchés sont demeurés plus ou moins isolés et limités, et l'intensité inégale du besoin de vendre et d'acheter n'a pas cessé d'y être le facteur principal de la fixation du prix. Or, cette inégalité était d'abord presque toujours à l'avantage de l'entrepreneur, acheteur de travail. Comme le remarquait Adam Smith, — et cette observation était particulièrement exacte à son époque — « à la longue, il se peut que le maître ait autant besoin de l'ouvrier que celui-ci a besoin du [403] maître; mais le besoin du premier n'est pas si pressant ». Sous le régime de l'esclavage et du servage les effets de cette inégalité étaient atténués, dans ce qu'ils pouvaient avoir d'excessif, par l'intérêt du maître: le propriétaire d'esclaves ou de serfs était intéressé à conserver intactes des forces productives qui constituaient, d'habitude, la part la plus considérable de son avoir: il s'abstenait, dans ce but, de soumettre les enfants à un travail prématuré et de nature à empêcher leur croissance et le développement naturel de leurs forces, comme aussi de surmener les adultes; enfin, il était intéressé à assurer la subsistance de ses esclaves, serfs ou sujets. Il n'en a plus été ainsi lorsque l'ouvrier a été affranchi: s'il lui a été possible d'obtenir pour lui-même, en sus de ses frais nécessaires d'entretien, la part de profit que s'attribuait auparavant son maître, en revanche, le prix de son travail a pu être abaissé au dessous de celui du travail de l'esclave ou de la corvée du serf: des entrepreneurs avides ou pressés par la concurrence ont pu profiter de l'inégalité que constatait Adam Smith pour augmenter la durée du travail de l'ouvrier et diminuer son salaire, en ne s'arrêtant qu'au minimum indispensable à l'entretien actuel de ses forces. Sans doute, ils s'exposaient à abaisser la qualité du travail, et, à la longue aussi, à en diminuer la quantité, mais ce risque était lointain, tandis que le profit qu'ils retiraient de l'abaissement du salaire était immédiat.
Les ouvriers ne pouvaient corriger que par deux moyens cette inégalité de situation, que les progrès de l'industrie aggravaient en remplaçant un grand nombre de petits patrons par un nombre de plus en plus réduit de grands entrepreneurs individuels ou collectifs et en diminuant ainsi, sur le même marché, la concurrence des acheteurs. Ils pouvaient aller offrir leur travail dans un autre marché, ou s'associer pour rétablir l'équilibre entre le besoin du vendeur et celui de l'acheteur. L'emploi du premier de ces procédés rencontrait malheureusement des obstacles de tous genres: absence des ressources indispensables à tout déplacement, rareté, lenteur et cherté des moyens de communication, défaut presque complet d'informations sur la situation des autres marchés, les prix des subsistances et des salaires, [404] manque d'intermédiaires pour les guider, lois restrictives de l'émigration, mesures et institutions soi-disant philanthropiques destinées à attacher l'ouvrier à l'atelier par des secours, des pensions de retraite, etc., etc. Ces obstacles qui étaient dans toute leur force à l'époque où les classes ouvrières sont devenues libres de disposer de leur travail, ont disparu en partie: le progrès des moyens de transport notamment a facilité les déplacements, l'émigration intéricure et extérieure s'est accrue dans des proportions extraordinaires; néanmoins, faute surtout du rouage intermédiaire qui mobilisait le travail esclave, les marchés du travail libre sont demeurés plus ou moins isolés et limités.
En présence des obstacles presque insurmontables qui les immobilisaient dans ces marchés limités, les ouvriers ont eu recours, en dépit des lois oppressives qui le leur interdisaient, au procédé des grèves, des coalitions, des unions ou des sociétés de résistance et de maintien des prix.
Dans ces marchés où la concurrence ne pouvait exercer pleinement son action régulatrice, où l'intensité respective des besoins demeurait le facteur principal des prix, le procédé des grèves et des coalitions, malgré ce qu'il avait de coûteux et de dommageable, pouvait seul remédier à l'inégalité de situation des deux parties. Si ignorants que fussent les ouvriers des lois qui régissent l'échange, ils ont appris par une dure expérience que l'ouvrier isolé et vivant le plus souvent au jour le jour est plus pressé de vendre son travail que l'entrepreneur de l'acheter, et que le besoin de l'entrepreneur est d'autant moins intense qu'il emploie un nombre plus considérable d'ouvriers, par conséquent que le retrait d'un seul lui cause une diminution de production et de profit relativement moins sensible. Cette expérience a provoqué l'invention du procédé du retrait collectif de l'offre, ou de la mise en grève, et ce procédé, l'expérience a démontré encore aux ouvriers qu'il fallait choisir de préférence pour le mettre en œuvre le moment où la demande des produits du travail était la plus active, où la grève pouvait causer le plus grand dommage aux entrepreneurs. Le succès ou l'insuccès de la grève est une question de temps. Il s'agit de savoir lesquels des ouvriers ou des entrepreneurs peuvent se passer le plus [405] longtemps, les uns du salaire, les autres du travail. L'issue de la lutte dépend du montant des ressources dont disposent les deux parties, de leur ténacité et des circonstances du moment. Si les entrepreneurs estiment que les ouvriers possèdent des ressources suffisantes pour prolonger leur abstension, s'ils ne peuvent se procurer dans la même localité ou faire venir du dehors des ouvriers en assez grand nombre pour remplacer les grévistes, s'ils ont des commandes urgentes à exécuter, ils compareront le dommage qu'ils subiraient pendant la durée probable de la grève au sacrifice que leur coûterait l'augmentation du salaire ou la diminution de la journée de travail, ils entreront en négociation avec les grévistes, réclameront au besoin les bons offices d'un arbitre, et finiront par céder. Si, au contraire, ils jugent que les ouvriers ne peuvent suspendre longtemps leur offre, faute de ressources, s'ils n'ont pas de commandes pressées, s'ils peuvent remplacer facilement les grévistes, ils résisteront et finiront par l'emporter. C'est une lutte qui a sa tactique, et dont les procédés se perfectionnent par l'expérience, mais qui, à mesure qu'elle met en mouvement des forces plus considérables, devient plus coûteuse. Même quand les ouvriers l'emportent, ils subissent une perte inévitable: celle du montant de leur salaire pendant la durée de la grève. Si la grève s'est prolongée, il faut des mois et même des années avant que l'augmentation du salaire leur ait fait récupérer cette perte. Ils risquent en outre de voir la clientèle, dont la grève n'a pas permis d'exécuter les commandes, se détourner de l'industrie de leur localité, et déterminer ainsi une diminution de la demande de travail, qui les placera plus que jamais à la merci des entrepreneurs. Le procédé des coalitions et des grèves, malgré ce qu'il a de coûteux et de dommageable, n'en est pas moins, dans un marché limité, le seul moyen efficace que possèdent les ouvriers pour corriger l'intensité inégale des besoins du vendeur de travail et de l'acheteur, surtout lorsque l'ouvrier isolé se trouve en présence d'un petit nombre d'entreprises puissantes [36].
Mais supposons que le travail devienne plus « mobilisable », [406] que les marchés isolés et limités de cette marchandise soient mis en communication, de manière à constituer un « marché général », où la concurrence puisse agir sans rencontrer d'obstacles, le prix du travail sur ce marché illimité cessera d'avoir pour facteur l'intensité des besoins des échangistes; il sera déterminé uniquement, comme l'est déjà celui des céréales, des grandes matières premières, des capitaux mobiliers, par le rapport des quantités. Alors l'emploi du procédé des coalitions et des grèves cessera d'être nécessaire pour devenir nuisible à ceux-là même qui y auront recours. Toute coalition ayant pour objet d'accaparer le travail et d'en suspendre l'offre sur un marché illimité échouerait comme ont échoué les coalitions pour l'accaparement des suifs, des cuivres, etc., et cet échec, devenu certain, déterminerait l'abandon d'un procédé passé à l'état de « vieille machine ». Sous l'impulsion régulatrice de la concurrence, désormais illimitée, le prix courant du travail graviterait, comme celui des autres marchandises, placées dans les mêmes conditions, vers le montant des frais de production augmentés du profit nécessaire, et la guerre civile du capital et du travail prendrait fin, comme il est arrivé pour celle des consommateurs et des producteurs des denrées nécessaires à la vie, lorsque le marché de ces denrées est devenu pleinement accessible à la concurrence.
Augmenter la mobilisabilité du travail, tel est donc le progrès qu'il s'agit d'accomplir pour résoudre la question ouvrière. Ce progrès est subordonné à deux conditions: la première c'est la multiplication et l'abaissement du prix des moyens de transport ou de mobilisation du travail, et l'aplanissement des obstacles naturels et artificiels qui entravent cette mobilisation, la seconde, c'est le développement du rouage intermédiaire du commerce du travail, à l'égal de celui du commerce des capitaux mobiliers et des produits de tous genres. Depuis un demi-siècle surtout, le premier de ces progrès est en pleine voie de réalisation: grâce aux chemins de fer et à la navigation à vapeur, l'homme a cessé d'être « detoutes les espèces de bagages la plus difficile à transporter, » et la circulation extérieure aussi bien qu'intérieure du travail s'est continuellement accrue. En revanche, le second progrès et [407] non le moins nécessaire, savoir la reconstitution au profit du travail libre du rouage intermédiaire qui desservait le travail esclave, est demeuré en retard. Les causes qui ont empêché jusqu'à présent, le développement et le perfectionnement de ce rouage qui occupait une place si considérable dans l'économie des anciennes sociétés, ces causes sont de diverses natures. Elles résident, d'une part, dans les entraves légales ou administratives, opposées à l'établissement et au fonctionnement utile des bureaux de placement et des sociétés d'émigration; d'une autre part, dans l'hostilité des ouvriers et des entrepreneurs eux-mêmes, à l'égard des intermédiaires. Comme nous l'avons remarqué ailleurs [37] , c'est la même hostilité qui animait jadis les consommateurs et les producteurs contre les marchands de grains et qui trouvait son explication sinon toujours sa justification dans la limitation des marchés et dans les manœuvres d'accaparement qu'elle rendait possibles. Les ouvriers redoutent de se trouver à la merci d'intermédiaires, appartenant généralement à une basse catégorie, dont la concurrence est limitée dans le marché étroit où ils opèrent; les entrepreneurs, qui étaient les maîtres de fixer les salaires à leur gré, à l'époque où les ouvriers ne possédaient ni le droit de s'associer pour suspendre leur offre dans le temps, ni la possibilité de le mobiliser dans l'espace, se montrent peu disposés à favoriser le développement d'un rouage qui achèverait de détruire leur monopole. Malgré ces obstacles, le besoin auquel répond le « commerce du travail » finira comme tout autre besoin par être satisfait, et il le serait déjà, selon toute apparence, si les obstacles qui l'entravent et les risques qui le grèvent n'avaient empêché ses profits de s'élever au taux nécessaire et retenu l'esprit d'entreprise et les capitaux de s'y porter [38].
[408]
En résumé, la solution de la question ouvrière réside dans l'établissement d'un marché régulateur des salaires, et ce [409] marché régulateur ne peut s'établir que par la mobilisation du travail. La suppression des entraves et l'abaissement des risques qui empêchent la mobilisation du travail doivent en conséquence figurer parmi les articles principaux d'un « programme économique ».
[410]
CHAPITRE V
Le self government. — La tutelle.↩
Qu'une grande partie des maux de la société provient des vices du self government de l'individu. — Comparaison des destinees de deux familles d'ouvriers. — Le passif et l'actif du bilan de l'existence individuelle. — économies que procurerait à la Société un bon self government. Le budget « des passions des hommes ». — Comment on peut le diminuer. — L'appareil de la repression. — Le perfectionnement de l'individu. — La nécessité de la tutelle des incapables. — La tutelle imposée et la tutelle libre. — Raison d'être de la tutelle imposée sous l'ancien régime. — Son organisation, ses avantages et ses inconvénients. — Qu'on a commis la faute de la remplacer par le self government obligatoire. — Que le besoin de tutelle continuant de subsister. Il y a éte pourvu au moyen de la tutelle gouvernementale. — Vice de la tutelle gouvernementale. — Que le progrès consiste à la remplacer par la tutelle libre
Les déperditions de forces vitales et les maux dont elles sont la source et qui retombent, par d'inévitables répercussions sur les parties les plus faibles du corps social, ne proviennent pas seulement, comme les socialistes le supposent, des vices des gouvernements, elles proviennent encore, et peut-être dans une proportion plus forte, de l'imperfection du self government des individus et des collectivités particulières:
Les institutions humaines, disait Malthus, quoi qu'elles puissent occasionner de grands maux à la société, ne sont réellement que des causes légères et superficielles, semblables à des plumes qui flottent sur l'eau, en comparaison des sources plus profondes du mal qui découlent des lois de la nature et des passions des hommes.
[411]
Il y a certainement de l'exagération dans ce passage célèbre de l'Essai sur le principe de population. Les charges et les servitudes d'un régime politique et économique qui a cessé d'être adapté aux conditions actuelles d'existence des sociétés civilisées ne peuvent être raisonnablement assimilées à des « plumes qui flottent sur l'eau »; en revanche, c'est une autre exagération de rendre les gouvernements exclusivement responsables des maux de la société. Une bonne part de cette responsabilité, probablement même la plus forte, revient au self government privé, au défaut de capacité intellectuelle et morale qui rend les individus plus ou moins impropres à gouverner utilement leur production et leur consommation, leurs affaires et leur vie, utilement, c'est-à-dire sans nuire à eux-mêmes et à autrui. Si l'on veut avoir une idée de l'importance du rôle du self government, que l'on prenne, dans une sphère haute ou basse, deux familles, l'une composée d'individus possédant, à un degré élevé, les qualités intellectuelles et morales qui constituent la capacité gouvernante, l'autre, non moins bien douée sous le rapport des qualités physiques et des aptitudes productives, mais pourvue à un faible degré des qualités nécessaires au gouvernement de soi-même, et que l'on compare leurs destinées pendant une période de quelque durée. La première pourra bien essuyer des revers: si c'est une famille d'ouvriers, elles souffrira de l'insuffisance des salaires, du poids des impôts, des chômages, des accidents du travail, mais à force de labeur, de prévoyance, de sobriété et de rigidité dans l'accomplissement de toutes ses obligations morales, elle résoudra à son avantage le problème de l'existence et s'élèvera, selon toutes probabilités, d'un ou de plusieurs degrés dans la hiérarchie sociale. La seconde, au contraire, si haut qu'elle soit placée dans cette hiérarchie, et quelle que soit l'importance de son capital de forces vitales, finira par le gaspiller et le perdre, faute des qualités nécessaires pour en gouverner utilement l'emploi, et par descendre, de chute en chute, dans le caput mortuum des rebuts de la société.
Si l'on considère donc la société, ou pour mieux dire, l'espèce humaine dans son ensemble, on trouve que sa prospérité, ses progrès ou sa décadence dépendent de chacun des [412] individus successifs qui la composent. Chaque existence individuelle a son doit et son avoir, son passif et son actif et se solde par une perte ou par un profit. Le passif de ce compte comprend d'abord le capital dépensé pour l'élève et l'éducation de l'individu, ensuite celui qu'il a dépensé lui-même ou qui a été dépensé pour lui jusqu'à la fin de sa vie. L'actif se compose du capital qu'il a créé et accumulé par son activité productive. Si, l'existence terminée, le capital dépensé se trouve reconstitué avec un surplus, la société ou l'espèce se trouve enrichie de ce surplus: l'existence de l'individu se solde par un profit. Si le capital n'est pas entièrement reconstitué, l'existence se solde par une perte. Toutefois en dressant ce compte, à supposer qu'il puisse être dressé, il importe de faire le départ de ce que l'individu a acquis aux dépens d'autrui et de ce qu'il a dépensé au profit d'autrui sans en être rétribué. Telle existence peut se solder par un profit individuel apparent et par une perte pour l'espèce, telle autre peut se solder par une perte individuelle et par un profit pour l'espèce.
Ce qui détermine, avant tout, la balance favorable ou défavorable de ce compte, c'est bien moins le montant plus ou moins considérable des forces vitales dont l'individu est doué ou dont il dispose que son aptitude à les diriger utilement pour lui-même et pour autrui. Toutes les créatures vivantes sont pourvues de forces adaptées à leur destination, c'est-à-dire à la conservation et à l'accroissement de la vie de l'individu, partant de l'espèce. Mais ces forces sont, les unes insuffisantes, les autres surabondantes. La tâche des facultés dirigeantes, qui sont les instruments du self government, consiste à stimuler les unes et à refréner les autres: faute de ce stimulant et de ce frein, celles-là ne produisent pas ce qu'elles pourraient produire; celles-ci consomment au-delà de ce qu'elles devraient consommer. Là, c'est la paresse; ici, sous des formes diverses, l'intempérance. La combinaison de ces deux vices excite l'individu à consommer plus qu'il ne produit: ils sont encore les facteurs de la tendance à s'emparer du bien d'autrui, et cette tendance est la cause principale des maux qui affligent l'espèce humaine, tant par les frais que coûtent les appareils, toujours insuffisants, qu'il a fallu établir [413] pour la réprimer que par les risques dont elle grève la production des forces vitales.
Supposons, en effet, que la tendance à s'emparer, par violence ou par ruse, du bien d'autrui cessât d'exister, ou que l'individu acquît une capacité de self government suffisante pour la réprimer toujours, le coûteux appareil à l'aide duquel chacune des sociétés, entre lesquelles se partage l'espèce, pourvoit à sa sécurité intérieure et extérieure, deviendrait inutile et pourrait être supprimé. A l'énorme économie que la société réaliserait de ce chef, viendrait s'ajouter le profit résultant de la suppression des précautions que chacun est obligé de prendre et du temps qu'il est obligé de dépenser pour se préserver de la malhonnêteté d'autrui; enfin un autre profit plus considérable encore, provenant de l'accroissement de l'excitation à produire dans un état social où l'on serait pleinement assuré de jouir soi-même des fruits de son travail et de sa peine. Le budget de la tendance au vol apparaît donc comme le plus lourd de tous. A la vérité, le vol procure à ceux qui le pratiquent avec succès des profits parfois considérables, mais ces profits particuliers du vol sous ses différentes formes, publiques et privées, collectives et individuelles, monopole, protectionnisme, sinécurisme, vol simple avec ou sans effraction, tromperie sur la qualité et le poids des marchandises, falsifications, escroquerie, banqueroute, etc., ne constituent qu'une quantité infinitésimale en comparaison de la perte de forces vitales qu'ils infligent à l'espèce. On peut en dire autant des faiblesses et des vices qui sont les facteurs de la tendance au vol, même lorsqu'ils ne poussent pas l'individu à s'emparer du bien d'autrui, lorsqu'ils ne paralysent ou ne détruisent que ses propres forces ou ses propres ressources. Le budget des « passions des hommes », pour nous servir de l'expression de Malthus, se chiffre par milliards tant par les forces vitales qu'il détruit que par celles qu'il empêche de produire, et ce budget, c'est l'insuffisance de capacité du self government individuel qui oblige l'espèce humaine à le payer.
Les impôts qui alimentent ce budget, aucune organisation sociale, si parfaite qu'on la suppose, ne réussirait à les supprimer; ils sont la dette de l'imperfection de la nature [414] humaine; on peut seulement en alléger le poids, soit en augmentant l'efficacité de l'appareil répressif des nuisances que produisent les « passions des hommes » soit en perfectionnant l'individu et son self government ou en soumettant les moins capables de se gouverner eux-mêmes à la tutelle des plus capables.
I. L'appareil Répressif. — L'appareil dont les sociétés disposent pour réprimer les nuisances individuelles ou collectives, et en empêcher par là même la production, se compose de trois grands rouages: l'opinion, le pouvoir social et la religion. C'est l'opinion, déterminée par l'observation et l'expérience, qui juge et décide de l'utilité ou de la nuisibilité des actes, et qui établit, en conséquence, sous forme de coutumes ou de lois, les règles positives du droit et de la morale, qu'elle se charge ensuite de faire observer avec le concours du pouvoir social et du pouvoir religieux. Mais l'opinion est faillible et ses jugements sont d'ailleurs faussés par l'intérêt particulier de ceux qui la conçoivent et l'expriment. En outre, l'opinion n'est pas « une »: l'opinion de la multitude sur le caractère d'utilité ou de nuisibilité des actes diffère fréquement de celle de la classe en possession du pouvoir social et celle-ci ne s'accorde pas toujours avec l'opinion du pouvoir religieux. Cependant, il est un certain nombre d'actes dont le caractère de nuisibilité est particulièrement grave et saisissant, que les trois pouvoirs répressifs s'accordent à condamner et auxquels ils opposent chacun la peine qui est à sa disposition. La multitude exécute son verdict par le blâme et la mise en quarantaine, nous dirions aujourd'hui le boycotage de ceux qu'elle a condamnés. A cette peine, à la fois morale et matérielle, le pouvoir social et le pouvoir religieux joignent les leurs. Grâce à ce triple appareil de gouvernement qui fixe et délimite, en prenant pour règle l'intérêt général et permanent de l'association, rattaché ou non à celui de l'espèce, les droits et les devoirs de chacun, les sociétés peuvent subsister, mais non sans subir une déperdition constante de forces vitales, tant par la fixation et la délimitation inexactes des droits et des devoirs que par le défaut d'adaptation et de proportion des pénalités répressives et l'incertitude de leur application. [415] Le perfectionnement successif de cet appareil de répression des nuisances, qui diminuent les forces vitales de la société et de l'espèce ou en ralentissent l'accroissement, doit encore figurer au nombre des articles d'un programme économique [39].
II. Le Progrès Du Self Government. La Tutelle. — Cependant, un progrès plus utile encore que celui-là, serait celui qui dispenserait les sociétés de maintenir l'imparfait et coûteux appareil de la répression, nous voulons parler du perfectionnement de l'individu et de sa capacité de se gouverner. En admettant que ce progrès soit un jour pleinement réalisé, que la multitude des individus successifs qui constitue l'espèce humaine acquière, avec la capacité de connaître exactement ses droits et ses devoirs, la force morale nécessaire pour exercer les uns et accomplir les autres, que la réaction de la conscience individuelle contre les infractions aux droits et les manquements aux devoirs devienne assez puissante pour dispenser de toute autre répression, que l'individu réussisse ainsi à se gouverner de la manière la plus conforme à l'intérêt général et permanent de l'espèce, le résultat sera pour celle-ci la production d'un maximum de forces vitales en échange d'un minimum de dépense, partant le plus grand accroissement possible de sa puissance d'expansion et de durée. Enfin, en supposant que la destinée de l'individu soit attachée à celle de l'espèce, cette conduite, quels que soient les sacrifices et les peines qu'elle lui impose, sera la plus conforme à son intérêt sinon actuel du moins futur.
Malheureusement, cette capacité intellectuelle et morale nécessaire au gouvernement de soi-même, aucune des individualités constitutives de l'espèce ne la possède et ne la possédera jamais dans toute sa plénitude; elle leur fait complètement défaut dans la première période de la vie, souvent même dans la dernière, et elle se trouve inégalement distribuée entre elles, dans la période intermédiaire. De là, la nécessité de la tutelle, c'est-à-dire du gouvernement des incapables ou des moins capables par les plus capables.
[416]
La tutelle peut être imposée: telle est la tutelle gouvernementale et celle du père de famille jusqu'à l'époque de l'émancipation légale des enfants; elle peut être libre et elle l'est dans les cas nombreux où un individu subordonne sa volonté à celle d'un individu ou d'une collectivité qu'il reconnaît plus capable que lui-même de diriger sa conduite d'une manière conforme à son intérêt. Mais la tutelle n'est utile qu'autant qu'elle n'empêche pas le développement de la capacité gouvernante du pupille; elle doit être mesurée à l'insuffisance de cette capacité, et, sauf dans le cas où l'individu est complètement incapable, il est le meilleur juge du besoin qu'il en a. Le défaut principal de la tutelle imposée, c'est de s'appliquer également à des individus inégalement incapables du self government et même à des individus en possession d'une capacité suffisante pour le pratiquer.
Dans les anciennes sociétés, la tutelle imposée était la règle; elle constituait une servitude générale à laquelle toutes les classes de la société, classes gouvernantes et classes gouvernées, maîtres, esclaves, serfs ou sujets étaient, à des degrés divers, assujettis; elle avait sa raison d'être, d'une part, dans l'insuffisance presque générale de la capacité du self government tant par le fait de l'ignorance où chacun se trouvait des limites de son droit et de son devoir que du défaut de force morale nécessaire pour y renfermer son activité; d'une autre part, dans les périls toujours imminents que la pression de la concurrence destructive faisait courir aux sociétés, et qui les obligeait, dans l'intérêt du salut commun, à imposer à leurs membres une discipline d'autant plus rigoureuse qu'ils étaient moins capables de se gouverner eux-mêmes. Cependant cette tutelle imposée n'était pas uniforme, et elle avait pour caractère essentiel d'être spécialisée. Chaque corporation politique, religieuse, industrielle avait la sienne, et. au-dessous de ces corporations entre lesquelles se distribuaient les classes libres ou réputées telles, la multitude des esclaves et des serfs était assujettie à la tutelle discrétionnaire du maître ou du seigneur. Les membres de la corporation politique qui possédait l'état, soit qu'elle fût gouvernée par un dictateur héréditaire ou par une assemblée de chefs élus, étaient soumis à un régime préventif des actes jugés nuisibles [417] à l'intérêt de la corporation, et ce régime était plus ou moins restrictif de leur liberté, selon que l'expérience avait démontré qu'ils étaient plus ou moins capables d'agir d'une manière conforme à l'intérêt corporatif. Les membres des corporations industrielles étaient soumis à une réglementation ayant le même objet. Cette réglementation prescrivait, par exemple, le mode de fabrication des étoffes et interdisait l'emploi des matériaux de basse qualité, elle obligeait à pratiquer publiquement les opérations de certains métiers, en vue d'empêcher les falsifications et les fraudes. Les propriétaires d'esclaves et de serfs exerçaient sur cette catégorie nombreuse d'individus une tutelle bien autrement étendue: ils réglaient notamment leur multiplication, décidaient du métier ou de la profession que l'esclave devait exercer, imposaient aux serfs l'obligation de cultiver certaines denrées de préférence à d'autres.
Cette tutelle imposée, qui caractérisait l'organisation des anciennes sociétés était défectueuse à bien des égards. C'est ainsi que la tutelle industrielle, tout en empêchant dans quelque mesure des individus avides et peu scrupuleux d'abaisser la qualité des produits aux dépens de la bonne renommée de la corporation, faisait obstacle aux progrès que la liberté eût permis de réaliser; c'est ainsi encore que la tutelle arbitraire à laquelle l'esclave était assujetti l'empêchait fréquemment de choisir le métier auquel il était le plus propre; en revanche, les restrictions que ce régime imposait à la liberté de chacun étaient rachetées par la sécurité qu'il procurait. La corporation politique ou industrielle était intéressée à la prospérité de ses membres, et elle venait à leur aide, en cas de nécessité, le maître ou le seigneur l'était plus encore à la conservation de ses esclaves ou de ses serfs. Cette assurance se payait à un prix élevé, mais si les assurés l'avaient trouvée trop chère et s'étaient sentis capables de s'en passer, auraient-ils continué, pendant de longs siècles, à la payer?
Sous la double influence de l'accroissement de la capacité du self government et de l'affaiblissement graduel de la pression de la concurrence destructive, la tutelle imposée et spécialisée des corporations, de l'esclavage et du servage a fini par disparaître des sociétés civilisées. L'émancipation s'est [418] faite. Le self government a non seulement remplacé la tutelle mais encore il a été rendu obligatoire. Nous savons quels ont été les résultats de ce changement de régime: si, pour les individualités capables du self government, la suppression des entraves et des gênes inhérentes à tout régime de tutelle a été avantageuse, elle a été nuisible à celles qui ne possédaient cette capacité que dans une mesure trop faible pour user utilement des droits qu'elle leur conférait et remplir les obligations qu'elle leur imposait. L'expérience a démontré, en un mot, qu'en supprimant la tutelle, on n'avait pas supprimé le besoin de tutelle. A défaut des institutions abolies, institutions grossières sans doute et qui n'étaient plus en harmonie avec les conditions nouvelles d'existence des sociétés, qu'a-t-on fait pour pourvoir à ce besoin? On s'est adressé à l'état, c'est-à-dire à la seule institution qui fut demeurée debout, au milieu des ruines de l'ancien régime, et on lui a demandé de remplacer la tutelle que l'on avait commis l'imprudence de supprimer au lieu de cesser de l'imposer.
L'état moderne a répondu à cette demande, devenue plus pressante à mesure que les maux causés par l'insuffisance du self government individuel se sont aggravés et multipliés. A la tutelle restreinte que ses fondés de pouvoir exerçaient jadis sur la corporation politique a succédé une tutelle générale qui s'étend dans ses applications diverses et multiples à toutes les classes de la société, tantôt sous forme de lois ou de règlements préventifs des nuisances produites par l'incapacité du self government, tantôt sous forme de lois de protection ou d'assistance. Cette tutelle, l'état a même entrepris de la monopoliser, en interdisant ou en entravant la création et la mise en œuvre des institutions qui pouvaient lui faire concurrence.
Cependant, l'expérience n'a pas tardé à démontrer l'incapacité de l'état à remplir la fonction de tuteur. Le vice capital de sa tutelle est celui-là même qui avait provoqué la destruction des anciennes institutions tutélaires, c'est d'être imposée, de s'appliquer aussi bien aux individualités capables du self government qu'à celles qui en sont incapables, d'opposer ainsi des obstacles à l'exercice utile de la capacité des unes afin de préserver les autres des effets nuisibles de [419] leur incapacité, et de déterminer, en dernière analyse, une déperdition de forces vitales au détriment de la société et de l'espèce. Le progrès consiste donc aujourd'hui à substituer à la tutelle imposée et généralisée, telle que l'exerce l'état, une tutelle libre, spécialisée et mesurée sur le besoin de tutelle, en laissant aux individus le choix entre le self government et la tutelle. Nous avons vu comment ce progrès peut être réalisé [40] ; il le sera d'autant plus vite que les maux provenant de l'insuffisance du self government iront s'aggravant et que l'expérience démontrera plus complètement l'impuissance de la tutelle gouvernementale à y remédier.
Le perfectionnement de l'individu et du self government individuel, la substitution de la tutelle libre et spécialisée à la tutelle imposée, généralisée et monopolisée de l'état, tels sont les derniers, mais non les moins importants articles d'un « programme économique. »
[420]
CHAPITRE VI
Portée limitée du programme économique.↩
Que la demande d'une réforme des institutions politiques et économiques se produit lorsqu'elles deviennent nuisibles après avoir été utiles. — Qu'elle se manifeste actuellement sous l'influence des progrès du matériel et des arts de la destruction et de la production. — Qu'elle est déterminée encore par la suppression hative et radicale de l'ancienne tutelle. — Vice des conceptions qui ont répondu à cette demande. — Le défaut de connaissance du mécanisme de la Société. — L'illusion et l'exagération de l'efficacité des réformes. — L'exagération de leur prix de revient. — Le discrédit des réformes politiques. — Les déceptions certaines des réformes et des experimentations socialistes. — Pourquoi le programme économique ne sera réalisé qu'après l'échec des programmes socialistes. — Que les réformes contenues dans ce programme ne peuvent avoir les effets d'une panacée. — Que l'œuvre du progrès est multiple et successive. — Qu'on peut acheter un progrès trop cher.
De tous temps et dans toutes les sociétés, le besoin de progrès s'est fait sentir et il a provoqué une « demande » de changement dans les institutions politiques et économiques, dans les règles de conduite des individus et dans l'outillage de leur industrie. Cette demande est particulièrement active aux époques et dans les pays où la concurrence, sous sa forme destructive ou productive, exerce une pression plus vive, où une expérience désastreuse démontre l'insuffisance des instruments et des procédés surannés qui sont mis en œuvre pour la soutenir. Elle l'est encore, lorsque les conditions d'existence de la société venant à se modifier, sous l'influence même des progrès accomplis, l'organisation adaptée à l'ancien [421] état de choses a cessé de l'être au nouveau. C'est ainsi que les progrès réalisés dans les arts de la destruction et de la production ont rendu nuisibles des institutions et des pratiques qui étaient auparavant nécessaires, telles que la dictature héréditaire d'une oligarchie ou d'une maison souveraine, la pratique de la guerre entre les peuples civilisés avec les servitudes qu'elle impose à la production et aux échanges; c'est ainsi enfin que le développement des facultés gouvernantes a rendu de même nuisible et intolérable la tutelle imposée sous les formes primitives et grossières de l'esclavage et du servage.
De là, la demande extraordinaire de progrès qui s'est manifestée surtout depuis que la transformation du matériel de la destruction a définitivement assuré la sécurité du monde civilisé et que celle du matériel de la production a commencé à internationaliser et à solidariser les intérêts des peuples. De là aussi, à la suite de l'abolition des anciennes formes de la tutelle, et des maux dont cette abolition, trop générale et trop souvent hative, a été la source pour le grand nombre des incapables du self government, la demande d'un nouveau régime de tutelle. Ces demandes n'ont pas manqué de provoquer des offres destinées à les satisfaire. Les réformateurs politiques et socialistes ont encombré le marché de leurs produits. Mais ces conceptions, improvisées pour répondre à la demande du moment, sont entachées pour la plupart d'un vice radical, en ce qu'elles ne tiennent aucun compte des lois naturelles qui régissent la vie des sociétés. Leurs auteurs prétendent reformer le plus compliqué et le plus délicat des mécanismes, — celui de la société — sans s'être donné la peine d'étudier la mécanique sociale. Cette absence d'une science gênante a pour effet naturel de les porter à s'exagérer l'efficacité des « systèmes » dont ils sont les inventeurs ou les promoteurs et de les persuader qu'on ne saurait en acheter trop cher l'application. Aux yeux des réformateurs politiques de la fin du siècle dernier et de la première moitié de ce siècle, par exemple, la substitution d'une forme de gouvernement à une autre ou bien encore d'un régime de suffrage universel à un régime de suffrage limité, devait avoir pour résultat infaillible l'amélioration radicale de la condition de la [422] société, et il ne fallait pas regarder au prix qu'il pouvait coûter. Si élevé que fût ce prix, le résultat ne pouvait manquer de le rembourser au centuple. Sur cette assurance, facilement acceptée par la multitude souffrante et ignorante, des révolutions ont été faites, l'ancien régime politique a été renversé, un nouveau régime a été établi, au prix d'énormes sacrifices de sang et d'argent. Mais tantôt les institutions nouvelles étaient moins adaptées que les anciennes à la situation de la société, tantôt le progrès réalisé ne compensait pas les frais qu'il avait coûtés. Alors qu'est-il arrivé? C'est que l'expérience ayant démontré que les réformes politiques n'avaient point la vertu d'une panacée, qu'elles n'amélioraient que dans une mesure limitée la condition de la multitude, quand elles l'amélioraient, elles sont tombées, peu à peu, en discrédit. Cependant, le besoin de réformes continuant plus que jamais à se faire sentir, aux réformateurs politiques ont succédé les réformateurs socialistes: ceux-ci ne se sont pas contentés de la réforme, désormais reconnue insuffisante, des institutions politiques, ils ont entrepris de changer l'ensemble des institutions sociales, en affirmant, comme le faisaient au surplus leurs devanciers, que l'application de leur système, communiste, fouriériste, collectiviste ou anarchiste, supprimerait infailliblement toutes les misères, guérirait tous les maux et inaugurerait l'ère du bonheur universel. Malgré les déceptions du passé, ils ont recruté et ils recrutent tous les jours des adhérents de plus en plus nombreux, tant est pressant le besoin de la réforme d'un régime qui a cessé d'être adapté aux conditions actuelles d'existence des sociétés civilisées. Il est donc à craindre qu'à la phase des expérimentations politiques ne succède celle des expérimentations socialistes, mais on peut prédire à coup sûr que celles-ci comme celles-là aboutiront à des déceptions coûteuses, et qu'elles seront suivies d'une réaction analogue à celle qui a discrédité et enrayé le progrès politique.
Nous ne pouvons nous dissimuler qu'un programme économique, fondé sur les lois naturelles, répond beaucoup moins, dans l'état actuel des esprits, à la demande de progrès que les programmes politiques et socialistes, et que c'est seulement après que l'expérience en aura fait justice qu'il [423] pourra avoir son tour. D'une part, il ne promet aux « producteurs » du progrès économique et social qu'une récompense purement morale, de l'autre, il ne peut donner aux « consommateurs », qui demandent ce progrès, qu'une satisfaction toujours incomplète. Chacune des réformes qui y sont comprises supprimera une certaine quantité de nuisances ou produira une certaine quantité d'utilités, mais, à la différence des panacées politiques ou socialistes, ces réformes laisseront toujours des maux à guérir et des progrès à réaliser. Si l'établissement du libre-échange et de l'assurance contre la guerre, la simplification de l'état, la mobilisation du travail, la substitution de la tutelle libre à la tutelle imposée, contribuent à améliorer et à élever sensiblement la condition de l'espèce humaine, ils ne tariront point cependant la source de ses maux. Si perfectionnés qu'on les suppose, le mécanisme de la production et de la distribution de la richesse, le self government et la tutelle libre ne seront jamais parfaits. Or, il ne faut pas oublier que toute imperfection dans les rouages et la mise en œuvre du mécanisme au moyen duquel se produisent et se distribuent les forces vitales, toute faute commise dans le gouvernement individuel ou collectif qui règle leur emploi utile, se traduit par une nuisance et produit une somme plus ou moins considérable de souffrances, qui vont se répercutant de proche en proche dans toutes les parties du corps social, en affectant surtout les parties les plus faibles de ce vaste et délicat organisme. Enfin, en admettant même que le mécanisme producteur et distributeur aussi bien que le gouvernement individuel ou collectif soient parfaits, l'imperfection du milieu, les troubles des saisons et les autres accidents auxquels l'homme ne pourra jamais, selon toute apparence, remédier entièrement, continueront d'être pour l'espèce une source de nuisances et de souffrances.
En résumé, — et c'est la conclusion qui ressort de l'étude attentive du phénomène du progrès, — l'amélioration de la condition des sociétés et des individus ne peut dépendre d'une seule réforme, si importante qu'elle soit. C'est une illusion orgueilleuse et naïve des réformateurs socialistes de croire qu'il suffira d'adopter leur système, d'établir le communisme, le fouriérisme, le collectivisme ou l'anarchisme [424] pour rendre tout progrès ultérieur désormais inutile, en sorte que l'humanité n'ait plus autre chose à faire qu'à jouir des bienfaits d'un système dont la conception est due au génie d'un nouveau Moïse. Il n'en va pas ainsi. Lœuvre du progrès est multiple et successive; elle transforme continuellement les institutions politiques, les rouages économiques et les pratiques morales aussi bien que l'outillage de l'industrie, et toute invention, toute découverte, toute acquisition qui accroît la somme des forces vitales de l'espèce et diminue la dépense nécessaire pour les acquérir contribue, dans une mesure plus ou moins large, à cette œuvre. Dans l'état de transition où nous sommes, entre un régime fondé sur la nécessité de la guerre et un autre régime qui implique la nécessité de la paix, la tâche qui s'impose aux producteurs du progrès est sans doute plus considérable qu'elle ne l'a été à aucune des autres périodes de l'histoire: il ne s'agit de rien moins que de démolir l'appareil de fortifications et de servitudes qui a protégé le premier âge de l'humanité, et qui, devenu un obstacle après avoir été un secours, retarde l'établissement du régime de liberté et de paix, adapté à sa maturité. Mais, cette œuvre accomplie, le nouveau régime aura ses défectuosités auxquelles il faudra remédier par d'autres progrès.
Tout progrès n'a donc qu'une portée limitée. Cette portée, il ne faut point l'exagérer et présenter comme une panacée un simple remède. Il faut calculer aussi ce que coûte chaque progrès et ce qu'il est dans sa nature de rapporter. On peut, — et c'est malheureusement une considération à laquelle ne s'arrêtent point les réformateurs politiques ou socialistes, — acheter un progrès trop cher si l'on dépense pour l'acquérir une somme de forces vitales supérieure à celle qu'il peut produire.
[425]
CHAPITRE VII
Les méthodes socialistes et la méthode économique.↩
Que le premier et nécessaire objectif du socialisme est la main-mise sur l'état. — Les deux méthodes de conquête de l'état. — La méthode révolutionnaire et la méthode constitutionnelle et parlementaire. — Ce que coûte et ce que rapporte la premiere. — Que toute revolution est condamnée à un avortement. — Mode d'opération de la seconde. — Ses résultats négatifs. — La méthode économique. — Qu'elle a pour objectif, non la conquête de l'état. mais celle de l'opinion. — Ses instruments. — Obstacles qu'elle rencontre. — Comment elle peut les surmonter. — Utilité de la concurrence des faux systèmes. — La puissance de l'opinion. — La force apparente et la faiblesse réelle des institutions qu'il s'agit de réformer. — Immoralité des impôts indirects, du papier-monnaie et des emprunts perpétuels, qui les soutiennent et les perpétuent. — Qu'il suffit d'éclairer l'opinion et de la laisser faire. — Utilité d'une Association cosmopolite pour la réalisation du programme économique.
Les doctrines socialistes, actuellement en vogue, tout en différant sur le mode d'organisation de la production et sur le régime de la distribution de la richesse, s'accordent sur un point fondamental: c'est que ni la production ni la distribution ne sont régies par des lois naturelles auxquelles l'homme est tenu d'obéir et qu'il n'est pas en son pouvoir de changer. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de tenir compte de ces lois naturelles qui n'existent pas. Chacune des sociétés ou des nations entre lesquelles se partage l'espèce humaine est maîtresse de régler à sa guise son économie intérieure, en favorisant tantôt une classe tantôt une autre, sans craindre de se [426] heurter à des lois supérieures dont la méconnaissance détermine sa décadence et sa ruine. L'état, organe de la société, est souverain en cette matière, il n'y a pas de puissance audessus de la sienne. Il s'agit donc avant tout d'enlever l'état aux classes propriétaires et capitalistes qui en ont fait l'instrument de leur domination et de leur exploitation pour le restituer au peuple, auquel il a été originairement ravi par un abus de la force. Lorsque le peuple aura recouvré la possession de cette toute puissante machine, il s'en servira pour faire des lois qui organisent la production et la distribution de la richesse au profit de la généralité, de même que les classes propriétaires s'en sont servies et continuent à s'en servir pour s'attribuer la meilleure part des fruits du travail de la multitude.
S'emparer de l'état, tel est le premier et nécessaire objectif du socialisme. Pour atteindre cet objectif, on peut employer deux méthodes: la méthode révolutionnaire et la méthode constitutionnelle et parlementaire. La première consiste à renverser par la force le gouvernement établi, aristocratique ou bourgeois, et à le remplacer par le gouvernement du peuple ouvrier. La seconde, plus lente mais moins périlleuse, réside dans l'extension des droits politiques, autrement dit dans l'établissement du suffrage universel, ayant pour conséquence inévitable quoique peut-être lointaine, la remise de la machine à faire les lois aux mains des masses populaires.
Ces deux méthodes sont également légitimes. En vertu de l'adage: adversus hostem œterna est auctoritas, le peuple a toujours le droit de reconquérir le pouvoir souverain qui lui a été dérobé et aucun scrupule ne doit l'arrêter dans l'exercise de ce droit. Il est le maître de choisir son heure et ses procédés: il peut recourir aux conspirations secrètes ou à l'insurrection ouverte et ses serviteurs ne doivent pas reculer même devant l'assassinat. Car lorsqu'il s'agit de rétablir la justice, la fin justifie les moyens, et toute objection morale doit être écartée en présence de la souveraineté du but. Toutefois si la méthode révolutionnaire, incontestablement la plus expéditive et la plus sûre, ne peut être employée avec des chances suffisantes de succès, le peuple peut, en attendant des circonstances plus propices, recourir à la méthode constitutionnelle et [427] parlementaire. C'est une question de possibilité et d'opportunité. La méthode constitutionnelle et parlementaire implique la constitution d'un parti politique, ayant pour mission de préparer et de voter l'ensemble des lois d'organisation de la production et de la distribution de la richesse, contenues dans le programme socialiste. Ce parti, les masses populaires qui forment, sous un régime de suffrage universel, la majorité électorale ne peuvent manquer, lorsqu'elles seront suffisamment éclairées, de le mettre en majorité dans le parlement. A son tour, il ne peut manquer, dès son arrivée au pouvoir, de réaliser fidèlement le programme que ses électeurs lui auront imposé, au besoin par un mandat impératif.
Telles sont les deux méthodes d'application auxquelles s'arrêtent les différentes écoles socialistes. Il y en a bien une troisième, celle des anarchistes, mais celle-ci n'est qu'une variante de la méthode révolutionnaire. Les anarchistes veulent, à la fois, renverser le gouvernement établi sans en constituer un autre, confisquer sans indemnité et supprimer la propriété individuelle. Seulement, à moins qu'avec la propriété ils ne suppriment les propriétaires, on ne voit pas bien comment ils réussiraient à arriver à leurs fins, s'ils s'abstenaient de reconstituer une force capable de briser toutes les résistances, c'est-à-dire un gouvernement.
Ces deux méthodes sont, comme nous l'allons voir, presque également coûteuses et décevantes. Analysons d'abord la première et faisons le compte de ce qu'elle coûte et de ce qu'elle rapporte. Le renversement d'un gouvernement exige, comme toute autre entreprise, la réunion et l'emploi d'un capital, destiné à recruter, à outiller et à entretenir une armée de conspirateurs et d'insurgés. A ces premiers frais de production de l'entreprise, il faut ajouter les dommages inévitables que causent les émeutes et les insurrections Si l'armée révolutionnaire est battue et dispersée, ces frais restent sans couverture et ces dommages sans compensation: c'est une perte sèche. En outre, la nation qu'il s'est agi d'affranchir, d'unifier ou de socialiser est obligée de couvrir la dépense de la répression et de subir les servitudes et les gênes que le gouvernement vainqueur lui inflige pour prévenir de nouvelles tentatives de révolte. Si la révolution triomphe, après une [428] lutte plus ou moins longue et onéreuse, quels progrès réalise-t-elle? Elle commence d'abord et nécessairement par remplacer le personnel du gouvernement vaincu et dépossédé par le personnel révolutionnaire, celui-ci généralement plus nombreux et médiocrement apte à remplir des fonctions auxquelles la pratique des conspirations et des émeutes n'avait point suffi à le préparer. De là, une augmentation inévitable des frais de gouvernement, et, jusqu'à ce que le nouveau personnel ait fini son apprentissage, un abaissement de la qualité des services politiques et administratifs. Cependant les révolutionnaires avaient un programme: c'est même uniquement afin de réaliser ce programme qu'ils ont entrepris la révolution. Qu'en font-ils? Lorsqu'ils sont entrés en possession du gouvernement, ils ne tardent pas à s'apercevoir qu'une partie de ce programme, et non la moins importante, celle qui concerne la diminution des dépenses publiques, doit être sacrifiée à la nécessité impérieuse de récompenser leur armée, et qu'une autre partie est ou utopique et irréalisable ou en opposition avec des intérêts prépondérants, avec lesquels tout gouvernement et surtout un gouvernement nouveau est tenu de compter. Toute révolution se trouve ainsi fatalement condamnée à un avortement. Les révolutionnaires naïfs ou mal repus ne se consolent point de cette déception de leurs rêves, mais les politiciens avisés abandonnent sans regret un bagage de réformes, devenu encombrant, car ils ont atteint le but essentiel qu'ils visaient: ils sont arrivés [41].
[429]
La méthode constitutionnelle et parlementaire procède habituellement de la méthode révolutionnaire; elle est moins onéreuse sans être beaucoup plus efficace. Lorsqu'un parti révolutionnaire s'est emparé du gouvernement d'un pays, il manque rarement de se diviser. Les mécontents, ceux qui n'ont pas obtenu la part à laquelle ils croyaient avoir droit dans les produits de l'entreprise et les utopistes qu'irrite l'abandon décevant du programme de la révolution, reprennent ce programme, en l'élaguant ou l'augmentant de manière à l'adapter à la demande actuelle. Ils constituent un parti dissident et s'efforcent d'enlever le pouvoir à leurs anciens associés. Si l'emploi des moyens révolutionnaires ne leur présente point des chances suffisantes de succès, — ce qui est le cas ordinaire dans un pays qui vient d'endurer la fatigue et de subir les dommages d'une révolution, — ils ont recours à la méthode constitutionnelle et parlementaire. Au lieu de projectiles meurtriers, cette méthode emploie des bulletins de vote et des boules de scrutin, mais, comme la méthode révolutionnaire, elle implique le recrutement et l'organisation d'une armée, avec l'appât d'une solde consistant dans les dépouilles des vaincus. Le nouveau parti s'efforce de gagner à sa cause la majorité électorale, soit par les promesses de son programme, soit par des appâts plus substantiels. Les fautes de ses adversaires, les déceptions dont leur avènement au pouvoir a été suivies, contribuent d'ailleurs à grossir rapidement le nombre de ses adhérents. A son tour, il arrive au pouvoir. Mais alors, il se heurte aux mêmes difficultés auxquelles s'étaient heurtés ses adversaires et il subit les mêmes nécessités qu'ils avaient subies. Il doit récompenser ses [430] partisans sous peine d'être abandonné par eux, renoncer aux articles utopiques de son programme et compter avec les intérêts hostiles aux réformes utiles que ce programme peut contenir, intérêts qui trouvent un appui naturel dans le parti dépossédé. Sous peine de renoncer aux fruits de sa victoire, il est donc obligé de laisser, encore une fois, cette victoire stérile.
Tels sont les résultats négatifs des procédés prétendus réformistes des révolutions et des luttes électorales et parlementaires. Ces procédés stériles et décevants, en consolidant ce qui devrait être supprimé ou réformé dans l'organisme politique et économique, ont propagé le sentiment décourageant de l'inutilité des tentatives de réforme et engendré le pessimisme des uns, le scepticisme des autres. Ainsi se prépare la décadence qui est tôt ou tard la conséquence du gaspillage des forces vitales d'une nation, et cette décadence devient plus difficile à éviter à mesure que la pression de la concurrence extérieure, sous sa forme destructive ou productive, devient plus forte.
La méthode économique diffère complètement de celles-là. Elle n'a point pour objectif la conquête du gouvernement, elle se propose uniquement de convertir l'opinion et de se servir de la pression de l'opinion convertie pour contraindre le gouvernement à accomplir les réformes devenues nécessaires ou à les laisser s'accomplir.
L'œuvre de la conversion de l'opinion a pour instrument la propagande écrite ou orale. Cette propagande qui s'opère au moyen de l'association, de la presse et de la parole, est fréquemment entravée par des obstacles provenant soit des mesures restrictives ou prohibitives des gouvernements soit de l'intolérance des populations; en revanche, elle est facilitée chaque jour davantage par le rapprochement matériel des individus, qui s'accomplit sous l'influence des progrès de l'industrie. Alors même que les associations et les réunions seraient interdites, que la presse serait soumise à la censure, les idées nouvelles se propageraient par la seule conversation, dans les vastes ateliers où la grande industrie réunit par centaines, parfois même par milliers, des travailleurs de toute provenance. La routine et l'intolérance naturelle des esprits [431] sont des obstacles beaucoup plus difficiles à surmonter qu'aucune prohibition gouvernementale et pénale. Lorsque les conditions d'existence des sociétés viennent à se modifier, il se passe toujours quelque temps avant que l'esprit de la multitude se rende compte de ce changement et de ses conséquences nécessaires. Il s'en tient aux idées et aux croyances dont il a été nourri de génération en génération, il se refuse même à examiner celles qui s'en écartent, et auxquelles il répugne d'autant plus qu'elles s'en écartent davantage. Mais à mesure que le changement devient plus sensible et que chacun en ressent plus vivement les effets, que la nécessité d'une réforme du régime établi se montre plus pressante, les esprits les plus réfractaires s'ouvrent aux nouveautés qu'ils avaient d'abord repoussées, et ils commencent par accepter celles qui s'éloignent le moins de leur fonds séculaire d'idées politiques et économiques. On s'explique ainsi que les doctrines socialistes se soient emparées de l'esprit des masses, imbues, depuis un temps immémorial, de la croyance à l'omnipotence et à l'omniscience de l'état. Ces doctrines, si erronées qu'elles soient et peut-être, à cause de ce qu'elles ont d'erroné, ont préparé la multitude à accepter des vérités qu'elle aurait rejetées si on les lui avait offertes d'emblée parce qu'elles étaient en opposition trop flagrante avec les idées et les croyances qui possédaient le monopole de son esprit, — monopole d'autant plus exclusif et intolérant qu'il avait une possession plus ancienne. C'est pourquoi, malgré les désordres qu'elle cause et les expériences nuisibles qu'elle provoque, la propagande socialiste n'est pas inutile, en ce qu'elle ouvre l'esprit de la multitude à la propagande économique.
On ne peut se dissimuler toutefois qu'étant donné le poids des intérêts attachés à la conservation du régime de l'état de guerre, l'incapacité ou l'inculture intellectuelle de la grande majorité de la multitude gouvernée, l'œuvre de la propagande économique ne soit difficile et lente. Mais, aussitôt que cette œuvre sera accomplie, aussitôt que l'opinion sera convertie, aucun obstacle matériel ne sera assez puissant pour empêcher sa volonté de prévaloir, et les réformes qu'elle exigera alors seront définitives [42]. Si l'opinion ne dispose que d'une force [432] purement morale, cette force est énorme. L'approbation et le blâme qui sont les agents dont elle dispose ont une efficacité souveraine. Le jour où une institution ou une pratique vient à être universellement condamnée par la conscience publique, aucune puissance matérielle n'est capable de la sauvegarder. Lorsque l'opinion sera convaincue, par exemple, que l'emploi des influences politiques pour augmenter les revenus d'une classe aux dépens de la généralité, n'est autre chose qu'une forme de l'escroquerie, elle mettra à l'index les protectionnistes et les politiciens leurs complices, comme elle y a mis les escrocs vulgaires, elle les exclura de la société des honnêtes gens et cette pénalité morale suffira pour courber sous sa loi les intérêts les plus réfractaires.
Il ne faut point s'exagérer d'ailleurs la puissance de cet ensemble d'institutions, pour la plupart surannées, qui constituent l'état moderne, et dont l'existence est purement artificielle. L'état moderne est un colosse, soit! mais c'est un colosse aux pieds d'argile. Il suffit de jeter un simple coup d'œil sur les ressources qui alimentent ses moyens de subsistance et d'action pour s'assurer que ces ressources sont singulièrement précaires et qu'elles lui feront défaut aussitôt que l'opinion sera pleinement édifiée sur le vice de leur origine: elles consistent principalement, comme on sait, dans les impôts indirects, le papier-monnaie et les emprunts en rentes perpétuelles ou amortissables à long terme.
Les impôts indirects sont ceux que les contribuables paient sans en connaître le montant: ils sont perçus sur la plupart des articles de consommation, les uns au profit de l'état [433] lui-même, les autres au profit des individus auxquels il accorde des privilèges qui leur permettent d'élever artificiellement le prix de leurs produits au-dessus du taux auquel le réduirait la concurrence. Depuis un siècle, ils ont été croissant tous les jours. Pour ne parler que de ceux que l'état perçoit à son profit, ils se sont accrus de manière à former, en moyenne dans l'ensemble des pays civilisés, les deux tiers de ses revenus. Si les contribuables qui les paient en connaissaient exactement le montant [43]et s'ils étaient obligés de le porter chez le percepteur sous peine d'être expropriés de leurs effets mobiliers et de leurs biens immobiliers, s'ils se rendaient compte d'autre part de la valeur réelle du plus grand nombre des services que ces impôts servent à alimenter, ils refuseraient certainement d'en supporter la charge. Ils ne consentiraient à payer, selon toute apparence, que l'assurance de leur vie et de leurs biens contre les risques intérieurs et extérieurs d'insécurité, et ils veilleraient, à la fois, à ce que les frais de cette assurance fussent réduits au strict nécessaire, et à ce que leur cote-part, dans ces frais, fut exactement proportionnée à la valeur et à la destination de leurs capitaux personnels, immobiliers et mobiliers, comme lorsqu'il s'agit de toute autre assurance. L'état moderne, privé du secours de cet impôt-mensonge que l'on désigne sous le nom d'impôt indirect, se trouverait bientôt réduit à ses attributions naturelles et nécessaires [44].
En supposant, de même, que l'opinion fut édifiée sur la nature et les effets du papier-monnaie et des emprunts perpétuels, et qu'elle en interdït l'usage comme nuisible et immoral, les guerres désormais inutiles, qui se perpétuent entre [434] les peuples civilisés, deviendraient promptement impossibles, car aucun peuple ne consentirait à en supporter les frais.
Que l'état moderne commette un acte nuisible et immoral en introduisant dans la circulation un papier dont l'émission a pour résultat ordinaire et presque inévitable d'abaisser l'étalon monétaire et de le soumettre à des fluctuations incessantes, qu'il commette ainsi, en l'aggravant, le crime qu'il punit chez les faux monnayeurs, — en l'aggravant, disons-nous, car l'étoffe de la fausse monnaie métallique possède encore quelque valeur, — c'est ce que l'analyse économique a mis en pleine lumière [45]. Or, le jour où l'opinion saura à quoi s'en tenir à cet égard et où elle condamnera le faux monnayage, qu'il soit pratiqué par l'état ou par les particuliers, les ressources que procure aux gouvernements belliqueux l'émission du papier-monnaie leur feront défaut et ils devront se borner à recourir aux emprunts.
Mais l'analyse économique ne démontre pas moins sûrement l'immoralité des emprunts sous forme de rentes perpétuelles ou amortissables à long terme que celle de l'altération de la monnaie. Qu'est-ce, en effet, qu'un emprunt en rentes perpétuelles? C'est un emprunt dont la génération actuelle fait la dépense et qu'elle oblige, au moins pour la plus grande part, les générations futures à acquitter. Or, cette dépense ne peut être justifiée que si l'objet auquel elle s'applique est manifestement utile à tous ceux qui sont appelés à en supporter les frais. Si elle n'est pas de nature à procurer aux générations futures un bénéfice supérieur ou au moins égal à la charge qu'elle leur impose, elle constitue un acte de spoliation à leur détriment, et elles ont le droit de refuser le paiement d'une lettre de change dont elles n'ont pas reçu la contre-valeur. Mais le jour où les dettes contractées pour des entreprises nuisibles courront le risque d'être répudiées par la postérité qu'elles accableront de leurs poids, la source la plus abondante à laquelle s'alimentent les guerres de l'état moderne ne sera-t-elle pas tarie?
On voit, en dernière analyse, que l'extension anormale de l'état moderne et ses pratiques nuisibles tiennent, avant tout, [435] à l'ignorance de ceux qui lui fournissent ses moyens de subsistance et d'action. La réforme de l'état se résout donc en une question d'éducation. éclairer l'opinion du monde civilisé sur les attributions et la conduite utile de l'état, voilà quelle doit être l'œuvre essentielle des réformateurs. L'opinion éclairée, il suffira de la laisser faire [46].
APPENDICE
[437]
L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE AFRICAIN↩
La question de l'abolition de l'esclavage africain est à l'ordre du jour depuis plus d'un siècle. Récemment encore elle a été l'objet des délibérations d'une conférence réunie officiellement à Bruxelles sous les auspices du roi des Belges. Mais, comme nous l'avons remarqué [47] , en cette matière comme en bien d'autres, la bonne volonté ne suffit pas. L'étude suivante, publiée à l'occasion de la conférence de Bruxelles [48]montrera une fois de plus que la philanthropie, lorsqu'elle n'est pas éclairée par la science; s'expose à aggraver les maux qu'elle veut guérir.
La conférence qui s'est réunie à Bruxelles pour étudier les moyens d'extirper l'esclavage du continent noir mérite certainement l'approbation universelle. L'esclavage est condamné par la conscience publique du monde civilisé. Personne ne songe plus à le défendre. Mais il en est des maux économiques et moraux comme des maux physiques; il ne suffit pas d'avoir la bonne [438] volonté de les guérir, il faut encore leur opposer des remèdes qui guérissent, sinon on s'expose à aggraver les souffrances du malade au lieu de les soulager. Malheureusement, les mesures que la conférence a recommandées pour combattre l'esclavage et qui se résument dans la prohibition de la traite des nègres appartiennent à cette dernière catégorie de remèdes. Ce n'est pas qu'on puisse lui reprocher d'avoir trop restreint son programme. Comme l'a fort bien remarqué Mgr le cardinal Lavigerie dans la lettre qu'il a adressé à S. M. le roi Léopold II, il ne peut être question d'entreprendre d'abolir d'un seul coup l'esclavage africain:
En se proposant l'abolition totale de l'esclavage indigène et en la proposant à tous ses adhérents, lisons-nous dans cette lettre de l'illustre cardinal, l'œuvre anti-esclavagiste ne fait autre chose que de se conformer au droit naturel et aux préceptes de la loi religieuse, qui proclame l'esclavage contraire au droit de la nature et au droit divin: Contra quod est a Deo et a natura institutum, a dit le grand Léon XIII. Or, ce droit ne souffre ni exception, ni dispense, la prohibition est absolue pour tout homme qui respecte la raison, la justice et la foi.
Mais, en proclamant ce principe et en poursuivant son application, l'œuvre anti-esclavagiste ne veut pas demander une chose impossible ou nuisible. Or, vouloir abolir l'esclavage africain d'un seul coup par la force, car on ne peut le faire que par ce seul moyen, c'est vouloir une œuvre irréalisable; toutes les armées, tous les trésors de l'Europe ne suffiraient pas à l'obtenir. De plus, l'état social actuel de l'Afrique indigène étant fondé sur l'esclavage depuis des siècles, out se trouverait jeté dans le chaos si on abolissait ainsi, en un jour, une organisation lamentable sans doute, mais cependant préférable au chaos.
Quoique, à notre avis, Mgr Lavigerie se trompe absolument, en affirmant que « l'esclavage ne peut être aboli que par la force », nous croyons, comme lui, que ce serait une entreprise chimérique d'essayer de l'extirper dès à présent du continent noir. On ne peut donc blâmer la conférence d'avoir limité son programme et de s'être bornée à l'étude des moyens d'empêcher la chasse, la vente et l'exportation des esclaves. Seulement, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de n'avoir tenu aucun compte des résultats pourtant décisifs de l'expérience en cette matière et de vouloir recourir encore une fois, pour la répression de la traite orientale, au procédé aussi inefficace que barbare de la prohibition qui a aggrave pendant un demi-siècle les maux de la traite occidentale.
[439]
I
Ce sont les états-Unis qui ont prohibé, les premiers, l'importation des nègres. L'état de Virginie prit l'initiative de cette prohibition en 1776 et son exemple fut suivi dans les années suivantes par la plupart des autres états de l'Union; mais il faut le dire, cette mesure avait un caractère protectionniste plutôt que philanthropique. La Virginie et les états voisins, le Maryland, le Kentucky, le Tennessee, s'adonnaient à l'élève des esclaves, considérés comme un simple bétail. De ces états éleveurs, ils étaient importés dans les états consommateurs, la Caroline du Sud, l'Alabama, la Georgie, où on les employait aux grandes cultures du coton et du sucre. De même que nos éleveurs de bétail ont entrepris une croisade contre l'importation des bœufs et des moutons d'Amérique, les éleveurs de nègres de l'Union se liguèrent pour empêcher l'introduction des nègres d'Afrique. La Caroline du Sud, le principal état importateur, résista jusqu'en 1808 ce mouvement protectionniste, mais à dater des cette année, à la prohibition devint générale et l'importation de nègres cessa presque entièrement aux états-Unis. L'élève intérieure y suppléa, et nous voyons dans les documents publiés par la Société anglaise et étrangère pour l'abolition de l'esclavage, qu'à la veille de la guerre de la sécession, le nombre des nègres produits dans les breeding states (états éleveurs) et vendus dans les autres s'élevait annuellement à 80,000 environ. La traite africaine était supprimée, mais pour être remplacée par la traite américaine.
Les abolitionnistes du temps ne s'aperçurent point, à ce qu'il semble, de ce que ce résultat avait d'insuffisant, pour ne pas dire de négatif, et ils crurent, de bonne foi sans doute, que l'interdiction de la traite aurait pour effet d'obliger les planteurs des Antilles et du Brésil, à remplacer les esclaves par des travailleurs libres. Les Wilberforce, les Clarkson et leurs émules, plus bien-veillants qu'éclairés, concentrèrent leurs efforts de ce côté, et ils décidèrent en 1807 le parlement anglais à abolir la traite. Un peu plus tard, en 1815, l'Angleterre provoquait une déclaration des puissances représentées au Congrès de Vienne contre la traite; en 1818, elle posait de nouveau, cette question au [440] Congrès d'Aix-la-Chapelle, et en 1822, au Congrès de Vérone. Enfin, elle envoyait une escadre sur la côte d'Afrique pour y faire la chasse aux négriers et elle concluait avec la plupart des puissances de l'Europe des traités ou des conventions destinés à faciliter la surveillance des croiseurs. C'est ainsi que, le 30 no-novembre 1831, elle signait avec la France une convention stipulant que les croiseurs des deux nations pourraient exercer le droit de visite sur les navires suspects de traite, soit qu'ils se couvrissent du pavillon anglais ou du pavillon français; c'est ainsi encore qu'un traité destiné à renforcer et à étendre la convention de 1831 fut signé le 30 décembre 1841 entre la France, l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie. Ce traité, ratifié par les quatre dernières puissances le 19 février 1842, ne le fut point par la France et peu s'en fallut qu'il ne devînt l'occasion d'une guerre entre les deux pays. Les croisières n'en subsistèrent pas moins pendant près d'un demi-siècle: c'est par centaines de millions que se comptent les frais de cette douane prohibitionniste, sans parler des milliers de marins emportés par les maladies dans les régions insalubres où elle était établie. Cependant, on n'aurait point à regretter ces sacrifices faits dans un intérêt d'humanité s'ils avaient eu pour résultat d'entraver efficacement un commerce odieux; mais on va voir que, tout en demeurant impuissantes à empêcher la traite, les mesures prises pour la prohiber ont cruellement aggravé les souffrances de ses victimes.
Avant la prohibition, les nègres transportés étaient généralement bien traités pendant le voyage, car les négriers avaient intérêt à ce que leur marchandise arrivât en bon état à sa destination. Mais à peine les lois répressives de la traite furent-elles mises en vigueur, que toutes les précautions prises dans ce but disparurent. Les négriers n'eurent plus alors qu'une préoccupation: celle d'échapper aux croiseurs. Ils réduisirent au minimum la place réservée à leurs cargaisons et n'embarquèrent plus que les quantités d'eau et de vivres rigoureusement nécessaires. Un Américain qui avait vu la traite de prés, le docteur Cliffe, a fait un tableau navrant de l'état de ces cargaisons de chair humaine, sous le régime de la prohibition:
Les esclaves, dit-il, sont entassés pêle-mêle et couchés sur le flanc, dans un [441] mélange confus de bras. de têtes. de jambes. grouillant les uns dans les autres, de sorte qu'il est difficile à l'un d'eux de remuer sans que la masse entière remue en même temps. Sur le même bâtiment, on forme parfois deux ou trois ponts, encombrés d'esclaves et dont la hauteur ne dépasse pas un pied et demi ou même un pied. Ils ont ainsi la place nécessaire pour se tenir couchés, aplatis comme l'insecte visqueux, mais un enfant lui-même ne pourrait s'asseoir dans ces longs cercueils à compartiments. On peut dire qu'ils sont arrimés comme des boucauts ou comme des livres sur les rayons d'une bibliothèque. Ils sont nourris par un homme qui leur descend une calebasse d'eau et une parcelle d'aliment. Un petit nombre d'entre eux, ceux qui semblent plus accablés, sont hissés sur le pont au grand air. Avant le redoublement de sévérité de nos lois, on leur distribuait leur nourriture sur le pont, par escouades successives, mais aujourd'hui ce faible adoucissement ne leur est même plus donné. Jadis les négriers amenaient avec eux un chirurgien; aujourd'hui il n'est plus de praticien de quelque valeur qui voulût les suivre. Les bâtiments perdent quelquefois plus de la moitié de leur cargaison et l'on cite même l'exemple d'un chargement de 160 nègres sur lesquels 16 seulement survécurent au voyage. Rien ne saurait donner une idée des souffrances auxquelles ces malheureux sont soumis, principalement a cause du manque d'eau; comme la présence à bord d'une grande quantité d'eau et de tonneaux expose les négriers à la confiscation, ils sont arrivés, après des calculs d'une odieuse précision, à reconnaitre qu'en distribuant une fois tous les trois jours à un individu l'eau contenue dans une tasse de thé, cela suffirait pour lui conserver la vie. Ils limitent en conséquence leurs approvisionnements d'eau fraiche à ce qu'il faut pour empêcher les esclaves de mourir de soif.
Rien ne saurait non plus donner une idée exacte de la saleté horrible d'un navire chargé de nègres. Amoncelés et en quelque sorte encaqués comme ils le sont, il devient à peu prés impossible de nettoyer les navires. Il est certain que si un blanc était plongé dans l'atmosphère où vivent ces malheureux, il serait immédiatement asphyxié... Au moment du débarquement, leurs rotules présentent l'aspect d'un crâne dénudé. Le bras se trouve dégarni de toute la partie musculaire, c'est un os recouvert de peau. Le ventre est protubérant et comme gonflé d'une manière maladive. Il faut qu'un homme prenne ces misérables dans ses bras pour les porter hors du bâtiment, car ils ne sont pas capables de marcher. Comme ils ne se sont pas tenus debout pendant un ou deux mois, leurs muscles sont affaiblis au point de ne pouvoir plus les soutenir. Ils ont l'air hébété, hagard, et l'on peut dire qu'ils sont descendus jusqu'au dernier degré d'abaissement au-dessous duquel il n'y a plus que la brute. Un grand nombre sont tout meurtris, couverts de larges ulcères, de maladies cutanées profondément repoussantes, et la chique se creuse, à travers l'épiderme et jusque dans les chairs, ses horribles refuges [49].
Deux chiffres suffiront au surplus pour mesurer l'accroissement des souffrances que la prohibition a infligées aux victimes de la traite: avant qu'elle n'eût été établie, le déchet des cargaisons [442] était évalué à 14 p. 100; après, il s'est élevé à 25 p. 100. Ce que représentent de privations et de tortures les 11 p. 100 d'augmentation de ce déchet de chair humaine, on peut aisément se le figurer. Au moins, la prohibition a-t-elle eu pour effet de diminuer sensiblement la traite? Ici encore, il faut laisser parler les chiffres.
En consultant les tableaux empruntés aux Blue books et reproduits dans les rapports de la British and foreign anti-slavery society, on trouve que depuis 1807, époque de l'abolition de la traite en Angleterre, jusqu'a 1819, époque de l'établissement des croisières, 2,290,000 nègres ont été enlevés à la côte d'Afrique. Sur ce nombre, 650,000 ont été expédiés au Brésil, 615,000 dans les colonies espagnoles et 562,000 dans les autres pays. Le dechet pendant la traversée a été de 433,000. De 1819 jusqu'en 1847, le nombre des nègres exportés a été de 2,758,505, ainsi répartis: Brésil, 1,121,800; colonies espagnoles, 831,027; déchet, 688,299; capturés, 117,380. Totaux, pendant les quarante années: esclaves importés au Brésil: 1,801,808, dans les colonies espagnoles, 1,446,6027; dans les autres contrées 562,000; déchet pendant la traversée, 1,121,299; capturés depuis 1,819, 117,380. Ce qui donne, en totalité, 504,8506 victimes de la traite depuis la prohibition [50]
Cette impuissance manifeste des mesures prohibitives de la traite, les abolitionnistes les plus ardents étaient obligés de la reconnaître, et la British and foreign anti-slavery society elle-même convenait, dans un de ses Rapports annuels, que l'étendue et l'activité du commerce des esclaves, bien qu'affectées dans une certaine mesure par la prohibition de la traite, n'avaient pas cessé d'être gouvernées par la demande des produits du travail esclave sur les marchés d'Europe.
Telle est cependant la désastreuse expérience que les puissances représentées à la Conférence de Bruxelles se proposent de recommencer.
II
Voyons si cette expérience a aujourd'hui de meilleures chances de réussite sur la côte orientale de l'Afrique, d'où sont enlevés les principaux contingents d'esclaves pour être portés sur les marchés de l'Egypte, de l'Arabie et de la Turquie, qu'elle n'en a [443] eu sur la côte occidentale, à l'époque où la traite alimentait les marchés américains.
Sans avoir l'importance de la traite américaine, celle qui alimente aujourd'hui les marchés orientaux atteint cependant un chiffre considérable. D'après l'auteur d'un excellent ouvrage sur la Traite orientale, M. Berlioux, ce chiffre s'élevait, il y a une vingtaine d'années, à 70,000 individus, et Mgr le cardinal Lavigerie le porte actuellement de 80 à 100,000. Mais ce chiffre ne comprend que les esclaves arrivés à destination. Au témoignage de Livinsgtone et des autres voyageurs, la chasse et le transport des esclaves des régions de l'intérieur jusqu'à la côte occasionneraient un déchet quintuple et même décuple [51]. Cette déperdition effroyable de vies humaines s'explique par les conditions dans lesquelles se fait ce trafic. Quoique, sur certains points, notamment dans la vallée du Nil, les trafiquants d'esclaves soient commandités par des maisons européennes [52]ils sont généralement mal pourvus de capitaux et n'ont pas les moyens de prendre les précautions nécessaires pour la conservation de leur marchandise pendant les longs trajets à travers d'immenses contrées où leurs convois ne trouvent point à se ravitailler. D'ailleurs, les esclaves que l'on n'enlève pas de force sont achetés à vil prix, en sorte que les pertes causées par le déchet ne réduisent que faiblement les bénéfices de l'opération. M. Berlioux nous fournit à cet égard des renseignements intéressants. Sur le marché de [444] Kouka (Bournou), dit-il, un jeune garçon coûte de 15 à 30 thalers (le thaler vaut fr. 3.75). Une jeune fille se vend de 30 à 60 thalers; les jeunes fellatahs, dont la couleur est plus claire et les traits sont réguliers, coûtent plus cher. Un vieillard ou une mère se donnent pour un prix de 3 à 10 thalers. C'est aussi le prix d'un enfant. Dans le Nyassa, la marchandise est encore à bien meilleur marché. D'après Livingstone, on pouvait y acheter un jeune esclave pour deux ou trois brasses de calicot, la valeur d'un ou deux francs. A Zanzibar, ce petit esclave qu'on avait acheté pour un franc ou deux se vendait de 5 à 10 thalers, et un homme robuste de 10 à 30 thalers. En perdant cinq ou même dix esclaves pendant le trajet pour en amener un aux ports d'embarquement, les marchands réalisaient donc encore des profits amplement rémunérateurs.
Sur les marchés d'importation de l'Arabie et des autres pays orientaux les prix s'élèvent naturellement beaucoup plus haut:
Les esclaves du Nelged, dit M Berlioux, s'y vendent à un prix bien supérieur a celui du marché de Zanzibar; ils coûtent à Riad 10 livres sterling par tête ou 258 fr. M. Palgrave ne nous donne que ce chiffre qui doit êtrele prix d'un homme fait et il ajoute que dans le Schomer l'esclave se vend un tiers en sus, 15 ou 18 livres... Les bénéfices ont été considérables pour le commerce et les prix ont monté rapidement dans les échanges. Le noir du Zambèze a été acheté pour un ou deux francs de calicot, aux environs de Nyassa; il s'est vendu 20 thalers ou 80 francs sur le marché de Zanzibar, et il finit par atteindre dans l'Arabie 230 ou 400 francs. Les bénéfices de ce commerce nous expliquent donc l'ardeur des négriers en même temps qu'ils nous montrent combien est pressante pour l'Arabie la nécessité de s'approvisionner de la population étrangère [53].
D'après les renseignements recueillis par Mgr le cardinal Lavigerie l'augmentation de la demande sur les marchés de l'Arabie y aurait fait encore hausser considérablement les prix depuis quelques années. A Djeddah, les esclaves se vendaient, suivant la qualité, de 60 à 300 dollars par tête en 1887 [54]
[445]
Quelles sont les causes de cette augmentation de la demande? M. Berlioux et âprès lui Mgr Lavigerie l'attribuent non sans quelque raison, au moins pour la Turquie, à la suppression de l'esclavage des blancs, qui ont cessé d'être capturés dans le bassin de la Méditerranée par les corsaires barbaresques, ou importés de la Circassie. En Arabie, où la population ne dépasse pas 8,000,000 d'habitants dans une région fertile de 700,000 kil. carrés, c'est-à-dire plus étendue que la France, la demande s'est accrue sous l'influence du développement de la production agricole, causé par l'ouverture du canal de Suez. Cette nécessité d'une importation de bras étrangers dans les pays musulmans est-elle, comme le supposent M. Berlioux et l'illustre cardinal, imputable à la religion mahométane? Nous croyons pour notre part, que la religion et les institutions du Coran y sont pour fort peu de chose. Ce qui l'attesterait, au besoin, c'est que, dans plusieurs pays chrétiens et particulièrement en France, la population [446] ne suffit pas aux besoins de la production. L'immigration libre des Belges, Allemands, Suisses, Italiens, etc., en France atteint annuellement, si elle ne le dépasse point, le chiffre de l'immigration forcée des nègres en Arabie et dans les autres parties de la Turquie. Ajoutons que dans les pays musulmans, comme en France, l'immigration sert principalement à combler les vides des emplois inférieurs de la domesticité, fort nombreux en Orient, de l'agriculture et de l'industrie. D'après tous les témoignages, les esclaves sont généralement bien traités, et quelques-uns même arrivent à des positions supérieures.
Le maitre a-t-il des propriétés, dit M. Berlioux, il en voie des serviteurs les cultiver pour lui; s'il n'en a pas, il loue des esclaves à différents titres, comme journaliers, comme employés, comme ouvriers. Il paraît que l'esclave est dans la famille presque comme un membre de cette famille, avec le droit d'exiger sa vente s'il est par trop maltraité. Celui qui travaille dans les champs a deux jours à sa disposition pour se procurer quelques bénéfices par son travail particulier. Celui qui est loué gagne au minimum huit pesos; sur cette somme, il en donne cinq à son maitre et en garde trois pour ses besoins personnels. De cette sorte il peut s'économiser un petit trésor et, sans sortir de sa condition, avoir des esclaves qui lui appartiennent en propre. La liberté leur vient quelquefois comme un héritage réglé par un testament de leur vieux maître. On ne peut en disconvenir, même sans accepter toutes ces descriptions optimistes, il y a une grande différence entre cet esclavage et celui que nous connaissions par l'Amérique, et sous le rapport matériel l'esclave du musulman a l'avantage sur l'esclave du chrétien.
... Chez les Wahabites, l'importance de la population negre, de même que son rôle et son influence, est réellement très considérable. Le témoignage de M. Palgrave qui le constate est d'autant plus précieux que ce voyageur, frappé surtout de la différence de position qui sépare l'esclave arabe de l'esclave américain, ignorant ou oubliant les circonstances dans lesquelles la chasse à l'homme est organisée en Afrique, trop peu attentif aux conséquences morales d'une pareille institution, montre parfois une indulgence singulière pour elle. Ces esclaves si bien traités, ont été, dit-il, soustraits « à une existence bonne pour les sangliers et les tigres des jungles ».
... Les noirs du Nedjed (Arabie) ne sont pas seulement remarquables par leur nombre, ils le sont aussi par le rôle très important qu'ils jouent. Esclaves ou affranchis, ils tiennent une grande place, ils ont une influence très marquée sur le gouvernement et une influence non moins grande sur les mœurs. Les affranchis que leur maître a dotés de la liberté par une décision gracieuse ou par son testament, forment une classe ayant absolument les mêmes droits que les Arabes, admise sur le pied d'égalité par la bourgeoisie et reçue dans les familles les plus nobles après quelques générations. Cette classe de citoyens s'appelle les verts. Le grand trésorier de Jeyzul, le roi des Wahabites, c'est-à-dire le ministre des finances, est un ancien esclave. Les gouverneurs des deux plus grandes [447] places de la région maritime, Houfouf et el-Katif, sont des nègres; et il faut remarquer que ces deux villes se trouvent dans le pays de El-Ahsa, qui est nouvellement conquis et qui déteste les Wahabites; en sorte que les postes les plus délicats, ceux qui demandent le plus de confiance de la part du gouvernement, dans une population ombrageuse et jalouse de son influence, comme les Wahabites. sont justement conflés a des noirs. Ces derniers n'ont même pas besoin de cesser d'être esclaves pour avoir de l'influence; dans le palais, sans compter les nègres de la garde du corps, les hôtes les plus nombreux que le prince admette sous sont toit, sont les serviteurs noirs qui y sont installés avec leurs familles [55]
Cette douceur de l'esclavage asiatique, en comparaison de l'esclave clave américain, ne suffit certainement pas pour en justifier le maintien. Il est clair que l'esclavage doit être aboli. Les dissidences ne peuvent porter que sur les moyens de l'abolir. Or, nous venons de voir qu'en Amérique la prohibition de la traite n'a aucunement contribué à ce résultat, qu'elle a aggravé les souffrances des esclaves sans cesser d'alimenter l'esclavage, au moins dans les pays où il n'était point recruté, comme aux états-Unis, par l'élève intérieure. Peut-on espérer qu'il en sera autrement pour la prohibition de la traite orientale? Sans doute, la marge des bénéfices qu'elle offre aux négriers n'égale pas celle que présentait la traite américaine, mais cette marge est plus que suffisante pour déterminer les marchands d'esclaves à affronter les risques des croisières. Une marchandise qui s'achète aux lieux de provenance pour quelques brasses de calicot et qui se vend, aux lieux d'importation, de 60 à 300 dollars, offrira, quoi qu'on fasse, un appât suffisant à la contrebande, et cet appât augmentera même à mesure que l'application des mesures prohibitives élévera davantage le prix de la marchandise. Il y aura plus de déchet pendant le transport, on sera peut-être obligé de jeter des cargaisons à la mer pour se dérober aux poursuites des croiseurs, mais ces pertes ne seront-elles pas compensées et audelà par l'accroissement des bénéfices?
On peut donc affirmer que la prohibition de la traite n'aura pas la vertu de détruire l'esclavage oriental. Elle élèvera le chiffre du déchet des cargaisons d'esclaves importés en contrebande, voilà tout! Si l'esclavage a disparu du continent américain, ce n'est point parce qu'on a prohibé la traite, c'est parce que les nègres [448] ont été affranchis, par la guerre aux états-Unis, moyennant rachat dans les colonies anglaises et françaises. Les puissances représentées à la conférence de Bruxelles sont-elles disposées à indemniser les propriétaires orientaux ou à conquérir l'Arabie avec la Turquie?
III
Il y a heureusement un procédé moins coûteux que le rachat et plus efficace que la prohibition ou la guerre pour mettre fin à l'esclavage, c'est le procédé de la concurrence. De quoi s'agit-il? A quel besoin répond cette importation annuelle de 80 à 100,000 esclaves d'Afrique en Asie? A un besoin de travail. Ce besoin auquel il est satisfait en Europe et actuellement en Amérique au moyen de l'immigration libre, c'est, jusqu'à présent, l'immigration forcée des négres esclaves qui y a pourvu en Arabie et en Turquie, mais le marché de travail n'y pourrait-il pas être approvisionné autrement? Au témoignage de M. Palgrave cité par M. Berlioux, il l'est déjà en partie. « Il y a deux sortes d'immigrations nègres en Arabie: l'immigration forcée, que la traite organise, et l'immigration volontaire. Celle-ci se compose aujourd'hui principalement d'Africains musulmans venus du pays des Somalis et des contrées voisines de la mer Rouge; quelques-uns restent à la suite du pèlerinage de la Mecque; d'autres arrivent directement pour chercher du travail et des ressources [56]. » Toutefois cette immigration libre est très insuffisante. Ce n'est pas que les nègres répugnent à émigrer; on les voit même s'engager en grand nombre dans les établissements européens, quoi-que le régime actuel des engagements ne diffère que nominalement de l'esclavage et soit parfois plus dur; mais la connaissance des marchés où leur travail est demandé et les ressources nécessaires pour s'y transporter leur font défaut. D'un autre côté, si les propriétaires arabes et turcs achètent des esclaves, ce n'est pas qu'ils aient un goût particulier pour l'esclavage, c'est parce qu'ils ne peuvent se procurer en nombre suffisant et à un prix modéré des domestiques et des ouvriers libres; c'est, en d'autres termes, [449] parce que les services de l'esclave lui reviennent moins cher. A un prix égal et même, dans une certaine mesure, supérieur, ils trouveraient avantage à employer des ouvriers ou des domestiques loués plutôt qu'achetés. En effet, dans des contrées telles que l'Arabie où les capitaux sont rares, le prix d'achat d'un esclave représente un gros intérêt, sans parler de l'amortissement; en outre, l'esclave est exposé à des accidents et à des maladies qui le rendent temporairement impropre au travail, il peut être paresseux, vicieux et ne rendre que de mauvais services. Il n'est pas facile alors de s'en débarrasser sans perte; enfin, la religion et les mœurs obligent les maîtres à nourrir et à bien traiter leurs vieux serviteurs. Ces charges et ces soins qu'implique l'esclavage renchérissent naturellement le travail acheté et le rendent, à bien des égards, moins avantageux que le travail loué.
Cela étant, le problème de la suppression de la traite et même de l'abolition de l'esclavage ne peut-il pas comporter une autre solution que celle de « la force »? Au lieu de recourir de nouveau au procédé coûteux et meurtrier de la prohibition, qui n'a eu d'autres résultats que d'aggraver les souffrances des esclaves et d'augmenter les bénéfices des négriers, ne pourrait-on pas essayer du procédé de la concurrence? Supposons qu'au lieu d'imposer aux contribuables des états représentés à la Conférence de Bruxelles, la dépense « forcée » (car rien n'est laissé à la liberté dans cette entreprise de libération) du nombre illimité de millions que coûtera l'entretien des croisières et peut-être des armées destinées à chasser les chasseurs de nègres [57] , les adversaires de l'esclavage et les amis des nègres s'entendent pour fonder une compagnie d'approvisionnement et de transport du travail libre de la côte d'Afrique dans les régions du monde oriental où les bras ne suffisent pas à la demande, et que cette compagnie, pourvue des ressources nécessaires et dirigée par [450] des notabilités anti-esclavagistes, établisse en Afrique des agences de recrutement, en Arabie et en Turquie des bureaux de placement et de location de travail, ne portera-t-elle pas au commerce des négriers la plus sûre, la plus mortelle des atteintes en lui enlevant sa clientèle? Du moment où les propriétaires arabes ou turcs pourront se procurer, en quantité suffisante et à un prix modéré, du travail loué, ne renonceront-ils pas d'eux-mêmes, sans y être forcés, à acheter des esclaves? Or, à mesure que le « débouché » qui alimente le commerce des négriers, viendra à se rétrécir, les bénéfices de ce commerce diminueront, tandis que la prohibition aurait, au contraire, pour effet de les accroître. Un moment arrivera où ils ne suffiront plus à couvrir les frais d'acquisition, de transport et de vente des esclaves et où la traite disparaîtra tout simplement parce qu'elle cessera de donner des bénéfices. La concurrence l'aura tuée, et cette fois, sans rémission, car elle l'aura remplacée. Est-il nécessaire d'ajouter que ce procédé de suppression de la traite et de l'esclavage joindrait à l'avantage d'être plus sûr que la prohibition, celui de coûter moins cher et qu'il pourrait même couvrir ses frais et au delà? Le transport et le placement des travailleurs libres, noirs ou blancs, est une industrie comme une autre et, n'en déplaise aux socialistes, cette industrie honnêtement pratiquée peut être une source de bénéfices légitimes. En soustrayant des hommes à « une existence bonne pour les sangliers et les tigres des jungles », suivant les expressions de M. Palgrave, pour les transporter dans un pays où leur condition se trouve sensiblement améliorée, on leur rend un service, et ce service, il n'y a aucune raison pour le leur rendre gratis. On en obtiendrait d'ailleurs aisément la rétribution en employant un système de retenues sur les salaires analogue à celui que pratiquent depuis longtemps les compagnies chinoises d'émigration, pour le remboursement des frais de transport de leurs clients. En tous cas, nous croyons que le côté économique du problème de la suppression de la traite, a été jusqu'à présent trop négligé par les abolitionnistes. On se convaincrait, en l'étudiant de près, qu'en cette matière comme en bien d'autres, la force ne résout rien et que la concurrence est un instrument de progrès et un agent de libération préférable à la prohibition.
[451]
IV
Comment l'esclavage africain pourrait être aboli par le procédé de la concurrence, c'est ce qu'il nous reste à examiner.
La question de l'esclavage africain doit être considérée sous ses deux aspects: la suppression de la traite et l'abolition de l'esclavage à l'intérieur.
I. La Suppression De La Traite. — Nous avons essayé de démontrer que la prohibition de la traite aurait pour résultat certain d'augmenter le déchet et les souffrances des victimes de ce commerce de chair humaine, sans y mettre un terme. Le seul moyen de le supprimer, c'est de le ruiner par la concurrence de l'exportation du travail libre.
Il s'agit donc de savoir comment cette exportation pourrait être entreprise et organisée.
Elle pourrait l'être par l'établissement d'une compagnie pourvue d'un capital suffisant, soit cinq millions, qui se chargerait de pourvoir les marchés d'importation de l'Arabie et de la Turquie, du travail libre destiné à remplacer le travail esclave qui leur est actuellement fourni par les nègriers. Cette compagnie établirait, d'une part, des agences et des bureaux de recrutement dans les parties du continent africain où le recrutement libre pourrait s'opérer avec le plus de succès, d'une autre part, des bureaux de placement, aux lieux d'importation. Elle pourrait employer dans ces deux sortes d'agences, sous la direction d'employés supérieurs européens, les Arabes et les indigènes qui sont au service des trafiquants actuels, en les attirant par l'appât de salaires plus élevés, et désorganiser ainsi la traite en la privant d'une partie de son personnel. Les agences de recrutement se procureraient des émigrants, soit en déterminant les indigènes libres à entrer au service de la compagnie, en leur offrant la perspective d'une amélioration assurée de leur sort, soit en rachetant des esclaves. Ces émigrants seraient transportés avec tous les soins nécessaires à la côte, et, par des navires convenablement aménagés, aux lieux d'importation. Là ils pourraient rester au service de la compagnie, ou disposer librement d'eux-mêmes, mais à charge par eux de rembourser successivement leurs frais [452] de transport avec adjonction du bénéfice ordinaire, au moyen de retenues sur leurs salaires. Sans doute, un certain nombre d'entre eux chercheraient à se dérober à leurs obligations, mais sur un marché où le travail est plus demandé qu'offert, où le placement des ouvriers et des serviteurs est facile, où les salaires sont relativement élevés, on pourrait organiser un service de recouvrement qui surveillerait les débiteurs jusqu'à ce qu'ils eussent acquitté le montant, d'ailleurs peu élevé, de leur dette, les frais de transport de l'intérieur à la côte et de la traversée de la mer Rouge, en y comprenant les frais des agences, etc., etc., ne pouvant être évalués à plus d'une centaine de francs.
Mais la Compagnie devrait se proposer pour but de conserver à son service le plus grand nombre sinon la totalité des émigrants, et ce but elle pourrait l'atteindre en leur procurant des avantages et une sécurité supérieurs à ceux qu'ils obtiendraient en exploitant eux-mêmes leur travail.
Comment procéderait-elle? Elle se chargerait de la nourriture et de l'entretien des émigrants qui resteraient à son service jusqu'à ce qu'elle eût réussi à les placer. Ce placement, elle l'organiserait au moyen d'agents ou de voyageurs chargés de s'enquérir des demandes de travail dans la région d'importation et de stipuler les conditions des contrats de location. Que les acheteurs actuels d'esclaves, dans ces régions où les capitaux sont rares, trouvent plus d'avantage à louer du travail, moyennant un prix de location payable par trimestre, par exemple, ou même par année, plutôt qu'à l'acheter, en déboursant une somme relativement considérable, et en subissant les charges et les risques qu'implique la possession des esclaves, cela n'a pas besoin d'être démontré. La Compagnie ne tarderait pas, selon toute apparence, à enlever leur clientèle aux marchands d'esclaves et, si l'on songe aux bénéfices considérables que réalisent ceux-ci, elle louerait le travail dont elle disposerait, à des conditions amplement rémunératrices. Ces conditions varieraient selon les convenances de la clientèle: tantôt, et le plus souvent suivant les habitudes prises, la nourriture et l'entretien du travailleur seraient fournis par l'employeur, tantôt ils seraient à la charge de la Compagnie et le prix de la location serait entièrement fourni en argent. Le produit des locations croîtrait naturellement avec le nombre des émigrants demeurés au service de la compagnie. [453] Si l'on se rappelle que la traite fait passer annuellement environ 80,000 esclaves du continent noir en Arabie et en Turquie, on peut évaluer sans exagération à 100,000 le nombre des travailleurs libres que la Compagnie aurait à son service au bout de deux ou trois ans. En supposant qu'elle louât leur travail au prix modique de 100 francs par an, en sus de la nourriture et de l'entretien, ce serait une recette annuelle de 10 millions. En déduisant de cette recette, la solde en argent que la Compagnie distribuerait à ses travailleurs, et qui ne devrait pas dépasser un 5e ou même un 10e du montant du salaire en vue d'éviter un gas-pillage nuisible (en supposant qu'ils soient nourris et entretenus par les employeurs), resterait une somme annuelle de 9 millions et au minimum de 8. Cette somme servirait à couvrir:
1° Les frais d'administration et de gestion de la Compagnie et de ses agences.
2° Les frais de recrutement, de transport et d'entretien des émigrants au service de la Compagnie, jusqu'à ce qu'ils fussent placés.
3° Leurs frais d'entretien pendant les périodes de chômage; les frais d'entretien des malades et des victimes d'accidents.
4° Les versements à une caisse de retraite, destinée à pourvoir à l'entretien des serviteurs de la Compagnie, à l'époque où ils deviendraient impropres au travail, avec cette stipulation que les travailleurs qui se retireraient du service de la Compagnie auraient, en tous temps, le droit de retirer les fonds versés en leur nom à cette caisse.
Le surplus constituerait le bénéfice de la Compagnie. Ce bénéfice pourrait être limité à 10 0/0. Au-dessus de ce chiffre, le bénéfice serait partagé entre les actionnaires de la Compagnie, ses fonctionnaires et sa clientèle d'ouvriers, soit, pour ceux-ci, sous forme d'un supplément de salaire ou d'une augmentation du chiffre de leur pension de retraite.
En admettant que les puissances représentées à la conférence de Bruxelles, convaincues à la fois de l'efficacité de ce procédé d'abolition de la traite, et de l'économie qu'elle leur procurerait, en leur épargnant les frais d'établissement des croisières, etc., consentissent à accorder aux actionnaires de la Compagnie, la garantie d'un minimum d'intérêt de 5 0/0 soit une somme annuelle de fr. 250,000, les sommes perçues en raison de cette [454] garantie pourraient leur être remboursées, lorsque les bénéfices viendraient à dépasser 8 0/0. Dans ce cas, et jusqu'à 10 0/0, le surplus serait affecté pour une moitié au remboursement, et distribué, pour l'autre moitié, aux actionnaires.
II. L'abolition De L'Esclavage A L'intéRieur Du Continent Africain. — Cependant il ne suffirait pas de supprimer la traite par la concurrence de l'émigration libre pour extirper l'esclavage du continent noir. Dans sa lettre à S. M. le roi des Belges, Mgr le cardinal Lavigerie convient que ce serait une chose impossible ou nuisible d'essayer de l'abolir par la force [58]. Mais cette œuvre de justice et d'humanité que la force serait impuissante à accomplir, on peut l'entreprendre par une autre application du principe bienfaisant de la concurrence: en opposant aux industries rudimentaires des tribus africaines, l'organisation, l'outillage et les procédés perfectionnés de l'agriculture et de l'industrie des peuples les plus avancés en civilisation. Cette question se lie à celle de l'exploitation et de la mise en valeur des vastes régions du continent noir sur lesquelles les nations européennes s'efforcent depuis quelques années, d'étendre leur domination.
Dans quel but l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, et les fondateurs de l'état libre du Congo font-ils les dépenses considérables qu'exigent et qu'exigeront de plus en plus la découverte, l'occupation et le gouvernement de ces immenses territoires? Ce n'est pas simplement, nous nous plaisons à le croire, pour y créer un débouché à l'excédent de leurs fonctionnaires civils et militaires, c'est encore pour y trouver de nouveaux marchés où ils puissent échanger les produits de leur industrie contre les matières premières de toute sorte que le sol et le sous-sol africain recèlent en abondance. Mais ces matériaux d'échange, il faut des capitaux et des bras pour les produire. Dans l'état actuel des choses, les articles que l'industrie indigène de l'Afrique peut fournir en échange des produits européens sont peu nombreux et peu susceptibles d'accroissement; le principal, l'ivoire, ne tardera même [455] pas à s'épuiser par le fait de la destruction des éléphants. Il faut donc créer en Afrique des exploitations rurales, forestières et minières, à l'européenne. Ces exploitations, on ne peut les demander à l'émigration et à la colonisation individuelle des capitaux et des bras, telles qu'elles se pratiquent d'Europe dans les deux Amériques et dans l'Afrique australe.
Les colons européens ne s'acclimatent que difficilement dans les régions tropicales, et ils ne résistent pas aux durs travaux de la culture du sol. Des entreprises de colonisation individuelles n'auraient aucune chance de succès, et l'on essayerait d'ailleurs vainement de détourner vers l'Afrique, le courant d'émigration qui se dirige vers l'Amérique. Seules des sociétés abondamment pourvues de capitaux, armées du puissant outillage de la grande industrie, et desservies par un personnel suffisant d'ouvriers indigènes, seraient capables de mettre en valeur les richesses naturelles du continent noir et de procurer à l'industrie européenne un marché important tout en couvrant les frais de découverte, d'occupation ou de gestion des établissements africains. Les capitaux et le personnel technique de direction, l'Europe pourrait les fournir, mais il s'agirait de recruter en Afrique même un personnel d'ouvriers, assez nombreux et assidu au travail pour assurer une exploitation stable et régulière. Or, jusqu'à présent on n'a guère obtenu ce résultat indispensable que par deux procédés: l'esclavage et l'engagement. L'esclavage est condamné au double point de vue de la justice et de l'humanité; l'engagement qui a remplacé l'esclavage dans la plupart des anciennes colonies des régions tropicales, n'est autre chose qu'une des formes et peut-être la pire forme de l'esclavage. Au moins, le propriétaire d'un esclave est intéressé, dans quelque mesure, à ne point épuiser hâtivement ses forces, tandis que le bénéficiaire d'un contrat d'engagement dont la durée est communément limitée à sept ans est au contraire intéressé à extraire de cette variété de bête de somme, la plus grande quantité possible de travail, dût-il la faire périr à la peine. L'engagé qui meurt d'épuisement avant l'expiration du contrat épargne même à celui qui l'exploite, les frais de rapatriement. Aussi, la Société pour l'abolition de l'esclavage a-t-elle dénoncé avec raison ce système comme plus dur et plus meurtrier que l'esclavage même. Nous avons eu l'occasion de le voir fonctionner aux Antilles et, malgré la surveillance [456] officielle qui est établie à grands frais pour la protection des engagés, il nous a paru le plus odieux spécimen de l'exploitation de l'homme noir par le blanc. Avons-nous besoin d'ajouter que le « contrat » que l'on fait signer « librement » par un engagé, complètement incapable d'en apprécier les stipulations n'est qu'une parodie hypocrite d'une formalité tutélaire? Mais comment, en dehors de l'esclavage et de l'engagement, se procurer les services réguliers d'un personnel de travailleurs, dans des régions où il est impossible d'acclimater des ouvriers européens? Ce problème, les propriétaires des colonies accoutumés à considérer le bâton ou le fouet comme le seul extracteur de travail, vraiment efficace, sont encore à peu près unanimes aujourd'hui à le déclarer insoluble.
Sans doute, le procédé du bâton a le mérite d'être expéditif et de n'exiger aucun effort d'intelligence de la part de ceux qui l'emploient, mais l'expérience a démontré heureusement qu'il y en a un autre, à la fois moins brutal et plus efficace, qui a prise sur les hommes, noirs, rouges ou jaunes, aussi bien que sur les blancs: c'est l'appât de l'intérêt, quand il est manié avec habileté et approprié au degré d'intelligence et de culture des gens auxquels on le présente. Pour ne citer qu'un exemple célèbre, c'est au moyen de cet appât, trop dédaigné par les amis du bâton, que les Jésuites du Paraguay avaient attiré et retenu les Indiens dans leurs missions. « Ils avaient fondé, dans le centre de l'Amérique du sud, dit M. Daireaux, un vaste et riche empire colonial qui fut détruit en 1767 par un simple décret royal, pour ne laisser sur le sol le plus fertile du monde que ruines, misère et barbarie, vestiges de grands villages aux maisons de pierre encore debout, dans leur alignement primitif, d'églises, de chapelles et de cathédrales, dont les nefs aux murailles élevées ont perdu leurs toitures.... L'admiration éclate, à chaque page, dans les descriptions de nos prédécesseurs, qui ont visité cette région peu après le départ des Jésuites. Cent mille habitants ont vécu là, sur cette langue de terre qui a environ dix-huit lieues de large, de la rive du Parana à celle de l'Uruguay. Que sont-ils devenus? Ils étaient cinq mille en 1869 [59]. » Cette œuvre de civilisation, les Jésuites l'avaient accomplie, sans recourir à la force, [457] en offrant aux Indiens à demi-sauvages des pampas, des moyens d'existence assurés, sous un régime de tutelle approprié à leur degré de développement intellectuel et moral. Eh! bien, le problème que ces habiles éducateurs avaient résolu en Amérique, ne pourrait-on pas essayer de le résoudre par le même procédé en Afrique?
Le principal obstacle que rencontre la mise en exploitation des richesses naturelles du continent noir, c'est, disons-nous, la difficulté de se procurer, d'une façon régulière et assurée, les services d'un personnel de travailleurs adaptés au climat. Si cet obstacle était surmonté, — et jusqu'à présent on a eu le tort de croire qu'il ne pouvait l'être que par l'esclavage auquel la juste répulsion de l'opinion interdit désormais de recourir, — on ne tarderait certainement pas à voir l'esprit d'entreprise et les capitaux se porter vers les rives du Congo et du Zambèze, en vue de recueillir les profits extraordinaires que procure la mise en valeur d'un sol vierge. Il s'agirait donc simplement de réunir un personnel de travailleurs indigènes, en remplaçant l'esclavage et le bâton par les procédés qu'avaient employés les Jésuites du Paraguay, et de mettre ce personnel au service des entreprises d'exploitation. On pourrait fonder dans ce but une compagnie qui se chargerait d'approvisionner de travail les entreprises agricoles et autres, soit en échange d'une rétribution en argent, soit moyennant une part dans les fruits de l'exploitation. En supposant que cette compagnie disposât de ressources suffisantes, et qu'elle offrit à son personnel avec la sécurité de l'existence, les attractions les plus propres à séduire des peuples enfants, n'est-il pas permis de croire qu'elle obtiendrait en Afrique des résultats analogues à ceux que les Jésuites avaient obtenus au Paraguay? Pourquoi même ne demanderait-on point pour cette œuvre d'initiation à la vie civilisée le concours des anciens éducateurs des Indiens? Qui sait s'ils ne retrouveraient pas en Afrique la popularité qu'ils ont perdue en Europe?
Bref, et sans entrer dans d'autres détails, c'est à la concurrence d'un état économique et social supérieur, opposé à l'organisation actuelle fondée sur l'esclavage et qu'on ne pourrait, de l'aveu même de Mgr Lavigerie « supprimer par la force sans tomber dans le chaos », que nous voudrions demander la solution du problème de l'abolition de l'esclavage africain. Ce [458] procédé serait lent sans doute, mais nous le croyons, malgré tout, plus certain que celui de la prohibition et de la force. S'il ne résolvait pas d'emblée la question de l'esclavage, il n'aurait pas du moins pour résultat d'augmenter le déchet de la traite et d'aggraver les souffrances des esclaves.
[459]
TABLE DES MATIÈRES↩
INTRODUCTION A L'éTUDE DE L'éCONOMIE POLITIQUE
I. Les lois naturelles. Les lois de l'économie des forces et de la concurrence. Comment les lois naturelles pourvoient à la conservation des espèces inférieures et maintiennent l'équilibre entre elles. La concurrence entre l'espèce humaine et les espèces infèrieures. La concurrence entre les différentes variétés de la race humaine. Nécessité de la guerre et de l'esclavage. — II. La formation des états. Qu'ils se constituent et s'organisent sous l'impulsion des lois naturelles. Comment leur constitution et leur organisation politique et militaire se perfectionnent sous l'impulsion des mêmes lois. Organisation primitive de l'exploitation des pays conquis et des populations assujetties. Causes déterminantes des progrès de cette exploitation. La substitution du servage et de la sujétion à l'esclavage. Les communautés et les corporations. Conséquences de ces progrès. Les étapes de la servitude à la liberté. — III. Comment les progrès réalisés sous l'impulsion des lois naturelles ont agi pour mettre in à la guerre. Que les profits de la guerre sont d'abord illimités. En quoi consistent ces profits. Pourquoi la guerre entre les peuples civilisés était nécessaire. Comment elle a cessé de l'être. Conséquence des progrès du matériel et de l'art de la guerre. Reflux de la civilisation sur la barbarie. Insuffisance originaire de la concurrence productive. Comment elle est née et s'est développée de manière à remplacer la guerre comme moteur du progrès. Résultats comparés de ces deux modes d'opération de la concurrence. Les profits directs de la guerre. Qu'ills ont fini par faire place à une perte. Le bilan actuel de la guerre. Pourquoi la guerre entre les peuples civilisés a cessé d'avoir sa raison d'être. — IV. Que l'organisation politique et économique des nations, ainsi que leur politique exterieure et intérieure sont demeurées adaptées à l'état de guerre. Les servitudes politiques. Les servitudes économiques. Le système protocteur. Raison de l'établissement de ce système sous le régime de l'état de guerre. Ses effets utiles et ses effets nuisibles. Causes qui ont agi pour lui enlever sa raison d'ètre. L'internationalisation croissante des échanges. Comment elle assure la sécurité des approvisionnements. Que le systeme protecteur n'est plus qu'un obstacle au progrès. Pourquoi les institutions adaptées à l'état de guerre sont devenues nuisibles après avoir été utiles. — V. Causes de la prolongation artificielle de l'état de guerre. Les sentiments engendrés par l'état de guerre. Les intérêts. Bénéflces que la guerre n'a pas cessé de procurer aux classes gouvernantes, malgré les pertes qu'elle occasionne aux classes gouvernées. Pourquoi elle ne peut se perpétuer. Causes qui agissent pour y mettre fin. — VI. Le processus de la naissance et des progrès des sciences morales et politiques. Leur ordre chronologique naturel. La politique. La morale. Le droit des gens. L'économie politique. Causes déterminantes de leur éclosion et de leur progrès. — VII et VIII. L'économie politique et l'importance croissante de son rôle . . . . . . . . . . . . . . .. 1
[460]
I.— LOIS ET PHÉNOMÈNES ÉCONOMIQUES
CHAPITRE PREMIER. — Les lois naturelles.
I. L'homme et ses éléments constitutifs. Le besoin. L'utilité. — II. La valeur. — III. La loi de l'économie des forces. — IV. L'association, la division du travail et l'échange. — V. L'échange. La loi de l'offre et de la demande. — VI. La concurrence. — VII. La loi de progression des valeurs . . . . . . . . 55
I. Les procédés et les agents de la production. L'association des forces productives et la division du travail. Le capital. — II. La genèse du capital. — III. L'entreprise: 1° La réunion du capital d'entreprise; 2° L'opération de la production; 3° Les frais de production et le produit net. — IV. Comment la production peut s'accroître . . . . . . . . . . . . . . ...... 71
CHAPITRE III. — Le capital personnel. — La production de l'homme.
I. Conditions économiques de la production de l'homme. La production des esclaves. — II. La production des hommes libres. — III. L'émigration et l'immigration. — IV. Les obstacles et les encouragements légaux à la production de l'homme. — V. Résumé et conclusion .............. 89
CHAPITRE IV. — Le capital immobilier. — La production de la terre.
I. La propriété fonclère est-elle légitime? — II. Les industries qui contribuent à la production de la terre. — III. La découverte. — IV. La conquête et l'occupation. — V. Le gouvernement et ses profits. — VI. Les profits futurs de la création d'un domaine territorial. — VII. Plus value et moins value: 1° La plus value; 2° La moins value. — VIII. Le processus de la création et du développement de la valeur foncière. — IX. La nationalisation du sol . . . 113
CHAPITRE V. — L'analyse de la production.
I. La production de l'homme et de la terre. — II. Les autres productions. — III. Les besoins. — IV. Les entreprises: 1° Leurs conditions naturelles d'existence; 2° Les formes et les dimensions des entreprises; 3° La quantité et les proportions du capital nécessaire aux entreprises; 4° Le rétablissement du capital . . . . . . . . . . . . . . ............. 136
CHAPITRE VI. — L'analyse de la production (Suite et fin).
I. Le produit brut, le produit net et le profit. — II. L'accroissement et la diminution de la production. — III. L'équilibre de la production et de la consommation. — IV. Résumé du processus de la production. La gravitation économique . . . . . . . . . . . . . . ........... 155
CHAPITRE VII. — La distribution. — La part du capital mobilier.
Résumé de l'analyse de la production. — Que les lois naturelles déterminent la distribution utile des produits. — équivalence de l'emploi des capitaux. — Le taux nécessaire de la rétribution du capital mobilier. — La privation et le risque. — Les capitaux immobilisés et les capitaux mobilisables. — Le taux courant. — L'offre et la demande. — Causes qui déterminent le montant de [461] l'offre. — L'accroissement de la production des capitaux. — L'extension et l'unification des marchés. — La gravitation du taux courant vers le taux nécessaire. — Raison d'ètre de l'intèrêt. — Origine du préjugé contre le prêt à intérêt. — La fonction du capitaliste .............. 171
CHAPITRE VIII. — La distribution. — La part du capital immobilier.
I. La rétribution du capital immobilier sous forme d'immeubles bâtis. Que la location n'implique pas la vente. Que l'amortissement s'ajoute au loyer et se proportionne à la durée de la propriété immobilière. — II. La rétribution du capital immobilier sous forme d'agents naturels appropriés. Causes qui abaissent le taux courant de cette rétribution au-dessous du taux nécessaire et qui l'élèvent au-dessus. Les éléments de la rétribution du capital-terre. La rétribution de l'association ou de l'état producteur d'un domaine territorial. La colonisation d'état Le système colonial. Pourquoi la production des domaines territoriaux doit être abandonnée a l'industrie privée La rétribution des intermédiaires de la propriété foncière. Le commerce des terres. Utilité de la spéculation. — III. La naissance et l'accroissement du revenu du propriétaire foncier. La théorie de la rente. Que la part de la terre est incessamment ramenée à son taux nécessaire. — IV. Résumé ........... 185
CHAPITRE IX. — La distribution. — La part du capital personnel.
I. Les frais de production du travail. La hiérarchie naturelle des fonctions productives. Que le progrès industriel a pour effet d'élever les frais de production du travail. — II. La part proportionnelle des profits afférents au travail. Le prix courant du travail. Analyse d'une entreprise. — III. La rétribution du capital d'entreprise et celle du capital d'exécution. Causes de l'abaissement du taux courant des salaires au-dessous du taux nécessaire. Comment il peut y être remédié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
CHAPITRE X. — La consommation.
Objet de la consommation. — La conservation et l'accroissement du capital — La reconstitution du capital personnel. Comment elle s'opère par le partage entre les besoins actuels, les besoins futurs et le besoin de reproduction. — La reconstitution des capitaux immobiliers et mobiliers. — La consommation nècessaire du propriétaire et du capitaliste ............ 222
CHAPITRE XI. — La propriété et la liberté. — Accord de l'économie politique avec la morale.
Que chaque espèce remplit une fonction nécessaire. — Que la nature assure la conservation et le progrès des espèces au moyen des lois de l'economie des forces et de la concurrence. — Que ces lois sont universelles. — La sphère d'activité des espèces inférieures et celle de l'homme. — Que l'animal ignore les lois naturelles tandis que l'homme peut les connaitre et régler sa production et sa consommation de manière à acquérir un maximum de forces vitales en échange d'un minimum de dépense. — Conditions nécessaires pour atteindre ce but — Le respect de la propriété et de la liberté d'autrui. — L'usage utile de la propriété et de la liberté. — L'accomplissement des devoirs. — Les obstacles à l'accroissement de la production des forces vitales. — Les obstacles provenant du milieu. — Les obstacles provenant de l'homme. — Déperditions de forces causées par les atteintes au droit et le non accomplissement des devoirs. — Le gouvernement de l'homme par lui-même. — Qu'il doit s'accorder avec les lois naturelles. — Objet de l'économie politique. La connaissance des lois naturelles et des phénomènes qui se produisent sous leur impulsion et sous celle des obstacles qui contrarient leur opération. — Objet de la morale. La connaissance du Droit et du Devoir . . 232
[462]
CHAPITRE XII. — L'organisation naturelle des sociétés. Les lois positives et les lois naturelles.
Que les sociétés primitives se sont constituées sous l'impulsion des lois naturelles de l'économie des forces et de la concurrence. — Nécessité des coutumes et des lois positives. — Les coutumes et les lois politiques ont pour objet la constitution du gouvernement de la société. — Les coutumes et les lois morales et économiques règlent la conduite utile de ses membres. — Comment se constitue le gouvernement et se réglent ses rapports avec les membres de la société. — Comment s'établissent les règles du droit et du devoir. — La tutelle. — Les sanctions des règles établies. — L'opinion. — Les lois pénales. — La sanction religieuse. — Que les lois positives sont plus ou moins utiles selon qu'elles se rapprochent ou s'écartent de la loi naturelle de l'économie des forces, et qu'elles progressent sous l'impulsion de la concurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 217
CHAPITRE PREMIER. — La localisation naturelle de la production. — Le libre échange.
La diversité du sol, du climat, des aptitudes, cause déterminante de la localisation naturelle de la production. — Obstacles qu'elle rencontre dans le milieu et dans l'homme. — Obstacle provenant de l'état de guerre. — Progrès qui ont contribué à crécr et à étendre le commerce international. — Causes qui ont détermine le maintien des obstacles dont l'état de guerre avait nécessité l'établissement. — L'intérêt fiscal. — Limite naturelle des droits fiscaux. — L'intérêt protectionniste. — Les industries qui exploitent exclusivement le marché intérieur. — Les rings et les corners. — Les industries d'exportation. — Dommage que leur cause la protection. — Leur exclusion inévitable du marché universel. — Conséquences de cette exclusion. — Que l'homme est libre d'obéir ou non aux lois naturelles, mais qu'en leur désobéissant il s'expose à une pénalité certaine. — Les pertes temporaires causées par la suppression des obstacles aux échanges. — Les compensations de ces pertes. — Nécessité vitale de la suppression des douanes au double point de vue de l'intérêt particulier des nations et de l'interêt général de l'espèce. — Causes qui la retardent . . . . . . . . . . . . . . .............. 261
CHAPITRE II. — Les progrès de l'outillage et des procédés de la production.
Que les progres de l'outillage et des procédés de la production sont subordonnés à l'étendue du marché. — Comment l'extension du marché ou l'augmentation de la capacité de consommation suscite le progrès en le rendant profitable. — Causes naturelles et artificielles de la limitation de la capacité de la consommation sous le régime de l'état de guerre. — Comment elle s'est accrue et a provoqué une demande de plus en plus active du progrès industriel. — Que les inventions se sont multipliées à mesure qu'elles sont devenues plus productives. — Que l'industrie de l'invention s'est perfectionnée en se spécialisant. — Nécessité de la garantie de la propriété des inventions. — Limite naturelle du progrés industriel .............. 273
CHAPITRE III. — Le progrès de la constitution des entreprises.
Comment la pression de la concurrence agit pour déterminer le progrès de la constitution des entreprises — L'entreprise individuelle et la corporation. — Raison d'être du régime des corporations. — Vice de ce régime. — En quoi l'abolition des corporations a été défectueuse. — La protection de l'entreprise [463] individuelle. — Que l'entreprise individuelle a cessé d'ètre adaptée aux conditions actuelles d'existence de la production. — Son imperfection et son insuffisance croissante. — La société impersonnelle à capital mobilisable. — En quoi elle est plus économique que l'entreprise individuelle. — Obstacles que les législations protectrices des entreprises individuelles opposent à son perfectionnement. — Qu'elle n'en est pas moins destinee à remplacer l'entreprise individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
CHAPITRE IV. — L'abaissement de la rétribution nécessaire du capital d'entreprise.
Le capital d'exécution et le capital d'entreprise. — En quoi ils consistent. — Comment leur rétribution peut être réduite. — Que cette réduction ne dépend que pour la plus faible part de l'entrepreneur d'industrie. — Progres qui la déterminent. — Comment la quantité nécessaire du capital d'entreprise peut ètre diminuée, sa puissance augmentée et sa rétribution abaissee. — La diminution de l'avance et l'abaissement des risques. — Limite naturelle de la réduction des frais du capital d'entreprise .............. 290
CHAPITRE V. — L'abaissement de la rétribution nécessaire du capital d'exécution.
Comment le progrès agit pour diminuer la rétribution nécessaire du capital d'exécution. — Changement qu'il opère dans la proportion du personnel et du matériel des entreprises. — Qu'en diminuant la quantité du personnel, il en éleve la qualité et la rétribution nécessaire. — Qu'il améliore, en conséquence, la condition des travailleurs. — Qu'il peut aussi la rendre pire. — Dans quel cas. — Erreur des socialistes à cet égard. — Que la suppression du salariat ne remédierait pas au mal de l'avilissement de la rétribution du travail. — Raison d'être du salariat. — Comment les frais d'avance et d'assurance que rembourse le salarié peuvent être réduits — La mobilisabilité des capitaux et le marchandage. — Causes pour lesquelles la classe ouvrière n'a pas bénéficié du progrès industriel autant qu'elle l'aurait dû. — Son incapacité dans la gestion du capital personnel. — La gestion de ce capital sous le régime de l'esclavage et sous le régime de la liberté — Nuisances particulières et générales causées par la mauvaise gestion du capital personnel. 299
CHAPITRE VI. — L'accroissement de la mobilisabilité des produits.
Diminution successive des frais de production jusqu'à la limite naturelle du progrès. — Que les frais de production ne sont qu'un point idéal vers lequel le prix courant gravite. — Condition nécessaire de cette gravitation. — La mobilisabilité des produits. — Le commerce. — Comment le commerce s'est spécialisé et étendu dans l'espace et le temps. — Progrès qui ont contribué à son extension. — La publicité commerciale. — Les frais de transport des produits dans le temps. — La spéculation. — Son utilité. — Résumé de l'opération des lois naturelles pour déterminer l'équilibre de la production et de la consommation. — Progrès réalisés par la mobilisabilité des produits et l'unification des marchés . . . . . . . . . . . . . . ........ 312
CHAPITRE VII. — L'accroissement de la mobilisabilité des capitaux.
La demande des capitaux. — Leur provenance. — Leur mode de réalisation. — Le taux nécessaire de leur rétribution. — Le prêt des capitaux. — La limitation du taux de l'intérét. — Les intermédiaires et leurs fonctions. — Les instruments de la circulation et du crédit. — La monnaie réelle et la monnaie [464] fiduciaire. — Le commerce de banque, agent de la mobilisation des capitaux. — Les marchés des capitaux. — Les capitaux immobilisés et les capitaux mobilisables. — La gravitation du taux courant vers le taux necessaire . . . . . . . . . . . . . . ............ 325
CHAPITRE VIII. — La mobilisabilité du travail et les causes qui l'entravent.
La mobilisabilité, condition de la mise en équilibre du prix courant du travail avec le prix nécessaire. — Insuffisance de la mobilisabilité du capital personnel. — Qu'elle a diminué par la substitution du servage à l'esclavage. — Le commerce des esclaves dans l'antiquité. — La situation du serf. — Celle du travailleur libre. — Obstacles à l'exploitation utile de son travail. — Inégalité originaire de la situation de l'ouvrier libre vis-à-vis de l'entrepreneur, causée par l'absence des intermédiaires. — Comment cette situation s'est amélioree. — Les coalitions. — Leurs avantages et leurs inconvénients. — Les unions et les syndicats. — La fonction nécessaire du commerce de travail. — Conséquences de son développement futur ............ 333
CHAPITRE IX. — Le bilan de l'émancipation des classes ouvrières.
La conservation du capital personnel sous le régime de l'esclavage. — L'insuffisance de la capacité de gestion de l'ouvrier libre. — Difficultés de la gestion du capital personnel. — Les obligations qu'elle implique. — Bilan de l'émancipation des travailleurs. — Que l'actif de ce bilan dépasse le passif. — Amélioration de la condition des ouvriers capables du self government. — Causes qui ont déprimé la condition des moins capables. — Le self government obligatoire et ses effets. — Le budget de l'ivrognerie. — Le dérèglement de la reproduction. — L'exploitation du travail des enfants et ses conséquences. — Nécessité d'une tutelie qui remédie au défaut de capacité de la gestion du capital personnel ............ 341
CHAPITRE PREMIER. — Programmes et remèdes socialistes.
La crise actuelle et ses causes. — La demande des remèdes. — Vices des systèmes socialistes qui ont répondu à cette demande. — L'ignorance ou la négation des lois naturelles. — Points sur lesquels les socialistes s'accordent. — Points sur lesquels ils diffèrent. — Le socialisme d'état et ses facteurs. — La philanthropie. — Maux qu'elle a aggravés. — La croyance à la toute puissance de l'état. — L'extension de ses attributions. — L'infériorité de l'état en matière de production et de distribution. — Ce que produirait la substitution de l'état à l'industrie privée. — L'intervention de l'état. — La tutelle gouvernementale et ses vices. — L'assistance publique. — La responsabilité des accidents du travail. — L'assurance obligatoire. — La limitation de la journée. — Conséquences de l'application du socialisme ......... 355
CHAPITRE II. — L'objectif et le mécanisme de la production du progrès.
Objectif du progrès, — L'accroissement des forces vitales de l'espèce. — Mécanisme du progrès. — Que la sécurité est la condition nécessaire du progrès. — Comment elle s'est établie. — La concurrence politique et guerrière. — Ses effets. — Les progrès réalisés par la guerre. — La décadence de la guerre. — Résumé des causes de la prolongation de l'état de guerre. — L'extension des attributions de l'état. — Changement de l'objectif du progrés ..... 368
[465]
I. La concurrence véhicule du progrès et régulateur de la production, de la distribution et de la consommation de la richesse. — Ne peut remplir ce double rôle qu'à la condition d'être libre. — Obstacles naturels au libre-échange. — Progrès qui ont contribué à les aplanir. — Exhaussement des obstacles artificiels. — Explication de cette contradiction. — L'intérêt fiscal et l'intérêt protectionniste. — Progrès qui ont augmenté les profits de la fiscalité et de la protection. — Puissance actuelle des intérêts fiscaux et protectionnistes. — Faiblesse et désunion de leurs adversaires. — Progrès qui agissent en faveur du libre-échange. — L'accroissement du marché général. — La nécessité vitale de l'abaissement des prix de revient. — Que le libre-échange s'impose aux nations concurrentes sous peine de ruine. — II. Comment pourra s'établir l'assurance contre la guerre. — Le Droit des gens et ses progrès. — Le Droit des neutres. — Droit et intérêt des neutres à empêcher la guerre. — Conséquences d'une assurance contre la guerre. — III. Les attributions nécessaires de l'état. — Progrès qui ont permis de les diminuer. — Causes qui ont empêché leur diminution. — Charge qu'elles infligent et nuisances qu'elle déterminent. — L'état-gendarme . . . . . . . . . . . . . . ... 381
CHAPITRE IV. — L'unification des marchés. — La mobilisation du travail.
La tendance à l'unification des marchés des produits et des capitaux, en dépit des entraves, servitudes et charges, issues de l'ancien régime. — L'impersonnalisation des prix. — Les marchés régulateurs. — La formation des prix sur un marché limité et sur un marché illimité. — La tendance à l'équilibre du prix courant au niveau des moindres frais de production. — Les causes qui retardent les progrès de la production et troublent la distribution. — La limitation des marchés du travail. — Ses effets sur la condition des ouvriers. — Les obtacles au déplacement des ouvriers. — L'expedient des coalitions et des grèves. — La mobilisabilité du travail et ses effets. — Conditions auxquelles elle est subordonnèe. — La multiplication et le bon marché des moyens de transport. — Le développement du rouage intermédiaire du commerce du travail. — Causes qui le retardent. — La mobilisation du travail, solution de la question ouvrière .............. 397
CHAPITRE V. — Le self government. — La tutelle.
Qu'une grande partie des maux de la société provient des vices du self government de l'individu. — Comparaison des destinées de deux familles d'ouvriers. — Le passif et l'actif du bilan de l'existence individuelle. — économies que procurerait à la Société un bon self government. Le budget « des passions des hommes ». — Comment on peut le diminuer. — L'appareil de la répression. — Le perfectionnement de l'individu. — La nécessité de la tutelle des incapables. — La tutelle imposée et la tutelle libre. — Raison d'être de la tutelle imposée sous l'ancien régime. — Son organisation, ses avantages et ses inconvénients. — Qu'on a commis la faute de la remplacer par le self government obligatoire. — Que le besoin de tutelle continuant de subsister, il y a été pourvu au moyen de la tutelle gouvernementale. — Vice de la tutelle gouvernementale. — Que le progrès consiste à la remplacer par la tutelle libre . . . . . . . . . . . . . . .. 410
CHAPITRE VI. — Portée limitée du programme économique.
Que la demande d'une réforme des institutions politiques et économiques se produit lorsqu'elles deviennent nuisibles après avoir éte utiles. — Qu'elle [466] se manifeste actuellement sous l'influence des progrès du matériel et des arts de la destruction et de la production. — Qu'elle est déterminée encore par la suppression hative et radicale de l'ancienne tutelle. — Vice des conceptions qui ont repondu à cette demande. — Le défaut de connaissance du mécanisme de la Société. — L'illusion et l'exagération de l'efficacité des réformes. — L'exagération de leur prix de revient. — Le discrédit des réformes politiques. — Les déceptions certaines des réformes et des expérimentations socialistes. — Pourquoi le programme économique ne sera réalisé qu'après l'échec des programmes socialistes. — Que les réformes contenues dans ce programme ne peuvent avoir les effets d'une panacée. — Que l'œuvre du progrès est multiple et successive. — Qu'on peut acheter un progrès trop cher . . . . . . . . . . . . . . ..... 420
CHAPITRE VII. — Les méthodes socialistes et la méthode économique.
Que le premier et nécessaire objectif du socialisme est la main-mise sur l'état. — Les deux méthodes de conquête de l'état. — La méthode révolutionnaire et la méthode constitutionnelle et parlementaire. — Ce que coûte et ce que rapporte la première. — Que toute révolution est condamnée à un avortment. — Mode d'opération de la seconde. — Ses résultats négatifs. — La méthode économique. — Qu'elle a pour objectif, non la conquête de l'état, mais celle de l'opinion. — Ses instruments. — Obstacles qu'elle rencontre. — Comment elle peut les surmonter. — Utilité de la concurrence des faux systèmes. — La puissance de l'opinion. — La force apparente et la faiblesse réelle des institutions qu'il s'agit de réformer. — Immoralité des impôts indirects, du papier-monnale et des emprunts perpétuels, qui les soutiennent et les perpétent. — Qu'il suffit d'éclairer l'opinion et de la laisser faire. — Utilité d'une Association cosmopolite pour la réalisation du programme économique . . . . . . . . . . . . . . ............ 425
APPENDICE. — l'abolition de l'esclavage africain ... 437
FIN DE LA TABLE DES MATIéRES
IMPRINERIE DE BAINT—DENIS. — BOUILLANT. 20, ROM DE PARIS.
Notes↩
[1] économie politique signifie arrangement intérieur de la Cité ou de l'état.
« Bien que le terme d'économie politique soit tout à fait moderne, dit Joseph Garnier, les deux mots qui le composent sont tres anciens. Les grees disaient oiconomia et les latins œconomia, de oicos, maison, nomos, loi, ou de nemo, j'administre, pour signifier la loi et l'administration de la maison. Aristote entendait par l'oiconomia l'administration de la famille sous le rapport moral comme sous le rapport matériel, c'est-à-dire l'êconomie domestique comme nous la définissons aujourd'hui, plus la direction intellectuelle et morale de la famille.
Le mot politique est encore plus ancien. Les grecs disaient: politikos, politika, politicon, de polis, ville, cité, ensemble de citoyens, et les romains: politicus, politica, politicum, dans le sens de civique, de politique, de relatif à la chose publique. »
Joseph Garnier. De l'origine et de la filiation du mot économie politique.
[2] « Si les progrès de l'industrie sont les facteurs nécessaires de l'augmentation de la richesse, il n'est pas cependant en leur pouvoir d'assurer un accroissement du bien-être des populations ou un allègement a leurs misères. Il ne suffit pas pour obtenir ce résultat de multiplier la richesse, il faut encore la bien employer. Or, si depuis un siècle, la puissance productive de l'homme s'est accrue avec plus de rapidité et d'ampleur qu'elle ne l'avait fait à aucune autre époque de l'histoire, il n'en a pas été de même de son aptitude à employer utilement les fruits de la production. C'est qu'il est malheureusement plus facile de perfectionner la machinery qui sert a produire que de régler et de refréner les appétits qui se disputent les produits. Si le XIXe siècle peut se glorifier d'un ensemble merveilleux de découvertes et d'inventions, s'il est par excellence le siècle du progrès mécanique, il est beaucoup moins celui du progrès moral. S'il a beaucoup acquis, il a encore plus gaspillé, et nous avons peur qu'il ne soit pas seulement au jugement de la postérité, le siècle du progrès, mais encore le siècle de l'intemperance. Les gouvernements ont donné l'exemple du dérèglement et de l'incontinence dans la dépense. Sur notre vieux continent, ils lègueront aux peuples du XXe siècle une dette qui s'élève dès à présent à plus de cent milliards avec des budgets dans lesquels le déficit est passé à l'état chronique. Les budgets individuels sont-ils mieux règles? L'impôt de l'intempérance ne coûte-t-il pas, à lui seul, aux classes ouvrières une somme presque équivalente à celle que leur enlève l'ensemble des impôts de l'é? N'a-t-on pas calculé que, en Angleterre, il s'élève aux deux tiers du montant des dépenses publiques? Faut-il donc s'étonner si le bien-être n'a pas progressé du même pas que la puissance de production de la richesse? » Journal des économistes, 5 série, t. V. p. 9.
[3] Il importe toutefois de remarquer que l'intensité de la demande n'est pas déterminée seulement par le besoin actuel des demandeurs. Elle s'accélère ou se ralentit et provoque l'accélération ou le ralentissement de l'offre de l'article d'échange à la fois d'après le compte des utilités existant sur le marché et d'après l'appréciation de celles qui pourront y être apportées, à mesure que le besoin s'en fera sentir. Les éléments de cette appréciation sont l'espace et le temps. Dans une année où la récolte est généralement abondante, on voit baisser le prix du ble sur le marché général, lequel comprend l'ensemble des marchés en communication entre eux dans l'espace et le temps. En supposant qu'un de ces marchés soit faiblement approvisionné, le prix u'y haussera point en raison de l'insuffisance actuelle de la quantité existante sur ce marché, les détenteurs de monnaie qui demandent le blé ralentiront leur demande, dans la prévision des apports futurs de blé; ils la proportionneront seulement à leurs besoins actuels. Au contraire, si dans une année de disette un marché est amplement pourvu de blé, les détenteurs de blé ralentiront leur demande de monnaie dans la prévision d'une diminution future des apports. D'où l'on peut conclure que l'intensité de la demande ne se mesure pas seulement sur les quantités existantes au marché mais encore sur celles qui peuvent y être apportées ou en être enlevées dans l'espace et le temps.
[4] Est-il nécessaire-de dire que la différence est, en réalité, bien autrement considérable et que les progrès de l'industrie associée et divisée l'accroissent tous les jours?
D'après M. G. Mulhall (The progress of the World) le produit moyen d'un acre de terre en Angleterre était en 1880 de 28 boisseaux. D'un autre côté, d'après M. Thorold Rogers (The economic interpretation of history) dans l'ancienne agriculture anglaise comme dans la moderne, le travail d'un homme peut être considéré comme amplement suffisant pour 20 acres. Or, en multipliant 20 par 28 on obtient 560 boisseaux. En évaluant à sept boisseaux la quantité de blé nécessaire à la nourriture annuelle d'un homme, on arrive à cette conclusion que le travail d'un agriculteur peut nourrir 80 personnes.
Dans un discours prononcé au congrès de l'Association britannique à Montreal en 1884, M. édouard Atkinson calculait que la quantité de pain consommée en une année à New York par 1,000 personnes était produite par le travail de 10 agriculteurs, meuniers, employés des chemins de fer, boulangers, etc.
The Westminster Review, march. 1889, p. 290.
[5] Slavery and the internal slave trade in the United States of the North America, being replies to questions transmitted by the committee of the British and foreign anti-Slavery Society. I vol. In-8°.
[6] Dictionnaire de l'économie politique. Art. Esclavage.
[7] Si nous faisons le relevé des naissances à Paris, en le reportant à la population adulte, il faudra constater une fécondité faible, inférieure d'un cinquième environ a la moyenne de la France. Ce fait est surtout remarquable dans les quartiers riches; ainsi sur 1,000 femmes de 15 à 50 ans, la natalité descend à 86 dans le IXe arrondissement (Opéra) et à 53 dans le VIIIe (élysée); elle se releve dans les quartiers populaires. Le XIIIe (Gobelins) donne 180 naissances, le XIXe (Buttes Chaumont) et le XVe (Vaugirard) 164. le XXe (Belleville) 160.
De Nadaillac. Affaiblissement de la natalité en France. p. 83.
Le même phénomène s'observe aux états-Unis.
Un sceptique, dit M. Claudio Jannet, parlant de la famille française, disait que les enfants y étaient un inconvenient. On dit encumbrances dans les familles de la Nouvelle Angleterre. Là aussi un mal caché et profond corrompt le foyer, stérilise la race et menace de détruire rapidement la vieille nationalité. Ce mal qui était inconnu autrefois, soulève tout à coup, à partir de 1880, le cri d'alarme des médecins, des publicistes, des législateurs. M. Hepworh Dixon a été effrayé de cette horreur pour les enfants que manifestent les femmes du meilleur monde, surtout dans les états renommes pour leur moralité et leurs lumières. C'est dans la société puritaine de Massachussetts, du Vermont, du Maine, du New-Hampshire, c'est dans le monde poli de Philadelphie et de Providence que ces sentiments contre nature se développent, tandis que les populations rurales de l'Ouest plus rudes et plus grossières y échappent.
Le directeur du dernier recencement, M. F. A. Walker constatait ainsi ce fait dans un mémoire lu en 1873 devant l'Américan social science association:
« Les habitudes auxquelles je fais allusion, ce sont d'une part le retard apporté au mariage et de l'autre le soin avec lequel on évite d'augmenter la famille. Que ces habitudes se répandent rapidement, quoique sans progression régulière parmi tous les états du Nord-Est, et du Centre ainsi que parmi les villes commerciales et industrielles de l'Ouest, cela n'a pas besoin d'être démontré par des rapprochements statistiques. Le fait est patent, palpable et se passe de preuve. »
Les résultats de ces mœurs nouvelles commencent à effrayer les hommes d'état . . . Le dernier rapport sur la population du Rhode-Island établit que dans cet état, cent Américains ont en moyenne deux enfants par an, tandis que cent immigrés en ont six. Si ces désordres continuent, — et ils continueront à moins d'une profonde réforme religieuse et morale, — avant cinquante ans il n'y aura plus dans les états du Nord un seul descendant de la vieille race Anglo-Saxonne. La Nouvelle Angloterre, la Pensylvanie et le New-York appartiendront exclusivement aux descendants des Irlandais et des Allemands si méprisés.
Claudio Jannet. Les états-Unis contemporains, chap. XII. La question des femmes.
[8] D après une communication faite par M. Engel à l'Institut international de statistique, réuni a Rome en 1887, voici quels seraient les prix de revient d'un enfant et d'un homme fait:
| Ages | Valeur de la consommation annuelle. | Prix de revient. |
|---|---|---|
| 0 | 125 fr. | 125 fr. |
| 1 | 137 50 | 262 50 |
| 2 | 150 | 412 50 |
| 3 | 162 50 | 575 |
| 4 | 175 | 750 |
| 5 | 187 50 | 937 50 |
| 10 | 250 | 2,062 50 |
| 15 | 312 50 | 3,500 |
| 20 | 375 | 5,250 |
| 25 | 437 50 | 7,312 50 |
D'après M. Edvard Young, chef de bureau de statistique de Washington, la valeur moyenne d'un immigrant, sans distinction d'âge ni de sexe, serait de 800 dollars. Un autre statisticien américain porte cette valeur à 1,125 dollars.
M. de Foville en suivant un autre mode d'évaluation porte, a notre avis, beaucoup trop bas la valeur de l'homme.
D'après lui:
« Le nouveau-ne (en France), en tant qu'instrument de production future, représente une valeur de 770 fr.
L'enfant de cinq ans, considéré de la même manière, vaut 1,330 fr.
L'enfant de dix ans 2,087 fr.
Le jeune homme de dix-sept ans qui a, ouverte devant lui, toute une longue période de labeur fécond, équivaut, à ce titre, a un capital de 3,373 fr.
Puis, à mesure que le travailleur avance en âge, son avenir se réduisant d'autant, le chiffre qui en mesure la puissance productive diminue rapidement. Nous trouvons 3,075 fr. à vingt-cinq ans, 2,493 fr. à trente-cinq ans, 1,544 fr. a quarante-cinq ans. A. De Foville. économiste français, 4 décembre 1875.
[9] C'est un chiffre minimum. On a vu plus haut que M. Engel évalue à ce chiffre la consommation annuelle d'un enfant de dix ans.
[10] Voici, d'après les relevés officiels, les chiffres de l'immigration d'Europe aux états-Unis de 1789 à 1887:
| De 1789 à 1820 | 250,000 |
| 1820 à 1882 | 11,397,181 |
| 1882 | 788,992 |
| 1883 | 603,322 |
| 1884 | 318,592 |
| 1885 | 395,346 |
| 1886 | 334,203 |
| 1887 | 490,109 |
| Total | 14,975,745 |
[11] Le nombre des étrangers existant en France, sans compter les étrangers naturalisés, était de 1,115,214, le 31 décembre 1886.
[12] Voir un aperçu de ces coutumes et reglements dans les Principes d'économie politique de Stuart Mill. Traduction de MM. Dussart et Courcelle-Seneuil, L. Ier, p. 402.
[13] Mac Culloch a fait remarquer, le premier, croyons-nous, mais sans y insister assez, que l'homme doit être considéré comme un capital.
« Quelque étendu, dit-il; que puisse paraitre. au premier coup d'œil, le sens que nous avons attaché au mot capital, nous sommes porte à croire qu'il pourrait encore s'interpréter d'une manière bien plus large. Au lieu d'entendre par le mot capital toute cette portion du produit de l'industrie qui peut s'appliquer a l'entretien de l'homme, ou au moyen de faciliter la production, il semble qu'il n'y ait aucune bonne raison pour ne pas admettre (et il y en a, au contraire, un grand nombre pour admettre) que l'homme doit être considéré comme formant une portion du capital national. L'homme est le produit des avances de richesse faites pour son existence, pour son éducation, etc., an même titre qu'un instrument quelconque crée par son industrie.... Tout individu arrivé a l'âge de maturité bien qu'il n'ait pas été formé pour un art ou pour une profession particulière. peut cependant être considéré avec une parfaite exactitude, sous le rapport de ses facultés naturelles comme une machine qui a coûté, pour sa construction, vingt années de soins assidus et la dépense d'un capital considérable. Et, si une somme plus importante a été dépensée pour le rendre propre à l'exercice d'une industrie ou d'une profession qui exige une habilité extraordinaire, la valeur de cet homme s'en accroitra proportionnellement, et il aura droit à une rémunération plus large pour ses talents; de même qu'une machine acquiert une plus grande valeur lorsqu'elle acquiert une puissance nouvelle par la dépense d'un nou veau capital ou d'un nouveau travail appliqué à sa construction.» Mac Culloch. Principes d'économie politique, t. Ier, p. 130. (Ed. Guillaumin).
Un statisticien progressiste, M. de Foville partage l'opinion de Mac Culloch, mais sans oser, dit-il, combler la lacune que l'omission de la valeur du « capital humain » a laissée dans la statistique de la richesse nationale.
« Le revenu national, dans un pays comme le nôtre, découle de deux sources differences: il y en a une part qui est fournie, comme spontanément, par les valeurs immobilières ou mobilières que les Français possèdent à l'état de richesse acquise, mais il y a une autre part du revenu national qui provient du travail même des Français. Supposons, par exemple, que les revenus cumules des 38 millions d'individus qui peuplent la France forment un total de 25 milliards: sur ces 25 milliards, il pourrait y avoir 15 milliards de salaires et 10 milliards d'intérêt de valeurs diverses, meubles ou immeubles. Nous dirions volontiers, dans cette hypothèse, que ces 10 milliards représentent le produit des capitaux possédés et que les 15 milliards qui s'y ajoutent sont le produit du capital humain. L'homme, en tant qu'instrument de production, est bien un capital, au même titre qu'un cheval, une machine à vapeur ou un champ, et l'évaluation du capital humain n'est pas un problème plus compliqué que bien d'autres. Mais cette manière d'envisager notre productivité individuelle n'est pas encore assez universellement admise pour que nous osions l'introduire ici. » A. de Foville. La France économique, chap. XXVII, richesse publique.
[14] « La demande d'êtres humains, comme celle de tout autre denrée, en règle nécessairement la production, l'accélère lorsqu'elle marche trop lentement, et l'arrête lorsqu'elle marche trop vite. C'est cette demande qui règle et détermine l'état de la population dans tous les pays de l'univers ». Adam Smith. Richesse des nations, p. 36. (Ed. Guillaumin).
Ces quelques lignes du père de l'économie politique donnent une notion plus exacte de la théorie de la population que le volumineux et trop célèbre ouvrage de Malthus.
[14] « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire: ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, de misères et d'horreurs n'eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables: Gardez-vous d'écouter cet imposteur; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont a tous et que la terre n'est à personne! »
Ce passage célèbre du « Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes » est sans contredit l'expression la plus éloquente du sophisme sur lequel se fondent toutes les théories du socialisme. Plus tard, M. Proudhon a résumé ce sophisme dans une formule non moins saisissante:
« A qui est dû le fermage de la terre? Au producteur de la terre sans doute. Qui a fait la terre? Dieu. En ce cas, propriétaire. retire-toi ».
Enfin, de nos jours, l'auteur de la théorie de la nationalisation du sol, M. Henry George s'est borné à paraphraser le sophisme que Rousseau et Proudhon avaient emprunté aux anciennes générations de communistes et a le vulgariser en le modernisant:
« Les lois de la nature, dit M. Henry George, sont les lois du créateur. On n'y trouve écrite la reconnaissance d'aucun droit, excepté celui du travail; et le droit égal de tous les hommes à se servir et à jouir de la nature, à s'adresser a elle par leurs efforts, et à recevoir et a posséder sa recompense, y est franchement et clairement écrit. Donc l'exercice du travail dans la production est le seul titre à la possession exclusive.
Ce droit à la proprieté qui nait du travail exclut la possibilité de tout autre droit de propriété. Si un homme a légitimement droit au produit de son travail, personne ne peut avoir un titre quelconque à la possession de choses qui ne sont pas le produit de son travail, ou le produit du travail de quelqu'un d'autre ayant transmis son droit. Si la production donne au producteur le droit de possession et de jouissance exclusive, il ne peut y avoir légitimement possession ou jouissance d'une chose n'étant pas la production du travail, et la reconnaissance de la propriété privée de la terre est une injustice.
... Une maison et le terrain sur lequel elle s'appuie sont des propriétés parce qu'ils sont soumis a la propriété, et sont classés par les légistes comme propriété foncière. Cependant ces deux choses diffèrent beaucoup en nature et en relations. La maison est le produit du travail humain et appartient a la classe appelée richesse en économie politique. Le terrain est une partie de la nature et appartient à la classe appelée terre en économie politique.
Le caractère essentiel de l'une de ces deux classes de choses est que ces choses sont la forme matérielle du travail, qu'elles sont amenées a l'existence par l'activité humaine, que leur existence ou leur non-existence, leur accroissement ou leur diminution, dépendent de l'homme. Le caractère essentiel de l'autre classe de choses, c'est que ces choses ne sont pas le produit du travail, et existent en dehors de l'activité humaine, en dehors de l'homme.... Si nous sommes tous ici-bas par la permission égale du Créateur, nous avons tous un titre égal a la jouissance de sa bienfaisance, un droit égal à l'usage de tout ce que la nature offre avec tant d'impartialité. C'est un droit qui est naturel et inalienable; c'est un droit qu'apporte chaque homme en naissant, un droit qui, pendant toute la durée de la vie de l'homme, n'est limité que par les droits égaux des autres. Dans la nature, il n'y a rien qui ressemble a un fief absolu de la terre. Il n'y a sur la terre aucun pouvoir qui puisse légitimement faire la concession d'une propriété exclusive de la terre. Si tous les hommes existants s'unissaient pour rejeter leurs droits égaux, ils ne pourraient pas rejeter les droits égaux de ceux qui leur succéderaient. Car, pour toute chose, que sommes-nous si ce n'est les tenanciers d'un jour? Avons-nous donc fait la terre, pour vouloir déterminer les droits de ceux qui, après nous, seront tenanciers a leur tour? Le Tout-Puissant, qui a créé pour l'homme la terre et l'homme pour la terre, a donné la terre en partage à toutes les générations des enfants des hommes par un décret écrit dans la constitution de toutes choses, décret qu'aucune action humaine ne peut annuler, qu'aucune prescription ne peut détruire. Que les parchemins soient aussi nombreux que possible, que la possession soit aussi longue que possible, la justice naturelle néanmoins, ne peut reconnaitre a un homme aucun droit a la possession et à la jouissance de la terre qui ne soit également le droit de tous ses semblables. Bien que le fils aîné du duc de Westminster ait des titres reconnus par des générations et des générations, cependant le plus pauvre des enfants nés aujourd'hui à Londres, a autant de droits que lui aux vastes propriétés du due. Bien que le peuple souverain de l'état de New-York ait reconnu les propriétés foncières des Astor, cependant l'enfant le plus chétif venant au monde dans un taudis, est investi à ce moment même d'un droit égal à celui de ces millionnaires. Et il est volé si on lui dénie ce droit. «Henry George. Progès et pauvreté. Livre VII. Chap. Ier. Injustice de la propriété privée de la terre. »
On sait que M. Henry George a déduit de l'injustice de la propriété privée de la terre, — sur laquelle, affirme-t-il, tous les hommes ont un droit égal, — sa célèbre théorie de la nationalisation du sol. Mais si un individu n'a pas le droit de s'approprier une portion de ce domaine commun de l'humanité et d'en jouir d'une manière exclusive, une nation c'est-à-dire une collection d'individus, a-t-elle ce droit? En s'appropriant le sol des états-Unis, la nation américaine ne commettrait-elle pas un vol au détriment du reste de l'espèce humaine, et ce vol ne serait-il pas particulièrement dommageable aux Groenlandais et aux Lapons, auxquels la nature, en dépit de l'impartialité que lui attribue bénévolement M. Henry George, n'a accordé qu'un terrain ingrat et une terre infertile? La théorie de la nationalisation du sol n'en est pas moins devenue populaire. Ce qui explique surtout la faveur avec laquelle elle a été accueillie, c'est qu'elle s'est produite dans un moment où l'esprit de monopole avait besoin de s'appuyer sur une théorie, bonne ou mauvaise, pour justifier les lois qui interdisent aux étrangers la possession du sol. En cette occasion comme en bien d'autres, les sophismes démocratiques du socialisme ont servi d'auxiliaires aux pratiques égoïstes du protectionnisme.
[16] Exactement 3,450 millions, d'après une statistique officielle, sans compter la valeur des vies humaines sacrifiées dans cette conquête.
[17] En 1776, au commencement de la guerre de l'Indépendance, les exportations anglaises pour l'Amérique du Nord étaient de 1,300,000 liv. st.; elles s'élevèrent a 3.600,000 en 1784, après que l'indépendance eut été reconnue. (F. Bastiat, Cobden et la Ligue, Introduction).
[18] Le progrès industriel substitue communément à l'emploi de la force physique du travailleur celui d'une force mécanique moins coûteuse et plus puissante. Dans les industries que le progrès transforme, on voit, en consequence, le travail humain changer successivement de nature: de purement physique a l'origine, du moins dans les fonctions inférieures, il devient de plus en plus intellectuel. Si nous examinons, par exemple, l'industrie de la locomotion à ses différentes périodes de développement, nous serons surpris de l'étendue et de la portée des transformations que le travail dont elle exige le concours a subies sous l'influence du progrès. A l'origine, c'est l'homme lui-même qui transporte les fardeaux. en mettant en œuvre as force musculaire. Il en est encore ainsi dans certaines parties de l'Inde, où les bras et les épaules des coolies sont les seuls véhicules en usage pour transporter les voyageurs aussi bien que les marchandises. Mais l'industrie de la locomotion vient à progresser. L'homme dompte le cheval, l'âne, le chameau, l'éléphant, et il les assujettit a porter des fardeaux; il invente encore la charrette, la voiture et le navire. Aussitôt la nature du travail requis pour le transport des hommes et des marchandises se modifie. La force musculaire ne suffit plus, elle ne joue mème plus qu'un rôle secondaire dans l'industrie des transports: le premier rôle appartient désormais à l'adresse et à l'intelligence. Il faut plus d'adresse et d'intelligence que de force musculaire pour guider un cheval, un âne. un chameau, un éléphant, pour conduire une voiture ou une charrette, pour diriger un navire. Survient enfin un dernier progrès. La locomotive avec sa longue file de wagons se substitue au cheval, a la charrette, à la diligence; le bateau a vapeur prend la place du navire a voiles. La fonction du travailleur dans l'industrie des transports acquiert, par suite de cette nouvelle transformation, un caractère intellectuel plus prononcé. Les employés des chemins de fer ont a déployer plus d'intelligence et moins de force physique que les voituriers, messagers, etc., qu'ils ont remplacés. Dans l'industrie des transports par eau, l'intervention de la vapeur supprime l'outillage humain qui était employé à manœuvrer l'appareil moteur des navires, les mâts, les voiles, les cordages. A cet appareil qui nécessitait encore l'application d'une certaine quantité de force musculaire, la vapeur substitue une machine dont les servants, chauffeurs ou mécaniciens, n'ont guère à faire œuvre que de leur intelligence.
En examinant donc l'industrie de la locomotion à son point départ et à son dernier point d'arrivée, on s'aperçoit que la proportion dans laquelle elle réclame le concours de la force musculaire et de la force intellectuelle de l'homme s'est progressivement modifiée, et que la dernière a fini par s'y substituer presque entièrement à la premiere. On obtient le mème résultat en étudiant l'action du progrès industriel sur les autres branches de la production, et l'on arrive ainsi à cette conclusion importante, que l'industrie moderne exige dans une proportion moindre que celle des premiers âges du monde l'intervention de la force musculaire de l'homme, mais qu'elle réclame, en revanche, a un bien plus haut degré, le concours de ses facultés intellectuelles et morales.
Cette modification progressive dans la nature des forces requises pour la production ne manque pas de se répercuter dans les frais de production du travail. A mesure que l'intelligence se substitue a la force musculaire dans l'industrie, on voit s'élever le niveau de la rémunération des travailleurs. Ainsi, les salaires des voituriers, des cochers. des conducteurs d'omnibus sont plus élevés que n'étaient ceux des porteurs de chaises; mais ils se trouvent à leur tour dépassés par ceux des employés des chemins de fer. De mème, il y a apparence que les travailleurs employés dans la navigation à voiles sont mieux rémunérés que ne l'étaient jadis les rameurs, tandis qu'ils le sont plus mal que le personnel employé dans la navigation à vapeur. Pourquoi en est-il ainsi? parce que l'intelligence nécessaire à l'exercice d'une industrie perfectionnée exige des frais d'entretien et de renouvellement plus considérables que la force musculaire requise par une industrie encore dans l'enfance; parce que les frais de production du travail intellectuel sont plus élevés que ceux du travail physique.
En examinant les modifications que subit la nature du travail sous l'influence du progrès industriel, on arrive, en définitive, à une conclusion qui peut être formulée ainsi:
Que le progrès industriel contribue dans toutes les branches de l'activité humaine à élèver le niveau des frais de production du travail.
Cours d'économie politique, 8° leçon. La part du travail.
[19] Pour subvenir aux nécessités de son existence l'homme dispose d'une portion de la création, et il est armé de facultés à l'aide desquelles il peut extraire, du milieu où il vit, tous les éléments de sa subsistance matérielle et morale. La terre avec ses innombrables variétés de minéraux, de végétaux et d'animaux, ses océans, ses montagnes, son humus fertile, l'atmosphère qui l'environne, les effluves de chaleur et de lumière qui alimentent la vie à sa surface, voilà le fonds abondant que la providence a mis au service de l'humanité. Mais ni les éléments divers qui composent ce fonds naturel de subsistance, ni les facultés dont l'homme dispose pour les utiliser n'ont été distribués d'une manière égale et uniforme. Chacune des régions du globe a sa constitution géologique particulière: ici s'étendent d'immenses couches de charbon, de fer, de plomb, de cuivre; là gisent l'or. l'argent, le platine, les pierres précieuses. Même diversité dans la distribution des espèces végétales et animales, le soleil qui échauffe et qui éclaire inégalement la terre, qui prodigue dans certaines zones la chaleur et la lumière, tandis qu'il abandonne les autres à la frigidité et à l'ombre, marque à chaque espèce les limites qu'elle ne peut franchir. Même diversité dans la répartition des facultés humaines. Un court examen suffit pour démontrer que tous les peuples n'ont pas été pourvus des mêmes aptitudes; que les Français, les Anglais, les Allemands, les Russes, les Chinois. les Indous, les Nègres ont leur génie particulier, provenant soit de la race, soit des circonstances naturelles du sol ou du climat; que les forces physiques, intellectuelles et morales de l'homme varient selon les races, les peuples et les familles: qu'il n'y a pas dans le monde deux individus dont les capacités soient égales et les aptitudes semblables. Diversité et inégalité des éléments de la production dans les différentes régions du globle; diversité et inégalité non moins prononcées des aptitudes, parmi les hommes; tel est le spectacle que nous présente la création.
De cet arrangement naturel des choses nait la nécessité des échanges. Aucune région du globe ne pouvant devenir le foyer de l'universalité des industries: au cun individu ne pouvant produire isolément l'ensemble des choses nécessaires à la satisfaction de ses besoins, que font les hommes? Les moins heureusement doués, ceux qui forment comme la transition entre l'espèce humaine et les autres espèces animales, se contentent des produits qu'ils peuvent façonner eux-mêmes et dont ils ont les matériaux sous la main. Ceux-ci demeurent plongés dans la primitive barbarie, et ils se trouvent incessamment soumis aux privations les plus dures. Mais les plus intelligents s'avisent d'un procédé qui met bientôt à leur service les ressources de la création tout entière. Au lieu de produire indifféremment toutes choses, chacun s'applique à celles que ses aptitudes particulières et la nature des matériaux dont il dispose lui permettent de produire avec facilité, et les échange contre les choses qu'il produit difficilement ou qu'il est incapable de produire. Grâce à ce procédé, à la fois si simple et si fécond, chacun peut obtenir une quantité de plus en plus considérable des choses nécessaires à la satisfaction de ses besoins, étendre et améliorer indéfiniment son existence.
Le procédé de l'échange étant découvert la division du travail peut s'établir et l'industrie se perfectionner, Alors les échanges se multiplient et la sphère dans laquelle ils peuvent s'opérer s'agrandit... Le résultat de cette extension de la sphère des échanges est facile à apprécier. Si, comme l'observation l'atteste, les différents peuples de la terre sont pourvus d'aptitudes particulières, si chaque région du globe a ses productions spéciales, à mesure que s'étendra la sphère des échanges on verra chaque peuple s'adonner de préférence aux industries qui conviennent le mieux à ses aptitudes ainsi qu'à la nature de son sol et de son climat; on verra la division du travail s'étendre de plus en plus parmi les nations. Chaque industrie se placera dans les conditions les plus économiques de production et le résultat final sera que toutes les choses nécessaires a la satisfaction des besoins de l'homme pourront être obtenues avec un maximum d'abondance et en échange d'un minimum de peine (a).
(a)dictionnaire de l'économie politique. Art. Liberté du commerce.
[20] Nous n'avons pas de données positives sur la valeur du commerce des états civilisés dans l'antiquité et au moyen âge. C'est seulement au commencement du dix-septième siècle qu'apparaissent, en Angleterre, les premiers rudiments d'une statistique commerciale. En 1613 la valeur officielle des importations de l'Angleterre et du pays de Galles ne dépassait pas 2,141,151 liv. sterl et celle des exportations 2,487,435 liv. sterl. Un peu plus d'un siècle après, en 1720, les importations étaient de 6,090,000 liv. sterl, et les exportations de 6,910,000 liv. sterl.: en 1765, année où Watt prit son brevet pour la machine a vapeur, les importations s'élevaient à 11,812,000 liv. sterl., et les exportations à 15,763,000 liv. sterl. Trente-cinq ans plus tard, en 1800, elles avaient triple: les importations montent à 30,570,000 liv. sterl., les exportations a 43,152,000 liv. sterl. Le régime prohibitif et la guerre continentale les maintiennent pendant une vingtaine d'années dans un état presque stationnaire, et ce n'est qu'au bout de quarante ans qu'elles se trouvent doublées. En 1840, les importations du Royaume-Unis sont de 67,492,000 liv. sterl., et les exportations, transit compris, de 116,480,00 liv. sterl. Mais, à dater de cette époque, sous l'influence du développement de voies de communication perfectionnées et du free trade, elles reçoivent une impulsion extraordinaire; en 1850, les importations atteignent 100,460,000 liv. sterl., et les exportations 93,251,000 liv. sterl. Enfin, en 1875, cent dix ans, après la prise du brevet de Watt, les importations s'élèvent à 373,941,325 liv. sterl. et les exportations des seuls produits anglais à 223,494,370 liv. sterl., formant un énorme total de près de 15 milliards de francs. Dans les autres états civilisés, ou la grande industrie s'est implantée. en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, aux états-Unis, la progression n'a guère été moindre. Récemment, un statisticien autrichien, M. Neuman Spallart, évaluait le mouvement commercial du globe à 78 milliards 700 millions, dont 44 pour l'Europe et 10 pour l'Amérique. A ces chiffres, il conviendrait d'ajouter ceux des échanges intérieurs de chaque état, sur lesquels la statistique ne fournit que des renseignements partiels et incomplets. En prenant pour base et pour point de comparaison le commerce extérieur de l'Angleterre, dans l'année de Watt, on n'exagérera certainement pas en disant que la somme des échanges internationaux, depuis cette époque caractéristique de l'éclosion de la grande industrie, a au moins vingtuplé.
L'évolution économique du XIXe siècle, p. 52.
[21] Il n'y a personne d'accoutumé à visiter les manufactures, dit Adam Smith, à qui on n'ait fait voir une machine ingénieuse imaginée par quelque pauvre ouvrier pour abréger et faciliter sa besogne. Dans les premieres machines à vapeur, il y avait un petit garçon continuellement occupé à ouvrir et à fermer alternativement la communication entre la chaudière et le cylindre, suivant que le piston montait et descendait. I.' un de ces petits garçons, qui avait envie de jouer avec ses camarades, observa qu'en mettant un cordon au manche de la soupape qui ouvrait cette communication et en attachant ce cordon à une autre partie de la machine, cette soupape s'ouvrirait et se fermerait sans lui, et qu'il avait la liberté de jouer tout à son aise. Ainsi une des découvertes qui ont le plus contribué à perfectionner ces sortes de machines depuis leur invention est due a un enfant qui ne cherchait qu'à s'épargner de la peine.
Cependant il s'en faut de beaucoup que toutes les découvertes tendant a perfectionner les machines et les outils aient été faites par les hommes destinés à s'en servir personnellement. Un grand nombre est dû à l'industrie des constructeurs de machines, depuis que cette industrie est devenue l'objet d'une profession particulière, et quelques-unes à l'habiletè de ceux qu'on nomme savants ou théoriciens, dont la profession est de ne rien faire, mais de tout observer, et qui, par cette raison, se trouvent souvent en état de combiner les forces des choses les plus éloignées et les plus dissemblables. Dans une société avancée, les fonctions philosophiques deviennent, comme tout autre emploi, la principale ou la seule occupation d'une classe particulière de citoyens. Cette occupation, comme toute autre, est ainsi subdivisée en un grand nombre de branches différentes, dont chacune occupe une classe particulière de savants, et cette subdivision du travail, dans les sciences comme en toute autre chose, tend à accroitre l'habileté et à épargner du temps. Chaque individu acquiert beaucoup plus d'expérience et d'aptitude dans la branche particulière qu'il a adoptée; il y a, au total, plus de travail accompli, et la somme des connaissances en est considérablement augmentée.
Adam Smith. Richesse Des Nations. Liv. I. chap. I. Division du travail.
[22] Voir pour le développement des arguments relatifs à cette question, l'article sur la Propriété des inventions dans le Journal des économistes de septembre 1855 et janvier 1856, reproduit dans les Questions d'économie politique et de droit public. T. II, p. 339. Voir aussi l'article: Propriété littéraire et artistique dans le Dictionnaire de l'économie politique 1853.
[23] L'évolution économique du XIXe siècle. Chap. Ier p. 5.
[24] Voir notre Cours d'économie politique. T. II, première leçon. Les poids et mesures.
[25] L'évolution économique du XIXe siècle. Chap. II, p. 34.
[26] Nous n'avons pas à signaler ici les progrès dont la constitution des sociétés impersonnelles à capital mobilisable nous parait susceptible. On pourrait démontrer aisément que cette constitution pêche contre la loi de l'économie des forces, et notamment que le gouvernement de ces sociétés devrait appartenir a leurs fondateurs, sous le contrôle des délégués des actionnaires, au lieu d'être nominalement issu d'une assemblée prétendue générale dont les fondateurs sont exclus ou ne figurent qu'à titre d'actionnaires.
[27] Le mouvement socialiste. Deuxième partie. La pacification des rapports du capital et du travail. Chap. Ier, p. 213.
[28] L'évolution politique et la Révolution, chap. VII. p. 207.
[29] Comme tous les autres progrès, ceux de l'industrie de la guerre ont eu pour résultat de diminuer le prix de revient du produit spécial de cette industrie, savoir de la puissance destructive ou, ce qui revient au même, d'accroitre cette puissance dans une proportion plus forte que son prix de revient. Comparez les effets destructeurs de l'obus à la dynamite à ceux de l'ancienne bombe, et vous trouverez qu'ils dépassent sensiblement les frais de production de cet instrument perfectionné de destruction comparés à ceux de l'instrument qu'il a remplacé.
Mais si le progrès a diminué les frais de production de la puissance destructive, en revanche il est devenu nécessaire dans les guerres modernes, au moins entre les peuples civilisés, d'en dépenser une somme incomparablement plus considérable que celle qui était dépensée dans les guerres d'autrefois. En supposant que cette somme ait décuplé, et que les frais de production de la puissance destructive aient diminué seulement de moitié ou même des trois quarts, on s'explique l'augmentation progressive du coût des guerres modernes, Cette augmentation ne provient pas, comme on le suppose généralement, de ce que la puissance destructive revient plus cher, elle provient de la nécessité d'en employer davantage.
[30] Voir les Questions d'économie politique et de droit public. Progrès réalisés dans les usages de la guerre. t. II. page 277.
[31] Voir la Morale économique. Appendice. Projet d'association pour l'établissement d'une Ligue des neutres.
[32] Voir Les lois naturelles. L'abolition de la servitude politique. p. 238.
[33] Une demonstration détaillée de l'infériorité des services publics compares aux services privés, sous le double rapport de la qualité et du prix, exigerait a elle seule un ouvrage spécial. Nous avons esquisse cette démonstration dans les Soirées de la rue Saint-Lazare, et nous n'avons cessé de la poursuivre, depuis plus de quarante ans dans la série de nos publications. Avons-nous besoin d'ajouter qu'elle a éte un des principaux objets des travaux de la plupart des économistes dignes de ce nom, Adam Smith. J. B. Say. Ch. Dunoyer, Bastiat, Joseph Garnier. Tous ont été d'accord pour combattre l'extension des attributions de l'état. Leurs successeurs ont suivi leurs traces, et c'est le mérite des économistes français d'avoir résisté résolument au socialisme d'état, aujourd'hui prédominant en Allemagne, en Italie, aux états-Unis, et propagé en Angleterre par l'école de Stuart Mill.
Nous nous bornerons à signaler sur la question générale des attributions de l'état, le Traite d'économie politique, de M. Courcelle Seneuil, les Leçons d'économie politique, de M. Frédéric Passy. les Progrès de la science économique, de M. Maurice Block, le Manuel d'économie politique, de M. H. Baudrillart, le Traité d'économie politique, de Charles Lehardy de Beaulieu, l'état moderne et ses fonctions, de M. Paul Leroy Beaulieu, le Socialisme d'état de M. Léon Say. — Sur la question spéciale de l'Enseignement, les Lettres sur l'enseignement des colleges, de Ch. Clavel, les articles de M. Rouxel dans le Journal des économistes. Sur l'intervention du gouvernement en matière de crédit: Le crédit et les banques, de Ch. Coquelin, la Liberté des banques, de Horn, l'Histoire des banques en France, de M. A. Courtois. la Monnaie, le credit et l'impôt, de M. G. du Puynode, etc., etc.
[34] L'analyse de la formation du prix courant donne l'explication de ce phénomène. Le prix courant est déterminé par l'intensité respective des besoins de vendre et d'acheter. Le besoin le plus intense augmente dans une proportion plus forte que le moins intense la quantité qu'il offre à l'échange, et c'est au moment où les deux quantités réciproquement offertes se font équilibre, ou elles représentent inversement une somme égale d'utilité, que l'échange s'opère. Mais deux cas peuvent se présenter: le marché peut être limité ou illimité. Dans le premier cas, c'est l'inégale intensité des besoins des échangistes en présence qui décide du prix, après un débat ou » marchandage « dans lequel chacun s'efforce de dissimuler l'intensité de son besoin de vendre ou d'acheter, — débat qui se prolonge plus ou moins longtemps, selon le degré de ténacité des échangistes, et la valeur qu'ils attachent à leur temps, selon encore qu'ils appréhendent plus ou moins l'intervention d'un concurrent dont le besoin de vendre soit moins intense ou le besoin d'acheter plus intense que le leur. Dans un marché limité ou la concurrence est entravée par des obstacles naturels ou artificiels, la probabilité de cette intervention est d'autant plus réduite que la concurrence est plus restreinte. Dans un marché illimité, au contraire, où la concurrence est libre d'entraves, où l'apport des produits à l'échange ne rencontre point d'obstacles, cette probabilité est constante, et n'a d'autre limite que celle des quantités disponibles; l'intensité inégale des besoins disparait, le prix se fixe d'après l'estimation des quantités qui peuvent être offertes d'une part, demandées de l'autre. Cette estimation faite, le prix du marché s'établit, et il fait loi dans tous les échanges qui s'opèrent sur le marché, en supprimant tout débat, tout marchandage. C'est ainsi que le prix du marché général détermine dans toute l'étendue de ce marché le taux de l'intérêt des capitaux, le prix des céréales, des cotons, des laines et des autres articles suffisamment « mobilisables. »
[35] Ce serait une histoire intéressante à faire que celle des perturbations et des maux causés par le monopole de la fabrication de la monnaie que s'est attribué l'état. Sous l'ancien régime, les gouvernements usaient habituellement de ce monopole pour falsifier la monnaie métallique. Si les gouvernements modernes ont abandonné ce procédé peu scrupuleux, c'est uniquement parce qu'ils l'ont remplacé d'une manière a la fois plus profitable pour eux, et plus onéreuse aux populations, par l'émission et la surémission du papier-monnaie. On pourrait ajouter que l'état arriéré de la machinery de la circulation monétaire a principalement pour cause l'intervention des gouvernements dans la fabrication de la monnaie, et l'établissement de l'étalon monétaire. Voir à ce sujet, Cours d'économie politique, t. II, sixième leçon, le nouveau régime monétaire, et dixième leçon, les intermédiaires du Credit.
[36] Voir Le mouvement socialiste. Les grèves et les Trade's Unions. p. 242.
[37] Cours d'économie politique, t. Ier. dixieme leçon, la Part du travail.
[38] Voir pour de plus amples développements sur les causes qui ralentissent les progrès du commerce du travail, et qui sont en voie de stériliser l'établissement des Bourses du travail: Les Soirées de la rue Saint-Lazare, 6° soirée. les Questions d'économie politique et de droit public; la Publicité du travail, t. Ier, p. 183; le mouvement socialiste; le Commerce du travail, chap. IV. p. 330; l'évolution économique du XIXe siècle, p. 330, les Lois naturelles, la Guerre civile du capital et du travail. Appendice, le Journal des économistes, septembre, 1888. la Bourse du travail, etc. etc.
Ajoutons que l'on commence à voir se dessiner chez les entrepreneurs d'industrie menacés par des grèves organisées sur un plan de plus en plus vaste, une tendance à abandonner le vieux procédé du lockout ou de la suppression générale du travail pour le procédé autrement efficace de la concurrence aux trade's unions et aux autres associations ouvrières, par la concession d'avantages que celles-ci sont hors d'état d'accorder à leurs membres.
Voici ce que nous lisons à ce sujet dans l'Indépendance belge du 16 avril.
« Vif émoi dans le monde ouvrier et socialiste, sur la nouvelle que la redoutable Fédération des armateurs (Shipping Federation) formée entre patrons pour résister à la Ligue des matelots, ouvriers des docks, etc., prépare, depuis quelques jours, une mesure destinée à exercer le rôle d'un violent élément dissolvant parmi les unions ouvrières. Il s'agit d'un projet aux termes duquel la Fédération accorderait à peu pres gratuitement une assurance sur la vie et contre les accidents à tous les marins non affiliés aux ligues d'ouvriers et qui servent librement sur les navires de la Fédération. Lesdits marins payent un droit d'un shelling pour leur livret d'inscription comme employés de la Fédération des armateurs. Désormais ce livret représenterait, sans frais supplémentaire, une assurance de 25 livres sterling (625 fr.) payable, en cas de mort du matelot, à celui de ses héritiers qu'il aurait désigné d'avance, ou payable a lui-même, en cas d'accident.
De plus, si le marin désire s'assurer pour une somme supérieure a 25 livres, il le pourra moyennant une prime extrêmement minime, la Federation des armateurs ayant obtenu des grandes compagnies d'assurances des conditions très avantageuses; en outre elle mettra de sa poche tout ce qu'il faudra pour réduire à presque rien la charge que s'imposera le marin, du fait de l'assurance. Vous devinez l'effet probable d'une pareille combinaison: alléchés par ce gâteau de l'assurance, des milliers de marins rompront apparement avec les ligues ouvrières pour passer à la Fédération des patrons; et les coalitions grévistes deviendront à peu près impossibles. »
C'est un premier pas dans une voie nouvelle. Que des grèves internationales viennent à éclater, en vertu d'un décret des congrès ouvriers, les entrepreneurs et les capitalistes leurs associes ou leurs commanditaires, iront plus avant dans cette voie. Ils s'apercevront de quel secours leur serait et quelle économie pourraient leur procurer des intermédiaires bien pourvus de capitaux qui feraient concurrence aux associations ouvrières pour le placement du travail et se chargeraient même d'une partie des opérations dévolues aux capitaux d'exécution, en déterminant, par ce progrès, un abaissement des frais de la production (a). Sans doute, les entrepreneurs d'industrie ne pourraient plus alors profiter de l'inégalité de situation qui leur permettait, trop souvent, d'abaisser à leur gré le salaire et d'augmenter la durée de la journée, mais cette inégalité va s'effaçant de jour en jour, pendant que l'absence ou l'insuffisance des intermédiaires les expose à subir le dommage des coalitions et des grèves. Que des sociétés puissantes, analogues à celles dont nous avons esquissé le type et les fonctions (b) se constituent; qu'elles se substituent, par la voie de la concurrence, aux trade's unions et aux autres associations ouvrières, que le prix du travail se fixe d'une manière impersonnelle sur un marché devenu illimité par l'opération de ce rouage nécessaire, et la guerre civile du capital et du travail prendra fin, au double avantage des entrepreneurs et des ouvriers sans parler des consommateurs.
(a) Lois naturelles, p. 295.
(b) Ibid.
[39] Voir, pour les développements de cette partie du programme, la Morale économique.
[40] Voir les Lois naturelles. Appendice, Projet d'une Societé a bénéfices limites, etc., p. 307.
[41] Arriver! Voilà toute la question. C'était déjà l'avis des grands révolutionnaires qui ont frayé la voix aux socialistes. Témoin cette jolie anecdote, empruntée aux Souvenirs de M. de Barante.
M. de Barante attendait un matin dans l'antichambre du ministre de l'Intérieur, et il y avait quelqu'un dans le cabinet du Ministre qui prolongeait beaucoup son audience. Fouché s'en excusa en faisant entrer le jeune préfet, puis il lui dit
« Savez-vous avec qui j'étais? Avec mon ami Thibaudeau. Imaginez-vous que j'ai dû remettre la tête à cet imbécile! N'était-il pas inquiet, désespéré du mariage de l'Empereur avec une archiduchesse d'Autriche? Une nièce de Marie-Antoinette, arrivant à Paris pour être impératrice! Il ne se faisait pas à cette idée! Comment se présenter devant elle? Comment aller désormais à la cour? Est-ce donc pour en venir là que nous avons fait la Révolution?
— Eh bien! oui, ai-je répondu, tu as voté la mort du roi et moi aussi. Que veux-tu? Ce n'était pas ta faute ni la mienne, la France avait la fièvre chaude. Dans de telles époques, on ne sait ce qu'on fait. On est entraîné par le courant. Et puis, les événements se sont calmés, l'ordre a été rétabli. Tu ne t'en es pas trouve trop mal, tu ne veux plus de révolution et, à présent, tu souhaites que les choses restent comme elles sont. Qu'est-ce qui peut mieux assurer leur durée que ce mariage de l'Empereur? Crois-tu que cette archiduchesse va nous ramener l'ancien régime? Est-ce possible? Avons-nous sollicité humblement ce mariage? Notre nouvelle impératrice arrivera-t-elle fiére, dédaigneuse, avec les rancunes du passé? pas du tout: elle est très honorée d'avoir été choisie par l'Empereur, elle ne se jouera pas à contrarier en rien son gouvernement et sa politique. Elle est niece de Marie-Antoinette ... Qu'importe! elle sera peut-être aimable et charmante comme était sa tante. oui, certainement, Marie-Antoinette était tout cela; on l'a calomniée, on a beaucoup crié contre elle et nous tous les premiers. C'est tout simple. Nous étions au parterre, debout, mécontents, tapageurs. A present nous voila bien assis, en premieres loges... et nous applaudissons. »
[42] C'est par ce procédé qu'à été préparée la plus grande réforme, et on pourrait dire même la seule réforme vraiment progressive qui ait été accomplie depuis un siècle, celle qui a aboli les lois-céréales, et mis fin au régime protecteur en Angleterre. Se tenant en dehors du gouvernement et des partis politiques, les promoteurs du free trade ont converti l'opinion à leur cause, d'abord en employant comme instruments de propagande, l'association, la parole et la presse, ensuite, en se servant de la pression de l'opinion convertie pour surmonter l'opposition des intérêts particuliers représentés dans le parlement, Les résultats de la réforme, ainsi préparée et accomplie, ayant été conformes à leurs prévisions, l'opinion lui est demeuré fidèle et l'a rendue définitive. En France, où ce travail d'éducation et de conversion n'a pas été fait, où les promoteurs de la réforme se sont bornés à gagner l'opinion du souverain du jour, elle n'a pu résister, — le souverain disparu, — à l'assaut des intérêts particuliers en majorité dans le parlement, et elle sera, selon toute apparence, emportée par la réaction protectionniste.
[43] Voir à ce sujet un compte détaillé des impôts que paie une famille d'artisans italiens à l'état, à la province, à la commune et aux industries protégées, dressé par M. Vilfredo Pareto. (Lettre d'Italie, Journal des économistes, septembre, 1890.)
Est-il nécessaire de dire que les renseignements de ce genre ne se rencontrent point dans les statistiques officielles si prodigues cependant de publications volumineuses, qui vont s'entassant dans les greniers des ministères,
Puis de là tout poudreux, ignorés sur la terre
Suivre chez l'épicier Neuf-Germain et la Serre
Ou, de trente feuillets réduits peut-être à neuf,
Parer, demi-rongés, les rebords du pont-neuf.
[44] Ces attributions sont définies et délimitées dans les Lois naturelles, 4e partie. La servitude politique.
[45] Cours d'économie politique, t. II. Septième leçon. Le papier-monnaie.
[46] Cette œuvre d'education de l'opinion peut être accomplie à la fois par la propagande individuelle et la propagande collective. On sait quels services le Cobden Club a déjà rendus et rend encore tous les jours à la cause du libre-échange. On pourrait fonder une association analogue, en lui assignant pour objectif la réalisation du « programme économique », et en définir ainsi le but et le mode d'action:
Art. 1er. — Il est fondé sous la dénomination d'Association cosmopolite, une association d'éducation et de propagande, ayant pour objet la réalisation des réformes qui constituent le Programme économique.
Art. 2. — Cette association s'occupera, en premier lieu, de propager la connaissance de l'économie politique, en s'appliquant à mettre cette science à la portée du grand nombre, en second lieu, elle instituera une enquête permanente destinée à mettre en lumière les effets nuisibles des lois, règlements et pratiques en opposition avec les lois naturelles ainsi que les effets utiles des réformes qui les en rapprochent.
Art. 3. — Elle s'abstiendra d'intervenir dans les luttes révolutionnaires ou constitutionnelles pour la conquête du gouvernement, et imposera à ses membres l'obligation de se tenir en dehors des partis politiques.
Art. 4. — Elle respectera complètement les lois établies, dussent ces lois faire obstacle à sa propagande, jusqu'à ce que la pression de l'opinion en ait déterminé la réforme.
[47] Troisfème partie, chap. 1er, p. 359.
[48] Journal des économistes; nos. de décembre 1889 et janvier 1890.
[49] Dictionnaire de l'économie politique. Art. Esclavage.
[50] Dictionnaire de l'économie politique. Art. Esclavage.
[51] En recueillant les données éparses, en rapprochant les faits, on arrive à cette conclusion qu'il y a annuellement ou qu'il y a eu en certaines années une exportation de 70,000 ou 80,000 personnes. Dans ce nombre ne sont pas compris tous ceux qui ont succombé avant d'arriver au marché, et il y a des routes où les victimes sont si nombreuses qu'on peut suivre les traces des caravanes aux cadavres laissés derrière elles. Si on veut y joindre les hommes qui se sont fait tuer en défendant leur liberté et ceux qui sont allés avec leur famille périr de misère au milieu des marais et des déserts, on arrivera à un chiffre effrayant. Sur certains points, d'après le témoignage d'un voyageur, l'esclavage ne représente qu'un cinquième et, sur d'autres points, un dixième de la population anéantie par cette chasse. Ainsi à côté des 70,000 malheureux qui partent chaque année pour l'exil le plus affreux, il y a, chaque année aussi, de trois à quatre cent mille morts qui restent sur le champ de bataille de la traite. (La Traite orientale, par E. P. Berlioux, p. 8)
[52] Le trafic du haut Nil est le plus intéressant pour nous, parce que les hommes qui le font, en déguisant leur brigandage sous les apparences d'un commerce régulier, appartiennent aux nations les plus civilisées de l'Europe. Il y a là non seulement les égyptiens ou des Tures, mais encore des Autrichiens, des Italiens, des Anglais et des Français. Id., p. 14.
[53] La Traite orientale, p. 312.
[54] Aujourd'hui, et par suite de la suppression de l'esclavage des blancs capturés autrefois par des pirates dans le bassin de la Méditerranée, et de celui des habitants du Caucase et de l'Asie, due à l'initiative persévérante de la Russie, les esclaves noirs et, par conséquent, la traite africaine, ont augmenté depuis plus d'un demi-siècle et, sur certains points, augmentent encore.
J'en ai donné souvent les preuves par les récits des explorateurs et des missionnaires, par les chiffres effroyables qu'ils ont cités et enfin, pour une époque plus voisine encore, car il s'agit de l'année 1888, par les témoignages officiels des agents anglais chargés de la surveillance de l'esclavage dans la Turquie, l'Égypte, la mer Rouge et l'océan Indien.
Je n'ai pas parlé ainsi par oui-dire, lit-on dans le rapport de l'un d'entre eux, mais par une conviction personnelle acquise sur les lieux, à Djeddah. Lorsque j'arrivai dans cette ville, comme le paquebot s'y arrête huit heures, je résolus de profiter de cette circonstance pour voir comment les choses se passaient là, et j'envoyai un de mes officiers voir s'il pourrait acheter un esclave. Il demanda, comme par hasard, au batelier qui l'avait conduit à terre quel était l'endroit ou il trouverait le plus facilement à acheter un esclave. Le batelier offrit de le conduire aux maisons du principal marchand.
Lorsqu'il fut connu qu'il désirait un esclave, plusieurs vinrent à lui dans la rue et lui offrirent de le conduire dans quelques autres maisons de marchands, où il trouva des esclaves nègres et abyssins, au nombre de six à quatorze dans chaque maison. Pour montrer comment tout cela se fait ouvertement, il me suffira de dire qu'il était accompagné par un officier égyptien en uniforme, et par un sergent-major de mon département, également en uniforme. Il m'aurait été également très facile d'entrer dans ces maisons, mais je préférai ne pas le faire, ear si j'avais été reconnu, on aurait probablement fait quelque désordre, sous prétexte qu'un chrétien entrait dans une maison musulmane.
Plus loin:
« Les esclaves sont introduits avec la complicité des autorités, qui reçoivent, je m'en suis assuré, un dollar par tête. Les marchands ont un nombre considérable d'esclaves, et on n'en a jamais vu, jusqu'lei, une pareille abondance sur le marché Djeddah. Les prix sont aussi bons, variant de 80 à 300 dollars, et davantage dans certains cas.
Un certain nombre de ces esclaves demeurent à Djeddah après leur vente; mais un plus grand nombre vont à la Mecque, d'où ils sont conduits, avec les caravanes de pèlerins, en Perse, à Bagdad et en Syrie ». (Lettre de Mgr Lavigerie.)
[55] La Traite orientate, p. 279 et 312.
[56] La Traite orientale, p. 295.
[57] Ce qu'll faudrait, ce serait aider, moralement et matériellement, dans la mesure du possible, les états musulmans qui ont des traités avec les puissances européennes à s'opposer au passage et à la vente publique des esclaves procurés par la traite. On ne peut en empêcher la continuation qu'en opposant des barrières sur terre par l'entretien de petits corps armés suffisants pour mettre obstacle au passage des caravanes, comme le demandait Gordon pour l'Égypte, et comme je l'al proposé moi-même en Belgique pour le haut Congo; et, sur mer, par des croisières pour arrêter les boutres chargés de la marchandise impie. (Lettre de Mgr. le cardinal Lavigerie à S. M. le roi Lépold II.)
[58] L'état social de l'Afrique indigène étant fondé sur l'esclavage depuis des siècles, tout se trouverait jeté dans le chaos si on abolissait ainsi, en un jour, une organisation lamentable sans doute, mais cependant préférable au chaos (Lettre de Mgr. Lavigerie à S. M. le roi Léopold II.)
[59] émile Daircaux. La vie et les mœurs à la Plata. Livre III, chap. II.