
Vilfredo Pareto, TraitÉ de sociologie gÉnÉrale, vol. 2a (texte) (1919)
 |
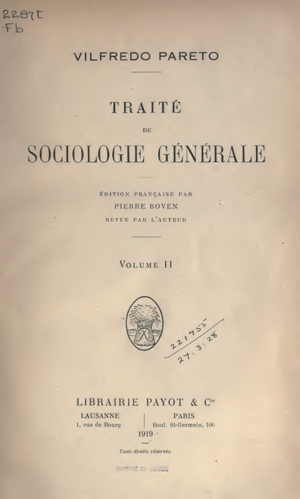 |
| Vilfredo Pareto (1848-1923) |
[Created: 31 Aug. 2022]
[Updated: November 30, 2022 ] |
Source
Pareto's Treatise was originally published in Italian in 1916, and then in a revised edition in French in 1917. It was later translated into English in 1935.
Vilfredo Pareto, Traité de sociologie générale. Édition française par Pierre Boven. Revue par l’auteur. Volume I (Paris: Librairie Payot, 1917). Volume II (Paris: Librairie Payot, 1919).
Editor's note: Because of the text's length and complexity I have split it into 5 separate files (see the main page for details):
- vol. 1 (1917) in facs. PDF and HTML [vol. 1a text only and vol. 1b endnotes]
- vol. 2 (1919) in facs. PDF and HTML [vol. 2a text only and vol. 2b endnotes]
- my vol. 3 - tables and supplementary material
Table des matières
Volume 2a (le texte) [this file]
TABLE DES CHAPITRES - DEUXIÈME VOLUME
Les chapitres
- Chapitre IX. – Les dérivations (§1397 à §1542), vol. 2, pp. 785-886
- Chapitre X – Les dérivations (suite) Examen de la IVe classe.(§1543 à §1686), vol. 2, pp. 887-1009
- Chapitre XI. – Propriétés des résidus et des dérivations (§1687 à §2059), vol. 2, pp. 1010-1305
- Chapitre XII. – Forme générale de la société (§2060 à §2411), vol. 2, pp. 1306-1600
- Chapitre XIII. – L’équilibre social dans l’histoire (§2412 à §2612), vol. 2, pp. 1601-1761
Volume 2b (les notes) [a separate file]
- Notes du Chapitre IX. – Les dérivations (§1397 à §1542), vol. 2, pp. 785-886
- Notes du Chapitre X – Les dérivations (suite) Examen de la IVe classe. (§1543 à §1686), vol. 2, pp. 887-1009
- Notes du Chapitre XI. – Propriétés des résidus et des dérivations (§1687 à §2059), vol. 2, pp. 1010-1305
- Notes du Chapitre XII. – Forme générale de la société (§2060 à §2411), vol. 2, pp. 1306-1600
- Notes du Chapitre XIII. – L’équilibre social dans l’histoire (§2412 à §2612), vol. 2, pp. 1601-1761
TABLE DES CHAPITRES
DEUXIÈME VOLUME
Chapitre IX. – Les dÉrivations (§1397 à §1542) ... 785
Les hommes se laissent persuader surtout par les sentiments (résidus). - Comment les dérivations se développent. - Les dérivations constituent le matériel employé tant dans les recherches non logico- expérimentales que dans les recherches logico-expérimentales ; mais les premières supposent aux dérivations le pouvoir d'agir directement sur la constitution sociale, tandis que les secondes les tiennent uniquement pour des manifestations des forces ainsi agissantes ; elles recherchent, par conséquent, les forces auxquelles correspondent, plus ou moins rigoureusement, les dérivations. - La part que nous attribuons ici au sentiment a été reconnue, bien qu'assez peu distinctement, par plusieurs des auteurs qui ont étudié les sociétés humaines. - La logique des sentiments. - La démonstration des dérivations n'est très souvent pas le motif qui les fait accepter. - Classification des dérivations. - Examen des I-, IIe et IIIe classes.
Chapitre X – Les dÉrivations (suite) (§1543 à §1686) ... 887
Examen de la IVe classe.
Chapitre XI. – PropriÉtÉs des rÉsidus et des dÉrivations (§1687 à §2059) ... 1010
Deux problèmes se posent : Comment agissent les résidus et les dérivations ? Dans quel rapport cette action se trouve-t-elle avec l'utilité sociale ? - Les raisonnements vulgaires soutiennent que les dérivations sont la cause des actions humaines, et parfois aussi des sentiments ; tandis que fort souvent les dérivations sont au contraire un effet des sentiments et des actions. - Les résidus en rapport avec les êtres concrets auxquels ils appartiennent. - Répartition et changements dans l'ensemble d'une société. - Les classes des résidus sont peu variables, les genres en sont beaucoup plus variables. - Formes et oscillations du phénomène. -Rapport entre les résidus et les conditions de la vie. - Action réciproque des résidus et des dérivations. - Influence des résidus sur les résidus. Influence des résidus correspondant à un même ensemble de sentiments. Influence des dérivations sur les résidus. - Considération des différentes classes sociales. - Les grands journaux. - Souvent nous nous imaginons que les dérivations sont transformées en résidus, tandis que c'est le contraire qui se produit. - Influence des dérivations sur les dérivations. - Rapport des résidus et des dérivations avec les autres faits sociaux. - Comment le désaccord entre les résidus et les principes logico-expérimentaux agit sur les conclusions. - Exemples. - Dans les matières non logico-expérimentales, le fait de raisonner en toute rigueur logique peut conduire à des conclusions ne concordant pas avec les faits, et le fait de raisonner avec une logique très défectueuse, en se laissant guider par le sentiment, peut conduire à des conclusions qui se rapprochent beaucoup plus des faits. - Différences entre la pratique et la théorie. - Comment des dérivations indéterminées s'adaptent à certaines fins (buts). - Exemples. - Mesures prises pour atteindre un but. - L'action exercée sur les dérivations a d'habitude peu ou point d'efficacité pour modifier les résidus. - Comment les mesures sociales sont acceptées. - Les mythes et, en général, les fins idéales. - Les fins idéales et leurs rapports avec les autres faits sociaux. - Classification des problèmes auxquels donnent lieu ces rapports. - Examen de ces problèmes. - Rapport entre le fait d'observer les règles de la religion et de la morale, et le fait de réaliser son propre bonheur. - Classification des solutions de ce problème. - Examen de ces solutions. - L'étude ainsi accomplie fournit un exemple de la vanité expérimentale de certaines doctrines fondées sur une prétendue grande utilité sociale. - Propagation des résidus. - Propagation des dérivations. - Les intérêts. - Le phénomène économique. - L'économie pure. - L'économie appliquée. - Plutôt que de déduire les théories de l'économie, il faut y faire des adjonctions. - Hétérogénéité sociale et circulation entre les diverses parties de la société. - Les élites de la population et leur circulation. - La classe supérieure et la classe inférieure, en général.
Chapitre XII. – Forme gÉnÉrale de la sociÉtÉ (§2060 à §2411) ... 1306
Les éléments et leurs catégories. - L'état d'équilibre. - Organisation du système social. - Composition des résidus et des dérivations. - Divers genres de mutuelle dépendance. - Comment on en peut tenir compte en sociologie. - Les propriétés du système social. - L'utilité et ses différents genres. - Maximum d'utilité d'un individu ou d'une collectivité. - Maximum d'utilité pour une collectivité. - Résidus et dérivations en rapport avec l'utilité. - Presque tous les raisonnements dont on use en matière sociale sont des dérivations. - Exemples. - Composition des utilités, des résidus et des dérivations. - L'histoire. - L'emploi de la force dans la société. - La classe gouvernante et la classe gouvernée en rapport avec l'emploi de la ruse et l'emploi de la force. - Comment la classe gouvernante s'efforce d'organiser sa défense. - La stabilité et la variabilité des sociétés. - Les cycles de mutuelle dépendance des phénomènes sociaux. - Le protectionnisme. - Divers genres de capitalistes. - Les spéculateurs et les rentiers. - Le régime politique. - La démocratie. - L'influence des gouvernements est d'autant plus efficace qu'ils savent mieux se servir des résidus existants ; elle est très souvent vaine, lorsqu'ils s'efforcent de les modifier. - Le consentement et la force sont le fondement des gouvernements. - Les gouvernements modernes. - La ploutocratie démagogique. - Dépenses pour consolider les divers régimes politiques. - Les partis politiques. - Les diverses proportions des résidus de la Ie classe et de ceux de la IIe chez les gouvernants et chez les gouvernés. - Les résultats économiques des différents régimes politiques. - Gouvernements qui font usage principalement de la force. - Gouvernements qui font usage principalement de la ruse. - Combinaisons de divers types. - Périodes économiques et périodes sociales. - Forme ondulatoire des phénomènes. - Oscillations des dérivations en rapport avec les oscillations sociales. - Erreurs habituelles qu'on commet en voulant les provoquer à dessein. - Mutuelle dépendance des oscillations. - Exemples. - L'ensemble social.
Chapitre XIII. – L’Équilibre social dans l’histoire (§2412 à §2612)... 1601
La proportion des résidus de la Ie classe et de ceux de la IIe, considérée comme l'un des facteurs principaux de l'équilibre social. - Indices de l'utilité sociale. - Exemples divers. - L'équilibre des diverses couches sociales. - Comment les moyens employés pour le conserver agissent sur la proportion des résidus de la Ie classe et de la IIe, par conséquent sur l'équilibre social. - Exemples divers. - Étude de l'évolution sociale à Rome. - Analogies avec l'évolution de nos sociétés. - Comment la souplesse et la cristallisation des sociétés sont des phénomènes qui se succèdent mutuellement. - C'est là un cas particulier de la loi générale des phénomènes sociaux, qui ont une forme, ondulatoire.
[785]
Chapitre IX↩
Les dérivations
§ 1397. Dans ce chapitre, nous nous occuperons des dérivations, telles qu'elles ont été définies au § 868 ; et puisqu'elles renferment la raison pour laquelle certaines théories sont produites et acceptées, nous étudierons les théories au point de vue subjectif indiqué au § 13. Souvent déjà, nous avons rencontré des dérivations, bien que nous n'ayons pas encore fait usage de ce terme, et l'on en trouvera chaque fois qu'on fixera son attention sur les façons dont les hommes tâchent de dissimuler, de changer, d'expliquer les caractères qu'ont en réalité certaines de leurs manières d'agir. C'est ainsi qu'au chapitre III, nous avons traité longuement des raisonnements, qui sont des dérivations par lesquelles on tâche de faire apparaître logiques les actions non-logiques ; et nous avons alors classé certaines dérivations considérées sous cet aspect. Nous en avons rencontré d'autres, envisagées sous d'autres aspects, aux chapitres IV et V.
Les hommes se laissent persuader surtout par les sentiments (résidus) ; par conséquent, nous pouvons prévoir, ce qui d'ailleurs est confirmé par l'expérience, que les dérivations tireront leur force, non pas de considérations logico-expérimentales, ou du moins pas exclusivement de ces considérations, mais bien des sentiments [FN: § 1397 -1]. Dans les dérivées, le noyau principal est constitué par un résidu ou par un certain nombre de résidus. Autour de ce noyau viennent se grouper d'autres résidus secondaires. Cet agrégat est créé par une force puissante, et quand il a été créé, il est maintenu uni par cette force, qui est le besoin de développements logiques ou pseudo-logiques qu'éprouve l'homme, besoin qui se manifeste par les résidus du genre (1-ε). C'est ensuite de ces résidus, avec l'aide d'autres encore, que les dérivations tirent en général leur origine.
§ 1398. Par exemple, au chapitre II, nous avons vu une catégorie étendue de dérivations qui expliquent certaines opérations sur les tempêtes ; elles naissent justement du besoin de développements logiques ou réputés tels (I-ε). Le noyau principal est constitué par les résidus de la foi en l'efficacité des combinaisons, (I-ζ) : on sent instinctivement qu'il doit y avoir un moyen quelconque d'exercer une action sur les tempêtes. Autour de ce noyau se disposent divers résidus de l'action mystérieuse de certaines choses et de certains actes ; et l'on a différentes opérations magiques. Dans ces opérations magiques interviennent, d'une manière accessoire, les résidus de choses rares et d'événements exceptionnels (I-β 2), les noms liés mystérieusement aux choses (I-γ 2), ainsi que d'autres opérations mystérieuses (I-γ 1), et même des combinaisons en général (I-α). Puis, toujours d'une manière accessoire, on fait intervenir les résidus de la IIe classe. On trouve une famille très étendue de ces résidus dans les explications que l'on donne des phénomènes, en avant recours à des personnifications (II-êta), telles que des divinités, des démons, des génies. Il est rare que, dans une catégorie de dérivations, il ne se trouve pas une famille de cette sorte.
§ 1399. Nous avons déjà traité abondamment des résidus, et il ne nous resterait d'autre chose à faire, au sujet des dérivées, que de noter les résidus principaux et les résidus accessoires. Mais nous n'aurions ainsi envisagé que le fond des dérivées, alors qu'il y a pourtant d'autres aspects sous lesquels on peut considérer les dérivations. D'abord, si l'on prête attention à la forme, il faut observer le rapport dans lequel la dérivation se trouve avec la logique ; c'est-à-dire si elle est un raisonnement correct ou un sophisme. Cette étude appartient aux traités de logique (§ 1410), et nous n'avons pas à l'entreprendre ici. Ensuite, il faut considérer le rapport dans lequel la dérivation peut être avec la réalité expérimentale. Elle peut être rigoureusement logique, et, par suite d'un défaut des prémisses, n'être pas d'accord avec l'expérience. Elle peut aussi n'être qu'apparemment logique, et, à cause du sens vague des termes, ou pour un autre motif, n'avoir aucune signification expérimentale, ou avoir une signification qui n'a qu'un lointain rapport avec l'expérience. Tel est l'aspect sous lequel nous avons envisagé les dérivations que nous avons étudiées aux chapitres III, IV et V, sans employer encore cette dénomination. Maintenant, en leur en ajoutant d'autres, nous devrons les étudier en détail, sous l'aspect subjectif de la force persuasive qu'elles peuvent avoir. Restera enfin un autre aspect sous lequel il est nécessaire de les envisager : celui de l'utilité sociale qu'elles peuvent avoir ; sujet dont nous nous occuperons au chapitre XII. En tout cas, pour avoir la théorie complète des dérivations, il faut rapprocher les chapitres III, IV et V du présent chapitre. La déduction parcourt à rebours la voie de l'induction ; par conséquent, celui qui utilise successivement ces deux voies retrouve la seconde fois sur son chemin une partie au moins des théories et des raisonnements qu'il avait rencontrés la première.
§ 1400. Il y a plusieurs critères pour classer les dérivations suivant l'aspect sous lequel on les considère (§ 1480). Puisque nous nous attachons ici au caractère subjectif des explications que l'on donne par les dérivations, de certaines actions, de certaines idées, et à la force persuasive de ces explications, nous tirerons de la nature de celles-ci le critère de notre classification. Là où n'existe pas d'explications, les dérivations font aussi défaut ; mais sitôt qu'on recourt aux explications, ou qu'on tente d'y recourir, les dérivations apparaissent. L'animal, qui ne raisonne pas, qui accomplit uniquement des actes instinctifs (§ 861), n'a pas de dérivations. Au contraire, l'homme éprouve le besoin de raisonner, et en outre d'étendre un voile sur ses instincts et sur ses sentiments ; aussi manque-t-il rarement chez lui au moins un germe de dérivations, de même que ne manquent pas les résidus. Dérivations et résidus se rencontrent chaque fois que nous étudions des théories ou des raisonnements qui ne sont pas rigoureusement logico-expérimentaux. Ainsi est-il arrivé au chapitre III (§ 325), où nous avons rencontré le type de dérivation le plus simple, qu'on trouve dans le précepte pur, sans motif ni démonstration. Il est employé par l'enfant et l'ignorant, lorsqu'ils font usage de la tautologie: « On fait ainsi parce qu'on fait ainsi »; tautologie par laquelle s'expriment simplement les résidus de la sociabilité, car, en somme, on veut dire : « Je fais ainsi, ou une autre personne fait ainsi, parce que, dans notre collectivité, on a l'habitude de faire ainsi ». Puis vient une dérivation un peu plus complexe, qui vise à donner une raison de l'habitude, et l'on dit : « On fait ainsi parce qu'on doit faire ainsi ». Ces dérivations, qui sont de simples affirmations, constitueront la première classe. Mais déjà dans la dernière des dérivations que nous venons de rapporter, une entité indéterminée et mystérieuse s'est fait entrevoir : c'est le devoir, premier indice d'un procédé général d'extension des dérivations qui, sous des noms différents, croissent avec l'invocation de divers genres de sentiments. Peu à peu, les hommes ne se contentent plus de ces noms seuls : ils veulent quelque chose de plus concret ; ils veulent aussi expliquer d'une façon quelconque pourquoi on emploie ces noms. Que peut bien être ce devoir qu'on met au jour ? Ignorants, hommes cultivés, philosophes répondent ; et, des réponses puériles du vulgaire, on va jusqu'aux théories abstruses de la métaphysique ; mais, au point de vue logico-expérimental, ces théories ne valent pas mieux que les réponses du vulgaire. On fait le premier pas en appelant à son aide l'autorité de sentences ayant cours dans la collectivité, l'autorité de certains hommes, et, par de nouvelles adjonctions, on allègue l'autorité d'êtres surnaturels ou de personnifications qui sentent et agissent comme des hommes. Ainsi, nous avons la IIe classe des dérivations. Le raisonnement acquiert de nouveaux développements, se subtilise, s'abstrait, quand on fait intervenir des interprétations de sentiments, des entités abstraites, des interprétations de la volonté d'êtres surnaturels ; ce qui peut donner une très longue chaîne de déductions logiques ou pseudo-logiques, et produire des théories qui ont quelque ressemblance avec les théories scientifiques, et parmi lesquelles nous trouvons celles de la métaphysique et de la théologie. Nous avons ainsi la IIIe classe. Mais les dérivations ne sont pas encore épuisées : il reste une classe étendue dans laquelle rentrent des preuves principalement verbales ; ce sera la IVe classe. On y trouve des explications de pure forme, qui usurpent l'apparence d'explications de fond. Ensuite (§ 1419) nous verrons comment ces classes se divisent en genres, et nous les étudierons en détail ; mais avant d'aller plus loin, il est nécessaire que nous ajoutions quelques considérations générales sur les dérivations et sur les dérivées.
§ 1401. Commençons par traduire dans le langage des résidus et des dérivations ce que nous avons exposé (§ 798-803) en nous servant de lettres alphabétiques. Dans les matières qui se rapportent à la vie des sociétés, les théories concrètes se composent de résidus et de dérivations. Les résidus sont des manifestations de sentiments. Les dérivations comprennent des raisonnements logiques, des sophismes, des manifestations de sentiments employées pour dériver ; elles sont une manifestation du besoin de raisonner qu'éprouve l'homme. Si ce besoin n'était satisfait que par les raisonnements logico-expérimentaux, il n'y aurait pas de dérivations, et à leur place, on aurait des théories logico-expérimentales. Mais le besoin de raisonnement de l'homme trouve à se satisfaire de beaucoup d'autres manières : par des raisonnements pseudo-expérimentaux, par des paroles qui excitent les sentiments, par des discours vains et inconsistants ; ainsi naissent les dérivations. Elles font défaut aux deux extrêmes : d'une part, pour les actions instinctives, d'autre part, pour les sciences rigoureusement logico-expérinientales. On les rencontre dans les cas intermédiaires.
§ 1402. Ce sont justement les raisonnements concrets correspondant à ces cas, qui sont connus directement. Ici, nous avons fait l'analyse, en séparant une partie presque constante (a) et une partie beaucoup plus variable (b) (§ 798 et sv.), auxquelles nous avons donné ensuite les noms de résidus et de dérivations (§ 868), et nous avons vu que la partie la plus importante pour l'équilibre social est celle des résidus (§ 800). Mais ainsi, nous sommes allés à l'encontre de l'opinion commune qui, dominée par l'idée des actions logiques, incline à intervertir le rapport indiqué tantôt, et à donner une plus grande importance aux dérivations (§ 415). La personne qui prend connaissance d'une dérivation croit l'accepter – ou la rejeter – par des considérations logico-expérimentales, et ne s'aperçoit pas qu'au contraire, elle est habituellement poussée par des sentiments, et que l'accord – ou l'opposition – de deux dérivations est un accord – ou une opposition – de résidus. Celui qui entreprend d'étudier les phénomènes sociaux s'arrête aux manifestations de l'activité, c'est-à-dire aux dérivations, et il ne remonte pas aux causes de l'activité elle-même, c'est-à-dire aux résidus. Il est ainsi arrivé que l'histoire des institutions sociales est devenue l'histoire des dérivations, et souvent l'histoire de dissertations sans fondement. On a cru faire l'histoire des religions en faisant l'histoire des théologies ; l'histoire des morales en faisant l'histoire des théories morales ; l'histoire des institutions politiques, en faisant l'histoire des théories politiques. En outre, comme la métaphysique a doté toutes ces théories d'éléments absolus dont on a cru tirer par la logique pure des conclusions non moins absolues, l'histoire de ces théories est devenue l'histoire des déviations de certains types idéaux existant dans l'esprit de l'auteur, déviations qu'on observe dans le monde concret. De nos jours, plusieurs personnes ont senti que cette voie s'écartait de la réalité, et, pour s'en rapprocher, elles ont substitué à ces raisonnements la recherche des « origines », sans s'apercevoir que, de cette façon, elles aboutissaient souvent a la simple substitution d'une métaphysique à une autre, en expliquant le plus connu par le moins connu, les faits susceptibles de l'observation directe, par des imaginations qui, se rapportant à des temps trop reculés, manquent entièrement de preuves, et en ajoutant des principes comme celui de l'évolution unique, qui dépassent entièrement l'expérience.
§ 1403. En somme, les dérivations constituent les matériaux employés par tout le monde. Mais les auteurs précités donnent aux dérivations une valeur intrinsèque, et les considèrent comme agissant directement dans la détermination de l'équilibre social, tandis que nous leur donnons ici uniquement la valeur de manifestations et d'indices d'autres forces, qui sont celles qui agissent en réalité dans la détermination de l'équilibre social. Jusqu'à présent, les sciences sociales ont été très souvent des théories composées de résidus et de dérivations, et qui avaient en outre un but pratique : elles visaient à persuader les hommes d'agir d'une certaine façon réputée utile à la société. Le présent ouvrage est un essai de transporter an contraire ces sciences exclusivement dans le domaine logico-expérimental, sans aucun but d'utilité pratique immédiate, avec la seule et unique intention de connaître les uniformités des faits sociaux (§ 86). Celui qui écrit un livre en ayant pour but de pousser les hommes à agir d'une certaine manière, doit nécessairement recourir aux dérivations, puisqu'elles constituent le langage au moyen duquel on parvient jusqu'aux sentiments des hommes et par lequel on peut en conséquence modifier leur activité. Au contraire, celui qui vise exclusivement à faire une étude logico-expérimentale doit s'abstenir avec le plus grand soin d'employer les dérivations : elles sont pour lui un objet d’étude, jamais un moyen de persuasion.
§ 1404. Ici, à propos du rôle que nous attribuons au sentiment dans les dérivations, nous nous trouvons en face d'un problème analogue à celui qui a été posé et résolu au chapitre III : si le rôle que le sentiment joue dans les dérivations est vraiment d'une si grande importance, est-il bien possible que tant d'hommes de talent qui étudièrent pratiquement et théoriquement les sociétés humaines ne s'en soient pas aperçus ? Nous devons répondre comme nous l'avons déjà fait pour le problème analogue du chapitre III, et dire que ce rôle a été effectivement aperçu, bien qu'indistinctement, sans qu'une théorie rigoureuse en fût donnée, sans que son importance en fût correctement appréciée, et cela pour divers motifs, parmi lesquels se trouve le préjugé qui attribue un rôle prépondérant aux actions logiques, dans les actions humaines.
Citons maintenant quelques exemples de la façon dont ce sujet a été compris par différents auteurs.
§ 1405. Suivant une théorie qui paraît assez probable, l'enthymème d'Aristote est un jugement accompagné de l'énoncé de sa cause ; l'enthymème des logiciens modernes est un syllogisme dans lequel l'une des prémisses est passée sous silence. Nous acceptons cette dernière définition ; on verra ensuite que les conséquences que nous en tirons sont vraies a fortiori pour l'enthymème d'Aristote.
§ 1406. Les dérivations sont souvent employées sous forme d'enthymème. Si l'on envisage l'art oratoire, il y a cette première raison qu'un discours composé de syllogismes serait lourd, ennuyeux, insupportable ; ensuite il y a un autre motif, d'un ordre plus général, et qui s'applique aussi bien à l'art oratoire qu'à un raisonnement scientifique ou prétendu tel. La forme syllogistique met en lumière le défaut logique des dérivations de la même façon qu'elle fait apparaître les sophismes. Il est donc bon de s'en abstenir, dans les raisonnements qui sont constitués par des associations d'idées ou de résidus. L'enthymème néglige une des propositions du syllogisme, et l'on peut prendre ses dispositions de manière à supprimer la proposition dans laquelle le défaut de logique est le plus apparent. Généralement, on néglige la majeure, c'est-à-dire la prémisse qui contient le moyen terme et le prédicat. La conclusion à laquelle on veut arriver contient le sujet et le prédicat ; le sujet est d'une telle importance qu'il est difficile de supprimer la mineure qui le contient. Quand le moyen terme est une entité non-expérimentale «§ 470), on gagne quelque chose à supprimer au moins l'une des propositions qui le contiennent.
§ 1407. Voici, par exemple, un enthymème cité par Aristote [FN: § 1407-1] « Ne garde pas une colère immortelle, toi qui es mortel ». Prise dans son sens littéral, cette proposition n'a pas de sens ; car il est évident que la colère d'un homme prend fin quand cet homme meurt et disparaît ; et il est par conséquent tout à fait inutile de lui recommander de ne pas garder une « colère immortelle ». Mais le sens de la proposition est bien différent : il consiste à recommander de ne pas garder sa colère trop longtemps, de ne pas avoir une colère très longue, laquelle est appelée immortelle.
Le résidu principal (a) est l'un de ceux qui dépendent de la sociabilité (IVe classe). Le résidu qu'on y ajoute pour dériver est l'un de ceux qui unissent les noms aux choses (I-γ). L'association d'idées qu'on fait naître ainsi est d'abord la répugnance qu'une personne éprouve à unir deux choses contraires, telles que immortel et mortel, puis la confusion qu'on crée entre immortel et très long. C'est dans cette confusion que gît le point faible du raisonnement. C'est pourquoi on doit autant que possible soustraire ce point faible à l'attention.
§ 1408. Il faut observer que la proposition que nous venons de citer est un enthymème au sens d'Aristote, mais non au sens moderne. Dans ce dernier sens, le syllogisme complet serait : « L'homme est mortel ; un mortel ne peut avoir une colère immortelle ; donc l'homme ne peut avoir une colère immortelle ». Mais ce n'est point ce que l'on veut démontrer ; on veut au contraire exprimer que l'homme ne peut – ou ne doit – avoir une trop longue colère. Si on l'exprime sous forme d'enthymème, on dira : « L'homme, étant mortel, ne doit pas avoir une trop longue colère » ; et sous cette forme, beaucoup de personnes accepteront le raisonnement, parce qu'elles seront frappées du contraste entre la vie courte de l'homme et une longue colère. Maintenant, complétons le syllogisme. « L'homme est mortel ; un mortel ne doit pas avoir une trop longue colère ; donc l'homme ne doit pas avoir une trop longue colère ». La proposition : « un mortel ne doit pas avoir une trop longue colère » attire justement l'attention sur le point faible du raisonnement ; il convient donc de la supprimer, pour éviter qu'on ne s'aperçoive de l'erreur ; et de cette façon, on est poussé à substituer l'enthymème au syllogisme. Cela est plus utile pour l'enthymème Aristote que pour l'enthymème moderne. Si, après avoir énoncé un jugement, nous nous bornons à indiquer la raison qui en est l'origine – ou qui semble en être l'origine – et si nous négligeons les propositions intermédiaires, nous nous plaçons dans les conditions les plus favorables au raisonnement par associations d'idées, ou de résidus, par opposition au raisonnement strictement logique. Aristote sentait cela instinctivement, quand il disait que l'enthymème était le syllogisme oratoire [FN: § 1408-1] . Il a raison aussi quand il voit dans les sentences une partie de l'enthymème [FN: § 1408-2] : les sentences sont la réduction ultime d'un syllogisme, dont il ne reste que la conclusion.
§ 1409. Il faut prendre garde à l'erreur où l'on tomberait, en croyant que la sentence est acceptée parce qu'elle fait partie d'un enthymème, et l'enthymème parce qu'il fait partie d'un syllogisme. Cette opinion peut être vraie, au point de vue de la logique formelle, mais non à celui des motifs pour lesquels un homme se laisse persuader. On accepte la sentence, on accepte l'enthymème, à cause des sentiments qu'ils provoquent, pour des motifs intrinsèques, sans les réunir au syllogisme complet (§ 1399). Aristote ajoute l'exemple à l'enthymème, comme moyen de persuasion [FN: § 1409-1] . L'exemple est une des dérivations les plus simples. On cite un fait, et l'on y ajoute un résidu de la IIe classe (Persistance des agrégats) ; c'est-à-dire qu'on donne à un cas particulier la force d'une règle générale.
§ 1410. Après avoir fait allusion aux sophismes de logique, John Stuart Mill [FN: § 1410-1] ajoute, mais seulement pour les exclure de son étude, deux autres sources d'erreur : l'une intellectuelle, l'autre morale. Cela se rapproche assez de la distinction que nous avons faite entre les dérivations (B) et (b). Dans un traité de logique, Mill a raison de ne pas s'occuper de ces sources d'erreur ; pour la sociologie, au contraire, elles sont d'une grande importance.
§ 1411. Quand le logicien a découvert l'erreur d'un raisonnement, quand il a dévoilé un sophisme, son œuvre est achevée. L'œuvre du sociologue commence, au contraire ; il doit rechercher pourquoi ces sophismes sont acceptés, pourquoi ils persuadent. Les sophismes qui ne sont que des subtilités logiques lui importent peu ou point, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'écho parmi les hommes; au contraire, les sophismes – ou même les raisonnements bien faits – qui sont acceptés par beaucoup de gens lui importent au premier chef. La logique cherche pourquoi un raisonnement est erroné, la sociologie pourquoi il obtient un consentement fréquent.
§ 1412. Suivant Mill, les sources d'erreurs morales se divisent en deux classes principales : l'indifférence à connaître la vérité et les inclinations, dont la plus fréquente est celle qui nous pousse dans le sens que nous désirons ; bien qu'ensuite nous puissions accepter une conclusion agréable aussi bien qu'une conclusion désagréable, pourvu qu'elles soient capables de susciter quelque sentiment intense. Cette indifférence et ces inclinations sont les sentiments correspondant à nos résidus ; mais Mill en traite assez mal. Il a été induit en erreur par le préjugé que seules les actions logiques sont bonnes, utiles, louables, tandis que les actions non logiques sont nécessairement mauvaises, nuisibles, blâmables. Il ne s'aperçoit pas que lui-même raisonne sous l'empire de cette inclination.
§ 1413. Le but de la dérivation est presque toujours présent à l'esprit de celui qui veut démontrer quelque chose ; mais il échappe souvent à l'observation de celui qui admet la conclusion de la dérivation. Quand le but est une certaine règle que l'on veut justifier, on tâche d'unir ce but à certains résidus : par des raisonnements plus ou moins logiques, si l'on cherche à satisfaire surtout le besoin de développements logiques qu'éprouvent ceux qu'on veut persuader, ou bien par l'adjonction d'autres résidus, si l'on vise à agir surtout sur les sentiments.
§ 1414. Ces opérations, rangées suivant leur degré d'importance, peuvent être exprimées de la façon suivante : 1° Le but. 2° Les résidus dont la dérivation tire son origine. 3° La dérivation. Une figure graphique fera mieux comprendre le phénomène. Soit B, le but, auquel on parvient en partant des résidus R’, R’’, R’’’,... et grâce aux dérivations R'rB, R'tB, R'vB... Par exemple, dans les théories morales, le but est le précepte qui défend de tuer un autre homme. On peut y arriver par une dérivation très simple : le tabou du sang. On peut partir du résidu d'un dieu personnel et atteindre le but par des dérivations nombreuses et variées. On peut partir d'un résidu métaphysique, ou d'utilité sociale, ou d'utilité personnelle, ou de quelque autre résidu semblable, et atteindre le but grâce à un nombre extrêmement grand de dérivations.
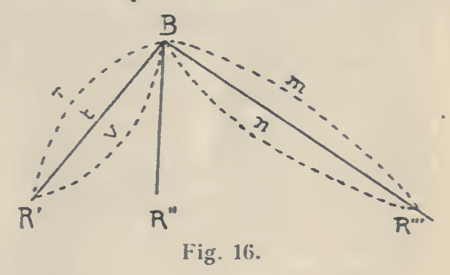
[Figure 16]
§ 1415. En général, les théologiens, les métaphysiciens, les philosophes, les théoriciens de la politique, du droit, de la morale, n'admettent pas l'ordre indiqué tout à l'heure (§ 1402). Ils ont la tendance d'assigner la première place aux dérivations. Pour eux, les résidus sont des axiomes ou des dogmes, et le but est simplement la conclusion d'un raisonnement logique. Comme ils ne s'entendent habituellement pas sur la dérivation, ils en disputent à perdre haleine, et se figurent pouvoir modifier les faits sociaux, en démontrant le sophisme d'une dérivation. Ils se font illusion et ne comprennent pas que leurs disputes sont étrangères au plus grand nombre des gens [FN: § 1415-1], qui ne pourraient les comprendre en aucune façon, et qui, par conséquent, n'en font aucun cas, si ce n'est comme d'articles de foi auxquels ils donnent leur consentement grâce à certains résidus. L'économie politique a été et continue à être en partie une branche de la littérature, et comme telle, elle n'échappe pas à ce que nous avons dit des dérivations. Il est de fait que la pratique a suivi une voie entièrement divergente de la théorie.
§ 1416. Ces considérations nous conduisent à d'importantes conclusions qui appartiennent à la logique des sentiments, mentionnée déjà au § 480.
1° Si l'on détruit le résidu principal dont procède la dérivation, et s'il n'est pas remplacé par un autre, le but aussi disparaît [FN: § 1416-1] . Cela se produit d'habitude, quand on raisonne logiquement sur des prémisses expérimentales, c'est-à-dire dans les raisonnements scientifiques. Pourtant, même dans ce cas, il se peut que la conclusion subsiste, quand les prémisses erronées sont remplacées par d'autres. Au contraire, dans les raisonnements non-scientifiques, le cas habituel est celui dans lequel les prémisses abandonnées sont remplacées par d'autres – un résidu est remplacé par d'autres. Le cas exceptionnel est celui où cette substitution n'a pas lieu. Entre ces cas extrêmes, il y a des cas intermédiaires. La destruction du résidu dont procède la dérivation ne fait pas disparaître entièrement le but, mais en diminue et affaiblit l'importance ; il subsiste, mais il agit avec moins de force. Par exemple, on a observé, aux Indes, que les indigènes qui se convertissent perdent la moralité de leur ancienne religion, sans acquérir celle de leur foi nouvelle et de leurs nouvelles coutumes (§ 1741).
2° Quand on raisonne scientifiquement, si l'on peut démontrer que la conclusion ne procède pas logiquement des prémisses, la conclusion tombe. Au contraire, dans le raisonnement non-scientifique, si l'on détruit une des formes de dérivation, une autre ne tarde pas à surgir. Si l'on montre le vide du raisonnement qui unit un certain résidu à une conclusion (au but), la plupart du temps, le seul effet en est la substitution d'une nouvelle dérivation à celle qui vient d'être détruite. Cela a lieu parce que le résidu et le but sont des éléments principaux, et que la dérivation est secondaire, et souvent de beaucoup. Par exemple, les diverses sectes chrétiennes ont des doctrines sur les bonnes œuvres et la prédestination, lesquelles, au point de vue logique, sont entièrement différentes et parfois même opposées, contradictoires ; et pourtant ces sectes ne diffèrent en rien par la morale pratique. Voici un Chinois, un musulman, un chrétien calviniste, un chrétien catholique, un kantien, un hégélien, un matérialiste, qui s'abstiennent également de voler ; mais chacun donne de ses actes une explication différente. Enfin, ce sont les dérivations qui unissent un résidu qui existe chez eux tous à une conclusion qu'eux tous acceptent. Et si quelqu'un invente une nouvelle dérivation ou détruit une de celles qui existent, pratiquement il n'obtiendra rien, et la conclusion demeurera la même.
3° Dans les raisonnements scientifiques, grâce à des déductions rigoureusement logiques, les conclusions les plus fortes s'obtiennent de prémisses dont la vérification expérimentale est aussi parfaite que possible. Dans les raisonnements non-scientifiques, les conclusions les plus fortes sont constituées par un puissant résidu, sans dérivations. On a ensuite les conclusions obtenues d'un fort résidu auquel s'ajoutent, sous forme de dérivation, des résidus qui ne sont pas trop faibles. Au fur et à mesure que s'allonge la distance entre le résidu et la conclusion, au fur et à mesure que des raisonnements logiques se substituent aux résidus, la force de la conclusion diminue, excepté pour un petit nombre d'hommes de science. Le vulgaire est persuadé par son catéchisme, et non par de subtiles dissertations théologiques. Ces dissertations n'ont qu'un effet indirect ; le vulgaire les admire sans les comprendre, et cette admiration leur confère une autorité qui s'étend aux conclusions. C'est ce qui est arrivé, de nos jours, pour le Capital de Marx. Un très petit nombre de socialistes allemands l'ont lu ; ceux qui peuvent l'avoir compris sont rares comme les merles blancs ; mais les subtiles et obscures dissertations du livre furent admirées de l'extérieur, et conférèrent de l'autorité au livre. Cette admiration détermina la forme de la dérivation, et non pas les résidus ni les conclusions, qui existaient avant le livre, qui continueront à exister quand le livre sera oublié, et qui sont communs tant aux marxistes qu'aux non-marxistes.
4° Au point de vue logique, deux propositions contradictoires ne peuvent subsister ensemble. Au point de vue des dérivations non-scientifiques, deux propositions qui paraissent contradictoires peuvent subsister ensemble, pour le même individu, dans le même esprit. Par exemple, les propositions suivantes paraissent contradictoires : on ne doit pas tuer – on doit tuer ; on ne doit pas s'approprier le bien d'autrui – il est permis de s'approprier le bien d'autrui ; ou doit pardonner les offenses – on ne doit pas pardonner les offenses. Pourtant elles peuvent être acceptées en même temps par le même individu, grâce à des interprétations et des distinctions qui servent à justifier la contradiction. De même, au point de vue logique, si A est égal à B, il s'ensuit rigoureusement que B est égal à A ; mais cette conséquence n'est pas nécessaire dans le raisonnement des dérivations.
§ 1417. Outre les dérivations, qui sont constituées d'un groupe de résidus principaux et d'un autre groupe, secondaire, de résidus qui servent à dériver, nous avons les simples unions de plusieurs résidus ou de plusieurs groupes, qui constituent seulement un nouveau groupe de résidus. En outre, nous avons les conséquences logiques – ou estimées telles – de la considération de l'intérêt individuel ou collectif, lesquelles font partie des classes de déductions scientifiques dont nous ne nous occupons pas ici.
§ 1418. La démonstration des dérivations est très souvent différente de la raison qui les fait accepter. Parfois cette démonstration et cette raison peuvent concorder ; par exemple, un précepte est démontré par l'argument d'autorité, et il est accepté grâce au résidu de l'autorité. D'autres fois elles peuvent être entièrement différentes ; par exemple, celui qui démontre quelque chose en se servant de l'ambiguïté d'un terme, ne dit certainement pas : « Ma démonstration est valide, grâce à l'erreur engendrée par l'ambiguïté d'un terme » ; tandis que celui qui accepte cette dérivation est, sans s'en apercevoir, induit en erreur par le raisonnement verbal.
§ 1419. Classification des dérivations :
Ire CLASSE
Affirmation (§ 1420-1433).
(I-α) Faits expérimentaux ou faits imaginaires (§ 1421-1427).
(I-β ß) Sentiments (§ 1428-1432).
(I-γ) Mélange de faits et de sentiments (§ 1433).
IIe CLASSE
Autorité (1434-1463).
(II-α) Autorité d'un homme ou de plusieurs hommes (§ 1435-1446).
(II-β) Autorité de la tradition, des usages et des coutumes (§ 1447-1457).
(I-γ) Autorité d'un être divin ou d'une personnification (§ 1458-1463).
IIIe CLASSE
Accord avec des sentiments ou avec des principes (§ 1464-1542).
(III-α ) Sentiments (§ 1465-1476).
(III-β) Intérêt individuel (§ 1477-1497).
(III-γ) Intérêt collectif (§ 1498-1500).
(III-δ) Entités juridiques (§ 1501-1509).
(III-ε) Entités métaphysiques (§ 1510-1532).
(III-ζ) Entités surnaturelles (§ 1533-1542).
IVe CLASSE
Preuves verbales (§ 1543-1686).
(IV-α ) Terme indéterminé désignant une chose réelle et chose indéterminée correspondant à un terme (§ 1549-1551).
(IV-β) Terme désignant une chose, et qui fait naître des sentiments accessoires, ou sentiments accessoires qui font choisir un terme (§ 1552-1555).
(IV-γ) Terme à plusieurs sens, et choses différentes désignées par un seul terme (§ 1556-1613).
(IV-δ) Métaphores, allégories, analogies(§ 1614-1685).
(IV-ε) Termes douteux, indéterminés, qui ne correspondent à rien de concret (§ 1686).
§ 1420. Ire CLASSE. Affirmation. Cette classe comprend les simples récits, les affirmations d'un fait, les affirmations d'accord avec des sentiments, exprimées non pas comme telles, mais d'une façon absolue, axiomatique, doctrinale. Les affirmations peuvent être de simples récits ou des indications d'uniformités expérimentales ; mais souvent elles sont exprimées de telle manière qu'on ne sait si elles expriment uniquement des faits expérimentaux, ou si elles sont des expressions de sentiments, ou bien si elles participent de ces deux genres. Nombreux sont les cas où il est possible de découvrir, avec une certaine probabilité, la manière dont elles sont composées. Prenons, par exemple, le recueil de sentences de Syrus. Les quatre premières appartiennent au genre (I-α); ce sont: «Nous autres hommes sommes également proches de la mort. – Attends d'un autre ce que tu auras fait à un autre. – Éteins par tes larmes la colère de qui t'aime. – Qui dispute avec un homme ivre se bat contre un absent ». Vient ensuite une sentence du genre (1-β) : « Mieux vaut essuyer une injure que la faire ». Suivent quatre sentences du genre (I-α), puis de nouveau une du genre (1-β), qui est : « Adultère est celui qui aime violemment sa femme ». Enfin, voici une sentence du genre (I-γ): « Tout le monde demande : Est-il riche ? personne : est-il bon ? » Là, il y a l'affirmation d'un fait (I-α) et un blâme de ce fait, (I-β). Voyons encore les sentences de Ménandre : « Il est agréable de cueillir toute chose en son temps ». C'est une sentence du genre (I-α). « Ne fais ni n'apprends aucune chose honteuse » est une sentence du genre (1-β). « Le silence est pour toutes les femmes un ornement ». C'est une sentence du genre
§ 1421. (I-α) Faits expérimentaux ou faits imaginaires. L'affirmation peut être subordonnée à l'expérience. En ce cas, c'est une affirmation de la science logico-expérimentale, qui ne trouve pas place parmi les dérivations. Mais l'affirmation peut aussi subsister par sa vertu propre, par une certaine force intrinsèque, indépendante de l'expérience. Dans ce cas, c'est une dérivation.
§ 1422. Comme nous l'avons déjà remarqué (§ 526, 1068), il y a une différence entre un simple récit et l'affirmation d'une uniformité. Tous deux peuvent appartenir à la science logico-expérimentale ou aux dérivations, suivant qu'ils sont subordonnés à l'expérience ou qu'ils subsistent par leur vertu propre.
§ 1423. Souvent, la personne qui suit la méthode des sciences logico-expérimentales commence par une dérivation qu'elle soumet ensuite à l'expérience. Dans ce cas, la dérivation n'est qu'un moyen de recherche, et, comme telle, peut avoir sa place dans la science logico-expérimentale, mais pas comme moyen de démonstration.
§ 1424. Quand d'un fait ou de plusieurs faits on tire l'expression d'une uniformité, le résidu que l'on y ajoute et qui sert à la dérivation exprime le sentiment que les rapports des faits naturels ont quelque chose de constant (§ 1068). C'est là un procédé scientifique, pourvu qu'on prenne garde que l'uniformité ainsi obtenue n'a rien d'absolu ; c'est une dérivation non-scientifique du genre (I-β), si l'on donne un caractère absolu au résidu de la constance des « lois » naturelles, ou si, d'une autre manière quelconque, on fait dépasser l'expérience par l'affirmation.
§ 1425. La simple affirmation a peu ou point de force démonstrative ; mais elle a parfois une grande force persuasive [FN: § 1425-1]. C'est pourquoi nous la trouvons ici, comme nous l'avons déjà trouvée là où nous recherchions de quelle manière on tâche de persuader que les actions non-logiques sont des actions logiques (chapitre III), tandis que nous ne l'avons pas trouvée là où nous avons étudié les démonstrations (chapitre IV). Cependant l'affirmation vraiment pure et simple est rare, et chez les peuples civilisés, très rare ; il y a presque toujours quelque adjonction, quelque dérivation ou quelque germe de dérivation.
§ 1426. Au contraire, l'affirmation de renfort est fréquente dans le passé et dans le présent. On l'ajoute à d'autres dérivations, sous forme d'exclamation. Dans la Bible, Dieu donne, par l'entremise de Moïse, certains ordres à son peuple, et ajoute de temps à autre, comme pour les renforcer: « Je suis l'Éternel, votre Dieu [FN: § 1426-1] ». Fréquentes sont de nos jours les affirmations qu'une certaine mesure est selon le progrès, la démocratie, qu'elle est largement humaine, qu'elle prépare une humanité meilleure. Sous cette forme, l'affirmation est à peine une dérivation ; ce n'est plutôt qu'une façon d'invoquer certains sentiments. Mais en étant souvent répétée, elle finit par acquérir une force propre, devient un motif d'agir, assume le caractère de dérivation.
§ 1427. On a aussi l'affirmation simple dans le tabou sans sanction, dont nous avons déjà parlé (§ 322). Ce genre de dérivations simples s'observe en un très grand nombre de dérivations composées ; il est même rare qu'une dérivation concrète en soit dépourvue. L'affirmation arbitraire se trouve généralement parmi des affirmations expérimentales, ou s'insinue, se dissimule au milieu d'un raisonnement, et usurpe pour elle le consentement donné à d'autres propositions parmi lesquelles elle se trouve.
§ 1428. (I-β) Sentiments. L'affirmation peut être une manière indirecte d'exprimer certains sentiments. Elle est acceptée comme « explication » par ceux qui ont ces sentiments. Elle est donc simplement la manifestation des résidus accessoires qui constituent la dérivation.
§ 1429. Quand d'un sentiment individuel on tire une uniformité ou un précepte, le résidu qui s'ajoute et qui sert à la dérivation est le sentiment qui transforme les faits subjectifs en faits objectifs (résidus II-ζ). Souvent il s'y ajoute ensuite les résidus de sociabilité (IVe classe). Un homme en voit fuir d'autres et fuit, lui aussi. C'est un mouvement instinctif, une action réflexe comme on en observe aussi chez les animaux. Il entend crier : « Fuyez ! » et s'enfuit. Nous sommes encore dans le cas précédent. On lui demande: « Pourquoi avez-vous fui ? » Il répond: « Parce qu'ayant entendu crier : Fuyez! je croyais qu'on devait fuir ». On voit ainsi poindre la dérivation, qui pourra se développer si l'on entreprend d'expliquer le pourquoi de ce devait. Voici une personne qui lit une poésie et s'écrie : « Elle est belle ! » Si elle disait : « Elle me paraît belle », ce serait la simple affirmation d'un fait subjectif ; mais en disant: « Elle est belle ! » elle transforme ce fait subjectif en un fait objectif. Eu outre, celui qui entend a l'idée que ce qu'on dit beau doit lui donner à lui-même l'impression du beau, et là intervient un résidu de sociabilité. C'est ainsi que les hommes ont généralement les goûts de la collectivité dans laquelle ils vivent.
§ 1430. Une affirmation est acceptée, obtient crédit, par les sentiments de divers genres qu'elle suscite chez qui l'écoute ; et ainsi ces sentiments acquièrent l'apparence d'une « explication ». Elle a de la valeur parce qu'elle est exprimée d'une façon doctorale, sentencieuse, avec une grande sûreté, sous une forme choisie, en vers mieux qu'en prose, imprimée mieux que manuscrite, dans un livre de préférence à un journal, dans un journal mieux qu'exprimée verbalement, et ainsi de suite (§ 1157).
§ 1431. Nous avons trois catégories de causes de la valeur de l'affirmation. l° Il y a un sentiment indistinct que celui qui s'exprime d'une de ces manières doit avoir raison. La dérivation est vraiment réduite au minimum : c'est celle qui appartient proprement au genre dont nous nous occupons. 2° Il y a l'idée que ces formes choisies font autorité. La dérivation est un peu plus développée et appartient à la IIe classe (§ 1434 et sv.). 3° Il y a l'idée plus ou moins indéterminée que cette autorité est justifiée. La dérivation appartient encore à la IIe classe (§ 1435), et peut se développer jusqu'à donner un raisonnement logique. Pour ne pas répéter deux fois les mêmes choses, nous traiterons ici des trois catégories ensemble.
On pourrait supposer, en faisant abstraction de la réalité, que les sentiments de la 3e catégorie produisent ceux de la 2e, et ceux-ci les sentiments de la 1re : on démontrerait « d’abord que certaines circonstances confèrent de l'autorité, puisqu'on accepte en général cette autorité ; enfin, même indépendamment de cette autorité, qu'on éprouve du respect pour les formes sous lesquelles elle s'exprime. Cela peut arriver parfois ; mais si l'on tient compte de la réalité, on voit que les trois catégories sont souvent indépendantes ; qu'elles ont une vie propre, et que lorsque existe un rapport entre la 2e et la 3e, il est l'inverse de celui que nous venons d'indiquer. En de nombreux cas, l'homme qui accepte l'affirmation exprimée sous les formes indiquées tout à l'heure ne fait pas tant de raisonnements. Il dit, par exemple: « J'ai lu cela dans mon journal », et pour lui cela suffit comme preuve de la réalité de la chose [FN: § 1431-1] . C'est là une dérivation du genre qui nous occupe. Elle n'existe que lorsque, explicitement ou implicitement, le sentiment de respect pour la chose imprimée ou écrite sert à expliquer, à justifier le consentement que rencontre ce qui est imprimé ou écrit. Si, au contraire, ce sentiment se manifeste simplement, sans qu'on en tire des conséquences, par exemple quand la chose imprimée ou écrite est considérée comme un fétiche, une amulette, ou même seulement considérée avec respect, on a un seul résidu, qui est celui dont nous avons déjà traité aux § 1157 et sv. Cette observation est générale : un sentiment s'exprime par un résidu; si celui-ci sert ensuite à expliquer, à justifier, à démontrer, on a une dérivation. Il convient encore d'observer que dans le fait d'un homme qui fait siennes les opinions d'un journal qu'il lit habituellement, il y a, outre la présente dérivation, un ensemble d'autres dérivations et de résidus, parmi lesquels ceux de la sociabilité, puisque le journal exprime ou est réputé exprimer l'opinion de la collectivité à laquelle appartient le lecteur. En d'autres cas, c'est l’idée d'autorité qui agit (§ 1157 et sv.), ajoutée à la précédente ou indépendante d'elle. Enfin, en un très petit nombre de cas, il s'y ajoute des sentiments de justification de l'autorité (§ 1432) ; mais habituellement les hommes ont d'abord le sentiment de l'autorité et tâchent de trouver ensuite une manière de la justifier.
§ 1432. Au point de vue logico-expérimental, le fait qu'une affirmation est énoncée avec une grande sûreté peut être un indice, fût-ce lointain, que cette affirmation n'est pas à mettre en doute. À moins qu'il ne s'agisse d'une répétition machinale, le fait qu'une affirmation est exprimée en latin prouve que l'auteur a fait certaines études, indice probable d'une autorité légitime. En général, le fait d'être exprimée sous une forme qui n'est pas accessible à tout le monde peut indiquer, souvent peut-être à tort, que cette affirmation provient de personnes mieux que d'autres à même de connaître la réalité. Dans le cas de l'imprimé, du journal, du livre, on peut remarquer qu'une affirmation exprimée sous l'une de ces formes doit par cela même presque toujours être considérée comme rendue publique ; ce qui a pour conséquence qu'elle peut être réfutée plus facilement qu'une affirmation clandestine qui passe de bouche en bouche. C'est pourquoi, si la réfutation n'a pas lieu, la première affirmation a plus de probabilités d'être vraie que la seconde. Mais il arrive bien rarement que les hommes soient mus par des considérations de cette sorte ; et ce ne sont pas des raisonnements logico-expérimentaux, mais bien des sentiments, qui les poussent à ajouter foi aux affirmations faites sous les formes indiquées.
§ 1433. (I-γ) Les genres (I-α ) et (I-β), séparés dans le domaine de l'abstraction, se trouvent presque toujours réunis dans le concret et constituent le présent genre. À la vérité, celui qui donne une explication peut, bien que cela se produise rarement, ne pas avoir le sentiment auquel on recourt pour la donner ; mais celui qui l'accepte a généralement ce sentiment, autrement il n'y donnerait pas son consentement. Il suit de là qu'en réalité, la plus grande partie des dérivations concrètes de la Ire classe appartiennent au genre (I-γ), et que les expressions des faits et des sentiments sont chez elles si intimement combinées, qu'on ne peut aisément les séparer. Souvent, il s'y ajoute aussi des sentiments d'autorité et d'autres semblables.
§ 1434. IIe CLASSE. Autorité. Ici, nous avons un mode de démonstration et un mode de persuasion. Nous avons déjà parlé du premier (§ 583 et sv.); parlons maintenant surtout du second. Dans cette classe, nous avons diverses dérivations, qui sont les plus simples après celles de la classe précédente. Comme dans beaucoup d'autres dérivations les résidus qui servent à dériver sont ceux de la persistance des agrégats. Aux résidus (II-ζ) qui transforment les sentiments en réalités objectives, s'ajoutent des résidus d'autres genres ; par exemple, ceux de l'autorité du père mort ou des ancêtres (II-β), de la tradition (II-α), de la persistance des uniformités (II-ε), etc. Comme d'habitude, les résidus de la Ire classe interviennent pour allonger et développer les dérivations.
§ 1435. (II-α) Autorité d'un homme ou de plusieurs hommes [FN: § 1435-1]. Un cas extrême est celui de dérivations exclusivement logiques. Il est évident que pour certaines matières, l'opinion d'une personne qui en a une connaissance pratique présente une plus grande probabilité d'être vérifiée par l'expérience, que l'opinion d'une personne ignorante et qui n'a pas cette connaissance. Une telle considération est purement logico-expérimentale, et nous n'avons pas à nous en occuper ici [FN: § 1435-2] . Mais il y a d'autres genres de dérivations par rapport auxquelles la compétence de l'individu n'est pas expérimentale ; elle peut être déduite d'indices trompeurs, ou même être entièrement imaginaire. Nous nous écartons le moins du cas logico-expérimental, lorsque nous présumons, avec une probabilité plus ou moins grande (§ 1432), l'autorité d'après des indices qui peuvent être véridiques ou trompeurs, et en outre lorsque, grâce à la persistance des agrégats, nous étendons la compétence au delà des limites
§ 1436. Parce que M. Roosevelt est un éminent politicien, il croit être savant en histoire, et donne à Berlin, une conférence dans laquelle il fait montre d'une certaine ignorance de l'histoire grecque et de la romaine. L'Université qui a été honorée par Mommsen lui décerne le titre de docteur honoris causa. Il fait la découverte vraiment admirable que l'adage : si vis pacem para bellum est de Washington, et il est nommé membre étranger de l'Académie des sciences morales et politiques de Paris. Certes, il connaît l'art de faire les élections politiques ; il sait aussi battre la grosse caisse, et n'ignore pas la manière de chasser le rhinocéros blanc ; mais comment tout cela lui confère-t-il la compétence de donner des conseils aux Anglais, sur la façon de gouverner l'Égypte, ou aux Français, sur le nombre d'enfants qu'ils doivent avoir ? Il y a sans doute des motifs politiques et de basse adulation, pour expliquer les honneurs qui lui furent décernés par l'Académie des sciences morales et politiques de Paris, et par les Universités de Berlin et de Cambridge, ainsi que les flatteries qu'il reçut d'hommes politiques puissants, dans son rapide voyage en Europe [FN: § 1436-1] ; mais là même où ces motifs font défaut, nous trouvons l'admiration des vains discours de M. Roosevelt. Il y a aussi le sentiment que l'homme qui réussit à se faire nommer président des États-Unis d'Amérique et à faire grand bruit dans cette fonction, doit être compétent en toute matière qui a quelque rapport avec les sciences sociales et historiques ; et aussi le sentiment que celui qui est compétent en une chose l'est en toutes ; le sentiment d'admiration générale, qui empêche de séparer les parties en lesquelles un homme est compétent, de celles où il ne l'est pas.
Autrefois, l'autorité du poète envahissait tous les domaines. En de nombreux cas, il y avait à cela un petit fondement logico-expérimental, parce que le poète était aussi, l'homme cultivé. Aujourd'hui, ce motif n'a plus de valeur pour le poète et le littérateur contemporains ; et pourtant, en de nombreux cas, ils passent pour compétents en des matières qui leur sont parfaitement étrangères. Voici M. Brieux qui, dans chacune de ses productions dramatiques, vous « résout » quelque « question sociale ». Il ne sait rien et décide de tout. Il découvre une thèse connue depuis les temps les plus anciens, et, après Plutarque et Rousseau, enseigne aux mères qu'elles doivent allaiter leurs enfants. Aussi est-il admiré par un grand nombre de bonnes gens. Anatole France est un romancier de tout premier ordre, très compétent quant au style et à la forme littéraire. En une langue merveilleuse, il a écrit des romans où l'on trouve une psychologie sagace et une fine ironie. En tout cela, son autorité est incontestable. Mais voilà qu'un beau jour il lui vient à l'idée de l'étendre à d'autres matières qu'il connaît beaucoup moins. Il veut résoudre des problèmes politiques, économiques, religieux, historiques. Il devient dreyfusard, socialiste, théologien, historien ; et il ne manque pas d'admirateurs dans toutes ses transformations. Le sentiment de l'autorité – aidé de la passion politique – est si fort en ce cas, qu'il résiste aux preuves contraires les plus évidentes. L'histoire de Jeanne d'Arc écrite par Anatole France conserve des admirateurs, après que Lang a publié les erreurs nombreuses et graves qu'elle contient. Il y en a de grossières, d'involontaires, et d'autres que l'on ne peut malheureusement tenir pour telles. Cependant, le livre jouit encore d'une grande autorité [FN: § 1436-2].
§ 1437. Le résidu de la vénération (§ 1156 et suiv.) sert souvent à donner du poids aux affirmations ; il peut avoir différents degrés et, de la simple admiration, aller jusqu'à la déification. Sous toutes ses formes, il peut être employé pour la dérivation, mais aux degrés les plus élevés, il devient souvent une forme de l'autorité ou de la tradition verbale ou écrite [FN: § 1437-1] .
§ 1438. On peut placer dans le présent genre de dérivations les nombreuses affirmations pseudo-expérimentales qu'on trouve en tout temps, et que chacun répète comme un perroquet. Parfois elles ont une apparence de preuve, dans un témoignage plus ou moins intelligent, plus ou moins véridique ; mais souvent aussi cette preuve fait défaut, et les affirmations restent en l'air, on ne sait comment, sans la moindre preuve expérimentale ou autre. Pour trouver de ces dérivations il suffit d'ouvrir plusieurs livres anciens et aussi quelques livres modernes. Nous n'ajouterons qu'un seul exemple à ceux que nous avons déjà cités. Saint Augustin veut prouver, contre les incrédules, la réalité des tourments qui attendent les damnés. Les incrédules lui objectaient qu'il n'était pas croyable que la chair brûlât sans se consumer, et que l'on souffrît sans mourir. À cela, le saint répond qu'il y a d'autres faits, également merveilleux, qui seraient incroyables s'ils n'étaient certains, et il en cite un grand nombre [FN: § 1438-1]. Sans doute, au point de vue expérimental, cette dispute est vaine, d'un côté comme de l'autre, parce que les tourments des damnés sont étrangers au monde expérimental, et que la science expérimentale ne peut en traiter d'aucune façon ; mais un fait étrange subsiste c'est que presque tous les faits cités par le saint sont imaginaires à tel point que si le livre était d'un adversaire, on aurait pu croire que celui-ci a voulu montrer la vanité des miracles dont le saint voulait donner la preuve. On aurait pu répondre au Saint : « Nous acceptons votre raisonnement ; nous vous concédons que les miracles que vous citez sont aussi vrais que les faits auxquels vous les comparez... lesquels faits sont faux ! » Pour l'un de ces faits, soit pour la chair de paon qui ne se corrompt pas, il y, a une pseudo-expérience ; pour les autres, la preuve est donnée par des dérivations fondées sur l'autorité [FN: § 1438-2] .
Saint Augustin est le précurseur de nos contemporains adorateurs de la Sainte Science : il dit croire uniquement à ce qui est prouvé par les faits, refusant d'ajouter foi aux fables des païens [FN: § 1438-3] ; et les fidèles de l'humanitarisme positiviste répètent qu'ils veulent croire uniquement ce qui est prouvé par les faits, refusant d'ajouter foi aux « fables » des chrétiens. Mais, par malheur, autant les faits du premier que les faits des derniers sont uniquement pseudo-expérimentaux.
Il convient de remarquer qu'à la fin pourtant un certain doute sur les faits s'insinue dans l'esprit de Saint Augustin [FN: § 1438-4] ce qui ne semble pas être le cas de nos admirateurs de la démocratie et de l'humanitarisme. L'omnipotence de Dieu est, en somme, pour Saint Augustin, la meilleure preuve des miracles. En cela, il a raison ; car, sortant ainsi du domaine expérimental, il échappe aux objections de la science logico-expérimentale, lesquelles conservent, au contraire, toute leur efficacité contre ceux qui s'obstinent à demeurer dans ce domaine.
§ 1439. Dans les dérivations, le résidu de l'autorité traverse les siècles sans perdre de sa force. De nos jours, après avoir parlé par la bouche des admirateurs de Eusapia Paladino, de Lombroso, de William James, il nous apparaît tel qu'il était quand Lucien écrivait son Menteur. Les fables dont se moque Lucien s'écartent très peu de celles qui ont cours aujourd'hui, et se justifiaient, de son temps, comme elles se justifient du nôtre, par l'autorité d'hommes réputés savants, graves. Bien longtemps avant que Lombroso et William James eussent promis de revenir, après leur mort, pour s'entretenir avec leurs amis, la femme d'Eucratès était venue, après sa mort, s'entretenir avec son mari. Le philosophe Arignôtos raconte d'autres histoires encore plus merveilleuses, et l'incrédule Tykhiadès, laissant voir qu'il n'y ajoutait guère foi, est considéré comme privé de bon sens, parce qu'il ne cède pas à de semblables autorités [FN: § 1439-1]. Il suffit d'ouvrir au hasard l'un des nombreux livres qui racontent des faits merveilleux, pour y trouver des observations semblables [FN: § 1439-2].
§ 1440. De nos jours, ces croyances existent aussi. Un grand nombre de gens croient à la guérison par la prière (§ 1695-2). Un très grand nombre vivent dans la crainte sacrée des médecins hygiénistes, qui sont les saints défendant les malheureux mortels des maléfices des démons devenus microbes. Un manuel de morale [FN: § 1440-1] (!) en usage dans les écoles françaises nous apprend que « (p. 33) pour être bien portant, il faut ne jamais boire d'alcool, ni de boissons alcooliques. Il ne faut jamais avaler une seule goutte d'eau-de-vie, de liqueur, d'absinthe ou d'apéritif ». Rien ne nous permet de croire que l'auteur ne pensait pas ce qu'il affirme ; et, dans le cas contraire, il aurait vraiment donné un déplorable exemple, dans un traité de morale. Il croyait donc – et les lecteurs doivent croire, en vertu de son autorité – qu'il suffit «d'avaler une seule goutte d'eau-de-vie ou de liqueur » pour n'être pas bien portant. Il est très facile de faire un essai, et de vérifier s'il est vrai qu'après avoir bu une seule goutte de liqueur on n'est pas bien portant. Dans ce cas, comme en beaucoup d'autres, on verra que l'expérience dément l'autorité. Mais il y a mieux. Un auteur affirme, comme résultat de l'expérience, que si un homme est buveur, sa fille ne peut plus allaiter, et que cette faculté est perdue à jamais pour les générations suivantes [FN: § 1440-2]. Ici la substitution de l'autorité à l'expérience est éclatante et se dément d'elle-même. Pour démontrer expérimentalement que la faculté d'allaiter est perdue à jamais pour « les générations suivantes », il est évidemment nécessaire d'avoir examiné ces générations, au moins pendant quelques siècles. Comment cela est-il possible ? Où sont les statistiques de quelques siècles en arrière, qui indiquent qu'un homme était buveur, puis indiquent que les femmes qui descendaient de lui ont pu ou non allaiter ? Passons sur le fait que si ce que dit cet auteur était vrai, on ne verrait plus, dans les pays de vignobles, de femmes allaitant leurs enfants ; il suffit de se promener dans une de ces contrées et de n'être pas aveugle pour s'assurer du contraire.
§ 1441. Voici un autre personnage, qui dit [FN: § 1441-1] – et il trouve des gens pour y croire – qu'il suffit d'un demi-litre de vin ou de deux litres de bière pour diminuer du 25 au 40 % la capacité de travail cérébral. Ainsi, dans les universités allemandes, où professeurs et étudiants boivent encore plus que les quantités qui viennent d'être indiquées, de bière ou de vin, on devrait avoir bien peu de capacité de travail cérébral. Le grand mathématicien Abel, qui abusait des boissons alcooliques, devait être un idiot ; mais nous ne nous en apercevons pas. Bismarck aussi devait avoir bien peu de capacité de travail cérébral [FN: § 1441-2] !
§ 1442. Il est remarquable que beaucoup, parmi les croyants de cette religion anti-alcooliste soient des adversaires acharnés de la religion catholique, et qu'ils se moquent de ses miracles, sans s'apercevoir que leurs miracles sont aussi étonnants que ceux des catholiques, et que s'il est vrai que la croyance en les uns et les autres est dictée par le sentiment, elle trouve ensuite sa justification dans l'autorité, avec cette différence en défaveur des croyants de la religion anti-alcooliste, qu'aujourd'hui il n'y a pas moyen de faire des expériences pour prouver qu'un miracle fait au temps passé était faux, tandis que chacun peut faire des expériences ou des observations qui démontrent la fausseté des affirmations miraculeuses rapportées tout à l'heure [FN: § 1442-1].
§ 1443. Le résidu de l'autorité apparaît aussi dans les artifices qu'on met en œuvre pour la détruire. On peut le voir dans une infinité de polémiques théologiques, morales, politiques.
§ 1444. Au point de vue logico-expérimental, la vérité de la proposition : A est B, est indépendante des qualités morales de l'homme qui l'énonce. Supposons que demain on découvre qu'Euclide fut un assassin, un voleur, en somme le pire homme qui ait jamais existé ; cela porterait-il le moindre préjudice à la valeur des démonstrations de sa géométrie ?
§ 1445. Il n'en est pas ainsi au point de vue de l'autorité. Si la proposition : A est B, est acceptée seulement grâce à l'autorité de celui qui l'énonce, tout ce qui peut affaiblir cette autorité nuit à la démonstration que A est B. L'artifice des polémistes consiste à placer dans le domaine de l'autorité une proposition qui a sa place dans le domaine logico-expérimental.
§ 1446. Il faut remarquer que ces moyens, justement parce qu'ils n'ont aucune force logico-expérimentale, perdent toute efficacité, quand on en fait un usage trop étendu. Désormais, on sait que lorsqu'un théologien dit d'un autre qu'il est un pervers, cela signifie seulement qu'ils sont d'avis différent ; et quand un journaliste dit d'un homme d'État qu'il est un malfaiteur, cela indique simplement qu'il a, pour le combattre, des motifs d'intérêt personnel, de parti ou d'opinion. En politique, ces moyens de détruire l'autorité peuvent n'avoir plus le moindre effet.
§ 1447. (II-β) Autorité de la tradition, des usages ou des coutumes. Cette autorité peut être verbale, écrite, anonyme, celle d’une personne réelle ou d'une personne légendaire. Dans ces dérivations, une grande part revient aux résidus de la persistance des agrégats, grâce auxquels, autrefois la « sagesse des ancêtres », aujourd'hui les « traditions du parti », acquièrent une existence propre et indépendante. Les dérivations qui emploient l'autorité de la tradition sont très nombreuses. Non seulement il n'y a pas de pays ou de nation qui n'ait ses traditions, mais encore les sociétés particulières n'en manquent pas. Ces traditions sont une partie importante de toute vie sociale. Expliquer un fait par la tradition est très facile, car, parmi les innombrables légendes qui existent, et qu'au besoin on peut même créer, on n'éprouve pas la moindre difficulté à en trouver une qui, grâce à quelque ressemblance plus ou moins lointaine, à un accord plus ou moins indéterminé de sentiments, s'adapte au fait que l'on veut « expliquer » [FN: § 1447-1].
§ 1448. Parfois, l'usage ne se distingue pas de la tradition, et souvent celui qui suit un certain usage ne sait donner d'autre motif de ses actions que : « On fait ainsi ».
§ 1449. Les traditions peuvent constituer des résidus indépendants, et là où ils sont assez puissants, la société devient comme rigide, et repousse presque toute nouveauté. Mais souvent les traditions ne sont que des dérivations et, en ce cas, la société peut innover peu ou beaucoup, même en contradiction avec le fond de la tradition, l'accord persistant seulement dans la forme. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de sectes chrétiennes.
§ 1450. Comme nous l'avons vu souvent, les dérivations sont en général d'une nature élastique. Celles de la tradition possèdent ce caractère à un degré éminent. On peut tirer tout ce qu'on veut, par exemple, d'un livre qui enseigne la tradition. Les Grecs trouvaient tout dans Homère, les Latins dans Virgile, et les Italiens trouvent beaucoup de choses dans Dante. Le cas de la Bible et de l'Évangile est très remarquable. Il serait difficile de dire ce qu'on n'y a pas trouvé. On en a tiré des doctrines en très grand nombre, différentes, contradictoires même, et l'on a démontré avec une égale facilité le pour et le contre.
§ 1451. Naturellement, chaque secte est persuadée de posséder la « vraie » interprétation, et repousse dédaigneusement celles d'autrui; mais cette « vérité » n'a rien de commun avec la vérité expérimentale, et tout critère fait défaut pour savoir qui a raison. Dans ce procès, il y a bien des avocats, mais pas de juges (§ 9).
§ 1452. On peut observer expérimentalement que certaines interprétations s'écartent du sens littéral ; mais celui qui possède une foi vive ne s'en soucie guère, et c'est de propos délibéré qu'il abandonne ce sens littéral. Par exemple, si le Cantique des Cantiques se trouvait dans un autre livre que la Bible, chacun y verrait immédiatement un chant d'amour (§ 1627). La foi y voit autre chose, et comme elle se place en dehors de l'expérience, celui qui veut rester dans le domaine de cette expérience ne peut rien objecter.
§ 1453. Tant que la tradition ne sert qu'à dériver, la critiquer a peu d'effet sur l'équilibre social. On ne peut dire que cet effet soit nul, mais, sauf les cas exceptionnels, il n'est pas grand.
§ 1454. À partir du XVIIIe siècle, on a combattu la Bible avec une formidable artillerie de science, d'érudition, de critique historique. On a démontré, d'une manière tout à fait évidente, qu'un grand nombre de passages de ce livre ne peuvent être pris dans leur sens littéral. L'unité du livre a été détruite, et au lieu du magnifique édifice que l'on a tant admiré, il ne reste que des matériaux informes. Eh bien, on ne voit diminuer ni l'admiration, ni le nombre des croyants [FN: § 1454-1] ; ceux-ci se comptent encore par millions, et il y a des gens qui, tout en critiquant la partie historique de la Bible, tombent à genoux devant le livre et l'adorent. Les dérivations changent, les résidus subsistent.
§ 1455. De nos jours, de braves gens se sont imaginé pouvoir détruire le christianisme, en tâchant de démontrer que le Christ n'a pas de réalité historique : ils ont donné un beau coup d'épée dans l'eau. Ils ne s'aperçoivent pas que leurs élucubrations ne sortent pas d'un cercle très étroit d'intellectuels, et qu'elles ne parviennent pas jusqu'au peuple, jusqu'au plus grand nombre des croyants. En général, ils ne persuadent que ceux qui sont déjà persuadés.
§ 1456. De même, des gens se sont imaginé qu'ils auraient détruit, en France, le patriotisme catholique, et qu'ils auraient ainsi contribué à assurer la suprématie du « bloc » radical-socialiste, s'ils avaient pu démontrer que Jeanne d'Arc était hystérique ou aliénée [FN: § 1456-1] . Ils n'ont été écoutés que par ceux qui étaient déjà de leur avis ; et loin de diminuer l'admiration de leurs adversaires pour Jeanne d'Arc, ils ont contribué à l'augmenter.
§ 1457. Les livres vénérés finissent souvent par acquérir un pouvoir mystérieux, et peuvent servir à la divination. C'est ce qui est arrivé par exemple à la Bible, à Virgile et à d'autres.
§ 1458. (II-γ) Autorité d'un être divin ou d'une personnification. Si l'on s'en tenait uniquement au fond, les dérivations de ce genre devraient être rangées parmi les précédentes, puisqu'à vrai dire nous ne pouvons connaître la volonté d'un être divin ou d'une personnification que par l'intermédiaire d'hommes et de traditions ; mais au point de vue de la forme, l'intervention surnaturelle est assez importante pour donner lien à un genre séparé. L'intervention d'une divinité engendre trois genres différents de dérivations. 1er La volonté de cette divinité étant supposée connue l'homme peut y obéir par simple respect, sans subtiliser trop sur les motifs de cette obéissance, en donnant simplement pour motif de ses actions la volonté divine, ou en y ajoutant un petit nombre de considérations sur le devoir qu'on a de la respecter. C'est ainsi qu'on a le présent genre. 2e L'homme peut obéir à cette volonté par crainte du châtiment qui menace le transgresseur des commandements divins. Ici, c'est l'intérêt individuel qui agit ; on a des actions qui sont la conséquence logique des prémisses. Ces dérivations appartiennent au genre (III-β) ou bien au genre (III-γ) si à l'intérêt individuel se substitue ou s'ajoute celui de la collectivité. 3e L'homme peut encore tâcher de mettre ses actions en accord avec la volonté divine, par amour pour la divinité, pour agir suivant les sentiments qu'on suppose à cette divinité, parce qu'en soi cela est bon, louable, de son devoir, indépendamment des conséquences. De cette façon naissent les dérivations du genre (III-ζ).
§ 1459. Comme nous l'avons dit souvent, nous séparons par l'analyse, dans le problème abstrait, ce qui est uni dans la synthèse du fait concret. Dans la pratique, les dérivations où figure une entité surnaturelle réunissent très souvent les deux premiers genres mentionnés tout à l'heure, et même de telle façon qu'il est difficile de les séparer. Elles ajoutent aussi souvent le troisième genre ; mais c'est là un passage à la métaphysique, on l'observe spécialement chez les gens qui se livrent à de longs raisonnements. Beaucoup d'individus éprouvent pour l'être surnaturel un sentiment complexe de vénération, de crainte, d'amour, qu'ils ne sauraient eux-mêmes pas diviser en éléments plus simples. Les controverses de l'Église catholique sur la contrition et l'attrition sont en rapport avec la distinction que nous venons de faire entre les genres de dérivations [FN: § 1459-1].
§ 1460. Dans les trois genres de dérivations, il faut faire attention aux manières dont on croit reconnaître la volonté de l'être divin ou l'accord avec les sentiments de cet être. Ces sentiments sont généralement simples, dans les deux premiers genres, bien qu'il y ait plusieurs exceptions, et beaucoup plus complexes dans le troisième. La divination antique comprenait une branche spéciale pour connaître la volonté des dieux.
§ 1461. Une entité abstraite peut parfois donner lieu aux dérivations qui sont propres à la divinité, quand cette entité abstraite se rapproche de la divinité, grâce aux résidus de la persistance des agrégats : c'est, pour ainsi dire, une divinité en voie de formation.
§ 1462. La dérivation qui invoque la volonté présumée ou les sentiments présumés de l'être surnaturel, a d'autant plus d'efficacité pour persuader que le résidu correspondant à l'être surnaturel est plus fort. La manière dont on s'imagine connaître sa volonté est secondaire. Il y a toujours quelque biais pour faire en sorte que l'être surnaturel veuille ce qui importe le plus à celui qui l'invoque (§ 1454-1] ). Souvent, les hommes se figurent qu'ils agissent d'une certaine façon par obéissance à la volonté d'êtres surnaturels, tandis qu'au contraire, ils supposent cette volonté, parce qu'ils agissent de cette façon. « Dieu le veut ! » s'écriaient les croisés, qui, réellement, étaient poussés en grande partie par un instinct migrateur semblable à celui qui existait chez les anciens Germains, par le désir de courir les aventures, par le besoin de nouveauté, par répugnance pour une vie réglée, par cupidité [FN: § 1462-1]. Si les hirondelles raisonnaient, elles pourraient dire aussi que, si elles changent de pays, deux fois l'an, c'est pour obéir à la volonté divine. De nos jours, c'est pour obéir aux lois du « Progrès », de la « Science », de la « Vérité », que certaines personnes s'approprient les biens d'autrui, ou qu'elles favorisent ceux qui se les approprient ; mais, en réalité, elles sont poussées par le désir très naturel de ces biens, ou de la faveur des gens qui se les approprient. Dans l'Olympe du « Progrès », une nouvelle divinité a maintenant sa place ; on lui a donné le nom d'« intérêts vitaux » ; elle préside aux relations internationales. Aux temps barbares, un peuple partait en guerre contre un autre, le mettait à sac, le pillait, sans tant de raisonnements. À notre époque, cela se fait encore, mais s'accomplit uniquement au nom des « intérêts vitaux » ; et cela constitue, dit-on, une immense amélioration. À qui n'est pas expert en une telle matière, le brigandage des États européens en Chine paraîtra peut-être assez semblable à celui d'Attila dans l'Empire romain ; mais celui qui est versé dans la casuistique des dérivations voit aussitôt entre les deux brigandages une énorme différence. Pour le moment, les « intérêts vitaux » ne sont pas encore invoqués par les brigands privés, qui se contentent d'une divinité plus modeste, et justifient leurs faits et gestes en disant qu'ils veulent « vivre leur vie ».
§ 1463. Parfois, la dérivation finit par avoir une valeur indépendante, et constitue un résidu ou bien une simple dérivation du présent genre (II-γ). Cela a lieu souvent avec les abstractions divinisées mais non personnifiées ; ce qui empêche de leur attribuer trop explicitement une volonté personnelle, et il est nécessaire qu'elles se contentent de quelque « impératif ». Nous en avons un grand nombre d'exemples, en tout temps. Au nôtre, voici un exemple important. L'automobile jouit de la protection du Progrès, qui est dieu ou peu s'en faut, de même que la chouette jouissait à Athènes de la protection de la déesse Athéna. Les fidèles du Progrès doivent respecter l'automobile, comme les Athéniens respectaient les chouettes. À notre époque où triomphe la démocratie, si l'automobile n'avait pas la protection du Progrès, elle serait proscrite, car elle est employée surtout par les gens riches ou, pour le moins, aisés, et tue bon nombre d'enfants de prolétaires, et même quelques prolétaires adultes ; elle empêche aux enfants des pauvres de jouer dans la rue, remplit de poussière les maisons des pauvres paysans et des habitants des villages [FN: § 1463-1]. Tout cela est toléré, grâce à la protection du dieu Progrès ; du moins en apparence car, en réalité, il y a aussi l'intérêt des hôteliers et des fabricants d'automobiles [FN: § 1463-2] . On va jusqu'à traiter ceux qui n'admirent pas les automobiles comme on traitait autrefois les hérétiques. Voici, par exemple, en Suisse, le canton des Grisons, qui ne veut pas laisser passer les automobiles sur les routes construites avec son argent. Aussitôt les prêtres et les fidèles du dieu Progrès se récrient et condamnent avec une colère vraiment comique cet acte hérétique et coupable de lèse-majesté divine ; ils demandent que la Confédération oblige le canton entaché d'une si grande perversité hérétique, de laisser libre parcours aux automobiles ; et ils avaient même proposé, pour arriver à leurs fins, une adjonction à la constitution fédérale ; peu s'en fallut qu'on ne la soumît au referendum populaire.
Notez, en ce cas, une dérivation qu'on rencontre habituellement dans les autres religions, et qui consiste à rendre l'individu fautif de ce qui est proprement une conséquence de la règle générale. Quand il se produit quelque accident qui, en vérité, a pour cause la grande vitesse qu'on permet aux automobiles, on en rejette toute la faute sur le conducteur de la machine, baptisé à cette occasion du nom de chauffard. Ainsi on dissimule la cause effective, et l'on ne risque pas de la faire disparaître. De même, dans les pays où existe la corruption parlementaire, on fait de temps à autre des enquêtes et des procès pour faire croire que les quelques individus frappés sont seuls coupables, et éviter le blâme qui retomberait sur toute l'institution qui produit de tels effets.
§ 1464. IIIe CLASSE. Accord avec des sentiments ou avec des principes. Souvent l'accord existe seulement avec les sentiments de celui qui est l'auteur de la dérivation ou de celui qui l'accepte, tandis qu'il passe pour un accord avec les sentiments de tous les hommes, du plus grand nombre, des honnêtes gens, etc. Ces sentiments se détachent ensuite du sujet qui les éprouve, et constituent des principes.
§ 1465. (III-α) Sentiments. Accord avec les sentiments d'un nombre petit ou grand de personnes. Nous avons déjà parlé de ces dérivations (§ 591-612), en les envisageant spécialement dans les rapports qu'elles peuvent avoir avec la réalité expérimentale ; il nous reste à ajouter des considérations au sujet de la forme qu'elles prennent.
§ 1466. L'accord avec les sentiments peut se manifester de trois façons, qui sont semblables à celles que nous avons indiquées déjà (§ 1458) pour l'obéissance à l'autorité ; c'est-à-dire que nous avons les trois genres suivants. 1° L'homme peut mettre ses actions en accord avec les sentiments vrais ou supposés d'êtres humains, ou d'un être abstrait, par simple respect pour l'opinion du plus grand nombre ou des doctes personnages qui sont les ministres de cet être abstrait. Nous avons ainsi les dérivations (III-α). 2° L'homme peut agir sous l'empire de la crainte de conséquences fâcheuses pour lui ou pour autrui ; et nous avons des dérivations des genres (III-β),(III-γ), (III-δ). 3° Enfin, l'homme peut être mu par une force mystérieuse qui le pousse à agir de manière à mettre ses actions en accord avec les sentiments indiqués ; et, dans le cas extrême, on a un « impératif » qui agit par une vertu propre et mystérieuse. Ainsi se constituent les genres (III-ε), (III-ζ). Dans les résidus qu'on emploie pour dériver, ceux de la sociabilité (IVe classe) jouent un rôle important.
§ 1467. Dans ce genre (III-α ) se trouve aussi l'accord avec les sentiments de l'auteur de la dérivation. Cet auteur ne raisonne pas objectivement, mais par simple accord de sentiments (§ 1454-1), usant largement des résidus de l'instinct des combinaisons (Ire classe). Il suffit que A ait avec B une analogie lointaine ou même imaginaire, pour qu'on emploie A en vue d'« expliquer » B par un accord indistinct de sentiments indéterminés. Quand intervient une certaine détermination et que les sentiments se manifestent sous une forme métaphysique, nous avons les dérivations du genre (III-ε). Souvent les dérivations par accord de sentiments prennent une forme simplement verbale, et l'accord s'établit entre les sentiments que font naître certains termes. Alors les dérivations ont proprement leur place dans la IVe classe.
§ 1468. Les cas concrets présentent souvent les trois genres de dérivations mentionnés au § 1466 ; mais le second, qui est très important pour les personnifications divines, se voit souvent à peine, ou disparaît entièrement dans les dérivations par accord de sentiments, surtout dans les dérivations métaphysiques. En outre, on trouve dans un grand nombre de dérivations par accord de sentiments un groupe de résidus de la IVe classe, dépendants de la sociabilité, c'est-à-dire un sentiment de vénération éprouvé par l'individu envers la collectivité, un désir d'imitation et d'autres sentiments semblables. C'est justement dans cet agrégat puissant de sentiments que réside la force qui pousse les hommes à accepter les raisonnements qui ont pour fondement le consentement d'un grand nombre ou de tous les hommes. C'est la solution du problème indiqué (§ 597, 598). Ici, nous avons à nous occuper principalement de l'accord de sentiments qu'on suppose agir par vertu propre (III-α ).
§ 1469. L'accord avec les sentiments subsiste souvent de lui-même, sans qu'on cherche explicitement à donner une forme précise au rapport dans lequel il peut se trouver avec la réalité objective. C'est l'affaire de la métaphysique de rechercher cette forme précise, qui s'exprime souvent par l'affirmation de l'identité de l'accord des idées et de l'accord des objets correspondants (§ 594, 595). On peut exprimer cette identité en disant que « s'il existe un concept dans l'esprit de tous les hommes, ou du plus grand nombre, ou dans un être abstrait, ce concept correspond nécessairement à une réalité objective ». Souvent on n'exprime pas cette identité ; elle demeure sous-entendue ; c'est-à-dire qu'elle ne s'énonce pas explicitement, qu'on ne donne pas une forme verbale au résidu auquel elle correspond (résidu II-ζ). Parfois on l'exprime sous diverses formes, comme évidente ou axiomatique ; c'est la manière propre aux métaphysiciens. Parfois encore, on essaie d'en donner une démonstration, en allongeant pour cela la dérivation. On dit, par exemple, que ce qui existe dans tout esprit humain y a été mis par Dieu, et doit donc nécessairement correspondre à une réalité objective : c'est la manière propre aux théologiens, employée pourtant aussi par d'autres personnes. Il y a encore la belle théorie de la réminiscence ; et l'on ne manque pas d'autres théories métaphysiques de cette sorte, y compris les théories positivistes d'H. Spencer.
§ 1470. Voyons quelques exemples pratiques de ces dérivations. Longtemps on a attribué une grande importance au consentement universel pour démontrer l'existence des dieux ou de Dieu. On peut obtenir ce consentement de la manière indiquée tout à l'heure : en sous-entendant que Dieu a imprimé un certain concept dans l'esprit humain, qui nous le manifeste ensuite [FN: § 1470-1] ; ou bien inversement, en partant de ce concept, et en vertu d'un principe métaphysique, on peut conclure à l'existence de Dieu. « Grecs et Barbares – nous dit Sextus Empiricus [FN: § 1470-2] – reconnaissent les dieux ». Maxime de Tyr nous fait la bonne mesure. Il commence par observer (4) qu'il règne une extrême diversité d'opinions sur ce qu'est Dieu, le bien, le mal, sur le honteux et sur l'honnête ; mais (5) dans un si grand désaccord, tous sont d'avis qu'il est un dieu unique, souverain et père de toute chose, auquel viennent s'ajouter d'autres dieux, ses fils et collègues. « C'est ce que disent l'Hellène et le Barbare, le continental et l'insulaire, le sage et l'ignorant... » C'est là un bel exemple d'un auteur donnant pour objective une théorie subjective, qui est la sienne. Combien de gens étaient loin de penser comme Maxime de Tyr [FN: § 1470-3] !
§ 1471. L'auteur veut répondre à l'objection qui est générale en (des cas semblables : de tous, qui éprouvent, affirme-t-on, certains sentiments, se trouvent exclus de fait plusieurs hommes qui ne les éprouvent pas. Il s'en tire par un procédé général aussi, de dérivation [FN: § 1471-1] (§ 592 et suiv.), en excluant, sans autre forme de procès, ces hommes du nombre des personnes à envisager. Ceux qui ne partagent pas l'avis de Maxime de Tyr sont des gens de rien ; donc il est évident que tous ceux qui ne sont pas des gens de rien partagent son avis. « Que si, dans le cours des temps, il a existé deux ou trois athées abjects et stupides, que leurs yeux trompent, qui sont induits en erreur par leur ouïe, eunuques quant à l'âme, sots, stériles, inutiles comme des lions sans courage, des bœufs sans cornes, des oiseaux sans ailes, cependant même par ceux-là tu connaîtras le divin... » [FN: § 1471-2]. Injurier ses adversaires n'a aucune valeur au point de vue logico-expérimental, mais peut en avoir beaucoup sous le rapport des sentiments [FN: § 1471-3].
§ 1472. L'affirmation suivant laquelle tous les peuples auraient une conception des dieux ne resta pas sans réponse. Elle fut mise en doute ou même nettement niée [FN: § 1472-1]. Cela importe peu au sujet dont nous traitons ici. Remarquons seulement que, comme d'habitude, le terme dieux ou Dieu n'étant pas bien défini, on peut à volonté trouver ou non cette conception dans l'esprit de certains hommes.
§ 1473. Il parait qu'on fait aussi une différence entre tous les peuples et tous les hommes, parce qu'on voudrait distinguer entre les simples gens qui représentent l'opinion populaire, et certains hommes qui veulent par trop subtiliser. Parmi ces derniers, on rangerait les athées, auxquels on pourrait ainsi légitimement opposer le bon sens du plus grand nombre.
§ 1474. Comme d'habitude, par les dérivations on peut prouver le pour et le contre ; et il ne manqua pas de gens qui se prévalurent du défaut de consentement universel, pour contester l'existence des dieux et de la morale. Platon accuse du fait les sophistes. Il semble qu'au fond ceux-ci disaient : les dieux, étant différents chez les divers peuples, ne tirent pas leur existence de la nature, mais de l'art ; le beau est autre selon la nature et selon la loi ; le juste n'existe pas par nature, puisque les hommes, toujours en désaccord à son sujet, font tous les jours de nouvelles lois.
§ 1475. On sous-entend souvent le consentement du plus grand nombre ; c'est-à-dire qu'il nous paraît si évident, que nous admettons, sans éprouver le besoin de nous exprimer explicitement sur ce point, que tous ou le plus grand nombre doivent être de cet avis. Parfois, comme nous l'avons déjà remarqué (§ 592 et sv.) on donne ce consentement comme démonstration ; parfois, il est à son tour démontré au moyen de quelque autre principe métaphysique [FN: § 1475-1], auquel on a vainement opposé le fait expérimental qu'un grand nombre d'opinions générales étaient fausses, par exemple celle portant sur l'astrologie. Cette adjonction au principe du consentement universel sert à donner satisfaction au besoin que l'homme a d'explications logiques.
§ 1476. Dans presque toutes les dérivations concrètes, on trouve la dérivation du consentement universel, du plus grand nombre, des honnêtes gens, des sages, de l'esprit humain, de la droite raison, de l'homme pondéré, avisé, etc. Très souvent, cette dérivation est implicite ; souvent elle se dissimule sous différentes formes ; par exemple, en une manière impersonnelle de s'exprimer : On croit, on comprend, on admet, etc., ou en rappelant un nom : Cette chose s'appelle ainsi ; ce qui veut dire simplement que l'auteur de la dérivation donne à cette chose un nom qui convient à certains de ses sentiments. Les proverbes aussi, les adages, les dictons universels, employés comme preuve, dissimulent généralement le consentement, vrai ou supposé, du plus grand nombre.
§ 1477. (III-β ß) Intérêt individuel. Si l'on veut persuader un individu de faire une certaine chose A qu'il ne ferait pas spontanément, différents moyens peuvent être employés, et une partie seulement d'entre eux appartiennent aux dérivations.
§ 1478. Les moyens suivants n'appartiennent pas aux dérivations. 1° L'individu ne sait pas qu'il lui serait utile de faire A : on le lui enseigne. C'est le rôle de l'expérience, de l'art, de la science. Par exemple, l'expérience vous enseigne à épargner dans l'abondance, pour faire face à la disette ; l'art vous enseigne à vous procurer le fer dont vous ferez la charrue ; la science vous enseigne le moyen d'atteindre un but déterminé. 2° Faire A est imposé à l'individu par une puissance extérieure et réelle, moyennant une sanction réelle. Si la puissance ou la sanction, ou toutes les deux, sont imaginaires, irréelles, on a un procédé qui appartient aux dérivations. Les lois civiles et les lois pénales ont précisément pour but d'établir des sanctions réelles. Le simple usage, la coutume, ont aussi une sanction ; elle consiste dans le blâme qui frappe celui qui les transgresse, dans les sentiments d'hostilité du reste de la collectivité auxquels il s'expose. 3° Faire A est imposé par la nature même de l'individu, de telle sorte que s'il ne le fait pas, il en éprouve du remords, de la peine.
§ 1479. Les procédés suivants appartiennent aux dérivations : 4° On affirme simplement – bien qu'en réalité cela ne soit pas – que faire A sera utile à l'individu considéré ; ne pas faire A lui sera nuisible [FN: § 1479-1] . Ce procédé correspond au 1er quand les déductions ne sont pas logico-expérimentales. Il nous donne les tabous avec sanction spontanée, intrinsèque au tabou. Parmi les résidus employés dans ces dérivations, il y a surtout ceux même qui sont utilisés dans la Ire classe (affirmation) et la IIe classe (autorité) des dérivations. 5° Faire – ou ne pas faire – A, est imposé à l'individu par une puissance extérieure, moyennant une sanction, quand la puissance ou la sanction, ou toutes les deux sont irréelles. Ce procédé correspond au 2d, où puissance et sanction sont réelles. 6° On affirme, sans pouvoir le démontrer, que l'individu considéré éprouvera du remords, de la peine d'avoir fait ou de ne pas avoir fait A. Ce procédé correspond au 3e. Toutes ces dérivations sont d'une grande importance dans les sociétés humaines, car elles servent surtout à faire disparaître le contraste qui pourrait exister entre l'intérêt individuel et l'intérêt de la collectivité ; et l'un des procédés les plus employés pour atteindre ce but consiste à confondre les deux intérêts, grâce aux dérivations, à affirmer qu'ils sont identiques, et que l'individu, en pourvoyant au bien de sa collectivité, pourvoit aussi au sien propre (§ 1903 à 1998). Parmi les nombreuses dérivations qu'on emploie dans ce but, il y ajustement celles que nous examinons maintenant. L'identité indiquée des deux intérêts s'obtient spontanément par le 4e et le 6e procédés, ou grâce à l'intervention d'une puissance irréelle, par le 5e procédé.
§ 1480. Au chapitre III (§ 325 et sv.), nous avons classé les préceptes et les sanctions, eu égard surtout à la transformation des actions non-logiques en actions logiques (§ 1400). Voyons la correspondance des deux classifications. Les classes du chapitre III sont désignées par (a), (b), (c), (d). En (a), la démonstration n'existe pas ; (a) est donc exclue des dérivations ; elle a sa place parmi les résidus. En (b), la démonstration existe, mais a été supprimée. Si elle est rétablie, et dans la mesure où elle est rétablie, (b) fait partie des dérivations, pourvu qu'il s'agisse d'une démonstration pseudo-expérimentale ; en ce cas, (b) correspond au 4e procédé, ou bien aussi au 6e. Si la démonstration est logico-expérimentale, (b) correspond au 1er et aussi au 3e. En (c), il y a une sanction réelle, imposée par une puissance réelle ; nous sommes donc dans le cas du 2e procédé. En (d), ou la puissance, ou la sanction, ou toutes les deux sont irréelles ; par conséquent, celle classe correspond au 5e procédé. Voyons maintenant séparément le 4e, le 5e et le 6e procédés.
§ 1481. 4e procédé. Démonstration pseudo-expérimentale. Le type est le tabou avec sanction. Nous avons déjà parlé du tabou sans sanction (§ 321 et sv.). On admet que la transgression du tabou expose à de funestes conséquences, semblables à celles qui affligent celui qui transgresse la prescription de ne pas faire usage d'une boisson vénéneuse. Dans l'un et l'autre cas, il y a des remèdes pour se soustraire à ces conséquences. Pour le tabou, les conséquences et les remèdes sont pseudo-expérimentaux (4e procédé), et pour la prescription concernant le poison, ils sont expérimentaux (1er procédé). En parlant des résidus, nous avons vu (§ 1252-1) quels remèdes on emploie, à l’île Tonga, pour faire disparaître les conséquences fâcheuses d'une transgression du tabou. Nous traitions alors du rétablissement de l'intégrité de l'individu ; et, à ce point de vue, nous avons mis ensemble la transgression du tabou avec ses remèdes, et la transgression, par un catholique, des préceptes de sa religion ; transgression à laquelle il remédie par la confession et la pénitence. Mais sous l'aspect des dérivations que nous envisageons maintenant, ces deux transgressions doivent être séparées, parce que la première concerne des maux et des remèdes qui ont une forme réelle, bien que le fond soit pseudo-expérimental ; et la seconde concerne les maux d'une vie future, par conséquent irréels, et des remèdes spirituels, tels que la contrition et l'attrition du pécheur. De nouvelles dérivations viennent s'ajouter au simple tabou. Là où existe le concept d'un être surnaturel, on le met en rapport avec le tabou, de même qu'avec toute autre opération importante [FN: § 1481-1]. Puis l'action spontanée du tabou se change en une action provoquée artificiellement ; et sans attendre que les effets nuisibles de la transgression du tabou se produisent spontanément, le pouvoir public avise au châtiment des coupables.
§ 1482. S. Reinach [FN: § 1482-1] admet que le précepte biblique d'honorer son père et sa mère est un tabou qui, en somme, aurait été primitivement : « (p. 6) N'insulte pas (ne frappe pas, etc.) ton père ou ta mère, ou tu mourras ». C'est un effet spontané de l'action. De même aussi, toujours suivant Reinach (p. 4), toucher l'arche du Seigneur avait pour effet spontané la mort. Quand Ouzza meurt pour avoir touché l'arche, « (p. 4) ce n'est pas l'Éternel qui frappe l'innocent Ouzza ; c'est Ouzza qui commet une imprudence, analogue à celle d'un homme qui touche une pile électrique et meurt foudroyé ».
§ 1483. D'une part, ce genre de tabou est très fort, parce qu'il met en action, directement et sans développements subtils, les résidus des combinaisons (§ 1416, 3°) ; et de fait, on observe l'existence de semblables tabous, non seulement en des temps reculés, mais aussi en des temps plus récents [FN: § 1483-1] . D'autre part, de semblables sanctions précises des tabous sont exposées à être démenties par l'observation ; par conséquent, au fur et à mesure que l'emploi de la logique et de l'observation se propagent, ces tabous se transforment nécessairement ; d'abord en rendant l'existence de la sanction plus indéterminée, et par ce fait moins sujette à être démentie ; ensuite, grâce à une double transformation, dont une branche rejette la sanction dans un monde surnaturel, et sert tant au vulgaire qu'aux gens cultivés, et dont une autre accumule les nuages de la métaphysique autour de la sanction, si bien qu'elle devient incompréhensible, et que, par conséquent, on n'en peut démentir l'existence, puisque personne ne peut nier l'existence d'une chose inconnue.
Chez les anciens, la prospérité des méchants était un argument cher aux athées, pour prouver que les dieux n'existaient pas. Les chrétiens leur brisèrent cette arme dans la main, car personne n'est jamais revenu de l'enfer ou du paradis pour raconter ce que devenaient les méchants ou les justes, et, à vrai dire, le voyage de Dante et ceux du même genre dépassent le monde expérimental.
§ 1484. Le roi Rio-Rio abolit le tabou, à Haouaï, en montrant publiquement qu'on pouvait le transgresser sans aucun effet fâcheux [FN: § 1484-1]. Son expérience eut l'effet désiré parce qu'il s'agissait d'un effet physique ; mais elle n'aurait pu avoir lieu si l'effet imminent avait été surnaturel ou métaphysique.
§ 1485. Le tabou ni le précepte, avec sanction surnaturelle, ne doivent nous occuper ici ; nous n'avons pas à examiner non plus les théories qui, grâce à des sophismes verbaux ou autres, font en réalité disparaître l'intérêt individuel qu'on dit vouloir envisager (§ 1897 et sv.). Nous n'étudierons maintenant que les dérivations dont le caractère prépondérant est de réduire au principe de l'intérêt individuel des actions qui ne paraissent pas en dépendre.
§ 1486. Comme type de ces dérivations, on peut prendre la théorie de Bentham. Au premier abord, il semble que toute équivoque soit exclue, et que, sous le rapport de la précision, la théorie ne laisse rien à désirer. Bentham dit [FN: § 1486-1] : « (p. 4) Je suis partisan du principe d'utilité... lorsque j'emploie les termes juste, injuste, moral, immoral, bon, mauvais, comme des termes collectifs qui renferment des idées de certaines peines et de certains plaisirs, sans leur donner aucun autre sens : bien entendu que je prends ces mots, peine et plaisir, dans leur signification vulgaire, sans inventer des définitions arbitraires pour donner l'exclusion à certains plaisirs ou pour nier l'existence de certaines peines. Point de subtilité, point de métaphysique ; il ne faut consulter ni Platon, ni Aristote. Peine et plaisir, c'est ce que chacun sent comme tel ; le paysan, ainsi que le prince, l'ignorant ainsi que le philosophe ».
§ 1487. On ne peut être plus clair. Mais là surgit aussitôt le problème qui se pose toujours en de semblables théories : « Comment concilier ce principe de l'égoïsme absolu avec le principe de l'altruisme(§ 1479), auquel l'auteur ne veut pas renoncer ? » Tel s'en tire avec les sanctions d'une puissance terrestre ou ultra-terrestre ; tel autre change le sens des termes ; tel autre recourt aux subtilités, réprouvées par notre auteur ; tel autre enfin, posant quelque principe, retire la concession qu'il a faite. Cette dernière voie est celle que suit notre auteur.
§ 1488. Le premier procédé employé par Bentham consiste à recourir à l'approbation ou à la désapprobation d'autrui. Voilà que le principe altruiste est introduit. Mais cela ne suffit pas : il faut encore le concilier avec le premier principe. Dans ce but, Bentham affirme que la désapprobation d'autrui nuit à l'individu, et que, par conséquent, il est utile à celui-ci de l'éviter [FN: § 1488-1]. Ainsi, il nous retire la concession qu'il nous avait faite. Si l'on dit à un voleur : « Si l'on découvre ton vol, tu seras mal vu et tu en pâtiras »; il peut répondre : « En mettant dans la balance, d'un côté le plaisir que me procure l'objet que je veux dérober, de l'autre le mal probable que ce vol peut m'attirer, je trouve que le plaisir est plus grand que le mal ». Nous ne pouvons alors rien lui objecter, si nous ne voulons pas aller à l'encontre du principe que nous avons posé, à savoir que « peine et plaisir, c'est ce que chacun sent comme tel », et sans mériter le reproche que « il est absurde de raisonner sur le bonheur des hommes autrement que par leurs propres désirs et par leurs propres sensations ». On trouve une idée claire de cette théorie de Bentham dans un cas pratique imaginé par lui-même [FN: § 1488-2], et qui est justement un de ces récits qu'on fait aux enfants quand on les menace de l'ogre. La meilleure réfutation est celle qu'a faite Mark Twain (3), dans ses deux récits humoristiques du bon petit garçon et du méchant petit garçon.
§ 1489. Ce premier procédé de démonstration n'est donc pas très efficace, et il semble que le défaut n'en a pas complètement échappé à Bentham [FN: § 1489-1] . C'est pourquoi il a recours à un second procédé de démonstration, et invoque un autre principe : celui « du plus grand bonheur du plus grand nombre [FN: § 1489-2] ». Il mettait ainsi en action les résidus de la sociabilité (IVe classe). En de nombreux cas, ce principe s'oppose au premier ; et, en se servant des deux principes à la fois, on supprime, on ne résout pas le problème moral qu'on avait posé, et qui consiste précisément à trouver le moyen de concilier, dans ces cas, l'utilité pour l'individu avec l'utilité pour le plus grand nombre.
Nous sommes tombés par hasard sur l'un de ces problèmes, où l'on sent qu'il y a un certain maximum de bonheur ou d'utilité pour les individus particuliers, et un maximum aussi pour la collectivité. Mais, ainsi que toutes les intuitions, celle-ci laisse le sujet comme enveloppé d'un nuage. Nous tâcherons de le dissiper au chapitre XII, en essayant de préciser les notions.
§ 1490. Une application singulière, faite par Bentham, du principe du bien du plus grand nombre est celle de l'esclavage. Suivant l'auteur, on pourrait admettre cette institution, s'il y avait un seul esclave pour chaque maître. Après cela, on serait tenté de croire qu'il conclut à une législation dans ce sens. Au contraire, il veut que l'esclavage soit graduellement aboli. Ici l'on voit bien que la dérivation a un but prédéterminé auquel on doit arriver. Bentham, ou celui qui recueillit ses œuvres, ne dédaigne pas le secours des gens qui, invoquant l'autorité du plus grand nombre, en excluent leurs adversaires. Il dit : « (p. 323) Les propriétaires d'esclaves à qui l'intérêt personnel n'a pas ôté le bon sens et l'humanité, conviendroient sans peine des avantages de la liberté sur la servitude... [FN: § 1490-1] » Que viennent faire ici le bon sens et l'humanité, que Bentham avait proscrits ? Et puis, si le maître d'esclaves a de l'humanité, cela suffit pour abolir l'esclavage, et il était inutile de construire une théorie qui s'appuie exclusivement sur l'intérêt personnel [FN: § 1] .
§ 1491. Les difficultés que rencontre Bentham sont principalement les deux suivantes. 1° Il veut que toutes les actions soient logiques, et se place ainsi en dehors de la réalité, où beaucoup d'actions sont au contraire non-logiques [FN: § 1491-1] . 2° Il veut concilier logiquement des principes logiquement incompatibles, tel que le principe égoïste et le principe altruiste.
§ 1492. Je n'entends nullement m'occuper ici de la valeur intrinsèque de cette théorie ni d'autres quelconques (§ 1404); et les recherches sur l'accord de ces théories avec les faits visent uniquement les rapports des dites théories avec les dérivations. La valeur logico-expérimentale de la théorie de Bentham est fort mince ; cependant elle a joui d'un grand crédit. Comment cela est-il possible ? Pour le même motif que celui en vertu duquel d'autres théories semblables ont obtenu un tel succès ; c'est-à-dire parce qu'elles unissaient les résidus de l'intégrité personnelle et ceux de la sociabilité. Cela suffit : les gens ne regardent pas de si près à la manière dont les résidus sont unis, c'est-à-dire à la dérivation. Bentham inclinerait à faire rentrer les animaux dans « le plus grand nombre » de sa formule. De même aussi John Stuart Mill, qui estime que « le principe général auquel toutes les règles de la pratique [de la morale] doivent être conformes et le critérium par lequel elles doivent être éprouvées, est ce qui tend à procurer le bonheur dit genre humain, ou plutôt de tous les êtres sensibles... [FN: § 1492-1] ».
§ 1493. Une autre belle dérivation est celle de Spinoza, qui cherche, comme d'habitude, à concilier le principe égoïste avec le principe altruiste [FN: § 1493-1] : « Car si, par exemple, deux individus entièrement de même nature se joignent l'un à l'autre, ils composent un individu deux fois plus puissant que chacun séparément. Rien donc de plus utile à l'homme que l'homme ; les hommes, dis-je, ne peuvent rien souhaiter qui vaille mieux pour la conservation de leur être, que de s'accorder tous en toutes choses [FN: § 1493-2] ». S'il y avait deux hommes affamés et un seul pain, ils s'apercevraient bientôt que rien n'est plus nuisible à un homme qu'un autre homme ; et l'homme qui se trouverait en présence d'un autre homme aimant la même femme que lui, aurait le même sentiment ; et l'affamé et l'amoureux souffriraient que d'autres hommes fussent de « même nature » qu'eux. Mais Spinoza va de l'avant, et dit que de ce principe il « suit que les hommes qui sont gouvernés par la Raison [on comprend que ceux qui ne sont pas de l'avis de Spinoza ne sont pas gouvernés par la Raison], c'est-à-dire que ceux qui cherchent ce qui leur est utile sous la conduite de la Raison, n'appètent rien pour eux-mêmes qu'ils ne désirent aussi pour les autres hommes, et sont ainsi justes, de bonne foi et honnêtes ». Les dérivations changent ainsi de forme, mais le fond est toujours que pour faire son propre bien, il faut faire celui d'autrui [FN: § 1493-3] , et nous retrouvons ce principe dans la doctrine moderne de la solidarité.
§ 1494. Burlamaqui commence par trouver la sanction des lois naturelles dans les maux que le cours ordinaire des choses inflige à qui transgresse ces lois. Nous avons ainsi une dérivation semblable à celle de Bentham. Notre auteur continue et, en homme prudent, il estime qu'il ne faut pas se fier entièrement à dame Nature, pour qu'elle fasse respecter ses lois, cette bonne dame étant parfois distraite ; c'est pourquoi il ajoute la sanction d'une vie surnaturelle. De cette façon, voyageant en dehors du monde expérimental, il évite les objections qu'on pourrait lui faire dans ce monde [FN: § 1494-1].
§ 1495. D'autres auteurs, Pufendorf, Hobbes, Spinoza, Locke, voient une sanction des lois naturelles dans le fait que l'individu, s'il les transgresse, cause un dommage à la société et, par conséquent, à lui-même, en tant qu'il fait partie de la société. C'est bien ainsi, d'une façon générale (§ 2115 et sv.) ; mais il faut tenir compte de la somme de l'utilité directe pour l'individu, et de la somme des maux indirects. Au contraire, chez ces auteurs et chez d'autres, nous avons un raisonnement qu'on retrouve en un très grand nombre de dérivations, et qu'on pourrait appeler le sophisme de répartition. Voici en quoi il consiste. Soit un individu qui fait partie d'une collectivité, et qui accomplit une certaine action A, laquelle nuit à la société. On veut démontrer qu'en ne se préoccupant que de son intérêt personnel, il trouve avantage à s'abstenir de cette action. Pour cela, on observe que l'individu en question, faisant partie de la collectivité, aura sa part du dommage causé à cette collectivité ; et l'on conclut que l'action A lui est nuisible, que s'il l'accomplit, ce ne peut être que par ignorance. De là résulte le principe d'après lequel les erreurs des hommes sur ce qui constitue le bien sont l'origine de tout mal [FN: § 1495-1].
§ 1496. Voici en quoi consiste le sophisme : 1° On élimine la considération de la quantité d'utilité ou de dommage, en supposant que tous agissent d'une certaine façon, tous d'une autre ; et l'on ne s'occupe pas du cas où une partie agissent d'une façon, une partie d'une autre ; 2° On néglige cette considération et, poussant les choses à l'extrême, on tient compte seulement de l'utilité ou seulement du dommage. Admettons cependant que si tous les individus s'abstenaient de faire A, chacun, en tant qu'il fait partie de la collectivité, retirerait une certaine utilité. Maintenant, si tous les individus moins un continuent à ne pas faire A, l'utilité pour la collectivité diminuera peut-être très peu, tandis que cet individu obtient, en faisant A, une utilité particulière beaucoup plus grande que la perte qu'il éprouve comme membre de la collectivité. Si l'on n'aperçoit pas immédiatement ce sophisme, cela tient à un résidu qui, la plupart du temps, intervient implicitement, et qui donne naissance à la première partie, indiquée tout à l'heure, du sophisme. C'est-à-dire qu'on suppose, sans le dire, que tous les individus agissent comme celui qu'on envisage ; et, en ce cas, il ne reste, pour cet individu, que le dommage réparti ; l'utilité directe disparaît, au moins en grande partie. La réponse à faire à ce raisonnement serait que celui qui fait A ne désire pas du tout que les autres fassent de même ; mais on ne peut la donner, pour ne pas blesser le résidu de l'égalité. Soit, par exemple, un voleur. Nous voulons lui persuader que voler est contre son intérêt individuel. Dans ce but, nous lui faisons remarquer les dommages que la société, en général, éprouve par le fait de l'existence du vol, et nous lui montrons qu'il souffre sa part de ces dommages. Il y a les dépenses pour la police, pour les magistrats, pour les prisons, etc.; il y a le dommage du manque de sécurité, etc. Il est certain que si personne ne volait, la société en retirerait un avantage, et chacun de ses membres aurait sa part de cet avantage. Mais le voleur peut répondre : 1° L'avantage direct qui me vient du vol est plus grand que le dommage indirect que j'éprouve comme membre de la collectivité, spécialement si l'on considère que mon abstention du vol n'a pas pour conséquence que d'autres s'abstiennent également de voler ; 2° Il est vrai que si tout le monde ou un grand nombre de gens volaient, le dommage indirect, en beaucoup de cas, l'emporterait sur l'utilité directe ; mais je ne désire nullement que tous volent je désire, au contraire, fortement que tous soient honnêtes et moi seul voleur [FN: § 1496-1] .
§ 1497. Nous trouvons une dérivation semblable dans celle qui fut quelque temps en usage pour défendre la solidarité. On disait que tous les hommes sont mutuellement dépendants ; et même, pour donner plus de force à l'argument, on faisait ressortir la dépendance mutuelle de tous les êtres (§ 449) ; on observait que les animaux dépendent des végétaux, ceux-ci des minéraux, et l'on concluait que, chaque homme dépendant des autres, il ne peut réaliser son bonheur qu'en contribuant à celui des autres. L'énumération est incomplète. Outre le genre de dépendance où A réalise son bonheur en contribuant à celui de B, C..., il y a aussi le genre de dépendance où A réalise son bonheur au détriment de B, C... ; par exemple, le loup qui mange les moutons, le maître qui exploite ses esclaves [FN: § 1497-1] . Le raisonnement dont nous avons parlé tout à l'heure est puéril et ne peut être accepté que par des personnes déjà persuadées.
§ 1498. (III-γ) Intérêt collectif. Si cet intérêt est réel, et si l'individu accomplit logiquement des actions en vue de cet intérêt, il n'y a pas de dérivation : nous avons simplement des actions logiques dont le but est d'atteindre un résultat voulu par l'individu. Il existe des résidus (IVe classe) qui poussent cet individu à exécuter ces actions. Mais, le plus souvent, le but objectif diffère du but subjectif (§ 151), et nous avons des actions non-logiques qu'on justifie par des dérivations. Ce genre de dérivations est très usité par qui veut obtenir quelque chose et feint de le demander, non pour lui, mais pour une collectivité. Un certain nombre de politiciens veulent quelque chose pour eux-mêmes ; ils le demandent pour le parti, pour le pays, pour la patrie. Certains ouvriers veulent améliorer leur condition, et demandent une amélioration pour les « prolétaires », pour la «classe ouvrière ». Certains industriels veulent obtenir des faveurs du gouvernement pour leur industrie, et les demandent pour l’industrie en général, pour les travailleurs. Depuis plus d'un demi-siècle, les « spéculateurs » (§ 2235) ont déployé tant d'habileté qu'ils ont obtenu des faveurs toujours croissantes des pouvoirs publics, au nom de l'intérêt des classes laborieuses, ou même de « l'intérêt public ».
1499. Pour trouver des exemples de cette dérivation, il suffit de lire une partie seulement des innombrables écrits en faveur de la protection douanière, de l'augmentation des dépenses publiques, et de nombreuses mesures par lesquelles les « spéculateurs » s'approprient l'argent de ceux qui ont des recettes fixes ou presque fixes, des « rentiers » (§ 2235). En politique, toutes les classes dominantes ont toujours confondu leur intérêt avec celui du pays entier. Quand les politiciens craignent l'augmentation excessive du nombre des prolétaires, ils sont malthusiens et démontrent que c'est dans l'intérêt du public et du pays. Quand ils craignent, au contraire, de ne pas avoir une population suffisante pour leurs desseins, ils sont anti-malthusiens, et démontrent également bien que c'est dans l'intérêt du public et du pays. Tout cela est accepté, tant que durent les résidus favorables à de telles dérivations ; tout cela est changé, lorsqu'ils se modifient ; jamais en vertu de raisonnements.
§ 1500. Ce genre de dérivations est si connu que l'idée est commune d'y faire rentrer presque tous les autres. On suppose explicitement ou implicitement que celui qui fait usage de raisonnements défectueux est de mauvaise foi, et qu'il emploierait de bons raisonnements s'il était de bonne roi. Cela est en dehors de la réalité. On peut fort bien s'en rendre compte par le grand nombre de dérivations importantes, voire très importantes, que nous exposons dans ce chapitre.
§ 1501. (III-δ) Entités juridiques. L'homme qui vit dans les sociétés civilisées se familiarise avec certaines relations morales ou juridiques qui façonnent, pour ainsi dire, son existence, dont s'imprègne son esprit, et qui finissent par faire partie de sa mentalité ; puis, par la persistance des agrégats, par la tendance à donner un caractère absolu à ce qui est relatif, il les étend au delà des limites entre lesquelles elles peuvent avoir une valeur. Elles n'étaient applicables qu'à certains cas et à certaines circonstances, et il les applique à n'importe quel cas, quelle circonstance. De cette façon prennent naissance la conception d'une morale absolue et celle d'un droit absolu. Ensuite, l'homme dont nous parlons suppose que ces relations, nées et développées avec la société, ont préexisté à celle-ci, qui en tire son origine. Ainsi surgissent les théories du « pacte », du « contrat social », de la « solidarité », avec son annexe, la « dette sociale », de la « paix par le droit », etc. Non content de cela, il étend aux animaux, aux êtres vivants en général, même aux inanimés, les relations juridiques et morales qui existent entre les hommes. Il va même jusqu'à étendre aux choses le pouvoir que la parole a parfois sur les hommes. De là l'idée des charmes magiques ; et la parole devient un puissant moyen d'agir sur les choses ; elle fait mouvoir et arrête les astres mêmes. Dans ces phénomènes, les résidus (I-β 1) entrent en jeu. Grâce à eux, certaines analogies, vraies ou supposées, nous poussent à étendre à un objet les caractères et les propriétés d'un autre objet. Le fond de ces phénomènes est donné par la persistance des agrégats, la forme par les dérivations au moyen desquelles on tâche de donner une apparence logique à ces actions non-logiques. Comme d'habitude, dans les phénomènes concrets, on a un mélange de différentes actions non-logiques, de dérivations et d'actions logiques par lesquelles ou cherche à tirer profit des actions non-logiques existantes ; mais cela revient à démontrer l'existence de ces actions non-logiques, car on ne peut utiliser ce qui n'existe pas, ni en tirer profit. Étant donnée la persistance des agrégats, par laquelle les hommes étendent les relations juridiques à des cas dans lesquels elles n'ont rien à faire, il est des personnes qui se prévalent de cette persistance pour parvenir à leurs fins ; mais il est évident qu'elles ne pourraient le faire, si cette persistance n'existait pas. Les gens habiles emploient les moyens qu'ils trouvent. Au moyen âge, ils profitaient des procès aux morts et aux animaux ; aujourd'hui, ils profitent des déclamations sur la « solidarité » ; demain, ils trouveront un autre expédient. Dans l'histoire, nous voyons des peines juridiques infligées à des êtres qui ne sont pas des hommes vivants : à Athènes, chez les anciens Hébreux, dans nos pays, au moyen âge, et même en des temps plus récents. Comme d'habitude, si nous ne connaissions qu'un seul genre de ces faits, nous demeurerions dans le doute sur la partie à considérer comme constante (résidus), et la partie à considérer comme variable (dérivations) ; mais le doute disparaît quand nous prêtons attention aux différents genres qui nous sont connus, et nous voyons que les dérivations d'un genre ne sont pas employées pour les autres genres. À Rome, la persistance des agrégats qui agit, paraît être principalement celle des rapports du chef de famille avec les liberi qui sont en son pouvoir [FN: § 1501-1], ou avec les esclaves ; et si nous ne connaissions que des faits de ce genre, nous ne pourrions affirmer que des actions juridiques ont été étendues aux animaux. Mais voici qu'à Athènes, apparaît l'action contre les animaux, indépendamment de leur propriétaire ; et même quand le procès est dirigé contre celui-ci, la personnalité de l'animal apparaît plus nettement [FN: § 1501-2] . On fait aussi procès contre les choses inanimées ; et Démosthène, s'opposant au décret qui voulait condamner sans jugement quiconque aurait tué Caridème, compare clairement le jugement des choses inanimées à celui des hommes, et dit qu'on ne peut ôter à ceux-ci une garantie qu'on accorde à celles-là [FN: §1501-3] . Une loi qu'on attribuait à Dracon [FN: § 1501-4] prescrivait de jeter hors des frontières le bois, les pierres, le fer qui, en tombant, auraient tué un homme. Platon reproduit cette loi, à l'instar d'autres lois anciennes, dans son livre sur Les Lois[FN: § 1501-5]. Aux choses inanimées, il ajoute les animaux qui auraient tué un homme ; et il faut remarquer que le cadavre du parricide doit, exactement de la même façon, être jeté hors des frontières de l'État. Pausanias raconte [FN: § 1501-6] qu'à Thasos un rival de Théagène allait toutes les nuits frapper la statue de celui-ci. La statue, pour punir cet homme, tomba sur lui et le tua. « Les fils du mort ouvrirent une action en homicide contre la statue. Les Thasiens jetèrent la statue à la mer, suivant une loi de Dracon... » Mais ensuite leur pays devint stérile, et l'oracle de Delphes en donna pour cause qu'ils avaient oublié le plus grand de leurs concitoyens ; aussi recherchèrent-ils la statue et la replacèrent-ils là où elle était primitivement. Que tout cela soit de la fable ou une légende issue de quelque fait historique, peu importe, puisque nous avons à prêter attention uniquement aux sentiments de ceux qui composèrent et de ceux qui accueillirent le récit ; et chez ces personnes apparaît avec évidence la persistance (les agrégats, en vertu desquels nous voyons une statue avoir des rapports juridiques analogues à ceux d'un homme. Enfin, nous avons, à Athènes, le procès fictif pour le meurtre du bœuf [FN: § 1501 note 7] ; où l'on peut voir, si l'on veut, des phénomènes de totémisme, mais où apparaît certainement aussi l'extension aux animaux des relations juridiques fixées pour les hommes. Pline raconte [FN: § 1501-8] qu'en Afrique on mettait en croix des lions pour effrayer les autres. Dans la Bible, on trouve plusieurs passages qui font clairement allusion à l'extension aux animaux de relations juridiques s'appliquant aux hommes [FN: § 1501 note 9].C'est de ces passages qu'aux siècles passés on tira en partie les dérivations ayant pour but de justifier cette extension ; tandis que d'un autre côté il ne manqua pas de gens qui, par d'ingénieuses dérivations, s'efforcèrent de donner un sens logique à ces passages. Le procès fait au cadavre du pape Formose [FN: § 1501-10] est demeuré célèbre. « (p. 274) Un jugement solennel contre Formose fut ordonné : (p. 275) le mort fut cité à comparaître en personne devant le tribunal d'un Synode [nous verrons plus loin qu'on citait de la même manière les animaux]. C'était en février ou en mars de l'an 897... Les Cardinaux, les Évêques et beaucoup d'autres dignitaires du clergé s'assemblèrent en synode. Le cadavre du pape, arraché à la tombe où il reposait depuis huit mois, fut revêtu des ornements pontificaux et déposé sur un trône, dans la salle du concile. L'avocat du pape, Stéphane, se leva, se tourna vers cette momie horrible, aux côtés de laquelle siégeait un diacre tremblant qui devait lui servir de défenseur [les animaux auront aussi leur avocat] ; il porta les accusations, et le pape vivant, avec une fureur insensée, demanda au mort : « Pourquoi, homme ambitieux, as-tu usurpé la chaire apostolique de Rome, toi qui étais déjà évêque de Porto ? » L'avocat de Formose parla, dans sa défense, pour autant que la frayeur ne lui paralysa pas la langue. Le mort demeura convaincu et fut jugé [ainsi demeureront convaincus et jugés les animaux]. Le Synode signa le décret de déposition, et prononça la sentence de condamnation ». L'Inquisition fit aussi de nombreux procès aux morts. Le but était de s'emparer des biens laissés par eux à leurs héritiers ; le moyen était les préjugés populaires, parmi lesquels l'extension aux morts des relations juridiques des vivants n'était pas le dernier.
§ 1502. Dans nos contrées, les procès contre les animaux durent du XIIe, et même avant, jusqu'au XVIIIe siècle. Berriat Saint-Prix a compilé un catalogue de ces procès, principalement en France [FN: § 1502-1]. Une partie eurent lieu devant les tribunaux laïques, une partie devant les tribunaux ecclésiastiques. La procédure devant le tribunal civil était la même que si l'accusé avait été un être humain [FN: § 1502-2]. Même devant les tribunaux ecclésiastiques, on procédait de cette manière ; mais, en de nombreux cas, la procédure apparaît comme une adjonction, un moyen d'éviter de frapper des innocents des foudres de l'Église ; et nous avons des cas où l'on fait allusion seulement à ces innocents, et pas à l'Église [FN: § 1502-3]. Puis, sous l'action du sentiment qui étendait aux animaux les rapports juridiques, on voulut que le procès précédât la sentence. Des motifs accessoires contribuèrent ensuite à faire traîner le procès en longueur : d'abord le profit qu'en retiraient les hommes de loi ; ensuite, en des temps où le scepticisme allait croissant, il se peut que les autorités ecclésiastiques ne fussent pas entièrement persuadées de l'efficacité qu'avaient les foudres de l'Église pour détruire les animaux, et qu'il ne leur déplût point que, le procès traînant en longueur, les animaux disparussent naturellement, sans attendre d'être frappés d'excommunication. Autrement, il serait difficile de comprendre les longueurs de procès comme celui sur lequel Menabrea nous fournit d'amples renseignements [FN: § 1502-4]. Cet auteur nous donne d'autres exemples des dérivations qui se manifestaient dans ces procès. « (p. 100) Une procédure faite en 1451... dans le but d'expulser les sangsues qui infestaient les eaux du territoire de Berne..., nous fournit des détails très curieux touchant le mode en usage pour la citation. On envoyait un sergent ou huissier sur le local où se tenaient les insectes, et on les assignait à comparaître personnellement tel jour, à telle heure, par-devers le magistrat, aux fins de s'ouïr condamner à vider dans un bref délai les fonds usurpés, sous les peines du droit. Les insectes ne paraissant pas, on renouvelait volontiers jusqu'à trois fois l'assignation, pour que la contumace fût mieux établie... Comme on peut bien se l'imaginer, les défendeurs (p. 101) faisaient toujours défaut... on nommait donc un curateur ou un procurateur aux bestioles. Cet officier jurait de remplir ses fonctions avec zèle, avec loyauté ; on lui adjoignait ordinairement un avocat. C'est en servant de défenseur aux rats du diocèse d'Autun, que le fameux jurisconsulte Barthélemy Chassanée, qui mourut premier président du parlement de Provence, commença sa réputation... Quoique les rats eussent été cités selon les formes, il fit tant qu'il obtint que ses clients seraient de rechef assignés par les curés de chaque paroisse, attendu, disait-il, que la cause intéressant tous les rats, ils devaient tous être appelés. Ayant gagné ce point, il entreprit de démontrer que le délai qu'on leur avait donné était insuffisant ; qu'il eût fallu tenir compte non seulement de la distance des lieux, mais encore de la difficulté du voyage, difficulté d'autant plus grande que les chats se tenaient aux aguets et occupaient les moindres passages ; bref, amalgamant la Bible aux auteurs profanes, amoncelant textes sur textes, et épuisant les ressources de l'érudite éloquence de ce temps-là, il parvint à faire (p. 102) proroger le terme de la comparution. Ce procès rendit Chassanée fort recommandable ».
§ 1503. Tout cela nous semble ridicule ; mais qui sait si, dans quelques siècles, les élucubrations de notre temps sur la solidarité ne seront pas tout aussi ridicules, et si l'invention de M. Bourgeois, d'une dette qui, à chaque instant s'éteint et à chaque instant renaît, ne semblera pas digne de figurer à côté de la défense des rats, soutenue par Chassanée. Il ne manquait pas de jurisconsultes et de théologiens qui estimaient qu'on ne pouvait étendre aux bêtes les procédures instruites contre les êtres raisonnables, et parmi les théologiens, nous ne trouvons rien moins que Saint Thomas [FN: § 1503-1]. Mais tout cela ne suffit pas à empêcher ces procédures ; de même que de nos jours rien ne sert d'avoir montré le manque de sens du « contrat social », de la doctrine de la « solidarité », de la « paix par le droit », de la Christian Science, et d'autres semblables théories fantaisistes, pour empêcher qu'on ne continue à employer ces dérivations [FN: § 1503-2] . Comme d'habitude, l'homme voit la paille qui est dans l'œil de son prochain et pas la poutre qui est dans le sien.
§ 1504. Les dérivations changent de forme pour s'adapter aux circonstances, le but qu'elles doivent atteindre restant le même. Parmi ceux qui estiment que la société humaine est née d'une convention, d'un pacte ou d'un contrat, plusieurs théoriciens ont parlé comme s'ils décrivaient un phénomène historique : un beau jour, des hommes qui ne vivaient pas encore en société se seraient assemblés quelque part, et auraient constitué la société, tout comme on voit aujourd'hui des hommes s'assembler pour constituer une société commerciale.
§ 1505. Cette conception apparaissant manifestement absurde, on a cherché à la rendre quelque peu raisonnable en abandonnant le domaine de l'histoire, et l'on a dit que les relations qui constituent la société existent, non parce que cette constitution a été effectivement établie par des hommes ne vivant pas encore en société, mais parce que ces relations doivent exister comme si cette constitution s'était réalisée [FN: § 1505-1] . Par exemple, c'est la façon dont les fidèles de Rousseau défendent maintenant les théories de leur maître. Mais, qu'on place le contrat social à l'origine des sociétés, au milieu ou à leur terme, il n'en demeure pas moins que les parties contractantes disposent de choses qui ne sont pas en leur pouvoir, puisque l'homme est un animal sociable qui ne peut vivre seul, sauf peut-être en des cas exceptionnels où il se trouverait réduit à une extrême misère. C'est pourquoi, au point de vue de la logique formelle, le raisonnement ne tient pas, même sous sa forme nouvelle.
§ 1506. Ensuite, on ne comprend pas pourquoi il ne s'applique pas aussi aux sociétés animales, comme celles des fourmis et des abeilles. Si nous supposons que seul le raisonnement et les déductions logiques peuvent conserver la société humaine, en empêcher la dissolution, comment expliquerons-nous que les sociétés des fourmis et des abeilles durent et se conservent ? Si, au contraire, nous admettons que ces sociétés sont maintenues par l'instinct, comment pourrons-nous nier que cet instinct joue aussi un rôle dans les sociétés humaines ?
§ 1507. La théorie de Rousseau est au fond celle de Hobbes ; mais, ainsi qu'il arrive d'habitude avec les dérivations, l'un de ces auteurs aboutit à une conclusion opposée à celle de l'autre. Aujourd'hui, c'est la théorie de Rousseau qui est en vogue, parce que nous vivons à une époque démocratique ; demain, la théorie de Hobbes pourrait prévaloir, si des temps favorables au pouvoir absolu revenaient ; et quand viendrait un temps favorable à une autre organisation sociale, on aurait bientôt fait de trouver la dérivation qui, toujours en partant de l'hypothèse du contrat social, aboutirait à des conclusions s'adaptant à cette organisation. Le point de départ et le point auquel on doit arriver sont fixes, parce qu'ils correspondent à certains résidus qui forment la partie constante du phénomène; avec un peu d'imagination, on trouve facilement une dérivation qui unisse ces points. Si une dérivation ne plaît pas, on en trouve d'autres, et pourvu qu'elles s'accordent avec certains résidus existant chez les hommes auxquels on s'adresse, il est à peu près certain qu'ils l'accueilleront favorablement.
§ 1508. Dans ce genre de dérivations, il faut ranger les théories de « la paix par le droit ». On a l'habitude d'objecter à ces théories que le droit sans la force qui l'impose n'a que peu ou point de valeur, et que si l'on fait emploi de la force, la guerre, chassée d'un côté, revient de l'autre. Cette objection ne se soutient qu'en partie. 1° De nombreuses règles de la vie sociale sont imposées sans qu'on fasse emploi de la force ; et il n'est pas absurde d'admettre que, sinon toutes les règles d'un certain droit international, au moins une partie d'entre elles sont imposées par l'opinion publique, par des sentiments existant chez les individus ; c'est ce qui arrive partiellement, en réalité. 2° La guerre ne disparaîtrait pas, mais deviendrait plus rare, quand une force internationale imposerait un certain droit ; de même que les actes de violence diminuent dans une société où la force du pouvoir public s'impose aux particuliers. D'un plus grand poids, et de beaucoup, est l'objection qui vise le terme de droit, lequel, dans ce cas, ne correspond à rien de précis. Les différents peuples dits civilisés occupent des territoires par la force, et il n'est pas possible de trouver un autre motif pour justifier les répartitions territoriales actuelles. Les justifications qu'on a tenté de donner se résolvent en des sophismes souvent puérils. Si la Pologne avait été plus forte que la Prusse, comme elle le fut aux temps passés, elle aurait pu conquérir la Prusse ; ayant été plus faible que la Prusse unie à la Russie et à l'Autriche, elle fut conquise par ces trois puissances. Si la Russie avait été plus forte que le Japon, elle aurait conquis la Corée ; au contraire, le Japon se l'est appropriée par la force des armes. Cela seul est réel ; le reste n'est que vain discours [FN: § 1508-1].
§ 1509. De même, pour les différentes classes sociales, il est impossible de trouver un droit capable de distribuer entre elles la richesse sociale. Les classes qui ont plus de force, d'intelligence, d'habileté, de ruse, etc., que d'autres, se font la part du lion. On ne voit pas comment on pourrait démontrer des principes d'une autre répartition, et surtout pas comment, si on les avait démontrés, on pourrait les imposer et les appliquer dans la vie réelle. Chaque homme a certainement son principe d'une répartition idéale pour lui : principe qui souvent n'est que l'expression de ses sentiments et de ses intérêts individuels ; et c'est ce principe qu'il s'imagine être le droit. Telle est la dérivation habituelle au moyen de laquelle on change le nom pour faire accepter la chose.
§ 1510. (III-ε) Entités métaphysiques. Dans ces dérivations, on recherche l'accord avec certaines unités étrangères au domaine expérimental. Au fond, c'est un accord de sentiments qui agit, une combinaison de résidus ; mais la forme est donnée par l'intervention de ces entités, qui sont étrangères à l'expérience, sans être surnaturelles. Pour dériver, on emploie principalement les résidus (II-δ), (II-thêta), auxquels, comme d'habitude, on en ajoute d'autres, dans les différents cas particuliers. Au point de vue logico-expérimental, il y a peu ou point de différence entre ces dérivations et celles qui font intervenir des divinités personnifiées [FN: § 1510-1] .
§ 1511. Les dérivations métaphysiques sont principalement à l'usage des gens cultivés. Le vulgaire, du moins dans nos pays, est porté à revenir de ces abstractions aux personnifications. Sans doute, il serait absurde de croire que, parmi nos contemporains, il y a des gens qui se représentent la Solidarité sous la forme d'une belle femme, comme les Athéniens se représentaient la déesse Athéna. Cependant, pour notre vulgaire, la Solidarité, le Progrès, l'Humanité, la Démocratie, ne figurent pas dans la même classe que de simples abstractions, telles qu'une surface géométrique, l'affinité chimique, l'éther lumineux [FN: § 1511-1] : elles sont dans des régions beaucoup plus élevées ; ce sont des entités puissantes, et qui font le bien du genre humain.
§ 1512. Dans ce domaine, l'évolution d'Auguste Comte est très remarquable. Il est poussé par une force irrésistible à attribuer des caractères concrets à ses abstractions, et va jusqu'à personnifier l'Humanité sous la forme du Grand-Être, à parler de la Terre, comme si elle était une personne, et à recommander l'adoration de l'espace sous la forme du Grand Milieu. Comme nous l'avons déjà observé (§ 1070 et sv.), ces sentiments constituent un agrégat confus dans l'esprit de nombreuses personnes, qui ne se préoccupent nullement de le diviser en ses parties aliquotes, ni de savoir où finit l'abstraction et où commence la personnification.
§ 1513. On trouve cette dérivation dans tous les raisonnements où l'on invoque la Raison, la Droite Raison, la Nature, les fins de l'homme ou d'autres fins semblables, le Bien, le Souverain Bien, le Juste, le Vrai, le Bon, le Droit, et maintenant spécialement la Science, la Démocratie, la Solidarité, l'Humanité, etc. Ce ne sont que des noms qui indiquent des sentiments indistincts et incohérents.
§ 1514. Il est une entité célèbre : l'entité métaphysique imaginée par Kant et admirée encore par tant de gens. Elle s'appelle Impératif catégorique [FN: § 1514-1]. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent savoir ce que c'est, mais ils ne réussissent malheureusement pas à le faire comprendre à ceux qui veulent rester dans la réalité. La formule de Kant concilie, comme d'habitude, le principe égoïste avec le principe altruiste, qui est représenté par la « loi universelle ». Celle ci flatte les sentiments d'égalité, de sociabilité, de démocratie. Enfin, beaucoup de gens ont accepté la formule kantienne pour conserver la morale usuelle, tout en se soustrayant à la nécessité de la placer sous la dépendance d'un dieu personnel. On peut faire dépendre cette morale de Jupiter, du Dieu des chrétiens, de celui de Mahomet, de la volonté de cette respectable dame qui porte le nom de Nature, ou de l'éminent Impératif catégorique : cela revient au même. Kant donne encore une autre forme à sa formule : « (p. 60) N'agis que d'après une maxime telle que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle ». Le caractère habituel de ces formules est d'être si indéterminées qu'on peut en tirer tout ce qu'on veut ; aussi aurait-on plus vite fait de dire : « Agis comme il plaît à Kant et à ses disciples », puisque, de toute façon, la « loi universelle » finira par être éliminée.
§ 1515. La première question qui se pose, quand on cherche à comprendre quelque chose à ces termes de la formule, est de savoir si 1° la « loi universelle» dépend de quelque condition ; ou bien si 2° elle ne dépend d'aucune condition. Autrement dit, cette loi doit-elle s'exprimer dans les sens suivants : 1° Tout homme qui a les caractères M doit agir d'une certaine façon ? Ou bien : 2° Tout homme, quels que soient ses caractères, doit agir d'une certaine façon ?
§ 1516. Si l'on accepte la première façon de s'exprimer, la loi ne signifie rien, et la difficulté consiste maintenant à fixer les caractères M qu'il convient d'envisager ; car si l'on s'en remet à l'arbitraire de celui qui doit observer la loi, il trouvera toujours moyen de choisir des caractères tels qu'il puisse faire tout ce qu'il veut, sans transgresser la loi. S'il veut justifier l'esclavage, par exemple, il dira comme Aristote qu'il y a des hommes nés pour commander (parmi lesquels, bien entendu, se trouve le digne interprète de la loi) et d'autres hommes nés pour obéir. S'il veut voler, il dira que le principe d'après lequel celui qui possède moins prend à celui qui possède davantage, peut fort bien être une loi universelle. S'il veut tuer son ennemi, il dira que la vendetta peut très bien être une loi universelle ; et ainsi de suite.
§ 1517. Par la première application qu'il fait de son principe, il semblerait que Kant repousse cette interprétation [FN: § 1517-1]. Sans faire de distinctions d'individus, il recourt au principe suivant lequel le suicide ne pourrait être une loi universelle de la nature.
§ 1518. Voyons maintenant la seconde manière d'interpréter la loi, manière suivant laquelle le raisonnement de Kant, cité tout à l'heure, pourrait tant bien que mal être soutenu. Il y a une autre difficulté : c'est que, pour appliquer la formule, toute la race humaine devrait constituer une masse homogène, sans la moindre différenciation dans les emplois des individus. Il est possible, si l'on fait des distinctions, que certains hommes commandent et que d'autres obéissent ; c'est impossible si l'on ne fait pas de distinctions ; car il ne peut y avoir une loi universelle d'après laquelle tous les hommes commandent si aucun n'obéit. Un homme veut passer sa vie à étudier les mathématiques. Si l'on fait des distinctions, il peut le faire sans transgresser la loi kantienne, car il peut bien y avoir une loi universelle d'après laquelle celui qui possède certains caractères M, passe sa vie dans l'étude des mathématiques, et celui qui ne possède pas ces caractères cultive les champs ou fait autre chose. Mais si l'on ne veut pas de distinctions, si l'on ne veut pas, ainsi qu'on ne l'a pas voulu dans le cas du suicide, séparer les hommes en classes, il ne peut y avoir une loi universelle d'après laquelle tous les hommes passent leur vie à étudier les mathématiques, ne serait-ce que parce qu'ils mourraient de faim, et par conséquent personne ne doit passer sa vie à cette étude. On n'aperçoit pas ces conséquences, parce qu'on raisonne avec le sentiment, et non en se plaçant en présence des faits.
§ 1519. Comme le font souvent les métaphysiciens, Kant, après nous avoir donné un principe qui devrait être unique – à ce qu'il dit – en ajoute ensuite d'autres qui surgissent on ne sait d'où.
Le troisième cas considéré par Kant est le suivant : « (p. 63) Un troisième se reconnaît un talent [là, nous trouvons des conditions dont on ne parlait pas dans le cas de l'homme qui se suicide ; pourquoi n'a-t-on pas dit alors : Un individu se reconnaît un tempérament tel que pour lui la vie est souffrance et non bonheur ?] qui peut, au moyen de quelque culture, le rendre un homme propre à toutes sortes d'emplois. Mais il se trouve dans des circonstances honorables, et préfère s'adonner au plaisir, au lieu de prendre la peine d'étendre et de perfectionner ses heureuses dispositions [FN: § 1519-1] ». Il veut savoir si cela peut être une loi naturelle. La réponse est affirmative, au moins sous un certain aspect. « (p. 63) Il aperçoit alors qu'à la vérité une nature est compatible encore avec une telle loi, fût-elle universelle, bien que l'homme (comme les habitants des îles de la mer du Sud) laissât ses talents sans culture et ne songeât qu'à passer sa vie dans l'oisiveté, les amusements, les plaisirs... [FN: § 1519-2] ». Donc, il paraîtrait, si nous voulons rester strictement attachés à la formule qu'on nous a donnée pour unique, que la chose pouvant être une loi universelle, est licite. Mais, au contraire, il n'en est pas ainsi : « (p. 64) ... mais il est impossible qu'il puisse vouloir que ce soit là une loi universelle de la nature, ou qu'elle eût été mise en nous comme telle par l'instinct naturel [dans la formule, on ne nous parle pas de cet instinct naturel]. En effet un être raisonnable veut nécessairement que toutes ses facultés soient développées en lui, parce qu'elles lui sont toutes données pour lui servir à atteindre toutes sortes de fins [FN: § 1519-3] ». Voilà un nouveau principe : certaines choses données [on ne sait par qui] en vue de certains buts.
Pour raisonner de cette façon, il faut modifier la formule de Kant et dire : « N'agis que d'après une maxime telle que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. D'autre part, ne te laisse pas tromper par cet adjectif possessif ta ; dire ta volonté, ce n'est qu'une façon de parler ; en réalité, c'est la volonté qui doit nécessairement exister chez l'homme, tout compte fait de ce qui lui a été donné, de ses fins et d'autres belles choses qui seront indiquées en temps et lieu ». Cela posé, on pourrait aussi se passer, au point de vue logico-expérimental, de la volonté, puisqu'elle est de toute façon éliminée. Mais il n'en est pas ainsi au point de vue du sentiment. Cette invocation à la volonté est nécessaire pour avoir l'appui du sentiment égoïste, et donner, à celui qui écoute, la satisfaction de concilier ce sentiment avec le sentiment altruiste.
D'autres sentiments sont aussi éveillés par ce principe de la « loi universelle ». D'abord celui d'une règle absolue, imposée par la Nature, dominant la mesquinerie des conflits humains, dépassant les discussions captieuses. Puis cet agrégat de sentiments qui nous font voir confusément l'utilité qu'il y a à ce que les sentences des juges soient motivées, qu'elles invoquent des règles générales, que les lois soient aussi faites suivant ces règles, et non pour ou contre un individu donné.
§ 1520. Remarquons en passant que cette utilité existe réellement, car cet état de choses met aussi un frein au caprice, comme le ferait la règle de Kant ; mais cette utilité n'est pas très grande, puisque, si l'on veut, on trouve toujours moyen de donner une apparence de généralité à une décision particulière. Si, parmi A, B, C, ... on veut favoriser ou léser A, on cherche, et l'on trouve toujours, un caractère par lequel A diffère de B, C, ... et l'on décide en considérant ce caractère, par conséquent avec une apparence de généralité. Laissons de côté l'autre manière, très en usage, de décider en général et d'appliquer en particulier, avec ou sans indulgence. Ainsi, dans nos lois, on trouve encore celle qui punit l'agression en général ; mais en particulier on ferme un œil et même les deux sur les agressions commises par les grévistes au détriment des « renards ».
En Italie, avant la guerre de 1911, on laissait insulter impunément les officiers. Un député put diffamer un officier, pour des motifs exclusivement d'ordre privé, qui n'avaient rien de politique, et, bien que condamné par les tribunaux, il ne fit jamais un jour de prison, pas même après son échec aux nouvelles élections. La guerre venue, on sauta de l'autre côté de la selle. Des personnes furent injuriées et frappées impunément, uniquement parce qu'elles ne se levaient pas quand on jouait la Marche royale, à la Scala de Milan.
§ 1521. Les théologiens scrutent la volonté de Dieu, et Kant scrute celle de la Nature. D'une manière ou de l'autre, nous n'échappons pas à ces investigations, aussi profondes que difficiles et imaginaires.
« (p. 14) Nous admettons comme principe qu'on ne trouve dans la nature d'un être organisé, c'est-à-dire d'un être destiné à vivre de manière à atteindre une fin, aucun organe qui ne soit merveilleusement approprié à cette fin [FN: § 1521-1]. [C'est là une réminiscence de la célèbre théorie des causes finales]. Si donc un être doué de la raison et de la volonté est chargé de sa conservation, de l'accroissement de son bien-être, en un mot, de son bonheur, et que ce soit là proprement la fin que la nature [qu'est-ce que cette entité ?] lui destine, on devrait alors trouver en lui une disposition conforme à cette fin. [Ce ne sont là que des affirmations arbitraires sur la fin arbitraire d'une entité arbitraire]. Mais il semble que cette créature serait très défectueuse si la nature avait chargé sa raison d'atteindre elle-même le but qu'elle lui destine [FN: § 1521-2] [cela pourrait être favorable à la théorie des actions non-logiques] ».
Tout ce raisonnement procède par affirmations arbitraires sur des choses fantaisistes ; il est véritablement puéril. Et pourtant beaucoup de personnes l'ont accepté et l'acceptent ; aussi est-il évident qu'elles ne peuvent être mues que par des sentiments que cette poésie métaphysique excite agréablement. Cela confirme, une fois de plus, l'importance des dérivations ; cette importance n'est pas du domaine de l'accord d'une théorie avec les faits, mais bien de celui de l'accord de cette théorie avec les sentiments.
§ 1522. D'une façon générale, ainsi que nous l'avons souvent répété, il ne faut pas s'arrêter à la forme des dérivations, mais rechercher dans le fond qu'elles recouvrent s'il y a des résidus qui ont quelque importance pour l'équilibre social. Aux nombreux exemples déjà donnés, nous ajoutons le suivant, et ce ne sera pas le dernier.
En août 1910, l'empereur allemand fit, à Kœnigsberg, un discours dont on parla beaucoup. Il disait :
« Ici, de sa propre autorité, le Grand Électeur s'est proclamé souverain ; ici, son fils a posé sur sa tête la couronne royale ; ici, mon grand-père, toujours de sa propre autorité, a posé sur sa tête la couronne royale de Prusse, démontrant clairement qu'il ne la recevait pas d'un parlement ni d'une assemblée populaire, mais qu'il recevait son pouvoir de la grâce de Dieu, qu'il se considérait comme l'exécuteur de la volonté du Ciel, et qu'en cette qualité, il croyait avoir le droit de porter la couronne impériale... Nous devons être prêts, considérant que nos voisins ont fait d'énormes progrès ; seule, notre préparation assurera la paix. C'est pourquoi je suis mon chemin, exécuteur, moi aussi, de la volonté divine, sans me soucier des mesquineries de la vie quotidienne, vouant ma vie au bien-être et au progrès de la patrie, et à son développement dans la paix. Mais pour faire cela, j'ai besoin du concours de tous mes sujets ».
Nous avons, dans ce discours, une dérivation du genre (III-γ).
Les partis d'opposition s'élevèrent contre ce discours, et l'accusèrent d'être « un cri de guerre contre le peuple et la représentation populaire », en parfaite contradiction avec la « conception moderne de l'État », une invocation du principe suranné du droit divin, opposé au « principe moderne du droit du peuple ». Ce sont là autant de dérivations du genre (III-δ), avec une tendance vers le genre (III-γ) le « droit du peuple » n'étant pas très différent du « droit divin » des rois.
§ 1523 Nous ne devons pas nous laisser-induire en erreur par le terme peuple, qui paraît indiquer une chose concrète. Sans doute, on peut appeler peuple l'agrégat des habitants d'un pays, et, dans ce cas, c'est une chose réelle, concrète. Mais c'est uniquement en vertu d'une abstraction hors de la réalité, que l'on considère cet agrégat comme une personne ayant une volonté et le pouvoir de la manifester. D'abord, d'une manière générale, pour que cela soit, il serait nécessaire que cet agrégat puisse comprendre les questions et être capable de volonté à leur sujet. Cela n'arrive jamais ou presque jamais. Ensuite, pour descendre au cas particulier, il est certain que, parmi les Allemands, il en est qui approuvent le discours de l'empereur, comme il en est qui le désapprouvent. Pourquoi ceux qui le désapprouvent auraient-ils le privilège de s'appeler « peuple » ? Ceux qui l'approuvent ne font-ils pas également partie du « peuple » ? Dans des cas de ce genre, on répond habituellement que c'est la majorité qu'on désigne par le nom de « peuple ». Alors, si l'on veut être précis, on ne devrait pas opposer au droit divin le droit du peuple, mais bien le droit de la majorité du peuple ; mais on n'exprime pas l'idée sous cette forme, pour ne pas en diminuer la force. Cette majorité est presque toujours une nouvelle abstraction. Généralement, on désigne par ce terme la majorité des hommes adultes, les femmes étant exclues. De plus, même en ces termes restreints, très souvent on ne sait pas ce que veut précisément cette majorité. On s'approche de la solution du problème dans les pays où existe le referendum ; mais dans ce cas encore, comme une partie souvent importante des hommes adultes ne vote pas, c'est uniquement par une fiction légale qu'on suppose que la volonté exprimée par les votants – pour autant qu'ils ont tous compris ce qu'on leur demande – est la volonté de la majorité. Dans les pays où n'existe pas le referendum, ce n'est que grâce à une longue série d'abstractions, de fictions, de déductions, que l'on arrive à faire équivaloir à la volonté du peuple la volonté d'un petit nombre d'hommes.
§ 1524. Il convient de remarquer que ceux qui croient à la « volonté du peuple » ne sont pas le moins du monde d'accord sur la façon dont elle se manifeste, et que leurs dissentiments ressemblent à ceux des orthodoxes et des hérétiques d'une religion quelconque. Ainsi, un profane pourrait croire qu'en France, sous Napoléon III les plébiscites manifestaient la « volonté du peuple ». Il tomberait dans l'erreur, comme y tombaient ces chrétiens qui estimaient que le Père doit être antérieur au Fils. Ces plébiscites ne manifestaient aucunement la « volonté du peuple »; tandis que la volonté de la majorité des Chambres de la troisième République la manifeste excellemment. Chaque religion a ses mystères, et celui-ci n'est après tout pas plus obscur que tant d'autres.
Dans tous les pays, quand on discute de réformes électorales, chaque parti s'occupe de ses intérêts, et accepte la réforme qu'il estime lui être la plus profitable [FN: § 1524-1] , sans se préoccuper beaucoup de la vénérable « expression de la volonté générale ». Beaucoup de « libéraux » refusent d'accorder le droit de vote aux femmes, parce qu'ils craignent qu'elles ne soient « réactionnaires », tandis que, justement pour ce motif, beaucoup de réactionnaires acceptent ce droit. En France, les radicaux ont en sainte horreur le referendum populaire : la « volonté générale » doit être exprimée par leur bouche, autrement elle n'est pas la « volonté générale ». En Italie, à l'extension du droit de vote n'a certes pas été étrangère l'espérance qu'ont eue des hommes politiques astucieux de s'en servir à leur avantage. En Allemagne, Bismarck l'accueillit comme une arme contre la bourgeoisie libérale. Il semblerait que les partisans de la représentation proportionnelle fassent exception ; mais beaucoup d'entre eux sont favorables à ce mode de représentation, parce qu'ils le considèrent comme un moyen d'obtenir, sans une lutte trop vive, sans courir les risques d'une bataille, une petite place autour de l'assiette au beurre.
§ 1525. La « conception moderne de l'État » est une autre abstraction. La conception manifestée par l'empereur est aussi celle de beaucoup d'hommes « modernes » ; qui dira pourquoi elle n'a pas droit à cette épithète de « moderne » ? Remarquons ici l'enthymème. Le raisonnement est le suivant : « La conception exprimée par l'empereur est contraire à la conception moderne de l'État ; donc elle est mauvaise ». Le syllogisme complet serait : « La conception exprimée par l'empereur est contraire à la conception moderne de l'État ; tout ce qui est contraire à la conception moderne de l'État est mauvais ; donc la conception de l'empereur est mauvaise ». On a supprimé la majeure, parce que c'est précisément la proposition qui appelle l'attention sur le point faible du raisonnement.
§ 1526. Maintenant, laissons de côté les dérivations, et cherchons le fond qu'elles recouvrent. Nous envisageons ainsi un cas particulier d'un problème général, relatif à l'utilité sociale, problème qui sera traité spécialement au chapitre XII. Ici, un très bref aperçu suffira. Dans toutes les collectivités, il y a deux genres d'intérêts : le genre des intérêts présents et le genre des intérêts futurs. De même, dans les sociétés anonymes, on doit trancher cette question : convient-il de répartir une part plus ou moins grande des bénéfices comme dividende aux actionnaires, ou d'en conserver plus ou moins pour renforcer les finances de la société ? On a différentes solutions, selon les circonstances et la composition des assemblées d'actionnaires.
§ 1527. Pour les peuples, l'intérêt des générations présentes est souvent opposé à l'intérêt des générations futures. L'intérêt matériel que perçoit presque exclusivement une partie de la population, est en opposition avec des intérêts de genres différents ; tel celui de la prospérité future de la patrie, qui est perçu surtout par une autre partie de la population, et que la première partie dont nous parlions tout à l'heure perçoit uniquement sous la forme d'un des résidus de la persistance des agrégats.
§ 1528. Les différents gouvernements sont portés à donner une importance différente à ces intérêts. Ainsi, la république romaine a eu, sous le même nom, des tendances diverses, suivant que le Sénat ou le peuple prévalait. Si nous écartons le voile des dérivations, nous trouvons, dans le discours de l'empereur allemand, l'affirmation des intérêts de la patrie, en opposition avec les intérêts temporaires d'une partie de la population. Dans les discours des adversaires, nous trouvons le contraire. Ainsi ceux-ci comme celui-là s'expriment par des dérivations aptes à émouvoir les sentiments, car il n'y a pas d'autre moyen de se faire entendre du vulgaire.
§ 1529. Le discours de l'empereur est beaucoup plus clair que celui de ses adversaires. Dans la proposition : « C'est pourquoi je poursuis mon chemin, exécuteur, moi aussi, de la volonté divine, sans me soucier des mesquineries de la vie quotidienne », remplacez « exécuteur de la volonté divine » par « représentant des intérêts permanents de la patrie », et vous aurez une proposition qui se rapproche du genre scientifique. Le motif pour lequel les contradicteurs sont moins clairs se trouve dans le fait qu'en Allemagne, le résidu du patriotisme est très fort, et qu'il est par conséquent difficile de dire trop clairement que l'on préfère les intérêts présents aux intérêts futurs et permanents de la patrie. Si l'on voulait traduire le discours impérial dans le langage de la science expérimentale, il conviendrait de commencer par rappeler que, si Bismarck, soutenu par la volonté de son souverain, n'avait pas gouverné contre la volonté de la Chambre populaire, l'empire allemand n'aurait peut-être pas pu être constitué. Le 7 octobre 1862, le Landtag prussien rejetait le budget par 251 voix contre 36. Les intérêts temporaires d'une partie de la population étaient en conflit avec les intérêts permanents de la patrie. Le roi Guillaume se décida à intervenir en faveur de ces derniers. Sous la signature de Bismarck, il décréta, le 13 octobre, la clôture de la session, et gouverna sans se préoccuper de l'approbation de cette assemblée.
Partant de ces observations, on conclurait du passé au futur. Les raisonnements des sciences expérimentales cherchent dans le passé le moyen de connaître l'avenir. On suit donc ces raisonnements, quand on recherche si, en certaines circonstances, on peut espérer qu'un moyen employé précédemment, et qui a eu un certain effet, peut encore être employé avec l'espoir d'obtenir un effet semblable.
Essayons de traduire aussi dans le langage de la science expérimentale les discours des adversaires de l'empereur. Parmi ces personnes, les plus logiques sont les socialistes, qui considèrent comme nuisible l'œuvre de Bismarck. Elles sont opposées aux intérêts que défendait Bismarck en 1862, et restent logiquement opposées aux intérêts semblables que défend l'empereur en 1910. Elles veulent exprimer que les intérêts présents des ouvriers doivent prévaloir sur tout autre genre d'intérêts. Puisqu'enfin c'est une tendance très commune, dans l'Europe contemporaine, on ne s'éloigne pas beaucoup de la vérité en donnant à cette tendance le nom de « conception moderne de l'État »; et puisque la forme parlementaire du gouvernement semble favoriser cette tendance, il n'est pas si erroné d'opposer la majorité parlementaire aux droits du souverain. Moins logiques sont les partis bourgeois qui font opposition à l'empereur, alors qu'en somme ils veulent précisément ce qu'il veut ; mais ils sont poussés à suivre cette voie par le désir de satisfaire un grand nombre de sentiments, sans se demander s'il n'en est pas d'inconciliables. Cette manière d'agir est fréquente en politique, et souvent très utile à un parti.
L'analyse que nous venons de faire pourrait être répétée pour la plus grande partie des manifestations de l'activité sociale. Grâce à elle, nous pouvons parvenir à nous former une certaine conception des forces qui déterminent l'équilibre social.
§ 1530. Les entités métaphysiques peuvent s'affaiblir jusqu'à être à peine perceptibles ; elles apparaissent d'une manière effacée dans certains accords de sentiments, et servent uniquement à leur donner une couleur intellectuelle. On en trouve souvent dans les explications des us et coutumes. Par exemple, on salue, on révère, on adore le soleil, parce qu'il est le principe de la vie sur la terre. On a cru que l'on pouvait prolonger la vie d'une personne en sacrifiant des enfants, comme si la vie était un fluide qui passe d'un être à un autre. En vertu de la même conception, un homme avancé en âge a pu croire prolonger sa vie en dormant à côté d'une jeune femme. Des ressemblances souvent imaginaires sont transformées en utilités métaphysiques, et servent à expliquer des faits. En général, le rôle de ces entités est de donner une apparence logique aux résidus de l'instinct des combinaisons (Ie classe).
§ 1531. Le concept métaphysique peut être sous-entendu. On a ainsi des dérivations qui se rapprochent beaucoup des dérivations par accord de sentiments (§ 1469), et qui peuvent être confondues avec elles. On en trouve un exemple remarquable dans le fait de ces métaphysiciens qui réfutent la science logico-expérimentale en ayant recours aux principes mêmes qu'elle déclare faux, et qui veulent à tout prix trouver l'absolu dans les raisonnements où l'on ne fait que leur répéter que tout est relatif. Ils opposèrent aux conclusions de la science expérimentale, et cela leur parut être un argument sans réplique, que pour obtenir des conséquences nécessaires, il faut avoir un principe supérieur à l'expérience. Si l'on ne savait pas que les hommes peuvent, en certaines matières, employer des dérivations absurdes, et en d'autres matières raisonner correctement, on se demanderait comment il est possible qu'il y ait des gens à l'esprit assez obtus, pour n'avoir pas encore compris que la science expérimentale n'a pas, ne cherche pas, ne désire pas, ne peut avoir de conséquences nécessaires (§ 976) ; que l'absolu contenu dans ce concept de nécessité lui est entièrement étranger, et qu'elle cherche uniquement des conséquences valables entre certaines limites de temps et d'espace. Maintenant, ces savantes personnes ont fait une belle trouvaille que la race des perroquets, toujours et partout nombreuse, répète sans se lasser. Aux déductions expérimentales tirées d'un certain nombre de faits, elles opposent qu'on n'a pas examiné tous les faits, et concluent, d'une manière plus ou moins explicite, que ces déductions ne sont pas nécessaires, ou bien qu'elles ne sont pas universelles ; et c'est fort bien : ces personnes sont en cela parfaitement d'accord avec les adeptes de la science expérimentale, et enfoncent une porte ouverte ; mais il est vraiment ridicule qu'elles s'imaginent avoir découvert que la science expérimentale ne fait pas ce que sur tous les tons elle dit, répète et ressasse ne pas vouloir faire. Enfin, il n'est de pires sourds que ceux qui ne veulent pas entendre, et s'il y a des gens qui s'obstinent à ne pas vouloir comprendre que la science expérimentale ne recherche rien qui soit nécessaire, universel, ou qui ait quelque autre semblable qualité absolue, il n'y a qu'à les laisser dans leur ignorance, et rire de leurs attaques contre la science expérimentale, comme on rit de celles de Don Quichotte contre les moulins à vent.
La science expérimentale est dans un perpétuel devenir, justement parce que tous les jours on découvre de nouveaux faits ; et par conséquent, tous les jours on peut devoir modifier les conclusions tirées des faits jusqu'alors connus. Qui se livre à des études scientifiques est semblable à un tailleur qui, chaque année, fait des habits pour un enfant. Celui-ci grandit, et chaque année le tailleur doit faire un habit à une mesure différente. Soit A, B, C,... P, la série des faits connus jusqu'à présent, en une science donnée, et dont on tire certaines déductions. Demain, on découvre de nouveaux faits, Q, R. Par conséquent, la série est prolongée ; elle devient A, B, C,... P, Q, R, et l'on peut en tirer encore les mêmes déductions que précédemment, ou bien on doit les modifier plus on moins, ou bien encore les abandonner entièrement. Tel a été jusqu'à présent le processus de toutes les sciences logico-expérimentales, et rien ne porte à croire qu'il sera différent à l'avenir.
§ 1532. Il y a plus. Nous ne pouvons pas aujourd'hui tirer de déductions universelles, parce que les faits Q, R, qu'on découvrira demain, nous sont encore inconnus, et il peut arriver que nous ne voulions pas non plus tirer de déductions générales des faits A, B, C,... P, qui nous sont connus, mais qu'au contraire, nous voulions les séparer en différentes catégories, et tirer, des déductions partielles de la catégorie A, B, C, d'autres déductions partielles de la catégorie D, E, F, et ainsi de suite. Ce procédé est général ; il est l'origine de toute classification scientifique.
Ainsi que nous l'avons déjà observé (§ 1166-1] ), si, après avoir choisi et mis ensemble les faits A, B, C, parce qu'ils ont un caractère commun X, nous énoncions la proposition suivante : ces faits ont ce caractère, nous ferions un simple raisonnement en cercle. Mais des propositions du genre des suivantes sont réellement des théorèmes. Il existe un certain nombre de faits où l'on trouve le caractère X. Là où il y a le caractère X existe aussi le caractère Y. Par exemple, nous choisissons les animaux qui allaitent leur progéniture, et nous les appelons mammifères. Ce serait raisonner en cercle que de dire : les mammifères allaitent leur progéniture. Mais les propositions suivantes sont des théorèmes : il existe un très grand nombre d'animaux qui allaitent leur progéniture ; – les animaux qui allaitent leur progéniture sont à sang chaud. Tout cela est plus que simple et élémentaire, mais est oublié, négligé, ignoré, en vertu d'une dérivation où existe, au moins implicitement, le principe de l'absolu, et sous l'empire de sentiments correspondant à ce principe. Le métaphysicien, habitué à raisonner d'une certaine façon, devient incapable d'entendre un raisonnement de nature entièrement différente. Il traduit dans sa langue, et par conséquent déforme les raisonnements exprimés dans la langue des sciences expérimentales, qui lui est entièrement étrangère et inconnue.
§ 1533. (III-ζ) Entités surnaturelles. Dans l'exposé d'une théorie, dans l'écrit qui la contient, il peut y avoir plus ou moins de récits de faits expérimentaux ; mais la théorie elle-même réside dans les conclusions qui sont tirées de ces prémisses, réelles ou imaginaires ; elle est ou n'est pas logico-expérimentale, et objectivement, il n'est pas question de plus ou de moins. Nous ne pouvons rien connaître de ce qui arrive en dehors du domaine expérimental ; c'est pourquoi le problème de savoir si une théorie s'en éloigne plus ou moins n'a aucun fondement objectif. Mais on peut poser le problème au point de vue des sentiments, et nous pouvons rechercher si certaines théories paraissent au sentiment s'éloigner plus ou moins de la réalité expérimentale. La réponse est différente, suivant les diverses classes de personnes. Nous pouvons, tout d'abord, les diviser en deux catégories : (A) les personnes qui, dans cette recherche, emploient rigoureusement la méthode logico-expérimentale ; (B) les personnes qui ne l'emploient que peu ou point. En outre, il faut faire attention qu'il y a des matières qui ne comportent qu'un genre d'explications. Ici, nous traitons des matières où l'on trouve les divers genres d'explications : expérimentales et non-expérimentales.
(A) Nous n'avons pas à nous occuper ici de cette catégorie. Laissons de côté les quelques hommes de science qui distinguent clairement ce qui est expérimental de ce qui ne l'est pas. Pour eux, l'ordre des théories, quant à leur contenu expérimental, est simplement le suivant ; l° théories logico-expérimentales ; 2° théories qui ne sont pas logico-expérimentales.
(B) Cette catégorie doit être divisée en genres, suivant l'emploi plus ou moins étendu, plus ou moins perspicace, plus ou moins judicieux, que l'on fait de la méthode logico-expérimentale.
(a) Aujourd'hui, et parfois quelque peu aussi dans le passé, les personnes cultivées qui font un usage plus ou moins étendu des méthodes logico-expérimentales, et aussi les personnes moins cultivées qui subissent l'influence des premières, s'imaginent que les personnifications s'éloignent beaucoup plus du domaine expérimental que les abstractions. On est entraîné dans cette voie, en partie par la confusion qu'on établit, spontanément ou à dessein, entre ces abstractions et les principes expérimentaux. Ainsi le contenu expérimental paraît décroître dans l'ordre suivant : 1° faits expérimentaux ; 2° principes pseudo-expérimentaux ; 3° abstractions sentimentales ou métaphysiques ; 4° personnifications, divinités. Des excroissances se produisent ensuite, par exemple celle des hégéliens, qui réduisent tout à la troisième catégorie ; mais les hommes qui suivent cette doctrine sont toujours peu nombreux, voire très peu nombreux, et le plus grand nombre des personnes, fussent-elles cultivées, ne comprend même pas ce qu'ils veulent dire. Les mystères de la métaphysique vont de pair avec les mystères de n'importe quelle autre religion.
b) Pour les gens sans culture, quand ils ne subissent pas l'influence des personnes cultivées et de leur autorité, l'ordre est différent. Les personnifications semblent se rapprocher de la réalité, beaucoup plus que toute autre abstraction. Il n'y a pas besoin de faire un grand effort d'imagination pour transporter chez d'autres êtres la volonté et les idées qu'on observe habituellement chez l'homme. On conçoit beaucoup plus facilement Minerve que l'intelligence abstraite. Le Dieu du Décalogue est plus facile à comprendre que l'impératif catégorique. L'ordre du contenu expérimental devient donc : 1° faits expérimentaux ; 2° principes pseudo-expérimentaux ; 3° personnifications, divinités ; 4° abstractions sentimentales ou métaphysiques. Là aussi des excroissances se produisent ; ainsi celles des mystiques, des théologiens et autres, qui confondent toutes les parties indiquées, dans celle qui concerne exclusivement la divinité. Les hommes qui suivent ces doctrines sont en nombre beaucoup plus grand que les métaphysiciens purs ; toutefois, chez les peuples civilisés, ils demeurent peu nombreux en comparaison de la population totale.
c) Enfin, pour les gens qui, ou bien ne sont pas capables de s'occuper de spéculations théologiques, métaphysiques, scientifiques, ou bien les ignorent, volontairement ou non, ou bien ne s'en occupent pas, quelle qu’en soit la raison, il reste uniquement : 1° faits expérimentaux; 2° principes pseudo-expérimentaux. Ces deux catégories se confondent et donnent une masse homogène où l'on trouve, par exemple, des remèdes expérimentaux et des remèdes magiques. Là aussi se produisent des excroissances, telles que le fétichisme et d’autres semblables. Un grand nombre, un très grand nombre de personnes ont pu ou peuvent s'approprier ces idées, auxquelles le nom de doctrines ne convient plus.
§ 1534. Nous savons déjà que l'évolution ne suit pas une ligne unique, et que par conséquent l'hypothèse d'une population qui, de l'état (c) passerait à l'état (b), puis à l'état (a) (§ 1536), serait en dehors de la réalité ; mais pour arriver au phénomène réel, nous pouvons partir de cette hypothèse, et y ajouter ensuite les considérations qui nous rapprocheront de la réalité. Si donc, par hypothèse, une population passe successivement par les trois états (c), (b), (a), il résulte des considérations que nous avons faites, que la masse des actions non-logiques de (c) et des explications rudimentaires qu'on en donne, produira peu à peu les explications par voie de personnifications, puis, par le moyen d'abstractions, les explications métaphysiques. Mais, parvenus à ce point, nous devons nous arrêter, si nous voulons envisager l'ensemble d'une population ; car, jusqu'à présent, on n'a jamais vu, nous ne disons pas une population entière, mais seulement une partie importante d'une population, parvenir à donner des explications exclusivement logico-expérimentales, et atteindre ainsi l'état (A). Il ne nous est vraiment pas donné de prévoir si cela pourra jamais arriver. Mais si nous considérons un nombre restreint, voire très restreint, de personnes cultivées, on peut dire que, de notre temps, il y a des personnes qui se rapprochent de cet état (A) ; et il pourrait aussi arriver, bien que le moyen de le démontrer nous fasse défaut, qu'à l'avenir, il y ait un plus grand nombre de personnes qui atteignent entièrement cet état.
Une autre conséquence des considérations que nous avons faites est que, pour être compris par le plus grand nombre de gens, même s'il s'agit des personnes cultivées, il faut parler le langage qui convient aux états (a) et (b), tandis que le langage propre de l'état (A) n'est pas et ne peut pas être compris.
§ 1535. Le phénomène hypothétique décrit ici s'écarte du phénomène réel, principalement sur les points suivants : 1° Nous avons séparé les matières qui admettent et celles qui n'admettent pas différents genres d'explication. En réalité elles sont mélangées, et l'on passe par degrés insensibles d'un extrême à l'autre. 2° Nous avons encore substitué des variations discontinues aux variations continues, en séparant les états (a), (b), (c). En réalité, il y a une infinité d'états intermédiaires. Pourtant, cette manière de s'exprimer ne serait pas un grand mal, car enfin il est presque toujours nécessaire de suivre cette voie, quand on ne peut faire usage des mathématiques. 3° La déviation par laquelle nous avons considéré la population comme homogène, tandis qu'elle est au contraire hétérogène, est d'une plus grande importance que les deux précédentes. Il est vrai que l'état d'une classe influe sur celui d'une autre ; mais il ne s'ensuit pas qu'on doive réduire ces classes à l'unité. La division de la société en une partie cultivée et une partie inculte est très grossière ; en réalité, les classes à considérer sont plus nombreuses. Pour donner une forme tangible à ces considérations, soient A, B, C, D,... différentes couches d'une population. Une certaine évolution porte l'état A à une position m, ce qui influe sur B, outre l'action générale de l'évolution, et porte cet état en n. Mais la résistance de B agit aussi sur A, de manière que la position m n'est pas donnée seulement par le sens général de l'évolution, mais aussi par la résistance de B. On peut faire de semblables considérations, en envisageant plusieurs couches A, B, C,... au lieu des deux seules que nous venons d'indiquer. En conclusion, l'état de la population sera représenté par la ligne m, n, p, q,... qui passe par les points m, n, p, q,... auxquels sont parvenues les diverses couches, par l'action générale de l'évolution et par les actions et réactions réciproques des différentes couches. Si, au lieu des nombreuses couches, on en considère une seule, par exemple A, on représente le résultat général de l'évolution, l'état général de la population par la ligne mx, qui peut différer beaucoup de l'état réel m, n, p... 4° Plus grande encore est la déviation de la réalité et l'erreur d'avoir considéré une évolution unique, là où il y en a plusieurs, et de l'avoir envisagée comme uniformément croissante en un certain sens, tandis qu'elle est généralement ondulée. 5° Enfin, puisque nous traitons ici exclusivement de dérivations, l'erreur de confondre l'évolution de celles-ci avec l'évolution générale de la société ne devrait pas être à craindre ; car cette évolution comprend non seulement celle des dérivations, mais aussi les évolutions des sciences logico-expérimentales, des résidus, de l'action des sentiments, des intérêts, etc. Pourtant il est bon de rappeler cette erreur, parce qu'on a l'habitude de la commettre, spécialement les personnes qui ne distinguent pas bien les actions logiques des actions non-logiques.
§ 1536. Le phénomène hypothétique décrit précédemment pour l'ensemble d'une population a été vu tant bien que mal par A. Comte, et constitue le fond de sa célèbre théorie des états fétichiste, théologique, métaphysique, positiviste. Il envisage une évolution qu'on pourrait dire semblable à l'évolution (c), (b), (a), (A), (fig. 17), mais avec les restrictions que nous allons voir. Avec le Cours de Philosophie positive, il tombe en plein dans l'erreur que nous avons indiquée au n° 5. L'évolution des explications des phénomènes naturels est pour lui l'évolution de l'état social. Plus tard, il corrigea en partie cette erreur, dans le Système de Politique positive, et fit « explicitement dominer le sentiment » (§ 286) ; mais avec cela il tomba dans des erreurs plus grandes (§ 284 et sv.). Comte était très éloigné du scepticisme expérimental, qu'il haïssait même profondément. C'était un dogmatique ; aussi exposa-t-il sa théorie, non telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire comme une première et grossière approximation, mais comme si elle avait une valeur précise et absolue. Et pourtant, il avait entrevu l'erreur que nous avons relevée au n° 3. Il ne lui avait pas échappé que, dans la réalité, on observait un certain mélange des couches intellectuelles [FN: § 1536-1]. En conclusion, pour nous reporter à la fig. 17, Comte veut substituer la ligne mx à la ligne réelle m, n, p, q,... pour avoir l'état de la société composée des couches A, B, C,... et il s'en tire en donnant à la ligne mx le nom de « vrai caractère philosophique des temps correspondants » ; tandis que la ligne m, n, p, q,... qui correspond à la réalité, n'est pas jugée digne de l'épithète vraie. L'emploi de semblables épithètes est un procédé général, usité justement pour faire croire que de nombreuses choses se réduisent à une seule, qui est celle que veut l'auteur. C'est aussi un procédé général que d'employer une suite d'affirmations (Ie classe) substituées aux démonstrations logico-expérimentales, en dissimulant sous l'abondance des mots la pauvreté du raisonnement [FN: § 1536-2] .
§ 1537. Une autre erreur très grave de A. Comte consiste à avoir donné de la philosophie positive une définition qui ne correspond en rien à l'emploi qu'il fait de ce terme, dans la suite de ses ouvrages [FN: § 1537-1]. Selon sa définition, la philosophie positive correspondrait à l'état (A), et l'évolution serait (c), (b), (a), (A); mais ensuite, la philosophie positive de Comte devient une sorte de métaphysique, et l'évolution s’arrête à la succession (c), (b), (a); ou bien, si l'on veut faire une concession à A. Comte, à la succession (c), (b), (a), (a 1) ; où l'on désigne par (a 1) un état dans lequel le sentiment range dans l'ordre suivant, en commençant par celle qui s'en éloigne le moins les théories qui s'écartent du domaine expérimental: 1° faits expérimentaux et interprétations positivistes de ces faits, c'est-à-dire la métaphysique positiviste ; 2° les autres métaphysiques ; 3° les théologies. Déjà dans le Cours de philosophie positive, on voit apparaître la tendance de l'auteur, non pas seulement à coordonner les faits, comme il le dit, mais bien à les interpréter suivant certains principes a priori existant dans son esprit. Cela est très différent de ce que nous promettait l'auteur, et n'est en somme que le procédé usité par toute autre métaphysique. Comme preuve de la tendance que nous avons relevée, on pourrait citer tout le Cours de Philosophie positive. À chaque pas, nous trouvons qu'au moyen des épithètes vrai, sain, nécessaire, inévitable, irrévocable, accompli, l'auteur tâche de soumettre les faits à ses idées, au lieu de les coordonner et d'y soumettre ses idées [FN: § 1537-2]. Mais tout cela n'est rien en comparaison des développements métaphysiques qui surabondent dans le Système de politique positive, et surtout en comparaison des abstractions divinisées qui apparaissent dans la Synthèse subjective. En conclusion, A. Comte a suivi personnellement une évolution qui, en gros, peut être exprimée de la façon suivante : 1° explications expérimentales, ou mieux pseudo-expérimentales ; 2° explications métaphysiques, quand il accordait encore la prédominance à l'intelligence sur le sentiment (§ 284 et sv.); 3° explications théologiques, quand il accorde la prédominance au sentiment, et spécialement quand, au dernier terme de l'évolution, dans la Synthèse subjective, il divinise ses abstractions. De cette façon, il a évolué dans une direction contraire à celle qu'il suppose dans les sociétés humaines.
§ 1538. Nous nous sommes arrêté quelque peu sur le cas de A. Comte, parce qu'il met en relief une grave erreur qui est générale, spécialement de notre temps, et qui consiste à supposer que les dérivations des personnifications s'écartent beaucoup plus de la réalité expérimentale que les dérivations métaphysiques ; tandis qu'au contraire il n'y a entre elles qu'une différence de forme. En somme, on exprime la même idée en disant comme Homère [FN: § 1538-1] : « Ainsi s'accomplissait la volonté de Zeus » ; ou bien comme disent les modernes : « Ainsi s'accomplit ce qu'impose le Progrès ». Qu'on personnifie ou non le Progrès, la Solidarité, une Humanité meilleure, etc., cela importe peu, au point de vue du fond expérimental.
§ 1539. Au point de vue de la forme de la dérivation, la personnification s'écarte davantage de l'abstraction métaphysique, lorsqu'on suppose qu'elle manifeste une volonté au moyen d'une révélation, de la tradition ou par d'autres semblables moyens pseudo-expérimentaux, ce qui constitue le genre de dérivations (II-γ) ; tandis qu'au contraire la personnification tend à se confondre avec l'abstraction métaphysique, lorsqu'on recherche l'accord, de celle-ci et de celle-là avec certaines réalités. Les dérivations de ce genre constituent une grande partie des théologies et des métaphysiques.
§ 1540. Il est important de remarquer un moyen employé pour connaître la volonté divine, avec laquelle les actions des hommes doivent s'accorder. Il consiste à supposer que Dieu doit agir comme un homme de bon sens, et vouloir ce que celui-ci veut. En somme, la volonté divine disparaît donc de la conclusion, et la volonté de l'homme de bon sens ou supposé tel subsiste seule (§ 1454-1). Nous avons ainsi un nouveau cas de la méthode générale de raisonnement, dans lequel on élimine un X non-expérimental (§ 480). Même quand on a recours à la révélation contenue dans l'Écriture Sainte, si l'on admet une interprétation un peu étendue, allégorique ou d'un genre semblable, on finit par éliminer cette révélation, et, somme toute, l'accord se fait uniquement avec les sentiments de celui qui interprète cette Écriture. Comme en d'autres cas semblables, le besoin que l'on éprouve d'avoir une dérivation au lieu d'une simple affirmation est remarquable. Au point de vue expérimental, la simple affirmation a la même valeur, souvent même vaut mieux, parce qu'on ne peut la réfuter. Mais là agissent les résidus (I-ε) du besoin de développements logiques ou pseudo-logiques.
§ 1541. Saint Augustin veut expliquer le passage de la Genèse où il est dit que le firmament sépare les eaux qui sont au-dessous de celles qui sont au-dessus [FN: § 1541-1] . Il objecte : « (2) Beaucoup de gens affirmaient, en effet, que les eaux, par leur nature, ne peuvent être sur le ciel sidéral » ; et il blâme la réponse qui s'en remet à l'omnipotence divine : « Il ne faut pas réfuter ceux-ci, en disant qu'en présence de l'omnipotence de Dieu, à qui toute chose est possible, nous devons croire que l'eau, bien que tellement pesante, comme nous le savons et le sentons, est au-dessus du corps céleste où sont les astres ». Et pourtant il eût été plus prudent de suivre cette voie, et de ne pas s'embarrasser dans les explications physiques, quelque peu fantaisistes, qu'il estime opportun de donner.
§ 1542. Comme d'habitude, par de semblables dérivations, ou peut toujours prouver également bien le pour et le contre. Le principe que Dieu agit comme un homme de bon sens sert à démontrer la « vérité » des Saintes Écritures, et sert également à en montrer la « fausseté » [FN: § 1542-1]. Inutile d'ajouter qu'au point de vue logico-expérimental, ni l'une ni l'autre de ces démonstrations n'ont la moindre valeur (2). Même au point de vue exclusivement logique, en laissant de côté toute expérience, on ne peut concilier la notion d'un Dieu omniscient avec la conception que l'homme peut juger l'œuvre de ce Dieu. En effet, l'ignorant est absolument incapable de comprendre ce que fait l'homme de science dans son laboratoire, et beaucoup de personnes ne sont pas, en cette matière, meilleurs juges que l'ignorant. On voit donc combien vaine est la prétention de ceux qui veulent, avec des connaissances rudimentaires, juger les œuvres de ceux qui possèdent des connaissances beaucoup plus étendues (§ 1995-1). De tels jugements, au sujet des personnifications, ont pour prémisse indispensable que la personnification soit faite, au moins mentalement, à l'image de celui qui la crée.
[887]
Chapitre X
Les dérivations (Suite)
§ 1543. IVe CLASSE. Preuves verbales. Cette classe est constituée par des dérivations verbales obtenues grâce à l'usage de termes d'un sens indéterminé, douteux, équivoque, et qui ne sont pas d'accord avec la réalité. Si l'on voulait entendre cette classification dans un sens très large, elle s'appliquerait à presque toutes les dérivations qui ne correspondent pas à la réalité ; elle comprendrait ainsi presque toutes les dérivations, et il n'y aurait plus lieu de distinguer la IVe classe des autres. Aussi est-il bon de restreindre le sens de la définition aux cas où le caractère verbal de la dérivation est bien tranché et l'emporte sur les autres. Il convient de ranger dans cette classe les sophismes logiques, en ce qui concerne le partie purement formelle, qui servent à satisfaire le besoin de raisonnements logiques éprouvé par les hommes (résidus I-ε). Mais cette partie est presque toujours accessoire : elle ne détermine pas le jugement de celui qui accepte la dérivation. Ce jugement est déterminé en vertu d'une partie beaucoup plus importante : les sentiments éveillés par le raisonnement. Comme d'habitude, ces sophismes logiques ne trompent que les personnes déjà disposées à se laisser induire en erreur ; ou, pour mieux dire, il n'y a d'erreur en aucune sorte. L'auteur du raisonnement et ceux qui l'acceptent se comprennent entre eux, grâce à un accord mutuel de sentiments, accord auquel ils donnent, comme toujours, la couleur du sophisme logique.
§ 1544. Dans les preuves verbales, les résidus qu'on emploie le plus pour dériver sont ceux qui donnent corps à une abstraction ayant un nom, qui prêtent une réalité à cette abstraction parce qu'elle a un nom, ou qui, vice versa, supposent qu'à un nom doit nécessairement correspondre une chose. Ce sont là les résidus (II-ζ). Ensuite, d'autres résidus de la IIe classe agissent aussi, et de même on trouve souvent les résidus (I-γ), qui unissent mystérieusement les noms aux choses. Enfin, il y a d'autres résidus, suivant les cas particuliers. Les résidus indiquent le désir d'atteindre un but ; et l'accomplissement de ce désir est obtenu au moyen de divers artifices, que le langage permet de mettre facilement en œuvre.
§ 1545. Ainsi que nous l'avons fait remarquer plusieurs fois, les termes du langage ordinaire ne correspondent généralement pas à des choses bien déterminées ; par conséquent, tout raisonnement dans lequel on emploie ces termes est exposé au danger de n'être autre chose qu'une dérivation verbale. Le danger est minime dans les raisonnements scientifiques, parce qu'on a toujours présentes à l'esprit les choses dont les noms employés sont de simples indications, semblables à des étiquettes ; il augmente dans les dérivations qui enlèvent ce caractère d'étiquettes aux termes : et, en suivant cette voie, on arrive aux dérivations métaphysiques, auxquelles ne manque presque jamais le caractère de dérivations verbales.
§ 1546. Un terme qui, employé dans un syllogisme, est susceptible de prendre plusieurs sens, peut donner à ce syllogisme plus de trois termes, et par conséquent le rendre faux. Très souvent, c'est le moyen terme qui, par son indétermination, rend le syllogisme faux. On passe d'un extrême, où l'on a un simple calembour, que personne ne prend au sérieux, à un autre extrême, où l'on a un raisonnement qui paraît profond, justement parce qu'il est obscur et indéterminé. Supposons le raisonnement : A est X, X est B, donc A est B. Si X a deux sens entre lesquels il ne peut y avoir confusion, par exemple un canon d'artillerie et un canon de l'Église, on a une simple plaisanterie. Si i désigne un agrégat de sentiments complexe et indéterminé, certains sentiments prédominent dans la proposition A est X, d'autres, dans la proposition X est B. Par conséquent, en réalité X est double ; mais les gens ne s'en aperçoivent pas et admirent le raisonnement (§ 1607). Ainsi, si X est la Nature, la Droite Raison, le Bien ou autres entités semblables, on peut être presque certain, pour ne pas dire tout à fait certain, que le raisonnement est de ce genre. Par exemple : « On vit bien quand on vit selon la Nature ; la Nature n'admet pas la propriété ; donc on vit bien quand il n'y a pas de propriété ». Dans la première proposition, de l'agrégat confus de sentiments, désigné par le terme Nature, surgissent les sentiments qui séparent ce qui est conforme à nos tendances (ce qui nous est naturel), de ce que nous faisons uniquement par contrainte (ce qui nous est étranger, déplaisant, hostile), et le sentiment approuve la proposition : « On vit bien, quand on vit selon la Nature ». Dans la seconde proposition surgissent les sentiments qui séparent le fait de l'homme (ce qui est artificiel), de ce qui existe indépendamment de l'action de l'homme (ce qui est naturel) ; et là aussi, celui qui se laisse guider par le sentiment admet que la propriété n'est pas l'œuvre de la Nature, que la Nature ne l'admet pas. Ensuite, de ces deux propositions résulte logiquement que l'on vit bien quand on vit sans la propriété ; et si cette proposition est aussi admise par le sentiment de celui qui entend le raisonnement, il estime celui-ci parfait sous tous les rapports. En vérité, le raisonnement est parfait, en ce sens qu'il satisfait tous les désirs de celui qui écoute, y compris le désir d'une teinte logique de quelque dérivation (§ 963, 1602).
§ 1547. Dans les cas concrets, les dérivations de la IVe classe que nous séparons en genres, sont employées ensemble, et souvent aussi s'ajoutent à d'autres dérivations. Il ne faut jamais oublier que ce n'est que par abstraction que nous pouvons isoler les dérivations simples qui composent les dérivations complexes qu'on observe dans l’usage courant.
§ 1548. Dans les genres de la IVe classe, les dérivations revêtent deux formes ; sous la première, on va de la chose au terme ; sous la seconde, on va du terme à la chose, réelle ou imaginaire. Dans les cas concrets, fréquemment les deux formes se mêlent, et, après être allé de la chose au terme, on revient du terme à une autre chose. Tel est le fond d'un nombre infini de raisonnements. Comme nous l'avons déjà dit au § 108, on peut sortir du domaine logico-expérimental aussi bien en employant des termes qui correspondent à des entités qui ne se trouvent pas dans ce domaine, qu'en faisant usage de termes indéterminés qui correspondent mal à des entités expérimentales. C'est pourquoi, parmi les dérivations, nous trouvons l'usage de ces termes. Nous avons déjà vu un grand nombre de dérivations verbales, au chapitre V. Au § 658 nous avons remarqué comment on va de la chose au nom et du nom à la chose, et, dans les paragraphes suivants, nous avons fait voir les erreurs qui se produisaient ainsi, c'est-à-dire les divergences entre les dérivations et la réalité. Les théories suivant lesquelles, de l'étymologie on peut déduire la nature de la chose dont on connaît le nom (§ 686 et sv.), sont justement des dérivations verbales dans lesquelles on va du nom à la chose. À cette opération étymologique directe s'ajoute une opération étymologique inverse (§ 691). Toutes les considérations faites à ce sujet au chapitre V sont ici sous-entendues.
§ 1549. (IV-α) Terme indéterminé désignant une chose réelle, et chose indéterminée correspondant à un terme. Ce genre de dérivation est si fréquent qu'il fait rarement défaut dans les dérivations concrètes. C'est pourquoi nous en avons déjà souvent parlé, et nous devrons encore en parler souvent, à l'avenir. Ici, nous nous bornerons à traiter d'un cas typique.
§ 1550. Un sophisme célèbre, connu sous le nom de sorite, a donné beaucoup à faire aux logiciens. Vous avez un grain de blé ; vous en-ajoutez un autre : vous n'avez pas un tas de grains ; vous en ajoutez un autre : vous n'avez pas non plus un tas de grains ; continuez ainsi indéfiniment, et vous en viendrez à la conclusion qu'un amoncellement de grains aussi grand qu'on voudra n'est pas un tas de grains ! La conclusion est évidemment fausse. Mais où gît l'erreur du raisonnement ? Le sophisme se présente souvent d'une façon inverse : en diminuant un tas d'un grain à la fois, et en démontrant ainsi que le dernier grain qui reste est un tas. De ce genre est le sophisme de l'homme auquel on enlève, un à un, tous ses cheveux sans qu'il devienne chauve, lorsqu'il lui en reste un seul. Cicéron explique bien qu'on peut généraliser le sophisme [FN: § 1550-1] : « (29, 92) Ce n'est pas seulement pour un tas de grains, duquel vient le nom [de sorite], mais pour n'importe quelle autre chose, telles la richesse et la pauvreté, le clair et l'obscur, beaucoup et peu, le grand et le petit, le long et le court, le large et l'étroit, que nous n'avons pas de réponse, si nous sommes interrogés au sujet d'augmentations ou de diminutions insensibles ». Il s'en tire avec une dérivation de ce genre allant du terme à la chose : parce que certains termes existent, il s'imagine qu'il doit aussi exister des choses réelles correspondantes : « La Nature [quand elle entre en scène, le sophisme est certain] ne nous donne aucune connaissance des limites des choses ». Donc, il y a vraiment une chose qui correspond au terme long, mais dame Nature n'a pas daigné nous faire connaître quelles sont les limites du long, et par conséquent nous autres, malheureux, ne pouvons le distinguer du court. Et si, au lieu de choses, il y avait seulement des sentiments qui correspondent à ces termes ? Dame Nature serait innocente de toute faute, et ce serait nous qui aurions le tort de ne pas savoir exprimer nos sentiments avec une précision suffisante. Chrysippe avait inventé une méthode dite du repos, pour se soustraire au sophisme. Il dit que, lorsqu'on vous demande si trois c'est peu ou beaucoup, avant d'arriver à ce terme beaucoup, il faut vous reposer. À quoi Carnéade objecte que cela n'empêchera pas qu'on ne revienne vous demander si, en ajoutant un au nombre auquel vous vous êtes arrêté, on obtient un grand nombre [FN: § 1550-2] . De plus, voici les sceptiques qui adoptent la méthode du repos, de Chrysippe, et l'étendent à tout raisonnement [FN: § 1550-3] . Carnéade se servait de ce sorite pour prouver qu'il n'y avait pas de dieux [FN: § 1550-4] .
§ 1551. Les philosophes qui n'ont pas pu trouver l'erreur de ce sophisme en ont été empêchés par l'habitude du raisonnement métaphysique. Ils ne pouvaient reconnaître cette erreur, sans reconnaître en même temps que tous leurs raisonnements étaient erronés. En effet, l'erreur du sorite consiste à employer des termes qui sont indéterminés, ne correspondent à rien de réel, et qui peuvent seulement éveiller certains sentiments. Il n'y a rien d'objectif qui corresponde aux termes beaucoup et peu, grand et petit, pesant et léger, etc. Mais le métaphysicien auquel il arriverait de reconnaître cela, entendrait aussitôt opposer à ses plus beaux raisonnements que dans la même et identique classe des termes que nous venons de relever, se trouvent aussi ceux de bon et mauvais, beau et laid, honnête et malhonnête, juste et injuste, moral et immoral, etc. (§ 963). La réponse à faire au sorite est la suivante : « Définissez ce que vous entendez par le terme tas (ou amoncellement ou autre semblable), et nous vous répondrons. Par exemple, si vous dites que le tas est composé de mille grains, lorsque nous serons arrivés à 999 grains, et que vous en ajouterez un autre, nous dirons : Voilà le tas ! Et si vous ne voulez pas définir rigoureusement les termes qu'il vous plaît d'employer dans votre raisonnement, à nous, il ne nous plaît pas de répondre. C'est à celui qui veut une réponse qu'il appartient d’expliquer clairement sa demande ». C'est ce que l'on doit répondre, aujourd'hui encore, aux économistes qui cherchent la cause de la valeur. Veuillez nous dire, braves gens, ce qu'est exactement cette valeur. Apprenez-nous comment et pourquoi elle doit avoir une cause, et ensuite nous vous répondrons; mais pas avant ». Dans le langage vulgaire, le terme valeur a certainement un sens évident, de même que le terme tas ; malheureusement ces sens sont également indéterminés, et cette circonstance empêche de pouvoir employer l'un ou l'autre dans des raisonnements scientifiques [FN: § 1551-1] .
§ 1552. (IV-β ß) Terme désignant une chose, et qui fait naître des sentiments accessoires, ou sentiments accessoires qui font choisir un terme. Ce genre de dérivations joue un grand rôle dans l'éloquence judiciaire et en politique. Il est très efficace pour persuader, d'autant plus que les sentiments ainsi suggérés par les termes s'insinuent chez celui qui écoute, sans que celui-ci s'en aperçoive. Dans sa Rhétorique, Aristote donne de bons conseils à ce propos [FN: § 1552-1] . « (10) Si l'on veut favoriser une chose, on doit prendre la métaphore de ce qu'il y a de meilleur ; si l'on veut nuire, de ce qu'il y a de pire ». Et plus loin : « (14) Les épithètes peuvent être empruntées au pire ou au honteux, comme : [Oreste] matricide ; ou bien au meilleur, comme : vengeur de son père ». Pour des motifs semblables, le fait de rester fidèle à sa foi se nomme persévérance, si la foi est orthodoxe, obstination, si elle est hérétique. En 1908, les amis du gouvernement russe appelaient exécution l'acte par lequel le gouvernement donnait la mort à un révolutionnaire ; assassinat, l'acte par lequel les révolutionnaires tuaient ceux qui appartenaient au gouvernement. Les ennemis du gouvernement intervertissaient les termes : c'est le premier acte qui était un assassinat, le second qui était une exécution. On fait une interversion analogue entre les termes expropriation et vol [FN: § 1552-2].
Répondant à un député, le comte de Bismarck disait, en 1864, au Landtag de Prusse [FN: § 1552-3] : « M. le député nous a reproché ... de ne vouloir rien avoir de commun avec l'Allemagne. Il faut qu'il y ait un charme tout particulier dans ce mot : „ allemand “. On voit que chacun cherche à s'approprier ce mot-là ; chacun nomme „ allemand “ ce qui lui est utile, ce qui peut être profitable à son intérêt de parti, et l'on varie, suivant le besoin, la signification du mot. De là vient qu'à certaines époques ce qui s'appelle „ allemand “ c'est de faire de l'opposition à la Diète, tandis qu'en d'autres temps, on dit qu'il est „ allemand “ de prendre parti pour la Diète devenue progressiste ». Aujourd'hui, celui qui veut favoriser quelque chose doit l'appeler moderne, démocratique, humain, et mieux encore largement humain, progressiste. À pareil feu d'artillerie peu de gens résistent. Si l'on s'en tient au sens propre des mots, il semblerait qu'un libre penseur devrait être un homme qui ne veut que peu ou point de liens à la pensée, ou mieux à la manifestation de la pensée, car la pensée intérieure est libre, tout à fait libre, et l'on ne peut vouloir ôter des liens qui n'existent pas. Au contraire, en fait, le libre penseur est un croyant qui veut faire dominer sa religion et imposer des liens à la pensée de ceux qui n'ont pas ses opinions [FN: § 1552-4]. Celui qui veut la liberté, dans le sens d'ôter les liens, devrait vouloir que, sans liens, on puisse parler aussi bien pour que contre la religion catholique. Au contraire, les libres penseurs admettent qu'on attaque la religion chrétienne, ou mieux la religion catholique, et refusent la faculté de la défendre. Ils veulent empêcher aux prêtres d'enseigner ; ils veulent que l'État ait le monopole de l'enseignement, pour pouvoir imposer leurs théories, pour lier la pensée dans le sens qu'ils estiment bon. Nous n'entendons nullement rechercher ici si cela peut être utile ou non à la société ; nous disons seulement que celui qui procède de cette façon détourne le mot libre de son sens usuel et lui fait signifier à peu près le contraire de ce sens.
§ 1553. De même, lorsqu'on parle de liberté et des liens qui l'entravent, souvent on laisse exprès indéterminée la nature de ces liens, et l'on ne distingue pas s'ils sont acceptés volontairement, ou s'ils sont imposés par une puissance extérieure, bien que cette différence soit essentielle en la matière [FN: § 1553-1]. On entend souvent parler de la « tyrannie papale » ; et l'on emploie le même terme, que la soumission à l'autorité papale soit volontaire, ou qu'elle soit appuyée par le bras séculier. Pourtant ce sont des choses entièrement différentes. De même, on entend souvent accuser d'oppression les personnes qui veulent exclure un individu quelconque de leur compagnie, qui veulent l'excommunier ; et l'on ne distingue pas si cette excommunication implique des peines édictées par les pouvoirs publics, ou bien si elle n'a d'autre effet que celui d'exclure l'individu d'une compagnie privée. Pourtant ce sont là encore des choses bien différentes. En France, par exemple, l'excommunication au moyen âge et l'excommunication aujourd’hui sont des choses qui, sous le même nom, diffèrent entièrement quant au fond. Aujourd'hui, le non-catholique se soucie peu d'être excommunié, et ne craint nullement d'être persécuté par la force publique. Mais il y a beaucoup de gens qui voudraient intervertir les rôles, et qui demandent, au nom de la liberté, que le pouvoir public intervienne pour imposer leur compagnie à ceux qui n'en veulent pas. C'est là un changement complet du sens des mots. Littéralement, on appelle libre la condition dans laquelle chacun choisit à soit gré sa compagnie, sans l'imposer à d'autres et sans qu'elle lui soit imposée par d'autres. S'il vous plaît d'appeler libre l'état dans lequel on vous impose la compagnie qui vous déplaît et vous répugne, il faut aussi, si nous voulons nous entendre, trouver un autre mot pour désigner au contraire l'état dans lequel on ne vous impose pas d'accepter la compagnie qui ne vous plaît pas [FN: § 1553-2].
§ 1554. En vérité, le sort échu au terme liberté est assez comique. En beaucoup de cas, maintenant il signifie précisément le contraire de ce qu'il signifiait il y a cinquante ans ; mais les sentiments qu'il fait naître demeurent les mêmes ; c'est-à-dire qu'il désigne un état de choses favorable aux personnes qui en font usage ou qui l'acceptent. Si Pierre lie Paul, celui-ci appelle liberté l'absence de ce lien ; mais si, à son tour, Paul lie Pierre, il appelle liberté le renforcement de ce lien. Dans les deux cas le terme liberté suggère à Paul des sentiments agréables. Il y a un demi-siècle, on appelait, en Angleterre, « parti libéral » celui qui voulait réduire autant que possible les liens qui ôtent en partie à l'individu la faculté de disposer de sa personne et de ses biens. Aujourd'hui, ou nomme « parti libéral » celui qui veut augmenter ces liens. Alors, le parti « libéral » voulait réduire les impôts ; aujourd'hui, il les augmente. En France et en Italie, les « libéraux » d'autrefois demandaient avec insistance qu'il fût permis à l'individu de travailler quand il lui plaisait, et jetaient feu et flamme contre la « tyrannie des rois et des prêtres » qui l'obligeaient à chômer aux jours de fête [FN: § 1554-1]. En France, au temps de la Restauration, les « libéraux » et le gouvernement se faisaient une guerre à mort pour ce motif. Qui ne se souvient des lignes écrites par P.-L. Courier, à ce propos ? [FN: § 1554-2] Même jusqu'en 1856, la crainte de voir imposer le repos dominical pousse à la résistance le Sénat de l'Empire, pourtant si soumis et si domestiqué ; mais un sentiment violent pousse même l'agneau à se révolter. Le sénateur Lavalette [FN: § 1554-3] « (p. 11) propose d'ajouter au serment que devra prêter la régente, conformément au sénatus-consulte de 1813, celui de faire respecter les lois du Concordat, y compris les lois organiques et la liberté du culte. Le coup visait directement l'Impératrice, suspectée d'être favorable à la suppression du mariage civil, au repos dominical obligatoire, et à toutes les exagérations ultramontaines ». Quand vint la votation, l'amendement fut admis par 56 voix et rejeté par 64. Maintenant tout est changé. La doctrine « libérale » veut qu'on impose le repos dominical, auquel, pour faire plaisir aux anticléricaux, on a donné le nom de repos hebdomadaire. Les ultra libéraux demandent qu'on institue des inspecteurs d'État, qui empêchent le travail que pourrait faire le citoyen, enfermé à double tour dans son domicile. Pour justifier ces mesures, on recourt à une dérivation du genre (IV-β 2). On dit que permettre à un individu de travailler en certains jours lèse la liberté de ceux qui ne veulent pas travailler ces jours-là, et que par conséquent on raisonne correctement en disant qu'on lui impose le chômage au nom de la liberté. Ceux qui sont métaphysiciens ajoutent qu'ainsi « l'État crée la liberté [FN: § 1554-4] ». Le terme liberté employé dans cette dérivation a trois sens : 1° un sens indéfini d'une personnification abstraite ; 2° un sens défini, qui est celui de la faculté de faire – ou de ne pas faire – et qui se dédouble en les deux suivants : (2-a) la faculté qu'a un individu déterminé ; (2-b) la faculté qu'ont d'autres individus différents de l'individu déterminé. Souvent, ces deux facultés s'opposent l'une à l'autre, et par conséquent, une mesure qui protège l'une lèse l'autre. Les dérivations tirent parti de ce triple sens pour transporter sur le premier ce qui n'est valable que pour l'un des seconds. Parfois, pour dissimuler cette amphibologie, ou ajoute une épithète à la liberté, dans le premier sens (§ 1561). La dérivation que nous examinons transporte sur le premier sens ce qui est valable pour le sens (2-b), et dit que la mesure envisagée protège la liberté. On pourrait, avec tout autant de raison, transporter sur le premier sens ce qui s'applique au sens (2-a), et l'on dirait alors que la mesure lèse la liberté. Le conflit pratique ne se résout ni par l'une de ces dérivations ni par l'autre, mais seulement en examinant si, en vue du but que l'on veut atteindre, il est utile de faire prévaloir (2-a) sur (2-b) ou vice versa. Mais ainsi, on passerait des dérivations au raisonnement logico-expérimental.
§ 1555. Nous venons de voir dans quel rapport se trouve la dérivation avec la réalité logico-expérimentale. Il nous reste à voir pourquoi on emploie cette dérivation. D'où provient cette obstination à désigner par un terme unique des choses différentes et même opposées ? Simplement du fait que l'on veut conserver les sentiments agréables que suggère ce terme [FN: § 1555-1] . C'est pour le même motif que l'empire romain continua à porter le nom de république. En outre aussi, mais certainement dans une mesure très secondaire, il y a là l'effet d'un reste de pudeur de certains politiciens qui, brûlant aujourd'hui ce qu'ils ont adoré hier, copiant les gouvernements « réactionnaires » dont ils disent tant de mal, veulent faire semblant d'avoir conservé la doctrine qui leur était profitable, lorsqu'ils combattaient ces gouvernements. Quant à la justification, en particulier, dont nous avons parlé, elle est employée, comme les autres dérivations de ce genre, pour transporter, à volonté, sur le sens (2-a) ou sur le sens (2-b), les sentiments favorables et indéterminés qui sont suscités par le sens 1.
§ 1556. (IV-γ) Terme à plusieurs sens et choses différentes désignées par un seul terme. On emploie cette dérivation, soit directement pour attribuer un sens à une proposition qu'on emploie ensuite dans un autre sens (§ 491-1), soit indirectement, pour éviter la contradiction de deux propositions ; ce qu'on obtient en dédoublant un ou plusieurs termes de ces propositions. On emploie aussi cette dérivation pour allonger un peu l'expression d'une simple affirmation, et donner ainsi au discours une apparence de raisonnement logique (§ 1420 et sv.). Au lieu de dire simplement : A est B, on dit : A est X ; puis, ou bien on sous-entend, par accord de sentiments, ou bien on dit explicitement que X est B, et l'on a ainsi « démontré » que A est B. Logiquement, cette voie allongée n'est pas meilleure que la voie abrégée (§ 783) ; mais elle est préférable, par rapport aux sentiments, car elle satisfait le besoin de développements pseudo-logiques [FN: § 1556-1].
De ce genre sont les sophismes très nombreux dans lesquels le moyen terme a deux sens, se dédouble, et ceux, très nombreux aussi, dans lesquels un terme a successivement deux significations, ce qui peut aboutir à un raisonnement en cercle. Un type très usité est le suivant. On affirme que tous les A ont l'opinion B. Ici, A a un sens générique, indéterminé et qui s'accorde simplement avec les sentiments de celui qui écoute. Par conséquent, d'habitude, on n'en demande pas davantage. Mais si l'on demande : « Définissez-moi A », la réponse, plus ou moins entortillée, embrouillée, implicite, aboutit au fond à affirmer qu'on appelle A ceux qui ont l'opinion B ; et ainsi A prend une nouvelle signification. De cette manière, le raisonnement revient à dire que celui qui a l'opinion B a l'opinion B. Nous avons déjà donné de nombreux exemples de cette sorte (§ 592, 593 et passim).
§ 1557. Comme exemple de l'usage direct du présent genre de dérivations, on peut citer celui du terme solidarité (§ 451 et sv.). Les solidaristes avouent eux-mêmes qu'on l'emploie dans des sens très différents. M. Croiset [FN: § 1557-1] dit, à propos de ce terme : « (p. VI). Tout le monde l'emploie, et à force de l'employer, on oublie volontiers de se demander ce qu'il signifie. Or, si l'on y regarde, on s'aperçoit sans peine qu'il s'applique à des choses fort différentes. Il y a d'abord une solidarité de fait qui n'est que la dépendance réciproque de divers éléments associés. Par exemple, en droit, des débiteurs sont solidaires lorsque chacun est tenu de payer la dette de tous. En biologie, les parties d'un organisme sont dites « solidaires », lorsque les modifications subies par l'une d'entre elles ont leur contre-coup sur les autres » [FN: § 1557-2]. À mettre ensemble deux choses très différentes, l'auteur se trompe. Deux individus également solvables sont condamnés à payer solidairement une certaine dette. Le créancier se fait payer par l'un d'eux, mais celui-ci a recours contre l'autre et se fait rendre la part qu'il a payée pour lui, de la dette commune. Un individu est condamné à avoir la main coupée, en un lieu où existe ce genre de peine. Si nous voulons, pour un moment, assimiler les deux bras à deux débiteurs solidaires, ils ont à acquitter solidairement la dette commune. Un seul la paye, et bien que l'autre ait sa main entière, l'individu ne s'amusera pas à en couper la moitié, ou toute autre partie, pour récupérer le bras privé de la main. Donc il y a une différence essentielle entre la solidarité des deux bras considérés comme des individus ayant une dette commune, et leur solidarité biologique. Ensuite l'auteur nous fait très naïvement connaître le motif pour lequel ce terme de solidarité a eu tant de succès. Le motif est, au fond, que ce terme est assez indéterminé pour que chacun puisse lui faire signifier ce qu'il désire [FN: § 1557-3] . L'observation est bonne et s'applique en général aux dérivations à termes ambigus et indéterminés. Voilà pourquoi des termes semblables sont excellents pour les dérivations, très mauvais pour les raisonnements scientifiques. Pour éveiller les sentiments et pour dissimuler la réalité, il est utile que les termes ne soient pas précis. Pour trouver les rapports qui existent entre les faits, il est utile que les termes soient aussi précis que possible. Les apôtres de la solidarité font donc très bien d'employer des termes indéterminés ; mais, à défaut d'autre preuve, cela seul suffirait à montrer la vanité de leur prétention de nous donner des raisonnements scientifiques.
§ 1558. Comme exemple de l'usage indirect des dérivations du présent genre, ou peut citer la proposition : « Tu ne dois pas tuer ». On forme cette proposition en donnant au terme tuer un sens général, pour avoir l'appui du tabou du sang, qui défend de verser le sang humain en général, ou du moins le sang des hommes d'une même collectivité. Mais voici apparaître des cas dans lesquels, au contraire, on doit tuer. Alors, pour faire disparaître la contradiction, on restreint le sens du terme tuer, et les deux propositions en lesquelles se dédouble le précepte : « Tu ne dois pas tuer » s'entendent dans ce sens : « On ne doit pas tuer, si ce n'est en certaines circonstances », et « l'on doit tuer en certaines circonstances ». De cette façon, il est vrai, la contradiction disparaît, mais devenues explicites, les deux propositions signifient peu de chose ou rien ; c'est pourquoi on ne leur donne pas directement cette forme.
§ 1559. Les pacifistes ont la formule : « Les conflits internationaux doivent être résolus par l'arbitrage, par le tribunal international de La Haye, et non par la guerre » ; et ils appellent cela assurer la paix par le droit. En 1911, l'Italie déclara la guerre à la Turquie, sans se soucier le moins du monde ni d'arbitrages ni du tribunal de La Haye. Les pacifistes étrangers restèrent fidèles à la formule, et blâmèrent le gouvernement italien. Plusieurs pacifistes italiens le louèrent, au contraire, parce qu'en faisant la guerre, il avait revendiqué « le bon droit de l'Italie ». Bien entendu, si un autre pays quelconque, X, s'était trouvé dans le même cas que l'Italie, plusieurs pacifistes du pays X auraient dit exactement ce qu'ont dit les pacifistes italiens, tandis que ceux-ci auraient désapprouvé le gouvernement du pays X [FN: § 1559-1]. De tels pacifistes, qui se montrent favorables à la guerre, paraissent donc avoir la formule : « Les conflits internationaux doivent être résolus par l'arbitrage, excepté le cas où il est plus profitable au pays qui veut faire la guerre de les résoudre par la guerre ». Mais, en présence de ces termes, on se demande : Qui n'est pas pacifiste ? En réalité, comme nous l'avons vu tant de fois, ces personnes agissent, poussées par certains sentiments, et non par un raisonnement logique.
§ 1560. Nous avons là un bon exemple des divergences possibles entre l'accord d'une théorie avec la réalité, et son utilité sociale.
Les pacifistes italiens se divisèrent en deux camps : d'un côté, ceux qui applaudissaient à la guerre de Libye, et que l'on pourrait appeler pacifiste-belliqueux ; de l'autre, ceux qui restèrent fidèles à leur doctrine pacifiste, et qu'on pourrait nommer pacifistes-pacifistes. Les premiers avaient certainement tort, au point de vue logique, et avaient peut-être raison, au point de vue de l'utilité que pouvait retirer leur nation. Il n'est pas moins certain que les seconds avaient raison, au point de vue de la logique et de la fidélité à leurs principes, tandis qu'ils pouvaient avoir tort, au point de vue de l'utilité. Ce n'est pas ici le lieu de résoudre, en ce cas spécial, le problème de l'utilité. Il suffit, pour notre raisonnement, que les solutions indiquées tout à l'heure comme possibles le soient effectivement. Plus loin (§ 1704 et sv.) nous verrons les résidus qui se dissimulaient sous ces dérivations, et nous traiterons d'un aspect de l'utilité, au chapitre XII.
§ 1561. Un moyen très usité pour dédoubler les termes consiste à y ajouter certaines épithètes, comme : vrai, droit, honnête, élevé, bon, etc. Ainsi, on distingue un vrai A d'un simple A, et la différence entre ces deux choses peut aller jusqu'à les rendre opposées. De cette façon, par exemple, on fait disparaître la contradiction que nous avons relevée (§ 1554) pour le terme liberté : on distingue une vraie liberté, de la simple liberté, et parfois la première est exactement le contraire de la seconde. Travailler quand il vous semble bon et quand il vous plaît, c'est de la simple liberté ; mais travailler seulement quand cela semble bon et plaît à d'autres, c'est de la vraie liberté. Boire du vin quand cela vous semble bon et vous plaît, c'est de la simple liberté ; le tsar l'octroie aux Finlandais ; mais si l'on vous interdit de boire même une seule goutte de vin, cela, c'est de la vraie liberté, et l'assemblée libérale de la Finlande l'aurait octroyée à ses administrés, si elle n'en avait été empêchée par le despotisme du tsar.
§ 1562. Cet emploi de l'épithète vrai est utile, parce que, comme nous l'avons vu pour le terme solidarité, signifiant peu de chose ou rien du tout, on peut lui faire signifier ce qu'on veut [FN: § 1562-1] . Et si quelque indiscret veut savoir ce que l'une de telles épithètes peut bien vouloir dire, aussitôt on lui sert un beau raisonnement en cercle. Veux-je donner à un terme A la signification du terme ?Je dis que le vrai A est B. Mais quelqu'un me demande : Comment distingue-t-on le vrai A du A qui n'est pas vrai ? Je réponds d'une façon plus ou moins voilée que seul le A qui est B mérite le nom de vrai.
§ 1563. C'est ainsi qu'on affirme que la raison conduit à une certaine conclusion B, par exemple à l'existence de Dieu, ou de la solidarité. L'athée, ou l'anti-solidariste répondent : « Ma raison à moi ne me conduit pas à cette conclusion ». On leur réplique : « Parce que vous ne faites pas usage de la droite raison ». Mais comment distingue-t-on la droite raison de celle qui n'est pas droite ? D'une manière bien simple : La droite raison croit en Dieu, ou en la solidarité.
§ 1564. Chacune des sectes chrétiennes a eu ses martyrs, et chacune a cru que seuls les siens étaient de vrais martyrs. Saint Augustin dit clairement et sans ambages : « (4) Tous les hérétiques aussi peuvent souffrir pour l'erreur, non pour la vérité, parce qu'ils mentent contre le Christ lui-même. Tous les païens et les impies qui souffrent, souffrent pour l'erreur » [FN: § 1564-1] . Bien entendu, la « vérité » est celle à laquelle Saint Augustin croit, et l'erreur, toute autre croyance. Bayle a bien vu le sophisme d'un raisonnement semblable à celui de Saint Augustin, et qui avait pour but de démontrer que les orthodoxes ont raison et les hérétiques tort de persécuter ceux qui n'ont pas leur croyance [FN: § 1564-2] . Ce sophisme, vieux de bien des siècles, est toujours vivace. Il a servi aux chrétiens pour persécuter les païens, aux catholiques pour persécuter les protestants ; et vice versa ; aux diverses sectes protestantes, pour se persécuter mutuellement, aux chrétiens pour persécuter les libres penseurs, et maintenant à ceux-ci pour persécuter ceux-là, et spécialement les catholiques. Sous le second Empire, en France, on ne voulait pas que Renan enseignât ; sous la troisième République, on ne veut pas que le Père Scheil enseigne (§ 618-2) ; mais l'Empire avait tort, parce qu'il était dans « l'erreur », et la République a raison, parce qu'elle est dans le « vrai ». Beaucoup de personnes, en Italie aussi, font le raisonnement suivant : « Les catholiques n'ont pas le droit d'enseigner, parce qu'ils enseignent l'erreur, seuls les libres penseurs ont le droit d'enseigner, parce qu'ils enseignent la vérité ». Naguère, c'était un raisonnement opposé qui était de mode. C'est ainsi que les sages changent avec les temps [FN: § 1564-3]. Autrefois les cléricaux disaient, aujourd'hui les libéraux répètent qu'on doit accorder la liberté du bien, non celle du mal ; la liberté du vrai, non celle de l'erreur. Inutile d'ajouter que ce qui est bien et vrai pour les uns est mal et erroné pour les autres, et vice versa. Les termes vérité, erreur ont autant de sens qu'il y a de partis. C'est seulement grâce à une dérivation (IV-β) qu'on préfère ces termes à leurs synonymes : ce que je crois, et : ce que je ne crois pas.
§ 1565. Les dérivations du genre (IV-γ) mettent généralement en action les résidus de la IIe classe. Les notions et les sentiments qu'un terme donné fait naître en nous persistent quand on ajoute une épithète à ce terme ; ils peuvent même être renforcés par un choix opportun des épithètes. Si la liberté est une bonne chose, combien meilleure doit être la vraie liberté ! Si la raison ne peut pas nous induire en erreur, la droite raison le pourra d'autant moins.
§ 1566. Le plus grand nombre des propositions exprimées sous la forme : « Cette doctrine est vraie, donc on peut, on doit l'imposer », emploient un terme équivoque. Les personnes auxquelles on veut imposer cette doctrine n'admettent nullement qu'elle soit vraie ; elles la disent fausse. La proposition indiquée plus haut devrait donc être exprimée ainsi : « Cette doctrine est pour nous la vérité ; donc nous pouvons, nous devons l'imposer ». Mais, sous cette forme, la proposition a beaucoup moins de force persuasive que sous la première forme.
§ 1567. Dans les dérivations théoriques, le sens du substantif vérité oscille souvent entre deux extrêmes. D'une part, le mot signifie ce qui est d'accord avec les faits ; c'est ce qu'on appelle parfois la vérité expérimentale et la vérité historique. D'autre part, il signifie ce qui est d'accord avec certains sentiments, lesquels emportent le consentement de la foi [FN: § 1576-1] . Entre ces deux extrêmes, il y a une infinité de sens intermédiaires. L'accord avec les faits peut être la conséquence d'observations et d'expériences scientifiques, de recherches appartenant à ce qu'on appelle la critique historique, ou même seulement de l'effet que produisent les faits sur l'esprit d'une personne ou de plusieurs personnes, des sentiments qu'ils font naître. Là aussi, nous trouvons des degrés intermédiaires entre les extrêmes : d'une part, le scepticisme scientifique ou historique, qui corrige certaines impressions par d'autres, et qui permet par conséquent de les adapter autant que possible aux faits ; d'autre part, une foi si vive que les faits ne peuvent l'ébranler en aucune façon ; et l'impression qu'ils font est toujours déformée d'autant qu'il est nécessaire pour l'accorder avec la foi [FN: § 1567-2]. La mécanique, d'Aristote à Laplace, l'histoire naturelle, de Pline à Cuvier, l'histoire romaine, de Tite-Live à Mommsen, l'histoire grecque, d'Hérodote à Grote et à Curtius, etc., ont progressé de ce dernier extrême au premier, et le terme vérité a continuellement changé de sens (§ 776 et sv.).
§ 1568. Ainsi que nous l'avons déjà dit (§ 645), celui qui répète un récit fait par autrui emploie souvent des termes quelque peu différents de ceux qu'il a entendus ; mais il estime dire la vérité, en ce sens que ses termes lui font éprouver la même impression que ceux qu'il a entendus. Il n'est pas possible de se rappeler les termes précis d'un long discours. La mémoire n'a gardé que le souvenir de l'impression éprouvée. C'est cette impression qu'on s'efforce de reproduire, lorsqu'on veut rapporter le discours ; et ce faisant, on croit de parfaite bonne foi avoir dit la vérité. En pratique, devant les tribunaux, cette reproduction approximative des faits suffit d'habitude, étant donné le but que se propose le tribunal. Si elle paraît insuffisante sur quelque point, le président prie le témoin de s'expliquer mieux.
§ 1569. On sait assez que les historiens anciens ont la manie de rapporter les discours qu'ils affirment avoir été prononcés par leurs personnages. Polybe même, pourtant si précis, suit cette voie [FN: § 1569-1] . Par exemple, il nous rapporte le discours tenu par P. Cornelius à ses soldats, avant la bataille du Tessin. Pourtant il est tout à fait certain que Polybe ne pouvait savoir, mot pour mot, ce que contenait ce discours. Il est donc évident que ce ne peut pas être la reproduction précise d'un fait, mais que c'est uniquement la manifestation de l'impression produite sur Polybe par les récits du fait. On peut en dire autant des récits des anciens historiens, en général, et aussi d'une partie considérable de ceux des historiens modernes. Ils nous font connaître plus souvent leurs impressions que des faits.
Parfois ces impressions se rapprochent de la réalité historique ;. parfois elles s'en écartent, et, la distance qui les sépare de la réalité s'accroissant, elles peuvent finir par n'avoir plus aucun rapport avec elle.
§ 1570. À cet extrême correspondent les impressions que décrit Jean Réville, à propos du quatrième évangile [FN: § 1570-1] : « (p. 113) Le but de l'évangile, le but même du Prologue, est historique, voilà ce qu'il importe essentiellement de ne pas perdre de vue. Seulement l'auteur écrit l'histoire comme l'écrivaient tous les hommes de son temps, imbus de l'esprit alexandrin, c'est-à-dire avec un souverain dédain pour la réalité matérielle concrète, de même que Philon ou saint Paul. L'histoire, telle que la comprennent ces grands esprits, ce n'est pas la narration pragmatique des événements, la fidélité dans la reproduction des détails, le souci d'une chronologie exacte, la (p. 114) résurrection intégrale du passé. La tâche de l'historien consiste pour eux à faire ressortir la valeur morale et spirituelle des faits, leur sens profond, ce qu'il y a de vérité éternelle [autre belle entité !] dans chaque phénomène historique contingent et éphémère. L'histoire se transforme pour eux en une vaste allégorie, un symbole perpétuel dont la valeur intime importe seule*. Cela est très difficile à comprendre pour nos intelligences modernes dont la mentalité est toute différente, mais c'est l'évidence même pour ceux qui ont vécu dans l'intimité de Philon et de la plupart des premiers écrivains chrétiens ». Au point de vue scientifique, ce passage contient de bonnes observations, avec l'adjonction de dérivations étrangères à la science. L'auteur éprouve le besoin de nous apprendre que Philon et Saint Paul sont de « grands esprits ». Il y a au contraire des gens qui les tiennent pour des auteurs dont la valeur logico-expérimentale est fort sujette à caution. On ne peut résoudre ce problème en passant ; mais il est singulier que l'auteur adresse cette louange à ces personnages précisément lorsqu'il nous les fait voir comme de piètres historiens. Encore s'il avait fait lui-même cette distinction ! Il y a là une dérivation (IV-β). L'auteur veut, par des sentiments accessoires, dissiper le blâme que pourraient faire naître les faits. Ensuite, on voit apparaître une respectable entité qui a nom « la tâche de l'historien ». Ces « grands esprits » la comprennent en ce sens qu'ils doivent écrire l'histoire sans se soucier des faits [FN: § 1] . Cela admis, on se demande pourquoi les Mille et Une nuits n'auraient pas leur place parmi les livres d'histoire. À ce qu'il paraît, il y a des « phénomènes historiques contingents et éphémères », et d'autres qui ne le sont pas. Quels sont donc ces phénomènes ? L'auteur ne le dit pas. Ensuite, il est impossible de savoir ce que peut bien être cette « vérité éternelle », dont il existe, à ce qu'il paraît, une quantité plus ou moins grande dans « chaque phénomène historique ». Annibal a passé avec son armée en Italie. C'est là un fait historique. Mais qui dira combien il renferme de « vérité éternelle » ? De tels propos sont vides de sens.
§ 1571. Ainsi, après avoir rappelé les doutes qui existent au sujet de la réalité historique du déluge biblique, A. Loisy ajoute [FN: § 1571-1] : « (p. 152) Le récit de la création est (p. 153) vrai, bien qu'il ne contienne pas d'histoire et qu'il s'encadre dans une cosmologie qui n'est plus admise aujourd'hui. Qui sait s'il n'y a pas dans les chapitres suivants, des récits qui sont vrais aussi à leur manière, bien qu'ils ne contiennent pas tous les éléments historiques matériellement exacts que nous nous efforçons d'y trouver ? » (§ 774 et sv.). Il est évident que, dans ce passage, le mot vrai a pour l'auteur un sens différent de celui qu'il possède, par exemple, dans la proposition : « Il est vrai que Garibaldi a débarqué en Sicile, en 1860 ». Mais tant que l'auteur ne nous dit pas le sens précis qu'il veut donner au mot vrai, nous ne pouvons ni accepter ni repousser les conclusions dans lesquelles se trouve ce terme, si nous voulons demeurer dans le domaine logico-expérimental. Si nous en sortons, si nous allons dans celui du sentiment, nous accepterons ou nous repousserons les conclusions, suivant les sentiments indéterminés que ce mot éveillera en nous [FN: § 1571-2]. On remarquera que tout concourt à agir sur le sentiment. L'auteur veut absolument tirer parti des sentiments favorables que le terme vrai éveille en nous ; aussi parle-t-il d'un récit qui est vrai, bien qu’il ne contienne pas d'histoire, d'éléments historiques matériellement exacts. Pourquoi matériellement ? Si l'on entend le mot vrai dans le sens de en accord avec les faits, comment un récit peut-il bien être historique et ne pas être matériellement exact ? Il pourrait être historique dans l'ensemble et ne pas être exact partiellement ; mais il ne semble pas que ce soit ce que l'auteur entend ; et s'il avait jamais entendu cela, il ne devait pas parler de récits vrais à leur manière. Jules César a été ou n'a pas été dictateur. Dans le premier cas, la dictature de César est un fait historique ; dans le second, elle ne l'est pas. On ne comprend pas ce que voudrait dire la proposition suivante : « Dire que César n'a pas été dictateur est un récit vrai à sa manière, bien qu'il ne renferme pas les éléments matériellement exacts que nous y cherchons ».
Il est difficile de deviner ce que l'auteur a exactement voulu dire. Il se peut qu'il ait voulu exprimer qu'il y a des récits qui ne correspondent pas à la réalité historique, à la réalité expérimentale, mais qui correspondent à certaines choses étrangères au monde de l'expérience, choses que le sentiment de certains hommes croit connaître. Si c'était effectivement de cette idée qu'il s'agit, il eût été plus précis de l'énoncer d'une façon analogue à celle que nous avons indiquée ; mais, au point de vue des dérivations, il était bon de s'en abstenir, afin de ne pas perdre ce cortège de sentiments agréables que le terme vérité traîne à sa suite.
§ 1572. Dans un chapitre plein de réticences, Mgr. Duchesne se donne beaucoup de peine pour justifier, sans en avoir l'air, les persécutions contre les donatistes [FN: § 1572-1] . Après avoir cité un ouvrage de Saint Augustin, il écrit : « (p. 143) Sous d'autres formes encore, livres de controverses, conférences locales, sermons, lettres, les évêques s'efforçaient de présenter la vérité et de la faire parvenir au public donatiste ». Il est évident que pour Mgr. Duchesne aussi, cette vérité est différente de celle que « présentaient et faisaient parvenir au public » Saint Augustin et d'autres Saints Pères, lorsqu'ils niaient qu'il y eût des antipodes. Si donc on voulait éviter l'équivoque, au lieu du mot vérité, on devrait écrire : ce que les catholiques croient être la vérité. Mais alors, on manquerait le but, qui est de créer une confusion entre la vérité subjective, qui n'est reconnue que par les personnes qui ont la foi, et la vérité objective, qui est prouvée par l'accord avec les faits, et par conséquent de faire naître un sentiment de blâme contre les donatistes, capables de nier cette vérité objective.
§ 1573. C'est précisément grâce aux termes qui, en réalité, sont subjectifs, que ces dérivations peuvent être employées pour prouver aussi bien le pour que le contre. Par exemple, les dérivations dont se sert Mgr. Duchesne, pour justifier les persécutions souffertes en Afrique par les donatistes, sont précisément les mêmes que celles dont on se sert en France, de notre temps, pour justifier les persécutions contre les coreligionnaires de Mgr. Duchesne. Celui-ci commence par reprocher aux donatistes d'avoir été les ennemis des catholiques. De même les libres penseurs français reprochaient aux catholiques d'être leurs ennemis et ceux de la République. Il arriva qu'en Afrique un évêque catholique de Bagaï (p. 130) fut maltraité par les donatistes. Il arriva qu'en France Dreyfus fut maltraité, dit-on, par les catholiques. « (p. 130) Poussé à bout, l'épiscopat catholique [le gouvernement républicain français]. se rappela qu'il existait des lois contre les fauteurs de schisme [contre les congrégations religieuses] et qu'en somme toute cette église donatiste [le plus grand nombre des congrégations religieuses] représentait une vaste contravention ». Après avoir rappelé les pénalités de la loi de Théodose contre les hérétiques, Mgr. Duchesne continue : « (p. 131) C'eût été beaucoup de sévérité, s'il s'était agi d'hérétiques paisibles [de catholiques qui ne s'occupent pas de politique, dira-t-on, en France ; qui ne sont pas des moines ligueurs, dira Waldeck-Rousseau]; mais, eu égard au tempérament des donatistes et aux excès qu'ils se permettaient sous l'œil de fonctionnaires complaisants, c'était trop peu [nos anti-cléricaux contemporains diront : mais eu égard au tempérament des cléricaux et aux excès qu'ils se permettaient contre Dreyfus, contre les Israélites, les protestants, contre les libres penseurs, sous l'œil de magistrats complaisants, c'était trop peu] ». Mgr. Duchesne se réjouit de la persécution exercée, au temps de Saint Augustin, contre les donatistes, comme le ministre Combes, un chef des anti-cléricaux, se réjouit de la persécution exercée, de notre temps, contre les catholiques, ou, si l'on veut, les « cléricaux » français. « (p. 132) On ne peut nier que la pression officielle ait abouti à de sérieux résultats. L'exaltation des circoncellions [des moines ligueurs de Waldeck-Rousseau] n'était pas le fait de tous les donatistes [de tous les catholiques français]. Il ne manquait pas parmi eux de gens sensés qui se rendaient compte de la stupidité de leur schisme [de l'infaillibilité du pape, dira-t-on en France] et ne cherchaient qu'un (p. 133) prétexte pour s'en détacher ; beaucoup étaient donatistes par habitude, par tradition de famille, sans savoir pourquoi, sans même y penser sérieusement [c'est dans des termes tout à fait identiques que les anti-cléricaux français parlaient des catholiques] ; d'autres n'étaient retenus dans la secte que par la frayeur que leur inspiraient les violents. En somme, l'intervention de l'État tendait beaucoup moins à molester les consciences qu'à les délivrer d'une oppression insupportable ». C'est justement ce qu'ont dit et répété Waldeck-Rousseau, Combes et tous les anti-cléricaux français ; et il ne manque pas de métaphysiciens pour nous apprendre qu'en persécutant les cléricaux le gouvernement a « créé la liberté ».
§ 1574. Ces bons et doux catholiques de Saint Augustin ne demandaient rien d'autre – dit Mgr. Duchesne – que l'unité de la foi. Mais n'est-ce pas précisément ce que demandait M. Combes ? Il disait : « Nous croyons qu'il n'est pas chimérique de considérer comme souhaitable et comme praticable de réaliser dans la France contemporaine ce que l'ancien régime avait si bien établi dans la France d'autrefois. Un seul roi, une seule foi : telle était alors la devise. Cette maxime a fait la force de nos gouvernements monarchiques, il faudrait en trouver une qui soit analogue et qui corresponde aux exigences du temps présent (séance du Sénat, du 24 juin 1904) ». Mgr. Duchesne cite un certain refrain, et ajoute : « (p. 127) Les enfants catholiques chantaient cela par les rues et popularisaient ainsi la politique d'union ». En France, au XXe siècle, La Lanterne et d'autres journaux anti-cléricaux se donnaient la même tâche. Sous Louis XIV, dans les Cévennes, les dragons aussi s'employaient activement à réaliser « l'unité de la foi ».
§ 1575. Les vérités qu'on trouve en ce monde sont si nombreuses, qu'il peut bien y en avoir une qui soit conforme au rapport existant entre le récit de Mgr. Duchesne et les faits tels qu'ils sont racontés par Saint Augustin, avec les commentaires dont celui-ci les accompagne. Mais il est certain que cette vérité n'est pas la vérité historique, et que le texte du saint fait une tout autre impression que la prose de l'auteur moderne.
En vérité, Saint Augustin vise à quelque chose de plus et de mieux qu'à réprimer « une contravention aux lois ». Le bon saint nous donne une théorie complète de la persécution. Il compare le schismatique au frénétique [FN: § 1575-1] , et veut employer la force pour guérir aussi bien l'un que l'autre. Il n'admet pas qu'on ne doive pas être forcé à la justice [FN: § 1575-2] , et il le prouve par un grand nombre de beaux exemples bibliques. Cet excellent homme veut employer l'exil et les amendes contre les dissidents, afin qu'ils apprennent à préférer ce qu'ils lisent dans l'Écriture aux rumeurs et aux calomnies des hommes [FN: § 1575-3] . Il va sans dire que les rumeurs et les calomnies sont les choses jugées telles par le docte Saint Augustin, par le grand savant qui lisait dans l'Écriture qu'il n'y a pas d'antipodes, contrairement aux rumeurs et aux calomnies des ignorants qui y croyaient. Pour qu'il ne subsiste aucun doute sur ses intentions, le saint ajoute : « Et cela, en vérité, je l'ai dit de tous les donatistes et de tous les hérétiques qui, devenus chrétiens par les sacrements, s'éloignent de la vérité du Christ ou de l'unité » [FN: § 1575-4]. Quiconque lirait uniquement l'histoire de Mgr. Duchesne, et ne recourrait pas au texte de Saint Augustin, serait loin de soupçonner l'existence de toute cette doctrine. Ce n'est pourtant pas une chose négligeable, et Mgr. Duchesne sait fort bien que lorsqu'en France, sous Louis XIV, on voulut persécuter les protestants, l'archevêque de Paris fit imprimer la traduction de deux lettres de Saint Augustin, pour justifier la nouvelle persécution par l'ancienne. Il n'ignore pas non plus que Bayle en tira argument pour une éloquente défense de la tolérance [FN: § 1575-5]. Mgr. Duchesne n'aurait pas mal fait de nous donner son avis sur ce point, sans recourir, pour pouvoir garder le silence, au prétexte de la contravention.
§ 1576. Il ne parle pas non plus de la cupidité qui portait les catholiques à s'approprier les biens des donatistes. Saint Augustin, qui nous apprend le fait [FN: § 1576-1], donne une réponse de peu de valeur, en disant que les donatistes qui se convertirent conservèrent leurs biens, et il feint de ne pas comprendre l'accusation, quand il objecte qu'il y a contradiction entre vouloir convertir les donatistes et vouloir les dépouiller de leurs biens : le reproche vise les biens, non pas de ceux qui se convertissent, mais de ceux qui ne se convertissent pas. Elles sont belles les métaphores dont se sert Saint Augustin, pour justifier les persécutions contre les donatistes [FN: § 1576-2] . « Devais-je raisonnablement m'opposer à cette mesure – dit-il – afin que vous ne perdiez pas les choses que vous dites vous appartenir, et que vous puissiez proscrire le Christ en toute sécurité ? afin que vous puissiez faire testament selon le droit romain, tandis que vous déchiriez par des incriminations calomnieuses le Testament de droit divin donné à vos pères [remarquez le double sens de testament et le jeu de mots tenant lieu d'argument] ... afin que vous puissiez librement contracter des achats et des ventes, tandis que vous osiez diviser ce que le Christ vendu a acheté ? » Et l'auteur continue ainsi, accumulant des contrastes obtenus grâce à des termes à double sens et des jeux de mots. Ces arguments pitoyables et absurdes ont été admirés par un grand nombre de gens. Ainsi que nous l'avons si souvent dit et répété en des cas semblables, cela montre la vanité des dérivations. Au fond, le raisonnement de Saint Augustin est le suivant : « Vous croyez ce que nous, nous estimons erroné. Par conséquent, tout est licite pour vous amener de cette croyance, que nous estimons mauvaise, à la nôtre, que nous estimons bonne ; et vous ne pouvez vous plaindre de rien, puisqu'en vous convertissant, vous avez un moyen d'éviter tout dommage ». Mais sous cette forme, le raisonnement a beaucoup moins de force persuasive que sous la forme employée par Saint Augustin, où la vérité et l'erreur, le bon et le mauvais, de subjectifs deviennent objectifs.
§ 1577. Il est naturel que celui qui partage la foi de Saint Augustin ne puisse admettre que les termes rappelés plus haut sont subjectifs. Mais s'il voulait qu'ils fussent objectifs, il pourrait aussi admettre, sans nuire à sa foi, que leur objectivité est différente de celle qu'on trouve dans une expérience de chimie ou de physique ; et cela suffirait pour éviter toute contestation avec la science expérimentale, qui s'occupe uniquement de faits de ce dernier genre.
§ 1578. D'autres fois, la confusion entre les nombreuses espèces de vérités a lieu sans aucune intention préconçue d'en tirer avantage. Elle reproduit seulement une confusion analogue qui existe dans l'esprit de l'auteur. Celui-ci voit les faits à travers un verre coloré, et les décrit tels qu'il les voit. Il dit ce qui lui paraît bien, et ne se soucie guère de rechercher dans quel rapport est ce bien avec la réalité expérimentale. Quand Renan parle de l'« ineffable vérité » [FN: § 1578-1] des sentences de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, il est évident qu'il donne au terme vérité un sens entièrement différent de celui qu'il aurait, si l'auteur parlait d'une expérience de chimie ou de physique ; mais on ne sait pas à quelle réalité objective correspond le terme dont Renan fait usage, et il semble probable qu'il corresponde simplement à certains de ses sentiments. De toute façon, on voit dans ses œuvres que, pour lui, la vérité historique n'est pas du tout la vérité scientifique. Il observe que deux récits d'une même scène, faits par des témoins oculaires, diffèrent essentiellement, et demande : « Faut-il pour cela renoncer à toute la couleur des récits et se borner à l'énoncé des faits d'ensemble ? Ce serait supprimer l'histoire [FN: § 1578-2] . » Non ; ce serait simplement supprimer le roman historique. Celui qui refuserait de s'occuper d'histoire parce qu'il ne peut la connaître au complet, dans tous ses moindres détails, refuserait de posséder le moins parce qu'il ne peut avoir le plus ; mais vice versa, celui qui accepte le moins qui est certain, ou presque certain, ne s'oblige pas ainsi à accepter aussi le plus, qui est incertain ou manifestement contraire aux faits. Nous ne pouvons avoir une description complète d'aucun fait ; mais il faut du moins s'efforcer de savoir ce qui nous est connu du fait, et ce que nous devons négliger. En outre, la probabilité a différents degrés. Il est presque certain que la bataille du Tessin a eu lieu ; il est très douteux qu'avant de la livrer, P. Cornelius ait prononcé le discours que lui attribue Polybe ; il est presque certain, en tout cas, qu'il doit y avoir quelque différence entre les paroles dites par P. Cornelius, et celles que rapporte Polybe. Il est presque certain – pour ne pas dire certain, au sens vulgaire – que Jutes César a existé ; il est très douteux, pour ne pas dire plus, que Romulus soit également un personnage réel. Nous ne pouvons donc mettre dans la même classe des choses si différentes. Au point de vue des dérivations, la confusion est utile ; au point de vue logico-expérimental, on ne saurait tolérer ces équivoques. Que l'on donne le nom qu'on voudra à l'accord d'un récit avec les faits ; qu'on l'appelle vérité historique ou autrement, cela importe peu. Mais si l'on ne veut pas parler pour ne rien dire, il faut que ce nom soit différent de celui qui désigne les miracles des diverses religions, les différentes légendes, les présages et les récits du genre de la Lampe merveilleuse d'Aladin. Une partie de ces récits auront, si l'on veut, une vérité supérieure à la vérité expérimentale, – soit, ne disputons pas là-dessus – mais en somme, il faut que cette vérité, supérieure autant qu'on voudra, ait un nom qui permette de la distinguer de l'humble, inférieure et vulgaire vérité expérimentale [FN: § 1578-3].
§ 1579. L'abbé de Broglie explique assez bien une notion subjective de la nature des prophéties. Kuenen avait démontré que les prophéties de la Bible ne concordent pas avec les faits ; l'abbé de Broglie répond [FN: § 1579-1] : « p. 194) Kuenen part d'une fausse notion de la prophétie. Il suppose que les textes prophétiques n'ont qu'un seul sens, que ce sens doit être clair, qu'il doit être celui que les Prophètes et leurs contemporains ont compris. Il n'admet d'accomplissement de prophétie que quand les événements sont conformes au sens ainsi fixé ». Tel est, en effet, le sens des raisonnements objectifs de la critique historique, et, en général, de la science logico-expérimentale [FN: § 1579-2] . L'abbé de Broglie oppose à Kuenen certains raisonnements subjectifs qu'on peut parfaitement accepter, pourvu qu'on les distingue des précédents. C'est là le point essentiel, si l'on ne veut pas divaguer. L'abbé de Broglie écrit : « (p. 194) Tout autre est la vraie notion de la prophétie ». Et comme d'habitude, ce terme vrai nous conduit à l'amphibologie. Cela n'arriverait pas, si, au lieu de vraie notion, l'abbé de Broglie disait « ma notion », ou bien « la notion des catholiques », ou s'il usait d'une autre expression équivalente ; mais il ne le fait pas, parce que la dérivation a besoin du mot vrai, pour faire naître certains sentiments. Notre auteur continue. « (p. 194) C'est une parole de Dieu, adressée aux générations futures et qui ne doit être comprise qu'après l'événement. C'est une énigme dont l'événement doit donner la clef » [FN: § 1579-3]. Si l'on raisonne objectivement, on doit reconnaître que, de cette façon, les prophéties des païens valent celles des chrétiens, et l'énigme du « mur de bois » qui devait sauver les Athéniens est même beaucoup plus claire qu'un grand nombre de prophéties bibliques. De notre temps, les somnambules nous gratifient aussi de prophéties vraies, qui ne sont comprises que par les gens bien disposés, et après que le fait prédit a eu lieu. Le Livre des Songes nous fait aussi connaître, avec une certitude absolue, les numéros qui sortiront au tirage de la loterie ; mais par malheur, c'est en général seulement après le tirage que l'on comprend quels numéros on devait jouer ; ce qui est profondément regrettable pour les pauvres gens qui portent leur argent à la loterie. Un certain Guynaud s'est donné la peine d'écrire un livre pour démontrer que toutes les prophéties de Nostradamus se sont vérifiées ; et ses raisonnements ne sont, après tout, pas plus mauvais que d'autres du même genre sur la vérification des prophéties [FN: § 1579-4] (§ 621 et sv.). Mais il n'est pas très difficile d'accorder des prophéties avec des faits passés. Lors même que l'erreur des faits est patente, l'abbé de Broglie tente encore une conciliation, et finit par dire que si l'on n’y réussit pas, on peut suspendre son jugement à ce sujet [FN: § 1579-5].
§ 1580. On pose souvent cette question ; « Comment doit-on écrire l'histoire ? » D'abord, il y a l'amphibologie du terme histoire, qui peut signifier deux genres bien différents de compositions, suivant le but visé : 1° On peut avoir le but exclusivement scientifique de décrire les faits et leurs rapports. Uniquement pour nous entendre, appelons histoire scientifique ce genre de composition. 2° On peut avoir divers autres buts : par exemple celui de fournir une lecture agréable ; c'est ce qu'on essaye de faire dans le roman historique ; un but didactique, qui serait de peindre l'histoire sous des couleurs si vives qu'elle pénètre et s'imprime dans l'esprit ; dans cette intention, on se résigne, s'il le faut, à sacrifier la précision au coloris ; et l'on s'efforce d'atteindre ce but au moyen d'histoires qui se rapprochent plus ou moins du roman historique ; un but d'utilité sociale ou d'une autre utilité semblable, qui consisterait à faire naître, à provoquer, à émouvoir les sentiments, de manière à fortifier le patriotisme, le respect pour un certain genre de régime politique, le désir de grandes et utiles entreprises, le sens de l'honnêteté, etc. On tend vers ce but au moyen de compositions flottant entre l'histoire scientifique et le roman historique, et qui ont pour caractéristique de savoir colorer opportunément les faits, et surtout de les passer sous silence, lorsqu'il le faut [FN: § 1580-1] . On doit savoir s'écarter de la réalité expérimentale, sans se laisser prendre en flagrant délit de mensonge. Souvent l'auteur est aidé en cette tâche, parce qu'avant d'induire les autres en erreur, il s'est trompé lui-même. Il voit les faits tels qu'il les dépeint aux autres. Ensuite, dans la question que nous étudions, il y a une autre amphibologie : celle du terme doit-on, qui peut se rapporter au but même, ou bien aux moyens à employer pour l'atteindre. La proposition : comment doit-on écrire l'histoire ? peut signifier : 1° Lequel des buts précédents doit-on, faut-il choisir? 2° Ce but choisi, quels moyens doit-on, faut-il employer pour l'atteindre ? La première de ces propositions est elliptique, comme toutes les autres du genre [FN: § 1580-2] . L'indication du but spécial en vue duquel on doit choisir ce but de l'histoire fait défaut. Par exemple, on peut dire : En vue de la prospérité matérielle, politique ou autre, d'un pays, d'une classe sociale, d'un régime politique, etc., comment est-il bon que se comportent les divers auteurs qui écrivent l'histoire ? Ou bien : Quand et comment est-il bon d'employer ces compositions historiques ? Convient-il d'en employer une seule ? ou bien de les employer toutes en proportions différentes, suivant les diverses classes sociales [FN: § 1580-3], suivant les diverses fonctions sociales des individus ? Ou bien encore : Dans un pays donné et en un temps donné, laquelle de ces compositions est-il bon d'employer dans les écoles primaires, laquelle dans les écoles secondaires, laquelle dans les universités, pour procurer des avantages déterminés à la société entière, à une partie de la société, à un régime politique déterminé, etc. ? La seconde des propositions indiquées est de nature technique. Le but est exprimé, et lorsqu'on demande de quels moyens on doit faire usage pour l'atteindre, cela revient à demander quels sont les moyens les mieux adaptés pour l'atteindre.
La proposition : « Comment doit-on enseigner l'histoire ? » se confond en grande partie avec la précédente, car, en général, on écrit l'histoire dans le but de l'enseigner, et, de toute manière, elle donne lieu à des observations analogues. D'habitude, on ne fait pas la distinction des genres que nous avons indiqués ici, et les compositions qui portent le nom d'histoire sont un mélange de ces genres, avec une adjonction d'un grand nombre de considérations éthiques. Mais il serait prématuré de s'arrêter maintenant sur ce sujet, qui trouvera mieux sa place au chapitre XII.
§ 1581. Jusqu'à présent, nous nous sommes placés au point de vue objectif. Si nous considérons ces propositions au point de vue subjectif, elles sont, en général, bien exprimées, et l'amphibologie disparaît, parce qu'au fond leur signification est la suivante : « Quels sont les sentiments qui, chez vous, s'accordent avec les sentiments qu'éveillent dans votre esprit les termes : écrire, enseigner l'histoire ? »
§ 1582. Précisément parce que, ainsi posé, le problème a une solution unique, beaucoup de personnes s'imaginent qu'il n'en a qu'une aussi, quand on l'envisage au point de vue objectif ; et s'il leur vient, par hasard, quelque doute, elles distinguent avec peine les différentes solutions objectives. Souvent, presque toujours, un auteur qui écrit une histoire plus ou moins altérée ne sait pas lui-même quelle altération il apporte aux faits, et il les raconte tels qu'ils se présentent à son esprit, sans trop se soucier de rechercher s'il les voit tels qu'ils sont. Il serait surpris, si on lui demandait : « Dites-nous au moins si c'est une histoire scientifique que vous voulez écrire, ou bien une histoire mélangée de roman historique, de digressions polémiques ou autres ». Il dirait peut-être : « C'est une histoire et voilà tout ». Ainsi que nous l'avons souvent observé, celui qui suit le raisonnement scientifique distingue, sépare des choses que les personnes étrangères à ce raisonnement confondent au moins en partie.
§ 1583. Même celui qui recherche de quelle manière on doit enseigner l'histoire, pour qu'elle soit le plus possible utile à la société, doit ou croire ou au moins feindre de croire qu'il y a une solution unique. Ni lui ni l'artiste qui joue dans un drame ne peuvent s'interrompre pour avertir le public que ce qu'ils disent est de la fiction ; tous deux doivent s'incarner dans leur rôle, éprouver ce qu'ils disent. Mais ces considérations nous entraînent dans un domaine différent de celui auquel appartient ce chapitre.
§ 1584. Le terme souverain bien [FN: § 1584-1], ou même simplement bien, a une infinité de sens, et chaque philosophe le définit à sa façon. Ces sens ont ceci de commun : un noyau de certains sentiments agréables, qui demeurent, après qu'on a éliminé des sentiments désagréables ou seulement même réputés tels. À un extrême, nous avons uniquement les plaisirs sensuels du moment ; puis vient s'ajouter la considération des peines ou des plaisirs futurs ; puis l'action qu'ont sur l'individu ceux qui sont en rapport avec lui ; puis l'opposition que l'individu même trouve entre les plaisirs sensuels et les plaisirs, ou les peines qu'il éprouve, grâce à certains résidus, particulièrement ceux de la IIe et de la IVe classe ; continuant ainsi, on voit ces résidus devenir prédominants, et les plaisirs sensuels accessoires ; jusqu'à ce qu'enfin, on atteigne l'autre extrême, où tout sentiment agréable est mis en un anéantissement des sens, en une vie future, en quelque chose qui dépasse, en somme, le domaine expérimental.
§ 1585. Jusqu'ici, nous avons considéré l'individu, vu de l'extérieur ; mais l'individu lui-même, dans son for intérieur, ne voit presque jamais les choses de cette façon. On remarquera tout d'abord que, à l'instar de ce qui arrive en général pour de semblables sentiments, là où nous cherchons des théories précises, il n'existe qu'un ensemble d'idées peu déterminées ou dont la détermination est seulement verbale. Et cela non seulement pour le vulgaire, mais aussi pour les gens instruits, même savants, très savants. Pourtant, il arrive que les commentateurs cherchent tant et plus quelle était l'idée de leur auteur, et ne réussissent presque jamais à la trouver [FN: § 1585-1] . Il n'y a pas à s'en étonner, ni à en attribuer la faute à quelque défaut de leurs connaissances ou de leur raisonnement, car ils cherchent ce qui n'existe pas (§ 541 1°, 578). Ensuite, comme nous l'avons déjà remarqué tant de fois, chez l'individu qui veut donner une forme précise et logique aux sentiments qu'il éprouve, il y a d'habitude la tendance à attribuer une valeur absolue à ce qui n'est que relatif, à rendre objectif ce qui n'est que subjectif. Par conséquent, celui qui a en lui l'un des innombrables agrégats de sentiments décrits plus haut n'exprimera pas son état en disant simplement ce qu'il éprouve : il exprimera comme absolue et objective cette façon de sentir. Il ne dira jamais : « À moi et pour moi ceci paraît être le souverain bien ». Il dira, ce qui est bien différent : « Ceci est le souverain bien » ; et il emploiera des dérivations pour le prouver.
§ 1586. La dérivation sera en partie justifiée par le fait qu'outre le phénomène subjectif indiqué tout à l'heure, il y en a d'autres encore, qui sont objectifs, et qu'il faut considérer. Un certain agrégat A de sentiments existant chez un individu, nous pouvons nous poser les problèmes suivants. Quel sera, à un moment déterminé, et pour un but déterminé, l'effet, sur l'individu, de l'existence de A. De même, quel sera cet effet sur d'autres individus déterminés, sur des collectivités déterminées ? Au fond, ces problèmes constituent la théorie de l'équilibre social, et la difficulté de les résoudre est très grande. C'est pourquoi, ne pouvant faire autrement, nous devons chercher à les simplifier, en sacrifiant plus ou moins la rigueur.
§ 1587. On peut obtenir une première simplification en ne tenant pas compte des déterminations précises de l'individu, des collectivités, du moment, ou bien, en d'autres termes, en considérant certains phénomènes moyens et généraux. Mais, pour ne pas tomber en de graves erreurs, il faut se rappeler ensuite que les conclusions de ces raisonnements seront, elles aussi, moyennes et générales. Par exemple, on peut dire : « Le plaisir présent peut être compensé par la peine future ». C'est une manière elliptique de dire : « Pour beaucoup d'hommes, en général, il y a compensation entre le plaisir présent et le plaisir futur ». On peut dire : « Pour beaucoup d'hommes, en général, le plaisir présent peut causer une grave peine, en raison de la perte de l'estime et de la considération (en général) des autres individus de la collectivité ». Mais il serait erroné de tirer de cette proposition générale une conséquence particulière, en disant, par exemple : « Le plaisir présent peut causer à Paul une grave peine, en raison de la perte de l'estime et de la considération des individus M, N, P... ». En effet, il se pourrait que Paul ne se souciât point de cette estime ni de la considération, en général, ou bien, en particulier, de l'estime et de la considération de M, N, P...
§ 1588. On indique souvent l'effet sur les collectivités d'une manière quelque peu indéterminée, en parlant de la prospérité économique, militaire, politique, de la nation ; ou bien de la prospérité de la famille ou d'une autre collectivité restreinte, au point de vue de l'économie, de la dignité, de l'estime d'autrui, etc. Quand on ne peut avoir le plus, on est bien forcé de se contenter du moins, et ces problèmes, bien que nullement rigoureux, peuvent toutefois conduire à des théories sociologiques qui, en moyenne et en général, ne s'écartent pas trop des faits. Pour l'heure, nous devons nous considérer comme heureux, si nous pouvons les résoudre tant bien que mal, au moins en partie. Au fur et à mesure que la science progressera, on s'efforcera de les poser et de les résoudre plus rigoureusement.
§ 1589. Mais pour celui qui ne suit pas les méthodes de la science expérimentale, ces problèmes ne sont même pas posés de la façon peu rigoureuse indiquée tout à l'heure ; ils sont posés d'une manière absolument indéterminée. On recherche, par exemple, ce que doit faire l'individu, sans même établir les distinctions si simples entre son « bien » direct et son « bien » indirect, entre le « bien » de l'individu considéré comme faisant partie d'une collectivité et le « bien » de la collectivité. Peut-être, par une concession extrême, parlera-ton du « bien » de l'individu et du « bien » de la nation à laquelle il appartient, et nous pourrons nous estimer heureux si, au bien de la nation on ne substitue pas le « bien » de l'humanité. Mais, dans cette considération, les résidus de la sociabilité ne tardent pas à s'imposer, et au lieu de rechercher la solution des problèmes, on fait un prêche pour démontrer à l'individu qu'il doit sacrifier son « bien » à celui de l'humanité.
§ 1590. Tout cela se reflète dans les dérivations au moyen desquelles, partant des sentiments qui existent chez l'individu, ou de certains résidus, on arrive à démontrer que cet individu doit agir de la manière que l'auteur de la dérivation estime bonne. Cette manière ne s'écarte jamais beaucoup de celle qui est reçue par la société dans laquelle vit l'auteur. Comme d'habitude, on sait d'où l'on part ; on sait où l'on doit arriver ; la dérivation suit une voie quelconque qui joint ces deux points.
§ 1591. La dérivation qui use du mot souverain bien, ou bien, met tout dans ce mot : elle y met les agrégats des sentiments dont elle part ; elle y met aussi tout ce qu'elle peut des résultats qu'elle veut obtenir. Ainsi, l'une des plus fréquentes dérivations est celle qui, partant des sentiments d'égoïsme, donne le moyen d'atteindre le but des oeuvres de l'altruisme.
§ 1592. Un phénomène analogue a eu lieu en économie politique. Les économistes littéraires, incapables d'avoir une notion précise de l'équilibre économique, ont mis dans le terme valeur tout ce qu'ils pouvaient y mettre comme données de faits et comme résultats auxquels ils voulaient arriver. C'est ainsi que le terme valeur est devenu, bien qu'en de moindres proportions, un quid simile du terme souverain bien.
§ 1593. Les philosophes anciens et les modernes, ainsi que les théologiens, se sont donné beaucoup de peine pour trouver ce que pouvait bien être ce souverain bien ; et comme c'est une chose subjective, au moins en grande partie, chacun trouvait aisément ce qui lui plaisait. L'extrême, auquel on ne considère autre chose que le plaisir présent des sens, extrême qui n'est atteint, pas même par le chien, lequel sait aussi considérer des peines et des plaisirs futurs, n'a pas ou presque pas de théoriciens ; il est même douteux que les propositions qu'on pourrait citer comme étant de cette espèce, soient autre chose que des plaisanteries.
§ 1594. La première adjonction au sentiment du plaisir sensuel présent peut être la considération des conséquences, sensuelles elles aussi, de ce plaisir. À vrai dire, il ne semble pas que personne ait jamais été assez stupide pour les négliger entièrement. Celui qui le ferait, devrait avaler, uniquement parce qu'elle a bon goût, une boisson qu'il saurait être toxique. La question consiste donc uniquement dans la considération plus ou moins étendue de ces conséquences [FN: § 1594-1] .
§ 1595. Chez les cyrénaïques, qui appelaient souverain bien le plaisir présent, il semble que l'extension des conséquences n'était pas grande, mais était pourtant notable. Aristippe [FN: § 1595-1] , pour le peu que nous en savons, voulait que l'homme gouvernât toujours par son esprit les sentiments de plaisir sensuel et présent auxquels il cédait. C'est ce qu'exprime le mot célèbre d'Aristippe à l'égard de Laïs [FN: § 1595-2] : « Je la possède ; elle ne me possède pas ». Suivent d'autres adjonctions, toujours pour considérer d'autres plaisirs, outre les plaisirs présents ; ainsi, on disait déjà d'Aristippe qu'il déconseillait de rien faire contre les lois, à cause des peines établies [FN: § 1595-3] , et l'on ajoute : de l'opinion ; mais cela nous transporte dans un autre domaine. En suivant cette voie, on peut, par des dérivations opportunes, arriver où l'on veut.
§ 1596. Quand on dit que le souverain bien c'est la volupté [FN: § 1596-1] (I, 12, 40) Extremum autem esse bonorum voluptatem, il y a déjà une dérivation qui appartient au genre (IV-γ), et qui feint de donner l'explication d'un terme indéterminé, obscur, en le présentant comme équivalent d'un autre terme, lui aussi indéterminé, obscur. À la vérité, la volupté qui figure dans cette formule n'est pas la volupté vulgaire, que tout le monde connaît, mais une autre, qu'il faut déterminer. Cicéron plaisante là-dessus [FN: § 1596-2] : « (II, 3, 6) Alors il dit en riant : Ce serait vraiment parfait que celui-là même qui dit que la volupté est le but de tout ce que nous attendons, l'extrême, l'ultime des biens, ne sût pas ce que c'est ! » Il ajoute que les termes de voluptas en latin, ![]() en grec, sont parfaitement clairs, et que ce n'est pas sa faute à lui s'il ne les comprend pas quand ils sont employés par Épicure ; mais que c'est la faute de celui-ci, qui les détourne de leur sens vulgaire. En cela, Cicéron a raison ; mais sa critique va beaucoup au-delà de ce qu'il voudrait, car elle atteint tous les raisonnements métaphysiques, y compris ceux de Cicéron lui-même. Pour ne pas chercher trop loin, voici que, lorsque Cicéron veut prouver que la volupté n'est pas le souverain bien, il dit, en parlant d'hommes qui satisfont tous les plaisirs des sens : « (II, 8, 24) Je ne dirai jamais que ces gens dissolus vivent bien ou bienheureusement ». Dans cette proposition, il induit le lecteur en erreur, par le double sens de vivre bien ou bienheureusement, cette expression pouvant se rapporter aux sensations des gens dissolus ou à celles de Cicéron, lequel devrait dire, par conséquent : « Les gens dissolus estiment leur vie bonne et bienheureuse, et moi, si je devais mener cette vie, je ne l'estimerais pas telle ». Cicéron ajoute ensuite : « (II, 8, 24) De là résulte, non pas que la volupté n'est pas la volupté, mais qu'elle n'est pas le souverain bien ». Cela est vrai ou faux, suivant la personne dont il s'agit. Pour les gens dissolus, c'est le souverain bien ; pour Cicéron, ce n'est pas le souverain bien ; et cette dernière expression se rapporte à une chose qui n'est pas bien définie [FN: § 1596-3].
en grec, sont parfaitement clairs, et que ce n'est pas sa faute à lui s'il ne les comprend pas quand ils sont employés par Épicure ; mais que c'est la faute de celui-ci, qui les détourne de leur sens vulgaire. En cela, Cicéron a raison ; mais sa critique va beaucoup au-delà de ce qu'il voudrait, car elle atteint tous les raisonnements métaphysiques, y compris ceux de Cicéron lui-même. Pour ne pas chercher trop loin, voici que, lorsque Cicéron veut prouver que la volupté n'est pas le souverain bien, il dit, en parlant d'hommes qui satisfont tous les plaisirs des sens : « (II, 8, 24) Je ne dirai jamais que ces gens dissolus vivent bien ou bienheureusement ». Dans cette proposition, il induit le lecteur en erreur, par le double sens de vivre bien ou bienheureusement, cette expression pouvant se rapporter aux sensations des gens dissolus ou à celles de Cicéron, lequel devrait dire, par conséquent : « Les gens dissolus estiment leur vie bonne et bienheureuse, et moi, si je devais mener cette vie, je ne l'estimerais pas telle ». Cicéron ajoute ensuite : « (II, 8, 24) De là résulte, non pas que la volupté n'est pas la volupté, mais qu'elle n'est pas le souverain bien ». Cela est vrai ou faux, suivant la personne dont il s'agit. Pour les gens dissolus, c'est le souverain bien ; pour Cicéron, ce n'est pas le souverain bien ; et cette dernière expression se rapporte à une chose qui n'est pas bien définie [FN: § 1596-3].
§ 1597. Nous avons une proposition : A est égal à B, et nous voulons au contraire qu'il soit égal à C. Pour cela, nous avons deux procédés : ou bien de respecter la première proposition, et de changer le sens de B, de manière à ce qu'il soit identique à C ; ou bien de nier la première proposition, et d'y substituer la suivante : A est égal à C.
§ 1598. La dérivation s'allonge, parce qu'en outre de la volupté, on veut tenir compte de résidus de la persistance des agrégats (juste, honnête, etc.), et de résidus de l'intégrité personnelle (honorable, digne, etc.), soit relativement à l'individu, en les plaçant dans l'agrégat de sentiments qu'il éprouve, soit à l'égard d'autres personnes, de la collectivité, en plaçant dans la dérivation l'indication de certains buts qu'on veut atteindre. On a ainsi un très grand nombre de théories dont nous n'avons pas à nous occuper ici ; nous nous bornerons à exposer le peu qui est nécessaire pour mieux comprendre la nature des dérivations.
§ 1599. Cicéron [FN: § 1599-1] rappelle que, selon Hiéronyme de Rhodes, le souverain bien est l'absence de toute douleur (II, 3, 8). Il blâme Épicure, qui ne sait se décider (II, 6, 18), car il devrait, ou accepter la volupté au sens vulgaire, que Cicéron dit être celui d'Aristippe, ou prendre pour volupté l'absence de douleur, ou unir les deux choses, et avoir ainsi deux buts. « (II, 6, 19) En vérité, de nombreux et grands philosophes tirent une semblable union des buts des biens ; ainsi Aristote, qui unit l'usage de la vertu à une vie de prospérité parfaite. Calliphon ajouta la volupté à l'honnête ; Diodore ajouta à l'honnête l'absence de douleur. Épicure aurait pu faire de même, s'il avait uni la maxime qui maintenant est de Hiéronyme avec celle qui fut d'Aristippe ». Il compte ensuite (II, 11, 35) qu'en ce qui concerne le souverain bien, il y a trois opinions dans lesquelles il n'est pas question de l'honnête : celles d'Aristippe ou d'Épicure, d'Hiéronyme, de Carnéade [pour celui-ci le souverain bien consiste à jouir des principes de la nature : Carneadi frui principiis naturalibus, esset extremum], trois autres où l'honnête est mis avec quelque chose d'autre ; ce sont celles de Polémon, de Calliphon, de Diodore. Une seule, dont Zénon est l'auteur, met le souverain bien dans la décence et dans l'honnêteté.
§ 1600. Suivant Saint Augustin, Varron faisait un compte plus ample des opinions possibles, et arrivait au nombre respectable de 298 ; mais ensuite il observe qu'elles se réduisent à douze, en triplant les quatre choses : la volupté – le repos – la volupté unie au repos – les premiers biens de la Nature – la vertu. Varron supprime les trois premières, non qu'il les blâme, mais parce qu'elles sont comprises dans les premiers biens de la Nature [c'est là une belle, mais obscure entité], et il réduit ainsi les opinions à trois : la recherche des premiers biens de la nature pour arriver à la vertu, ou la vertu pour arriver à ces biens, ou la vertu pour elle-même. Saint Augustin [FN: § 1600-1] tourne en plaisanterie tous ces bavardages, et, les négligeant, établit et arrête que la vie éternelle est le souverain bien, la mort éternelle le souverain mal. Ainsi nous voilà arrivés à l'autre extrême des dérivations.
§ 1601. Le noyau de sentiments correspondant aux divers sens donnés par les métaphysiciens et par les théologiens au terme vrai, est constitué principalement par des notions qui ne trouvent pas d'opposition dans l'esprit de celui qui emploie l'un des noms que l'on donne à ces sens. Ainsi naît spontanément la conception de l'égalité du bien et du vrai, qui sont des agrégats de sentiments, lesquels ne trouvent ni l'un ni l'autre d'opposition dans l'esprit de celui qui emploie ces mots. Pour des motifs semblables, on peut étendre l'égalité à ce qu'on dit être beau. Y aura-t-il un homme qui, trouvant une chose bonne et vraie, ne la jugera pas de même belle ? Ce qui existe dans son esprit doit exister dans l'esprit de tous, surtout si c'est un métaphysicien ou un théologien ; et quiconque a le malheur de ne pas penser comme lui, ne mérite certainement pas le nom d'homme. D'où résulte aussitôt la conclusion que tous les hommes sont d'accord avec lui ; et le pouvoir et le lustre de ses excellentes théories s'accroissent. Mais il se peut que cet homme éminent trouve un pareil, qui ne soit pas d'accord avec lui. Autrefois ils se persécutaient alors mutuellement, se mettaient en prison, parfois se brûlaient ; aujourd'hui, adoucis, ils se contentent de s'injurier.
§ 1602. Il y a aussi une belle entité qui s'appelle Nature et qui, avec son adjectif naturel, auquel se joint encore un certain état naturel, joue un grand rôle dans les dérivations. Ce sont des mots si indéterminés que souvent celui-là même qui les emploie ne sait ce qu'il veut leur faire exprimer [FN: § 1602-1] . Dans la vie journalière, l'homme rencontre beaucoup de choses qui lui sont contraires, lui causent des maux ou seulement des ennuis, par suite de certaines circonstances qu'il estime artificielles. Telles seraient les attaques des brigands, les embûches des voleurs, les arrogances de ceux qui sont riches ou puissants, etc. Si l'on élimine toutes ces circonstances, il reste un noyau, que nous appellerons naturel, par opposition aux artifices éliminés, et qui doit nécessairement être parfaitement bon, puisque nous nous sommes précisément débarrassés de tout ce qu'il y avait de mal (§ 1546). Qu'on veuille bien observer, en effet, la manière dont raisonnent tous les auteurs métaphysiciens, théologiens, adeptes des physiocrates, de Rousseau, et autres semblables rêveurs. Ils ne disent pas : « Voici un état que nous appelons naturel. L'observation de tel et tel qui l'ont vu et étudié, a fait connaître qu'il avait certaines qualités ». Au contraire, ces personnes, partant de l'état présent, éliminent tout ce qui leur paraît mal, et donnent le nom de naturel à ce qui reste. Bien plus, Rousseau, admiré, adoré encore par beaucoup de gens, avoue naïvement qu'il ne se soucie pas des faits (§ 821). Parmi ses nombreux précurseurs, on peut mettre ce saint Père qui, louant le bel ordre donné par Dieu à la Nature, raconte que, dans cette Nature, tous les petits animaux vivent dans la paix et la concorde [FN: § 1602-2] . N'avait-il donc jamais vu des araignées manger des mouches, des oiseaux manger des araignées, des abeilles essaimer ? N'avait-il pas lu Virgile [FN: § 1602-3] ? De nos jours encore, nous trouvons des auteurs qui valent ce saint Père, et rien n'est plus amusant que la manière de raisonner de ceux qui se moquent des « superstitions catholiques », et qui accueillent avec respect les superstitions des fidèles de Rousseau.
§ 1603. Dans les notes de sa traduction du traité des Lois de Cicéron [FN: § 1603-1] , Ch. de Rémusat trouve au moins quatre sens dans lesquels le mot Nature est employé par Cicéron. À cause du manque de place, je me borne à les indiquer brièvement ; mais le lecteur fera bien de les voir dans l'original. Nous avons : l° un sens général : la nature est l'ensemble des faits de l'univers 2° un sens particulier : la nature est la constitution de chaque être 3° un autre sens, expliqué ainsi : « Mais Cicéron l'emploie aussi dans un sens propre et singulier, qui n'est déterminé qu'implicitement et par la connaissance de sa doctrine [excellent moyen de créer des logomachie]. La nature d'un être est ce qui le constitue, ce qu'il est, ou sa loi. En conséquence elle est bonne, elle est sa perfection ; témoin ces phrases : Ad summum perducta natura, 1, 8; ducem naturam, 1, 10, etc. Ainsi l'expression du droit naturel n'est pas indifférente ; car elle emporte que le droit existe par lui-même, qu'il fait partie de la loi générale des êtres [il y a des gens qui comprennent cela !] Voyez : Natura constitutum, 1, 10 ; quod dicam naturam esse, quo modo est natura, utilitatem a natura, 1, 12 ». 4° Une certaine puissance. « C'est par une dérivation vague de cette acception que l'on se représente aussi la nature comme une puissance distincte et agissante qui produit et conserve le monde... Natura largita est, docente natura, 1, 8 ; eadem natura, 1, 9; natura factos, natura dati, a natura data, 1, 12 ».
Le lecteur peut aisément se figurer combien est précieux pour les dérivations ce terme qui signifie tout. et rien.
§ 1604. Avec Aristote, dame Nature change entièrement d'aspect. Le Stagirite [FN: § 1604-1] commence par remarquer (II, 1, 1) que les êtres naturels ont en eux un principe de mouvement ou de repos, tandis qu'au contraire un lit, un vêtement ou d'autres objets semblables n'ont pas ce principe, parce qu'ils ne tendent pas à changer. Il suit de là que « (2) la nature est principe et cause du mouvement et du repos, pour l'être en lequel ce principe existe primitivement en soi et non par accident ». Ensuite, il y a encore une autre définition. « (1, 10) En un sens, nous pouvons appeler nature la matière première existant chez les êtres qui ont en eux un principe de mouvement et de mutation. En un autre sens : la forme et l'espèce selon la définition [FN: § 1604-2] ». Aujourd'hui encore, il y a des gens qui s'imaginent comprendre ces discours et les admirent. Dans la préface de sa traduction du traité que nous venons de citer d'Aristote, Barthélemy Saint-Hilaire dit : « (p. IV). je n'hésite pas à déclarer pour la Physique qu'elle est une de ses œuvres [d'Aristote] les plus vraies et les plus considérables » [FN: § 1604-3] . Pourtant, au sujet de la définition de la nature, indiquée tout à l'heure, le bon Barthélemy Saint-Hilaire a quelques scrupules : « (p. XXXII) Je ne voudrais pas soutenir que cette définition (p. XXXIII) de la nature soit à l'abri de toute critique... Lui-même [Aristote] sans doute la trouvait insuffisante ; car il essaie de l'approfondir un peu davantage. Il se demande donc puisqu'il reconnaît deux éléments essentiels dans l'être, la matière et la forme, avec la privation, si c'est la matière ou la forme qui est la véritable nature [comment distingue-t-on la vraie nature de celle qui n'est pas vraie ?] des êtres. Il incline à penser que la forme d'une chose est bien plutôt sa nature que ne l'est la matière ; car la matière n'est en quelque sorte qu'en puissance, tandis que la forme est l'acte et la réalité ». Nous avons ainsi un excellent exemple de dérivations verbales : on a mis ensemble un grand nombre de mots qui excitent certains sentiments, mais qui ne correspondent à rien de réel.
§ 1605. D'après la manière dont furent constitués les agrégats de sentiments correspondant aux termes : fin de l'homme, souverain bien, droite raison, nature, on comprend aisément que ces termes peuvent être pris l'un pour l'autre, car, en somme, ils représentent, avec beaucoup d'indétermination, un même ensemble de sentiments. C'est ainsi que les Stoïciens ont pu dire que la fin de l'homme, le souverain bien, c'est vivre suivant la nature. Qu'est-ce que cette nature représente de précis ? On l'ignore ; et il est bon qu'on ne le sache pas, parce que les sens divers et indéterminés qu'on lui donne servent à faire accepter la proposition indiquée tout à l'heure, et d'autres semblables. Bien plus, selon Stobée, Zénon commença par dire d'une manière encore plus indéterminée, que la fin, c'est de vivre d'une façon harmonique ; ce qui, ajoute Stobée, [FN: § 1605-1] « est vivre suivant une raison et harmoniquement. Mais ceux qui vinrent ensuite, en corrigeant, expliquèrent ainsi : vivre en harmonie avec la nature [FN: § 1605-2] ... Cléanthe, le premier,... ajouta la nature, et établit que la fin, c'était de vivre en harmonie avec la nature ». Continuant à rendre équivalents des termes qui correspondent à certains sentiments, les Stoïciens disent que la fin, c'est la félicité : « c'est là vivre suivant la vertu, vivre harmoniquement ou, ce qui revient au même, vivre suivant la nature ».
§ 1606. Il convient ensuite de porter spécialement notre attention sur le principe de sociabilité et sur le principe altruiste qui existent en de tels agrégats de sentiments, et de ne pas oublier la droite raison. Toutes ces belles choses, nous les fourrerons dans la notion de nature, et nous dirons avec les stoïciens, selon Diogène Laërce [FN: § 1606-1] : « Par conséquent, la fin c'est vivre conséquemment à la nature, c'est-à-dire suivant sa propre nature et suivant celle de l'univers, sans rien faire de ce que la loi commune prohibe habituellement, ce qui est la droite raison qui arrive partout [sic ], qui est auprès de Zeus, et qui avec lui gouverne toute chose existante. C'est là la vertu de l'homme heureux et la prospérité de la vie, alors que tout se fait en accord avec l'esprit de chacun, avec la volonté du modérateur de toute chose. C'est pourquoi Diogène dit expressément que la fin, c'est la droite raison dans le choix de ce qui est selon la nature; et Archidamos dit que c'est vivre en accomplissant tous ses devoirs ». Voilà un bon exemple de dérivation verbale : on accumule des mots, et l'on a un mélange où il y a un peu de tout.
§ 1607. Le type de ces dérivations est le suivant. On veut démontrer que A est égal à B. On commence par démontrer que A est égal à X, parce que les sentiments éveillés par A et par X concordent ; et l'on prend soin de choisir X d'un sens tellement vague et indéterminé que, d'une part, les sentiments que fait naître ce terme concordent avec ceux qui sont provoqués par A ; d'autre part, ils peuvent aussi concorder avec ceux provoqués par B. De cette façon s'établit l'égalité de X et de B. Mais comme on a déjà vu que A est égal à X, il en résulte que A est aussi égal à B, ce que précisément on voulait démontrer. Ce raisonnement est semblable à celui que nous avons déjà vu (§ 480 et sv.), et au moyen duquel on prouve l'égalité de A et de B par l'élimination d'une entité X, étrangère au domaine expérimental. De même, en d'autres cas, l'intervention d'un terme indéterminé qui correspond mal à une chose réelle, a des conséquences semblables à l'intervention d'un terme correspondant à une entité qui se trouve entièrement en dehors du domaine expérimental (§ 108, 1546). Un exemple remarquable de ces dérivations est celui que nous avons examiné précédemment (§ 1557 et sv.), en traitant de la solidarité. Nous avons vu alors que X (solidarité-fait) est vraiment, de l'aveu des auteurs même du raisonnement, l'opposé de B (solidarité-devoir); et pourtant, la proposition A est X (parmi les hommes existe la solidarité-fait) sert à démontrer que A est B (parmi les hommes, il faut qu'existe la solidarité-devoir).
Au point de vue de la logique formelle, les raisonnements avec X indéterminé sont des syllogismes à plus de trois termes, le moyen terme X étant devenu multiple, précisément à cause de son indétermination, sans que, souvent, on puisse même fixer avec précision combien il a de sens. Ensuite, si X sort du domaine expérimental, outre la cause d'erreur indiquée, qui subsiste presque toujours, nous avons la majeure et la mineure du syllogisme, qui n'ont pas de sens, parce qu'elles établissent des rapports entre des faits expérimentaux et des entités non-expérimentales.
§ 1608. Rousseau dit que la volonté générale X ne peut errer ; ce qui correspond à la proposition : X est A (sans erreurs, droite). Pour démontrer cela, il considère tous les citoyens comme constituant une seule personne, ayant une seule volonté, et comme il donne d'ailleurs un sens spécial au terme erreur, la proposition veut dire qu'une personne est seule juge de ce qui lui est agréable ou désagréable. Sous cette forme on peut admettre la proposition. Maintenant, on modifie X, et l'on ne peut faire autrement, puisque ces citoyens qui agissent tous ensemble comme une seule personne n'existent pas. On affirme, sans donner de preuve, que la volonté générale X est exprimée par la somme des volontés particulières, quand les citoyens votent sans communiquer entre eux. Comme cela aussi est impossible, on modifie nouvellement X, et, se contentant du peu qu'on puisse avoir, on suppose que X est la somme des volontés particulières sans brigues et sans associations partielles. Ainsi s'établit l'égalité de la volonté générale avec le vote des citoyens B, lorsqu'ils votent sans brigues et sans associations partielles. Mais nous avons vu que X est égal à A ; donc A est égal à B, et nous concluons qu'il ne peut y avoir d'erreur A dans la décision des citoyens B qui votent sans brigues et sans associations partielles. Le jeu plaît aux admirateurs de Rousseau, et ils le continuent. De nouveau, X se modifie et devient l'expression de la majorité des élus de la majorité (?) des électeurs, sans qu'il soit plus question des brigues ni des associations. C'est ainsi que nous avons l'un des dogmes les plus sublimes de la religion démocratique [FN: § 1608-1].
§ 1609. Ce raisonnement est accepté par beaucoup de gens. Ce n'est pas en vertu de sa valeur logico-expérimentale, car elle est zéro ; ni du manque d'intelligence des personnes qui l'acceptent, parce qu'il y en a de très intelligentes. D'où vient donc le succès de la dérivation ? Il a une infinité de causes. En voici quelques-unes : 1°Les gens qui font partie, ou croient faire partie de la majorité, acceptent volontiers une théorie qu'ils comprennent dans ce sens qu'elle consacre leur infaillibilité. 2° Les habiles qui gagnent de l'argent au moyen des droits protecteurs et de tant d'autres façons ; ceux qui obtiennent de l'élection populaire pouvoir, honneurs, richesses, jugent tous les théories, non d'après leur valeur intrinsèque, mais d'après la force qu'elles ont de flatter les électeurs dont ils dépendent. Est-ce la faute des habiles, si les électeurs se repaissent de sornettes ? Blâmé de s'être jeté aux pieds du tyran Denys, Aristippe répondit : « Ce n'est pas ma faute à moi, mais à Denys, qui a les oreilles aux pieds ». 3° Des personnes qui ne font pas partie de la majorité, mais sont hostiles à leurs supérieurs dans la hiérarchie sociale, qui s'attachent à ceux qu'ils croient être en majorité, pour combattre ces supérieurs, ou simplement pour leur faire pièce. 4° Un petit nombre d'individus qui ont un besoin intense de religiosité acceptent ce dogme de la religion démocratico-humanitaire, comme ils auraient accepté tout autre dogme. Ils auraient peut-être été prêtres de Cybèle, aux temps du paganisme, moines au moyen âge, ils sont aujourd'hui adulateurs de la plèbe. 5° Beaucoup de personnes peu intelligentes acceptent l'opinion de la collectivité, grande ou restreinte, dans laquelle elles vivent, et passent facilement de l'admiration de Bossuet à celle de Voltaire, de Rousseau, de Tolstoï et de tous ceux qui obtiennent de la renommée et du crédit. 6° Des personnes, qui jugent les théories sans y comprendre grand'chose, estiment cette théorie bonne uniquement parce qu'elle flatte agréablement leurs sentiments. Enfin, on pourrait trouver d'autres causes semblables, en fixant son attention sur les nombreuses catégories qu'on peut former, suivant les différentes façons dont les intérêts et les sentiments agissent sur le jugement des hommes.
§ 1610. Le genre de dérivations (IV-γ) a un cas extrême, dans lequel on observe de simples coïncidences verbales. Par exemple, en 1148, au concile de Reims [FN: § 1610-1] « fut amené un gentilhomme Breton nommé Eon de l'Étoile, homme presque sans lettres : qui se disoit être le fils de Dieu et le juge des vivans et des morts, sur l'allusion grossière de son nom avec le mot latin Eum dans cette conclusion des exorcismes Per eum qui judicaturus est : et dans celle des oraisons Per eumdem. Cette imagination toute absurde qu'elle étoit, ne laissa pas de lui servir à séduire une grande multitude de peuple ignorant des extrémitez de la France, c'est-à-dire, de Bretagne et de Gascogne... » L'amphibologie des termes et des propositions est un excellent moyen pour expliquer les oracles et les prophéties ; et quand on y ajoute les métaphores (IV-δ) et les allégories (IV-ε), il serait vraiment nécessaire d'être entièrement dépourvu d'imagination pour ne pas savoir tirer de ces oracles et de ces prophéties tout ce qu'on peut désirer. Prenant comme point de départ des raisonnements de ce genre, qu'on prétend faits sérieusement, on arrive peu à peu à de simples plaisanteries, telles que la réponse donnée à celui qui demandait s'il pouvait demeurer en sécurité quant à ses ennemis : Domine stes securus, qu'on peut comprendre dans le sens qu'il pouvait effectivement demeurer en sécurité, et qui signifiait le contraire : Domi ne stes securus.
§ 1611. Un exemple remarquable des dérivations du présent genre (IV-γ), au moyen desquelles on parcourt les deux voies, de la chose au mot et du mot à la chose, nous est donné par les explications du terme démon.
§ 1612. 1° De la chose au mot. Les Grecs désignaient par le terme ![]() des choses imaginaires, variables suivant les temps et les auteurs. Dans Homère,
des choses imaginaires, variables suivant les temps et les auteurs. Dans Homère, ![]() se confond souvent avec la notion de
se confond souvent avec la notion de ![]() , ou mieux avec la notion de l'action du
, ou mieux avec la notion de l'action du ![]() . On a dit, mais cela est douteux, que souvent c'est l'action mauvaise qui est indiquée ainsi. Chez Hésiode, les
. On a dit, mais cela est douteux, que souvent c'est l'action mauvaise qui est indiquée ainsi. Chez Hésiode, les ![]() sont d'une nature intermédiaire entre celle des dieux et celle des hommes, mais ils sont tous bons. Dans la suite, cette nature intermédiaire permit de distinguer de bons et de mauvais démons. Messieurs les philosophes ont voulu s'en mêler, et comme leur sens moral était offusqué de voir la religion populaire attribuer aux dieux de bonnes et de mauvaises actions, ils jugèrent à propos, pour s'épargner la peine que leur causaient les mauvaises, d'en faire cadeau aux démons [FN: § 1612-1]. C'est là une dérivation semblable à celle qui distingue la droite raison, qui fait tout bien, de la simple raison, qui pèche parfois. Ce thème des mauvaises actions fut développé par plusieurs auteurs, qui créèrent des démons pervers au-delà de toute expression.
sont d'une nature intermédiaire entre celle des dieux et celle des hommes, mais ils sont tous bons. Dans la suite, cette nature intermédiaire permit de distinguer de bons et de mauvais démons. Messieurs les philosophes ont voulu s'en mêler, et comme leur sens moral était offusqué de voir la religion populaire attribuer aux dieux de bonnes et de mauvaises actions, ils jugèrent à propos, pour s'épargner la peine que leur causaient les mauvaises, d'en faire cadeau aux démons [FN: § 1612-1]. C'est là une dérivation semblable à celle qui distingue la droite raison, qui fait tout bien, de la simple raison, qui pèche parfois. Ce thème des mauvaises actions fut développé par plusieurs auteurs, qui créèrent des démons pervers au-delà de toute expression.
§ 1613. 2° Du mot à la chose. Les chrétiens trouvèrent ce terme ![]() en usage, et en tirèrent profit pour remonter du mot à la chose. Les Grecs, qui d'abord avaient mis ensemble dieux et démons, à un moment donné les séparèrent, pour pouvoir rejeter exclusivement sur les démons les fautes et les crimes qu'il leur était difficile de nier chez les dieux [FN: § 1613-1] . Les chrétiens ne se le firent pas dire deux fois ; et, confondant, de bonne foi ou à dessein, l'ancien et le nouveau sens du terme démon, ils conclurent que, de l'aveu des païens eux-mêmes, les dieux de ceux-ci étaient des êtres malfaisants. De cette façon, la dérivation réalisait le désir des chrétiens, qui trouvaient des témoins et des preuves de leur propre théologie dans le camp même de l'adversaire. Cet excellent Platon ayant, dans le Banquet, raconté plusieurs fables absurdes sur les démons, Minucius Félix [FN: § 1613-2] a grand soin de ne pas laisser perdre ce trésor, et se prévaut de l'autorité de Platon pour démontrer que les démons animaient les statues des dieux. Lactance aussi estime que les dieux des Gentils sont des démons, et, s'adressant aux Gentils, il leur dit [FN: § 1613-3] : « S'ils estiment qu'on ne doit pas se fier à nous, qu'ils en croient Homère, qui met le très grand Jupiter au rang des démons, ainsi que d'autres poètes et philosophes qui nomment de la même manière les démons et les dieux. De ces deux noms, le premier est vrai, le second faux ». Tatien, lui aussi, fait de Zeus le chef des démons. Il peut avoir tort, aussi bien qu'il peut avoir raison, car l'un et les autres nous sont également inconnus ; c'est pourquoi la science expérimentale ne saurait absolument pas décider si Tatien dit vrai ou non [FN: § 1613-4] .
en usage, et en tirèrent profit pour remonter du mot à la chose. Les Grecs, qui d'abord avaient mis ensemble dieux et démons, à un moment donné les séparèrent, pour pouvoir rejeter exclusivement sur les démons les fautes et les crimes qu'il leur était difficile de nier chez les dieux [FN: § 1613-1] . Les chrétiens ne se le firent pas dire deux fois ; et, confondant, de bonne foi ou à dessein, l'ancien et le nouveau sens du terme démon, ils conclurent que, de l'aveu des païens eux-mêmes, les dieux de ceux-ci étaient des êtres malfaisants. De cette façon, la dérivation réalisait le désir des chrétiens, qui trouvaient des témoins et des preuves de leur propre théologie dans le camp même de l'adversaire. Cet excellent Platon ayant, dans le Banquet, raconté plusieurs fables absurdes sur les démons, Minucius Félix [FN: § 1613-2] a grand soin de ne pas laisser perdre ce trésor, et se prévaut de l'autorité de Platon pour démontrer que les démons animaient les statues des dieux. Lactance aussi estime que les dieux des Gentils sont des démons, et, s'adressant aux Gentils, il leur dit [FN: § 1613-3] : « S'ils estiment qu'on ne doit pas se fier à nous, qu'ils en croient Homère, qui met le très grand Jupiter au rang des démons, ainsi que d'autres poètes et philosophes qui nomment de la même manière les démons et les dieux. De ces deux noms, le premier est vrai, le second faux ». Tatien, lui aussi, fait de Zeus le chef des démons. Il peut avoir tort, aussi bien qu'il peut avoir raison, car l'un et les autres nous sont également inconnus ; c'est pourquoi la science expérimentale ne saurait absolument pas décider si Tatien dit vrai ou non [FN: § 1613-4] .
§ 1614. (IV-δ) Métaphores, allégories, analogies. Données comme une simple explication, comme un moyen de se faire une idée d'une chose inconnue, les métaphores et les analogies peuvent être employées scientifiquement pour passer du connu à l'inconnu ; mais, données comme une démonstration, elles n'ont pas la moindre valeur scientifique. Parce qu'une chose A est, en certains points, semblable, analogue à une autre chose, B, il ne s'ensuit nullement que tous les caractères de A se retrouvent en B, ni qu'un certain caractère soit précisément l'un de ceux pour lesquels l'analogie existe.
§ 1615. Il y a des usages directs et des usages indirects des métaphores et des analogies. Comme exemple d'usages directs, on peut prendre le suivant. A et B ont en commun le caractère P, par lequel A est analogue à B, et métaphoriquement dit égal à B. Mais B a aussi un caractère Q, qui ne se retrouve pas en A. De l'égalité de A et de B on tire la conclusion que A a aussi le caractère Q. C'est là l'usage le plus fréquent du raisonnement par analogie, parce qu'on aperçoit moins l'erreur, si l'on a soin de ne pas séparer P de Q, et de s'exprimer de manière à ne pas laisser apercevoir que c'est seulement à cause du caractère commun P, que A est dit égal à B. Comme exemple d'usages indirects, on peut citer le suivant. A est analogue à B pour un certain caractère P, qui se trouve être commun en A et en B. De même, B est analogue à C pour un certain caractère commun Q, qui n'existe pas en A. On raisonne ainsi : A est égal à B; B est égal à C ; donc A est égal à C (§ 1632).
Cet usage n'est pas très fréquent, parce que la forme du raisonnement fait saisir le sophisme. Pour le dissimuler mieux, il faut supprimer autant que possible toute forme de raisonnement logique, et employer la dérivation qui persuade par les sentiments accessoires que suggèrent certains termes (IV-β).
§ 1616. Les dérivations au moyen de métaphores, d'allégories, d'analogies, sont très usitées par les métaphysiciens et les théologiens. Les œuvres de Platon sont une suite de métaphores et d'analogies, données comme démonstrations. Par exemple, il écrit la République pour étudier ce qu'est le juste et l'injuste, et c'est par l'analogie qu'il résout ce problème. Il commence (p. 386 e) par établir une analogie entre la recherche de la justice et la lecture de l'écriture. Celle-ci ne se lit-elle pas mieux quand elle est écrite avec de grands caractères ? Donc cherchons quelque chose où la justice se trouve en grands caractères. La justice se trouve en l'homme et dans la société ; mais la société est plus grande que l'homme ; donc il sera plus facile d'y discerner la justice. Et dans tout le livre on continue sur ce pied. Dans le Phédon, Platon donne une excellente démonstration de l'immortalité de l'âme : « (p. 71) Socrate. Dis-moi donc, au sujet de la vie et de la mort, ne dirais-tu pas que vivre est le contraire de mourir ? – Kébès. Certainement. – Soc. Et qu'ils naissent l'un de l’autre ? Kéb. Oui. – Soc. Donc qu'est-ce qui naît du vivant ? – Kéb. Le mort. – Soc. Mais qui donc naît du mort ? – Kéb. On est forcé d'avouer que c'est le vivant. – Soc. Donc, ô Kébès, du mort naissent les vivants et tout ce qui a vie. – Kéb. Il semble. – Soc. Donc nos âmes sont [après la mort] aux Enfers ? – Kéb. Il me semble... ».
§ 1617. Au temps de la querelle des investitures, le pape et l'empereur brandissaient des métaphores, en attendant que des armes plus concrètes décidassent de la victoire. La métaphore des deux glaives est célèbre. « C'est que sur le fondement de cette parole des apôtres à Jésus-Christ : Seigneur, voici deux glaives ; on prétendoit que ces deux glaives signifioient la puissance temporelle, qu'on appelloit le glaive matériel, et la puissance ecclesiastique, qu'on appelloit le glaive spirituel ; et c'est en ce sens que Saint Bernard dit dans cette lettre : L'un et l'autre glaive appartient à Pierre ; l'un doit être tiré à sa sollicitation, l'autre de sa main, toutes les fois qu'il en est besoin. C'est de celui qui convenoit le moins à Pierre, qu'il lui fut dit de le mettre dans le fourreau. Il étoit donc aussi à lui, mais il ne le devoit pas tirer de sa main » [FN: § 1617-1]. Les partisans de l'empereur n'admettaient nullement que le glaive matériel appartînt aussi au pape. « D'où vient cette autorité au pape de tirer un glaive meurtrier outre le glaive spirituel ? Le pape Gregoire premier dit, que s'il eût voulu se mêler de faire mourir des Lombards, ils n'eussent plus eu ni roi ni ducs. „ Mais, ajoute-t-il, parce que je crains Dieu, je ne veux participer à la mort d'aucun homme, quel qu'il soit “. À cet exemple tous les papes suivans se contentoient du glaive spirituel : jusques au dernier Gregoire, c'est-à-dire, Hildebrand, qui le premier s'est armé contre l'empereur du glaive militaire, et en a armé les autres papes par son exemple » [FN: § 1617-2] . On employait d'autres belles métaphores. « Grégoire VII, successeur de Saint Pierre, représentant de Jésus-Christ sur la terre, croyait pouvoir châtier les successeurs de Nemrod, qui n'étaient pour lui que des anges rebelles. L'âme ne l'emportait-elle point sur la matière, l'Église sur la société laïque, et le sacerdoce sur l'Empire, comme le soleil sur la lune et l'or sur le plomb ? [FN: § 1617-3] ». Ces deux métaphores, la comparaison du pouvoir papal à l'âme, du pouvoir laïque à la matière, et la comparaison du pouvoir papal au soleil, du pouvoir laïque à la lune, furent largement employées. Dans sa lettre à Henri, roi d'Angleterre, Saint Yves se sert de la première métaphore ; et elle est confirmée par Saint Thomas [FN: § 1616-4] .
§ 1618. Il est encore d'autres métaphores : celle qui considère l'Église comme unie à l'État, à l'instar de l'union matrimoniale de l'homme (l'Église) avec la femme (l'État) [FN: § 1618-1] ; et celle qui, du nom de Saint Pierre, tire la démonstration du fondement divin de l'Église et de la papauté, et au sujet de laquelle on a tant écrit [FN: § 1618-2].
§ 1619. Nous avons déjà étudié les explications métaphoriques, principalement pour rechercher si et comment on pouvait remonter aux faits dont on supposait qu'elles tiraient leur origine (chap. V). Maintenant, nous les considérons principalement comme moyen d'arriver à certaines conclusions qu'on a en vue. Un peuple a un livre vénéré ou sacré ; par exemple Homère pour les Grecs, le Coran pour les musulmans, la Bible pour les Israélites et pour les chrétiens. Ou peut accepter le livre à la lettre [FN: § 1619-1]. Mais, tôt ou tard, il arrive qu'on veut voir s'il y a un autre sens que le sens littéral. On pourrait se livrer à cette recherche sans autre but que de trouver ce sens ; c'est ce que font parfois les érudits. Mais généralement on a une intention prédéterminée, et, à vrai dire, on ne cherche pas ce qu'il y a dans le livre, mais de quelle manière on peut le faire concorder avec une certaine conception déjà connue a priori. En d'autres termes, on cherche une interprétation, une dérivation, pour concilier deux choses indépendantes : le texte et la conception que l'on veut justifier (§ 1414, 1447). Pour cela, l'interprétation symbolique et l'interprétation allégorique nous offrent des moyens puissants et faciles. Nous ne parlons pas ici d'interprétations comme celles de Palaephate, dont nous nous sommes déjà occupés ailleurs (§ 661).
§ 1620. S'il y avait une règle quelconque pour déterminer quel symbole, quelle allégorie doit nécessairement représenter une expression donnée A, les interprétations symboliques ou allégoriques pourraient n'être pas vraies, c'est-à-dire ne pas correspondre aux faits, mais elles seraient du moins déterminées. Mais cette règle n'existant pas, il appartient à l'arbitraire de l'interprète de choisir le symbole et l'allégorie, et ce choix se fait souvent grâce à des ressemblances lointaines, puériles, absurdes ; par conséquent, l'interprétation devient entièrement arbitraire, indéterminée. Par exemple, cela est maintenant manifeste pour tout le monde, dans les interprétations allégoriques qu'on a données autrefois des poésies homériques. Aujourd'hui, il ne se trouve plus personne pour les prendre au sérieux ; et pourtant, si grande est la force des sentiments qui poussent à accepter certaines dérivations que, de nos jours, les modernistes les renouvellent pour l'Évangile, et trouvent des gens qui les admirent.
§ 1621. Le lecteur voudra bien se rappeler que nous parlons toujours exclusivement au point de vue de la science logico-expérimentale, et que, de ce fait, toute excursion quelconque dans le domaine de la foi nous est interdite. Si la foi impose une certaine interprétation, nous n'avons pas à dire si elle a tort ou raison : bien plus, ces termes n'ont même pas de sens en ce cas, ou, si l'on veut, ils en ont un entièrement différent de celui qu'on leur attribue dans le domaine logico-expérimental. Si quelqu'un dit que la foi lui impose de croire que le Cantique des cantiques raconte l'amour du Christ pour son Église, nous n'avons rien à objecter. Cette question échappe entièrement à la présente étude. Mais s'il veut démontrer cette interprétation par des arguments logico-expérimentaux, il pénétrera ainsi dans notredomaine, et nous jugerons ces arguments d'après les règles des sciences logico-expérimentales.
De même, il ne faut pas oublier que nous ne traitons pas ici de l'utilité sociale que peuvent avoir certaines interprétations ou certaines doctrines. Ce sujet sera étudié au chapitre XII. Une interprétation peut être absurde, au point de vue expérimental, ou à celui de la logique formelle, et être – ou ne pas être – utile à la société. C'est une chose à voir dans chaque cas particulier.
§ 1622. L'allégorie est souvent introduite à cause du besoin que l'homme éprouve d'ajouter des ornements à ses récits, même sans aucun but déterminé. C'est le motif pour lequel certains écrivains ne peuvent rien raconter sans y mêler des allégories, spontanément et même sans s'en apercevoir. Mais, plus souvent, l'allégorie est employée pour arriver à une fin, pour concilier des théories entre elles, des théories avec des faits, etc. [FN: § 1622-1]
§ 1623. Un cas singulier est celui de Saint Augustin, qui commença par l'allégorie, pour finir par s'en tenir au sens littéral, tandis qu'habituellement on suit la voie opposée. Il avait besoin de l'allégorie pour combattre les Manichéens, et il s'en servit ; ensuite il en vint au sens qu'il appelle littéral [FN 1623-1]. Pourtant, il ne faut pas se laisser induire en erreur par ce mot, car Saint Augustin admet aussi le sens figuré comme étant littéral, et ainsi il ne lui est pas moins facile qu'avec l'allégorie de tirer ce qu'il veut de l'Écriture sacrée. Lorsque, par exemple, le saint docteur dit [FN: 1623-2] (II, 13, 27) que la lumière peut signifier la créature spirituelle ; quand il dit (IV, 9, 16) que le repos du Seigneur, le septième jour, doit être entendu en ce sens que Dieu a donné le repos en lui avec le don du Saint Esprit à ses créatures raisonnables, parmi lesquelles se trouve l'homme ; quand il dit (IV, 35, 57) que le premier jour que Dieu fit, c'est la créature spirituelle et raisonnable, c'est-à-dire les anges surcélestes et les vertus ; et lorsqu'en de nombreux autres endroits il parle de même, il faut reconnaître que s'il n'use pas d'allégories, il use de métaphores ou de symboles ou d'interprétations analogues qui, au fond, sont aussi éloignées du sens littéral que pourraient l'être les allégories les plus hardies.
§ 1624. Saint Augustin accepte en même temps la réalité historique et l'allégorie, dans les récits de l'Évangile, et c'est là une théorie professée par beaucoup de personnes. Selon Saint Augustin, dans le miracle, il y a le fait historique, et en même temps une leçon pour nous [FN: § 1624-1] . « (3, 3) Nous trouvons trois morts visiblement ressuscités par notre Seigneur ». Pour le saint, c'est un fait historique ; mais il ajoute : « (3, 3) Notre Seigneur Jésus-Christ voulait que ce qu'il faisait corporellement fût aussi entendu spirituellement ». « (4, 4) Voyons donc ce qu'il voulut nous enseigner par les trois morts qu'il a ressuscités ». Tout cela est très clair.
Le fait historique et l'allégorie se trouvent souvent ensemble. Par conséquent, on ne peut savoir si l'auteur a voulu raconter un fait ou nous donner un enseignement allégorique ; car le dilemme n'existe pas, les deux choses pouvant subsister ensemble. En réalité, cela arrive fréquemment; en outre, ou bien l'auteur ne connaît pas les limites entre le récit et l'allégorie, ou bien il les oublie et il est incapable de distinguer ces deux choses l'une de l'autre ; ce qui, a fortiori, rend inutile toute tentative semblable, faite par d'autres personnes, sur le traité de cet auteur. C'est pour cette raison qu'il n'y a rien de solide dans la dispute à laquelle les modernistes, renouvelant d'anciennes tentatives, se livrent pour interpréter l'Évangile de Jean. Parfois, un auteur sépare un récit de la morale allégorique qu'on en peut tirer. Ce récit et cette morale peuvent, dans son esprit, être tous deux étrangers à la réalité ; par exemple lorsque l'auteur fait parler des animaux et en tire une morale ; en ce cas, il n'y a aucune difficulté, au point de vue logique. Il se peut aussi que l'auteur prenne le récit pour un fait réel, et l'interprète cependant en un sens allégorique [FN: § 1624-2] . En ce cas, il n'est pas facile de saisir le lien logique qu'il établit entre le fait et l'allégorie. Mais la difficulté naît principalement de l'habitude de notre esprit, qui veut chercher de la précision là où il n'y en a pas, là où l'auteur du récit et de l'allégorie s'est contenté d'un lien indéterminé.
§ 1625. De l'allégorie voulue et clairement tenue pour non-réelle, comme celle dont usent les poètes, on passe par degrés insensibles à l'allégorie que l'auteur emploie sans le savoir, et qui, dans son esprit, se confond avec la réalité. On observe souvent ce fait, lorsque la parole exprime un sentiment vif, qui donne forme et vie aux épithètes, aux images, aux allégories [FN: § 1625-1]. Les légendes tirent fréquemment leur origine de ces phénomènes. C'est là un des si nombreux cas où, comme nous l'avons vu, les termes sont indéterminés, parce que les limites des sentiments qu'ils expriment sont aussi indéterminées. On ne distingue pas bien le caractère réel du caractère allégorique d'une chose, de la même façon qu'on ne distingue pas bien le caractère objectif du caractère subjectif d'une personnification (§ 1070 et sv.). Par exemple, on ne sait si les anciens Grecs, qui entendaient nommer le songe pernicieux de l'Iliade, donnaient à ce terme un sens exclusivement allégorique, plutôt qu'un sens mêlé d'allégorie et de réalité.
§ 1626. En cette matière, nous avons plus et mieux que de simples probabilités : nous avons des faits qui sont connus en toute certitude. En outre, puisqu'on les observe en un temps comme le nôtre, où dominent la tendance scientifique et la critique historique, nous pouvons, a fortiori, admettre que des faits analogues ont pu avoir lieu en des temps où la science et la critique faisaient défaut. L'un de ces faits, vraiment remarquable, est celui de la Synthèse Subjective d'A. Comte. D'une part, l'auteur nous donne ses conceptions, non comme des réalités, mais comme des fictions utiles ; et d'autre part, il lui arrive de se complaire tellement à ces fictions qu'il les confond avec la réalité [FN: § 1626-1]. C'est là un cas où il nous est donné de connaître la voie AT (§ 636) qui, de certains faits A, mène a une théorie T. Supposons que, dans plusieurs siècles, on ne connaisse plus cette voie, et qu'il ne reste qu'une certaine théorie suivant laquelle la Terre a sagement préparé les conditions favorables à l'existence d'un certain Grand Être. Alors surgiront des interprètes de cette mythologie. Une partie d'entre eux, se proposant seulement, dans ses études, de deviner A, fera très probablement fausse route, et trouvera tout autre chose que A. D'autres nombreuses personnes, partant de cette vénérée théorie T, voudront arriver à certaines fins préétablies C, et inventeront dans ce but de belles et savantes dérivations, obtenues au moyen de subtiles interprétations allégoriques et métaphoriques.
§ 1627. Les interprétations de ce genre, dont on a voulu faire usage pour mettre d'accord les Saintes Écritures avec les faits expérimentaux, sont trop connues pour que nous nous y attardions. Souvent déjà, nous avons rencontré l'exemple vraiment remarquable du Cantique des cantiques (§ 1452). Puisque ce livre a trouvé place, par hasard ou autrement, dans les Saintes Écritures, il est nécessaire qu'il soit littérairement beau et moral ; ce qu'on démontre par les allégories, par les métaphores et par d'autres interprétations semblables [FN: § 1627-1] . Nous en avons à profusion, en tout temps. M. Gautier (loc. cit. § 1627-1) les classe de la façon suivante [FN: § 1627-2] : « (p. 129) 1° Allégorie politique. Ce système n'a jamais eu un grand nombre d'adhérents ; mais il est représenté par une série d'hypothèses individuelles, cherchant la clef du Cantique dans l'histoire d'Israël... 2° Allégorie théocratique. Les interprètes qui se rattachent à ce point de vue ont, comme les précédents, le mérite de ne pas sortir des limites de l'ancienne alliance. D'après eux, le Cantique dépeint (p. 130) l'amour réciproque de Yahvé et d'Israël. Dans le détail, il règne une grande variété d'interprétations... 3° Allégorie messianique ou christologique. …Celui-ci [le Cantique proclame l'union de l'époux et de l'épouse, du Christ, le divin chef, et de son Église... 4°Allégorie mystique. Avec ce mode d'interprétation, on quitte le sol de l'histoire... on est dans la sphère intime des rapports de l'âme avec Dieu... On ne s'étonnera pas de le voir adopté et développé dans les milieux monastiques ; il faut aussi noter qu'il est en faveur dans l'Église grecque ». L'auteur ajoute encore une autre interprétation : « (p. 131) Certains théologiens sentant la difficulté d'attribuer à l'auteur du Cantique une intention religieuse, et répugnant pourtant à renoncer à tout caractère de ce genre pour un livre biblique, ont eu recours à une distinction. C'est le cas de Franz Delitzsch et de Zœckler. Ceux-ci ne prétendent pas que l'auteur du livre ait voulu (p. 132) écrire une allégorie ; il s'est simplement proposé, suivant eux, de chanter l'amour humain. Mais, ajoutent-ils, il n'en est pas moins permis et même commandé de donner à ce poème une signification spirituelle, religieuse ; sa présence dans le recueil biblique prouve que telle est la volonté de Dieu. Dans ce cas... ce n'est plus d'allégorie qu'il s'agit, mais d'interprétation typique ou typologique [FN: § 1627-3] ». Il faut que les hommes aient beaucoup de temps à perdre, pour l'employer à ces vétilles. Nos contemporains s'occupent moins de ces divagations théologiques, mais ils les ont remplacées par des divagations métaphysiques. C'est bonnet blanc, blanc bonnet.
Renan aussi a son interprétation, qui n'est autre chose qu'un cas particulier de son système d'explication des antiquités chrétiennes. Il enlève à celles-ci le surnaturel et le mystique, mais il y laisse, il exalte même le sens éthique. Si ces antiquités ne sont pas divines, elles sont du moins hautement morales. C'est là le motif du succès qui accueillit l'œuvre de Renan. Il y avait d'un côté les croyants, de l'autre les mécréants, athées ou voltairiens, au milieu un très grand nombre de personnes qui ne voulaient aller ni à l'un ni à l'autre de ces extrêmes, et qui, partant, étaient disposées à accepter une œuvre qui fût quelque peu sceptique, sans manquer aux égards dus aux croyances ; qui enlevât le surnaturel, mais laissât le sublime ; qui suivit cette voie du juste milieu dans laquelle tant de gens aiment à demeurer [FN: § 1627-4]. L'humanitarisme n'a pas assez d'énergie pour repousser entièrement les anciennes croyances ; il en repousse uniquement ce qui ne s'accorde pas avec sa foi. De même que les chrétiens qui voyaient des démons dans les dieux des païens, l'humanitarisme voit des travestissements éthiques dans la théologie. À ce point de vue, on pourrait dire que Renan, John Stuart Mill, Auguste Comte, Herbert Spencer et un grand nombre d'autres, sont chrétiens, sans le Christ. Mais à d'autres points de vue, des différences apparaissent. Ils ont des résidus communs et des dérivations différentes. Donc, pour Renan : « (p. 137) Le poème n'est ni mystique, comme le voulaient les théologiens, ni inconvenant, comme le croyait Castalion, ni purement érotique, comme le voulait Herder ; il est moral; il se résume en un verset, le 7e du chap. VIII, le dernier du poème : „ Rien ne peut résister à l'amour sincère ; quand le riche prétend acheter l'amour il n'achète que la honte “. L'objet du poème n'est pas la voluptueuse passion qui se traîne dans les sérails de l'Orient dégénéré, ni le sentiment équivoque du quiétiste hindou ou persan, cachant sous des dehors menteurs (p. 138) son hypocrite mollesse, mais l'amour vrai... ». Si cela suffit pour rendre moral un poème, on peut trouver plusieurs passages analogues dans le livre des épigrammes érotiques de l'Anthologie grecque, et par conséquent les baptiser « moraux ». Par exemple : « (29) Si l'on demande le prix d'un baiser, celui-ci devient plus amer que l'ellébore ». (267) À un jeune homme qui dit aimer une jeune fille, et qui ne l'épouse pas parce qu'elle n'est pas assez riche, on objecte : « Tu n'aimes pas ; tu te trompes ; comment un cœur amoureux peut-il donc si bien compter ? » Piepenbring non plus ne laisse pas le Cantique des cantiques sans défense. Il cite [FN: § 1627-5] (p. 703) Budde, qui estime que, dans cet ouvrage, Salomon et la Sulamite sont des types allégoriques ; le premier est le type de la gloire, la seconde de la beauté. « (p. 704) Il établit en outre, à la suite de Wetzstein, que le Cantique des Cantiques n'est autre chose qu'un recueil de chansons de noce... Il se pourrait que l'éditeur de ce recueil eût voulu protester par sa publication contre la polygamie et faire l'éloge de l'affection mutuelle de deux époux, ce qui conférerait à ces pages une valeur morale sérieuse, malgré le réalisme trop cru qui s'y rencontre ». Voyez quelles bonnes raisons il trouve pour sauver la morale ! Voilà encore un des nombreux cas où l'on voit bien le caractère artificieux des dérivations.
§ 1628. Comme au § 636, traçons un graphique. T est le texte du Cantique des Cantiques ; A est son origine ; C est la conséquence que l'on veut tirer de T. Celui qui use des dérivations veut souvent nous faire croire que C se confond avec A. C doit être nécessairement une chose édifiante, et l'on cherche simplement la voie qui, de T peut mener en C. Il est des gens qui suivent la voie allégorique T p C, et démontrent que le Cantique des Cantiques exprime l'amour de Jésus-Christ et de l'Église. Il est des gens qui suivent la voie T n C, et démontrent que le Cantique des Cantiques chante les types de la gloire et de la beauté. Il est des gens qui suivent la voie T p C, et démontrent que le poème chante la victoire de l'amour sur la richesse. Viennent ensuite des gens qui suivent la voie T q C, et trouvent l'éloge de la monogamie. On peut continuer ainsi indéfiniment ; et l'on peut être certain que, quelle que soit la conclusion morale C à laquelle on veut arriver, la voie qui de T mène à C ne fera jamais défaut.
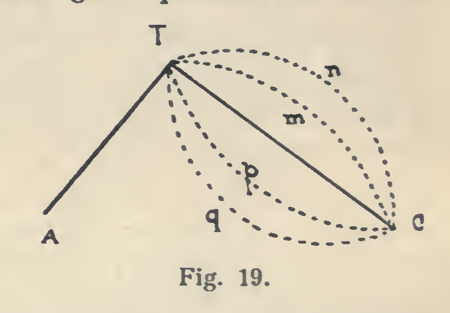
[Figure 19]
§ 1629. Parfois, surtout aux temps passés, la dérivation est vraiment étrange. Voyez, par exemple, le long commentaire de Saint Bernard sur le Cantique des Cantiques. La fantaisie créatrice d'allégories y dépasse toute limite. Voici, au hasard, quelques-unes de ces allégories. Que de choses en ces quelques mots : « Les fils de ma mère combattirent contre moi ». D'abord, l'épouse, – c'est-à-dire l'Église, – rappelle qu'elle a été persécutée. Comment donc ? C'est très clair. « Anna, Caïphe et Juda Iscariot étaient fils de la synagogue, et ils combattirent cruellement à sa naissance l'Église qui était aussi fille de la synagogue, en mettant en croix son fondateur Jésus. Ainsi donc, Dieu accomplit alors par eux ce qu'il avait déjà annoncé par le Prophète, disant : « Je frapperai le pasteur, et je disperserai les brebis »... De ceux-là donc et des autres qu'on sait avoir combattu les chrétiens, l'épouse dit « Les fils de ma mère combattirent contre moi[FN: § 1629-1]». L'Ecclésiaste et l'Ecclésiastique n'ont pas non plus donné peu à faire aux commentateurs. L'Ecclésiastique fut placé par les protestants parmi les livres apocryphes [FN: § 1629-2] , mais l'Ecclésiaste reste parmi les livres du canon biblique. Dans l'Ecclésiaste, il y a certainement des préceptes épicuriens ; mais, grâce à d'ingénieuses interprétations, les commentateurs en font des préceptes moraux et religieux. Saint Jérôme emploie principalement deux modes d'interprétation. D'une part, il suppose, sans la moindre preuve, que l'auteur ne parle pas en son propre nom lorsqu'il recommande de se donner du bon temps [FN: § 1629-3] . D'autre part, il prend dans un sens spirituel ce qui manifestement est dit dans un sens matériel. Par exemple, manger et boire doivent être entendus en un sens spirituel [FN: § 1629-4] , et là où l'auteur parle d'embrasser la femme, il faut entendre embrasser la sagesse [FN: § 1629-5] . À ce taux-là, on peut faire un texte moral et religieux même de l'Art d'aimer d'Ovide.
§ 1630. Les modernistes se sont trouvés en présence des mêmes difficultés que leurs prédécesseurs, en voulant concilier une foi ancienne avec une nouvelle ; et pour surmonter ces difficultés, ils ont usé de méthodes identiques à celles qui avaient été mises en œuvre déjà depuis des siècles et des siècles. Le point de départ des modernistes est l'Écriture Sainte des chrétiens, Écriture qu'ils entendent conserver. Le point auquel ils veulent arriver, c'est un accord avec la foi en la Science et la Démocratie. À l'égard de la Science, ils disent, il est vrai, qu'on ne peut leur adresser le reproche exprimé par les paroles de Grégoire IX, de plier« (p. 120) à la doctrine philosophique les pages célestes de l'Écriture [FN: § 1630-1] » ; mais, au fond, ils font tout ce qu'ils peuvent pour arriver à cet accord et c'est pourquoi ils ont eu recours à « l'expérience intime du chrétien », qui est une parodie des expériences de la chimie, de la physique et des autres sciences naturelles.
À l'égard de la sainte Démocratie, ils manifestent clairement leurs intentions [FN: § 1630-2] et laissent apercevoir l'envie mal cachée d'en obtenir des honneurs et des faveurs. Mais cette Démocratie a déjà la sainte Science dans son panthéon ; comment s'en tirer ? Ne vous mettez pas en peine. Les allégories et les métaphores doivent pourtant bien servir à quelque chose. Voici M. Loisy qui renouvelle, en la disant moderne, l'antique exégèse de Philon le Juif, et qui supprime la réalité historique du Christ dans l’Évangile selon Saint Jean [FN: § 1630-3] . Cependant, M. Loisy reprend d'une main ce qu'il donne de l'autre. L'allégorie, le symbole sont de belles choses, mais la réalité n'est pas non plus à dédaigner [FN: § 1630-4] : « (p. 169) Ainsi la mort de Jésus est un fait historique dont la réalité n'a subi aucune transfiguration ; mais ce n'est pas en tant que mort naturelle qu'elle appartient à la foi ; c'est en tant que mort volontaire et symbole principal de la rédemption ». Enveloppée d'un brouillard si épais, l'idée de l'auteur n'est pas facile à saisir. « (p. 170) Pareillement, si l'on entend par science ce qu'entendent les modernes, et avec eux les savants modernistes, il est évident que la science en elle-même [comment distingue-t-on la science en elle-même de la simple science ?] ne peut être subordonnée à la foi, bien que le travail scientifique, en tant qu'émanant d'un être moral, puisse être entièrement (p. 171) inspiré, on peut même dire gouverné par son influence ». C'est là une énigme. Si le « travail scientifique » est inspiré et gouverné par la foi, comment se peut-il que la science, qui est le fruit de ce travail, ne soit pas subordonnée à la foi ? Si vous « inspirez et gouvernez » un artisan, il semblerait que ce qu'il produit devrait vous être subordonné. Il est vrai que ce sont, comme d'habitude, les épithètes, qui permettent de changer le sens des termes et de les élever de la terre aux nues. Cette science en elle-même doit être pour le moins cousine, sinon sœur, de la Droite Raison. Une autre belle inconnue, c'est le travail scientifique en tant qu'émanant d'un être moral. Il semblerait que les travaux scientifiques entrepris pour trouver un théorème de mathématique, une uniformité chimique, physique, astronomique, biologique, etc., demeurent les mêmes, qu'ils émanent d'un être moral ou d'un être immoral. Comment fait-on de les dédoubler ? Euclide était-il ou n'était-il pas un être moral ? Nous n'en savons vraiment rien, et n'éprouvons nullement le besoin de le savoir, pour juger sa géométrie. Comparée à ces phrases nébuleuses de M. Loisy, l'Encyclique papale, à laquelle il veut répondre, apparaît comme un modèle de clarté [FN: § 1630-5] ; et c'est justement à cause de cette clarté que, selon les modernistes, l'Encyclique se trompe en rapportant leurs opinions, lesquelles veulent exprimer et taire en même temps les choses.
§ 1631. M. L. Bourgeois et ses disciples solidaristes avaient à résoudre un problème analogue. Le point de départ était l'organisation sociale présente ; le point auquel on voulait arriver était une espèce de socialisme bourgeois. Pour effectuer le passage, on recourt à des dérivations de genres différents. Il est, entre autres, une belle métaphore, celle d'une dette qui, sans cesse payée, renaît et subsiste sans cesse [FN: § 1631-1]. Il semble que ce soit une plaisanterie ; au contraire, ce raisonnement puéril est tout à fait sérieux. Nous avons, en ce cas, une dérivation avec une entité juridique (III-δ) qui dégénère et devient une dérivation verbale (IV-δ). La notion d'une dette qui renaît au fur et à mesure qu'on la paie n'a de juridique que l'apparence : elle est simplement verbale.
§ 1632. Voyons un exemple de l'emploi indirect des métaphores. Dans son traité du Baptême [FN: § 1632-1], Tertullien commence par remarquer qu'il y a une femme du nom de Quintilla, qui combat le baptême ; puis il fait un raisonnement du genre de celui que nous avons indiqué (§ 1615). Quintilla A est une vipère B, – il ne le dit pas, mais on le comprend, – parce que Quintilla a en commun avec la vipère le caractère P d'être venimeuse. La vipère aime habiter les lieux arides. Voilà le caractère Q, qu'on trouve chez la vipère, et qui n'apparaît pas directement chez Quintilla. Mais de l'analogie entre elle et la vipère, on conclut que Quintilla doit aussi aimer le sec, fuir l'humide et l'eau C. Ensuite Tertullien refait un raisonnement implicite du même genre pour les chrétiens. Ceux-ci sont faits tels par le baptême ; le baptême est administré avec de l'eau ; donc celui qui est ennemi de l'eau est ennemi des chrétiens. Enfin on conclut que Quintilla est ennemie des chrétiens. Il est douteux que personne ait jamais pu prendre au sérieux ce raisonnement puéril ; mais il peut avoir été bien accueilli à cause des sentiments accessoires provoqués par les termes employés ; c'est-à-dire qu'il a été accepté comme un mélange de dérivations du présent genre (IV-β).
§ 1633. Ce traité de Tertullien est une mine de dérivations. En noter quelques-unes encore ne sera pas une digression inutile.
Quelqu'un s'étonnait qu'un peu d'eau puisse donner l'éternité. Tertullien répond en citant les mystères des Gentils, semblables au baptême chrétien [FN: § 1633-1] . C'est là une dérivation par analogie et par autorité (IIe classe). Ensuite, il examine pourquoi l'eau est estimée digne de régénérer le chrétien. Il répond par des analogies qui mettent en œuvre des résidus (I-β). Ensuite, on a des dérivations par analogie, auxquelles s'ajoutent des dérivations (III-α). Tout d'abord – dit Tertullien – il faut étudier l'origine de l'eau. « Au commencement – est-il dit – Dieu créa le ciel et la terre. La terre était invisible et désordonnée ; les ténèbres étaient sur l'abîme, et l'esprit de Dieu flottait sur les eaux. Tu as donc, homme, à vénérer l'eau, d'abord pour son antiquité, ensuite pour sa dignité, puisque l'esprit divin la préférait comme siège à tous les autres éléments ». Il continue, raconte de l'eau nombre de belles choses, et ne s'arrête que parce qu'il craint, s'il en disait davantage, de faire le panégyrique de l'eau plutôt que du baptême [FN: § 1633-2] . Il conclut qu'il n'y a pas à douter que l'eau, dont Dieu s'est servi en tant de choses, ne serve aussi à ses sacrements, et que, « elle qui gouverne la vie terrestre ne procure aussi la vie céleste » [FN: § 1633-3] .
§ 1634. Tertullien recourt ensuite à une dérivation (III-α) du consentement universel (IV). Il rapporte l'opinion qu'il existe des esprits immondes sur les eaux. Puis il la confirme en observant qu'on appelle Nympholeptes, Limphatices, Hydrophobes, ceux que les eaux tuèrent, rendirent fous, frappèrent de terreur. C'est là une dérivation (IV-δ), grâce à laquelle, de l'existence d'un terme métaphorique, on conclut qu'il existe une chose correspondante. Ayant ainsi posé qu'il existe des esprits immondes sur les eaux, et qu'ils agissent au détriment de l'homme, Tertullien conclut par une dérivation du présent genre (IV-δ). (IV) « Il ne sera pas malaisé de croire que le saint ange de Dieu gouverne l'eau pour le salut des hommes, puisque l'ange du mal, par un usage profane, emploie ces mêmes éléments au détriment de l'homme ». La dérivation est renforcée par une autre (IV-β), qui met en œuvre des résidus (I-β)
§ 1635. Ce type de dérivations composées, qui apparaît ici avec une clarté naïve, se retrouve, d'une façon plus ou moins dissimulée, dans un très grand nombre de raisonnements ; c'est-à-dire qu'on a une dérivation par métaphore ou analogie (IV-δ), à laquelle s'ajoutent des dérivations de sentiments accessoires (IV-β), et qui mettent en œuvre divers résidus et principalement des résidus de la Ire classe.
§ 1636. Des allégories et des métaphores peuvent être opposées à d'autres allégories et à d'autres métaphores. Des raisonnements non-scientifiques sont souvent victorieusement opposés à d'autres raisonnements non-scientifiques. Ce qui, au point de vue logico-expérimental, est une pure logomachie, peut, au point de vue de la propagande d'une doctrine, avoir une grande efficacité, par le moyen des sentiments ainsi provoqués.
§ 1637. Les adversaires de la peine de mort ont un argument usuel tiré d'une métaphore. Ils disent que la peine de mort est « un assassinat légal », et que la « Société » oppose ainsi un assassinat à un autre assassinat.
§ 1638. On va même plus loin dans cette voie. Anatole France [FN: § 1638-1] dit que « les juges n'ont rien trouvé de mieux, pour châtier les larrons et les homicides, que de les imiter », et qu'en somme la justice ne tend qu'à doubler leurs délits et leurs crimes. Assurément, au point de vue logico-expérimental, ce verbiage vaut ceux dont on use pour démontrer que la « Société » a le droit d'infliger l'amende et la peine de mort. Mais, outre ces questions de métaphores, il en est d'autres qui portent sur les choses. Pour nous exprimer comme A. France, donnons le même nom à ce qu'on a appelé, jusqu'à présent, vol et amende, ou bien assassinat et exécution judiciaire. Pourtant, si nous voulons nous entendre, il faudra bien faire comprendre de quelle chose nous voulons précisément parler. Mettons donc un astérisque au terme vol*, pour désigner l'amende, et un astérisque aussi au terme assassinat*, pour désigner l'exécution judiciaire de la peine de mort. En cette matière, il y a d'autres problèmes que ceux des noms à donner aux choses. Si l'on disait à un homme : « Vous êtes homicide, aussi bien si vous tuez votre fils, que si vous tuez le brigand qui veut tuer votre fils, donc, il doit vous être indifférent de faire l'une ou l'autre chose », il est probable qu'il répondrait : « À moi, le nom ne m'importe nullement ; je tue le brigand et je sauve mon fils ». À la société humaine aussi, les noms importent peu. Parmi les problèmes de choses qu'on aurait à envisager, deux surtout sont à noter. 1° Comment se fait-il que le plus grand nombre des nations civilisées ont opposé en fait le vol * au vol, l'assassinat * à l'assassinat ? 2° Ces mesures sont-elles utiles ou indifférentes ou nuisibles à la prospérité de la société ? Ces problèmes ne peuvent évidemment être résolus qu'au moyen de considérations sur les choses, et non au moyen de considérations sur les noms des choses ; il faut étudier les faits, et non les métaphores des littérateurs. La dérivation employée par A. France est copiée de la dérivation générale, très en usage chez les humanitaires, au moyen de laquelle on donne aux délinquants le nom de « malheureux » [FN: § 1638-2] ; puis, profitant du sens équivoque de ce terme, on conclut que les délinquants méritent les plus tendres attentions de la « société ». Telle est l'origine d'œuvres comme les Misérables de Victor Hugo, au moyen desquelles les littérateurs gagnent de l'argent en flattant les instincts humanitaires. Le chien enragé aussi est un « malheureux », et la « société » n'a rien trouvé d'autre à opposer à la mort qu'il donne aux gens, que la mort qu'on lui inflige. Il se pourrait que ce fût encore là un bon moyen pour se débarrasser de certains délinquants beaucoup plus dangereux que les chiens enragés. Quiconque désire connaître les beaux exploits de ces gens en trouvera facilement tant qu'il voudra dans les chroniques des journaux.
La fièvre humanitaire a maintenant acquis un tel degré d'acuité que ceux qui en souffrent ne se contentent plus des faits du présent, mais recherchent avidement ceux du passé, même d'un passé reculé, pour donner libre cours à leur passion aveugle ; et comme les hommes industrieux savent produire ce que le consommateur demande, nous voyons de stupéfiantes manifestations avoir lieu en faveur des délinquants du passé [FN: § 1638-3] . On ne sait pas si c'est pour faire une satire discrète de cette fièvre, ou par amour du paradoxe, ou pour ces deux raisons, que l'éminent avocat Henri Robert revient sur le cas quelque peu lointain de Lady Macbeth, et fait une défense éloquente de cette remarquable personne, à tel point que la tourbe humanitaire veut l'absoudre et la réhabiliter. Mais il y a mieux : plusieurs excellentes personnes constituent un comité pour réviser le procès de la trop célèbre madame Lafarge, fait sous le règne de Louis-Philippe. Peut-être lirons-nous un jour en quatrième page des journaux : « Bonne récompense à qui indiquera un procès qui puisse servir de dada aux humanitaires ».
§ 1639. Nous avons vu comment, en partant d'un fait réel, une description, un récit, successivement altérés, modifiés, transformés, aboutissent à une légende. Quand on parcourt cette voie, on ajoute souvent des allégories, des métaphores, des symboles. Ainsi croit et se développe la légende, en s'écartant toujours plus du fait réel qui lui a donné naissance (voir: FN: § § 1639 note 1).
§ 1640. Telle est la voie par laquelle on passe de la chose aux mots ; mais les légendes se forment aussi par une autre voie, dans laquelle on passe des mots à la chose ; c'est-à-dire que la légende n'a pas le moindre fondement réel, qu'elle est créée de toutes pièces, en partant de certains mots. Il arrive aussi, en réalité, qu'on suive les deux voies ensemble. Par exemple, une chose réelle donne naissance à un récit, qui s'altère et se modifie, et auquel on ajoute des métaphores, des allégories ; puis celles-ci sont supposées figurer des choses réelles ; c'est-à-dire que des mots on va à la chose, qui est imaginaire, mais que l'on suppose réelle, et de laquelle on part ensuite pour obtenir de nouveaux récits, de nouvelles métaphores, et ainsi de suite.
§ 1641. Le besoin qu'éprouvent les hommes d'exercer leurs facultés de raisonnement et de logique (résidus I-ε) est tel que lorsqu'ils portent leur attention sur un terme quelconque T, ils veulent l'expliquer, c'est-à-dire qu'ils veulent en tirer une dérivation plus ou moins logique. Ainsi, de T, un auteur arrive à certaines choses, A, qui sont imaginaires ; un autre arrive à d'autres choses, B, imaginaires aussi ; d'autres encore emploient d'autres dérivations. Les choses A, B, tirées de T, ont parfois une certaine ressemblance, qui peut même être grande. Quand nous ne connaissons que A et B, nous ne savons si B n'est pas constitué au moyen de A, en copiant en partie A (ou vice versa), ou bien si A et B sont indépendants et ont une commune origine T1. Il y a des exemples des deux phénomènes ; par conséquent le choix a priori est impossible. Il faut recourir à l'observation des faits, et voir si une des voies TA, TB ou AB existe ; quelquefois, ces voies peuvent même exister ensemble. On a des phénomènes de ce genre, lorsqu'on cherche les sources d'un auteur. Aujourd'hui, on tâche un peu trop de deviner, et beaucoup de recherches de ce genre ont des fondements plus que mal assurés [FN: § 1641-2].
§ 1642. Si A est chronologiquement antérieur à B, beaucoup d'auteurs admettent sans autre que B est une imitation de A. Nous avons vu des cas (§ 733 et sv.) où il apparaît clairement que cette déduction peut être entièrement erronée. Par conséquent, du seul fait que A est antérieur et semblable à B, on ne peut rien déduire au sujet de la dépendance dans laquelle B serait par rapport à A ; il faut d'autres faits, d'autres observations.
§ 1643. C'est un fait bien connu que le quatrième Évangile est d'un style très différent de celui des trois premiers ; il y a beaucoup plus de métaphysique, de symbolisme que dans les trois premiers. Il se peut que son auteur rapporte d'une façon différente les faits dont il a eu connaissance, comme l'ont eue les trois premiers évangélistes (qu'il parcoure la voie, du fait à la théorie); il se peut, au contraire que, tenant un récit d'autres personnes, il tire de ce récit sa propre exposition métaphysique (qu'il parcoure la voie, de la théorie au fait), et il n'est pas exclu que ces deux voies puissent avoir été parcourues ensemble. Nous ne voulons nullement nous occuper ici de ces problèmes, ni ajouter un chapitre à tant d'autres qui ont été écrits déjà sur ce sujet. Nous entendons nous placer exclusivement au point de vue tout à fait restreint d'un exemple de dérivation.
§ 1644. Déjà dans Saint Paul, il est fait mention d'une certaine science mensongère, qui pourrait être semblable à ce qui fut ensuite connu sous le nom de Gnose, semblable aux fioritures du quatrième Évangile. Nous n'examinons pas s'il y a eu rapport direct entre ces choses [FN: § 1644-1] , ou si indépendamment elles sont nées du besoin de raisonner, de donner un développement métaphysique à l'histoire, à la légende, ou bien si elles se sont produites autrement [FN: § 1644-2] . Nous les notons seulement comme de simples faits, et nous voyons que parmi elles il existe une certaine gradation, telle qu'on observe le développement métaphysique maximum dans la Gnose.
§ 1645. Les termes de Gnose, Gnosticisme, ne sont pas bien déterminés. Laissons de côté Clément d'Alexandrie, pour lequel le vrai gnostique est le catholique, et considérons uniquement les sectes hérétiques. Il y en a plusieurs, et même le manichéisme est mis en rapport avec la Gnose [FN: § 1645-1]. Bornons-nous à la Gnose valentinienne, comme type de l'espèce. On y trouve des traces marquées d'un parcours, du terme à la chose. Les mots deviennent des personnes, et ces personnes conservent le sexe correspondant au genre grammatical du mot. Ces entités une fois créées avec des sexes différents, on les accouple, et elles donnent naissance à de nouvelles entités ne se distinguant pas des mots qui leur servent de nom. Puis la légende croît et se développe. Les entités ont tous les caractères des mots, vivent et agissent selon ces caractères. Les nombres jouent un rôle dans la légende. Que les valentiniens aient hérité la conception suivante des pythagoriciens, ou qu'ils la tiennent d'ailleurs, ils ont l'idée que quelque chose de réel correspond à une certaine perfection imaginée par eux, des nombres ; et ils assignent à cette perfection un rôle dans la légende. Certaines entités appelées æons, aeons, ou éons [FN: § 1645-2], jouent un rôle éminent dans les doctrines des gnostiques. Il est impossible de savoir ce que ceux-ci pouvaient bien entendre sous ce nom, et cela ne doit pas étonner, car il est probable qu'eux-mêmes n'en savaient rien.
§ 1646. Saint Irénée nous fait connaître la doctrine des valentiniens. Il écrit en grec. De ce texte, il ne reste que des fragments, mais il en existe une vieille traduction latine. Nous traduisons ici du texte grec ; et comme en grec le genre de certains mots est autre qu'en français, nous plaçons à côté du mot français un m ou un f suivant que le mot grec est masculin ou féminin [FN: § 1646-1]. « Ils disent qu'à une hauteur invisible et innommable, il y a un parfait Æon préexistant. Celui-ci (lacune), ils l'appellent aussi premier père et abîme (m). (lacune). Étant infini, invisible, éternel, incréé, il demeura en repos et en parfaite tranquillité, durant un temps infini, éternel. Avec lui était l'Intelligence (f), qu'ils appellent aussi Grâce (f) et Silence (f) ; il lui vint à l'idée de manifester [émanation] cet Abîme, principe de toute chose. Il déposa comme un sperme cette émanation qu'il eut l'intention d'émettre comme dans la matrice de sa compagne Silence (f). Celle-ci reçut ce sperme et, devenue grosse, donna le jour à l'Esprit (ou la Raison) (m), semblable et égale à celui qui l'avait émise, et comprenant seule la grandeur de son père. Cet Esprit (m), ils l'appellent aussi Unigenitus, père et principe de toute chose. Avec lui fut émise la Vérité. C'est là la tétrade (le nombre quaternaire) primitive et originaire pythagoricienne, qu'ils disent être aussi racine de toute chose. C'est donc : Abîme (m) et Silence (f), ensuite Esprit (m) et Vérité (f) ». Après cette première tétrade en vient une autre, constituée par le Verbe (m) avec la Vie (f), et par l'Homme (m) avec l'Église (f). Avec la première tétrade, on a ainsi une ogdoade ![]() , qui est, paraît-il, une fort belle chose. Le Verbe et la Vie produisent dix autres Æons, dont il nous semble inutile de citer ici les noms. L'Homme, en faisant l'amour avec madame l'Église
, qui est, paraît-il, une fort belle chose. Le Verbe et la Vie produisent dix autres Æons, dont il nous semble inutile de citer ici les noms. L'Homme, en faisant l'amour avec madame l'Église ![]() , en produit douze. En tout, les Æons sont donc trente, et forment le Plérôme [FN: § 1646-2].Vient ensuite toute une histoire de la passion de Sophia (f) (sagesse). Un récit qui doit être des valentiniens, qui croyaient que l'Abîme avait engendré sans conjoint, nous apprend comment Sophia [FN: § 1646-3] « voulut imiter son père, et engendrer d'elle-même sans conjoint, afin d'accomplir une œuvre nullement inférieure à celle du Père. Elle ignorait que seul celui qui est incréé, principe de tout, racine, hauteur et abîme, peut engendrer sans conjoint » [FN: § 1646-4].
, en produit douze. En tout, les Æons sont donc trente, et forment le Plérôme [FN: § 1646-2].Vient ensuite toute une histoire de la passion de Sophia (f) (sagesse). Un récit qui doit être des valentiniens, qui croyaient que l'Abîme avait engendré sans conjoint, nous apprend comment Sophia [FN: § 1646-3] « voulut imiter son père, et engendrer d'elle-même sans conjoint, afin d'accomplir une œuvre nullement inférieure à celle du Père. Elle ignorait que seul celui qui est incréé, principe de tout, racine, hauteur et abîme, peut engendrer sans conjoint » [FN: § 1646-4].
Héra aussi voulut imiter Zeus, qui seul avait engendré Athéna ; et, sans avoir commerce avec personne, elle engendra Héphaistos (Vulcain), lequel, quoique boiteux, est un dieu puissant. La pauvre Sophia n'en put faire autant. « Donc la Sophia ne produisit que ce qu'elle pouvait produire : une substance amorphe et confuse. C'est ce que dit Moïse : La terre était invisible et confuse » [FN: § 1646-5] . L'histoire continue longuement ; mais ce que nous en avons dit jusqu'ici suffit à en faire connaître la nature.
§ 1647. L'auteur des Philosophumena s'attache principalement aux allégories métaphysiques des valentiniens, et dit (VI, 2, 29) que Valentin tira sa doctrine, non de l'Évangile, mais de Pythagore et de Platon [FN: § 1647-1] . Saint Épiphane s'attache, au contraire, aux personnifications des valentiniens, et dit (I, 3) qu'elles reproduisent les générations des dieux des Gentils, tels que nous les voyons dans Hésiode, Stésichore et d'autres poètes [FN: § 1647-2] . Ces deux aspects sous lesquels on considère la doctrine valentinienne ont certainement une part de vérité. Cependant, il ne faut pas oublier que tous les rêveurs métaphysiciens possèdent une source commune à laquelle ils s'abreuvent, ainsi d'ailleurs que tous les inventeurs de légendes. C'est pourquoi il est difficile de savoir jusqu'à quel point ils se copient, et jusqu'à quel point les idées qu'ils expriment naissent spontanément en eux (§ 733 et sv.).
§ 1648. Il y a certainement beaucoup de cas où l'on a des preuves directes de plagiat, d'interpolations, de falsifications; d'autres dans lesquels, à défaut de preuves directes, on a de grandes probabilités d'imitations ; mais quand les preuves directes manquent entièrement, il n'est pas permis de conclure de la seule ressemblance à l'imitation.
Par exemple, il est souvent malaisé de distinguer les imitations mutuelles du néo-orphisme et du christianisme, les parties nées spontanément de celles qui sont seulement imitées [FN: § 1648-1] . Les auteurs israélites et chrétiens qui croyaient que Platon avait imité les Saintes Écritures hébraïques [FN: § 1648-2], se trompaient ; mais leur assertion pourrait se changer en une autre, concordant avec les faits, si l'on disait que les Israélites, les chrétiens, les auteurs comme Platon, les orphiques, etc., ont tiré leurs doctrines d'un fonds commun de résidus et de dérivations ; ce qui suffit à expliquer les ressemblances de doctrines indépendantes. Quand celles-ci entrent ensuite en contact avec les parties semblables nées spontanément, il s'y ajoute des imitations, en partie voulues, en partie involontaires.
§ 1649. Les valentiniens oscillent entre la combinaison abstraite d'éléments et l'union sexuelle. Ils imitent en cela beaucoup d'autres doctrines qui cherchent à se servir du puissant résidu sexuel, tout en lui ôtant tout caractère de volupté matérielle. Dans un fragment de Valentin, qui nous a été conservé par Saint Épiphane, les deux sexes s'unissent dans l'Æon, qui est appelé mâle-femelle ![]()
![]() ; mais ensuite on parle de l'union des Æons dans les mêmes termes que pour l'homme et la femme, en ajoutant que la copulation est « sans corruption » [FN: § 1649-1] . Le néo-orphisme aussi oscille entre l'allégorie et la personnification, et, comme en beaucoup d'autres doctrines, on a tantôt des êtres personnifiés, tantôt de simples abstractions métaphysiques [FN: § 1649-2] .
; mais ensuite on parle de l'union des Æons dans les mêmes termes que pour l'homme et la femme, en ajoutant que la copulation est « sans corruption » [FN: § 1649-1] . Le néo-orphisme aussi oscille entre l'allégorie et la personnification, et, comme en beaucoup d'autres doctrines, on a tantôt des êtres personnifiés, tantôt de simples abstractions métaphysiques [FN: § 1649-2] .
§ 1650. Un autre exemple remarquable se trouve dans ce Justin dont les Philosophamena nous font faire la connaissance [FN: § 1650-1]. Il découvre trois principes, non engendrés, de toutes les choses, et divague sur la façon dont ils produisirent le créé. Dans cette doctrine comme dans celle des valentiniens, les allégories tiennent compte de la Bible. Mais précédemment, sans cette aide, Hésiode avait imaginé comment toutes les choses avaient été engendrées [FN: § 1650-2]. De semblables cosmogonies, il y en a tant qu'on veut, en tous temps et chez tous les peuples. Même un auteur du XIXe siècle, Fourier, a voulu avoir la sienne [FN: § 1650-3] ; et qui voudrait en composer d'autres réaliserait facilement son intention par des allégories.
§ 1651. D'autres allégories verbales apparaissent dans la controverse entre les réalistes et les nominalistes. On sait que les réalistes transformaient en réalités les abstractions et les allégories, et se laissaient entraîner par ce grand courant qui traverse les siècles, des temps reculés jusqu'à nos jours [FN: § 1651-1]. Au point de vue logico-expérimental, cette controverse peut durer et dure en effet indéfiniment (§ 2368 et sv.), car il manque un juge pour trancher. À la vérité, tant le réaliste que le nominaliste décrivent uniquement leurs propres sentiments ; par conséquent, ils ont « raison » tous les deux, et la contradiction de leurs théories est une contradiction de sentiments. Chacun selon ses propres goûts préférera l'une ou l'autre théorie, ou bien une théorie intermédiaire, mais lorsqu'il en aura choisi une, tout moyen lui fera défaut pour enfermer autrui dans ce dilemme : ou de l'accepter, ou de refuser créance à des faits logico-expérimentaux.
Si nous ne nous laissons pas arrêter par le caractère incertain et nébuleux de ces théories, caractère qui les exclut nécessairement du domaine logico-expérimental, nous pourrons dire que les nominalistes semblent se rapprocher beaucoup plus de la science expérimentale. Mais la proposition qui affirme l'existence des individus ne peut appartenir à la science expérimentale ; elle sort entièrement du domaine expérimental ; le terme existence, employé de cette façon, appartenant proprement à la métaphysique. Expérimentalement, dire qu'une chose existe signifie seulement qu'elle fait partie du monde expérimental.
§ 1652. Mais, en cette matière (§ 2373), il est un autre problème qui appartient entièrement à la science expérimentale, et qui consiste à rechercher quelle est la voie, parmi les deux suivantes, qu'il convient de suivre pour découvrir les uniformités des faits. 1° Étudier directement les individus, en les classant selon des normes variables, d'après les résultats que l'on cherche ; considérer comme un moyen de raisonnement l'ensemble des caractères communs que présente une classe, et quand une théorie est obtenue, vérifier si elle reproduit les faits particuliers qu'elle doit expliquer. 2° Étudier un ensemble mal défini, mal déterminé, de caractères, en demeurant satisfait si le nom qu'on donne à cet ensemble concorde avec nos sentiments, et déduire de cette étude les rapports des individus que l'on croit, que l'on suppose faire partie de cet ensemble ; et l'on tient pour une démonstration les déductions logiques tirées de cette étude, sans se soucier autrement de vérifications expérimentales. L'expérience du développement des sciences a prononcé. Toutes les uniformités que nous connaissons, nous les avons découvertes, ou pour mieux dire démontrées, en suivant la première voie ; tandis que la seconde a toujours conduit à des théories qui ne concordent pas avec les faits. Par conséquent, l'expérience du passé nous enseigne quelle est la voie que nous devons suivre, si nous voulons avoir des théories qui concordent avec les faits.
Les doctrines nominalistes ajoutent une partie métaphysique, souvent petite, à une partie expérimentale, souvent grande ; tandis qu'il arrive généralement le contraire pour les doctrines réalistes [FN: § 1652-1]. Il est manifeste qu'elles portent sur un monde bien différent de celui de la réalité expérimentale [FN: § 1652-2] .
§ 1653. Les allégories sont un produit de la fantaisie humaine ; c'est pourquoi elles se ressemblent lorsqu'elles appartiennent à des hommes d'une même race ou de races voisines, et quelquefois aussi de n'importe quelle race.
Par exemple, les récits de la création se ressemblent chez les différents peuples, parce que ceux-ci conçoivent la création de la même façon que la production des êtres qu'ils ont sous les yeux. Aussi imaginent-ils spontanément, et non en se copiant mutuellement, des êtres mâles et femelles, des principes masculins et féminins qui, en s'unissant, produisent toute chose. Ils font souvent et volontiers naître le monde ou les choses d'un œuf ; ils font guerroyer ces êtres ou ces principes, les font aimer, haïr, jouir, souffrir. Il se peut que, parfois, un de ces récits ait été copié sur un autre, au moins partiellement ; mais ils peuvent aussi être semblables sans qu'il y ait imitation. [FN: § 1653-1]
§ 1654. Les croyants diront que la ressemblance de ces récits a pour but de reproduire un fait unique, dont le souvenir a été transmis diversement. Cela peut être ; mais cette question dépasse le monde expérimental. Le moyen de la trancher nous fait donc défaut.
§ 1655. Les allégories et les métaphores ont habituellement part à la formation des légendes ; mais on ne peut conclure de ce fait qu'une légende donnée soit nécessairement une simple allégorie, et surtout pas qu'elle soit l'allégorie qui paraît vraisemblable à notre imagination. Outre les allégories et les métaphores, il y a dans les légendes un élément historique ou pseudo-historique, romanesque ; et de plus parfois les imitations, les réminiscences ne font pas défaut. Ainsi, il semble très probable que la métaphore, l'allégorie, ont joué un rôle important dans la formation de la Gnose valentinienne ; mais il nous est impossible de savoir précisément quel est ce rôle. Nous connaissons cette théorie presque exclusivement par les écrits de ses adversaires. Mais, quand bien même nous aurions les textes originaux, nous ne saurions comment déterminer avec précision la part de la métaphore et celle de l'allégorie. Il est d'ailleurs probable que les auteurs mêmes de cette théorie ne connaissaient pas cette part, du moins si nous en jugeons par les faits qui nous sont connus.
§ 1656. Il est nécessaire d'aller du connu à l'inconnu. Nous avons précisément plusieurs exemples de formation de semblables légendes. Par exemple, Fourier en a créé une. C'est un mélange de récits et de métaphores ; et l'on ne pas voit très clairement si l'auteur lui-même savait quelles étaient les limites précises des éléments qu'il mettait en œuvre [FN: § 1656-1]. Le rôle que jouent les Æons, chez les valentiniens, les planètes le jouent chez Fourier ; et comme les Æons, elles s'accouplent et engendrent les choses de l'univers.
§ 1657. Si nous ne savions pas comment s'est constituée la théorie de Fourier, et si, cette théorie nous étant donnée, nous voulions en deviner les origines, il est évident que nous nous tromperions en supposant : 1° que Fourier a voulu simplement écrire une histoire ; ou bien : 2° qu'il a voulu se servir de simples métaphores. En réalité, il est demeuré entre ces deux extrêmes. Pour lui, les faits existent, mais les mots par lesquels il les exprime sont la preuve de leur existence, à cause des sentiments que font naître les métaphores produites par ces mêmes mots (IV-β).
§ 1658. C'est pourquoi, s'il nous arrive de trouver par hasard une théorie analogue, nous pourrons, faute de preuves contraires directes, admettre du moins comme possible que cette théorie a été constituée d'une façon semblable à celle de Fourier.
§ 1659. Voici un autre exemple. Enfantin, Père Suprême de la religion saint-simonienne, découvre une nouvelle trinité, et, avec l'enthousiasme d'un néophyte, il en célèbre les beautés sublimes [FN: § 1659-1]. Il n'y a pas le moindre motif pour mettre en doute la bonne foi de l'auteur. Naïvement, celui-ci nous fait assister à la naissance d'une théologie. Saint-Simon et ses disciples avaient en l'esprit la notion de la trinité catholique, peut-être aussi celle de la perfection du nombre trois, cher aux dieux païens. Sans qu'ils s'en aperçussent, cette notion les conduisit à créer de nombreuses trinités. Ensuite, un beau jour, ils les découvrent, s'étonnent, les trouvent en accord avec leurs sentiments, sont frappés d'admiration à la vue de tant de belles et profondes élucubrations. Il est de même probable que les gnostiques valentiniens avaient en l'esprit des conceptions mythologiques semblables à celles que nous lisons dans Hésiode, et en outre les concepts métaphysiques de Platon, de Pythagore et d'autres philosophes. Avec ces matériaux, sans s'en apercevoir, ils édifièrent leur théogonie. Aujourd'hui nous les découvrons, nous les analysons, nous les distinguons, et nous gratifions les auteurs gnostiques de desseins et de conceptions qu'ils n'ont peut-être jamais eus.
§ 1660. Comme dernier exemple, rappelons le récit, fait par Éginhard, de la bière changée en vin [FN: § 1660-1]. L'auteur croit évidemment raconter un fait. Non seulement il n'y mêle en aucune façon des métaphores, mais il cherche en vain ce que ce prodige peut bien signifier, quelle allégorie il en peut tirer. Supposons que nous ne connaissions pas le naïf récit d'Eginhard, et que nous n'ayons connaissance que du fait brut. De celui-ci, nous voulons remonter à la matière qui est ainsi racontée, et nous raisonnons comme M. Loisy à propos des miracles du quatrième Évangile. Nous dirons que le miracle rapporté par Eginhard est « inintelligible, absurde ou ridicule comme matière de fait, à moins qu'on y voie des tours audacieux de prestidigitateur ». (§ 774). Nous ne manquerons pas de moyens pour trouver « une interprétation facile et simple » de ce miracle ; et nous aurons le choix entre une infinité de métaphores également vraisemblables. Mais, en ce cas, l'erreur sera évidente, puisque Eginhard, bien loin de vouloir exprimer une métaphore, la cherche et avoue ne pouvoir la trouver. Il pourrait donc en arriver de même pour les interprétations allégoriques du quatrième Évangile. Pourquoi donc si, dans cet Évangile, l'eau changée en vin exprime non un fait mais l'allégorie de la « Loi remplacée par l'Évangile » (§ 774), le récit d'Eginhard n'exprimerait-il pas, non ce qui dans l'esprit du narrateur était un fait, mais une allégorie supposée ? Les personnes qui racontèrent le fait à Eginhard avaient en l'esprit le miracle raconté dans l'Évangile, et, naturellement, sans la moindre intention de tromper, elles rapportèrent ce qu'elles croyaient de bonne foi être un fait. Pourquoi, agissant d'une manière semblable, des causes analogues ne nous auraient-elles pas donné les récits des miracles du quatrième Évangile ?
§ 1661. Cette manie de vouloir traduire en allégories tous les récits que nous estimons être étrangers au monde réel, n'a aucun fondement expérimental. Au contraire, nous avons une foule d'exemples qui rendent manifeste que beaucoup d'auteurs qui racontent des miracles croient de bonne foi raconter des faits réels. Les métaphores qui peuvent se trouver dans le récit s'y introduisent à l'insu de l'auteur même, et non pas suivant ses intentions arrêtées. En d'autres cas, si même elles s'y introduisent suivant ses intentions arrêtées, elles s'ajoutent au fait sans en altérer le moins du monde la réalité effective ou supposée.
§ 1662. Nous avons déjà vu (§ 1623, 1624) comment Saint Augustin admet en même temps l'interprétation littérale et l'interprétation allégorique. On pourrait citer, à ce propos, un très grand nombre d'autres exemples. Il suffira de donner encore celui de Saint Cyprien. Il s'exprime clairement au sujet du miracle du changement de l'eau en vin. Pour lui, c'est un fait réel, mais il a eu lieu pour enseigner et démontrer (docens et ostendens) certaines choses [FN: § 1662-1] . Entièrement arbitraire est donc la voie que l'on voudrait suivre maintenant, en intervertissant ce rapport, et en supposant que les auteurs n'ont pas cru à la réalité des faits qui peuvent avoir aussi une interprétation allégorique.
§ 1663. Quand nous avons un exemple aussi évident sous les yeux, comment faisons-nous d'affirmer, sans la moindre preuve, que l'auteur du quatrième Évangile suivit une voie entièrement différente de celle que parcourut Saint Cyprien, et sépara ce que celui-ci réunit ? Tant que nous n'aurons pas de preuves à ce propos, et que nous voudrons nous laisser guider par de simples probabilités, celles-ci seront au contraire en faveur d'une ressemblance entre la voie parcourue par l'auteur du quatrième Évangile, et celle suivie par Saint Cyprien.
§ 1664. Un autre exemple du même auteur – qui nous en fournirait autant que nous voudrions – confirme ce mélange indéterminé entre la réalité effective ou supposée, et la métaphore. Saint Cyprien dit [FN: § 1664-1] : « C'est pourquoi le Saint Esprit vint sous la forme d'une colombe. La colombe est un animal simple et joyeux, sans fiel amer, sans morsures cruelles, etc. » Ou bien les mots n'ont plus aucun sens, et les textes ne signifient plus rien, ou bien il faut de toute nécessité reconnaître que Saint Cyprien croit que réellement le Saint Esprit a pris la forme d'une colombe ; et ce qu'il ajoute c'est pour donner les causes de cette transformation, et en aucune façon pour la mettre en doute.
§ 1665. Les dérivations par métaphores sont souvent à l'usage des personnes cultivées, mais souvent aussi elles servent aux personnes de culture moyenne, pour mettre la foi d'accord avec la science logico-expérimentale. Tout ce qui, dans un récit ou une théorie, ne semble pas pouvoir être accepté au point de vue expérimental, est mis sans autre au compte de la métaphore. La différence entre la foi et ce demi-scepticisme consiste en ce que la foi croit à la réalité du récit et y ajoute la métaphore : le fait réel est un signe qui nous enseigne quelque chose ; tandis que le demi-scepticisme ne croit pas à la réalité du récit ; il n'ajoute pas la métaphore à la réalité : au contraire, il la substitue au fait ; elle seule est réelle ; le fait est imaginaire. Quant à la science expérimentale, elle n'a pas à accepter ou à rejeter les conclusions de la foi, ni du demi-scepticisme : ce sont des choses qui sortent de son domaine ; elle se borne à repousser des conclusions dictées exclusivement par le sentiment, sans aucun fondement expérimental.
§ 1666. Au chapitre V (§ 637 et sv.), nous avons mentionné les deux problèmes qui se posent à l'égard des théories. Dans le chapitre précédent, nous avons étudié le premier, et, dans celui-ci, le second. Il nous reste maintenant à les envisager ensemble, en résumant les considérations que l'on peut faire partiellement sur eux. Prenons comme types des cas concrets : 1° un récit purement mythologique, par exemple le récit des amours d'Aphrodite et d'Arès, au VIIIe chant de l'Odyssée ; 2° une fable entièrement allégorique, où l'on fait parler les animaux ; par exemple, la fable du loup et de l'agneau ; 3° la Gnose valentinienne (§ 1645 et sv.) ; 4° la théorie des créations de Fourier (§ 1650-3, 1656-1) ; 5° la théorie d'Auguste Comte sur la Terre et le Grand Être (§ 1626-1) ; 6° la théorie des réalistes (§ 1651) ; 7° la théorie de la solidarité.
§ 1667. Au point de vue du premier problème du chapitre V, c'est-à-dire au point de vue des rapports avec les faits réels, tous ces types sont égaux, et leur valeur logico-expérimentale est proprement zéro : ils ne correspondent en aucune façon aux faits expérimentaux. Au point de vue du deuxième problème du chapitre V, c'est-à-dire en considérant la voie suivie dans les déductions, et son efficacité persuasive, on peut distinguer : a) la composition de la dérivation ; b) la façon dont elle est accueillie.
§ 1668. (a) La composition de la dérivation. Les sept types notés ont un caractère commun : l'usage arbitraire de certaines entités, étrangères au domaine expérimental. Tertullien, qui voit la paille qui est dans l'œil de son prochain, refuse toute créance aux valentiniens, et leur demande de démontrer leur assertion au sujet de l'Abîme, dont ils « s'imaginent prouver péremptoirement l'existence parce qu'ils le définissent tel que nous savons qu'il doit être ». Bravo ! Comme si l'on pouvait prouver l'existence des songes ! Prouver l'existence de l'Abîme, du Chaos, des dieux et des déesses, de la copulation des planètes, de la Terre sensitive de Fourier, des universaux, des bêtes qui parlent, etc., est chose entièrement impossible.
§ 1669. Mais il y a des degrés dans l'arbitraire, qui est limité par les sentiments que suscitent les mots et par certaines conventions au sujet de leur usage. Dans les créations de Fourier, l'arbitraire paraît être très grand. Quand les gnostiques font copuler des entités de nom masculin avec des entités de nom féminin, ils mettent sous les yeux du lecteur des faits qui lui sont bien connus. Au contraire, on ne comprend pas bien comment et pourquoi, chez Fourier, la Terre copule avec elle-même et avec Pallas. Si l'on prend garde que le pôle nord et le pôle sud sont tous deux froids, on ne sait pas pourquoi le fluide du premier est mâle et celui du second femelle. Mais si nous portons notre attention sur les termes nord, sud, nous comprendrons comment le sud, qui suggère l'idée de chaleur, va mieux avec la nature douce de la femme. On a un peu moins d'arbitraire, mais toujours beaucoup, dans les compositions mythologiques. On doit, en vérité, respecter certaines conventions ; mais, entre ces limites, le mythe peut prendre des formes aussi variées que l'on veut. De même, dans les fables qui font parler les animaux, l'arbitraire n'est pas moindre que dans les romans modernes. Le Roman de Renart est un bel exemple de la très grande variété de semblables fables. Dans la Théogonie d'Hésiode, l'arbitraire est moindre, bien que toujours important. On comprend que le sentiment accepte volontiers que le Chaos existait tout d'abord, et aussi l'Amour. Que la Terre ait produit le Ciel, ou le Ciel la Terre, le sentiment le comprend ; de même aussi, que la Terre et le Ciel, unis ensemble, aient produit un grand nombre de choses. Mais pourquoi, parmi ces choses, il y a Kœos, Kreios, Hypérion, etc., nous ne pouvons guère le tirer du sentiment. Chez les gnostiques valentiniens, l'arbitraire est encore moindre. Le sentiment comprend que l'origine de toute chose soit préexistante, en un lieu très lointain et innommable ; et l'on ne refuse pas à ces entités les noms d'Abîme et de Premier Père. Tous ces mots sont choisis uniquement parce qu'ils suscitent des sentiments qui concordent avec celui que nous avons d'ignorer ce principe de toute chose. La fable de Sophia, qui veut connaître le Père, éveille en nous le sentiment du désir qui existe chez les hommes de connaître ce qui est au-delà de l'expérience. L'analogie fait comprendre comment les larmes conviennent à la matière humide, le rire à la lumière et ainsi de suite (§ 1670). Les analogies avec la perfection pythagoricienne des nombres ou avec la valeur numérique des lettres, bien que très superficielles et arbitraires, ont des rapports avec certains sentiments existant dans l'esprit humain. Dans la mythologie d'A. Comte, l’arbitraire n'est pas très différent de ce qu'il est dans les théories gnostiques ; mais il ne s'affirme pas si clairement. Dans la théorie de la solidarité, l'arbitraire n'est pas très différent de celui des deux types précédents. En somme, le but est de persuader aux gens qui ont de l'argent de le partager avec la clientèle de certains politiciens. C'est pourquoi on recourt à la solidarité, à la dette qui, à chaque instant, s'éteint et renaît. On aurait pu tout aussi bien avoir recours à des entités différentes, telles que la plus-value de Marx, ou à d'autres semblables. L'arbitraire diminue, quand nous passons aux théories réalistes. On comprend que pour individualiser Socrate, on ait recours à la Socratité (§ 1651-1) et que le sentiment se complaise à une si belle explication. Il est également beau de savoir que la côtelette est une manifestation de la côtelettité ; mais tout comme le vulgaire ignorant, les métaphysiciens mangent la côtelette, sans avoir recours à la côtelettité pour apaiser leur faim.
§ 1670. Voyons ces dérivations, au point de vue des personnifications. Elles sont complètes dans les récits du type de la narration des amours d'Aphrodite et d'Arès, à tel point même que l'on peut souvent les prendre pour des récits historiques quelque peu altérés. La personnification est complète aussi, mais entièrement artificielle dans les fables où les animaux parlent. Les gnostiques valentiniens se débattent contre les difficultés de l'accord entre les personnifications et les allégories. Ils vont des unes aux autres, sans jamais trouver un terrain ferme où s'arrêter. En donnant un sexe à leurs entités, il semblerait vraiment qu'ils les ont personnifiées, mais ils ne tardent pas à aller des personnifications aux abstractions, changeant l'Æon en un principe androgyne (IRÉNÉE, I, 1). Pourtant, ils ne demeurent pas dans l'abstraction, puisqu'ils nous parlent d'une génération obtenue comme d'un sperme déposé comme dans une matrice [FN: § 1670-1] , et d'entités qui conçoivent, fécondent, enfantent. Ils s'efforcent ensuite de faire disparaître le sens matériel, en parlant de copulation « sans corruption » (§ 1649). Pour la production de la matière, ils se passent aussi de l'union des sexes. « Ils disent que des larmes d'Achamoth naquit la matière humide ; de son rire, la matière lumineuse ; de sa tristesse, la matière solide ; de sa frayeur, la matière mobile ». Enfin, ils oscillent entre le sens propre et le sens métaphorique, entre la personnification et l'allégorie, sans s'arrêter jamais définitivement à un sens déterminé.
§ 1671. On sait assez que la métaphore engendre très facilement la personnification. Nous en avons un très grand nombre d'exemples. Les personnifications employées dans la mythologie de A. Comte ressemblent à celles des gnostiques, avec cette différence que A. Comte commence par dire que ce sont des fictions, puis l'oublie et en parle comme de véritables personnes. On ne trouve aucune personnification dans la théorie de la solidarité. La personnification est nulle aussi dans la théorie des réalistes. Mais il faut prendre garde qu'il s'agit de la forme et non du fond. Enfin de compte, l'Abîme des valentiniens, l'essence universelle des réalistes, jouent le même rôle, sous des dehors différents. Toutes les choses existantes proviennent tant de l'une que de l'autre, et cette provenance est conçue en usant d'une personnification beaucoup plus accusée, comme une génération des Æons, ou bien, supprimant la personnification, en considérant les individus comme des accidents de l'essence universelle. On peut ajouter, si l'on veut, le Chaos d'Hésiode ou toute autre chose de ce genre. Enfin, en faisant produire toute chose par l'Abîme, par les universaux, par le Chaos, ou par d'autres entités semblables, on satisfait des sentiments de même nature et l'on crée des théories que les différentes personnes accueillent selon leurs goûts.
§ 1672. Voyons le point de vue de la transformation des métaphores, non plus en personnes, mais seulement en réalités objectives [FN: § 1672-1]. Ce caractère manque entièrement ou presque entièrement aux fables mythologiques ou à celles des animaux parlants. Il est de même très peu accentué dans la mythologie de Fourier. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, dans la Gnose valentinienne, les métaphores se mêlent aux personnifications, s'y confondent, et il est difficile ou même impossible de les séparer. A. Comte commence par essayer de les séparer, puis il les réunit, et finit par de simples personnifications. Les métaphores prédominent dans la théorie de la solidarité et chez les réalistes.
§ 1673. Les confusions entre les métaphores et la réalité sont habituelles chez qui raisonne sous l'empire du sentiment. Chez les rêveurs de la métaphysique et de la théologie, la chose, le symbole, la métaphore, l'allégorie, tout se mêle et se confond dans l'esprit. Il est impossible de raisonner sérieusement avec des gens qui emploient des termes si indéterminés, si nébuleux, qu'eux-mêmes en ignorent le sens. Voici M. L. Bourgeois qui nous parle avec une grande admiration des notions tirées de l'idée de la mutuelle dépendance, lesquelles « remplissent d'un contenu tout nouveau l'idée morale [FN: § 1673-1] ». Ces mots accolés ensemble ne veulent rien dire, et l'idée morale se remplit, comme la Sigè est fécondée par l'Abîme. Si M. L. Bourgeois avait vécu au temps des valentiniens, il aurait peut-être personnifié ses métaphores.
§ 1674. Toutes ces dérivations à métaphores verbales sont très usitées en métaphysique, où souvent elles dominent exclusivement et dans la partie métaphysique des théologies, où toutefois elles sont généralement accessoires. Un mot suscite certains sentiments. Le mot se transforme en chose, et l'on croit facilement que les sentiments qu'il suscite sont produits par cette chose. La poésie, la littérature, l'éloquence et même la conversation ordinaire ne peuvent se passer de ces transformations ; autrement elles manqueraient leur but principal, qui est d'émouvoir les sentiments. Elles donnent ainsi une certaine tournure d'esprit qui persiste quand on raisonne de science, et quand le but n'est pas au moins explicitement, d'émouvoir les sentiments, mais est seulement de rechercher les rapports des faits entre eux.
§ 1675. (b) Façon dont les dérivations sont accueillies. Au point de vue de la foi que les hommes ont en elles, on notera les caractères suivants. Les fables des animaux parlants n'ont jamais été prises pour des réalités. Les mythologies des valentiniens, de A. Comte, de Fourier, ont eu un certain nombre de croyants. De même aussi les métaphores de la solidarité. Beaucoup plus nombreux sont, parmi les gens cultivés, ceux qui croient à un réalisme plus ou moins mitigé. Le plus grand nombre de croyants est, de beaucoup, celui des gens qui ont cru, ou qui croient encore à la mythologie. Pour nous, maintenant, la mythologie grecque est un roman, mais un grand nombre d'hommes la tinrent pour une réalité, durant des siècles ; et nous l'avons remplacée par d'autres du même type. Le nombre des croyants s'accroît lorsque, de ces types simples de dérivations, on passe aux types composés, spécialement à ceux qui naissent de l'union du premier et du dernier type ; c'est-à-dire pour l'union du récit mythologique avec les métaphores du réalisme. La plus grande partie des religions sont constituées de cette façon.
§ 1676. Au point de vue des sentiments que satisfont les sept types notés « § 1666), on peut observer que l'instinct des combinaisons est surtout satisfait par le premier. Chez les enfants et chez beaucoup d'hommes, le second type le satisfait aussi ; mais chez beaucoup de personnes, des instincts moraux sont en outre satisfaits ; c'est-à-dire que les résidus de la seconde classe interviennent. Le sixième type, et plus généralement les raisonnements métaphysiques, satisfont le besoin d'explications logiques que l'homme cultivé éprouve (résidus I-ε). De même aussi le septième type et d'autres analogues, qui recouvrent par le raisonnement des appétits brutaux. Les 3e, 4e, 5e types s'efforcent d'unir la satisfaction de l'instinct de combinaison à celui du raisonnement logique ; et il semble qu'ils n'atteignirent leur but qu'en petite partie, car ils durèrent peu et n'eurent pas beaucoup de croyants. Au contraire, les religions qui durèrent longtemps et eurent de nombreux croyants atteignirent mieux ce but. L'ancienne religion romaine fut supplantée par celle de la Grèce, parce qu'elle [FN: § 1676-1] ne satisfaisait en aucune façon l'instinct du raisonnement. Le néo-platonisme fut vaincu par le christianisme, parce qu'il ne satisfaisait pas le besoin de combinaisons concrètes. De même, le modernisme, qui rénove les explications allégoriques de Philon, ne fait pas son chemin dans le peuple, parce qu'il satisfait uniquement les besoins intellectuels d'un petit nombre de raisonneurs. La théologie n'est plus de mode, pas même quand elle se dissimule sous le voile démocratique.
§ 1677. Il est nécessaire de bien comprendre que la personnification satisfaisant le besoin du concret, et l'allégorie le besoin de l'abstraction, les dérivations tendent à les employer autant que possible ensemble, pour tirer parti de toutes les deux. Mais il n'est pas facile de les faire concorder. Là, l'Église catholique se montre sage et habile en dissimulant sous le mystère la correspondance qui pourrait exister entre le concret et l'allégorie. Le quatrième Évangile est le complément nécessaire des trois premiers, pour satisfaire complètement le besoin religieux des hommes ; et c'est avec beaucoup de bon sens que l'Église catholique réprouve les interprétations des modernistes, comme elle en réprouva déjà d'autres analogues, qui visaient à séparer la réalité historique de l'allégorie. Elle condamna les fables des gnostiques, qui faisaient trop pencher la balance d'un côté, mais elle accepta dans une certaine mesure des interprétations allégoriques qui satisfaisaient le besoin de raisonner et de déduire qu'éprouvent les hommes. À ce point de vue, Saint Thomas est vraiment remarquable, et nous ne saurions quel autre auteur pourrait lui être comparé. Il satisfait de la meilleure façon possible les divers besoins du concret et de l'allégorie, et sait éviter, avec un art consommé, les contrastes qui se manifestent à chaque instant entre la réalité et l'allégorie.
§ 1678. Il est un autre aspect sous lequel les dérivations doivent être considérées. Il est d'une grande importance : c'est celui du jugement qu'on porte sur les dérivations par rapport à la réalité, et cela non seulement en ce qui concerne leur accord avec l'expérience, mais aussi en ce qui touche leur rapport avec l'utilité individuelle ou l'utilité sociale. Nous avons déjà traité longuement le premier sujet, en parlant de la façon dont les actions logiques et les non-logiques étaient envisagées (chap. IV et V) ; mais il nous reste à ajouter certaines choses, qui ne pouvaient trouver leur place qu'après l'exposition faite tout à l'heure des théories. Après cela, nous n'aurons pas épuisé la matière, et nous devrons encore étudier les oscillations concomitantes de ces dérivations et d'autres phénomènes sociaux, ce que nous ferons au chapitre XII (§ 2329 et sv.).
§ 1679. Il y a des gens qui ne veulent s'attacher qu'aux actions logiques, tenant les non-logiques pour issues d'absurdes préjugés, capables seulement de causer des maux à la société. De même, il y a des gens qui veulent envisager une doctrine uniquement au point de vue de l'accord avec l'expérience, et qui déclarent que tout autre point de vue est vain, stupide, nuisible. Cette théorie offusque les sentiments de beaucoup d'autres gens et ne concorde pas avec les faits, puisque ceux-ci démontrent clairement que des doctrines (dérivations) qui sortent du domaine logico-expérimental sont des expressions de sentiments qui jouent un rôle important dans la détermination de l'équilibre social (§ 2026). La théorie dont nous parlons est donc fausse, au sens que nous donnons à ce terme ; mais où est l'erreur ?
§ 1680. Les adversaires de ceux qui dédaignent les théories estimées non-réelles contestent ce caractère de non-réalité. Ils sentent instinctivement qu'il est faux que ces théories soient de vains assemblages de mots sans effet social ; et, voulant leur restituer leur dignité, ils s'efforcent de toute façon de les faire paraître réelles ou supérieures à la réalité (§ 2340). C'est là une nouvelle erreur qui, à son tour, offusque les sentiments de ceux qui vivent dans la pratique et dans la réalité. Elle démontre une fois de plus la vanité logico-expérimentale de l'affirmation qu'on oppose à ces personnes. Ainsi apparaît une des causes qui font naître et se perpétuer les oscillations qu'on observe depuis tant de siècles entre le scepticisme et la foi, entre le matérialisme et l'idéalisme, entre la science logico-expérimentale et la métaphysique (§ 2341).
§ 1681. Ne nous occupons ici que de quelques-unes des oscillations que nous étudierons ensuite d'une façon générale (§ 2329 et sv.). En un peu plus d'un siècle, c'est-à-dire de la fin du XVIIIe siècle au commencement du XIXe, nous avons vu régner le scepticisme voltairien, auquel succéda l'humanitarisme de Rousseau, et ensuite apparaître la religion révolutionnaire ; puis vint le retour de la religion chrétienne ; ensuite, de nouveau le scepticisme, le positivisme ; et maintenant derechef commence une nouvelle oscillation dans le sens mystico-nationaliste. Si nous exceptons les sciences naturelles, et si nous portons notre attention seulement sur les théories sociales, nous voyons qu'on n’avance pas beaucoup, ni dans un sens ni dans l'autre. En somme, si la foi n'est qu'un préjugé nuisible, comment se fait-il qu'elle survive à tant de siècles, se transformant et renaissant à chaque instant, après que ses ennemis, du temps de Lucrèce à nos jours, croient l'avoir éteinte ? Et si le scepticisme scientifique est vraiment si inutile, si peu concluant, si nuisible au genre humain, comment se fait-il qu'il puisse, de temps à autre, revenir à la charge, ne fût-ce qu'avec le simple bon sens d'un Lucien, d'un Montaigne, d'un Bayle, d'un Voltaire ? Comment se fait-il que l'on ne constate pas de progrès dans les opinions sociales, alors qu'il est incontestable dans les sciences naturelles ?
§ 1682. Si nous voulons ne fixer notre attention que sur les faits, nous verrons qu'il y a erreur de part et d'autre, parce qu'on réduit à l'unité des choses qui doivent demeurer séparées. Il faut distinguer l'accord avec les faits d'une doctrine ou d’une théorie et leur importance sociale. Le premier peut être nul et la dernière très grande. Mais cette importance ne prouve pas l'accord, de même que l'accord ne prouve pas l'importance. Une théorie peut ne pas correspondre à des faits objectifs, être entièrement fantaisiste à ce point de vue, et correspondre au contraire à des faits subjectifs de grande importance pour la société (§ 844). Celui qui voit l'importance sociale d'une mythologie, la veut aussi réelle. Celui qui en nie la réalité, en nie aussi l'importance sociale. Tout au contraire, les faits font clairement voir que les mythologies n'ont pas de réalité et ont une grande importance sociale. En cette matière, le préjugé est si fort que beaucoup de gens s'imaginent que l'ère des mythologies est définitivement close, que ce sont là de vains souvenirs d'un passé qui ne reviendra plus, et ils ferment ainsi volontairement les yeux sur les très nombreux faits qui les montrent encore vives et prospères. De même, il est d'autres personnes qui s'imaginent que l'œuvre, accomplie durant tant de siècles, par la science logico-expérimentale est vaine, et que, pour connaître les faits, on pourra revenir aux songeries d'un Platon, rénovées par un Hegel.
§ 1683. Les oscillations observées dans les opinions sociales sont, dans le domaine de la théorie (§ 2340 et sv.), le résultat de l'antagonisme de deux forces opposées : la correspondance des dérivations à la réalité et leur utilité sociale. Si les deux forces se confondaient, un mouvement continu qui établirait la prédominance absolue de leur ensemble ne serait pas impossible, au moins sous un certain aspect. Mais puisqu'au lieu de se confondre elles restent distinctes et de sens différent, et qu'il demeure, d'une part, sinon impossible, au moins malaisé de se soustraire entièrement à la réalité, et, d'autre part, de négliger entièrement l'utilité sociale, il en résulte nécessairement que dans tout ce qui se rapporte à l'organisation sociale, la théorie oscille comme un pendule, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Il n'en est pas ainsi dans les sciences naturelles, parce que les théories mathématiques, chimiques, astronomiques, etc., n'ont, pour le moment du moins, que peu ou point d'importance sociale. C'est pourquoi le pendule se déplace toujours plus du côté des théories logico-expérimentales, sans qu'aucune force, du moins aucune force importante (§ 617), le fasse revenir du côté des dérivations métaphysiques, théologiques ou autres semblables [FN: § 1683 note 1). Au temps passé, cette force put être observée en quelques cas ; elle se manifesta par les procès pour impiété, à Athènes, dans le procès de Galilée et en d'autres semblables ; mais elle finit par s'épuiser, parce qu'elle ne correspondait pas à une utilité sociale effective, ou pour mieux dire, parce que, l'utilité sociale n'étant qu'un des éléments du phénomène, très important, c'est vrai, cette force ne correspondait pas à des sentiments dont les hommes ne pouvaient se passer sans de très graves altérations de l'équilibre social. Étant donné qu'ici nous ne visons d'aucune manière à prêcher, mais bien uniquement à rechercher les uniformités des faits sociaux, nous pouvons sans aucun inconvénient, nous devons même maintenir le pendule exclusivement du côté où il se déplace de plus en plus dans les sciences naturelles (§ 86, 1403).
§ 1684. Peut-être le lecteur a-t-il trouvé superflue l'exposition que nous avons faite du gnosticisme, et s'est-il dit : « Qu'est-ce que ces fables ont affaire avec la sociologie ? » – Elles ont affaire avec la sociologie, parce qu'elles expriment des sentiments qui sont toujours puissants dans notre société ; et, sans parler de leurs manifestations dans les théories de Saint-Simon, de Fourier, de A. Comte, du socialisme humanitaire et d'autres, on voit tous les jours naître et prospérer, en Amérique et en Angleterre, des sectes chrétiennes non moins absurdes, au point de vue exclusivement expérimental, que les sectes gnostiques. Maintenant s'y ajoutent le néo-bouddhisme, la théosophie, le spiritisme, l'occultisme, etc., qui ont des adeptes dans toute l'Europe. Qui veut se persuader que les modernes ne le cèdent en rien aux anciens pour imaginer des fantasmagories qu'ils regardent comme de sublimes vérités, n'a qu'à lire, parmi tant de livres, celui de Sinnett sur le Bouddhisme ésotérique ou positivisme hindou [FN: § 1684-1].
D'une manière plus générale, on peut se demander pourquoi nous nous occupons longuement de l'étude des dérivations théologiques de la religion chrétienne. Les fidèles de cette religion les considèrent comme l'expression de vérités absolues ; les ennemis, comme l'expression d'absurdes préjugés, qui – disent-ils – ont été actuellement dissipés par les « lumières de la science », et dont, par conséquent, il est à peu près inutile de s'occuper sérieusement.
Nous nous plaçons entièrement en dehors de ces deux points de vue opposés. Les dérivations de la religion chrétienne, comme celles du Talmud, du paganisme, et autres semblables, sont étudiées par nous en vue de connaître les résidus qui leur ont donné naissance et les formes générales que l'on observe dans les dérivations. Si ces résidus avaient disparu actuellement, si ces formes étaient tombées en désuétude, notre étude aurait un caractère purement historique ; elle n'en conserverait pas moins une importance que l'on reconnaîtra devoir être assez grande, si l'on remarque que, par exemple, la religion chrétienne a été pendant des siècles l'expression de l'état psychique de millions et de millions d'hommes. Mais nous avons vu que les résidus qui existaient au temps du paganisme, ceux que nous trouvons au moyen âge chrétien, ceux que nous observons actuellement, sont, en grande partie, d'une même nature, et que seules les dérivations ont beaucoup changé d'aspect, tout en conservant des développements analogues ; notre étude n'est donc pas exclusivement historique, et elle nous permet d'étendre nos connaissances des phénomènes contemporains.
C'est ce que nous pouvons répéter au sujet de l'étude des sociétés politiques de la Grèce et de Rome ; elle constitue une des meilleures préparations à l'étude de nos sociétés modernes, qui, fort différentes quant à la forme, conservent, avec les sociétés anciennes, un fond commun, dû précisément au fait que les résidus se transforment et changent fort lentement.
Il est bien entendu qu'il ne s'agit que d'études théoriques. Nous avons assez souvent dit et répété que nous n'avions pas la moindre intention de rechercher ici des recettes pour résoudre les problèmes concrets qui se présentent à l'homme pratique.
§ 1685. Après avoir rapporté les fantasmagories des gnostiques et la passion de Sophia, Renan, qui, comme d'habitude, veut ménager la chèvre et le chou, exprime mal une idée, vraie sous certains aspects, en louant la partie de ces fantaisies qui exalte certains sentiments [FN: § 1685 -1]. Il se rapprocherait beaucoup plus des faits si, au lieu de parler objectivement, il parlait subjectivement, et disait que les sentiments qui étaient satisfaits par la Théogonie d'Hésiode et par d'autres productions semblables, y compris les mythes gnostiques qu'il rapporte, existent encore chez un grand nombre d'hommes de notre temps, et se manifestent d'une façon analogue à celle dont ils se manifestaient par le passé. Celui qui veut prêcher aux hommes pour les attirer dans la voie qu'il estime la meilleure, blâme ou loue ces sentiments et leurs manifestations. Celui qui s'occupe uniquement de science les décrit et tâche d'en découvrir les rapports avec les autres faits sociaux.
§1686. (IV-ε) Termes douteux, indéterminés, qui ne correspondent à rien de concret. C'est la limite extrême des dérivations verbales, qui finissent par apparaître comme un simple cliquetis de mots [FN: § 1686 -1]. Peu de ces dérivations servent au vulgaire, qui, interdit, stupéfait de l'étrangeté des mots, reste bouche bée, supposant qu'elles cachent Dieu sait quels mystères [FN: § 1686-2] . Le plus grand nombre est à l'usage des métaphysiciens, qui s'en repaissant continuellement, finissent par s'imaginer qu'elles correspondent à des choses réelles. Le lecteur trouvera dans leurs œuvres autant d'exemples qu'il voudra ; nous n'en avons déjà rapporté que trop dans ce livre ; c'est pourquoi il nous reste peu de chose à ajouter. Nous devons remarquer seulement que le torrent de ces mots dépourvus de sens et incohérents coule de l'antiquité jusqu'à nos jours [FN: § 1686-3]. Tantôt il se gonfle et se répand en inondations, tantôt il se retire et coule dans un lit régulier. En tout cas, il subsiste, et l'on voit par conséquent qu'il satisfait à un besoin humain, comme le chant, la poésie, les fables. Chaque temps a ses termes à la mode. Par exemple, aujourd'hui, en Italie, on emploie beaucoup le terme superare (dépasser, surpasser) et ses dérivés superatori (dépasseurs), superamento (dépassement). [FN: § 1686-4] Que signifient-ils de précis ? Personne ne le sait ; mais ce doit être quelque chose de fort beau, parce qu'à entendre ces termes, les adversaires demeurent abasourdis, consternés, et ne savent plus que dire. En effet, que voulez-vous répondre à qui vous objecte que votre théorie est dépassée (superata) ? Veuille le dieu de la métaphysique que le théorème du carré de l'hypothénuse ne soit pas aussi dépassé (superato), sinon adieu géométrie ! En général, les termes maintenant à la mode sont, en un sens favorable : vivant, dynamique, spirituel, auxquels s'opposent, en un sens défavorable, ceux de mort, stase et mécanique. De ce dernier, par un audacieux néologisme, on a fait en italien le verbe mecanizzare. Que voulez-vous répondre à qui vous objecte que votre histoire est morte, tandis que la sienne est vivante ? [FN: § 1686-5] ou bien que vous mécanisez dans la stase ce que lui spiritualise dans la dynamique ? Si vous comprenez cela, vous n'éprouverez aucune difficulté à saisir le sens précis des célèbres plaidoiries prononcées par deux seigneurs devant Pantagruel, et du mémorable arrêt par lequel Pantagruel mit fin à leur débat [FN: § 1686-6] . Dans sa comédie Les Grenouilles, Aristophane feint, pour se moquer d'Euripide, qu'à presque tous les vers de ce poète, on peut ajouter, en manière de conclusion : « Il perdit sa fiole ». Semblablement, ces mots privés de sens concret peuvent s'adapter à n'importe quel raisonnement [FN: § 1686-7] .
[1010]
Chapitre XI.↩
Propriétés des résidus et des dérivations
§ 1687. L'étude que nous venons de faire des résidus et des dérivations nous a fait connaître les manifestations de certaines forces qui agissent sur la société, et par conséquent ces forces mêmes aussi. Ainsi, peu à peu nous approchons de notre but, qui est de nous rendre compte de la forme que prend la société, sous l'empire des forces qui agissent sur elle. La voie est longue ; mais, voulant nous laisser guider exclusivement par les faits, nous n'avons trouvé aucun moyen de l'abréger. Nous avons reconnu et classifié les résidus et les dérivations. Cela faisant, nous avons aussi découvert certaines de leurs propriétés. Maintenant, il convient que nous étudiions ces dernières en détail. Pour connaître la forme que revêt la société, il est manifeste que nous devrons considérer ensemble tous les éléments qui déterminent cette forme. Mais avant de pouvoir le faire, il est nécessaire que nous étudiions séparément ces éléments et certaines de leurs combinaisons. C'est ce que nous ferons dans le présent chapitre, pour étudier dans le suivant l'ensemble social.
Nous commencerons par considérer ces éléments d'une manière intrinsèque, abstraction faite de leur rapport avec l'utilité sociale. Étant donnés certains résidus et certaines dérivations, deux genres de problèmes se posent. 1° Comment agissent ces résidus et ces dérivations ? 2° En quel rapport cette action est-elle avec l'utilité sociale ? L'empirisme vulgaire traite en même temps des deux problèmes, qu'il ne distingue pas ou qu'il distingue mal (§966 et sv.). Il convient que l'analyse scientifique les sépare ; et il est essentiel, pour éviter de trop faciles erreurs, qu'en traitant du premier, on n'ait pas l'esprit préoccupé par le second.
§ 1688. Avant de pousser plus loin, il sera bon de faire quelques observations sur la manière de nous exprimer. Remarquons tout d'abord, en ce qui concerne les dérivations, que nous avons désigné par ce nom un phénomène qu'il convient de diviser en deux, pour des études ultérieures. Il y a la dérivation proprement dite et la manifestation à laquelle elle aboutit. C'est-à-dire qu'il y a une démonstration, ou mieux une pseudo-démonstration, et un théorème ou un pseudo-théorème. Ces deux derniers peuvent rester constants, tandis que varient les dérivations qui y conduisent. Par exemple, dans la dérivation qui veut démontrer l'existence de la solidarité-droit, nous pouvons séparer la manifestation de cette existence dans l'esprit de celui qui emploie la dérivation, et la démonstration qu'on en donne, c'est-à-dire la dérivation proprement dite. Celle-ci peut varier, tandis que celle-là reste constante ; et parfois la seconde est répétée d'imitation par qui est dépourvu ou presque dépourvu de la première. Les hommes s'approprient souvent mécaniquement, sans grande persuasion, des propos qui sont de mode dans la société au milieu de laquelle ils vivent (§2003 et sv.). Nous continuerons, comme par le passé, à désigner par le nom de dérivation le phénomène dans son ensemble, et quand nous voudrons distinguer les deux parties, nous emploierons les noms de manifestations et de dérivations proprement dites.
En analysant les dérivations proprement dites, on trouve d'abord comme fondement le besoin de développements logiques, puis les résidus de la Ie classe, par lesquels on satisfait ce besoin, et enfin des résidus de toutes les autres classes, qu'on emploie comme moyens de persuasion. En analysant les manifestations, on trouve comme fondement les résidus. C'est en effet ainsi que nous les avons trouvés dans les chapitres précédents. À ces résidus s'ajoutent, comme vernis logique, des dérivations proprement dites, des raisonnements divers. En outre, dans les cas concrets, autour d'un résidu principal s'en disposent d'autres, qui sont accessoires.
§ 1689. L'erreur principale des raisonnements vulgaires, ainsi que des raisonnements métaphysiques, consiste non seulement à intervertir les termes du rapport entre les dérivations et les actions humaines, dans l'idée que celles-là sont en général la cause de celles-ci, tandis qu'elles en sont au contraire la conséquence, mais encore à donner une existence objective aux dérivations proprement dites et aux résidus dont elles sont issues.
Comme nous l'avons déjà dit (§94,149), nous ne donnons aucun sens métaphysique à ces termes : existence objective ; il est bon, par conséquent, que nous indiquions le sens dans lequel ils sont employés ici. Prenons, par exemple, le « droit naturel » ou le « droit des gens ». Dans l'esprit d'un très grand nombre de personnes, les notions de certains rapports entre les hommes sont acceptées favorablement, les notions de certains autres repoussées avec défaveur. En outre, les premières notions s'unissent à d'autres auxquelles on donne habituellement les noms de bon, honnête, juste, etc., et se heurtent à d'autres auxquelles on donne habituellement des noms contraires : mal, malhonnête, injuste, coupable, etc. Rien ne s'oppose à ce qu'on donne le nom de droit naturel à l'ensemble, même indéterminé, de ces premières notions, et qu'on exprime le fait indiqué plus haut en disant que la notion du droit naturel existe dans l'esprit « des hommes ». Il est des personnes qui, de là, concluent qu'il doit aussi exister une chose de ce nom, et qu'il ne reste qu'à la trouver et à la définir avec précision. Si à cela nous objections qu'une existence subjective n'a pas pour conséquence une existence objective, nous tomberions dans une discussion métaphysique dont nous voulons au contraire nous tenir éloigné. Notre réponse est tout autre, et consiste surtout à remarquer que, par le même mot exister, on a exprimé deux choses différentes, dans les propositions précédentes. Pour mieux voir cela, faisons un raisonnement parallèle au précédent. C'est un fait que dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est-à-dire des chimistes, la notion de chlorure de sodium est acceptée avec d'autres notions de réactions chimiques et s'y trouve liée. Rien n'empêche que nous exprimions ce fait en disant que la notion de chlorure de sodium existe dans l'esprit « des hommes ». De là, on peut conclure, bien qu'en pratique on suive la voie inverse, qu'il doit exister une chose de ce nom.
Les deux raisonnements ont bien une partie semblable, mais ils en ont une autre entièrement différente. Chez les chimistes, les conséquences logiques de la notion de chlorure de sodium se vérifient en pratique avec une si grande probabilité qu'on peut les qualifier du terme vulgaire de certaines. Les conséquences logiques du droit naturel se vérifient quelquefois, en pratique ; plus souvent elles ne se vérifient pas. Le chimiste ne dit pas : « Le chlorure de sodium en solution devrait précipiter le nitrate d'argent ». Il dit, ce qui est bien différent : « Le chlorure de sodium en solution précipite le nitrate d'argent ». L'adepte du « droit naturel » ne peut pas employer cette dernière expression, et doit toujours se contenter de la première. Il suffit d'ouvrir l'histoire pour voir que le « droit des gens » est comme le caoutchouc. Les puissants en font ce qu'ils veulent. Sans remonter trop haut, en 1913, certains puissants États européens décident qu'il doit exister une principauté d'Albanie, laissent le Monténégro faire le siège de Scutari, puis, un beau jour, l'obligent à abandonner la ville ; et comme le Monténégro hésite, ils envoient, sans aucune déclaration de guerre, leurs escadres établir le blocus des côtes monténégrines, et capturent le yacht du roi Nicolas. Il est impossible de découvrir quel « droit » ces puissances ont de faire cela, et notamment quel « droit » elles ont sur le territoire albanais et sur Scutari, à moins qu'on ne veuille donner au terme « droit » le sens qu'il a dans la fable du loup et de l'agneau. Ces États font donc ce qu'ils veulent du « droit des gens », mais ils ne pourraient pas faire ce qu'ils veulent des réactions chimiques ; et avec toute leur puissance, ils ne pourraient pas empêcher que le chlorure de sodium en solution ne précipitât une solution de nitrate d'argent. Il y a donc une différence essentielle, au point de vue pratique, entre les deux cas considérés, et l'existence du chlorure de sodium et d'autres corps chimiques est différente de l'existence du « droit naturel », « des gens » ou d'autres semblables entités. Dans les deux cas aussi, les conséquences logiques qu'on peut tirer sont différentes. Par exemple, je tire la conséquence logique qu'un certain poids de chlorure de sodium contient un poids déterminé de chlore ; je fais l'analyse et je vérifie cette conséquence. Il en va tout autrement des conséquences logiques de ces entités dépourvues de toute précision, et qui portent les noms de « droit des gens », « droit naturel », et autres semblables. Toujours à propos du Monténégro, le ministre anglais des affaires étrangères déclare qu'on ne peut permettre au Monténégro d'occuper Scutari, parce que la population n'y est pas de la même race qu'au Monténégro, ne parle pas la même langue, n'a pas la même religion. Donc, il semblerait qu'un pays n'a pas le « droit » d'en occuper un autre qui présente ces caractères. On demande : les Hindous sont-ils de la même race, parlent-ils la même langue, ont-ils la même religion que les Anglais ? Si l'on répond négativement, pourquoi le Monténégro n'a-t-il pas le « droit » d'occuper Scutari, et les Anglais ont-ils le « droit » d'occuper les Indes ? [FN: § 1689-1] Cela demeure un mystère.
D'une façon générale, quand nous disons que la notion de droit naturel existe dans l'esprit des hommes, nous exprimons le fait que dans l'esprit de certains hommes se trouvent des notions auxquelles on donne ce nom. On peut faire un essai pratique, et l'on verra qu'il réussit. En outre, de ce fait on peut tirer la conséquence qu'en raisonnant avec ces hommes, il est utile, pour les persuader, de tenir compte de cette notion qu'ils ont en eux. Là aussi l'expérience réussira ; c'est pour ce motif que les puissants, au lieu de dire simplement qu'ils veulent une chose, se donnent la peine d'employer des sophismes pour démontrer qu'ils « ont le droit » d'avoir cette chose ; ils imitent le loup dans ses propos à l'agneau. La proposition énoncée tout à l'heure est donc du genre de l'autre, qui affirme l'existence, en certains esprits, de la notion du chlorure de sodium, avec cette différence que cette dernière est beaucoup plus précise. Semblable encore est la proposition qui affirme l'existence d'une chose portant le nom de chlorure de sodium. Au contraire, la proposition qui affirme l'existence du « droit naturel » est d'un genre entièrement différent [FN: § 1689-2]. Pour que cette proposition fût du genre précédent, les conditions suivantes seraient nécessaires : 1° qu'on puisse définir avec quelque précision ce qu'on entend par ce terme ; 2° que les conséquences logiques de cette définition se vérifient en pratique. Ni l'une ni l'autre de ces conditions n'est remplie. Au chapitre IV, nous avons précisément fait voir qu'il est impossible de savoir avec un peu de précision ce que les auteurs entendent par le terme de « droit naturel » ; et il y a de très nombreuses preuves montrant qu'on peut bien déduire logiquement de ce terme ce qui devrait arriver suivant certains auteurs, mais non, du moins en général, ce qui arrive effectivement [FN: § 1689-3]. C'est pourquoi, dans une étude qui a pour but de connaître ce qui a lieu sûrement, de semblables entités ne peuvent nous être d'aucun usage. Nous les considérons seulement comme des manifestations de sentiments ; sentiments que nous avons précisément recherchés, dans les chapitres VI, VII et VIII, parce qu'ils appartiennent à la catégorie des choses dont nous pouvons faire usage pour connaître ce que l'on observe en réalité. Pour le même motif, nous avons recherché, dans les chapitres IX et X, les voiles dont ces choses sont recouvertes, les formes sous lesquelles elles se présentent. Ainsi nous avons procédé d'une manière analogue à celle de l'homme de science qui recherche d'abord la composition d'un corps chimique, et ensuite la forme sous laquelle il cristallise.
§ 1690. Pour revenir aux observations sur la manière de s'exprimer, il faut remarquer que, les sentiments étant manifestés par les résidus, il nous arrivera souvent, afin d'abréger, de nommer simplement les résidus pour désigner aussi les sentiments qu'ils manifestent. En ce sens, nous disons que les résidus sont parmi les éléments qui déterminent l'équilibre social ; proposition qui doit être traduite et entendue en ce sens que « les sentiments manifestés par les résidus sont parmi les éléments qui se trouvent en rapport de mutuelle détermination avec l'équilibre social ». Mais cette proposition aussi est elliptique et doit être traduite à son tour. Prenons garde au danger d'attribuer une existence objective (§94, 149, 1689) aux résidus, ou même aux sentiments. En réalité, nous observons seulement des hommes se trouvant dans un état révélé par ce que nous appelons des sentiments. C'est pourquoi la proposition énoncée tout à l'heure doit se traduire sous cette forme : « Les états dans lesquels se trouvent certains hommes, et qui sont révélés par les sentiments, lesquels se manifestent par les résidus, sont parmi les éléments qui se trouvent en rapport de mutuelle détermination avec l'équilibre social ». Mais si nous voulons vraiment nous exprimer d'une manière rigoureuse, cela ne suffit point encore. Que peuvent bien être ces états « des hommes », ou si l'on veut, ces « états psychiques » ? Ce sont des abstractions. Qu'y a-t-il dessous ? Nous devrons donc dire : « Les actes des hommes sont parmi les éléments qui se trouvent en rapport de mutuelle détermination avec l'équilibre social. Parmi ces actes, il y a certaines manifestations auxquelles nous avons donné le nom de résidus, et qui sont étroitement liées à d'autres actes ; de telle sorte que, les résidus étant connus, on peut aussi, en des circonstances données, connaître les actes. Par conséquent nous dirons que les résidus sont parmi les éléments qui se trouvent en rapport de mutuelle détermination avec l'équilibre social ». On peut bien dire cela une fois, pour fixer avec une rigueur stricte le sens des termes employés, mais il serait inutile, fastidieux, et vraiment pédant de parler toujours avec de pareilles longueurs. C'est pourquoi, à la proposition précédente, on substitue cette autre, qui s'exprime en disant : « Les résidus sont parmi les éléments qui déterminent l'équilibre social » ; et cela ne peut apporter aucun inconvénient, si l'on se rappelle toujours le sens donné aux termes ainsi employés [FN: § 1690-1].
Les dérivations aussi manifestent des sentiments, soit directement ceux qui correspondent aux résidus dont ils tirent leur origine, soit indirectement ceux qui servent à dériver. Mais nommer les dérivations au lieu des résidus qu'elles manifestent, ainsi que le langage vulgaire a l'habitude de le faire, pourrait induire en de graves erreurs. C'est pourquoi nous nous en abstiendrons dans tous les cas où le doute au sujet de la signification de la proposition nous paraîtra possible.
Le sujet étant très important, il conviendra d'ajouter quelques éclaircissements. Nous observons, par exemple, différents cas dans lesquels la poule défend ses poussins, et nous résumons l'observation des faits passés, la prévision des faits futurs, la notion d'une uniformité, en disant que « la poule défend ses poussins », qu'il y a en elle un sentiment qui la pousse à les défendre, que cette défense est la conséquence d'un état psychique donné. De même, nous observons divers cas dans lesquels certains hommes se font tuer pour leur patrie, et nous résumons l'observation des faits passés, la prévision des faits futurs, la notion d'une uniformité étendue à un grand nombre d'individus, en disant que « les hommes – ou certains hommes – se font tuer pour leur patrie », qu'il y a en eux un sentiment qui les pousse à se sacrifier pour leur patrie, que ce sacrifice est la conséquence d'un état psychique donné. Mais, chez les hommes, nous observons aussi certains faits qui sont la conséquence de l'emploi du langage par l'être humain, et qui, par conséquent, ne peuvent être observés chez les animaux. C'est-à-dire que les hommes expriment par le langage certaines choses que nous mettons en rapport avec les faits observés, lorsque ces hommes se font tuer pour leur patrie. Ils disent, par exemple, Dulce et decorum est pro patria mori. Nous disons qu'ils expriment ainsi un certain sentiment, un certain état psychique, etc. Mais cela n'est pas très rigoureux, car les sentences que nous considérons de cette manière comme exprimant un sentiment (on dirait mieux : un ensemble de sentiments), un état psychique, etc., sont multiples et variées. En séparant dans ces sentences et autres propositions la partie constante de la partie variable, nous avons trouvé les résidus et les dérivations ; et nous avons dit que le résidu exprime ce sentiment, cet état psychique, etc. Mais ainsi nous ajoutons quelque chose aux faits. L'observation expérimentale nous dit seulement qu'il y a des faits concomitants d'hommes qui se sacrifient pour leur patrie, et qui s'expriment d'une certaine manière [FN: § 1690-2]. Nous rendons compte de cela au moyen des propositions suivantes qui, d'abord rapprochées de la réalité, s'en écartent ensuite toujours plus. 1° On remarque à la fois des actes de dévouement pour la patrie, et des expressions qui approuvent, louent ces actes. Ces expressions ont une partie commune que nous appelons résidu. 2° Les hommes se sacrifient pour leur patrie, et ont un sentiment manifesté par les résidus, sentiment qui les pousse à faire cela. La différence avec la réalité gît dans le terme sentiment, qui n'est pas précis. En outre, l'uniformité est énoncée sans conditions, tandis qu'il devrait y en avoir. Enfin, même si l'on suppose qu'il y a toujours un sentiment qui pousse aux actes, cela pourrait donner lieu à des objections. 3° Au lieu de dire : « et ont un sentiment, etc. », on dit : « parce qu'ils ont un sentiment, etc. ». Le terme parce que éloigne de la réalité, en indiquant un rapport de cause à effet, tandis que nous ne savons pas avec précision si ce rapport existe. 4° Les hommes croient que se sacrifier pour sa patrie est un devoir ; c'est pourquoi ils accomplissent ces actes de sacrifice. Là, nous nous éloignons beaucoup de la réalité, en admettant que les actes sont des conséquences des croyances, et en substituant les actions logiques aux actions non-logiques. Cette dernière manière de s'exprimer est usuelle, mais induit facilement en erreur, même si l'on a dans l’esprit que c'est uniquement une forme de la première. On peut employer la seconde manière de s'exprimer, pourvu qu'on ait présent à l'esprit que, rigoureusement, nous devons toujours nous en rapporter à la première. Nous avons fait et ferons un abondant usage de cette seconde manière de s'exprimer, spécialement sous la forme équivalente qui met en rapport les actes et les résidus. On peut employer la troisième manière, mais toujours avec la précaution de s'en rapporter à la première, et en se tenant sur ses gardes contre le danger de tirer des conséquences logiques du terme parce que qui y est employé. Les termes : sentiments, résidus, sont commodes en sociologie, de même que le terme force est commode en mécanique. On peut les employer sans inconvénients si l'on a toujours présente à l'esprit la réalité à laquelle ils correspondent.
§ 1691. LES RÉSIDUS EN GÉNÉRAL. Pour reconnaître et classer les résidus, nous les avons considérés indépendamment de l'intensité des sentiments qu'ils manifestent, et indépendamment du nombre de personnes chez lesquelles ils se rencontrent ; par abstraction, nous les avons séparés des êtres concrets auxquels ils appartiennent. Il faut maintenant tenir compte de toutes ces circonstances.
Parlons d'abord de l'intensité. Il faut distinguer entre l'intensité propre au résidu, et celle qui lui vient de la tendance générale de l'individu à être plus ou moins énergique. Par exemple, celui qui a un fort sentiment de patriotisme et peu de courage, combattra avec beaucoup moins d'énergie pour sa patrie que celui qui a un sentiment beaucoup moins fort, mais est courageux. Celui qui a fortement l'instinct des combinaisons, mais est paresseux, réalisera moins de combinaisons que celui qui possède cet instinct à un moindre degré, mais est actif. On peut donc admettre que certaines circonstances, auxquelles nous donnons le nom d'énergie ou, au contraire, de faiblesse, élèvent ou abaissent le niveau général de certains résidus [FN: 1691-1].
§ 1692. Voyons ensuite les résidus en rapport avec les êtres concrets auxquels ils appartiennent. Supposons qu'en un lieu et en un temps déterminés, on ait observé mille phénomènes A ; qu'en un autre lieu ou en un autre temps, on ait observé cent phénomènes B ; enfin, qu'en un lieu ou un temps encore différents, on ait observé un seul phénomène C. Pour trouver les résidus, nous avons comparé A avec B, avec C , en en cherchant la partie constante, sans tenir compte du nombre des phénomènes A, B, C. Maintenant, nous devons diriger notre étude vers cette partie du sujet, et étudier la répartition des résidus. D'ailleurs, nous ne pourrons pas avancer beaucoup dans cette voie, parce que nous manquons encore d'une théorie de la division de la société en classes. Nous pourrons donc seulement commencer l'étude, que nous poursuivrons au chapitre suivant, après avoir donné cette théorie (§2025 et sv.).
§ 1693. Pour la partie statique, nous devons examiner : 1° la répartition des résidus dans une société donnée ; 2° la répartition entre les diverses couches de cette société. Pour la partie dynamique, il faut voir : l° comment, à peu près, les résidus varient dans le temps, soit qu'ils changent chez les individus d'une même couche sociale, soit que le changement ait lieu par le mélange des couches sociales ; 2°comment chacun de ces deux phénomènes se produit.
§ 1694. En outre, il faut prendre garde au mouvement rythmique que l'on observe en tous les phénomènes sociaux (§2329). Un phénomène à peu près constant est représenté, non pas par une droite mn, mais bien par une courbe ondulée svt. Un phénomène d'intensité croissante est représenté, non pas par une droite ab, mais bien par une courbe ondulée rpq. Les lignes telles que mn, ab, représentent le mouvement moyen du phénomène. C'est ce mouvement que nous nous proposons d'étudier maintenant (§1718).
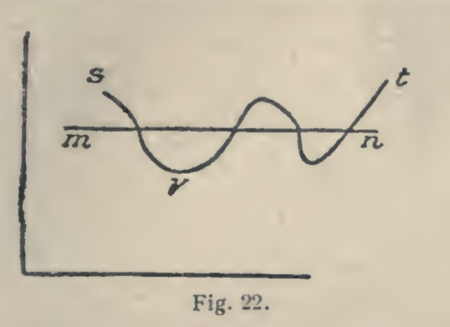
Figure 22
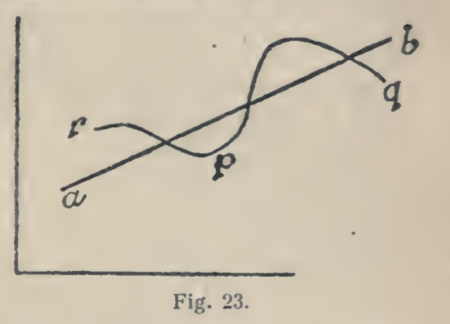
Figure 23
§ 1695. RÉPARTITION ET CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION D'UNE SOCIÉTÉ. Ici, nous ne recherchons pas quelles causes déterminent le caractère d'une société : si c'est la race, le climat, la position géographique, la fertilité du sol, la productivité économique, etc. Nous étudions les sociétés historiques en tant que faits, sans vouloir, pour le moment, remonter aux origines. Dans ces sociétés historiques, nous observons des phénomènes qui, au fond, varient peu, tandis que leur forme varie beaucoup. Par exemple, les différentes religions qui se succèdent peuvent revêtir des formes aussi diverses que l'on voudra, mais en fin de compte, elles sont des manifestations de sentiments religieux qui varient peu. On peut en dire autant des différentes formes de gouvernement ; elles ont chacune leur propre « droit divin », explicite ou implicite [FN: § 1695-1]. Le libre-penseur moderne impose, au nom de la déesse Science, une morale qui diffère peu de celle que le Dieu des Israëlites donna à son peuple, ou de celle que le peuple chrétien reçut de son Dieu, ou de celle que plusieurs peuples de l'antiquité reçurent des dieux ou de législateursdivins ou légendaires. Les dérivations par lesquelles on justifie le caractère impératif et absolu de toutes ces morales ne varient pas beaucoup non plus.
Même en des phénomènes beaucoup moins importants, on observe de semblables uniformités. Par exemple, aux malades qui, pour recouvrer la santé, affluaient dans les temples d'Esculape, se sont substitués, au moyen âge, des fidèles qui demandaient la santé aux saints, visitaient leurs lieux sacrés et leurs reliques, et ont aujourd'hui des descendants parmi les fidèles qui se rendent à Lourdes, ou parmi les adeptes de la Christian Science [FN: § 1695-2], ou aussi parmi ceux qui remplissent la bourse de quelque charlatan. Nous n'avons pas de statistiques précises qui nous fassent connaître le nombre de ces personnes et, par conséquent si et comment leur proportion a varié par rapport à l'ensemble des habitants ; mais il est certain que cette proportion a été et demeure considérable ; qu'elle n'était pas et n'est pas petite ; et que, si l'on peut admettre comme probable qu'elle ait diminué des temps passés aux nôtres, toute preuve certaine de ce fait nous manque. Ne pouvant avoir le plus, nous devons nous contenter du moins, qui est, après tout, toujours mieux que rien.
§ 1696. Aux phénomènes rappelés tout à l'heure, il faut en ajouter d'autres analogues. Dans les temples d'Esculape, la thérapeutique ne consistait pas exclusivement en opérations surnaturelles ou, si l'on veut, de suggestion : souvent elle était, en partie du moins, matérielle, et par conséquent d'ordre médical. À ce point de vue, si nous voulons prendre comme terme de comparaison les cures de Lourdes, celles de la Christian Science et celles d'autres sectes semblables [FN: § 1696-1], il semble que l'on ait rétrogradé dans la voie qui aboutit à une augmentation de l'élément scientifique, car, à Lourdes et chez les adeptes de la Christian Science, tout traitement médical a disparu ; il est même fortement blâmé par les Scientistes. Mais il faut aller plus loin, et ajouter encore les traitements que l'on opérait autrefois, en très grand nombre, par la magie, par les reliques et par d'autres moyens fantaisistes, qui feraient pencher en faveur d'une conclusion opposée à la précédente.
§ 1697. On remarquera encore que les cures des temples d'Esculape ne sont pas remplacées exclusivement, de nos jours, parcelles de Lourdes, par celles de la Christian Science, ou par d'autres semblables, mais que, parmi elles, il faut ranger aussi celles de nombreux médecins que, par un heureux néologisme, Daudet a nommés les morticoles [FN: 1697-1]. On remarquera aussi que la crédulité ancienne a exactement son parallèle dans la crédulité moderne [FN: 1697-2]. En aucun temps, les thaumaturges ne se sont enrichis comme aujourd'hui aux dépens des naïfs, et en beaucoup de pays, la loi protège ces ministres de la déesse Science autant et plus que n'ont été protégés, en d'autres temps, les ministres des dieux païens. Dans les cliniques, dans les lieux de cure, qui sont les temples du thaumaturge, les fidèles accourent en grand nombre. Certains d'entre eux guérissent, si la bonne mère Nature les regarde d'un œil favorable, tandis que tous contribuent à enrichir le prêtre de la déesse et ses acolytes, parmi lesquels il ne faut pas oublier le pharmacien, qui fait payer cent ce qui coûte un, ni l'inventeur de spécialités médicinales, lesquelles passent comme des météores, guérissent pendant un temps plus ou moins long, souvent très court, puis disparaissent, mais laissent riche l'heureux spéculateur sur la crédulité d'autrui, qui exploite le bon public avec la complicité du législateur. Aucun fait, pour évident et manifeste qu'il soit, ne peut ouvrir les yeux des exploités.
On accusait autrefois les confesseurs d'extorquer des legs aux moribonds, en les menaçant des châtiments éternels. Aujourd'hui, les thaumaturges font mieux encore : ils exploitent aussi les héritiers, en leur envoyant un compte hyperbolique d'honoraires, persuadés que, pour éviter un procès et l'accusation d'ingratitude envers le défunt, les héritiers préféreront payer. Il ne faut pas se dissimuler non plus qu'afin de capter la bienveillance des humanitaires, et pouvoir, avec leur appui, continuer de telles extorsions, ces nouveaux saints hommes soignent gratuitement les pauvres, de même qu'autrefois les saints religieux servaient aux pauvres gens, devant les portes des couvents, de grandes marmites de soupe. On se moqua de cette charité, lorsque la foi vint à diminuer. Aujourd'hui, la foi aux nouveaux thaumaturges est encore si vive qu'elle ne laisse pas de place à de semblables moqueries [FN: § 1697-3].
Connaissant l'absolu, le prêtre voulait l'imposer. Nonobstant les continuels démentis de l'expérience, plusieurs de nos docteurs s'imaginent que leur science est parvenue à une certitude dont elle est, au contraire, bien éloignée [FN: 1697-4]. Ils veulent imposer aux populations qui regimbent leurs présomptueuses volontés d'aujourd'hui, qui ne sont pas celles d'hier, qui ne seront pas celles de demain. Au XVIIIe siècle, en Italie et en France, le directeur spirituel régnait ; aujourd'hui, certains docteurs ont pris sa place. Comme d'habitude, dans l'une et l'autre de ces superstitions, les hommes faibles et les femmes mordent plus facilement à l'hameçon. Il y avait alors des directeurs spirituels, semblables aux directeurs médicaux d'aujourd'hui qui tyrannisent les familles, y sèment la zizanie, les ruinent. Là où la persuasion ne réussit pas, la force de la loi y supplée. Les religieux catholiques défendaient à leurs sujets de manger de la viande en carême, et faisaient payer les dispenses de cette obligation. Nos directeurs hygiéniques défendent à leurs sujets, en plusieurs pays, de boire du vin ou d'autres boissons alcooliques, excepté comme remèdes dont ils sont les dispensateurs exclusifs, non sans quelque profit pécuniaire qui dépasse souvent de beaucoup celui qu'obtenaient les religieux des temps passés [FN: § 1697-5]. L'Église se mêlait de prohiber ou de permettre les mariages, et se faisait payer les dispenses dans les cas prohibés. Aujourd'hui, certains humanitaires proposent d'empêcher que l'on puisse se marier sans un certificat médical, ce qui ouvrirait aux directeurs hygiéniques une nouvelle source de profits pécuniaires... et aussi d'autres avantages, lorsque les futures épouses seraient jeunes et attrayantes.
§ 1698. On pourrait citer un grand nombre d'autres faits semblables. Tous montrent que des superstitions qu'on croirait facilement avoir disparu se sont, au contraire, transformées, et subsistent toujours sous une autre forme. Par exemple, du moyen-âge à notre époque, le rôle de la magie dans la vie des sociétés a diminué d'importance, même si l'on tient compte de ce qu'en ont hérité les somnambules, les spirites, les télépathistes et autres thaumaturges [FN: § 1698-1]. Mais le domaine dont la magie était chassée a été partiellement occupé par la déesse Science. D'une manière générale, dans le domaine des arts et des sciences, l'évolution a certainement eu lieu dans le sens d'un accroissement d'importance de la science expérimentale ; mais le fait d'une semblable évolution est moins certain, si l'on considère le domaine de la politique et de l'organisation sociale. Il convient de remarquer que les simples combinaisons étrangères à l'expérience scientifique sont bien loin d'avoir disparu de la vie des sociétés ; tout au contraire, elles subsistent en grand nombre et sont prospères et florissantes. Comme les résidus du genre (I-δ) correspondent à ces combinaisons, au moins en grande partie, on peut dire que, dans son ensemble, ce genre a changé beaucoup moins qu'il ne semblait à première vue.
§ 1699. Ajoutons que la même science expérimentale tire son origine de l'instinct des combinaisons et correspond à des résidus de la IIe classe. C'est ce qu'elle a de commun avec les divagations de la magie et d'autres doctrines fantaisistes. Celui qui n’y prend pas garde pourrait croire que la Ie classe entière a subi un accroissement considérable, des temps passés aux nôtres, et a refoulé les résidus de la IIe classe. Cet accroissement existe certainement, mais une étude attentive le fait reconnaître moindre qu'il ne paraît. Les combinaisons de la science expérimentale se sont énormément accrues du passé à nos jours ; mais elles ont occupé, en grande partie, le domaine tenu autrefois par les combinaisons de l'empirisme, de la magie, de la théologie, de la métaphysique. Au point de vue de l'utilité sociale, ce déplacement des combinaisons est très avantageux ; mais au point de vue du rôle que les résidus jouent dans les actions humaines, la compensation qui s'est établie est manifeste, de sorte que la somme totale a changé beaucoup moins que les deux parties dont elle se compose ; et si l'on considère la Ie classe dans soli ensemble, on verra qu'au fond elle varie peu et lentement.
§ 1700. On peut émettre des considérations semblables pour les autres classes. Voyons, par exemple, la IIe classe (persistance des agrégats). On y trouve un genre (II-β) qui n'a pas disparu. Au contraire, c'est grâce à l'observation des faits contemporains qu'au chapitre VI nous avons pu le dégager des dérivations qui le masquaient autrefois. Mais il n'est pas douteux qu'à notre époque il joue un rôle beaucoup moins important qu'en des temps reculés, lorsque nos ancêtres gréco-latins n'avaient presque aucun autre culte que celui des morts, ou bien quand, au moyen âge, le principal souci des vivants semblait être de fonder des messes pour les morts. On peut, par conséquent, affirmer en toute sécurité que l'importance des résidus du genre (II-β) a beaucoup diminué depuis les temps passés jusqu'à nos jours.
§ 1701. Mais il est remarquable que cette diminution a été, au moins en partie, compensée par des accroissements des autres genres de la même classe. Celle-ci n'a donc pas beaucoup changé, dans son ensemble. Les dieux du polythéisme gréco-latin conquirent peu à peu le domaine laissé libre par le culte des morts ; et, à leur tour, ils furent dépossédés par les divinités et par les saints du christianisme [FN: 1701-1]. Au XVIe siècle, la Réforme fit une guerre implacable au culte des reliques, et surtout à celui que l'Église romaine vouait à l'allégement des châtiments des morts ; mais, au fond, elle y substitua d'autres persistances d'agrégats. Sous la domination de Calvin, on jouissait de beaucoup moins de liberté, on était soumis à beaucoup plus de règles dictées par des considérations ultra-expérimentales, à Genève qu'à Rome sous la domination des papes ; et, somme toute, le protestantisme fut beaucoup plus strict, beaucoup plus oppressif que là religion catholique, dans les pays où il s'y substitua, tandis que même la religion catholique, poussée par la guerre qu'on lui faisait, devint plus restrictive, moins indulgente, plus envahissante. En somme, à Rome, sous Léon X et avant Luther, il régnait une liberté de pensée qui disparut dans les pays protestants, et ensuite dans les pays catholiques aussi. Les admirateurs même du protestantisme disent qu'il accrut la « religiosité » ; ce qui revient à dire qu'il accrut l'importance des résidus de la IIe classe.
§ 1702. Un grand nombre d'autres observations confirment ces déductions. Celui qui porte son attention principalement sur la forme logique perçoit de très grandes différences entre diverses religions qui sont opposées ; tandis que celui qui porte son attention principalement sur les sentiments, y découvre des formes diverses d'un même fond. En Europe, dans la seconde moitié du XIXe siècle, le socialisme se développa, refoulant une partie des religions existantes, ainsi la religion catholique et le nationalisme, en assimilant d'autres, ainsi l'humanitarisme et le christianisme dit « libéral », bien qu'il soit peu chrétien [FN: § 1702-1] et pas du tout libéral. Puis, vers le commencement du XXe siècle, eut lieu un retour offensif des religions différentes du socialisme [FN: § 1702-2] ; la marée positiviste humanitaire redescendit un peu, et le sentiment religieux socialiste recula. Les religions accessoires telles que le libéralisme [FN: § 1702-3], l'humanitarisme, le tolstoïsme, etc., reculèrent aussi, et même davantage, tandis que se renforçait notablement le nationalisme, que prospérait le catholicisme, que cessait l'éclipse subie par les diverses métaphysiques, et que même la magie et l'astrologie recommençaient à se développer [FN: § 1702-4].
§ 1703. Les différences d'intensité qu'on observa dans la faveur croissante du public pour une partie de ces dérivations, et la faveur décroissante pour une autre partie, sont un indice certain des différences d'intensité des résidus auxquels elles correspondent. Vers 1913, on vit cela clairement en Italie, où la rapide montée de la marée nationaliste alla de pair avec un déclin non moins rapide de la foi socialiste. Le mouvement se produisit en France aussi ; la marée de la foi nouvelle était occasionnée non seulement par le nationalisme, mais aussi, bien qu'en petite partie, par la vigueur nouvelle du catholicisme. En Allemagne aussi, le socialisme déclina quelque peu [FN: § 1703-1]. En Angleterre, il est de même arrivé que l'avance d'une des religions sociales a été compensée par le recul d'une autre, ou de plusieurs autres ; mais en ce pays, c'est le socialisme qui a avancé ; c'est le nationalisme et le libéralisme qui ont reculé. Comme le mouvement actuel, en Angleterre, a lieu en partie, c'est-à-dire pour le nationalisme, dans une direction contraire à celle du mouvement général des peuples européens, il se pourrait qu'il ne durât pas longtemps. La transformation du Japon au XIXe siècle est très remarquable [FN: § 1703-2]. Les dérivations ont changé ; demeurent les sentiments, les résidus, qui s'expriment en partie diversement. La IIe classe (persistance des agrégats) est peu ou point changée, mais les genres ont subi des variations souvent considérables.
§ 1704. Il est important de considérer l'exemple de l'Italie, rappelé plus haut ; ce n'est pas à cause de l'ampleur et de l'intensité du mouvement, car, dans l'histoire, nous en avons un grand nombre d'autres d'une ampleur et d'une intensité bien plus considérables ; c'est parce que, ce mouvement avant eu lieu sous nos yeux, nous en pouvons mieux connaître la nature. Ici, nous ne recherchons pas quel rôle ont pu jouer, dans le mouvement, les artifices politiques et financiers, et pas davantage si et comment les sentiments ont crû comme de faibles petites plantes arrosées par la bienfaisante rosée politique et financière. Nous reviendrons sur ce sujet au chapitre XII. Ici, nous considérons les sentiments déjà existants, et nous recherchons uniquement comment a varié la répartition des résidus de la IIe classe, et comment le phénomène fut en partie masqué par le voile des dérivations. Sur ce dernier point, nous ajouterons d'autres considérations à celles qui ont été faites précédemment (§1559 et sv.). Dès 1908, on pouvait voir se dessiner le mouvement qui apparut ensuite clairement en 1911. Alors, la religiosité d'un grand nombre de socialistes, de libéraux, d'humanitaires, de tolstoïens, etc., prit la forme de religiosité nationaliste et belliqueuse. Nous avons un signe, qui n'est pas négligeable, de la décadence du sentiment socialiste chez ses chefs, dans le fait qui se produisit lorsque, le 23 février 1912, la Chambre approuva le décret d'annexion de la Libye. À l'appel nominal, 38 députés, dont 33 socialistes, émirent un vote défavorable. Au scrutin secret, ils ne furent que 9. Par conséquent, un certain nombre d'entre eux avaient une foi socialiste ou nationaliste si faible, qu'ils pouvaient émettre des votes contraires lors de la votation publique et de la votation secrète [FN: § 1704-1]. Cela rappelle l'observation de Machiavel, que : « les hommes savent très rarement être tout bons ou tout mauvais ».
§ 1705. La transformation de la religiosité pacifiste en religiosité belliqueuse fut très remarquable, à cause du contraste qu'elle présentait.
Ne fussent les conditions sanitaires de l'Italie, qui empêchèrent les pacifistes étrangers de venir à Rome au congrès de la paix que leurs coreligionnaires italiens s'obstinaient à vouloir assembler, tandis qu'on préparait l'expédition de Tripoli, ce congrès de la paix aurait eu pour principal thème les louanges que les pacifistes italiens [FN: § 1705-1], à peu d'exceptions près [FN: § 1705-2], s'apprêtaient à donner à la guerre.
§ 1706. Comme d'habitude, et à l'instar des exemples si nombreux que nous avons vus, les dérivations vinrent à la rescousse pour démontrer qu'en ce cas spécial, la guerre ne répugnait nullement aux doctrines pacifistes générales. C'est là un des cas très nombreux dans lesquels apparaît nettement le caractère accessoire des dérivations, qui ne déterminent pas les événements, mais sont, au contraire, déterminées par eux, ainsi que la fable bien connue du loup et de l'agneau en donne un exemple depuis des temps très reculés.
§ 1707. La guerre était déterminée par un ensemble d'intérêts et de sentiments semblables à ceux qui, depuis un siècle au moins, ont déterminé les guerres coloniales de tous les grands états européens, et l'Italie ne faisait que suivre et encore de loin tant d'autres pays, sur la voie qu'ils avaient largement ouverte. Elle n'aurait peut-être pas pu s'en abstenir sans courir de graves dangers. Si l'on avait simplement dit cela, on aurait exprimé les causes réelles de l'événement. Mais on voulut recourir à des dérivations qui satisfissent les sentiments correspondant aux résidus de la IIe classe.
§ 1708. 1° D'abord les sentiments de justice. L'ultimatum du marquis de San Giuliano relevait des injustices commises par la Turquie au détriment de l'Italie ; par exemple, qu'une jeune fille italienne avait été enlevée, disait-on. La conclusion logique eût été d'exiger réparation de ces injustices, que cette jeune fille fût rendue aux autorités italiennes. Au contraire, par un raisonnement très spécial, la conclusion était que l'Italie devait s'emparer de Tripoli, et la jeune fille enlevée, après avoir servi de prétexte, disparaissait, et l'on ne parlait plus d'elle.
2° Puis vinrent au bon moment les atrocités que les combattants turco-arabes commirent, dit-on, sur les morts, les blessés, les prisonniers italiens. Mais, en bonne logique, la cause doit précéder l'effet ; et il est étrange de donner pour cause d'une guerre des faits arrivés depuis cette guerre, et qui en sont une conséquence.
3° On disait aussi que l'Italie devait délivrer les Arabes de l'oppression des Turcs. Il est vrai que les Arabes ne voulaient pas être délivrés ; mais cela importait peu ou point ; ils devaient, de vive force, être « délivrés ». Pour conquérir la Grèce, la Rome ancienne trouva le prétexte de « délivrer » les Grecs. La Rome moderne, beaucoup plus modeste, se contentait de « délivrer » les Arabes tripolitains. Les sophismes et les dérivations ont la vie très longue.
4° Subsidiairement, on recourut quelque peu aux sentiments de l'intégrité nationale. Un décret ayant uni la Tripolitaine et la Cyrénaïque à l'Italie, les Arabes qui ne voulaient pas se soumettre étaient des « rebelles ». On peut être pacifiste et demander que l'on étouffe la « rébellion ».
5° On fit aussi une légère allusion aux sentiments chrétiens. Mais on ne tarda pas à abandonner cette voie dangereuse, qui pouvait conduire à donner à la guerre un caractère de conflit entre le christianisme et l'islamisme.
6° Un argument plus important fut le recours aux sentiments religieux d'aujourd'hui. Si, dans le passé, on opposait la religion du Christ à celle de Mahomet, de nos jours et de la même façon, on oppose la religion du saint Progrès et de la très sainte Civilisation, à la superstition de l'immobilité et de la barbarie. Les pacifistes rénovèrent la vieille théorie suivant laquelle les peuples chrétiens ne devaient pas se faire la guerre entre eux, et ne devaient combattre que les infidèles [FN: § 1708-1]. Ils nous disent qu'ils voulaient la paix entre les nations civilisées, mais non entre celles-ci et les nations barbares. La nouvelle théorie est beaucoup moins précise que l'ancienne, car enfin il est facile de savoir si une nation est chrétienne ou non, au moins dans la forme. Mais comment faire pour savoir si elle est civilisée, et surtout si elle atteint le point de civilisation nécessaire pour avoir la paix et non la guerre ? La Post de Berlin voudrait que l'Allemagne s'emparât des colonies du Portugal, pour y substituer la civilisation germanique saine à la civilisation latine corrompue. Beaucoup d'Allemands croient fermement qu'il existe une seule civilisation, la germanique, et que le reste est barbarie. Devons-nous accepter cette théorie ? Qui tranchera cette question ardue ? Elle n'est nouvelle que de forme. Le fond se trouve déjà dans la demande qu'en une nouvelle de Boccace, Saladin adresse au Juif Melchisédeck : « J'aimerais assez que tu me dises laquelle des trois lois tu tiens pour la vraie, de la judaïque, de la sarrasine ou de la chrétienne ». Le Japon est-il civilisé ou barbare ? Est-il permis ou non, suivant la doctrine pacifiste, de lui faire la guerre ? Les difficultés croissent pour les puissances qui englobent diverses nations réputées les unes civilisées, les autres barbares. La France est certainement une nation civilisée. Perd-elle cette qualité à cause de ses possessions africaines et asiatiques ? Et l'Angleterre ? Et la Russie ? Il est évident que la théorie invoquée dans un but de discussion n'est ni vraie ni fausse : elle n'a tout simplement aucun sens.
7° On ne découvre pas beaucoup plus de sens à cette belle trouvaille des pacifistes, qui nous présentent leur paix comme devant exister seulement entre les nations européennes et, supposons-nous, aussi entre les nations américaines. Cette épithète d'européennes se rapporte-t-elle à la race ou au territoire ? Si elle se rapporte à la race, la guerre de l'Italie contre la Turquie se justifie, il est vrai ; mais une guerre contre les Magyars ou contre les Russes parmi lesquels se trouvent tant de Tartares, se justifierait également ? Si l'épithète se rapporte au territoire, la Turquie a un territoire en partie européen, en partie asiatique, ainsi que l'Angleterre, la Russie et d'autres nations ; la théorie pacifiste finit alors par ne plus s'appliquer à aucun peuple. Négligeons aussi de moindres considérations, comme celles de la fatalité historique de l'ancienne domination de Rome en Afrique, et d'autres qui empruntent leur forme à semblable rhétorique.
§ 1709. L'une des plus belles trouvailles, parmi tant d'autres, est celle selon laquelle le pacifisme aurait pour règle qu'on peut faire la guerre chaque fois qu'on l'estime utile à sa patrie. Si l'on admet cela, il sera bien difficile de trouver dans le monde quelqu'un qui ne soit pas pacifiste ; car enfin, qui est assez dénué de bon sens pour dire : « Je désire la guerre, parce que je crois qu'elle sera funeste à ma patrie ? » Et qui dira pourquoi, si les nationalistes du pays A ont le droit de faire la guerre, ceux du pays B n'auraient pas également ce droit ? Et si on l'accorde à tous, quel but peut bien avoir le pacifisme ? Ces excellents pacifistes n'en finissaient plus de louer l'arbitrage et les congrès de La Haye, qui prescrivaient d’avoir recours à cet arbitrage avant de se mettre en guerre ; et puis ils approuvèrent leur gouvernement, lequel ne s'en soucia en aucune façon. Ainsi, que devient la « Paix par le droit » ? Pour résoudre le problème qui divise les pacifistes et les non-pacifistes, il ne s'agit pas de savoir si l'on doit faire ce qui est utile on nuisible à sa patrie. Il s'agit de savoir si la guerre est toujours nuisible, excepté dans le cas de défense de son propre territoire, ainsi que l'affirment les pacifistes qui ne sont pas italiens, et comme l'affirmaient aussi ceux qui sont italiens, avant la guerre pour la conquête de Tripoli ; ou bien si la guerre, même de conquête, peut être parfois utile, ainsi que l'affirment les adversaires des pacifistes. De même, il s'agit de savoir si, comme l'affirment les pacifistes, les règles du « droit » suffisent à résoudre les conflits internationaux, ou bien si, comme l'affirment les non-pacifistes, la guerre est parfois indispensable. Si l'on admet que celle-ci peut avoir lieu chaque fois qu'une nation la préfère à l'arbitrage, il est impossible de trouver quelqu'un qui ne soit pas pacifiste. Ajoutons, pour montrer l'absolue vanité des motifs invoqués pour justifier la guerre de Libye, que sitôt la victoire obtenue, on ne se soucia plus de ces motifs ou prétextes. On disait que la guerre était entreprise en vertu d'un sentiment de justice, pour réparer les offenses dont des citoyens italiens avaient été victimes. Aucune de celles-ci ne fut réparée. Bien plus, les nouvelles et beaucoup plus graves offenses résultant de l'expulsion des Italiens du territoire turc demeurèrent sans réparation. Les sentiments de pitié pour les peuples opprimés par les Turcs, très vifs en faveur des Arabes, auxquels il plaisait d'être « opprimés » par les Turcs, ne s'étendirent pas aux peuples chrétiens qui voulaient se soustraire au joug des Turcs ; et l'Italie fit la paix juste au moment qui put être profitable à la Turquie contre ces peuples. Quant aux saints Progrès, Civilisation et autres analogues, le gouvernement italien ne s'en soucia plus, à moins que l'on ne veuille affirmer que dans la guerre entre la Turquie d'une part et les peuples balkaniques et helléniques de l'autre, le saint Progrès et la très sainte Civilisation étaient du côté de la Turquie. Enfin si, dans son conflit avec l'Italie, la Turquie devait être considérée comme nation non-européenne, à laquelle il était par conséquent licite de faire la guerre, tout à coup par un tour de passe-passe, elle sembla se transformer en nation européenne, dans son conflit avec la Bulgarie, la Serbie, le Monténégro et la Grèce ; et l’on ne devait donc pas lui faire la guerre. En vertu d'une telle transformation, on conclut la paix au plus tôt.
§ 1710. Toutes ces dérivations si peu logiques, et parfois même ridicules, aboutissent au même point. Il est donc évident qu'on les a émises en vue de la conclusion qu'on en voulait tirer, et non pas que, trouvées indépendamment de la conclusion, celle-ci en est résultée. C'est pourquoi nous voyons, comme en tant d'autres cas semblables, que ces dérivations sont seulement l'accessoire, et que le principal gît dans les sentiments et dans les intérêts dont provient la conclusion, que l'on tente a posteriori de justifier par les dérivations. Ainsi disparaît la diversité que celles-ci paraissent manifester, et qui n'est qu'apparente. Le fond demeure ; il est beaucoup plus constant : c'est la réalité. D'une façon générale, il arrive souvent qu'en public les hommes politiques attribuent à leurs actes des causes qui ne sont pas les véritables. Cela arrive surtout quand ils donnent des règles générales comme étant ces causes [FN: § 1710-1) (§1689).
§ 1711. En ce qui concerne le degré plus ou moins grand de résistance opposée par les diverses formes de religiosité à la vague nationaliste qu'on observa en Italie, dans l'année 1911, il faut remarquer que, parmi les socialistes, bon nombre restèrent fidèles à leurs doctrines opposées aux guerres bourgeoises. De même, presque tous les mazziniens restèrent rigidement opposés à ce qu'ils estimaient être une guerre monarchique ; tandis qu'un très grand nombre de pacifistes italiens se firent belliqueux ; que les humanitaires, les tolstoïens se tapirent, disparurent, s'évanouirent. Il convient donc aussi de disposer en ce même ordre de degré de résistance des différents partis, la force des croyances, au moins en Italie et dans le temps présent. Peut-être l'ordre ne serait-il pas très différent pour d'autres pays.
§ 1712. Dans la IIIe classe des résidus, les actes du culte de la religion chrétienne ont diminué, chez les peuples civilisés modernes, mais ont été partiellement remplacés par des actes du culte des saints socialistes, des saints humanitaires, et surtout du culte de l'État et du dieu Peuple. On ne voit pas quelle différence fondamentale il y a entre les fêtes d'un saint catholique et les fêtes du bicentenaire de Rousseau, pour lesquelles l'État français inscrivit trente mille francs à son budget.
Il est naturel que, pour l'humanitaire, le saint catholique est une vieille baderne, et Rousseau un homme éminent ; tandis que, pour le catholique, les rôles sont intervertis. Mais cette différence dans les jugements fait précisément voir la ressemblance des sentiments qui animent l'humanitaire et le catholique. Les processions catholiques ont presque disparu, mais ont été remplacées par les « cortèges » et par les « manifestations » politiques et sociales. Les protestants ne vont pas à la messe comme y vont les catholiques ; mais ils se rendent à des réunions de prières de leur religion, parfois très bruyantes, comme le sont celles des « réveils ». On les trouve avec les libres-penseurs dans les réunions des spirites, tandis que les Anglais et les Américains psalmodient à qui mieux mieux. Pour beaucoup de ceux qui s'écartent de la religion chrétienne, l'enthousiasme chrétien s'est changé en enthousiasme « social », ou « humanitaire », ou « patriotique », ou « nationaliste » ; il y en a pour tous les goûts. Le dieu Peuple n'a plus un athée. On peut, de même que pour tout autre dieu, différer sur la manière de l'adorer, mais non sur le devoir de l'adorer. Et qui donc n'éprouve pas le besoin de proclamer qu'on doit tout sacrifier au bien du peuple ? En paroles, cela s'entend, car pour les actes, souvent il en est autrement. Tous les partis rivalisent pour se prosterner devant le Peuple, et les Chevaliers d'Aristophane figurent également bien les faits d'Athènes et ceux auxquels nous assistons aujourd'hui. Il n'est pas un réactionnaire, quelque excessif qu'il soit, qui ose dire du mal du dieu Peuple ; seul un esprit bizarre comme celui de Nietzsche se le permit, et il apparaît comme l'exception qui confirme la règle [FN: § 1712-1]. Les hommes de science qui, dans leur for intérieur, se rendent compte de la vanité de la nouvelle religion, dissimulent l'athéisme, comme le dissimulaient déjà leurs prédécesseurs, lorsque c'était un délit de mettre en doute la « vérité » de la religion chrétienne ; ils parlent des « abus » de la démocratie, comme on parlait en d'autres temps des « abus » du clergé.
En conclusion, les formes des résidus de la IIIe classe peuvent avoir beaucoup changé, mais le fond a varié beaucoup moins, surtout si on le considère dans son ensemble.
§ 1713. Pour la IVe classe, on pourrait croire qu'il y a eu une forte augmentation, en même temps qu'une non moins grande diminution des résidus de la Ve classe. Pour beaucoup de personnes, c'est un article de foi que, de nos jours, la « sociabilité » s'est beaucoup accrue, tandis que « l'individualisme » diminuait. Mais, au fond, il n'en est pas ainsi, et le changement est souvent exclusivement formel. Par exemple, le sentiment de la subordination qui, dans les temps passés, se manifestait par la sujétion des classes inférieures par rapport aux classes supérieures, se manifeste aujourd'hui pour les classes inférieures par un assujettissement aux chefs de grèves, de syndicats, de partis [FN: § 1713-1], et, pour les classes supérieures, par une soumission à la plèbe, qui est aujourd'hui adulée comme ne le fut jamais aucun roi absolu des siècles passés [FN: § 1713-2]. En ces temps-là, les rois essuyaient parfois de vertes admonestations des papes ; ils éprouvaient aussi de l'opposition de la part de leur noblesse ; tandis qu'aujourd'hui personne n'a la hardiesse de blâmer « le peuple », et encore moins de lui résister ouvertement ; ce qui n'empêche pas que les politiciens le gouvernent, le trompent, l'exploitent, de même qu'autrefois les sycophantes et les démagogues exploitaient Démos à Athènes, de même qu'en des temps plus rapprochés de nous, les courtisans tiraient profit de leurs maîtres [FN: § 1713-3]. En de nombreux parlements, il n'est pas difficile d'apercevoir, sous des dérivations politiques, le fond des intérêts privés par lesquels l'organisation se maintient. Le fait est bien connu ; on peut le constater en de nombreuses publications de divers genres [FN: § 1713-4]. De ces publications sous forme de livres, d'opuscules, de revues et de journaux, on pourrait Composer une grande bibliothèque. Mais les plus importantes sont les publications officielles des enquêtes parlementaires, très difficiles à se procurer, et que personne ne lit, mais qui pourront servir à l'historien futur pour répéter le mot sur Rome que Salluste met dans la bouche de Jugurtha [FN: § 1713-5]. De temps en temps éclate un « scandale », comme celui des banques en Italie, du Panama en France. On fait une enquête qui, à défaut d'autre chose, sert à faire croire au public que c'est une exception, alors qu'au contraire c'est la règle ; puis les eaux agitées reprennent leur tranquillité accoutumée ; et comme les forces constantes finissent par l'emporter sur les forces temporaires, les politiciens se remettent à leurs manœuvres usitées, et le cas n'est pas rare de voir que l'un d'eux, sévèrement frappé à la suite d'une enquête, soit de nouveau ministre et devienne même le maître du pays [FN: § 1713-6], tandis que les opérations dites de « sauvetage » accroîtront le pouvoir de ceux qui tiennent le couteau par le manche.
En général, les partis d'opposition reprochent ces faits aux hommes qui sont au gouvernement, et croient avoir ainsi démontré qu'il serait utile au pays de les chasser du pouvoir. Les amis des gouvernants nient, s'efforcent de trouver des circonstances atténuantes, et, avec plus de succès, tâchent de faire tomber ces faits dans l'oubli. Les gens experts en l'art de gouverner reconnaissent, lorsqu'ils se trouvent dans l'intimité, la vérité des faits, mais ils ajoutent que cela n'ôte rien à l'utilité qu'il y a à ce que leurs amis demeurent au pouvoir [FN: § 1713-7]. Inutile d'ajouter que, lorsque les hommes de l'opposition arrivent au pouvoir, et que ceux du gouvernement passent à l'opposition, les raisonnements s'intervertissent aussi avec les rôles. Il se peut que tout cela soit utile, comme ayant pour effet de maintenir vifs certains sentiments qui profitent à la société ; mais c'est un sujet dont il n'y a pas lieu de nous occuper ici (§2140) ; nous avons seulement voulu rappeler que nous recherchons ici exclusivement comment varient certains résidus, et l'on ne doit donc pas attribuer à nos observations plus de portée qu'elles n'en ont dans ce sujet restreint, et entendre, même implicitement, que, au point de vue de l'utilité sociale, elles condamnent ou approuvent les faits relevés. (§41) Il s'agissait uniquement de faire voir que les raisonnements dont on veut les recouvrir sont comme d'habitude du genre des dérivations.
§ 1714. Nous avons aujourd'hui, sous une forme différente, une nouvelle féodalité, qui reproduit en partie le fond de l'ancienne [FN: § 1714-1]. Aux temps de celle-ci, les seigneurs rassemblaient leurs vassaux pour faire la guerre et, s'ils remportaient la victoire, ils les récompensaient par le butin. Aujourd'hui, les politiciens, les chefs des syndicats, agissent de la même façon, et rassemblent leurs troupes pour les élections (§2265), pour accomplir des actes de violence contre leurs adversaires et gagner de cette façon des avantages dont jouit ensuite le camp victorieux. Autrefois, les vassaux qui refusaient de suivre leurs seigneurs à la guerre étaient punis, de même que le sont aujourd'hui les kroumirs, les jaunes, les brebis noires des Anglais, les renards des Français, lorsqu'ils refusent de prendre part à une guerre industrielle. Le sentiment que provoque la « trahison » de ces insoumis, chez les troupes fidèles, est précisément le même que celui éprouvé par les hommes du moyen âge pour la félonie du vassal. Les privilèges dont les nobles jouissaient en ce temps ont leurs correspondants dans les privilèges judiciaires, fiscaux [FN: § 1714-2] et autres dont jouissent maintenant les députés et, dans une mesure restreinte mais non négligeable, leurs électeurs aussi, s'ils sont du côté du gouvernement.
§ 1715. Autrefois, le besoin d'uniformité se manifestait en certaines choses ; aujourd'hui, il se manifeste en d'autres, mais il est cependant toujours le même. Le besoin d'uniformité à l'égard de la religion chrétienne a diminué et a même presque disparu en certains pays, tandis que le besoin des uniformités économiques, sociales, humanitaires, croissait et devenait prédominant. Les hommes du moyen-âge voulaient l'unité religieuse et admettaient les statuts personnels et différents régimes pour les diverses communes ou provinces d'un même état ; les hommes modernes laissent pleine liberté de différences religieuses, mais veulent, au moins en paroles, l'uniformité des statuts des personnes, des communes, des provinces. Il était défendu à l'ancien Athénien d'introduire de nouveaux dieux dans la cité ; mais il lui était permis, à part certaines prescriptions religieuses, de travailler quand et comment il lui plaisait. Aujourd'hui, en beaucoup de pays, la loi ne se soucie plus des dieux nouveaux, mais fixe rigoureusement les jours et les heures auxquels il est permis de travailler. L'ancien Romain devait respecter le culte officiel, mais pouvait boire du vin ; aujourd'hui, en plusieurs pays, le culte officiel n'existe plus, ou bien est peu protégé, mais ou interdit de boire du vin. Les inquisiteurs de la foi catholique recherchaient avec diligence les offenses à leur sainte religion ; nos abstinents et nos dominicains de la vertu recherchent avec non moins de diligence les offenses à la sainte religion de l'abstinence du vin et des femmes ; et si les effets de ces inquisitions sont différents, c'est d'abord que les temps se sont faits plus doux pour la répression de tous les délits, et que, si le désir ne manque pas aux inquisiteurs modernes, le pouvoir leur fait défaut, au moins en partie [FN: § 1715-1]. D'autre part, la police est aujourd'hui mieux faite ; aussi l'oppression a-t-elle gagné en extension ce qu'elle a perdu en intensité, et la somme des souffrances infligées de cette façon aux hommes demeure assez grande.
Selon le processus ondulatoire des phénomènes sociaux, que nous avons noté tant de fois déjà, on observe maintenant (année 1913) un retour à l'état psychique qui existait en France, quand on y faisait le procès de Madame Bovary et d'autres livres « immoraux ». En Italie, des procès de ce genre n'ont pas fait défaut de nos jours. En France, les critiques que l'on adresse maintenant à des productions littéraires estimées « immorales » rappellent, bien que dans une moindre mesure, celles qu'on adressa à La Dame aux Camélias [FN: § 1715-2]. En Angleterre, un évêque se met à critiquer les chansons de Gaby Desly, et veut qu'on interdise au public de les entendre. Au fond, c'est toujours le même sentiment d'individus qui veulent imposer à autrui par la force leur propre « morale ». Parmi ceux-là, il est beaucoup d'hypocrites, mais il y a aussi des personnes de bonne foi. L'état d'esprit de celles-ci paraît être le suivant. Elles ont en elles certaines persistances d'agrégats, si vives et puissantes qu'elles dominent entièrement leur esprit. C'est à ce phénomène qu'on donne le nom de foi. L'objet de cette dernière peut être divers ; indiquons-le d'une manière générale par A. La personne qui a cette foi attribue à A une valeur absolue, repousse de son esprit tout doute, toute considération d'opportunité, toute intromission d'autres faits entrant en ligne de compte [FN: § 1715-3]. Contraindre autrui à avoir la même foi en A, ou du moins à agir comme s'il l'avait, revient en somme à obliger les gens à faire leur propre bien et celui d'autrui ; c'est simplement une manière de donner une forme concrète au bien absolu ; Compelle intrare. En ce qui concerne le fond des phénomènes, il importe peu que A soit la foi d'Anytos et de Mélètos, ou celle de Saint-Augustin, ou celle de Torquemada, ou celle de M. Béranger, de gens cultivés, ou d'imbéciles, d'hommes d'État, ou de littérateurs, d'un grand nombre de gens, ou d'un petit nombre : il n'y a de variable que les dérivations par lesquelles on veut faire apparaître les conclusions de la foi comme des démonstrations d'une « science », laquelle n'est qu'une pure ignorance. On remarquera que le mouvement oscillatoire se produit autour d'une ligne qui indique qu'en moyenne, de nos jours, le phénomène diminue d'intensité. Nous ne sommes plus aux temps où l'on condamnait à boire la ciguë ou au bûcher les dissidents. Nos « moralistes » et nos dominicains de la vertu doivent se contenter d'infliger de moindres peines.
§ 1716. [Note ajoutée à l’édition française par l’auteur : [FN: § 1716-1a]] Si l'on compare le seigneur féodal à l'homme riche notre contemporain, on peut dire que le sentiment d'intégrité de l'individu a beaucoup diminué. Mais si l'on étend la comparaison à toutes les classes sociales, on verra bientôt que, par compensation, ce sentiment s'est grandement accrû dans les classes populaires. Celles-ci n'eurent jamais un sentiment de leur dignité tel qu'elles le possèdent aujourd'hui, pas même chez les démocraties latines et grecques, surtout si l'on y tient compte des esclaves et des affranchis. De même la protection des sentiments d'intégrité du délinquant a aujourd'hui atteint une intensité beaucoup plus grande que jamais, dans nos contrées. Pour employer la phraséologie vulgaire, nous dirons que, dans la répression des délits, on sacrifiait l’« individu » à la « société » dans les siècles passés, et que maintenant on sacrifie la « société » à l'« individu ». Alors on ne craignait pas beaucoup de frapper l'innocent, pourvu que le coupable ne pût échapper ; aujourd'hui, on ne regarde pas de si près à épargner le coupable, non seulement pour sauver l'innocent, mais encore pour satisfaire les sentiments humanitaires [FN: § 1716-1]. On voit les mêmes personnes invoquer le « droit de la société » contre l'« individu », pour dépouiller autrui de ses biens, et le « droit de l'individu » contre la « société », pour protéger le délinquant. C'est là l'un des si nombreux cas dans lesquels un même individu peut employer en même temps des dérivations contradictoires. Nous ne devons pas nous y arrêter, et il nous faut rechercher les sentiments auxquels ils servent de voile. Ici, ils sont manifestes : ce sont simplement les sentiments favorables à une certaine classe de personnes qui désirent s'emparer du bien d'autrui et commettre impunément des délits. Parfois il n'y a qu'une différence de forme. Pierre, qui appartient à la classe nombreuse des pauvres, veut s'approprier un objet qui est la propriété de Paul, lequel appartient à la classe restreinte des riches. Il peut exécuter l'opération de deux façons [FN: § 1716-2] : 1° se faire attribuer par la loi la possession de cet objet ; dans ce but il lui convient d'invoquer le droit des plus nombreux en regard des moins nombreux, ce qu'il exprime en parlant du droit de la « société » à l'égard de l'« individu » ; 2° s'emparer directement de l'objet. Mais, en ce cas, Pierre n'appartient plus à la classe la plus nombreuse de la société, mais bien à la plus restreinte. La dérivation précédente ne peut donc être employée comme avant : on peut identifier à la « société » la partie pauvre de celle-ci ; on ne peut pas, quelque grands que soient l'ignorance et le manque de bon sens avec lesquels certaines dérivations sont acceptées, identifier à la « société » la respectable classe des délinquants ; il faut donc trouver une autre dérivation qui permette d'atteindre le but. On la trouve facilement en parlant alors des « droits » de l'individu délinquant contre la société [FN: § 1716-3]. Dans le premier cas, si un innocent est frappé, on dit : « C'est un malheur, mais le bien de la société l'emporte sur tout ». Si, dans le second cas, un innocent est frappé, on dit : « On ne peut tolérer cela en aucune façon ; périsse la société, plutôt que l'innocent ». Quiconque que veut avoir des exemples pratiques de ces deux manières de raisonner, employées, bien que contradictoires, par les mêmes personnes, n'a qu'à lire les écrits humanitaires et socialistes, en France, au temps de « l'affaire Dreyfus » [FN: § 1716-4].
Nous avons trouvé les sentiments dont partent les dérivations ; mais nous ne devons pas nous en tenir là : il convient que nous voyions encore pourquoi on emploie ces dérivations et non d'autres. Ce n'est évidemment pas pour le plaisir d'employer des dérivations contradictoires qu'on fait usage des deux que nous venons de citer ; il doit y avoir quelque motif ; ce motif ne peut être que d'agir sur les sentiments de celui qui écoute la dérivation. Il est vrai qu'elle manifeste certains sentiments, mais elle a aussi pour but d'agir sur certains autres. Ici, il n'y a pas de doute quant aux sentiments sur lesquels on veut agir. Pour la première dérivation, ce sont ceux qui correspondent aux intérêts de la partie pauvre de la population, et dans ceux-là déjà, il y a une notable proportion de sentiments d'intégrité individuelle. Pour la seconde dérivation, il peut y avoir, chez certains politiciens, le désir d'obtenir la faveur de quelques délinquants [FN: § 1716-5] qui sont d'excellents agents électoraux, ou bien de gagner la faveur des parents et des amis de ces délinquants ; mais c'est là la partie la moins importante du phénomène, et si l'on use de cette dérivation, il est évident qu'elle correspond aux sentiments d'un grand nombre de personnes. Ces sentiments sont surtout ceux de l'intégrité personnelle, qu'on ne veut pas permettre d'offusquer, même chez le délinquant. On observera en outre que jamais, en aucun temps de l'histoire, il ne fut permis aux délinquants, ou pour mieux dire à certains d'entre eux, d'être insolents à l'égard des magistrats, comme ils le sont aujourd'hui. Il est des procès aux assises où les rôles du président qui interroge et de l'accusé qui répond semblent intervertis [FN: § 1716-6]. Tout cela est encore confirmé par la très grande répugnance que l'on a aujourd'hui pour les peines corporelles, qui ne sont rejetées que parce qu'elles attentent à la « dignité humaine » ou, en d'autres termes, parce qu'elles sont parmi les plus grandes offenses à l'intégrité individuelle.
En conclusion donc, si nous regardons au fond et non aux dérivations qui le recouvrent, nous voyons que, à notre époque, les résidus de la Ve classe (intégrité personnelle) ont plutôt augmenté que diminué, en comparaison des résidus de la IVe classe (sociabilité).
§ 1717. Les résidus de la VIe classe (résidus sexuels) sont peut-être les moins variables. Les voiles dont on les recouvre se transforment, l'hypocrisie qu'ils provoquent change, mais, dans le fond, on ne perçoit pas qu'ils subissent des changements importants (§1379 et sv.).
§ 1718. En somme, pour une société donnée, on peut fixer l'échelle suivante des variations, qui croissent de la première à la dernière catégorie : 1° les classes des résidus ; 2° les genres de ces classes ; 3° les dérivations. Une figure fera mieux comprendre les rapports entre les classes et les genres de résidus. Le mouvement, dans le temps, d'une classe de résidus, peut, par exemple, être représenté par la courbe ondulée MNP. Certains genres sont représentés par les courbes, ondulées elles aussi, mnpq, rsvt. Les ondulations sont plus petites pour la classe que pour beaucoup de genres. Le mouvement moyen de la classe, qui, par exemple, va en augmentant, est représenté par AB ; et pour les genres dont une partie va en augmentant, une partie en diminuant, par ab, xy. La variation représentée par AB est beaucoup moins grande que celle de plusieurs genres ab, xy. Dans l'ensemble, il y a une certaine compensation entre ceux-ci, et c'est ainsi que s'atténue, pour la classe, tant la variation représentée par AB que l'ampleur des ondes de la courbe MNP.
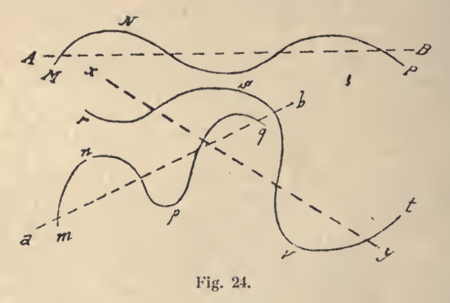
Figure 24
Pour les phénomènes sociaux, en général, l'étude de ce mouvement oscillatoire présente des difficultés, qui peuvent être graves, lorsqu'on veut se rendre compte de la façon dont le phénomène se produit, abstraction faite de variations occasionnelles, temporaires, accessoires. Par exemple, celui qui comparerait la position r à la position s, pour en déduire le mouvement général du phénomène, conclurait que ce mouvement va en augmentant d'intensité, tandis qu'au contraire, la ligne xy montre qu'en moyenne et en général, il va en diminuant d'intensité. De même, celui qui comparerait la position s à la position v, trouverait que le phénomène va en diminuant d'intensité beaucoup plus vite que cela n'a lieu en réalité, en moyenne, en général, comme le fait voir la ligne xy[FN: § 1718-1]. Lorsqu'on peut mesurer le phénomène, et que l'on a des observations pour un temps assez long, il n'est pas très difficile de remédier à cet inconvénient. Par l'interpolation, on peut déterminer la ligne xy, autour de laquelle oscille le phénomène, et en connaître, par conséquent, le mouvement moyen, général [FN: § 1718-2]. Cela est beaucoup plus difficile, quand on ne peut avoir, ou que l'on n'a effectivement pas de mesures précises du phénomène ; ce qui nous oblige à substituer aux déterminations rigoureuses des mathématiques une estimation où l'arbitraire, le sentiment individuel, et peut-être aussi la fantaisie, ont une part plus ou moins grande. C'est pourquoi, il faut subordonner ces estimations à une critique sévère, et ne négliger aucune vérification possible.
§ 1719. Entre les diverses classes de résidus, il se produit peu ou point de compensation. Il semblerait, à première vue, qu'il y ait cette compensation entre les résidus de la VIe classe et des résidus religieux d'autres classes ; et l'on verrait même en cela le motif pour lequel un grand nombre de religions font la guerre à la religion sexuelle, s'efforçant de s'enrichir de ses dépouilles. Mais en étudiant les faits de plus près, on découvre que la controverse porte sur les dérivations et non sur les résidus. Les autres religions ne détruisent pas les résidus de la religion sexuelle : elles se les approprient, en ne changeant que la forme sous laquelle ils s'expriment. Nous avons vu cela longuement, au chapitre X.
§ 1719 bis. À propos du peu de changement qu'apporte le temps aux résidus, une observation se présente, analogue à celles que nous avons déjà faites au sujet des actions non-logiques (§252), et en d'autres occasions semblables. Si vraiment les changements des résidus sont fort lents, comment ce fait a-t-il pu échapper aux nombreux auteurs de talent qui ont étudié les caractères des sociétés humaines ? Il ne leur a nullement échappé ; seulement ils l’ont exprimé, ainsi que c'est l'habitude dans les commencements de toute science, d'une manière vague, et sans viser en aucune sorte à la rigueur scientifique.
Dans le dicton : nil novi sub sole, et dans d'autres analogues, il y a déjà, plus ou moins voilée par le sentiment [FB: § 1719 bis-1], la conception qu'une partie au moins des phénomènes sociaux demeure constante. Dans le pédantisme des grammairiens voulant imposer à leurs contemporains et aux générations futures l'usage exclusif des formes du langage qui ont servi aux générations passées, il y a, comme prémisse implicite, l'idée que les sentiments n'ont pas changé, ne changeront pas, au point que de nouvelles formes de langage soient nécessaires pour les exprimer. La vie du langage nous donne une image de la vie des autres phénomènes sociaux. Le fond de la langue change, mais fort lentement ; des néologismes s'imposent, mais en petit nombre ; les formes grammaticales se modifient, mais la substance persiste pendant des siècles.
Une longue suite de littérateurs a imité les auteurs anciens ; des pédants ont même voulu prescrire cette imitation. Cela ne se comprendrait pas, si ces personnes et celles auxquelles s'adressaient leurs œuvres n'avaient pas eu des sentiments fort semblables à ceux qui sont exprimés par les anciens [FN: § 1719 bis-2]. D'ailleurs – abstraction faite de toute imitation – comment pourrions-nous encore goûter les poésies homériques, les élégies, les tragédies, les comédies grecques et les latines, si nous n'y trouvions pas exprimés des sentiments que nous partageons, du moins en grande partie ? Eschyle, Sophocle, Euripide, Aristophane, Plaute, Térence, Virgile, Horace, et une infinité d'autres auteurs de l'antiquité gréco-latine sont-ils, pour nous, des étrangers que nous ne comprenons plus ? Ne trouvons-nous pas chez Thucydide, Polybe, Tacite, et chez beaucoup d'autres historiens anciens, la description de phénomènes qui, sous une forme différente, parfois même très différente, nous révèlent un fond de sentiments humains identiques à ceux que nous observons actuellement ? Tout penseur qui a réfléchi et médité sur les phénomènes sociaux a fini, le plus souvent, par y reconnaître une partie variable et une autre partie, relativement fixe [FN: § 1719-bis-3]. Nous n'avons fait ici que donner une forme rigoureuse à cette conception ; comme le chimiste en découvrant l'alumine et le carbonate de chaux a donné une forme rigoureuse aux notions qui existaient bien avant lui, et grâce auxquelles les hommes distinguaient l'argile et la pierre à chaux.
§ 1720. Si, durant un certain temps, les classes des résidus changent peu ou pas, dans une même société, cela n'empêche nullement qu'elles puissent être très différentes dans des sociétés différentes. C'est un cas que nous avons étudié au chapitre II.
§ 1721. Afin de ne pas anticiper sur les présentes études, nous avons alors employé une terminologie différente de celle dont nous faisons maintenant usage. Au §172, nous disions: « Un état psychique très important est celui qui établit et maintient certains rapports entre des sensations ou des faits, par l'intermédiaire d'autres sensations P, Q, R... » Maintenant, nous dirons que le maintien de ces rapports est une persistance d'agrégats. Nous avons fait une longue étude de ces phénomènes au chap. VI. Au §174, nous parlions d'une force X qui unit les sensations P, Q, R… ; maintenant, nous dirons que cette force est celle qui maintient les agrégats, qu'elle mesure l'intensité de la persistance des agrégats. La force Y, (§174), qui pousse à innover, correspond aux résidus de la Ie classe (instinct des combinaisons).
L'étude accomplie, au chapitre II, des différences entre les sociétés de Sparte, d'Athènes, de Rome, de l'Angleterre, de la France, n'est autre chose qu'une étude des différences que l'on observe, dans ces sociétés, entre l'intensité des sentiments correspondant aux résidus de la Ie classe, et l'intensité des sentiments correspondant aux résidus de la IIe classe. Il est remarquable que les mêmes conclusions auxquelles nous aboutissons maintenant, avec la théorie des résidus, nous aient été alors imposées directement par l'étude des faits, indépendamment de toute théorie générale quelconque.
§ 1722. Maintenant que nous avons une théorie générale, nous pouvons nous occuper de nouveau du sujet traité déjà directement, et exprimer les conclusions sous une forme plus générale. Par exemple, au chapitre II, nous écrivions (§174) : « Supposons que chez deux peuples Y soit identique et X différent. Pour innover, le peuple chez lequel X est faible fait table rase des rapports P, Q, R,... et leur en substitue d'autres ; le peuple chez lequel X est intense laisse subsister autant que possible ces rapports, et modifie la signification de P, Q, R,... ». Nous dirons maintenant : « Supposons que chez deux peuples les résidus de la Ie classe (instinct des combinaisons) soient d'égale force, et les résidus de la IIe classe (persistance des agrégats) de force inégale. Pour innover, le peuple chez lequel les résidus de la IIe classe sont le moins forts fait table rase du fond et des noms des agrégats P, Q, R,… , et y substitue d'autres agrégats et d'autres noms ; le peuple chez lequel les résidus de la IIe classe sont le plus forts change bien le fond des agrégats P, Q, R,..., mais laisse subsister autant que possible les noms, en se servant pour cela de modifications opportunes des dérivations, par lesquelles il justifie, fût-ce en usant de sophismes, le fait de donner un nom identique à des choses différentes ». Ajoutons que cela a lieu justement parce qu'en général les dérivations varient beaucoup plus facilement que les résidus, et que, comme toujours, le mouvement se produit selon le point de moindre résistance.
Les proportions des diverses classes de résidus, chez les différents peuples, sont peut-être les meilleurs indices de leur état social.
§ 1723. RÉPARTITION ET CHANGEMENT DES RÉSIDUS DANS LES DIVERSES
COUCHES D'UNE SOCIÉTÉ. Les résidus ne sont pas répandus également ni également puissants, dans les diverses couches d'une même société. Le phénomène est commun et connu en tout temps. On a souvent relevé la superstition et la néophobie des classes inférieures de la société, et il est bien connu qu'elles furent les dernières à conserver la foi en la religion qui leur doit précisément son nom de paganisme. Chez elles, les résidus des IIe et IIIe classes sont plus répandus et plus puissants ; tandis que c'est au contraire souvent l'inverse pour les résidus de la Ve classe (intégrité de l'individu).
§ 1724. Diviser la société en deux couches, dont l'une est appelée inférieure, l'autre supérieure, nous rapproche un peu plus de la réalité, que considérer la société comme homogène ; toutefois, nous sommes encore loin du fait concret et de la réalité. Si nous voulons nous en rapprocher davantage, il faut diviser la société en un plus grand nombre de classes, et en constituer autant qu'il y a, en gros, de caractères différents des hommes ; mais pour ne pas dévier de l'étude que nous avons en vue, nous devons remettre à plus tard cette recherche (§2025 et sv.).
§ 1725. RAPPORTS ENTRE LES RÉSIDUS ET LES CONDITIONS DE LA VIE. On
peut tirer des diverses occupations des hommes d'utiles divisions des résidus. Ces divisions même furent connues depuis les temps les plus reculés ; mais presque toujours, les auteurs qui en traitent mêlent, comme d'habitude, deux choses bien différentes : 1° le fait simple de la différence des résidus, suivant la différence des occupations, du genre de vie; 2° une appréciation de la valeur éthique, politique, sociale, etc. des divers résidus. Souvent même, la première chose apparaît seulement comme une conséquence indirecte de la seconde.
§ 1726. Par exemple, lorsque Caton [FN: § 1726-1], louant les agriculteurs, dit : « Les agriculteurs donnent des hommes très vigoureux et des soldats très courageux, qui réalisent des gains très honorés et non pas odieux ; et ceux qui s'occupent d'agriculture ne roulent pas de mauvaises pensées », il exprime indirectement l'opinion que, chez les agriculteurs, on trouve des résidus différents de ceux qu'on rencontre chez d'autres citoyens ; et la dernière phrase laisse entendre qu'ils sont moins portés à innover, c'est-à-dire que chez eux, les résidus de la IIe classe présentent une importance plus grande que chez d'autres hommes.
§ 1727. Beaucoup d'observations ont été faites en tout temps, au sujet des commerçants, des militaires, des magistrats, etc., et dans l'ensemble on admet que les sentiments varient suivant le genre d'occupation. De cette façon, la théorie dite du matérialisme économique pourrait se confondre avec la théorie des résidus, si l'on remarque que ceux-ci dépendent de l'état économique. Cela serait certainement vrai ; mais l'erreur consiste à vouloir séparer l'état économique, des autres phénomènes sociaux avec lesquels il est au contraire en rapport de dépendance mutuelle, et en outre à substituer un unique rapport de cause à effet aux nombreux rapports analogues qui s'entrelacent.
§ 1728. Nous pouvons rapprocher de ces observations celles qui ont été faites à propos de l'influence qu'ont sur le caractère des hommes les conditions du sol, du climat, etc. Hippocrate en parle longuement dans son traité Des airs, des eaux et des lieux. Les rapports qu'il établit entre les conditions de la vie des hommes et leur caractère sont probablement erronés ; mais le fait subsiste de ces différences de caractère, indépendantes de la volonté, des raisonnements, du progrès des connaissances. Il explique la différence de caractère des Européens et des Asiatiques par les différences du sol et du climat, auxquelles il ajoute les différences des institutions ; et non content d'avoir mentionné les différences générales, il en parle aussi à l'égard de chaque peuple. À vrai dire, peu ou point d'auteurs nient les différences de caractère des divers peuples ; ils diffèrent sur les causes, mais non sur l'existence du fait. Singulière est la conception de l'empereur Julien, qui veut que la diversité de caractère des différents peuples provienne des divers êtres divins préposés à les gouverner. Pourtant, à ces êtres, il ajoute ensuite l'air et la terre [FN: § 1728-1].
§ 1729. Sans s'apercevoir de la contradiction avec sa théorie, qui donne une très grande importance aux actions logiques (§354 et sv.), Buckle fait des observations analogues à celles d'Hippocrate, sur l'influence que le climat et le sol, auxquels il ajoute l'alimentation qui en dépend, ont sur le caractère des hommes, sur leurs mœurs, sur leur civilisation. Ici encore, il faut remarquer que les rapports trouvés par Buckle sont peut-être en partie vrais et en partie erronés ; mais, quoi qu'il en soit, il n'en subsiste pas moins le fait d'une détermination des actions humaines par les résidus, et non par les dérivations ; et l'on voit varier ces actions avec les résidus. L'auteur sait aussi d'où proviennent ces résidus. Nous nous arrêtons sur cette voie, et laissons de nouvelles études prononcer sur ce sujet.
§ 1730. À ce propos, on pourrait citer un grand nombre d'autres auteurs ; il suffira de rappeler ici Demolins, qui croit avoir démontré que la civilisation d'un peuple est déterminée par les voies qu'il a suivies dans ses migrations. Les livres de cet auteur se lisent avec plaisir et intérêt : ils attirent comme le chant des Sirènes. Ses raisonnements paraissent excellents et très concluants ; cependant, parvenu au terme, on se demande : « Mais est-il bien vrai que la voie de migration, souvent hypothétique, ait une si grande vertu pour déterminer chaque caractère d'un peuple, sans l'intervention d'autres facteurs ? » Et alors, on s'aperçoit que la force du raisonnement dépend plus du talent de l'auteur que de la puissance des faits et de la logique, et l'on met un point d'interrogation là où il y avait précédemment un simple point. Là aussi, nous laissons à d'autres études le soin de déterminer l'influence de la voie de migration sur les caractères de la civilisation. Nous nous contentons, pour le moment, du fait que ces caractères, au moins en partie, ne dépendent pas du raisonnement, de la logique des hommes, de la connaissance d'une certaine morale, d'une certaine religion, etc. ; c'est-à-dire, pour répéter ce que nous avons observé souvent déjà, qu'ils dépendent beaucoup plus des résidus que des dérivations, sans pourtant exclure que les dérivations puissent agir aussi, dans une mesure secondaire.
§ 1731. Les théories relevées tout à l'heure sont des tentatives d'expliquer les phénomènes sociaux par des rapports de cause à effet ; elles sont semblables à celles qu'on eut en économie politique, antérieurement à la synthèse de l'économie pure. Elles ne sont pas entièrement fausses : elles contiennent une part, parfois peut-être importante, qui concorde avec l'expérience ; mais elles en contiennent aussi une qui s'en écarte entièrement. Cela surtout parce que l'on néglige la mutuelle dépendance des phénomènes de deux façons : 1° là où l'on ne voit qu'une seule « cause », il y en a un très grand nombre ; 2° même si, par abstraction, on en considère une seule, et qu'on la mette en rapport de cause à effet avec d'autres phénomènes, on s'éloigne encore de la réalité, en ce que cette « cause » supposée a, avec ses effets, des rapports de mutuelle dépendance, qui donnent naissance à une suite d'actions et de réactions.
Il faut d'ailleurs faire attention que les phénomènes sociaux, ainsi que les phénomènes économiques, ayant généralement une forme ondulée, nous devons avant toute chose être fixés sur les ondulations dont nous cherchons les rapports. Supposons deux phénomènes avec des indices mesurables, que nous prendrons pour les ordonnées de deux courbes (§1718-2), et cherchons les rapports qu'il peut y avoir entre ces deux phénomènes. Si l'on veut tenir compte des moindres oscillations, c'est un problème entièrement insoluble, tandis qu'on peut en avoir une solution au moins grossièrement approchée, si l'on se résigne à ne considérer que les oscillations les plus notables, ou bien la marche générale des phénomènes. Cette marche générale peut être déterminée de deux manières. La première, fort imparfaite expérimentalement, consiste à substituer aux phénomènes concrets des entités abstraites que l'on suppose représenter plus ou moins bien ces phénomènes. C'est ainsi que l'on dira que la hauteur des marées dépend de l'attraction du soleil et de la lune. Cette hauteur n'existe pas ; il y a une infinité de hauteurs, selon les points que l'on considère. De même quand on dit que le change des monnaies d'un pays dépend de l'état des dettes et des créances de ce pays avec l'étranger, on met en rapport deux entités abstraites, qui n'ont pas d'existence concrète. Il n'y a pas un change, il y a une infinité de changes, parfois même un change différent à chaque contrat réel. Il n'y a pas un état des dettes et des créances ; il y a une infinité de dettes et de créances, et chaque moment en voit naître et disparaître quelques-unes. Les économistes disent que sur un même marché il ne saurait exister, en même temps, des prix différents, pour la même marchandise. Ce sont là des abstractions qui parfois se rapprochent de la réalité, parfois s'en écartent et peuvent ne la représenter que fort imparfaitement. De même l'offre et la demande d'une marchandise sur un marché donné sont encore des abstractions. D'ailleurs on peut, en général, répéter la même chose pour toutes les entités que considère l'économie politique. M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir ; les personnes qui s'occupent de ces entités font des interpolations (§1694) sans s'en apercevoir. Mais il vaut toujours mieux n'agir qu'à bon escient, et cette remarque nous conduit à nous occuper de la seconde manière d'étudier la marche des phénomènes. Cette manière consiste à tracer les courbes qui représentent les phénomènes, à interpoler ces courbes, et à rechercher les rapports qui existent entre les courbes interpolatrices (§1718-2).
Mais ici il faut se garder d'une nouvelle erreur que l'on fait facilement de nos jours. La seconde manière de considérer les phénomènes ne doit pas nous faire négliger la première, car toutes deux peuvent concourir à augmenter la somme de nos connaissances. Parce que le phénomène décrit par l'arpentage est plus concret que celui décrit par la topographie, lequel à son tour est plus concret que celui dont s'occupe la géodésie, nous ne devons pas négliger, abolir la géodésie, pour y substituer la topographie, qui devrait à son tour céder la place à l'arpentage. Parce que la théorie empirique des marées nous rapproche plus du concret que la pure théorie astronomique, nous ne devons pas jeter celle-ci par dessus bord [FN: § 1731-1]. Parce que nous étudions empiriquement les ondulations des phénomènes économiques, nous ne devons pas négliger pour cela l'Économie abstraite.
Il est un fait très remarquable, et c'est que chacune des manières que nous venons de mentionner peut utilement se développer autant dans le sens abstrait que dans le sens concret. Lorsque la théorie des marées de Newton devient celle de Laplace, elle se développe dans le sens abstrait ; lorsque les observations empiriques de la hauteur des marées dans les différents ports devient la théorie de Thomson et de G.-H. Darwin, la théorie des marées se développe dans le sens concret. Lorsque, à l'ancienne économie, s'ajoute le chapitre de l'économie mathématique, la science se développe dans le sens abstrait ; lorsque l'on considère les ondulations des phénomènes économiques et des phénomènes sociaux (§2292-1), ainsi que nous le faisons maintenant, la science se développe dans le sens concret [FN: § 1731-2]. C'est ce que n'arrivent pas à comprendre prendre les très nombreuses personnes qui, ayant le jugement faussé par les préjugés ou l'ignorance, n'ont aucune idée de la nature logico-expérimentale des sciences sociales et des sciences économiques. Parfois leurs élucubrations font songer à un individu qui chercherait des recettes de cuisine dans un traité de mathématique, ou des théorèmes de géométrie dans un livre de cuisine [FN: § 1731-3].
§ 1732. Il faut donc prendre garde de ne pas tomber en des erreurs analogues, et pour cela, nous devrons avoir toujours présent à l'esprit que, lorsque nous parlons, par exemple, de l'action des résidus sur les autres facteurs sociaux, nous ne nous attachons qu'à une partie du phénomène, et qu'il en est une autre, laquelle consiste non seulement en l'action de tous ces faits sur les résidus, mais aussi dans les actions mutuelles de tous ces phénomènes (2203 et sv.).
On peut distinguer différents procédés de traiter des phénomènes mutuellement dépendants : (1) on considère uniquement des rapports de cause à effet, et l'on néglige entièrement cette mutuelle dépendance. (2) Au contraire, on en tient compte. (2a) On considère encore des rapports de cause à effet, mais on s'efforce de tenir compte de la mutuelle dépendance, en faisant attention aux actions et aux réactions, et par d'autres moyens. (2b) On raisonne directement dans l'hypothèse de la mutuelle dépendance [FN: § 1732-1] (§ 2091 et Sv.). Le meilleur procédé est évidemment (2b), mais on ne peut malheureusement l'employer qu'en un très petit nombre de cas, à cause des conditions qu'il exige. En effet, il impose l'emploi de la logique mathématique, qui seule peut tenir compte de la mutuelle dépendance dans toute son étendue. Par conséquent, il ne s'applique qu'aux phénomènes mesurables. Il demeure exclu d'un très grand nombre d'autres, parmi lesquels presque tous ceux de la sociologie. Ensuite, même pour les phénomènes que l'on peut mesurer, de graves difficultés surgissent, sitôt que le phénomène est un peu compliqué. On en a un exemple remarquable dans la mécanique céleste, qui rencontre encore des difficultés insurmontables pour déterminer les mouvements d'un grand nombre de corps de masses presque égales, lorsqu'elle ne peut plus considérer une partie des dépendances mutuelles comme des perturbations. L'économie pure arrive à poser les équations de certains phénomènes, mais non à résoudre ces équations, au moins en général [FN: § 1732-2]. Par conséquent, dans les sciences économiques et sociales, le procédé (2b) demeure un but idéal que l'on n'atteint presque jamais en réalité [FN: § 1732-3]. Dirons-nous nous pour cela que ce procédé est inutile ? Non, parce que nous en tirons notamment deux grands avantages. 1° Il donne à notre esprit une image des phénomènes, image que nous ne pourrions obtenir d'aucune autre façon. Assurément la surface de la terre n'a pas la forme d'une sphère géométrique, et pourtant le fait de considérer cette forme sert à nous donner une idée de ce qu'est la terre. 2° Il nous indique la voie que nous devons suivre pour éviter les erreurs du procédé (1), et pour nous rapprocher de la réalité. Même un signal qu'il est impossible d'atteindre peut servir à indiquer un chemin. Nous pouvons, par analogie, transporter en sociologie les résultats que nous donne l'économie mathématique, laquelle nous fournit ainsi des notions que nous ne pourrions obtenir d'une autre manière, et que nous éprouverons ensuite avec l'expérience, pour décider si nous devons les accepter on les rejeter. 3° Enfin, la notion, même imparfaite, de la mutuelle dépendance, nous engage à adopter le procédé (2a) qui, grâce à l'emploi des rapports de cause à effet (§2092), permet d'obtenir des résultats au moins semblables à ceux que l'on obtiendrait avec le procédé (2b), et d'éviter les erreurs du procédé (1), lequel est le plus imparfait et le plus erroné de tous [FN: § 1732-4]. En l'état présent de nos connaissances, l'utilité du procédé (2b) est donc moins directe qu'indirecte ; il nous éclaire, nous guide et nous fait éviter les erreurs du procédé (1) ; ainsi, il nous rapproche beaucoup plus de la réalité [FN: § 1732-5]. Ce n'est pas ici le lieu de nous arrêter à étudier les détails du procédé (2a). Nous en traiterons longuement plus loin (§2091 et sv.). Notons seulement, car cette considération nous sera nécessaire, que ce procédé (2a) devient facile, lorsqu'on a un phénomène principal qui prend la forme d'un rapport de cause à effet, précisément ou approximativement, et d'autres phénomènes, accessoires, secondaires, de moindre importance, par lesquels se manifeste la mutuelle dépendance. Quand nous pouvons réduire à ce type, qui est celui de la mécanique céleste, les phénomènes que nous voulons étudier, nous sommes sur une bonne voie pour en acquérir la connaissance.
Visant précisément à ce but, nous avons vu que les résidus étaient beaucoup plus constants que les dérivations ; c'est pourquoi nous avons pu considérer qu'ils étaient en partie la « cause » des dérivations, mais sans oublier l'action secondaire des dérivations, qui peuvent être parfois la « cause » des résidus, ne fût-ce que d'une manière subordonnée. Nous voyons maintenant que dans les différentes classes sociales, il y a divers résidus ; mais, pour le moment, nous n'entendons nullement établir si c'est le fait de vivre dans une certaine classe qui produit certains résidus chez les individus, ou bien si c'est l'existence de ces résidus chez ces individus qui les pousse dans cette classe, ou mieux encore si les deux effets se manifestent simultanément. Nous parlerons de tout cela dans le prochain chapitre ; bornons-nous maintenant à décrire les uniformités qui apparaissent dans la distribution des résidus chez les diverses classes sociales.
§ 1733. Un grand nombre de faits nous sont connus à ce sujet, bien que manquant d'une grande précision, et souvent recouverts par des voiles littéraires et métaphysiques ; cependant, nous pouvons en déduire avec une certaine probabilité que dans les diverses couches sociales, l'échelle de variabilité croissante mentionnée au §1718 peut subsister, soit : 1° les classes des résidus ; 2° les genres de ces classes ; 3° les dérivations. Mais la variabilité est plus grande pour les couches sociales que pour la société entière, car, pour celle-ci, il se produit des compensations entre les diverses couches. En outre, il y a des catégories sociales composées d'un petit nombre d'individus pour lesquels les variations peuvent être grandes et soudaines, tandis qu'elles sont petites et lentes pour le plus grand nombre des citoyens. De même que les classes supérieures changent plus facilement la façon de s'habiller, elles changent aussi plus facilement leurs sentiments, et plus encore leurs façons de les exprimer. Les changements de mode, dans les diverses manifestations de l'activité humaine, se suivent de beaucoup plus près dans les classes riches ou élevées que dans les classes pauvres ou basses. Il y a aussi plusieurs changements qui demeurent dans les limites des premières et ne s'étendent pas aux secondes, très souvent parce qu'elles disparaissent des classes supérieures, avant d'être parvenues aux classes inférieures.
§ 1734. Malheureusement, l'histoire et la littérature nous font mieux connaître l'état d'âme, les sentiments, les mœurs du petit nombre d'individus qui font partie des couches supérieures, que ceux du nombre beaucoup plus grand d'individus qui font partie des couches inférieures. De là naissent des erreurs nombreuses et graves, car on est poussé à étendre à toute la population, ou au moins à une grande partie de la population, ce qui ne s'applique qu'à un nombre restreint, peut-être très restreint d'individus. Il s'y ajoute une autre erreur, qui provient du fait qu'on ne tient pas compte, chez les individus, des changements que la circulation des élites apporte dans les classes supérieures, et que l'on confond, par conséquent, des changements d'individus avec des changements de sentiments chez les mêmes individus. Par exemple, dans une classe X qui demeure fermée, les sentiments et leurs expressions peuvent changer ; mais si la classe X est ouverte, à ce changement s'en ajoute un autre, qui provient de ce que la composition de la classe se modifie. Ce changement dépend, à son tour, de la rapidité plus ou moins grande de la circulation.
§ 1735. ACTION RÉCIPROQUE DES RÉSIDUS ET DES DÉRIVATIONS. Les résidus
peuvent agir : (a) sur d'autres résidus ; (b) sur les dérivations. De même, les dérivations peuvent agir : (c) sur les résidus ; (d) sur les dérivations. Ici, nous ne considérons ces effets qu'intrinsèquement, sans rechercher en quel rapport ils peuvent être avec l'utilité des individus ou de la société.
En général, de l'action des résidus sur les dérivations (b), nous n'avons plus rien à dire ici, puisque nous en avons déjà longuement parlé jusqu'à présent ; et nous avons fait voir que, contrairement à l'opinion générale, les résidus agissent puissamment sur les dérivations, et les dérivations faiblement sur les résidus. C'est pour arriver à cette démonstration que nous avons commencé notre étude par la considération des actions non-logiques. Il ne nous reste plus à parler que d'un cas spécial, qui est celui de certaines oscillations des dérivations, correspondant à des oscillations des résidus. Mais nous ne pouvons le faire ici, parce qu'il nous manque beaucoup de notions que nous acquerrons seulement au chapitre suivant. C'est pourquoi nous devons renvoyer à la fin du dit chapitre l'étude de ce sujet (§2329 et sv.). En attendant, nous étudierons les genres de rapports (a), (c), (d).
§ 1736. (a) ACTION DES RÉSIDUS SUR LES RÉSIDUS. Il convient de distinguer d'abord les résidus a, b, c... qui correspondent à un même ensemble P de sentiments, des résidus m, n, r, s qui correspondent à un autre ensemble Q de sentiments. Les résidus a, b, c, qui correspondent à un même ensemble P de sentiments, concordent ensemble, ne sont pas trop discordants, ne sont pas trop ouvertement contradictoires. Au contraire, il peut y avoir discordance et contradiction entre les résidus a, b, c... correspondant à l'en semble de sentiments P, et les résidus m, n, r,... correspondant à un autre ensemble Q. Puisque les résidus se manifestent à nous par les dérivations, nous aurons également des dérivations pas trop discordantes et des dérivations discordantes. D'autres dérivations discordantes proviennent de l'utilité d'agir sur diverses personnes possédant divers résidus (§1716).
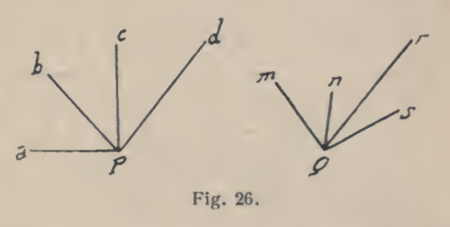
Figure 26
§ 1737. RÉSIDUS DISCORDANTS ET LEURS DÉRIVATIONS. On observe souvent,
chez un même individu, des dérivations contradictoires, qui révèlent des résidus contradictoires, eux aussi, et l'individu, ou bien n'aperçoit pas la contradiction, ou bien s'efforce de la faire disparaître par des sophismes manifestes [FN: § 1737-1]. Nous en avons donné de nombreuses preuves, et nous en donnerons d'autres, parce qu'il importe beaucoup de mettre ce fait en lumière. Considérons différents groupes de résidus, et supposons que chacun de ces groupes corresponde à certains ensembles de sentiments. Nous verrons que l'action mutuelle de ces groupes, lorsqu'ils sont discordants, est généralement faible ou nulle pour tous, et se manifeste seulement chez les gens cultivés, par des tentatives sophistiques de concilier les dérivations nées de ces groupes, tandis que les gens incultes ne s'en soucient souvent même pas.
§ 1738. En général, exception faite des personnes qui ont l'habitude de faire de longs et subtils raisonnements, l'individu ne tâche pas de faire concorder ensemble les dérivations discordantes ; il se contente de les faire concorder avec ses sentiments, c'est-à-dire avec les résidus qui correspondent à ces sentiments. Cela suffit au plus grand nombre des hommes. Un plus petit nombre éprouvent un besoin de logique, de raisonnements pseudo-scientifiques,
qui les poussent à subtiliser sur l'accord des dérivations entre elles. Les théologiens, les métaphysiciens, ont toujours été en très petit nombre, comparés au reste de la population.
§ 1739. Les critiques littéraires et les critiques historiques recherchent souvent quelle était la pensée d'un auteur, d'un homme d'État. Cette recherche suppose qu'il existe une pensée unique. Cela est parfois vrai, mais beaucoup plus souvent faux. Si ces critiques s'examinaient eux-mêmes, ils trouveraient aisément des exemples de conceptions contradictoires, sans aller en chercher chez d'autres personnes. Celui qui est déterministe verrait que souvent il agit comme s'il ne l'était pas. Ces critiques ne manqueraient pas de trouver ensuite plusieurs préceptes de morale qu'ils interprètent à leur manière, et qui sont interprétés d'une manière différente par d'autres personnes. Il va sans dire que chacun trouve sa propre interprétation bonne et celle d'autrui mauvaise. Admettons ; mais cela confirme que ce sont des choses différentes ; et pour qui a une autre interprétation, il y a contradiction entre le précepte formel et la façon dont notre critique l'observe. Dans un moment où il est joyeux, un individu affirmera que celui qui observe les règles de la religion et de la morale est certain de vivre heureux. Dans un moment de tristesse, il s'écriera avec Brutus : « Vertu, tu n'es qu'un nom ! » Quelle est l'idée de cet individu ? Il en a deux, et il est également de bonne foi en les exprimant, bien qu'elles soient contradictoires. De semblables faits sont d'une grande importance pour déterminer les phénomènes sociaux. C'est pourquoi nous ne devons pas nous contenter de les affirmer simplement, mais nous devons en donner des preuves abondantes. Cela justifie la minutie de beaucoup de détails que nous avons cités et que nous citerons ; tandis qu'en l'absence de ce but, nous perdrions purement et simplement notre temps.
§ 1740. ACTION DES RÉSIDUS CORRESPONDANT À UN MÊME ENSEMBLE DE
SENTIMENTS. Elle peut se produire de trois façons, qui doivent être distinguées avec soin. Soit P, une disposition psychique correspondant à un ensemble de sentiments qui sont manifestés par les résidus a, b, c, d,... Ces sentiments peuvent être d'intensité diverse ; ce que nous exprimons elliptiquement en disant que les résidus sont d'intensité diverse (§1690).
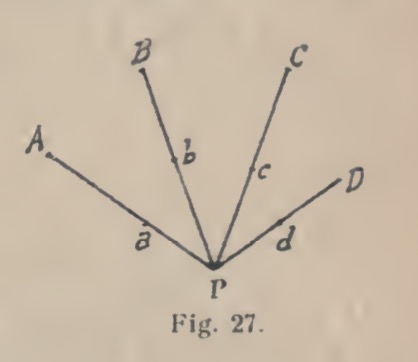
Figure 27
§ 1741. 1° Si, pour un motif quelconque, l'état psychique, commune origine P des sentiments, augmente d'intensité, tous les résidus a, b, c,... augmenteront aussi d'intensité en devenant A, B, C... ; et vice versa, si P diminue d'intensité. Parmi les motifs pour lesquels P croît ou diminue d'intensité, il peut y avoir l'augmentation ou la diminution d'un groupe de résidus a, qui réagit sur P. En ce cas, l'augmentation ou la diminution de a fait croître ou diminuer tous les groupes b, c,... Pour une collectivité très nombreuse, cet effet est souvent lent et peu important, car, ainsi que nous l'avons vu, le total d'une classe de résidus varie lentement et peu. Pour un individu particulier il peut être plus rapide et plus fort. Tel est le cas cité (§1416) des personnes qui, aux Indes, se convertissent au christianisme, et qui perdent la moralité de l'ancienne religion sans acquérir celle de la nouvelle. C'est aussi ce qu'on a pu observer en Grèce pour les sophistes dégénérés, et en d'autres cas analogues. Chez eux, certains résidus a furent détruits, et par conséquent toute la catégorie b, c, d,... fut affaiblie.
§ 1742. 2° Nous avons un grand nombre de cas où l'on voit qu'un groupe de résidus peut augmenter au détriment d'autres groupes de la même classe. Par exemple, l'instinct des combinaisons, qui peut s'appliquer à divers genres de combinaisons. Il y a donc là une nouvelle répartition en a, b, c,.., sans que P varie.
Si nous réunissons les effets 1°, et 2°, nous aurons diverses combinaisons. Par exemple a augmente ; cela fait augmenter P, et par conséquent aussi b, c,... ; mais l'augmentation de a est obtenue en outre en prenant une partie de ce qui revenait à b, c,... En conséquence, il pourra y avoir un groupe b qui augmente parce que la partie que lui enlève a est plus petite que la partie qu'il gagne par l'augmentation de P ; un autre groupe c pourra diminuer, parce qu'on lui ôte plus que ce qu'il garde, etc.
§ 1743. 3° Il pourrait y avoir une action directe de a sur b, c,... sans passer par l'intermédiaire de P. Il est facile de confondre cette manière avec la première. On peut remarquer que, lorsque a est devenu A, on a vu b devenir B, c devenir C, etc. ; et, raisonnant en vertu du post hoc propter hoc, on peut croire que c'est le fait de a devenu A qui est la « cause » des changements de b en B, de c en C, etc. ; et l'on arrive ainsi à supposer un rapport direct entre a et b, c,...
§ 1744. L'observation vulgaire donne une forme spéciale à ce raisonnement, par la substitution habituelle des actions logiques aux actions non-logiques. On suppose que a a une origine logique P, et que, par conséquent, si l'on modifie a, en le faisant devenir A, on estime que l'origine logique est renforcée, et que, de ce fait, les changements de b en B, de c en C, etc., sont déterminés.
Par exemple, on dit : « Celui qui est religieux s'abstient de mal faire, parce qu'il sait que Dieu punit les mauvaises actions ; donc si nous faisons croître le sentiment religieux a, nous ferons croître aussi l'honnêteté b, les bonnes mœurs c, l'honorabilité d, etc. [FN: § 1744-1] ». Les faits ont démontré que ce raisonnement est erroné ; et nous connaissons maintenant les causes de l'erreur, lesquelles consistent à confondre les actions logiques avec les actions non-logiques. Le raisonnement deviendrait bon si à l'augmentation de a on substituait l'augmentation de P. Nous pouvons exprimer cela d'une manière assez imparfaite, mais qui a le mérite de donner une vive image du phénomène, en remarquant que les actes dont b, c, d,... tirent leur origine sont en partie semblables à ceux dont a tire la sienne ; et si nous les appelons tous religieux et religions les ensembles a, b, c, d,... nous pourrons observer qu'en faisant croître une de ces religions, on agit peu sur les autres, tandis qu'en faisant croître les sentiments de persistance des agrégats P, dont elles sont issues, on agit puissamment sur toutes. Habituellement, on croit le contraire, et l'on estime que faire croître une de ces religions est un moyen efficace d'accroître les autres. Nous traiterons de ce sujet plus loin (§1850 et sv.).
§ 1745. Mais le fait qu'une démonstration donnée de l'action d'un résidu sur les autres est erronée, n'empêche nullement qu'il puisse y avoir des cas où cette action existe réellement, et nous devons la rechercher directement dans les faits. Il n'est pas facile de la trouver, et souvent, quand on croit l'observer, il est possible aussi de l'interpréter comme une action selon le premier procédé ; on demeure donc dans le doute sur la conclusion à tirer. Mais il y a aussi des faits qui démontrent clairement l'indépendance des résidus a, b, c,..., par exemple le fait si connu de brigands qui sont de fervents catholiques, et une infinité d'autres faits analogues, dans lesquels b, c, d,.., n'apparaissent pas liés à a. En se bornant à certaines probabilités, on peut dire que l'action directe, quand elle existe, se manifeste principalement entre les résidus qui sont les plus voisins ou au moins du même genre ; difficilement entre les résidus de genres différents ou de classes différentes. Par exemple, celui qui croit déjà facilement à un grand nombre de fables, accordera créance à une de plus. Cela paraît être une action directe, bien que l'on puisse dire aussi que la croyance en un grand nombre de fables révèle un état psychique grâce auquel on accorde facilement créance à une nouvelle fable.
§ 1746. (c) ACTION DES DÉRIVATIONS SUR LES RÉSIDUS. Ce sujet se rapproche beaucoup de celui dont nous avons traité tout à l'heure. Parmi les manifestations des sentiments se trouvent les dérivations, et l'action de celles-ci sur les résidus est par conséquent semblable à l'action des résidus de la IIIe classe et d'un genre de la Ie classe, c'est-à-dire du genre (I-ε), sur les autres résidus. C'est seulement grâce à cette action que les dérivations ont une efficacité importante pour la détermination de l'équilibre social. Une dérivation qui donne uniquement libre cours au besoin de logique éprouvé par l'homme, et qui ne se transforme pas en sentiments, ou qui ne renforce pas des sentiments, agit peu ou point sur l'équilibre social. Ce n'est qu'une dérivation de plus ; elle satisfait certains sentiments, et voilà tout. On peut dire brièvement, mais aussi sans beaucoup de rigueur, que, pour agir sur la société, les raisonnements doivent se transformer en sentiments, les dérivations en résidus. Il faut pourtant faire attention que cela est vrai seulement pour les actions non-logiques, et pas pour les actions logiques.
§ 1747. En général, une dérivation est acceptée, moins parce qu'elle persuade les gens, que parce qu'elle exprime sous une forme claire des idées que ces gens ont déjà d'une manière confuse. C'est là généralement le phénomène principal. Une fois la dérivation acceptée, elle accroît la force et la vigueur des sentiments qui, de cette façon, trouvent la manière de s'exprimer. C'est un fait bien connu que les sentiments sur lesquels la pensée s'arrête souvent, croissent plus vivaces que d'autres auxquels elle ne s'arrête pas (§1749, 1832). Ce phénomène est généralement secondaire, par rapport au premier.
C'est précisément parce que les dérivations n'ont guère d'efficacité que par les sentiments qu'elles excitent, que les personnes qui sont étrangères à ces sentiments, soit qu'elles ne les partagent pas, soit que les ayant autrefois partagés, elles les aient oubliés, se rendent difficilement compte de la valeur pratique de certaines dérivations. On accuse souvent alors ceux qui les ont prohibées d'avoir manqué d'intelligence, tandis qu'il n'y a peut-être en eux qu'un défaut d'habileté [FN: § 1747-1].
§ 1748. Au point de vue logico-expérimental, le seul moyen de réfuter valablement une affirmation A consiste à en démontrer l'erreur ; pour les actions logiques, cela se fait par la logique et l'observation (§1834). Il n'en est pas ainsi au point de vue des sentiments et pour les actions non-logiques. Les raisonnements et les observations expérimentales ont peu d'influence sur les sentiments et les actions non-logiques ; les dispositions naturelles de l'individu en ont beaucoup et sont presque seules à en avoir. C'est pourquoi, aux sentiments il convient d'opposer d'autres sentiments. Une dérivation absurde peut être un bon moyen de réfuter une autre dérivation absurde, tandis que tel ne serait pas le cas au point de vue logico-expérimental. Enfin, le silence peut être un bon moyen d'ôter sa force à une affirmation A, tandis que la réfuter, même victorieusement au point de vue logico-expérimental, peut lui profiter au lieu de lui nuire (§1834) [FN: § 1748-1].
§ 1749. [Note ajoutée à l’édition française par l’auteur : [FN: § 1749-1a]] Parler à un individu d'une chose, soit pour en dire du bien, soit pour en dire du mal, peut disposer cet individu, s'il ne l'est pas encore, à s'occuper de cette chose, ou accroître cette disposition s'il l'a déjà [FN: § 1749-1]. Bien plus, il est remarquable que pour beaucoup de personnes qui aiment la contradiction, dire du mal d'une chose est un moyen plus sûr de la leur faire accepter, que d'en dire du bien. En certaines matières, ainsi en matière sexuelle, on éveille aussi, de cette façon, un certain instinct de perversité, qui pousse l'individu à faire précisément ce qu'on voudrait l'empêcher de faire [FN: § 1749-2]. C'est pourquoi, en ces matières, il arrive souvent que le silence, lorsqu'il maintient vraiment l'individu dans l'ignorance, est presque le seul moyen efficace d'agir sur lui.
En matière politique, le silence sur les hommes est aussi très efficace. Nombreux sont les cas dans lesquels il vaut mieux pour un politicien être attaqué et injurié que de ne pas occuper l'esprit du public. C'est pourquoi un fait quelconque qui le mette en évidence peut être aussi l'origine d'un succès pour lui. De très nombreux avocats trouvèrent dans un procès le commencement de la gloire et du pouvoir ; ainsi Gambetta. Pour ôter de la valeur aux faits, n'en pas parler est moins efficace, mais cependant toujours utile [FN: § 1749-3]. L'efficacité dépend de la possibilité d'empêcher ainsi que le public ne s'occupe du fait, soit parce que beaucoup de gens demeurent sans en avoir connaissance, soit parce qu'une partie de ceux qui le connaissent, n'en entendant plus parler, sont portés à l'oublier. Ce n'est pas ici le lieu de rechercher quand et comment cela se fait, puisque maintenant nous recherchons seulement quelle est l'action des résidus, et non les façons dont l'organisation sociale permet d'atteindre certains buts. Le silence sur les raisonnements est aussi plus ou moins efficace, suivant qu'il sert à faire ignorer, oublier, négliger les raisonnements que l'on veut combattre, et vaut souvent plus et mieux que n'importe quelle réfutation. De même, la répétition, n'eût elle pas la moindre valeur logico-expérimentale, vaut plus et mieux que la meilleure démonstration logico-expérimentale [FN: § abc-1]. La répétition agit surtout sur les sentiments, modifie les résidus ; la démonstration logico-expérimentale agit sur la raison ; elle peut, dans l'hypothèse la plus favorable, modifier les dérivations, mais a peu d'effet sur les sentiments. Quand un gouvernement ou quelque puissance financière veut faire défendre une mesure par les journaux à sa dévotion, il est remarquable que souvent, presque toujours, les raisonnements employés sont loin d'être les meilleurs pour démontrer l'utilité de la mesure ; on emploie généralement les pires dérivations verbales, d'autorité, et autres semblables. Mais cela importe peu ; au contraire, c'est parfois utile ; il faut surtout avoir une dérivation simple, que tout le monde puisse comprendre, même les plus ignorants [FN: § 1749-5], et la répéter indéfiniment.
§ 1750. Il arrive souvent que la réfutation, même excellente, d'un raisonnement absurde soit un moyen de donner du crédit à ce raisonnement, s'il correspond à des sentiments en ce moment puissants (§1749 [FN: § abc-1]) Cela s'applique aussi aux raisonnements qui sont bons au point de vue logico-expérimental et, en général, aussi à des attaques de tout genre et des persécutions contre des théories, des opinions, des doctrines. De là provient l'illusion que la Vérité a la force de surmonter victorieusement les persécutions ; ce qui peut être en accord avec les faits, pour les raisonnements de pure science logico-expérimentale, mais l'est beaucoup moins, et souvent se trouve en complet désaccord avec eux, pour les raisonnements qui dépendent un peu ou beaucoup des sentiments.
§ 1751. L'effet noté tout à l'heure des réfutations et des persécutions peut être appelé indirect. On observe un effet semblable pour le silence. Si cet effet s'étend à une classe importante et nombreuse de faits, et à des sentiments puissants, il laisse non satisfaits parmi ces derniers les sentiments correspondant à la IIIe classe des résidus et au genre (I-ε) de la Ie classe, tandis que l'abstinence même augmente le besoin de les satisfaire. Cela est remarquable en matière sexuelle, et tout le monde sait que les voiles accroissent le désir ; mais ce n'est pas moins vrai en matière religieuse et politique. Là où il est interdit d'attaquer la religion dominante ou le régime politique existant, le plus petit blâme, la moindre attaque, émeuvent fortement les gens ; là où c'est permis, et où cela se fait souvent, les gens s'y habituent et n'y font plus attention.
Cela a lieu pour les deux parties que nous avons vues exister dans les effets des dérivations(§1747). En effet, les individus contraints au silence refoulent en eux-mêmes des sentiments qui se manifestent à la première occasion favorable ; et celle-ci peut être justement la production de certaines dérivations, qui sont, par conséquent, accueillies avec une très grande faveur, et qui, une fois acceptées, donnent une force et une vigueur nouvelles aux sentiments. Puisque dans la réalité, nous observons ensemble ces deux parties des phénomènes, nous ne savons trop comment les séparer, et la tendance que nous avons à réduire toutes les actions à des actions logiques, nous porte à donner à la seconde partie une importance beaucoup plus grande qu'elle n'a en réalité, lorsque pourtant nous ne la considérons pas exclusivement. Les vérifications que nous pouvons faire dans le cas concret concernent principalement le phénomène dans son ensemble, constitué des deux parties, que nous ne pouvons séparer que par l'analyse.
En France, vers la fin du XVIIIe siècle, les attaques de Voltaire, de d'Holbach et d'autres philosophes, contre la religion catholique, furent en rapport avec un phénomène d'ensemble contraire à cette religion, et qui ne se renouvelle plus maintenant, lors d'attaques analogues. Dans le phénomène de la fin du XVIIIe siècle, il y avait très probablement une partie qui était réellement un effet des écrits contraires à la religion ; mais la plus grande partie était certainement celle qui manifestait des sentiments existant déjà chez les hommes (§1762 et sv.). Dans les pays où, comme maintenant en Allemagne, on ne permet pas de publier quoi que ce soit contre le souverain, le plus léger blâme à son adresse est lu avidement par le public. Dans les pays où, comme aujourd'hui en Belgique, on peut dire ce qu'on veut du souverain, personne ne prend garde à ce qui s'écrit contre lui [FN:§ 1751-1]. Très connu est le fait qui s'est produit en France, en 1868, lorsque l'Empire, après avoir longtemps imposé silence à la presse, lui donna un peu de liberté. Le public suivit avec avidité, non seulement les attaques acharnées, mais aussi celles qui nous paraissent aujourd'hui avoir été de peu d'importance [FN: § 1751-2].
§ 1752. Tant pour le silence que pour les réfutations et les persécutions, nous avons donc un effet direct et un effet indirect (§1835) ; et la détermination de la résultante de ces deux effets est une question de quantité. À un extrême, l'effet direct surpasse de beaucoup l'effet indirect, puis, peu à peu, l'un augmente et l'autre diminue, et l'on atteint l'extrême opposé, où l'effet indirect dépasse de beaucoup l'effet direct. Au premier extrême, on trouve les mesures qui frappent un petit nombre de faits, et qui n'émeuvent pas des sentiments puissants. De ce genre sont, par exemple, les mesures prises contre un petit nombre de dissidents en politique, en religion, en morale. À l'autre extrême, on trouve les mesures qui visent des faits nombreux, et qui émeuvent des sentiments puissants. De ce genre sont, par exemple, les mesures par lesquelles on essaie vainement d'empêcher les manifestations de l'appétit sexuel.
§ 1753. Aux siècles passés, en Europe, on croyait que gouvernement, religion, morale, ne pouvaient subsister, si l'on ne réglait pas les manifestations de la pensée ; et les faits survenus aussitôt après la Révolution de 1789, parurent démontrer la vérité de cette théorie. C'est pourquoi, dans les premières années du XIXe siècle, elle eut un regain de vogue. Ensuite, peu à peu, ces liens de la manifestation de la pensée disparurent, et maintenant ils sont supprimés en grande partie, excepté pour la religion sexuelle ; et les gouvernements, la religion, la morale subsistent ; il semble donc que la théorie est erronée. De tels jugements sont trop absolus, parce que les circonstances dans lesquelles la théorie est mise en pratique sont changées. Ôter la liberté de pensée à ceux qui n'éprouvent pas le besoin de la manifester n'a aucun effet ; l'ôter à ceux qui éprouvent ce besoin laisse non satisfaits des désirs qui deviennent intenses. C'est pourquoi, ainsi qu'il arriva en France, vers la fin du XVIIIe siècle, la liberté d'exprimer sa pensée a des effets intenses et nuisibles pour les institutions du passé. Pourtant, ces effets s'affaiblissent peu à peu, et cette liberté finit par agir très peu sur les sentiments, car, là où elle est usuelle, elle agit surtout par les dérivations qui, nous le savons déjà, n'ont en général pas grand effet. Mais c'est justement pourquoi il devient alors efficace de passer sous silence un fait, un raisonnement, car c'est l'un des cas où l'effet direct dépasse de beaucoup l'effet indirect.
Les considérations auxquelles nous venons de nous livrer nous conduisent à la limite où commence l'étude des mesures aptes à atteindre un but, c'est-à-dire l'étude des mouvements virtuels. Nous nous en occuperons plus loin (§1825 et sv.).
§ 1754. Jusqu'à présent, nous nous sommes exprimés comme si la société était une masse homogène. Mais puisque tel n'est pas le cas, ce que nous avons dit peut uniquement s'appliquer, et même seulement d'une manière approximative, à une couche de la population, telle qu'on puisse, sans erreur grave, la considérer comme homogène ; et pour connaître les effets sur l'ensemble de la population, il est nécessaire de tenir compte des effets sur les différentes couches (§2025 et sv.). De là provient un phénomène connu empiriquement depuis longtemps : celui de la diversité des effets de la liberté de manifester sa pensée, pour les gens cultivés et pour la partie inculte de la population. Mais c'est là un sujet dont nous parlerons plus à propos au chapitre suivant.
§ 1755. [Note ajoutée à l’édition française par l’auteur : [FN: § 1755-1a]] On a un bon exemple de l'action des dérivations dans les effets que produisent les grands journaux, de nos jours. Qu'ils aient un grand pouvoir, c'est une observation banale ; mais ce pouvoir ne provient pas de ce qu'ils puissent faire usage de la force pour imposer leurs raisonnements, ni de la valeur logico-expérimentale de ceux-ci, qui sont souvent puérils. Il naît seulement de l'art d'agir sur les résidus, au moyen des dérivations. Les résidus sur lesquels on veut agir doivent généralement préexister ; ce qui fixe les limites du pouvoir des journaux, qui ne peuvent aller à l'encontre des résidus, mais uniquement s'en servir en vue de leurs fins [FN: § 1755-1]. Exceptionnellement et à la longue, un résidu nouveau peut surgir, ou bien quelque résidu qui semblait disparu peut reparaître. Cette action sur les résidus explique aussi qu'il y ait des journaux d'opposition payés par les gouvernements [FN:§ 1755-2]. Au point de vue logique, la chose paraît absurde. Comment un gouvernement peut-il avoir assez peu de bon sens pour payer les gens qui parlent contre lui ? Mais si l'on prend garde aux sentiments, on aperçoit l'utilité de la mesure. Tout d'abord, le gouvernement obtient que le journal payé se taise opportunément, qu'il ne réveille pas le chat qui dort, qu'il pousse ses lecteurs à faire éclater leur colère par des moyens qui soient moins que d'autres dangereux pour le gouvernement. Ensuite, il y a des moments où une forte agitation s'empare du pays. À ces moments, une goutte d'eau peut faire déborder la coupe, et il est utile que les journaux d'opposition ne versent pas cette goutte. Enfin, et c'est surtout à quoi visent les puissants syndicats financiers qui, à l'instar du gouvernement, subsidient parfois des journaux apparemment ennemis, il y a un moyen de combattre certaines mesures, certains projets de lois, moyen qui a sur les sentiments un effet favorable, autant et plus que la meilleure défense. Il faut ajouter que le fait de disposer d'un journal d'opposition [FN:§ 1755-3] donne un moyen – et souvent c'est le seul – de faire parvenir jusqu'à ses adversaires certains discours qu'ils ne liraient pas dans les journaux favorables au gouvernement ou aux syndicats financiers, ou bien qu'ils tiendraient pour suspects, précisément parce qu'ils les lisent dans ces journaux. On a aussi un moyen puissant d'agir par les journaux, en passant sous silence certains faits, certains raisonnements, certains discours, certains ouvrages. Souvent, en certains cas, c'est uniquement le silence que le gouvernement ou la finance demandent aux journaux sur lesquels ils ont quelque influence [FN: § 1755-4]. Le mensonge par omission peut être aussi utile que le mensonge par commission.
Presque tous les grands journaux, y compris plusieurs de ceux qui s'affichent socialistes, sont directement ou indirectement liés à la ploutocratie qui règne aujourd'hui dans les pays civilisés, et aux gouvernements auxquels elle a part [FN:§ 1755-5]. Il est remarquable que la Confédération Générale du Travail ait senti cela, instinctivement, il est vrai, et l'ait exprimé dans le manifeste qu'elle publia à l'occasion de la guerre balkanique, en 1912 [FN: § 1755-6]. Nous ne parlons pas ici de la façon dont le sentiment est exprimé, c'est-à-dire de la dérivation, qui est absurde comme tant d'autres, mais uniquement du sentiment irraisonné, qui appartient à l'instinct. Tout cela est très connu [FN: § 1755-7], et aucune personne prenant part à la vie publique ou appartenant à la haute finance n'est assez naïve pour le nier, si on l'interroge en particulier ; mais en public, elle hausse les épaules, et nie hypocritement. Il est surprenant de voir des gens qui savent ces choses en général, et qui nonobstant accordent créance à leur journal, à des arguments sur lesquels on ne peut douter que l'argent de la finance internationale ait une grande influence. Par exemple, durant la guerre des Balkans, les nouvelles données par un grand nombre de journaux avaient avec la réalité beaucoup moins de rapport qu'avec les visées de la « spéculation » ou de la finance internationale [FN: § 1755-8] ; et pourtant ces nouvelles étaient crues par des personnes qui savaient bien quand et comment ces visées se manifestent. Les ploutocrates démagogues tels que Caillaux et Lloyd George sont loués, grâce à des arguments sonnants, par des journaux d'une grande renommée ; et beaucoup de petits poissons mordent à l'hameçon, ce qui n'est pas fait pour étonner, mais de gros poissons rusés s'y laissent prendre aussi, ce qui est moins facile à comprendre. Il est vrai que ces derniers feignent souvent de croire ce qui tourne à leur profit.
§ 1756. Il y a un petit nombre de dérivations très en usage pour agir sur les gens ignorants, et que nous trouvons dans les harangues au peuple d'Athènes, à celui de Rome, et bien davantage dans nos journaux. L'une des plus fréquentes a pour but de mettre en œuvre les sentiments d'autorité (IV-ε 2). Si l'on voulait donner une forme logique à la dérivation, on devrait dire : « Une certaine proposition A ne peut être bonne que si elle est faite par un homme honnête ; je démontre que celui qui fait cette proposition n'est pas honnête, ou qu'il est payé pour la faire ; donc j'ai démontré que la proposition A est nuisible au pays [FN:§ 1756-1] ». Cela est absurde ; et celui qui use de ce raisonnement sort entièrement du domaine des choses raisonnables. Il n'en est pas ainsi pour qui l'écoute et demeure persuadé, non par la force de la logique, mais par une association de sentiments. Cette personne, à son insu, a l'intuition qu'elle est incapable de juger directement si A est favorable ou contraire au bien du pays, qu'elle doit s'en remettre au jugement d'autrui ; et, pour accepter ce jugement, elle veut qu'il vienne d'une personne digne d'estime.
Cette dérivation est souvent presque la seule employée par certains journaux pour lesquels il n'existe plus de problèmes de choses, et qui résolvent toutes les questions par des injures contre les personnes. Il convient de remarquer que, pour les plumitifs, il est beaucoup plus facile d'injurier que de raisonner. C'est souvent un moyen efficace, parce que le public qui se repaît de ces écrits est ignorant, et parce qu'il juge plus avec le sentiment qu'avec la raison. Mais la corde trop tendue casse, et il est arrivé en beaucoup de pays que désormais l'injure et la calomnie lancées contre les hommes politiques ne soient plus très efficaces ; elles l'étaient bien davantage, lorsqu'elles étaient réprimées par les tribunaux et, de ce fait, moins habituelles.
§ 1757. Un genre remarquable de ces dérivations tend à mettre en œuvre les résidus sexuels. Une règle qui souffre peu d'exceptions, voulait, aux siècles passés, que les fidèles de la religion dominante accusassent de mauvaises mœurs les fidèles des sectes dissidentes (§1341 et sv.). À vrai dire, les faits étaient presque toujours faux [FN:§ 1757-1] : mais peu importe : supposons qu'ils fussent vrais. En ce cas, la dérivation contient une partie logique ; c'est-à-dire que l'on peut à bon droit l'opposer justement à celui qui prêche une certaine morale et agit contrairement à cette morale. Mais une telle partie disparaît, quand on emploie la dérivation contre des hommes politiques ou contre des souverains. Les faits démontrent clairement qu'il n'existe pas le moindre rapport entre les mœurs sexuelles d'un homme et sa valeur comme homme politique ou comme souverain. Et pourtant, c'est un argument que les ennemis de ces hommes emploient presque toujours contre eux, et quand la haine est vive, l'accusation de relations incestueuses devient normale. De simples hommes politiques eurent l'honneur d'être traités, sous ce rapport, à l'égal des souverains.
§ 1758. En général, les dérivations qui agissent sur les résidus sexuels ont l'avantage de pouvoir être difficilement réfutées, et de nuire à l'adversaire, même, si par hasard, la réfutation est parfaite. Par exemple, on a affirmé, mais sans pouvoir le prouver, que Napoléon Ier avait eu des rapports sexuels avec ses sœurs ; et pour beaucoup de gens, cela suffit pour le condamner comme homme privé, comme homme politique, comme souverain. De même autrefois, l'accusation d'hérésie, même non prouvée, suffisait pour qu'un homme fût au moins suspect aux bons catholiques. Aujourd'hui, l'hérésie de la religion sexuelle occupe la place tenue jadis par l'hérésie de la religion catholique.
§ 1759. D'autres dérivations très en usage sont les dérivations verbales. Par exemple, aux temps de la Restauration, en France, tout ce qui déplaisait au parti dominant portait l'épithète de « révolutionnaire », et c'était une condamnation suffisante. Aujourd'hui, on dit « réactionnaire », et c'est aussi une condamnation suffisante. De cette façon, on fait agir les sentiments de parti, de secte (résidus de la sociabilité, IVe classe).
§ 1760. La concurrence des grands journaux n'est pas considérable, parce que fonder un de ces journaux coûte beaucoup. Par conséquent, il peut être très utile d'avoir plusieurs journaux à sa disposition, et il est utile aussi qu'ils appartiennent à divers partis. C'est ce qu'ont très bien compris les puissants syndicats financiers : aidés de la forme anonyme des sociétés qui possèdent les journaux, ils ont su acquérir de l'influence sur ces sociétés et s'en servir adroitement [FN: § 1760-1]. On cite les noms de plusieurs journaux appartenant à des partis opposés, ennemis même, et qui dépendent d'un même trust de journaux. Parmi les faits de ce genre, plusieurs sont établis par de bonnes preuves. En somme ces trusts exploitent les sentiments des lecteurs de journaux, et leur influence est du même genre, mais beaucoup plus grande, que celle dont jouirent les jésuites [FN:§ 1760-2].
§ 1761. Revenons au sujet général des rapports entre les dérivations et les résidus. Il faut prendre garde que souvent nous nous imaginons que les dérivations se sont transformées en résidus, tandis que c'est le phénomène opposé qui a eu lieu : que ce sont les résidus qui se manifestent par les dérivations (§1747, 1751). Nous sommes facilement induits en cette erreur par la manière dont les phénomènes sociaux nous sont connus. Nous en avons connaissance surtout par la littérature ; aussi nous est-il facile de prendre l'effet pour la cause, et de croire que ce qu'exprime la littérature est la cause, tandis que ce n'est que l'effet.
§ 1762. Par exemple, nous observons, en un certain temps, qu'une conception donnée prend naissance dans les productions littéraires, puis se développe, croît avec vigueur, et il nous semble que nous décrivons bien les faits en disant que c'est la littérature qui a fait entrer cette conception dans l'esprit des hommes. Cela peut parfois arriver ; mais le cas inverse est beaucoup plus fréquent : ce sont les sentiments existant dans l'esprit des hommes, qui ont fait naître, croître et prospérer cette littérature (§1751). Ajoutons que les résidus du genre (IV- ε 2), c'est-à-dire les sentiments d'autorité, agissent de manière à nous induire en erreur. Quand nous lisons les oeuvres d'un grand écrivain, il nous semble évident que lui seul a eu le pouvoir de façonner la société selon les conceptions qu'il exprime.
§ 1763. Lorsque nous lisons, par exemple, les œuvres de Voltaire, nous sommes poussés à croire qu'il a été l'artisan de l'incrédulité qui se manifeste chez les hommes de son temps. Mais, en y réfléchissant un peu, nous nous demandons comment, si c'est là une règle générale, les œuvres de Lucien, qui ne le cèdent en rien à celles de Voltaire, tant pour la perfection littéraire que pour la force de la logique, n'ont pas eu un effet semblable à celles de Voltaire, et comment il se fait que Lucien reste seul dans son incrédulité, tandis qu'autour de lui croissaient la foi et la superstition. Il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer ces faits et tant d'autres semblables, qu'en reconnaissant que la semence jetée germe ou ne germe pas, suivant qu'elle tombe dans une terre favorable ou défavorable.
En France, les philosophes du XVIIIe siècle ont reproduit contre le christianisme des arguments avancés déjà par l'empereur Julien et par Celse. Pourquoi eurent-ils un succès que n'eurent pas leurs prédécesseurs ? Évidemment parce que les esprits des hommes auxquels ils s'adressaient étaient différents.
Il y a plus : si Voltaire avait été l'artisan principal des idées répandues parmi ses concitoyens, ces idées n'auraient pas dû diminuer d'intensité, tant que durait l'activité littéraire de leur auteur. Au contraire, vers la fin de la vie de Voltaire, lorsque sa renommée allait encore croissant, voilà qu'un mouvement entièrement opposé à ses théories se manifeste, et que les classes cultivées se tournent vers Rousseau. En vérité, celui-ci n'a guère fait qu'exprimer des dérivations correspondant à des résidus négligés par Voltaire ; c'est à cette circonstance qu'il a dû la faveur du public ; de même que Voltaire dut la faveur dont il jouit aux dérivations correspondant à d'autres résidus. Ces auteurs ne furent pas les artisans des sentiments du public ; ce sont, au contraire, ces sentiments qui furent les artisans de la renommée de ces auteurs.
Il faut entendre cela de la partie principale du phénomène (§1747), car les faits montrent clairement que l'œuvre des auteurs n'a pas été entièrement vaine, et qu'elle a pourtant produit quelque effet ; mais celui-ci, comparé au premier, apparaît secondaire.
§ 1761. Les observations que nous venons de faire se rapportent à l'efficacité de certains raisonnements, mais n'ont rien à voir avec la valeur intrinsèque de ces raisonnements. Il est évident que la valeur scientifique d'un Newton, la valeur en l'art de la guerre d'un Napoléon Ier ou d'un Moltke, l'habileté politique d'un Bismarck, la valeur littéraire d'un Lucien ou d'un Voltaire, n'ont rien à faire avec les résidus. Mais pour qu'elles obtiennent des effets importants, il est nécessaire qu'elles rencontrent des circonstances favorables, dans des sociétés où existent certains résidus. Si Newton avait vécu au moyen âge, il n'aurait peut-être produit qu'une œuvre de théologie ; si Voltaire avait vécu au temps de Lucien, il n'aurait pas trouvé d'écho, et si Lucien avait vécu au temps de Voltaire, ses doctrines seraient devenues populaires ; si Bismarck avait vécu en un pays ou auraient régné les politiciens démocrates ou les ploutocrates, il serait peut-être resté parfaitement inconnu, et si même il avait pu parvenir jusqu'au Parlement, il s'y serait vu préférer un Depretis ou un Giolitti, en Italie, un Rouvier ou un Caillaux, en France.
§ 1765. Il est encore une autre cause à l'erreur qui attribue aux dérivations une part trop grande dans la détermination de l'équilibre social. Elle naît du fait qu'on attribue une existence objective à certaines notions, à certains principes, à certains dogmes, et qu'on raisonne ensuite comme s'ils agissaient par leur vertu propre, indépendamment des résidus. Les résidus de la IIe classe (persistance des agrégats) agissent fortement pour produire cette illusion. Les entités métaphysiques qui sont créées grâce à eux sont entièrement semblables aux dieux des théologiens, et agissent d'une manière analogue. Autrefois, peu nombreuses étaient les histoires qui racontaient les événements et en cherchaient les rapports, sans faire intervenir les dieux. De nos jours, peu nombreuses sont celles qui, explicitement ou implicitement, n'admettent pas que principes et théories donnent au phénomène social sa forme.
§ 1766. (d) ACTION DES DÉRIVATIONS SUR LES DÉRIVATIONS. Nous avons déjà
traité de ce sujet, en étudiant les dérivations, et nous avons remarqué comment, lorsqu'un type devient à la mode, des dérivations de ce genre naissent en grand nombre. Les résidus de la sociabilité, qui poussent l'homme à ressembler à ses concitoyens, à les imiter, agissent pour donner une forme commune à certaines dérivations. En outre, celui qui, en un cas spécial, a été empêché par l'intensité de ses sentiments, de voir le vice d'un certain raisonnement, est facilement entraîné à ne plus apercevoir ce vice, en d'autres cas où il ne serait pas détourné par la force des sentiments. Cela favorise la production de dérivations semblables à celles qui sont employées dans ce cas spécial [FN: § 1766-1]. Ajoutons qu'il faut beaucoup moins d'effort intellectuel pour imiter que pour créer. C'est pourquoi les auteurs de second ordre ont l'habitude de répéter des phrases, des formules, des raisonnements employés par les auteurs d'une autorité et d'une renommée plus grandes.
§ 1767. L'action mutuelle des dérivations est très importante elle a pour effet de faire disparaître, du moins en apparence, la contradiction qu'il peut, au fond, y avoir entre ces dérivations. Nous en avons déjà parlé longuement, et nous avons aussi remarqué l'erreur d'un grand nombre de personnes cultivées, qui, parce qu'elles ont un besoin puissant de logique, apparent ou réel, s'imaginent que tout le monde, et chacun au même degré, éprouve ce besoin. C'est pourquoi, entre autres choses, elles produisent des religions scientifiques, croyant satisfaire un besoin populaire, tandis que ces religions demeurent à l'usage exclusif de leurs quelques fondateurs. Lorsqu'une dérivation est acceptée, il arrive que parmi les personnes cultivées, les littérateurs, les théologiens, les métaphysiciens, les pseudo-savants, il est des personnes qui en tirent des conséquences logiques, lesquelles s'écartent toujours plus des résidus qui correspondent à la dérivation dont ces conséquences sont issues, et qu'elles s'éloignent, par conséquent, toujours plus aussi de la réalité. Soient, par exemple, A, certains sentiments, certains résidus auxquels correspond la dérivation S : quand cette correspondance ne s'altère pas, S est un moyen d'exprimer un fait réel, et il ne s'en écarte que dans la forme.
Mais une déduction logique C, tirée de S, pourra s'écarter de A dans le fond, et de beaucoup (§2083). Ce fait se présente à nous sous différentes formes. 1° Forme du défaut de précision. La dérivation S, exprimée en langage vulgaire, ne correspond parfois à rien de précis, et n'est acceptée que par un accord indéterminé avec certains sentiments. Elle ne peut donc servir de prémisse à aucun raisonnement rigoureux (§826 et sv.). 2° Forme du défaut de correspondance. Dans l'hypothèse la plus favorable, même quand il y a correspondance entre S et A, celle-ci n'est jamais parfaite, et, par conséquent, les déductions tirées de S ne s'appliquent pas à A. C'est pourquoi, considérant ensemble ces deux formes, on peut dire que, vu le défaut de précision ou de correspondance de S, on ne peut tirer de S aucune déduction rigoureuse, ou bien si l'on peut en tirer, elles ne s'appliquent pas à A. 3° Forme de l'ensemble des sentiments. Le groupe de sentiments A n'est jamais bien défini. Par conséquent, le défaut de correspondance entre A et S naît, non seulement de l'imperfection de la correspondance entre la partie définie de A et de B, entre le noyau de la nébuleuse des sentiments et S, mais en outre du défaut complet de correspondance entre la partie indéfinie de A et S, entre les nues qui entourent le noyau de A et de S. 4° Forme de la mutuelle dépendance des groupes de sentiments. Le groupe A n'est pas indépendant d'autres groupes M, P, Q... Chez l'individu, ces groupes se sont accommodés au mieux pour exister ensemble ; ils vivent en un certain accord, qui est rompu par leurs conséquences logiques (§1937). Par exemple, autrefois chez beaucoup de seigneurs chrétiens, on trouvait, imposé par la religion, le sentiment A du pardon des injures et le sentiment M, imposé par les nécessités de la vie pratique, de la défense de l'honneur, et aussi de la vengeance. Mais cet accord eût été rompu entre les conséquences logiques de A et celles de M, si, d'une part, on avait tiré de A la conséquence que le seigneur devait souffrir patiemment, sans même se défendre, toute injure, tout mépris, et si, d'autre part, on avait tiré de M la conséquence que l'Évangile, qui ne tient aucun compte de M, est un livre absurde et inutile. 5° Forme de la correspondance entre les théories et les faits sociaux. Si, pour chaque individu, la correspondance entre A et S était parfaite, elle le serait aussi pour une collectivité composée d'individus semblables, et de S, on pourrait déduire logiquement les actions de cette collectivité. La connaissance des formes politiques et sociales deviendrait aisée. En effet, il n'est pas difficile de connaître les dérivations qui ont cours dans une société ; et si de ces dérivations on pouvait tirer logiquement la connaissance des faits politiques et sociaux, la science sociale ne rencontrerait pas, pour se constituer des difficultés ni plus grandes ni autres que celles rencontrées par la géométrie. On sait assez qu'il n'en est pas ainsi, et que ces raisonnements géométriques nous écartent toujours, peu ou prou, de la réalité. Mais c'est une erreur que d'en accuser la nature du raisonnement : ce sont les prémisses qui nous écartent de la réalité. C'est aussi une erreur que vouloir apprécier l'importance sociale d'un résidu par la correspondance, avec la réalité, des déductions qu'on tire de ce résidu, tandis qu'au contraire, cette importance consiste surtout dans sa correspondance avec les sentiments qu'il exprime [FN:§ 1767-1].
Nous avons souvent déjà et longuement parlé des problèmes qui revêtent les quatre premières formes. Il nous reste maintenant à étudier à fond ceux de la cinquième ; mais ils font partie d'une question plus générale dont nous allons nous occuper.
§ 1768. RAPPORT DES RÉSIDUS ET DES DÉRIVATIONS AVEC LES AUTRES
FAITS SOCIAUX. Nous avons vu (§802, 803) qu'il y a correspondance entre les sciences logico-expérimentales, qui partent de principes expérimentaux (A) pour en tirer avec une logique rigoureuse des conséquences (C), et les raisonnements sociaux qui partent de résidus (a), pour en tirer, par des dérivations (b), mélangées de résidus et de logique, des conséquences (c). Excluons pour un moment le cas où les observations ne seraient pas bonnes, ou dans lequel la logique serait erronée ; alors les conclusions des sciences logico-expérimentales concorderont sûrement avec les faits, puisque les principes (A) représentent précisément des faits, et le raisonnement est rigoureux. Mais on ne peut en dire autant des raisonnements sociaux, puisque nous ne savons en quel rapport les résidus (a) sont avec les faits, ni quelle valeur a le raisonnement (b) dont d'autres résidus font partie. Et pourtant, l'expérience journalière fait voir qu'un grand nombre de ces raisonnements conduisent à des conséquences concordant avec les faits ; et cela ne peut être mis en doute, si l'on prend garde que ces raisonnements sont les seuls qu'on emploie dans la vie sociale, et que, s'ils conduisaient à des résultats ne concordant pas en général avec les faits, il y a longtemps que toutes les sociétés auraient été détruites, anéanties. Comment peut bien se produire cet accord avec les faits, des conclusions tirées des résidus ?
§ 1769. La solution de ce problème doit être cherchée dans le rapport où se trouvent les résidus et les dérivations avec les faits sociaux. Si les résidus étaient l'expression de ces faits, comme le sont les principes des sciences expérimentales, si les dérivations étaient rigoureusement logiques, l'accord des conclusions avec l'expérience devrait être certain et parfait. Si les résidus étaient pris au hasard, si les dérivations l'étaient aussi, cet accord serait extraordinairement rare. Donc, puisque l'accord a lieu souvent mais non toujours, résidus et dérivations doivent occuper une position intermédiaire entre les deux extrêmes notés tout à l'heure. On prendra garde qu'un résidu qui s'écarte de l'expérience peut être corrigé par une dérivation qui s'écarte de la logique, de telle sorte que la conclusion se rapproche des faits expérimentaux. Cela se produit parce qu'en accomplissant des actions non-logiques, les hommes, poussés par l'instinct, se rapprochent précisément de ces faits expérimentaux (§1776), et, sans s'en apercevoir, corrigent par un mauvais raisonnement les conséquences tirées d'un résidu qui s'écarte de la réalité.
§ 1770. Le problème que nous examinons est une partie d'une question encore plus générale : la façon dont les formes des êtres vivants et celles des sociétés sont déterminées. Ces formes ne sont pas produites au hasard ; elles dépendent des conditions dans lesquelles vivent les êtres et les sociétés. Mais quelle est précisément cette dépendance, nous ne le savons pas, après avoir dû écarter la solution darwinienne qui nous l'aurait enseigné. Pourtant si nous ne pouvons résoudre complètement le problème, nous pouvons du moins connaître certaines propriétés des formes et des résidus. Tout d'abord, il est évident que ces formes et ces résidus ne peuvent être en contradiction trop flagrante avec les conditions dans lesquelles ils sont produits ; c'est ce qu'il y a de vrai dans la solution darwinienne (§828, 2142). Un animal qui a seulement des branchies ne peut vivre dans l'air sec ; un animal qui a seulement des poumons ne peut vivre perpétuellement immergé ; de même des hommes qui ont seulement des instincts anti-sociaux ne pourraient vivre en société. Ensuite, on peut pousser plus loin et reconnaître qu'il y a une certaine adaptation entre les formes et les conditions de vie. La solution darwinienne est erronée, parce qu'elle veut cette adaptation parfaite ; mais cela n'empêche pas qu'en gros l'adaptation a lieu. Il est certain qu'animaux et plantes ont des formes adaptées en partie, et parfois merveilleusement adaptées à leurs conditions d'existence. De même, on ne peut nier que les peuples aient des instincts plus ou moins adaptés à leur genre de vie (§ 1937). Prenons garde pourtant que c'est là un rapport entre deux choses, mais il n'est nullement établi que l'une soit conséquence de l'autre. Reconnaissons que le lion vit de proie et a des armes puissantes pour la capturer, mais ne disons pas qu'il vit de proie, parce qu'il a ces armes, ou qu'il a ces armes parce qu'il vit de proie. Un peuple belliqueux a des instincts belliqueux ; mais nous ne disons pas s'il est belliqueux à cause de ses instincts, ou s'il a ces instincts parce qu'il est belliqueux.
§ 1771. Maintenant, nous avons, très en gros, la solution de notre problème. Les raisonnements sociaux donnent des résultats qui ne s'écartent pas trop de la réalité, parce que les résidus, soit ceux dont proviennent les dérivations, soit ceux qui servent à dériver, se rapprochent graduellement de la réalité. Si les premiers résidus sont dans ce cas, et si les dérivations sont quelque peu logiques, on obtient des conséquences qui, d'habitude, ne s'écartent pas trop de la réalité. Si les premiers résidus ne sont pas dans le cas indiqué plus haut, ils sont corrigés par les seconds, qui conseillent l'usage de dérivations sophistiques, pour se rapprocher de la réalité.
§ 1772. Voyons maintenant d'autres particularités du phénomène. Nous pouvons, pour la correspondance entre les résidus et les autres faits sociaux, répéter les considérations présentées déjà au §1767, pour la correspondance entre les dérivations et les résidus. 1° Certains résidus correspondent assez mal aux faits dont dépend l'organisation sociale. On ne peut en aucune façon les faire correspondre à des principes logico-expérimentaux tirés de ces faits. 2° Même les résidus qui, tant bien que mal, correspondent aux faits déterminant l'organisation sociale, et qui, en gros, correspondent à des principes logico-expérimentaux tirés de ces faits, n'ont pas une correspondance précise, et manquent totalement de la précision exigée pour de tels principes.
Au sujet des dérivations, nous pouvons remarquer qu'habituellement elles vont au delà de la réalité dans le sens qu'elles indiquent, et qu'au contraire, elles demeurent très rarement en deçà. On peut noter trois formes principales dans ce phénomène. Tout d'abord, à cause de la tendance que le sentiment a de pousser à l'extrême, les dérivations ont une tendance marquée à se transformer en idéal et en mythe : une inondation locale devient facilement le déluge universel ; l'utilité, pour la vie en société, de suivre certaines règles se transforme en commandements divins ou en impératif catégorique. Ensuite, la nécessité d'énoncer en peu de mots les dérivations pour les faire accepter et pour les imprimer dans l'esprit, fait que l'on prend garde uniquement au principal, et qu'on néglige l'accessoire : on énonce un principe, sans faire attention aux restrictions, aux exceptions, qui le rapprocheraient beaucoup plus de la réalité. On dit : « Tu ne tueras point », allant ainsi très au delà de la règle qu'on veut établir, et qu'on exprimerait longuement, en indiquant dans quels cas et dans quelles circonstances on ne doit pas tuer, dans quels autres on peut, dans quels autres encore on doit tuer. On dit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », allant ainsi au delà de la règle qu'on veut établir, pour que les hommes vivant en une collectivité donnée se témoignent une mutuelle bienveillance. Enfin, l'efficacité d'une foi pour pousser les hommes à une action énergique est d'autant plus grande que la foi est plus simple, plus absolue, plus dépourvue de restrictions et de doutes, c'est-à-dire qu'elle s'écarte plus du scepticisme scientifique. De là vient que la dérivation, dans la mesure où elle a pour but de pousser les hommes à agir, emploie des principes simples qui dépassent la réalité, qui tendent à un but au delà et souvent très au delà de celle-ci. En conclusion, pour revenir des dérivations à la réalité, il est presque toujours nécessaire de faire la part de l'exagération.
Les conditions qui, d'une argumentation font une bonne dérivation, sont donc très souvent opposées à celles qui en font un bon raisonnement logico-expérimental, et autant l'argumentation se rapproche de l'une de ces limites, autant elle s'éloigne de l'autre. Mais le raisonnement logico-expérimental correspond à la réalité, et par conséquent, si les hommes qui agissent suivant les dérivations se rapprochent de la réalité, il faut que la divergence existant entre ces dérivations et la réalité soit corrigée en une certaine mesure. Cette correction est obtenue grâce au contraste et à la composition (§2087 et sv.) des nombreuses dérivations qui existent dans une société. La forme la plus simple, mais aussi la moins
fréquente, sous laquelle ce phénomène se manifeste, est celle de deux dérivations, A et B, directement contraires, telles que A, dépassant la réalité d'une part, B d'autre part. A et B se rapprochent beaucoup plus de la réalité lorsqu'elles existent ensemble, que chacune d'elles considérée séparément : par exemple, la dérivation A, qui prescrit d'aimer son prochain comme soi-même, et la dérivation B, qui impose le devoir de vengeance. La façon la plus compliquée, mais aussi la plus fréquente, est celle de nombreuses dérivations A, B, C,. , qui ne sont pas directement opposées, et qui, unies, composées ensemble (§2087 et sv., 2152 et sv.), donnent une résultante, laquelle se rapproche beaucoup plus de la réalité que chacune d'elles ; par exemple, les nombreuses dérivations qu'on observe chez tous les peuples civilisés, sur le droit des gens, sur l'égoïsme patriotique, sur l'indépendance de la justice, sur la raison d'État, sur l'abolition de l'intérêt de l'argent, sur l'utilité d'accroître la dette publique, etc.
§ 1773. COMMENT LA DIVERGENCE ENTRE LES RÉSIDUS ET LES PRINCIPES LOGICO-EXPÉRIMENTAUX AGIT SUR LES CONCLUSIONS. Supposons que nous raisonnions selon la méthode logico-expérimentale, en prenant comme prémisses certains résidus (a). Nous arriverions ainsi à des conclusions (c). Si nous raisonnions de la même manière sur des principes rigoureusement expérimentaux (A), nous aboutirions à des conclusions (C). Nous voulons savoir en quel rapport se trouvent les conclusions (c) avec les conclusions (C). Pour cela, il faut savoir en quel rapport les résidus (a) sont avec les principes (A). Faisons une hypothèse qui se vérifie en certains cas. Supposons que (a) coïncide avec (A), seulement entrer certaines limites, et qu'au delà de ces limites il s'écarte de (A), ou bien que certains résidus, ou les propositions qui les expriment, représentent la réalité seulement entre certaines limites, et voyons quelles conclusions on peut tirer de ces propositions. Il faut distinguer le cas où les limites sont connues, de celui où elles sont inconnues. Si elles sont connues, le problème est bientôt résolu. Les conclusions tirées de ces propositions seront vraies dans les limites entre lesquelles s'appliquent les dites propositions. Les propositions scientifiques sont toutes de ce genre, et se vérifient entre des limites plus ou moins éloignées.
§ 1774. Si les limites ne sont pas connues, le problème est beaucoup plus difficile et souvent insoluble. Malheureusement pour les raisonnements sociaux, pour les raisonnements par dérivations, les limites nous sont peu ou point connues ; aussi devons-nous nous contenter de solutions grossièrement approximatives. Nous pouvons dire que de propositions vraies entre certaines limites mal connues, on tire des conclusions qui concordent avec les faits, pourvu que le raisonnement ne nous écarte pas trop de l'état où les propositions sont vraies. C'est bien peu de chose, et l'on peut s'en contenter uniquement parce que peu est mieux que rien.
§ 1775. Exemples. On sait que sous la pression barométrique de 760 mm. de mercure, lorsque la température monte de 4 à 100° centigrades, le volume de l'eau augmente. Dans ce cas, les limites entre lesquelles la proposition est vraie sont bien déterminées, et nous sommes avertis de ne pas l'étendre au delà de ces limites ; en effet, de 0 à 4°, le volume de l'eau diminue au lieu d'augmenter. Quand nous disons que dans une société donnée, il est utile que les mesures sociales soient décidées par la majorité des citoyens, même en laissant de côté le défaut de précision de cette proposition, nous ignorons entre quelles limites elle concorde avec les faits. Il est probable que l'on répondrait négativement à qui demanderait s'il est utile que la moitié plus un des hommes d'une société puissent décider de tuer et de manger l'autre moitié moins un. Mais il est probable aussi que l'on répondrait affirmativement à qui demanderait s'il est utile que la moitié plus un puisse décréter une loi pour la circulation des automobiles. Entre certaines limites, la proposition peut donc concorder avec les faits, tandis qu'entre certaines autres elle ne concorde pas. Mais quelles sont ces limites ? Nous ne sommes pas en mesure de donner une réponse satisfaisante à cette question [FN: § 1775-1].
§ 1776. Là où la science fait encore défaut, l'empirisme vient à l'aide. Il a et il aura longtemps encore une très grande part en matière sociale, et souvent il corrige les défauts des prémisses (§1769). Celui qui a une bonne carte topographique et sait bien s'en servir trouvera sûrement le chemin pour aller d'un lieu à un autre. Mais l'animal, guidé par l'instinct, le trouvera tout aussi bien, et parfois mieux ; de même l'homme qui, pour avoir parcouru plusieurs fois ce chemin, le suit d'instinct. Celui qui a une mauvaise carte topographique, et l'interprète rigoureusement, trouvera peut-être moins facilement son chemin que ceux qui se trouvent dans les cas extrêmes mentionnés tout à l'heure. Les géographes anciens disaient que le Péloponèse avait la forme d'une feuille de platane [FN: § 1776-1]. Celui qui part de cette prémisse et raisonne logiquement, connaîtra moins bien la topographie du Péloponèse que celui qui a une carte moderne faite suivant les règles de l'art, et même, si l'on veut, que celui qui a une carte médiocre du Péloponèse. Celui qui se décide au hasard se rapproche du premier quant à l'accord avec l'expérience. Viennent ensuite ceux qui se laissent guider par les résidus et par les dérivations ; ils ressemblent à celui qui sait que le Péloponèse a la forme d'une feuille de platane. Enfin, nous avons ceux qui sont simplement des hommes pratiques ; ils ressemblent à l'ignorant qui a parcouru le Péloponèse en long et en large. Ces deux catégories de personnes obtiennent souvent des résultats qui ne s'écartent pas trop de l'expérience.
§ 1777. On a l'habitude de dénommer fausses les propositions qui ne sont pas un simple résumé de l'expérience, comme le sont les principes expérimentaux. Voyous ce qu'on peut tirer de ces propositions. Il faut d'abord expliquer le terme faux. Si l'on indique par là une proposition entièrement en désaccord avec les faits, aucun doute que, raisonnant logiquement sur des prémisses fausses, on arrive à des conclusions fausses, c'est-à-dire ne concordant pas avec les faits. Mais le terme faux désigne souvent une explication fausse d'un fait réel ; et, en ce cas, de ce genre de propositions, on peut, entre certaines limites, tirer des conclusions vraies, c'est-à-dire concordant avec les faits.
§ 1778. Exemples. Pour expliquer comment la pompe aspire l'eau, on disait autrefois que « la Nature avait horreur du vide ». Le fait était vrai. L'explication fausse. Raisonnant maintenant d'une manière semblable à celle dont on raisonnait alors, nous pouvons néanmoins tirer de cette explication des conclusions qui sont vérifiées par l'expérience. On prend une bouteille et on la remplit d'eau ; on la ferme avec la main ; on plonge le col dans l'eau et l'on enlève la main. Qu'arrivera-t-il ? Nous répondrons : « L'eau restera suspendue dans la bouteille, parce que, si elle en sortait, la bouteille resterait vide, et nous savons que cela n'est pas possible, puisque la Nature a horreur du vide ». Faisons l'expérience, et nous verrons que la conclusion concorde avec le fait. Faisons la même expérience avec un tube fermé à l'un des bouts, haut d'un mètre, plein de mercure, et dont l'autre bout est ouvert et plonge dans un bain de mercure. La conclusion précédente ne se vérifie plus : le mercure descend dans le tube et en laisse vide une partie. Si, au lieu d'un fait physique, il s'agissait d'un fait social, d'autres dérivations pour l'expliquer ne feraient pas défaut. On pourrait, par un beau et subtil raisonnement, analogue à ceux qui sont en usage dans les théories du droit naturel, démontrer que l'horreur de dame Nature pour le vide cesse à environ 760 mm. de mercure. On sait que le nombre 7 est parfait, de même le nombre 6 ; unis, ils doivent donner un ensemble absolument parfait, et l'amour de dame Nature pour cet ensemble parfait peut vaincre l'horreur qu'elle a pour le vide. Si la hauteur du mercure était exprimée en pouces ou en tout autre système de mesures, cela n'apporterait aucune difficulté. Bien des auteurs, entre autres Nicomaque Gerasene (§963), nous enseigneraient à trouver toujours la perfection du nombre que nous aurions en vue. À qui objecterait que la hauteur à laquelle dame Nature cesse d'avoir horreur du vide est beaucoup plus grande avec l'eau qu'avec le mercure, on pourrait répondre qu'il en doit être ainsi, car enfin l'eau est « le meilleur des éléments », et que, par conséquent, elle doit être privilégiée au regard du mercure. Ce raisonnement vaut à peu près ceux de M. Léon Bourgeois sur la solidarité.
Pour expliquer pourquoi on devait secourir les voyageurs étrangers, les païens grecs disaient que ces voyageurs étaient envoyés par Zeus, et les chrétiens citaient l'Évangile, où il est dit que celui qui accueille l'étranger accueille Jésus-Christ. Si, de ces propositions on tire la conclusion qu'il est utile de secourir l'étranger, on a une proposition qui peut concorder avec les faits pour les peuples anciens et aussi, dans une plus faible proportion, pour les peuples modernes. C'est une conclusion semblable à celle à laquelle nous avons abouti pour la bouteille pleine d'eau. Si l'on voulait tirer ensuite la conclusion, qui ressort logiquement aussi, à savoir que les étrangers doivent être honorés, suivant les Grecs comme envoyés de Zeus, suivant les chrétiens comme s'ils étaient Jésus-Christ en personne, on aurait des conclusions qui n'ont jamais concordé avec les faits, ni chez les Grecs ni chez les chrétiens.
Donc, en raisonnant grosso modo, nous pouvons dire que des dérivations existant en une société donnée, on peut tirer des conclusions qui seront vérifiées par l'expérience, pourvu : 1° qu'on déduise une certaine tare de ces dérivations, qui vont habituellement au delà du but auquel on vise en réalité (§1772) ; 2° que le raisonnement ne nous éloigne pas trop de l'état de cette société ; 3° qu'on ne pousse pas à l'extrême limite logique le raisonnement qui a pour prémisses les résidus correspondant à ces dérivations. Les termes certaine tare, trop, extrême limite, sont peu précis, justement parce qu'on ne précise pas les limites entre lesquelles les dérivations ou les résidus qui les produisent, correspondent aux faits, et aussi parce que, dans le langage vulgaire, les dérivations sont exprimées d'une manière peu ou pas rigoureuse. On énoncerait peut-être plus clairement la dernière des conditions posées tout à l'heure, en disant que le raisonnement sur les dérivations doit être plus de forme que de fond, et qu'en réalité il convient de se laisser guider par le sentiment des résidus, plutôt que par la simple logique [FN:§ 1778-1].
§ 1779. Vers la fin du XIXe siècle, en France, le parti révolutionnaire trouva bon de mettre en pratique l'œuvre de certains théoriciens qu'on appelle « intellectuels », et qui voulaient précisément soumettre la pratique aux conclusions qu'ils tiraient logiquement de certains de leurs principes (§1767-1). Les « intellectuels » croyaient naïvement récolter l'admiration des gens qui se servaient d'eux uniquement comme d'instruments ; et ils opposaient orgueilleusement les splendeurs de leur logique aux ténèbres des « préjugés » et des « superstitions » de leurs adversaires ; mais, en fait, ils s'éloignaient de la réalité beaucoup plus que ceux-ci. Par exemple, quelques « intellectuels » partaient du principe qu'on ne doit jamais condamner un innocent, et en tiraient les conséquences les plus extrêmes, sans vouloir entendre autre chose (§2147, exemple II). Il est évident que ce principe est utile à une société, mais il est vrai aussi que cela n'a lieu qu'en de certaines limites. Pour réfuter cette affirmation, il serait nécessaire de suivre l'une des deux voies suivantes : 1° nier qu'il puisse y avoir divergence entre l'observation de ce principe et la prospérité d'une nation ; 2° ou bien affirmer que l'homme ne doit pas se soucier de cette prospérité, mais bien se contenter de suivre ce principe. Ni l'une ni l'autre de ces propositions n'étaient admises par les « intellectuels », gens en réalité beaucoup moins logiques qu'ils ne voulaient le paraître ; elles auraient mieux trouvé leur place parmi les « superstitions » attaquées par les « intellectuels », car la première ne diffère pas beaucoup de celle qui affirme que Dieu récompense les bons et punit les méchants ; la seconde est celle du croyant ascète qui méprise les biens terrestres. La politique faite de cette manière est puérile ; et les « intellectuels » étaient ainsi plus loin de la réalité que beaucoup de politiciens pratiques de petite envergure.
§ 1780. On peut parcourir à rebours la voie suivie par les dérivations ; c'est-à-dire que de certaines manifestations on peut déduire les principes dont elles sont la conséquence logique. Dans les sciences logico-expérimentales, si les manifestations concordent avec les faits, les principes dont ils sont la conséquence concordent aussi. Il n'en est pas ainsi dans les raisonnements à dérivations : les principes dont les manifestations seraient la conséquence logique, peuvent être en contradiction complète avec les faits (§2024).
§ 1781. Par exemple, voici un tolstoïen qui réprouve toute guerre, même si elle est strictement défensive. Le principe dont on déduit cette doctrine est que les hommes, pour être heureux, « ne doivent pas résister au mal ». Mais le résidu qui est ainsi exprimé est très différent ; c'est un résidu subjectif, au lieu d'être un résidu objectif. Pour demeurer en accord avec les faits, le tolstoïen devrait dire : « Je m'imagine que je serais heureux si je ne résistais pas au mal ». Ce qui n'empêche pas qu'un autre puisse, au contraire, se sentir malheureux s'il ne résiste pas au mal ; et pour changer sa proposition subjective en proposition objective, le tolstoïen devrait démontrer, ce qu'il ne fait ni ne peut faire, que les autres hommes doivent se rendre malheureux pour lui faire plaisir. Le tolstoïen qui raisonne avec une logique rigoureuse, tire du principe que « l'on ne doit pas résister au mal », des conséquences qui peuvent atteindre le comble de l'absurde. Le tolstoïen qui ne s'est pas placé entièrement en dehors de la réalité, sacrifie la logique, se laisse guider par les sentiments, parmi lesquels il y a aussi ceux de la conservation individuelle et de la conservation sociale, et aboutit à des conséquences moins absurdes ; bien plus, s'il sait employer une subtile casuistique, et s'il ne répugne pas à laisser de côté la logique rigoureuse, il peut même aboutir à des conséquences qui concordent avec les faits.
§ 1782. De cette façon, et pour résumer, nous sommes portés à affirmer qu'en des cas semblables, raisonner avec une logique tout à fait rigoureuse conduit à des conclusions contredites par les faits, et que raisonner très défectueusement au point de vue logique, avec des sophismes évidents, peut conduire à des conclusions qui se rapprochent beaucoup plus des faits.
§ 1783. Cette proposition provoquera l'indignation des nombreuses personnes qui s'imaginent que raison et logique sont les guides des sociétés humaines ; et pourtant ces personnes admettent sans s'en apercevoir, et sous d'autres formes, des propositions qui sont équivalentes à celle-là. Par exemple, tout le monde a toujours, opposé la théorie à la pratique ; et même les hommes qui, en certaines matières, sont exclusivement théoriciens, reconnaissent en d'autres matières l’utilité, la nécessité de la pratique. De semblables propositions sont des dérivations qui manifestent les faits suivants. 1° Quand la théorie part de propositions rigoureusement scientifiques, elle isole par abstraction un phénomène qui, en réalité, est lié à d'autres. 2° Quand la théorie part de propositions empiriques qui ne sont vraies qu'en de certaines limites, nous sommes exposés, dans le raisonnement, à sortir de ces limites sans nous en apercevoir. 3° Quand la théorie part de dérivations, celles-ci, manquant habituellement de précision, ne peuvent servir de prémisses à un raisonnement rigoureux. 4° Dans ce cas, nous savons peu de chose ou rien des limites au-delà desquelles les dérivations cessent d'être vraies, si même elles ne sont entièrement fausses. Toutes les difficultés que nous venons de relever, et d'autres semblables, font que souvent l'homme pratique, qui se laisse guider parles résidus, aboutit à des conclusions que les faits vérifient beaucoup mieux que celles de l'homme exclusivement théoricien, qui raisonne en toute logique.
§ 1784. En politique, le théoricien n'a pas encore pu prendre une revanche comme il l'a eue en beaucoup d'arts. Quand les circonstances futures d'un phénomène diffèrent beaucoup de celles où l'empirique a vu se produire un phénomène donné, l'empirique ne peut rien prévoir au sujet de ce phénomène, et s'il l'essaie, il se trompe sûrement, sauf les quelques cas où il devine tout à fait au hasard. Au contraire, si le théoricien a à sa disposition une théorie qui n'est pas trop imparfaite, il peut prévoir des faits qui se rapprochent de ceux qui ont lieu réellement.
§ 1785. Au moyen âge, les maîtres maçons ont construit des édifices merveilleux. Ils y sont arrivés par la pratique et l'empirisme, sans avoir la plus lointaine idée de la théorie de la résistance des matériaux, mais uniquement en essayant à plusieurs reprises, en se trompant et en rectifiant les erreurs. Grâce à la théorie de la résistance des matériaux, les architectes modernes, non seulement évitent en grande partie ces erreurs, mais en outre construisent des édifices que les maîtres maçons ou d'autres artisans des siècles passés n'auraient jamais su construire. La pratique avait enseigné aux médecins certains remèdes, qui étaient souvent meilleurs que ceux des charlatans ou des alchimistes, et qui quelquefois aussi ne valaient rien du tout. Aujourd'hui, les théories chimiques ont fait disparaître, non pas toutes, mais un très grand nombre des erreurs où l'on tombait autrefois, et la biologie a permis de faire un meilleur usage des nombreuses substances que la chimie met à la disposition des médecins. Il y a peu de temps, pour produire de la fonte dans un haut fourneau, il valait mieux suivre les prescriptions d'un empirique que celles d'un théoricien. Maintenant, cette industrie ne s'exerce plus sans l'aide de chimistes et d'autres théoriciens. On en peut dire autant de la teinturerie et de beaucoup d'autres arts.
§ 1786. Au contraire, pour la politique et pour l'économie politique, nous sommes encore bien loin du jour où la théorie pourra donner des prescriptions utiles. Ce n'est pas seulement la difficulté de la matière qui nous éloigne de ce jour, mais aussi l'invasion de la métaphysique et de ses raisonnements, qui seraient mieux nommés divagations, et le fait singulier que cette invasion a son utilité, puisque le raisonnement par dérivations métaphysiques – ou théologiques – est le seul que beaucoup d'hommes soient capables de tenir et de comprendre. Ici apparaît très caractérisé le phénomène du contraste entre connaître et agir. Pour connaître, la science logico-expérimentale seule a de la valeur ; pour agir, il vaut beaucoup mieux se laisser guider par les sentiments. Ici apparaît aussi un autre phénomène important : celui de l'efficacité de la division d'une collectivité en deux parties, afin de faire disparaître cette opposition. La première partie, dans laquelle prédomine le savoir, régit et dirige l'autre, dans laquelle prédominent les sentiments ; de telle sorte qu'en conclusion l'action est bien dirigée et énergique.
§ 1787. Nous avons vu que, dans les prévisions politico-sociales, il y a un grand nombre de cas où l'on aboutit plus facilement à des résultats en accord avec les faits, en prenant pour guides les résidus plutôt que les dérivations. C'est pourquoi, dans les cas indiqués, les prévisions seront d'autant meilleures que les dérivations se mêleront moins aux résidus. Tout au contraire, lorsqu'on veut obtenir des propositions scientifiques, connaître les rapports des choses et des faits, abstraire de cas concrets un phénomène donné pour l'étudier, on atteindra le but d'autant mieux que les résidus nous guideront moins dans le raisonnement, que celui-ci sera exclusivement logico-expérimental, et que les résidus seront uniquement considérés comme faits externes, jamais subis comme dominant notre pensée. En d'autres termes, les déductions pratiques ont avantage à être essentiellement synthétiques et inspirées par les résidus ; les déductions scientifiques, à être essentiellement analytiques, et de pure observation (expérience) appuyée de déductions logiques.
§ 1788. Si nous voulons nous servir des termes vulgaires de « pratique » et de « théorie», nous dirons que la pratique est d'autant meilleure qu'elle est plus pratique, la théorie d'autant meilleure qu'elle est plus théorique. La pratique théorique ou la théorie pratique sont en général très mauvaises.
§ 1789. Les hommes pratiques sont souvent poussés à donner une théorie de leurs actions, laquelle vaut habituellement peu de chose ou rien du tout. Ils savent faire; ils ne savent pas expliquer pourquoi ils font. Les théories de ces hommes sont presque toujours des dérivations qui n'ont pas le moindre rapport avec les théories logico-expérimentales.
§ 1790. Le contraste entre la pratique et la théorie prend quelquefois la forme d'une négation absolue de la théorie. Par exemple, une certaine « école historique » a nié non seulement l'existence des théories économiques, mais aussi celle de lois en cette matière (§2019 et sv.). Si, après cela, les adeptes de cette école s'étaient bornés à s'occuper de la pratique, ils auraient pu prendre rang parmi les hommes d'État, au lieu de n'être que des sophistes et des faiseurs de vains discours, comme ils l'ont été. Il y aurait eu beaucoup de vérité, dans le fond de leurs croyances, et seule la façon de les exprimer aurait été erronée. Ils auraient dû dire que les théories de l'économie politique et de la sociologie ne sont pas encore capables d'effectuer la synthèse des phénomènes sociaux, de nous donner des prévisions sûres pour les phénomènes concrets, et que, par conséquent, à l'instar de ce qui est arrivé en
d'autres branches du savoir humain, tant que la théorie n'est pas beaucoup plus avancée, il convient de se contenter de la pratique et de l'empirisme.
§ 1791. Mais les adeptes de « l'école historique » étaient surtout des théoriciens. Leurs critiques aux théories de l'économie politique étaient des critiques de théoriciens ; ils appelaient « pratiques » leurs critiques, croyant changer le fond en changeant le nom. En réalité, leurs théories sont bien plus mauvaises que celles de l'économie politique, car elles se fondent sur des dérivations éthiques dépourvues de toute précision et sans beaucoup ou même sans aucun rapport avec les faits, tandis que les théories économiques trouvent au moins un appui dans les faits, et ne pèchent que parce qu'elles sont incomplètes et qu'elles ne peuvent faire la synthèse des phénomènes sociaux concrets. Ces dernières théories sont imparfaites ; les premières sont erronées et souvent fantaisistes.
§ 1792. Remarquez la contradiction de ces prétendus historiens. D'un côté, ils affirment qu'il n'existe pas de lois, C'est-à-dire d'uniformités, en économie politique ni en sociologie. D'un autre côté, ils raisonnent d'une façon qui présuppose nécessairement l'existence de ces lois. D'abord, à quoi peut bien servir leur étude de l'histoire, s'il n'existe pas d'uniformités, et si, par conséquent, l'avenir n'a aucun rapport avec le passé ? C'est une pure perte de temps, et il vaudrait mieux lire des contes de fées ou des romans qu'étudier l'histoire. Celui qui, au contraire, estime que l'on peut tirer du passé des règles pour l'avenir, admet par cela même qu'il existe des uniformités.
Ensuite, si l'on s'attache au fond du sujet, on ne tarde pas à voir que l'erreur de ces braves gens provient de ce qu'ils ne sont jamais arrivés à comprendre qu'une loi scientifique n'est autre chose qu'une uniformité. L'esprit faussé par les divagations de leur métaphysique et de leur éthique, brûlant du désir de trouver des dérivations qui puissent justifier certains courants sentimentaux, et plaire à un public ignorant autant qu'eux de toute règle du raisonnement scientifique, ils s'imaginent que les lois économiques et sociales sont des êtres mystérieux et puissants, qui voudraient s'imposer à la société, et ils s'insurgent contre ces prétentions, surtout s'il s'agit de lois qui leur déplaisent ; tandis qu'ils admettent ces prétentions avec empressement, s'il s'agit des lois imaginaires de la métaphysique et de l'éthique. Ils sont les croyants d'une religion différente de celle à laquelle ils s'opposent ; ils nient les lois, supposées absolues, de leurs adversaires. Mais à ces divinités, ils en substituent d'autres, qui sont tout autant étrangères au monde logico-expérimental. Certaines lois les gênaient ; ils ne se sentaient pas capables de les réfuter ; ils étaient étrangers au raisonnement scientifique, et de ce fait incapables de comprendre que ni ces lois ni d'autres d'aucun genre ne pouvaient avoir un caractère absolu. C'est pourquoi, afin de supprimer l'obstacle qui se présentait à eux, ils agirent comme les croyants d'une religion nouvelle, qui abattent les anciens autels pour en élever de nouveaux ; comme agirent les chrétiens, en proclamant que les dieux des païens étaient de vains simulacres, et que seul leur Dieu était vivant et vrai. Ils ne manquaient pas d'ajouter à la persuasion de la foi, de pseudo-raisonnements pour démontrer que leur religion était beaucoup plus rationnelle que l'ancienne. Ces balivernes acquièrent et conservent du crédit, parce qu'elles conviennent aux sentiments et à l'ignorance de qui les écoute. On s'explique ainsi que les historiens, en économie, peuvent, avec peu ou point de difficulté, continuer à répéter comme des perroquets que les lois économiques et les lois sociologiques souffrent des « exceptions », tandis que – disent-ils – ce n'est pas le cas des lois scientifiques. Ils ne savent pas, ils ne soupçonnent même pas que leurs « exceptions » ne sont autre chose que des phénomènes qui proviennent de l'intervention de causes étrangères à celles que la science considère par abstraction, et que cette intervention existe en chimie, en physique, en géologie et dans toutes les sciences, comme en économie et en sociologie. Les différences sont tout autres qu'ils ne se les figurent. Elles consistent dans le degré de difficulté à séparer par abstraction, ou même matériellement, certains phénomènes de certains autres. Parmi ces différences, il convient de noter que certaines sciences, ainsi la géologie, doivent recourir surtout à l'observation (différente de l'expérience) ; elles ne peuvent séparer matériellement un phénomène des autres, comme le peuvent faire les sciences telles que la chimie, qui sont en mesure de recourir largement à l'expérience (différente ici de la simple observation). À ce point de vue, l'économie politique et la sociologie se rapprochent de la géologie et s'éloignent de la chimie.
§ 1793. La haine de Napoléon Ier pour « l'idéologie » manifeste nettement le contraste entre la pratique et la théorie. Dans la séance du 20 décembre 1812, Napoléon Ier, répondant au Conseil d'État, accuse l'idéologie d'avoir occasionné les malheurs qui avaient frappé la France, et lui oppose l'étude de l'histoire [FN: § 1793-1]. Cette dernière observation est excellente, puisqu'elle conseille de recourir à l'expérience, qui est l'origine et la source de toute science. Mais, précisément par ce fait, elle contredit l'invocation de Napoléon aux « principes sacrés de la justice », invocation qui appartient à la métaphysique pure. Napoléon ne s'apercevait pas qu'ainsi il ne faisait qu'opposer une « idéologie » à une autre « idéologie » ; et lorsqu'il affirme que cette dernière est la cause des malheurs de la France, il exprime une théorie, qui peut concorder ou ne pas concorder avec les faits, mais qui, de toute façon, demeure une théorie.
§ 1794. Des cas semblables se présentent pour beaucoup d'auteurs qui, en parole, repoussent les théories, et en fait opposent simplement une théorie à une autre théorie. Taine [FN: § 1794-1], par exemple, met parmi les causes de la Révolution française l'usage de la « méthode mathématique », terme par lequel il entend les déductions de pure logique. « (p. 304) Conformément aux habitudes de l'esprit classique et aux préceptes de l'idéologie régnante, on construit la politique sur le modèle des mathématiques. On isole une donnée simple, très générale, très accessible à l'observation, très familière, et que l'écolier le plus inattentif et le plus ignorant peut aisément saisir ». En effet, de cette façon est constituée non seulement cette théorie, mais toutes les théories, excepté la considération de l'écolier ignorant. La conséquence à tirer de ce fait est qu'aucune théorie, même lorsqu'elle part de principes expérimentaux [FN: § 1794-2], ce qui arrive rarement pour les théories sociales (§1859), ne peut, si elle est considérée séparément, représenter les phénomènes concrets et complexes. C'est pourquoi, après avoir séparé les phénomènes par l'analyse scientifique, et en avoir ainsi étudié les différentes parties, il est nécessaire de les réunir, et de procéder à la synthèse, qui fera connaître le phénomène concret. Taine n'entend nullement s'engager dans cette voie. Il note une erreur de raisonnement, et veut démontrer qu'elle fut l'origine des malheurs de la France. En agissant ainsi, il crée une théorie aussi abstraite, aussi unilatérale, aussi « mathématique » que celles qu'il réprouve. De plus, cette théorie est fausse, parce qu'il prend l'effet pour la cause, ou mieux parce qu'elle ne tient pas compte de la mutuelle dépendance des faits.
§ 1795. L'usage de ce que Taine appelle la « méthode mathématique » n'a certainement pas produit la Révolution, et jamais aucune méthode n'eut ce pouvoir. Mais, en réalité, il y avait en France un certain état d'esprit qui se manifestait théoriquement par cette « méthode » notée par Taine, et pratiquement par les actes qui préparaient la Révolution.
§ 1796. Sous d'autres formes encore apparaît le sentiment confus, indistinct qui oppose la pratique à la théorie, et qui, somme toute, est mû par l'intuition que, pour se rapprocher des faits, il convient de raisonner sur les résidus plutôt que sur les dérivations. De ce genre est l'assertion qu'en toute chose il faut s'en tenir au « juste milieu » ; ou celle-ci, que les prescriptions (dérivations) doivent être interprétées suivant « l'esprit » et non suivant la lettre ; ce qui toutefois signifie souvent qu'on doit les interpréter dans le sens qui plaît à celui qui fait cette observation.
§ 1797. DÉRIVATIONS INDÉTERMINÉES ; COMMENT ELLES S'ADAPTENT À CERTAINES FINS. Ainsi que nous l'avons déjà remarqué (§1772), les dérivations vont habituellement au delà des limites de la réalité. Parfois, comme dans les mythes, les hommes ne se soucient pas d'une telle divergence ; mais parfois, comme dans les dérivations pseudo-expérimentales, ils s'efforcent, par différents moyens, d'établir un certain accord avec la réalité. Parmi ces moyens, celui de l'indétermination des termes par lesquels on exprime la dérivation, est très efficace. Il n'existe presque aucune prescription morale ou religieuse qu'on puisse suivre à la lettre. Cela montre bien l'écart qui existe entre les dérivations et la réalité, et comment les premières s'adaptent à cette dernière, parce qu'elles permettent des interprétations sophistiques. Les dérivations peuvent être employées uniquement pour rechercher les résidus qu'elles manifestent, mais ne peuvent servir de prémisses à des raisonnements rigoureusement logiques, pour en déduire des conclusions en accord avec la réalité.
§ 1798. C'est ce que les croyants théologiens ou métaphysiciens ne veulent pas admettre. Ils prétendent que leurs prescriptions sont claires, précises, rigoureuses, et qu'elles correspondent entièrement à la réalité. Malgré cela, ils ne sont pas disposés à accepter toutes les conséquences qu'on en peut tirer. Pour repousser la conclusion d'un raisonnement, il est nécessaire de nier les prémisses ou de ne pas accepter la manière d'en tirer les conclusions. Les croyants ne veulent pas suivre la première voie. Ils sont donc nécessairement contraints de suivre la seconde. C'est pourquoi, parmi eux, il en est qui nient sans autre que l'on puisse raisonner logiquement sur leurs prémisses, et qui veulent qu'on les prenne non « suivant la lettre, mais suivant l'esprit ». Il en est d'autres qui, au lieu de repousser la logique, la prennent pour alliée, et demandent à la casuistique le moyen de conserver les prémisses et d'échapper à certaines de leurs conséquences. Viennent enfin d'autres encore, qui suppriment tout à fait le problème gênant, en affirmant que rien n' « existe » si ce n'est les concepts de l'esprit humain – lequel, au fond, n'est autre que leur esprit – que cet esprit « crée la réalité ». Il est par conséquent manifeste qu'aucune divergence ne peut exister entre leurs conceptions et l'expérience. C'est là un moyen vraiment excellent de repousser toute objection de la science expérimentale [FN: § 1798-1] (§1910 et sv.).
§ 1799. Les religions sont idéalistes ; elles ne pourraient être autrement, sans cesser d'être des religions, et sans perdre toute efficacité et toute utilité sociale. Elles dépassent la réalité, et pourtant elles doivent vivre et se développer dans la réalité. Il est donc nécessaire qu'elles trouvent moyen de faire concorder idéalisme et réalité. Pour cela, les actions non-logiques viennent à l'aide, et, pour justifier ces actions non-logiques, on a recours aux dérivations et à la casuistique. Il arrive souvent que ce fait est amèrement reproché à une religion donnée par ses adversaires, qui devraient, au contraire, la louer de savoir conserver le stimulant de l'idéalisme, en le conciliant avec les nécessités de la réalité, et qui, se servant eux-mêmes de ces moyens et de ces procédés, font voir clairement qu'on ne peut pas s'en passer. On pourrait donner une infinité de preuves de ces faits, prises en toute contrée et en toute religion. Nous nous bornerons ici à quelques exemples pris dans nos contrées et dans la religion chrétienne [FN:§ 1799-1]. On sait que celle-ci, au fur et à mesure qu'elle faisait des prosélytes dans le monde romain, dut se relâcher de son rigorisme primitif, et tolérer des libertés que d'abord elle condamnait énergiquement. En outre, beaucoup de conversions étaient en grande partie purement formelles, beaucoup de changements, de forme plutôt que de fond. C'est ce qui arriva surtout pour les conversions des Barbares, au temps de la chute de l'empire romain. Par exemple, on peut voir dans Saint Grégoire de Tours combien mince était la couche de vernis chrétien des rois francs et des chefs barbares, qui adaptaient la nouvelle religion à leur tempérament sauvage et batailleur. C'est justement pourquoi les régions occidentales du bassin de la Méditerranée purent mieux résister aux invasions asiatiques que les régions orientales, où le tempérament des habitants était et devenait plus doux. Un peuple d'ascètes et de moines, tel qu'il devrait être formé, s'il prenait à la lettre les dérivations des premiers chrétiens, ne peut pas être un peuple belliqueux ; et l'on ne voit pas comment des hommes qui véritablement « ne résisteraient pas au mal », pourraient résister à l'envahisseur de leur pays. Heureusement pour les peuples des régions occidentales de la Méditerranée, les dérivations chrétiennes n'affaiblirent pas du tout leurs instincts belliqueux ; elles en tempérèrent seulement les excès qui pouvaient être nuisibles. On peut aujourd'hui observer quelque chose de semblable, mais en de bien moindres proportions, dans le contraste qui existe entre la France et l'Allemagne. Dans le premier de ces pays règne la religion démocratico-humanitaire, qui semble être contraire aux qualités belliqueuses du peuple. Dans le second subsiste la religion patriotique, qui les exalte. Mais ce contraste peut tenir plus de la forme que du fond, ou bien être passager, et correspondre seulement à l'une des si nombreuses oscillations qu'on observe dans les phénomènes sociaux. Messieurs les éthiques ont coutume de parler avec horreur des prélats guerriers et des barons bardés de fer du moyen âge ; mais ils devraient se dire que si les sentiments qui se manifestaient de cette façon avaient disparu, les pays de l'Europe occidentale auraient eu le sort des pays de l'Asie Mineure et de la Turquie d'Europe, et nos philosophes, au lieu de pouvoir déraisonner commodément en un pays civilisé, auraient servi quelque conquérant asiatique. D'autres braves gens s'indignent hautement parce qu'au moyen âge et un peu plus tard, le Saint-Siège ne fut pas assez religieux ou pas assez « chrétien », comme ils le disent, et parce qu'il sut opportunément concilier les dérivations chrétiennes avec les nécessités sociales et politiques. Mais c'est précisément une des causes qui ont permis à la civilisation présente de renaître, après la décadence de la civilisation gréco-latine, puis de croître et de se développer. Celui qui rejette et blâme cette civilisation peut aussi en blâmer les origines. Il n'en est pas ainsi de qui l'accepte, la loue, en jouit, car la contradiction ne permet pas qu'on veuille la fin sans accepter les moyens. Nous n'entendons ainsi nullement affirmer que tout fût utile à la société, dans cette entreprise pour concilier certaines dérivations religieuses et morales avec la pratique de la vie. Il est certain, au contraire, qu'il y avait une partie utile et une partie nuisible ; nous voulons seulement dire que la première fut plus importante que la seconde.
§ 1800. La majeure partie des préceptes de l'Évangile sont des dérivations poétiques qui révèlent certains résidus. C'est justement parce qu'ils manquent de précision, et souvent se contredisent, qu'ils ont pu être acceptés en des temps si différents, par toute espèce de peuples. Quand les résidus de la Ie classe prédominent, on interprète les préceptes de l'Évangile de façon à les rendre compatibles avec la vie ordinaire. Quand les résidus de la IIe classe et ceux de l'ascétisme prédominent, on s'efforce de s'en tenir au sens littéral, et de s'en servir contre tout progrès de la civilisation. Par exemple, toute prévoyance disparaîtrait, et les peuples civilisés retourneraient à l'état sauvage, si l'on prenait à la lettre le précepte d'après lequel on ne doit pas épargner, pas se soucier de l'avenir plus que ne s'en soucient les oiseaux des champs [FN:§ 1800-1]. Si l'on veut entendre dans leur sens rigoureux les règles données de cette manière, ces règles ne s'appliquent qu'à l'imprévoyant et au vagabond. Par conséquent, en toute société civilisée, il est nécessaire de corriger ces règles par quelque interprétation [FN:§ 1800-2]. Généralement on a voulu les entendre en ce sens qu'il faut s'occuper plus de l'âme que du corps ; mais, en ce cas, à quoi s'appliquent les exemples des oiseaux et du lis ? Ont-ils peut-être une âme dont ils s'occupent plus que de leur corps ?
§ 1801. Les observations de Saint Jérôme sont dignes de remarque [FN:§ 1801-1]. Il veut, au fond, que nous entendions les paroles de Saint Matthieu dans ce sens que nous devons, il est vrai, travailler pour nous procurer le pain quotidien, mais que nous ne devons nous soucier de l'avenir en aucune façon.
§ 1802. Le pur ascétisme, qu'on trouve non seulement dans la religion chrétienne, mais en d'autres, fuit le travail, et de tout temps il y eut des hommes qui vécurent oisifs, en parasites de la société. Cette attitude est la conséquence de certains sentiments, et non de raisonnements, qui interviennent seulement a posteriori pour donner une justification logique des actions. Diogène vivait à peu près comme un frère capucin, en ce qui concerne les moyens d'existence ; mais il donnait de son attitude des motifs différents de ceux qu'avançait le frère. Lorsque ces raisonnements ont des conséquences qui heurtent trop violemment les conditions de la vie individuelle ou sociale, ils se modifient nécessairement pour s'adapter à ces conditions. Il y eut de tout temps des saints, des ermites, des fanatiques, qui voulurent prendre à la lettre les paroles de l'Évangile. En revanche, il y eut des hommes au courant des nécessités de l'existence ordinaire, qui s'efforcèrent de donner de l'Évangile une interprétation qui ne fût pas trop rigoureuse.
§ 1803. Il paraît qu'au temps de Saint Augustin, il y avait des personnes qui suivaient le sens littéral de ces préceptes, et l'opposaient au conseil que donne Saint Paul de travailler. Saint Augustin n'éprouve aucune difficulté pour concilier des préceptes si différents [FN: § 1803-1], et, par un procédé logique étrange, il tire de cette contradiction même la démonstration que la contradiction n'existe pas. En résumé, son raisonnement est le suivant : « Vous dites que A contredit B ? Eh bien non, cela prouve que l'on doit entendre B d'une façon différente du sens littéral ». La conception de Saint Augustin est évidemment que les Saintes Écritures constituent un ensemble dont les parties ne peuvent jamais se contredire. C'est pourquoi il n'y a en elles aucune contradiction, parce qu'il ne peut pas y en avoir. Saint Augustin [FN:§ 1803-2] dit qu'il a dû écrire le livre du travail des moines, parce que, parmi ceux-ci, il en était qui ne voulaient pas travailler, croyant ainsi obéir à l'Évangile. Le Saint montre leur erreur et leur contradiction, du fait qu'effectivement ils ne suivent pas le précepte évangélique à la lettre. À la vérité, il démontre ainsi uniquement que le suivre à la lettre est très difficile, ou pour mieux dire impossible ; mais il ne démontre nullement que le sens soit autre que celui des termes employés. Pour se sortir d'embarras, le Saint change entièrement le sens des paroles de l'Évangile. Il dit [FN: § 1803-3] : « Tout le précepte se réduit donc à la règle que, même en étant prévoyants, nous devons penser au règne de Dieu, et qu'en combattant pour le règne de Dieu, nous ne devons pas nous inquiéter de la prévoyance [des biens matériels] » On trouve de semblables interprétations chez d'autres saints Pères, qui cherchent le moyen de concilier le texte, pourtant bien clair, de l'Évangile, avec la nécessité de la vie des peuples civilisés [FN:§ 1803-4].
Saint Thomas a une ingénieuse interprétation, par laquelle il cherche à ménager la chèvre et le chou. Il examine la question : « Quel doit être le souci de l'avenir ? [FN: § 1803-5] » Comme d'habitude, il commence par citer les arguments en faveur de la solution qu'il rejette ensuite. Dans le présent cas, cette solution est qu'on doit avoir souci de l'avenir. Sont en faveur de cette thèse : 1° le passage (Prov., VI, 6), où l'on trouve l'exemple de la fourmi prévoyante ; 2° la prévoyance appartient à la prudence, qui est une vertu ; 3° le passage (Jean, XII), d'où il appert que le Christ avait une bourse, confiée à Judas, et cet autre (Act., IV, 34, 35), où il est dit que les apôtres gardaient le prix des terres qui était déposé à leurs pieds. « Il est donc permis d'avoir le souci de l'avenir. Mais ce que dit le Seigneur (Matth., VI, 34) est contraire à cela : Nolite solliciti esse in crastinum... Conclusion : il faut que l'homme ait le souci de l'avenir en temps convenable et opportun, non pas en dehors de ce temps ». On ne voit pas trace de cette invention du « temps convenable et opportun » dans l'Évangile, et surtout pas des explications qu'ajoute Saint Thomas : « À chaque jour suffit sa peine ; c'est ainsi qu'à l'été revient le soin de moissonner, à l'automne de vendanger. Si donc quelqu'un se souciait déjà de la vendange en été, il se mettrait à tort en souci pour l'avenir. C'est pourquoi ce souci, étant superflu, est prohibé par le Seigneur, lorsqu'il dit : Nolite solliciti esse in crastinum... Quant à l'exemple de la fourmi, on répond « que la fourmi a le souci convenant au temps, et que, par ce fait, elle nous est donnée comme devant être imitée ». Quand on voit un génie puissant, tel que Saint Thomas, recourir à de si misérables arguments, il faut vraiment reconnaître que mettre d'accord la lettre du précepte évangélique avec les nécessités pratiques de la vie est une entreprise désespérée.
§ 1804. Au IVe siècle de notre ère, parut l'hérésie des masaliens, appelés aussi euchites et enthousiastes. On dit qu'à l'origine ce furent des Gentils [FN: § 1804-1] ; cela peut être, car enfin on trouve les résidus d'ascétisme chez les Gentils, comme chez les chrétiens. Ensuite, il y eut des hérétiques chrétiens de cette sorte. Ceux-ci fuyaient le travail manuel et passaient leur temps à prier et à dormir [FN: § 1804-2]. L'Église catholique, qui fut toujours étrangère à de telles extravagances, les repoussa, et voulut du moins discipliner la vie contemplative, mais en tout temps, elle eut à batailler contre de semblables tendances.
§ 1805. À ce point de vue, remarquable est la controverse avec les franciscains, qui voulaient s'imposer à l'Église, et que l'Église sut, au contraire, s'assimiler et employer à ses fins. C'est là un des si nombreux exemples où l'on voit que l'art de gouverner consiste à se servir des résidus, et non à vouloir les modifier.
§ 1806. Au XIIe et au XIIIe siècle, il se produisit, en Italie et en France, une renaissance de la civilisation, renaissance qui se manifestait, comme toujours, par la recrudescence des résidus de la Ie classe, qui disputaient le terrain aux résidus de la IIe classe. Le clergé qui, en ce temps, était l'unique classe intellectuelle de la société, se rapprochait peu à peu, dans ses mœurs, de la société laïque. Les moralistes décrivent le phénomène comme une « perversion » des mœurs du clergé catholique. C'est ainsi qu'ils le décriront de nouveau, au temps de la Renaissance et de la Réforme protestante. Ils ont raison, si l'on admet le point de vue auquel ils envisagent les faits. Mais il en est un autre aussi, qui est celui du progrès de la civilisation ; et, sous cet aspect, la « perversion » des mœurs du clergé est une « amélioration » dans les conditions d'existence des peuples civilisés, lesquelles, ou bien ne s'améliorent pas, ou bien même empirent, sitôt que ces mœurs sont « corrigées ou réformées », grâce à une augmentation considérable de certains résidus de la IIe classe et de l'ascétisme. Ce n'est pas que les mœurs bonnes ou mauvaises du clergé aient un rapport direct avec le progrès de la civilisation ; mais elles sont un indice de l'influence de certains résidus de la IIe classe, de même que l'ascension du mercure dans un thermomètre n'est pas la cause de l'élévation de la température, mais en est seulement l'indice. Au XIIe et au XIIIe siècle, une marée de religiosité, venue, comme toujours, des classes inférieures, arrêta le progrès de la civilisation, de même que l'arrêta, mais pour peu de temps, la marée de religiosité de la Réforme protestante. La marée du moyen âge provoqua l'Inquisition ; celle du XVIe siècle fit naître les jésuites. Toutes deux retardèrent pour plusieurs siècles la liberté de pensée (résidus de la Ie classe) à laquelle on marchait, lorsqu'elles survinrent. Tels sont les phénomènes ; mais, dans les dérivations, ils apparaissent déformés (§2329 et sv.).
§ 1807. L'une des plus grandes déformations est celle dont nous allons nous occuper tout à l'heure en détail ; elle voit, dans les phénomènes, des conséquences de certaines interprétations logiques de l'Écriture Sainte, on y trouve des applications d'autres raisonnements semblables. Une autre déformation n'est certes pas à négliger : c'est celle qui met d'un côté la papauté, qui veut gouverner despotiquement et imposer la « superstition », de l'autre les hérétiques, qui veulent avoir la « liberté », et faire usage du raisonnement scientifique. En fait, la « superstition », ou si l'on veut la « religiosité », était plus grande chez les hérétiques. Ceux-ci accordaient moins de liberté, et là où ils dominaient, ils imposaient des règles très restrictives et pénibles, dictées par leur ascétisme [FN: § 1807-1]. Il faut prendre garde que les marées de religiosité (prédominance des résidus de la IIe classe) se sont produites autant dans la partie orthodoxe que dans la partie hérétique ou schismatique ; cela démontre encore plus que l'orthodoxie et l'hérésie, ou le schisme, ne furent autre chose que des voiles recouvrant un fond commun.
§ 1808. Cette déformation et d'autres semblables donnent lieu à de très nombreuses interprétations des faits. Celui qui est ennemi de la papauté, par exemple, approuve nécessairement tous les hérétiques et les schismatiques ; et il est comique de voir des libres penseurs, ennemis de toute religion – disent-ils – admirer ceux qui voulaient imposer des formes religieuses extrêmement strictes et rigoureuses. Combien d'admirateurs modernes de Calvin, s'ils avaient vécu de son temps, eussent été persécutés et opprimés par lui ! Villari, qui se dit « positiviste », admire Savonarola, uniquement parce qu'il était ennemi du pape ; mais si Villari avait vécu sous le pouvoir de ce frère, il ne s'en serait pas tiré en douceur, lui et ses « vanités ». Somme toute, le pape Borgia n'opprimait ni la littérature ni la science, et Savonarola, s'il avait pu gouverner, aurait détruit toute littérature profane, toute science, sauf peut-être la théologie, pour autant qu'on peut l'appeler une science. Nous ne recherchons pas ici si cela eût été « bien » ou « mal »; nous entendons seulement noter la contradiction qui existe, à vouloir admirer en même temps la « science libre » et la superstition envahissante et opprimante de Savonarola.
§ 1809. La marée de religiosité qui se produisit au moyen âge, se manifesta en partie par des hérésies comme celle des Albigeois, en partie par des œuvres qui étaient orthodoxes, sinon en fait, du moins en apparence. Telle fut l'institut, un des ordres mendiants. Saint François d'Assise, qui a des admirateurs jusqu'en nos temps, même parmi les fidèles du dieu Progrès, fut le fondateur d'un ordre de Frères dont les paroles évangéliques citées plus haut étaient – ou devaient être – la règle rigoureuse. Il est maniteste que ces personnes ne peuvent être qu'une exception dans une société civilisée. Si les franciscains doivent vivre d'aumône, il est nécessaire qu'il y ait quelqu'un pour la leur faire. S'ils ne doivent pas penser au lendemain, il est nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui y pense pour eux. Ils peuvent être imprévoyants, s'ils vivent en une société de gens prévoyants ; autrement, ils mourraient de faim, et tout serait dit.
§ 1810. L'attitude des papes, en présence du phénomène franciscain, dépendait de causes diverses. Les sentiments de religiosité (résidus de la IIe classe) n'y étaient pas étrangers ; ils se manifestèrent surtout chez Célestin V. Mais c'étaient principalement les résidus de la Ie classe qui agissaient, et les papes avaient à résoudre le problème, qui très souvent s'est présenté aux gouvernants : de savoir, par des combinaisons opportunes, se servir des sentiments qui pourraient leur susciter des adversaires, ou favoriser ceux qui existaient déjà, afin de combattre ces adversaires même. Les flots de la religiosité et de la superstition se soulevaient contre la digue de la papauté. Celle-ci demanda à la religiosité et à la superstition même le moyen de renforcer ce rempart. C'est pourquoi, si l'on regarde superficiellement l'œuvre de la papauté à l'égard des franciscains, elle paraît changeante et contradictoire ; et si, au contraire, l'on pénètre mieux le fond des choses, et que l'on écarte des cas exceptionnels comme celui de Célestin V, elle apparaît parfaitement unie et dirigée vers un même but. Les papes favorisaient les franciscains jusqu'à l'extrême limite de l'orthodoxie ; ils les réprimaient quand ils dépassaient cette limite. Ils voulaient bien se servir d'eux comme d'auxiliaires ; ils ne pouvaient les tolérer comme ennemis. Ils se servaient d'eux volontiers contre les hérétiques, contre le clergé riche et puissant qui voulait se maintenir indépendant du Saint Siège, car pour combattre cette partie du clergé, la réforme des mœurs était une bonne arme ; mais la réforme devait s'arrêter au point au delà duquel le Saint Siège lui-même aurait été lésé. En fin de compte, cette conception l'emporta, parce qu'ainsi qu'il arrive toujours, le prétendu retour à l'Évangile finissait par n'être que le voile de l'hérésie [FN: § 1810-1]. C'est même ce motif fondamental qui, de nos jours, a fait apparaître de nouveaux admirateurs de Saint François, lesquels sont simplement des ennemis du pape et s'ils louent Saint François, c'est pour attaquer le pape.
§ 1811. Il y a aussi, chez eux, un résidu d'humanitarisme démocratique ; il apparaît encore mieux chez leurs prédécesseurs, qui ne furent pas seulement les franciscains, interprètes très stricts de la Règle, mais aussi les cathares et d'autres sectes analogues. Au fond, l'œuvre des uns et des autres consistait en une poussée qui visait à détruire la civilisation ; en une prédominance des résidus de la IIe classe, qui sont toujours si puissants dans les couches inférieures de la société.
§ 1812. Innocent III voyait l'absurdité de la règle de Saint François, et hésitait à l’approuver ou à la rejeter [FN: § 1812-1] « (p. 428) Il ne pouvait certainement pas repousser ces forces nouvelles, qui venaient à son aide d'une manière inattendue pour combattre l'hérésie ; et, l'on ne peut douter qu'il bénît le mendiant d'Assise, sans lui défendre de persévérer dans son œuvre ; mais il ne se départit jamais de ses doutes sur la Règle, qui lui paraissait ne pas répondre aux besoins réels et aux tendances de la nature humaine ; et il ne voulut pas accorder une bulle d'approbation ». En 1223, le pape Honorius III rendit une bulle d'approbation à la Règle. Il voyait croître une force nouvelle, et cherchait à en tirer parti.
§ 1813. Ce n'étaient pas seulement les papes qui voulaient se servir à leurs fins de la religiosité des franciscains ; Frédéric II eut la même intention, lui qui n'avait guère trop de religiosité [FN:§ 1813-1]. Il était d'un type parfaitement opposé à celui de Célestin V. Sur ce fond s'étendait le voile des dérivations ; nous allons nous en occuper.
§ 1814. Aussitôt après la mort de Saint François, et peut-être précédemment aussi, se manifesta dans l'Ordre la dissension entre ceux qui voulaient s'en tenir strictement à la Règle, ou si l'on veut aux paroles de l'Évangile, et ceux qui voulaient concilier la première et les autres avec les nécessités de la vie des gens civilisés [FN: § 1814-1]. Plus tard, l'Ordre se divisa en trois : les Petits Frères et les Spirituels, observateurs rigides de la Règle, mais différents par leurs conceptions théologiques, et les Conventuels, qui interprétaient la Règle avec quelque liberté [FN: § 1814-2]. Le pape Célestin V permit que l'on détachât de l'ordre des Mineurs un autre ordre, sous le nom de Frères du pape Célestin ou pauvres ermites. Ces gens étaient intransigeants sur l'observation de la Règle. Ce pape, qui ne demeura pas sur le trône de Saint Pierre, était un homme simple et très religieux. Le pape Boniface VIII, qui lui succéda, s'entendait, au contraire, en politique, et persécuta ces pauvres ermites [FN: § 1814-3].
§ 1815. Enfin, puisque sans rien posséder et sans prévoyance, les hommes ne peuvent pas vivre, il fallait trouver un biais pour interpréter les paroles de l'Évangile et la Règle de Saint
François, afin qu'elles ne heurtassent pas trop le besoin de posséder et la prévoyance. On sait que les dérivations sont comme le caoutchouc, et qu'on peut les étirer de manière à leur faire signifier ce qu'on veut. Il ne fut donc pas difficile de trouver non seulement un, mais plusieurs biais. Les principaux furent une observance formelle pour les Frères, tandis que d'autres gens possédaient et avaient de la prévoyance pour les Frères. Grégoire IX confia cette mission à des personnes interposées ; Jean XXII l'attribua aux supérieurs, auxquels les simples Frères devaient obéissance. Il agit ainsi, parce que ses adversaires s'en faisaient une arme contre lui. Mais s'il l'avait voulu, il aurait pu maintenir l'interprétation de Grégoire IX, et en tirer ce qu'il lui plaisait.
§ 1816. La dérivation imaginée par Grégoire IX est ingénieuse, La Règle interdisait aux Frères de recevoir de l'argent ; comment donc acheter ou vendre ? D'une façon très simple. Une personne qui n'est pas tenue d'observer la Règle reçoit l'argent et le dépense pour les besoins des Frères. Les Frères ne doivent rien posséder en propre. Comment donc avoir des immeubles et des meubles ? Il n'y a là aucune difficulté. La nue propriété demeurera à d'autres personnes, et les Frères en auront l'usufruit. Ainsi, il est de même exclu que n'importe qui puisse s'approprier ce dont les Frères ont l'usage. Ils obéissent à la Règle en ne résistant pas à qui veut les dépouiller ; mais le propriétaire intervient et repousse l'agresseur. Tolstoï vivait d'une façon semblable : il « ne résistait pas au mal », ne repoussait pas celui qui voulait le dépouiller ; mais sa femme y pourvoyait ; elle résistait aux envahisseurs, les repoussait, et conservait la fortune dont son mari vivait.
§ 1817. Innocent IV, en 1245, et Nicolas III, en 1279, perfectionnèrent la forme de la théorie. Le pape Nicolas dit qu'on doit distinguer la propriété, la possession, l'usufruit des choses, et qu'il ne peut y avoir de profession qui exclue l'usage des choses nécessaires à la vie. Il démontre longuement que l'esprit de la Règle de Saint François est de permettre cet usage. La Règle dit que les Frères peuvent avoir des bréviaires ; donc elle permet l'usage des bréviaires et d'autres livres utiles pour les offices divins. La Règle veut que les Frères prêchent. « Il est certain que cela présuppose la science ; la science nécessite l'étude ; on ne peut étudier convenablement sans l'usage des livres. Il ressort de tout cela que la Règle permet aux Frères l'usage des choses nécessaires à l'alimentation, à l'habillement, au culte divin, à l'étude savante ». Qui veut donner aux Frères veut donner à Dieu. « Et il n'est personne à qui, au lieu de Dieu, on puisse transférer cette propriété plus convenablement qu'au Saint-Siège, et à la personne du Pontife romain, vicaire du Christ, père de tous et spécialement des Minorites » [FN: § 1817-1]. Avec la constitution Exivi de paradiso, du pape Clément V, on revient pour quelque temps à l'interprétation littérale, et l'on voit de nouveau apparaître les très respectables oiseaux, nourris par la divine Providence [FN: § 1817-2]. Vint ensuite le pape Jean XXII, qui comprenait beaucoup mieux les nécessités de la vie pratique. Comme il avait à se plaindre des Frères Mineurs dissidents, il se tourna contre eux. Il n'eut pas beaucoup de peine à relever l'absurdité de la dérivation grégorienne, et ce qu'il y avait de ridicule à séparer la propriété de l'usufruit, pour les choses qui se consomment, car c'est vraiment une singulière dérivation que celle qui conserve la propriété d'une bouchée de pain à d'autres personnes qu'à celle qui le mange. Comme la controverse des franciscains avait, ainsi qu'il arrive habituellement en des cas semblables, tourné en disputes puériles, en l'espèce sur la coupe et la longueur des vêtements, le pape Jean XXII [FN: § 1817-3] décréta par une constitution de 1317, qu'il appartenait aux supérieurs des franciscains de déterminer la forme des vêtements, la qualité de l'étoffe, et de conserver le grain et le vin, réprimandant les Frères et leur rappelant que leur vertu principale devait être l'obéissance. Les franciscains ne cessèrent pas leur opposition : ils osèrent se révolter contre la volonté du pape, qui, de cette façon, fut poussé à développer sa dérivation [FN:§ 1817-4]. Il révoqua la bulle de Nicolas III. Ensuite, par la bulle Ad conditorem, il affirma qu'il était permis, d'une façon générale, à un pape, de révoquer les constitutions de ses prédécesseurs, et démontra la vanité de la séparation de la propriété et de l'usufruit, pour les choses qui se consomment [FN: § 1817-5]. Par conséquent, il refusa la propriété, que l'on voulait donner au pape, des biens des Mineurs, et l'attribua à ceux-ci, qui devaient en disposer par l'intermédiaire de leurs supérieurs [FN:§ 1817-6]. Cette fluctuation d'interprétations fait ressortir les difficultés insurmontables qu'il y a de concilier la rigueur théorique du précepte franciscain avec la vie pratique. Ici, nous les voyons avec un grossissement ; nous les découvrons de même dans les doctrines de la non-résistance au mal, du pacifisme, de l'humanitarisme. Mais nous les trouvons aussi, en des proportions différentes, parfois moindres, dans presque toutes les doctrines éthiques, celles du droit naturel, et en d'autres semblables, qu'on peut défendre uniquement grâce à des distinctions et des interprétations sophistiques, subtiles, prodigieuses, qui leur enlèvent toute détermination précise.
§ 1818. De nos jours, Tolstoï, par sa théorie du devoir de ne pas résister au mal, donne un nouvel exemple de dérivations absurdes. Les antimilitaristes se rapprochent de lui, eux qui veulent désarmer leur pays, et qui rêvent d'une paix universelle. Les antialcooliques [FN: § 1818-1], les vertuistes, les ascètes et les ultra hygiénistes qui vivent dans la terreur sacrée du microbe, augmentent encore la beauté d'un si beau chœur.
§ 1819. Parmi tous ces gens, nombreux sont ceux qui ne mettent pas d'accord leurs discours et leurs œuvres. Les discours vont d'un côté, les faits de l'autre, tandis que les gens plus scrupuleux cherchent à concilier les uns et les autres. Souvent, celui qui admire et exalte l'idée évangélique de Tolstoï, de ne pas défendre ce que l'on possède contre qui veut s'en emparer, se montre ensuite, dans les faits, impitoyable avec ses débiteurs, et ne permet à aucun d'eux de lui prendre la moindre chose [FN: § 1819-1]. Il trouve, quand c'est nécessaire, des prétextes sans fin qui justifient amplement cette attitude. Il ne manque pas de pacifistes, d'anti-militaristes, qui veulent néanmoins que leur patrie soit grande et puissante à la guerre, et qui exhibent de superbes raisonnements pour louer la guerre au nom de la paix. Combien de gens veulent prohiber les boissons alcooliques et font usage –pour soigner leur santé, disent-ils – de l'éther, de la morphine, de la cocaïne, ou boivent tant de thé qu'ils se donnent une maladie à laquelle on a donné le nom de théisme ; et combien d'autres font partie, en compagnie de leur maîtresse adultère, des sociétés « pour le relèvement moral », ou pour empêcher la « traite des blanches », et se justifient en disant qu'ils ont le droit de « vivre leur vie ».
§ 1820. G. Eusèbe [FN: § 1820-1] rapporte de Numenius une anecdote, sûrement inventée, mais qui fait voir, comme avec une loupe, le fait dont nous parlons. Numenius raconte donc qu'un certain Lacide, volé à son insu par ses esclaves, voyait disparaître les objets enfermés dans la dépense, sans savoir comment cela se faisait. Arcésilas, discourant sur l'impossibilité où nous sommes de rien entendre, l'avait persuadé. À son tour, Lacide professait cette doctrine, et disait que nous ne pouvons rien savoir de certain, donnant comme preuve le fait qui lui était arrivé. L'un de ses auditeurs, qui connaissait la fraude des esclaves, la lui révéla ; aussi le brave homme eut-il soin de mieux fermer la dépense. Mais les esclaves ne s'arrêtèrent pas pour cela ; ils brisaient les cachets mis par lui à la dépense ; puis, effrontément, ils lui démontraient que, n'étant sûr de rien, il ne pouvait pas non plus être certain d'avoir mis les cachets à la dépense. Le jeu dura longtemps, au détriment et à la honte du pauvre Lacide, jusqu'à ce que celui-ci mit tout raisonnement de côté et dit aux esclaves : « Garçons, nous discutons d'une manière dans les écoles et nous vivons d'une autre ».
§ 1821. Engagé sur cette voie des dérivations, on aboutit facilement au ridicule. Au XVIe siècle, un certain Gedicus considère comme sensée l'argumentation d'un livre où l'on veut démontrer que les femmes n'appartiennent pas à la race humaine, mulieres non esse homines, tandis qu'il s'agit là seulement d'une plaisanterie satirique [FN:§ 1821-1].
§ 1822. Un autre exemple remarquable des façons dont on s'efforce d'échapper aux conséquences logiques de certains principes, est celui de la morale. Les peuples civilisés s'imaginent naïvement mettre en pratique les principes de la morale théorique en cours chez eux, tandis qu'ils agissent très diversement, et recourent à de subtiles interprétations, et à une ingénieuse casuistique, pour concilier la théorie et la pratique, qui sont toujours en désaccord.
§ 1823. À chaque pas, dans l'histoire des peuples civilisés, on trouve la mise en pratique du principe que la fin justifie les moyens ; et ceux qui l'affirment explicitement ne sont pas ceux qui l'emploient le plus. Chaque secte, chaque parti accuse ses adversaires d'actes immoraux, et ne voit aucunement les siens propres. Les « libéraux » ont-ils assez crié contre les gouvernements « réactionnaires » ? et puis ils ont fait pis. En Italie, les gouvernements du passé étaient accusés de « spéculer sur l'immoralité », par le jeu du loto ; et le gouvernement très moral qui leur a succédé a maintenu et maintient ce jeu. C'est au nom d'un gouvernement qui retire des dizaines de millions par année du jeu de loto, que les magistrats condamnent celui qui joue aux jeux de hasard [FN:§ 1823-1]. En France, et en d'autres pays, les courses de chevaux jouent le rôle du loto. Les censeurs autrichiens étaient ridicules, mais pas plus que M. Luzatti, qui distribuait à tire-larigot des feuilles de vigne aux statues des musées. Les Bourbons de Naples étaient, dit-on, amis de la camorra ; mais le gouvernement qui leur a succédé ne dédaigne pas de se montrer bienveillant envers elle, pour obtenir des élections de députés à sa guise.
§ 1824. Il y a de braves personnes, lesquelles, de parfaite bonne foi, n'ont aucune parole de reproche pour les gens qui, dans le Midi de la France, font voter les absents et les morts, tandis que ces mêmes personnes entrent en fureur à la seule idée que les jésuites pouvaient admettre que la fin justifie les moyens. Parmi ceux qui, en Italie, ont toléré les abus de confiance révélés par « l'enquête sur les banques, » et par d'autres analogues, et qui continuent à en tolérer de semblables, il y a des honnêtes gens convaincus de suivre rigoureusement les principes de la morale théorique. Parmi les personnes qui, en France, approuvent le procureur général Bulot, lorsqu'il déclare que les magistrats doivent s'incliner devant la « raison d'État, le fait du prince », sous peine d'être révoqués [FN: § 1824-1], il y a des gens d’une moralité au moins moyenne, qui croient de bonne foi que le gouvernement présent a supprimé les abus de la justice qui entachaient les gouvernements passés, et que si, sous la monarchie, il y avait des privilégiés, sous la république, la loi est égale pour tous. Cette foi n'est nullement ébranlée par des procès comme ceux de Rochette ou de Mme Caillaux. Nous ne voulons ici que relever l'écart entre la pratique et la morale théorique, ainsi que l'illusion de ceux qui se les imaginent identiques ; mais nous n'entendons nullement porter un jugement quelconque sur les effets socialement utiles ou nuisibles de cet écart, ni sur ceux dérivant du fait que le plus grand nombre des gens s'en rend compte ou non.
§ 1825. MESURES POUR ATTEINDRE UN BUT. Les considérations précédentes se rapportent aux mouvements réels. Occupons-nous maintenant d'étudier un problème qui touche aux mouvements virtuels, en recherchant quels phénomènes se produisent, quand les résidus ou les dérivations se modifient. Nous ferons ici cette étude en considérant séparément certains groupes de résidus et de dérivations (§1687), et nous connaîtrons ainsi seulement une partie du phénomène. Pour le connaître dans son intégrité, nous devons considérer ensemble tous les éléments qui agissent sur la société. C'est ce que nous ferons au chapitre suivant. Nous y étudierons la composition de certaines forces qu'ici nous envisageons séparément.
Nous avons déjà établi les fondements de cette étude (§1735 à 1767), au sujet de l'action mutuelle des résidus et des dérivations ; mais tandis que nous recherchions alors ce qu'était cette action, à un point de vue général, maintenant, nous nous efforçons d'apprendre comment elle doit être pour atteindre un but déterminé.
§ 1826. Il faut prendre garde à la division, mentionnée déjà, (§1688) des dérivations en dérivations proprement dites, et en manifestations, qui correspondent aux démonstrations et aux doctrines. Considérons un ensemble de sentiments P, dont proviennent les résidus, ou mieux les groupes de résidus (a), (b), (c)... De l'un de ceux-ci, (a), au moyen des dérivations proprement dites m, n, p,... on obtient les manifestations ou les doctrines r, s, t, ... et semblablement, des autres groupes b, c, ... Ce n’est que pour simplifier que nous considérons un ensemble de sentiments. En réalité, nous devrions en considérer un plus grand nombre, dont les effets sont tantôt distincts, tantôt unis en certains groupes de résidus. Mais cette étude synthétique pourra être effectuée avec les éléments que nous allons exposer.
§ 1827. Nous pourrons distinguer les cas suivants de mouvements virtuels. 1° Le cas dans lequel on supprime (a) est le plus facile. Cette suppression entraîne celle des manifestations r, s, t,…, et il n'y aurait rien à ajouter, si le groupe (a) n'était pas accompagné de groupes analogues qui persistent. Quand il est seul, les manifestations r, s, t,... disparaissent bien, mais les autres qui sont analogues demeurent. En outre, l'affaiblissement ou la disparition du groupe (a) peuvent être compensé par le renforcement ou par l'apparition d'autres résidus de la même classe (§1742).
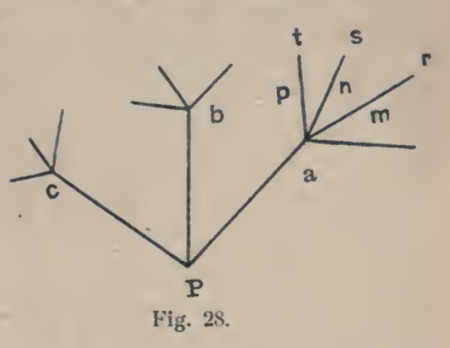
Figure 28
§ 1828. Ainsi, nous exposons d'une autre manière le même sujet dont nous avons déjà traité, lorsque nous avons observé que, pour une collectivité très nombreuse, la totalité des résidus d'une classe variait peu, beaucoup moins que les genres particuliers et les espèces. Ce sujet est très important ; mais pour le traiter avec toute l'ampleur voulue, il nous faudrait presque autant d'espace que nous en employons ici pour la sociologie entière. Par conséquent, nous devons nous arrêter dans cette voie, d'autant plus qu'il nous reste à étudier d'autres problèmes très importants, à propos desquels nous ne pourrons toutefois pas exposer tout ce que nous aurions à dire.
§ 1829. 2° Qu'arrive-t-il si l'on modifie ou si l'on détruit une ou plusieurs des dérivations proprement dites m, n, p,... ? Ce problème a déjà été résolu à un point de vue général. Nous avons vu en de nombreux cas que les dérivations, c'est-à-dire l'ensemble des dérivations proprement dites et des manifestations, avaient une importance secondaire au regard des résidus, tandis que l'importance des dérivations proprement dites était encore moindre et souvent négligeable. La production de ces dérivations est très facile, et si l'on en fait disparaître une, il en apparaît aussitôt une autre, sans aucun changement dans le fond des phénomènes.
Pourtant, ce n'est là qu'une première approximation. Bien que secondaire et parfois très faible, l'action des dérivations proprement dites peut ne pas être absolument nulle. Il resterait, par conséquent, comme seconde approximation, à la rechercher. Mais ici le manque d'espace nous empêche de pouvoir nous entretenir longuement de ce sujet, et nous devons nous contenter de quelques traits.
§ 1830. Qu'arrive-t-il si l'on modifie ou si l'on détruit une ou plusieurs des manifestations r, s,... ? Pour résoudre ce problème, il faut se rappeler ce qu'en de très nombreux exemples nous avons trouvé, au sujet de l'action réciproque des résidus (a) et des manifestations r, s,.... L'action principale, et de beaucoup la plus importante, est celle de (a) sur r, s, Une classe entière de résidus, la IIIe, pousse les individus chez lesquels elle se trouve, à se livrer à ces manifestations. Si cette action était isolée, s'il n'y en avait pas d'autres, la suppression de r n'aurait d'autre effet que de faire disparaître, précisément r. Vice versa, si une autorité quelconque contraignait les individus à accomplir r, cette action n'aurait d'autre effet que de faire apparaître r.
§ 1831. Que cela soit la partie principale du phénomène, c'est prouvé par le fait que celui qui a une religion éprouve le besoin d'accomplir les actes du culte, et que, vice versa, contraindre celui qui n'a pas de sentiments religieux à accomplir les actes du culte, ne fait pas naître chez lui ces sentiments.
§ 1832. Mais outre cette partie principale du phénomène, il y en a aussi une autre, secondaire : une réaction de r sur (a). 1° Les manifestations spontanées de certains sentiments servent à renforcer ces sentiments. Le sentiment religieux pousse à des actes du culte, et ceux-ci renforcent le sentiment religieux (§1747). Les manifestations qui ne sont pas spontanées peuvent quelquefois avoir un effet semblable, généralement assez faible ; mais elles ont ensuite un autre effet en sens contraire, qui naît par réaction contre la violence que subit l'individu ; et cet effet peut, en certains cas, être important. 2° Si certaines manifestations r sont supprimées spontanément, il peut se produire un effet opposé à celui noté maintenant, lorsqu'elles s'accomplissent spontanément, c'est-à-dire un affaiblissement des sentiments correspondants à (a). On obtient un effet semblable, qui peut être, en certains cas, important, lorsque ces manifestations sont impunément tournées en dérision. Le ridicule est une arme qui, sinon toujours, du moins souvent, est efficace pour affaiblir les résidus de la persistance des agrégats. Si les manifestations sont supprimées par la force, le phénomène devient complexe. Nous en avons déjà étudié un cas particulier (§1752 et sv.). En général, on peut remarquer que si des sentiments puissants correspondent aux manifestations que l'on empêche d'accomplir, ces sentiments sont renforcés par la réaction que produit cette suppression [FN: § 1832-1]. Si, au contraire, les sentiments sont faibles, à la longue ils peuvent être encore affaiblis. Toujours d'une manière générale, l'emploi de la force est beaucoup plus efficace pour empêcher de tourner en ridicule certaines manifestations que pour les imposer. Protéger directement certains résidus de la IIe classe est peu utile ; les protéger indirectement, en empêchant qu'ils soient offusqués, peut souvent être très utile. C'est là un cas particulier du fait général que celui qui gouverne peut mieux et plus facilement se servir des résidus existants que les modifier (§1843).
§ 1833. Le motif pour lequel les sentiments forts sont renforcés, est qu'en réalité on ne supprime pas la manifestation (r) : on empêche seulement qu'elle soit publique; mais elle demeure dans le domaine privé, ne fût-ce que dans la conscience, et se fortifie à cause des obstacles mêmes qui sont mis à ce que les gens se livrent à cette manifestation [FN: § 1833-1]. Par conséquent, avec cette restriction, on peut dire que la suppression de r affaiblit toujours, peu ou beaucoup, (a), pourvu que cette suppression soit réelle et s'étende aussi aux intimes pensées individuelles. Qu'une dérivation disparaisse parce qu'elle est repoussée par le public, ou parce qu'elle est réprouvée par l'autorité, il semble à beaucoup de personnes que c'est la même chose au point de vue de l'équilibre social. Au contraire, ces deux cas diffèrent du tout au tout. Dans le premier cas, la disparition de la dérivation est l'indice d'un changement qui a lieu dans les conditions de l'équilibre social ; dans le second cas, elle n'est que l'indice du désir qu'ont les autorités de changer ces conditions, au moyen d'une action, laquelle, le plus souvent, demeure inefficace (§1715).
§ 1834. Nous avons maintenant l'explication générale des faits particuliers rappelés précédemment (§1748 à 1754). Si, dans les sciences logico-expérimentales, on réfute facilement une assertion A, en en démontrant la fausseté (§1748), cela vient du fait que la manifestation r, constituée par cette assertion, disparaît ainsi, et qu'elle ne correspond pas à des sentiments (a) d'une force considérable. Le fait est confirmé par l'exception qu'il faut faire, lorsqu'un homme de science a des sentiments d'amour-propre ou d'un autre genre, qui l'induisent à accueillir A indépendamment de la valeur logico-expérimentale de la démonstration. Si, dans les matières où les actions non-logiques et le sentiment jouent un rôle, le fait de combattre la manifestation r ne lui enlève aucune force (§1748), cela provient de ce qu'ainsi les sentiments manifestés par r ne s'affaiblissent pas, mais qu'au contraire, en certains cas, ils se fortifient (§1749, 1750).
§ 1835. L'effet, que nous avons appelé indirect, des réfutations et des persécutions (§1751), est celui que nous considérons maintenant : celui de contrarier la manifestation, qui comprend les deux parties indiquées au §1747, c'est-à-dire la manifestation de sentiments ou d'idées existant déjà, et qui correspondent à (a), et l'effet propre de la dérivation (§1751).
§ 1836. Les sentiments qui, pour l'ensemble d'une population ou d'une classe sociale, sont appelés puissants, peuvent l'être intrinsèquement, ou parce qu'ils sont suscités par un grand nombre de faits, ou parce qu'ils appartiennent à beaucoup d'individus ; et vice versa pour les sentiments appelés faibles. C'est pourquoi, au §1752, on a tenu compte non seulement de la puissance intrinsèque des sentiments, mais aussi du nombre plus ou moins grand des faits et des individus auxquels certaines mesures s'appliquent.
§ 1837. Quand la suppression externe de r renforce (a), il s'ensuit que s, t,... sont aussi renforcés ; c'est-à-dire qu'il y a des cas dans lesquels l'affaiblissement ou la destruction d'une manifestation r fait croître les autres manifestations s, t,... Cet effet est semblable à celui qu'on obtient, lorsqu'un groupe de résidus s'affaiblit, et que, par compensation, d'autres se fortifient. Ces deux effets s'observent aussi confondus ensemble.
§ 1838. De très importantes conséquences au sujet des mouvements virtuels résultent des considérations précédentes ; nous les rangerons sous quatre chefs : (α) du §1838 au §1841 ; (β) du §1842 au §1849 ; (γ) du §1850 au §1859 ; (δ) du §1860 au §1862.
(a) Si un gouvernement veut supprimer un certain groupe de résidus (a), il a un moyen sûr, qui est de supprimer, si possible, tous les individus chez lesquels ces résidus existent. L'efficacité de ce procédé est prouvée par l'Espagne, où l'Inquisition réussit à extirper l'hérésie et la libre pensée. Si l'État romain avait pu procéder de même à l'égard du christianisme, il l'aurait probablement aussi extirpé ; mais il ne pouvait pas agir ainsi, parce que les résidus r qui se manifestaient par le christianisme, étaient les mêmes que ceux qui se manifestaient par le culte de Mithra, s, du Soleil, t, par la philosophie néo-platonicienne, v, par le mysticisme de Philon, x, et par tant d'autres, y, z,... L'empereur Julien, grand ennemi des chrétiens, avait en lui les mêmes résidus que ceux-ci. Toutes les manifestations r, s, t, v, x, y, z,... en apparence si diverses, appartenaient en très grande partie à un même groupe de sentiments (a), qui étaient ceux de tant de personnes que, pour détruire (a), il eût été nécessaire de détruire presque toute la population de l'empire romain, ce qui, évidemment, était impossible. L'empereur Constantin fit mieux que de s'obstiner, comme ses prédécesseurs, à vouloir détruire ou modifier ces sentiments : il s'en servit comme d'un moyen de gouverner (§1843).
§ 1839. La suppression des résidus (a) peut avoir lieu spontanément ; en ce cas, au lieu de mouvements virtuels, nous avons des mouvements réels. Les événements qui agissent puissamment sur une population modifient fortement les sentiments de ceux qui virent ces événements. Mais quand la mort les a tous ou presque tous détruits, ceux qui vivent alors, et qui ne connaissent les dits événements que par tradition, en reçoivent une impression beaucoup plus faible. De cette façon, on peut dire approximativement que les individus qui avaient des sentiments correspondant au groupe (a) ont disparu [FN: § 1839-1].
§ 1840. On observe des phénomènes semblables, lorsqu'au lieu de disparaître, apparaissent des individus ayant ces sentiments. C'est ce qu'on put observer dans l'empire romain, quand, à l'ancienne population du Latium, ou même à la population italique, se substitua celle des affranchis ou d'autres individus ayant surtout une origine orientale. Nous nous exprimons d'une manière impropre, quand nous parlons d'une invasion du christianisme dans l'empire romain. Ce ne fut pas une invasion d'idées, de dérivations : ce fut une invasion d'hommes qui apportaient avec eux les résidus qui se manifestèrent par des dérivations. Les anciens peuples de Rome, du Latium et de l'Italie, avaient certains résidus auxquels correspondait une certaine religion. Les peuples orientaux avaient divers résidus auxquels correspondait une religion différente. Rome vainquit ces peuples par les armes et les asservit ; mais ensuite, elle en tira ses affranchis, qui devinrent ses citoyens, et permit que les peuples vaincus affluassent à Rome, des provinces sujettes, voire de la Judée méprisée. C'est pourquoi ce n'est pas la Grèce seule, mais bien aussi l'Asie, l'Afrique et d'autres contrées barbares, qui apportèrent à Rome leurs sentiments et les conceptions ou les dérivations correspondantes. Non seulement vers la fin de l'Empire, mais aussi au beau milieu de son existence, les Romains n'avaient que le nom de commun avec les populations qui conquirent le bassin de la Méditerranée.
§ 1841. Pour supprimer (a), beaucoup de personnes croient qu'on peut recourir à un changement de l'éducation. Ce procédé peut être efficace, si l'action du changement d'éducation est continuée durant le reste de la vie. Autrement, il a peu ou point d'efficacité. Les futurs chrétiens furent instruits dans les écoles païennes ; la plupart des chefs des ennemis de la religion chrétienne, en France, vers la fin du XVIIIe siècle, furent instruits dans les écoles des jésuites ; et la plupart des chefs de la Révolution française aussi. Cela ne prouve pas que l'effet de l'éducation soit zéro ; cela prouve qu'elle est seulement une partie des multiples effets dont la résultante est donnée par les actions de l'homme.
§ 1842. (β) Pour agir sur (a), les gouvernements opèrent habituellement sur les manifestations r, s,... Ils y sont poussés moins par un raisonnement logique que par l'action non-logique des sentiments qui sont heurtés par les manifestations r, s,... La dérivation habituellement employée est la suivante : « Par r se manifestent des sentiments qui sont nuisibles à la société ; donc je réprimerai r ». Si le raisonnement était logico-expérimental, on devrait ajouter : « parce qu'en réprimant r, je détruirai les sentiments qui se manifestent ainsi ». Mais c'est là justement le point faible de cette proposition, car il n'est pas du tout démontré qu'en réprimant la manifestation de certains sentiments on détruise ces sentiments.
§ 1843. Il y aune abondance vraiment imposante de faits qui démontrent le peu d'efficacité de l'action qu'on veut exercer sur les résidus, en agissant sur les manifestations, et pis encore sur les dérivations. Les mesures de rigueur contre les manifestations de la pensée par le moyen de la presse ont-elles empêché la première révolution française, la chute de Charles X, en France, et les mouvements révolutionnaires de 1831, dans toute l'Europe ; puis, de nouveau, les mouvements de 1848, le fait que les révolutionnaires se sont renforcés en France, sous Napoléon III, les mouvements révolutionnaires en Russie, après la guerre du Japon ? Et comment pourrait-on user de plus de rigueur envers la presse qu'on ne le faisait en Russie ? Au faîte de sa puissance, le prince de Bismarck, auréolé des victoires sur la France et de la fondation de l'empire allemand, parut vouloir détruire les résidus qui se manifestaient sous la forme du socialisme et du catholicisme, en réprimant leurs manifestations : il obtint précisément l'effet contraire : il les renforça. Le socialisme est devenu le parti le plus nombreux, en Allemagne. Le catholicisme, avec le parti du Centre, a obtenu souvent une part prépondérante dans le gouvernement [FN:§ 1843-1]. En homme pratique et avisé qu'il était, Bismarck finit par reconnaître lui-même l'erreur commise parle Kulturkampf [FN:§ 1843-2]. Le gouvernement de l'empereur Guillaume II suivit très opportunément une voie opposée, et, au lieu de se mettre à combattre ou à vouloir modifier les résidus qui se manifestaient par le catholicisme, il s'en servit comme d'un moyen de gouverner. Il ne sut ou ne voulut pas faire de même pour les sentiments manifestés par les Alsaciens-Lorrains et les Polonais ; c'est pourquoi, en ce cas, son œuvre fut vaine, comme l'avait été celle du Kulturkampf (§2247-1). Le fait de la Pologne est tout à fait typique. Un pays a été partagé en trois. Dans les territoires soumis à la domination russe ou prussienne, le gouvernement veut combattre ou modifier les sentiments : il fait une œuvre inutile qui n'aboutit à rien. Dans la partie soumise au régime autrichien, le gouvernement se sert de ces mêmes sentiments comme d'un moyen de gouverner, et il obtient du succès [FN: § 1843-3]. Rome acquit la sympathie et la fidélité des peuples conquis, précisément parce qu'elle respectait leurs sentiments. Pour une cause semblable, la domination anglaise se maintient aux Indes ; et il arrive aussi que de toutes les colonies françaises, la Tunisie est celle où la domination française est le mieux acceptée et le mieux vue, parce que c'est aussi celle où les sentiments, les us et coutumes des sujets, sont le plus respectés.
Prenons garde, en outre, que les peuples supportent plus facilement de lourdes charges que des tracasseries qui semblent petites et insignifiantes, et qui choquent leurs mœurs. On sait que la révolte des cipayes, aux Indes, fut occasionnée par le bruit que les Anglais enduisaient de graisse de porc la ficelle qui fermait les cartouches, qu'on déchirait alors avec les dents avant de les mettre dans le fusil. De petites vexations en fait de langue, d'usages religieux et, dans les pays orientaux, en fait de femmes, sont difficilement tolérées. Mais il faut faire attention que pour petit et insignifiant que ces faits paraissent, au point de vue logique, ils sont au contraire grands et importants au point de vue des sentiments. Les gouvernements qui ne saisissent pas cela obtiennent exactement l'effet contraire à celui qu'ils ont en vue. En 1913, le chancelier allemand dit, au Reichstag, que les difficultés avec les habitants de l'Alsace-Lorraine provenaient de ce que ceux-ci préféraient leurs cousins et cousines français à leurs cousins allemands. Or l'art de gouverner consiste précisément à savoir se servir de ces sentiments, et non à perdre sa peine à vouloir inutilement les détruire, ce qui a souvent pour effet de les renforcer. Celui qui sait se soustraire à la domination aveugle de ses propres sentiments se trouve en des conditions favorables pour se servir de ceux d'autrui à ses propres fins. Au contraire, celui qui est soumis à la domination de ses sentiments ne sait pas se servir ou se sert mal de ceux d'autrui; il les heurte inutilement, et n'obtient pas ce qui lui serait avantageux. On peut généralement en dire autant pour les rapports entre gouvernants et gouvernés. L'homme politique qui sert le mieux ses intérêts et ceux de son parti est celui qui n'a pas de préjugés et qui sait tirer parti de ceux d'autrui.
§ 1844. Les faits de la religion sexuelle nous fournissent un autre exemple excellent de l'inutilité de l'œuvre qui, en réprimant les manifestations, vise à détruire les résidus dont ces manifestations proviennent. On se demande si, au cours des siècles, toutes les lois et les mesures prises contre les mauvaises mœurs ont eu le moindre effet sur celles-ci ; à tel point que si l'on ne se mettait pas en garde contre le raisonnement post hoc propter hoc, on inclinerait à dire qu'au contraire, là où les mesures prises contre les mauvaises mœurs sont les plus rigoureuses, c'est là que celles-ci sont les plus mauvaises. Nous pouvons voir autour de nous que les mesures qui répriment une manifestation r servent uniquement à renforcer les autres manifestations s, t,... Là où l'on fait la guerre à Cythère, la puissance de Sodome, de Lesbos et d'Onan s'accroît. Là où, sous prétexte de réprimer la « traite des blanches », on fait la chasse aux femmes légères, là fleurissent l'adultère et les mariages annuels résultant de divorces faciles.
§ 1845. En beaucoup de faits frappés par la législation pénale, nous avons des manifestations du genre de celles que nous venons de noter. Les vols et les assassinats ne sont certes pas des manifestations théoriques ; mais il n'en résulte pas qu'ils soient indépendants des sentiments, qu'ils n'en soient pas une manifestation. C'est justement pourquoi ils ont quelques caractères semblables à ceux que nous avons notés tout à l'heure.
1° Dans la mesure où les actions non-logiques entrent dans ces faits, ceux-ci échappent au raisonnement. C'est pourquoi la menace de la peine a peu d'efficacité pour empêcher les hommes de commettre les délits graves et les délits dits passionnels, parce que, si nous laissons de côté les exceptions, ces délits procèdent de sentiments forts poussant à des actions non-logiques. Dans les moindres délits, le sentiment a moins d'influence ; par conséquent, le rôle de la logique devient plus important : la menace de la peine a plus d'efficacité pour empêcher des contraventions que pour empêcher l'assassinat.
2° La cause principale des délits, sauf toujours les exceptions, est l'existence de certains sentiments (a). La théorie du criminel-né ajoute que ces sentiments viennent de naissance à l'individu. Cela semble vrai en partie, mais pourrait difficilement être admis en entier, car l'ensemble des circonstances de lieu, de temps et autres, dans lesquelles l'individu a vécu, ont certainement modifié au moins certains sentiments qu'il possédait de naissance. Mais opposée à la théorie dite de la « responsabilité », qui ramène tout à des actions logiques, la théorie du criminel-né apparaît presque comme la vérité opposée à l'erreur.
3° Parmi les faits les moins douteux de la science sociale, il y a celui-ci : que jusqu'à présent, l'effet de la peine pour amender le criminel a été plus qu'insignifiant, surtout en ce qui concerne les crimes les plus graves. Souvent même, il est arrivé qu'au contraire il a rendu le criminel plus mauvais. Cela se produit en vertu de la règle générale suivant laquelle supprimer par la force les manifestations d'un groupe de sentiments, diminue souvent peu ou point l'intensité de ce groupe, et quelquefois l'accroît. Beaucoup de tentatives ont été faites pour porter remède à ce défaut de la législation pénale, et à vrai dire sans grand effet ; le peu qu'on a obtenu a été précisément le résultat d'une action sur les sentiments (a).
§ 1846. 4° Le seul moyen qui se soit montré efficace pour faire diminuer les crimes consiste à faire disparaître les criminels, moyen analogue à celui indiqué en (α), §1837.
5° En outre, il est certain que l'état général des sentiments de la population agit sur les crimes. Il y a des peuples de voleurs, d'autres d'escrocs, d'autres d'assassins, etc. C'est-à-dire que les groupes de sentiments (a), (b),... sont différents suivant les peuples, les lieux, les temps, et souvent des compensations s'opèrent entre les divers genres.
§ 1847. 6° Notons d'autres raisonnements erronés : ce sont ceux qui, de l'inefficacité de la peine au point de vue des actions logiques, concluent à son inefficacité en général. Par exemple, il est erroné de dire : « La peine de mort est inefficace, parce qu'elle n'empêche pas un homme directement et logiquement de tuer ». Son efficacité est d'une autre nature. Tout d'abord, il est certain qu'elle fait disparaître l'assassin, qu'elle délivre la société d'une partie, au moins, des individus qui ont un penchant à tuer. Ensuite elle agit indirectement en renforçant les sentiments qui font envisager le crime avec horreur. Il est difficile de nier ce fait, si l'on prend garde à l'efficacité des règles dites de l'honneur, lesquelles n'ont pas de sanction pénale directe, mais engendrent un certain état de choses, grâce aux sentiments qui conviennent à cet état de choses ; en sorte que la majeure partie des hommes répugnent à transgresser ces règles. Ainsi, le Sicilien manquera difficilement aux règles de l'omertà [FN: § 1847-1], parce que, dès sa naissance, il a eu ou acquis les sentiments qui conviennent à ces règles, et la punition qui frappe les transgresseurs maintient et renforce ces sentiments.
Autre exemple. Le raisonnement suivant est erroné. Du fait supposé (la vérité est peut-être différente), que la loi appelée loi de sursis n'a pas augmenté le nombre des récidives, on conclut à son innocuité. Les modifications des sentiments se produisent lentement, parfois très lentement. Il faut que plusieurs générations passent, pour qu'on puisse connaître sûrement l'effet de cette loi et d'autres semblables. En outre, ce n'est pas à la récidive seule qu'il faut prendre garde, mais à la criminalité en général. L'effet de la loi de sursis s'étend très au delà du criminel qu'elle protège : le reste de la population s'habitue à penser qu'on peut commettre impunément un premier délit ; et si cela agit sur les sentiments, la répulsion qui éloigne instinctivement l'homme civilisé du délit venant à diminuer, la criminalité générale peut croître, sans que la récidive croisse également. La répression énergique des délits, exercée aux siècles passés, durant de longues années, a contribué à maintenir certains sentiments de répugnance pour le crime, sentiments que nous trouvons aujourd'hui chez les hommes ; et pour les détruire, il faudra aussi un temps assez long. Les peuples qui se paient aujourd'hui le luxe de l'humanitarisme agissent comme l'enfant prodigue qui dilapide l'héritage paternel.
§ 1848. Il faut prendre garde ici à ce que nous avons déjà mentionné au §1832, touchant l'effet produit par la possibilité de tourner en ridicule certaines manifestations de sentiments. La douceur des lois, la loi du sursis, par laquelle on tend presque à octroyer au citoyen le droit de commettre un premier délit, l'indulgence extrême des tribunaux et du jury, la patience humanitaire des magistrats qui tolèrent, dans les débats publics, que l'accusé leur manque de respect (§1616-1), et qu'il aille parfois jusqu'à les insulter et à se moquer de la peine dont il est menacé, le confort dont on jouit dans certaines prisons modernes, où, sous prétexte de procéder au « relèvement moral » du délinquant, on le traite avec toutes sortes d'égards, et où il se trouve souvent beaucoup mieux que chez lui ; les réductions des peines déjà si douces, les grâces et les amnisties fréquentes : tout cela permet à un très grand nombre d'hommes de tourner en dérision le délit et sa répression, de se vanter – se posant en hommes courageux et dépourvus de préjugés – de n'avoir aucune répugnance à commettre un délit et de n'en pas craindre la répression, laquelle est souvent plus apparente que réelle.
La religion humanitaire renforce ces sentiments, en fournissant les dérivations au moyen desquelles ils s'expriment, les mythes qui en sont la théologie.
§ 1849. 7° Semblable est généralement l'action des théologies, des morales métaphysiques ou autres, qui toutes, pour autant qu'elles sont de simples dérivations ou des manifestations de dérivations, ont peu ou point d'effet direct sur la criminalité. Pour autant qu'elles sont des manifestations de sentiments, elles paraissent avoir un effet qui, en grande partie, provient de ces sentiments mêmes (§1680). Par conséquent, si on laisse de côté l'effet indirect noté tout à l'heure, on obtient peu ou rien en agissant sur elles. Le peu d'effet que cette action est capable de donner provient de la réaction des dérivations sur les sentiments qui leur donnent naissance, et ensuite de l'action de ces sentiments sur la criminalité. Nous avons là un cas particulier de la loi générale que nous avons trouvée dans l'action des résidus et dès dérivations.
§ 1850. (γ) De même, lorsque nous recherchons les effets qui résultent d'une modification de (a), nous avons un cas particulier de la loi générale de l'action des résidus correspondant à un même ensemble de sentiments (§1740). Les gouvernements qui, d'une manière ou d'une autre, agissent sur (a), doivent savoir que, même s'ils ne s'en aperçoivent pas, ils agissent aussi sur d'autres résidus de la même classe [FN: § 1850-1]. Quelquefois ils le savent, et c'est là le motif pour lequel, par raison d'État, les gouvernements ont protégé une religion déterminée. Pour justifier cette manière d'agir, outre le sophisme déjà signalé au §1644, et par lequel on substitue des actions logiques aux actions non-logiques, ces gouvernements se servent aussi d'un raisonnement qui a pour but de démontrer qu'en protégeant un genre de résidus, on favorise aussi tous les autres genres de résidus dépendant de certains ensembles de sentiments (§1744). Dans ce but, on fait usage de dérivations qui sont des variétés du type suivant : « Quiconque est religieux a des sentiments que je désire voir chez les bons citoyens ; donc je dois m'efforcer de faire que tout le monde ait la religion X, que j'ai déterminée et que je protégerai ». Laissons de côté la question de l'efficacité de cette protection, qui consiste habituellement en actions sur les manifestations religieuses. Nous venons de traiter de cette question. Supposons pour un moment que la protection soit efficace, et poursuivons.
§ 1851. Le raisonnement logico-expérimental correspondant à la dérivation indiquée tout à l'heure serait : « Quiconque est religieux a les sentiments que je désire voir chez les bons citoyens ; mais on ne peut être religieux qu'en ayant les sentiments d'une religion donnée ; donc je m'efforcerai de faire que les citoyens aient précisément les sentiments de cette religion ». La proposition : « on ne peut être religieux qu'en ayant les sentiments d'une religion donnée » est absolument démentie par l'expérience, et nombre d'hommes pratiques le savent (§1843), même s'ils estiment utile de n'en pas parler en public. Beaucoup de religions, différentes dans la forme, sont des manifestations de sentiments religieux qui diffèrent peu. En outre, la religiosité est habituellement plus grande chez les hérétiques que chez ceux qui suivent la religion orthodoxe protégée par le gouvernement, lequel protège en effet une certaine théologie, certains actes du culte, mais persécute précisément cette même religiosité qu'il dit vouloir protéger. Ici, l'erreur est double : d'abord la confusion déjà signalée entre les dérivations et les résidus, c'est-à-dire entre la théologie et la religiosité ; puis la confusion entre certains résidus et le reste des résidus du même genre ou de genres analogues. Si les résidus de différentes religions sont a1, a2, a3,... et si l'on renforce l'ensemble de sentiments dont ils dépendent (§1744), on aura renforcé la religiosité ; mais si l'on renforce a1 au détriment de a2, a3,... la religiosité peut n'avoir pas augmenté, mais avoir, au contraire, diminué. Que l'on compare l'état de la religion catholique, aux États-Unis d'Amérique, où toutes les sectes chrétiennes ont une liberté très large, avec l'état de cette même religion, en France, lorsque, comme sous Napoléon III, par exemple, elle jouissait de la protection du gouvernement, et l'on apercevra aussitôt combien cette protection est inefficace pour renforcer les résidus religieux. Qu'on y ajoute l'exemple de Rome sous la papauté, où l'on avait en même temps de vigoureuses répressions des manifestations contraires au catholicisme et des résidus religieux catholiques très faibles [FN: § 1851-1].
§ 1852. L'erreur que nous avons signalée tout à l'heure a été perçue par beaucoup de personnes ; mais, comme d'habitude, au lieu de se manifester sous forme logico-expérimentale, cette intuition a pris la forme d'une dérivation qui, sous l'aspect logico-expérimental, est tout aussi erronée que celle à laquelle elle s'oppose. Les hérétiques ont revendiqué la « vérité » de leur hérésie, opposée à l' « erreur », de la religion dominante ; ils ont exalté leur « religiosité », opposée au relâchement de leurs adversaires ; ils ont démontré qu'ils étaient tout aussi bons citoyens que les orthodoxes, et même meilleurs. Puis les métaphysiciens et les théoriciens se sont mis à subtiliser sur ce sujet. Ils ont invoqué les « droits » de la conscience individuelle en présence des pouvoirs publics, la sacro-sainte « liberté de pensée », qui est de telle nature qu'on peut l'invoquer pour soi, tandis qu'on la dénie à ses adversaires, la « tolérance », dont les orthodoxes doivent user envers les hérétiques, tandis que ceux-ci sont dispensés d'en user à l'égard des orthodoxes ; un grand nombre d'autres argumentations semblables, qui ont parfois persuadé, non par la force de leur logique, mais parce qu'elles correspondaient à des sentiments qui, développés avec le changement des conditions sociales, entraient en conflit avec d'autres sentiments, lesquels étaient autrefois tout aussi vigoureux, et confondaient la religiosité en général avec l'une de ses manifestations. Ces argumentations ont aussi parfois persuadé, parce qu'elles correspondaient à des sentiments qui tiraient leur origine du renforcement des instincts des combinaisons, et de changements analogues en d'autres résidus.
§ 1853. Il est nécessaire de faire ici une distinction importante. Nous avons démontré que, pour obtenir les effets de la religiosité, il est bon que les personnes chargées de réglementer les actions d'autrui soient quelque peu, peut-être même très indifférentes aux formes de la religion ; mais la démonstration ne s'étend pas à ceux qui agissent, et ce serait une grave erreur que de vouloir la leur appliquer. Au contraire, l'attachement à sa foi et l'aversion pour celle d'autrui est généralement l'indice d'un sentiment vif de sa propre foi ; il est par conséquent aussi un indice que l'on obtiendra les effets désirés de la religiosité. Elliptiquement, on pourrait dire qu'il est bon que celui qui doit agir ait cet attachement et cette aversion, pourvu qu'on entende par là, non les dérivations par lesquelles ces deux sentiments se manifestent, mais les sentiments qui renforcent la foi (§1744). Si quelqu'un disait qu'il serait bien que les hommes fussent tolérants envers ceux qui ont une foi différente, il n'y aurait rien à objecter, sinon que celui qui affirme cela suppose inexistante une liaison (§126) qu'on observe habituellement. Il est de même utile que celui qui se sert de la religiosité des autres à des fins sociales, ne s'adonne pas à certaines manifestations extrêmes de cette religiosité. Celui qui a une foi vive la manifeste parfois d'une manière nullement raisonnable, et qui peut être parfaitement ridicule [FN: § 1853-1]. De même aussi, si quelqu'un disait – et beaucoup de gens le disent effectivement – qu'il serait bien que les hommes s'abstinssent de ces démonstrations, tout en éprouvant un sentiment vif de leur foi, la réponse serait identique à celle donnée tout à l'heure : soit qu'il n'y a rien à objecter à ce désir, sinon que croire cela possible c'est supposer inexistante une liaison qu'on a observée habituellement. Tout cela n'empêche pas que l'on puisse s'efforcer d'affaiblir ces liaisons, que l'on puisse essayer de diminuer l'intolérance de certains sentiments, le manque de bon sens et le ridicule de certaines manifestations. L'erreur naît lorsque, sans se soucier de l'existence des liaisons, on condamne et l'on veut supprimer les conséquences des sentiments qu'on veut conserver [FN:§ 1853-2].
La différence relevée ici entre celui qui fait agir et celui qui agit est d'ordre général ; nous en verrons un grand nombre d'autres exemples.
§ 1854. Pour faciliter l'exposition, nous avons employé tout a l'heure le terme religion, qui n'est et ne peut être défini avec précision ; c'est pourquoi il faut être en garde contre les erreurs qui pourraient provenir de son indétermination. Les ensembles appelés religions sont constitués par des résidus et des dérivations. Il y a des résidus communs à ces différents ensembles ; il y en a de différents. C'est de là précisément, en grande partie, que naît la difficulté de donner une définition unique de ces ensembles. Les définitions déjà données sont innombrables. On en discute depuis des siècles sans rien conclure ; à ces définitions s'en ajouteront d'autres à l'avenir, et l'on continuera à discuter sur les définitions futures comme sur les définitions passées, tant que les hommes se complairont à ces vains discours. Nous savons déjà que la valeur sociale des religions, comme celle de toute autre doctrine, dépend très peu des dérivations, énormément des résidus. En plusieurs religions, il y a un groupe important de résidus, constitué principalement par des persistances d'agrégats, qui correspondent à des sentiments de discipline, de soumission, de hiérarchie. C'est ce dont eurent plus ou moins l'intuition les gouvernements qui voulaient protéger la religion pour avoir des sujets fidèles. Ces sentiments se manifestent principalement par le culte. De là vient qu'au point de vue de l'utilité sociale, le culte importe beaucoup plus que la théologie. Cela est contraire à l'opinion commune, mais en accord avec les faits.
§ 1855. La haute valeur sociale de l'ancienne religion romaine provient justement de ce qu'elle était constituée presque exclusivement d'actes du culte, et qu'elle avait, par conséquent, un maximum de parties utile. Parmi les sectes chrétiennes, la valeur du catholicisme pour maintenir la discipline dépasse de beaucoup celle des autres sectes.
§ 1856. Ici surgit spontanément une objection. L'Italie est catholique ; pourtant les sentiments de discipline y sont beaucoup moins puissants qu'en Prusse, pays protestant. Pour rendre l'objection plus forte, laissons de côté le fait que le luthéranisme prussien est une des sectes protestantes où se maintiennent le plus les actes de discipline, et ne fixons notre attention que sur le fait principal qui donne la solution du problème : sur l'existence simultanée de différents groupes analogues de résidus. Parmi ceux-ci il en est de remarquables : ceux qui se manifestent par la foi monarchique et par l'esprit militaire, ainsi que par la soumission aux autorités. En Italie, ces résidus sont faibles ; en Prusse, ils sont très forts. C'est là un des si nombreux cas où un groupe de résidus se fortifie au détriment des groupes analogues.
§ 1857. Lorsqu'on fixe son attention principalement ou uniquement sur les dérivations, on désigne souvent par le même nom des choses différentes. Par exemple, un ensemble où il y a unité de dérivations nous apparaît comme une religion unique, tandis qu'elle peut être divisée en plusieurs, si l'on fait attention aux résidus différents, grâce auxquels elle est acceptée par des classes diverses de personnes. Voyons, par exemple, le socialisme. Les classes inférieures, qui attendent de cette religion l'amélioration de leur sort, acceptent le socialisme surtout grâce aux résidus d'intégrité personnelle, et en outre grâce aux intérêts. Dans les classes supérieures, nous avons d'abord ceux qui se servent du socialisme à leurs fins. Leurs actions sont principalement logiques ; par conséquent nous n'en parlons pas. Puis nous avons des gens qui acceptent le socialisme, mus surtout par des résidus de sociabilité, parmi lesquels ceux de l'ascétisme jouent souvent un grand rôle. La religion socialiste de ces gens, envisagée au point de vue des résidus, est donc entièrement différente de celle des classes inférieures. Des considérations analogues s'appliquent aux autres religions; par exemple à la religion catholique. Si l'on exclut, comme d'habitude, ceux qui s'en servent à leurs propres fins, il reste, avec unité de dérivations, des religions différentes selon les différents résidus qui sont mis en action ; et ici, nous avons une classe où les résidus de l'ascétisme ont une action de beaucoup prépondérante, en comparaison de celle des autres résidus. C'est ce que comprirent bien les hommes qui gouvernèrent l'Église catholique ; et, sous l'unité de dérivations, ils surent admettre les nombreuses variétés de résidus, qui se trouvent chez le clergé séculaire, le clergé régulier, les laïques, les différents ordres de frères, etc. Voilà un nouvel exemple où l'on voit, comme d'habitude, que l'art de gouverner consiste en grande partie à savoir utiliser les résidus existants (§1843).
§ 1858. Au point de vue de leur valeur sociale, les résidus de l'ascétisme sont en général inutiles et même nuisibles. Par conséquent, il est assez probable que la religion socialiste des classes inférieures est socialement utile, tandis que la religion ascétique des classes supérieures est nuisible. En somme, la première peut être révolutionnaire, mais elle n'est pas du tout contraire à la hiérarchie; au contraire, elle la favorise, et l'autorité des chefs socialistes est beaucoup mieux respectée que celle des magistrats de beaucoup de gouvernements. La religion socialiste est une grande école de discipline, et l'on peut dire qu'à ce point de vue, elle vient immédiatement après la religion catholique. Elle sert à renforcer les résidus de la Ve classe (intégrité personnelle) chez les hommes des couches inférieures de la société, et mieux que n'importe quelle autre mesure – y compris celle de l'instruction obligatoire – elle a pu soulever des individus appartenant à une masse amorphe à la dignité de citoyens ; par conséquent, la force d'action s'est accrue dans la société entière. Au contraire, la religion ascétique n'est que débilitante pour toute énergie. Quand elle est efficace, elle affaiblit les résidus de la Ve classe dans les couches sociales supérieures, et, du petit nombre d'individus qui l'acceptent de bonne foi, elle fait des êtres inermes, imbéciles, inutiles à eux-mêmes et à autrui, et tels que s'ils jouaient un rôle important dans le gouvernement de la société – ce qui n'est heureusement pas le cas – ils la mèneraient à sa ruine. La pratique de cette religion n'a pas une utilité plus grande que n'en avaient les actions des frères qui se macéraient dans le désert. Étant en dehors de la réalité des intérêts, cette pratique ne permet pas aux conflits sociaux de se résoudre suivant leur équilibre, et provoque une inutile consommation d'énergie. En conclusion, la religion du socialiste prolétaire et révolutionnaire a des effets opposés à ceux de la religion du socialiste « intellectuel » et « transformiste ». C'est ce que comprennent par intuition les gouvernements qui font la cour à cette dernière religion, dont ils peuvent se servir à leurs fins, et qui combattent avec acharnement la première, qui les empêcherait de continuer à exploiter le pays [FN: § 1858-1]. C'est aussi ce que comprennent par intuition plusieurs socialistes, quand ils repoussent la coopération des « capitalistes », des « intellectuels », et qu'ils ne veulent pas renoncer à la « lutte des classes ». On peut faire des observations analogues pour la foi des syndicalistes, des anarchistes ou d'autres sectes analogues qui se substitueront peu à peu à celles-ci. Souvent les classes supérieures ont, à leur déclin, de la répugnance à faire usage de la force. Cela arrive d'habitude parce que le plus grand nombre des individus qui les composent préfèrent recourir presque uniquement à la ruse, et le plus petit nombre, par manque d'intelligence ou par lâcheté, répugne à des actes énergiques. Comme nous le verrons plus loin (§2170 et sv.), l'usage de la force est indispensable dans la société, et si une classe gouvernante ne veut pas y recourir, il est nécessaire, au moins dans les sociétés qui continuent à subsister et à prospérer, que cette classe cède la place à une autre qui veuille et sache employer la force. De même que la société romaine fut sauvée de la ruine par les légions de César et par celles d'Octave, il se pourrait que notre société fût un jour sauvée de la décadence par ceux qui seront alors les héritiers de nos syndicalistes et de nos anarchistes.
§ 1859. Le point faible de la religion humanitaire n'est pas dans la défectuosité logico-expérimentale de ses dérivations. À ce point de vue, elles valent tout autant que les dérivations des autres religions ; mais, parmi celles-ci, il y en a qui renferment des résidus utiles aux individus et à la société, tandis que la religion humanitaire n'a que peu ou point de ces résidus. Comment se peut-il qu'une religion qui n'a d'autre but que le bien de l'humanité, et qu'on appelle humanitaire précisément pour ce fait, puisse ne pas avoir de résidus correspondant au bien de la société ? La réponse à cette objection a déjà été donnée au §1779. Les principes dont la doctrine humanitaire est une conséquence logique ne correspondent en rien aux faits. Ils expriment, sous une forme objective, un sentiment subjectif d'ascétisme. L'intention des humanitaires de bonne foi est de faire le bien de l'humanité, de même que l'intention d'un enfant qui tue un petit oiseau en le caressant trop était de faire le bien de cet animal. D'autre part, n'oublions pas que l'humanitarisme a eu aussi quelque effet social favorable, puisqu'il a contribué à faire diminuer les peines ; et si parmi celles-ci il y en avait d'utiles dont la réduction fut nuisible à la société, il y en avait aussi d'inutiles dont la réduction fut profitable (§1861). En revanche, la doctrine de l'humanitarisme ne tient pas debout, au point de vue logico-expérimental, soit parce qu'elle n'a aucune valeur intrinsèque de ce genre, soit et surtout parce que, même si par une hypothèse qui n'est pas du tout probable, elle avait cette valeur, cela ne servirait à rien pour pousser les hommes à des actions utiles, car ils sont guidés principalement par le sentiment. De semblables observations servent à juger l'action des « intellectuels ». Cette action a très peu d'éléments utiles et beaucoup de nuisibles, parce qu'au point de vue des sentiments, les intellectuels ferment les yeux à la réalité, telle qu'elle se reflète en un grand nombre de sentiments qu'ils condamnent par le fait qu'ils n'en comprennent pas le rôle social ; et, au point de vue logico-expérimental, ils ne raisonnent pas sur les faits, mais sur les dérivations, dont ils tirent avec une rigueur logique inopportune des conséquences qui divergent entièrement des faits (§1782). Les considérations que nous venons de présenter s'appliquent à la religion démocratique en général. Les nombreuses variétés de socialisme, de syndicalisme, de radicalisme, de solidarisme, de tolstoïsme, de pacifisme, d'humanitarisme, etc., forment un ensemble que l'on peut rattacher à la religion démocratique, et qui est semblable à celui des innombrables sectes qui apparurent à l'origine de la religion chrétienne. Nous voyons maintenant croître et dominer la religion démocratique, de même que les hommes des premiers siècles de notre ère virent commencer et croître la domination de la religion chrétienne. Les deux phénomènes ont de nombreuses et profondes analogies. Pour connaître le fond de ces phénomènes, il faut mettre de côté les dérivations et aller jusqu'aux résidus. La valeur sociale de l'une ou de l'autre de ces deux religions ne réside nullement dans leurs théologies, mais gît au contraire dans les sentiments manifestés par elles. Pour connaître la valeur sociale du marxisme, savoir si la théorie de la plus-value de Marx est erronée ou non, importe à peu près tout autant que pour connaître la valeur sociale du christianisme, il importe de savoir si et comment le baptême lave le péché originel ; c'est-à-dire que cela importe peu ou point. Certaines exagérations du syndicalisme n'enlèvent pas plus de valeur à la religion démocratique, que les exagérations franciscaines n'en enlèvent à la religion catholique. Les théories de la solidarité et la cosmogonie biblique sont également en dehors de la réalité expérimentale ; mais cela ne diminue nullement l'importance sociale des religions auxquelles les premières et la seconde appartiennent. Ainsi que nous l'avons relevé maintes et maintes fois, on ne peut, de la vanité logico-experimentale de ces dérivations ou d'autres semblables, tirer la conclusion qu'elles sont nuisibles ou même seulement inutiles ; ce sont des choses qui ont peu ou point de rapport. L'analogie de certaines dérivations de la religion chrétienne et de la démocratique explique qu'elles se confondent en certaines sectes, telles que celles des tolstoïens, des démocrates chrétiens, des protestants dits libéraux, des modernistes, des nouveaux admirateurs de Saint François, etc. Si l'on excepte et si l'on met à part les dérivations, nous voyons apparaître la grande transformation sociale qui s'est manifestée à l'origine du christianisme, et la non moins grande transformation sociale qui s'accomplit maintenant, et qui est manifestée par la religion démocratique. La découverte des rapports de ces transformations avec l'utilité sociale est un problème très important et très difficile. Pour le résoudre, il est nécessaire d'avoir une théorie de l'utilité sociale beaucoup plus développée, beaucoup moins imparfaite que celle dont nous pouvons à peine tracer maintenant les grandes lignes. Mais nous pouvons bien dire qu'on obtiendra la première approximation du problème en négligeant de considérer les dérivations dont l'action est secondaire et doit, par conséquent, n'être envisagée que dans des approximations successives. Nous pouvons ajouter qu'il est indispensable de considérer les sentiments manifestés par ces transformations, non pas objectivement, séparés des individus, mais en rapport avec eux, les mêmes sentiments pouvant être utiles chez certains individus, nuisibles chez d'autres. Enfin, il faut aussi laisser entièrement de côté des questions secondaires, telles par exemple que celle de la moralité de certains adeptes de ces religions. Chaque religion a ses parasites ; c'est un fait secondaire qui a peu d'action sur la valeur sociale des religions. Ceux de nos contemporains qui n'appartiennent pas à la religion démocratique sont, en grande partie, dans des conditions semblables à celles des Gentils qui assistaient à l'envahissement de la religion chrétienne. Aujourd'hui, quelques-uns estiment à tort, de même qu'autrefois leurs prédécesseurs estimaient à tort, pouvoir s'opposer efficacement au développement de la religion dont ils sont adversaires ; et ils croient pouvoir le faire en réfutant les dérivations de cette religion. D'autres personnes trouvent ces dérivations si absurdes qu'elles dédaignent de s'en occuper ; et en cela aussi elles agissent comme certains de leurs prédécesseurs [FN: § 1859-1]. Les uns et les autres font usage habituellement de dérivations qui ne sont pas du tout meilleures que celles qu'ils repoussent. Très peu de gens ont l'idée, peut-être pourrait-on dire que personne n'a l'idée de laisser entièrement de côté les dérivations, et d'étudier exclusivement les faits et les rapports qui existent entre eux.
§ 1860. (δ) Enfin l'on peut vouloir faire disparaître une certaine manifestation r, en conservant les autres s, t... ; ou bien vice versa instituer r sans que s, t,... existent aussi. C'est presque toujours très difficile, souvent impossible. Pour que les hommes accomplissent réellement et constamment les actions r, il est nécessaire qu'ils aient les sentiments correspondant aux résidus (a) dont (r) est la conséquence. S'ils ont ces résidus, avec r apparaîtront s, t... ; s'ils ne les ont pas, il n'y aura pas r, mais s, t. n'y seront pas non plus.
§ 1861. Supposons, par exemple, qu'on veuille supprimer les peines r pour les délits de pensée et les délits d'hérésie des différentes religions, et conserver des peines très graves s, t,. pour le vol et l'assassinat. Cela n'est pas impossible, puisque nous avons l'exemple de la Rome ancienne, mais est très difficile, puisque, durant de nombreux siècles, cela n'a pas eu lieu en Europe, chez, les peuples dits civilisés. En effet, chez eux, on a observé que là où r a disparu ou presque disparu, s, t,. se sont aussi affaiblis. Cet effet a été obtenu parce que le groupe de résidus (a) dont dépendent les peines s'est modifié dans le sens d'un accroissement des sentiments de pitié pour ceux qui transgressaient les règles en vigueur dans la société. En outre, certains intérêts, contraires à certaines religions, se sont développés, et cela explique pourquoi la diminution des peines a été plus grande pour certains délits d'hérésie que pour d'autres. Par exemple, après la chute du second Empire, en France, les intérêts des républicains étaient contraires à ceux des catholiques. Les peines pour offense à la religion catholique furent donc supprimées et, par extension, celles pour offense à la religion chrétienne. L'Empire s'était fait le champion – en paroles – de la religion sexuelle [FN:§ 1861-1] ; la République augmenta ensuite la liberté, dans ce domaine aussi ; mais plus tard, l'action de l'Empire oubliée, il se produisit un peu de réaction.
§ 1862. On observe aussi dans l'espace des effets semblables à ceux que nous avons signalés dans le temps. En France, les délits d'offense à la religion chrétienne sont entièrement exempts de peine, tandis qu'en Angleterre il y a quelque reste de peine pour celui qui offense le christianisme. Les délits d'hérésie sexuelle sont beaucoup moins recherchés et punis en France qu'en Angleterre. On observe une différence analogue pour les délits de droit commun, qui sont traités avec beaucoup plus d'indulgence en France qu'en Angleterre. De semblables faits résultent de ce que les hommes raisonnent, non d'après les méthodes des sciences logico-expérimentales, mais en usant principalement du sentiment (§826 et sv.).
§ 1863. Obstacles à l'institution d'une législation. Les obstacles à l'institution d'une législation parfaitement adaptée au but que se propose le législateur sont de deux genres. D'abord il faut trouver cette législation. Pour cela, il est nécessaire de résoudre, non seulement le problème particulier que nous venons de nous proposer (§1825), mais aussi l'autre, plus général, des effets indirects des mesures prises, soit de la composition des forces sociales (§2087). Pour accomplir cette œuvre, à supposer même que le législateur raisonne suivant les méthodes de la science logico-expérimentale, il lui manque encore les éléments scientifiques avec lesquels il pourrait résoudre son problème. On peut d'ailleurs raisonnablement espérer qu'en progressant la sociologie pourra un jour fournir ces éléments.
§ 1864. Mais ce n'est pas tout : il faut ensuite mettre en pratique cette législation. On ne peut le faire qu'en agissant sur les intérêts et sur les sentiments, et il faut prendre garde que les dérivations que l'on devra employer de ce fait diffèrent entièrement des raisonnements logico-expérimentaux qui peuvent faire découvrir la législation adaptée à ce but. Qu'on étudie quels furent, par le passé, les motifs invoqués pour faire accepter des mesures sociales, et l'on verra qu'ils étaient vraiment vains, et que très souvent les hommes visaient un but et en atteignirent un autre. Dans le petit nombre de cas où les gouvernants atteignirent le but qu'ils avaient voulu, ils entraînèrent le peuple, en lui faisant voir un but différent, et en l'encourageant par des discours du caractère voulu pour être entendus par le vulgaire, c'est-à-dire puérilement inefficaces, au point de vue logico-expérimental. Prenons garde, en outre, que là où, pour atteindre un certain but, on peut agir sur les intérêts et sur les sentiments en les modifiant, cette modification, outre les effets désirés, pourra facilement en avoir d'autres auxquels on ne vise pas du tout, et il restera à considérer ensemble les uns et les autres de ces effets, et à voir quelle sera, en fin de compte, l'utilité sociale pour l'ensemble. Ce problème est analogue à celui que doit résoudre la mécanique pratique pour construire une machine. Celle-ci transforme une partie de l'énergie en un effet voulu, et en perd une autre partie. La première partie est souvent très petite en proportion de la seconde.
§ 1865. Les mesures sociales ont aussi, en général, une partie utile et une partie inutile ou nuisible ; mais quiconque veut la première doit nécessairement accepter la seconde. Ici aussi, nous répétons qu'il faut considérer non seulement les effets directs, ainsi que nous le faisons maintenant, mais aussi les effets indirects, dont nous nous occuperons au chapitre suivant.
§ 1866. Quand le mécanicien a trouvé la meilleure machine, il éprouve peu de difficultés à la faire accepter, et sans exclure absolument les dérivations, il peut faire principalement usage de raisonnements logico-expérimentaux. Il n'en est pas de même de l'homme d'État, pour lequel les dérivations sont, au contraire, le principal, et l'expression de raisonnements logico-expérimentaux n'est que secondaire et exceptionnelle. Le choix d'une machine étant en très grande partie une action logique, il n'y a aucun inconvénient, par exemple, si l'on démontre que la machine à vapeur ne transforme en effet utile qu'une petite partie de l'énergie calorifique produite dans le foyer de la chaudière ; au contraire, cela peut être utile, puisque cela met sur la voie d'accroître la partie utilement consommée. Mais si le choix d'une machine était principalement une action non-logique, si, dans ce choix, le sentiment jouait un rôle important, il serait avantageux de posséder une théorie absurde, qui affirmerait que dans la machine à vapeur on ne perd pas la plus petite partie de l'énergie produite (§1868 et sv.).
Pour faire accepter la machine, il convient que quelqu'un se préoccupe d'y parvenir ; il convient encore beaucoup plus, il est même indispensable que, de même, pour faire accepter une mesure sociale, il y ait quelqu'un qui la patronne. Dans un cas comme dans l'autre, l'intérêt individuel est un puissant moteur ; mais pour les mesures sociales, le sentiment est encore plus efficace, spécialement s'il s'exalte et prend la forme d'une religion. Par conséquent, c'est une condition favorable, s'il est tel qu'il s'exprime par des dérivations enthousiastes, dépassant la froide réalité, et très différentes des raisonnements sceptiques des sciences logico-expérimentales. Actuellement, la popularité de ces sciences tient beaucoup à ce que le vulgaire les accepte comme des dérivations. Le progrès des sciences logico-expérimentales a fait naître un sentiment de vénération à leur égard, et il faut le satisfaire, mais cela n'est pas difficile parce que le vulgaire se contente d'une lointaine, très lointaine apparence logico-expérimentale donnée aux dérivations.
§ 1867. La proposition que nous venons d'énoncer au sujet des sentiments manifestés par les dérivations, est exprimée vulgairement en disant que les dérivations enthousiastes réussissent mieux que le froid raisonnement à déterminer les hommes à l'action ; et l'on peut aussi accepter ce mode elliptique de s'exprimer, pourvu que l'on entende qu'il s'agit, non des dérivations, mais bien des sentiments qu'elles manifestent (§2085).
§ 1868. Les sentiments qui s'expriment par des dérivations dépassant l'expérience et la réalité ont une grande efficacité pour pousser les hommes à l'action. Ce fait explique la façon dont se produit un phénomène très bien observé et mis en lumière par G. Sorel ; c'est que les doctrines sociales agissant avec efficacité (on dirait mieux : les sentiments manifestés par ces doctrines) prennent la forme de mythes [FN:§ 1868-1]. Répétant en d'autres termes une observation faite tant de fois déjà, nous dirons que la valeur sociale de ces doctrines (ou des sentiments qu'elles expriment) ne doit pas être jugée par leur forme mythique, qui n'est qu'un moyen d'action, mais bien intrinsèquement, par l'effet produit.
§ 1869. Cette matière n'étant pas facile, il sera peut-être bon, pour l'expliquer, d'avoir recours à l'intuition visuelle en mettant sous les yeux du lecteur une image grossière, peut-être même erronée si l'on y regarde de trop près, mais capable d'éclairer la notion beaucoup plus précise que donne le raisonnement. Négligeons les cas où les gens, croyant aller d'un côté, vont, en fait, d'un autre côté (§1873), et attachons-nous à ceux où l'on va, au moins en partie, du côté désiré. Supposons qu'un individu se trouve en h, où il jouit d'une certaine utilité représentée par l'indice ph, et qu'on veuille l'engager à se porter en m, où il jouira d'une utilité plus grande qm. Lui exposer la chose de cette façon serait peu propre à le pousser à l'action. Au contraire, on lui propose un point T, placé très loin sur la tangente hT à la courbe hm, et où l'on jouirait d'une utilité très grande rT, mais entièrement fantaisiste. Il arrive alors quelque chose d'analogue à ce qui se produit pour un point matériel mu par une force tangentielle h T sur une courbe hm ; c'est-à-dire que l'individu a T en vue et se porte vers T, mais, retenu par les liaisons de la pratique, il ne peut suivre la tangente hT : il est contraint de rester sur la courbe, et finit par se trouver en m, où d'autre part il ne serait peut-être jamais allé, s'il n'avait pas été sollicité par la force tangentielle selon hT.
§ 1870. Il est évident que pour connaître les conditions dans lesquelles l'individu se trouvera en m, il n'y a pas lieu de se préoccuper de T. L'indice rT est en somme arbitraire, et n'a aucun rapport avec l'indice réel mq, excepté celui-ci : que le déplacement vers T et vers m fait croître l'indice qui avait ph pour valeur. En outre, il n'importe vraiment pas du tout que T soit imaginaire, fantaisiste, si m est, au contraire, concret, réel.
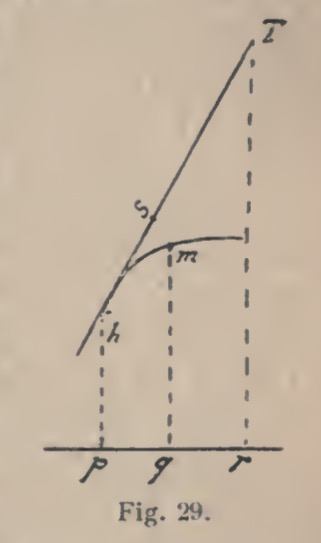
Figure 29
§ 1871. Un être qui accomplirait exclusivement des actions non-logiques serait poussé de h en m, sans en avoir conscience. L'homme, qui est un animal logique, veut savoir pourquoi il se meut dans le sens hm ; aussi, celui qui est déjà poussé sur la voie hm par l'instinct, par ses intérêts ou par d'autres causes semblables, donne-t-il libre cours à sa fantaisie et imagine-t-il un but ou fin T. Lorsque ensuite, par la persistance des agrégats, la conception fantaisiste de T prend, chez lui, la valeur d'un sentiment, cette conception agit aussi indépendamment d'autres causes pour le pousser sur la voie hm. Elle agit de même sur ceux qui trouvent ces sentiments dans la société où ils vivent, et qui n'auraient pas d'autres motifs, ou en auraient de très peu déterminants pour parcourir la voie indiquée. Quand le but imaginé T est seulement une explication, il satisfait le désir de raisonnements logiques ou pseudo-logiques, mais a peu ou point d'effet pour pousser les hommes à agir ; et comme explication il a la valeur limitée du fait que les dérivations se rapprochent plus ou moins des raisonnements logico-expérimentaux. Les dérivations correspondent à la réalité dans la mesure où le trait hm de la courbe peut se confondre approximativement avec le trait hs de la tangente.
§ 1872. La divergence entre m et T et le fait que, pour aller en m, il faut viser à T, ont de nombreuses conséquences, outre celle que nous avons relevée tout à l'heure. Nous aurons à nous en entretenir dans ce chapitre et le suivant.
§ 1873. Il peut arriver, et il arrive effectivement parfois, que le phénomène ne se produise pas d'une manière analogue à celle indiquée par la fig. 29, mais qu'il ait lieu d'une manière analogue à celle indiquée par la fig. 30. Autrement dit, il arrive que l'individu qui voudrait se mouvoir selon h T, pour accroître l'utilité dont il jouit, se meuve, au contraire, de h à f, et fasse diminuer cette utilité, laquelle, au lieu de l'indice ph, finit par avoir l'indice plus petit vf. À ces cas se rattachent ceux où les dérivations ne correspondent en rien à la réalité, c'est-à-dire dans lesquels on ne peut supposer, pas même pour un petit parcours, que hT coïncide approximativement avec hf. En outre, il arrive souvent que la tendance à se porter en T se manifeste, de fait, dans une tout autre direction ; c'est le cas que nous avions commencé par exclure (§1869). L'intuition visuelle peut aussi aider grosso modo à mieux comprendre cela. La figure 30 peut représenter une section verticale de la superficie hf, sur laquelle l'individu doit se mouvoir. Voyons-en une projection horizontale (fig. 31). Le point h est mu par une force directe selon hT, mais il rencontre certains obstacles (préjugés, sentiments, intérêts, etc.) qui le contraignent à se mouvoir sur la ligne ehfg. Par conséquent, sous l'action de la force hT, il ne se meut nullement vers T, mais arrive en f. De même, un navire peut se mouvoir contre le vent. Les considérations développées tout à l'heure nous serviront encore dans la suite (§ 2148 et sv.) à l'étude de phénomènes analogues.
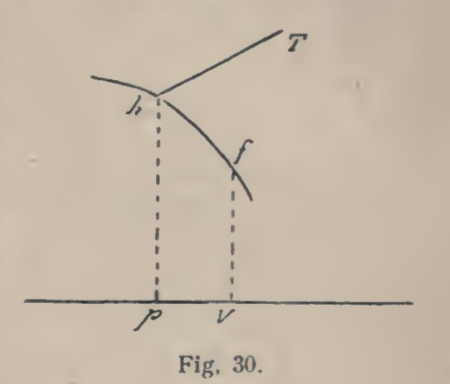
Figure 30
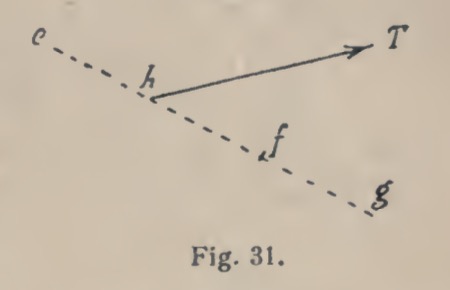
Figure 31
§ 1874. Nous venons de voir ce qui peut arriver ; reste à savoir ce qui arrive habituellement en réalité. Si l'on prend garde à l'ensemble des phénomènes, on voit immédiatement que, fût-ce entre des limites restreintes, les actions qui ont des buts idéaux T, ou qui sont accomplies comme si elles avaient ces buts, doivent en beaucoup de cas atteindre aussi des buts d'utilité individuelle et sociale, c'est-à-dire arriver à un point m où les indices de ces utilités vont croissant. En effet, les actions non-logiques sont encore en grand nombre et d'une grande importance à l'époque actuelle ; elles étaient en plus grand nombre et d'une plus grande importance dans le passé. Le moteur d'un grand nombre de ces actions, c'est-à-dire le but T auquel elles tendent, est exprimé par des dérivations théologiques, métaphysiques et autres semblables, tandis que le but pratique des hommes est le bien-être et la prospérité d'eux-mêmes et de leur société. Si ces deux buts étaient toujours opposés, si celui qui tend vers le premier n'atteignait jamais le second, il n'aurait pas été possible de voir subsister et prospérer des sociétés où il était si important d'atteindre le premier but. Pour revenir à la fig. 29 du §1869, les faits observés démontrent qu'il doit y avoir eu, dans les sociétés humaines, un grand nombre de cas où les phénomènes se sont produits d'une manière analogue à celle qui est indiquée par cette figure ; c'est-à-dire qu'en se portant vers T, les hommes doivent avoir pourvu à ce qui leur est utile, et s'être portés en m, parce que si tous les cas s'étaient, au contraire, produits presque tous comme ceux indiqués par la fig. 30 du §1873, c'est-à-dire si les hommes, se portant vers T, étaient allés en f, à leur détriment, les sociétés humaines auraient dû décliner toujours ; et comme cela n'est pas arrivé, l'hypothèse que nous avons faite demeure exclue.
§ 1875. Prenons garde que s'il est ainsi démontré que souvent les hommes qui visent un but imaginaire en ont atteint un autre, réel, qui leur a été favorable, il n'est nullement démontré que cela ait toujours eu lieu. Par conséquent, il reste encore à résoudre le problème qui recherche quand et entre quelles limites ces buts coïncident, étant données les circonstances de lieu et de temps dans lesquelles on considère le phénomène. Nous ne savons pas non plus si, quand et où la substitution d'un but imaginaire à un but réel peut être utile. Avant d'entreprendre l'étude de ces problèmes et des différentes solutions qui en furent données, il faut que nous portions notre attention sur un sujet de nature plus générale.
§ 1876. LES BUTS IDÉAUX ET LEURS RAPPORTS AVEC LES AUTRES FAITS SOCIAUX [FN:§ 1876-1]. Supposons une société composée d'individus qui, en partie, agissent en visant certains principes idéaux T, en observant certaines règles idéales, ou bien en accomplissant des actions non-logiques qui apparaissent à un observateur comme des conséquences de ces principes, de ces règles, et étudions la nature et les effets des actions accomplies de cette manière, ainsi que les rapports de ces actions avec les diverses utilités (§2115 et sv.). Deux problèmes se posent aussitôt. 1° Comment les faits sont-ils en réalité ? 2° Comment sont-ils vus par ceux qui s'en occupent, et spécialement par les auteurs des théories et des doctrines ? Pour ceux-ci, les solutions des problèmes sont, au moins en grande partie, explicites ; mais pour le plus grand nombre d'hommes elles sont souvent implicites, c'est-à-dire que, sans les énoncer, les hommes agissent comme s'ils se laissaient guider par elles. On peut dire, mieux encore, pour éviter le danger habituel de confondre les actions logiques avec les actions non-logiques, que les actions des hommes sont de telle sorte que quiconque veut trouver un principe logique qu'elles supposent, est conduit à l'une des solutions indiquées. Ce principe est donc simplement déduit des actions par celui qui les observe ; ce n'est pas du tout un principe dont celui qui agit déduise logiquement sa manière d'agir (§2147 et sv.). Un autre problème vient s'ajouter à celui-là : 3° Comment les faits doivent-ils être vus pour que cela soit utile aux individus, à la société, etc. (§2115 et sv.). Mais ce problème rentre dans les précédents, si l'on considère comme but T la croyance à certains faits, et, de cette façon, il correspond au 1er problème posé tout à l'heure. Cela nous permet aussi d'apercevoir un autre problème qui correspond au 2° que nous venons de rappeler, et que l'on peut énoncer en disant : 4° Comment le rapport entre l'utilité et la manière dont les hommes interprètent les faits a-t-il été vu par les gens, et spécialement par les auteurs ? On a fait allusion souvent déjà aux 3e et 4e problèmes, sans les nommer explicitement, et nous aurons à en parler encore, au cours de cet ouvrage. Plus loin (§1896, 1932), nous en traiterons un peu en général et dans un cas particulier. Ici nous considérerons seulement le 1er et le 2e problèmes, et nous aurons les sujets d'étude suivants :
- I. Le but ou fin T (§1877 et 1878)
- I – 1° Premier problème (§1877);
- 1 – 2° Second problème (§1878) ;
- II. Les rapports de T et de m (§1879 à 1891) ;
- II - 1° Premier problème 1879 à 1882) ;
- II - 2° Second problème 1883 à 1891) ;
- II - 2° (a) On confond, ou du moins on rapproche beaucoup T et m (§1883 et 1884) ;
- II - 2°(b) On sépare entièrement et a priori les buts T, de l'utilité m (§1885 à 1891);
- II - 2° (b-α) On considère certains buts T (§1886)
- II - 2° (b-β) On oppose nettement les buts imaginaires T à l'utilité (§1887) ;
- II - 2° (b-γ) Cas intermédiaires (§ 1888 à 1891);
- III. Manière dont on unit T comme effet à certaines causes (§1892 et 1893);
- III - 1° Premier problème (§1892)
- III - 2°Second problème (§1893) ;
- IV. Nature des voies qui conduisent au but T (§1894 et 1895)
- IV - 1° Premier problème 1894)
- IV - 2° Second problème 1895).
§ 1877. 1 - Le but ou fin T. Puisque nous le supposons en dehors de l'expérience, les buts logico-expérimentaux auxquels tendent les sciences et les arts demeurent exclus de la présente étude.
I - l° Pour les animaux, T paraît être un simple instinct. Il peut l'être aussi pour les hommes, dans un petit nombre de cas ; mais, habituellement, il s'exprime au moins sous forme de résidus, et pour satisfaire le besoin de logique que l'homme éprouve, sous forme de dérivations manifestations (§1688). Il faut distinguer le but T (α) qu'un homme a spontanément, du but T (β) qu'un autre homme s'efforce de lui suggérer. Cette distinction a une très grande importance dans les sociétés humaines, à cause de l'opposition que l'individu ressent entre son utilité propre et celle d'un autre homme ou de la société. On peut dire que l'histoire de la morale et de la législation est l'histoire des tentatives faites pour concilier tant bien que mal ces différents genres d'utilité. Pour les animaux, l'instinct pourvoit à cette conciliation. L'effet en est admirable, pour concilier l'utilité des petits avec celle des père et mère, et souvent pour substituer la première à la seconde. Il se produit quelque chose de semblable pour les hommes ; mais le besoin qu'ils éprouvent de raisonner les empêche de s'en tenir à des actes purement instinctifs, et les pousse dans le vaste domaine des dérivations.
§ 1878. 1 - 2° La manière dont les hommes qui ont arrêté leur attention sur les buts T les ont vus, est généralement la suivante : ils les ont considérés comme des principes absolus, ou du moins comme des principes expérimentaux, résultant d'une forme réelle présumée aux principes imaginaires. Cela a eu lieu non seulement en vertu de la tendance que les résidus de la persistance des agrégats, dont les T sont constitués, ont d'assumer une forme absolue, ou tout au moins une apparence de réalité concrète, mais aussi en vertu de l'utilité pratique qu'il y a de ne laisser aucun doute s'insinuer dans l'esprit de qui l'on veut persuader, et de se servir dans ce but de la force que l'absolu, ou du moins la réalité présumée, confère aux principes. Les deux motifs subsistent de nos jours. Le second se fortifie même avec les progrès de la science, qui donne une plus grande autorité à la réalité. Il ne semble pas que ces motifs soient sur le point de disparaître prochainement. On peut donc prévoir qu'il continuera à y avoir des T à caractère absolu et des T imaginaires présentés comme réels, et que si les liaisons que nous connaissons maintenant ne changent pas, la société ne peut exister sans de tels buts (§2143 et sv.).
Les auteurs qui ne veulent pas se placer entièrement en dehors du monde réel sont contraints de reconnaître l'existence de ces buts dans le passé et dans le présent ; mais une partie d'entre eux affirment qu'ils disparaîtront, et qu'au terme de l'évolution il n'y aura plus que des buts expérimentaux.
§ 1879. II. Les rapports entre le but T et le point m auquel les individus parviennent effectivement, et les rapports entre le but T et les différentes utilités.
II - 1° La solution du problème objectif résulte de l'ensemble des études auxquelles nous nous livrons ici. C'est en partie pour y arriver que nous avons dû traiter longuement des résidus et des dérivations, afin de retrouver le fond sous la forme. En résumé, on peut dire que le fait de viser à une fin imaginaire T, pour atteindre une fin réelle m, est un moyen souvent indispensable, mais aussi toujours imparfait, d'atteindre cette fin. L'emploi de ce moyen est analogue à celui d'une machine qui transforme en énergie utile une partie seulement de l'énergie totale qu'elle consomme (§1864 et sv.). Par conséquent, si l'on affirme que le fait de substituer la recherche d'une fin réelle, expérimentale, à celle d'une fin imaginaire T, supprimerait une déperdition de forces, accroîtrait l'utilité de la société, on ne s'écarte nullement de la vérité ; de même qu'on ne s'en écarterait pas non plus en affirmant que le fait d'employer des machines qui transforment en effet utile la totalité de l'énergie consommée, supprimerait une déperdition dans l'économie sociale, et accroîtrait l'utilité de celle-ci.
§ 1880. Reste à savoir maintenant si cela est possible. C'est le problème le plus important pour qui ne veut pas rester dans les nuages. Ainsi que nous l'avons déjà relevé (§130 et sv.), si l'on conserve toutes les liaisons du système social, ce qui existe ne diffère pas de ce qui pourrait exister, et les cas possibles sont ceux où l'on suppose inexistantes certaines liaisons dont ou peut effectivement observer l'absence en des cas réels (§2143 et sv.).
§ 1881. En somme, ce fait est admis aussi, implicitement du moins, par ceux qui, aux fins imaginaires, veulent substituer des fins réelles, et rendre la vie sociale entièrement logico-expérimentale ; mais habituellement ces personnes réduisent ces liaisons à une seule : l'ignorance. Elles ne doutent nullement qu'une fois cette ignorance dissipée, la société suivra la voie qu'elles indiquent. On peut supposer inexistante la liaison de l'ignorance, au moins en grande partie, car il est certain qu'il y a et qu'il y a eu des hommes instruits, et que, dans l'ensemble de la société, le savoir s'est accru avec les siècles. Il n'y a donc pas là de difficulté qui nous entrave ; mais elle surgit insurmontable, dans la partie du sujet qui réduit à la seule liaison de l'ignorance toutes les liaisons qu'il faut supprimer pour rendre la conclusion possible. Si les hommes les plus intelligents, les plus instruits ou « savants », au sens vulgaire du mot, étaient aussi ceux qui donnent le plus d'importance aux principes logico-expérimentaux dans les matières sociales et excluent les autres principes, il serait permis de conclure qu'avec le temps des hommes semblables refuseraient tout ce qui n'est pas logico-expérimental, et que les autres hommes, en se rapprochant des premiers par leur savoir, se rapprocheraient d'eux aussi en ce qu'ils admettraient uniquement les principes logico-expérimentaux. Mais les faits ne se passent point ainsi. Parmi les hommes intelligents, instruits et « savants », au sens vulgaire du mot, si les théologiens ont vu diminuer leur nombre et leur pouvoir, les métaphysiciens proprement dits prospèrent, jouissent de la renommée et du pouvoir. Ils sont renforcés par d'autres métaphysiciens, dits « positivistes », ou qui, sous différents noms, sortent à chaque instant du domaine logico-expérimental. De nombreux savants, éminents dans les sciences naturelles, où ils font usage exclusivement ou presque exclusivement des principes logico-expérimentaux, les oublient bel et bien lorsqu'ils dissertent sur les « sciences » sociales [FN:§ 1881-1]. Quant à l'ensemble de la population, on observe une succession de théologies et de métaphysiques, plutôt qu'une diminution de la totalité de ces phénomènes (§2329 et sv.), ainsi que nous l'avons vu souvent déjà, et comme nous le rappellerons de nouveau tout à l'heure en étudiant le second problème.
§ 1882. Nous conclurons donc que le fait de viser à certains buts ou fins imaginaires T fut souvent dans le passé, continue dans le présent, et continuera probablement dans un avenir prochain, à être utile aux sociétés humaines (§1932) ; que souvent il arrive qu'il y a plusieurs fins T, T', T". , très différentes au point de vue des dérivations, mais équivalentes ou presque équivalentes au point de vue de l'utilité sociale (§1740, 1850 et sv.) ; mais que tout cela n'empêche nullement que le fait de tendre à d'autres fins imaginaires, théologiques ou métaphysiques, puisse avoir été dans le passé, soit dans le présent, et soit à l'avenir nuisible à la société (§1873, fig. 30). On ne peut pas résoudre d'une façon générale le problème de l'utilité de ces fins : il faut distinguer de quelles fins il s'agit, et voir dans quels rapports elles se trouvent avec les autres faits sociaux. Il faut faire cette distinction, non seulement qualitativement, mais aussi quantitativement (§2142 et sv.). En outre, il faut rechercher s'il existe une certaine proportion plus avantageuse que d'autres à l'utilité sociale, entre la poursuite de buts imaginaires et celle de buts logico-expérimentaux. Ce n'est pas tout. La société étant hétérogène, il faut tenir compte de ce fait, et il est nécessaire de se livrer aux recherches susdites pour les différentes classes sociales. C'est précisément ce que nous ferons au chapitre suivant.
§ 1883. II-2°. Quand les doctrines qui ont eu cours sur les rapports entre T et m font largement usage des dérivations, elles apparaissent mieux dans l'étude de III et de IV. Maintenant, nous prêtons plus attention au fond qu'à la forme des doctrines qui établissent un rapport entre T et m.
II-2° (a). On confond, ou du moins on rapproche beaucoup T et m. On peut le faire de deux façons : (A) on croit que tendre à la fin idéale est la meilleure manière de réaliser son utilité et celle d'autrui. On tend à T et l'on arrive à m. (B) Vice versa, on croit tendre à une fin idéale, quand au contraire, on recherche en somme son utilité personnelle ou celle d'autrui. On tend à m et l'on invoque T. D'ailleurs tout cela demeure très indéterminé [FN: § 1883-1], ainsi que nous le verrons mieux en un cas particulier (§1897 et sv.). Les diverses utilités notamment sont souvent confondues.
(A) Ces doctrines sont beaucoup plus nombreuses et plus importantes que les autres. Cela parce que le but des doctrines est presque que toujours de persuader l'individu de tendre à une fin qui procure l'utilité d'autrui ou de la société. Si nous désignons par T (1) la fin égoïste qui procurerait l'utilité m (1) de l'individu, et par T (2) la fin altruiste qui procurerait l'utilité m (2) d'autrui ou de la société, le but d'un très grand nombre de doctrines éthiques est de confondre en une seule masse homogène T (1), T (2), m (1), m (2). Si l'on met au premier plan l'utilité m (1) de l'individu, de laquelle se rapprochent jusqu'à se confondre ou à être très rapprochées les fins T (1), T (2) et l'utilité m (2), on a les germes dont naîtront, par des dérivations opportunes, les différentes « morales utilitaires ». Depuis les temps les plus reculés, ces morales utilitaires parviennent jusqu'à nous. Elles s'expriment depuis les fables en usage à l'enfance de nos races jusqu'aux élucubrations de Bentham et des positivistes. Le plus grand nombre des individus ne peut oublier son utilité propre m (1) ; il faut donc leur montrer qu'on la réalise en tentant à T (2), et en parvenant à m (2).
Si l'on met au premier plan T (2), souvent confondu avec T (1), et desquels se rapprochent m (1) et m (2), on a les germes de nombreuses morales théologiques et métaphysiques. Pour mieux rapprocher T (2) de m (1) et les confondre, les morales théologiques font usage de sanctions appliquées par leur être surnaturel. Les morales métaphysiques y substituent un impératif quelconque, sans grande efficacité, il est vrai (§1886, 1938).
§ 1884. (B) L'égoïste agit consciemment, visant à m et invoquant T ; mais un grand nombre de gens de parfaite bonne foi font aussi cela. Rares sont les hommes cyniquement égoïstes, et rares aussi sont les purs hypocrites. La plupart des hommes désirent concilier leur avantage personnel avec les résidus de la sociabilité (IVe classe), faire leur propre bien, et paraître faire celui d'autrui, couvrir l'égoïsme du manteau de la religion, de l'éthique, du patriotisme, de l'humanitarisme, de la fidélité au parti, etc., tendre à des satisfactions matérielles, et faire semblant de n'en rechercher que d'idéales [FN:§ 1884-1]. En outre, ces hommes se procurent de la sorte l'appui des personnes qui sont alléchées par la beauté du but idéal T, tandis qu'elles se soucieraient assez peu, peu ou pas du tout, du but humble et terre à terre m. C'est pourquoi ils se mettent en quête de théories capables d'atteindre le but. Ils en trouvent aisément ; et les théoriciens de la théologie, de l'éthique, de la sociabilité, ainsi que d'autres personnages, leur en fournissent beaucoup. Tous réalisent parfois aussi leur propre avantage, en vendant une marchandise recherchée sur le marché, tandis qu'ils semblent n'être en quête que de doctrines sublimes.
§ 1885. II-2° (b) On sépare entièrement les fins T de l'utilité m. Habituellement, ce n'est qu'en apparence que l'on s'occupe des fins T en général, tandis qu'en somme les auteurs des doctrines ont principalement ou exclusivement en vue certaines de leurs fins particulières T.
§ 1886. II-2° (b-α). On considère uniquement certaines fins T. L'auteur ne se soucie pas de l'utilité m, ou bien il l'envisage comme n'ayant que peu ou point de valeur. On a ainsi les morales théologiques ou métaphysiques qui, faisant abstraction de l'utilité, imposent d'une manière absolue ce que l'homme doit faire, et en outre les morales ascétiques, mystiques et autres semblables. Grâce aux puissants résidus de l'ascétisme, ces dernières morales sont importantes, mais beaucoup moins que les morales de la classe (I). En général, l'ascétisme est sa propre fin ; mais parfois, grâce aux sanctions surnaturelles, il peut aboutir à une morale qui ait l'apparence d'une morale de la classe (I) ; c'est lorsqu'au lieu de l'utilité réelle m, il considère une utilité imaginaire. Cette apparence est trompeuse, car, comme critère de classification, m doit être essentiellement réel.
§ 1887. II-2° (b-β). On oppose nettement les fins imaginaires T à l'utilité m. Les auteurs ont l'habitude de s'exprimer comme s'ils traitaient de toutes les fins imaginaires ; mais en somme ils n'ont en vue que certaines fins, auxquelles ils veulent en substituer d'autres, également imaginaires. On a le choc de deux théologies, de deux métaphysiques, et non le choc de la théologie et de la métaphysique avec la science logico-expérimentale. Dans cette catégorie figurent les doctrines purement ascétiques, qui ne visent pas à une félicité ultra-terrestre, qui sont leur propre fin, qui repoussent délibérément l'utilité. Il s'y trouve aussi les doctrines pessimistes, qui affirment que quelle que soit la fin proposée, on ne pourra jamais arriver à la félicité, que l'on confond ici avec l'utilité.
§ 1888. II-2° (b-γ) Cas intermédiaires. On ne sépare pas a priori T de m : on les considère comme des phénomènes séparés, qui peuvent avoir entre eux différents rapports. Si ceux-ci sont expérimentaux, on arrive à la solution logico-expérimentale ; c'est-à-dire qu'on a la solution II-1°. S'ils dépassent l'expérience, ou bien sont fixés a priori, on a diverses dérivations. Parmi celles-ci, il faut remarquer les doctrines qui divisent les fins imaginaires T en deux classes, dont une (T h) passe pour être toujours utile, une autre (T k) toujours nuisible, extrêmement nuisible. Inutile d'ajouter que la classe (T h) est celle qui correspond à la religion de l'auteur. On confond très souvent ce cas avec les précédents, parce que les auteurs n'admettent habituellement pas la division des fins imaginaires ou même seulement idéales T en deux genres (T h) et (T k). Pour eux le genre (T h) existe seul, et les fins (T h) sont les seules existantes ; par conséquent elles sont « réelles », « vraies », tandis que les fins (T k) sont inexistantes, « irréelles », « fausses ». De la sorte, les fins (T h) étant les seules existantes suivant les théories de ces auteurs, elles prennent la place de la catégorie (T) dont il s'agit dans les cas précédents, et elles se confondent avec elle.
§ 1889. On observe des phénomènes de cette sorte dans l'histoire, lorsqu'une religion veut en supplanter une autre. Alors on les aperçoit clairement. Ils sont un peu plus voilés, quand les doctrines matérialistes, positivistes ou autres semblables, attaquent toutes les « religions » ; mais il suffit d'un peu d'attention pour s'apercevoir que ces doctrines ne diffèrent des religions qu'elles combattent que par le nom et pas par le fond, et qu'en réalité ce qu'on dit être la lutte de la « Raison » contre les religions positives est seulement la lutte de deux théologies. Il ne faut pas oublier que si l'on invoque aujourd'hui la « Raison » contre le christianisme, celui-ci l'a déjà invoquée contre le paganisme, et que la théologie moderne du Progrès n'est nouvelle qu'en partie, tandis que partiellement elle reproduit sous d'autres formes des conceptions anciennes.
§ 1890. Dans la théologie du Progrès, l'histoire de l'humanité est surtout, peut-être exclusivement le récit de la lutte entre un principe du « Mal », qui est la « Superstition », et un principe du « Bien », qui est la « Science ». Écrire l'histoire revient simplement à paraphraser le vers de Lucrèce :
Tantum Religio potuit suadere malorum.
La religion du Progrès est polythéiste. La Superstition, reine des ténèbres, princesse du Mal, a tout un cortège de divinités inférieures, et, ainsi qu'il arrive habituellement, parmi celles-ci il en est dont le crédit augmente, et d'autres dont le crédit diminue ou même s'annule. À une certaine époque, l'auri sacra fames occupait la première place dans la hiérarchie. Aujourd'hui, elle est bien déchue. Aux temps de la ferveur chrétienne fut en vogue la superstition païenne, que l'on opposait à la Vraie Religion. Dans les temps modernes, la Propriété privée disputa la première place à la Superstition. Rousseau la dénonça dans des invectives terribles. Mais aux temps de la révolution de 1789, la Superstition régna de nouveau, avec tout un cortège de ministres : les rois, les nobles, les prêtres. Ensuite, on revint à d'autres spéculations théoriques, et le Capitalisme succéda à la Propriété privée, comme Jupiter succéda à Saturne. Bienheureux qui possède cette clé du savoir ! Tout phénomène passé, présent ou futur est expliqué par le mot magique de Capitalisme. Le Capitalisme seul est la cause de la misère, de l'ignorance, des mauvaises mœurs, des vols, des assassinats, des guerres. Il ne sert à rien de citer l'exemple des femmes disciples de Messaline [FN:§ 1890-1], que l'on trouve en tout temps. C'est un article de foi que si le capitalisme n'existait pas, toutes les femmes seraient chastes, et la prostitution n'existerait plus. Il ne sert à rien de citer l'exemple des peuples sauvages qui passent leur vie en guerres perpétuelles. La foi nouvelle nous impose de croire que, sans le capitalisme, on ne verrait aucune espèce de guerre. Cependant aujourd'hui un grand nombre de socialistes prennent part à la guerre. Ils cherchent à s'excuser par une belle casuistique : ils sont opposés aux guerres en général, partisans de celle qui leur profite en particulier. S'il existe des pauvres, des ignorants, des paresseux, des malfaiteurs, des alcooliques, des aliénés, des débauchés, des voleurs, des assassins, des conquérants, c'est exclusivement la faute du capitalisme. Le raisonnement par lequel on démontre ce fait est le post hoc, propter hoc habituel. La société est capitaliste. Donc, ses maux proviennent du Capitalisme. Il s'y ajoute d'autres raisons, qui reviennent en somme à affirmer que si les hommes avaient de tout à satiété, ils ne commettraient pas d'actes malfaisants et de crimes pour se procurer ce qui leur manque ; et comme on admet que seul le Capitalisme empêche les hommes d'avoir tout à satiété, il en résulte que cette entité est la cause de tout acte malfaisant.
§ 1891. Au principe du Mal s'oppose le principe du Bien, qui fut jadis la Vraie Religion, et qui est aujourd'hui la Science. Elle aussi s'entoure de divinités secondaires, telles que la Démocratie, l'Humanitarisme, le Pacifisme, la Vérité, la Justice, et toutes les entités qui peuvent mériter l'épithète de progressistes. Ainsi que les anges de lumière combattent les anges des ténèbres, ces divinités luttent contre les entités dites réactionnaires, et défendent et sauvent la pauvre humanité des embûches de ces démons.
§ 1892. III. Manière dont on unit T, comme effet, à certaines causes. III-1° Nous avons déjà vu l'une de ces manières, qui consiste en la confusion que l'on cherche à établir entre les fins et les utilités. Mais ce n'est pas la seule, soit parce qu'on peut lier les fins et les intérêts d'une autre manière que par cette confusion, soit parce qu'outre les intérêts, les hommes ont des passions, des sentiments, auxquels on peut lier les fins. Quant aux moyens d'obtenir l'union des fins à d'autres faits, nous avons, non seulement, la persuasion, mais aussi la contrainte. Celle-ci apparaît dans l'hostilité que subit celui qui viole des usages, des coutumes, des règles, en usage dans la société où il vit. Elle est mise en pratique dans les lois pénales. Nous ne nous en occupons pas ici. Pour la persuasion, on a d'innombrables productions littéraires, depuis les simples fables jusqu'aux plus subtiles élucubrations théologiques, éthiques, métaphysiques, positivistes, etc. Comme nous l'avons vu tant de fois déjà, la force persuasive de ces productions ne réside pas dans les dérivations, mais bien dans les résidus et dans les intérêts qu'elles mettent en action. C'est pourquoi seules resteront en usage les productions qui lient les fins à de puissants résidus et à d'importants intérêts. On peut trouver ces résidus dans les différentes classes. Très forts sont certains résidus de persistance des agrégats. Seuls ou unis à d'autres résidus, parmi lesquels il faut noter surtout ceux de la sociabilité, ils donnent les nombreuses entités dont les hommes ont peuplé leurs Olympes divins, métaphysiques, sociaux. Nous pouvons donc prévoir que les fins T seront liées à ces entités. C'est précisément ce qu'on observe dans les morales théologiques, métaphysiques, et dans celles qui se fondent sur la vénération pour la tradition, pour la sagesse des ancêtres, à laquelle correspond aujourd'hui l'excellence du Progrès, pour les us et coutumes de la tribu, de la cité, de la nation, des gens. Dans les us et coutumes, les résidus de la sociabilité jouent un rôle remarquable ; et l'un des genres de ces résidus, le genre IV-dzéta, joue un rôle principal dans les morales de l'ascétisme.
Pour rester dans la réalité, il faut prendre garde qu'un grand nombre de fins T exprimant des règles de vie sont données, sinon dans la forme, du moins dans le fond. Elles sont un produit de la société où on les observe, et non la conséquence de recherches théoriques. Par conséquent on recherche non pas la fin T, mais bien, T étant donnée, avec quoi et comment il faut la lier (§636, 1628). Dans le temps, le but auquel on veut persuader à l'individu qu'il doit tendre varie peu, au moins quant au fond. Les résidus avec lesquels on le lie varient un peu plus. Les dérivations et les raisonnements pseudo-scientifiques qui servent à la liaison varient beaucoup plus.
§ 1893. III-2° Généralement, dans les doctrines, quand les fins ne s'imposent pas d'elles-mêmes d'une manière absolue, on les tient pour une conséquence de principes théologiques, métaphysiques, ou de l'intérêt ; et l'on a ainsi les diverses morales dont nous avons déjà vu les germes en étudiant les rapports de T et de m (§1883 et sv.). Quant au mode d'union, on croit sans autre qu'il est rigoureusement logique. Aujourd'hui, on le dit scientifique et même expérimental. De la sorte, l'expression de la fin T apparaît comme l'énoncé d'un théorème. Il est vraiment miraculeux qu'on retrouve ainsi ce qui existait dans la conscience de qui était à la recherche du théorème, et très souvent dans l'opinion de la collectivité à laquelle cet individu appartient. Il n'y a pas de danger que le moraliste théoricien aboutisse dans ses recherches à un théorème qui répugne à sa conscience, et il est bien rare qu'il aboutisse à un théorème qui répugne à l'éthique de la société où il vit. Vice versa, si l'on démontre qu'une certaine fin T n'est pas une conséquence logique de principes expérimentaux ou du moins « rationnels », on croit avoir démontré qu'elle ne peut être que nuisible. Là encore, il est vraiment merveilleux que les fins qui ne plaisent pas au moraliste, ou qui sont contraires à l'éthique de sa collectivité, soient précisément celles que de ce fait on trouve contraires à l'expérience, ou du moins à la « raison ».
1894. IV. Nature des voies qui conduisent au but T. IV-1° C'est proprement le sujet de l'étude des dérivations. Nous l'avons déjà faite en grande partie. D'abord, nous avons trouvé (§306 et sv.) les voies qui aboutissent à faire paraître logiques les actions non-logiques accomplies en visant au but T. On suit ces voies avec l'intention explicite, mais plus souvent implicite, de confondre T avec m, car les actions logiques mènent à m ; et si elles mènent aussi à T, la logique étant unique, on ne peut distinguer T de m. Ensuite, nous avons trouvé d'autres voies, quand nous avons étudié les dérivations en général. Ces voies nous sont apparues alors comme des cas particuliers de faits généraux. Nous verrons tout à l'heure d'autres cas particuliers (§1902 et sv.). Ici, nous n'avons pas à nous étendre sur ce sujet.
§ 1895. IV-2° Nous n'avons pas non plus à nous arrêter sur la manière dont ces voies sont considérées dans les doctrines, parce que nous avons souvent exposé, et nous avons récemment rappelé que les dérivations et les raisonnements pseudo-scientifiques sont considérés comme des raisonnements logico-expérimentaux. Nous ne nous attarderons pas non plus à décrire ici comment, bien que scientifiquement faux, ce fait peut souvent être utile au point de vue social. Nous avons déjà traité abondamment de ces sujets, et nous aurons à y revenir.
§ 1896. Maintenant disons deux mots des 3e et 4e problèmes mentionnés au §1876.
3° Comment il est utile aux individus, à la société, etc., que les faits soient vus. Nous aurons surtout à considérer le problème II-1° du §1876, et nous devons répéter que sa solution résultera de l'ensemble des études que nous sommes en train d'accomplir. Nous traiterons longuement de ce problème au chapitre suivant. Pour le moment, nous nous bornons à le poser. On doit le comprendre comme embrassant, non pas les doctrines considérées en elles-mêmes, séparées des individus qui les professent, mais bien les doctrines considérées dans leurs rapports avec les individus et le rôle qu'elles jouent dans la société. C'est ce que les empiriques comprirent en tout temps, et que la théologie de l' « égalité » nie aujourd'hui a priori. Pour employer la terminologie en usage, laquelle pourtant pourrait induire en erreur par son manque de précision, nous dirons qu'il peut être utile que les hommes croient vraies des doctrines erronées. Nous nous rapprocherons un peu plus de la réalité en employant des expressions plus précises, et en disant qu'il peut être utile que les hommes croient conformes à l'expérience, à la réalité, des doctrines qui ne le sont pas.
4° Comment le rapport entre les utilités et la manière dont les hommes comprennent les faits a été vu par les gens, et spécialement par les auteurs. Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, les empiriques ont vu parfois, mais indistinctement, une solution qui se rapproche de celle que nous avons indiquée tout à l'heure : la solution de la science logico-expérimentale. Un très petit nombre de théoriciens en eurent quelque notion ; le plus grand nombre accepta des solutions qui correspondent à celles de II-2° (a). On a confondu la « vérité » et l'utilité, en affirmant qu'il est toujours utile pour soi-même et pour les collectivités, que les hommes voient les faits sous leur véritable aspect. Si par « vérité » on entend la conformité avec l'expérience, cette proposition est erronée, ainsi que les empiriques l'ont bien vu en tout temps. Si, comme il arrive souvent, par « vérité » on entend la conformité avec certains concepts nébuleux de l'auteur, la proposition peut se rapprocher de la réalité expérimentale ou s'en écarter entièrement, suivant que l'utilité de ces concepts nébuleux se rapproche ou s'écarte de l'expérience (§1773 et sv.). À la « vérité » peuvent venir s'ajouter d'autres fins que l'on confond avec l'utilité. Parmi elles figure très souvent la « justice ». On affirme, par exemple, que seul est utile ce qui est vrai, juste, moral, etc. En outre, la théologie de l' « égalité », qui fait aujourd'hui partie de celle du Progrès, repousse avec horreur l'idée qu'il peut être utile que les individus aient des doctrines différentes, qu'ils tendent à des fins différentes, suivant leur rôle social.
Les autres solutions sont de moindre importance. Il n'est pas nécessaire de nous y arrêter maintenant. Nous ne pouvons poursuivre ces études, parce que les notions précises des différentes utilités nous font défaut (§2115 et sv.). Nous reviendrons sur ce sujet au chapitre suivant. En attendant, afin de mieux comprendre les théories générales exposées tout à l'heure, et qui sont très importantes pour la sociologie, il sera bon d'examiner un cas particulier.
§ 1897. RAPPORT ENTRE OBSERVER DES RÈGLES DE LA RELIGION ET DE LA MORALE, ET RÉALISER LE BONHEUR INDIVIDUEL [FN: § 1897-1]. En tout temps, les hommes se sont occupés de rechercher si, en observant ces règles, l'homme faisait son bonheur. Ce problème est plus restreint que les précédents ; d'abord parce qu'on ne recherche pas les rapports en général, mais qu'on veut uniquement connaître si l'on arrive ou si l'on n'arrive pas au bonheur. Par conséquent, on exclut les solutions théologiques ou métaphysiques de II-2°
(b) (§1876), qui considèrent le devoir, abstraction faite de l'utilité ; et l'on considère uniquement celles qui tiennent compte d'une certaine utilité, réelle ou imaginaire [FN: § 1897-2]. Une autre raison pour laquelle ce problème est plus restreint que le précédent, c'est que les fins T, considérées dans les problèmes plus étendus que nous avons étudiés tout à l'heure, ne consistent pas seulement à observer les règles de la religion et de la morale, mais sont, en général, tout ce qui est conseillé, imposé par une foi ou par un sentiment vif. Aussi trouvons-nous parmi elles d'autres règles en usage dans la société, qui naissent de la tradition ou d'une autre façon semblable, ainsi que des fins sentimentales, idéales, mythiques ou d'autres genres analogues. Enfin, l'utilité apparaît ici sous une forme spéciale, sous celle du bonheur.
§ 1898. Pour résoudre le problème particulier que nous nous sommes posé, il faut tout d'abord donner une plus grande précision à l'énoncé. Nous pouvons négliger le très grand défaut de précision des termes : religion, morale, parce qu'ils ne sont pas essentiels au problème, qui demeurerait le même, si l'on parlait d'observer certaines règles, auxquelles on peut donner le nom que l’on veut, par conséquent aussi les noms nullement précis de religion et de morale. Mais il y a, dans l'énoncé du problème, deux points sur lesquels le doute est important et ne peut en aucune façon être négligé. Le premier est le sens des termes : bonheur, malheur ; et nous verrons que ceux qui voulaient résoudre le problème en un certain sens ont tiré parti de ce doute (§1904). L'autre point qui n'est pas précis, c'est de savoir qui est l'agent et qui est celui qui réalise le bonheur ou le malheur. Là-dessus, il faut faire les distinctions suivantes.
I. On peut supposer réunies dans la même ou les mêmes personnes l'action et la réalisation ; c'est-à-dire qu'on peut demander : « Si un homme observe exactement les règles de la morale et de la religion, sera-t-il nécessairement heureux ? et malheureux s'il les transgresse ? » Ou bien : « Si les hommes constituant une collectivité observent ou transgressent les règles susdites, seront-ils heureux ou malheureux ? » – II. Les personnes qui observent ou transgressent les règles, et celles qui sont heureuses ou malheureuses peuvent être différentes. Surtout dans les investigations pratiques, on a considéré les cas où un homme observe ou transgresse certaines règles, et où ses descendants ou ses concitoyens, ou plus généralement d'autres hommes appartenant à une certaine collectivité, éprouvent du bonheur ou du malheur, par suite de la manière d'agir de cet homme.
§ 1899. Il est généralement utile à la société de donner une réponse affirmative aux questions que nous venons d'indiquer, c'est-à-dire : « En observant les règles de la religion, de la morale, de la tradition, les hommes sont-ils heureux, ou font-ils le bonheur de ceux auxquels ils tiennent ? » Cette observation nous met en présence du 3e problème (§1876) ; et si nous voulons raisonner avec une rigueur scientifique, nous devons le distinguer nettement des 1er et 2e problèmes dont nous sommes en train de nous occuper. Le raisonnement vulgaire, qui s'appuie surtout sur l'accord de sentiments, ne fait habituellement pas cette distinction ; et c'est précisément parce qu'on mélange des questions tout à fait distinctes, qu'on obtient des solutions affirmatives en plus grande abondance que des solutions négatives, et qu'on les estime dignes de louange, tandis que les solutions négatives, et même celles qui mettent seulement en doute les solutions affirmatives, passent pour mériter le blâme.
§ 1900. Il convient d'observer que si l'on donne une réponse entièrement affirmative aux questions, dans le premier cas du §1898, par cela seul, on donne ainsi une réponse au moins partiellement négative, dans le second ; et vice versa. En effet, si un homme peut seulement éprouver du bonheur ou du malheur de par ses actes, c'est-à-dire suivant qu'il observe ou qu'il transgresse certains principes, il s'ensuit qu'il ne peut, en aucun cas, éprouver de bonheur ou de malheur de par les actes d'autrui. Vice versa, s'il peut éprouver du bonheur ou du malheur de par les actes d'autrui, il s'ensuit qu'il ne peut pas éprouver de bonheur ou de malheur uniquement de par ses actes.
§ 1901. Cela est si simple et si évident, qu'à s'en tenir seulement à la logique, il est difficile de comprendre comment on peut l'oublier ou le négliger. Pourtant c'est ce qui arrive à un très grand nombre d'auteurs. Le motif est celui que nous avons eu à rappeler souvent déjà : la prédominance du sentiment, qui chasse la logique, et empêche l'homme de se rendre compte des principes dont ses actions seraient une conséquence logique. Seul un observateur étranger connaît ces principes, tandis que celui qui agit les admet implicitement (§1876).
§ 1902. Examinons maintenant quelles sont les solutions que l'on a données aux problèmes indiqués ici, soit qu'on les ait considérés ensemble, soit qu'on les ait séparés. Tout d'abord, classons les solutions.
SOLUTIONS AFFIRMATIVES (§1903 à 1998).
Cas particuliers de la théorie générale II-2° (a)
Solutions verbales (§1903 à 1929).
(A 1) Pétition de principe (§1904 à 1912).
(A 2) Changement du sens des préceptes et des règles, d'objectif en subjectif (§1913 à 1918).
(A 3) Casuistique, Interprétation des préceptes et des règles (§1919-1929).
Solutions objectives. Bonheur et malheur pris au sens vulgaire (§1930 à 1998). (B 1) Affirmation d'un accord parfait (§1934 à 1976).
Pour supprimer les exceptions :
(B 2) Bonheur et malheur repoussés dans l'espace et dans le temps (§1977 à 1988).
Cas particuliers de la théorie générale II-2° (b-α.) :
(B 3) Bonheur et malheur repoussés hors du monde réel (§1989 à 1994).
(B 4) On ne réussit pas à trouver une interprétation. Les voies du Seigneur sont insondables (§1995 à 1998).
SOLUTIONS NÉGATIVES (§1999 à 2001). Cas particulier de la théorie générale II - 2° (b-β) :
(C) Négation absolue; pessimisme (§1999 et 2000).
Cas particulier de la théorie générale I - 1°- ou de II - 2° (b -γ) :
(D) Négation conditionnelle. Il y a deux phénomènes différents qui peuvent avoir certains points communs (§2001).
Les solutions (B 1) et (C) proviennent de ce que chacune considère exclusivement un groupe de résidus. Les solutions (A), (B2), (B3), (B4) proviennent du désir de concilier les dérivations contradictoires issues de différents groupes de résidus. Le genre de solutions (D) comprend, outre des solutions intermédiaires des genres précédents, la solution scientifique, qui vise exclusivement à la recherche des uniformités. Examinons maintenant ces différents genres de solutions.
§ 1903. (A) Solutions verbales. Elles appartiennent à la grande classe des dérivations verbales dont nous avons parlé au chap. X. Ici, nous devons considérer des cas particuliers de ce phénomène général.
§ 1904. (A1) PÉTITION DE PRINCIPE. On tire argument de l'absence de précision des termes du langage vulgaire (§1898), pour donner au terme « bonheur » le sens d'un état créé par l'observance de certains principes. Cela posé, il est évident que si l'homme heureux est celui qui observe certains principes, celui qui observe ces principes est heureux. On peut répéter la même chose d'une collectivité, d'un État.
§ 1905. Diogène Laërce rapporte dans les termes suivants les opinions des stoïciens [FN:§ 1905-1]. « Des choses existantes, ils disent que les unes sont bonnes, les autres mauvaises, les autres indifférentes. La vertu, la prudence, la justice, l'énergie, la tempérance et d'autres semblables sont bonnes. Les choses qui sont contraires à celles-là sont mauvaises : la sottise, l'injustice et le reste. Celles qui ne profitent ni ne nuisent sont indifférentes ; ainsi la vie, la santé, la volupté, la beauté, la force, la richesse, la gloire, la noblesse et les choses qui leur sont contraires : la mort, la maladie, la peine, la laideur, la faiblesse, la pauvreté, l'obscurité et les autres choses semblables ». Cela posé, il est facile de conclure que nous devons rechercher les choses bonnes, fuir les mauvaises, ne pas nous soucier des indifférentes. Mais, de la sorte, nous exprimons seulement qu'en agissant suivant certaines règles, on en vient à cette fin qui est d'agir suivant ces règles ; ce qui est tout à fait évident, mais ne nous enseigne vraiment rien. Pourtant, dans le raisonnement des stoïciens, il y a quelque chose de plus. C'est qu'ils insinuent, par association d'idées, que nous devons agir de cette façon. Ainsi, la tautologie est dissimulée ; mais, par malheur, l'adjonction est purement métaphysique.
§ 1906. On cherche aussi à confondre les biens, tels qu'ils sont définis à nouveau, avec les biens, au sens habituel. Suivant ce procédé, dans son explication de la doctrine des stoïciens, Cicéron leur fait dire : « Je demande ensuite qui pourrait vraiment se glorifier d'une vie misérable, et non d'une vie heureuse » ? Ainsi, l'on cherche à insinuer adroitement que la vie heureuse est « glorieuse », et Cicéron oublie que les stoïciens ont précisément rangé la gloire parmi les choses indifférentes.
Quand on sort du domaine de la réalité pour errer dans les espaces imaginaires, il est bon de ne pas s'éloigner ensuite de ces espaces, si l'on veut éviter des erreurs et des contrastes inévitables, qui peuvent aller jusqu'au ridicule. C'est pour ce motif que la métaphysique de Hegel subsiste, tandis que sa Philosophie de la nature est oubliée. Il s'est trompé en suivant une voie où les subtilités et les divagations métaphysiques se dissipent à la lumière de l'expérience.
§ 1907. Plusieurs auteurs anciens se moquèrent des fantaisies des stoïciens et de leur désir de paraître ce qu'ils n'étaient pas. Athénée (IV, p. 158) rapporte que selon la doctrine des stoïciens « le Sage peut faire bien toute chose, même faire cuire intelligemment les lentilles ». Il cite des vers de Théognètos, dans lesquels on dit que [FN: § 1907-1] « les livres des stoïciens pervertirent la vie » de l'un des interlocuteurs. Dans l'une de ses satires, Horace se moque aussi des stoïciens, qui sont des mendiants et se croient des rois [FN:§ 1907-2].
§ 1908. L'auteur du Traité en faveur de la noblesse, sur lequel on met le nom de Plutarque, raconte d'une manière plaisante comment les imaginations métaphysiques sont contredites par la réalité : « (XVII, 2) Mais ni lui [Chrysippe] ni aucun des stoïciens n'ont besoin de la noblesse, eux qui sont les adeptes de cette philosophie qui peut leur procurer instantanément toute chose, comme avec une baguette magique, ainsi qu'ils s'en vantent, et les rendre riches, bien nés, beaux, royaux. Mais ces riches vont mendiant leur nourriture à autrui. Ces rois ne sont obéis de personne ; ils dépendent de tout le monde, bien qu'ils possèdent toute chose, et c'est à peine s'ils peuvent payer le trimestre de leur loyer ».
§ 1909. De même, ces hommes éminents qui affirment que « le monde extérieur n'existe pas » – cela se peut, parce qu'expérimentalement ce cliquetis de mots ne signifie rien – se transportent dans un monde fantaisiste qui n'a rien à faire avec la vie pratique (§95, 1820). Ces concepts de la métaphysique trouvent leur plein développement dans les affirmations de la Christian Science, suivant lesquelles, pour ne pas souffrir de la maladie, il suffit de se persuader que la maladie n'existe pas (§1695-2). En effet, tout concept qui n'existe pas chez un individu est pour lui inexistant. Mais c'est là une simple tautologie, et l'observation démontre que certains concepts s'imposent aux individus en général, bien que ceux-ci s'efforcent de les repousser de toute façon. Il est vrai que les adeptes de Madame Eddy, qui fonda la Christian Science, repoussèrent loin d'eux le concept de la mort de cette personne, et que, par conséquent, pour eux, ce concept n'existait pas. Mais un jour vint où il s'imposa à eux, ou, pour mieux dire, la négation de ce concept ne put plus s'accorder avec d'autres concepts, auxquels nous donnons vulgairement le nom de mort. À nous, cela nous suffit : nous ne voulons nullement discuter la question métaphysique de l'existence ou de la non-existence de la mort.
§ 1910. De même, il est certain que, pour un individu, l'histoire consiste tout entière dans les concepts qu'il a. Il est certain que si quelques concepts lui font défaut, la partie de l'histoire correspondant à ces concepts est pour lui inexistante. Mais c'est aussi un fait d'observation que les concepts qu'il a ainsi contrastent plus ou moins avec d'autres concepts qu'il peut acquérir dans la suite, suivant les rapports de ces concepts avec ce que nous appelons des faits historiques (§1798). Si un Polonais ignore l'histoire du partage de sa patrie, il peut s'imaginer qu'elle constitue encore un royaume indépendant, et pour lui le partage est inexistant ; il peut le demeurer longtemps, pendant toute la vie de ce Polonais, si on enferme celui-ci dans une maison de santé, et s'il ne revient pas à l'état que nous appelons vulgairement celui de l'homme sain. Mais s'il revient à cet état, voici que de nouveaux concepts entrent en lutte avec celui qu'il avait jusqu'alors admis, et les chassent de son esprit. Ce fait d'observation vulgaire nous suffit, et nous laissons à autrui le soin de disserter sur la non-existence du monde extérieur.
§ 1911. Un autre raisonnement du genre (A 1) est celui d'Épictète. Il commence par diviser les choses en deux catégories [FN: § 1911-1] (I, 1) celles qui sont en notre pouvoir et celles qui n'y sont pas. Sont en notre pouvoir : les opinions, l'impulsion, le désir [les appétits], l'aversion et, en peu de mois, n'importe laquelle de nos actions. Ne sont pas en notre pouvoir : le corps, les biens, la renommée, les magistratures et, en peu de mots, tout ce qui n'est pas notre œuvre.
(2) Celles qui sont en notre pouvoir sont, de leur nature, libres, dégagées, déliées ; celles qui ne sont pas en notre pouvoir sont inermes, esclaves, liées, étrangères [au pouvoir d'autrui] ». Cela posé, la suite du raisonnement ne fait pas un pli : « (3) ... si tu considères comme tien uniquement ce qui est tien [les choses en ton pouvoir], et que tu considères, ainsi que cela est, comme n'étant pas tien ce qui t'est étranger n'est pas en ton pouvoir personne ne te contraindra jamais, personne ne te liera, tu n'adresseras de reproches à personne, tu n'accuseras pas, tu ne feras rien contre ta volonté, personne ne te nuira, tu n'auras pas d'ennemi, car aucun mal ne te sera imposé ». En effet, il est parfaitement vrai que si une chose quelconque t'est imposée et que tu dises vouloir la faire, tu pourras affirmer que tu ne fais rien contre ta volonté. Ainsi raisonnait celui qui, tombé de cheval, disait : « Je voulais descendre ».
§ 1912. La doctrine d'Épictète et d'autres analogues, telles que la résignation du chrétien à la volonté de Dieu, ne sont pas des théories scientifiques : ce sont des consolations pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas combattre. Il est certain que souvent on diminue la douleur en n'y pensant pas, et en tâchant de se figurer qu'elle n'existe pas. On trouve de nouveau quelque chose de semblable dans la Christian Science, et les cas ne manquent pas où le médecin, et mieux encore le charlatan, soulage la douleur du malade par sa seule présence. La faveur qui accueillit la doctrine d'Épictète est l'un des nombreux symptômes qui présageaient le succès du christianisme.
§ 1913. (A 2) Changement du sens des préceptes ou des règles, d'objectif en subjectif. Dans le genre (A 1), la tautologie provenait du changement de sens des termes bien, bonheur, malheur. Dans le présent genre elle provient du changement de sens des préceptes. En effet, si l'on considère uniquement les règles que l'individu observe avec plaisir, on peut certainement affirmer qu'en les observant il éprouve du plaisir.
§ 1914. Par exemple, si nous considérons objectivement la torture, nous pourrons dire qu'en général c'est un malheur pour les hommes de la subir ; mais si nous considérons subjectivement ce qu'elle fait éprouver à un martyr chrétien, nous verrons que c'est pour lui un bonheur de la subir pour sa foi.
§ 1915. Quand on observe que celui qui agit mal ne peut être heureux, parce qu'il éprouve des remords, on suppose implicitement qu'il est capable de les éprouver ; mais il n'est pas difficile de voir que, chez un grand nombre de personnes, ils sont très faibles ou même n’existent pas du tout ; aussi, pour eux, la peine dont on les menace est presque ou entièrement indifférente [FN: § 1915-1].
§ 1916. En somme, la plupart de ceux qui veulent réformer la société supposent qu'elle sera constituée par des personnes douées des sentiments et des conceptions qu'il leur plaît d'imaginer, et c'est uniquement sous ces conditions qu'ils peuvent promettre à ces personnes de les rendre heureuses.
§ 1917. Par exemple, les protestants qui n'admettent plus la divinité du Christ créent une doctrine entièrement subjective. Ils disent que le Christ est le type de l'homme parfait. C'est uniquement une conception à eux, et ils n'ont aucun moyen de combattre qui dirait, au contraire, que c'est le type de l'homme imparfait. Mais ce moyen existe pour qui croit à la divinité du Christ, car cette divinité est quelque chose d'objectif, d'indépendant de l'opinion individuelle, et l'on peut donc menacer le mécréant de l'action de cette entité objective. Mais comment le menacer de l'action d'une chose qui dépend de lui, et qu'il peut accepter, changer, repousser comme il lui plaît ? Ajoutons qu'à l'égard de l'Ancien Testament, beaucoup de personnes font usage d'une pétition de principe : elles excluent de l'inspiration divine toutes les parties qu'elles jugent contraires à leur morale, après quoi elles peuvent conclure en toute sécurité que leur morale concorde avec l'inspiration divine.
§ 1918. Le pouvoir des préceptes, dans une société et en un temps donnés, provient surtout du fait que ces préceptes sont acceptés par le plus grand nombre des personnes qui composent cette société, et du fait que ceux qui les transgressent éprouvent un sentiment pénible, se trouvent mal à l'aise. Ces préceptes sont simplement l'expression peu précise des résidus existant dans la société. Par conséquent, il est inutile de rechercher si, d'une façon générale, et pour le plus grand nombre d'individus qui constituent la société, le fait de suivre ces préceptes procure du plaisir, le fait de les transgresser du déplaisir. S'il n’en était pas ainsi, ces préceptes n'exprimeraient pas des résidus existant chez le plus grand nombre des individus, ils n'auraient pas cours dans la société considérée. Le problème à résoudre est différent. Au point de vue du plaisir individuel (ophélimité), il consiste à rechercher quel effet ont les préceptes sur les personnes qui ne possèdent pas les résidus exprimés par ces préceptes, et de quelle manière on peut persuader aux dissidents qu'ils éprouveront un plaisir ou une peine qu'ils ne ressentent pas directement. Au point de vue de l'utilité, nous avons à rechercher si le fait d'observer ces préceptes est avantageux à l'individu, à la collectivité, à la nation, dans le sens qu'on voudra donner au terme utilité ; par exemple, dans le sens de la prospérité matérielle, si on la considère comme utile. Si l'on empêche un animal de suivre son instinct, il éprouve un sentiment de malaise ; mais il se peut qu'en fin de compte son bien-être matériel soit augmenté. Si un homme politique transgresse une règle usuelle dans la société où il vit, il se peut qu'il éprouve un sentiment de malaise, et il se peut qu'en fin de compte, son action soit nuisible à la société ; mais il se peut aussi qu'elle lui soit utile. Ce sont là les cas qu'il convient d'examiner.
§ 1919. (A 3) Casuistique. Interprétation des préceptes et des règles. Précisément afin d'éviter ces sentiments de malaise, afin de les remplacer par les sentiments agréables que suscite le fait de suivre des préceptes, tandis qu'en même temps l'utilité qui résulte de leur transgression est réalisée, on recourt à la casuistique et aux interprétations. Cela est même nécessaire pour satisfaire certains sentiments et ne pas s'écarter, du moins en apparence, des conséquences logiques des dérivations. De la sorte, on obtient en outre l'avantage, petit ou grand, d'être sans paraître, de travailler dans son propre intérêt, et de sembler rigide observateur de la morale et de l'honnêteté, digne, par conséquent, de la bienveillance du public, aux gens qui parfois se laissent persuader par les sophismes, et le plus souvent ne demandent qu'un prétexte pour être persuadés. Cela peut se faire artificieusement, mais quelquefois aussi de bonne foi [FN: § 1919-1]. À travers la casuistique usitée par les gouvernements et les États pour justifier quelqu'une de leurs actions, le salus populi suprema lex esto transparaît souvent. Si l'on affirmait cela sans autre, ce serait un bon motif logique, et l'on aurait ainsi une des solutions D mais comme on ne veut pas choquer les personnes qui croient aux solutions affirmatives, on s'efforce de concilier l'inconciliable, en confondant ces solutions avec la solution D. D'autre part, ceux qui accusent et blâment les gouvernements et les États d'avoir transgressé certains préceptes, expriment bien rarement d'une manière claire quelle solution du problème ils acceptent. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas si, niant que la salus populi consiste à transgresser les règles, ils admettent l'une des solutions affirmatives ; ou bien si, admettant la solution D et repoussant la salus populi, ils veulent que même au risque de subir de graves dommages, voire peut-être la ruine complète, on suive les préceptes en acceptant l'une des solutions métaphysiques ou théologiques (§1897) ; ou bien encore si, repoussant la solution D, ils mettent la salus populi dans le fait d'observer une solution telle que (A 2), (B 2), (B 3). Ils s'efforcent de persuader par un simple et indistinct accord de sentiments.
Moyennant l'appui efficace de la casuistique et des interprétations, on peut affirmer que le fait de suivre certains préceptes et certaines règles procure toujours la prospérité matérielle des individus, des collectivités, des États, de l'humanité. Par exemple, on prêche en général que l'on doit toujours tenir les promesses qu'on a faites ; mais ensuite, dans les cas particuliers où il est avantageux de ne pas les tenir, on ne manque jamais d'excellents prétextes pour se soustraire à ce devoir.
§ 1920. L'histoire de Rome abonde en interprétations de ce genre. Grâce à elles, tout en agissant avec mauvaise foi, les Romains étaient persuadés d'agir de bonne foi. Un exemple suffira : celui de la casuistique par laquelle les Romains trompèrent les Numantins, tout en conservant l'apparence de la bonne foi [FN:§ 1920-1]. Grâce à cette belle casuistique, Rome sauva l'armée, qui aurait pu être détruite par les Numantins, et s'en tira en offrant aux Numantins un consul dont elle ne pouvait vraiment tirer aucun parti comme général. Les Numantins avant refusé ce cadeau généreux, Mancinus revint à Rome, et réintégra même sa place au Sénat [FN: § 1920-2]. Ce sont là les miracles éclatants d'une casuistique savante !
§ 1921. On dit que l'histoire des Fourches Caudines a été copiée sur celle de Numance [FN: § 1921-1]. Si elle est vraie, on a une preuve que cette casuistique était habituelle chez les Romains. Si elle est fausse, la preuve est encore meilleure, car, en inventant, les Romains auront certainement choisi ce qui leur paraissait le mieux ; et le fait d'avoir copié l'histoire de Numance montre qu'ils n'y trouvaient rien de contraire à la réputation d'honnêteté qu'ils entendaient conserver, et dont ils se faisaient gloire. Cela est confirmé par Cicéron qui, écrivant un traité pour nous enseigner nos devoirs, cite en l'approuvant l'action des Romains aux Fourches Caudines et à Numance [FN: § 1921-2]. Il était assez intelligent pour comprendre que si l'on voulait agir honnêtement avec les Numantins, ce n'était pas le consul seul qu'on devait leur livrer, mais toute l'armée, en la replaçant ainsi dans les conditions où elle se trouvait lorsqu'elle fut délivrée, grâce à un traité que les Romains refusaient de respecter.
§ 1922. De nos jours, la célèbre dépêche d'Ems a donné lieu à une discussion dans laquelle brille une très belle casuistique. Welschinger écrit [FN:§ 1922-1] : « (p. 125) Dans sa critique des Pensées et Souvenirs [de Bismarck], l'historien Horst-Kohl considère « comme un fait extraordinaire » que le roi Guillaume ait autorisé son ministre à communiquer la dépêche d'Ems aux ambassadeurs et aux journaux. „ La forme – dit-il – fut l'affaire du ministre, et notre démocratie sociale, qui n'a pas le culte de la patrie, est d'une insolence inqualifiable, quand elle parle de la falsification de la dépêche d'Ems, alors que Bismarck agissait seulement pour accomplir un ordre royal avec l'assentiment de Moltke et de Roon, sous la pression violente du sentiment de l'honneur surexcité au plus haut degré. Bismarck prévit le préjudice apporté à notre évolution vers trop de condescendance. Persuadé que pour passer par-dessus le gouffre qui avait été creusé entre le Sud et le Nord par la différence des dynasties, des mœurs et des coutumes de races différentes, il n'y avait qu'à jeter un pont par une guerre nationale faite en commun contre un ennemi toujours prêt à la (p. 126) guerre depuis des siècles, il donna à la communication un tour particulier [FN:§ 1922-2] qui amena les Français dans la situation pénible de déclarer eux-mêmes la guerre, ou de garder le soufflet que Bismarck avait su leur donner “ ».
Cela rappelle la célèbre restriction mentale de celui qui, à la question : « A-t-il passé par là ? », répondit : « Non », sous-entendant « dans ma manche ». Non, Bismarck n'a pas falsifié la dépêche d'Ems : il lui a « donné un tour particulier ». Il se peut que la démocratie sociale n'ait pas « le culte de la patrie » ; mais M. Horst-Kohl ne semble vraiment pas avoir le culte de la vérité. Nous entendons la vérité expérimentale, parce qu'il y a tant de vérités que parmi elles il pourrait bien s'en trouver une à l'usage de M. Horst-Kohl.
§1923. Ensuite, cet « historien » devient le défenseur de la morale la plus rigide ; il dit : « (p. 126) Si la guerre est venue à éclater par la faute des Allemands, alors les Français sont absolument autorisés à se plaindre d'une entreprise aussi brutale et à réclamer l'Alsace-Lorraine qui, comme prix de la victoire, reste entre nos mains ».
Si M. Horst-Kohl croit réellement ce qu'il écrit, il est doué d'une prodigieuse naïveté. Combien de changements y aurait-il à faire à la carte géographique des États, si chacun devait restituer les provinces conquises par suite d'une guerre qu'il a voulue ! Mais il est des gens qui accueillent favorablement de pareilles inepties. C'est pourquoi elles sont dignes d'attention. Toujours il y eut, il y a et il y aura des puissants : princes ou peuples, aristocraties ou plèbes, partis grands ou petits, pour transgresser les lois de la morale ; et pour défendre leur œuvre, jamais il n'a manqué, il ne manque ou il ne manquera de casuistes qui, de bonne foi ou non, gratis ou payés, produisirent, produisent et produiront de beaux et subtils raisonnements. Pourtant, seuls ceux qui peuvent répéter le quia nominor leo ont la faculté de transgresser les règles, et d'avoir dans leur manche de complaisants casuistes pour démontrer qu'ils en sont respectueux. À vrai dire, les raisonnements de ces dignes personnages persuadent uniquement, en général, ceux qui sont déjà persuadés, ceux qui ont la vue obscurcie par un sentiment fort, par un culte du genre de celui dont parle le casuiste Horst-Kohl. Par conséquent leur efficacité à persuader est faible ; mais elle peut servir a fortifier les sentiments préexistants qui les font accueillir favorablement. Vice versa, le blâme adressé aux puissants, pour leurs transgressions des règles de la morale, est approuvé et répété surtout par ceux qui sont déjà leurs adversaires ou leurs ennemis [FN:§ 1923-1], et qui sont mus par des sentiments de nature semblable, mais de sens contraire à ceux des gens qui sont favorables ou amis des puissants. Quant aux puissants, ils ne se soucient guère de ces logomachies, auxquelles ils ne prêtent attention que pour les légers avantages qu'ils en peuvent retirer : ils laissent dire et continuent leur œuvre.
§ 1924. Des cas où l'interprétation est donnée de bonne foi, on passe peu à peu à ceux où elle est entièrement le produit de la mauvaise foi. Ces derniers cas sont fort nombreux. S'ils apparaissent mieux chez les anciens que chez les modernes, c'est peut-être seulement parce que les premiers étaient moins hypocrites que les seconds.
§ 1925. Il est difficile de croire que des prétextes du genre des suivants fussent donnés de bonne foi. Craignant les Épirotes, les Acarnaniens demandèrent la protection de Rome, et « obtinrent du Sénat romain l'envoi d'ambassadeurs qui enjoindraient aux Étoliens de retirer les garnisons des cités de l'Acarnanie, afin que fussent libres ceux qui seuls ne s'allièrent pas aux Grecs contre Troie, dont Rome était issue ». Ce souvenir mythologique vint à point aux Romains. Le livre des Stratagèmes de Polyen et celui de Frontin sont tout pleins de tromperies de toute sorte. Virgile dit fort bien qu'à la guerre on use de la vertu ou de la tromperie [FN: § 1925-1].
§ 1926. On ne sait pas pourquoi on a voulu donner comme propre aux jésuites la maxime – la fin justifie les moyens. En réalité, elle est aussi ancienne que toute littérature à nous connue. C'est l'une des interprétations par lesquelles on s'efforçait d'accorder la théorie et la pratique. Agésilas [FN:§ 1926-1] parlait fort bien de la justice et, en paroles, il la plaçait au-dessus de l'utilité, mais en fait il intervertissait les termes. Judith aussi estimait que, pour faire disparaître Holopherne, la fin justifiait les moyens ; et c'est un peu pour cela que les protestants ont exclu son livre de leur Bible ; mais il y est resté beaucoup d'autres choses qui valent les embûches de Judith ! [FN: § 1926-2]
§ 1927. La fête des Apaturies n'était très probablement que la fête des Fratries ; le peuple inventa une étymologie qui faisait de cette fête la glorification de la fraude.
On disait donc que la possession de certains territoires, objet de contestations entre Athéniens et Béotiens, devait être disputée entre les rois des deux pays. « Thymœtès [FN: § 1927-1], en ce temps roi des Athéniens, craignant ce duel, céda son royaume à qui voudrait bien s'exposer au danger du combat contre Xanthos, roi des Béotiens. Mélanthos, séduit par la récompense de la royauté, se chargea du combat, et l'on fixa les clauses du traité. Quand on en vint aux mains, Mélanthos vit une sorte de figure d'homme imberbe qui suivait Xanthos. Il cria qu'agir ainsi était injuste, car amener un auxiliaire était contraire aux clauses du traité. Frappé de stupeur, en entendant cet incroyable discours, Xanthos fit volte-face pour regarder. Aussitôt Mélanthos darda sa lance et le tua... ...Ensuite les Athéniens, suivant les prescriptions de l'oracle, élevèrent un temple à Dionysos Mélanthidos, et y sacrifièrent chaque année. Ils sacrifièrent aussi à Zeus trompeur, parce que, dans le combat, la ruse les avait secourus.
Dans un très grand nombre de récits mythologiques ou historiques de l'antiquité, on voit percer la fraude, et elle recueille plus de louange que de blâme.
§ 1928. Dans l'Iliade, Zeus n'a pas honte d'envoyer le songe pernicieux (ou plein, réel) dire des mensonges à Agamemnon et le tromper. Après avoir promis vie sauve à Dolon, les Grecs le tuent. Dans l'Odyssée, Ulysse dit autant de mensonges que de mots, et sa protectrice Athéna s'en réjouit [FN: § 1928-1]. Dante use d'une restriction mentale, lorsqu'il promet an frère Albéric de lui ôter du visage les durs voiles [de glace]. Invité ensuite à tenir sa promesse, il ne le fait pas.
E cortesia fu lui esser villano.
(Inf., XXXIII, 150)
Avec une si grande et si belle abondance d'interprétations, on justifie tout ce que l'on veut, et la même personne peut affirmer successivement des choses contradictoires, sans le moindre scrupule de manquer aux règles de la logique [FN:§ 1928-2].
§ 1929. Machiavel n'eut qu'un tort, si l'on peut parler de tort. Ce fut de mépriser de semblables niaiseries, en écrivant (c. XL) [FN: § 1929-1] : « Se servir de la ruse dans la conduite de la guerre est une chose glorieuse. Quoique ce soit une action détestable d'employer la fraude dans la conduite de la vie [cela est dit seulement pour excuser ce qui suit ; c'est pourquoi l'auteur ne se soucie pas de la contradiction], néanmoins, dans la conduite de la guerre, elle devient une chose louable et glorieuse ; et celui qui triomphe par elle de ses ennemis ne mérite guère moins de louanges que celui qui en triomphe par les armes. C'est le jugement que portent ceux qui ont écrit l'histoire des grands hommes. Les exemples en sont trop nombreux pour que j'en rapporte aucun. Je ferai observer seulement que je ne regarde pas comme une ruse glorieuse celle qui nous porte à rompre la foi donnée et les traités conclu ; car, bien qu'elle ait fait quelquefois acquérir des États et une couronne, ainsi que je l'ai exposé précédemment, elle n'a jamais procuré la gloire. [On remarquera la cause pour laquelle Machiavel conseille de s'abstenir d'un certain genre de fraudes]. (c. XLI) La patrie doit se défendre par l’ignominie ou par la gloire, et, dans l'un et l'autre cas, elle est bien défendue. – Partout où il faut délibérer sur un parti d'où dépend uniquement le salut de l'État, il ne faut être arrêté par aucune considération de justice ou d'injustice, d'humanité ou de cruauté, de gloire ou d'ignominie ; mais, rejetant tout autre parti, ne s'attacher qu'à celui qui le sauve et maintient sa liberté. Les Français ont toujours imité cette conduite, et dans leurs actions et dans leurs discours, pour défendre la majesté de leurs rois et la puissance de leur royaume... [FN: § 1929-2] » (§1975-2], 2449).
§ 1930. (B) Solutions objectives. Les divagations de la rhétorique et de la philosophie sont en partie un produit de luxe ; mais la vie pratique exige d'autres considérations, et les gens veulent surtout savoir comment ils doivent s'y prendre pour atteindre le bonheur, pris au sens vulgaire, c'est-à-dire la prospérité matérielle. C'est pourquoi il leur faut des réponses aux problèmes objectifs qui appartiennent à cette matière. Le vulgaire se soucie peu de savoir d'où procèdent les règles. Il lui suffit qu'elles existent dans la société et qu'elles soient acceptées et respectées. Dans l'opposition à leur transgression se manifeste surtout le sentiment qui s'oppose aux perturbations de l'équilibre social (résidus (α) de la Ve classe). C'est le même sentiment qui se manifeste dans les plus anciens documents bibliques et, en général, à l'origine de toute civilisation. Il apparaît presque seul dans l'opinion que la transgression du tabou a nécessairement des conséquences nuisibles. Le même sentiment se retrouve dans l'idée que ce qui est légal est juste. En somme, par cette formule on dit qu'il faut respecter volontairement tout ce qui est légal, qu'on ne doit pas troubler l'équilibre social existant. L'invasion du raisonnement est contenue par la force des sentiments qui défendent les règles existantes, et aussi par l'utilité sociale de ces règles. Par conséquent, le raisonnement abandonne la logique et l'expérience, fait appel au sophisme, se superpose ainsi au sentiment sans trop l'offusquer. Ce mélange de sentiments et d'explications sophistiques est essentiellement hétérogène. De là proviennent les contradictions extraordinaires qui ne font jamais défaut dans ces raisonnements. Nous en avons déjà vu plusieurs, quand nous étudiions les dérivations (§1481 et sv.) Autour de ce noyau se disposent ensuite d'autres résidus, tels que les (dzéta) et (êta) de la IIe classe.
§ 1931. Ces solutions objectives, précisément parce qu'elles sont objectives, sont aisément contredites par les faits. Le vulgaire ne s'en soucie pas ; il n'attache guère d'importance aux théories, et accepte même des solutions objectives contradictoires, sans se soucier de la contradiction. Les hommes qui ont l'habitude des recherches logiques, les penseurs, les théoriciens, veulent savoir d'où procèdent les règles que l'on dit devoir être observées ; ils n'omettent pas de leur attribuer des origines qui, habituellement, sont le produit de leur imagination. En outre, certains contrastes entre les théories et les faits causent à ces personnes du malaise, de l'ennui, de la souffrance. C'est pourquoi elles s'efforcent, autant qu'elles le peuvent, de supprimer, d'écarter, de dissimuler ces contrastes. En général, elles n'abandonnent pas entièrement les solutions objectives, ni surtout, parmi celles-ci, les solutions optimistes ; mais elles tâchent de supprimer, ou du moins d'expliquer, par des interprétations appropriées, les exceptions qu'on ne peut nier. C'est là un cas particulier de l'emploi des dérivations, dont nous avons déjà parlé (§1737, 1738). Ainsi, on a les genres (B 2), (B 3), (B 4), qui, partant du domaine expérimental, finissent par en sortir entièrement [FN:§ 1931-1].
Le motif pour lequel nous pouvons prévoir que dans une société stable donnée nous trouverons en majeure partie des résidus favorables à sa conservation, nous permet aussi de prévoir que, dans cette société, nous trouverons surtout en usage des solutions affirmatives de notre problème, lesquelles y seront plus que d'autres divulguées et bien accueillies ; tandis que les personnes qui éprouvent le besoin de développements logiques ou pseudo-logiques, s'efforceront par tous les moyens, avec un art subtil, grâce à d'ingénieux sophismes, de faire disparaître les contradictions qui se manifestent par trop ouvertement entre ces solutions et la pratique. Cela se produit effectivement. Nous avons déjà vu que, dans les dérivations, on tâche de créer une confusion entre le bien de l'individu et celui de la collectivité, afin de pousser l'individu à s'efforcer de travailler au bien de celle-ci, tout en croyant, même quand ce n'est pas vrai, travailler à son bien propre. En ces cas, cela est aussi utile à la société qu'expérimentalement erroné.
§ 1932. Il convient de donner ici un aperçu des solutions des 3e et 4e problèmes indiqués d'une façon générale au §1896. Les résidus les plus nombreux et les plus efficaces dans une société ne peuvent pas être entièrement contraires à la conservation de la société, car, si cela était, la société se dissoudrait et finirait par ne plus exister. Il faut que ces résidus soient, au moins en partie, favorables à la conservation de la société. L'observation confirme précisément que les résidus existant dans une société lui sont en grande partie favorables. Il convient donc à la société que ni ces résidus ni les préceptes (dérivations) qui les manifestent ne soient offusqués et amoindris. Mais ce but est mieux atteint si l'individu estime, croit, s'imagine qu'en observant ces préceptes, en acceptant ces dérivations, il travaille à son propre bien. Donc, en raisonnant d'une manière générale, très en gros, sans s'arrêter à des exceptions possibles et nombreuses, on peut dire qu'il convient à la société qu'au moins dans l'esprit du plus grand nombre d'individus étrangers à la classe dirigeante, le 3e problème soit résolu de telle sorte que les faits apparaissent, non tels qu'ils sont en réalité, mais tels que la considération des fins idéales les représente. Par conséquent, si nous passons du cas général à notre cas particulier, il convient à la société que les individus mentionnés tout à l'heure acceptent, observent, respectent, vénèrent, aiment spontanément les préceptes existant dans la société où ils vivent. Parmi ces préceptes, la place d'honneur est occupée par ceux qu'on appelle, fût-ce sans aucune précision, les préceptes de la « morale » et de la « religion ». On dirait mieux « des religions », en désignant par ce nom, non seulement les persistances d'agrégats qu'on a l'habitude d'appeler ainsi, mais aussi un grand nombre d'autres du même genre. De là proviennent la grande efficacité et la grande puissance des deux forces, morales et religions, pour le bien de la société, à tel point qu'on peut dire que sans morales ni religions, aucune société ne peut subsister, et que l'affaiblissement de ces forces coïncide habituellement avec la décadence de la société [FN: § 1932-1]. Les personnes qui ont porté leur attention sur ce sujet ne se sont donc pas trompées, depuis les temps les plus reculés où nous connaissions leurs idées, lorsqu'elles ont résolu le 4e problème en ce sens qu'il est utile que les hommes voient les faits, non tels qu'ils sont en réalité, mais tels que les représente la considération des fins idéales ; par conséquent, pour employer la terminologie courante, lorsqu'elles ont attribué une très grande importance à la « morale » et à la « religion », généralement celles qui existaient alors ; tandis qu'un petit nombre de personnes très avisées et d'une grande perspicacité attribuaient cette importance aux « morales » et aux « religions » en général, se rapprochant ainsi de la réalité, où cette importance revient à certaines persistances d'agrégats et aux actions non-logiques qui en sont une conséquence implicite ou explicite. Mais précisément parce qu'il y avait un écart plus ou moins grand avec la réalité, on ne peut pas dire qu'en émettant ce jugement sur les « morales » et sur les « religions », ni surtout sur une morale spéciale et une religion spéciale, ces personnes ne soient parfois allées au delà de la vérité, faisant ainsi le mal de la société, tandis qu'elles cherchaient à faire son bien. Elles se trompèrent généralement, lorsqu'elles voulurent donner les motifs de la solution acceptée du 4e problème. Elles eurent recours à des motifs fallacieux et presque toujours imaginaires, fantaisistes. Mais enfin, c'est là une simple erreur théorique qui importe peu, car, quels que soient les motifs, l'effet subsiste. Au contraire, il fut et il est encore une autre erreur, très nuisible celle-là. C'est celle, déjà notée, de confondre les morales et les religions avec une morale et une religion spéciales ; par quoi l'on attribue aux dérivations une importance qui revient uniquement aux résidus. De là provinrent, lorsque les adeptes de ces théories trouvèrent le champ libre, un énorme gaspillage d'énergie dépensée pour produire des effets peu ou point importants, et des souffrances souvent considérables, infligées aux hommes sans aucun avantage. Quand les adeptes des théories que nous venons de rappeler rencontrèrent de la résistance, il naquit aussi, chez leurs adversaires, une idée erronée : celle d'étendre à toute persistance d'agrégats en général, à tout genre d'actions non-logiques, les objections que l'on peut adresser à juste titre aux gens qui veulent imposer une dérivation déterminée, provenant de certaines persistances d'agrégats. Si une certaine persistance d'agrégats Q, utile à la société, se manifeste par les dérivations A, B, C, D, ..., il est ordinairement nuisible à la société de vouloir imposer une dérivation déterminée A, en excluant les autres B, C, ... ; tandis qu'il est utile à la société que les hommes acceptent les dérivations qui leur plaisent le mieux, et qui manifestent que le résidu existe chez eux, lequel seul, ou presque seul, est important [FN: § 1932-2].
§ 1933. Les solutions négatives sont souvent de capricieuses manifestations de pessimisme, des effusions de personnes blessées et vaincues dans les combats de la vie. Elles prennent difficilement une forme vulgaire. Les solutions scientifiques, qui ne sont pas des manifestations de sentiments, mais qui résultent de l'observation des faits, sont extrêmement rares. Lorsqu'elles sont émises, très peu de gens les comprennent. C'est ce qui est arrivé pour la partie scientifique des raisonnements de Machiavel (§1975). Les solutions optimistes et les solutions pessimistes peuvent coexister, parce que – nous l'avons vu tant de fois – on peut observer des résidus contradictoires simultanément, ou successivement chez le même individu. Le vulgaire laisse subsister la contradiction ; les personnes cultivées tâchent de la faire disparaître. De là proviennent plusieurs de nos solutions.
§ 1934. (B 1) Affirmation d'un accord parfait. Nous ignorons si l'on a jamais affirmé, tout à fait explicitement, un accord parfait, et tiré ensuite de cet accord toutes les conséquences, toutes les déductions qu'il comporte. Implicitement, il apparaît dans les morales utilitaires (§1935). Il ne manque pas d'autres doctrines qui affirment cet accord en général, comme une théorie abstraite [FN:§ 1934-1], sans d'ailleurs trop se soucier de rechercher quelles en seraient les conséquences nécessaires. Très souvent, ces doctrines sont uniquement des manifestations de sentiments vifs, qui prennent les désirs pour la réalité, dans l'intention de faire le bien, soit de l'individu, soit de la société ; ou bien elles sont des manifestations d'une foi vive en certaines entités ou certains principes entièrement étrangers au domaine expérimental. Souvent, presque toujours, leur forme manque de toute précision, et tandis que, prises à la lettre, elles semblent affirmer quelque chose de certain, l'ambiguïté des termes, les nombreuses exceptions, les diverses interprétations, ôtent au précepte le meilleur de sa substance, ainsi qu'à l'affirmation suivant laquelle le précepte est favorable au bien de qui l'observe.
§ 1935. Depuis les anciens temps jusqu'aux nôtres, on trouve des théories qui affirment que transgresser les règles de la morale et, surtout chez les anciens, celles de la religion, a pour conséquence le malheur terrestre, tandis que le fait d'observer ces règles a pour conséquence le bonheur terrestre. Il est un genre remarquable parmi ces théories : celui des théories dites de la morale utilitaire, suivant lesquelles la morale n'est que l'expression d'un jugement correct sur l'utilité. Une action malhonnête n'est autre chose que la conséquence d'un jugement erroné sur l'utilité. On ne pourrait avoir un accord plus parfait de la morale et de l'utilité, car c'est l'accord rigoureusement logique de la conclusion avec les prémisses d'un syllogisme. Ces théories ont une apparence de théories scientifiques, et sont constituées par des dérivations dont nous avons déjà parlé (§1485 et sv.). Elles jouissent de la faveur, surtout lorsqu'on cherche à faire passer pour entièrement rationnelle la vie humaine, et à expulser les actions non-logiques. Aussi trouvent-elles facilement une place dans les théologies de la Raison, de la Science, du Progrès.
§ 1936. Dans d'autres théologies et, d'une manière générale, dans les doctrines qui ne repoussent pas la partie idéale, on trouve des théories différentes des précédentes, et qui prennent parfois une apparence scientifique. Elles ne repoussent pas les caractères métaphysiques et théologiques ; au contraire, ce sont ceux auxquels elles s'attachent principalement. D'une façon générale, et en portant uniquement notre attention sur les lignes principales communes à ces théories, nous trouvons qu'elles présentent les caractères suivants. 1° La punition de celui qui transgresse les préceptes occupe souvent une place éminente ; la récompense de celui qui les respecte apparaît comme secondaire. Cela probablement parce que, dans la vie humaine, les maux sont plus nombreux et font plus d'impression que les biens. 2° Les confusions des deux genres de problèmes indiqués au §1898 sont habituelles. À la rigueur, on pourrait affirmer que quiconque agit suivant les préceptes de la morale et de la religion, en réalisant son propre bonheur, ne peut en aucune façon porter préjudice à ceux qui sont confiés à ses soins ou qui sont en rapport avec lui d'une manière ou d'une autre. Mais on le fait rarement ; on le sous-entend plus qu'on ne le dit ; on le laisse sous une forme implicite et nébuleuse. Très souvent on parle de châtiments et de récompenses, sans dire s'ils seront le lot de l'individu qui a fait l'action mauvaise, ou la bonne, ou bien s'ils s'étendront aux autres gens. Pour l'individu lui-même, on a soin de ne pas oublier l'échappatoire consistant à renvoyer à un temps indéterminé la conséquence de ses actes. Autrement dit, on n'exprime pas si l'on veut ou non recourir aux exceptions du groupe (B-2). 3° Il faut remarquer qu'à vouloir être rigoureux, nous devons voir aussi une confusion en ce qu'on attribue à un même individu un fait dont il est l'auteur, et le châtiment ou la récompense qui lui revient après un certain temps. En raisonnant ainsi, on admet implicitement que l'individu est unique dans les différents temps qui se suivent. Matériellement, on ne peut pas l'admettre. Mais si l'on admet une unité métaphysique, appelée âme ou autrement, laquelle subsiste tandis que le corps change, on peut admettre l'unité de l'individu. Autrement, si l'on veut raisonner en toute rigueur, on doit dire en quel sens on entend cette unité. 4° Les théories dont nous parlons contiennent ordinairement en grande abondance et à un haut degré les contradictions indiquées au §1931. Elles énoncent des propositions et les contredisent aussitôt, implicitement, ou même explicitement. Elles affirment que chacun éprouve du malheur ou du bonheur uniquement de son propre fait, et peu après elles émettent quelque autre affirmation dont il ressort que l'homme éprouve aussi du malheur et du bonheur par le fait d'autrui. Souvent même elles affirment cela explicitement, et personne ne semble se soucier de la contradiction. En réalité, de même qu'elles considèrent toujours un individu à différents moments comme une unité, de même elles sont souvent entraînées à considérer comme une unité la famille, une certaine collectivité, la nation, l'humanité. Là agissent les résidus de la permanence des agrégats ; ils font que l'agrégat devient l'unité. En des temps reculés, un grand nombre de personnes ne se posaient même pas ce problème : la famille doit-elle être considérée comme une unité, pour les châtiments et les peines ? De même aujourd'hui, un grand nombre de personnes ne se posent pas non plus ce problème : au même point de vue, l'agrégat matériel que nous appelons un individu doit-il être considéré comme une unité dans le temps ? (§1982).
§ 1937. Un grand nombre des théories que nous examinons ne se soucient pas de ces problèmes. En affirmant que chacun éprouve du malheur ou du bonheur par son propre fait, elles laissent indéterminé le sens de ce terme chacun. Ensuite, lorsqu'on cherche à le déterminer, surgissent les théories que nous examinerons dans les genres (B-2) et suivants. Le défaut de précision et de logique est très grand en ces matières. Il s'explique facilement par le fait, que nous avons noté tant de fois, de la contradiction des résidus qui existent chez un même individu, et du désir qu'a celui-ci de faire disparaître ces contradictions, du moins en apparence.
Parfois ce désir n'existe même pas, non seulement pour les rigoristes qui ne voient qu'un côté des questions, mais aussi pour la moyenne des hommes, lorsqu'il s'agit de contradictions qui sont devenues habituelles et frustes. À la longue, elles finissent par s'effacer, paraissent naturelles ; la plupart des individus ne s'en aperçoivent même pas, et ils agissent comme si elles n'existaient pas. C'est là un fait général, et qui s'observe dans toutes les branches de l'activité humaine.
Par exemple, un grand nombre de personnes admettent, implicitement ou explicitement, qu'on peut changer, déterminer entièrement les actions des hommes, par des raisonnements ou des prédications agissant sur les sentiments, et en même temps, elles reconnaissent l'existence de caractères tels qu'ils nous sont explicitement exposés en des œuvres du genre de celles de Théophraste et de La Bruyère ; ou implicitement dans un nombre infini de productions littéraires, depuis l'Iliade et l'Odyssée jusqu'aux romans modernes ; ou tels qu'ils nous sont révélés par l'expérience journalière des rapports avec nos semblables. Or il y a contradiction entre ces deux manières de voir [FN:§ 1937-1]. On ne saurait admettre que le prodigue et l'avare n'aient entendu bon nombre de raisonnements et de sermons contre leurs défauts, et s'ils ne s'en sont pas corrigés, si raisonnements et sermons n'ont pas eu de prise sur eux, cela veut dire évidemment qu'il y a quelque autre chose qui détermine leurs actions, et que ce quelque autre chose est assez puissant pour résister aux raisonnements et aux sermons. Si malgré tout ce que, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, on a pu dire et écrire contre l'intempérance, et ce qu'on a pu faire pour la réprimer, on trouve encore des intempérants, il faut bien admettre l'existence d'une force qui les produit et qui résiste aux forces contraires. En exposant ici une théorie des actions non-logiques, nous n'avons fait que donner une forme scientifique à des conceptions plus ou moins vagues qui existent généralement chez presque tous les hommes, on pourrait même dire : chez tous ; que bon nombre d'auteurs ont exprimées plus ou moins clairement, et que d'innombrables faits ne permettent pas de négliger. Nous ne nions pas que raisonnements et sermons puissent agir sur les hommes (§1761 et sv.), nous affirmons que leur action n'est pas exclusive ni même, en bien des cas, prépondérante, qu'ils ne déterminent pas seuls les actions des hommes, que d'autres éléments interviennent, qui n'appartiennent pas aux catégories des raisonnements et des sermons, ni même à celle des dérivations. Or un grand nombre de personnes nient cela en théorie, agissent pratiquement comme si elles l'admettaient, et ne s'aperçoivent pas de la contradiction.
Parfois quelque auteur porte son attention sur cette contradiction ou d'autres analogues, et en tire des effets littéraires, depuis la simple plaisanterie jusqu'à d'importantes recherches psychologiques. Les contradictions entre la religion et la pratique de la vie ont donné lieu à une infinité de productions intellectuelles aboutissant à des conclusions opposées, selon le but qu'elles se proposent, ou selon qu'elles donnent le premier rang à la religion ou à la pratique. Elles sont dirigées contre celle-ci, si l'on admet qu'on y doive trouver une rigoureuse application des théories religieuses. C'est le thème des prédicateurs, des ascètes, des saints, des rigoristes de tout genre. Elles sont dirigées contre la religion, si l'on admet que les nécessités de la vie priment les doctrines, et si l'on veut attaquer la religion en un point faible. C'est le thème des athées, des matérialistes, des « libertins », et en général de ceux qui n'ont qu'une foi assez tiède ou n'en ont pas du tout. Entre ces deux extrêmes, se tiennent les casuistes, qui, par d'ingénieux sophismes et des prodiges d'interprétations, s'efforcent de concilier l'inconciliable. Des phénomènes semblables s'observent dans les rapports de la religion et de la morale, qui parfois est considérée comme un simple appendice de la religion ; parfois comme une unité indépendante, mais qui doit nécessairement aller d'accord avec la religion ; parfois, au contraire, comme s'opposant à celle-ci, ou à l'une de ses sectes. Tantôt c'est la religion qui juge la morale, tantôt c'est la morale qui juge la religion. Les premiers chrétiens soutenaient que la morale faisait voir que leur religion était supérieure à la religion païenne. Les païens ripostaient, mais sans obtenir beaucoup d'effet, que le patriotisme donnait un jugement contraire. Les chrétiens et les païens, ainsi que les différentes sectes chrétiennes entre elles, se sont réciproquement accusés d'immoralité, et ont largement usé et abusé de ce genre d'argument. C'est d'une des oppositions entre la rigueur des préceptes religieux et les nécessités de la vie pratique que Pascal a tiré ses Provinciales. Admirable production au point de vue littéraire, mais qui sonne faux au point de vue de la réalité expérimentale, car elle se borne à dénoncer les sophismes des casuistes, et elle ne les remplace pas, laissant ainsi subsister, en la dissimulant, la contradiction entre la doctrine et les nécessités de la pratique. Les raisonnements des casuistes n'ont aucune valeur logique, mais les préceptes de Pascal manquent également de valeur pratique.
Les contradictions entre le droit et la vie pratique, surtout entre le droit international et les nécessités de la politique, ont existé de tout temps; elles fourmillent dans l'histoire gréco-romaine, se compliquent de questions religieuses au moyen-âge, persistent très nombreuses dans les siècles suivants, et sont loin de faire défaut de nos jours.
Il s'agit donc, en somme, d'un phénomène très général, auquel se rattachent les cas particuliers que nous sommes en train d'étudier.
§ 1938. La notion du châtiment ou de la récompense qui suivent les actions présente, outre la forme pseudo expérimentale, deux autres formes qui souvent s'unissent en une seule : la forme métaphysique et la forme religieuse. Dans la forme métaphysique, châtiment ou récompense suivent nécessairement l'action, sans qu'à vrai dire on sache pourquoi. Cette forme est aujourd'hui dissimulée sous un voile pseudo-expérimental ; mais en somme, elle reste la même. Sous la forme religieuse, on sait pourquoi châtiment ou récompense suivent nécessairement l'action : c'est par la volonté d'une divinité. Mais cette intervention ouvre la porte à l'arbitraire de la divinité, qui ne se contente généralement pas d'être une gardienne plus ou moins rigide de la morale, mais qui agit aussi pour son propre compte, venge les offenses et les négligences auxquelles elle peut être en butte, autant et souvent plus sévèrement que les offenses et les négligences affectant la morale.
§ 1939. Quand le sentiment religieux est puissant, on ne voit là rien de blâmable. Quand il s'affaiblit, et que les sentiments de bienveillance envers nos semblables se développent, on s'efforce de réduire autant que possible, parfois jusqu'à la faire disparaître, cette dernière partie de l'action divine. On dit alors qu'une religion est d'autant plus « en progrès, parfaite », que la divinité s'occupe plus de la morale, et néglige le reste. Mais on ne prend pas garde qu'en procédant ainsi, la limite dont la « religion parfaite » se rapproche est l'absence de toute religion et la confusion de la religion et de la métaphysique (§1917, 1883).
§ 1940. Il est maintenant nécessaire d'apporter les preuves de nos affirmations. Le lecteur ne devra pas regretter que dans ce but nous exposions de nombreux détails, car il se souviendra que les théories n'ont d'autre valeur que celle de représenter les faits, quelle que soit leur importance, et que par conséquent seuls ces faits peuvent donner ou enlever de la valeur aux théories. À vrai dire, si l'on voulait citer les preuves au complet, on devrait transcrire toute l'histoire ; et comme cela est impossible, il faut nous résigner à choisir et à exposer un petit nombre de cas qui peuvent servir de types.
§ 1941. On peut retrouver des exemples de contradictions presque chez tout auteur qui affirme l'accord dont nous traitons. Parfois la contradiction est explicite, c'est-à-dire que dans le même auteur se trouvent certains passages qui disent le contraire de ce qu'expriment certains autres passages. Parfois elle est implicite, c'est-à-dire qu'elle apparaît dans les conséquences que l'on peut tirer de différents passages.
§ 1942. Nous avons des exemples de contradictions explicites dans le poème qui a pour titre Les travaux et les jours. Il est un grand nombre de passages où l'auteur exprime que celui qui fait le mal est toujours puni. Ainsi (265-266) : « L'homme qui machine du mal contre autrui machine du mal contre lui-même ». Il ajoute trois vers (267-269) pour dire que Zeus voit tout ; puis, sans aucune transition, il dit (270-273) : « Maintenant je ne serai pas juste parmi les hommes, ni mon fils non plus, puisqu'il est mal d'être un homme juste, si l'homme injuste a plus de droits [FN: § 1942-1] ».
§ 1943. On trouve des contradictions de ce genre chez un grand nombre d'auteurs moralistes. Voici, par exemple, que dans la Sagesse de Jésus, fils de Sirach, on nous dit que la Sagesse remplit la maison de toute chose ; et puis l'on ajoute que la sagesse du pauvre le relève et le fait asseoir parmi les grands [FN: § 1943-2]. Et comment ? Elle n'a donc pas rempli sa maison de toute chose, puisqu'il est resté pauvre !
§ 1944. Comme exemple de contradictions implicites, celui des anciens Israélites suffira. D'une part, ils étaient persuadés que Iaveh récompensait toujours par des biens terrestres l'homme juste et pieux, et qu'il châtiait l'homme injuste et impie, en le privant des biens terrestres [FN: § 1944-1]. D'autre part, ils croyaient que le pauvre jouissait de la faveur de Iaveh [FN: § 1944-2]. Ces deux propositions ont des conséquences contradictoires. De la première proposition on déduit que les riches devraient être justes, pieux et favorisés par Iaveh, et les pauvres, au contraire, injustes, impies et en horreur à Iaveh. De la seconde proposition résulte exactement le contraire. La contradiction est criante [FN: § 1944-3] ; elle ne pouvait échapper aux penseurs israélites, qui s'efforcèrent de l'éliminer de diverses manières. Mais nous en parlerons plus loin (§1979).
§ 1945. Les peuples se sont imaginé et s'imaginent encore que dans leurs guerres ils remportent la victoire grâce au secours de leurs dieux. L'agrégat qui porte le nom de peuple est considéré comme une unité, et l'action de chaque individu particulier qui fait partie de l'agrégat contribue à attirer ou à repousser la faveur des dieux. Parfois l'action d'un seul individu suffit à faire châtier, beaucoup plus rarement à faire récompenser tout l'agrégat. Parfois il semble nécessaire que les individus soient assez nombreux pour constituer une partie notable de l'agrégat.
§ 1946. Quant aux dieux, chaque peuple peut avoir les siens propres, et le peuple victorieux remporte la victoire pour lui-même et pour ses dieux. Ceux-ci sont ennemis des dieux étrangers, que ce peuple ne doit honorer en aucune façon. Le type de semblables phénomènes est celui des Israëlites avec leur Dieu « jaloux ». Les peuples qui se combattent peuvent avoir aussi des dieux propres, ou bien des dieux communs ; mais dans les deux cas, il faut que chaque peuple révère non seulement ses dieux, mais aussi les autres. Des types de ces phénomènes sont ceux des Grecs et des Romains avec leurs dieux. L'Iliade nous a rendu familières des conceptions de ce genre et d'autres genres analogues. Il peut y avoir un seul dieu pour deux ou plusieurs peuples combattants, et l'on suppose que ce dieu se décide en faveur d'un peuple plutôt que d'un autre, suivant certaines règles, pas bien déterminées, mais qui, chez les peuples modernes, tendent à se confondre avec celles de la « morale » et de la « justice », telles que chaque peuple les comprend. Le type de ces phénomènes se voit dans les luttes entre les peuples catholiques, ou bien entre les peuples protestants. Dans les guerres entre catholiques et protestants, autrefois on opposait volontiers les croyances ; aujourd'hui on raisonne plutôt comme si elles ne différaient pas, et comme si un Dieu unique devait décider qui il favoriserait, en suivant les règles de la « morale » et de la « justice ». Inutile d'ajouter que tout cela ne supporte pas la moindre critique logico-expérimentale.
§ 1947. En 1148, la ville de Damas fut assiégée par les Croisés, qui, repoussés, durent lever le siège. Chrétiens et musulmans, chacun de son côté, attribuèrent le fait à leur propre Dieu. On peut, à ce sujet, comparer le récit de Guillaume de Tyr et celui des auteurs musulmans [FN:§ 1947-1].
§ 1948. Le Dieu d'Israël était quelque peu capricieux ; le Dieu des chrétiens, qui lui succéda, agit souvent d'une manière qu'on ne comprend pas bien. Il commença par donner la victoire aux Croisés, qui défendaient sa foi ; puis il les priva de son secours, à cause – dit-on – de leurs péchés. Il paraît que sa colère dure toujours, car le sépulcre du Christ continue à être au pouvoir des infidèles [FN:§ 1948-1].
§ 1949. Inutile de rappeler les ordalies ou jugements de Dieu : elles sont trop connues. Si nous prenons garde uniquement aux dérivations, ces ordalies sont strictement connexes à la théorie suivant laquelle Dieu punit les mauvaises actions et récompense les bonnes. Bayle cite un fait qui peut servir d'exemple aux contradictions comiques de cette théorie. Le chevalier de Guise, fils du duc de Guise qui, en 1588, fut assassiné à Blois, tua, dans la rue, à Paris, le 5 janvier 1613, le baron de Lux. Le fils de celui-ci provoqua en duel le chevalier de Guise et fut tué par lui. « On n'oublia point de remarquer l'inégalité du succès dans des combats où la justice paroissoit semblable. Si le Chevalier devoit vaincre dans le premier, parce qu'il cherchoit la vengeance du sang de son père, il devoit être vaincu dans le second, parce qu'il s'agissoit de faire raison au fils d'un homme qu'il avoit tué. Et néanmoins le sort lui fut aussi favorable dans le second que dans le premier. Ce fut une chose qui surprit beaucoup de gens et sur laquelle on fit beaucoup d'attention. Mais communément parlant ces sortes d'affaires se décident selon le plus ou le moins d'adresse, et de courage, et de force des combattants, ou par le concours de quelques causes fortuites ; et non pas selon le plus ou le moins de droit [FN: § 1949-1] ».
§ 1950. De nos jours, on ne croit plus que Dieu manifeste par les duels des particuliers de quel côté est le bon droit ; mais on continue à croire plus ou moins qu'il le manifeste dans les guerres entre les nations. Une guerre juste doit, pour un grand nombre de personnes, être une guerre victorieuse. Vice versa, une guerre victorieuse est nécessairement une guerre juste. Beaucoup d'Allemands furent et demeurent persuadés que la guerre de 1870 fut victorieuse parce que le Seigneur voulut donner la victoire aux vertus germaniques contre la corruption latine [FN: § 1950-1]. Cela se peut ; mais il se pourrait que le génie des Bismarck, des Moltke, des Roon, ainsi que l'humanitarisme stupide de Napoléon III, de ses ministres, de l'opposition démocratique, même de la part des conservateurs, aient eu aussi quelque part dans les victoires allemandes.
§ 1951. Il est toujours utile que les peuples croient que leurs dieux combattent en leur faveur (§1932). Le roi de Prusse agit donc excellemment en prescrivant un jour de prière, par son décret du 21 juillet 1870. Il disait : « Je dois d'abord remercier Dieu de ce qu'aux premiers bruits de guerre, un seul sentiment s'est manifesté dans tous les cœurs allemands : celui d'un armement général contre l'oppression, et celui d'une espérance réconfortante en la victoire que Dieu accordera à notre juste cause. Mon peuple se serrera autour de moi dans cette guerre, comme autrefois il s'est serré autour de mon père qui repose en Dieu. C'est en Lui que je mets toute mon espérance, et je demande à mon peuple de faire de même... ». Mais Dieu était aussi prié par l'autre camp, comme autrefois les dieux d'Homère étaient priés par les Grecs et par les Troyens. Napoléon III, lui aussi, s'adressait au peuple français, en disant : « Dieu bénira nos efforts. Un grand peuple qui défend une juste cause est invincible ». Le Dieu des chrétiens n'entendit point ces prières et mena l'armée française à Sedan, de même que le Zeus de l'Iliade n'entendit pas les prières des Troyens, et permit la destruction de leur cité. Ollivier, sous le ministère duquel on déclara la guerre « juste », mais hélas malheureuse, de 1870, se console en espérant que si la « justice » ne fut pas récompensée, elle le sera du moins à l'avenir. Il écrit : [FN: § 1951-1] « (p. 12) ...il [Bismarck] oblige à la guerre par (p. 13) une impertinence intolérable un souverain systématiquement pacifique [voilà une première faute] depuis la campagne d'Italie [origine des malheurs de la France, comme le vit bien Thiers], sans la complaisance duquel [voilà la faute qui n'aura plus de remède] il n'eût pas même tenté la fortune à Sadowa [où il vainquit l'Autriche et prépara la défaite de la France et la ruine du très humain Napoléon III] et qui, partout favorable à l'indépendance des peuples [en sacrifiant son pays à ces utopies], était décidé, malgré les alarmes de ses diplomates [qui voyaient un peu plus clair que cet aveugle], à n'opposer aucun obstacle au libre développement de l'Allemagne et à ajouter ainsi un service nouveau à ceux déjà rendus par la généreuse France aux peuples germaniques en 1789, 1830, 1848 [tous ces braves gens méritaient peut-être des prix de vertu ; mais il est douloureux que c'ait été la France qui dût payer ces prix sous la forme des cinq milliards d'indemnité de guerre à l'Allemagne]. L'ingratitude, a dit Cavour, est le plus odieux des péchés. C'est aussi le plus maladroit des calculs [FN: § 1951-2] [affirmation gratuite d'Ollivier, sans la moindre bribe de démonstration]. Bismarck a voulu noyer dans le sang d'une victoire commune les antipathies des États du Sud frémissants encore de leur défaite récente. Mieux que ce remède dangereux, la patience eût apaisé les colères [autre affirmation sans aucune bribe de démonstration). Une unité allemande qui se fût constituée sans un démembrement de la France, étant sûre d'un lendemain paisible, aurait pu devenir pour tous un bienfait, non une calamité. Dieu punit quelquefois en accordant le succès. L'avenir le démontrera ». Qui vivra verra ! En attendant cette punition à venir, qui frappera les descendants, les Français contemporains souffrent et les Allemands exultent. Que l'on compare ce naïf passage éthique d'Ollivier aux discours réalistes de Bismarck, et l'on comprendra aisément comment et pourquoi le second devait vaincre le premier.
Un auteur qui est loin d'être en tout de l'avis d'Émile Ollivier H. Welschinger, dit pourtant à son tour : [FN: § 1951-3] « (p. 56) le souvenir de la guerre de 1870 et le traité de Francfort, qui en a été la suite lamentable, seront pour bien longtemps encore – à moins de réparations qui sont le secret de l'éternelle Justice – une cause de discorde entre les deux nations ». Ainsi invoquée par deux camps opposés, l'éternelle Justice ne devait pas savoir vers qui se tourner ; elle finit par préférer le camp où une armée plus nombreuse et mieux préparée était commandée par des généraux meilleurs.
§ 1952. On peut constater dans l'histoire que c'est ordinairement le camp qu'elle préfère. Quand l'armée thébaine brisa à Leuctres la puissance spartiate, elle fut efficacement soutenue par l'éternelle Justice, qui avait à venger les deux filles de Schédasos, auxquelles certains Spartiates avaient fait violence, en des temps reculés (§2437-4), et qui avaient leur tombe sur le champ de bataille. Cette influence des puissances surnaturelles avait été annoncée avant le combat ; mais Grote observe avec justesse : [FN: § 1952-1] « (p. 7) tandis que les autres étaient ainsi encouragés par l'espoir d'un secours surhumain, Épaminondas, auquel la direction de la prochaine bataille avait été confiée, prit soin (p. 8) qu'il ne manquât aucune précaution humaine ». Voilà peut-être ce qui aura déterminé à l'action l'éternelle Justice. Ce que lit Épaminondas est certainement ce qu'il convient toujours de faire en des cas semblables. Il est bon de discourir sur l'éternelle Justice, mais il est encore mieux d'agir comme si elle n'existait pas.
§ 1953. Aujourd'hui, bon nombre de personnes qui ne croient plus au surnaturel n'ont changé que la forme de la dérivation, et à la divine justice elles ont substitué la « justice immanente des choses », qui est une très belle mais peut-être un peu obscure entité. Elle préfère agir dans les affaires privées plutôt que dans les entreprises guerrières, peut-être parce qu'elle a plusieurs pacifistes parmi ses fidèles (§1883-1).
§ 1954. Il est certain que chez les anciens Israélites, les Grecs et les Romains, l'action de la divinité ne concordait pas entièrement avec la défense de la morale et de la justice. Il y avait quelque chose de plus, qui avait pour but de défendre certaines prérogatives divines. Cela déplaît à des théoriciens qui voudraient que cette différence n'existât pas ; aussi la nient-ils tout simplement et sans se soucier des contradictions manifestes ou voilées dans lesquelles ils tombent ; ils nous fournissent ainsi d'excellents exemples de ces contradictions, exemples d'autant meilleurs que leurs auteurs sont plus intelligents, pondérés, cultivés.
§ 1955. Chez les Pères de l'Église et plus tard, jusqu'à notre époque, chez les théologiens catholiques, on comprend que la foi était un obstacle à la croyance que le Dieu de l'Ancien et celui du Nouveau Testament pussent faire quelque chose qui ne fût pas parfaitement moral et juste. C'est pourquoi, par des interprétations diverses, ces auteurs modifient les conceptions qui sont exprimées en un sens opposé, dans l'Écriture. Nous n'avons pas à nous y arrêter, car ce sujet sort, au moins en partie, du domaine expérimental. Remarquons seulement que, parmi les protestants libéraux, il ne manque pas de gens qui, précisément au point de vue expérimental, reviennent aux conceptions des anciens Israélites [FN: § 1955-1].
§ 1956. Au contraire, nous devons nous arrêter quelque peu sur le fait qu'à notre époque de si grande diffusion de science et de critique, il y a beaucoup de gens qui, tout en disant vouloir demeurer dans le domaine logico-expérimental, ferment les yeux afin de ne pas voir les faits, et gratifient les hommes du passé d'opinions qu'en réalité ils n'ont jamais eues. Ce fait a lieu parce que là où le sentiment domine, le sens critique s'affaiblit ou même disparaît. Voici un auteur, Maury, qui est pourtant l'un des meilleurs connaisseurs de l'antiquité classique, et qui s'exprime ainsi [FN: § 1956-1] : « (p. 48) Le châtiment céleste, voilà ce dont en effet étaient menacés ceux qui avaient enfreint les lois de la morale, de même que la récompense attendait les bonnes actions. La tragédie d'Ion d'Euripide finit par une allocution mise dans la bouche du chœur, qui déclare que les bons trouvent enfin le prix de la vertu, et les méchants la juste peine de leur crime, idée qui apparaît dès les temps homériques. La vengeance divine, qui n'est que la détermination prise par la divinité de ne point laisser le crime impuni, que l'implacable aversion qu'elle nourrit contre lui, atteint toujours le criminel »…« (p. 49) Aux mythes antiques qui nous peignent simplement, sous les apparences du symbole et de l'allégorie, les phénomènes physiques, succèdent d'autres mythes plus moraux dont l'objet est de faire ressortir ce principe redoutable de l'inévitabilité de la vengeance divine ».
§ 1957. Si l'on voulait s'en tenir à cette opinion, pourtant très autorisée, on estimerait que les anciens Grecs, et spécialement Euripide, penchaient pour la solution affirmative de notre problème, et croyaient que les dieux récompensaient toujours les bons et châtiaient les méchants ; mais si l'on étudie directement les faits, on arrivera à une conclusion bien différente.
§ 1958. Tout d'abord, chez Euripide lui-même, on peut facilement trouver plusieurs passages tout à fait contraires à celui que nous venons de citer. Par exemple, dans Hélène, le chœur dit qu'il ne sait si c'est un dieu ou quelqu'un qui n'est pas dieu, ou un être intermédiaire, qui gouverne les événements du monde, à voir leurs fluctuations tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. [FN: § 1958-1] Pis encore, dans l'Hercule furieux, le chœur dit que les bons n'ont pas un meilleur sort que les méchants. [FN: § 1958-2]
§ 1959. Ensuite, plus particulièrement si l'on considère la tragédie Ion, citée par Maury, on trouve peu judicieuse la conclusion du chœur. Apollon fait violence à la vierge Créuse, et la rend mère d'Ion. Pour cacher sa faute involontaire, la jeune fille expose l'enfant. Ensuite, Apollon ment et trompe Xouthos, mari de Créuse, en lui faisant croire qu'Ion est son fils, à lui Xouthos, et Apollon dit naïvement qu'il fait cela pour introduire Ion dans une famille riche et illustre. Créuse ne sait pas qu'Ion est son fils, et celui-ci ne sait pas qu'elle est sa mère. Croyant qu'il est, comme l'a dit Apollon, un fils bâtard de son mari, elle veut l'empoisonner, et lui, pour se venger, veut la tuer. Grâce à une certaine corbeille, elle reconnaît son fils, et Athéna survient pour dissiper tous les doutes et pour confirmer cette descendance.
§ 1960. En tout cela, on ne voit pas où sont « les bons qui trouvent enfin la récompense de la vertu ». Ne parlons pas d'Apollon, qui est un beau type de malfaiteur ; mais on ne voit pas que Créuse ait été plus vertueuse que d'autres personnes, et l'on ne peut certes pas appeler vertu la tentative d'empoisonner Ion ; son unique mérite fut d'enflammer Apollon. Le pauvre Xouthos n'a fait de mal à personne, et il est gratifié d'un fils qui ne lui appartient nullement. Quant à Ion, c'est un bon diable qui, à part son dessein de tuer Créuse, ne fait ni bien ni mal. En vérité, cet exemple est mal choisi pour qu'on y voie la récompense des « bons » et le châtiment des « méchants ».
§ 1961. En somme, la conclusion de la tragédie est différente ; elle consiste dans le fait que la protection des dieux est efficace ; mais non que cette protection s'obtienne toujours par la vertu.
Ce fait est plus apparent dans la tragédie Hippolyte, et Maury aurait dû y prendre garde. La malheureuse Phèdre n'a pas « honoré l'iniquité », comme dit Maury ; elle n'a pas non plus négligé de « vénérer les dieux ». Aphrodite reconnaît que Phèdre lui a édifié un temple magnifique ; mais elle la sacrifie allégrement au désir qu'elle a de se venger d'Hippolyte. Elle dit clairement : « Il est certain que Phèdre est une noble femme, mais elle succombera tout de même, car son mal ne m'empêchera pas de faire que mes ennemis satisfassent à ma vengeance [FN: § 1961-1] ».
Quand on a sous les yeux de tels passages d'un auteur, il faut vraiment que le sentiment obscurcisse la raison, pour citer ce même auteur dans le but de démontrer que « la vengeance divine n'est que la détermination prise par la divinité de ne pas laisser le crime impuni ».
§ 1962. Maury est loin d'être isolé ; il y a même de nos jours un très grand nombre de personnes qui, parce qu'elles estiment bon de croire que la vertu est récompensée et le vice puni, s'imaginent retrouver cette conception en tout temps, chez tous les peuples, et même chez des auteurs qui sont loin d'avoir une telle conception. Il importe de noter de semblables faits, parce qu'ils nous font voir combien, même de nos jours, les résidus de la IIe classe sont puissants. Un savant qui étudie l'histoire des us et coutumes d'un peuple ne sait pas et ne veut pas se borner à la recherche des uniformités : il éprouve le besoin irrésistible de louer sa morale, sa foi politique, sa religion ; il sort du domaine des recherches scientifiques et se met à prêcher.
§ 1963. Dans un livre qui, d'autre part, renferme une foule d'excellentes observations et de judicieuses déductions, on lit [FN: § 1963-1] : « (p. 178) L'essence de la foi religieuse, telle qu'elle était professée par tout être intelligent, durant les beaux temps de la Grèce, (p. 179) peut se résumer ainsi en quelques mots : il existe un ensemble d'êtres divins dont la puissance s'exerce sur la nature et sur l'humanité, d'où procèdent le bien et le mal, de qui nous pouvons à notre gré nous concilier ou nous aliéner la faveur. Le moyen de leur être agréable et de nous les rendre propices, c'est, d'une part, d'accomplir en leur honneur les cérémonies religieuses auxquelles ils ont été habitués de tout temps et dont eux-mêmes nous ont imposé la loi ; de l'autre, de nous bien comporter et de remplir nos devoirs envers l'État et envers nos semblables, devoirs qui eux aussi nous ont été impérieusement tracés soit par les dieux, soit par les hommes inspirés ou que révèlent à chacun de nous notre raison et notre conscience ». Au lieu du pluriel dieux, mettez le singulier dieu, et vous aurez précisément ce que les chrétiens pensent de leur religion. L'auteur transporte cette conception dans le passé. C'est l'un des innombrables cas de persistance des agrégats (IIe classe). Ses lecteurs éprouvent l'impression que les « éternelles vérités » de leur morale et de leur religion pouvaient vraiment être obscurcies par le polythéisme, mais qu'elles existaient pourtant dans la conscience de tout « être intelligent ». Et ceux qui, tels les athées et les sceptiques, ne croyaient pas à ces belles choses ? Nous les éliminons facilement, grâce à l'épithète intelligent ; c'est-à-dire que nous les déclarons étrangers à cette catégorie, et tout est dit (§1471, 1476). Où Schœmann a-t-il trouvé chez les auteurs grecs que pour, nous rendre les dieux « propices », il suffit « d'accomplir en leur honneur les cérémonies » et de « remplir nos devoirs » ? Quelles cérémonies en l'honneur des dieux la fille d'Agamemnon avait-elle négligé d'accomplir ? À quels devoirs envers ses semblables avait-elle manqué, pour mériter que les dieux imposassent à son père de la sacrifier ? Et Mégara, femme d'Héraclès, et leurs enfants, pour quelle négligence de cérémonies ou de devoirs méritèrent-ils d'être tués par Héraclès ? Euripide nous montre la Furie que, sur l'ordre d'Hèra, Iris charge de troubler la raison d'Héraclès. La Furie hésite à remplir une mission si perverse, mais finit par obéir ; et il ne semble pas que le public trouvât rien à redire à la tradition suivie par le poète. Quand et comment Hector avait-il péché contre les dieux et contre ses semblables, pour devoir être tué par Achille, et pour que son cadavre dût être traîné autour des murs de Troie ? Et ainsi de suite : on peut citer autant qu'on veut de légendes semblables. Il est vrai que Platon les repousse et les blâme, et c'est peut-être à lui que pensait notre auteur ; mais en ce cas, celui-ci devait nommer clairement Platon, au lieu de nous parler de « tout être intelligent ».
§ 1964. Decharme cite un fragment de la tragédie d'Eschyle intitulée Les Héliades, où l'on dit [FN: § 1964-1] : « (p. 102) Zeus est l'éther, Zeus est aussi la terre, Zeus est aussi le ciel; Zeus est toutes choses et ce qu'il y a au-dessus de toutes choses ». Decharme ajoute : « Rien de plus élevé qu'une pareille doctrine ; rien de plus contraire en même temps à la religion populaire... Cette conception toute nouvelle de Zeus, qui ne pouvait être alors que le rêve de quelques grands esprits, nous permet de mesurer combien la religion d'Eschyle a dépassé celle de son temps ». Ne nous arrêtons pas à la partie subjective du raisonnement. L'auteur a un certain idéal et appelle « grands esprits » ceux qui se rapprochent de son idéal. Ne nous attachons qu'aux faits. Est-il bien vrai qu'on trouve de telles conceptions dans les tragédies d'Eschyle, au lieu de celles de la religion populaire ? À vrai dire, il importerait peu de résoudre ce problème, si l'on recherchait uniquement les opinions d'Eschyle ; mais en trouvant les opinions exprimées dans ses tragédies, qui furent accueillies favorablement par le peuple athénien, nous découvrons les résidus que ce peuple acceptait, et cela nous importe davantage.
§ 1965. Dans la trilogie de l'Orestie, le contraste est manifeste entre la conception d'une conséquence spontanée, mécanique, du délit, et la conception du jugement qu'on en peut tirer, si l'on tient compte des circonstances dans lesquelles le délit a été commis. On peut même dire que le but de la trilogie est de poser le problème qui naît de ce contraste, et de le résoudre. Comme on sait, les Érinyes sont vaincues par Apollon ; ce qui signifie que la seconde conception l'emporte sur la première. Pourtant, celle-ci est loin de disparaître entièrement, et les raisonnements d'Apollon ne sont pas très concluants. [FN: § 1965-1]
§ 1966. On peut former trois catégories des passages de la trilogie qui ont trait à cette matière.
1° Passages qui supposent que l'homicide engendre l'homicide, ou, d'une manière générale, que la transgression de certaines règles engendre une autre transgression, abstraction faite de toute notion de « juste » ou « d'injuste », ou du moins si l'on attribue un rôle effacé à cette notion. Par exemple, quand Clytemnestre a tué Agamemnon, le chœur en accuse le génie qui a envahi la maison des fils de Tantale, et Clytemnestre dit [FN: § 1966-1] : « Maintenant ta bouche a bien jugé, en invoquant le démon trois fois funeste de ces gens ; car il nourrit dans nos cœurs une cupidité sanguinaire. Avant que la calamité ancienne ait pris fin, voici du nouveau sang ». Ensuite, nous avons les passages [FN: § 1966-2] : « Y a-t-il expiation pour le sang tombé à terre ? » – « L'homicide doit payer sa dette [FN: § 1966-3] ». Électre demande au chœur ce qu'il doit souhaiter aux assassins de son père [FN: § 1966-4]. « Le chœur : „ Qu'un démon ou un mortel vienne vers lui “. – Électre : „ Un juge ou un vengeur, dis-tu. “ – Le chœur : „ Prie simplement que quel-qu'un les tue à leur tour “ ». Enfin, la fatalité qui pèse sur les Atrides est une dérivation de l'idée qu'il existe un lien nécessaire entre le délit et ses conséquences. Comme toutes les dérivations de ce genre, celle-ci est peu précise et peu logique. De là les difficultés que nous rencontrons quand nous voulons connaître avec précision la doctrine de l'auteur, et pis encore, d'une façon générale, ce que les hommes du temps comprenaient par le mot destin. Nous cherchons ce qui n'existe pas : une doctrine précise ; et au contraire, cette doctrine ne l'est pas. Il faut prendre garde que ce n'est pas nécessairement le bien qui naît du bien, le mal du mal, ce qui supposerait, implicitement du moins, un sentiment de « justice ». Au contraire, le mal peut naître du bien. Eschyle exprime clairement cette opinion, que pourtant il n'admet pas. Le chœur dit [FN: § 1966-5] : « Une vénérable maxime existe depuis longtemps parmi les mortels : un grand et complet bonheur de l'homme engendre, et ne demeure pas stérile ; mais d'un sort prospère naît une inextinguible misère. Mon sentiment est différent de celui des autres, car, au bout de quelque temps, l'impiété engendre une descendance semblable à elle-même ; mais une maison vraiment juste a toujours dans son sort une belle descendance ». Égisthe rappelle les crimes successifs, engendrés l'un par l'autre, et qui pèsent sur les Atrides. En tout cas l'homicide a pour conséquence nécessaire, inévitable, de souiller le meurtrier, qu'il soit ou non coupable, qu'il soit homicide volontaire ou involontaire (§1253). D'ailleurs Eschyle a des doutes à cet égard. Le chœur des Euménides dit qu'Athéna ne peut juger Oreste, car celui-ci, souillé d'homicide, ne peut jurer ; mais Athéna répond [FN: § abc-6] : « Préfères-tu entendre correctement qu'agir correctement ? » ce qui veut dire : « Préfères-tu la forme au fond de la justice ? » Il convient de remarquer que le problème ainsi posé n'est pas résolu, et qu'Athéna exprime seulement une opinion ; tandis que le procès continue, parce qu'Oreste affirme et démontre qu'il est purifié [FN: § 1966-7], c'est-à-dire parce que le motif invoqué par les Euménides est inexistant.
§ 1967. 2° Passages où la conception de la justice est principale. D'abord, on peut observer que toute la trilogie aboutit à la prédominance de cette conception sur les usages anciens : les divinités nouvelles vainquent et dominent les divinités anciennes. Ensuite on fait souvent concorder la conception de la fatalité avec celle de la « justice ». Nous avons vu tantôt ces conceptions en lutte. L'auteur tranche le différend en faveur de la dernière. « La vie heureuse est, parmi les mortels, une déesse et une déesse souveraine ; la balance de la justice agit promptement sur celui qui est en lumière ; d'autres, qui sont aux confins de la lumière et des ténèbres, souffrent plus tard ; d'autres restent dans une nuit éternelle [FN: § 1967-1] ». Les Euménides se glorifient d'être les dispensatrices de la justice [FN: § 1967-2]. « Notre fureur ne se déchaîne pas sur celui qui étend les mains : il passe sa vie sain et sauf. Mais si quelque criminel comme cet homme [Oreste], cache ses mains tachées de sang, nous, justes témoins, venant au secours des morts, vengeresses du sang, finalement nous nous manifestons à lui ». Ces deux genres de passages indiquent également le châtiment comme conséquence inévitable du crime ; ils diffèrent par la manière dont la conséquence découle. Mais si tout délit engendre des maux, tous les maux ne sont pas engendrés par les délits ; en d'autres termes, il y a des châtiments qui sont infligés pour des faits qui ne sont pas des transgressions des règles de la justice et de la morale, et vice versa, il y a des transgressions qui restent sans châtiment. Nous avons ainsi le troisième genre de passages.
§ 1968. 3° Passages où la « justice » fait entièrement défaut. Par exemple, Clytemnestre décrit la destruction de Troie : la mort des vaincus, le pillage, l'incendie ; tout cela n'est rien : [FN: § 1968-1] « S'ils révèrent les dieux tutélaires et les temples de la terre conquise, les vainqueurs ne seront pas vaincus à leur tour [FN: § 1968-2] ».
§ 1969. L'envie des dieux, dont parlent tant les auteurs de la Grèce antique (§1986), apparaît aussi dans la trilogie. Agamemnon craint d'offenser les dieux en marchant sur des tissus de pourpre [FN: § 1969-1]. Le chœur dit que du bonheur naît le malheur, et que la prospérité humaine se brise sur quelque écueil caché. Aussi conseille-t-il de jeter, par mesure de prudence, une partie des biens qu'on possède [FN: § 1969-2].
§ 1970. Ces contrastes apparaissent fort bien dans le discours que tient Zeus, au premier chant de l'Odyssée. Eustathe voit bien qu'on y posait le problème du bien ou du mal que l'homme, par ses actions, s'attire à lui-même, et du bien ou du mal qu'indépendamment de ces actions les dieux ou le destin lui suscitent. Zeus commence par se plaindre de ce que les hommes accusent à tort les dieux de leurs maux, tandis qu'en réalité ils se les attirent eux-mêmes [FN:§ 1970-1]. La théorie est évidente : du délit vient le châtiment, et Zeus est seulement témoin des événements qui ont lieu. Athéna réplique et expose une autre théorie [FN: § 1970-2]. Les maux des hommes devraient être le seul châtiment de leurs mauvaises actions. Égisthe a été justement puni ; mais Ulysse, qui n'a pas mal agi, ne devrait pas subir le châtiment de l'exil loin de sa patrie. Zeus reprend la parole [FN: § 1970-3]. Il a déjà oublié son affirmation d'après laquelle les hommes accusent à tort de leurs maux les dieux ; il dit que les maux d'Ulysse ont pour origine la colère de Poséidon, qui persécute Ulysse, parce qu'il a aveuglé le Cyclope.
Pourtant, en agissant ainsi, Ulysse n'a nullement péché contre les règles de la justice. Nous avons donc une troisième théorie. Les maux des hommes leur viennent en partie de ce qu'ils agissent follement, en partie de ce qu'ils sont frappés par quelque dieu, sans aucune faute de leur part. Les autres dieux entravent, il est vrai, l'œuvre de Poséidon à l'égard d'Ulysse ; mais ils n'essaient même pas de porter secours aux malheureux Phéaciens que Poséidon punit, non pas pour quelque mauvaise action, mais au contraire pour avoir accompli la bonne action de ramener Ulysse dans sa patrie, pour avoir obéi au précepte divin qui veut que les étrangers soient considérés comme venant de Zeus.
§ 1971. Avec ces passages et d'autres sous les yeux, on ne comprend pas comment J. Girard peut dire que, dans l'Odyssée [FN: § 1971-1], « (p. 97) s'il est une idée d'où dépende visiblement toute la suite des faits, c'est : d'une part, que les hommes par leur obstination dans le mal attirent sur eux le châtiment, et, de l'autre, qu'un prix éclatant est réservé à la vertu énergique et patiente ». Une belle récompense, en vérité, fût réservée aux pauvres et vertueux Phéaciens ! Les contradictions relevées tout à l'heure dans le premier chant de l'Odyssée ne semblent pas avoir été aperçues par leur auteur. Plus tard, des doutes se manifestèrent sur ces sujets, et l'on chercha à résoudre les problèmes auxquels ils donnèrent naissance. Dans son commentaire, Eustathe [FN: § 1971-2] attribue, comme origine aux maux des hommes, d'une part Zeus et le destin, qu'il met ensemble ; d'autre part, l'imprudence, ou mieux le manque de discernement ![]() des hommes, qui s'attirent des maux à eux-mêmes. Il semble qu'il s'attache surtout à cette question : les maux sont-ils indépendants ou dépendants de l'action des hommes ?
des hommes, qui s'attirent des maux à eux-mêmes. Il semble qu'il s'attache surtout à cette question : les maux sont-ils indépendants ou dépendants de l'action des hommes ?
§ 1972. L'exemple que nous venons de donner est l'un de ceux, fort nombreux, que l'on peut citer pour montrer qu'en beaucoup de cas la recherche de l'idée qu'avait l'auteur d'une composition littéraire est vaine, et cela pour le motif que dans ces cas, il n'y a pas une idée unique (§541), ni chez l'auteur, ni chez celui qui l'écoute. L'un et l'autre se laissent guider par le sentiment, qui laisse les propositions indéterminées, et parfois les accepte même si elles sont contradictoires. Il y a, chez les hommes, deux sentiments qui naissent, l'un des infortunes « méritées », l'autre des infortunes « imméritées ». Si l'on dit que toute infortune est méritée, en certaines circonstances, le premier sentiment peut agir seul, tandis que le second reste latent. Vice versa, si l'on parle du destin qui fait endurer des maux à l'innocent, le second sentiment agit, et le premier est inactif.
§ 1973. Il est nécessaire d'avoir cela présent à l'esprit, lorsqu'on traite des dieux et du destin, du contraste entre la « Justice » et la « fatalité ». L'empereur Julien se moque du Dieu des Hébreux, qui se fâche pour des motifs futiles ; mais il oublie que les dieux du paganisme étaient tout aussi faciles à irriter [FN: § 1973-1]. En réalité, les hommes ont l'habitude d'attribuer à leurs dieux les caractères des hommes puissants.
§ 1974. Dans le petit livre de Bayet, que nous citons souvent, parce qu'il est généralement en usage dans les écoles laïques françaises, et qu'il renferme par conséquent les théories protégées par la « défense de l'école laïque », on commence par donner une solution affirmative du problème que nous étudions ici. En effet, nous lisons dans cet ouvrage [FN: § 1974-1] : « (p. 1) Les bonnes actions sont celles qui nous sont utiles, c'est-à-dire celles qui nous rendront VRAIMENT HEUREUX. Les mauvaises actions sont celles qui nous sont nuisibles, c'est-à-dire celles qui nous rendront MALHEUREUX. On peut donc dire que la morale nous enseigne quelles sont les choses qu'il faut faire pour être vraiment heureux ». Donc, quiconque suit les enseignements de la morale sera vraiment [attention à cet adverbe] heureux ; mais pour qu'aucun doute ne subsiste, l'auteur, après la théorie générale, cite encore un cas particulier : « (p.1) On dit, par exemple, que nous avons le devoir de ne pas mentir : cela veut dire que, si nous mentons, nous serons malheureux tôt ou tard, et que si, au contraire, nous ne mentons pas, nous serons VRAIMENT HEUREUX ». Enfin, pour ceux qui n'ont pas encore compris, on ajoute : « (p. 2) Il est aussi sot et aussi dangereux de ne pas écouter ce que dit la MORALE que de ne pas écouter ce que dit la MÉDECINE ». Fort bien ; la théorie exposée est claire. Mais, un peu plus loin, l'auteur cite F. Buisson, qui dit qu'autrefois les manants étaient « (p. 26) courbés sur la glèbe, noirs, livides, taillables et corvéables à merci ». Donc ils étaient malheureux ; donc, si celui qui observe les règles de la morale est toujours heureux, cela signifie que les manants n'observaient pas ces règles. Mais ce n'est certainement pas ce que veut dire l'auteur. Il y a mieux. Comme nous l'avons vu (§1716-2]), l'auteur affirme que les conditions présentes de la société ne sont pas justes, et que « tout le monde doit désirer que cela change ». Donc, si la théorie exposée est vraie, on doit conclure que si les pauvres sont aujourd'hui malheureux, c'est parce qu'ils n'observent pas les règles de la morale. Le remède à leurs maux consisterait donc à observer ces règles, puisque, dit l'auteur, « la morale nous enseigne quelles sont les choses qu'il faut faire pour être vraiment heureux ». Est-ce peut-être la conclusion de l'auteur ? En aucune façon ! Il a déjà oublié ce qu'il avait dit peu avant, et il donne comme remède l'élection de députés et de sénateurs d'un certain parti (§1716-2]). Mais si cela est nécessaire et suffisant pour donner plus de bonheur aux pauvres, pourquoi l'auteur a-t-il commencé par dire qu'on obtenait cet effet en observant les règles de la morale ? Il pourrait, il est vrai, répondre que, pour lui, élire des députés et des sénateurs d'un certain parti, c'est une règle de morale. Ainsi nous revenons au genre (A-1). Si l'on appelle moral tout ce qui, suivant un auteur, peut procurer le bonheur, il est très certain qu'on peut conclure, toujours selon cet auteur, que la morale procure le bonheur. Toute pétition de principe donne toujours une conclusion incontestable. La Science de M. Bayet est probablement la respectable entité qui, de nos jours, a été divinisée ; mais elle n'a vraiment rien à faire avec la science logico-expérimentale. Nombre de siècles se sont écoulés depuis le temps où fut composé le premier chant de l'Odyssée, jusqu'à celui où M. Bayet a donné ses œuvres au monde. Peut-être le mérite littéraire de ces deux compositions est-il quelque peu différent ; mais dans l'un et dans l'autre nous trouvons des contradictions analogues. Pourtant l'Odyssée est exempte de la présomption d'avoir dissipé les ténèbres de la « superstition » par l'éclat de la sacro-sainte Science.
§ 1975. Le second sujet indiqué au §1898 se rapporte aux conséquences produites, dans le cas où la personne qui observe ou transgresse les règles est différente des personnes qui retirent un avantage, ou bien subissent un dommage de ce fait, auquel elles sont étrangères. Quand il y aurait lien de traiter ce sujet, il arrive parfois que les auteurs négligent entièrement le problème de la correspondance de ce fait avec le bonheur ou le malheur des personnes, ou bien qu'ils font seulement une lointaine allusion à une solution implicite. De nos jours, cela se produit surtout au sujet des rapports entre gouvernants et gouvernés, et, en général, les auteurs semblent se rapprocher plus ou moins implicitement de l'une des deux thèses suivantes : 1° Les gouvernants doivent observer les règles existantes, et il n'y a pas lieu de se soucier d'autre chose, ni de résoudre le problème des conséquences ; 2° les gouvernants peuvent transgresser ces règles pour faire le bien public ; mais on admet cela sans trop en parier, et parfois même en affirmant le contraire. D'une manière ou de l'autre, on échappe à la nécessité de résoudre le problème de la correspondance entre les actions et les conséquences [FN:§ 1975-1]. Celui qui voit objectivement les faits, celui qui ne veut pas, de propos délibéré, fermer les yeux à la lumière, est tout de même obligé de reconnaître que ce n'est pas en étant des moralistes timorés que les gouvernants font prospérer les nations; mais il passe le fait sous silence, ou s'excuse de l'exprimer, et accuse des événements la « corruption » des mœurs. Pourtant, même ainsi, il n'évite pas le reproche d'immoralité dont on gratifia Machiavel, parce qu'il avait simplement exprimé des uniformités que tout le monde peut vérifier dans l'histoire [FN:§ 1975-2] (§2449). On l'a accusé d'avoir plagié Aristote et d'autres auteurs : il s'est simplement rencontré avec ceux qui ont décrit la réalité. Cet exemple montre la difficulté qu'il y a à faire une analyse scientifique. La plupart des gens sont incapables de séparer deux études qui sont pourtant entièrement différentes : I. L'étude des mouvements réels, qui porte sur les faits et sur leurs rapports. Les faits que rapporte Machiavel sont-ils ou non vrais ? Les rapports qu'il aperçoit entre eux sont-ils ou non réels ? C'est ce dont ne semblent guère, se soucier la plupart de ceux qui l'attaquent ou le défendent ; toute leur attention se porte vers la partie suivante. II. L'étude des mouvements virtuels, qui est l'étude des mesures à prendre en vue d'un but déterminé. Qui attaque Machiavel l'accuse de prêcher aux princes de devenir des tyrans ; qui l'excuse répond qu'il a seulement montré comment on peut atteindre ce but, mais qu'il n'a pas recommandé ce but. L'accusation et l'excuse peuvent subsister toutes deux, mais elles sont étrangères à la question de savoir comment les faits se passeront, en certains cas hypothétiques. On remarquera qu'en homme pratique, Machiavel a voulu traiter d'un cas concret, qui devient ainsi un cas particulier de la question générale. Il a écrit Le Prince, mais, exactement sur le même modèle, il aurait pu écrire Les Républiques. [FN: § 1975-3] Il l'a même fait en partie dans les Discours sur la première décade de Tite-Live, et, s'il avait vécu de nos jours, il aurait pu faire porter ses études sur les Régimes parlementaires. Il a recherché quels sont les moyens les plus appropriés pour que les princes conservent le pouvoir, et il a examiné les deux hypothèses, du prince nouveau et du prince héréditaire. Sur le même modèle, il aurait pu faire des recherches analogues pour les autres régimes politiques. Toujours sur le même modèle, il aurait pu étendre ses recherches au point de vue du but, et étudier quels sont les moyens les plus appropriés pour obtenir les puissances économiques, militaire, politique, etc. Ainsi, du cas particulier concret étudié par lui, il se serait élevé jusqu'à la question générale des mouvements virtuels, qui est précisément une de celles que considère la sociologie. On ne pouvait pas encore faire cela de son temps, de même qu'on ne pouvait le faire au temps de son unique et grand prédécesseur Aristote, parce que les sciences sociales n'étaient même pas nées. Aussi demeure-t-on émerveillé de la puissance extraordinaire du génie d'Aristote, et plus encore de celle du génie de Machiavel, de ces hommes qui, avec les éléments si imparfaits que leur fournissaient les connaissances du temps où ils vivaient, surent s'élever à un si haut degré. Mais on voit aussi combien grande est l'ignorance de certains de nos contemporains, qui ne sont même pas capables de saisir l'importance de la question étudiée par Machiavel, auquel ils opposent des billevesées éthiques et sentimentales, dépourvues de toute valeur scientifique ; cependant qu'avec une prétention ridicule, ils s'imaginent étudier les sciences politiques et sociales.
On trouve des exemples importants chez Émile Ollivier [FN:§ 1975-3]. Il essaie, sans trop insister il est vrai, d'établir la concordance entre les bonnes œuvres et le bonheur, en reculant ce dernier dans l'avenir (§1951) ; mais il ne s'arrête pas à cet essai, tandis que, dans tout l'ouvrage de seize volumes [plus tard dix-sept], il s'efforce de présenter Napoléon III comme un parfait honnête homme. Comme, d'autre part, il est incontestable que le sort ne lui fut pas propice, cela prouve, en admettant les yeux fermés les affirmations d'Ollivier, que les bonnes actions peuvent ne pas aller de pair avec le succès. Ajoutons que dans le passage où il s'en remet à l'avenir pour changer le sort de mauvais en bon, il ne nous explique pas du tout comment l'avenir peut remédier aux maux des gens qui sont morts avant que le sort change. Il ne semble pas avoir de théorie très précise (§ 1995-3), et il ne traite pas la question de la divergence entre les malheurs des Français en 1870 et les bonnes œuvres précédentes de leur empereur. Devons-nous admettre que c'est là un cas analogue, bien qu'opposé, à celui des Achéens qui souffrirent tant de maux occasionnés par l'orgueil d'Agamemnon ? ou devons-nous admettre une autre explication ? Ollivier ne s'aperçoit pas que les justifications qu'il donne des actions de Napoléon III, au point de vue de la morale privée, sont une condamnation certaine des actions de ce souverain comme homme d'État [FN: § 1975-4].
§ 1976. D'une façon générale, les personnes qui ont une foi vive y trouvent le souverain bien, et sont, par conséquent, portées à croire que le fait d'observer les règles imposées par cette foi conduit nécessairement au bonheur. Pourtant, quand le terme bonheur désigne une chose existant dans le domaine expérimental, affirmer une concordance parfaite entre l'observation des règles de la morale et de la religion d'une part, et le bonheur d'autre part, ou bien entre la transgression de ces règles et le malheur, c'est se mettre trop souvent en contradiction avec l'observation des faits [FN:§ 1976-1], pour qu'on obtienne le consentement des hommes, à moins que l'on ne trouve moyen de faire disparaître le contraste par des explications appropriées. C'est à quoi s'employèrent un grand nombre de gens, depuis les anciens temps jusqu'à l'époque moderne. Dans ce but, parfois les théoriciens inventèrent de toutes pièces les arguments ; plus souvent, et avec beaucoup plus d'efficacité, ils les cherchèrent dans les expressions déjà existantes de certains résidus. Par exemple la persistance des agrégats pousse les hommes à considérer comme une unité une certaine collectivité, et le théoricien peut tirer parti de ce fait pour expliquer comment une personne appartenant à cette collectivité subit des maux sans les avoir mérités en aucune façon. Il suffit pour cela d'invoquer des fautes commises par quelque autre personne de la collectivité (§1979).
§ 1977. (B-2) Bonheur et malheur repoussés dans l'espace et dans le temps. Un individu accomplit une action M, dont on affirme que doit découler un fait P, lequel peut être aussi l'effet du hasard. Il est évident que plus long sera l'espace de temps que nous accorderons pour que P se produise, après que M a eu lieu, plus grande deviendra la probabilité que P puisse se produire par simple hasard. Bien plus, si l'espace de temps est assez long, la réalisation de P est si probable qu'on peut la qualifier de certaine. Si les gens qui tâchent de deviner les numéros de la loterie donnent un siècle pour qu’un numéro sorte, au lieu de désigner un tirage déterminé, ils peuvent être presque certains, disons même certains, que leurs prédictions seront vérifiées. De même, si le temps dans lequel doit se vérifier la prophétie est long et indéterminé, ou ne court aucun danger d'être démenti en affirmant qu'un peuple qui agit mal est tôt ou tard puni, et un peuple qui agit bien, tôt ou tard récompensé. Aucun peuple, durant une longue série d'années ou de siècles, n'a que des événements heureux ou que des événements malheureux. Par conséquent, si l'on n'est pas limité par le temps, on trouvera toujours la punition ou la récompense cherchées.
Il est un procédé remarquable de repousser dans le temps et dans l'espace les conséquences des événements heureux ou malheureux qui arrivent aux hommes. On affirme que, si des malheurs affligent un homme qui est bon, cela tourne à son avantage, parce que cela sert à le corriger de quelque vice ou de quelque défaut, ou que cela engage d'autres hommes à se corriger des leurs ; et si, mais plus rarement, un événement heureux arrive à un méchant homme, on dit que cela tourne à son détriment, parce que, aveuglé, il court à sa perte ; ou bien que cela sert à inspirer aux gens le mépris des biens terrestres, en leur montrant que les méchants en jouissent eux aussi (§ 1995-3).
§ 1978. Étant donnée la brièveté de la vie humaine, on a moins de chances de trouver pour l'homme que pour les peuples la correspondance désirée, dans le temps, entre les actions et leurs conséquences. Cependant il est difficile que tout aille bien ou que tout aille mal pour un homme, dans le cours de son existence. Par conséquent, même pour lui, on trouvera la correspondance cherchée entre une action qu'il a accomplie et le châtiment ou la récompense de cette action. C'est pourquoi nous avons un grand nombre de théories qui, pour le même individu, reculent l'expiation dans le temps. D'autres affirment que le mal d'un homme sert à le corriger, et qu'en conséquence, après un certain temps, il fera le bien de cet homme. Celui qui dit aujourd'hui : « Attendez l'avenir pour voir si la faute ne sera pas punie, la bonne action récompensée », ne peut se voir opposer aujourd'hui un démenti certain par l'expérience, car l'avenir nous est inconnu, à nous comme à lui. Mais si la théorie qu'il énonce est générale, si elle s'applique au passé, – et c'est bien ainsi qu'il l'entend ordinairement, – nous devrions connaître aujourd'hui la punition ou la récompense qui revint avant leur mort aux hommes dont nous savons l'histoire ; et quand on fait cette recherche, on voit que la théorie n'est pas du tout vérifiée par l'expérience. Ce fait échappe à qui se laisse dominer par le sentiment. C'est un cas analogue à celui que nous avons cité (§1440-2), de gens qui croient que les femmes descendant d'hommes qui boivent du vin perdent la faculté d'allaiter. Ces gens ne prennent pas garde que si c'était vrai, on ne trouverait plus, dans les pays viticoles, une seule femme qui puisse allaiter.
§ 1979. Si nous élargissons le cercle de nos recherches, et que nous passons d'un individu à d'autres individus, nous pouvons encore plus aisément retrouver quelques maux, ou quelques biens, à mettre en rapport avec une action déterminée. Des résidus puissants poussent les hommes à considérer la famille comme une unité, et nous pouvons tirer parti de cette circonstance pour trouver, parmi les descendants d'un homme, quelqu'un qui subit le châtiment ou reçoit la récompense d'une action accomplie par cet homme [FN:§ 1979-1]. Le succès de cette recherche est certain : quand a-t-on jamais vu, au cours des siècles, la descendance d'un homme n'être l'objet que d'événements heureux, ou que d'événements malheureux ?
§ 1980. Le malheureux Crésus envoya des ambassadeurs pour reprocher à Apollon les infortunes dont lui, Crésus, avait été accablé. Par la bouche de la Pythie, le dieu répondit sans reprocher en aucune façon à Crésus d'avoir jamais péché contre les dieux ou contre les hommes. Il dit : « Le sort fixé par le destin ne peut pas être évité, même par un dieu. Crésus a été frappé à cause de la faute de son cinquième ascendant... » Hérodote [FN: § 1980-1], qui rapporte cette légende, n'y trouve rien à redire. Denys l'Ancien, tyran de Syracuse, commettait toutes sortes de crimes et de sacrilèges, et en riait allègrement. Après avoir saccagé le temple de Proserpine à Locres, il revenait à Syracuse. Son navire était poussé par un bon vent, ce qui lui fit dire à ses amis : « Voyez quelle bonne navigation les dieux immortels eux-mêmes accordent aux sacrilèges ! » Valère Maxime, qui rapporte ce fait [FN: § 1980-2], ajoute d'autres semblables exemples d'impiété, et conclut : « Bien qu'il ne payât pas la peine due à ses crimes, il reçut néanmoins, après sa mort, dans l'infamie de son fils, le châtiment auquel il avait échappé pendant sa vie. Si la colère divine est lente à la vengeance, elle compense le retard du supplice par sa gravité ». L. Cornelius Sulla fut heureux sa vie entière [FN:§ 1980-3] ; mais Faustus Sulla, son fils, fut tué par les soldats de Sitius, et Publius Sulla, son neveu, fut l'un des complices de Catilina. Dînant chez un vétéran, à Bologne, Auguste lui demanda s'il était vrai que celui qui, en Arménie, avait le premier enlevé la statue de la déesse Anaïtis, était mort frappé de cécité et de paralysie [FN: § 1980-4]. Le vétéran répondit que c'était précisément grâce à la jambe de la déesse qu'Auguste dînait ; que lui, le vétéran, avait le premier frappé la statue, et que toute sa fortune provenait de ce butin. Si nous connaissions l'histoire de tous les descendants de ce vétéran, aucun doute que nous n'en trouvions un auquel il sera arrivé quelque malheur, et nous pourrions admettre qu'il subissait la peine du crime de son ancêtre. De même, lorsque Crésus perdit le trône et la liberté, la Pythie découvrit aisément qu'il était puni pour le crime de son cinquième ascendant [FN:§ 1980-5] ; et si Crésus avait eu une vie toujours heureuse, son fils aurait pu subir la punition de son sixième ascendant, et ainsi de suite à l'infini [FN: § 1980-6].
§ 1981. Nonobstant un nombre immense de mauvaises actions, les Romains ont joui d'une longue prospérité ; mais rien ne nous empêche de croire qu'ils ont expié leurs mauvaises actions par l'invasion des Barbares. De même, les invasions des mahométans peuvent avoir puni les fautes des chrétiens, et les invasions des chrétiens en terre musulmane peuvent avoir puni les fautes des mahométans. Qui cherche trouve, et sans trop de peine.
§ 1982. La « responsabilité » des fautes, comme la « récompense » des vertus, peut non seulement passer aux descendants, mais aussi s'étendre à des collectivités diversement composées. Chez les anciens, l'opinion était générale que la faute d'un homme retombait sur tous ses concitoyens. Rome sut aussi tirer parti des mauvaises actions de certains consuls, mais elle n'en fit pas une théorie. Quand les auteurs anciens ne montrent aucune répugnance à admettre que les enfants subissent le châtiment dû à leur père, il est évident que la famille leur apparaît comme une unité, représentée par le paterfamilias. De même, lorsqu'ils parlent d'une cité frappée à cause des mauvaises actions de l'un de ses citoyens, ils la voient comme une unité [FN: § 1982-1]. Dans les deux cas, la punition de l'unité, à cause de la faute d'une partie de cette unité, est « juste », comme est « juste » la punition du corps entier d'un individu pour le crime commis par sa main. Cette considération de l'unité renferme le résidu principal (persistance des agrégats) ; et ce n'est qu'accessoirement qu'on fait usage des dérivations qui s'efforcent de concilier la punition – ou la récompense – de l'agrégat, avec la faute – ou le mérite individuel. Ajoutons que ce que nous appelons « faute » est assimilé, au moins en partie, à une souillure qui altère l'intégrité de l'individu, de sa famille, des diverses collectivités dont il fait partie. C'est pourquoi l'on voit surgir spontanément l’idée que l'intégrité doit être rétablie, non pour l'individu seul, mais aussi pour la famille et pour les diverses collectivités (§1231 et sv.).
§ 1983. Parmi les diverses dérivations mentionnées tout à l’heure, il faut remarquer celle qui affirme que la cité est frappée avec justice, parce qu'elle pouvait se soustraire au châtiment en punissant elle-même le coupable [FN: § 1983-1]. De nombreux faits rendent manifeste l'artifice de cette dérivation. Souvent le châtiment frappait la cité ou la collectivité avant qu'elles eussent connu le crime et le coupable, et par conséquent lorsqu'il était absolument impossible de châtier directement le coupable, ou d'expier le crime de quelque manière que ce fût. Les anciennes légendes fournissent à foison des exemples de peuples frappés pour des crimes ignorés, qui sont ensuite révélés par les prophètes ou par les devins. Les Achéens ne savaient en aucune façon pourquoi la peste les décimait, et pour qu'ils l'apprissent, il fallut que Calchas, protégé par Achille, leur révélât la colère d'Apollon et la cause de cette colère. Ajoutons que même après cette révélation, il ne s'agit nullement d'un châtiment quelconque que les Achéens auraient dû infliger à Agamemnon ; et la peste cesse, non pas à cause de ce châtiment, lequel ne se produit ni avant ni après, mais bien par la satisfaction donnée à Apollon. Agamemnon se décide volontairement à restituer Criséis à son père, « parce qu'il veut que le peuple soit sauf et ne périsse pas [FN: § 1983-2] ». Pour se dédommager, il enlève Briséis à Achille. Comment les Thébains pouvaient-ils bien éviter d'être frappés par la peste, puisqu'ils ignoraient entièrement les crimes dont Œdipe s'était involontairement rendu coupable ? Aussi, l'oracle d'Apollon ne leur reproche aucune faute : il prescrit une expiation, comme un médecin prescrit une médecine à son malade [FN: § 1983-3].
§ 1984. Si un peuple souffrait pour les mauvaises actions de son roi, il profitait, en revanche, de ses bonnes actions. Hésiode décrit le bonheur des peuples gouvernés par un roi juste, et leur malheur s'ils sont gouvernés par un roi injuste. Chez lui se mêle l'idée que les actions du roi sont punies ou récompensées sur le peuple, avec l'idée expérimentale que le malheur ou le bonheur du peuple dépend d'un mauvais ou d'un bon gouvernement [FN: § 1984-1].
§ 1985. Les collectivités qui souffraient par la faute d'un de leurs membres pouvaient être composées plus ou moins arbitrairement. La simple compagnie, même accidentelle, des méchants, pouvait nuire. Dans le domaine expérimental, cela peut arriver en de nombreux cas ; par exemple, celui qui néglige les mesures de prudence dans une poudrière peut causer la mort de toutes les personnes qui s'y trouvent. On suppose qu'il en est de même en d'autres cas, où il n'existe pas de preuve expérimentale. Se trouvant sur un navire, au milieu de la tempête, et accusé d'être la cause du malheur commun à tous ses compagnons, Diagoras répondit en montrant d'autres navires également en danger par le fait de la même tempête, et il demanda si ceux qui l'accusaient croyaient que lui, Diagoras, était aussi sur ces navires-là [FN: § 1985-1]. L'observation parait concluante à beaucoup de personnes, mais elle ne l'est pas. Si l'on suppose que l'athéisme de Diagoras pouvait nuire aux gens qui se trouvaient avec lui sur un navire, on peut admettre également qu'il nuisait à tous ceux qui se trouvaient dans son voisinage à lui, Diagoras, fût-ce même sur d'autres navires. Il s'agit là uniquement de plus ou de moins, d'étendre ou de restreindre l'espace où l'impiété de Diagoras agissait pour attirer la tempête.
§ 1986. L'envie des dieux ![]() , qui ne permettait pas à un homme de passer sa vie entièrement heureux, s'étendait à sa descendance et à sa collectivité. Il est singulier que Plutarque, qui reprend Hérodote pour avoir cru à cette envie [FN: § 1986-1], en cite lui-même un exemple dans la vie de Paul-Émile [FN: § 1986-2]. En ce cas comme en d'autres semblables, ce sont les résidus de la IIe classe qui agissent. Paul Émile et ses enfants sont considérés comme un agrégat, et l'on ne songe pas à séparer les enfants du père. L'agrégat ne doit pas être entièrement heureux : il est frappé en l'une de ses parties.
, qui ne permettait pas à un homme de passer sa vie entièrement heureux, s'étendait à sa descendance et à sa collectivité. Il est singulier que Plutarque, qui reprend Hérodote pour avoir cru à cette envie [FN: § 1986-1], en cite lui-même un exemple dans la vie de Paul-Émile [FN: § 1986-2]. En ce cas comme en d'autres semblables, ce sont les résidus de la IIe classe qui agissent. Paul Émile et ses enfants sont considérés comme un agrégat, et l'on ne songe pas à séparer les enfants du père. L'agrégat ne doit pas être entièrement heureux : il est frappé en l'une de ses parties.
§ 1987. D'ordinaire, les théoriciens modernes blâment sévèrement les vieux préjugés, d'après lesquels les vices du père pèsent sur son fils. Ils ne s'aperçoivent pas qu'il existe un phénomène semblable dans notre société, en ce sens que les vices du père profitent au fils et le disculpent [FN: § 1987-1]. Pour le criminel moderne, c'est une vraie chance que d'avoir parmi ses ascendants ou d'autres parents un criminel, un aliéné ou même seulement un alcoolique. Devant les tribunaux, un tel fait lui vaut une diminution de peine, et parfois même le fait acquitter. Désormais, il n'y a presque plus de procès pénal où l'on ne fasse usage de ce moyen de défense. La démonstration métaphysique par laquelle on établit qu'une peine doit être infligée au fils à cause des vices du père, a autant et pas plus de valeur que celle par laquelle on établit que, pour la même raison, la peine dont le fils aurait autrement été frappé, doit être supprimée ou diminuée. Quand on ne trouve aucune excuse au criminel dans les vices de ses ascendants, on a toujours la ressource de la trouver dans les mauvaises actions de la « société ». En n'ayant pas convenablement pourvu au bonheur du criminel, elle a la « responsabilité » du crime. Ensuite, la peine frappe, non pas la société, mais l'un de ses membres, pris au hasard, ou sans rapport aucun avec la faute présumée [FN:§ 1987-2].
§ 1988. La notion de solidarité, en vertu de laquelle les bons subissent la peine des méchants, apparaît aussi çà et là dans l'antiquité. Elle est devenue fondamentale dans le catholicisme. Pour faire concurrence aux I et aux socialistes, Brunetière a beaucoup insisté sur ce dernier point.
§ 1189. (B-3). Bonheur et malheur repoussés hors du monde réel. Au point de vue de la logique formelle, il est impossible de contester l'exactitude de ces solutions. Ainsi que nous l'avons souvent dit et répété, la science expérimentale ne peut en aucune façon s'occuper de ce qui dépasse le domaine expérimental ; aux limites de ce domaine, elle perd toute compétence.
§ 1990. Mais précisément en ce domaine, nous devons rappeler simplement ici qu'on ne saurait admettre l'affirmation de ceux qui s'imaginent que les peines et les récompenses surnaturelles ont été inventées par des gens qui s'en servaient pour maîtriser les hommes. Les notions de ces peines et de ces récompenses existent indépendamment de tout dessein prémédité. Elles font partie des résidus de la persistance des agrégats, pour lesquels la personnalité humaine subsiste après la mort. Les hommes pratiques se sont servis de ces notions, comme ils se servaient d'autres sentiments existant dans la société, et les théoriciens en ont fait usage pour résoudre leurs problèmes. Ils peuvent bien leur avoir donné des formes littéraires, métaphysiques, pseudo-scientifiques : ils ne les ont pas inventées ; ils ont façonné une matière déjà existante, et, comme les hommes pratiques, ils s'en sont servis ensuite à leurs fins.
§ 1991. Maïmonide nous fait connaître la théorie de la secte musulmane des Kadrites et de celle des Mo'tazales [FN: § 1991-1], qui poussent à l'extrême les explications (B-2) et (B-3). En général, on ne va pas si loin, et nous avons de très nombreuses explications mixtes et surtout mal déterminées.
§ 1992. Nous avons d'autres interprétations, semblables aux précédentes. Ce sont celles qui, au lieu de repousser les conséquences d'un acte dans un monde imaginaire, se bornent à les repousser dans le domaine du possible. On dit, par exemple : « Cet homme est heureux, mais il aurait pu l'être davantage ; cet autre est malheureux, mais il évite ainsi un malheur plus grand ». Le domaine du possible est indéfini, et l'on démontre ainsi tout ce qu'on veut. De tout temps, on a fait sur ce sujet d'élégants exercices de rhétorique.
§ 1993. Un ermite blâmait les jugements de Dieu, parce qu'il voyait des gens qui vivaient mal avoir beaucoup de biens, et d'autres qui vivaient bien, souffrir beaucoup de maux. Un ange survint, et le conduisit en un lieu où demeurait un autre ermite, qui, après une longue pénitence, voulait retourner parmi les tentations du monde. L'ange jeta le second ermite dans un précipice. La mort, qui contrastait en apparence avec la bonne vie de cet ermite, en était, au contraire, la récompense, parce qu'il obtenait ainsi la béatitude éternelle [FN: § 1993-1]. Ainsi de suite, l'ange montra au premier ermite d'autres cas semblables, dans lesquels le mal apparent devient un bien réel, ou vice versa.
§ 1994. Que le lecteur ne croie pas que notre temps ne s'adonne plus à ces fables. Quand on cite aux anti-alcooliques les exemples d'hommes parvenus à un grand âge, d'autres très forts dans les travaux matériels ou intellectuels, bien qu'ils aient bu du vin et d'autres boissons alcooliques, ils répondent que s'ils s'en étaient abstenus, ils auraient vécu encore plus longtemps, ils auraient été encore plus remarquables, matériellement et intellectuellement. Un beau type de dominicain de la vertu a dit, dans une conférence : « On cite de grands hommes d'État et de grands capitaines qui n'étaient pas chastes, des guerriers très braves qui ne l'étaient pas non plus ; c'est vrai, mais s'ils avaient été chastes, ils eussent été encore meilleurs ». Les gens qui tiennent de semblables raisonnements, ou mieux ces vains propos, oublient que le fardeau de la preuve incombe à qui émet une affirmation, et qu'à invoquer uniquement des possibilités, on prend facilement des vessies pour des lanternes.
§ 1995. (B-4). On ne réussit pas à trouver une interprétation. Les voies du Seigneur sont insondables [FN:§ 1995-1]. On peut simplement affirmer que nous ne pouvons pas savoir pourquoi un certain acte a telles conséquences, et l'on peut ne pas se soucier de savoir si elles sont « justes » ou « injustes ». Telle paraît être la conclusion du livre de Job, et telle était la doctrine des Ascharites, comme l'expose Maïmonide [FN:§ 1995-2]. À qui n'affirme rien, on ne peut rien objecter. C'est pourquoi il n'y aurait rien à opposer à la personne qui se bornerait à dire qu'elle ne sait rien des voies du Seigneur, si cette personne s'en tenait logiquement à sa doctrine. Mais souvent il n'en est pas ainsi. L'auteur commence par faire voir qu'il connaît très bien les « voies du Seigneur », et c'est seulement lorsqu'il est serré parles objections qu'il proclame que ces voies sont insondables. Dans les raisonnements de Saint Augustin, nous avons de ce procédé un exemple qui peut servir de type. Il est général ; on le trouve souvent chez les théologiens et chez d'autres penseurs [FN:§ 1995-3].
§ 1996. Comme d'habitude, on n'aperçoit pas la contradiction de ceux qui affirment ne pas connaître ce qu'ils prétendent connaître ; c'est parce que le sentiment domine. En somme le raisonnement est du type suivant : « A doit être B ; et si on ne le constate pas, je ne saurais en dire la raison; mais cela ne diminue pas ma foi que A doive être B ». Sous cette forme, la science expérimentale n'a rien à reprendre, pour le motif tant de fois rappelé qu'elle n'a rien à faire avec la foi. Mais souvent la forme, au moins implicite, est différente, et se rapproche du type suivant : « A est B ; et si on ne le constate pas, c'est une illusion, parce qu'en réalité, d'une manière que je ne connais pas, A est B ». Quand A et B sont dans le domaine de l'expérience, cette proposition appartient à la science logico-expérimentale, et celle-ci ne peut admettre que A soit B, si l'on constate que A n’est pas B, et elle ne se soucie pas de savoir si l'on peut connaître ou non la cause de ce fait.
§ 1997. Dans ce cas aussi, ce ne sont pas les théoriciens qui ont inventé que les « voies du Seigneur » sont insondables. Ils ont trouvé dans les populations ce sentiment, qui dépend des résidus de la IIe classe ; ils s'en sont servis tout en donnant à ses manifestations des formes qui leur plaisaient.
§ 1998. De ce genre de solutions se rapproche beaucoup celui des solutions métaphysiques, telles que l'impératif catégorique de Kant. Elles posent en principe une certaine conception du devoir, sans dire ce qu'il en sera de l'individu qui refusera de le remplir, qui n'en tiendra aucun compte. Les contradictions habituelles ne font pas défaut dans ces solutions, car on énonce tout ce qu'il plaît à l'auteur d'imposer, et on tait la réponse aux objections. Un type de ces raisonnements est le suivant. « On doit faire A parce qu'il est une conséquence de B ». Et pourquoi doit-on faire B ? « Parce que c'est une conséquence de C ». Et ainsi de suite, on arrive à cette question : « Pourquoi doit-on faire P ? » On y répond par quelque impératif catégorique. Ces solutions métaphysiques sont généralement à l'usage des théoriciens. Les hommes pratiques et le vulgaire n'y prêtent pas grande attention.
§ 1999. Négation absolue. Pessimisme. Ces solutions sont peu importantes pour l'équilibre social, parce qu'elles ne sont jamais populaires. Elles sont particulièrement usitées par des littérateurs et des philosophes [FN: § 1999-1]. Elles n'ont de valeur que comme manifestations de l'état psychique de certains individus. Dans un moment de découragement beaucoup de gens répètent le mot de Brutus : « Vertu, tu n'es qu'un nom ! » Beaucoup se complaisent à lire les productions pessimistes de Leopardi, comme ils se complaisent à entendre une belle tragédie ; mais ni les premières ni la seconde n'agissent dans une mesure notable sur leurs actes.
§ 2000. Le pessimisme a souvent pour effet de pousser aux jouissances matérielles, et nombre de littérateurs expriment cette idée : « Jouissons tandis que nous sommes en vie, parce qu'après la mort nous ne jouirons plus ». En Russie, après la guerre contre le Japon, il y eut un mouvement révolutionnaire et d'ardents espoirs d'un bel avenir. La révolution domptée et ces espoirs dissipés, il vint un temps de découragement et une propension aux jouissances matérielles.
§ 2001. (D) Négation conditionnelle. On a deux phénomènes différents qui peuvent avoir certains points communs. Le lecteur qui a prêté attention aux nombreux faits que nous avons exposés, et auxquels on en pourrait ajouter facilement un très grand nombre d'autres, a déjà aperçu la solution scientifique des problèmes posés au §1897. Quant au premier de ces problèmes, le fait de suivre avec précision les règles existantes dans une collectivité a certains effets favorables à l'individu, à la collectivité considérés séparément, à l'individu et à la collectivité pris ensemble, et certains autres effets contraires (§2121 et sv.). Ordinairement, les premiers sont plus importants que les seconds. On ne peut connaître les uns et les autres que moyennant une étude de chaque cas particulier. Quant au second problème, il est bon, dans une certaine mesure, que l'on croie toujours favorable à l'individu et à la collectivité le fait de suivre les règles existant dans une collectivité ; qu'il n'y ait là dessus aucun doute ni contestation. D'autre part, cette croyance peut être nuisible dans une certaine mesure ; mais ordinairement les effets favorables l'emportent sur les effets nuisibles. Pour connaître ces effets, il faut une analyse de chaque cas particulier.
Revenant aux problèmes plus généraux exposés au §1897, nous pouvons répéter à la lettre ce que nous avons dit tout à l'heure, en substituant seulement les résidus existant dans une collectivité et leurs conséquences, aux règles indiquées. Il faut ensuite étudier les diverses solutions que donnent de ces problèmes les théologies et les métaphysiques. À l'égard du premier problème, les théologies des religions dites positives et les métaphysiques admettent ordinairement qu'agir suivant les résidus existants sanctionnés par elles, et suivant les conséquences de ces résidus, ne peut avoir que des effets « bons, justes, utiles ». Au contraire, les théologies de la sainte Raison et celles du Progrès proclament qu'agir suivant certains de ces résidus, qualifiés par elles de « préjugés », et les conséquences qu'on en tire, ne peut avoir que des effets « mauvais, injustes et pernicieux ». Comme d'habitude, la science logico-expérimentale n'accepte ni les unes ni les autres de ces affirmations dogmatiques, mais entend discuter chaque cas au moyen de l'expérience, qui seule peut nous faire connaître l'utilité ou le dommage de certaines manières d'agir.
§ 2002. L'étude que nous venons d'accomplir nous offre un excellent exemple de la vanité expérimentale de certaines doctrines, unie à leur grande utilité sociale.
Il y a plus de deux mille ans que les moralistes recherchent quels rapports peuvent exister entre le fait d'observer exactement les règles de la morale, et celui du bonheur ou du malheur qui en résulte pour les individus et les collectivités. Ils n'ont pas encore réussi à trouver une théorie qui concorde avec les faits, ni même à pouvoir en énoncer une qui revête une forme précise, et n'emploie que des termes ne dépassant pas le monde expérimental. Ils ressassent indéfiniment les mêmes choses. Une théorie disparaît, puis renaît, puis reparaît de nouveau, et ces alternances continuent sans trêve ni repos (§616 et sv.).
Aujourd'hui encore, quand les historiens et d'autres adeptes des sciences sociales veulent juger d'après la « morale » les actions des hommes, ils s'abstiennent de dire, comme cela serait pourtant nécessaire, quelle solution du problème indiqué ils acceptent. Ils la laissent implicite, enveloppée dans les nuées du sentiment ; ce qui leur permet de la changer quand cela leur est utile, et souvent d'en avoir successivement deux ou davantage, qui sont contradictoires. Il est facile de comprendre combien peu de valeur logico-expérimentale peuvent avoir des conclusions tirées ainsi de prémisses implicites, incertaines, inconsistantes, nébuleuses. Ces conclusions sont acceptées par accord de sentiments, et non pour d'autres motifs. Les polémiques auxquelles on se livre à leur sujet sont de simples logomachies.
Si l'on compare l'éthique d'Aristote aux éthiques modernes, on voit aussitôt qu'entre elles la différence est beaucoup moindre qu'entre la physique d'Aristote et la physique moderne. Pourquoi cela ?
On ne peut dire que le fait se soit produit parce que les sciences naturelles auraient été étudiées par des hommes d'un plus grand talent que ceux qui ont étudié, l'éthique. Outre que souvent un seul et même auteur, par exemple Aristote, a écrit sur les unes et sur l'autre, il n'est pas possible de trouver dans l'histoire un seul indice de cette hypothétique différence de talent.
On pourrait chercher la cause de la différence de développement de ces disciplines dans les difficultés intrinsèques de leur étude, et dire que la physique, la chimie, la géologie et les autres sciences naturelles ont progressé plus que l'éthique, parce que leur étude est plus facile. Ne nous arrêtons pas à l'observation de Socrate, qui veut qu'elle soit, au contraire, plus difficile [FN: § 2002-1] : c'est une observation qui est vraie, mais seulement pour les raisonnements faits par le sentiment. Mais comment s'expliquer que jusqu'au XVe siècle, à peu près, la physique, la chimie et d'autres sciences semblables n'ont pas fait plus de progrès que l'éthique ? Pourquoi la plus grande facilité supposée à leur étude n'eut-elle aucune influence ? Ces sciences vont de pair avec l'éthique, si même elles ne restent en arrière, tant qu'on emploie dans les unes et les autres la même méthode théologique, métaphysique ou sentimentale. Elles s'en détachent et progressent rapidement, quand les méthodes sont différentes, et que les sciences naturelles font usage de la méthode expérimentale. Il est donc évident que c'est de cette différence des méthodes que provient la différence de progrès de l'éthique et des sciences naturelles.
Nous ne sommes pas encore arrivés au terme des points d'interrogation. Nous devons nous demander : pourquoi cette différence de méthodes ? Le hasard peut l'avoir fait surgir ; mais pourquoi subsiste-t-elle depuis des siècles et persiste-t-elle ? Les Athéniens furent également hostiles à Anaxagore, qui disait que le soleil était une pierre incandescente, et à Socrate, qui prêchait une morale dont ils ne voulaient pas. En des temps plus rapprochés des nôtres, on condamna également les « erreurs » de Copernic, reproduites par Galilée, et les « erreurs » morales des hérétiques. Pourquoi le champ est-il aujourd'hui laissé libre au premier genre d'« erreurs », tandis que le second est condamné, au moins par l'opinion publique, et en partie aussi par le pouvoir public ?
Il est évident que cette différence d'effets est l'indice de forces différentes, elles aussi. Au premier rang de celles-ci apparaît l'utilité des recherches expérimentales portées à la connaissance du vulgaire ou même effectuées par lui ; tandis que, dans les mêmes circonstances, les recherches et les discussions touchant l'éthique peuvent être nuisibles à la société, et parfois même en ébranler les fondements.
Nous avons donc la preuve et la contre-preuve des effets produits quand la vérité expérimentale et l'utilité sociale concordent ou divergent (§73).
§ 2003. PROPAGATION DES RÉSIDUS. Si certains résidus se modifient chez des individus donnés d'une collectivité, cette modification peut s'étendre directement, par imitation. Mais ce cas se distingue très difficilement de celui de l'extension provoquée indirectement par le changement de certaines circonstances, qui produisent la modification des résidus d'abord chez certaines personnes, et peu à peu chez d'autres. Toutefois ou peut facilement reconnaître que ce second cas est beaucoup plus fréquent que le premier, parce qu'on voit les modifications des résidus se combiner avec des modifications des circonstances économiques, politiques et autres.
§ 2004. PROPAGATION DES DÉRIVATIONS. Ici aussi, il y a des cas analogues. Comme les résidus sont parmi les circonstances principales qui déterminent les dérivations, on peut avoir les trois cas suivants : 1° propagation par imitation ou d'une autre manière directe ; 2° propagation à cause des modifications des résidus correspondant aux dérivations : 3° propagation à cause d'autres circonstances qui agissent sur la collectivité.
Il faut prendre garde qu'un même résidu A peut avoir de nombreuses dérivations S, S', S",..., (§2086), et que le choix entre celles-ci peut avoir lieu pour diverses causes, même de peu d'importance, parfois être déterminé uniquement par le caprice, par la mode, par des circonstances insignifiantes. On peut faire une remarque semblable pour les différentes manifestations de certains résidus ou de certains sentiments. Par exemple, on sait assez que de temps à autre une forme quelconque de suicide devient à la mode, et qu'elle manifeste le sentiment de dégoût de la vie [FN:§ 2004-1].
§ 2005. Il suit de là que, contrairement à ce qui a lieu pour les résidus, l'imitation joue un grand rôle dans la propagation des formes des dérivations et de certaines autres manifestations des résidus. Tous ceux qui parlent la même langue expriment par des termes en grande partie semblables les mêmes sentiments. De même, tous ceux qui vivent dans un certain ambiant, qui en subissent les actions multiples, sont poussés à manifester les mêmes sentiments sous des formes en grande partie semblables. La similitude s'étend aux dérivations ou manifestations de résidus différents. Supposons qu'au résidu A correspondent les dérivations S, S', S",..., qu'au résidu B correspondent les dérivations T, T', T",..., qu'au résidu C correspondent les dérivations U, U', U",.... et ainsi de suite. Supposons en outre que S, T, U,. soient semblables en quelque manière, qu'ils soient de même nature, comme aussi S', T',U',.... de même S", T", U",. et ainsi de suite. Cela posé, si maintenant il arrive que, grâce à certaines circonstances, fussent-elles de peu d'importance, on ait choisi S pour manifester le résidu A, il arrivera très facilement que, pour manifester B on choisisse T, pour manifester C on choisisse U, etc. ; c'est-à-dire que l'on choisisse autant de termes de la série semblable S, T, U,... En d'autres circonstances, en un autre temps, on choisira les termes de la série semblable S', T', U',… ; de même pour d'autres séries semblables. C'est précisément ce que l'on constate dans la réalité. Par exemple, nous observons qu'en nu certain temps les dérivations théologiques S, T, U,... sont à la mode, qu'en un autre temps, elles sont remplacées par certaines dérivations métaphysiques S', T', U',. Le temps n'est pas éloigné où était en usage la série des dérivations positivistes, ou celle des dérivations du darwinisme, par lesquelles on expliquait tous les phénomènes et quelques autres par dessus le marché. Les phénomènes concrets sont complexes. L'imitation y joue un rôle plus ou moins important, mais un grand nombre d'autres circonstances y ont part aussi (§1766).
§ 2006. Le marxisme nous offrit une infinité de dérivations semblables S", T", U",. qui
expliquaient tout phénomène social par le « capitalisme » (§1890). Dans ce cas l'imitation est évidente. Ces dérivations manifestent certains résidus qui dépendent surtout de circonstances économiques et sociales ; mais d'autres dérivations auraient pu les manifester tout aussi bien. Le choix des dérivations S", T", U",. se fit principalement par imitation.
§ 2007. Il faut tenir compte de ce fait, lorsqu'on veut, des dérivations remonter aux résidus. Il existe de grands courants sociaux qui produisent des changements généraux dans les dérivations, tandis que les résidus subsistent. Nous avons donné dans cet ouvrage de nombreux exemples de ce phénomène. Une époque peut employer principalement les dérivations S, T, U,... ; une autre les dérivations S', T', U',... Si l'on s'en tient à la forme, il semble qu'il y ait eu un grand changement, que ce soient là vraiment des états distincts de la civilisation ; tandis qu'en somme ce sont seulement des temps où se manifestent, sous des formes différentes, des résidus qui sont les mêmes ou presque les mêmes.
§ 2008. Nous avons là un cas particulier de phénomènes beaucoup plus généraux, que l'on observe quand les dérivations religieuses, éthiques, métaphysiques, mythiques, s'adaptent aux nécessités de la vie pratique. Les théories ne peuvent être entièrement séparées de la pratique. Il faut qu'il y ait entre les premières et la seconde une certaine adaptation, qui se produit par une suite d'actions et de réactions. Ainsi que nous l'avons vu dans tout cet ouvrage, et contrairement à l'opinion courante, particulièrement à l'opinion des éthiques, des littérateurs, des pseudo-savants, l'influence de la pratique sur les théories est, dans les matières sociales, beaucoup plus grande que celle des théories sur la pratique. Ce sont les théories qui s'adaptent à la pratique, plutôt que la pratique aux théories. Mais de la sorte on ne nie pas, – nous l'avons souvent dit et répété, – qu'il y ait aussi une influence des théories sur la pratique. On affirme seulement, ce qui est bien différent, qu'habituellement elle est beaucoup moindre que l'influence de la pratique sur les théories. Par conséquent, le fait de considérer uniquement cette influence donne très souvent une première approximation du phénomène concret, ce que ne donnerait pas la considération exclusive de l'influence des théories sur la pratique. Cette simple observation a pour conséquence de montrer la vanité d'un très grand nombre d'ouvrages consacrés à l'étude des phénomènes politiques et sociaux, et aussi de plusieurs ouvrages d'économie [FN: § 2008-1].
§ 2009. LES INTÉRÊTS. Les individus et les collectivités sont poussés par l'instinct et par la raison à s'approprier les biens matériels utiles, ou seulement agréables à la vie, ainsi qu'à rechercher de la considération et des honneurs. On peut donner le nom d'intérêts à l'ensemble de ces tendances. Cet ensemble joue un très grand rôle dans la détermination de l'équilibre social.
§ 2010. LE PHÉNOMÈNE ÉCONOMIQUE. On trouve une partie très considérable de cet ensemble en économie. Nous devrions traiter ici de cette science, si elle n'avait déjà été l'objet d'ouvrages importants, auxquels il nous suffira de renvoyer. Nous nous bornerons à donner un aperçu des rapports de l'économie avec les autres parties de la sociologie.
§ 2011. L'ÉCONOMIE PURE. De la même manière que le droit pur tire les conséquences de certains principes, l'économie pure tire les conséquences de certaines hypothèses (§825). L'une et l'autre de ces sciences s'appliquent aux phénomènes concrets, pour autant que les hypothèses faites jouent un rôle prépondérant dans ces phénomènes.
L'évolution historique des connaissances humaines se résout en une marche descendante qui, moyennant l'analyse, va du concret à l'abstrait, suivie d'une marche ascendante qui, moyennant la synthèse, remonte de l'abstrait au concret. Partant de la nécessité pratique d'évaluer la surface des champs ou d'autres terres, on descend à des recherches abstraites, telles que celles de la géométrie, de l'arithmétique, de l'algèbre ; de ces recherches abstraites
on remonte à l'art de l'arpenteur, à la géodésie. Nous avons trois anciens traités grecs sur l'économie : deux qui portent le nom d'Aristote, bien qu'un au moins de ceux-ci ne soit pas de cet auteur, et un de Xénophon. Ce sont des considérations pratiques sur l'art du ménage des citoyens ou de la cité. De ces considérations, par une infinité de degrés, on est descendu jusqu'aux abstractions de l'économie pure ; il s'agit maintenant de remonter jusqu'à l'étude des phénomènes concrets ; mais ce n'est pas en s'efforçant de donner aux abstractions obtenues par l'analyse les caractères des économies anciennes qu'on atteindra la connaissance de ces phénomènes : ce n'est pas en tâchant de donner des caractères concrets à la géométrie d'Euclide qu'on est parvenu à la connaissance de l'art de l'arpenteur, ou de la géodésie. La voie suivie en une infinité de cas semblables est entièrement différente ; elle consiste essentiellement en une synthèse de nombreuses théories.
De tout temps il s'est trouvé des gens pour proclamer l'inutilité des recherches abstraites. En un certain sens ces gens ont raison. Le plus souvent, une de ces recherches, isolée des autres, n'a que peu ou point d'utilité directe pour la pratique. Ce n'est que par leur ensemble et aussi par les habitudes intellectuelles qu'elles donnent que ces recherches peuvent être utiles en pratique. Sous ce rapport, l'économie pure, isolée, n'a pas plus d'utilité directe que ne l'ont un grand nombre de théories de la géométrie, de l'arithmétique, de l'algèbre, de la mécanique, de la thermodynamique, etc., théories que l'on enseigne pourtant dans toutes les écoles des ingénieurs. Quant à l'utilité directe, l'étude de l'échange, en économie pure, est semblable à l'étude que l'on fait, dans tous les cours de physique, sur la chute des corps dans le vide. Elle lui ressemble par ses qualités et par ses défauts, par son utilité et par son inutilité. Une plume qui tombe dans l'air ne suit pas mieux la loi de la chute des corps dans le vide, que certains échanges pratiques ne suivent les lois données par l'économie pure. Du premier fait on ne déduit pas l'inutilité de l'étude de la mécanique, pas plus que du second on ne saurait déduire l'inutilité de l'étude de l'économie pure (§87-1).
§ 2012. Comme d'habitude, la théorie est venue après l'art. Les analyses des juris-consultes romains ont suivi les décisions des préteurs. De même, l'œuvre d'Adam Smith a suivi d'innombrables recherches sur des questions pratiques d'économie, et les œuvres de Walras et d'Edgeworth sur l'économie pure sont venues après une infinité d'ouvrages d'économie pratique et théorique.
§ 2013. Supposons certains êtres qui aient des appétits ou des goûts, et qui, à les satisfaire, rencontrent certains obstacles. Que se passera-t-il ? L'économie pure répond à cette question. C'est une science très étendue, à cause de la grande diversité des goûts et de l'extra-ordinaire diversité des obstacles. Les résultats auxquels elle arrive constituent une partie intégrante et très importante de la sociologie ; mais ils n'en constituent qu'une partie, qui, en certains phénomènes, peut même être petite, négligeable, et qui, en tout cas, doit être combinée avec les autres parties, pour nous donner l'image des phénomènes concrets.
§ 2014. L'ÉCONOMIE APPLIQUÉE. De même qu'on passe de la mécanique rationnelle à la mécanique appliquée par l'adjonction de considérations sur les phénomènes concrets, de même on passe de l'économie pure à l'économie appliquée. Par exemple, la mécanique rationnelle nous donne la théorie d'un levier idéal ; la mécanique appliquée nous enseigne à construire des leviers concrets. L'économie pure nous fait connaître le rôle de la monnaie dans le phénomène économique ; l'économie appliquée nous fait connaître les systèmes monétaires existants, ceux qui ont existé, leurs transformations, etc. De la sorte, nous nous rapprochons davantage de la réalité, sans toutefois l'atteindre encore. La mécanique appliquée nous enseigne comment agissent les organes d'une machine à vapeur ; mais il appartient à la thermodynamique de nous apprendre comment agit la vapeur. Ensuite, nous devrons recourir à un grand nombre d'autres considérations, y compris celles de l'économie, pour nous guider dans le choix d'une machine motrice. L'économie appliquée nous fournit d'abondants renseignements sur la nature et sur l'histoire des systèmes monétaires ; mais pour savoir comment et pourquoi ils ont existé, il faut faire appel à d'autres considérations. Laissons de côté la géologie et la métallurgie, qui doivent nous enseigner comment les métaux précieux furent obtenus. Mais en nous bornant à la considération des forces sociales seules, il nous reste encore à savoir comment et pourquoi certains gouvernements ont falsifié la monnaie, et d'autres pas ; comment le monométallisme or anglais existe en même temps que le bimétallisme boiteux français, le monométallisme argent chinois, la circulation de papier en un grand nombre d'États. La monnaie est un instrument des échanges, et sous ce rapport son étude appartient à l'économie ; mais c'est aussi un instrument pour prélever des impôts, sans qu'une grande partie du public s'en aperçoive ; et sous ce rapport l'étude de la monnaie appartient à différentes branches de la sociologie. Remarquons que nous avons choisi exprès un phénomène où la partie économique est de beaucoup prépondérante. Pour d'autres phénomènes, l'écart entre la théorie et la pratique est plus apparent. L'économie pure nous enseigne que la protection douanière a pour effet direct (prenons garde à cette restriction) une destruction de richesse. L'économie appliquée confirme cette déduction ; mais ni l'une ni l'autre de ces sciences ne peut nous dire pourquoi le libre-échange anglais existe en même temps que le protectionnisme américain, le protectionnisme allemand et tant d'autres, différents par leur intensité et leurs modalités. Nous comprenons encore moins comment il se fait que la prospérité de l'Angleterre se soit accrue avec le libre-échange, et que la prospérité de l'Allemagne se soit accrue au contraire avec la protection (§2184 et sv.).
§ 2015. Les gens qui, d'une part, entendaient dire que les théories économiques démontraient que le protectionnisme avait pour effet une destruction de richesse, et qui, d'autre part, voyaient prospérer les pays où ce protectionnisme était en vigueur, n'y comprenaient plus rien. Ne connaissant pas les causes réelles de cette contradiction, ils en supposaient d'imaginaires. Les uns déclaraient erronées les théories économiques, qu'ils n'étaient même pas capables de comprendre ; d'autres allaient plus loin, et proclamaient la vanité et l'erreur de toute théorie sociale... sauf de la leur, bien entendu ; d’autres imitaient don Quichotte, qui savait préparer un baume, excellent pour guérir les blessures des chevaliers, mais nuisible aux écuyers ; ils exhibaient une économie nationale quelconque, propice à eux et à leurs amis ; d'autres, ne pouvant trouver la raison de ce qui existait, rêvaient à ce qui aurait dû exister ; d'autres encore abandonnaient le terrain semé d'obstacles de l'économie, et pataugeaient dans les marais de l'éthique et de la métaphysique ; d'autres enfin divaguaient sur d'autres voies diverses, toutes également éloignées de la seule qui peut conduire au but, et qu'on trouve dans l'étude expérimentale des phénomènes sociaux qui agissent sur le phénomène économique et le modifient.
§ 2016. On peut décrire en quelques mots la voie suivie, au moins en partie, par les économistes classiques, en disant que la science s'appliqua à étudier non seulement ce qui était, mais encore ce qui devait être. Elle substitua partiellement une prédication à l'étude objective des faits. Cette œuvre est excusable chez les premiers économistes. Il eût même été difficile de faire autrement à l'époque d'Adam Smith et de J.-B. Say. Il semblait alors que toute la civilisation se renouvelât matériellement et intellectuellement. Le passé était misère, ignorance, préjugés ; l'avenir serait prospérité, savoir, œuvres rationnelles : une religion nouvelle fascinait les esprits humains, et la sainte Science repoussait dans les gouffres de l'enfer les actions non-logiques ; elle ne laissait de place dans l'Olympe qu'à la logique et à la très sainte Raison. À ces motifs de caractère général, s'en ajoutaient d'autres, de caractère particulier, parce que la science économique avait fait tout d'un coup un pas de géant, comparable à ceux faits par la physique et par la chimie. Il semblait donc naturel que l'analogie dût se poursuivre, que seule l'ignorance pût soutenir les anciennes divagations économiques, physiques et chimiques, contre les nouvelles théories, et que les doctrines économiques du passé dussent disparaître devant les nouvelles, comme la théorie du phlogistique avait disparu devant la théorie des équivalents. C'est pourquoi le rôle principal des économistes consistait à dissiper cette ignorance en enseignant et en prêchant la vérité. Cette conception parut trouver une confirmation expérimentale décisive et splendide dans le succès de la ligue de Cobden. Voilà, pouvait-on dire, que les prévisions faites sont vérifiées. L'éloquence savante de Cobden et de ses amis a dissipé les ténèbres de l'ignorance ; elle a vaincu et défait le protectionnisme ; elle a institué le libre-échange, dont l'Angleterre a retiré ensuite une incroyable prospérité. Partout surgissaient des ligues imitées de celle de Cobden. Il semblait vraiment que toute l'organisation économique dût être renouvelée dans le sens que voulaient les économistes. Mais aucune de ces ligues n'obtint des résultats même vaguement sem blables à ceux obtenus par la ligue de Cobden. Pendant quelque temps on put espérer expliquer ce fait par la difficulté qu'on rencontre à instruire les ignorants. Mais maintenant cette excuse n'est plus valable ; il est manifeste que si ces ignorants n'apprennent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas apprendre. On a aussi accusé les politiciens qui les induisent en erreur par des artifices trompeurs. En effet, cela concorde en grande partie avec les faits ; mais il reste à expliquer comment et pourquoi les politiciens ont ce pouvoir. C'est précisément là que se pose une question sociologique qui domine la question économique.
§ 2017. Les économistes classiques se préoccupaient de ce qui devait être. Ils le déterminaient par la logique, en partant d'un petit nombre de principes ; et comme la logique et ces principes s'appliquent à tout le globe terrestre, ils trouvaient des lois qui avaient aussi cette application étendue. Mais étant donné que leurs conclusions étaient démenties par les faits, il fallait trouver où était l'erreur. Comme d'habitude, on crut la trouver dans les prémisses et dans la théorie ; on les déclara fausses, tandis qu'elles sont simplement incomplètes. On voulut les rejeter entièrement, tandis qu'il faut seulement les compléter.
§ 2018. Supposons un géomètre qui découvre le théorème du carré de l'hypothénuse. Il conclut avec raison qu'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit ont respectivement 3 et 4 mètres aura une hypothénuse de 5 mètres. Il veut mettre en pratique les résultats de la théorie, et dit : « Quelle que soit la manière dont on suppose qu'on mesure ces trois côtés, on trouvera toujours les nombres indiqués ». À Paris, un observateur veut vérifier cette proposition. Il prend une ficelle, et, sans l'étirer du tout, il mesure deux côtés de l'angle droit, l'un de 3 et l'autre de 4 mètres, puis tire la ficelle autant qu'il peut, et trouve 4 m 60 pour l'hypothénuse. À Londres, un autre observateur procède de façon inverse, et, pour les côtés 3 et 4, il trouve une hypothénuse de 5 m 40. Les résultats de la théorie ne concordent pas avec les faits. Pour rétablir l'accord, il faut simplement ajouter à la théorie géométrique des considérations sur les manières de mesurer les segments de droite. Ces considérations pourront donner lieu à différentes théories, et l'ensemble de celles-ci et de la théorie géométrique nous permettra d'expliquer et de prévoir les faits tels que ceux de Paris et de Londres.
§ 2019. Au contraire, on voit surgir certaines personnes qui pour rétablir l'accord avec les faits, nient sans autre l'existence de la géométrie, rejettent le théorème du carré de l'hypothénuse, parce qu'il est obtenu au moyen d'un « abus » de la méthode déductive, et parce qu'il ne tient pas dûment compte de l'éthique, laquelle est pourtant si importante pour les hommes. D'une manière subordonnée, même si ce théorème pouvait exister, elles nient qu'il puisse être le même à Paris et à Londres ; elles proclament vouloir substituer à la géométrie « universelle » autant de géométries « nationales », différentes suivant les pays, et elles concluent qu'au lieu de s'occuper de théories géométriques, il faut faire simplement l'« histoire » de toutes les mesures qu'on a jamais faites des triangles rectangles. Si, en en mesurant un, quelque enfant se mouche et se trompe dans le compte des centimètres, ils écrivent une belle dissertation sur l' « éthique » de l'acte de se moucher, et décrivent longuement l'enfant, nous disant s'il avait les cheveux rouges ou noirs, et nous donnant force renseignements précieux du même genre. Telle est l'image très peu déformée d'un grand nombre d'ouvrages de l'« école historique » en économie politique (§1790 et sv.).
§ 2020. Cette discipline eut quelque temps du succès pour des motifs étrangers à la science logico-expérimentale. Ce fut une réaction des sentiments nationalistes contre les sentiments cosmopolites, et en général un retour offensif des sentiments de la persistance des agrégats (IIe classe) contre les sentiments de l'instinct des combinaisons (Ie classe). Sa partie éthique donna naissance au socialisme de la chaire, qui satisfit les désirs de certains nationalistes bourgeois, lesquels ne voulaient pas aller jusqu'aux doctrines cosmopolites de Marx. Mais elle eut aussi des effets en rapport avec la science logico-expérimentale, bien qu'elle y demeurât étrangère.
En opposant une autre erreur à celle de l'économie classique, elle les décela toutes les deux.
Directement, par suite de ses tendances éthiques, elle était moins expérimentale que l'école classique ; mais, indirectement, grâce à l'étude de l'histoire, elle servit à désagréger un édifice qui était en train de dépasser l'expérience pour s'élever dans les régions de la métaphysique.
§ 2021. Marx aussi estima se rapprocher de la réalité en rejetant la théorie de la valeur, et en substituant à la théorie, très imparfaite, qui avait cours en son temps, une autre, encore plus imparfaite, qui est en somme une mauvaise, très mauvaise copie de la théorie de Ricardo. Par la théorie de la plus-value, il ajouta, lui aussi, des considérations éthiques là où elles n'avaient que faire. Mais son œuvre sociologique est supérieure à celle de l'école historique. Il contribua, lui aussi, à désagréger l'édifice éthico-humanitaire de l'économie classique, élevé à l'usage de la bourgeoisie. La conception de la « lutte des classes » montra l'absolue nécessité d'ajouter de nouvelles notions à celles de l'économie, pour arriver à la connaissance du phénomène concret. L'éthique de Marx n'est, en somme, pas meilleure que l'éthique bourgeoise ; mais elle est différente. Cela suffit pour mettre sur la voie qui mène à la connaissance de leur erreur commune.
§ 2022. Sous un grand nombre d'autres formes qu'il serait trop long de rappeler ici, le besoin se manifesta, pour se rapprocher de la réalité, d'ajouter de nouvelles considérations à celles qui étaient usitées en certaines théories économiques. Nous avons déjà dit un mot de l'une de ces formes (§38, 1592) en faisant allusion au dessein d'introduire ces considérations grâce à l'indétermination du terme valeur. En ce cas, l'erreur affecte moins le but que le moyen. Celui-ci est si indirect, et conduit par une voie si longue, avec une telle abondance de détours souvent inextricables et bordés de précipices, qu'il n'est pas possible d'atteindre le but. Ce moyen ressemble à celui qu'emploierait une personne qui se proposerait d'étudier toute la grammaire latine en partant de l'étude de la conjonction et. Il est vrai que tout chemin mène à Rome ; mais celui-ci est vraiment bien long et peu praticable.
Plusieurs économistes voient maintenant que leur science donne des résultats qui divergent plus ou moins du phénomène concret, et comprennent par intuition la nécessité de la perfectionner, mais ils se trompent sur la voie à suivre pour accomplir leur dessein. Ils s'obstinent à vouloir tirer de leur science seule ce qui est nécessaire pour se rapprocher du phénomène concret (§2011) ; tandis qu'au contraire il faut recourir à d'autres sciences, traiter spécialement du phénomène concret, et non accessoirement, à l'occasion d'un problème économique. Ils veulent modifier, parfois détruire, au lieu d'ajouter. C'est pourquoi, de même que nous voyons l'écureuil tourner dans sa roue, nous les voyons ergoter indéfiniment sur la valeur, sur le capital, sur l'intérêt du capital, etc., répétant, pour la centième fois, des choses banales, cherchant quelque nouveau « principe » dont ils puissent faire sortir une économie meilleure. Malheureusement, ce n'est que pour un petit nombre d'entre eux que meilleur veut dire mieux en accord avec les faits. Pour le plus grand nombre, et de beaucoup, il veut dire, au contraire, mieux en accord avec leurs sentiments. Même dans la première hypothèse, cette recherche est vaine, du moins pour le moment. Tant que la science n'a pas fait beaucoup plus de progrès, il importe moins de s'occuper des principes économiques que de l'enchevêtrement des résultats de l'économie avec ceux des autres sciences sociales. Mais c'est ce dont beaucoup ne se soucient nullement, parce que c'est là une étude longue, fatigante, qui exige la connaissance d'un grand nombre de faits ; tandis qu'au contraire, quiconque a un brin d'imagination, du papier et une plume à sa disposition, peut écrire une dissertation sur les « principes ».
Ces considérations s'appliquent aussi à un grand nombre d'autres doctrines (§2269, 2273) qui ont pour but de donner des théories des phénomènes de la société humaine. Une science sociale quelconque, si elle n'est pas purement, exclusivement descriptive, si elle ne se borne pas à dire : « En tel et tel cas on a observé A et, en même temps, B, C, D... », en s'abstenant rigoureusement de tirer la moindre conséquence de cette coïncidence et de la juger en aucune façon, repose nécessairement sur la solution de problèmes appartenant à la catégorie dont le type général est : « En quels rapports mutuels se trouvent A, B, C... ? » Et ce type ne diffère que par la forme du suivant, qui considère les mouvements virtuels (§136) : « Si A apparaît où il n'était pas, ou bien est modifié là où il était, quels autres faits B, C voit-on apparaître ou se modifier ? Si B apparaît où il n'était pas, ou bien est modifié là où il était, quels autres faits A, C..., voit-on apparaître ou se modifier ? » Et ainsi de suite pour C, D [FN:§ 2022-1]. Pour mieux voir la chose, réduisons le cas général des rapports au cas particulier d'un rapport de cause à effet entre A et B, C. Il est bien évident que toute science sociale qui se propose d'étudier les effets de l'intervention de la cause A doit être en mesure d'en connaître les effets B, C Ce problème ne diffère du suivant que par la forme : Si l'on fait intervenir ou si l'on modifie A, quels effets B, C apparaîtront, ou se modifieront ?
C'est aux différentes branches des sciences sociales et à leur synthèse, exprimée par la sociologie, que nous pouvons demander la solution de tels problèmes. Mais un grand nombre des auteurs qui étudient les sciences sociales, bien loin d'avoir une idée, même très vaguement approchée, des solutions, ne sont pas en mesure de comprendre comment se posent ces problèmes, dont, le plus souvent, ils ignorent jusqu'à l'existence.
Le but de leurs recherches est généralement de trouver des arguments pour défendre une doctrine qui leur est dictée par la coterie intellectuelle à laquelle ils appartiennent ou dont ils recherchent la faveur, par les gouvernements qui les emploient ou dont ils désirent la bienveillance, les partis politiques ou sociaux auxquels ils se rattachent [FN: § 2022-2], les croyances théologiques, métaphysiques, ethniques, patriotiques ou autres qu'ils partagent. Ils plaident plutôt qu'ils ne jugent impartialement. Si A leur plaît, il s'agit de montrer que tous ses effets ne peuvent qu'être « favorables », s'il leur déplaît, « défavorables » ; sans que d'ailleurs on définisse ces termes : favorables, défavorables, en indiquant, au moins, quelle utilité (§ 2111 et sv.) on a en vue [FN:§ 2022-3].
Parfois, les meilleurs de ces auteurs se cantonnent dans une partie de la science, et s'efforcent d'éviter toute incursion dans les parties dont l'accès leur semble dangereux. Ainsi firent de nombreux économistes classiques, proclamant hautement qu'ils s'abstenaient rigoureusement de traiter les questions politiques [FN: § 2022-4]. D'autres arrivent à un résultat analogue, simplement parce que, soit par paresse d'esprit, influence des préjugés, ignorance, ou toute autre cause, ils acceptent des solutions toutes faites pour certaines matières [FN: § 2022-5]. Beaucoup d'économistes admettent les solutions de la morale courante, sans les soumettre au moindre examen. Ils ont accepté la sainteté de la propriété quiritaire ; et maintenant que le vent a tourné, ils se laissent dominer par les conceptions d'un socialisme plus ou moins mitigé. Beaucoup d'auteurs supposent la toute puissance de l'entité par eux nommée État, surtout de l'État éthique ; ils étudient avec soin des effets insignifiants des incidences d'un impôt, et négligent ceux, bien plus importants, qui permettent à un gouvernement de l'établir, ou l'en empêchent ; ils se perdent en des calculs compliqués d'intérêt composé, supposent que les épargneurs se décident par des raisonnements que ceux-ci n'ont jamais faits, et oublient les effets de l'impôt sur la circulation des élites, et les effets de cette circulation sur l'impôt. Il n'y a pas bien longtemps qu'ils avaient pour article de foi que l'impôt « doit » être proportionnel ; actuellement, leurs successeurs ont pour article de foi qu'il « doit » être progressif ; le plus souvent, les gens qui s'occupent de ces matières ignorent que de tels changements de doctrines sont en état de dépendance avec les autres faits sociaux ou bien ils se trompent lourdement à ce sujet.
De la sorte, et de bien d'autres encore, on aboutit à négliger, à méconnaître la mutuelle dépendance des phénomènes sociaux ; ce qui est actuellement une des erreurs les plus nuisibles au progrès expérimental des sciences sociales.
§ 2023. Pour résoudre des questions semblables à celle que nous avons posée au §2014, il est nécessaire de considérer, non pas le phénomène économique seul, mais tout le phénomène social, dont ce premier phénomène ne constitue qu'une partie. L'état complexe X d'un pays peut évidemment être décomposé en deux autres états : l'un économique A, et l'autre non-économique B. Supposons que l'état économique A devienne A'. Si nous admettons que la connaissance de cet état A' suffise pour connaître l'état social complexe X’ qui suit ce changement, nous admettons par là même que A et B sont indépendants, que l'on peut faire varier A sans faire varier B, et vice-versa. Si, au contraire, nous n'admettons pas cela, nous ne pouvons pas non plus admettre que, pour connaître complètement X’, la connaissance de A' suffise. La connaissance de ce que devient B, c'est-à-dire de B' ; est nécessaire ; et l'on ne peut l'obtenir si l'on ne connaît pas la mutuelle dépendance de A et de B.
Plusieurs économistes ont raisonné, non par analyse et par abstraction, mais sur l'ensemble du phénomène concret, comme si A et B étaient indépendants. Ils ont cru pouvoir étudier A sans se soucier de B. On ne saurait en faire un reproche à ceux qui ont constitué la science, car il faut étudier les questions l'une après l'autre ; et l'étude de l'action de la partie A seule est une préparation nécessaire à l'étude de l'action combinée de A et de B. Les partisans de l'interprétation matérialiste de l'histoire eurent le grand mérite de découvrir la dépendance de A et de B ; mais ils commirent l'erreur de prétendre que cette dépendance était un rapport par lequel A était la cause de B. À eux non plus on ne peut reprocher trop cette erreur, car avant de trouver la forme réelle de la dépendance entre A et B, il était nécessaire d'avoir l'idée de l'existence d'une telle dépendance. Maintenant que le progrès de la science a mis en lumière la dépendance de A et de B, les économistes qui persistent à l'ignorer ne sont plus excusables, ni les auteurs qui persistent à donner à cette dépendance une forme qu'elle n'a pas en réalité. Nous devons étudier ici le phénomène complexe de la société, en tenant compte de la mutuelle dépendance de A et de B, dans sa forme réelle. C'est ce que nous ferons au chapitre suivant.
§ 2024. On a beaucoup fait pour l'étude du phénomène économique; et l'œuvre ainsi accomplie nous sera très utile pour arriver à la connaissance de cette partie spéciale du phénomène social, considérée indépendamment des autres. Pour utiliser les ouvrages dits de science économique, il convient que nous en éliminions tout ce qui se rapporte à l'éthique, directement ou indirectement, ne fût-ce que parce que les auteurs, ne traitant pas à fond cette partie de leur sujet, acceptent et emploient des expressions indéterminées, dont on peut tirer tout ce qu'on veut, ainsi que nous l'avons fait voir tout au long dans les chapitres précédents. Nous devons aussi éliminer tout ce qui a la nature de conseils, de recommandations, de prêches adressés en vue de pousser les hommes à certaines œuvres pratiques. C'est une matière étrangère à la science, et qui doit en demeurer séparée si l'on veut éviter le danger de tomber en de graves erreurs.
§ 2025. HÉTÉROGÉNÉITÉ SOCIALE ET CIRCULATION ENTRE LES DIFFÉRENTES PARTIES [FN: § 2025-1]. Plusieurs fois déjà nous nous sommes trouvés en présence de cette hétérogénéité, et nous aurons à nous en occuper davantage, maintenant que nous passerons à l'étude des conditions de l'équilibre social ; il est donc nécessaire que nous en traitions spécialement.
On pourrait étudier séparément l'hétérogénéité de la société et la circulation entre les différents groupes sociaux ; mais comme, dans la réalité, les phénomènes correspondants sont unis, il sera bon de les étudier ensemble, afin d'éviter des répétitions. Que cela plaise ou non à certains théoriciens, il est de fait que la société humaine n'est pas homogène : que les hommes sont différents physiquement, moralement, intellectuellement. Ici, nous voulons étudier les phénomènes réels. Donc, nous devons tenir compte de ce fait. Nous devons aussi tenir compte de cet autre fait : que les classes sociales ne sont pas entièrement séparées, pas même dans les pays où existent les castes, et que, dans les nations civilisées modernes, il se produit une circulation intense entre les différentes classes. Il est impossible de considérer dans toute son ampleur le sujet de la diversité des multiples groupes sociaux [FN:§ 2025-2], et les façons si nombreuses dont ils se mélangent. Par conséquent, comme d'habitude, ne pouvant obtenir le plus, il faut se contenter d'avoir le moins, et s'efforcer de simplifier le problème, afin de le rendre plus abordable. C'est un premier pas dans une voie que d'autres pourront poursuivre. Nous considérerons le problème seulement en rapport avec l'équilibre social, et nous tâcherons de réduire le plus possible le nombre des groupes et des modes de circulation, en mettant ensemble les phénomènes qui se présentent comme analogues en quelque façon [FN: § 2025-3].
§ 2026. LES ÉLITES ET LEUR CIRCULATION [FN: § 2026-1]. Commençons par donner du phénomène une définition théorique, aussi précise que possible ; ensuite, nous verrons quelles considérations pratiques nous pourrons y substituer, dans une première approximation. Négligeons tout à fait, pour le moment, la considération de la nature bonne ou mauvaise, utile ou nuisible, louable ou blâmable des différents caractères des hommes, et portons notre attention uniquement sur le degré de ces caractères. Autrement dit, sont-ils de peu d'importance, moyens ou grands ? et plus précisément, quel indice quantitatif peut-on assigner à chaque homme, eu égard au degré du caractère considéré ?
§ 2027. Supposons donc qu'en toutes les branches de l'activité humaine, on attribue à chaque individu un indice qui indique ses capacités, à peu près de la manière dont on donne des points aux examens, dans les différentes matières qu'enseignent les écoles. Par exemple, à celui qui excelle dans sa profession, nous donnerons 10. À celui qui ne réussit pas à avoir un seul client, nous donnerons 1, de façon à pouvoir donner 0 à celui qui est vraiment crétin. À celui qui a su gagner des millions, que ce soit bien ou mal, nous donnerons 10. À celui qui gagne des milliers de francs, nous donnerons 6. À celui qui arrive tout juste à ne pas mourir de faim, nous donnerons 1. À celui qui est hospitalisé dans un asile d'indigents, nous donnerons 0. À la femme politique, telle l'Aspasie de Périclès, la Maintenon de Louis XIV, la Pompadour de Louis XV, qui a su capter les bonnes grâces d'un homme puissant, et qui joue un rôle dans le gouvernement qu'il exerce de la chose publique, nous donnerons une note telle que 8 ou 9. À la gourgandine qui ne fait que satisfaire les sens de ces hommes, et n'a aucune action sur la chose publique, nous donnerons 0. À l'habile escroc qui trompe les gens et sait échapper aux peines du code pénal, nous attribuerons 8, 9 ou 10, suivant le nombre de dupes qu'il aura su prendre dans ses filets, et l'argent qu'il aura su leur soutirer. Au pauvre petit escroc qui dérobe un service de table à son traiteur et se fait encore mettre la main au collet par les gendarmes, nous donnerons 1. À un poète comme Musset, nous donnerons 8 ou 9, suivant les goûts. À un rimailleur qui fait fuir les gens en leur récitant ses sonnets, nous donnerons 0. Pour des joueurs d'échecs, nous pourrons avoir des indices plus précis en nous fondant sur le nombre et le genre des parties qu'ils ont gagnées. Et ainsi de suite, pour toutes les branches de l'activité humaine.
§ 2028. Prenons garde que nous traitons d'un état de fait, et non d'un état virtuel. Si quelqu'un se présente à l'examen d'anglais en disant : « Si je voulais, je pourrais savoir très bien l'anglais. Je ne le sais pas, parce que je n'ai pas voulu l'apprendre », l'expert répondra : « Le motif pour lequel vous ne le savez pas ne m'importe nullement : vous ne le savez pas, je vous donne 0 ». Si, de même, on disait : « Cet homme ne vole pas, non parce qu'il ne saurait pas, mais parce qu'il est un honnête homme », nous répondrons : « Très bien, nous l'en louons, mais comme voleur nous lui donnons 0 ».
§ 2029. Il est des gens qui vénèrent Napoléon Ier, comme un dieu ; il en est qui le haïssent comme le dernier des malfaiteurs. Qui a raison ? Nous ne voulons pas résoudre cette question à propos d'un sujet tout à fait différent. Bon ou mauvais, il est certain que Napoléon Ier n'était pas un crétin, ni même un homme insignifiant, comme il y en a des millions. Il avait des qualités exceptionnelles, et cela suffit pour que nous le placions à un degré élevé. Mais par là nous ne voulons nullement préjuger des questions qu'on pourrait poser sur l'éthique de ces qualités ou sur leur utilité sociale.
§ 2030. En somme, comme d'habitude, nous faisons ici usage de l'analyse scientifique, qui sépare les sujets et les étudie l'un après l'autre. Toujours comme d'habitude, à la rigueur qu'on obtiendrait en considérant des variations insensibles de nombres donnés, il faut substituer l'approximation des variations brusques de grandes classes. Ainsi dans les examens, on distingue les candidats reçus de ceux qui ne le sont pas ; ainsi, au point de vue de l’âge, on distingue les enfants, les jeunes gens, les vieillards.
§ 2031. Formons donc une classe de ceux qui ont les indices les plus élevés dans la branche où ils déploient leur activité, et donnons à cette classe le nom d'élite. Tout autre nom et même une simple lettre de l'alphabet, seraient également propres au but que nous nous proposons (§119).
§ 2032. Pour l'étude à laquelle nous nous livrons, celle de l'équilibre social, il est bon encore de diviser en deux cette classe. Nous mettrons à part ceux qui, directement ou indirectement, jouent un rôle notable dans le gouvernement ; ils constitueront l'élite gouvernementale. Le reste formera l'élite non-gouvernementale [FN: § 2032-1].
§ 2033. Par exemple, un célèbre joueur d'échecs fait certainement partie de l'élite. Non moins certainement, ses mérites de joueur d'échecs ne lui ouvrent pas la voie pour exercer une influence dans le gouvernement ; et par conséquent, si d'autres de ses qualités ne viennent à son aide, il ne fait pas partie de l'élite gouvernementale. Les maîtresses des souverains absolus ou d'hommes politiques très puissants font souvent partie de l'élite, soit à cause de leur beauté, soit par leurs dons intellectuels. Mais seule une partie d'entre elles, qui avaient les aptitudes spéciales qu'exige la politique, jouèrent un rôle dans le gouvernement.
§ 2034. Nous avons donc deux couches dans la population : 1° la couche inférieure, la classe étrangère à l'élite ; nous ne rechercherons pas, pour le moment, l'influence qu'elle peut exercer dans le gouvernement ; 2° la couche supérieure, l'élite, qui se divise en deux : (a) l'élite gouvernementale ; (b) l'élite non-gouvernementale.
§ 2035. En réalité, il n'y a pas d'examens pour assigner à chaque individu sa place dans ces différentes classes. On y supplée par d'autres moyens : par certaines étiquettes qui remplacent l'examen tant bien que mal. De semblables étiquettes existent aussi là où il y a des examens. Par exemple, l'étiquette d'avocat désigne un homme qui devrait connaître le droit, et qui souvent le connaît, mais qui parfois n'y connaît rien. D'une manière analogue, dans l'élite gouvernementale se trouvent ceux qui portent l'étiquette de fonctions politiques d'un certain rang ; par exemple : ministre, sénateur, député, chef de service au ministère, président de cour d'appel, général, colonel, etc., sauf les exceptions inévitables de ceux qui ont réussi à se faufiler parmi les précédents sans posséder les qualités correspondant à l'étiquette qu'ils ont obtenue.
§ 2036. Ces exceptions sont beaucoup plus considérables que pour les avocats, les médecins, les ingénieurs, ou pour ceux qui se sont enrichis par leur propre habileté, ou encore pour ceux qui font preuve de talent en musique, en littérature, etc. Le motif en est, entre autres, qu'en toutes ces branches de l'activité humaine les étiquettes sont obtenues directement par chaque individu, tandis que pour l'élite une partie des étiquettes sont héréditaires ; par exemple celles de la richesse. Autrefois, il y en avait aussi d'héréditaires dans l'élite gouvernementale. Aujourd'hui, telles sont celles des souverains. Mais si l'hérédité directe a disparu, l'hérédité indirecte demeure puissante, et celui qui a hérité un grand patrimoine est facilement nommé sénateur, en certains pays, ou se fait élire député en payant les électeurs et en les adulant, si besoin est, par des professions de foi archidémocratiques, socialistes, anarchistes. La richesse, la parenté, les relations, sont utiles aussi en beaucoup d'autres cas, et font donner à qui ne devrait pas l'avoir l'étiquette de l'élite en général ou de l'élite gouvernementale en particulier.
§ 2037. Là où l'unité sociale est la famille, l'étiquette du chef de famille profite aussi à tous ceux qui la composent. À Rome, celui qui devenait empereur élevait généralement ses affranchis à l'élite, souvent même à l'élite gouvernementale. Pourtant, un nombre plus on moins grand de ces affranchis qui jouaient un rôle dans le gouvernement possédaient des qualités, bonnes ou mauvaises, grâce auxquelles l'étiquette qu'ils avaient obtenue par la faveur de César se trouvait à sa place. Dans nos sociétés, l'unité sociale est l'individu ; mais la situation qu'il occupe dans la société profite aussi à sa femme, à ses enfants, à sa parenté, à ses amis.
§ 2038. Si toutes ces déviations du type étaient peu importantes, on pourrait les négliger, comme on les néglige en pratique, dans les cas où, pour exercer une fonction, un diplôme est exigé. On sait qu'il est des personnes qui possèdent ces diplômes sans les mériter ; mais enfin l'expérience montre que dans l'ensemble on peut ne pas tenir compte de ce fait.
§ 2039. On pourrait encore, au moins sous certains aspects, négliger ces déviations, si elles demeuraient presque constantes ; c'est-à-dire si la proportion variait peu ou point, entre les gens qui possèdent l'étiquette d'une classe sans avoir les qualités correspondantes, et le total de la classe.
§ 2040. Mais il n'en est pas ainsi ; les cas réels que nous devons considérer dans nos sociétés diffèrent de ces deux-là. Les déviations sont trop nombreuses pour être négligées. Leur nombre est variable ; et de cette variation résultent des phénomènes d'une grande importance pour l'équilibre social. Il est donc nécessaire que nous les étudiions en particulier.
§ 2041. En outre, il faut considérer la manière dont les divers groupes de la population se mélangent. Celui qui passe d'un groupe à un autre y apporte généralement certaines tendances, certains sentiments, certaines aptitudes qu'il a acquis dans le groupe dont il vient. Il faut tenir compte de cette circonstance.
§ 2042. On a donné le nom de CIRCULATION DES ÉLITES à ce phénomène, dans le cas particulier où l'on ne considère que deux groupes, l'élite et le reste de la population.
§ 2043. En conclusion, nous devons surtout porter notre attention : 1° dans un même groupe, sur la proportion entre l'ensemble du groupe et le nombre de personnes qui en font nominalement partie, sans toutefois posséder les caractères exigés pour en faire effectivement partie ; 2° entre différents groupes : sur les manières dont s'effectuent les passages d'un groupe à l'autre, et sur l'intensité de ce mouvement, c'est-à-dire sur la vitesse de la circulation.
§ 2044. Il faut remarquer que cette vitesse de circulation doit être considérée, non seulement d'une manière absolue, mais aussi par rapport à l'offre et à la demande de certains éléments. Par exemple, un pays qui vit toujours en paix a besoin de peu de soldats dans la classe gouvernante, et la production des soldats peut être exubérante en proportion des besoins. Survient un état de guerres continuelles ; il faut beaucoup de soldats. La production, bien que restant la même, peut être insuffisante pour les besoins [FN: § 2044-1]. Notons en passant que ce fut l'une des causes de la destruction de nombreuses aristocraties.
§ 2045. Autre exemple. Dans un pays où le commerce et l'industrie sont peu développés, la production d'individus possédant à un haut degré les qualités requises pour ces genres d'activité est exubérante. Le commerce et l'industrie se développent : cette production, tout en restant la même, ne suffit plus aux besoins.
§ 2046. Il ne faut pas confondre l'état de droit avec l'état de fait ce dernier seul, ou presque seul, est important pour l'équilibre social. Il y a de très nombreux exemples de castes fermées légalement, et dans lesquelles, en fait, se produisent des infiltrations souvent assez considérables. D'autre part, à quoi sert qu'une caste soit légalement ouverte, si les conditions de fait qui permettent d'y entrer font défaut ? Si tous ceux qui s'enrichissent font partie de la classe gouvernante, mais que personne ne s'enrichisse, c'est exactement comme si cette classe était fermée ; et si peu de gens s'enrichissent, c'est comme si la loi mettait de grands obstacles à l'accès de cette classe. On vit un phénomène de ce genre à la fin de l'empire romain. Celui qui devenait riche entrait dans l'ordre des curiales ; mais très peu de personnes devenaient riches.
Théoriquement, nous pouvons envisager un très grand nombre de groupes ; pratiquement nous sommes forcés de nous borner aux plus importants. Nous procéderons par approximations successives, en allant du simple au composé.
§ 2047. LA CLASSE SUPÉRIEURE ET LA CLASSE INFÉRIEURE EN GÉNÉRAL.
Le moins que nous puissions faire est de diviser la société en deux couches : une couche supérieure, dont font habituellement partie les gouvernants, et une couche inférieure, dont font partie les gouvernés. Ce fait est si manifeste qu'il s'est en tout temps imposé à l'observateur le moins expert ; il en est de même du fait de la circulation des individus entre ces deux couches. Platon lui-même s'en douta, et voulait la régler artificiellement (§278). On a souvent parlé des « parvenus », et les études littéraires faites sur eux sont très nombreuses. Donnons maintenant une forme plus précise à des considérations entrevues depuis longtemps. Nous avons mentionné déjà (§1723 et sv.) la différence de répartition des résidus entre les divers groupes sociaux, et surtout entre la classe supérieure et la classe inférieure. Cette hétérogénéité sociale est un fait que décèle la moindre observation.
§ 2048. La proportion des résidus de la Ie et de la IIe classe change avec le temps dans les différentes couches sociales, et ces changements sont assez importants pour la détermination de l'équilibre. L'observation vulgaire les a perçus sous une forme spéciale, celle de changements, dans la couche supérieure, des sentiments dits « religieux ». On remarqua qu'en certains temps ils allaient en s'affaiblissant, en certains autres en croissant, et que ces oscillations correspondaient à des changements sociaux importants. D'une façon plus précise, on peut décrire le phénomène en disant que, dans la couche supérieure, les résidus de la IIe classe s'affaiblissent peu à peu jusqu'à ce qu'une marée, montant de la couche inférieure, vienne de temps en temps les renforcer [FN:§ 2048-1].
§ 2049. Vers la fin de la République romaine, les hautes classes n'avaient plus que des sentiments religieux très affaiblis. Ces sentiments s'accrurent dans une mesure considérable, grâce à l'entrée dans les hautes classes, d'hommes des basses classes : des étrangers, des affranchis et d'autres gens que l'empire romain introduisit dans les hautes classes (§2549). On eut un nouvel et fort accroissement lorsque, au temps du Bas-Empire, le gouvernement passa entre les mains d'une bureaucratie provenant des basses classes et d'une plèbe militaire. Ce fut le temps où la prédominance des résidus de la IIe classe se manifesta par la décadence de la littérature, des arts et des sciences, et par l'invasion des religions orientales, principalement du christianisme [FN: § 249-1].
§ 2050 La réforme protestante, au XVIe siècle, la révolution anglaise au temps de Cromwell, la révolution française de 1789, manifestent de grandes marées religieuses qui, parties des classes inférieures, submergent le scepticisme des classes supérieures. De nos jours, aux États-Unis d'Amérique, le mouvement qui élève les individus des classes inférieures est très intense. Nous y voyons un peuple où les résidus de la IIe, classe sont très puissants. Il y naît en abondance des religions étranges et en opposition avec tout sentiment scientifique, ainsi la Christian Science, et l'on y voit des lois hypocrites pour imposer la morale, à l'instar de celles du moyen âge européen.
§ 2051. Certains agrégats, parfois mal définis, et qu'on appelle des aristocraties, font partie de la couche supérieure de la société, de l'élite. Il est des cas où le plus grand nombre de ceux qui appartiennent à ces aristocraties possèdent effectivement les caractères qu'il faut pour y rester ; par exemple l'aristocratie romaine des premiers temps de la République, et de nos jours, en partie du moins, les Magyars, en Hongrie. Il est d'autres cas où ces caractères font défaut à un nombre considérable de membres des dites aristocraties, par exemple celle de France à la veille de la grande révolution. Les membres de ces aristocraties peuvent jouer un rôle plus ou moins grand dans l'élite gouvernementale, ou bien en être exclus.
§ 2052. À part quelques exceptions que nous négligeons, à l'origine les aristocraties guerrières, religieuses, commerciales, les ploutocraties, devaient certainement faire partie de l'élite, et parfois elles la constituaient entièrement. Le guerrier victorieux, le commerçant dont les affaires prospéraient, le ploutocrate qui s'enrichissait, étaient certainement des hommes tels que chacun dans son art était supérieur au vulgaire. Alors l'étiquette correspondait au caractère effectif. Mais ensuite, avec le temps, il se produisit une fissure, souvent considérable, et parfois très considérable ; tandis que, d'autre part, certaines aristocraties qui, à l'origine, jouaient un rôle important dans l'élite gouvernementale, finirent par n'en plus constituer qu'une partie minime. C'est ce qui eut lieu surtout pour l'aristocratie guerrière.
§ 2053. Les aristocraties ne durent pas. Quelles qu'en soient les causes, il est incontestable qu'après un certain temps elles disparaissent. L'histoire est un cimetière d'aristocraties. Le peuple athénien constituait une aristocratie, par rapport au reste de la population, des métèques et des esclaves. Il disparut sans laisser de descendance. Les diverses aristocraties romaines disparurent. Les aristocraties barbares disparurent. Où sont, en France, les descendants des conquérants francs ? Les généalogies des lords anglais sont très exactes. Il subsiste fort peu de familles descendant des compagnons de Guillaume le Conquérant ; les autres ont disparu. En Allemagne, l'aristocratie actuelle est en grande partie constituée par les descendants des vassaux des anciens seigneurs. La population des États européens s'est accrue dans une mesure énorme depuis plusieurs siècles à aujourd'hui. Or, il est certain, très certain, que les aristocraties ne se sont pas accrues en proportion.
§ 2054. Ce n'est pas seulement quant au nombre que certaines aristocraties sont en décadence ; c'est aussi quant à la qualité, en ce sens que l'énergie y diminue, et que se modifient les proportions des résidus qui leur servirent à s'emparer du pouvoir et à le conserver. Mais nous traiterons plus loin ce sujet (§2190 et sv.). La classe gouvernante est entretenue, non seulement en nombre, mais, ce qui importe davantage, en qualité, par les familles qui viennent des classes inférieures, qui lui apportent l'énergie et les proportions de résidus nécessaires à son maintien au pouvoir. Elle est tenue en bon état par la perte de ses membres les plus déchus.
§ 2055. Si l'un de ces mouvements cesse, et qui pis est, s'ils cessent tous deux, la partie gouvernante s'achemine vers la ruine, qui souvent entraîne avec elle celle de la nation entière. L'accumulation d'éléments supérieurs dans les classes inférieures, et vice-versa, d'éléments inférieurs dans les classes supérieures, est une cause puissante de perturbation de l'équilibre. Si les aristocraties humaines étaient semblables aux races de choix des animaux, qui se reproduisent longtemps, à peu près avec les mêmes caractères, l'histoire de la race humaine serait entièrement différente de celle que nous connaissons.
§ 2056. Par l'effet de la circulation des élites, l'élite gouvernementale est dans un état de transformation lente et continue. Elle coule comme un fleuve ; celle d'aujourd'hui est autre que celle d'hier. De temps en temps, on observe de brusques et violentes perturbations, semblables aux inondations d'un fleuve. Ensuite la nouvelle élite gouvernementale recommence à se modifier lentement : le fleuve, rentré dans son lit, s'écoule de nouveau régulièrement.
§ 2057. Les révolutions se produisent parce que, soit à cause du ralentissement de la circulation de l'élite, soit pour une autre cause, des éléments de qualité inférieure s'accumulent dans les couches supérieures. Ces éléments ne possèdent plus les résidus capables de les maintenir au pouvoir, et ils évitent de faire usage de la force ; tandis que dans les couches inférieures se développent les éléments de qualité supérieure, qui possèdent les résidus nécessaires pour gouverner, et qui sont disposés à faire usage de la force.
§ 2058. Généralement, dans les révolutions, les individus des couches inférieures sont dirigés par des individus des couches supérieures, parce que ceux-ci possèdent les qualités intellectuelles utiles pour livrer bataille, tandis qu'ils sont dépourvus des résidus que possèdent précisément les individus des couches inférieures.
§ 2059. Les changements violents ont lieu par soubresaut. Par conséquent, l'effet ne suit pas immédiatement la cause, qui peut avoir agi quelque temps avant que le soubresaut se produise. Lorsqu'une classe gouvernante ou une nation se sont maintenues longtemps par la force et se sont enrichies, elles peuvent subsister encore quelque temps sans faire usage de la force : en achetant la paix aux adversaires, et en la payant non seulement à prix d'or, mais aussi au prix des honneurs et de la réputation dont elles avaient jusqu'alors joui, et qui constituent un certain capital. Tout d'abord, on garde le pouvoir à force de concessions, et l'on s'imagine qu'on peut le faire indéfiniment. C'est ainsi que l'empire romain de la décadence achetait la paix aux Barbares avec de l'argent et des honneurs. C'est ainsi que, dilapidant en peu de temps le patrimoine de ses ancêtres, patrimoine fait d'amour, de respect et de vénération presque religieuse pour la monarchie, Louis XVI put, toujours en cédant, être le roi de la Révolution. C'est ainsi que l'aristocratie anglaise put prolonger son pouvoir durant la seconde moitié du XIXe siècle, jusqu'à l'aurore de sa décadence, annoncée par le Parliament Bill, au commencement du XXe.
[1306]
Chapitre XII↩
Forme générale de la société
§ 2060. LES ÉLÉMENTS. La forme de la société est déterminée par tous les éléments qui agissent sur elle ; et ensuite, elle réagit sur les éléments. Par conséquent, on peut dire qu'il se produit une détermination mutuelle. Parmi les éléments, nous pouvons distinguer les catégories suivantes : 1° le sol, le climat, la flore, la faune, les circonstances géologiques, minéralogiques, etc.; 2° d'autres éléments extérieurs à une société donnée, en un temps donné ; autrement dit, les actions des autres sociétés sur celle-ci, actions qui sont extérieures dans l'espace, et les conséquences de l'état antérieur de cette société, conséquences qui sont extérieures dans le temps ; 3° des éléments intérieurs, dont les principaux sont la race, les résidus ou les sentiments qu'ils manifestent, les tendances, les intérêts, l'aptitude au raisonnement, à l'observation, l'état des connaissances, etc. Les dérivations aussi figurent parmi ces éléments.
§ 2061. Les éléments que nous avons mentionnés ne sont pas indépendants ; la plupart sont mutuellement dépendants. En outre, parmi les éléments, il faut ranger les forces qui s'opposent à la dissolution, à la destruction des sociétés durables. C'est pourquoi, lorsqu'une de celles-ci est constituée sous une certaine forme déterminée par les autres éléments, elle agit à son tour sur ces éléments. Ceux-ci, en ce sens, doivent aussi être considérés comme étant en état de mutuelle dépendance avec la société dont nous parlons. On observe quelque chose de semblable pour les organismes des animaux. Par exemple, la forme des organes détermine le genre de vie ; mais celui-ci, à son tour, agit sur les organes (§ 2088 et sv.).
§ 2062. Pour déterminer entièrement la forme sociale, il serait nécessaire d'abord de connaître tous ces innombrables éléments, ensuite de savoir comment ils agissent, et cela sous forme quantitative. En d'autres termes, il serait nécessaire d'affecter d'indices les éléments et leurs effets, et d'en connaître la dépendance, enfin, d'établir toutes les conditions qui déterminent la forme de la société. Grâce à l'emploi des quantités, on exprimerait ces conditions par des équations. Celles-ci devraient se trouver en nombre égal à celui des inconnues, et les détermineraient entièrement [FN: § 2062-1].
§ 2063. Une étude complète des formes sociales devrait considérer au moins les principaux éléments qui les déterminent, en négligeant uniquement ceux dont l'action peut être jugée accessoire. Mais actuellement, cela n'est pas plus possible pour les formes sociales que pour les formes animales ou végétales. Il est, par conséquent, nécessaire de se limiter à une étude qui embrasse seulement une partie du sujet. Heureusement pour notre étude, plusieurs éléments agissent sur les tendances et sur les sentiments des hommes ; c'est pourquoi, en considérant les résidus, nous tiendrons compte indirectement de ces éléments.
§ 2064. L'action de la première catégorie d'éléments, indiquée au § 2060, c'est-à-dire du sol, du climat, etc., est certainement très importante. Pour le démontrer, il suffirait de comparer la civilisation des peuples des régions tropicales avec celle des peuples des régions tempérées. On s'est livré à beaucoup d'études sur ce sujet, mais sans grand profit jusqu'à présent. Nous n'étudierons pas ici directement l'action de ces éléments ; mais nous en tiendrons compte indirectement, en admettant comme donnés les résidus, les tendances, les intérêts des hommes soumis à l'action de ces éléments.
§ 2065. Afin de diminuer encore les difficultés, nous bornerons notre exposé aux peuples de l'Europe et du bassin de la Méditerranée, en Asie et en Afrique. Ainsi, nous laisserons encore de côté les importantes et insolubles questions concernant les races. Nous devons nécessairement tenir compte de l'influence des autres peuples sur l'un d'eux, car les divers peuples de la région considérée ne demeurèrent jamais isolés ; mais la puissance militaire, politique, intellectuelle, économique, etc., par laquelle se manifestent ces actions, dépend des éléments des sentiments, des connaissances des intérêts ; par conséquent, on pourra retrouver, au moins en partie, les causes de la puissance dans ces éléments.
§ 2066. En tout cas, que le nombre des éléments que nous considérons soit petit ou grand, nous supposons qu'ils constituent un système, que nous appellerons système social (§ 119), et nous nous proposons d'en étudier la nature et les propriétés.
Ce système change de forme et de caractère avec le temps ; et quand nous nommons le système social, nous entendons ce système considéré aussi bien en un moment déterminé, que dans les transformations successives qu'il subit en un espace de temps déterminé. De même, lorsqu'on nomme le système solaire, on entend ce système considéré aussi bien en un moment déterminé, que dans les moments successifs qui composent un espace de temps, petit ou grand.
§ 2067. L'ÉTAT D'ÉQUILIBRE [FN: § 2067-1] . D'abord, si nous voulons raisonner avec quelque rigueur, nous devons déterminer l'état auquel nous voulons considérer le système social, dont la forme change continuellement. L'état réel, statique ou dynamique, du système est déterminé par ses conditions. Supposons qu'on provoque artificiellement quelque modification dans sa forme (mouvements virtuels, § 130) ; aussitôt une réaction se produira ; elle tendra à ramener la forme changeante à son état primitif, modifié par le changement réel. S'il n'en était pas ainsi, cette forme et ses changements ne seraient pas déterminés, mais demeureraient arbitraires.
§ 2068. Nous pouvons utiliser cette propriété pour définir l'état que nous voulons considérer. Pour le moment, nous le désignerons par la lettre X. Cet état est tel, dirons-nous, que si l'on y introduisait artificiellement quelque modification différente de celle qu'il subit en réalité, aussitôt se produirait une réaction qui tendrait à le ramener à l'état réel [FN: § 2068-1] Ainsi, l'état X est rigoureusement défini.
§ 2069. Il change à chaque instant, et nous ne pouvons ni ne voulons l'envisager ainsi dans ses moindres détails. Par exemple, pour tenir compte de l'élément fertilité d'un champ, nous ne voulons pas chaque minute, chaque heure, chaque jour, ni chaque mois, considérer comment croît le grain dans le champ ensemencé ; nous ne portons notre attention que sur son produit annuel. Pour tenir compte de l'élément patriotisme, nous ne pouvons pas suivre chaque soldat, dans tous ses mouvements, du jour où il est appelé sous les armes jusqu'à celui où il se fait tuer. Il nous suffit de noter le fait global de la mort d'un certain nombre d'hommes. De même encore, l'aiguille de la montre se meut par secousses. En mesurant le temps, nous négligeons cette circonstance, comme si l'aiguille se mouvait d'un mouvement continu. Considérons donc des états successifs X1, X2, X3,...., auxquels on parvient au bout de certains espaces de temps, fixés précisément en vue d'atteindre les états que nous voulons envisager, et qui sont tels que chacun des éléments y a produit l'action propre que nous voulons considérer.
Afin de mieux comprendre cela, voyons quelques exemples. Nous en avons lui, très simple, en économie pure. Supposons un individu qui, dans l'unité de temps, par exemple chaque jour, troque du pain contre du vin. Il commence par avoir zéro de vin, et s'arrête quand il a une certaine quantité de vin [FN: § 2069-1] (fig. 32). L'axe des temps est Ot. Indiquons par ab = bc = cd = de , les espaces qui représentent l'unité de temps. L'axe des quantités de vin est Oq. Au commencement de la première unité de temps, l'individu a zéro de vin; il est en a. À la fin, il a la quantité bX1 de vin ; il est en X1. Chaque jour, la même opération se répète, et à la fin de chaque jour, ou de chaque unité de temps, l'individu est en X1, X2, X3, .... Tous ces points se trouvent sur une ligne MP, parallèle à Ot, et qui en est séparée par une distance égale à la quantité de vin que l'individu retire chaque jour du troc. La ligne MP est appelée ligne d'équilibre, et, d'une façon générale, c'est la ligne déterminée par les équations de l'économie pure [FN: § 2069-2] . Elle peut ne pas être parallèle à l'axe Ot, car il n'est pas nécessaire que chaque jour la même opération se répète identique. Par exemple, elle peut être la ligne MP de la fig. 33. ab = bc = cd = ... sont toujours les unités de temps, mais au début de ces unités, l'individu est en a, en s en r, en d, en u, ..., et à la fin, en X1, en X2 , en X3 , en X4 , en X5, .... La ligne MX1X2X3X4X5... est encore appelée ligne d'équilibre. Lorsqu'on dit que l'économie pure nous donne la théorie de l'équilibre économique, cela revient à dire qu'elle nous enseigne comment, des positions a, s, r, d, u, ..., on passe aux positions finales X1, X2, X3, X4, X5…, et pas autre chose [FN: § 2069-3].
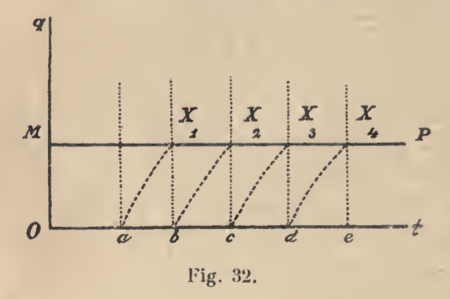
Figure 32
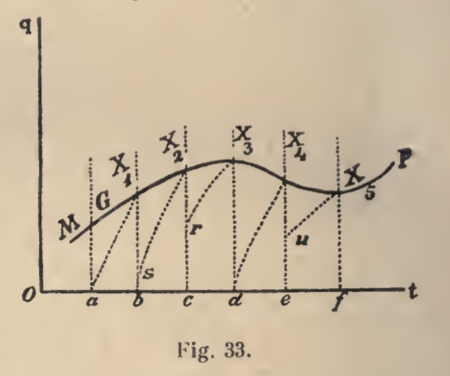
Figure 33
Maintenant voyons le cas le plus général. Dans la figure précédente, ab, bc, cd, ... ne sont plus égaux entre eux, mais représentent divers espaces de temps, supposés par nous pour étudier un phénomène au terme de ces espaces de temps, dans lesquels un élément exerce l'action propre que nous voulons considérer. Les points a, s, r, d, u, ... représentent l'état de l'individu, au début de cette action ; X1 , X2 , X3 , ... l'état de l'individu, quand elle est accomplie. La ligne MX1 , X2,... P est appelée ligne de l'état X (§ 2076).
§ 2070. Cette définition est identique, sous une forme différente, à celle qui est donnée au § 2068. En effet, si tout d'abord nous partons de la définition donnée tout à l'heure de l'état X1, nous voyons que l'action de chaque élément étant accomplie, la société ne peut pas, d'elle-même, assumer une autre forme que X1, et que si elle en était écartée artificiellement, elle serait forcée d'y revenir aussitôt, car autrement sa forme ne serait pas entièrement déterminée, ainsi qu'on l'a supposé, par les éléments considérés. En d'autres termes, supposons que la société soit arrivée en un point X1, (fig. 34), en suivant une voie aX1; supposons encore qu'en X1, l'action que nous voulons considérer, et qui est produite par certains éléments, soit accomplie. Si la société est écartée artificiellement de X1, cela ne pourra avoir lieu que dans les cas suivants : 1° en portant cette société en des points tels que l, n, qui se trouvent en dehors de la ligne aX1, ; 2° en portant cette société en un point m de aX1. Dans le premier cas, la société doit tendre à revenir en X1, autrement son état ne serait pas, comme on l'a supposé, complètement déterminé par les éléments considérés. Dans le second cas, l'hypothèse serait en contradiction avec la supposition que nous avons faite, à savoir que l'action des éléments est complète ; en effet, elle n'est complète qu'en X ; elle est incomplète en m. À ce point, les éléments considérés agissent encore, et portent la société de m en X1. Ensuite, partant de la définition donnée au § 2068, on voit que, vice versa, si l'on éloigne artificiellement la société de l'état X1, et qu'elle tende à y revenir, cela indique que la société a été portée, ou bien, comme dans le premier des cas précédents, en des points l, n, différents de ceux qui sont déterminés par les éléments considérés, ou bien en un point m, où l'action des éléments considérés n'est plus accomplie. Si, au lieu d'atteindre successivement les points X1 , X2 , X3..., le système parcourait d'un mouvement continu la ligne X1X2X3 ... , il n'y aurait rien à changer aux définitions données tout à l'heure. On devrait dire seulement que si le système s'écartait artificiellement de la ligne X1X2 ..., il tendrait bientôt à y revenir, et que si les éléments accomplissent leur action propre lorsqu'on leur fait parcourir cette ligne, ils n'accompliraient pas la même action, si le système ne se trouvait pas exactement sur la ligne considérée.
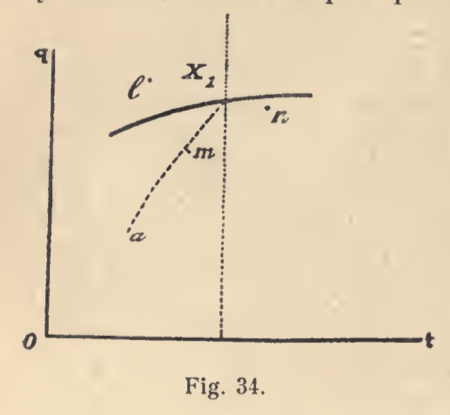
Figure 34
§ 2071. Nous avons ainsi la définition précise et rigoureuse annoncée au § 123 pour l'état que nous avons l'intention de considérer. Afin de la mieux connaître, examinons les analogies, de même que pour connaître la forme de la terre, on examine une sphère. Commençons par l'analogie d'un phénomène concret. L'état X que nous considérons est semblable à celui d'un fleuve ; les états X1 , X2, ..., sont semblables à ceux de ce fleuve, chaque jour, par exemple. Le fleuve n'est pas immobile ; il coule, et toute modification, si petite soit-elle, qu'on apporte à sa forme et à son cours, est la cause d'une réaction qui tend à rétablir l'état primitif.
§ 2072. Voyons ensuite une analogie abstraite, à laquelle nous avons fait allusion au § 121. L'état X que nous considérons est analogue à celui de l'équilibre dynamique d'un système matériel [FN: § 2072-1] . Les états X1 , X2 , ... sont analogues à des positions d'équilibre successives de ce système. On peut remarquer aussi que l'état X est analogue à l'état d'équilibre d'un organisme vivant [FN: § 2072-2] .
§ 2073. Cherchons des analogies dans un domaine plus voisin du nôtre. Les états X1 , X2 , X3 ,..., sont analogues à ceux que l'économie pure considère pour un système économique. L'analogie est si grande que l'on peut considérer les états du système économique comme des cas particuliers des états généraux du système sociologique[FN: § 2073-1].
§ 2074. Il est une autre analogie que nous ne pouvons pas négliger si nous voulons pénétrer en notre matière. L'état X est analogue à celui qu'on appelle équilibre statistique, dans la théorie cinétique des gaz. Pour comprendre cela, considérons un cas particulier, celui, par exemple, de la consommation des cigares d'une certaine qualité, en un pays donné. Les états X1 , X2 , X3, ..., représenteront, par hypothèse, les consommations annuelles de ces cigares. Commençons par supposer qu'elles sont presque toutes égales : nous dirons que la consommation des cigares est constante. Mais par là nous n'entendons nullement affirmer que la consommation de chaque individu est constante. Au contraire, nous savons très bien qu'elle est très variable ; mais toutes les variations se compensent à peu près. De ce fait, la résultante est zéro, ou mieux voisine de zéro. Le cas n'est certes pas exclu où il pourrait se produire en un même sens un si grand nombre de ces variations que la résultante ne serait plus voisine de zéro. Mais ce cas a une probabilité si petite qu'il n'est pas nécessaire de le considérer. C'est ce qu'on exprime en disant que la consommation est constante. Si, au contraire, la probabilité n'est pas extrêmement petite, nous observerons des oscillations autour de la valeur constante de la consommation. Ces oscillations suivront la loi des probabilités. Supposons ensuite que X1 , X2 , X3, ... représentent des consommations croissantes. Nous pourrons répéter, avec les modifications nécessaires, les observations que nous venons de faire. Nous dirons que nous ne supposons nullement que les consommations de chaque individu soient croissantes ; que nous savons, au contraire, qu'elles sont très variables, mais que nous traitons d'un équilibre statistique, dans lequel les variations se compensent de telle sorte qu'il en résulte une consommation totale croissante ; que celle-ci peut avoir une probabilité si grande qu'on n'observe pas d'oscillations dépendant des probabilités, ou bien pas assez grande pour que ces oscillations se produisent. Enfin, par la préparation de l'étude de ces cas particuliers, il sera facile de comprendre la signification générale de X1 , X2 , X3 ,... pour des consommations variables de n'importe quelle façon.
§ 2075. Qu'on étende à tout un système social les considérations exposées pour le système des consommateurs d'une qualité de cigares, et l'on aura une idée claire de l'analogie que nous avons en vue, pour les états X1 , X2 , X3, ...
§ 2076. Nous pourrions continuer à désigner par les lettres X et X1 , X2,... les états sociaux que nous voulons considérer (§ 119) ; mais peut-être le lecteur commence-t-il à être las de cette façon de désigner les choses, et préférerait-il qu'on leur donnât des noms. Nous pourrions prendre ce nom au hasard; mais il vaut peut-être mieux l'emprunter à une chose analogue à celle que nous voulons désigner. C'est pourquoi, nous en tenant à l'analogie mécanique, nous appellerons états d'équilibre les états X et X1 , X2 ,… mais il faut rechercher le sens de ce terme exclusivement dans les définitions données aux § 2068 et 2069, en tenant compte des observations du § 2074.
§ 2077. Nous venons de simplifier notre problème en substituant la considération de certains états successifs à celle de l'infinité des changements insensibles qui conduisent à ces états. Nous devons continuer dans cette voie, et nous efforcer de simplifier encore la considération de la mutuelle dépendance et celle des éléments à considérer.
§ 2078. Dans notre étude, nous nous arrêtons à certains éléments, comme le chimiste s'arrête aux corps simples ; mais nous n'affirmons pas du tout que les éléments auxquels nous nous arrêtons ne soient pas réductibles à un plus petit nombre, ou même, par exemple, à une unité. De même, le chimiste n'affirme pas que le nombre des corps simples soit irréductible, et que, par exemple, on ne puisse, un jour, y reconnaître différentes manifestations d'un seul élément [FN: § 2078-1].
§ 2079. ORGANISATION DU SYSTÈME SOCIAL. Le système économique est composé de certaines molécules mues par les goûts, et retenues par les liaisons des obstacles qui s'opposent à l'obtention des biens économiques. Le système social est beaucoup plus compliqué. Même si nous voulons le simplifier le plus possible sans tomber en de trop graves erreurs, nous devrons du moins le considérer comme composé de certaines molécules contenant certains résidus, certaines dérivations, certains intérêts, certaines tendances. Ces molécules, sujettes à de nombreuses liaisons, accomplissent des actions logiques et des actions non-logiques. Dans le système économique, la partie non-logique est entièrement reléguée dans les goûts. On la néglige, parce que les goûts sont supposés donnés. On se demandera si l'on ne pourrait pas faire de même pour le système social : admettre comme donnés les résidus, où serait reléguée la partie non-logique, et étudier les actions logiques auxquelles ils donnent naissance. En effet, on aurait ainsi une science qui serait semblable à l'économie pure ou même à l'économie appliquée. Mais, malheureusement la ressemblance cesse, sous le rapport de la correspondance avec la réalité. En de certaines circonstances il n'y a pas un trop grand écart entre la réalité et l'hypothèse suivant laquelle les hommes accomplissent, pour satisfaire leurs goûts, des actions économiques que l'on peut en moyenne considérer comme logiques. Aussi les conséquences de telles hypothèses donnent-elles, en ces circonstances, une forme générale du phénomène, dont les divergences d'avec la réalité sont peu nombreuses et pas considérables. Au contraire, il y a un grand écart entre la réalité et l'hypothèse suivant laquelle, des résidus, les hommes tirent des conséquences logiques, et agissent d'après celles-ci. En ce genre d'activité, ils emploient les dérivations plus souvent que les raisonnements rigoureusement logiques. C'est pourquoi quiconque voudrait prévoir leurs faits et gestes, sortirait entièrement de la réalité. Les résidus ne sont pas seulement, comme les goûts, l'origine des actions, mais agissent aussi sur toute la suite des actions qui sont accomplies dès l'origine. Nous nous en rendons compte précisément parce que les dérivations se substituent aux raisonnements logiques. Donc, la science constituée sur l'hypothèse qu'on tire les conséquences logiques de certains résidus donnés, fournirait du phénomène une forme générale qui aurait peu ou rien de commun avec la réalité [FN: § 2079-1] . Cette science serait à peu près une doctrine semblable à celle de la géométrie non-euclidienne, ou à celle de la géométrie dans l'espace à quatre dimensions. Si nous voulons demeurer dans la réalité, nous devons demander à l'expérience de nous faire connaître non seulement certains résidus fondamentaux, mais aussi les diverses manières dont ils agissent pour déterminer les actions des hommes. Pour de semblables motifs, l'étude de beaucoup de faits dits économiques ne peut se faire sans l'aide de la sociologie.
§ 2080. Portons notre attention sur les molécules du système social, c'est-à-dire sur les individus. Ceux-ci possèdent certains sentiments, manifestés par les résidus. Pour abréger, nous désignerons ces sentiments par le seul nom de résidus. Nous pourrons dire alors que chez les individus existent des mélanges de groupes de résidus, mélanges qui sont analogues à ceux de composés chimiques qu'on trouve dans la nature ; tandis que les groupes mêmes de résidus sont analogues à ces composés chimiques. Au chapitre précédent, nous avons déjà étudié la nature de ces mélanges et de ces groupes ; nous avons remarqué que si une partie d'entre eux semblent être presque indépendants, une autre partie sont dépendants, de telle sorte que l'accroissement de l'un est compensé par la diminution d'autres mélanges ou d'autres groupes, et vice versa. Plus loin, nous verrons d'autres genres de dépendance (§ 2088). Que ces mélanges et ces groupes soient dépendants ou indépendants, il convient maintenant de les ranger parmi les éléments de l'équilibre social.
§ 2081. Les résidus se manifestent par les dérivations, qui sont ainsi un indice des forces qui agissent sur les molécules sociales. Nous les avons divisées en deux catégories (§ 1826) : les dérivations proprement dites et les manifestations auxquelles elles aboutissent. Ici, pour avoir une vue du tout, nous les considérons ensemble.
§ 2082. Contrairement à l'opinion vulgaire qui, dans la détermination de la forme sociale, attribue une grande importance aux dérivations et, parmi celles-ci, aux dérivations proprement dites, aux théories, nous avons vu, grâce à de nombreuses et longues recherches, que, directement, ces éléments agissent peu dans la détermination de cette forme, et que ce fait échappe, parce qu'on attribue aux dérivations les effets qui sont le propre des résidus manifestés par ces dérivations. Pour acquérir une efficacité notable, les dérivations doivent d'abord se transformer en sentiments (§ 1746) ; ce qui, d'ailleurs, n'est pas si facile.
§ 2083. En ce qui concerne les dérivations, un fait est capital les dérivations ne correspondent pas précisément aux résidus dont elles proviennent (§ 1767 et sv., 1780 et sv.). De ce fait découlent les principales difficultés que nous rencontrons pour constituer la science sociale, car seules les dérivations nous sont connues. Parfois on ne sait trop comment remonter des dérivations aux résidus dont elles procèdent. Cela n'arriverait pas si les dérivations étaient de la nature des théories logico-expérimentales (§ 1768, 2007). Ajoutons que les dérivations renferment un grand nombre de principes que l'on n'invoque pas explicitement, qui demeurent implicites, et qui, précisément pour cela, manquent beaucoup de précision (§ 2002). L'incertitude est plus grande pour les dérivations proprement dites que pour les manifestations, mais elle ne fait pas défaut non plus chez celles-ci. Afin de porter remède en quelque mesure à ce défaut, il est nécessaire de rassembler un grand nombre de dérivations appartenant au même sujet, et d'en chercher la partie constante, en la séparant de la partie variable.
§ 2084. Lors même qu'il y a correspondance, au moins approximative, entre la dérivation et le résidu, celle-là dépasse habituellement le sens de celui-ci et la réalité (§ 1772). Elle indique une limite extrême en deçà de laquelle reste le résidu. Très souvent elle renferme une partie imaginaire qui exprime une fin placée bien au delà de celle que l'on indiquerait, si l'on exprimait rigoureusement le résidu (§ 1869). Si la partie imaginaire croît et se développe, on a les mythes, les religions, les morales, les théologies, les métaphysiques, les théories idéales. Cela arrive principalement lorsque les sentiments qui correspondent à ces dérivations sont intenses, et d'autant plus facilement que l'intensité est plus grande.
§ 2085. C'est pourquoi, prenant le signe pour la chose, on peut dire que les hommes sont poussés à une action énergique par ces dérivations. Mais cette proposition, prise à la lettre, serait loin d'être vraie, et doit être remplacée par cette autre : que les hommes sont poussés à une action énergique par les sentiments qui s'expriment par ces dérivations (§ 1869). En de nombreux cas, il est indifférent d'employer la première ou la seconde proposition. Ce sont surtout ceux où l'on remarque une correspondance entre les actions et ces dérivations. La correspondance existant entre les actions et la chose révélée par les dérivations existe aussi entre les actions et les dérivations, et vice versa. En d'autres cas, le fait de substituer la première à la seconde proposition peut être cause de graves erreurs. Ces cas sont surtout ceux où, voulant modifier les actions, on croit y arriver en modifiant les dérivations. La modification du signe ne modifie point la chose à laquelle correspondent les actions ; par conséquent, elle ne modifie pas non plus celles-ci. (§ 1844 et sv.)
§ 2086. Quand des dérivations on veut remonter aux résidus, il faut prendre garde qu'un même résidu B peut avoir un grand nombre de dérivations T, T', T", ..., (§ 2004 et sv.) qui peuvent aisément se substituer les unes aux autres. C'est pourquoi : 1° si, dans une société, on trouve T, et dans une autre T', on ne peut conclure que ces deux sociétés aient des résidus correspondants qui soient différents ; car elles peuvent, au contraire, avoir le même résidu B (§ 2004 et sv.) ; 2° la substitution de T à r a peu ou point d'efficacité pour modifier la forme sociale, car cette substitution n'altère pas les résidus B qui, beaucoup plus que les dérivations, déterminent cette forme (§ 1844 et sv.) ; 3° mais le fait que celui qui doit agir estime, ou n'estime pas, cette substitution indifférente, peut avoir de l'efficacité, non pas pour ces opinions considérées intrinsèquement, mais bien pour les sentiments qu'elles manifestent (§ 1847) ; 4° parmi les dérivations T, T', T", ..., il peut y en avoir de. contradictoires. Deux propositions qui sont telles se détruisent ; il n'en est pas ainsi de deux dérivations contradictoires : non seulement elles peuvent subsister ensemble, elles se renforcent même mutuellement. Souvent d'autres dérivations interviennent pour faire disparaître la contradiction, et rétablir l'accord. Ce phénomène est d'importance très secondaire, parce que les hommes trouvent et acceptent très facilement des dérivations sophistiques de cette sorte. Ils éprouvent un certain besoin de logique, mais le satisfont aisément par des propositions pseudo-logiques. Par conséquent, la valeur intrinsèque, logico-expérimentale, des dérivations T, T', T",, ... a d'habitude peu de rapport avec l'efficacité de leur action sur l'équilibre.
§ 2087. COMPOSITION DES RÉSIDUS ET DES DÉRIVATIONS. NOUS avons considéré des groupes séparés de résidus ; voyons maintenant comment ils agissent lorsqu'on les considère ensemble. Le phénomène présente quelque analogie, sous un certain aspect, avec les compositions chimiques et, sous un autre aspect, avec la composition position des forces, en mécanique. D'une façon générale, supposons une société sur laquelle agissent certains sentiments correspondant aux groupes de résidus A, B, C, .... qui nous sont manifestés par les dérivations a, b, c, .... Donnons à chacun de ces groupes de résidus un indice quantitatif qui corresponde à l'intensité de l'action de chaque groupe. Nous aurons ainsi les indices α, β, γ, …, En outre, nous appellerons S, T, U, les dérivations, les mythes, les théories, etc., correspondant aux groupes A, B, C.... Le système social sera alors en équilibre, sous l'action des forces α, β, γ, …, qui sont à peu près dirigées dans le sens des dérivations S, T, U, .... et les obstacles entrant en ligne de compte. Ainsi, nous exprimons simplement sous une forme nouvelle ce que nous avons dit précédemment.
§ 2088. Continuant à donner cette forme au raisonnement, nous énoncerons les propositions suivantes. 1° On ne peut pas, ainsi qu'on le fait d'habitude, juger séparément de l'effet de chaque groupe de résidus ou de la variation d'intensité de ce groupe. Si cette intensité varie, pour que l'équilibre soit maintenu, il faut généralement qu'il se produise des variations d'autres groupes. Ici apparaît un genre de dépendance, différent de celui que nous avons rappelé au § 2080. Il faut donner des noms différents à des choses différentes § 119). Nous donnerons le nom de premier genre de dépendance à la dépendance directe entre les divers groupes de résidus, et nous appellerons second genre de dépendance la dépendance indirecte provenant de la condition que l'équilibre soit maintenu, ou d'autres conditions analogues. 2° Le mouvement réel a lieu selon la résultante des forces α, β, γ, .... qui ne correspond en rien à la résultante imaginaire (si toutefois elle se conçoit) des dérivations S, T, U, .... 3° Ces dérivations nous font seulement connaître le sens dans lequel certains mouvements tendent à s'accomplir (§ 2087) ; mais ce sens même n'est généralement pas celui qui serait indiqué par la dérivation prise dans son acception rigoureuse, comme on devrait entendre une proposition logico-expérimentale. Par exemple, nous avons vu souvent que deux dérivations contradictoires peuvent subsister ensemble, ce qu'on ne peut admettre pour deux propositions logiques. Les deux propositions : A est égal à B ; B n'est pas égal à A, est inférieur à A, sont logiquement contradictoires, et, par conséquent, ne peuvent subsister ensemble. Au contraire, comme dérivations, elles peuvent subsister ensemble, et elles expriment une seule et même chose : c'est que les A veulent dominer sur les B. Ils font usage de la première proposition pour affaiblir la résistance de ceux qui, sans être favorables aux B, ne voudraient pas qu'ils fussent assujettis. Ils font usage de la seconde proposition pour inciter à l'action ceux qui sont déjà favorables aux A. 4° Comme d'habitude, si le système social ne se meut pas suivant la direction indiquée par les résidus A, auxquels correspond la force α, cela n'a pas lieu parce qu'on a contrecarré directement A, ou moins encore parce qu'on a réfuté la dérivation correspondante S, mais parce que le mouvement selon A a été dévié par l'action des résidus B, C, .... Parmi ceux-ci, il faut distinguer les résidus des différentes classes (§ 2153-4°), parce qu'en vertu de la propriété que possède l'ensemble d'une même classe de demeurer presque constant, il faut prêter attention à l'action des diverses classes plus qu'à celle de chaque résidu. Nous poursuivrons plus loin ces considérations (§ 2148 et sv.).
§ 2089. Afin de mieux comprendre la différence entre les dépendances mutuelles du premier et celles du second genre, représentons-nous une certaine société. Son existence est déjà un fait ; en outre, nous avons les divers faits qui se produisent dans cette société. Si nous considérons ensemble le premier de ces faits et les seconds, nous dirons qu'ils sont tous mutuellement dépendants (§ 2204). Si nous les séparons, nous dirons que les derniers sont mutuellement dépendants entre eux (mutuelle dépendance du premier genre), et qu'en outre, ils sont mutuellement dépendants avec le premier fait (mutuelle dépendance du second genre). De plus, nous pourrons dire que le fait de l'existence de la société résulte des faits que l'on observe dans la société ; c'est-à-dire que ceux-ci déterminent l'équilibre social. Nous pourrons ajouter que si le fait de l'existence de la société est donné, les faits qui se produisent dans cette société ne sont plus entièrement arbitraires, mais qu'il faut qu'ils satisfassent à certaines conditions ; c'est-à-dire que l'équilibre étant donné, les faits qui le déterminent ne sont pas entièrement arbitraires.
Voyons maintenant quelques exemples de la différence entre les dépendances mutuelles du premier et celles du second genre. La tendance des Romains au formalisme dans la vie pratique agissait de manière à faire naître, subsister, accroître ce formalisme dans la religion, dans le droit, dans la politique; et vice versa. Nous avons ici une mutuelle dépendance du premier genre. Au contraire, nous avons une mutuelle dépendance du second genre, dans le fait que la tendance des Romains à l'indépendance pouvait subsister grâce au formalisme politique, qui faisait éviter le danger de l'anarchie. C'est effectivement ce qui arriva jusque vers la fin de la république. La tendance au formalisme politique ayant alors disparu (surtout parce que les Romains avaient été remplacés par des hommes d'autres nations), la tendance à l'indépendance dut aussi diminuer et accepter comme moindre mal le despotisme impérial. Si cette tendance n'avait pas diminué, la société romaine se serait dissoute, ou pour des causes internes, ou parce qu'elle aurait été soumise par d'autres peuples, ainsi qu'il arriva précisément à la Pologne, pour la même raison. Ici, il n'y a pas de mutuelle dépendance directe entre les résidus de la IIe classe (tendance au formalisme politique) et les résidus de la Ve classe (tendance à l'indépendance), qui serait une mutuelle dépendance du premier genre. Mais il y a une mutuelle dépendance indirecte, qui provient du fait que, pour la collectivité romaine, en ce temps et en ces circonstances, on n'avait pas une position d'équilibre dans l'état où l'indice de la tendance à l'indépendance (résidus de l'intégrité personnelle) serait demeuré constant, tandis que diminuait l'indice du formalisme politique (résidus de la persistance des agrégats). C'est là la mutuelle dépendance du second genre.
§ 2090. À la façon même dont agit la mutuelle dépendance du second genre, on s'aperçoit que ses effets doivent souvent se produire beaucoup plus lentement que ceux de la mutuelle dépendance du premier genre ; puisqu'il faut qu'il survienne une altération de l'équilibre, et qu'ensuite celle-ci se répercute sur les autres résidus. En outre, toujours pour ce motif, le second genre de mutuelle dépendance jouera un rôle beaucoup plus considérable que le premier dans les mouvements rythmiques sociaux (§ 1718).
§ 2091. Nous avons déjà traité des diverses manières de tenir compte de la mutuelle dépendance (§ 1732). Pour suivre la meilleure méthode (2-b) indiquée dans ce paragraphe, il serait nécessaire de pouvoir assigner un indice à chacune des choses mutuellement dépendantes, et ensuite de faire usage de la logique mathématique, pour déterminer ces indices par un système d'équations. On a pu faire cela pour l'économie pure ; on ne peut le faire, du moins maintenant, pour la sociologie, et nous sommes, par conséquent, obligés d'employer des méthodes moins parfaites (§ 2203 et sv.).
§ 2092. Comme nous nous servons ici du langage vulgaire au lieu du langage mathématique, il ne sera peut-être pas inutile de citer un exemple très simple de la méthode (2-a). Il met en lumière le rapport en lequel cette méthode se trouve avec la méthode (2-b). Soient deux quantités x et y qui sont en un état de mutuelle dépendance. Si nous faisons usage du langage mathématique, en suivant la méthode (2-b), nous disons qu'il existe une équation entre les deux variables x et y, et il n'est pas nécessaire d'ajouter autre chose. Si nous faisons usage du langage vulgaire, nous devons suivre le mode (2-a ), et nous dirons que x est déterminée par y, mais qu'elle réagit ensuite sur y, de telle sorte que y se trouve aussi dépendre de x. On remarquera que l'on pourrait invertir les termes et dire que y est déterminée par x, mais qu'elle réagit ensuite sur x, de telle sorte que x se trouve aussi dépendre de y. Adopté pour les équations, parfois ce mode donne les mêmes résultats que le mode (2-b), parfois il ne les donne pas [FN: § 2092-1]. C'est pourquoi, d'une manière générale, il ne faut substituer le mode (2-a) au mode (2-b) qu'avec beaucoup de circonspection, et il est nécessaire, en tout cas, d'examiner attentivement les effets de ces substitutions.
§ 2093. Admettons, uniquement par hypothèse, qu'on ait pu assigner certains indices x1, x2, ... aux sentiments, certains autres y1 , y2, ... aux conditions économiques, certains autres z1, z2, ... aux coutumes, aux lois, aux religions, d'autres encore, u1 , u 2, ... aux conditions intellectuelles, au développement scientifique, aux connaissances techniques, et ainsi de suite. Pour nous servir du langage mathématique, nous dirons que l'état X défini au § 2068 est déterminé par un nombre d'équations égal au nombre des inconnues x1, x2, ... y1 , y2, ..., z1 , z2, ... etc. De même nous dirons que les états X1 , X2 , X3, ..., définis au § 2069, sont déterminés.
§ 2094. En outre, considérant la dynamique du système, nous appellerons aussi déterminé le mouvement qui, si les circonstances indiquées par les paramètres des équations ne variaient pas, porterait le système successivement aux positions X1 , X2 , X3 , .... Si ces circonstances variaient, le mouvement varierait aussi, et les positions successives seraient X 1 , X'2, X3 ... (fig. 35).
§ 2095. Nous pouvons supposer donné un certain nombre d'inconnues, pourvu que nous supprimions un nombre égal d'équations. Nous pourrions, par exemple, supposer donnés certains sentiments correspondant aux indices x1, x2, ..., et alors le mouvement qui porte aux positions X 1 , X2 , X3, … serait celui qui se produirait si ces sentiments demeuraient constants, tandis que le mouvement X 1 , X'2 , X'3, … serait celui qui se produirait si ces sentiments variaient.
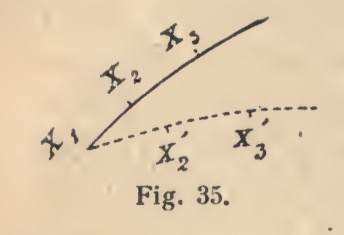
Figure 35
§ 2096. Si nous supprimons quelques équations du système qui détermine l'équilibre et le mouvement, un nombre, égal d'inconnues seront indéterminées (§ 130), et nous pourrons considérer les mouvements virtuels ; c'est-à-dire que nous pourrons faire varier certains indices et déterminer les autres [FN: § 2096-1]. En cela se manifestera la mutuelle dépendance des éléments.
§ 2097. Pour nous servir du langage vulgaire, nous dirons que tous les éléments considérés déterminent l'état d'équilibre (§ 2070), qu'il existe certaines liaisons (§ 126), et que si, par hypothèse, nous en supprimons quelques-unes, on pourra considérer des changements hypothétiques de la société (mouvements virtuels) [FN: § 2097-1] . Pour mieux comprendre la mutuelle dépendance, qui apparaît d'emblée avec le langage mathématique, nous ajouterons que les sentiments dépendent des conditions économiques, comme celles-ci dépendent de ceux-là, et qu'il existe des dépendances analogues entre les autres éléments.
§ 2098. L'examen des faits nous permet de pousser notre étude au delà de ces considérations générales. Pour nous servir du langage mathématique, nous dirons que les variables ne sont pas de même nature dans toutes les équations, ou, pour mieux dire, qu'on peut les supposer approximativement de nature différente.
§ 2099. Tout d'abord, on remarque qu'il existe des groupes diversement variables. Bornons-nous à une grossière approximation, et réduisons-les à trois. L'un d'eux est si peu variable que, pour une durée pas trop longue, il est possible de le considérer comme constant (conditions géographiques, climatériques, géologiques, etc.). On peut donc le faire passer dans le groupe des quantités constantes. Un autre groupe est peu variable (par exemple les classes des résidus). On peut le supposer constant pour une courte durée ; mais ensuite il faut tenir compte du fait qu'il varie si le temps se prolonge. Un autre est assez variable (par exemple, les connaissances intellectuelles) ; un autre est très variable (par exemple, les dérivations).
§ 2100. Ensuite, il faut faire attention que, toujours approximativement, on peut diviser en différents groupes les équations qui déterminent l'équilibre, de telle sorte que la mutuelle dépendance avec les autres groupes devient négligeable. Nous avons de bons exemples de ce phénomène en économie pure. Il peut y avoir des équations où figurent seulement deux variables. En ce cas, on peut dire que l'une est déterminée par l'autre.
§ 2101. Pour nous servir du langage vulgaire, nous dirons que, dans la détermination de l'équilibre, on peut considérer certains éléments comme constants pour une assez longue durée ; d'autres comme constants pour une durée moins longue, mais toujours pas courte ; d'autres comme variables, etc. Nous ajouterons que, au moins approximativement, et dans une première approximation, la mutuelle dépendance peut être considérée seulement en certains groupes d'éléments, les divers groupes étant supposés indépendants. Quand l'un de ces groupes se réduit à deux éléments, et que l'un de ceux-ci est presque constant, on peut dire que cet élément est la cause et l'autre l'effet.
§ 2102. Par exemple, si, par hypothèse, on détache des autres éléments la situation géographique d'Athènes et sa prospérité commerciale, au temps de Périclès, on peut dire que le premier élément est la cause, et le second l'effet. Mais nous avons constitué ce groupe arbitrairement. Si ces deux éléments étaient unis indissolublement, puisque le premier n'a pas changé, le second ne devait pas changer non plus, et puisque, au contraire, le second a changé, cela signifie qu'il ne dépendait pas exclusivement du premier, qu'il n'était pas l'effet de cette cause.
§ 2103. Autre exemple. Si, pour Rome antique, nous formons un groupe constitué par les mœurs et par la prospérité politique et économique, et si nous admettons, par hypothèse, que les mœurs étaient, au temps des guerres puniques, meilleures qu'à la fin de la République ; si nous admettons, en outre, une autre hypothèse, à savoir que les mœurs et la prospérité forment un groupe indépendant, nous pourrons dire, avec beaucoup d'auteurs, que les bonnes mœurs furent la cause de la prospérité de Rome. Mais voici que les mêmes auteurs ou d'autres nous disent que la prospérité de Rome fut la cause de la corruption des mœurs. Au sens ordinaire que l'on donne au terme cause, cette proposition contredit la précédente. Elles peuvent subsister ensemble si, faisant abstraction du rapport de cause à effet, on parle uniquement d'une mutuelle dépendance. Sous cette forme, on pourrait énoncer le rapport entre les mœurs et la prospérité d'un peuple en disant que les bonnes mœurs accroissent la prospérité, laquelle réagit sur les mœurs et les corrompt. Ni cette proposition ni les précédentes ne concordent avec les faits ; mais ici, nous n'avons pas à nous occuper de cela.
§ 2104. On comprend aisément qu'au lieu d'un groupe de deux éléments, on puisse considérer un groupe d'un plus grand nombre d'éléments, puis divers groupes, chacun constitué de plusieurs éléments. C'est là le seul procédé dont nous disposons pour obtenir des solutions approximatives, qui s'amélioreront à mesure qu'augmentera le nombre des éléments et des groupes considérés (§ 2203 et sv.).
§ 2105. LES PROPRIÉTÉS DU SYSTÈME SOCIAL. Un système d'atomes et de molécules matérielles possède certaines propriétés thermiques, électriques et autres. D'une manière analogue, un système constitué par des molécules sociales a, lui aussi, certaines propriétés qu'il importe de considérer. L'une d'elles fut de tout temps perçue par intuition, ne fût-ce que d'une façon grossière. C'est à elle qu'avec peu ou point de précision on a donné le nom d'utilité, de prospérité, ou un autre semblable. Nous devons maintenant rechercher dans les faits si, sous ces expressions indéterminées, il y a quelque chose de précis, et en découvrir la nature. L'opération à laquelle nous procédons est analogue à celle qu'ont effectuée les physiciens, lorsqu'aux concepts vulgaires et indéterminés du chaud et du froid, ils substituèrent le concept précis de la température.
§ 2106. Portons notre attention sur ce qu'on nomme prospérité économique, morale, intellectuelle, puissance militaire, politique, etc. Si nous voulons traiter scientifiquement de ces entités, il est nécessaire de pouvoir les définir rigoureusement ; et si nous voulons les introduire dans la détermination de l'équilibre social, il est nécessaire de pouvoir, en quelque manière, les faire correspondre à des quantités, fût-ce par de simples indices.
§ 2107. On a pu faire cela en économie pure ; c'est la cause du progrès de cette science ; mais on ne peut le faire également en sociologie. Toujours comme d'habitude, nous surmonterons cette difficulté en substituant de grossières approximations aux données précises en nombres, qui nous font défaut. De même, celui qui ne dispose pas d'une table de mortalité est obligé de se contenter de l'approximation grossière qu'on obtient, en reconnaissant que la mortalité commence à être grande dans les premières années de l'enfance, puis diminue, puis croît de nouveau, dans les dernières années (§ 144). C'est peu, très peu de chose ; mais c'est mieux que rien ; et le moyen d'accroître ce peu est, non pas de le rejeter, mais de le conserver et d'y faire des adjonctions successives.
§ 2108. Si nous demandons : « L'Allemagne est-elle, maintenant, en 1913, plus puissante militairement et politiquement qu'en 1860 ? », tout le monde répondra oui. Si, ensuite, nous demandons : « De combien exactement ? », personne ne pourra répondre. On peut répéter la même chose pour des questions semblables ; et l'on comprend que les choses nommées puissance militaire, politique, intellectuelle, etc., sont susceptibles de croître ou de diminuer, sans d'ailleurs que nous puissions assigner des nombres précis qui leur correspondent dans les différents états.
§ 2109. Moins précise encore est l'entité prospérité et force d'un pays, laquelle résume ces diverses puissances. Pourtant chacun comprend que la prospérité et la puissance de la France, par exemple, sont plus grandes que celles de l'Abyssinie, et qu'aujourd'hui, en 1913, elles sont plus grandes qu'immédiatement après la guerre de 1870. Tout le monde comprend, sans qu'il y ait besoin d'aucune précision numérique, la différence entre Athènes au temps de Périclès, et Athènes après la bataille de Chéronée, entre la Rome d'Auguste et la Rome d'Augustule. Des différences même beaucoup plus légères sont perçues et évaluées tant bien que mal. C'est pourquoi, si la précision des nombres nous fait défaut, nous avons cependant toujours du phénomène une idée pas trop éloignée de la vérité. On peut ensuite descendre aux détails et considérer les différentes parties de cet ensemble.
§ 2110. Pour avoir une idée plus précise, il est nécessaire d'énoncer les normes, en partie arbitraires, que l'on entend suivre pour déterminer les entités que l'on veut définir. L'économie pure a pu le faire : elle a choisi une norme unique, soit la satisfaction de l'individu, et a établi qu'il est l'unique juge de cette satisfaction. C'est ainsi qu'on a défini l'utilité économique ou ophélimité. Mais si nous nous posons le problème, très simple aussi, de rechercher ce qui est le plus profitable à l'individu, abstraction faite de son jugement, aussitôt apparaît la nécessité d'une norme, qui est arbitraire. Par exemple, dirons-nous qu'il lui est avantageux de souffrir physiquement pour jouir moralement, ou vice versa ? Dirons-nous qu'il lui est avantageux de rechercher uniquement la richesse ou de se préoccuper d'autre chose ? [FN: § 2110-1] En économie pure, nous lui laissons le soin de décider. Si maintenant nous voulons le priver de cet office, il faut que nous trouvions quelqu'un d'autre à qui le confier.
§ 2111. L'UTILITÉ. Quel que soit le juge que l'on veuille choisir, quelles que soient les normes que l'on décide de suivre, les entités qui sont déterminées de cette façon jouissent de certaines propriétés communes. Nous allons les étudier. Donc, après avoir fixé les normes suivant lesquelles il nous plaît de déterminer un certain état limite dont on suppose qu'un individu, ou une collectivité, se rapprochent, et après avoir donné un indice numérique aux différents états qui se rapprochent plus ou moins de cet état limite, de telle sorte que l'état le plus rapproché ait un indice plus grand que celui de l'état qui s'en écarte le plus, nous dirons que ces indices sont ceux d'un état X. Puis, comme d'habitude, uniquement pour éviter l'ennui que procure dans le discours l'usage de simples lettres de l'alphabet, nous substituerons à la lettre X un nom quelconque. Ce nom, toujours comme d'habitude, afin d'éviter de trop fréquents néologismes, nous l'emprunterons à quelque phénomène analogue. Quand on sait ou qu'on croit savoir qu'une chose « est avantageuse » à un individu, à une collectivité, on dit qu'il est « utile » que l'un et l'autre s'efforcent d'obtenir cette chose, et l'on estime que l'utilité dont ils jouissent est d'autant plus grande qu'ils se rapprochent le plus de la possession de cette chose. C'est pourquoi, par simple analogie, et pour aucun autre motif, nous donnerons le nom d'UTILITÉ à l'entité X définie tantôt [FN: § 2111-1] .
§ 2112. Il faut prendre garde que, précisément parce que le nom est déduit d'une simple analogie, l'utilité ainsi définie peut parfois concorder tant bien que mal avec l'utilité du langage vulgaire ; mais, d'autres fois, elle peut ne pas concorder, tant et si bien qu'elle peut être exactement le contraire. Par exemple, si nous fixons comme état limite pour un peuple celui de la prospérité matérielle, notre utilité diffère peu de l'entité à laquelle les hommes pratiques donnent ce nom ; mais elle diffère grandement de l'entité que l'ascète a en vue. Vice versa, si nous fixons comme état limite celui du parfait ascétisme, notre utilité coïncidera avec l'entité que l'ascète a en vue, mais différera entièrement de celle que vise l'homme pratique.
Enfin, comme en ce cas les hommes ont l'habitude de désigner du même nom des choses contraires, il ne nous reste de choix qu'entre deux manières de nous exprimer : 1° nous écarter résolument du langage vulgaire, donner des noms différents à ces choses différentes, et comme elles sont assez nombreuses, nous aurons de nombreux néologismes ; 2° conserver un même nom à ces choses, en faisant attention qu'il les désigne seulement d'une manière générale, comme le nom d'une classe d'objets, comme en chimie le nom de corps simple, en zoologie le nom de mammifère, etc., et que les espèces appartenant à cette classe seront fixées d'après le critère choisi pour déterminer l'utilité.
§ 2113. Il est certainement regrettable qu'un seul terme désigne des choses différentes. C'est pourquoi il serait bon d'éviter l'usage du terme utilité dans le sens défini au § 2111, sens qui concorde avec l'un de ceux que ce terme a en langage vulgaire, et d'y substituer l'usage d'un nouveau terme, ainsi qu'on l'a fait en économie, où l'on a disjoint l'ophélimité et l'utilité. Je crois qu'il viendra un temps où il sera nécessaire de le faire. Si je m'en abstiens ici, c'est uniquement par crainte d'abuser des néologismes [FN: § 2113-1].
§ 2114. Prenons garde d'ailleurs qu'un seul terme nouveau ne nous tirera pas entièrement d'embarras. En effet, même quand on considère l'une des utilités particulières, à propos du but, par exemple celle qui est en rapport avec la prospérité matérielle, on trouve encore diverses espèces d'utilités, eu égard aux personnes ou aux collectivités, à la manière dont on les obtient, à la conception qu'en ont les hommes, et à d'autres semblables circonstances.
§ 2115. Tout d'abord, il faut distinguer les cas, suivant qu'il s'agit de l'individu, de la famille, d'une collectivité, d'une nation, de la race humaine. Il ne faut pas seulement considérer l'utilité de ces diverses entités ; il faut encore établir une distinction : séparer leurs utilités directes de celles qu'elles produisent indirectement, grâce à leurs rapports mutuels. Par conséquent, négligeant d'autres distinctions qu'il serait peut-être bon d'établir, et nous bornant à celles qui sont vraiment indispensables, nous devons tenir compte des genres suivants :
-
Utilité de l'individu ; (a -1) Utilité directe ; (a -2) Utilité indirecte, obtenue parce que l'individu fait partie d'une collectivité ; (a -3) Utilité d'un individu, en rapport avec les utilités des autres individus ;
-
Utilité d'une collectivité donnée ; on peut établir pour ce genre d'utilités des distinctions analogues aux précédentes ;
(b -1) Utilité directe pour la collectivité, considérée séparément des autres collectivités ; (b -2) Utilité indirecte, obtenue par l'influence d'autres collectivités ; (b -3) Utilité d'une collectivité, en rapport avec les utilités des autres collectivités.
Bien loin de concorder, ces diverses utilités sont souvent en opposition manifeste. Nous avons déjà vu un grand nombre d'exemples de ces phénomènes (§ 1975 et sv.). Les théologiens et les métaphysiciens, par amour de l'absolu, qui est unique, les moralistes, pour inciter l'individu à s'occuper du bien d'autrui, les hommes d'État, pour l'inciter à confondre son utilité personnelle avec celle de sa patrie, et d'autres personnes, pour de semblables motifs, ont coutume de ramener, parfois explicitement, souvent implicitement, toutes les utilités à une seule.
§ 2116. En demeurant dans le domaine logico-expérimental, on peut établir d'autres distinctions et considérer les diverses utilités de deux manières : telles que se les représente l'un des membres de la collectivité, ou telles que les voit un étranger, ou l'un des membres de la collectivité, qui s'efforce, autant qu'il le peut, de porter un jugement objectif. Par exemple, un individu qui ressent fortement l'utilité directe (a-1), et peu ou point l'utilité indirecte (a-2), soignera simplement ses intérêts, sans se soucier de ses concitoyens, tandis que celui qui juge objectivement les actions de cet individu verra qu'il sacrifie la collectivité à son profit.
§ 2117. Nous n'avons pas encore fini de faire des distinctions. Chacune des espèces indiquées au § 2115 peut être considérée suivant le temps, c'est-à-dire au présent et aux divers temps futurs. L'opposition entre ces différentes utilités ne peut être moindre que pour les précédentes, ni moindre non plus la différence pour qui se laisse guider par le sentiment et pour qui considère ces utilités objectivement.
§ 2118. Afin de donner une forme beaucoup plus concrète au raisonnement, considérons spécialement une des utilités, celle qui est en rapport avec la prospérité matérielle. Dans la mesure où les actions humaines sont logiques, on peut, à la rigueur, observer que l'homme qui va à la guerre et qui ignore s'il restera sur un champ de bataille ou s'il reviendra chez lui, agit poussé par des considérations d'utilité individuelle, directe ou indirecte, puisqu'il compare l'utilité probable, au cas où il reviendrait sain et sauf, avec le dommage probable, au cas où il mourrait ou serait blessé. Mais ce raisonnement ne s'applique plus à l'homme qui va à une mort certaine pour la défense de sa patrie. Il sacrifie délibérément son utilité individuelle à l'utilité de sa nation. Nous sommes ici dans le cas de l'utilité subjective indiquée au § 2117.
§ 2119. La plupart du temps, l'homme accomplit ce sacrifice par une action non-logique, et les considérations subjectives d'utilité ne se font pas ; il ne reste que les considérations objectives que peut faire celui qui observe les phénomènes. Tel est le cas pour les animaux, dont beaucoup, poussés par l'instinct, se sacrifient pour le bien d'autres sujets de leur espèce : la poule qui affronte la mort en défendant ses poussins ; le coq pour défendre la poule ; la chienne pour défendre ses petits, et ainsi de suite ; par instinct, ils sacrifient leur vie pour l'utilité de leur espèce. Les espèces animales très prolifiques l'emportent en sacrifiant les individus. On tue les souris par milliers, et il en reste toujours. Le phylloxéra a vaincu l'homme et s'est rendu maître de la vigne. L'utilité d'aujourd'hui s'oppose souvent à celle des jours prochains, et l'opposition donne naissance aux phénomènes bien connus sous le nom de prévoyance et d'imprévoyance, pour les individus, pour les familles, pour les nations.
§ 2120. UTILITÉ TOTALE. Si l'on tient compte, pour un individu, des trois genres d'utilité indiqués au § 2115, on a, en conclusion, l'utilité totale dont jouit l'individu. Par exemple, l'individu peut retirer, d'une part un dommage direct, d'autre part une utilité indirecte, comme membre d'une collectivité ; et cette utilité indirecte peut être assez grande pour compenser et au delà le dommage direct, de sorte qu'en fin de compte il reste une certaine utilité. Il en va de même pour une collectivité. Si l'on pouvait avoir des indices pour ces différentes utilités, en les additionnant, on aurait l'utilité totale de l'individu ou de la collectivité.
§ 2121. MAXIMUM D'UTILITÉ D'UN INDIVIDU ou D'UNE COLLECTIVITÉ. Comme l'utilité à laquelle nous venons de faire allusion a un indice, il peut se faire qu'en un certain état elle ait un indice plus grand qu'en des états voisins, c'est-à-dire que nous ayons un maximum. Pratiquement, fût-ce d'une manière confuse, des problèmes de cette sorte sont perçus par intuition. Nous en avons rencontré un déjà sur notre chemin, quand nous avons recherché l'utilité qu'un individu pouvait avoir à suivre certaines règles existant dans la société (§ 1897 et sv.), ou, plus généralement, l'utilité qu'il pouvait retirer en visant certains buts idéaux (§ 1876 et sv.). Nous n'avons considéré alors que la solution qualitative des problèmes, et là même nous n'avons pu pousser bien loin, parce qu'une définition rigoureuse de l'utilité nous faisait défaut. Il est donc nécessaire de revenir sur ce sujet.
§ 2122. Quand on considère, pour un individu, un genre déterminé d'utilité, on a des indices des utilités partielles et aussi un indice de l'utilité totale ; c'est ce qui nous permet d'estimer l'utilité dont jouit l'individu, en des circonstances données. En outre, si en même temps que celles-ci varient, l'indice de l'utilité totale, après avoir commencé par croître, finit par décroître, il y aura un certain point où cet indice sera maximum. Tous les problèmes posés précédemment d'une manière qualitative (§ 1876 et sv. ; § 1897 et sv.) deviennent alors quantitatifs, et aboutissent à des problèmes de maxima. Par exemple, au lieu de rechercher si, en observant certaines règles, un individu fait son bonheur, nous aurons à rechercher si et de combien s'accroît son ophélimité ; et, entrés dans cette voie, nous en viendrons à rechercher comment et quand cette ophélimité devient maxima.
§ 2123. Les problèmes particuliers posés au § 1897 sont compris dans les problèmes plus généraux du § 1876, et ceux-ci, à leur tour, font partie d'une catégorie encore plus générale. Si l'état d'un individu dépend d'une certaine circonstance à laquelle on peut assigner des indices variables, et si, pour chacun de ces indices nous pouvons connaître l'indice de l'utilité totale pour un individu (ou pour une collectivité considérée comme un individu), nous pourrons connaître la position de l'individu (ou de la collectivité) à laquelle cette utilité atteint un maximum.
§ 2124. Enfin, si nous répétons cette opération pour toutes les circonstances dont dépend l'équilibre social, lorsque les liaisons seront données, nous aurons autant d'indices parmi lesquels nous pourrons en choisir un plus grand que tous ceux qui l'avoisinent ; et cet indice correspondra au maximum d'utilité, toutes les circonstances mentionnées plus haut entrant en ligne de compte.
§ 2125. Si difficiles que soient pratiquement ces problèmes, ils sont théoriquement plus faciles que d'autres dont nous devons parler maintenant.
§ 2126. Jusqu'à présent, nous avons considéré les maxima d'utilité d'un individu séparé des autres, d'une collectivité séparée des autres ; il nous reste à étudier ces maxima lorsqu'on compare entre eux les individus ou les collectivités. Pour abréger, nous nommerons seulement les individus, dans la suite de cet exposé, mais le raisonnement s'appliquera aussi à la comparaison entre collectivités distinctes. Si les utilités des individus étaient des quantités homogènes, et que, par conséquent, on pût les comparer et les additionner, notre étude ne serait pas difficile, au moins théoriquement. On additionnerait les utilités des divers individus, et l'on aurait l'utilité de la collectivité constituée par eux. Nous reviendrions ainsi aux problèmes déjà étudiés.
§ 2127. Mais les choses ne vont pas si facilement. Les utilités des divers individus sont des quantités hétérogènes, et parler d'une somme de ces quantités n'a aucun sens ; il n'y en a pas : on ne peut l'envisager. Si l'on veut avoir une somme qui soit en rapport avec les utilités des divers individus, il est nécessaire de trouver tout d'abord un moyen de faire dépendre ces utilités de quantités homogènes, que l'on pourra ensuite additionner.
§ 2128. MAXIMUM D'OPHÉLIMITÉ POUR UNE COLLECTIVITÉ, EN ÉCONOMIE POLITIQUE. Un problème d'une nature analogue à celle du précédent s'est posé en économie politique, et a dû être résolu par cette science. Il sera utile que nous en donnions un rapide aperçu, pour nous préparer à la solution beaucoup plus difficile du problème sociologique. En économie politique, nous pouvons déterminer l'équilibre sous la condition que chaque individu obtienne le maximum d'ophélimité. Les liaisons peuvent être données de telle sorte que cet équilibre soit parfaitement déterminé. Maintenant, si l'on supprime quelques liaisons, cette détermination unique cessera, et l'équilibre sera possible en une infinité de points pour lesquels les maxima d'ophélimité individuels sont atteints. Dans le premier cas, seuls étaient possibles les mouvements qui amenaient au point d'équilibre déterminé ; dans le second, d'autres mouvements sont possibles aussi. Ces derniers sont de deux genres bien distincts. Dans le premier genre, que nous nommerons P, les mouvements sont tels qu'en agissant dans l'intérêt de certains individus, on nuit nécessairement à d'autres. Dans le second genre, que nous nommerons Q, les mouvements sont tels que l'on agit dans l'intérêt, ou au détriment de tous les individus, sans exception. Les points P sont déterminés lorsqu'on égale à zéro une certaine somme de quantités homogènes dépendant des ophélimités hétérogènes [FN: § 2128-1].
§ 2129. La considération des deux genres de points P et Q est d'une grande importance en économie politique. Quand la collectivité se trouve en un point Q dont elle peut s'éloigner à l'avantage de tous les individus, en leur procurant à tous de plus grandes jouissances, il est manifeste qu'au point de vue économique et si l'on ne recherche que l'avantage de tous les individus qui composent la collectivité, il convient de ne pas s'arrêter en un tel point, mais de continuer à s'en éloigner tant que c'est à l'avantage de tous. Lorsque ensuite ou arrive en un point P où cela n'est plus possible, il faut, pour s'arrêter on pour continuer, recourir à d'autres considérations, étrangères à l'économie ; c'est-à-dire qu'il faut décider, au moyen de considérations d'utilité sociale, éthiques ou autres quelconques, dans l'intérêt de quels individus il convient d'agir, en en sacrifiant d'autres. Au point de vue exclusivement économique, une fois la collectivité parvenue en un point P, il convient qu'elle s'arrête. Ce point a donc, dans le phénomène, un rôle analogue à celui du point où l'on obtient le maximum d'ophélimité individuel, et auquel, par conséquent, l'individu s'arrête. À cause de cette analogie, on l'appelle : point du maximum d'ophélimité pour la collectivité [FN: § 2129-1]. Mais, comme d'habitude, il n'y a rien à déduire de l'étymologie de ces termes (§ 2076) ; et pour éviter le danger toujours imminent de divagations de cette sorte, nous continuerons à nommer ce point, point P.
§ 2130. Si une collectivité pouvait être considérée comme une personne, elle aurait un maximum d'ophélimité, ainsi que l'a cette personne ; c'est-à-dire qu'il y aurait des points où l'ophélimité de la collectivité serait maxima. Ces points différeraient des points Q indiqués au § 2128. En effet, puisqu'il est possible de s'éloigner de ces points à l'avantage de tous les individus de la collectivité, il est évident que, de cette façon, on peut faire croître l'ophélimité de la collectivité. Mais on ne peut pas dire que ces points coïncideraient avec les points P. Considérons une collectivité constituée par deux individus, A et B. Nous pouvons nous éloigner d'un certain point P, en ajoutant 5 à l'ophélimité de A et en retranchant 2 de l'ophélimité de B, nous portant ainsi en un point s ; ou bien ajoutant 2 à l'ophélimité de A, et retranchant 1 à l'ophélimité de B, nous portant ainsi en un point t. Nous ne pouvons pas savoir auquel de ces deux points s, t, l'ophélimité de la collectivité sera plus grande ou moins grande, tant qu'on ne nous dit pas de quelle façon on peut comparer les ophélimités de A et de B ; et c'est précisément parce qu'on ne peut les comparer, parce qu'elles sont des quantités hétérogènes, que le maximum d'ophélimité de la collectivité n'existe pas ; tandis qu'au contraire le maximum d'ophélimité pour la collectivité peut exister, puisqu'on le détermine indépendamment de toute comparaison entre les ophélimités d'individus différents.
§ 2131. LE MAXIMUM D'UTILITÉ POUR UNE COLLECTIVITÉ, EN SOCIOLOGIE [FN: § 2131-1]. Étendons les considérations précédentes à la sociologie. Chaque individu, dans la mesure où il agit logiquement, s'efforce d'obtenir un maximum d'utilité individuelle, ainsi que nous l'avons indiqué au § 2122. Si nous supposons qu'une partie des liaisons qu'impose l'autorité publique sont supprimées, sans être remplacées par d'autres, une infinité de positions d'équilibre deviennent possibles avec les conditions de maxima individuels indiquées plus haut. L'autorité publique intervient pour en imposer quelques-unes et en exclure d'autres. Supposons qu'elle agisse logiquement et dans le seul dessein d'obtenir une certaine utilité. Cela a lieu bien rarement, mais il n'est pas nécessaire de nous préoccuper ici de ce fait, puisque nous considérons, non pas un cas réel et concret, mais bien un cas théorique et hypothétique. Pour ce cas, l'autorité publique doit nécessairement comparer les différentes utilités ; il n'est pas nécessaire de rechercher maintenant d'après quels critères. Lorsque, par exemple, elle met en prison le voleur, elle compare les souffrances qu'elle lui impose avec l'utilité qui en résulte pour les honnêtes gens, et elle estime grosso modo que cette utilité compense au moins ces souffrances ; autrement, elle laisserait courir le voleur [FN: § 2131-2] . Pour abréger, nous n'avons comparé ici que deux utilités ; mais il va sans dire que, tant bien que mal, et souvent plutôt mal que bien, l'autorité compare toutes les utilités dont elle peut avoir connaissance. En somme, elle accomplit grossièrement l'opération que l'économie pure effectue avec rigueur, et, au moyen de certains coefficients, elle rend homogènes des quantités hétérogènes. Cela fait, on peut additionner les quantités obtenues. et déterminer, par conséquent, des points du genre P.
§ 2132. En pratique, on se rend compte de tout cela, plus ou moins bien, souvent mal, très mal, et l'on dit que l'autorité publique doit s'arrêter au point à partir duquel, en continuant, elle ne procurerait aucun « avantage » à toute la collectivité ; qu'elle ne doit pas infliger de souffrances « inutiles » à la collectivité entière ni à une partie de la collectivité ; qu'elle doit agir tant qu'elle peut dans l'intérêt de cette collectivité, sans que ce soit au détriment du but qu'elle a en vue « pour le bien public » ; qu'elle doit « proportionner » l'effort au but, et ne pas imposer de lourds sacrifices avec de petits « avantages ». La définition précédente a pour objet de substituer des considérations rigoureuses à ces expressions manquant de toute précision et fallacieuses par leur indétermination.
§ 2133. En économie pure, on ne peut pas considérer une collectivité comme une personne ; en sociologie, on peut considérer une collectivité, sinon comme une personne, au moins comme une unité. L'ophélimité d'une collectivité n'existe pas. On peut, à la rigueur, envisager l'utilité d'une collectivité. C'est pourquoi, en économie pure, il n'y a pas danger de confondre le maximum d'ophélimité pour une collectivité avec le maximum d'ophélimité d'une collectivité, lequel n'existe pas ; tandis qu'en sociologie, il faut faire bien attention de ne pas confondre le maximum d'utilité pour une collectivité avec le maximum d'utilité d'une collectivité, puisque tous deux existent.
§ 2134. Considérons, par exemple, l'augmentation de la population. Si l'on fixe son attention sur l'utilité de la collectivité, il sera bon, surtout pour sa puissance militaire et politique, de pousser la population jusqu'à la limite, assez élevée, au delà de laquelle la nation s'appauvrirait et la race tomberait en décadence. Mais si nous attachons notre esprit au maximum d'utilité pour la collectivité, nous trouverons une limite beaucoup plus basse [FN: § 2134-1] . Il y aura lieu de rechercher en quelles proportions les différentes classes sociales jouissent de cette augmentation de puissance militaire et politique, et en quelle proportion diverse elles l'acquièrent par leurs sacrifices. Quand les prolétaires disent qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants, lesquels ne font qu'accroître le pouvoir et les gains des classes gouvernantes, ils parlent d'un problème de maximum d'utilité pour la collectivité. Peu importent les dérivations dont ils usent, telles que celles de la religion du socialisme ou du pacifisme : il faut regarder ce qu'il y a dessous. Les classes gouvernantes répondent souvent en confondant un problème de maximum de la collectivité avec le problème de maximum pour la collectivité. Elles essaient aussi de ramener le problème à la recherche d'un maximum d'utilité individuelle, en tâchant de faire croire aux classes gouvernées qu'il y a une utilité indirecte, laquelle, si l'on en tient dûment compte, change en avantage le sacrifice que l'on demande à ces classes. Effectivement, cela peut arriver quelquefois ; mais cela n'arrive pas toujours ; et nombreux sont les cas où, même en tenant largement compte des avantages indirects, il résulte, non pas un avantage, mais bien un sacrifice pour les classes gouvernées. En réalité, seules les actions non-logiques sont capables de faire qu'en ces cas les classes gouvernées, oubliant le maximum d'utilité individuelle, se rapprochent du maximum d'utilité de la collectivité, ou bien seulement de celui de la classe gouvernante. Celle-ci a très souvent compris ce fait par intuition.
§ 2135. Supposons une collectivité en des conditions telles qu'il n'y ait pour elle d'autre choix que d'être très riche avec une grande inégalité de revenus pour ses membres, ou bien d'être pauvre avec des revenus presque égaux. La recherche du maximum d'utilité de la collectivité peut faire approcher du premier état ; celle du maximum pour la collectivité peut faire approcher du second. Nous disons peut, parce que l'effet dépendra des coefficients employés pour rendre homogènes les utilités hétérogènes des différentes classes sociales. L'admirateur du « surhomme » assignera à l'utilité des classes inférieures un coefficient presque égal à zéro, et obtiendra un point d'équilibre qui se rapproche beaucoup du premier état. L'homme entiché de l'égalité assignera à l’utilité des classes inférieures un coefficient élevé, et obtiendra un point d'équilibre qui se rapprochera beaucoup du second état. Nous n'avons pas d'autre critère que le sentiment, pour choisir entre l'un et l'autre état.
§ 2136. Il existe une théorie – nous ne recherchons pas ici jusqu'à quel point elle concorde avec les faits – suivant laquelle l'esclavage fut une condition nécessaire du progrès social, parce que – dit-on – il a permis à un certain nombre d'hommes de vivre dans les loisirs, et par conséquent de s'occuper de recherches intellectuelles. Cela étant admis pour un moment, celui qui veut résoudre un problème de maximum d'utilité de l'espèce et regarde seulement à l'utilité de l'espèce, décidera que l'esclavage a été « utile »; celui qui veut résoudre aussi un problème de ce genre, mais regarde seulement à l'utilité des hommes réduits en esclavage, décidera que l'esclavage a été nuisible, et il laissera de côté, pour le moment, certains effets indirects. On ne peut demander : « Qui a raison ? Qui a tort ? » parce que ces termes n'ont pas de sens, tant qu'on n'a pas choisi un critère pour établir la comparaison entre ces deux décisions (§ 17).
§ 2137. De là nous devons conclure, non pas qu'il est impossible de résoudre des problèmes qui considèrent en même temps différentes utilités hétérogènes, mais bien que, pour traiter de ces utilités hétérogènes, il faut admettre quelque hypothèse qui les rende comparables. Lorsque cette hypothèse fait défaut, ce qui arrive très souvent, traiter de ces problèmes est absolument vain ; c'est simplement une dérivation dont ou recouvre certains sentiments, sur lesquels seuls, par conséquent, nous devrons fixer notre attention, sans trop nous soucier de leur enveloppe.
§ 2138. Même dans les cas où l'utilité de l'individu n'est pas en opposition avec celle de la collectivité, les points de maximum de la première et les points de maximum de la seconde ne coïncident habituellement pas. Revenons, pour un moment, au cas particulier étudié aux § 1897 et sv. Soit, pour un individu donné, A le point extrême qui représente l'observation très stricte de tout précepte existant dans la société, B un autre point extrême qui représente la transgression des préceptes qui ne sont pas reconnus comme proprement indispensables, mnp la courbe d'utilité de l'individu, lequel commence à éprouver un dommage en A, puis obtient un avantage qui devient maximum en n, qui diminue ensuite et se change en un dommage en B. D'une manière analogue, soit srv, la courbe de l'utilité qu'obtient la société, par le fait que l'individu considéré observe plus ou moins bien les préceptes. Cette utilité a un maximum en r. Au point q, intermédiaire entre A et B, on a, pour l'individu, le maximum d'utilité qn. Au point t, intermédiaire aussi entre A et B, on a le maximum d'utilité tr de la collectivité, lequel est obtenu par le fait de l'individu considéré [FN: § 2138-1] .
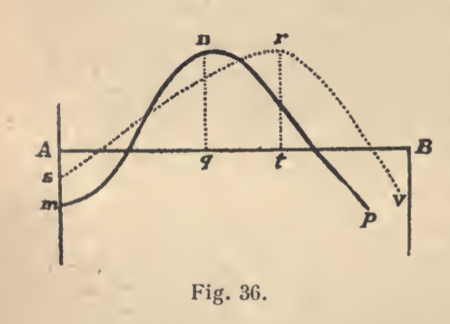
Figure 36
§ 2139. Au lieu d'un seul individu, on peut en considérer plusieurs qui aient à peu près la même courbe d'utilité m, n, p ; et alors la courbe srv d'utilité de la collectivité dont font partie les individus mentionnés, sera celle que l'on obtient en tenant compte des actions de ces individus. Au lieu de simples transgressions aux règles existant dans une société, considérons les transformations de ces règles et les innovations qui s'accomplissent dans la société. Nombreux sont les cas où t est beaucoup plus rapproché de B que q ; autrement dit, dans le cas de certains individus, il est avantageux pour la société que l'innovation soit plus grande que celle qui donnerait le maximum d'utilité à ces individus. Par exemple, les individus déjà riches et puissants ont souvent peu à gagner s'ils innovent, tandis que la société peut retirer grand avantage de leurs innovations. Ou bien encore : pour les individus aimant la vie tranquille, t est beaucoup plus près de B que q ; c'est-à-dire que, pour eux, toute innovation, qui d'ailleurs peut être utile à la société, leur est désagréable, pénible. Tout au contraire, pour les « spéculateurs », t est beaucoup plus loin de B que q ; c'est-à-dire que les spéculateurs tendent à innover plus qu'il n'est utile à la société. De cette façon, si nous considérons différentes catégories d'individus, on comprend qu'entre leurs actes il puisse y avoir une certaine compensation, grâce à laquelle, chacun tirant de son côté, il résulte une position toute proche de t, où l'on a le maximum d'utilité de la société.
§ 2140. RÉSIDUS ET DÉRIVATIONS EN RAPPORT AVEC L'UTILITÉ. Précédemment (§ 2123) nous avons considéré par abstraction certaines choses qui pouvaient agir sur l'équilibre social. Maintenant nous spécifions et considérons principalement les résidus et les dérivations. Nous avons déjà traité un sujet analogue, lorsque nous recherchions les mesures capables d'atteindre un certain but (§ 1825 et sv.). Le problème a été alors considéré qualitativement, et nous n'avons pas pu pousser bien avant, parce que la définition de l'utilité nous manquait « 2111 et sv.). Les mouvements virtuels ont été considérés, en général, par rapport à un but quelconque, et seulement d'une manière subordonnée par rapport à l'utilité. Maintenant, nous nous occuperons principalement de l'utilité.
§ 2141. Comme préparation à notre étude, laissons de côté pour un moment la société humaine, et supposons deux types extrêmes de sociétés abstraites. 1° Une société où agissent exclusivement les sentiments, sans raisonnements d'aucun genre. Très probablement, les sociétés animales se rapprochent beaucoup de ce type. 2° Une société où agissent exclusivement les raisonnements logico-expérimentaux. En recourant à l'intuition visuelle du § 1869, nous dirons que, dans le premier cas, les individus se portent instinctivement de h en m (fig. 29), sans raisonner, sans avoir en vue un but idéal T ; par conséquent, la tangente hT n'existe pas. Dans le second cas, les individus se portent de h en m, en vertu du seul raisonnement, et la tangente cesse d'exister, parce qu'elle se transforme en l'arc de courbe hm.
§ 2142. Dans le cas du premier type, la forme de la société est déterminée si l'on donne les sentiments et les circonstances extérieures dans lesquelles se trouve la société, ou bien si l'on donne seulement les circonstances, et si l'on ajoute la détermination des sentiments, au moyen des circonstances. Le darwinisme, poussé à l'extrême, donnait la solution complète du problème par le théorème de la survivance des individus les mieux adaptés aux circonstances [FN: § 2142-1] (§ 828, 1770). Pourtant, même en ce cas si simple, le voile qui recouvre ces sujets n'était pas entièrement déchiré. Tout d'abord, on pouvait demander : « Comment peut-il bien se trouver sur le même sol tant de variétés d'animaux ? L'une des espèces devrait être mieux adaptée que les autres, et les avoir par conséquent détruites. Ensuite, sous cette expression « mieux adaptée » se cachent les mêmes difficultés que nous avons rencontrées, quand nous avons traité de l'« utilité ». Le « mieux adapté » en vue de la prospérité individuelle peut ne pas être le «mieux adapté » en vue de la prospérité de l'espèce. Voyez, par exemple, les souris : elles subsistent uniquement grâce à leur extraordinaire fécondité. Supposons qu'il naisse certaines souris mieux adaptées que les autres pour fuir les pièges de l'homme, mais qui soient en même temps d'une moindre fécondité. Il se pourra qu'échappant aux pièges, elles se substituent à d'autres souris, puis qu'en raison de leur moindre fécondité l'espèce disparaisse.
§ 2143. Dans le cas du 2e type, la forme de la société n'est pas du tout déterminée lorsqu'on donne les circonstances extérieures ; il faut encore indiquer quel est le but que doit atteindre la société au moyen du raisonnement logico-expérimental. N'en déplaise aux humanitaires et aux positivistes, une société déterminée exclusivement par la « raison » n'existe pas et ne peut exister ; et cela, non pas parce que les « préjugés » des hommes les empêchent de suivre les enseignements de la « raison », mais parce que les données du problème que l'on veut résoudre par le raisonnement logico-expérimental font défaut (§ 1878, 1880 à 1882). Ici apparaît de nouveau l'indétermination de la notion d'utilité, indétermination que nous avons rencontrée déjà, lorsque nous avons voulu définir l'utilité (§ 2111). Les notions que les différents individus ont au sujet de ce qui est bien pour eux-mêmes ou pour autrui sont essentiellement hétérogènes, et il n'y a pas moyen de les réduire à l'unité.
§ 2144. Ce fait est nié par ceux qui croient connaître l'absolu. Ils ramènent toutes les opinions des hommes à la leur, car ils éliminent les autres par les procédés des dérivations, procédés dont nous avons donné de nombreux exemples ; mais cette élimination n'a de valeur que pour ces personnes et pour leurs adeptes, tandis que les autres hommes demeurent d'un avis différent.
§ 2145. Même les réformateurs de la société ne remarquent habituellement pas et négligent le fait de la diversité d'opinions des hommes, au sujet de l'utilité. C'est parce qu'ils tirent implicitement de leurs propres sentiments les données dont ils ont besoin. Ils disent et croient résoudre un problème objectif, qui est celui-ci : « Quelle est la meilleure forme sociale ? » ; tandis qu'ils résolvent, au contraire, ce problème subjectif : « Quelle est la forme qui satisfait le mieux mes sentiments ? [FN: § 2145-1] » Naturellement, le réformateur estime que ses sentiments doivent être ceux de tous les honnêtes gens, et que ces sentiments sont, non seulement excellents de leur propre nature, mais aussi très utiles à la société. Malheureusement, cette croyance ne change rien à la réalité.
§ 2146. La société humaine se trouve en un état intermédiaire des deux types indiqués tout à l'heure. Sa forme est déterminée, non seulement par les circonstances extérieures, mais aussi par les sentiments, les intérêts, les raisonnements logico-expérimentaux ayant pour but d'obtenir la satisfaction des sentiments et des intérêts, et aussi, d'une manière subordonnée, par les dérivations qui expriment, et parfois fortifient des sentiments et des intérêts, et qui servent, en certains cas, de moyen de propagande. Les raisonnements logico-expérimentaux ont une grande valeur, lorsque le but est donné et que l'on cherche les moyens propres à l'atteindre. Par conséquent, ils sont employés avec succès dans les arts et métiers, en agriculture, dans l'industrie, dans le commerce. Ainsi, à côté de nombreuses sciences techniques, on a pu constituer une science générale des intérêts, l'économie, qui suppose ces raisonnements employés exclusivement dans certaines branches de l'activité humaine. Ces raisonnements trouvent aussi leur application à la guerre, et ont donné naissance à la stratégie et à d'autres sciences semblables. Ils pourraient aussi s'appliquer à la science du gouvernement ; mais, jusqu'à présent, ils ont été employés comme arts individuels de gouverner, plutôt que pour constituer une science abstraite ; cela parce que le but n'est pas déterminé, ou que, s'il est déterminé, on ne veut pas le dévoiler. En général, pour ces motifs et pour d'autres, les raisonnements logico-expérimentaux ont joué un rôle effacé dans l'organisation de la société. Il n'y a pas encore de théories scientifiques en cette matière, et pour tout ce qui s'y rattache, les hommes sont mus beaucoup plus par les sentiments que par les raisonnements. Un certain nombre de personnes savent tirer profit de cette circonstance et s'en servir pour satisfaire leurs intérêts ; ce faisant, de temps à autre, elles utilisent opportunément des raisonnements en partie empiriques et en partie logico-expérimentaux.
§ 2147. Presque tous les raisonnements dont on fait usage en matière sociale sont des dérivations. Souvent, leur partie la plus importante est celle que l'on tait, qui est implicite (§ 1876), à peine mentionnée. En la recherchant, c'est-à-dire en étudiant de quels principes les conclusions pourraient bien être une conséquence, on peut, en de nombreux cas, parvenir à la connaissance des sentiments et des intérêts qui font accepter les conclusions auxquelles aboutit la dérivation. Pour mieux connaître la nature de ces dérivations, étudions deux exemples. Nous ne pourrons examiner que quelques-uns des principes implicites qu'on peut y supposer, parce que, à vouloir les chercher tous, on devrait prêter attention à l'infinité de motifs qui déterminent les opinions des hommes. Nos raisonnements sont strictement bornés aux dérivations et ne visent pas le fond du sujet. À ce propos, le lecteur voudra bien se rappeler le paragraphe (III-m) de la table III.
Exemple I. Examinons l'apologue bien connu, de Bastiat, au sujet de l'usage d'un rabot [FN: § 2147-1] , et la manière dont Bastiat se sert de cet apologue, dans sa controverse avec Proudhon [FN: § 2147-2] . La dérivation apparaît déjà dans le sujet de cette controverse. On veut savoir si l'intérêt du capital est légitime ou non [FN: § 2147-3] , et aucun des deux interlocuteurs n'essaie même de définir ce terme de légitime. Pour Bastiat, il semble que légitime veuille dire en accord avec ses sentiments, lesquels, par une dérivation des moins dissimulées (§ 591 et sv.), deviennent ceux de tous les hommes. Proudhon a aussi cette notion, mais il en ajoute un grand nombre d'autres semblables, pour mettre ses théories en accord avec les sentiments des personnes auxquelles il s'adresse [FN: § 2147-4] (dérivations de la IIIe classe), et cet accord s'établit facilement, car il a lieu entre des choses indéterminées que l'on étire comme on veut et jusqu'où l'on veut. Bastiat et Proudhon sont d'accord que le prêt est un service [FN: § 2147-5], mais ni l'un ni l'autre ne définit ce qu'il entend précisément par ce terme, et il arrive naturellement que chacun d'eux tire des conclusions différentes de la proposition qu'ils ont admise tous deux. Chez Bastiat domine l'idée que celui qui a rendu un « service » a « droit » à une rémunération. Chez Proudhon domine l'idée que les hommes d'une société se rendent mutuellement des « services », et que, par conséquent, leurs « droits » à des rémunérations se compensent. Ces propositions peuvent être vraies ou fausses, suivant le sens des termes qui y sont employés ; elles sont du genre des propositions du droit naturel. Proudhon indique ensuite un moyen pratique de réaliser cette compensation des rémunérations ; mais nous n'avons pas à nous occuper ici de ce sujet. Examinons seulement le principe implicite d'après lequel il faut d'abord reconnaître à quelle organisation s'appliquent la « justice » et le « droit », puis, d'une manière subordonnée, quel est, en pratique, le moyen de trouver cette organisation [FN: § 2147-6). Si le principe était exposé explicitement, aussitôt surgiraient les nombreux problèmes sur les multiples utilités, et sur les rapports dans lesquels elles peuvent se trouver avec les règles, quelles
qu'elles soient, qui portent les noms de « justice » et de « droit ». Les deux interlocuteurs ont quelque intuition de ces problèmes, et s'efforcent de démontrer – avec peu de succès, il est vrai – l'identité de la « justice » et du « droit » avec une « utilité » fort mal définie [FN: § 2147-7). Bastiat fait usage d'une dérivation très usitée, et qui consiste à présenter un exemple hypothétique en guise de démonstration (§ 1409). L'exemple peut trouver sa place dans les raisonnements logico-expérimentaux, s'il est donné uniquement pour faire mieux comprendre l'idée de l'auteur, mais jamais à titre de démonstration. Le syllogisme complet serait : un phénomène A supposé a pour conséquence B ; les phénomènes réels sont égaux ou semblables à A dans la partie que nous considérons ; donc, ils auront pour conséquence B. Mais en citant seul l'exemple hypothétique : A a pour conséquence B, on supprime souvent la proposition qu'il importerait le plus de démontrer, à savoir que les phénomènes réels sont égaux ou semblables à A ; et on laisse la conclusion implicite pour dissimuler cette suppression (§ 1406). L'exemple hypothétique de Bastiat est donné précisément par l'apologue du rabot ; mais on ne peut pas reprocher à l'auteur de supprimer la proposition affirmant que l'exemple est le type du phénomène réel, car il l'exprime clairement [FN: § 2147-8] . En revanche, on peut dire qu'il se trompe et que la réalité est différente. Bastiat réduit à deux les parties en présence : un homme qui a une scie et un rabot, et un autre homme qui veut faire des planches. Cette réduction va trop loin en ce qui concerne la ressemblance avec les phénomènes réels. On se rapprocherait un peu de la vérité en considérant trois hommes : un qui utilise les planches, deux qui les produisent, dont l'un n'a que ses deux mains pour travailler, et l'autre a la scie et le rabot. Cette petite modification de l'hypothèse suffit à changer entièrement les conclusions de Bastiat, même en acceptant sa façon de les tirer. Elles subsistent uniquement pour le consommateur, dans ses rapports avec le groupe des deux producteurs, mais elles n'ont plus aucune valeur pour répartir entre eux le produit de leur travail. En effet, le travailleur n'a aucun besoin de planches ; il est donc inutile de lui dire qu'en un an il en ferait une, à peine, sans la scie et le rabot, et qu'au contraire il en fait cent avec ces instruments. Le problème à résoudre est différent. Il y a un travail commun de l'ouvrier et du capitaliste, et l'on veut connaître en quelle proportion le produit de ce travail doit être réparti entre eux. Ce problème est insoluble, si l'on ne définit pas rigoureusement le terme doit, et l'apologue de Bastiat ne nous est, par conséquent, d'aucun secours. Celui qui estime que le produit doit revenir au « capital », tiendra pour usurpée la part qui va à l'ouvrier, en sus de ce qui est strictement nécessaire pour le maintenir dans des conditions telles qu'il puisse travailler, et il conclura en faveur de l'esclavage, ou de toute autre organisation donnant un maximum de bénéfice au capitaliste. Celui qui estime que le produit doit revenir au « travail », tiendra pour usurpée la part que prend le capital ; il l'appellera plus-value et nommera sur-travail le travail auquel il correspond. Celui qui estime que le produit doit revenir non pas aux individus qui l'obtiennent, mais à la société, qui assure à ces individus les conditions sans lesquelles ils ne pourraient produire, celui-là jugera que le produit revient à la société, qui le répartit ensuite au mieux. Celui qui estime que le produit doit se partager suivant certaines règles, par exemple selon celles de la libre concurrence, estimera qu'il faut laisser l'ouvrier et le capitaliste débattre entre eux ce partage. Et ainsi de suite, on aura autant de solutions que l'on assignera de sens au terme doit. Nous aurons d'autres solutions encore, si nous supposons que le terme doit sous-entend qu'on atteint certains buts d'utilité sociale. Par exemple, on pourrait rechercher quelles règles de répartition correspondent à un maximum de puissance politique et militaire du pays, quelles sont celles qui correspondent à un maximum de jouissances pour une collectivité déterminée, et ainsi de suite. On ne peut déclarer « vraie » ni « fausse » en elle-même aucune de ces solutions ; et ce n'est qu'après qu'on aura énoncé avec précision ce qu'on entend par ce terme doit, qu'on pourra rechercher si la solution proposée est ou non une conséquence de cette définition.
Il reste à résoudre de nombreux problèmes sur les critères d'après lesquels on détermine qui est le consommateur, qui l'ouvrier, qui le capitaliste, et sur les conséquences de ces critères. Pour les individus présentant tels caractères, il peut y avoir, par exemple, des castes rigoureusement fermées ; ou bien il se peut que l'on passe de l'une à l'autre, et il reste encore à voir jusqu'à quel point, dans la réalité, on observe ce qui est légalement possible (§ 2046). D'autres problèmes surgissent encore ici, tels ceux, très importants, de l'hérédité. La possession du rabot fabriqué par Jacques doit-elle passer, oui ou non, à son fils, ou à d'autres personnes choisies par lui ? [FN: § 2147-9) Il est difficile d'affirmer que tous ces moyens de procéder sont indifférents en ce qui concerne les effets économiques ; mais enfin, si l'on tient à l'affirmer, soit, pourvu qu'on le dise explicitement ; et lorsqu'on ne cherche pas à supprimer ainsi l'étude des problèmes qui se posent par le fait qu'on envisage les effets économiques des différents modes de circulation entre les classes sociales, il faut examiner les solutions de ces problèmes, et faire connaître ce qu'on en pense. Les difficultés qui naissent de cette indétermination sont habituellement évitées de la manière indiquée plus haut, c'est-à-dire en séparant entièrement les problèmes économiques des autres problèmes sociaux, sans d'ailleurs qu'on explique clairement quels seront les effets réciproques des différentes solutions. En présence de l'affirmation explicite signalée tout à l'heure, on trouve dans le raisonnement de Bastiat un grand nombre de propositions implicites. Quand il fait intervenir un contrat entre Jacques et Guillaume, au sujet du rabot, il suppose implicitement la liberté de contracter, tandis qu'on discute précisément si elle doit ou non exister. Pour dissimuler ce défaut de raisonnement, il a recours à la « morale » ; mais à quelle « morale » ? À celle qui est en usage dans les sociétés où cette liberté existe en partie ; par conséquent, tournant en cercle, il donne, comme démonstration, en général, de certaines règles de la « morale », ces règles mêmes, établies sous l'influence d'une société particulière. Mais comme d'autre part notre société n'admet qu'en partie la liberté des contrats, sa « morale » renferme aussi des principes contraires à cette liberté, et les adversaires de Bastiat peuvent en tirer, avec tout autant de raison, des conséquences opposées à celles que tire Bastiat.
D'une façon générale, soient A et B, deux sociétés dans lesquelles les règles de répartition du produit entre les capitalistes et les travailleurs sont différentes. Celui qui envisage le problème uniquement sous son aspect économique, admet implicitement que cette différence de répartition n'a pas d'effet sur l'organisation sociale, et que, par celle-ci, elle ne réagit pas sur l'organisation économique (§ 2203 et sv.). Cela peut être, mais il faut le démontrer, parce que cela pourrait aussi ne pas être ; et quand, de fait, cela ne serait pas, nous aurions à résoudre un très grand nombre de problèmes qu'implicitement le raisonnement de Bastiat suppose négligeables, en les passant sous silence. Les dérivations de Bastiat sont, comme il arrive d'habitude, essentiellement qualitatives ; elles négligent la composition des résidus et des dérivations (§ 2087 et sv.) ; mais nous ferons mieux comprendre cela par l'exemple suivant.
Exemple II Vers la fin de l'année 1913, à Saverne en Alsace, un conflit éclata entre les autorités militaires et les autorités civiles. Pour maintenir l'ordre, les premières agirent indépendamment des secondes.
Nous n'entendons nullement nous occuper ici du fond des faits, lequel est un cas particulier d'un problème général qui sera étudié plus loin (§ 2174 et sv.), ni des caractères de légalité – ou d'illégalité – que peuvent présenter ces faits. Nous consacrons la présente étude exclusivement aux dérivations auxquelles ils ont donné naissance [FN: § 2147-10] . Ces dérivations furent semblables, grosso modo, à celles que provoqua l'affaire Dreyfus (§ 1779) ; mais elles eurent un effet bien différent, parce que la solidité des organisations conservatrices, en Allemagne (§ 2218), rendit impossible le bouleversement social que leur désagrégation permit en France [FN: § 2147-11). Au fond, dans l'un et l'autre cas se trouvaient en présence ceux qui veulent que l'habileté civile et la force révolutionnaire prédominent sur la force militaire du gouvernement, et d'autre part, ceux qui ne veulent pas que cela ait lieu [FN: § 2147-12). Désignons par A et B les deux états indiqués de cette manière. L'individu qui en choisit un, mu uniquement par la foi en certains de ses principes abstraits, se met en dehors du domaine logico-expérimental, et nous n'avons pas à nous occuper de lui. Bien au contraire, nous devrons prêter attention à ses actes, s'il se range dans ce domaine, en affirmant, par exemple, que sa solution assure quelques-unes des différentes utilités de l'individu et de la société. C'est là une proposition qui concerne exclusivement la science logico-expérimentale, et, pour en traiter, il est nécessaire de résoudre des problèmes analogues à ceux dont nous avons parlé aux § 1897 et sv. Ils sont ignorés ou résolus explicitement dans les dérivations. Celui qui affirme que l'intervention des autorités militaires est condamnable uniquement parce qu'elle est contraire à la légalité, aux droits individuels, à la Démocratie ou au Progrès, affirme par là implicitement, ou bien qu'il faut s'occuper uniquement de ces entités, sans se soucier de leurs utilités diverses [FN: § 2147-13) ou bien que la solution obtenue en cherchant à être en accord avec ces entités, concorde avec la solution qui serait donnée par les utilités que l'on veut considérer. On peut en dire autant à l'égard de qui approuve l'intervention des autorités militaires, uniquement parce qu'elle est en accord avec certains de ses principes à lui. Il n'est pas fait la moindre allusion à tout cela, dans les dérivations. Les solutions de ces problèmes sont ou bien entièrement omises, ou bien implicites. Pour donner une forme un peu plus concrète à ces considérations, fixons notre attention sur l'une des utilités, sur la puissance militaire du pays, et considérons les deux états de choses qu'on pourrait présentement appeler germanique et latin, mais dont il faudrait intervertir les noms, si nous traitions du temps où eut lieu la bataille de Iéna (§ 2364). En l'état de choses latin, on admet que l'autorité militaire doit être l'humble servante de l'autorité civile ; en l'état de choses germanique, on admet qu'elle est au-dessus de l'autorité civile. En France, le préfet a le pas sur le général ; en Prusse, non seulement le général, mais tout officier a le pas sur toute autorité civile [FN: § 2147-14] . En l'état de choses latin, on veut que si la force révolutionnaire, ou même seulement populaire, se trouve en opposition avec la force militaire du gouvernement, la première ait tous les droits et la seconde tous les devoirs, et surtout celui de tout souffrir avant de faire usage des armes : injures, coups, lapidation, tout est excusé si cela vient du peuple, tandis qu'il est absolument interdit de réagir à la force armée du gouvernement. Le peuple est toujours excusable ; parce qu'il est « excité » par la seule présence de la force publique, il peut s'abandonner impunément à toute impulsion. Au contraire, la force publique doit avoir une patience inépuisable [FN: § 2147-15] : frappée sur une joue, elle doit présenter l'autre ; les soldats doivent être autant de saints ascètes ; on ne comprend pas pourquoi on leur met en main un fusil ou un sabre plutôt qu'un rosaire du saint Progrès. L'état de choses germanique est l'opposé. La force militaire doit être absolument respectée par tout le monde. Quiconque a les nerfs facilement excités à la seule vue de cette force, fait bien de rester chez soi ; autrement il apprendra à ses dépens que, comme disait Bebel à ses partisans, les balles frappent et les sabres coupent. Réagir contre les insultes ou les coups n'est pas seulement une permission pour la force publique : c'est une obligation. Un officier est déshonoré s'il essuie impunément la plus légère violence. Ce sont ceux qui ont insulté la force publique qui doivent faire preuve de patience. Quand cette force publique réagit, elle se préoccupe uniquement d'imposer le respect à ses adversaires.
Le principe de « ne pas résister au mal » est totalement inconnu dans l'armée prussienne, et dans toute l'armée allemande : officiers et soldats savent que s'ils portent des armes, c'est pour s'en servir lorsque c'est nécessaire, et pour se faire respecter. En Allemagne, il est absolument impossible qu'il se produise un fait semblable à celui qui eut lieu en France, lorsque le ministre de la marine Pelletan, se rendant à un arsenal pour le visiter, était avec un amiral dans une voiture derrière laquelle les ouvriers de l'arsenal criaient à tue-tête « ... et nos balles seront pour les amiraux ! » Les Allemands peuvent avoir tort, mais ils n'admettent pas cela. La défense de la patrie, sa puissance militaire, sont-elles également assurées par l'un et l'autre de ces deux états de choses ? Et si elles ne le sont pas, lequel des deux états de choses leur est le plus favorable ? Ces problèmes ne sont pas parmi les principaux sur lesquels portent les dérivations favorables à l'état de choses latin ; ils occupent, au contraire, la première place, mais sont résolus a priori, dans les dérivations favorables à l'état de choses germanique [FN: § 2147-16). Le motif de cette différence consiste probablement en ce qu'il est facile de saisir comment l'état de choses germanique est favorable à la puissance militaire du pays, tandis qu'il est difficile de le saisir pour l'état de choses latin. Malgré les différences de l'intuition, on ne peut en toute rigueur exclure a priori que l'état de choses latin soit également favorable ou plus favorable que l'état de choses germanique, à la puissance militaire du pays ; mais pour accepter de semblables affirmations, il serait nécessaire au moins d'avoir un commencement de démonstration, lequel fait totalement défaut dans les dérivations favorables à l'état de choses latin [FN: § 2147-17). Et là, on voit bien comment les dérivations peuvent se passer de la logique : les mêmes Français qui déplorent les maux des Alsaciens-Lorrains conquis par l'Allemagne, s'efforcent, sans s'en apercevoir, de détruire la puissance militaire de leur propre pays, c'est-à-dire de provoquer de nouvelles conquêtes allemandes. Ils se plaignent d'un mal et veulent l'étendre. Le défaut de logique disparaîtrait si, dans les dérivations, on devait sous-entendre cette proposition : qu'elles visent non à l'utilité présente, mais à celle de l'avenir, et cette autre proposition, que la conquête peut être un mal temporaire et un bienfait futur. On a vu des exemples de ce fait dans les conquêtes romaines ; il n'est donc pas impossible. Reste à démontrer qu'il se produira effectivement. On pourrait considérer aussi d'autres utilités, par exemple celles de certaines collectivités. Il est évident que l'état de choses latin est favorable aux collectivités qui veulent agir contre la loi ou contre l'arbitraire gouvernemental. Pour imposer leur volonté, il suffit qu'elles aient le courage de descendre dans la rue. L'état de choses germanique est favorable au maintien de l'ordre, du respect de la loi, et aussi de l'arbitraire et des crimes de ceux qui gouvernent. Là aussi apparaissent les dérivations. Du côté de ceux qui veulent renverser le régime social actuel, on estime que ce renversement est toujours un « bien »; et la croyance se raffermit avec les mythes de la sainte Démocratie, de même qu'en intervertissant les rôles, elle se raffermirait avec les mythes de la sainte Aristocratie ou de la sainte Monarchie, si les révolutionnaires étaient aristocrates ou monarchistes. Du côté de ceux qui veulent maintenir l'état social actuel ou qui en font leur profit, on emploie moins de dérivations, parce que celui qui détient le pouvoir n'a pas besoin de beaucoup de raisonnements pour inciter ses subordonnés à l'action. On se sert des dérivations seulement quand on croit opportun de justifier ses actes, et pour briser l'opposition de ceux qui mordent à cet hameçon. D'habitude, ces dérivations visent à montrer que le maintien de l'ordre légal, avec lequel on confond visiblement l'arbitraire des gouvernants, est le « bien » suprême, auquel on doit tout sacrifier ; ou bien elles invoquent le principe que la fin justifie les moyens ; et pour les gouvernants, quel meilleur but peut-il y avoir que de se maintenir au pouvoir et d'en tirer profit ? [FN: § 2147-18) Si dans la suite il éclate un conflit de nations différentes, par exemple en des cas semblables à celui de Saverne, personne, dans la nation dominatrice, n'oserait mettre en doute que le but suprême est le maintien de cette domination. La foi nationaliste est en cela identique à la foi musulmane, à la foi chrétienne, à la foi démocratique et à tant d'autres fois imaginables. Il s'y ajoute des mythes en très grand nombre, par lesquels on démontre clair comme le jour que la nation dominatrice est digne de dominer, et que la nation assujettie ne mérite autre chose que la sujétion. Depuis le temps où la Rome antique proclamait la légitimité de sa domination sur les peuples vaincus, jusqu'à nos jours où les nations dites civilisées « démontrent » qu'il est légitime, juste, convenable, utile et, ajoutent celles qui sont chrétiennes, conforme à la volonté du Seigneur, qu'elles dominent, exploitent, oppriment, détruisent les nations auxquelles il leur plaît de refuser le nom de civilisées, on trouve en nombre immense des dérivations du genre indiqué, lesquelles, sous d'autres noms, répètent presque toutes les mêmes choses.
Aussi bien ceux qui préconisent l'état de choses latin que ceux qui préconisent l'état de choses germanique, négligent entièrement le problème quantitatif (§ 2174 et sv.). Les forces et les liaisons qui déterminent l'état A sont possibles de même que les forces et les liaisons qui déterminent l'état B, puisque, en réalité, on observe ces deux états. Mais des forces et des liaisons qui déterminent un état intermédiaire C sont-elles aussi possibles ? Si non, pour connaître où se trouve le maximum d'utilité, il suffit de comparer A et B [FN: § 2147-19). Si oui, pour connaître ce maximum, il faut comparer A, C, B. Dans le cas spécial que nous examinons, cela revient à rechercher jusqu'à quel point, pour atteindre certains buts, il faut donner de l'importance et de la force à l'armée, par rapport aux autorités civiles. Et si l'on fait cette recherche, on obtiendra des résultats qui, à première vue, sembleront paradoxaux : que l'état de choses latin, préconisé par les démocrates, pourrait bien, en dernière analyse, être funeste à la démocratie, soit par la conquête étrangère, soit par un acheminement vers l'anarchie, qui a été déjà le tombeau de tant de démocraties. Semblablement, on verra que l'état de choses germanique, préconisé par les monarchistes, pourrait bien, en dernière analyse, être funeste à la monarchie. Un état intermédiaire C pourrait peut-être mieux que A et que B atteindre les buts visés par quelques-uns de ceux qui préconisent ces états extrêmes. Quiconque veut traiter scientifiquement le sujet doit considérer au moins une partie de ces problèmes et d'autres semblables ; et plus il en considérera, meilleur sera son raisonnement, au point de vue logico-expérimental. Au contraire, celui qui cherche à persuader autrui, à pousser les hommes à agir, doit s'abstenir de ces recherches, non seulement parce qu'elles ne peuvent être comprises du vulgaire auquel on s'adresse, mais aussi, comme nous l'avons dit tant de fois, parce qu'elles favoriseraient le scepticisme scientifique, qui est contraire à l'action énergique et résolue du croyant ; et, au point de vue de l'efficacité des dérivations, son langage sera d'autant meilleur qu'il considérera moins de problèmes scientifiques et qu'il possédera plus l'art de les dissimuler et de les voiler.
§ 2148. COMPOSITION DES UTILITÉS, DES RÉSIDUS ET DES DÉRIVATIONS. Pour connaître les utilités complexes qui résultent de la composition des résidus et des dérivations, nous poursuivrons le raisonnement commencé au § 2087, lorsque nous avons considéré d'une manière synthétique l'action des résidus et des dérivations. La matière n'est pas facile ; par conséquent, il ne faut refuser aucun secours, même s'il nous vient d'analogies imparfaites. Faisons donc appel, comme nous l'avons fait déjà, à l'intuition visuelle (§ 1869), non pour démontrer quoi que ce soit, car ce serait une grave erreur, mais uniquement pour mieux comprendre les raisonnements abstraits. Afin de pouvoir faire usage de figures graphiques dans l'espace à trois dimensions, supposons que l'état d'un individu soit tel qu'on puisse le représenter par un point h d'une surface dont l'ordonnée sur un plan horizontal représente l'indice de l'ophélimité dont jouit l'individu. En projection horizontale, l'état de l'individu est donc représenté par le point h, et si l'on fait une section verticale qui passe par h, on obtient la droite gl, qui est la section du plan horizontal de projection, la courbe To, qui est la section de la surface, et l'ordonnée ph, qui est l'indice de l'utilité dont jouit l'individu (§ 1869). Le point h est soumis aux forces de direction A, B,... et d'intensité α, β, ..., ainsi qu'il a été dit au § 2087 il doit toujours se maintenir sur la surface que nous avons supposée, et qui est déterminée par les liaisons.
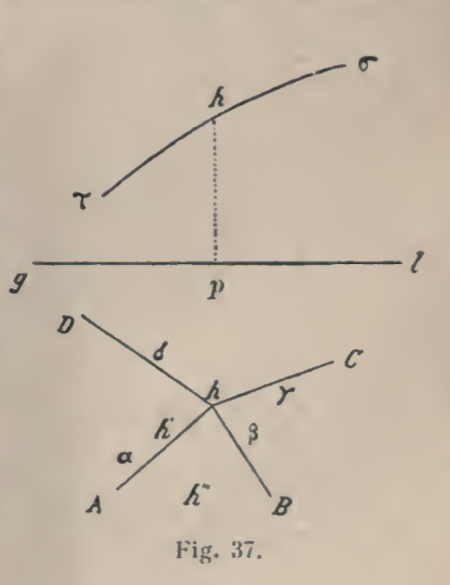
Figure 37
§ 2149. Parlons maintenant, non plus de l'ophélimité d'un individu, mais de l'utilité d'une collectivité, et supposons que la fig. 37 s'applique au cas de cette utilité. Supposons que le point h se trouve dans la position où l'on obtient le maximum d'utilité de la collectivité. Il se peut que sur la droite hA il y ait un point h' où l'utilité de la collectivité soit plus grande qu'en h ; par conséquent l'idée surgit spontanément qu'il est bon de faire croître , pour porter la collectivité au point h'. Telle est la façon dont on raisonne habituellement en matières sociales.
§ 2150. Mais si l'équilibre était possible en h', l'hypothèse suivant laquelle h est un point de maximum d'utilité de la collectivité, ne correspondrait pas à la réalité. Selon cette hypothèse, l'équilibre n'est possible en aucun autre point voisin de h, et où l'utilité de la collectivité serait plus grande ; donc il n'est pas possible en h'. Par conséquent, faire croître α portera le point d'équilibre, non pas en h', mais bien en un point tel que h", où l'utilité de la collectivité est moindre. Cela se produit parce que l'augmentation de α pour conséquence de modifier β, γ, ...; et ici apparaît le second genre de mutuelle dépendance des résidus (§ 2088).
§ 2151. Le raisonnement que nous venons d'exposer ne dépend nullement des hypothèses que nous avons faites pour représenter dans un espace à trois dimensions la position du point h, ni de n'importe quelle autre représentation analogue. Ce raisonnement peut donc être répété indépendamment de ces hypothèses, et la conclusion s'applique au cas général de l'utilité dépendante des résidus.
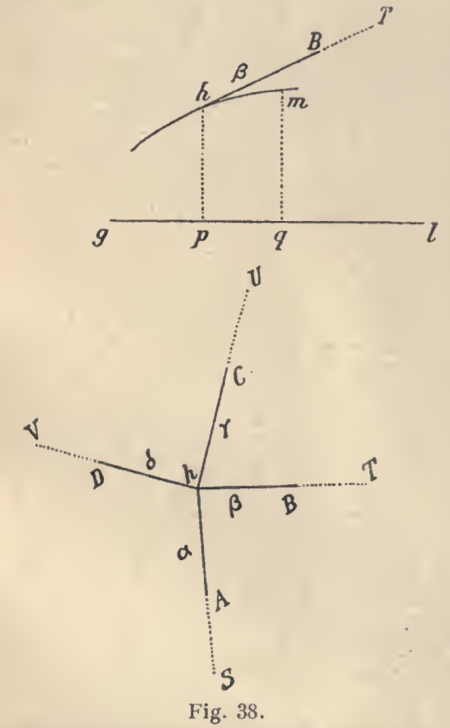
Figure 38
§ 2152. Ajoutons maintenant la considération des dérivations, et appliquons au cas général le raisonnement tenu au § 1869, en un cas particulier. Reproduisons la fig. 37 du § 2148, en y ajoutant les dérivations S, T, U, V, ..., ou si l'on veut, les mythes, les idéologies, qui poussent les hommes à agir suivant les directions A, B, C,... mus par les forces α, β, γ,... La section verticale est supposée faite selon hBT. La force β selon hB, provient de ce que les hommes visent à un but imaginaire T ; et si cette force agissait seule, elle porterait l'individu au point m. Mais si l'équilibre est obtenu au point h, l'effet de cette force est compensé, détruit par ceux des autres forces. Cela a lieu aussi bien si h est un point de maximum d'utilité, que s'il est un point quelconque, pourvu qu'il soit un point d'équilibre.
§ 2153. Maintenant, nous pouvons répéter, en introduisant la considération de l'utilité, les observations faites au § 2088. 1° Si l'on a un motif d'admettre que B, agissant seul, ferait croître l'utilité, il ne s'ensuit nullement qu'en agissant à l'encontre des autres résidus, et en rapport de subordination avec les liaisons, il aurait encore pour effet une augmentation d'utilité. 2° La variation de l'utilité dépend de l'action de la résultante des forces manifestées par les résidus ; elle ne dépend pas de la résultante imaginaire des dérivations, si toutefois elle est concevable. La résultante réelle est bien différente : elle indique la direction dans laquelle se meuvent les individus, dans une société où existent les dérivations considérées ; et dans cette direction, on peut se rapprocher de la réalité beaucoup plus que ne l'indique toute dérivation considérée à part (§ 1772) ; il en est de même pour l'utilité. Cela a lieu effectivement dans les sociétés où l'activité des hommes est orientée davantage vers le réel, moins vers la fantaisie, et où la prospérité augmente. 3° Il ne faut pas attacher trop d'importance au fait que la dérivation, dépassant les limites de la réalité, vise un but imaginaire qu'on peut, en conséquence, tenir à juste titre pour nuisible. La dérivation indique seulement la direction dans laquelle le mouvement tend à se produire, et non pas la limite où arrivera l'individu. Celui-ci arrivé à cette limite, l'utilité peut s'être accrue, tandis qu'elle diminuerait ensuite et se changerait en désavantage, si l'individu poussait au-delà, du côté de la dérivation. 4° Soient A, B,..., certains résidus d'une même classe (I) ; P, Q, R,. d'autres résidus d'une autre classe (II). Soient encore X, la résultante des résidus A, B, C,. de la classe (I), Y la résultante des résidus P, Q, R,... de la classe (I), et ainsi de suite. Soit enfin omega, la résultante totale de toutes les forces X, Y,.... laquelle détermine le mouvement réel et par conséquent l'utilité. Si l'on n'a pas l'utilité – ou le dommage – qui découlerait des résidus A considérés à part, cela n'a pas lieu parce que A n'agit pas, et moins encore parce qu'on a réfuté valablement une dérivation qui correspond à A ; mais à cause de l'opposition des résidus B, C,... P, Q,... En outre, en vertu de la propriété de l'ensemble d’une classe A, B,. de demeurer presque constante, A peut diminuer beaucoup, disparaître même, sans que X varie beaucoup, et sans que, comme conséquence, la résultante omega et l'utilité qu'elle engendre varient beaucoup. On reconnaît bien mieux les variations de omega et de l'utilité, en prêtant attention aux variations des résultantes X, Y,... qu'en s'attachant aux variations de l'un quelconque des résidus A, B,.. P, Q,....
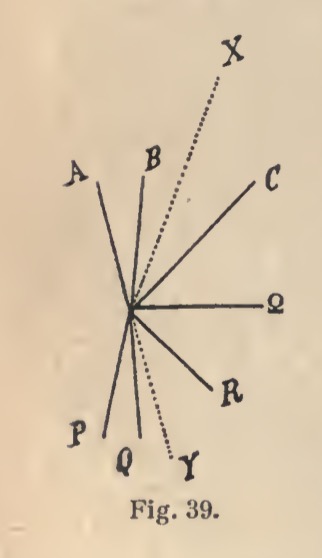
Figure 39
§ 2154. De même, nous pourrons appliquer à l'utilité les observations présentées au § 2086, à propos des différentes dérivations T, T’, T",…, correspondant à un même résidu B. 1° Puisque ce sont les résidus qui agissent principalement sur l'équilibre, on ne peut conclure de l'existence d'une des différentes dérivations T, T', T",. , que peu de choses ou rien au sujet de l'utilité. 2° La substitution de T' à T a peu ou point d'effet pour modifier l'utilité. 3° Mais le fait que celui qui doit agir juge au contraire très utile la dérivation T acceptée par lui, et tient les autres pour nuisibles, ce fait peut être avantageux ; ou, pour mieux dire, les sentiments manifestés de cette façon peuvent être utiles. En effet, hormis un petit nombre d'ascètes, les hommes se résolvent difficilement à distinguer l'utilité, de ce qu'ils estiment être « bon ». Par conséquent, s'ils estiment vraiment « bonne » la dérivation T, ils la jugent de même « utile » ; et si cela n'avait pas lieu, ce serait un indice qu'ils n'ont pas grande foi en cette dérivation. Ce qu'il y a d'imaginaire et de nuisible en cette croyance, est ensuite corrigé par les autres croyances qui existent aussi dans la société [FN: § 2154-1] (§ 1772, 2153). 4° Si d'une manière intrinsèque, au point de vue logico-expérimental, une dérivation semble pouvoir mieux que d'autres accroître l'utilité, on ne peut en conclure qu'il en sera ainsi en réalité. Il se pourrait encore que la dérivation qui, en elle-même, paraît plus utile, corresponde à des sentiments moins avantageux que ceux auxquels correspond une dérivation qui, en elle-même, paraît moins utile. Toutes les propositions que nous venons d'énoncer sont en contradiction avec l'opinion vulgaire ; mais l'expérience fait voir qu'elles concordent avec les faits.
§ 2155. Il résulte aussi de ce que nous avons exposé que le problème de l'utilité est quantitatif, et non qualitatif, comme on le croit habituellement. Il faut rechercher en quelles proportions les conséquences d'une certaine dérivation S (fig. 38), ou du principe auquel elles aboutissent, peuvent être utiles à la société, combinées avec les conséquences d'autres dérivations, T, U, V,…, et non pas, ainsi qu'on a coutume de le faire, si S est utile ou nuisible à la société, problème qui peut n'avoir aucun sens. Généralement, les dérivations ne tiennent aucun compte de ces considérations quantitatives, pour les motifs, tant de fois indiqués, qui les font viser à l'absolu (§ 1772) ; et quand une dérivation finit par proclamer un certain principe, l'affirmation que l'on doit s'y rallier d'une manière absolue, sans restrictions de quantité ou d'autre sorte, est presque toujours implicite.
Il sera utile d'ajouter à ces raisonnements abstraits des considérations de nature beaucoup plus concrète, et à l'énoncé de propositions générales, d'ajouter des exemples de cas particuliers. Nous commencerons par examiner un cas important où se mêlent, sans distinction bien nette, les raisonnements sur des buts idéaux T et les raisonnements sur des buts réels ; puis nous verrons différents cas d'utilités complexes.
§ 2156. L'HISTOIRE. Nous avons vu (§ 1580) que les ouvrages qui portent ce nom sont habituellement un composé de divers genres d'observations, auxquelles s'ajoutent des dérivations et des considérations éthiques, sans que les buts que vise l'auteur et les mythes T soient bien séparés des faits réels m (fig. 29). D'une façon générale, on peut dire que, jusqu'à présent, on a fait l'histoire des dérivations plutôt que celle des résidus, l'histoire des conceptions T, plutôt que celle des forces manifestées par ces conceptions.
§ 2157. C'est fort bien quand l'histoire se rapproche plus ou moins d'une composition qui a pour but d'agir sur les sentiments des hommes (§ 1580), quand l'exhortation se mêle plus ou moins à l'observation expérimentale ; mais il faut évidemment faire usage d'un autre procédé quand l'histoire a pour but exclusif ou du moins principal de décrire les faits réels et leurs rapports.
§ 2158. Si l'on considère exclusivement et d'une manière intrinsèque les conceptions, les buts idéaux, les mythes, on obtient des éthiques, des métaphysiques, des théologies. Si l'on considère exclusivement des faits réels, et en conséquence uniquement comme tels les conceptions, les buts idéaux, les mythes, on obtient des études de science expérimentale ou, pour leur donner un nom (§ 119), des histoires scientifiques (§ 1580, 2076).
§ 2159. Les compositions qui sont aptes à persuader les gens, à émouvoir les sentiments, à entraîner les hommes dans une voie déterminée, sont un mélange des deux catégories précédentes, parce que l'esprit humain demande, en proportions variables, l'idéal et le réel. Ces proportions varient en un temps donné et en un pays donné, suivant les individus, et, si l'on considère la moyenne des individus, en divers pays et en des temps différents, ces proportions ont une marche rythmique, comme c'est le cas de presque tous les phénomènes sociaux.
§ 2160. Dans nos contrées et à notre époque, les histoires théologiques sont tombées en désuétude, tandis que les histoires métaphysiques et les histoires éthiques continuent à jouir d'un grand crédit, qui parait bien devoir se maintenir encore longtemps [FN: § 2160-1]. Parfois ces caractères théologiques, métaphysiques, éthiques sont explicitement avoués par les auteurs; mais aujourd'hui cela arrive rarement. Plus souvent, les auteurs ne distinguent pas les différentes parties dont se compose leur histoire (§ 1582) ; ils ont recours à l'amphibologie du terme vérité historique (§ 1578), pour dissimuler ce mélange ; ils n'expriment pas clairement que, suivant leur conception, ce sont les dérivations qui déterminent les formes sociales ; mais ils font en sorte que cette propriété des dérivations soit une conséquence implicite de la proposition, tenue pour axiomatique, suivant laquelle les actions des hommes sont une conséquence de leurs croyances.
§ 2161. Voyons dans quels rapports se trouvent les écrits de ces auteurs avec la science logico-expérimentale. Celui qui attribue une origine surnaturelle à la religion respecte du moins la logique formelle, en donnant à la religion la valeur de cause première des phénomènes sociaux. Au contraire, celui qui attribue une origine terrestre à la religion doit, s'il veut aussi rester uniquement dans le domaine de la logique formelle, expliquer comment et pourquoi la religion est une cause et non un effet. Quand, par exemple, les adversaires de la religion chrétienne la rendent responsable de la dissolution de l'empire romain, il leur reste encore à nous expliquer pourquoi la propagation de cette religion a été une cause et non un effet de cette dissolution, et aussi pourquoi ces phénomènes ne peuvent pas être envisagés comme simplement concomitants. Celui qui affirme que les concepts moraux sont imprimés par Dieu dans l'esprit de l'homme, peut sans autre les attribuer comme cause première aux phénomènes sociaux. En outre, il n'a aucun besoin de rechercher si, quand et dans quelle mesure il convient aux hommes de les suivre : ils obéissent à l'ordre de Dieu, cela suffit ; ils n'ont pas à se préoccuper d'autre chose. Mais quiconque sort de cette forteresse, inexpugnable en face de la logique formelle, et veut attribuer la morale comme cause aux phénomènes sociaux, doit premièrement expliquer, comme dans le cas précédent, pourquoi elle est une cause et non un effet ou un phénomène concomitant. Ensuite, il faut qu'il dise quelle solution il entend donner au problème posé au § 1897 ; autrement dit, il faut qu'il dise en quel rapport il estime que se trouvent certaines règles de morale ou d'une autre discipline avec l'utilité sociale. Celui qui fait une étude de cas de conscience n'a pas besoin d'énoncer cela, ni celui qui fait exclusivement une étude des phénomènes sociaux sans établir une dépendance entre eux et les cas de conscience. Mais celui qui mélange les deux études doit exprimer dans quel rapport il veut les placer : quel pont il entend construire pour passer de l'une à l'autre.
§ 2162. Les historiens ont coutume de s'abstenir de donner ces explications, parce qu'ils veulent se soustraire à l'entreprise difficile, ou mieux impossible, de démontrer la solution qu'ils adoptent. Ils se contentent d'admettre implicitement que le fait de suivre les règles de la morale a toujours pour conséquence l'utilité sociale (solutions affirmatives, § 1903 à 1998). Ils trouvent créance, parce que cette proposition est vraie, très en gros, pour les actions des simples particuliers, et parce que, grâce à la persistance des agrégats, on l'étend au gouvernement de la chose publique. Le fait de disjoindre, de cette façon, les différentes parties du phénomène social et d'admettre des solutions implicites pour les parties qu'on ne prend pas en considération, ce fait a pour l'auteur le grand avantage de faciliter l'étude de la partie dont il traite, puisqu'il peut l'envisager seule, et d'obtenir plus facilement pour ses conclusions l'approbation du public, puisqu'elles supposent implicitement certaines solutions qui sont assez généralement acceptées. C'est pourquoi le procédé indiqué n'est pas employé seulement par les historiens, mais aussi par les économistes (§ 2147) et par d'autres auteurs qui étudient les phénomènes sociaux. Il se compose de deux parties. La première consiste dans la disjonction des différents éléments du phénomène social ; la seconde consiste à admettre pour les éléments qu'on ne prend pas en considération des solutions implicites presque toujours en accord avec les sentiments du public auquel s'adresse le discours. Au point de vue logico-expérimental, la première partie de l'opération est admissible, elle est même indispensable ; car autrement on ne pourrait pas étudier le phénomène. Ainsi que nous l'avons dit et répété tant de fois, la science est essentiellement analytique. Mais la seconde partie de l'opération appartient aux dérivations et nous fait sortir entièrement du domaine logico-expérimental, où il n'y a aucune place pour des propositions implicites dictées par le sentiment, et où l'on ne peut trouver que des faits et des déductions de faits. La science logico-expérimentale repousse donc absolument les solutions implicites qui appartiennent aux sentiments, et dont les dérivations font et doivent faire très largement usage ; elle y substitue des solutions explicites, obtenues exclusivement en considérant les faits.
Les historiens ont aussi coutume de s'attarder à juger au point de vue éthique et légal les actions des hommes publics, et comme d'habitude sans énoncer sur quelles règles éthiques, sur quelles lois ils fondent leur jugement. Là encore leurs prémisses sont implicites ; on les accepte parce que, grâce à la persistance des agrégats, elles s'étendent en dehors du domaine où s'appliquent les règles et les lois qui régissent les relations entre particuliers. Bien qu'en de bien moindres proportions ce phénomène est semblable à celui où les règles juridiques établies pour les hommes sont étendues aux animaux. On a longuement discuté si César avait ou non le « droit » de franchir le Rubicon. Résoudre aujourd'hui ce problème est à peu près aussi utile à l'étude de l'histoire et des phénomènes sociaux, que de donner une réponse à la célèbre question posée au moyen âge : utrum chimaera, bombinans in vacuo, possit comedere secundas intentiones; mais ce peut être un exercice utile à l'étude abstraite du droit public romain.
§ 2163. Pour un grand nombre d'historiens, c'est un article de foi que Napoléon III commit un crime, en faisant le coup d'État qui lui donna le pouvoir. Cela peut être ou non, suivant le sens, qu'on donnera au terme crime. Dans les rapports entre particuliers, il est défini par le code pénal, par les lois, par la jurisprudence ; mais de quel code, de quelles lois, de quelle jurisprudence veut-on faire usage pour juger les faits politiques ? Il faut l'énoncer clairement. Il ne suffit pas de dire, comme le font beaucoup de personnes, que c'est un crime de renverser tout gouvernement légitime, parce qu'ensuite il faudrait définir ce qu'est un gouvernement légitime. En vérité, de Louis XVI à Napoléon III, et de Napoléon III à la République, ce fut une succession ininterrompue de gouvernements qui surgissaient en en renversant un autre, soi-disant légitime, et qui affirmaient ensuite être tout aussi légitimes et même davantage. Nous ne pouvons rien décider, tant qu'on ne nous dit pas d'après quelles règles on doit juger ces contestations ; et quand bien même nous le saurions, et que ce jugement serait rendu, on ne voit pas bien en quoi il pourrait servir le moins du monde à accroître nos connaissances des phénomènes sociaux et de leurs rapports. Le lecteur voudra bien remarquer que nous avons eu la discrétion de nous arrêter à Louis XVI ; mais nous pouvions remonter plus haut, et rechercher la légitimité du pouvoir royal, constitué sur les ruines de la féodalité, la légitimité du pouvoir de Pépin, des rois francs, des conquérants romains des Gaules, et ainsi de suite à l'infini. On peut remédier à l'absurdité de ces recherches en admettant la prescription ; mais reste à en fixer le terme. Sera-t-il de trente ans, comme en France pour la propriété privée ? ou bien d'un autre nombre d'années ? Et puis, quelle est l'autorité qui le détermine ? Et par quels moyens se fera-t-elle obéir ? Vues à la lumière des règles de la morale et du droit privé, les mœurs de Catherine II de Russie étaient condamnables, tout au moins répréhensibles, et les actes accomplis par elle en vue de s'assurer le trône, criminels [FN: § 2163-1] . Mais ce jugement-là n’est pas en rapport de dépendance très étroite avec les phénomènes sociaux et leurs relations. Par exemple, il ne nous sert de rien pour résoudre cette question : aurait-il été plus utile à la Russie que ce fût le mari de Catherine qui régnât, plutôt que Catherine elle-même ? Élisabeth d'Angleterre voulait paraître chaste ; or, il paraît qu'elle ne le fût pas. Quel rapport cela peut-il bien avoir avec l'évolution sociale, en Angleterre, au temps de cette reine ? Ces faits ont du rapport avec l'histoire, non par la valeur éthique qu'ils peuvent avoir en eux-mêmes, mais comme circonstances concomitantes de certains événements, ou parce qu'ils en déterminent certains autres. Parmi ces circonstances, on peut mentionner aussi la valeur éthique extrinsèque, c'est-à-dire le jugement que des personnes mêlées aux événements portent sur ces actes. Mais en cela il faut procéder avec prudence et se tenir sur ses gardes, car, très souvent, ce n'est pas le jugement qu'on porte qui agit sur les événements, mais bien les événements sur ce jugement, lequel est bienveillant ou sévère, selon les sentiments que l'on éprouve, d'autre part, envers les personnes que l'on juge. L'affaire du collier a beaucoup nui à Marie-Antoinette ; il semble pourtant qu'elle n'y fut en rien fautive. Au contraire, des faits bien autrement scandaleux et certains n'avaient jusqu'alors pas nui aux membres de la famille royale de France. En politique surtout, le scandale nuit au faible et cause peu d'ennuis au fort. On petit en voir des exemples chaque jour.
§ 2164. M. Aulard, quand il traite du troisième volume de Taine et en cite la préface, adresse deux critiques à l'auteur : de n'avoir pas été assez exact, et d'avoir négligé plusieurs documents. Au point de vue de l'histoire des phénomènes sociaux, ni l'une ni l'autre de ces critiques ne tient debout. Les inexactitudes incriminées n'ont rien de fondamental. Elles peuvent avoir de l'importance parfois pour porter un jugement éthique sur les hommes ; elles importent peu ou point à l'histoire des phénomènes sociaux [FN: § 2164-1]. Les documents cités par Taine sont plutôt trop que pas assez nombreux. Il n'est pas nécessaire de tant de preuves pour savoir que dans la Révolution française, comme en tant d'autres révolutions, les politiciens dérobèrent à pleines mains et supprimèrent par la mort leurs ennemis. Et quiconque prête attention aux procédés des politiciens, en des temps tranquilles, s'aperçoit facilement que leurs faits et gestes, en temps de révolution, démontrent l'existence de forces qui, d'une époque à l'autre, diffèrent seulement par leur intensité. Taine croit, au contraire, qu'il y a principalement une différence de qualité, et il veut accuser les politiciens de la Révolution française de fautes dont les politiciens de tous les temps et de tous les pays ne sont pas indemnes ; en outre, par une erreur plus grande encore, il cherche l'origine de ces fautes dans des raisonnements faux des politiciens.
§ 2165. M. Aulard omet ces reproches et d'autres semblables, que l'on peut adresser à l'étude de Taine. C'est probablement parce qu'en somme il suit la même voie que cet auteur, et entre eux la différence consiste uniquement en ce que le jugement éthique porté sur les Jacobins est défavorable chez Taine, favorable chez M. Aulard. Mais l'histoire n'a que faire d'un tel jugement éthique, ni dans un sens ni dans l'autre [FN: § 2165-1] . Qu'on veuille lire de suite Le Prince de Machiavel, la Cité Antique de Fustel de Coulanges, les Philippiques de Cicéron, le volume cité tout à l'heure et surtout sa préface. On ne tardera pas à voir que les deux premiers ouvrages appartiennent à une classe, les deux derniers à une autre, et qu'on ne peut confondre en aucune façon ces classes. Les premiers de ces ouvrages étudient des rapports de faits sociaux ; les derniers ont principalement en vue des jugements éthiques.
§ 2166. En somme, il n'y a pas grande différence, à propos des faits, entre les admirateurs et les détracteurs de la Révolution française. Mais les derniers disent que les hommes de la Révolution furent poussés à l'action par leur tempérament pervers ; et les premiers affirment qu'ils y furent poussés par la résistance et la perversité de leurs adversaires [FN: § 2166-1]. Il importe à peu près autant à l'histoire des phénomènes, de trancher cette question, que de savoir si César, Auguste, Cromwell et tant d'autres hommes semblables étaient honnêtes et avaient de bonnes mœurs, ou s'ils étaient malhonnêtes et avaient de mauvaises mœurs. Taine croit imiter l'homme de science qui décrit des animaux, mais il fait erreur. Son ouvrage peut ressembler à un ouvrage littéraire tel que l'histoire des animaux de Buffon, et non à un ouvrage tel que le Traité de Zoologie concrète de DELAGE et HÉROUARD. C'est à ce traité, au contraire, que ressemble la description que fait Machiavel, des exploits de Valentin.
§ 2167. Les discussions éthiques sur la Révolution française n'ont pas non plus le mérite d'être nouvelles ; elles sont absolument semblables à celles qu'on a faites, qu'on fait et qu'on fera pour toute révolution politique, sociale, religieuse. Ceux qui sont favorables à la révolution la disent « justifiée » par les machinations des adversaires des révolutionnaires. Ceux qui sont opposés à la révolution la condamnent à cause des machinations des révolutionnaires. On ne peut savoir qui a raison ou tort, si l'on ne nous dit pas premièrement quelles règles sont applicables pour absoudre ou condamner ; et quand bien même, par hypothèse, on le saurait, cette sentence procurerait peut-être un certain plaisir éthique, mais elle serait tout à tait incapable de nous faire connaître les rapports des faits politiques et sociaux ou les uniformités que l'on peut y trouver (§ 2166-1).
§ 2168. Parmi les nombreux motifs pour lesquels les historiens de la Révolution française ont suivi la voie indiquée tout à l'heure, – en quoi ils ne diffèrent pas des historiens en général – nous devons mentionner ici deux des principaux, dont l'un est subjectif et l'autre objectif. Le motif subjectif, que nous venons d'énoncer en partie, est celui pour lequel les historiens nous donnent un mélange de dissertations éthiques, de prédications, d'exhortations, d'observations de faits et des rapports de ces faits. Dans l'hypothèse la plus favorable, ces observations ne sont que l'un des buts auxquels tend l'historien, et souvent elles ne sont pas même un but, mais, au contraire, un moyen d'atteindre les autres buts. Ce motif est général et se retrouve dans presque toutes les histoires.
§ 2169. Le motif objectif est général aussi, mais il apparaît beaucoup plus dans l'histoire de la Révolution française. Il consiste en ce que chacun des partis en lutte est poussé à employer la même phraséologie, comme étant celle qui est la plus propre à agir sur le sentiment. Ainsi des dérivations identiques recouvrent des résidus différents. C'est pourquoi celui qui s'arrête aux dérivations ne peut rien connaître des forces qui agissaient en réalité. En certains cas, la contradiction est si patente qu'elle n'a pu échapper aux historiens. S'ils découvrent, par exemple, qu'Auguste fonde l'Empire en prétendant restaurer la République, et que Robespierre, adversaire de la peine de mort, en fait très largement usage, au lieu d'y voir le fait général des différences entre les dérivations et les résidus, ils ont recours à un jugement éthique sur ces hommes, en relevant les contradictions dans lesquelles ils sont tombés. Il est constant que la restauration qu'Auguste disait avoir faite de la République était un mensonge, tout comme l'humanitarisme de Robespierre. Mais si nous voulons étudier les faits, nous ne pouvons nous arrêter là, et deux questions se posent immédiatement ; l'une est de peu d'importance, l'autre en a beaucoup. La première est de savoir si Auguste ou Robespierre étaient de bonne ou de mauvaise foi, car il se pourrait encore, comme nous l'avons vu en tant d'autres cas, qu'en faisant usage des dérivations pour persuader autrui, ils se fussent persuadés eux-mêmes [FN: § 2169-1] . La seconde question qui, presque seule, importe à l'histoire, est de rechercher comment et pourquoi les sentiments et les intérêts recouverts par ces dérivations obtinrent du succès. Croit-on vraiment que les Romains furent induits en erreur par Auguste, les Français par Robespierre, comme un client est induit en erreur par le joaillier qui lui vend un diamant faux, en lui faisant croire qu'il est authentique ? Cette thèse est insoutenable. En réalité, même les personnalités d'Auguste et de Robespierre s'effacent, au moins en partie, et nous devons dire que les sentiments et les intérêts représentés par ces hommes l'emportèrent sur les sentiments et sur les intérêts représentés par d'autres hommes. Les phénomènes observés furent la résultante de tous les facteurs sociaux, parmi lesquels les dérivations jouèrent un rôle, c'est vrai, mais peu important (§ 2199).
§ 2170. L'EMPLOI DE LA FORCE DANS LA SOCIÉTÉ. En général, les sociétés existent parce que chez la plus grande partie de leurs membres, les sentiments qui correspondent aux résidus de la sociabilité (IVe classe) sont vifs et puissants. Mais il y a aussi, dans les sociétés humaines, des individus chez lesquels une partie au moins de ces sentiments s'affaiblissent et peuvent même disparaître. De là découlent deux effets très importants, et qui, en apparence, sont contraires : l'un qui menace de dissolution la société, l'autre qui en fait sortir la civilisation. Au fond, il s'agit toujours d'un mouvement, mais qui peut se produire dans différentes directions.
§ 2171. Il est évident que si le besoin d'uniformité (IV-β) était assez puissant, chez chaque individu, pour empêcher qu'un seul d'entre eux s'écartât d'une façon quelconque des uniformités existant dans la société où il vit, celle-ci n'aurait aucune cause interne de dissolution. Mais elle n'aurait pas non plus de cause de changement, soit du côté d'une augmentation, soit du côté d'une diminution de l'utilité des individus ou de la société. Au contraire, si le besoin d'uniformité faisait défaut, la société ne subsisterait pas, et chaque individu irait pour son propre compte, comme font les grands félins, les oiseaux de proie et d'autres animaux. Les sociétés qui vivent et qui changent ont donc un état intermédiaire entre ces deux extrêmes.
§ 2172. On peut concevoir une société homogène, où le besoin d'uniformité est le même chez tous les individus, et correspond à l'état intermédiaire mentionné tout à l'heure ; mais l'observation démontre que ce n'est pas le cas des sociétés humaines. Elles sont essentiellement hétérogènes, et l'état intermédiaire dont nous parlions existe parce que, chez certains individus, le besoin d'uniformité est très grand ; chez d'autres il est modéré, chez d'autres très petit, chez quelques-uns il peut même faire presque entièrement défaut, et la moyenne se trouve, non pas chez chaque individu, mais dans la collectivité de tous ces individus. On peut ajouter, comme donnée de fait, que le nombre des individus chez lesquels le besoin d'uniformité est supérieur à celui qui correspond à l'état intermédiaire de la société, est beaucoup plus grand que le nombre de ceux chez lesquels ce besoin est plus petit, immensément plus grand que le nombre de ceux où il manque entièrement.
§ 2173. Pour le lecteur qui nous a suivi jusqu'ici, il est inutile d'ajouter qu'après avoir noté les effets de la plus grande et de la moins grande puissance des sentiments d'uniformité, on peut prévoir aussitôt qu'ils auront donné naissance à deux théologies (§ 2147, exemple II), l'une exaltant l'immobilité en une certaine uniformité, réelle ou imaginaire, l'autre exaltant le mouvement dans une certaine direction. C'est en effet ce qui a eu lieu, et d'une part l'on a peuplé les Olympes populaires, où les dieux avaient fixé et établi une fois pour toutes comment devait être la société humaine ; on a peuplé les Olympes des réformateurs utopistes, qui tiraient de leur esprit transcendant le concept de la forme dont la société humaine ne devait désormais plus s'écarter. D'autre part, depuis les temps de l'antique Athènes jusqu'à nos jours, les dieux, maîtres du mouvement dans une certaine direction, exauçaient les prières des fidèles ; et maintenant ils triomphent dans notre nouvel Olympe, où règne, majestueux, l'omnipotent Progrès. De cette façon, l'état intermédiaire de la société s'établissait comme d'habitude : il était la résultante de nombreuses forces, parmi lesquelles apparaissent les deux catégories indiquées et dirigées vers des buts imaginaires divers, et correspondant à des classes diverses de résidus (§ 2152 et sv.).
§ 2174. Le problème qui recherche si l'on doit ou non employer la force dans la société, si c'est avantageux ou non, n'a pas de sens, car on fait emploi de la force, tant du côté de ceux qui veulent conserver certaines uniformités, que du côté de ceux qui veulent les transgresser [FN: § 2174-1] ; et la violence de ceux-ci s'oppose, s'attaque à la violence de ceux-là. En effet, quiconque est favorable à la classe gouvernante et dit qu'il réprouve l'emploi de la force, réprouve en réalité l'emploi de la force par les dissidents qui veulent se soustraire aux règles de l'uniformité. S'il dit qu'il approuve l'emploi de la force, en réalité, il approuve l'emploi qu'en font les autorités, pour contraindre les dissidents à l'uniformité. Vice versa, quiconque est favorable à la classe gouvernée et dit qu'il réprouve l'emploi de la force dans la société, réprouve en réalité l'emploi de la force par les autorités sociales en vue de contraindre à l'uniformité les dissidents ; et s'il loue, au contraire, l'emploi de la force, en réalité il entend l'emploi de la force par ceux qui veulent se soustraire à certaines uniformités sociales [FN: § 2174-2] .
§ 2175. Il n'a pas grand sens non plus le problème qui recherche s'il convient à la société d'employer la force, pour imposer les uniformités existantes, ou bien s'il convient de l'employer pour les transgresser ; car il est nécessaire de distinguer entre les différentes uniformités, et de voir lesquelles sont utiles, lesquelles sont nuisibles à la société. À vrai dire, cela ne suffit pas non plus, car il faut aussi examiner si l'utilité de l'uniformité est assez grande pour compenser le dommage de l'emploi de la force qui l'impose, ou bien si le dommage de l'uniformité est assez grand pour surmonter les dommages de l'emploi de la force qui la détruit (§ 2195). Parmi ces dommages, il ne faut pas négliger celui, très grave, de l'anarchie, qui serait la conséquence d'un emploi fréquent de la force pour détruire les uniformités existantes ; de même que, parmi les utilités du maintien des uniformités même nuisibles, il faut ranger le fait de donner de la force et de la stabilité à l'organisation sociale. En conséquence, pour résoudre la question de l'emploi de la force, il ne suffit pas de résoudre celle de l'utilité en général de certaines organisations : il faut aussi et surtout faire le compte de tous les avantages et de tous les dommages, soit directs, soit indirects (§ 2147, exemple II). Cette voie conduit à la solution d'un problème scientifique, mais elle peut être, et souvent est effectivement différente de celle qui conduit à un accroissement de l'utilité de la société. Par conséquent, il est bon qu'elle soit suivie par ceux qui ont à résoudre un problème scientifique, ou bien, mais en partie seulement, par certaines personnes de la classe dirigeante ; tandis qu'au contraire, pour l'utilité sociale, il est souvent bon que ceux qui sont dans la classe dirigée et qui ont à agir, acceptent, selon les cas, une des théologies : celle qui impose de conserver les uniformités existantes, ou bien celle qui persuade qu'il faut les changer.
§ 2176. Outre les difficultés théoriques, ces considérations servent à expliquer comment il se fait que les solutions qu'on donne habituellement au problème général indiqué tout à l'heure, n'ont pas grand'chose et parfois rien de commun avec la réalité. Les solutions des problèmes particuliers s'en rapprochent bien davantage, parce que, appliquées à un lieu et à un temps déterminés, elles présentent moins de difficultés théoriques, et parce que l'empirisme tient compte implicitement d'un grand nombre de circonstances que la théorie ne peut estimer explicitement, tant qu'elle n'est pas très développée. Ce n'est pas ici le lieu d'étudier l'emploi de la force, depuis les temps anciens jusqu'à l'époque moderne, ni d'examiner trop de détails. Nous nous bornerons au temps présent, et nous chercherons, très en gros, si nous pouvons trouver une formule qui donne l'image générale des faits que l'on observe. Si nous traitions d'un passé très récent, nous devrions mettre ensemble les transgressions des règles d'uniformité intellectuelles et celles de l'ordre matériel. Le temps n'est pas éloigné où elles étaient mises sur le même pied, on bien les premières estimées plus graves que les secondes. Mais aujourd'hui, hormis certaines exceptions, ce rapport est renversé, et les règles d'uniformité intellectuelles que les pouvoirs publics cherchent à imposer sont peu nombreuses. Il faut donc les considérer séparément des règles de l'ordre matériel. Nous allons parler de celles-ci ; plus loin, nous aborderons les premières (§ 2196 et sv.). Nous attachant donc aux transgressions de l'ordre matériel chez les peuples civilisés modernes, nous voyons qu'en général l'emploi de la force pour les réprimer est admis d'autant plus facilement que la transgression peut être considérée comme une anomalie individuelle, ayant pour but d'obtenir des avantages individuels ; d'autant moins que la transgression apparaît davantage comme une œuvre collective, ayant pour but des avantages collectifs, spécialement si elle tend à substituer certaines règles générales à celles qui existent.
§ 2177. Cela exprime ce qu'il y a de commun en un grand nombre de faits où l'on distingue le délit dit privé du délit dit politique. Par exemple, on établit une différence, souvent très grande, entre l'individu qui tue ou dérobe pour son propre compte, et celui qui commet les mêmes actes avec l'intention d'être utile à son parti. En général, chez les peuples civilisés, on accorde l'extradition du premier, on refuse celle du second. On a de même une indulgence toujours croissante pour les délits commis à l'occasion de grèves ou d'autres conflits économiques, sociaux, politiques. On incline toujours plus à n'opposer aux agresseurs qu'une résistance passive, en interdisant aux agents de la force publique de faire usage de leurs armes, ou en autorisant cet usage seulement en des cas d'extrême nécessité. Ces cas ne se présentent d'ailleurs jamais en pratique, parce que, tant que l'agent est en vie, on affirme que la nécessité n'est pas extrême ; et il est tout à fait inutile d'admettre ce caractère d'extrême nécessité lorsque l'agent est tué, et qu'il ne peut, par conséquent, plus profiter de la bienfaisante autorisation de faire usage de ses armes. La répression par le moyen des tribunaux se fait toujours plus molle. Les délinquants, ou bien ne sont pas condamnés, ou bien, s'ils sont condamnés, ils demeurent en liberté, grâce à la loi de « sursis » ; ou bien encore, s'ils ne profitent pas de cette loi, les réductions de peine, les grâces, les amnisties, viennent à leur secours, de telle sorte qu'ils ont peu ou rien à craindre des tribunaux (§ 2147-18). Enfin, d'une façon à vrai dire très indistincte, confuse, nébuleuse, l'idée apparaît qu'un gouvernement existant peut bien opposer une certaine force à ses adversaires, mais pas trop grande, et qu'il est toujours condamnable, si l'emploi de la force est poussé au point de donner la mort à un nombre important, souvent même à un petit nombre de ces adversaires ou à un seul ; et l'on n'admet pas non plus que le gouvernement se débarrasse de ces adversaires en les mettant en prison ou autrement. À cette formule, qui exprime d'une manière abstraite ce qui se passe d'une manière concrète, s'opposent diverses théories qui expriment ce qui devrait arriver, suivant leurs auteurs. Nous en parlerons plus loin (§ 2181 et sv.). Pour le moment, fixons notre attention sur les rapports de mutuelle dépendance entre cette façon d'employer la force, et les autres faits sociaux. Comme d'habitude, nous aurons une suite d'actions et de réactions, où l'emploi de la force apparaît parfois comme cause et parfois comme effet.
§ 2178. À l'égard des gouvernements, nous avons à considérer principalement cinq catégories de faits. 1° Un petit nombre de citoyens peuvent, pourvu qu'ils soient violents, imposer leur volonté aux gouvernants qui ne sont pas disposés à repousser cette violence par une violence pareille. L'effet voulu par ces citoyens se produit très facilement si, en n'usant pas de la force, les gouvernants sont mus principalement par des sentiments humanitaires. Si, au contraire, ils n'usent pas de la force parce qu'ils estiment plus judicieux d'employer d'autres moyens, on a souvent l'effet suivant. 2° Pour empêcher la violence ou pour y résister, la classe gouvernante recourt à la ruse, à la fraude, à la corruption et, pour le dire en un mot, le gouvernement, de lion se fait renard. La classe gouvernante s'incline devant la menace de violence, mais ne cède qu'en apparence, et s'efforce de tourner l'obstacle qu'elle ne peut surmonter ouvertement. À la longue, une telle façon d'agir produit un effet puissant sur le choix de la classe gouvernante, dont seuls les renards sont appelés à faire partie, tandis que les lions sont repoussés (§ 2227). Celui qui connaît le mieux l'art d'affaiblir ses adversaires par la corruption, de reprendre par la fraude et la tromperie ce qu'il paraissait avoir cédé à la force, celui-là est le meilleur parmi les gouvernants. Celui qui a des velléités de résistance et ne sait pas plier l'échine en temps et lieu est très mauvais parmi les gouvernants, et ne peut y demeurer que s'il compense ce défaut par d'autres qualités éminentes. 3° De cette façon, les résidus de l'instinct des combinaisons (Ie classe) se fortifient dans la classe gouvernante; ceux de la persistance des agrégats (IIe classe) s'affaiblissent, car les premiers sont précisément utiles dans l'art des expédients, pour découvrir d'ingénieuses combinaisons qu'on substituera à la résistance ouverte ; tandis que les résidus de la IIe classe inclineraient à cette résistance ouverte, et un fort sentiment de persistance des agrégats empêche la souplesse. 4° Les desseins de la classe gouvernante ne portent pas sur un temps trop lointain. La prédominance des instincts des combinaisons, l'affaiblissement de la persistance des agrégats, font que la classe gouvernante se contente davantage du présent et se soucie moins de l'avenir. L’individu prévaut, et de beaucoup, sur la famille ; le citoyen, sur la collectivité et sur la nation. Les intérêts présents ou d'un avenir prochain, ainsi que les intérêts matériels, prévalent sur les intérêts d'un avenir lointain et sur les intérêts idéaux des collectivités et de la patrie. On s'efforce de jouir du présent sans trop se soucier de l'avenir. 5° Une partie de ces phénomènes s'observent aussi dans les relations internationales. Les guerres deviennent essentiellement économiques. On tâche de les éviter avec les puissants, et l'on ne s'attaque qu'aux faibles. On considère ces guerres avant tout comme une spéculation (§ 2328). Souvent, on achemine inconsciemment le pays à ces guerres, en faisant naître des conflits économiques que l'on espère ne jamais voir tourner en conflits armés ; lesquels sont souvent imposés par des peuples où l'évolution qui conduit à la prédominance des résidus de la Ie classe n'est pas si développée.
§ 2179. À l'égard des gouvernés, on a les rapports suivants, qui correspondent en partie aux précédents. 1° S'il y a, dans la classe gouvernée, un certain nombre d'individus disposés à employer la force, et s'ils ont des chefs capables de les conduire, on observe souvent que la classe gouvernante est dépossédée, et qu'une autre prend sa place. Le fait se produit facilement si la classe gouvernante est mue surtout par des sentiments humanitaires ; très facilement, si elle ne sait s'assimiler les éléments de choix qui surgissent dans la classe gouvernée : une aristocratie humanitaire et fermée, ou peu ouverte, réalise le maximum d'instabilité. 2° Il est, au contraire, plus difficile de déposséder une classe gouvernante qui sait se servir de la ruse, de la fraude, de la corruption, d'une manière avisée. C'est très difficile, si cette classe réussit à s'assimiler le plus grand nombre de ceux qui, dans la classe gouvernée, ont les mêmes dons, savent employer les mêmes artifices, et pourraient par conséquent être les chefs de ceux qui sont disposés à faire usage de la violence. La classe gouvernée qui, de cette manière, demeure sans guide, sans habileté, sans organisation, est presque toujours impuissante à instituer quoi que ce soit de durable. 3° Ainsi, dans la classe gouvernée, les résidus de l'instinct des combinaisons s'affaiblissent un peu. Mais le phénomène n'est pas comparable à celui du renforcement de ces résidus dans la classe gouvernante, car celle-ci, étant composée d'un nombre bien moindre d'individus, change considérablement de nature si l'on y ajoute, ou si l'on y enlève un nombre restreint d'individus ; tandis que ce nombre apporte peu de changement à un total énormément plus grand. Il reste, en outre, dans la classe gouvernée, beaucoup d'individus possédant des instincts de combinaisons qui ne sont pas utilisés en politique ou dans des opérations du même ordre, mais seulement dans les arts qui en sont indépendants. Cette circonstance donne de la stabilité aux sociétés, car il suffit à la classe gouvernante de s'adjoindre un nombre restreint d'individus, pour priver de ses chefs la classe gouvernée. D'ailleurs, à la longue, la différence de nature s'accroît entre la classe gouvernante et la classe gouvernée. Chez la première, les instincts des combinaisons ont tendance à prédominer ; chez la seconde, ce sont les instincts de persistance des agrégats qui ont cette tendance. Quand la différence devient suffisamment grande, il se produit des révolutions. 4° Celles-ci donnent souvent le pouvoir à une nouvelle classe gouvernante, présentant un renforcement des instincts de persistance des agrégats ; et cette classe ajoute, par conséquent, à ses projets de jouir du présent, ceux de jouissances idéales à obtenir dans l'avenir ; le scepticisme le cède en partie à la foi. 5° Ces considérations doivent être en partie étendues aux relations internationales. Si les instincts des combinaisons se renforcent chez un certain peuple, au delà d'une certaine limite, proportionnellement aux instincts de persistance des agrégats, ce peuple peut facilement être vaincu à la guerre par un autre peuple, chez lequel ce phénomène ne s'est pas produit. La puissance d'un idéal pour mener à la victoire s'observe aussi bien dans les guerres civiles que dans les guerres internationales. Celui qui perd l'habitude d'employer la force, celui qui est habitué à juger commercialement une opération d'après son doit et son avoir en argent, celui-là est facilement incliné à acheter la paix. Il se peut que cette opération, considérée en elle-même, soit bonne, parce que la guerre aurait coûté plus d’argent que le prix payé pour la paix. Mais l'expérience démontre qu'à la longue, s'ajoutant à celles qui suivent inévitablement, cette opération a pour effet d'entraîner un peuple à sa ruine. Très rarement, le phénomène noté tout à l'heure de la prédominance des instincts des combinaisons se produit dans la population entière. D'habitude, on l'observe seulement dans les couches supérieures, et peu ou point dans les couches inférieures et plus nombreuses. Par conséquent, lorsque la guerre éclate, on demeure étonné de l'énergie dont le vulgaire fait preuve, énergie que l'on ne prévoyait nullement à considérer les couches supérieures seules. Parfois, ainsi qu'il arriva à Carthage, cette énergie ne suffit pas à sauver la patrie, parce que la guerre a été mal préparée, mal conduite par les classes dirigeantes du pays, et bien préparée, bien conduite par les classes dirigeantes de l'ennemi. D'autres fois, ainsi qu'il arriva pour les guerres de la Révolution française, l'énergie populaire suffit à sauver la patrie, parce que, si la guerre a été mal préparée par les classes dirigeantes du pays, elle a été encore plus mal préparée et plus mal conduite par les classes dirigeantes de ses ennemis ; ce qui donne le temps aux couches inférieures de la société de chasser du pouvoir leur classe dirigeante, et d'y substituer une autre, beaucoup plus énergique, et dans laquelle les instincts de persistance des agrégats se trouvent en proportions très supérieures. D'autres fois encore, ainsi qu'il arriva en Allemagne après la défaite de Iéna, l'énergie populaire se propage dans les classes supérieures, et les pousse à une action qui peut être efficace, parce qu'elle nuit à une foi vive une habile direction.
§ 2180. Les phénomènes que nous venons de noter sont les principaux ; mais il s'en ajoute un très grand nombre d'autres, secondaires. Parmi ceux-ci, il convient de remarquer que si la classe gouvernante ne sait pas, ne veut pas, ne peut pas faire usage de la force pour réprimer les transgressions des uniformités dans la vie privée, l'action anarchique des gouvernés y supplée. En histoire, c'est un fait bien connu que la vengeance privée disparaît ou reparaît, suivant que le pouvoir public abandonne ou assume la répression des délits. C'est ainsi que l'on a vu reparaître la vengeance privée sous la forme du lynchage, en Amérique et même en Europe. On observera encore que là où l'action du pouvoir public est faible, il se constitue de petits États dans le grand État, de petites sociétés dans une plus grande. De même, là où l'action de la justice publique disparaît, celle de la justice privée, sectaire, s'y substitue, et vice versa [FN: § 2180-1]. Dans les relations internationales, sous les flagorneries des déclamations humanitaires et éthiques, il n'y a que la force. Les Chinois s'estimaient supérieurs en civilisation aux Japonais (§ 2550-1), et ils l'étaient peut-être ; mais aux Chinois manquait la force militaire qui, grâce à un reste de « barbarie » féodale, ne faisait pas défaut aux Japonais. Aussi, attaqués par les hordes européennes dont les exploits en Chine rappellent, comme l'a si bien dit G. Sorel, ceux des conquistadores espagnols en Amérique, les pauvres Chinois, lorsque leur pays eut subi le meurtre, les rapines et les pillages des Européens, durent, pour comble, leur payer une indemnité, tandis que les Japonais, vainqueurs des Russes, se font respecter de tout le monde. Il y a quelques siècles, l'habileté diplomatique consommée des maîtres chrétiens de Constantinople ne les sauvait pas de la ruine que leur apportaient le fanatisme et la force des Turcs. Et maintenant, en 1913, exactement dans le même lieu, les vainqueurs, déchus de leur fanatisme et de leur force, se fiant à leur tour aux espoirs trompeurs de l'habileté diplomatique, sont vaincus et défaits par la force de leurs anciens sujets. Très grave est l'illusion des hommes politiques qui s'imaginent pouvoir suppléer par des lois inermes à l'emploi de la force armée. Parmi les nombreux exemples qu'on pourrait citer, ceux de la constitution de Sulla et de la constitution conservatrice de la troisième République française suffiront. La constitution de Sulla tomba, parce qu'on ne garda pas la force armée qui pouvait la faire respecter. La constitution d'Auguste subsista, parce que les successeurs de cet empereur s'appuyèrent sur la force des légions [FN: § 2180-2] . La Commune vaincue et défaite, Thiers s'imagina que le gouvernement devait s'appuyer sur les lois plus que sur la force armée, et ses lois furent éparpillées comme feuilles au vent, par la tempête de la ploutocratie démocratique [FN: § 3] . Nous ne rappelons pas l'exemple de Louis XVI de France, qui, par son veto, croyait pouvoir arrêter la Révolution : c'était l'illusion d'un homme privé de sens et de courage [FN: § 2180-4) (§ 2201).
§ 2181. Comme d'habitude, tous ces faits apparaissent voilés par les dérivations. En un sens, nous avons des théories qui condamnent dans tous les cas l'emploi de la violence par les gouvernés ; en un autre sens, des théories qui la réprouvent si elle est employée par les gouvernants (§ 2147 18, 2174).
§ 2182. Quand on n'éprouve pas trop le besoin de faire usage de la logique, les premières théories font simplement appel, par des abstractions du genre de celles de 1'« État », à la vénération pour les hommes qui détiennent le pouvoir, et à la réprobation envers ceux qui cherchent à troubler ou à bouleverser l'ordre existant (§ 2192). Quand on estime utile de satisfaire le besoin de logique qu'éprouve l'homme, on s'efforce de créer une confusion entre l'acte de celui qui, exclusivement pour son propre compte, transgresse une uniformité fixée dans la société, et l'acte de celui qui la transgresse dans un intérêt collectif, et pour la remplacer par une autre. On cherche ainsi à étendre au second acte la réprobation dont le premier est généralement l'objet. À notre époque, on tient des raisonnements qui ont quelque rapport avec la théologie du Progrès. Plusieurs de nos gouvernements ont une origine révolutionnaire. Comment, sans renier cette origine, condamner les révolutions qu'on pourrait tenter contre eux ? On y parvient en leur attribuant un nouveau droit divin : l'insurrection était légitime contre les gouvernements du passé, qui fondaient leur pouvoir sur la force ; elle ne l'est plus contre les gouvernements modernes, qui fondent le leur sur la « raison ». Ou bien : l'insurrection était légitime contre les rois et les oligarchies ; elle ne l'est en aucun cas contre le « peuple ». Ou encore : on peut l'employer là où n'existe pas le suffrage universel ; on ne le peut plus là où l'on possède cette panacée. Et de nouveau : elle est inutile et par conséquent coupable, dans tous les pays où le « peuple » peut exprimer sa « volonté ». Enfin, pour ne pas oublier de donner quelque satisfaction à messieurs les métaphysiciens : l'insurrection n'est pas tolérable là où existe un « État de droit ». Le lecteur voudra bien nous excuser de ne pas lui définir cette belle entité : malgré toutes les recherches que nous avons faites, elle nous demeure parfaitement inconnue, et nous préférerions avoir à décrire la Chimère.
§ 2183. Toujours comme d'habitude, toutes ces dérivations sont dépourvues de sens précis. Tous les gouvernements font emploi de la force, et tous affirment être fondés sur la raison. En fait, avec ou sans suffrage universel, c'est toujours une oligarchie qui gouverne, et qui sait donner l'expression qu'elle désire à la « volonté populaire »; ainsi de la loi royale qui donnait l'imperium aux empereurs romains, ainsi des votes de la majorité d'une assemblée élue de façons diverses, ainsi du plébiscite qui donna l'Empire à Napoléon III, ainsi de tant d'autres volontés populaires, jusqu'au suffrage universel savamment guidé, acheté, manipulé par nos « spéculateurs ». Qui est ce dieu nouveau qu'on appelle « Suffrage universel » ? Il n'est pas mieux défini, pas moins mystérieux, pas moins en dehors de la réalité que tant d'autres divinités, et sa théologie ne manque pas plus qu'une autre de contradictions patentes. Les fidèles du « Suffrage universel » ne se laissent pas guider par leur dieu ; ce sont eux qui le guident, qui lui imposent les formes sous lesquelles il doit se manifester. Souvent, tandis qu'ils proclament la sainteté de la majorité, ils s'opposent par l'« obstruction » à la majorité, même s'ils ne sont qu'une petite minorité ; et tout en encensant la déesse Raison, ils ne dédaignent nullement, en certains cas, le secours de la ruse, de la fraude, de la corruption.
§ 2184. En somme, ces dérivations expriment surtout le sentiment de ceux qui, cramponnés au pouvoir, veulent le conserver, et aussi le sentiment beaucoup plus général de l'utilité de la stabilité sociale. Si, dès qu'une collectivité, petite ou grande, n'était pas satisfaite de certaines règles fixées dans la société dont elle fait partie, elle recourait aux armes pour supprimer ces règles, la société elle-même se dissoudrait. La stabilité sociale est si utile que, pour la maintenir, il est avantageux de recourir à des buts imaginaires (§ 1879, 1875), à des théologies diverses, parmi lesquelles celle du suffrage universel peut aussi trouver place, et de se résigner à souffrir certains dommages réels. Pour qu'il soit utile de troubler la stabilité sociale, il faut que ces dommages soient très graves, et comme les hommes sont guidés efficacement non par le raisonnement scientifique du sceptique, mais par des sentiments vifs qui s'expriment sous forme d'idéaux, les théories du « droit divin » des rois, des oligarchies, du « peuple », des « majorités », d'assemblées politiques, et autres semblables, peuvent être utiles entre certaines limites, et l'ont été effectivement, quelque absurdes qu'elles soient au point de vue scientifique.
§ 2185. Les théories qui approuvent l'emploi de la force par les gouvernés s'unissent presque toujours avec celles qui réprouvent cet emploi par les gouvernants. Un petit nombre de rêveurs réprouvent d'une manière générale l'emploi de la force par n'importe qui ; mais ces théories, ou bien n'ont aucun effet, ou bien n'ont que celui d'affaiblir la résistance des gouvernants, laissant le champ libre à la violence des gouvernés ; aussi pouvons-nous nous borner à considérer d'une façon générale le phénomène sous la première forme.
§ 2186. Un grand nombre de théories n'est pas nécessaire pour pousser à la résistance et à l'emploi de la force ceux qui sont on croient être opprimés. Pourtant, les dérivations sont surtout destinées à persuader ceux qui seraient neutres dans le conflit, de désapprouver la résistance des gouvernants et, par conséquent à rendre cette résistance moins vive, ou bien aussi à persuader de cette idée les gouvernants eux-mêmes; ce qui, d'ailleurs, ne peut guère réussir aujourd'hui, sauf avec les gens qui sont contaminés par l'humanitarisme. Il y a quelques siècles, on pouvait obtenir, dans nos contrées, par des dérivations religieuses, un certain succès auprès de ceux qui étaient sincèrement chrétiens, et dans d'autres contrées, par des dérivations de la religion qu'on y pratiquait, auprès de ceux qui y croyaient fermement. Comme l'humanitarisme est une religion semblable à la religion chrétienne, à la religion musulmane, etc., nous pouvons dire, d'une façon générale, que l'on peut parfois obtenir le concours des neutres et affaiblir la résistance des gouvernants, en faisant usage de dérivations de la religion, quelle qu'elle soit, si ces personnes la professent sincèrement. Mais comme les dérivations se prêtent aisément à la démonstration du pour et du contre, ce moyen est souvent peu efficace, quand il ne sert pas simplement à voiler des intérêts.
§ 2187. De notre temps, où les conflits sont surtout économiques, on accuse le gouvernement d'« intervenir » dans une contestation économique, s'il veut protéger les patrons ou les « renards », les « jaunes », contre la violence des grévistes. Si les agents de la force publique ne se laissent pas assommer sans faire usage de leurs armes, on dit qu'ils manquent de sang-froid, qu'ils sont « impulsifs, neurasthéniques ». On doit leur refuser, comme aux « renards », la faculté de faire usage de leurs armes quand ils sont attaqués par les grévistes ; car ceux-ci pourraient être tués, et le crime d'agression, même si malheureusement il existe, ne mérite pas la peine de mort (§ 2147-18). Les jugements des tribunaux sont flétris comme étant des « jugements de classe » ; en tout cas, ils sont toujours trop sévères. Enfin, il convient que les amnisties effacent tout souvenir de ces conflits. On pourrait croire que du côté des « renards », et de celui des patrons, on se sert de dérivations directement opposées, puisque les intérêts sont opposés ; mais cela n'a pas lieu, ou a lieu d'une manière atténuée, en sourdine. Pour les « renards », la cause en est qu'ils ont généralement peu de courage ; ils ne sont soulevés par aucun idéal ; ils se gênent presque de leur action, et agissent sans l'oser dire. Quant aux patrons, la cause est que beaucoup d'entre eux sont des « spéculateurs », qui espèrent se récupérer des dommages de la grève avec l'aide du gouvernement, et aux frais des consommateurs ou des contribuables. Leurs conflits avec les grévistes sont des contestations de complices qui se partagent le butin. Les grévistes, qui font partie du peuple, lequel abonde en résidus de la IIe classe, ont non seulement des intérêts, mais aussi un idéal. Les patrons « spéculateurs », qui font partie de la classe enrichie par les combinaisons, ont, au contraire, des résidus de la Ie classe à foison. Par conséquent, ils ont surtout des intérêts et point ou très peu d'idéal. Ils emploient mieux leur temps à des opérations lucratives qu'à édifier des théories. Parmi eux se trouvent plusieurs démagogues ploutocrates, habiles à faire tourner à leur profit une grève qui semblerait vraiment faite contre eux [FN: § 2187-1] .
Il y a ensuite des considérations générales qui servent aussi bien dans les conflits civils que dans les conflits internationaux, et qui reviennent à invoquer les sentiments de pitié pour les souffrances occasionnées par l'usage de la force, en faisant entièrement abstraction des causes pour lesquelles on en fait usage, et de l'utilité, ou du dommage, découlant du fait qu'on l'emploie ou non. Il s'y ajoute parfois des expressions de vénération ou du moins de compassion, pour le « prolétariat », qui jamais ne peut mal faire, ou du moins est excusable quoi qu'il fasse. Autrefois, on usait d'expressions analogues, correspondant à des sentiments analogues, en faveur du pouvoir royal, théocratique, aristocratique.
§ 2188. Il est remarquable, parce que cela concorde avec la nature essentiellement sentimentale des dérivations, que les théories qui seraient les meilleures au point de vue logico-expérimental sont habituellement négligées. Par exemple, au moyen âge, il y avait une excellente raison à donner en faveur du pouvoir clérical, lorsqu'il avait contestation avec le pouvoir impérial, royal ou du baron : c'est qu'il était presque l'unique contrepoids de ces pouvoirs, presque l'unique défense de l'intelligence, de la science, de la culture, contre la force ignorante et brutale. Mais cette raison était peu ou point invoquée, et les hommes préféraient se référer à des dérivations tirées de la doctrine de la révélation et des Saintes Écritures (§ 1617). Aujourd'hui, quand les patrons qui jouissent de la protection économique s'indignent parce que les grévistes veulent supprimer la concurrence que leur font les « jaunes », on ne répond pas qu'ils veulent empêcher d'autres de faire ce qu'ils font eux-mêmes, et qu'ils ne disent pas comment et pourquoi la libre concurrence des ouvriers est bonne, et celle des patrons mauvaise. Voici un individu qui veut passer la frontière en introduisant de la saccharine en Italie. Les douaniers accourent et empêchent par la violence cette concurrence aux fabricants de sucre, en allant, s'il le faut, jusqu'à faire usage de leurs armes, et parfois à tuer le contrebandier, que personne ne plaint ; tandis que c'est grâce à cette violence, à ces homicides, que plusieurs personnes ont pu gagner des richesses considérables, qui leur procurent de la considération, des honneurs, et jusqu'à un siège parmi les législateurs. Reste à savoir pourquoi la violence ne peut être également employée pour augmenter les salaires des ouvriers.
§ 2189. On peut objecter que la violence qui protège les intérêts des patrons est légale, et que celle dont les grévistes font usage contre les « jaunes » est illégale. Ainsi, la question n'est plus l'utilité de la violence, mais l'utilité du moyen par lequel on l'exerce, et c'est, à la vérité, une question importante. La violence légale est l'effet des règles existant dans une société, et, en général, son emploi est d'une utilité plus grande, ou d'un désavantage moindre que l'emploi de la violence privée, laquelle tend à détruire ces règles. On remarquera que les grévistes pourraient répondre, et parfois ils répondent effectivement, qu'ils font usage de la violence illégale, parce qu'on leur ôte le moyen d'employer la force légale. Si, par la violence légale, la loi contraignait quelqu'un d'autre à leur donner ce qu'ils demandent, ils n'auraient pas besoin de recourir à la violence illégale. On peut répéter cela dans un très grand nombre d'autres cas. Quiconque fait usage de la violence illégale ne désire rien de mieux que de pouvoir la transformer en violence légale.
§ 2190. Mais le sujet n'est pas épuisé ; maintenant, nous arrivons au point saillant de la question. Laissons de côté le cas particulier, et parlons d'une manière générale. C'est proprement une contestation entre la ruse et la force. Pour en décider dans le sens qu'il n'est jamais utile d'opposer la force à la ruse, en aucun cas, fût-il exceptionnel, il serait nécessaire de démontrer que toujours, sans aucune exception, l'emploi de la ruse est plus utile que celui de la force (§ 2319). Supposons que, dans un certain pays, il y ait une classe gouvernante A, qui s’assimile les meilleurs éléments de toute la population, au point de vue de la ruse. Dans ces circonstances, la classe gouvernée B est privée en grande partie de ces éléments, et par ce fait, elle ne peut avoir que peu ou point d'espoir de jamais vaincre la partie A, tant que l'on combat par la ruse. Si celle-ci était accompagnée de la force, la domination de la partie A serait perpétuelle. Mais c'est le cas d'un petit nombre d'hommes. Chez la plupart, celui qui fait emploi de la ruse est moins capable d'employer la violence, le devient toujours moins, et vice-versa. Par conséquent, si l'on accumule dans la partie A des hommes qui savent mieux se servir de la ruse, la conséquence en est qu'on accumule dans la partie B des hommes qui sont plus aptes à employer la violence. De cette façon, si le mouvement continue, l'équilibre tend à devenir instable, puisque les A sont servis par la ruse, mais qu'il leur manque le courage pour faire usage de la force, ainsi que les instruments nécessaires pour cet usage ; tandis que les B ont bien le courage et les instruments, mais l'art de s'en servir leur fait défaut. Si les B viennent à trouver des chefs qui possèdent cet art, et l'histoire nous enseigne qu'habituellement ils leur viennent de dissidents des A, ils ont tout ce qu'il faut pour remporter la victoire et chasser du pouvoir les A. Nous en avons des exemples innombrables dans l'histoire, depuis les temps les plus reculés jusqu'aux nôtres [FN: § 2190-1].
§ 2191. Il faut observer ici que souvent ce bouleversement est utile à la collectivité, surtout dans le cas où la classe gouvernante tend toujours plus à l'humanitarisme. Il l'est moins lorsqu'elle est constituée par des individus qui ont toujours plus la tendance d'employer les combinaisons au lieu de la force, moins encore, au point de devenir nuisible, si ces combinaisons ont pour conséquence, même indirecte, la prospérité matérielle de la collectivité. Supposons un pays où la classe gouvernante A tende toujours plus à l'humanitarisme, c'est-à-dire qu'elle accepte uniquement les persistances des agrégats les plus nuisibles, qu'elle repousse les autres comme de vieux préjugés, et qu'en préparant le « règne de la raison », elle devienne toujours moins capable d'user de la force, autrement dit qu'elle s'exonère du principal devoir des gouvernants. Ce pays s'achemine à une ruine complète. Mais voici que la partie gouvernée B s'insurge contre la partie A. Pour la combattre, par des discours, la partie B fait usage des dérivations humanitaires si chères à la partie A ; mais sous ces dérivations se cachent des sentiments bien différents, qui ne tardent pas à se manifester par des actes. Les B font largement usage de la force : non seulement ils dépossèdent les A, mais ils en tuent plusieurs ; et, à vrai dire, ils accomplissent ainsi une œuvre aussi utile que celle qui consiste à détruire des animaux nuisibles. Les B apportent avec eux, au gouvernement de la société, une grande somme de persistance des agrégats. Il importe peu ou point que ces persistances d'agrégats soient différentes des anciennes : il importe seulement qu'elles existent (§ 1744, 1850), et que, grâce à elles, la collectivité acquière de la stabilité et de la force. Le pays échappe à la ruine et renaît à la vie. Celui qui juge superficiellement peut-être tenté de n'arrêter son esprit qu'aux massacres et aux pillages qui accompagnent le bouleversement, sans se demander si ce ne sont pas là les manifestations, déplorables sans doute, de forces sociales et de sentiments qui sont, au contraire, très utiles. Celui qui dirait que ces massacres et ces pillages, loin d'être condamnables, sont, au contraire, l'indice que ceux qui les commirent méritaient le pouvoir, pour l'utilité de la société, celui-là exprimerait un paradoxe, parce qu'il n'existe pas de rapport de cause à effet, ni d'étroite et indispensable dépendance mutuelle entre ces maux et l'utilité de la société. Mais ce paradoxe renfermerait pourtant un grain de vérité, étant donné que les massacres et les pillages sont le signe extérieur par lequel se manifeste la substitution de gens forts et énergiques à des gens faibles et vils [FN: § 2191-1].
Nous venons de décrire d'une manière abstraite un grand nombre de bouleversements concrets, depuis celui qui donna l'Empire à Auguste jusqu'à la révolution française de 1789 (§ 2199 et sv.). Si la classe gouvernante française avait eu la foi qui conseille l'emploi de la force, et la volonté de l'employer, elle n'aurait pas été dépossédée, et, en travaillant dans son intérêt, elle aurait travaillé dans celui du pays. Puisqu'elle devint incapable d'accomplir cette tâche, il était utile qu'une autre classe se substituât à elle, et comme c'était justement l'emploi de la force qui faisait défaut, c'était une conséquence d'uniformités très générales que l'on allât à l'autre extrême, où l'on fait usage de la force, même plus qu'il n'est besoin. Si Louis XVI n'avait pas été un homme peu sensé et encore moins courageux, qui se laissa tuer sans combattre, et qui préféra porter sa tête sous la guillotine plutôt que de tomber en brave, les armes à la main, c'eût peut-être été lui qui eût détruit ses adversaires. Si les victimes des massacres de septembre, leurs parents, leurs amis, n'avaient pas été pour la plupart des humanitaires sans aucun courage ni aucune énergie, c'eût été eux qui eussent détruit leurs ennemis au lieu d'avoir attendu d'être détruits. Il était utile au pays que le gouvernement passât à ceux qui faisaient preuve de la foi et de la volonté nécessaires à l'emploi de la force. L'utilité pour la société est moins apparente lorsque la classe gouvernante est composée de gens chez lesquels prédominent les instincts des combinaisons, et même, en de certaines limites, cette utilité peut ne pas exister. Mais si la classe gouvernante perd trop les sentiments de persistance des agrégats, on arrive facilement à un point où elle n'est plus capable de défendre, non seulement son propre pouvoir, mais encore, ce qui est pis, l'indépendance du pays. Alors, si l'on croit cette indépendance utile, on doit aussi estimer utile la disparition de la classe qui ne sait plus remplir sa tâche de défense nationale. Comme d'habitude, c'est de la classe gouvernée que peuvent sortir ceux qui ont assez de foi et de volonté pour employer la force à défendre la patrie.
§ 2192. La classe gouvernante A s'efforce, de diverses façons, de maintenir son pouvoir et d'écarter le danger dont les B la menacent (§ 1827, 1838, 2394 et sv.). C'est pourquoi, tantôt elle s'efforce de se servir de la force des B, et c'est le moyen le plus efficace ; tantôt elle s'efforce d'empêcher que ses dissidents ne se mettent à la tête des B, ou plutôt de cette partie des B qui est disposée à user de la force ; mais cela est bien difficile à réaliser. Les A usent de dérivations pour calmer les B (§ 2182) : ils leur disent que « tout pouvoir vient de Dieu », que recourir à la violence est un « crime », qu'il n'y a aucun motif d'employer la force pour obtenir, si c'est « juste », ce qu'on peut obtenir par la « raison ». Cette dérivation a pour but principal d'empêcher les B de livrer bataille sur un terrain qui leur est favorable, afin de les attirer sur un autre terrain, celui de la ruse, où leur défaite est certaine, s'ils combattent contre les A qui, en fait de ruse, leur sont immensément supérieurs. Mais, comme d'habitude, l'efficacité de ces dérivations dépend en majeure partie de sentiments préexistants qu'elles expriment, et seulement en petite partie de sentiments qu'elles créent.
§ 2193. À ces dérivations il faut en opposer d'autres, ayant une efficacité analogue ; et il est bon qu'une partie des dérivations mettent en œuvre des sentiments partagés par les gens qui s'imaginent être neutres, bien qu'en réalité ils ne le soient peut-être pas, et qui voudraient ne prendre parti ni pour les A ni pour les adversaires des A, mais avoir uniquement en vue ce qui est « juste » et « honnête ». On trouve ces sentiments surtout parmi ceux qui sont manifestés par les résidus de la sociabilité (IVe classe), et plus encore parmi les sentiments de pitié (IV-γ et IV-γ 2). C'est pourquoi le plus grand nombre des dérivations qui sont favorables à la violence de la classe gouvernée, défendent cette violence plutôt indirectement que directement, en condamnant la résistance de la classe gouvernante, au nom de la sociabilité, de la pitié, de la répulsion pour les souffrances d'autrui [FN: § 2193-1]. Ces derniers sentiments sont presque les seuls qu'invoquent un grand nombre de pacifistes, lesquels, pour défendre leur thèse, ne savent faire autre chose que décrire les « horreurs de la guerre ». Souvent, aux dérivations concernant les conflits sociaux s'ajoutent les sentiments d'ascétisme, qui agissent parfois sur une partie des individus de la classe A, et peuvent par conséquent être très profitables aux B.[FN: § 2193-2]
§ 2194. En somme, toutes ces dérivations expriment surtout les sentiments de ceux qui veulent changer l'organisation sociale. Elles sont donc utiles ou nuisibles, suivant que ce changement est utile ou nuisible. Celui qui voudrait affirmer que le changement est toujours nuisible, que la stabilité est le plus grand bien, devrait, en conséquence, être prêt à démontrer, ou bien qu'il serait utile que les sociétés humaines fussent restées toujours dans un état de barbarie, ou bien que le passage de cet état à l'état civilisé présent a eu lieu ou aurait pu (§ 133 et sv.) avoir lieu sans guerres ni révolutions. Cette seconde affirmation est tellement contredite par la réalité, telle qu'elle apparaît dans l'histoire, que le simple fait d'en traiter est absurde. Reste la première affirmation, que l'on pourrait défendre en donnant un sens spécial au terme « utilité », et en accordant crédit aux théories qui célèbrent les joies de l'« état de nature ». Quiconque ne veut pas aller jusque là ne peut pas admettre non plus la première proposition ; il est donc contraint par les faits et par la logique de reconnaître que les guerres et les révolutions furent parfois utiles, ce qui, d'ailleurs, ne veut pas dire toujours. Cela étant admis pour le passé, tout fondement fait défaut pour démontrer que cela n'aura pas lieu également dans l'avenir.
§ 2195. Nous voici donc, comme d'habitude, chassés du domaine qualitatif, où dominent les dérivations, et conduits dans le domaine quantitatif de la science logico-expérimentale. On ne peut pas affirmer d'une façon générale que la stabilité soit toujours utile, ni que le changement le soit toujours. Il faut examiner chaque cas en particulier, évaluer l'utile et le nuisible, et voir si le premier surpasse le second, ou vice-versa.
§ 2196. Nous avons déjà remarqué (§ 2176) qu'en de nombreux cas, il se trouve que la stabilité est utile. Non moindre serait le nombre des cas où l'on trouverait que les transgressions aux règles existantes sont utiles, si l'on mettait ensemble les règles de l'ordre intellectuel et celles de l'ordre matériel. Mais si on les sépare, on verra que, surtout dans les transgressions qui sont l'œuvre d'un petit nombre d'individus, il est de très nombreux cas où les transgressions des règles de l'ordre intellectuel par un seul individu ou par quelques-uns sont utiles, et qu'il y a peu de cas où ces transgressions aux règles de l'ordre matériel soient utiles aussi. Or il est une formule (§ 2176) en vertu de laquelle les transgressions de l'ordre matériel doivent être d'autant plus réprimées qu'elles sont plus individuelles, d'autant moins réprimées qu'elles sont plus collectives. On voit donc qu'en un très grand nombre de cas, les effets de cette formule ne nous écartent pas trop du maximum d'utilité sociale, comme ce serait le cas si l'on appliquait aussi cette formule aux transgressions de l'ordre intellectuel. Telle est, en somme, la principale raison que l'on peut donner en faveur de ce qu'on appelle « la liberté de pensée ».
§ 2197. Les auteurs des dérivations ne l'entendent pas ainsi. Les dissidents défendent leur opinion, parce qu'elle est « meilleure » que celle de la majorité. Il est utile qu'ils aient cette foi, parce qu'elle seule peut leur donner assez d'énergie pour résister aux persécutions auxquelles ils s'exposent presque toujours. Tant qu'ils sont peu nombreux, ils demandent seulement une petite place au soleil pour leur secte ; mais, en réalité, ils soupirent après le moment où, de persécutés, ils pourront se changer en persécuteurs ; ce qui ne manque pas d'arriver sitôt que leur nombre a effectivement augmenté au point qu'ils puissent imposer leur volonté. Alors cesse l'utilité de la dissidence passée, et apparaît le dommage de la nouvelle orthodoxie.
§ 2198. Dans l'étude du phénomène de l'emploi de la force, plus encore que dans l'étude d'autres phénomènes sociaux, nous sommes portés à considérer uniquement les rapports de cause à effet, et de cette façon, en de nombreux cas, nous ne nous écartons pas trop de la réalité, car enfin, dans la suite d'actions et de réactions qu'il faut considérer, l'action de la force produisant certains effets est considérable. D'ailleurs, il convient de ne pas s'arrêter sur ce point, mais d'aller de l'avant, pour voir s'il est des phénomènes plus généraux auxquels nous puissions nous attacher.
§ 2199. Par exemple, un peu plus haut (§ 2169), nous avons comparé la révolution qui s'est produite à Rome, au temps d'Auguste, et celle qui eut lieu en France, au temps de Louis XVI, et nous avons vu que, pour comprendre ces révolutions, nous devions rechercher sous les dérivations les sentiments et les intérêts que ces dérivations reflètent. En continuant, en faisant un pas de plus, nous observons qu'au temps de la chute de la république romaine comme à celui de la chute de la monarchie française, la classe gouvernante ne savait pas ou ne pouvait pas employer la force, et qu'elle fut chassée du pouvoir par une autre classe, qui savait et pouvait user de la force (§ 2191). À Rome comme en France, cette classe sortit du peuple, et constitua, à Rome les légions de Sulla, de César, d'Octave ; en France, les bandes révolutionnaires qui vainquirent le pouvoir royal, en complète décadence, et l’armée qui vainquit les troupes médiocres des potentats européens. Les chefs de cette classe parlaient naturellement latin à Rome et français en France, et non moins naturellement faisaient usage des dérivations qui convenaient à chacun de ces peuples. Au peuple romain ils offrirent des dérivations qui s'adaptaient aux sentiments pour lesquels on changeait le fond en conservant la forme (§ 174 et sv.). Au peuple français, ils offrirent des dérivations qui appartenaient à la religion du « Progrès », si chère alors à ce peuple. Aux temps de la révolution anglaise, Cromwell et d'autres ennemis de la monarchie des Stuarts ne s'étaient pas servi autrement des dérivations bibliques.
§ 2200. Les dérivations françaises nous sont beaucoup mieux connues que les dérivations romaines, non seulement à cause de la plus grande quantité de documents français qui nous sont parvenus, mais aussi parce qu'il semble très probable que les dérivations françaises ont été plus nombreuses. Si Octave avait continué à être le défenseur du Sénat, peut-être aurait-il fait une consommation très abondante de dérivations ; mais quand, près de Bologne, s'entendant avec Antoine et Lépide [FN: § 2200-1], il confia sa fortune exclusivement à la force des légions, il remisa les dérivations à l'arsenal comme armes inutiles, et ne les ressortit qu'après la victoire, pour atténuer les souffrances des conservateurs romains. Quelque chose de semblable se produisit en France, pour Napoléon Ier ; mais avant lui, les, Jacobins, qui lui montrèrent la voie, ne purent faire seulement œuvre de lions : ils durent recourir aussi aux artifices des renards. De sa propre autorité, Octave s'était assuré le concours d'une troupe armée, d'abord à ses frais, ensuite avec l'argent qu'il pouvait extorquer à autrui, grâce à la force. Les chefs révolutionnaires français, ne pouvant s'engager dans cette voie dès l'abord, durent, en commençant, se procurer des troupes révolutionnaires au moyen des dérivations. Celles-ci, exprimant les sentiments de nombreux adversaires du gouvernement, groupaient ces adversaires autour des chefs révolutionnaires ; et comme elles exprimaient aussi les sentiments de presque tous les gouvernants, elles avaient pour effet d'endormir complètement leur vigilance, et d'affaiblir entièrement leur résistance, déjà très faible. Ensuite, sitôt que les chefs révolutionnaires furent au pouvoir, ils imitèrent les triumvirs et un grand nombre d'autres gouvernants de ce genre, en dispensant à leurs partisans l'argent et les biens de leurs adversaires.
§ 2201. Ainsi que nous l'avons répété nombre de fois déjà, si l'effet des dérivations est beaucoup moins grand que celui des résidus, il n'est pas nul, et les dérivations servent à donner une force et une efficacité plus grande aux résidus qu'elles expriment. On ne peut donc pas dire que les historiens qui ont étudié exclusivement, ou ne fût-ce même que principalement, les dérivations de la révolution française, aient porté leur attention sur une partie du phénomène dépourvue de toute valeur concluante ; on peut dire seulement qu'ils se sont trompés en considérant comme principal ce qui n'était que secondaire. Plus grande a été l'erreur de ne pas rechercher quel rôle avait joué l'emploi de la force, et les causes pour lesquelles certains hommes n'en firent pas usage et d'autres en usèrent. Le petit nombre de ceux qui ont porté leur attention sur l'emploi de la force ont fait de nouveau fausse route, en admettant que c'était à cause des dérivations que les gouvernants s'abstinrent de cet emploi ; tandis qu'une telle abstention et les dérivations avaient une commune origine dans les sentiments de ces hommes. Pourtant, à qui l'observe attentivement, le phénomène paraît bien établi sur des preuves et des contre-preuves. Louis XVI tombe parce qu'il ne veut pas, ne sait pas, ne peut pas se servir de la force ; et parce qu'ils veulent, qu'ils savent, qu'ils peuvent s'en servir, les révolutionnaires triomphent. Ce n'est pas l'efficacité de leurs théories, mais uniquement celle de la force de leurs partisans qui porte au pouvoir diverses factions, jusqu'à ce que le Directoire, qui s'en était tiré par la force, dans son conflit avec de plus faibles que lui, succombe lui-même à la force dans son conflit avec Bonaparte, rendu fort par ses troupes victorieuses. À son tour, le pouvoir de Bonaparte dura jusqu'à ce qu'il fût écrasé par la force plus grande des armées coalisées. De nouveau, voici que se succèdent, en France, des gouvernements, qui tombent parce qu'ils ne veulent pas, ne savent pas, ne peuvent pas se servir de la force [FN: § 2201-1] , tandis que surgissent de nouveaux gouvernements, grâce à l'emploi de la force. On observa ce fait à la chute de Charles X, à celle de Louis-Philippe, à l'avènement de Napoléon III ; et l'on peut ajouter que si le gouvernement versaillais put se maintenir, en 1871, contre l'insurrection de la Commune, ce fut parce qu'il eut à son service une forte armée et sut s'en servir.
§ 2202. Mais ici se pose spontanément cette question : pourquoi certains gouvernements ont-ils fait usage de la force, et d’autres n'en ont-ils pas fait usage ? On comprend que le pas fait tout à l'heure dans l'explication des phénomènes doit être suivi d'autres pas. En outre, on voit qu'il peut n'être pas exact de dire, comme nous venons de le faire, qu'un gouvernement est tombé parce qu'il n'a pas employé la force ; car, s'il y avait des faits dont dépendrait celui de n'avoir pas employé la force, ces faits seraient proprement la cause des phénomènes, tandis que le fait de n'avoir pas employé la force ne serait qu'une cause apparente. Il se pourrait aussi que ces faits dépendissent à leur tour, au moins en partie, de l'abstention de l'emploi de la force, et que, par conséquent, aux rapports de cause à effet, il s'en superposât d'autres, de mutuelle dépendance. Ce n'est pas tout. Si l'on remarque que les gouvernements qui ne savent pas ou ne peuvent pas se servir de la force tombent, on remarque aussi qu'aucun gouvernement ne dure en faisant exclusivement usage de la force (§ 2251). De tout cela, il ressort à l'évidence que nous avons considéré seulement une face du problème, et qu'il est par conséquent nécessaire d'étendre le champ de nos recherches, et d'étudier les phénomènes d'une façon beaucoup plus générale. C'est ce que nous allons faire maintenant.
§ 2203. LES CYCLES DE MUTUELLE DÉPENDANCE. – Reportons notre attention sur l'ensemble des éléments dont dépend l'équilibre social ; et puisque nous ne pouvons malheureusement pas les considérer tous et tenir rigoureusement compte de la mutuelle dépendance, suivons la voie indiquée déjà aux § 2104 et 2092. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les éléments, nous considérerons un nombre restreint de catégories que nous choisirons naturellement parmi les plus importantes, et que nous étendrons ensuite peu à peu, pour y ranger le plus possible d'éléments. Quant à la mutuelle dépendance, nous substituerons le procédé (2-a) au procédé (2-b) du § 1732, en prenant toujours garde aux écueils signalés au § 2092-1.
§ 2204. Un élément d'une catégorie donnée agit sur ceux des autres catégories, qu'il soit séparé des autres éléments de sa catégorie, ou qu'il y soit uni. Nous appellerons direct l'effet qu'il a si on le considère séparément des autres éléments de la même catégorie ; indirect l'effet qu'il a en vertu de son union avec les éléments de la même catégorie. Ainsi l'on continue la distinction commencée au § 2089. Nous avions alors divisé les faits en deux catégories : 1° le fait de l'existence d'une société ; 2° les faits accomplis dans cette société, ou les éléments dont résulte cette existence. Maintenant divisons cette seconde catégorie, d'abord en groupes, puis séparons dans chaque groupe un élément des autres du même groupe, et cherchons quel effet il a sur les éléments des autres catégories (effet direct), lorsqu'il est séparé, et quel effet il a sur eux, quand on le considère comme uni aux éléments de sa catégorie (effet indirect).
§ 2205. Considérons maintenant la mutuelle dépendance des catégories. Pour être bref, indiquons par des lettres les éléments suivants : (a) résidus, (b) intérêts, (c) dérivations, (d) hétérogénéité et circulation sociale. Si nous pouvions faire usage de la logique mathématique, la dépendance mutuelle entre ces éléments s'exprimerait par des équations (§ 2091); mais puisqu'on ne peut le faire pour le moment, il nous reste à nous servir du langage vulgaire (§ 2092), à considérer cette dépendance mutuelle sous une autre forme, celle d'actions et de réactions des éléments, et à suivre la voie indiquée au § 2104.
§ 2206. Nous dirons donc que : (I) ; (a) agit sur (b) , (c) , (d) – (II) ; (b) agit sur (a) , (c) , (d) – (III) ; (c) agit sur (a), (b), (d) – (IV) ; (d) agit sur (a), (b), (c). D'après ce que nous avons exposé aux chapitres précédents, on voit que la combinaison (I) donne une partie très importante du phénomène social ; et peut-être en avaient-ils quelque lointaine et imparfaite idée, ceux qui plaçaient dans l'éthique le fondement de la société. Peut-être aussi y a-t-il là ce grain de réalité qui peut se trouver dans les doctrines métaphysiques qui soumettent les faits aux « concepts ». En effet, les résidus et les sentiments correspondants se reflètent dans ces concepts, fût-ce d'une manière imparfaite. Enfin, c'est cela aussi qui assure la continuité de l'histoire des sociétés humaines, car précisément la catégorie (a) varie peu ou lentement. Mais nous en parlerons longuement plus loin. La combinaison (II) donne aussi une partie assez considérable du phénomène social, à laquelle on peut appliquer ce que nous venons de dire à propos de la combinaison (I). L'importance de la combinaison (II) fut aperçue par les adeptes du « matérialisme historique », qui, d'ailleurs, tombèrent dans l'erreur de prendre la partie pour le tout, et de négliger les autres combinaisons. La combinaison (III) est de moindre importance que toutes les autres ; c'est parce que les humanitaires, les « intellectuels », les adorateurs de la déesse Raison, ne l'ont pas vu, que leurs élucubrations sont erronées, non-concluantes, vaines. Mais plus que les autres combinaisons, celle-ci nous est connue par la littérature ; c'est pourquoi on lui donne habituellement une importance qui va bien au delà de la réalité. La combinaison (IV) n'est pas de peu d'importance. C'est ce qu'ont en partie aperçu Platon et Aristote, pour ne pas parler d'autres anciens. Aujourd'hui, les considérations de Lapouge, de Hamon et d'autres, bien que partiellement erronées et imparfaites, ont eu le grand mérite de mettre en évidence ce phénomène très important ; tandis que le fait de le négliger vicie radicalement les théories dites démocratiques.
§ 2207. Il faut avoir présent à l'esprit que les actions et les réactions se suivent indéfiniment, comme en cercle (§ 2102-1) ; par exemple, en commençant par la combinaison (I), on arrive à la combinaison (IV), et de celle-ci on passe de nouveau à la combinaison (I). Dans la combinaison (I), l'élément (a) agissait sur (d) ; dans la combinaison (IV), l'élément (d) agit sur (a) ; puis on revient à la combinaison (1) , par laquelle (a) agit de nouveau sur (d) , et ainsi de suite. Par conséquent, une variation de (a) , en vertu de la combinaison (I), fait varier les autres éléments (b) , (c) , (d) . Uniquement afin de nous entendre (§ 119), nous donnerons le nom d'effets immédiats à ces variations de (a) , (b) , (c) , (d) , provoquées par la combinaison (I). Mais, en vertu des autres combinaisons, les variations de (b) , (c) , (d) font aussi varier (a) . Par le mouvement circulaire que nous avons mentionné, cette variation se répercute dans la combinaison (I), et donne lieu à de nouvelles variations de (a) , (b) , (c) , (d) .Toujours afin de nous entendre, nous donnerons à celles-ci le nom d'effets médiats. Parfois, il est nécessaire de considérer en semble deux ou plusieurs combinaisons. Plus loin (§ 2343 et sv.), nous verrons un exemple très important où, à cause de l'entrelacement des effets, nous sommes obligés d'étudier ensemble les combinaisons (II) et (IV). L'état d'équilibre concret que l'on observe en une société est une conséquence de tous ces effets, de toutes ces actions et réactions. Il est donc différent d'un état d'équilibre théorique obtenu en considérant un ou plusieurs des éléments (a) , (b) , (c) , (d) , au lieu de les considérer tous. Par exemple, l'économie politique appartient à la catégorie (b) , et comprend une partie qui est l'économie pure. Celle-ci nous fait connaître un équilibre théorique, différent d'un autre équilibre théorique, qu'on obtiendrait par l'économie appliquée ; ce nouvel équilibre rentre toujours dans la catégorie (b) ; il est différent des autres équilibres théoriques que l'on obtiendrait en combinant (b) avec une partie des éléments (a) , (b) , (d) , différent enfin de l'équilibre théorique, beaucoup plus rapproché de la réalité, obtenu en combinant ensemble tous les éléments (a) , (b) , (c) , (d) [FN: § 2207-1] (§ 2552).
§ 2208. Il sera utile de donner une forme moins abstraite à ces considérations, et, en même temps, d'aller de cas particuliers à des cas plus généraux, suivant la méthode inductive. Mettons dans la catégorie (b) la protection douanière des industries, au moyen de droits d'importation. Nous aurons d'abord ses effets économiques directs et indirects. L'économie politique, qui est la science de la catégorie (b) , s'occupe surtout de ces effets-là. Nous ne nous arrêterons pas ici, et rappellerons seulement quelques effets qu'il nous est nécessaire de considérer. Parmi ceux-là nous devons tout d'abord nous attacher à certains effets économiques, jusqu'à présent quelque peu négligés par l'économie politique. Ceux qui défendaient le libre-échange ont d'habitude considéré, au moins implicitement, les bas prix comme un bien pour la population, tandis que ceux qui défendaient la protection les considéraient comme un mal. La première de ces opinions était facilement acceptée par qui prêtait attention surtout à la consommation ; la seconde par qui s'arrêtait surtout à la production ; mais au point de vue scientifique, elles avaient toutes les deux peu ou point de valeur, car elles partaient d'une analyse incomplète du phénomène [FN: § 2208-1]. On fit un grand pas en avant dans la voie scientifique, lorsque, grâce aux théories de l'économie mathématique, on put démontrer qu'en général la protection a pour conséquence directe une destruction de richesse [FN: § 2208-2] . Si l'on pouvait ajouter la proposition, admise implicitement par un grand nombre d'économistes, suivant laquelle toute destruction de richesse est un « mal », on pourrait logiquement conclure que la protection est un « mal » [FN: § 2208-3). Mais pour admettre cette proposition, il faut d'abord rechercher quels sont les effets économiques indirects et les effets sociaux de la protection. Pour ne parler maintenant que des premiers, nous voyons que la protection transporte, d'une partie A de la population à une partie B, une certaine somme de richesse, moyennant la destruction d'une somme q de richesse. Cette somme est le coût de l'opération. Si, avec la nouvelle distribution de la richesse, la production n'augmente pas d'une quantité plus grande que q, l'opération est économiquement nuisible à l'ensemble de la population. Si elle augmente d'une quantité plus grande que q, elle est économiquement utile. Il ne faut pas exclure ce cas a priori, car dans la partie A se trouvent les paresseux, les fainéants, ceux qui font peu usage des combinaisons économiques ; tandis que parmi les B se trouvent les gens avisés en matière économique, capables de la plus grande activité, et ceux qui savent très bien se servir des combinaisons économiques. Pour parler ensuite d'une manière générale, non seulement des effets économiques, mais aussi des effets sociaux, nous devrons distinguer entre les effets dynamiques, qui se produisent peu de temps après que l'on a institué la protection, et les effets statiques, qui se produisent après que la protection a été établie depuis longtemps. Il faut aussi distinguer entre les effets qui ont lieu pour des productions qui peuvent aisément s'accroître, telles les productions industrielles, en général, et celles qui ont lieu pour les productions qui peuvent difficilement s'accroître, telles les productions agricoles. L'effet dynamique est plus considérable pour les industriels que pour les agriculteurs. Lorsqu'on établit la protection, les industriels qui possèdent déjà les usines qui seront protégées, et ceux qui savent judicieusement prévoir ou instituer la protection, jouissent d'un monopole temporaire. Celui-ci ne prendra fin que lorsque de nouveaux industriels viendront faire concurrence aux premiers, Il faut pour cela un temps qui n'est souvent pas court. Au contraire, les agriculteurs ont peu à craindre de nouveaux concurrents ; par conséquent, pour eux, l'effet dynamique diffère peu de l'effet statique. En outre, la protection peut donner naissance à de nouvelles industries, et, par conséquent, faire croître, sinon les gains, du moins le nombre des industriels. Cela peut aussi avoir lieu pour l'agriculture, mais en de bien moindres proportions ; et d'habitude, la protection substitue seulement une culture à une autre. Au contraire, l'effet statique est moins considérable pour les gains des industriels que pour ceux des agriculteurs ; il accroît les rentes de ceux-ci, tandis que la concurrence annule les rentes des monopoles temporaires des industriels. C'est précisément pour cela que la protection industrielle détruit, habituellement, plus de richesse que la protection agricole ; car avec celle-ci, les rentes nouvelles qui constituent un simple transfert de richesse, échappent à la destruction.
§ 2209. Voyons les effets immédiats (§ 2207) sur les autres catégories. Combinaison II. L'effet le plus grand a lieu sur d, c'est-à-dire sur l'hétérogénéité sociale. Les effets dynamiques de la protection industrielle enrichissent non seulement l'individu bien doué au point de vue technique, mais surtout l'homme bien doué sous le rapport des combinaisons financières, ou de la ruse, permettant de se concilier les faveurs des politiciens, qui confèrent les avantages de la protection. Telles de ces personnes qui possèdent ces qualités à un degré éminent deviennent riches, puissantes, gouvernent le pays. Il arrive de même pour les politiciens qui savent opportunément vendre les avantages de la protection. Chez tous ces individus, les résidus de la Ie classe sont intenses, et ceux de la IIe beaucoup plus faibles. D'autre part, ceux chez lesquels les qualités du caractère ont plus d'importance que les qualités d'ingéniosité technique on financière, ou qui ne possèdent pas les qualités mentionnées d'activité et d'habileté, sont frustrés. En, effet, d'une part ils ne retirent aucun avantage de la protection, et d'autre part ce sont eux qui en font les frais. Les effets statiques de la protection industrielle sont, non pas identiques, mais analogues, et, s'ils enrichissent beaucoup moins de gens, ils ouvrent néanmoins la voie à l'activité de ceux qui possèdent les qualités indiquées d'ingéniosité et de ruse, et ils accroissent la population industrielle, souvent au détriment de la population agricole. Bref, admettons que, pour constituer la classe gouvernante, on tienne compte des examens hypothétiques que nous supposions au § 2027, dans le but d'éclairer le sujet. On donne alors plus de points aux individus qui ont des résidus de la Ie classe, intenses et nombreux, et qui savent s'en servir pour tirer profit de la protection. On en donne moins à ceux qui ont des résidus de la Ie classe rares et faibles, ou qui ne savent pas mettre opportunément en valeur les résidus nombreux et forts. De cette façon, la protection industrielle tend à développer les résidus de la le classe, chez la classe gouvernante. En outre, la circulation se fait plus intense. Dans un pays où il y a peu d'industries, celui qui naît bien doué, sous le rapport des instincts de combinaisons, trouve beaucoup moins d'occasions d'appliquer ces instincts que celui qui naît dans un pays où il y a un grand nombre d'industries, et où il en surgit toujours de nouvelles. L'art de capter les faveurs de la protection offre un vaste champ d'activité à ceux qui possèdent ces qualités, même s'ils ne s'en servent pas directement dans l'industrie. Pour continuer l'analogie indiquée au § 2027, on peut dire que les examens ayant pour but de connaître qui possède en plus grande quantité les résidus de la Ie classe, se font plus fréquents, et qu'un plus grand nombre de candidats y sont appelés.
§ 2210. Il ne semble pas qu'il se produise des effets intenses sur la catégorie (a – résidus), entre autres parce que les résidus changent lentement (§ 2321). Au contraire, des effets considérables se produisent sur la catégorie (c – dérivations), et l'on remarque une belle floraison de théories économiques pour la défense de la protection. Beaucoup d'entre elles peuvent aller de pair avec les dédicaces et les sonnets qu'on adressait autrefois aux gens riches, pour obtenir d'eux quelque subside (§ 2553).
§ 2211. Combinaison III. Les dérivations agissent peu ou point sur les résidus, peu sur les intérêts, un peu sur l'hétérogénéité sociale (d) , parce que dans toute société, les gens habiles à louer les puissants peuvent s'introduire dans la classe gouvernante. Schmoller n'aurait peut-être pas été nommé à la Chambre des Seigneurs de Prusse, s'il avait été libre-échangiste. Vice versa, les libre-échangistes anglais ont obtenu les faveurs du gouvernement dit « libéral ». Nous avons ainsi des effets indirects en dehors des catégories. Les intérêts (b) ont agi sur les dérivations (c) , et celles-ci agissent sur l'hétérogénéité sociale (d) .
§ 2212. Combinaison IV. Ici, nous avons de nouveau des effets très importants. Nous les trouvons moins dans l'action de l'hétérogénéité sur les résidus que dans l'action des intérêts ; cela pour le motif habituel du peu de variabilité des résidus.
§ 2213. D'ailleurs, et si l'on envisage la combinaison IV en général, l'action indirecte ou médiate des intérêts sur les résidus n'est pas négligeable, et peut même devenir considérable, si elle s'exerce durant de longues années. Chez une nation préoccupée exclusivement de ses intérêts économiques, les sentiments qui correspondent aux combinaisons sont exaltés, ceux qui correspondent à la persistance des agrégats sont méprisés. On observe donc des changements dans ces deux classes de résidus. Les genres des résidus, et spécialement les formes sous lesquelles ils s'expriment, se modifient, et les dérivations changent. La perfection apparaît dans l'avenir, au lieu d'être placée dans le passé ; le dieu Progrès s'installe dans l'Olympe. L'humanitarisme triomphe, parce que désormais on soigne mieux ses intérêts par la fraude que par la force. Tourner les obstacles et ne pas les surmonter de vive force devient un principe. Avec de telles pratiques et à la longue, le caractère s'amollit, et la ruse, sous toutes ses formes, devient souveraine.
§ 2214. Ces phénomènes ont été aperçus en tout temps. Mais, en général, les auteurs qui y fixèrent leur attention ne tardèrent pas à dévier de l'étude des faits, pour s'adonner à des considérations éthiques, pour louer ou blâmer, et pour rechercher de quelle façon l'on devait s'y prendre afin d'atteindre un certain idéal qui était le leur [FN: § 2214-1] .
§ 2215. Revenant maintenant au cas particulier de la protection, nous remarquons le fait suivant. Une fois que, grâce à cette protection, les intérêts ont porté dans la classe gouvernante des hommes largement pourvus de résidus de la Ie classe, ces hommes agissent à leur tour sur les intérêts, et poussent la nation entière vers les occupations économiques, vers l'industrialisme. Le phénomène est si remarquable qu'il n'a pas échappé, même à des observateurs superficiels, ou à d'autres, qu'aveuglent des théories erronées. Il a été souvent décrit sous le nom d'accroissement du « capitalisme » dans les sociétés modernes. Ensuite, par le raisonnement habituel post hoc propter hoc, on a pris cet accroissement du capitalisme pour la cause de l'amollissement des sentiments moraux (persistance des agrégats).
§ 2016. Dans le phénomène mentionné tout à l'heure, nous avons un effet médiat : les intérêts ont agi sur l'hétérogénéité ; celle-ci, à son tour, agit sur les intérêts. Ainsi, par une suite d'actions et de réactions, il s'établit un équilibre où deviennent plus intenses la production économique et la circulation des élites. La composition de la classe gouvernante se trouve ainsi profondément modifiée.
§ 2217. L'augmentation de la production économique peut être telle qu'elle surpasse la destruction de richesse produite par la protection. D'où, somme toute, la protection peut donner un profit et non une perte de richesse. Par conséquent, il peut arriver, mais il n'arrive pas nécessairement, que la prospérité économique d'un pays s'accroisse avec la protection industrielle.
§ 2218. On remarquera que c'est là un fait médiat, qui est produit par l'action de la protection industrielle sur l'hétérogénéité sociale et la circulation des élites, lesquelles réagissent ensuite sur le phénomène économique. C'est pourquoi l'on peut supprimer le premier anneau de cette chaîne, et pourvu que l'on conserve le second, l'effet se produira également. C'est pourquoi aussi, si la protection agissait différemment sur l'hétérogénéité sociale et sur la circulation des élites, l'effet se produirait aussi différemment, C'est ce qui arrive, en effet, pour la protection agricole, en général. Par conséquent, demeurant au point du cycle où nous sommes, nous dirons qu'on pourra avoir un effet médiat d'une augmentation de prospérité économique, soit avec la protection industrielle, soit avec le libre-échange, qui supprime une coûteuse protection agricole. Ce dernier cas est, très en gros, le phénomène qui eut lieu en Angleterre, au temps de la ligue de Cobden. La suppression de la protection agricole eut un puissant effet. Beaucoup moindre fut celui de la suppression de la protection industrielle, parce qu'en ce temps-là l'industrie anglaise était la première du monde ; aussi les effets furent-ils au plus haut degré ceux de la première mesure. Ajoutons qu'en Angleterre la circulation des élites était déjà intense, et qu'elle fut accrue par diverses mesures politiques. Au contraire, quand l’Allemagne eut recours au protectionnisme, cette circulation était lente, et s'accomplissait en grande partie pour des causes étrangères aux causes économiques. Le protectionnisme agricole avait peu ou point d'action sur cette circulation, déjà lente par elle-même, tandis que le protectionnisme industriel la stimula d'une façon merveilleuse. Par conséquent, ce fut surtout ce genre de protectionnisme qui produisit ces effets. En Angleterre, on observa aussi les effets qui découlent de la disparition de la protection agricole, et le pays s'achemina toujours plus vers un état d’industrialisme démagogique qui ne peut exister en Allemagne, tant que la classe des Junker, protégée par les droits agricoles, est forte et vigoureuse.
En Italie, après la constitution du nouveau royaume, le protectionnisme financier et celui des entreprises publiques avaient déjà produit sur l'hétérogénéité sociale l'action dont nous avons vu déjà que la protection industrielle était capable. Quand donc celle-ci fut établie, mêlée à une forte proportion de protection agricole, elle produisit des effets médiats peu importants, sauf peut-être dans l'Italie septentrionale ; tandis que dans l'Italie méridionale, la protection agricole produisit presque seule un effet ; et de fait, dans l'ensemble, les effets médiats furent presque insensibles ; on ne vit clairement que les effets économiques de la destruction de richesse [FN: § 2218-1] , jusqu'à ce qu'ils fussent ensuite masqués par la superposition des effets d'une période de prospérité générale de tous les peuples civilisés.
§ 2219. On ne pouvait obtenir de l'économie politique seule la connaissance des causes de ces divers effets, qui pourtant sont de nature économique. Il fallait en combiner l'étude avec celle d'une autre science, plus générale, qui, nous enseignant à faire peu de cas des dérivations, au moyen desquelles on créait des théories erronées, nous montrât combien nombreuses étaient les forces qui agissent réellement sur les phénomènes, et quelle était leur nature. Ces phénomènes, bien que strictement économiques en apparence, dépendaient en réalité d'autres phénomènes sociaux.
§ 2220. Le lecteur remarquera que nous venons d'ébaucher seulement à grands traits une première image du phénomène, et qu'il nous reste beaucoup à faire pour noter les parties secondaires. Mais ce n'est pas ici le lieu de procéder à cette étude (§ 2231 et sv., 2310 et sv.). En revanche, nous devons nous appliquer à faire disparaître une autre imperfection, qui tire son origine du fait que nous nous sommes arrêtés en un point du cycle, tandis qu'il est nécessaire de poursuivre, et de voir d'autres et de nouveaux effets médiats.
§ 2221. Si aucune force ne s'y opposait, le cycle d'actions et de réactions mentionné tout à l'heure se continuant indéfiniment, la protection économique et ses effets devraient aller toujours croissant. C'est en effet ce qu'on remarque chez nombre de peuples, au XIXe siècle ; mais, d'autre part, il naît et se développe des forces qui s'opposent à ce mouvement. En traitant, non plus d'un cas particulier de protection, mais d'un cas général, nous trouverons ces forces dans les modifications que subit l'élite, et dans les variations des circonstances qui rendent possible le mouvement du cycle considéré (§ 2225). L'histoire nous enseigne que lorsque la proportion des résidus de la Ie et de la IIe classe varie chez l'élite, les mouvements ne continuent pas indéfiniment en un même sens, mais que, tôt ou tard, ils sont remplacés par des mouvements en sens contraire. Souvent ceux-ci ont lieu par l'effet de guerres, comme ce fut le cas pour la conquête que Rome fit de la Grèce. Ce pays possédait en grande abondance des résidus de la Ie classe, tandis que Rome avait alors une plus grande quantité de résidus de la IIe classe. Souvent aussi les mouvements contraires au cours observé durant un temps assez long se produisirent sous forme de révolutions intérieures [FN: § 2221-1] . Un exemple remarquable de ces phénomènes est la substitution de l'Empire à la République, à Rome. Ce fut là surtout une révolution sociale, qui changea beaucoup la proportion des résidus dans la classe gouvernante. Considérant les deux effets ensemble, on peut dire, en général et grosso modo, que là où l'un ne se produit pas, l'autre se manifeste. Il en est comme des fruits qui, une fois mûrs, sont cueillis par la main de l'homme ou tombent naturellement à terre : de toute façon ils sont détachés de la plante. La cause indiquée tout à l'heure des modifications de l'élite est parmi les plus importantes qui déterminent la forme ondulatoire assumée par le phénomène. Nous en rechercherons plus loin des exemples remarquables (§ 2311, 2343 et sv., 2553).
§ 2222. Nous voyons, chez nombre de peuples, la protection industrielle accompagner la protection agricole, et même, actuellement en Europe, elles ne vont pas l'une sans l'autre ; et comme elles ont, au moins en partie, des effets opposés, on voit que les résultats des faits poussent les empiriques à se tenir presque instinctivement dans une certaine moyenne. En général, les protections du genre de la protection industrielle et celles du genre de la protection agricole, unies ensemble à divers degrés, donnent chez les gouvernants diverses proportions correspondantes de résidus de la Ie et de la IIe classe, avec les divers effets découlant de ce fait (§ 2227).
§ 2223. Les considérations précédentes s'étendent facilement à tout autre genre de protection, non seulement économique, mais aussi de natures diverses. Par exemple, la protection des classes belliqueuses, réalisée lorsque les hommes acquièrent richesses, honneurs, pouvoirs, surtout par la guerre, agit comme la précédente sur l'hétérogénéité sociale, mais en un sens différent; c'est-à-dire qu'elle tend à développer les résidus de la IIe classe chez les gouvernants. Comme la précédente, elle intensifie la circulation, et permet à ceux qui ont des instincts belliqueux de s'élever des couches inférieures dans la classe gouvernante. En ce cas, les résidus subissent des effets appréciables, pour autant que le fait est possible, et si l'on tient compte de leur peu de variabilité. La guerre tend à augmenter l'intensité des résidus de la IIe classe. Comme d'habitude, les effets produits sur les dérivations sont considérables, moindres toutefois que dans le cas précédent, parce que les théories sont peu ou point nécessaires à la guerre. Pour mieux voir cela, en des cas extrêmes, il suffit de comparer Sparte et Athènes. C'est pourquoi, les dérivations aussi ont peu ou point d'influence sur l'hétérogénéité sociale, un peu plus sur les résidus. Enfin, portant notre attention sur la combinaison IV, nous voyons que la protection des intérêts favorables à la guerre pousse la nation à s'occuper de la guerre. C'est pourquoi l'on a ici aussi un effet médiat.
§ 2224. En ce cas naissent aussi des forces qui tendent à produire un mouvement contraire à celui du cycle considéré. On a déjà remarqué, dans les temps anciens, que la guerre moissonnait largement les aristocraties guerrières. Par conséquent, d'un côté, les guerres fréquentes font entrer dans la classe gouvernante les hommes animés de sentiments belliqueux, et de l'autre, elles les détruisent. Somme toute, ces deux mouvements en sens contraire peuvent, suivant les cas, enrichir ou appauvrir d'éléments belliqueux cette classe, et par conséquent accroître aussi ou diminuer en elle certains résidus. Dans les temps modernes, la guerre exige non seulement des hommes, mais aussi d'immenses dépenses, auxquelles ne peut pourvoir qu'une production économique intense. C'est pourquoi, si la guerre accroît les éléments belliqueux dans la classe gouvernante, la préparation de la guerre les diminue en faisant entrer dans cette classe des éléments industriels et commerciaux. Ce second effet est maintenant prépondérant en France, en Angleterre, en Italie ; beaucoup moindre en Allemagne.
§ 2225. En ce qui concerne les circonstances qui rendent possibles les cycles considérés (§ 2221), il faut remarquer que pour le cycle belliqueux, il est nécessaire qu'il se trouve des pays riches à exploiter par la conquête. Pour le cycle industriel, il est avantageux, mais non indispensable, qu'il y ait des peuples peu développés économiquement, qu'on puisse exploiter par la production industrielle. Il faut prendre garde à un phénomène jusqu'ici peu aperçu : au fait que, pour se développer, l'industrialisme a besoin d'une classe nombreuse de gens qui épargnent ; tandis que l'industrialisme même déprime généralement l'instinct d'épargne, et pousse les hommes à dépenser tout ce qu'ils gagnent (§ 2228).
D'une manière générale et dans tous les temps, on peut observer que le mouvement du cycle belliqueux présente des contrastes plus grands que celui du cycle industriel. En effet, jusqu'à un certain point, le cycle industriel se suffit à lui-même : il produit la richesse qu'il consomme. Quand la prospérité des peuples pauvres qu'on exploite commence à se développer, leur consommation augmente, et par conséquent les peuples riches en profitent. Le dommage pourra se produire seulement lorsque les peuples pauvres commenceront à égaler les peuples riches. Quant à l'épargne, nous savons que les résidus se modifient très lentement. C'est pourquoi l'effet du cycle industriel sur les sentiments qui poussent à épargner, n'est pas du tout rapide. L'épargne peut continuer à croître longtemps, évitant ainsi que l'on ne vienne à manquer de matière exploitable, matière indispensable à la continuation de l'industrialisme. Au contraire, pour tirer avantage des arts qui ont trait à la guerre, un peuple a besoin de pouvoir les exercer contre des peuples suffisamment riches ; et si ceux-ci disparaissent, le peuple qui est en très grande partie belliqueux meurt de consomption. Un cas exceptionnel fut celui de la Rome antique, où, durant de longues années, on put observer les effets médiats des guerres de conquête. Mais cela se produisit d'abord parce qu'il fallut longtemps pour que la matière qui alimentait les conquêtes vînt à manquer ; ensuite parce que celles-ci n'étaient pas seules à faire la prospérité matérielle de Rome : des commerces et des industries n'y contribuaient pas peu. De la sorte, on atteignit le maximum de prospérité vers la fin de la République et le commencement de l'Empire; puis vinrent à manquer en même temps les peuples riches à conquérir et à exploiter, ainsi que la prospérité commerciale et industrielle. La conquête de régions barbares ne pouvait apporter à Rome aucun profit comparable à celui qu'elle avait retiré de la conquête des riches régions de la Grèce, de l'Afrique, de l'Asie; tandis que l'arrêt de la circulation des élites et la destruction toujours croissante de la richesse épuisaient les sources de la production économique.
§ 2226. C'est à l'exploitation de peuples économiquement peu développés qu'on dut en partie la prospérité de Carthage et de Venise, et qu'on doit, partiellement aussi, celle des États industriels et commerciaux modernes. Plusieurs de ces derniers ne produisent pas la quantité de blé nécessaire à l'alimentation de leurs peuples. Par conséquent, ils ont besoin, pour vivre, d'être en relations avec des peuples agricoles qui ont, au contraire, un excédent de production de blé. Que deviendrait l'Angleterre, si tous les peuples du globe n'avaient que le blé nécessaire à leur consommation ? Il est certain que l'état de choses actuel serait profondément changé. La prospérité de Carthage vint se briser contre la puissance militaire de Rome, comme la prospérité de Venise fut gravement ébranlée par les conquêtes turques. Mais il ne semble pas que de pareils dangers menacent la prospérité des peuples industriels modernes, du moins pour le moment. D'une manière générale, supposons des peuples où l'un des deux cycles que nous avons indiqués est en train de s'accomplir, et d'autres peuples où c'est l'autre cycle qui s'accomplit. Si ces deux groupes de peuples viennent à se faire la guerre, l'un ou l'autre peut être détruit, selon le degré d'évolution. C'est ainsi que les peuples modernes chez lesquels se produit l'évolution industrielle vainquent, dominent, détruisent les peuples barbares ou semi-barbares encore arriérés dans l'évolution militaire. Tout au contraire, les peuples économiquement les plus développés du bassin de la Méditerranée furent subjugués par Rome, et l'empire romain fut détruit par les barbares. Chez les peuples civilisés de notre époque, les différences du degré d'évolution du cycle qu'ils accomplissent sont petites. C'est pourquoi, bien que considérable, la force résultant de la disparité de cette évolution n'est pas prépondérante.
§ 2227. Parmi les effets que provoque le changement de proportion des résidus, de l'instinct des combinaisons et de la persistance des agrégats dans la classe gouvernante (§ 2221), il faut prendre garde à ceux qui peuvent affaiblir la résistance de cette classe, en lutte avec la classe gouvernée [FN: § 2227-1] . Pour avoir une première idée de ces importants phénomènes, on peut observer que grosso modo la classe gouvernante et la classe gouvernée sont l'une à l'égard de l'autre comme deux nations étrangères. La prédominance des intérêts principalement industriels et commerciaux peuple la classe gouvernante d'hommes rusés, astucieux, possédant de nombreux instincts de combinaisons, et la dépeuple d'hommes au caractère fort, d'hommes fiers, possédant de nombreux instincts de persistance des agrégats (§ 2178). Cela peut arriver pour d'autres causes. D'une manière générale, c'est-à-dire en considérant la combinaison (IV) du § 2206, nous verrons que si l'on gouvernait seulement avec la ruse, la fourberie et les combinaisons, le pouvoir de la classe chez laquelle les résidus de l'instinct des combinaisons l'emportent de beaucoup serait très durable. Il prendrait fin seulement quand la classe se dissocierait d'elle-même par dégénérescence sénile. Mais pour gouverner, il faut aussi la force (§ 2176 et sv.) ; et à mesure que les résidus de l'instinct des combinaisons se développent, et que ceux de la persistance des agrégats s'atrophient chez les gouvernants, ceux-ci deviennent toujours moins capables d'user de la force. Nous avons donc un équilibre instable, et des révolutions se produisent, comme celle du protestantisme contre les hommes de la Renaissance, ou du peuple français, en 1789, contre sa classe gouvernante. Ces révolutions réussissent pour des causes en partie analogues à celles pour lesquelles Rome, fruste et inculte, conquit la Grèce civilisée et cultivée. Une exception qui confirme la règle est celle de Venise, qui garda longtemps son régime politique, parce que son aristocratie sut conserver ces sentiments de persistance des agrégats, sentiments nécessaires à l'emploi de la force. Le peuple chez lequel prédominent les résidus de la persistance des agrégats les apporte dans la classe gouvernante, soit par infiltrations (circulation des élites), soit par secousses, au moyen des révolutions (§ 2343 et sv.).
§ 2228. Chez les peuples modernes économiquement avancés, les industries, les commerces, et aussi l'agriculture, ont besoin de capitaux énormes. En outre, les gouvernements de ces peuples sont très coûteux, parce qu'ils doivent suppléer par la ruse et par les dépenses qui en sont la conséquence, à la force qui leur fait défaut : ils vainquent par l'or, et non par le fer. C'est pourquoi ces peuples, chez lesquels s'accomplit avec une intensité toujours croissante le cycle industriel, ont besoin d'une grande quantité d'épargne (§ 2317). Mais les caractères de l'épargne vont mieux avec les résidus de la persistance des agrégats qu'avec ceux de l'instinct des combinaisons. Les gens aventureux, toujours en quête de nouvelles combinaisons, épargnent peu. Par conséquent, il faut à la classe gouvernante industrielle et commerciale au plus haut point, un substratum de gens de nature différente et qui épargnent. Si elle ne le trouve pas dans son propre pays, elle doit le chercher à l'étranger, comme c'est le cas des États-Unis d'Amérique, qui font une si abondante consommation de l'épargne européenne. La classe gouvernante française trouve dans son propre pays l'épargne dont elle a besoin, et qui est produite en grande quantité surtout par la femme, chez laquelle les résidus de la persistance des agrégats sont encore prépondérants. Mais si les femmes françaises deviennent semblables aux américaines, et s'il n'y a pas quelque compensation, il pourra se produire une diminution considérable de la quantité d'épargne que la France fournit à sa classe gouvernante et à d'autres pays (§ 2312 et sv.).
§ 2229. Nous devons remarquer ensuite qu'en l'état actuel des sciences sociales, non encore parvenues à l'état de sciences logico-expérimentales, la prédominance des résidus de la Ie classe est proprement la prédominance, non seulement des intérêts, mais aussi de dérivations, de religions intellectuelles, et non de raisonnements scientifiques. Souvent ces dérivations s'écartent de la réalité beaucoup plus que les actions non-logiques du simple empirique. Quand la chimie n'existait pas encore, un empirique connaissait mieux la teinturerie qu'une personne dominée par les élucubrations théoriques qui se manifestent par la magie et autres semblables billevesées. Comme les mandarins chinois, les « intellectuels » européens sont les pires des gouvernants ; et le fait que les « intellectuels » européens ont joué un rôle moins important que les mandarins, dans le gouvernement de la chose publique, est une des si nombreuses causes pour lesquelles le sort des peuples européens fut différent de celui du peuple chinois. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le peuple japonais, guidé par ses chefs féodaux, a tellement dépassé en puissance le peuple chinois. Il est certain que les « intellectuels » peuvent être éloignés du gouvernement, même là où, dans la classe gouvernante, les résidus de l'instinct des combinaisons sont prépondérants. Venise eut ce bonheur singulier ; mais, en général, la prédominance des résidus de l'instinct des combinaisons, dans la classe gouvernante, porte celle-ci à faire largement appel aux «intellectuels », qui sont, au contraire, repoussés des classes où prédominent les résidus de la persistance des agrégats : les « préjugés », pour parler le jargon de nos humanitaires.
§ 2230. Nous avons indiqué (§ 2026 et sv.) une classification générale des couches sociales, et nous avons aussi fait allusion (§ 2052) aux rapports entre cette classification et celle des aristocraties. Le sujet n'est pas épuisé ; il peut donner lieu à un grand nombre d'autres considérations, parmi lesquelles il en est une d'ordre économique, très importante.
§ 2231. On a confondu, et l'on continue à confondre, sous le nom de capitalistes[FN: § 2231-1], d'une part les personnes qui tirent un revenu de leurs terres et de leurs épargnes, d'autre part les entrepreneurs. Cela nuit beaucoup à la connaissance du phénomène économique, et encore plus à celle du phénomène social. En réalité, ces deux catégories de capitalistes ont des intérêts souvent différents, parfois opposés. Ils s'opposent même plus que ceux des classes dites des « capitalistes » et des « prolétaires » [FN: § 2231-2]. Au point de vue économique, il est avantageux pour l'entrepreneur que le revenu de l'épargne et des autres capitaux qu'il loue à leurs possesseurs soit minimum ; il est, au contraire, avantageux à ces producteurs qu'il soit maximum. Un renchérissement de la marchandise qu'il produit est avantageux à l'entrepreneur. Peu lui importe un renchérissement des autres marchandises, s'il trouve compensation dans les avantages de sa propre production ; tandis que tous ces renchérissements nuisent au possesseur de la simple épargne. Quant à l'entrepreneur, les droits fiscaux sur la marchandise qu'il produit lui nuisent peu ; parfois ils lui profitent, en éloignant la concurrence. Ils nuisent toujours au consommateur dont les revenus proviennent de ce qu'il place à intérêt son épargne. D'une façon générale, l'entrepreneur peut presque toujours se récupérer sur le consommateur, des augmentations de frais occasionnées par de lourds impôts. Le simple possesseur d'épargne ne le peut presque jamais. De même, le renchérissement de la main d'œuvre ne nuit souvent que peu à l'entrepreneur : uniquement pour les contrats en cours ; tandis que l'entrepreneur petit se récupérer par une augmentation du prix des produits, pour les contrats futurs. Au contraire, le simple possesseur d'épargne subit d'habitude ces renchérissements sans pouvoir se récupérer en aucune façon. Par conséquent, en ce cas, les entrepreneurs et leurs ouvriers ont un intérêt commun, qui se trouve en opposition avec celui des simples possesseurs d'épargne. Il en est de même pour les entrepreneurs et les ouvriers des industries qui jouissent de la protection douanière. La protection douanière agricole a souvent des effets contraires. Aussi est-elle repoussée par les ouvriers industriels, qui sont plus impulsifs, tandis qu'elle est acceptée par les entrepreneurs, mieux et plus avisés, parce qu'ils la considèrent comme un moyen de maintenir la protection industrielle.
§ 2232. Au point de vue social, les oppositions ne sont pas moindres. Prennent rang parmi les entrepreneurs, les gens dont l'instinct des combinaisons est bien développé, instinct indispensable pour réussir en cette profession. Les gens chez lesquels prédominent les résidus de la persistance des agrégats restent parmi les simples possesseurs d'épargne. C'est pourquoi les entrepreneurs sont généralement des gens aventureux, en quête de nouveautés, tant dans le domaine économique que dans le domaine social. Les mouvements ne leur déplaisent pas : ils espèrent pouvoir en tirer profit. Les simples possesseurs d'épargne sont, au contraire, souvent des gens tranquilles, timorés, qui dressent toujours l'oreille, comme fait le lièvre. Ils espèrent peu et craignent beaucoup des mouvements, car ils savent, par une dure expérience, qu'ils sont presque toujours appelés à en faire les frais (§ 2214). Le goût pour une vie aventureuse et dépensière, comme le goût pour une vie tranquille et vouée à l'épargne, sont en grande partie l'effet d'instincts, et bien peu du raisonnement [FN: § 2232-1]. Ils sont semblables aux autres caractères des hommes ; ainsi le courage, la lâcheté, la passion du jeu, la concupiscence, les dispositions pour certains exercices corporels ou pour certains travaux intellectuels, etc. Tous ces caractères peuvent être quelque peu modifiés par des circonstances accessoires ; mais il n'y a aucun doute que ce sont principalement des caractères individuels, sur lesquels le raisonnement n'a que peu ou point d'influence. Vouloir changer par le raisonnement un homme lâche en un homme courageux, un homme imprévoyant en un homme prévoyant, éloigner du jeu un joueur, des femmes un débauché, ou produire d'autres effets semblables, tout le monde sait que c'est œuvre presque toujours – on pourrait même dire toujours – vaine. On ne peut pas contester ce fait en exhibant des statistiques [FN: § 2232-2] , comme on l'a voulu faire pour démontrer que l'épargne est une action essentiellement logique, et que sa quantité est déterminée principalement par l'intérêt qu'on en peut obtenir. En ces cas, les statistiques de phénomènes très complexes, substituées à l'observation directe de phénomènes simples qu'on veut connaître, ne peuvent qu'induire en erreur [FN: § 2232-3). Toutes les actions de l'homme qui tirent leur origine de l'instinct peuvent être plus ou moins modifiées par le raisonnement ; et ce serait une erreur d'affirmer que cela n'a pas lieu aussi pour les actions qui tirent leur origine de l'instinct d'épargne ; mais cela n'empêche pas que cet instinct représente la partie principale du phénomène, partie qui demeure non-logique.
§ 2233. Les faits mentionnés tout à l'heure nous mettent sur la voie d'une classification plus générale, contenant la précédente, et dont nous devrons souvent nous servir pour expliquer les phénomènes sociaux [FN: § 2233-1] (§ 2313 et sv.). Mettons dans une catégorie que nous appellerons (S) les personnes dont le revenu est essentiellement variable et dépend de leur habileté à trouver des sources de gain. Si nous raisonnons d'une manière générale et négligeons les exceptions, dans cette catégorie se trouveront précisément les entrepreneurs dont nous venons de parler. Avec eux seront, en partie du moins, les possesseurs d'actions de sociétés industrielles et commerciales, mais non les possesseurs d'obligations, qui trouveront mieux leur place dans la classe suivante. Il y aura aussi les propriétaires de bâtiments, dans les villes où l'on fait des spéculations immobilières ; de même les propriétaires de terres, avec la condition semblable de l'existence de spéculations sur ces terres ; les spéculateurs à la Bourse ; les banquiers qui gagnent sur les emprunts d'État, sur les prêts aux industries et aux commerces. Ajoutons toutes les personnes qui dépendent de celles-là : les notaires, les avocats, les ingénieurs, les politiciens, les ouvriers et les employés qui retirent un avantage des opérations indiquées plus haut. En somme, nous mettons ensemble toutes les personnes qui, directement ou indirectement, tirent un profit de la spéculation, et qui par différents moyens contribuent à accroître leurs revenus, en tirant ingénieusement parti des circonstances.
§ 2234. Rangeons dans une autre catégorie, que nous appellerons (R) , les personnes dont le revenu est fixe ou presque fixe et dépend peu par conséquent des combinaisons ingénieuses que l'on peut imaginer. Dans cette catégorie figureront, grosso modo [FN: § 2234-1], les simples possesseurs d'épargne, qui l'ont déposée dans les caisses d'épargne, dans les banques, ou qui l'ont placée en rentes viagères, en pensions ; ceux dont les revenus consistent principalement en titres de la dette publique, en obligations de sociétés, ou en autres titres semblables à revenu fixe ; les possesseurs d'immeubles et de terrains, étrangers à la spéculation, les agriculteurs, les ouvriers, les employés qui dépendent de ces personnes, ou qui, d'une manière ou d'une autre, ne dépendent pas de spéculateurs. Enfin, nous rassemblons ainsi toutes les personnes qui, ni directement ni indirectement, ne tirent profit de la spéculation, et qui ont des revenus ou fixes ou presque fixes, ou du moins peu variables.
§ 2235. Dans le seul dessein d'abandonner l'usage incommode de simples lettres, donnons le nom de spéculateurs aux personnes de la catégorie (S) , et de rentiers aux personnes de la catégorie (R) [FN: § 2235-1]. Nous pourrons répéter, pour ces deux catégories de personnes, à peu près ce que nous avons dit précédemment (§ 2197) des possesseurs de simple épargne et des entrepreneurs, et les deux nouvelles catégories auront des conflits économiques et sociaux analogues à ceux des précédentes. Dans la première des catégories dont nous nous occupons maintenant, ce sont les résidus de la Ie classe qui prédominent ; dans la seconde, ce sont ceux de la IIe classe. Il est facile de comprendre comment cela se produit. Celui qui possède des capacités remarquables en fait de combinaisons économiques ne se contente pas d'un revenu fixe, souvent assez mesquin ; il veut gagner davantage ; et s'il trouve des circonstances favorables, il s'élève à la première catégorie. Les deux catégories remplissent dans la société des fonctions d'utilité diverse. La catégorie (S) est surtout cause des changements et du progrès économique et social. La catégorie (R) est, au contraire, un puissant élément de stabilité, qui, en un grand nombre de cas, évite les dangers des mouvements aventureux de la catégorie (S) . Une société où prédominent presque exclusivement les individus de la catégorie (R) demeure immobile, comme cristallisée. Une société où prédominent les individus de la catégorie (S) manque de stabilité : elle est en un état d'équilibre instable, qui peut être détruit par un léger accident à l'intérieur ou à l'extérieur.
Il ne faut pas confondre les (R) avec les « conservateurs », ni les (S) avec les « progressistes », les innovateurs, les révolutionnaires (§ 226, 228 à 244) ; il peut y avoir des points communs, il n'y a pas d'identité. On trouve des évolutions, des innovations, des révolutions que les (R) appuient. D'abord, en grand nombre, celles qui ramènent dans les classes supérieures des résidus de la persistance des agrégats, lesquels en avaient été bannis par les (S) . Une révolution peut être faite contre les (S) : telle est celle qui aboutit à la fondation de l'empire romain, et, en partie, celle de la Réforme protestante. Ensuite, les (R) , précisément parce que chez eux prévalent les résidus de la persistance des agrégats, peuvent être aveuglés par ces sentiments au point d'agir contre leurs propres intérêts : ils se laissent duper aisément par qui fait appel à leurs sentiments, et fort souvent ils ont été les artisans de leur propre ruine (§ 1873). Si les seigneurs féodaux, qui avaient fort accentué le caractère des (R) , ne s'étaient pas laissé entraîner par un ensemble de sentiments dont la passion religieuse n'était qu'une partie, ils auraient facilement compris que les Croisades devaient amener leur ruine. Si la noblesse française, qui vivait de ses rentes, et la partie de la bourgeoisie qui se trouvait dans les mêmes conditions, n'avaient pas été, au XVIIIe siècle, sous l'empire des sentiments humanitaires, elles n'auraient pas préparé la Révolution, qui devait leur être fatale. Parmi les personnes qui furent guillotinées, plus d'une avait longuement, patiemment, savamment aiguisé le couperet qui devait lui trancher la tête. De nos jours, ceux des (R) qui sont dits « intellectuels » marchent sur les traces des nobles français du XVIIIe siècle, et travaillent autant qu'il est en leur pouvoir à la ruine de leur classe (§ 2254).
Il ne faut pas confondre non plus les catégories (R) et (S) avec celles que l'on peut former en considérant les occupations économiques (§ § 1726,1727). Ici encore, nous trouvons des points de contact, mais nous n'avons pas une coïncidence parfaite. Un négociant en détail se trouve souvent dans la catégorie (R) ; un négociant en gros peut aussi y appartenir, mais en de nombreux cas on le trouve dans la catégorie (S) . Parfois une même entreprise peut changer de caractère. Un individu de la catégorie (S) fonde une industrie qui est le résultat d'heureuses spéculations ; quand elle donne, ou paraît donner de beaux bénéfices, il la transforme en société anonyme, retire son épingle du jeu, et passe dans la catégorie (R) . Un grand nombre d'actionnaires de cette société appartiennent aussi à la catégorie (R) : ce sont ceux qui, en achetant des actions, ont cru acquérir des titres de tout repos. S'ils ne se trompent pas, le caractère de l'industrie en question change donc aussi : elle passe de la catégorie (S) à la catégorie (R) . Mais en bien des cas, la meilleure spéculation du fondateur de l'industrie est celle qu'il fait en la transformant en société anonyme, qui bientôt périclite, et comme d'habitude, ce sont les (R) qui paient les pots cassés. Il n'est guère d'industrie plus avantageuse que celle qui consiste à exploiter l'inexpérience, la naïveté, les passions des (R) . Dans nos sociétés, la richesse d'un grand nombre de personnes n'a pas d'autre source [FN: § 2235-2] .
§ 2236. Les diverses proportions en lesquelles les catégories (S) et (R) se trouvent dans la classe gouvernante, correspondent à divers genres de civilisation. Ces proportions sont parmi les principaux caractères à considérer dans l'hétérogénéité sociale [FN: § 2236-1]. Si, par exemple, nous reportons notre attention sur le cycle considéré un peu plus haut (§ 2209 et sv.), nous dirons que, dans les pays démocratiques modernes, la protection industrielle accroît la proportion de la catégorie (S) dans la classe gouvernante. De cet accroissement résulte une nouvelle augmentation de la protection, et cela continuerait ainsi indéfiniment, si des forces ne naissaient pas, qui s'opposent à ce mouvement (§ 2221). Pour continuer ces recherches, il faut que nous ajoutions, aux considérations qui viennent d'être faites, l'étude d'autres phénomènes.
§ 2237. LE RÉGIME POLITIQUE. Parmi les divers phénomènes compliqués que l'on observe dans une société, celui du régime politique est très important. Il est étroitement lié à celui de la nature de la classe gouvernante, et tous deux sont en rapport de mutuelle dépendance avec les autres phénomènes sociaux.
§ 2238. Comme d'habitude, on a souvent attribué une importance exagérée à la forme, et négligé quelque peu le fond. On a considéré principalement la forme sous laquelle se manifeste le régime politique. D'autre part, spécialement en France, sous le règne de Napoléon 111, et surtout parmi les économistes, se manifesta la tendance à donner peu ou point de valeur, non seulement à la forme du régime politique, mais encore au fond même de ce régime. Ainsi, on passait d'un extrême à l'autre, et à des théories exclusivement politiques de la société, on opposait des théories exclusivement économiques, entre autres celle du matérialisme historique. On tombait de la sorte dans l'erreur habituelle de négliger la mutuelle dépendance des phénomènes sociaux (§ 2361 et sv.).
§ 2239. Pour ceux qui attribuent une très grande importance à la forme du régime politique, il est de prime importance de trancher la question suivante : « Quelle est la meilleure forme de régime politique ? » Mais cette question a peu ou point de sens, si l'on n'ajoute pas à quelle société cette forme doit s'adapter, et si l'on n'explique pas le terme « meilleure », qui fait une vague allusion aux diverses utilités individuelles et sociales (§ 2115). Bien que çà et là on ait quelquefois saisi ce fait, la considération des formes de régime politique a donné lieu à des dérivations sans fin, qui aboutissent à divers mythes. Ces mythes et ces dérivations sont de nulle valeur, au point de vue logico-expérimental; tandis que les uns et les autres, ou mieux les sentiments qu'ils manifestent, peuvent produire des effets très importants pour pousser les hommes à agir. Il est certain que les sentiments manifestés par la foi monarchique, républicaine, oligarchique, démocratique, etc., ont joué et jouent encore un rôle appréciable dans les phénomènes sociaux, ainsi qu'on peut l'observer pour les sentiments manifestés par d'autres religions. Le « droit divin » d'un prince, celui d'une aristocratie, celui du « peuple », de la plèbe, de la majorité, et tous ceux qu'on peut imaginer, n'ont pas la moindre valeur expérimentale. Nous ne devons, par conséquent, les considérer qu'extrinsèquement, comme des faits et une manifestation de sentiments. Ceux-ci, comme les autres caractères des hommes constituant une société donnée, agissent de manière à déterminer le genre et la forme. Ensuite, il ne faut pas oublier que le fait de remarquer que l'un quelconque de ces « droits » n'a pas de fondement expérimental, ne diminue nullement l'utilité qu'on peut lui reconnaître pour la société. Ce fait la diminuerait, si la proposition était une dérivation, étant donné qu'en ces raisonnements on sous-entend, en général, que « tout ce qui n'est pas rationnel est nuisible ». Mais ce fait laisse intacte la considération de ]'utilité, lorsque la proposition est rigoureusement logico-expérimentale, car cette proposition ne renferme pas le sous-entendu de l'affirmation indiquée tout à l'heure (§ 2147). L'étude des formes du régime politique appartient à la sociologie spéciale. Nous ne nous en occupons ici que pour rechercher le fond, recouvert par les dérivations, et pour étudier les rapports des diverses compositions de la classe gouvernante avec les autres phénomènes sociaux.
§ 2240. En cette matière, comme en d'autres semblables, dès les premiers pas, nous nous heurtons à l'obstacle de la terminologie. Cela est naturel, car, pour les recherches objectives que nous voulons effectuer, nous avons besoin d'une terminologie objective ; tandis que, pour les raisonnements subjectifs que l'on fait habituellement, il faut une terminologie subjective, qui est la terminologie vulgaire. Par exemple, chacun reconnaît qu'aujourd'hui la « démocratie » tend à devenir le régime politique de tous les peuples civilisés. Mais quelle est la signification précise de ce terme « démocratie » ? Il est encore plus indéterminé que le terme complètement indéterminé de « religion ». Il est, par conséquent, nécessaire que nous le laissions de côté, et que nous nous mettions à étudier les faits qu'il recouvre [FN: § 2240-1] .
§ 2241. Voyons donc les faits. Tout d'abord, nous constatons une tendance marquée des peuples civilisés modernes à user d'une forme de gouvernement où le pouvoir de faire des lois appartient en grande partie à une assemblée élue par une fraction au moins des citoyens. On peut ajouter qu'il existe une tendance à accroître ce pouvoir, et à augmenter le nombre des citoyens qui élisent l'assemblée.
§ 2242. Exceptionnellement, en Suisse, le pouvoir de légiférer de l'assemblée élue est restreint par le referendum populaire. Aux États-Unis d'Amérique, il a quelque tempérament dans les Federal Courts. En France, Napoléon III tenta de le restreindre au moyen des plébiscites. Il ne réussit pas, et l'on ne peut affirmer avec certitude que ce fut pour s'y être mal pris, car le régime qui en sortit fut détruit par la force armée d'une nation ennemie. La tendance à augmenter le nombre des participants aux élections est générale. C'est là une voie que, pour le moment, on ne parcourt pas à rebours. On étend toujours le droit de vote. Après l'avoir donné aux hommes adultes, on veut l'accorder aux femmes. Il n'est pas impossible qu'on l'étende aussi aux adolescents.
§ 2243. Sous ces formes presque égales chez tous les peuples civilisés, il y a une grande diversité de fond, et l'on donne des noms semblables à des choses dissemblables. Nous voyons, par exemple, que le pouvoir de l'assemblée législative élue passe d'un maximum à un minimum. En France, la Chambre et le Sénat étant électifs, on peut les considérer, dans la recherche que nous faisons ici, comme une assemblée unique. On peut dire qu'elle est entièrement souveraine, et que son pouvoir n'a pas de limites. En Italie, le pouvoir de la Chambre des députés est limité, en théorie par le Sénat, en fait par la monarchie. En Angleterre, il existait une limite effective au pouvoir de la Chambre des Communes dans celui de la Chambre des Lords, aujourd'hui affaibli, et une autre limite dans celui de la monarchie, maintenant fort diminué aussi. Aux États-Unis d'Amérique, le président, élu indépendamment de la Chambre, limite effectivement le pouvoir de celle-ci. En Allemagne, le Conseil fédéral, et plus encore l'empereur, avec l'aide de la caste militaire, limitent grandement le pouvoir du Reichstag. Ainsi, par degrés, on arrive à la Russie, où la Douma a peu de pouvoir, et au Japon, où l'assemblée élue en a aussi très peu. Laissons de côté la Turquie et les républiques de l'Amérique centrale, où les assemblées législatives sont quelque peu chimériques.
§ 2244. Ne nous arrêtons pas à la fiction de la « représentation populaire ». Autant en emporte le vent. Allons de l'avant, et voyons quel fond se trouve sous les diverses formes du pouvoir de la classe gouvernante. À part des exceptions qui sont en petit nombre et de peu de durée, on a partout une classe gouvernante peu nombreuse, qui se maintient au pouvoir, en partie par la force, en partie avec le consentement de la classe gouvernée, qui est beaucoup plus nombreuse. Au point de vue du fond, les différences résident principalement dans les proportions de la force et du consentement ; au point de vue de la forme, dans les manières dont on fait usage de la force et dont on obtient le consentement.
§ 2245. Ainsi que nous l'avons déjà remarqué (§ 2170 et sv.), si le consentement était unanime, l'usage de la force ne serait pas nécessaire. Cet extrême ne s'est jamais vu. Un autre extrême est représenté par quelques cas concrets. C'est celui d'un despote qui, grâce à ses soldats, se maintient au pouvoir contre une population hostile. Ce phénomène appartient au passé, ou bien il s'agit d'un gouvernement étranger qui maintient dans la sujétion un peuple indocile. C'est un phénomène dont il y a actuellement encore plusieurs exemples. Le motif pour lequel, dans le premier cas, l'équilibre est beaucoup plus instable que dans le second, doit être recherché dans l'existence de divers résidus. Les satellites du despote n'ont pas des résidus essentiellement différents de ceux du peuple sujet. C'est pourquoi il leur manque la foi qui maintient et en même temps contient l'usage de la force ; et ces satellites disposent volontiers du pouvoir à leur caprice, comme le firent les prétoriens, les janissaires, les mameluks, ou bien ils abandonnent la défense du despote contre le peuple. Au contraire, le peuple dominateur a généralement des us et coutumes, et parfois une langue et une religion, différents du peuple sujet ; par conséquent, il y a différence de résidus, et la foi nécessaire pour user de la force ne fait pas défaut. Mais elle ne fait pas défaut non plus chez le peuple sujet, quand il s'agit de résister à l'oppression, et cela explique comment, à la longue, l'équilibre peut être rompu.
§ 2246. Précisément par crainte de cette éventualité, il arrive que les peuples dominateurs s'efforcent de s'assimiler les peuples sujets ; et quand ils y réussissent, c'est certainement le meilleur moyen d'assurer leur pouvoir ; mais souvent ils échouent, parce qu'ils veulent changer violemment les résidus, au lieu de tirer parti de ceux qui existent. Rome posséda à un degré éminent l'art de tirer parti des résidus ; c'est pourquoi elle put s'assimiler un grand nombre de peuples qui l'entouraient, dans le Latium, en Italie, dans le bassin de la Méditerranée.
§ 2247. Plusieurs fois déjà nous avons eu l'occasion de remarquer que l'œuvre des gouvernements est d'autant plus efficace qu'ils savent mieux tirer parti des résidus existants [FN: § 2247-1] (§ 1843) ; d'autant moins qu'ils ignorent cet art ; et qu'elle est généralement inefficace et vaine, quand ils visent à les changer violemment. En effet, presque tous les raisonnements sur la cause pour laquelle certains actes des gouvernements réussissent ou échouent, aboutissent à ce principe.
§ 2248. Nombre de personnes sont empêchées de le reconnaître à cause des dérivations. Par exemple, si A est la dérivation par laquelle s'expriment certains sentiments des sujets, on trouve facilement une autre dérivation, B qui, en somme, exprime de même les sentiments de la classe dominante. Mais celle-ci estime que cette dérivation B est une réfutation valide et évidente de A. Sous l'empire de cette foi, elle admet qu'il sera facile d'imposer B aux sujets, car enfin c'est seulement les obliger d'ouvrir les yeux et de reconnaître une chose d'une vérité évidente. Au conflit des sentiments se substitue de la sorte un conflit de dérivations, soit une logomachie. D'autres personnes se rapprochent un peu plus de la réalité, mais usent de sophismes. Elles insistent longuement sur l'utilité pour un peuple d'avoir une unité de foi en certaines matières, et négligent entièrement de considérer la possibilité d'y arriver sans aller au devant de graves inconvénients, qui peuvent compenser, et au-delà, l'avantage espéré. D'autres personnes encore supposent implicitement que celui qui tire parti des sentiments d'autrui, alors qu'il ne les partage pas, doit nécessairement le faire dans un dessein malhonnête et nuisible à la société. Aussi condamnent-elles sans autre cette œuvre, comme étant celle d'hypocrites malveillants. Mais cette façon de raisonner est propre à un petit nombre de moralistes, et s'observe bien rarement chez les hommes pratiques.
§ 2249. Le fait de tirer parti des sentiments existant dans une société, afin d'atteindre un certain but, n'est intrinsèquement ni avantageux ni nuisible à la société. L'avantage et l'inconvénient dépendent du but. Si celui-ci est profitable à la société, il y a un avantage ; s'il est nuisible, il y a un inconvénient. On ne peut pas dire non plus que lorsque la classe gouvernante vise à un but qui lui est avantageux, sans se soucier de ce qu'il est pour la classe sujette, celle-ci subisse nécessairement un dommage. En effet, il est des cas très nombreux où la classe gouvernante, recherchant exclusivement son propre avantage, procure en même temps celui de la classe gouvernée. Enfin, le fait de tirer parti des résidus existant dans une société est seulement un moyen, et vaut ce que vaut le résultat auquel il conduit.
§ 2250. Aux résidus, il faut ajouter les intérêts, comme moyen de gouvernement. Parfois ils peuvent ouvrir la seule voie qu'il y ait pour modifier les résidus. Il convient d'ailleurs de faire attention que les intérêts seuls, non recouverts de sentiments, sont bien un puissant moyen d'agir sur les gens chez lesquels prédominent les résidus de l'instinct des combinaisons, et par conséquent sur un grand nombre des membres de la classe gouvernante, mais qu'ils sont, au contraire, peu efficaces, s'ils sont seuls, sans les sentiments, lorsqu'il s'agit d'agir sur les gens chez lesquels prédominent les résidus de la persistance des agrégats, et par conséquent sur le plus grand nombre des membres de la classe gouvernée. En général, on peut dire, très en gros, que la classe gouvernante voit mieux ses intérêts, parce que chez elle les voiles du sentiment sont moins épais, et que la classe gouvernée les voit moins bien, parce que chez elle ces voiles sont plus épais. On peut dire aussi qu'il en résulte que la classe gouvernante peut tromper la classe gouvernée, et l'amener à servir ses intérêts, à elle classe gouvernante. Ces intérêts ne sont pourtant pas nécessairement opposés à ceux de la classe gouvernée ; souvent même tous deux coïncident, de telle sorte que la tromperie tourne à l'avantage de la classe gouvernée elle-même.
§ 2251. Dans toute l'histoire, le consentement et la force apparaissent comme des moyens de gouverner. Ils apparaissent déjà dans les légendes de l'Iliade et de l'Odyssée, pour assurer le pouvoir des rois grecs ; on les voit aussi dans les légendes des rois romains. Puis, à l'époque historique, à Rome, ils agissent aussi bien sous la République que sous le Principat ; et il n'est point démontré que le gouvernement d'Auguste obtint moins le consentement de la classe gouvernée que ne purent l'obtenir les divers gouvernements de la fin de la République. Puis, plus tard, des rois barbares et des républiques du moyen âge jusqu'aux rois de droit divin, il y a deux ou trois siècles, et enfin aux régimes démocratiques modernes, on trouve toujours ce mélange de force et de consentement.
§ 2252. De même que les dérivations sont beaucoup plus variables que les résidus qu'elles manifestent, les formes sous lesquelles apparaissent l'usage de la force et le consentement sont beaucoup plus variables que les sentiments et les intérêts dont ils proviennent, et les différences de proportions entre l'usage de la force et le consentement ont en grande partie pour origine les différences de proportions entre les sentiments et les intérêts. La similitude entre les dérivations et les formes de gouvernement va plus loin ; les unes aussi bien que les autres agissent beaucoup moins sur l'équilibre social que les sentiments et les intérêts dont elles proviennent. Beaucoup de savants s'en sont doutés. Pourtant, ils allèrent un peu trop loin, en affirmant que la forme du gouvernement est indifférente.
§ 2253. Il existe partout une classe gouvernante, même là où il y a un despote ; mais les formes sous lesquelles elle apparaît sont diverses. Dans les gouvernements absolus, seul un souverain paraît en scène ; dans les gouvernements démocratiques, c'est un parlement. Mais dans la coulisse se trouvent ceux qui jouent un rôle important au gouvernement effectif. Sans doute, ils doivent parfois s'incliner devant les caprices de souverains ou de parlements ignorants et tyranniques ; mais ils ne tardent pas à reprendre leur œuvre tenace, patiente, constante, dont les effets sont bien plus grands que ceux de la volonté des maîtres apparents. Dans le Digeste, nous trouvons d'excellentes constitutions sous le nom de très mauvais empereurs, de même qu'à notre époque, nous voyons des codes passables approuvés par des parlements assez ignares. En l'un et l'autre cas, la cause du fait est la même, c'est-à-dire que le souverain laisse faire les jurisconsultes. En d'autres cas, le souverain ne s'aperçoit même pas de ce qu'on lui fait faire, et les parlements moins encore qu'un chef ou qu'un roi avisé. Moins que tout autre s'en aperçoit le souverain Démos ; et parfois cela a permis de réaliser, contrairement à ses préjugés, des améliorations des conditions sociales, ainsi que des mesures opportunes pour la défense de la patrie. Le bon Démos croit faire sa volonté, et fait, au contraire, celle de ses gouvernants. Mais très souvent cela profite uniquement aux intérêts de ces gouvernants, qui, depuis le temps d'Aristophane jusqu'au nôtre, usent largement de l'art de berner Démos [FN: § 2253-1]. Comme le firent déjà les ploutocrates de la fin de la République romaine, nos ploutocrates se préoccupent de gagner de l'argent, soit pour eux-mêmes, soit pour assouvir les appétits de leurs partisans et de leurs complices ; ils se soucient peu ou point d'autre chose. Parmi les dérivations dont ils usent pour démontrer l'utilité de leur pouvoir pour la nation, il faut remarquer celle qui affirme que le peuple est plus capable de juger les questions générales que les questions spéciales. En réalité, c'est exactement l'inverse. Il suffit de raisonner quelque peu avec des personnes qui ne sont pas cultivées, pour constater qu'elles comprennent beaucoup mieux les questions spéciales, qui sont habituellement concrètes, que les questions générales, qui sont habituellement abstraites. Mais les questions abstraites présentent cet avantage pour les gouvernants, que quelle que soit la solution donnée par le peuple, ils sauront en tirer les conséquences qu'ils voudront. Par exemple, le peuple élit des hommes qui veulent abolir l'intérêt du capital, la plus-value des industries, et réfréner l'avidité des spéculateurs (questions générales), et ces hommes, directement ou indirectement, en soutiennent d'autres ; ils accroissent énormément la dette publique, et par conséquent les intérêts payés pour ce capital ; ils maintiennent, ils accroissent même la plus-value dont jouissent les industriels. Beaucoup de ceux-ci s'enrichissent grâce à la démagogie, et confient le gouvernement de l'État aux spéculateurs. On voit même certains de leurs chefs devenir des diplomates, tel Volpi, qui conclut le traité de Lausanne, ou des ministres, tels Caillaux et Lloyd George.
§ 2254. La classe gouvernante n'est pas homogène. Elle-même a un gouvernement et une classe plus restreinte ou un chef, un comité qui effectivement et pratiquement prédominent. Parfois, le fait est patent, comme pour les Éphores, à Sparte, le Conseil des Dix, à Venise, les ministres favoris d'un souverain absolu ou les meneurs d'un parlement. D'autres fois, le fait est en partie masqué, comme pour le Caucus, en Angleterre, les Conventions des États-Unis, les dirigeants des « spéculateurs », qui opèrent en France et en Italie, etc. [FN: § 2254-1]. La tendance à personnifier les abstractions, ou même seulement à leur donner une réalité objective, est telle que beaucoup de personnes se représentent la classe gouvernante presque que comme une personne, ou au moins comme une unité concrète, qu'ils lui supposent une volonté unique, et croient qu'en prenant des mesures logiques, elle réalise les programmes. C'est ainsi que beaucoup d'antisémites se représentent les Sémites, beaucoup de socialistes les bourgeois ; tandis que d'autres personnes se rapprochent davantage de la réalité, en voyant dans la bourgeoisie une organisation qui agit en partie sans que les bourgeois en soient conscients. Comme d'autres collectivités, les classes gouvernantes accomplissent des actions logiques et des actions non-logiques. La partie principale du phénomène, c'est l'organisation, et non pas la volonté consciente des individus, qui, en certains cas, peuvent même être entraînés par l'organisation là où leur volonté consciente ne les porterait pas. Quand nous parlons des « spéculateurs », il ne faut pas se les figurer comme des personnages de mélodrame qui, mettant à exécution des desseins pervers par de ténébreux artifices, régissent et gouvernent le monde. Cela n'aurait guère plus de réalité qu'une fable mythologique. Les « spéculateurs » sont des hommes qui se préoccupent simplement de leurs affaires, et chez lesquels les résidus de la Ie classe sont puissants. Ils s'en servent pour tâcher de gagner de l'argent, et se meuvent selon la ligne de moindre résistance, comme le font en somme tous les hommes. Ils ne tiennent pas des assemblées pour concerter leurs desseins communs, et n'en délibèrent pas non plus d'une autre manière. Mais l'accord se produit spontanément, parce que si, en des circonstances données, il y a une ligne de plus grand profit et de moindre résistance, la plupart de ceux qui la cherchent la trouveront, et, chacun la suivant pour son compte, il semblera, bien que cela ne soit pas, que tous la suivent d'un commun accord. Mais d'autres fois, il arrivera aussi que, mus par les forces de l'organisation dont ils font partie, leur volonté sera récalcitrante, et ils poursuivront involontairement la ligne de conduite qu'implique leur organisation. Il y a cinquante ans, les « spéculateurs » ignoraient entièrement l'état de choses actuel auquel les a conduits leur œuvre. La voie suivie est la résultante d'une infinité de petites actions, déterminées chacune par l'intérêt présent. Ainsi qu'il arrive dans tous les phénomènes sociaux, elle est la résultante de certaines forces agissant au milieu de certaines liaisons et de certains obstacles. Par exemple, lorsque nous disons qu'aujourd'hui les « spéculateurs » préparent la guerre en faisant des dépenses toujours croissantes, nous n'entendons nullement affirmer qu'ils en soient conscients. Bien au contraire. Ils préparent la guerre en faisant des dépenses toujours croissantes, et en suscitant des conflits économiques, parce qu'ils y trouvent un profit direct. Mais, bien qu'importante, cette cause n'est pas la principale : il en est une autre de plus grande importance. Elle consiste à se servir, comme d'un moyen de gouverner, des sentiments de patriotisme existant dans la population. En outre, les « spéculateurs » des différents pays se font concurrence, et se prévalent des armements pour obtenir des concessions de leurs rivaux. Il existe d'autres causes semblables ; toutes poussent à accroître les armements, sans que cela ait lieu en vertu d'un plan préconçu. D'autre part, les spéculateurs qui possèdent en abondance des résidus de la Ie classe, saisissent par intuition, sans qu'il soit besoin de raisonnements et de théories, que si une grande et terrible guerre éclatait, entre autres cas possibles, il se pourrait qu'ils dussent céder la place aux hommes chez lesquels abondent les résidus de la IIe classe. C'est pourquoi, en vertu du même instinct qui fait fuir le cerf devant le lion, ils sont opposés à une telle guerre, tandis qu'ils consentent volontiers à de petites guerres coloniales, auxquelles ils peuvent présider sans aucun danger. C'est de leurs intérêts et de leurs sentiments que résulte leur œuvre, et non pas de leur volonté réfléchie et arrêtée. Par conséquent, cette œuvre peut en fin de compte aboutir où ils le désirent, mais elle pourrait aussi les entraîner là où ils n'auraient jamais voulu aller. Il pourrait encore arriver qu'un jour éclatât la guerre préparée mais non voulue. Elle serait la conséquence de l'œuvre antérieure des « spéculateurs », œuvre qu'ils n'auront jamais voulue, à aucun moment. De même, les « spéculateurs » de la Rome antique préparèrent la chute de la République et l'avènement de César et d'Auguste, mais sans savoir qu'ils entraient dans cette voie, et sans vouloir le moins du monde atteindre ce résultat. En ce qui concerne les « spéculateurs », de même qu'en ce qui concerne d'autres éléments de l'organisation sociale, le point de vue éthique et le point de vue de l'utilité sociale doivent être nettement distingués. Au point de vue de l'utilité sociale, les « spéculateurs » ne sont pas condamnables parce qu'ils accomplissent des actions réprouvées par l'une des éthiques qui ont cours ; on ne doit pas les excuser non plus, si l'on se place au point de vue de ces éthiques, parce qu'ils sont utiles socialement. Il faut aussi rappeler que l'existence de cette utilité dépend des circonstances dans lesquelles se déroule l'œuvre des spéculateurs, et notamment du nombre de ceux-ci, proportionnellement aux individus chez lesquels les résidus de la IIe classe sont puissants, soit dans la population totale, soit dans la classe gouvernante. Pour connaître et évaluer cette utilité, nous avons à résoudre un problème quantitatif, et non un problème qualitatif. À notre époque, par exemple, le développement considérable de la production économique, l'extension de la civilisation à des pays nouveaux, l'augmentation notable de l'aisance des populations civilisées, sont dus en grande partie à l'œuvre des spéculateurs ; mais ceux-ci ont pu l'accomplir, parce qu'ils sortaient de populations où il y avait encore en abondance des résidus de la IIe classe. Il est douteux, il est même peu probable qu'on puisse réaliser de tels avantages si, dans la population ou même seulement dans la classe gouvernante, les résidus de la IIe classe diminuent beaucoup (§ 2227-1, 2383-1).
§ 2255. Si nous voulons avoir des exemples concrets de l'emploi des moyens de gouverner indiqués tout à l'heure, nous n'avons qu'à songer à l'Italie, au temps du gouvernement du ministère Depretis. Comment ce politicien put-il bien jouer le rôle de maître de la Chambre et du pays, pendant tant d'années ? Il n'était pas le chef d'une armée victorieuse ; il n'avait pas l'éloquence qui entraîne les hommes, ni l'autorité que donnent des actions d'éclat ; il n'était pas imposé par le souverain. D'où venait donc sa force ? Une seule réponse est possible : il sut magistralement se servir des sentiments et des intérêts qui existaient dans le pays ; de ces derniers surtout ; cela en devenant le véritable chef du syndicat des « spéculateurs » qui régnait sur le pays et qui détenait le pouvoir effectif dont il n'avait que l'apparence. Il fit la fortune d'un grand nombre de « spéculateurs », par la protection douanière, par les conventions ferroviaires, par les concessions gouvernementales où l'État était volé à pleines mains, par les désordres des banques, découverts plus tard : jamais chef de bande n'accorda plus de pillages et de rapines à ses troupes. Le gouvernement de Crispi fut un intermède : il voulut modifier les résidus et ne se soucia pas beaucoup des intérêts des « spéculateurs ». Il voulait faire naître le sentiment du nationalisme en un peuple où il n'existait pas encore, et comme d'habitude son œuvre fut vaine. Au lieu de se servir des socialistes, il les combattit, et par conséquent se fit des ennemis de leurs chefs les plus intelligents et les plus actifs. Les « spéculateurs » lui furent ou hostiles ou indifférents : il leur donnait peu ou rien à dévorer. Enfin, les conditions de la période économique dans laquelle il gouvernait lui furent défavorables (§ 2302). Il tomba brusquement par suite d'une défaite subie en Abyssinie ; mais même sans cela il n'aurait pu se maintenir au gouvernement. On remarquera le contraste entre Crispi et son successeur Giolitti. Celui-ci fut vraiment un maître en l'art de se servir des intérêts et des sentiments. Non moins que Depretis, il se fit chef du syndicat des « spéculateurs », protecteur des trusts. Pour les soutenir, il fallait de l'argent. Les banques, ayant placé une grande partie de leurs ressources en emprunts d'État, ne pouvaient donner toute l'aide dont on avait besoin. Le ministère Giolitti se mit en mesure de procurer de l'argent au gouvernement par le monopole des assurances. Par conséquent, en rendant disponible l'argent des banques, il aidait les trusts [FN: § 2255-1]. Il sut utiliser les sentiments d'une manière vraiment admirable, sans en négliger aucun. Crispi avait voulu créer les sentiments nationalistes, et avait fait œuvre vaine. Giolitti les trouva existant déjà dans le pays, et il s’en servit largement avec succès. Il ne chercha nullement à combattre le socialisme ; il en circonvint et flatta les chefs. Les uns « reléguèrent Marx au grenier » (c'est ainsi qu'il s'exprima) ; d'autres furent apprivoisés à tel point qu'ils méritèrent le nom de socialistes royaux. Il soutint largement les coopératives socialistes. Son œuvre fut possible parce qu'il fut favorisé par les circonstances économiques (§ 2302), qui furent au contraire défavorables à Crispi. Ces circonstances favorables permirent à Giolitti de mener à bonne fin la guerre de Libye et de renvoyer à plus tard la liquidation des nombreuses dépenses occasionnées par sa politique. Ami des socialistes, au moins de ceux qui n'étaient pas trop sauvages, dont la foi n'était pas trop vive, il ne se montra point l'ennemi des cléricaux. Au contraire, il sut se servir d'eux aussi, et s'il ne les apprivoisa pas, du moins il les rendit plus traitables et en tira largement parti dans les élections. Grâce au concours des sentiments nationalistes, il dissocia le bloc républicain, et le réduisit à un petit noyau de personnes demeurées aveuglément fidèles à leurs principes. Il étendit le droit de suffrage électoral pour faire peur à la bourgeoisie et s'en faire le protecteur, tandis qu'il s'efforçait aussi d'apparaître comme celui des partis populaires. En somme, il n'est pas de sentiments ni d'intérêts, en Italie, dont il n'ait su judicieusement tirer parti à ses fins. C'est pourquoi il réussit, et put entreprendre la campagne de Libye, bien autrement coûteuse et dangereuse que la campagne d'Abyssinie, qui fut fatale à Crispi (§ 2302). On dit qu'il ne voulait pas la guerre de Libye, et qu'il la fit uniquement pour satisfaire certains sentiments, s'en servant comme d'un moyen de gouverner. Comme tous les hommes chez lesquels prédominent fortement les résidus de la Ie classe, il se servait des sentiments, mais ne les comprenait pas très bien ; il ne saisissait pas comment ils pouvaient subsister dans les masses populaires, tandis qu'il les voyait céder chez les chefs qu'il adulait et bernait. Il n'avait pas une juste conception de la valeur sociale de ces sentiments. Cela ne portait guère préjudice à ses menées d'alors, mais l'empêchait d'avoir une vue claire de l'avenir ainsi préparé. Au reste, il se souciait peu de cela et ne se préoccupait que du présent. En portant un grand coup à l'empire ottoman, par la guerre de Libye, il préparait la guerre balkanique, et par conséquent altérait profondément l'équilibre européen ; cependant il ne songeait pas à préparer la puissance militaire de son pays, en vue de conflits futurs. Il n'augmentait pas convenablement les dépenses en faveur de l'armée et de la flotte, parce qu'il lie voulait pas exaspérer les contribuables, et parce qu'il avait surtout besoin des suffrages des socialistes. Au contraire, il se vantait d'avoir maintenu ou accru, malgré la guerre, les dépenses en faveur des travaux publics et les subventions de divers genres aux électeurs. Il dissimulait, au budget, les dépenses de la guerre, remettant à plus tard le soin de les solder. Il accroissait à la dérobée la dette publique, par l'émission de bons du trésor à longue échéance, qu'il faisait absorber par les banques et les caisses d'épargne, au risque de compromettre gravement l'avenir. De cette façon, tout en faisant la guerre, il en dissimulait les charges. Sur le moment, cela était avantageux, car il contentait ainsi ceux qui voulaient la guerre et ceux qui ne voulaient pas en supporter les conséquences indispensables ; mais on renvoyait ainsi à plus tard et on aggravait les difficultés qu'on n'aplanissait pas. En ce cas particulier, on voit, comme avec une loupe grossissante, l'œuvre à laquelle les « spéculateurs » tendent généralement. Le fait que les résidus de la Ie classe prédominaient fortement chez Giolitti et ses partisans, et que ceux de la IIe classe leur faisaient presque défaut, profita, puis finit par nuire à leur pouvoir. Celui-ci se trouva ébranlé par l'action d'une cinquantaine de députés socialistes que les élections de 1913 envoyèrent au Parlement, et chez lesquels prédominaient, au contraire, les résidus de la IIe classe. Avant ces élections, le parti socialiste avait dû choisir entre le « transformisme » et l'intransigeance, c'est-à-dire entre une voie où les résidus de la Ie classe étaient en plus grande abondance, et une autre voie, où les résidus de la IIe classe prédominaient. Ainsi qu'il arrive habituellement, tant pour les nations que pour les partis, les chefs avaient la tendance de suivre la première voie, mais il monta du peuple une marée qui mit en évidence d'autres chefs, et les poussa avec une partie des anciens dans la seconde voie, où prédominent les sentiments. Ce fut une heureuse circonstance pour le parti socialiste, parce qu'il se mit ainsi dans des conditions favorables pour livrer bataille à un gouvernement sans convictions ni foi.
Nous avons ici un cas particulier d'un phénomène général, dont nous devrons parler longuement. En d'autres termes, nous voyons que la plus grande force d'un parti n'est pas réalisée par la prédominance exclusive des résidus de la Ie classe, ni de ceux de la IIe, mais par une certaine proportion des uns et des autres.
§ 2256. L'intermède du gouvernement Luzzatti confirme les déductions du paragraphe précédent. M. Luzzatti avait grandement servi les intérêts de ceux qui jouissent de la protection douanière ; mais ceux-ci n'avaient plus besoin de son aide lorsqu'il devint président du Conseil, parce qu'alors la protection n'était pas en danger, et l'on sait que le passé ne nous appartient plus. D'autre part, le ministre Luzzatti était loin de représenter aussi bien que Giolitti le syndicat des « spéculateurs », et il ne savait pas comme lui se servir des sentiments existants, tout en y restant étranger. C'est pourquoi Giolitti, demeuré le maître effectif quand le ministre Luzzatti gouvernait, retira sans le moindre effort le pouvoir à ce dernier, lorsque vint le moment que lui, Giolitti, estimait convenable. De même, M. Sonnino, très supérieur à d'autres hommes d'État, par la culture et les conceptions politiques, n'a jamais pu rester au pouvoir, parce qu'il ne sait pas ou ne veut pas représenter fidèlement le syndicat des « spéculateurs ». En France, le ministre Rouvier fut souvent le maître du Parlement, précisément à cause de ses mérites comme chef d'un semblable syndicat. Son dernier ministère prit fin, non à cause de difficultés intérieures, mais bien en raison de la politique extérieure. La force de M. Caillaux réside tout entière dans les « spéculateurs » qui l'entourent. Mais il ne faut pas s'arrêter à ces noms ou à d'autres, et croire que ces faits soient particuliers à certains hommes, à certains régimes politiques, à certains pays, alors que ce sont au contraire des faits dépendant étroitement de l'organisation sociale dans laquelle les « spéculateurs » constituent l'élite gouvernementale [FN: § 2256-1]. En Angleterre, les campagnes électorales contre la Chambre des Lords furent soutenues financièrement par les « spéculateurs » dont les ministres dits « libéraux » se firent les chefs [FN: § 2256-2). En Allemagne, les trusts des grands industriels et des grands financiers arrivent jusque sur les marches du trône ; mais la caste militaire leur dispute encore partiellement la place. Aux États-Unis d'Amérique, Wilson et Bryan, parvenus au pouvoir comme adversaires en apparence, et probablement sincères, des trusts et des financiers, agirent de manière à les favoriser, en maintenant l'anarchie au Mexique, dans le but d'avoir un président soumis à la finance des États-Unis. Ces pacifistes poussèrent la désinvolture jusqu'à inviter le gouvernement du Mexique au congrès de la paix à la Haye, au moment précis où la flotte des États-Unis attaquait Vera-Cruz, tuant hommes, femmes, enfants. Le passé le plus proche de nous ressemble au présent. En France, Louis-Napoléon Bonaparte put devenir Napoléon III, parce qu'il se fit le chef des « spéculateurs » ; tandis qu'en Italie, les gouvernements d'autrefois tombaient pour les avoir ignorés, omis, négligés. C'est peut-être aller trop loin, mais pas énormément, que de dire que si le gouvernement du roi de Naples et les autres gouvernements voisins avaient accordé la concession des Chemins de fer Méridionaux, et pris l'initiative d'autres entreprises semblables, ils n'auraient pas été renversés. Durant bien des années, les « libéraux », en France et en Italie, nous ont corné aux oreilles leur admiration pour le gouvernement parlementaire anglais, qu'ils donnaient au monde pour modèle. Une partie d'entre eux ignoraient peut-être la grande corruption de ce régime, que décrit fort bien Ostrogorski ; mais une partie la connaissaient certainement, et s'ils la passaient sous silence, c'était parce que les loups ne se mangent pas entre eux.
§ 2257. Pour se maintenir au pouvoir, la classe gouvernante emploie des individus de la classe gouvernée ; on peut les diviser en deux catégories, qui correspondent aux deux moyens principaux par lesquels on s'assure ce pouvoir (§ 2251). Une catégorie fait usage de la force, ainsi les soldats, les agents de police, les bravi des siècles passés. L'autre catégorie emploie l'artifice, et, de la clientèle des politiciens romains, arrive à celle de nos politiciens contemporains. Ces deux catégories ne font jamais défaut, mais ne se trouvent pas dans les mêmes proportions réelles, et moins encore dans les mêmes proportions apparentes. La Rome des prétoriens marque un autre extrême, où le principal moyen réel de gouvernement, et encore plus le principal moyen apparent, est la force armée. Les États-Unis d'Amérique marquent l'autre extrême, où le principal moyen de gouvernement est, en réalité et un peu moins en apparence, les clientèles politiques. Sur celles-ci on agit par différents moyens [FN: § 2257-1] . Le principal est le moins manifeste : le gouvernement protège les intérêts des « spéculateurs », souvent sans qu'il y ait avec eux aucune entente explicite. Par exemple, un gouvernement protectionniste jouit de la confiance et de l'appui des industriels protégés, sans qu'il ait besoin de conclure des accords explicites avec tous ; mais il peut bien y avoir quelque accord avec les principaux. Il en est de même pour les travaux publics ; pourtant l'accord avec les grands entrepreneurs tend à devenir la règle. Ensuite, il y a des moyens plus connus, moins importants au point de vue social, mais qui passent au contraire pour plus importants au point de vue éthique. Ce sont entre autres, aujourd'hui, les corruptions politiques d'électeurs [FN: § 2257-2), de candidats élus, de gouvernants, de journalistes, et autres semblables [FN: § 2257-3), auxquelles font pendant, sous les gouvernements absolus, les corruptions de courtisans, de favoris, de favorites, de gouvernants, de généraux, etc., lesquelles n'ont d'ailleurs pas entièrement disparu. Ces moyens furent usités de tout temps, depuis ceux de l'antique Athènes et de la Rome républicaine jusqu'à nos jours. Mais ils sont proprement la conséquence du gouvernement d'une classe qui s'impose par la ruse pour régner sur un pays. C'est pourquoi les innombrables tentatives faites pour en réprimer l'usage ont été et demeurent vaines. On peut couper tant qu'on veut le chiendent : il croit de nouveau vivace, si la racine reste intacte. Nos démocraties, en France, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, tendent toujours plus vers un régime de ploutocratie démagogique. Peut-être s'acheminent-elles ainsi vers quelque transformation radicale, semblable à l'une de celles qu'on observa dans le passé.
§ 2258. À part quelques exceptions dont la principale est celle des honneurs qu'un gouvernement peut accorder (§ 2256-1, 2257-3), des dépenses sont nécessaires pour assurer tant le concours de la force armée que celui de la clientèle. Il ne suffit donc pas de vouloir employer ces moyens : il faut aussi pouvoir le faire. Cela dépend en partie de la production de la richesse, et cette production elle-même n'est pas indépendante de la manière dont on se sert de la force armée et des clientèles. Le problème est donc compliqué et doit être considéré synthétiquement (§ 2268). Analytiquement, on peut dire qu'en de nombreux cas la force armée coûte moins que les clientèles ; mais il se peut qu'en certains cas celles-ci soient plus favorables à la production de la richesse. On devra en tenir compte dans la synthèse (§ 2268).
§ 2259. L'évolution « démocratique » paraît être en rapports étroits avec l'emploi plus large du moyen de gouverner qui fait appel à l'artifice et à la clientèle, par opposition au moyen qui recourt à la force. On vit cela déjà vers la fin de la République, à Rome, où se produisit le conflit précisément entre ces deux moyens, et où, avec l'Empire, la force l'emporta. On le voit mieux encore dans le temps présent, où le régime d'un bon nombre de pays « démocratiques » pourrait être défini : une féodalité en grande partie économique (§ 1714) où le principal moyen de gouverner en usage est le jeu des clientèles [FN: § 2259-1] ; tandis que la féodalité guerrière du moyen âge faisait usage surtout de la force des vassaux. Un régime en lequel le « peuple » exprime sa « volonté », – à supposer qu'il en ait une, – sans clientèles ni brigues ni coteries, n'existe qu'à l'état de pieux désirs de théoriciens, mais ne s'observe en réalité ni dans le passé ni dans le présent, ni dans nos contrées, ni en d'autres.
§ 2260. Ces phénomènes, aperçus par beaucoup d'auteurs, sont habituellement décrits comme une déviation, une « dégénérescence » de la « démocratie ». Mais quand et où a-t-on jamais vu l'état parfait, ou au moins bon, dont celui-ci a dévié, ou « dégénéré » ? Personne ne peut le dire. On peut seulement observer que lorsque la démocratie était un parti d'opposition, elle avait moins de tares qu'actuellement ; mais c'est là un caractère commun à presque tous les partis d'opposition, auxquels, pour mal faire, il manque moins la volonté que le pouvoir.
§ 2261. On remarquera, en outre, que les défauts des divers régimes politiques peuvent bien être différents, mais que, dans l'ensemble, on ne peut affirmer que certains genres de ces régimes diffèrent beaucoup des autres, à ce point de vue [FN: § 2261-1]. Les reproches adressés à la démocratie moderne ne diffèrent pas beaucoup de ceux qu'on adressait à certaines démocraties antiques, par exemple à celle d'Athènes. S'il y a un grand nombre de faits de corruption dans les unes et les autres, il ne serait pas difficile d'en trouver de semblables dans les monarchies absolues, dans les monarchies tempérées, dans les oligarchies, et dans d'autres régimes (§ 2445 et sv., 2454).
§ 2262. Les partis ont l'habitude d'envisager ces faits au point de vue éthique, et de s'en servir pour se combattre mutuellement. Le point de vue éthique est celui qui impressionne le plus le peuple. Aussi l'ennemi religieux ou politique est-il généralement accusé, à tort on à raison, de violer les règles de la morale. Souvent on a en vue la morale sexuelle (§ 1757 et sv.), qui impressionne beaucoup un grand nombre de personnes. Ce genre d'accusation fut très usité contre les hommes puissants, dans les siècles passés. Il sert encore parfois aujourd'hui, dans la politique, en Angleterre. C'est ainsi que dans ce pays-là la carrière politique de Sir Charles Dilke fut brisée. Dans l'histoire, on ne trouve aucun rapport entre des fautes semblables ou plus grandes d'un homme et sa valeur politique. Le rapport semble plus probable quand les fautes se rattachent à l'appropriation du bien d'autrui et aux corruptions. Cependant, dans ce domaine aussi, les hommes qui occupent une place éminente dans l'histoire sont généralement bien loin d'être exempts de telles fautes, et, pour rester dans le domaine de l'éthique, les différences sont de forme plus que de fond. Sulla, César, Auguste, distribuaient brutalement à leurs vétérans les biens des citoyens ; avec plus d'artifice, et mieux, les politiciens modernes les distribuent à leurs partisans, grâce à la protection économique et autres semblables moyens. Il existe réellement une différence de fond entre ces deux modes de procéder ; mais il faut les chercher dans un autre domaine (§ 2267). La considération exclusive du phénomène, au point de vue éthique, empêche de voir les uniformités de rapports de faits qui s'y trouvent. Supposons, par exemple, une certaine organisation sociale dans laquelle existe cette uniformité : que pour gouverner, il est nécessaire aux gouvernants d'accorder des faveurs, de protéger les financiers et les entrepreneurs de la production économique, et de recevoir en retour les faveurs de ces personnes, d'être protégés par eux. Les rapports entre les gouvernants et ces « spéculateurs » seront tenus secrets autant que possible. Pourtant, de temps à autre, on en découvrira un. En d'autres termes, on en viendra à savoir que certains A, qui sont au gouvernement, ont eu certains rapports avec les « spéculateurs », et ce sont presque toujours des B, adversaires des A, qui dévoilent le fait [FN: § 2262-1]. Cela posé, si l'on voulait procéder selon les méthodes de la science expérimentale, on devrait s'y prendre comme suit : 1° Sous l'aspect des mouvements réels. Il y aurait lieu d'examiner si le fait est accidentel, isolé, ou bien s'il rentre dans une nombreuse classe de faits semblables. En ce dernier cas, il faudrait examiner à quelle uniformité correspond cette classe de faits, et en quel rapport de dépendance cette uniformité se trouve avec les autres uniformités de la société considérée. 2° Sous l'aspect des mouvements virtuels. À supposer que l'on veuille empêcher le retour de faits semblables à celui dont il s'agit, il est nécessaire de rechercher quels liens doivent être supprimés ou modifiés, parmi ceux qu'il est possible de supprimer (§ 134), afin d'obtenir l'effet voulu.
Cette manière de raisonner ne s'observe presque jamais, mieux vaut dire jamais [FN: § 2262-2). Cela pour deux causes principales. La première est celle tant de fois notée, et suivant laquelle, aux raisonnements logico-expérimentaux, les hommes préfèrent habituellement les dérivations, et parmi celles-ci les dérivations éthiques. La seconde est que le petit nombre des gens qui seraient capables de voir la réalité des choses, ont intérêt à en écarter l'attention du public. Il faut en effet prendre garde que d'habitude les B n'ont nullement le dessein d'ôter à tout le monde le pouvoir d'accomplir les faits blâmés, mais bien de l'enlever uniquement aux A. Ils visent moins à changer l'ordre social qu'à le faire tourner à leur profit, en dépossédant les A et en se substituant à eux. C'est pourquoi il est bon que les actes paraissent être une conséquence non pas de l'ordre social, mais de la perversité des A. Il semblerait que les partis dits « subversifs », qui veulent détruire l'ordre social actuel, devraient procéder autrement. Mais ils ne le font pas, parce que les changements qu'ils désirent sont généralement d'un autre genre que ceux qui empêcheraient le retour des faits indiqués. Par conséquent, ces partis suivent aussi la voie des dérivations éthiques, en ajoutant que la perversité des A est causée par l'organisation qu'eux, les B, veulent détruire, par exemple le « capitalisme ». Les A et les B font bon accueil à ces dérivations, car en visant à des éventualités très reculées et peu probables, ils distraient l'attention de causes beaucoup plus rapprochées et beaucoup plus faciles à atteindre [FN: § 2262-3).
De cette façon, le raisonnement se prolonge toujours plus dans les divagations éthiques, et les meilleures, pour ceux qui en font usage, sont celles qui distraient l'attention des points où ils voient un danger. Les suivantes sont habituellement les plus usitées.
1° Comme ce sont les B qui ont dévoilé les méfaits des A, les amis des A prennent l'offensive contre les B, et disent qu'après tout ceux-ci ne sont pas « meilleurs » que les A ; en quoi ils ont souvent raison ; et ce qui fait que leur avis est aussi partagé par des personnes de bonne foi [FN: § 2262-4]. Ainsi un problème très dangereux se change en un autre, plus anodin. Au lieu de chercher s'il y a, dans l'ordre social, une cause qui produit les méfaits des A et des B, lesquels sont dévoilés, ceux des A par les B, et ceux des B par les A, on cherche quelle est la comparaison morale à établir entre les A et les B. Comme ce dernier problème est presque insoluble, après un grand débat, l'énorme émotion causée par le scandale des A n'aboutit à rien. 2° On a une variété de la dérivation précédente, lorsqu'on démontre que les B, en dévoilant les méfaits des A, sont mus par un intérêt de parti. Il existe d'autres dérivations semblables, qui toutes ont pour but de substituer ce problème : « Comment et pourquoi les méfaits des A ont-ils été dévoilés? », à cet autre : « Ces méfaits existent-ils, oui ou non, et quelle en est la cause ? » 3° On obtient d'autres dérivations, non plus en comparant les A et les B, mais en traitant d'eux séparément. À l'égard des A, on recourt au procédé, si efficace dans les défenses devant les jurés, et consistant à rechercher chacun des actes de la vie d'un accusé, avec une telle abondance de détails, qu'on masque le fait visé par l'accusation. On dit que les A ont été de bons patriotes, qu'ils ont bien servi leur parti, et l'on exhibe quantité d'autres choses semblables, entièrement étrangères à l'accusation. Une dérivation très en usage consiste à affirmer – que ce soit vrai ou non – que les A n'ont retiré aucun avantage pécuniaire direct des faits qui leur sont reprochés. On passe sous silence les avantages pécuniaires directs ou indirects, les avantages sous forme d'honneurs, de pouvoir, et autres semblables, qu'ont retirés des personnes de leur famille, des amis, des partisans, des électeurs, etc. On passe aussi sous silence l'avantage indirect que les A ont obtenu, en parvenant au pouvoir et en s'y maintenant, grâce à l'appui des personnes qu'ils ont soutenues, à celui de la presse payée par les financiers protégés [FN: § 2262-5), ou directement favorisée. Mais quand bien même on pourrait démontrer qu'en accomplissant leurs méfaits, les A furent mus par des sentiments d'une morale très pure et très élevée, ces méfaits et le dommage qu'en éprouve le public n'en existeraient pas moins. Comme d'habitude, au problème de cette existence et de ce dommage on en substitue un autre, qui y est étranger : celui de la valeur morale des A. Mutatis mutandis, on emploie contre les A des dérivations analogues : au lieu de prouver l'existence et les dommages des faits dont ils sont accusés, on démontre que les A ont peu ou point de valeur morale ; ce qui est un problème entièrement différent du premier. À l'égard des B, on obtient des dérivations analogues par de semblables substitutions de problèmes. 4° Un grand nombre de dérivations recommandent le silence afin de ne pas porter préjudice aux amis, au parti, au pays. En somme, sous des dehors plus ou moins enjolivés, on prêche qu'il n'importe pas tant d'empêcher les mauvaises actions que d'empêcher qu'elles ne soient connues [FN: § 2262-6). 5° Enfin, nous avons des procédés qui sont plutôt des artifices que des dérivations. On s'en sert pour étendre autant que possible à un grand nombre de personnes les accusations portant sur des faits analogues à ceux qui sont dénoncés. Cela est facile, car ce sont des faits usuels en certains régimes, et ces procédés sont très efficaces, attendu que, écrit déjà Machiavel [FN: § 2262-7] , « quand une chose importe à beaucoup de gens, beaucoup de gens doivent en prendre soin ». Parfois, on demeure surpris de voir qu'au moment de remporter la victoire et de précipiter les A dans l'abîme, les B s'arrêtent tout à coup, hésitent et finissent par se contenter d'une demi-victoire. Mais la raison en est qu'ils se sentent aussi coupables que les A et craignent de donner l'éveil. Les nombreuses personnes honnêtes, naïves, qui ignorent la réalité des faits, ont recours à des dérivations d'espèces très variées, grâce auxquelles les causes des actions se recouvrent des voiles de l'indulgence, de la pitié, de l'amour pour la patrie, etc.
§ 2263. On peut diviser en deux catégories les hommes qui, grâce à des manœuvres politiques et financières, font de gros bénéfices. La première de ces catégories comprend ceux qui dépensent à peu près ce qu'ils gagnent. Ces personnes se prévalent souvent de cette circonstance pour dire que les manœuvres politiques et financières ne leur ont rien rapporté, puisqu'elles ne les ont pas enrichies. La seconde catégorie est constituée par ceux qui ont retiré de leurs gains non seulement ce dont ils avaient besoin pour subvenir à de grandes dépenses, mais encore ce qui leur a constitué un patrimoine. Les deux catégories sont composées des hommes nouveaux qui gouvernent les nations modernes, tandis que peu à peu ceux qui tiennent un patrimoine de leurs ascendants disparaissent de la classe gouvernante. Rarement, les manœuvres de certains « spéculateurs » sont découvertes et tournent au désavantage de ceux qui s'y sont livrés. Mais ceux qui sont frappés constituent un très petit nombre de ceux qui se livrent à ces manœuvres, tandis que le plus grand nombre échappe à toute peine ou à tout blâme. Parmi eux, un nombre, petit il est vrai, mais encore notable, gagne de grandes fortunes, de grands honneurs, et gouverne l'État. En Italie, on peut observer que presque tous les grands patrimoines constitués récemment proviennent des concessions gouvernementales, des constructions de chemins de fer, des entreprises subventionnées par l'État, de la protection douanière, et que de la sorte nombre de gens ont pu s'élever aux premiers honneurs du royaume. C'est pourquoi toute cette organisation apparaît aux politiciens avisés comme celle d'une grande loterie, où l'on peut gagner des lots considérables, d'autres moins importants, d'autres peu importants, et où malheureusement on court le risque professionnel de se trouver parmi ceux qui sont frappés. Mais enfin, ce risque n'est pas plus grand que celui de subir des dommages et des malheurs dans la plupart des professions.
§ 2264. Parfois il arrive que le négociant qui fait faillite est plus honnête que celui qui s'enrichit. Il arrive de même souvent que les politiciens frappés sont parmi les moins coupables. Les circonstances peuvent leur avoir été défavorables ; ou bien ils peuvent avoir manqué de ce qu'il faut d'habileté, d'énergie ou de courage à mal faire pour se tirer d'affaire. « Les hommes, dit Machiavel, savent très rarement être ou tout bons ou tout mauvais », et dans ces luttes des politiciens, souvent ce sont les plus « mauvais » qui se tirent d'affaire. Il est comique de les voir juger et condamner les moins « mauvais », au nom de la vertu et de la morale. Cela rappelle le mot de Diogène qui [FN: § 2264-1] , « voyant un jour certains magistrats mener [en prison l'un des trésoriers qui avait dérobé une fiole, dit : Les grands voleurs mènent en prison] le peti voleur ». Il est certain que si la justice consiste à « donner à chacun le sien », un grand nombre de ces condamnations ne sont pas « justes », parce que ceux qui sont frappés ont reçu plus qu'il ne leur revenait [FN: § 2264-2).
§ 2265. De petits pays, comme la Suisse, avec une population très honnête, peuvent demeurer en dehors de ce courant qui inonde tous les grands pays civilisés, et qui coule boueux du passé au présent. On a souvent remarqué que le régime absolu en Russie n'était pas moins corrompu ni corrupteur que le régime ultra-démocratique des États-Unis d'Amérique. Les libre-échangistes disaient que la seule cause en était l'existence de la protection douanière dans ces deux pays. Il y a là quelque chose de vrai, car il est incontestable que la protection douanière offre un vaste champ à la corruption. Mais il y a aussi d'autres causes, car la corruption politique n'est pas absente de l'Angleterre libre-échangiste. La part de la vérité deviendrait plus grande si, au lieu de la protection douanière, il s'agissait de la protection économique. Mais en ce cas aussi il resterait toujours d'autres champs ouverts à la corruption [FN: § 2265-1] : dans les mesures militaires, dans les constructions de forts et de navires, dans les travaux publics, dans les diverses concessions de l'État (§ 2548), dans l'administration de la justice, où les députés et autres politiciens ont tant de pouvoir, dans les faveurs et les honneurs dont dispose l'État, dans la répartition des impôts, dans les lois dites sociales, etc.
§ 2266. Le souci d'être bref nous interdit d'apporter trop de preuves des affirmations précédentes : il suffira de s'en référer à quelques types. Quant aux différents pays et à la variété des régimes politiques, dans le premier semestre de 1913 nous avons en Russie les accusations habituelles de corruption de l'administration de la marine et de la guerre ; en Hongrie, le scandale des banques qui versèrent des millions dans la caisse électorale du parti alors au pouvoir, et de la société constituée en vue d'installer une maison de jeu dans l'île Marguerite, société qui paya 500 000 couronnes aux intermédiaires politiques, et versa 1 500 000 couronnes dans la caisse électorale du parti ; en Angleterre, le scandale de la télégraphie sans fil ; en France, celui des casinos de jeu ; en Italie, le scandale du Palais de Justice, pour ne pas parler de celui des fournitures pour la Libye ; en Allemagne, les accusations de corruption portées contre les puissantes maisons qui fournissent les armements de l'armée. On remarquera qu'en tous ces cas, moins le dernier, c'étaient principalement des parlementaires qui étaient compromis, parce qu'en tous ces pays, moins le dernier, ce sont précisément eux qui détiennent le pouvoir, et qui, par leurs intrigues, font pression sur le gouvernement, lorsqu'ils n'en font pas partie. Là où les députés peuvent faire et défaire les ministères, la corruption parlementaire règne généralement. Quant au temps et aux différents partis, on peut observer qu'en France, sous le règne de Napoléon III, les républicains faisaient grand bruit au sujet de la corruption du gouvernement. Mais ensuite, parvenus au pouvoir, ils montrèrent, avec le Panama et d'autres nombreux faits de corruption, qu'à ce point de vue ils ne restaient pas en arrière de leurs prédécesseurs. En Italie, quand la droite gouvernait, les diverses gauches poussaient les hauts cris contre la corruption de leurs adversaires ; ensuite, arrivées successivement au pouvoir, elles en firent autant et même pis. Aujourd'hui, il paraît que l'on doit attendre l’âge d'or pour le moment où la « corruption bourgeoise » cédera la place à l' « honnêteté socialiste ». Mais il n'est pas certain que cette promesse sera mieux tenue que tant d'autres semblables, faites par le passé.
§ 2267. Considérons tous ces faits d'un peu haut, en nous dégageant autant que possible des liens des passions sectaires et des préjugés, nationaux, de parti, de perfection, d'idéal et d'autres semblables entités. Nous voyons qu'en somme, quelle que soit la forme du régime, les hommes qui gouvernent ont en moyenne une certaine tendance à user de leur pouvoir pour se maintenir en place, et à en abuser en vue d'obtenir des avantages et des gains particuliers, que parfois ils ne distinguent pas bien des gains et des avantages du parti, et qu'ils confondent presque toujours avec les avantages et avec les gains de la nation. Il suit de là : 1° que, à ce point de vue, il n'y aura pas grande différence entre les diverses formes de régime. Les différences résident dans le fond, c'est-à-dire dans les sentiments de la population : là où celle-ci est plus honnête ou moins honnête, on trouve aussi un gouvernement plus honnête ou moins honnête ; 2° que les usages et les abus seront d'autant plus abondants que l'intromission du gouvernement dans les affaires privées sera plus grande ; au fur et à mesure que la matière à exploiter augmente, ce qu'on en peut retirer augmente aussi ; aux États-Unis, où l'on veut imposer la morale par la loi [FN: § 2267-1], on voit des abus énormes, qui font défaut là où cette contrainte n'existe pas, ou existe dans de bien moindres proportions; 3° que la classe gouvernante s'efforce de s'approprier les biens d'autrui, non seulement pour son usage propre, mais aussi pour les faire partager aux personnes de la classe gouvernée qui défendent la classe gouvernante, et qui en assurent le pouvoir, soit par les armes, soit par la ruse, avec l'appui que le client donne au patron ; 4° que, le plus souvent, ni les patrons ni les clients ne sont pleinement conscients de leurs transgressions des règles de la morale existant dans leur société, et que, quand bien même ils s'en aperçoivent, ils les excusent facilement, soit en considérant qu'en fin de compte d'autres feraient de même soit sous le prétexte commode de la fin qui justifie les moyens; et pour eux, la fin qui consiste à maintenir son propre pouvoir ne peut être qu'excellente ; bien plus, c'est en parfaite bonne foi que plusieurs d'entre eux confondent cette fin avec celle du salut de la patrie ; il peut aussi y avoir des personnes qui croient défendre l'honnêteté, la morale, le bien public, tandis qu'au contraire leur œuvre recouvre les machinations de gens qui cherchent à gagner de l'argent [FN: § 2267-2) ; 5° que la machine gouvernementale consomme de toutes façons une certaine quantité de richesses, quantité qui est en rapport, non seulement avec la quantité totale de richesses entrant dans les affaires privées auxquelles s'intéresse le gouvernement, mais aussi avec les moyens dont use la classe gouvernante pour se maintenir au pouvoir, et par conséquent avec les proportions des résidus de la Ire et de la IIe classe, dans la partie de la population qui gouverne et dans celle qui est gouvernée.
§ 2268. Entreprenons maintenant de considérer les différents partis de la classe gouvernante. Dans chacun d'eux, nous pouvons distinguer trois catégories : (A) des hommes qui visent résolument à des fins idéales, qui suivent strictement certaines de leurs règles de conduite ; (B) des hommes qui ont pour but de travailler dans leur intérêt et dans celui de leur client ; ils se subdivisent en deux catégories : (B-α) des hommes qui se contentent de jouir du pouvoir et des honneurs, et qui laissent à leurs clients les avantages matériels ; (B – β) des hommes qui recherchent pour eux-mêmes et pour leurs clients des avantages matériels, généralement de l'argent. Ceux qui sont favorables à un parti appellent « honnêtes » les (A) de ce parti, et les admirent ; ceux qui sont hostiles au parti les disent fanatiques, sectaires, et les haïssent. Les (B–α) sont généralement tenus pour honnêtes par ceux qui leur sont favorables, regardés avec indifférence, au point de vue de l'honnêteté, par leurs ennemis. Les (B–β), lorsqu'on découvre leur existence, sont appelés « malhonnêtes » par tout le monde ; mais leurs amis s'efforcent de ne pas les laisser découvrir et, pour atteindre leur but, ils sont capables de nier même la lumière du soleil. D'habitude, les (B–α) coûtent au pays beaucoup plus que les (B–β) ;car sous leur vernis d'honnêteté, il n'y a sorte d'opérations qu'ils ne fassent pour priver autrui de ses biens et pour en faire profiter leurs clientèles politiques. Il convient d'ajouter que parmi les (B – α) se dissimulent aussi plusieurs personnes qui, sans rien prendre pour elles-mêmes, font en sorte d'enrichir leur famille [FN: § 2268-1] . La proportion des catégories indiquées tout à l'heure dépend en grande partie de la proportion des résidus de la Ire et de la IIe classe. Chez les (A) , les résidus de la IIe classe l'emportent de beaucoup ; c'est pourquoi on peut appeler ces personnes honnêtes, fanatiques, sectaires, suivant le point de vue auquel on les considère. Chez les (B) , ce sont les résidus de la le classe qui prédominent ; c'est pourquoi ces personnes sont plus aptes à gouverner. Quand elles parviennent au pouvoir, elles se servent des (A) comme d'un lest, qui d'ailleurs sert aussi à donner au parti un certain semblant d'honnêteté ; mais, dans ce but, les (B–α) remplissent mieux les conditions voulues. Ces gens constituent une marchandise peu abondante et très recherchée par les partis (§ 2300). Dans la clientèle, chez les hommes du parti qui n'est pas au pouvoir, chez les électeurs, les proportions des résidus de la Ie et de la IIe, classe correspondent, sans d'ailleurs être identiques, à celles qui existent dans la partie gouvernante, dans l'état major. Seul un parti où les résidus de la IIe classe sont abondants peut élire un grand nombre d'individus de la catégorie (A) . Mais, sans s'en rendre compte il en élit aussi d'autres, de la classe (B) , car ceux-ci sont rusés, avisés, maîtres en l'art de trouver des combinaisons, et induisent facilement en erreur les électeurs naïfs chez lesquels existent en grande quantité des résidus de la IIe classe.
Dans nos organisations politiques, il faut diviser les partis en deux grandes classes: (I) partis qui s'acheminent au gouvernement ; lorsqu'un y arrive, les autres forment l'opposition ; (II) partis intransigeants, qui ne parviennent pas au gouvernement. Il résulte de ce que nous avons déjà remarqué, que dans les partis (I), il y aura un minimum de (A) et un maximum de (B) , et vice-versa dans les partis (II). En d'autres termes, on exprime cela en disant que les partis qui n'arrivent pas au pouvoir sont souvent plus honnêtes, mais aussi plus fanatiques et plus sectaires que ceux qui y parviennent. C'est là le sens de l'expression commune en France : la République était belle sous l'Empire. Ce fait dépend essentiellement des organisations. Dans les partis qui parviennent au gouvernement, un premier choix s'effectue aux élections. Sauf les exceptions, qui ne sont pas très nombreuses, on ne devient député qu'en payant, ou bien en accordant, et plus encore en promettant, des faveurs gouvernementales. Cela constitue un filet qui laisse passer bien peu de (A) . Ceux qui se rapprochent le plus des (A) , ce sont les candidats qui se trouvent être assez riches pour acheter la députation, laquelle est pour eux un luxe. Cela paraît bizarre, mais c'est pourtant vrai, que ces gens sont, après les (A) , les plus honnêtes des politiciens. Ils sont en petit nombre, parce que les dépenses nécessaires pour acheter les électeurs sont énormes ; et celui qui les fait de ses propres deniers veut ensuite s'en récupérer par des gains ; et celui qui ne peut ou ne veut faire ces dépenses, en charge le gouvernement, sous la forme de concessions et de faveurs de diverses espèces. Grande est la concurrence, et seuls viennent à flot les hommes chez lesquels existent des instincts de combinaisons en grande abondance (résidus de la Ire classe). Un second et plus rigoureux choix a lieu parmi les députés qui deviennent ministres. Les candidats députés devaient faire des promesses aux électeurs, les candidats ministres doivent faire des promesses aux députés, et s'engager à travailler dans l'intérêt de ceux-ci et de leur clientèle politique [FN: § 2268-2] . Les naïfs croient que pour faire cela il suffit de n'être pas honnête. Ils se trompent : il faut de rares qualités de finesse, d'habileté dans tous les genres de combinaisons. Les ministres ne disposent pas de coffres dont ils puissent tirer l'argent à la poignée, pour le distribuer à leurs partisans. Il faut, avec un art subtil, trouver dans le domaine économique des combinaisons de protection économique, de faveurs aux banques, aux trusts, de monopoles, de réformes fiscales, etc., et, dans les autres domaines, des combinaisons de pression sur les tribunaux, de distribution d'avantages honorifiques, etc., profitant à ceux qui soutiennent le pouvoir. En outre, il est bon de s'efforcer de séparer les (A) des autres partis. Celui qui a une foi opposée à celle de ces (A) réussira difficilement dans ses intentions ; mais celui qui n'a aucune foi, qui a presque uniquement des résidus de la Ire classe, pourra beaucoup mieux agir sur ces (A) , et se servir de leur propre foi pour les attirer à lui, ou du moins pour enlever toute efficacité à leurs oppositions. On peut donc être sûr que dans les partis qui s'acheminent au gouvernement, les résidus de la Ire classe prédominent de beaucoup. Il ne peut en être autrement avec les organisations présentes. C'est pourquoi elles tendent toujours plus vers une ploutocratie démagogique. Souvent les différents partis s'accusent mutuellement de malhonnêteté. Ils ont raison ou tort, suivant le point de vue auquel on considère les faits. Presque tous les partis ont leurs (B – β) ; par conséquent, celui qui les considère exclusivement peut, à bon droit, accuser le parti de malhonnêteté. Ils ont aussi leurs (B–α), et celui qui les considère peut ou non accuser le parti de malhonnêteté, suivant le sens qu'il donne à ce terme. Enfin, peu nombreux sont les partis qui n'ont pas leurs (A) ; et quiconque les considère exclusivement dira que le parti est honnête. Ensuite, si l'on veut prêter attention à la proportion des (A) et des (B) , on trouvera certains cas où les (A) prédominent certainement, et où, par conséquent, on peut dire que le parti est « honnête ». Mais en un grand nombre d'autres cas, on ne sait vraiment pas si, chez les divers partis qui se disputent le gouvernement, il existe une grande différence entre les proportions des (A) et des (B) . On peut dire seulement que les (A) sont assez rares. Dans les couches inférieures de la population, les résidus de la IIe classe existent encore en grande quantité ; par conséquent, les gouvernements qui, en réalité, sont mus par de simples intérêts matériels, doivent au moins feindre de viser à des fins idéales ; et les politiciens doivent se recouvrir d'un voile d'honnêteté, à vrai dire souvent assez ténu. Quand l'un d'eux est pris la main dans le sac, le parti adverse fait grand tapage, tâchant de tirer parti du fait comme d'une arme utile à ses fins. Le parti auquel appartient le présumé coupable s'efforce tout d'abord de le défendre ; puis, si cela lui paraît trop difficile ou impossible, il le jette par dessus bord, comme un navire en danger se défait de sa cargaison. La population suit le développement du fait comme elle suit le développement de l'action d'une œuvre théâtrale, et si elle peut y découvrir un tant soit peu de sentiment et d'amour, la moitié du monde se prélasse à ce spectacle gratuit. Les incidents insignifiants deviennent le principal du fait, et l'on néglige entièrement ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'organisation qui a ces faits pour conséquence. Si un ministre se laisse prendre à exercer une pression sur un magistrat, tout le monde crie à tue-tête, mais personne ne demande que les magistrats, rendus vraiment indépendants, soient soustraits à l'influence des ministres. Cela vient de ce que les partis d'opposition veulent bien se servir du fait pour chasser du pouvoir leurs rivaux, mais qu'ils entendent faire exactement comme eux, lorsqu'ils seront au pouvoir, et parce que le vulgaire ne comprend que les faits concrets, particuliers, et ne sait pas s'élever à la considération des règles abstraites, générales. Par conséquent, les « scandales » succèdent aux « scandales », sans interruption. Tandis que l'un éclate, l'autre se prépare et va éclater, et les gens s'émeuvent à chaque nouveau cas, trouvant extraordinaire ce qui est au contraire parfaitement ordinaire et une conséquence des institutions voulues ou tolérées par ces gens eux-mêmes. Les éthiques croient que le fait est un produit du hasard, qui a porté au pouvoir un homme « malhonnête » ; que ce fait est parfaitement semblable à celui d'un caissier qui dérobe son patron. Il n'en est point ainsi. Ce n'est pas un cas fortuit qui a donné le pouvoir à un homme de cette sorte : c'est le choix, conséquence des institutions ; et si l'on veut établir la comparaison avec le caissier, il faut ajouter que celui-ci n'a pas été choisi comme on fait d'habitude, mais que le patron est allé le chercher parmi les personnes qui ont le plus la tendance de se sauver en emportant la caisse, et qui présentent le plus d'aptitudes à commettre cet acte, grâce à des qualités de ruse et d'autres analogues [FN: § 2268-3].
§ 2269. Il est nécessaire d'avoir une notion des résultats économiques des différents modes de gouverner (§ 2258). Au sujet des dépenses, on a cru pouvoir les déduire de la somme prélevée sous forme d'impôt ou acquise autrement par l'État. Mais cette somme ou une autre semblable représente seulement une partie des dépenses de la nation, car il faut tenir compte des protections économiques et politiques, du coulage résultant des lois dites « sociales », et enfin de toute autre mesure qui entraîne des dépenses et du coulage, même si ces deux rubriques ne figurent pas au bilan de l'État. Après qu'on a évalué d'une manière quelconque le coût de l'entreprise gouvernement, il reste à en évaluer la production. Ce problème est très difficile, voire impossible à résoudre dans toute son extension. Par conséquent, on a dû chercher des solutions approximatives. L'une de celles-ci, qui d'ailleurs n'est pas présentée comme telle, mais à laquelle on a l'habitude d'attribuer une valeur absolue, trouve aujourd'hui un grand crédit. On l'obtient en supposant que le gouvernement satisfait aux « besoins publics », et qu'il y pourvoit en levant des impôts. Ainsi, on évalue en même temps les deux parties du bilan économico-social de l'État, et l'on égalise automatiquement la valeur de la production à son coût.
§ 2270. Théoriquement, cette solution a le mérite de se prêter à de faciles calculs en vue de disposer de la meilleure manière possible les recettes et les dépenses. En peu de mots, on admet un certain besoin A, on en évalue le coût a, et l'on s'arrange à en répartir la charge entre les contribuables grâce à des recettes équivalentes. Ensuite, pour satisfaire le désir de développements logiques, on ajoute un grand nombre de dérivées sur les « besoins » et sur la « répartition », en faveur de laquelle on s'adonne à des prêches, selon les principes sentimentaux d'une des nombreuses éthiques sociales en cours. De cette façon, on obtient la solution qui concorde le mieux avec les sentiments de l'auteur de la théorie et de ses adeptes, mais non celle qui représente le mieux les faits tels qu'ils sont.
§ 2271. Parmi ces dérivations, il faut noter un genre pseudo-scientifique que l'on obtient en étendant les conceptions de l'économie pure aux « besoins » sociaux des hommes. On suppose que ces « besoins » sont satisfaits par l' « État ». Ensuite, au moyen des considérations sur l'utilité marginale, on déduit les règles d'un certain équilibre entre ces « besoins » et les « sacrifices » nécessaires à les satisfaire. On a ainsi des théories qui peuvent concorder en certains cas avec la logique formelle, mais qui s'écartent de la réalité au point de n'avoir parfois avec elle rien de commun. Les manières dont cette séparation se produit sont diverses. Il suffira de relever ici les suivantes. 1° La notion de « besoins » n'est nullement déterminée ; par conséquent elle ne peut servir de prémisse à un raisonnement rigoureux. Les économistes se heurtèrent à une difficulté de ce genre, et ne trouvèrent d'autre moyen de l'éviter que de distinguer une utilité objective, dont ils ne s'occupèrent pas, et une utilité subjective (ophélimité), qu'ils prirent en considération, uniquement pour déterminer l'équilibre économique. Ce n'est pas tout : ils durent aussi admettre, d'abord, que l'individu est seul juge de la question de savoir si cette utilité subjective existe ou non, ensuite qu'il est seul juge de l'intensité de cette utilité. Tout cela ne pourrait avoir un sens pour une collectivité, que si l'on pouvait la considérer comme une personne unique (§ 2130), ayant une unité de sensation, de conscience, de raisonnement. Mais comme cela ne concorde pas avec les faits, les déductions qu'on tire de cette hypothèse ne peuvent concorder non plus avec eux. La notion des « besoins » collectifs est employée pour faire disparaître artificiellement les difficultés qui naissent du fait que l'on doit considérer les diverses espèces d'utilités, pour se rapprocher de la réalité (§ 2115 et sv.). 2° À supposer que l'on puisse préciser la notion de « besoins », nous n’avons pas encore fait disparaître toutes les causes principales d'erreurs, et nous nous trouvons en présence d'une erreur de grande importance. Le raisonnement que l'on fait sur les « besoins » collectifs suppose que les hommes les satisfont par des actions logiques ; au contraire il n’en est rien, et les actions non-logiques jouent un très grand rôle dans le phénomène. Il est vrai qu'elles jouent aussi un certain rôle dans les phénomènes concrets économiques, mais ce rôle est généralement assez peu important, au moins dans le commerce en gros ; par conséquent, on peut le considérer comme nul dans une première approximation, et la théorie qui suppose que les hommes accomplissent des actions logiques pour se procurer des biens économiques, donne des conclusions que l'expérience vérifie, au moins en très grande partie.
Il en va tout autrement pour les phénomènes concrets sociaux. Dans une partie d'entre eux, à la vérité très importante, les actions non-logiques sont prédominantes, à tel point qu'une théorie qui considère uniquement les actions logiques ne donne pas même une première approximation, mais aboutit à des conclusions qui n'ont que peu ou rien de commun avec la réalité. 3° Enfin, des raisonnements semblables à ceux que nous examinons négligent des effets très importants de l'action gouvernementale, par exemple les effets de la circulation des élites. Il est vrai que le terme « besoins collectifs » est si élastique que l'on y peut faire entrer tout ce qu'on veut, et qu'on peut dire, par exemple, qu'une circulation des élites, d'une certaine sorte et d'une certaine intensité, est un « besoin collectif ». On peut même introduire dans cette notion le besoin de stabilité des gouvernements, celui des révolutions, de la substitution de la classe gouvernante à une autre, et ainsi de suite indéfiniment. Mais il est vrai aussi qu'un terme signifiant tant de choses finit par ne plus rien signifier, et que le raisonnement auquel il sert de prémisse dissimule une logomachie.
§ 2272. Pratiquement, les solutions mentionnées, au § 2270 servent à la classe gouvernante ou à celle qui veut le devenir, pour justifier son pouvoir et le faire plus facilement accepter de la classe sujette. Supposons que la classe gouvernante A veuille faire accepter une certaine mesure X dont elle fait son profit ; il est évident qu'il lui est avantageux de donner le nom de « besoin social » à cette mesure, et de s'efforcer de faire croire à la classe gouvernée, laquelle n'en retire aucun avantage et en fait les frais, qu'au contraire cette mesure est destinée à satisfaire un « besoin »» de cette classe. S'il se trouve quelque mécréant qui prétende ne pas éprouver ce « besoin », on lui répond aussitôt qu'il « devrait » l'éprouver. Par exemple, parmi les « besoins collectifs », on range d'habitude la défense nationale. Voici un pays G qui maintient dans la sujétion l'une de ses provinces A, dont les habitants n'éprouvent nullement le « besoin » d'être unis à G ; tout au contraire, ils éprouvent le « besoin » opposé de s'en détacher et de s'unir au pays F. Le pays G fait payer un impôt à tous les citoyens, y compris ceux de A, afin d'augmenter les armements dirigés contre le pays F, et de se mettre en mesure d'empêcher que A puisse s'unir à lui. On devrait donc dire que cet impôt est destiné à profiter à ceux qui tiennent la province A dans la sujétion, ou, si l'on veut, à satisfaire un de leurs « besoins ». Mais on préfère affirmer, en pleine contradiction avec les faits, que de la sorte on satisfait un « besoin collectif » de tous les habitants, y compris ceux de A. De cette façon, l'oppression que subissent les habitants de A est moins évidente. De même, voici un pays dans lequel un parti socialiste ou syndicaliste déclare qu'il n'éprouve nullement le « besoin » d'une certaine guerre voulue par le reste de la population. Il est bon de dire que cette guerre satisfait un « besoin » de la « nation », parce qu'ainsi on passe sous silence, on dissimule, on s'efforce d'atténuer le désaccord qui règne entre ceux qui éprouvent le « besoin » et ceux qui, au contraire, ne l'éprouvent pas du tout. Les sophismes de ce genre sont dissimulés par l'ambiguïté voulue du terme « besoin collectif », (dérivations IV-γ). Il peut signifier au moins quatre choses distinctes et différentes : 1° un besoin effectif de tous les membres de la collectivité ; 2° un besoin effectif de certains membres de la collectivité, besoin qui renferme aussi certains caractères déterminés, par exemple le besoin des « honnêtes gens », des « patriotes », de ceux qui ont une certaine foi, etc. ; 3° un besoin que la majorité effective de la collectivité déclare être un « besoin de la collectivité » ; 4° un besoin que la majorité d'une certaine assemblée, ou certains gouvernants, délégués dans ce but par la loi, ou qui ont obtenu ce pouvoir par la ruse, par la force ou autrement, déclarent être un « besoin de la collectivité ». Habituellement, les raisonnements que l'on fait au sujet de l'utilité de satisfaire ces besoins, ont en vue le premier de ceux-ci. Or, on veut au contraire appliquer les conclusions au second, lequel, grâce à l'indétermination des termes, se trouve être tout simplement ce que l'auteur de la dérivation estime bon [FN: § 2272-1] ; ou bien, on veut les appliquer au quatrième, qui n'est autre chose que la manifestation de la volonté des gouvernants ; ou encore à quelque autre besoin de ce genre.
§ 2273. Souvent, dans la matière qu'on appelle la science des finances, nous avons donc deux genres de dérivations 1° des dérivations qui ont en vue de tirer des conséquences de certains principes éthiques ou sentimentaux, et qui peuvent s'éloigner beaucoup de la réalité ; 2° des dérivations qui ont en vue de donner une couleur théorique à des résultats auxquels on est parvenu par une tout autre voie. Avec ces dérivations, on arrive à des conclusions concordant avec la réalité, mais seulement parce qu'elles ont été fixées préventivement. Si l'on regarde uniquement la réalité, on voit aussitôt que les gouvernements s'efforcent de retirer tout ce qu'ils peuvent de leurs contribuables, et qu'ils ne sont jamais retenus par le fait qu'ils n'auraient pas de « besoins » à satisfaire. Le seul tempérament est la résistance des contribuables. La science pratique des finances d'un ministre ne consiste donc point à rechercher des démonstrations théoriques de théorèmes et des conséquences de certains principes ; elle consiste tout entière à trouver un moyen de vaincre cette résistance, de plumer l'oie sans trop la faire crier. Cette science, ou cet art, quel que soit le nom qu'on veuille lui donner, a été très perfectionné de nos jours ; et désormais, par tradition, dans les ministères des différents pays, il s'est établi certaines règles qui permettent de soutirer de l'argent en suivant la ligne de moindre résistance. On sait tirer avantage des fortes commotions qui peuvent se produire dans un pays ; on sait évaluer la force nécessaire pour pousser aux dépenses, force qui provient des personnes qui en retireront profits et bénéfices, et la force de résistance aux nouveaux impôts, qui provient des personnes sur lesquelles ils pèseront. On connaît les artifices capables d'accroître la première et de diminuer la seconde. C'est après avoir tenu compte de toutes ces circonstances que l'on décide les nouvelles dépenses et les nouveaux impôts. Il n'y a pas grand mal si l'on recouvre ensuite ces visées d'un vernis de dérivations qui les fasse apparaître comme une conséquence logique de certains sentiments. Au contraire, cela peut être utile, car il est un grand nombre de personnes sur lesquelles n'agissent pas, ou agissent faiblement les intérêts qui poussent à désirer les nouvelles dépenses ou à résister aux nouveaux impôts ; on peut facilement duper ces personnes par de belles dérivations. Les gouvernements n'en manquent jamais ; ils trouvent toujours des théoriciens qui se mettent à leur service pour leur en fournir [FN: § 2273-1] . Mais il faut prendre garde que les dérivations sont les conséquences des visées du gouvernement, non pas celles-ci de celles-là.
§ 2274. Si nous voulons résoudre le problème posé au § 2258, nous devons tout d'abord écarter les dérivations dont nous avons vu quelques exemples ; puis, ayant présente à l'esprit la complexité du phénomène, nous devons en rechercher les parties essentielles. Parmi celles-ci se trouvent certainement les parties dont nous avons déjà tenu compte, c'est-à-dire les effets produits sur la prospérité économique et sociale, ceux de la défense contre des agressions qui pourraient venir de l'étranger, ceux de la sécurité publique, d'une bonne et prompte justice, de certains travaux publics, et d'un grand nombre d'autres fonctions gouvernementales. Mais les effets de la circulation des élites sont tout aussi importants, si ce n'est plus. Il en est de même pour le stimulant ou la dépression qu'éprouve indirectement l'économie nationale, par rapport aux formes de gouvernement. Il faut prendre garde que très souvent les gouvernants visent à certains effets, et en obtiennent indirectement d'autres. Parmi ceux-ci, il en est qui ne sont ni prévus ni voulus. Par exemple, les gouvernements qui instituent la protection douanière, afin de procurer des gains à leur clientèle, obtiennent l'effet, auquel ils n'ont nullement pensé, de favoriser la circulation des élites. Au point de vue éthique, on peut juger une mesure indépendamment des autres phénomènes sociaux. Au point de vue de l'utilité, on ne peut faire cela : il faut voir, dans l'ensemble, comment cette mesure modifie l'équilibre. Une mesure blâmable au point de vue éthique, peut être louable au point de vue de l'utilité sociale ; et vice versa, une mesure louable au point de vue éthique peut être blâmable au point de vue de l'utilité sociale. Mais à ce point de vue, il est bon que la partie intéressée de la population croie, au contraire, qu'il y a identité entre la valeur éthique d'une mesure et son utilité sociale. Il serait long et difficile de faire une étude de cette matière en prêtant attention au moins aux détails principaux. Contentons-nous ici de l'effleurer en nous efforçant d'en acquérir une idée générale. Étant donné l'objet de cette étude, portons notre attention sur certains types de gouvernements que l'histoire nous fait connaître.
I. Gouvernements qui font principalement usage de la force matérielle et de celle des sentiments religieux ou d'autres analogues. Par exemple : les gouvernements des cités grecques à l'époque des « tyrans », de Sparte, de Rome au temps d'Auguste et de Tibère, de la république de Venise dans les derniers siècles de son existence, d'un grand nombre d'états européens au XVIIIe siècle. À ces gouvernements correspond une classe gouvernante chez laquelle les résidus de la IIe classe prédominent sur ceux de la Ire. La circulation des élites est généralement lente. Ce sont des gouvernements peu coûteux, mais qui, d'autre part, ne stimulent pas la production économique, soit parce qu'ils répugnent naturellement aux nouveautés, soit parce qu'ils ne favorisent pas, grâce à la circulation des élites, les personnes qui ont au plus haut degré l'instinct des combinaisons économiques. Si d'ailleurs cet instinct subsiste dans la population, on peut avoir une prospérité économique passable (Rome au temps du Haut-Empire), pourvu que les gouvernements n'y fassent pas obstacle. Mais souvent, à la longue, il y a un obstacle, parce que l'idéal des gouvernements de cette sorte est une nation figée dans ses institutions (Sparte, Rome au temps du Bas-Empire, la Venise décadente). Ces gouvernements peuvent s'enrichir par les conquêtes (Sparte, Rome) ; mais comme de cette façon on ne produit pas de richesse nouvelle, cet enrichissement est nécessairement précaire (Sparte, Rome). En outre, dans le passé, on vit souvent ces régimes dégénérer en gouvernements d'une tourbe armée (prétoriens, janissaires), capables tout au plus de dilapider la richesse.
§ 2275. II. Gouvernements qui font principalement usage de l'artifice et de la ruse. (II-a) Si l'artifice et la ruse sont surtout employés pour agir sur les sentiments, on a certains gouvernements théocratiques, aujourd'hui entièrement disparus de nos contrées, et dont nous pouvons par conséquent négliger de nous occuper. Peut-être les gouvernements des anciens rois en Grèce et en Italie pourraient-ils s'en rapprocher, au moins en partie ; mais leur histoire nous est trop peu connue pour que nous puissions l'affirmer. (II-b) Si l'artifice et la ruse sont surtout employés pour agir sur les intérêts – ce qui d'ailleurs ne veut pas dire qu'on néglige les sentiments – on a des gouvernements comme ceux des démagogues à Athènes, de l'aristocratie romaine à diverses époques de la République, de nombreuses républiques du moyen-âge, et enfin le type très important du gouvernement des « spéculateurs » de notre temps.
§ 2276. Les gouvernements de tout le genre II, même ceux qui agissent sur les sentiments, possèdent une classe gouvernante chez laquelle les résidus de la Ire classe prédominent sur ceux de la IIe. En effet, pour agir efficacement par l'artifice et par la ruse, tant sur les intérêts que sur les sentiments, il faut posséder l'instinct des combinaisons à un haut degré, et ne pas être retenu par trop de scrupules. La circulation des élites est habituellement lente dans le sous-genre (II-a) ; elle est au contraire rapide, et parfois très rapide, dans le sous-genre (II-b) . Dans le gouvernement de nos « spéculateurs », elle atteint un maximum. Les gouvernements du sous-genre (II-a) sont habituellement peu coûteux, mais aussi peu producteurs ; plus que d'autres, ils endorment les populations et ôtent tout stimulant à la production économique. Ne faisant pas un usage important de la force, ils ne peuvent suppléer à cette production par celle des conquêtes ; bien plus, ils deviennent facilement la proie des voisins qui savent user de la force ; par conséquent, ils disparaissent, ou par suite de cette conquête, ou par décadence interne. Les gouvernements du sous-genre (II-b) sont coûteux et souvent très coûteux, mais ils produisent aussi beaucoup et parfois énormément. Il peut donc y avoir un excédent de production sur les dépenses, tel qu'il assure une grande prospérité au pays ; mais il n'est nullement certain que cet excédent, avec l'accroissement des dépenses, ne puisse se réduire à de plus modestes proportions, disparaître, et peut-être aussi se changer en déficit. Cela dépend d'une infinité de conditions et de circonstances. Ces régimes peuvent dégénérer en gouvernements de gens avisés mais sans grande énergie, qui sont facilement abattus par la violence, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est ce qu'on vit pour un grand nombre de gouvernements démocratiques des cités grecques, et ce qui joua un rôle au moins important dans la chute de la République romaine et dans celle de la République de Venise.
§ 2277. En réalité, on trouve des combinaisons de ces différents types. Parfois, tantôt l'un, tantôt l'autre de ceux-ci y prédomine. Les gouvernements chez lesquels existe une proportion notable du type (II-b) , avec une quantité importante du type (I), peuvent durer longtemps en sécurité grâce à la force, et sans que la prospérité économique vienne à diminuer. Le Haut-Empire romain se rapproche de ce type mixte. Ces gouvernements courent le risque de la dégénérescence du type (I), et s'exposent en outre à ce que la proportion qu'ils renferment du type (II-b) se réduise par trop. Les gouvernements chez lesquels existe une notable proportion du type (II-b) , avec une petite quantité du type (I), peuvent durer longtemps parce qu'ils ont une certaine force pour se défendre, tandis qu'ils acquièrent une importante prospérité économique. Ils courent le risque de la dégénérescence de (II-b) , et en outre s'exposent à ce que la proportion qu'ils renferment du type (I) se réduise par trop, ce qui les met presque certainement en danger d'invasion étrangère. Ce phénomène a joué un rôle dans la destruction de Carthage et dans la conquête de la Grèce par les Romains.
§ 2278. Il convient aussi de remarquer qu'un mélange des types. (I) et (II-b) peut exister chez un gouvernement qui fait principalement usage de la force dans ses relations avec l'étranger, et de l'artifice dans ses relations intérieures. De ce genre se rapproche celui du gouvernement de l'aristocratie romaine, aux beaux temps de la République.
§ 2279. PÉRIODES ÉCONOMIQUES. Les mouvements rythmiques d'un groupe d'éléments se répercutent sur les mouvements des autres éléments, de manière à produire le mouvement que l'on observe pour l'ensemble des groupes. Parmi ces actions et réactions, il en est de remarquables : celles qui se produisent entre le groupe des éléments économiques et les autres groupes.
§ 2280. On peut juger de l'état économique d'un pays d'une manière qualitative, d'après l'opinion exprimée par les auteurs au sujet de l'enrichissement ou de l'appauvrissement du pays. Ce moyen, à la vérité très imparfait, est le seul qui soit à notre disposition pour le passé. Nous voyons Athènes s'enrichir après les guerres médiques, s'appauvrir après le désastre de Sicile ; Sparte s'enrichir lorsqu'elle avait l'hégémonie en Grèce, s'appauvrir après la bataille de Leuctres. Pour Rome, les phénomènes ondulatoires sont aussi très accusés. Nous les voyons se produire depuis la Rome antique, quasi légendaire, jusqu'à la Rome du moyen-âge. En des temps plus rapprochés des nôtres, les phénomènes deviennent plus généraux, c'est-à-dire que les ondulations ont une tendance à être les mêmes pour plusieurs pays en même temps. Cela résulte de la solidarité économique de ces pays.
§ 2281. Là où existent des statistiques des phénomènes économiques, fussent-elles imparfaites, on trouve un moyen de substituer des évaluations quantitatives aux évaluations qualitatives. Cette substitution est toujours avantageuse, même si la méthode suivie est imparfaite, ne serait-ce que parce qu'elle ouvre la voie d'un perfectionnement continuel, grâce à de meilleures statistiques et par leur emploi plus judicieux.
§ 2282. Le problème des rapports entre le mouvement de la population et les conditions économiques induisit les économistes à rechercher quels étaient au moins les indices de ces conditions. Pour les pays principalement agricoles, l'abondance des récoltes peut être prise comme indice ; mais la quantité des récoltes n'est pas connue directement, dans les temps passés, et l'on chercha un autre indice dans le prix du blé, qui est le principal aliment de nos peuples. Le prof. Marshall accepte cet indice pour l'Angleterre, jusque vers le milieu du XIXe siècle, quand ce pays devint principalement industriel. Ensuite, on chercha les indices dans le mouvement du commerce international et dans les sommes compensées au Clearing House. À propos des crises économiques, Clément Juglar remarqua que plusieurs autres indices concordent. C'est précisément cette concordance qui fait mieux voir le cours général du mouvement économique. On a cherché diverses combinaisons d'indices économiques, afin d'avoir une idée du cours économique général d'un pays ; mais jusqu'à présent on a peu ou rien obtenu de cette manière [FN: § 2282-1] . La difficulté principale provient de la manière de combiner les indices, et, si on les additionne, des coefficients que l'on doit assigner à chacun d'eux. On ne peut leur assigner à tous également le coefficient un, parce que l'on compenserait ainsi l'augmentation d'un phénomène économique très important par la diminution d'un phénomène économique insignifiant. Il faut un coefficient qui ait au moins un rapport lointain avec l' « importance » du phénomène. Non seulement il est très difficile à trouver, mais encore on ne sait même pas précisément ce qu'est cette « importance » ; bien plus, à vrai dire, ces indices sont aussi nombreux que les buts auxquels on tend. Par exemple, il semblerait naturel d'assigner comme « importance » aux titres de crédit leur valeur effective. Supposons qu'il s'agisse de 100 millions en titres de dettes publiques et de 100 millions en actions de sociétés industrielles. Les valeurs étant égales, nous assignerons un indice égal aux uns et aux autres. Par conséquent, si les titres de dette publique acquièrent la valeur de 110 millions, et que les actions industrielles descendent à 90 millions, il y aura compensation parfaite. Cela va bien, si nous recherchons l'effet produit sur l'ensemble du capital en dette publique et en actions ; cela ne va plus si nous voulons étudier le mouvement économique. On sait que souvent, dans les temps de dépression économique, les titres de dette publique renchérissent et que les actions industrielles baissent de prix. C'est pourquoi, au lieu de compenser les 10 millions d'augmentation des titres de la dette publique par les 10 millions de diminution des actions industrielles, on se rapprocherait davantage de la réalité, mais on en serait toujours éloigné, si l'on changeait le signe de la diminution, si on l'additionnait à l'augmentation, et si l'on considérait la somme de 20 millions comme un indice du changement de l'état économique. Les nombreux indices, additionnés avec différents coefficients, donnent donc souvent une précision trompeuse [FN: § 2282-2] , et tant que la science n'a pas progressé, et de beaucoup, il convient de s'en tenir à de simples indices généraux, comme seraient, en Angleterre, les sommes compensées au Clearing House, ou à d'autres indices analogues. Les variations du nombre des individus d'une population sont généralement petites. On peut donc les négliger en présence de variations économiques considérables, comme seraient, dans un court espace de temps, les variations des sommes compensées au Clearing House, ou les variations du commerce international. Mais il y a un motif de prime importance pour considérer directement le total du commerce international, et non ce total divisé par le nombre des individus qui constituent la population. En effet, nous recherchons un indice de la prospérité économique du pays ; et il est évident que si chaque individu continue à faire les mêmes recettes, à fournir la même production économique, la prospérité économique croît si la population croît, elle diminue si la population diminue. Supposons qu'en Angleterre la somme du commerce international et celle des compensations au Clearing House demeurent constantes pour chaque habitant, et que la population diminue de moitié : on devra admettre que la prospérité économique a diminué. Autrement, on arriverait à un résultat absurde. En effet, supposons que, dans toute l'Angleterre, il reste un seul homme. Grâce au commerce des peaux d'animaux sauvages, alors prospère dans l'île, cet homme obtient une somme égale à celle que l'on a aujourd'hui par habitant : la prospérité économique de l'Angleterre n'aurait pas diminué, ce qui est absurde. Vice-versa, si la production demeure constante, ainsi que le commerce par habitant, une augmentation de population est une augmentation de prospérité économique pour le pays [FN: § 2282-3].
§ 2283. L'affluence des métaux monétaires est très importante pour les variations des conditions économiques dans un pays, comme aussi, de nos jours, la production de l'or, car tous les pays civilisés ont entre eux des communications commerciales très intenses. L'or lui-même est devenu la monnaie, internationale. Sans vouloir donner trop de rigueur à la théorie quantitative de la monnaie, car le phénomène subit de nombreuses perturbations, il est certain qu'une augmentation considérable dans l'affluence des métaux monétaires agit puissamment sur les prix. Le fait s'est vérifié dans un trop grand nombre de cas, depuis les temps anciens jusqu'aux nôtres, pour qu'on puisse l'expliquer comme une simple coïncidence fortuite. Il est au plus haut point un rapport de cause à effet, sans que nous voulions exclure les réactions que les prix peuvent avoir sur l'affluence des métaux monétaires et sur leur production. De nos jours, les différentes façons dont les opérations financières et commerciales sont compensées agissent aussi beaucoup sur les prix, sans qu'il soit besoin de recourir à la monnaie métallique. Mais il faut prendre garde que de cette façon on rend plus sensibles les effets de l'augmentation d'une quantité d'or déterminée, car elle devient une fraction plus considérable de l'or qui demeure en circulation.
L'émission de papier-monnaie, ce que l'on a nommé l'inflation, a, sur les phénomènes sociaux, certains effets analogues à ceux de l'abondance des métaux précieux.
§ 2284. Des études nombreuses et remarquables ont été faites, non seulement sur la théorie de la production des métaux précieux et les variations concomitantes des prix, mais aussi sur certaines conséquences sociales de ces phénomènes. Les auteurs portèrent principalement leur attention sur les changements que les variations des prix produisaient dans les conditions des créanciers et des débiteurs, et par conséquent aussi dans les conditions des classes riches et des classes pauvres. Comme ces variations de prix eurent lieu souvent dans le sens d'une hausse, ce cas fut le mieux étudié. D'autres phénomènes, d'importance égale, et parfois plus grande, furent au contraire négligés, entre autres la variation dans l'intensité de la circulation des élites et ses conséquences politiques. En outre, on trouve là presque toujours l'erreur habituelle consistant à substituer des rapports de cause à effet aux rapports de mutuelle dépendance. L'affluence des métaux monétaires, ou, d'une façon générale, la production des métaux précieux, les variations de prix qui en sont la conséquence, les organisations concomitantes des systèmes monétaires, sont toutes des phénomènes qui font partie de la catégorie (b) du § 2205, c'est-à-dire de la catégorie des intérêts ; nous devons les considérer comme faisant partie des cycles étudiés aux § 2206 et sv.
§ 2285. Il faut faire attention que c'est surtout l'ensemble de la catégorie (b) qui agit sur les cycles, et que les phénomènes rappelés tout-à-l'heure, dépendant de l'affluence des métaux précieux, ne constituent qu'une partie de cet ensemble. C'est pourquoi les conséquences de ces phénomènes peuvent être partiellement annulées par les conséquences en sens contraire d'autres phénomènes ; ou bien, d'une manière analogue, elles peuvent croître en intensité.
§ 2286. Dans les temps passés et dans les temps modernes, on observe de nombreuses coïncidences entre l'abondance monétaire et la prospérité économique et politique d'un pays, mais souvent sans qu'on puisse bien discerner où est la cause et où est l'effet ; et ce serait une grave erreur d'admettre que l'affluence des métaux monétaires a pour conséquence nécessaire la prospérité d'un pays. Athènes fut prospère quand elle recevait les tributs de ses alliés, et quand elle retirait une grande quantité d'argent des mines du Laurium. D'une part, si les tributs des alliés étaient une cause de prospérité, ils en étaient aussi un effet, puisqu'ils étaient imposés par la puissance athénienne. D'autre part, l'argent des mines était une cause prédominante, mais il était aussi partiellement un effet, puisque si le peuple athénien avait été pauvre et faible, il n'aurait pas eu les esclaves et d'autres capitaux nécessaires à l'exploitation des mines. Le temps de la plus grande prospérité de Rome antique était celui où les conquêtes y faisaient affluer l'or, l'argent, le cuivre des peuples vaincus en Asie, en Afrique, en Europe. Dans ce cas, l'affluence des métaux monétaires est un effet prédominant des conquêtes. Les peuples modernes sont obligés de faire des dépenses énormes pour les armements ; elles n'étaient pas nécessaires aux peuples antiques. Par conséquent, si la richesse monétaire de Rome peut avoir été directement de quelque utilité aux conquêtes, elle ne fut certainement pas la cause principale des victoires du peuple romain. La combinaison (I) du § 2206 était donc alors d'une importance beaucoup plus grande que la combinaison (II), tandis qu'il ne peut y avoir une telle différence pour les peuples modernes. La combinaison (III), comme d'habitude, était de peu d'importance. Quant à la combinaison (IV), elle agissait en sens contraire de la combinaison (I), de manière à renforcer, ou même seulement à entretenir les résidus de la Ire classe. Ce fut l'une des causes de la décadence de l'Empire (§ 2550 et sv.).
§ 2287. Il est un cas différent du précédent : c'est celui où l'affluence des métaux précieux provient, non pas de la conquête ou de quelque autre semblable événement indépendant de la prospérité économique, mais où elle est une conséquence partielle de cette prospérité même, laquelle permet au peuple qui en jouit de se procurer ces métaux. Le fait fut manifeste pour plusieurs communes et républiques du moyen-âge, chez lesquelles nous trouvons à la fois bonne monnaie et prospérité économique, unies dans une dépendance mutuelle.
§ 2288. Sauf précisément ces exceptions, le moyen-âge est une époque de misère matérielle et intellectuelle ; c'est aussi une époque de misère monétaire. On ne peut pas dire que celle-ci fût la cause de celle-là, mais il serait téméraire d'affirmer qu'elle y était étrangère, car la dépendance est mise en lumière par les phénomènes de la période suivante.
§ 2289. La découverte de l'Amérique est l'un de ces nombreux événements imprévus et impossibles à prévoir, qui provoquent tout d'un coup de grands changements dans la catégorie (b) . Les découvertes de la technique industrielle, au XIXe siècle, sont un autre de ces événements; mais ils étaient un effet de la prospérité, dans une mesure beaucoup plus grande que la découverte de l'Amérique, qui eut lieu grâce à des moyens peu nombreux et misérables. Dès la fin du XVe siècle, lorsque l'Amérique fut découverte, jusque vers le milieu du XVIIe siècle, deux périodes très remarquables coïncident en Europe. On a une période de prospérité économique, intellectuelle, politique, et une période de grande abondance monétaire et d'augmentations extraordinaires des prix. Les phénomènes des deux périodes apparaissent ici beaucoup plus mutuellement dépendants que dans les cas de Rome (§ 2286) et du moyen-âge (§ 2288). En effet, si le premier mouvement provenait d'un cas fortuit, c'est-à-dire de la découverte de l'Amérique, ce mouvement continua et crût en intensité, parce que les conditions de l'Europe devinrent toujours plus favorables à la production de la richesse. La cause en fut principalement la prédominance acquise peu à peu par les résidus de la Ire classe et les buts vers lesquels étaient tournés les sentiments correspondants, les hommes se vouant alors aux arts et aux sciences, de préférence à la théologie et à la magie. Le premier mouvement partit donc de la combinaison (I), mais il fut suivi de la combinaison (II), et il serait difficile d'affirmer laquelle de ces deux combinaisons était, dans l'ensemble, la plus importante. La combinaison (IV) semble être d'une importance égale ; elle agit dans le même sens que les deux premières, ce qui arrive aussi pour la combinaison (III), laquelle, d'ailleurs, bien que notable, a peu d'influence sur les événements.
§ 2290. Depuis le milieu du XVIe siècle jusque vers l'an 1720, avec une grossière approximation, nous avons une période de calme pour la prospérité économique, et une période dans laquelle la production des métaux précieux ne varie pas beaucoup. Mais après 1720 et jusque vers 1810, toujours d'une manière grossièrement approchée, on a une période de rapide augmentation de la production des métaux précieux, et une période de prospérité économique, qui se manifeste principalement en Angleterre, tandis que, sur le continent, elle est troublée par les guerres de la révolution française. Celle-ci apparaît tout à fait comme un phénomène de la combinaison (IV), c'est-à-dire un phénomène dépendant de la circulation des élites. Après 1810, nous sommes aidés par des statistiques, d'abord peu parfaites, puis toujours meilleures; aussi pouvons-nous donner un peu plus de précision à notre exposé.
§ 2291. Il faut comprendre la description que nous avons faite jusqu'ici des phénomènes, comme étant analogue à celle que l'on fait lorsque, sur une carte géographique, on représente une chaîne de montagnes par une ligne. En réalité, il n'y a pas de ligne appelée Apennins, qui divise en deux l'Italie, ni une ligne appelée Alpes, qui l'entoure ; cependant cette image générale et grossière de la péninsule est commode.
§ 2292. Aujourd'hui, nous nous rapprochons bien davantage du phénomène réel, grâce à l'emploi des statistiques. Pourtant, nous devons demeurer toujours dans les considérations générales, et rechercher des images d'ensemble qui négligent les détails. Nous avons déjà indiqué (§ 1718) la manière d'étudier ces phénomènes d'une façon générale. Maintenant, il nous reste à examiner cette manière dans le cas particulier dont nous nous occupons [FN: § 2292-1] .
§ 2293. Prenons comme exemple le mouvement commercial de la France avec l'étranger. Dans l'appendice II, on trouvera les tableaux numériques de cette statistique et d'autres encore. Continuons ici à exposer les conclusions [FN: § 2293-1] . Si l'on dessine un diagramme sur ces données, et si l'on observe attentivement la courbe ainsi obtenue, on voit surtout trois genres de variations : 1° Variations accidentelles ; 2° Variations à courte période ; 3° Variations à longue période.
1° Variations accidentelles. – Elles n'interrompent pas pour longtemps la direction générale de la courbe, qui aussitôt reprend comme avant. Un exemple remarquable est celui de 1848 ; plus remarquable encore celui de 1870. Les forces qui déterminent l'équilibre dynamique demeurant en action, si une force accidentelle vient à le troubler, aussitôt que cette force disparaît, l'équilibre se rétablit (§ 2268), et le processus reprend son cours.
2° Variations à courte période. – Souvent déjà ces variations ont été aperçues, et en partie étudiées sous le nom de crises. Un exemple remarquable est celui de 1881. On a une partie ascendante, le long de laquelle on remarque des variations accidentelles, et une partie descendante semblable. Il est caractéristique que l'on ne passe pas peu à peu de la partie ascendante à la partie descendante, mais qu'on y passe brusquement. Une augmentation insolite de prospérité présage souvent une chute prochaine.
3° Variations à longue période. – Elles n'ont pas été étudiées jusqu'à présent, cela en grande partie parce qu'on n'avait pas encore les données statistiques nécessaires.
Si l'on regarde dans l'ensemble la courbe du mouvement commercial, en s'efforçant de faire abstraction des variations précédentes, on voit aussitôt qu'elle n'a pas une allure uniforme. À des périodes de rapide augmentation font suite des périodes de lente augmentation, ou de dépression, suivies de nouveau de périodes d'augmentation plus ou moins rapide. Par exemple, de 1852 à 1873, il y a une période de rapide augmentation, interrompue par la guerre de 1870-1871, et suivie d'une période de légère augmentation, ou de dépression, de 1873 à 1897. Arrive de nouveau une période de rapide augmentation, de 1898 à 1911. On observe aussi dans le passé de semblables périodes, mais en de beaucoup moindres proportions. Par exemple de 1806 à 1810, il y a déclin. Puis, de 1816 à 1824 vient une période de dépression; ensuite une période d'augmentation, de 1832 à 1846.
Cette manière de considérer les phénomènes est d'ailleurs un peu grossière ; il faut que nous trouvions moyen d'obtenir une plus grande précision. On y arrivera en interpolant la courbe obtenue, c'est-à-dire en cherchant autour de quelle ligne elle oscille. Les résultats de ces calculs se trouveront dans l'appendice II.
§ 2294. Si nous faisons des diagrammes analogues au précédent, pour l'Angleterre, pour l'Italie, pour la Belgique, nous voyons que les conclusions sont semblables. Dans tous ces pays, on peut distinguer trois variations à période longue, lesquelles vont à peu près de 1854 à 1872, de 1873 à 1896, de 1898 à 1912. La considération du phénomène de l'émigration en Italie, des sommes compensées au Clearing House de Londres, du produit des théâtres de Paris, confirment ces déductions [FN: § 1194-1] . Il est donc évident que nous avons à faire à un phénomène de nature très générale.
§ 2295. On sait assez qu'après 1870 la production de l'argent devint si grande que ce métal ne put continuer à être employé comme vraie monnaie, et finit, dans les pays civilisés, par être employé uniquement comme monnaie fiduciaire. C'est pourquoi, tandis que jusqu'au XIXe siècle nous avons considéré la production globale de l'or et de l'argent, depuis le XIXe siècle, nous devons considérer la production de l'or, laquelle finit peu à peu par être l'unique source de la vraie monnaie.
§ 2996. La moyenne annuelle de la production de l'or, qui était seulement de 189 millions de francs dans la décade de 1841 à 1850, devient de 687 millions entre 1851 et 1855, et se maintient à peu près à cette somme, jusqu'à la fin de la période de 1866 à 1870. Par conséquent, nous avons une certaine correspondance entre la période de prospérité économique de 1854-1872, et une période de grande production aurifère. Dans la période de 1871-1875, la production annuelle moyenne de l'or atteint 599 millions de francs. Après 1875, nous avons la statistique des productions annuelles séparées. Il y a une période de productions décroissantes ou constantes qui finit en 1891 à peu près. Cette période aussi correspond assez bien à celle de calme économique, entre 1873 et 1876. Enfin, de 1892, où la production de l'or est de 750 millions de francs, jusqu'en 1912, où elle est de 2420 millions de francs, on a une période de rapide et grande augmentation de la production aurifère. Cette période correspond à peu près à celle de 1898-1912, de grande prospérité économique.
§ 2297. Nous répétons que les rapports trouvés tout à l'heure ne doivent pas être interprétés en ce sens que l'augmentation de la production de l'or serait la cause de la prospérité économique. Certainement, cette augmentation a eu une influence en ce sens par ses effets sur les prix, et plus encore sur la circulation des élites ; mais sans aucun doute, elle a été aussi un effet de cette prospérité. Aujourd'hui, la majeure partie de l'or n'est plus extrait des alluvions, comme c'était le cas au début, en Californie et en Australie. On l'extrait de mines, où il faut des travaux souterrains très coûteux, et des machines très chères. C'est pourquoi la production de l'or n'est aujourd'hui possible que moyennant des capitaux immenses. Par ce fait, elle dépend de la prospérité économique elle-même, laquelle devient de la sorte une cause, après avoir été un effet. On remarquera aussi que la production de l'or fait augmenter les prix, mais que ceux-ci, à leur tour, réagissent sur cette production, en faisant croître le coût de l'extraction. Il existe actuellement un grand nombre de mines à minerai pauvre, qui ne peuvent être exploitées avec les prix actuels de la main-d'œuvre et des installations. Elles pourraient être exploitées, sitôt que ces prix diminueraient, même d'une petite quantité. Cela pourra se produire au fur et à mesure que l'on exploitera le minerai riche.
§ 2298. Ces rapports appartiennent à la catégorie économique désignée par (b) au § 2205. Ils nous font voir comment cet ensemble (b) se constitue de ses différentes parties ; mais nous ne devons pas nous arrêter sur ce point : il faut examiner les actions et les réactions entre cette catégorie et les autres. Nous l'avons déjà fait, sans tenir compte des ondulations, dans le cas particulier de la protection douanière. Nous sommes partis de là pour traiter de la protection économique, et aussi, plus généralement, des cycles d'actions et de réactions entre les différentes catégories d'éléments (§ 2208 et sv.). Ce que nous avons dit alors pourra, avec des adjonctions et des modifications légères, nous faire connaître le phénomène, même dans le cas des ondulations.
§ 2299. Occupons-nous maintenant de l'état économique et social des peuples civilisés, depuis le début du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Les combinaisons (§ 2206) les plus importantes sont la combinaison (II) et la combinaison (IV). Fixant d'abord notre attention sur la partie vraiment la plus importante du phénomène, nous pouvons même considérer, dans une première approximation, un cycle restreint dans lequel les intérêts (b) agissent sur la circulation des élites (d) et, en retour, celle-ci sur ceux-là. Il serait difficile peut-être impossible, de séparer les deux parties du cycle, qu'il convient par conséquent de considérer dans son ensemble.
§ 2300. Si l'on voulait indiquer en peu de mots les différences qui existent entre l'état social (M) avant la révolution française, et l'état actuel (N), on devrait dire qu'elles consistent principalement en une prédominance des intérêts économiques et en une beaucoup plus grande intensité de la circulation des élites [FN: § 2300-1] . Désormais, la politique étrangère des États est presque exclusivement économique (§ 2328), et la politique intérieure se réduit aux conflits économiques. D'autre part, sauf un petit nombre de restrictions, en Allemagne et en Autriche, non seulement tous les obstacles à la circulation des élites ont disparu, mais encore celle-ci est devenue effectivement intense, grâce à l'appui de la prospérité économique. Aujourd'hui, presque tous ceux qui possèdent à un haut degré les résidus de la Ire classe, (instinct des combinaisons), et qui savent faire preuve d'aptitudes dans les arts, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans le commerce, dans la constitution d'entreprises financières, honnêtes ou malhonnêtes, dans la duperie des bons producteurs d'épargne, dans l'habileté à obtenir l'autorisation d'exploiter les citoyens les moins habiles, grâce à la politique, aux protections douanières ou autres, aux faveurs de tout genre, ceux-là sont certains, à moins d'une étrange malchance, non seulement de s'enrichir, mais aussi d'obtenir honneurs et pouvoir, en somme de faire partie de la classe gouvernante. Toujours sauf des exceptions, telles, en partie, que les faits qui s'observent en Allemagne, les chefs de cette classe sont les hommes qui savent le mieux servir les intérêts économiques de la classe gouvernante. Parfois, ils se font payer directement en argent, parfois indirectement par l'argent que retirent les personnes de leur famille ou leurs amis ; parfois, ils se contentent du pouvoir et des honneurs que confère ce pouvoir, abandonnant l'argent à leurs troupes. Cette dernière catégorie de personnes est beaucoup plus recherchée que les autres, pour gouverner le pays. En effet, ces personnes échappent aux critiques de l'opposition, qui, afin d'être entendue du bon peuple, doit faire usage du langage des dérivations, et qui se tient aux aguets pour découvrir quelque accusation venimeuse d'« immoralité » à lancer contre ses adversaires. Grâce à cet art, un politicien qui s'approprie quelques milliers de francs avec trop de désinvolture est mis à pied, si le secours de ceux auxquels il est utile n'est pas efficace ; tandis que le politicien qui ne prend rien pour lui-même, mais qui fait cadeau, aux frais du public, de plusieurs millions, et même de plusieurs centaines de millions de francs à ses troupes, celui-là conserve le pouvoir et gagne en bonne réputation et en honneurs (§ 2268).
§ 2301. La circulation des élites d'aujourd'hui fait donc entrer dans la classe gouvernante un grand nombre de personnes qui détruisent la richesse, mais elle y en fait entrer un plus grand nombre encore qui la produisent. Nous avons là une preuve très certaine que l'action de ces dernières l'emporte sur celle des premières, puisque la prospérité économique des peuples civilisés s'est énormément accrue. En France, après 1854, au temps de la fièvre des constructions de chemins de fer, plusieurs financiers peu honnêtes, plusieurs politiciens, se sont enrichis et ont détruit de grandes sommes de richesse; mais des sommes incomparablement plus grandes de richesses ont été produites par les chemins de fer, et le résultat final de l'opération a été une grande augmentation de prospérité pour le pays. Nous n'avons pas à rechercher ici si on pouvait l'obtenir également en épargnant les dépenses que coûtèrent les parasites financiers, politiques et autres ; nous traitons de mouvements réels, non de mouvements virtuels ; nous décrivons ce qui a eu lieu et ce qui a lieu, nous ne voulons pas aller plus loin. Le lecteur voudra bien se souvenir de cette observation dans toute la suite de cet ouvrage.
§ 2302. Dans les périodes où la prospérité économique croît rapidement (§ 2294), il est beaucoup plus facile de gouverner que lorsqu'elle est stagnante. On peut constater ce fait d'une manière empirique, en comparant les états politiques et sociaux des périodes économiques indiquées au § 2293. On peut dire qu'en France, les succès du second Empire coïncident avec la période de prospérité économique qui commence en 1854. Plus tard, surgissent des difficultés, et peut-être, même sans la guerre de 1870, l'Empire aurait-il couru de très graves dangers dans la période 1873-1896. Ces dangers ne manquèrent pas aux gouvernements de cette période, non seulement en France, mais ailleurs aussi. Un peu partout en Europe, c'est le temps héroïque du socialisme et de l'anarchie. Bismarck lui-même, pourtant si puissant, a besoin, pour gouverner, des lois exceptionnelles contre les socialistes. En Italie, cette période aboutit à la révolte de 1898, domptée uniquement par la force. Ensuite, de nouveau, de 1898 jusqu'à présent, revient un temps de gouvernement facile, ou, si l'on veut, pas trop difficile ; il aboutit, en Italie, en 1912, à la dégénérescence des partis d'opposition et à la facile dictature de Giolitti ; tandis qu'en Allemagne, les socialistes – que les temps ont changé ! – approuvent au Reichstag les nouvelles et très grosses dépenses en faveur des armements, et qu'en Angleterre, les pacifistes successeurs des Fenians de la période 1873-1898 obtiennent facilement le Home Rule.
Que l'on compare, en Italie, l'effet de la guerre d'Abyssinie, intervenue dans la période 1873-1898, et celui de la guerre de Libye, intervenue dans la période 1898-1912 (§ 2255). Pour le moment, nous ne recherchons pas de causes et d'effets, ni de rapports de mutuelle dépendance : nous notons seulement des coïncidences, lesquelles pourraient être fortuites. Quelles qu'en aient été les causes, il est certain, très certain, que la population italienne accueillit d'une façon bien différente la guerre d'Abyssinie et celle de Libye. Contre la première, les partis dits « subversifs » s'insurgèrent avec une extrême énergie, tandis qu'ils acceptèrent la seconde, consentants ou résignés. Il fallut qu'il s'en passât de belles et de bonnes, pour que, du socialisme jusqu'alors existant, il se détachât un parti dit des « socialistes officiels », lequel, manquant à la vérité de chefs jouissant d'autorité, condamna la guerre de Libye. Que l'on compare, en France, l'opposition aux entreprises coloniales, au temps de Jules Ferry (période 1873-1898), au consentement ou à la résignation avec laquelle fut accueillie l'entreprise du Maroc (période 1898-1912), bien autrement coûteuse et dangereuse. Assurément, le contraste entre ces deux périodes n'est pas très différent de celui que nous avons trouvé dans la comparaison analogue faite tout à l'heure pour l'Italie. Que l'on compare encore l'émotion de la population française, quand on découvrit les détournements des politiciens au préjudice de l'entreprise du Panama, avec le calme et l'indifférence qui accueillirent les détournements, sans doute non moins malhonnêtes ni de moindre importance, grâce auxquels on fit disparaître la plus grande partie du célèbre milliard des congrégations. Dans le second cas, il semblait vraiment que, songeant aux pirates, beaucoup de gens se disaient en eux-mêmes : « Pauvres diables, il est vrai qu'ils ont fait de beaux bénéfices ; mais après tout, il y en a pour tout le monde : pour eux et pour nous ». Une telle indulgence n'est guère possible que si le gâteau est assez grand pour qu'en outre des grosses tranches que se taillent les principaux politiciens, les politiciens secondaires en obtiennent d'autres plus petites, et que beaucoup de gens en aient au moins une miette. On ne saurait croire combien le fait de n'avoir rien à ronger allume le zèle des politiciens et les pousse à une défense féroce de la morale, de l'honnêteté et de tant d'autres belles choses. Que l'on compare encore les furieuses luttes de l'affaire Dreyfus, auxquelles on peut attribuer l'effet d'une grande révolution, avec les conflits politico-sociaux beaucoup plus pacifiques de la période 1898-1912, et l'on devra bien reconnaître qu'il y a quelque chose de changé dans les conditions de la société politique.
§ 2303. Il serait facile de citer un grand nombre d'autres faits semblables dans le présent ; il ne serait pas difficile d'en trouver d'analogues dans le passé. C'est une remarque banale qu'alors les mauvaises récoltes et les famines provoquaient la mauvaise humeur des sujets, et les poussaient facilement à la révolte. Dans des temps plus proches des nôtres, de mauvaises récoltes et des famines ne furent pas non plus étrangères au développement de la révolution française. Il est impossible d'admettre que tant de coïncidences soient fortuites. Il est évident qu'il doit y avoir quelque rapport entre les phénomènes dont on remarque ainsi la coïncidence. Cette conclusion sera confirmée par l'analyse, laquelle nous fera connaître la nature de ce rapport.
§ 2304. Elle peut évidemment varier, lorsque varient les conditions sociales. Les famines poussaient les peuples à la révolte, comme la faim fait sortir le loup du bois ; mais le rapport entre les conditions économiques et l'humeur de la population est bien autrement compliqué chez les peuples économiquement très développés, comme le sont les peuples modernes.
§ 2305. Pour ceux-ci, comme nous l'avons déjà dit (§ 2299), il faut que nous considérions principalement le cycle restreint dans lequel (b) agit sur (d) , et vice versa. En un mot, on peut dire que, pour se maintenir en place, les gouvernements modernes emploient toujours moins la force et toujours plus un art très coûteux, et qu'ils ont grandement besoin que la prospérité économique seconde leur action ; qu'en outre, ils ressentent beaucoup plus les variations de cette prospérité. Sans doute, même les gouvernements qui usaient surtout de la force étaient en danger, lorsque la misère se faisait cruellement sentir, parce qu'alors à leur force s'en opposait une autre plus grande, produite par le désespoir. Mais ils pouvaient demeurer en sécurité, tant que les conditions économiques changées n'avaient pas atteint cette limite ; tandis qu'au contraire, tout changement de ces conditions, souvent même peu important, se répercute sur l'organisation, bien autrement compliquée et changeante, des gouvernements qui s'en remettent surtout à l'art coûteux des mesures économiques. Pour pousser les sujets à la révolte, il fallait des souffrances économiques bien plus grandes que celles qui se traduisent par des élections contraires au gouvernement. On comprend donc facilement que les périodes économiques mentionnées au § 2293, lesquelles n'atteignirent pas la limite de la misère, correspondent, sous des gouvernements différents, à des conditions différentes. Sous des gouvernements qui s'en remettent surtout à la force, elles produisent beaucoup moins de changements sociaux et politiques que sous des gouvernements qui recourent largement à l'art des combinaisons économiques.
§ 2306. Précisément pour pouvoir mettre en œuvre les combinaisons qui leur sont indispensables, les gouvernements modernes sont entraînés à dépenser, en un temps donné, plus que ne comporteraient leurs recettes. Ils comblent la différence en faisant de nouvelles dettes, avouées ou dissimulées [FN: § 2306-1], qui leur permettent d'effectuer tuer immédiatement des dépenses, – dont ils rejettent le poids sur l'avenir. Cet avenir s'éloigne d'autant plus que la prospérité économique croît plus rapidement; car, grâce à elle, le produit des impôts existants s'accroît, sans nouvelles aggravations, et les bonis des budgets futurs de l'État peuvent, au moins en partie, servir à payer les déficits des budgets passés. Nos gouvernements se sont peu à peu accoutumés à cet état de choses, pour eux si commode et si agréable. Désormais ils escomptent régulièrement les augmentations des budgets futurs pour compenser les dépenses présentes. Le fait se produit dans un grand nombre de pays, grâce à différents procédés, parmi lesquels il faut noter celui des budgets spéciaux ou extraordinaires, que l'on institue parallèlement au budget général ou ordinaire ; celui qui consiste à faire figurer le montant de nouvelles dettes aux recettes de l'État, ou à constituer débitrices certaines administrations de l'État, pour des sommes qu'elles ont dépensées, et d'inscrire ces sommes au crédit de l'État, qui se trouve être en même temps créancier et débiteur. De la sorte, on porte à l'actif les dépenses qui devraient figurer au passif. Ensuite, lorsque par ces artifices ou d'autres semblables on a changé un déficit réel en un boni fictif, on charge des journalistes bien payés de proclamer aux gens la bonne nouvelle des finances prospères ; et si quelqu'un émet quelque doute sur ces jeux de comptabilité, on l'accuse de « discréditer le pays ».
§ 2307. Cette façon d'agir ne provoque pas de graves difficultés dans les périodes de rapide augmentation de prospérité économique : l'augmentation naturelle des recettes [FN: § 2307-1] du budget couvre les supercheries du passé, et l'on remet à l'avenir le soin d'amender celles du présent. Mais les difficultés surgissent dans les périodes de calme ; elles deviendraient bien plus grandes s'il se produisait une période un peu longue de régression économique. L'organisation sociale actuelle est telle que peut-être aucun gouvernement ne pourrait surmonter un tel danger, et qu'il se produirait de terribles catastrophes, d'une intensité bien plus grande que celles dont nous parle l'histoire. Même la stagnation économique peut n'être pas exempte de dangers.
§ 2308. Mais négligeons ces éventualités hypothétiques ; traitons uniquement des mouvements réels, et voyons maintenant l'un des motifs des coïncidences relevées au § 2302. Ce motif est que, dans les périodes de stagnation économique, le gouvernement doit demander aux gouvernés de plus grands sacrifices, tandis que diminuent les bénéfices qu'il pouvait leur procurer, ainsi qu'à ses partisans. En effet, d'un côté, il doit payer les dépenses du passé, pour lesquelles il avait escompté les augmentations de recettes qui présentement font défaut ; d'un autre côté, si la période de stagnation se prolonge, il devient toujours plus malaisé de faire des dépenses en comptant sur l'avenir pour les payer.
§ 2309. Supposons la circulation économique et la circulation des élites stagnantes. Les gens qui possèdent à un haut degré l'art des combinaisons économico-politiques, sur lesquelles s'appuient nos gouvernements, ne trouvent plus alors leur récompense, ni comme conséquence naturelle des institutions existantes, ni artificiellement par l'intervention directe du gouvernement.
Il est difficile à celui-ci d'amadouer l'adversaire, parce qu'il devient difficile de trouver quelque chose à lui offrir. Si même on trouve suffisamment pour les chefs, les partisans qui demeurent ventre vide s'agitent et refusent de les suivre. Par exemple, les diverses conditions du budget empêchaient Crispi, et permettaient à Giolitti, de subventionner largement les coopératives et d'autres associations socialistes, ainsi que les trusts industriels et financiers. C'est certainement une cause, petite ou grande, de la diversité des phénomènes relevés au § 2302. Lorsqu'en 1913 on eut un commencement de stagnation économique en Italie, les partisans militants du socialisme refusèrent de suivre leurs chefs déjà apprivoisés, et en suivirent d'autres, qui se présentèrent aux élections avec un programme nettement opposé à la guerre de Libye et à l'augmentation des dépenses militaires. Les chefs avaient oublié que chez le peuple persistait l'idéalisme qu'eux-mêmes avaient perdu, soit spontanément, soit grâce aux faveurs du gouvernement. À cet idéalisme populaire, le gouvernement ne pouvait s'opposer en excitant, par de grosses dépenses, les intérêts populaires. C'est pourquoi l'opposition au gouvernement et aux chefs qui s'étaient mis dans sa dépendance s'accrut et se fortifia.
§ 2310. Maintenant nous sommes en mesure de poursuivre les études commencées au § 2231 et sv. Les périodes de rapide augmentation de la prospérité économique sont favorables aux « spéculateurs », qui s'enrichissent et pénètrent dans la classe gouvernante, s'ils n'en font pas encore partie. Ces périodes sont défavorables aux « rentiers » à rente presque fixe. Ceux-ci déclinent, soit à cause de l'augmentation naturelle des prix, soit parce qu'ils ne peuvent faire face à la concurrence des spéculateurs, pour se concilier les faveurs du public et des politiciens. Des effets inverses se produisent dans les périodes de stagnation économique. Tout cela doit s'entendre dans un sens très général, en gros, parce que plusieurs détails du phénomène peuvent être différents.
§ 2311. Il suit de là que lorsque les périodes de rapide augmentation de la prospérité économique prédominent sur les périodes de stagnation, la classe gouvernante recrute toujours plus de « spéculateurs » qui y renforcent les résidus de l'instinct des combinaisons (§ 2178 et sv.) ; elle voit diminuer le nombre des « rentiers » à rente presque fixe, gens qui ont généralement plus puissants les résidus de la persistance des agrégats. Ce changement dans la composition de la classe gouvernante a pour effet de pousser toujours plus les peuples aux entreprises économiques, et d'accroître la prospérité économique, jusqu'à ce que surgissent de nouvelles forces qui neutralisent le mouvement (§ 2221 et sv.). Le contraire se produit quand prédominent les périodes de stagnation ou surtout de décadence économique. On a des exemples des premiers phénomènes chez les peuples civilisés modernes. On trouve des exemples des seconds phénomènes chez les peuples du bassin méditerranéen, au temps de la décadence de l'Empire romain, jusqu'après les invasions barbares et au moyen-âge. Ces effets sur la composition de la classe gouvernante ne sont pas les seuls qu'on remarque dans les périodes indiquées de prospérité et dans celles de stagnation. Plus loin, nous traiterons d'autres périodes (§ 2343 et sv.).
§ 2312. Dans les sociétés humaines civilisées, les producteurs d'épargne remplissent une fonction d'une très grande importance (§ 2228). Ils ressemblent aux abeilles qui recueillent le miel dans les alvéoles ; la comparaison se soutient encore en ce que l'on peut souvent dire d'eux : Sic vos non vobis mellificatis, apes. On ne va pas au delà de la vérité en affirmant que la civilisation est en raison directe de la quantité d'épargne que possède ou que met en œuvre un peuple. Si la prospérité économique croît, la quantité d'épargne consacrée par la production croît aussi, Si la prospérité économique est stagnante, la quantité d'épargne consacrée à la production décroît aussi.
§ 2313. Pour aller de l'avant, nous devons nous référer à la classification que nous avons faite aux § 2233-2234, en considérant deux catégories (S) et (R) , auxquelles nous avons donné les noms de spéculateurs et de rentiers uniquement par raison de commodité (§ 2235). Quand les producteurs de cette épargne ont le nécessaire pour vivre, ils se trouvent en grande partie dans la classe (R) des rentiers à rente presque fixe [FN: § 2313-1]. Leurs caractères sont contraires à ceux des individus qui appartiennent à la classe (S) , soit des « spéculateurs » (§ 2232). Ce sont en général des gens renfermés, prudents, timides, qui fuient toute aventure, non seulement dangereuse, mais tant soit peu risquée en apparence. Ils sont très faciles à gouverner et aussi à dépouiller, pour qui sait se servir avec opportunité des sentiments correspondant aux résidus de la persistance des agrégats, lesquels sont chez eux puissants [FN: § 2313-2). Les « spéculateurs » sont au contraire habituellement exubérants, prompts à accepter les nouveautés, prompts à l'action économique ; ils se plaisent aux aventures économiques dangereuses, et les recherchent. En apparence, ils se soumettent toujours à qui dispose de la force ; mais ils travaillent par dessous, et savent détenir la réalité du pouvoir dont d'autres n'ont que le semblant. Aucun échec ne les décourage ; chassés d'un côté, ils reviennent de l'autre, comme les mouches. Si l'orage gronde, ils courbent la tête sous la rafale, mais la redressent sitôt qu'elle a passé. Par leur insistance tenace et leur art subtil des combinaisons (Ie classe des résidus) ils surmontent tous les obstacles. Leurs opinions sont toujours celles qui leur sont le plus profitables sur le moment : hier conservateurs, ils sont aujourd'hui démagogues ; demain ils seront anarchistes, pour peu que les anarchistes soient près de s'emparer du pouvoir [FN: § 2313-3). Mais ils savent n'être pas tout entiers d'une couleur, car il convient de se concilier l'amitié de tous les partis quelque peu importants. Sur la scène, on voit lutter les uns contre les autres des spéculateurs catholiques et sémites [FN: § 2313-4] , monarchistes et républicains, libre-échangistes et socialistes ; mais dans la coulisse ces gens-là se serrent la main et poussent d'un commun accord aux entreprises qui peuvent rapporter de l'argent [FN: § 2313-5]. Quand l'un d'eux tombe, ses ennemis usent envers lui de pitié, attendant qu'au moment opportun on leur témoigne des égards analogues. Les deux catégories de personnes dont nous avons parlé savent peu se servir de la force, et la craignent. Les hommes qui en font usage et ne la craignent pas constituent une troisième catégorie, qui dépouille très facilement la première, plus difficilement la seconde ; celle-ci, aujourd'hui vaincue et défaite, se relève demain et gouverne.
§ 2314. On trouve une preuve très évidente du peu de courage des rentiers, dans la résignation lâche et stupide avec laquelle ils acceptent les conversions des dettes publiques des États [FN: § 2314-1]. Autrefois, on pouvait se demander s'il y avait avantage à les accepter ou à les refuser. Désormais, après tant d'exemples dans lesquels, à la suite des conversions, les titres sont descendus au-dessous du pair, il faut vraiment être borné pour espérer qu'une nouvelle conversion puisse avoir un résultat différent. Les possesseurs de titres anglais et les possesseurs de titres français, au temps des dernières conversions, ne pouvaient-ils donc pas prévoir, dès l'origine, ce qui les attendait à l'avenir ? En 1913, le consolidé anglais est tombé à 72 % et le français à 86. Et bien, si dans quelques années ces titres remontaient au delà du pair, leurs possesseurs seraient assez stupides ou assez lâches pour accepter une nouvelle conversion. On remarquera qu'il suffirait qu'une petite partie d'entre eux se missent d'accord pour refuser toute espèce de conversion ; mais il serait plus facile de lancer un troupeau de moutons à l'assaut d'un lion, que d'obtenir de ces gens-là le moindre acte énergique : ils courbent la tête et se laissent égorger. Exactement comme un troupeau de moutons, les possesseurs d'épargne française se laissent tondre par le gouvernement, lequel accorde ou refuse aux gouvernements étrangers la faculté d'émettre des emprunts en France, sans égard à la protection de l'épargne, mais bien à ses convenances politiques à lui, auxquelles parfois se subordonne, s'ajoute, et même se substitue l'intérêt privé de certains démagogues ploutocrates. À cela s'ajoutent des impôts variés sur les ventes-achats des titres, le timbre sur les titres, etc., le tout grevant les possesseurs d'épargne. Quelques-uns, il est vrai, commencent maintenant à prendre la défense de leurs propres intérêts, en envoyant leur argent à l'étranger ; mais au total, ils forment une toute petite fraction, tant par le nombre que par la somme d'épargne.
§ 2315. On trouve un autre exemple de moindre importance, mais pourtant toujours notable, dans l'action des cléricaux possesseurs d'épargne, en France, durant les années qui précédèrent la suppression des congrégations religieuses et la confiscation de leurs biens. On savait sans aucun doute que, tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, cela devait arriver. Les possesseurs de ces biens ne surent pas mettre en œuvre la moindre combinaison pour éviter le dommage imminent. Au contraire, ils s'efforcèrent de le rendre plus grave, par leur manie de posséder des immeubles, c'est-à-dire de donner à leur richesse la forme la plus favorable à une confiscation par le gouvernement. Cependant il était très facile d'éviter, au moins en grande partie, la spoliation imminente. L'argent et les titres pouvaient être placés en lieu sûr, si on les déposait à l'étranger. Quant aux immeubles, s'ils tenaient vraiment à en avoir la propriété, ils pouvaient la conférer à une société anonyme dont ils auraient gardé le plus grand nombre de titres et négocié quelques-uns aux bourses de Londres, de Berlin, de New-York, de manière à élever devant qui voudrait dépouiller la société anonyme l'obstacle de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Amérique.
§ 2316. Ce fait n'est pas spécial aux cléricaux français. Depuis le temps où fut dépouillé l'oracle de Delphes jusqu'à nos jours, on remarque un courant continu qui, des producteurs ou des simples possesseurs d'épargne, va aux institutions religieuses, lesquelles sont ensuite dépouillées par le gouvernement, exactement comme les agriculteurs récoltent chaque année le miel que les industrieuses abeilles ne cessent jamais de butiner [FN: § 2316-1].
Ce phénomène même n'est qu'un cas particulier d'un phénomène bien plus général, qui consiste en ce que, dans nos sociétés, telles que nous les connaissons depuis les temps historiques, les producteurs et les possesseurs d'épargne sont continuellement dépouillés du fruit de leur économie.
Considérée en ses moyens, cette opération s'accomplit par la violence, la guerre, le pillage, la violence des particuliers, ou bien la fraude et la tromperie, par des lois d'impôts frappant spécialement les possesseurs d'épargne, des émissions de fausses monnaies ou de dettes publiques qui seront répudiées tôt ou tard, partiellement ou en totalité, des monopoles, des droits protecteurs, des mesures de tout genre venant altérer les conditions de la production et les prix qui seraient donnés par la libre concurrence, etc. La forme la plus simple est celle d'une spoliation directe et violente d'un certain nombre d'épargneurs, souvent choisis au hasard, uniquement en considération de leur richesse ; elle correspond en quelque sorte à la chasse des animaux sauvages. Des formes de plus en plus compliquées, de plus en plus ingénieuses et générales, apparaissent dans le cours de l'histoire ; elles correspondent en un certain sens à l'élevage des animaux domestiques. L'analogie s'étend aux effets de ces formes. Le premier genre détruit incomparablement plus de richesses, amène beaucoup plus de perturbations sociales que le second.
Considérée en ses modalités, l'opération qui dépouille les possesseurs d'épargne peut être plus ou moins directe ou indirecte : être imposée, ou, au moins en partie, volontaire. Le type du premier mode se trouve dans l'impôt, les prestations obligatoires, les atteintes à l'héritage, les mesures, fréquentes dans l'antiquité, pour abolir ou alléger les dettes [FN: § 2316-2] . Le type du second mode s'observe lorsque l'opération a lieu en deux actes. Dans le premier, les individus donnent leur épargne à certaines corporations, principalement à des corporations religieuses, à des temples ; ils la confient à l'État ou à des institutions garanties par l'État. Dans le second acte, les corporations et les institutions sont dépouillées, parfois par l'ennemi, quelquefois par de puissants particuliers, souvent par l'État national, qui, souvent aussi, s'approprie les sommes dont il s'était reconnu débiteur ou dont il avait garanti la restitution. Les premières opérations sont entièrement ou principalement volontaires. Sous l'empire de mythes religieux, païens autrefois, ensuite chrétiens [FN: § 2316-3] , aujourd'hui nationalistes, les individus se laissent entraîner à faire don de leur épargne, espérant s'assurer les bienfaits de leurs dieux, ou attirés par les arrérages qu'on promet de leur payer, et par l'espoir, souvent fallacieux, qu'ils ne perdront pas intérêt et principal. Les secondes opérations suivent naturellement. Elles ont lieu selon la ligne de moindre résistance : on prend l'épargne là où elle se trouve et là où, une résistance énergique faisant défaut, elle est moins bien défendue [FN: § 2316-4] . Prélever une somme par l'impôt, ou par un emprunt qu'on répudiera ensuite, directement ou par des mesures dites de protection, provoque des résistances fort différentes chez le peuple. Considérée dans le temps, la spoliation se manifeste soit par des catastrophes que séparent de grands espaces de temps, parfois de plusieurs siècles, soit par des phénomènes se reproduisant en de plus courtes périodes, tels par exemple les pertes infligées aux épargneurs, lors de ce que l'on a appelé des « crises économiques », soit par des dispositions, législatives ou autres, agissant d'une manière continue, telles les liturgies et la triérarchie à Athènes anciennement, ou des impôts progressifs, de nos jours. En somme, en tout cela, nous avons un nouvel exemple des oscillations de grande, moyenne, et de petite ampleur, que présentent les phénomènes économiques et les phénomènes sociaux (§ 2293).
Les grandes oscillations prennent, surtout sous l'empire de sentiments éthiques, le caractère de catastrophes ; on croit que la considération de celles-ci doit être écartée de l'étude d'une société régulière et normale. C'est là une illusion. Il faut bien se rendre compte qu'elles ne diffèrent des autres oscillations que par l'intensité, et que leur ensemble est aussi régulier, aussi normal que tout autre phénomène social [FN: § 2316-5). Pour toutes les oscillations la forme peut changer, le fond demeure constant. La différence est principalement de forme entre la falsification matérielle des monnaies métalliques et les émissions de papier-monnaie [FN: § 22316-6] , entre les emprunts faits à des trésors sacrés, et certaines émissions de dettes publiques, entre les usurpations brutales accomplies autrefois par la puissance des armes, et les opérations financières des politiciens modernes, entre les dons faits à des satellites armés, et les largesses octroyées aux électeurs influents. Pourtant un changement appréciable s'observe dans la forme, par l'élimination graduelle des procédés les plus brutaux. À notre époque, on ne voit plus se reproduire de violentes et brutales spoliations du genre de celles qui servirent à Octave, Antoine et Lépide, pour s'assurer le concours de leurs soldats (§ 2200-1). De même, le système de livrer les contribuables à la rapacité de certaines personnes, auxquelles ensuite on fait rendre gorge violemment [FN: § 2316-7), a presque entièrement disparu des pays civilisés, ou s'est transformé.
Le transfert des biens économiques qui résulte des atteintes à la propriété peut parfois avoir pour effet d'augmenter la production. C'est ce qui arrive quand les biens passent des mains de personnes qui ne savent ou ne veulent pas en tirer le meilleur parti possible, aux mains de qui les exploite mieux. Mais le plus souvent, les biens provenant de la spoliation sont dissipés à l'instar de ceux que procure le jeu, et le résultat final est une destruction de richesse. Les vétérans enrichis par Sulla, au bout de peu de temps étaient retombés dans le besoin (§ 2577-1). Nos contemporains peuvent voir le luxe des gens que la politique enrichit, et le gaspillage auquel ils se livrent. Réunissant les atteintes à la propriété et la prodigalité spontanée des possesseurs d'épargne ou de leurs héritiers, nous pouvons dire que nous trouvons là des forces qui viennent contrecarrer les efforts des producteurs d'épargne, et restreindre considérablement l'accumulation de la richesse.
La régularité remarquable que présentent, dans le temps et l'espace, les phénomènes que nous venons d'étudier, nous conduit à admettre que, depuis les temps historiques et dans nos sociétés, le droit de propriété privée ne subsiste que tempéré par des actes et des dispositions qui lui sont opposés. En d'autres termes, nous n'avons pas d'exemples de sociétés dans lesquelles ce droit subsiste indéfiniment et en toute rigueur. Nous concevons en outre qu'on ne doit pas se placer exclusivement au point de vue restreint d'une éthique qui, en ces atteintes, ne trouve que des incidents regrettables, condamnables, venant léser le droit, la justice, l'équité, mais qu'il convient de se placer à un point de vue beaucoup plus étendu, et de voir en de tels phénomènes la manifestation d'une liaison qui est le complément nécessaire [FN: § 2316-8] des liaisons établies par le droit de propriété privée.
Les preuves de ce théorème se trouvent dans l'histoire, mais il est en outre confirmé par de nombreuses déductions, parmi lesquelles il convient de remarquer celles auxquelles donne lieu la théorie de l'intérêt composé.
Depuis longtemps, on a observé que cette théorie, appliquée à un long espace de temps, donne des résultats que la pratique dément absolument [FN: § 2316-9] . « (470) Un centime placé à intérêt composé, au taux 4 %, à l'époque de la naissance de Jésus-Christ, donnerait, en l'an 1900, un nombre fabuleux de francs, exprimé par 23 suivi de vingt-neuf zéros [plus exactement un nombre de 31 chiffres, dont les premiers sont 23 085...]. En supposant que le globe terrestre fût entièrement en or, on trouve qu'il faudrait plus de 31 de ces globes pour représenter cette somme. On arriverait à un résultat tout aussi absurde, en éliminant la considération de la monnaie et en supposant que les biens économiques, en général, se soient multipliés suivant cette progression. Une somme de 100 000 francs placée à l'intérêt du 3 % donnerait, en 495 ans, 226 milliards ; c'est-à-dire à peu près la fortune actuelle de la France. En 1660, la fortune de l'Angleterre aurait été, selon Petty, de 6 milliards ; admettons le chiffre de 8 milliards pour le Royaume-Uni. Si nous prenons l'évaluation de la Trésorerie, c'est-à-dire 235 milliards, en 1886, le taux moyen de l'intérêt, pour qu'en 226 ans la somme de 8 milliards se transforme en une somme de 235 milliards, est de près de 1,5 %. (471) On conclut de cela que ce n'est qu'exceptionnellement que la richesse peut augmenter suivant une progression géométrique dont la raison atteint ou dépasse 1,02 ou 1,03… Si la richesse devait continuer à croître, en Angleterre, suivant la même progression que nous observons de 1865 à 1889, on aurait, au bout de quelques siècles, des revenus absolument fabuleux. Il est donc certain que cette progression ne pourra pas se maintenir pour les siècles futurs... (472) Les tarifs des assurances sur la vie sont établis par des calculs d'intérêts composés. On peut les admettre tant qu'il ne s'agit que d'une petite partie de la population et de la richesse du pays. Ces calculs conduiraient à des résultats entièrement en dehors de la réalité, s'ils devaient comprendre toute la population et une fraction notable de la richesse nationale … » On peut ajouter que si quelques familles avaient placé à intérêt composé un centime, à la naissance de Jésus-Christ, et avaient pu conserver la richesse ainsi produite, il y a longtemps qu'elles auraient absorbé toute la richesse qui existe sur notre globe. On arrive ainsi, pour la répartition de la richesse, à des résultats tout aussi absurdes que ceux que l'on obtiendrait pour le total de la richesse.
En présence de tels faits, solidement établis, on s'est arrêté à la conclusion que la théorie et les calculs des intérêts composés ne peuvent pas s'appliquer à une partie notable de la population, pendant un temps fort long ; conclusion qui, à vrai dire, reproduit simplement la description des faits, ne les explique pas. Nous même, en 1896, nous n'avons pas été beaucoup au delà [FN: § 2316-10). Aujourd’hui les théories de la sociologie nous permettent de compléter cette étude. Si les résultats pratiques ne confirment pas les déductions théoriques, cela ne tient pas à un défaut de la théorie des intérêts composés, cela tient à ce que l'on a admis une prémisse qui ne se trouve pas dans la réalité. Cette prémisse, implicite dans les calculs d'intérêts composés, consiste à supposer que, en un très grand espace de temps, on peut accumuler la richesse grâce à des taux d'intérêt ne s'écartant pas trop de ceux qu'on observe, pendant ce même espace de temps, pour les accumulations de courte durée et pour de faibles fractions de la richesse totale.
Le fait que des conclusions rigoureusement logiques d'une certaine prémisse ne se vérifient pas, suffit pour prouver que cette prémisse est erronée, ou du moins incomplète ; telle doit donc être celle que nous venons d'énoncer. Mais comment expliquer la contradiction entre les résultats donnés par la théorie, selon qu'on l'applique à des temps plus ou moins longs, à des fractions plus ou moins grandes de la richesse totale ?
Si l'on négligeait la considération que les taux d'intérêt adoptés sont à peu près ceux qu'on observe en réalité, on pourrait supposer que la richesse accumulée devient de moins en moins productive, et que, à la longue, le taux de l'intérêt tend vers zéro. C'est peut-être ce qui se dégage vaguement des théories optimistes sur la diminution du taux de l'intérêt. Mais ces théories sont démenties par les faits [FN: § 2316-11] , qui prouvent clairement que, depuis le temps où florissait Athènes jusqu'à nos jours, le taux de l'intérêt a subi des variations successives, le faisant augmenter et diminuer tour à tour, et qu'il est loin d'être tombé à zéro en notre temps. Il faut donc écarter l'hypothèse d'un taux d'intérêt se réduisant, à la longue, à zéro ; et alors on est forcé d'admettre que si l'accumulation qui serait la conséquence des taux réels d'intérêt ne se produit pas, c'est parce qu'elle est tenue en échec par des destructions successives de la richesse. Or, c'est ce que l'observation révèle effectivement. L'histoire est remplie de la description des nombreuses causes de destruction de la richesse. Les unes en affectent le total : ce sont les guerres, les révolutions, les épidémies, les pillages et les gaspillages de toutes sortes ; les autres affectent principalement la distribution de la richesse, et empêchent des accumulations indéfinies dans les mêmes familles, dans les mêmes collectivités, tout en ayant aussi, par ricochet, des effets sur le total de la richesse : ce sont les atteintes à la propriété privée des individus, des familles, des collectivités, les transferts de richesses imposés par la force, ou provoqués par la prodigalité. C'est ainsi que les courbes de l'accumulation de la richesse, pour une même famille, une même collectivité, pour une même nation, et enfin pour l'humanité entière, affectent, au lieu de la forme régulièrement croissante que donnerait un taux constant d'intérêt, une forme ondulée, présentant des oscillations autour d'une courbe moyenne (§ 1718). Celle-ci, pour toute l'humanité, est certainement plus ou moins croissante, depuis les temps historiques jusqu'à nos jours, sans qu'on puisse exclure qu'il y ait eu des périodes décroissantes. Non moins certainement, pour une même nation, pour une même collectivité, pour une même famille, elle est aussi telle, mais sûrement avec des périodes décroissantes.
La durée des périodes est longue pour la population totale du globe, modérée pour les nations [FN: § 2316-12] , plus courte pour les collectivités, fort courte pour les familles. Ce n'est là, en somme, qu'un cas particulier d'un phénomène très général (§ § 2293, 2330), et les oscillations révèlent et manifestent les différentes forces qui agissent sur l'agrégat social.
D'autres effets ont une importance tout aussi considérable que les effets économiques. Si nous nous plaçons au point de vue de la circulation des élites, les mesures ayant les caractères de catastrophes, de violence, ou même simplement d'une application très générale, peuvent, parmi des conséquences utiles à la société, en avoir de nuisibles à un degré plus élevé que celui d'effets du même genre produits par des mesures ayant des caractères de persuasion, de fraude, et qui, par là-même, ne s'appliquent qu'à certaines catégories de personnes. En effet, les premières mesures atteignent plus ou moins indistinctement les individus, quelle que soit la place qu'ils occupent dans la circulation des élites ; les secondes atteignent principalement les individus qui, par leur simplicité, leur naïveté, leur crédulité, leur défaut de courage ou simplement d'initiative, se trouvent dans les plus bas degrés de l'échelle des élites. Les premières mesures peuvent donc, bien plus que les secondes, détruire des éléments utiles à la société.
Si maintenant, des considérations que nous venons de développer, on tirait la conclusion qu'on peut abolir complètement la propriété privée ou d'autres institutions analogues, on tomberait dans une erreur très générale en économie et en sociologie. Cette erreur, que nous avons eu de nombreuses occasions de signaler, consiste à substituer des conditions qualitatives aux conditions quantitatives, à négliger la mutuelle dépendance des phénomènes sociaux, à s'imaginer qu'on peut, pour expliquer les phénomènes concrets, se borner à considérer une seule de leurs liaisons, et qu'on peut la modifier sans que les autres soient affectées.
Pour compléter notre étude, il ne faut pas oublier que l'histoire nous fournit des faits correspondant, en un sens exactement opposé, à ceux que nous venons de noter. Elle nous fait connaître qu'en des sociétés fondées, en apparence du moins, sur l'absence ou la réduction à un minimum de la propriété privée, ou sur l'égalité des conditions, on a toujours vu apparaître et se développer la propriété privée ou des institutions analogues, ainsi que l'inégalité des conditions ; ce qui manifeste la nécessité (expérimentale) d'autres liaisons, en un sens opposé à celui des premières [FN: § 2316-13] .
Ici encore, il faut ajouter que celui-là ferait fausse route qui, de ces faits, tirerait la conséquence que l'on peut supprimer entièrement toute atteinte à la propriété privée ou à d'autres institutions analogues, ainsi qu'à l'inégalité des conditions, et qu'il tomberait exactement dans la même erreur que celle précédemment indiquée.
Nous avons ici simplement un nouvel exemple de la composition des forces qui agissent sur la société.
Enfin, il est encore un autre genre d'erreurs sur lequel doit se porter notre attention, et qui consiste en la confusion que l'on fait habituellement entre les mouvements réels et les mouvements virtuels.
Du fait que l'histoire constate l'existence de certaines catégories de liaisons simultanées, qui subsistent de tout temps, on peut déduire qu'elles sont en un état de mutuelle dépendance (mouvements réels) non seulement entre elles, mais aussi avec les autres conditions de l'équilibre social ; on ne peut pas conclure que la forme sous laquelle elles se manifestent procure à la société le maximum d'une des utilités qu'on peut avoir en vue (mouvements virtuels).
§ 2317. Par suite du peu de courage des producteurs et des possesseurs d'épargne, leur volonté agit peu sur les phénomènes économiques. Ceux-ci sont déterminés par la quantité totale d'épargne, beaucoup plus que par la résistance que les possesseurs d'épargne pourraient opposer à qui veut les dépouiller. De même, pour continuer l'analogie employée un peu plus haut, la quantité de miel qu'obtient l'apiculteur dépend de la quantité totale qu'en récoltent les abeilles, et non de la résistance que celles-ci pourraient opposer à qui le leur enlève [FN: § 2317-1].
§ 2318. Dans les périodes de stagnation économique, la quantité d'épargne disponible augmente. Ainsi se prépare la période suivante de rapide augmentation de prospérité économique, dans laquelle la quantité d’épargne disponible diminue et une nouvelle période de stagnation se prépare ; et ainsi de suite indéfiniment.
§ 2319. À ces deux genres d'oscillations s'en superpose un troisième, dont la durée est beaucoup plus longue et se compte généralement par siècles. En d'autres termes, il arrive à chaque instant que les éléments sachant et voulant faire usage de la force, et chez lesquels existent puissantes les persistances des agrégats, secouent le joug qui leur est imposé par les spéculateurs ou par d'autres catégories de personnes expertes en l'art des combinaisons. Ainsi commence une nouvelle période, durant laquelle peu à peu les catégories vaincues reviennent au pouvoir, pour en être ensuite de nouveau dépossédées, et ainsi de suite (§ 2331).
§ 2320. Dans l'étude de ces phénomènes, il faut prendre garde que souvent il existe en un même pays une catégorie très étendue où l'on observe cette évolution, et une autre, restreinte ou très restreinte, où l'usage de la force est constant. Un exemple typique de ce fait s'est vu dans l'empire romain. L'évolution indiquée s'accomplissait dans la population civile, mais en même temps il existait un nombre très restreint de soldats, chez lesquels il n'y avait pas évolution, et qui, par la force, soutenaient l'Empire et lui donnaient un chef. De nos jours, en de beaucoup moindres proportions, on peut voir quelque chose de semblable dans l'empire allemand. Il faut aussi prendre garde que les personnes dont nous venons de former des catégories ont des amis, des clients, des tenants et des aboutissants de divers genres, avec lesquels elles sont tantôt d'accord, tantôt en désaccord, et dont il est nécessaire de tenir compte pour évaluer l'action sociale de ces personnes. De nos jours, les rapports entre les industriels et leurs ouvriers, entre les politiciens et la bureaucratie [FN: § 2320-1], ainsi que d'autres rapports semblables, sont très connus (§ 2327).
§ 2321. Élargissons maintenant le cycle restreint étudié aux 2219 et sv., dans lesquels on considérait seulement les intérêts (b) et la circulation des élites (d) . Considérons l'action de ces éléments sur les résidus (a) et sur leurs dérivations (c) . La seconde action est facile à connaître, parce qu'elle nous est révélée par la lecture et par un très grand nombre de faits. Il n'en est pas ainsi de la première, qu'il faut découvrir sous ces manifestations. En général, on se trompe parce qu'on la suppose beaucoup plus grande qu'elle n'est en réalité. Par exemple, il y a quelques années, on aurait pu croire que le cycle (b) (d) - (d) (b) avait modifié beaucoup les résidus (a) , en ce sens qu'il n'avait laissé subsister chez les hommes que les sentiments de rationalisme et d'humanitarisme ; mais voici que le nationalisme surgit très puissant ; ensuite, avec une intensité moindre, mais pourtant notable encore, on remarque l'impérialisme et le syndicalisme, tandis que refleurissent d'antiques religions, l'occultisme, le spiritisme, les sentiments métaphysiques ; la religion sexuelle atteint le comble d'un fanatisme ridicule ; et voici encore que la foi en des dogmes antiques ou nouveaux se manifeste sous un grand nombre de formes. De la sorte, il apparaît que le cycle indiqué avait vraiment agi beaucoup plus sur les dérivations que sur les résidus.
§ 2322. Un phénomène semblable se produisit dans la Rome antique, au temps d'Hadrien et de Marc Aurèle, lorsque la courbe de la domination des intellectuels et celle du rationalisme atteignirent leur point culminant. Il semblait alors vraiment que désormais le monde devait être régi par la raison ; mais avec le principat de Commode commença la descente de cette courbe, non pas ainsi que beaucoup le croient encore, à cause des « vices » de l'empereur, mais par une réaction naturelle, semblable à tant d'autres que nous montre l'histoire. En attendant, dans les bas-fonds sociaux mûrissait la riche moisson de foi qui se manifesta ensuite dans la philosophie païenne, dans le culte de Mithra, dans d'autres semblables, et finalement dans le christianisme.
§ 2323. Il n'est nullement permis de déduire de là que l'action du cycle (b) (d) - (d) (b) sur les résidus (a) soit nulle. On doit seulement tirer cette conclusion : tandis que dans le cycle on remarque des variations rythmiques considérables, des périodes bien tranchées présentant des caractères différents, dans les résidus (a) , on constate des effets beaucoup plus faibles.
§ 2324. Le cycle (b) (c) (d) - (d) (c) (b) ... est important. On comprend facilement que les dérivations (c) s'adaptent aux nouvelles conditions de la circulation des élites (d) . Elles subissent, bien qu'à un moindre degré, l'influence du changement des conditions économiques. À ce point de vue, on peut les considérer comme des effets de ces causes. Au fur et à mesure que la classe dominante s'enrichit d'éléments chez lesquels prédominent les instincts des combinaisons, et qu'il lui répugne d'employer loyalement et franchement la force, les dérivations s'adaptent à ces conceptions. L'humanitarisme et le pacifisme apparaissent et prospèrent ; on parle comme si le monde pouvait être régi par la logique et par la raison, tandis que toutes les traditions sont tenues pour de vieux préjugés. Que l'on parcoure la littérature : à Rome, au temps des Antonins ; dans nos contrées, à la fin du XVIIIe siècle, particulièrement ; en France ; puis de nouveau dans la seconde moitié du XIXe siècle ; et l'on reconnaîtra facilement ces caractères.
§ 2325. Parfois, on observe le développement parallèle d'une autre littérature, qui a principalement en vue de changer la répartition du gain entre la classe gouvernante et ceux qui la soutiennent : à Rome, entre les patriciens et les plébéiens, entre les sénateurs et les chevaliers, pour la répartition du butin de guerre, des tributs des provinces ; dans nos contrées, entre les politiciens et les spéculateurs, entre les chefs d'industries et leurs ouvriers, pour la répartition du produit de la protection économique et des tributs prélevés sur les possesseurs de rentes fixes, les petits actionnaires et les producteurs d'épargne. Plus grand est le butin à partager, plus vive est la lutte, plus abondante est la littérature qu'elle suscite, et par laquelle on démontre combien telle ou telle classe est méritoire et utile, ou bien coupable et nuisible, suivant les préférences spontanées ou grassement payées de l'auteur. Plusieurs intellectuels et humanitaires de bonne foi, et beaucoup de simples d'esprit, demeurent émerveillés, abasourdis, à l'ouïe de si miraculeuses démonstrations, et ils rêvent d'un monde qu'elles régiront ; tandis que les spéculateurs les acceptent favorablement, bien qu'ils en connaissent la vanité : pendant que les gens s'y arrêtent et s’en repaissent, eux, sans être dérangés, effectuent leurs opérations profitables.
§ 2326. Au début du XIXe siècle, soit parce que la classe gouvernante possédait des résidus de la persistance des agrégats en plus grande quantité qu'il ne lui en est resté aujourd'hui, soit parce qu'elle n'était pas instruite par l'expérience qui l'aida ensuite, elle n'estimait nullement ces dérivations inoffensives, et surtout ne les croyait pas avantageuses. C'est pourquoi elle les persécutait et les réprimait par la loi. Mais ensuite, peu à peu, elle s'aperçut qu'elles n'étaient en rien un obstacle à ses profits, et qu'au contraire, parfois et même souvent, elle les favorisait ; aussi la classe gouvernante est-elle devenue aujourd'hui indulgente, et la loi ne réprime t-elle plus ces dérivations. Alors, les riches financiers étaient presque tous conservateurs ; aujourd'hui, ils favorisent les révolutionnaires intellectuels, socialistes, et même anarchistes. Les plus virulentes invectives contre le « capitalisme » s'impriment avec l'aide des « capitalistes ». Parmi eux, ceux qui n'ont pas le courage de pousser si loin se faufilent du moins parmi les radicaux [FN: § 2326-1]. Un type remarquable de ce phénomène est le célèbre comité Mascuraud, en France, lequel est composé d'industriels et de négociants riches, qui poussent jusqu'au point où le radicalisme confine au socialisme. Sous des noms différents, on remarque des faits semblables en Italie, en Angleterre, en Autriche-Hongrie, en Allemagne. Si nous ne le voyions pas de nos yeux, il semblerait étrange que, dans tous les pays, les défenseurs des prolétaires ne soient pas eux-mêmes prolétaires, mais au contraire des hommes très fortunés, quelques-uns même riches ou richissimes, comme certains députés et certains littérateurs socialistes. Bien plus, à vrai dire, les prolétaires n'ont d'adversaires dans aucun parti : dans les livres, dans les journaux, dans les productions théâtrales, dans les discussions parlementaires, toutes les personnes aisées déclarent vouloir le bien des prolétaires. Entre elles, il n'y a de discussion que sur la manière de réaliser ce bien, et c'est d'après ces diverses manières que se constituent les différents partis. Mais toute la bourgeoisie aisée ou riche de notre temps est-elle vraiment devenue si soucieuse du bien d'autrui et si négligente du sien propre ? Qui donc croirait que nous vivons au milieu de tant de saints et d'ascètes ? Ne serait-ce pas que quelque Tartufe, conscient ou inconscient, se faufile parmi eux ? Lorsque certains riches personnages, tels que Caillaux, se donnent tant de mal pour établir l'impôt progressif, sont-ils vraiment mus uniquement par le désir de partager leurs biens avec autrui, sans qu'il y ait même un brin du désir opposé, de les accroître ? Tout est possible, mais il est des choses qui paraissent peu probables L'apparence est peut-être différente de la réalité. Les riches qui paient ceux qui prêchent qu'on doit leur enlever leurs biens paraissent dépourvus de bon sens ; mais ils sont au contraire fort avisés, car, tandis que d'autres bavardent, eux accroissent leur fortune. Les spéculateurs semblent de même dépourvus de sagesse, lorsqu'ils se montrent favorables à l'impôt progressif, ou qu'ils le décrètent ; ils sont au contraire très sagaces quand, grâce à ce jeu, ils peuvent effectuer des opérations dont ils retirent beaucoup plus que ne leur enlève l'impôt [FN: § 2326-2] .
§ 2327. Les industriels croyaient aussi, il y a un certain temps, que toute augmentation de salaire de leurs ouvriers devait faire diminuer le profit de l'industrie. Mais l'expérience leur a aujourd'hui appris qu'il n'en était pas ainsi : que les salaires des ouvriers et les profits de l'industrie pouvaient croître en même temps, l'augmentation étant payée par les rentiers, par les petits actionnaires et par les producteurs d'épargne, ou même par d'autres industriels moins avisés. Cette découverte fut faite en premier lieu par les industriels qui jouissaient de la protection douanière. Naturellement ils auraient aimé toucher le bénéfice dans son intégralité ; mais ils finirent par comprendre qu'ils travaillaient mieux à leurs intérêts en partageant ce bénéfice avec les ouvriers, et que, déduction faite de la part de ceux-ci et de la compensation accordée aux politiciens dispensateurs de la manne protectionniste, il restait toujours un beau bénéfice. C'est pourquoi il est aujourd'hui beaucoup plus facile qu'autrefois de résoudre les conflits provoqués par les grèves, spécialement dans les industries qui jouissent de la protection douanière, ou qui vendent leurs produits au gouvernement. Bien plus, ceux-là même qui exercent ces industries savent faire tourner à leur profit les grèves mêmes (§ 2187-1). Les gens ingénieux trouvent moyen de tirer avantage de ce qui semblerait devoir leur porter préjudice.
§ 2328. Les artifices et l'ingéniosité des spéculateurs apparaissent aussi dans la politique internationale. Ces gens ont avantage à préparer la guerre, à cause de l'activité économique nécessaire à la préparation des armements, et parce que, pour la défense de leurs intérêts, ils tirent parti des sentiments de nationalisme. Mais la guerre elle-même pourrait nuire gravement à leur domination, parce que sur les champs de bataille le soldat compte plus que le spéculateur ; et ils restent interdits à l'idée qu'un général victorieux pourrait leur ôter le pouvoir. C'est pourquoi, avec l'aide de leurs bons amis intellectuels, ils s'efforcent de toute façon de persuader les peuples civilisés que désormais le règne de la force est terminé, que les grandes guerres sont devenues impossibles, grâce à la puissance des moyens de destruction, et qu'il suffit de dépenser beaucoup pour les armements, afin de préparer la guerre, sans qu'ensuite il soit nécessaire de la faire. Mais, en ce qui concerne les dépenses, ils se heurtent à la concurrence d'autres affamés du budget, qui veulent que ces dépenses soient affectées aux « réformes sociales » ou à d'autres buts semblables ; et ils doivent transiger avec eux. Les puissants syndicats financiers tantôt font prêcher par leurs journaux la concorde et la paix, et exalter les miracles du droit international et les bienfaits « de la paix par le droit » ; tantôt ils poussent aux discordes, à la protection des « intérêts vitaux » de la nation, à la défense de la « civilisation » de leur peuple, à la sauvegarde de « droits » spéciaux, suivant les avantages qu'il en résultera pour leurs savantes combinaisons. Les populations secondent plus ou moins ces manœuvres ; c'est un exemple remarquable des dérivations et du fait que les mêmes sentiments peuvent être orientés vers des buts différents. Mais celui qui suscite la tempête ne peut pas toujours l'apaiser à sa guise [FN: § 2328-1] , et les spéculateurs courent le risque de voir leurs incitations aux discordes aller plus loin qu'ils ne l'ont prévu, et aboutir à la guerre qu'ils abhorrent. Aujourd'hui la ruse domine, mais il n'en résulte nullement que la force ne dominera pas demain, fût-ce pour peu de temps.
§ 2329. OSCILLATIONS DE DÉRIVATIONS, EN RAPPORT AVEC LES OSCILLATIONS SOCIALES. Ce phénomène est très important ; comme manifestation d'idées et de doctrines, il apparaît dans les conflits entre les diverses dérivations sentimentales, théologiques, métaphysiques, et entre celles-ci et les raisonnements des sciences logico-expérimentales. En faire l'histoire serait faire l'histoire de la pensée humaine. Comme manifestation de force agissant dans la société, il apparaît dans le conflit entre les sentiments correspondant à divers résidus, surtout entre ceux qui correspondent aux résidus de la Ire classe et ceux qui correspondent aux résidus de la IIe classe ; par conséquent aussi dans le conflit entre les actions logiques et les actions non-logiques. C'est pourquoi il est très général et domine, sous diverses formes, toute l'histoire des sociétés humaines. Il n'y a pas lieu de s'étonner qu'en suivant la méthode inductive, il nous soit souvent arrivé de le rencontrer.
Les deux cas suivants sont remarquables. Tout d'abord, traitant des doctrines qui dépassent l'expérience, nous avons vu surgir cette question : comment l'expérience a-t-elle agi de manières si différentes dans les dérivations sentimentales, théologiques, métaphysiques, et dans les raisonnements scientifiques (§ 616 et sv.) ? Nous avons dû donner un aperçu de la réponse à cette question, tout en renvoyant au présent chapitre des études ultérieures. Ensuite, lorsque nous étudiions les dérivations, nous avons eu à examiner comment et pourquoi certaines dérivations, évidemment fausses, vaines et absurdes au point de vue expérimental, persistaient et se reproduisaient depuis des siècles et des siècles (§ 1678 et sv.). Ce fait faisait surgir une objection d'un grand poids contre le prétendu caractère de ces dérivations, car on pourrait se demander comment il était possible que depuis si longtemps les gens ne se fussent pas encore aperçus qu'elles étaient fausses, vaines et absurdes. Nous ne pouvions alors ni négliger cette question et passer outre sans autre, ni y répondre entièrement, car nous manquions de certains éléments que nous avons acquis seulement plus tard. C'est pourquoi nous avons dû nous contenter de commencer alors l'étude que nous allons achever. En attendant, avec le progrès de nos recherches, cette question s'était étendue (§ 1678 et sv.) ; elle a pris maintenant la forme de la mutuelle dépendance entre le mouvement ondulatoire des résidus et celui des dérivations, ainsi qu'entre ces faits et les autres faits sociaux, parmi lesquels il faut considérer principalement les faits économiques. Lorsqu'on considère de longs espaces de temps, la proportion des résidus de la persistance des agrégats, comparés à ceux de l'instinct des combinaisons, peut varier dans une mesure sensible, surtout pour les classes intellectuelles de la société. Alors apparaissent des phénomènes importants en ce qui concerne les dérivations.
§ 2330. Même avec ces limites déjà très larges, le problème indiqué n'est encore qu'un cas particulier d'un sujet plus général : celui de la forme ondulatoire des diverses parties des phénomènes sociaux et des rapports mutuels entre ces parties et ces ondulations [FN: § 2330-1] .
On peut dire que, de tout temps, les hommes ont eu quelque idée de la forme rythmique, périodique, oscillatoire, ondulée des phénomènes naturels, y compris les phénomènes sociaux. Cette conception est en rapport avec les persistances d'agrégats, (résidus de la IIe classe) qui naissent de l'observation du retour périodique du jour et de la nuit, des saisons, et plus tard, lorsqu'on commence à faire des observations astronomiques, des phases de la lune, du mouvement des corps célestes. En d'autres domaines, on remarque des retours périodiques de fertilité et de stérilité, d'abondance et de disette [FN: § 2330-2] , de prospérité et de décadence. Chez les individus, on remarque une succession ininterrompue, la mort faisant disparaître des personnes qui sont remplacées par d'autres ; les âges de l'enfance, de la virilité, de la vieillesse, se succédant indéfiniment chez des individus différents. La conception d'une succession analogue pour les familles, les cités, les peuples, les nations, l'humanité entière, naît spontanément lorsque, la tradition ou l'histoire embrassant un assez grand nombre d'années, des hommes intelligents et curieux portent leur attention sur ce sujet. D'autre part, le spectacle des cataclysmes terrestres et l'action des résidus de la persistance des abstractions (II-δ) font appliquer à tout l'univers, plus ou moins en connaissance de cause, la conception d'un mouvement rythmique. Ensuite, et en ces cas divers, le besoin de développements logiques (résidus I-epsilon) et l'intervention des résidus de la persistance des uniformités (II-epsilon) induisent à créer des doctrines, qui croissent et prospèrent par l'adjonction de considérations métaphysiques et pseudo-expérimentales.
Fort probablement, les auteurs qui raisonnent a priori ou d'une manière dogmatique, ainsi que le font la plupart des métaphysiciens, étendent instinctivement à tout l'univers les impressions qu'ils ont reçues de certains faits, et affirment ainsi que tout est soumis au rythme du mouvement. Mais d'autres auteurs aboutissent à la même conclusion par une généralisation hâtive et dépassant de beaucoup les faits, que d'ailleurs ils déforment [FN: § 2330-3).
En général, les retours sont notés, non par rapport à des phénomènes bien définis et caractérisés, mais par rapport à des abstractions plus ou moins vagues ; ce qui, en y ajoutant en cas de besoin la doctrine des exceptions (§ 1689 [FN: § 3] ), permet d'adapter la théorie à toutes les circonstances, et de la vérifier sûrement. Même de nos jours, même pour des phénomènes qui ont des indices facilement mesurables, on a vu naître la théorie de Jevons sur les « crises économiques », sans que le terme de « crise » fût bien défini. En un sens opposé apparaît souvent un besoin de précision, par lequel on est conduit à des résultats illusoires : on veut fixer quel sera exactement, ou en moyenne, l'espace de temps qui s'écoulera entre un retour et l'autre. C'est là une conséquence de l'instinct qui pousse beaucoup de personnes à donner une forme concrète à leurs abstractions (résidus II-dzeta).
Parfois on ne fixe pas de terme aux oscillations ; mais parfois aussi, plus souvent, sous l'empire de l'instinct qui pousse l'homme à rechercher son bien et celui de ses semblables, on voit apparaître plus ou moins explicitement la conception d'une limite à ces oscillations, laquelle se trouve généralement en un état heureux ; seuls quelques pessimistes la mettent en un état malheureux, en une complète destruction.
Une étude un peu diffuse de ces théories, n'en déplaise aux fanatiques de la « méthode historique » et aux partisans des « bibliographies complètes », ne serait d'aucune utilité pour la connaissance des phénomènes que les théories devraient représenter. Le temps qu'on emploierait à ce travail peut être plus utilement consacré à l'étude objective des phénomènes, ou, si l'on préfère, des témoignages directs s'y rapportant (§ 95, 1689), ainsi qu'à la recherche des indices mesurables des phénomènes et à la classification des oscillations par ordre d'intensité ; cela pour voir si, de la sorte, on parvient à isoler les plus grandes oscillations et à découvrir quelques-unes au moins des très nombreuses relations qui existent entre les oscillations des différents phénomènes (§ 1718, 1731, 2293). L'étude des théories que nous avons mentionnées peut être utile à la connaissance des dérivations dont elles se composent. C'est encore une étude objective, seulement l'objet ne se trouve plus ici dans les phénomènes que veulent représenter ces théories ; il est contenu dans l'expression même des théories, dans les écrits qu'on examine. Nous avons déjà cité assez d'exemples de telles dérivations, pour pouvoir ici n'en traiter que très brièvement.
Platon avait la conception d'une cité parfaite, et il ne pouvait se dissimuler que les cités existantes dont il avait connaissance n'étaient pas établies sur ce modèle. D'autre part, puisqu'il prêchait pour faire passer dans la réalité cette cité imaginaire, il devait admettre la possibilité de son existence, qui était seulement repoussée hors du temps présent dans le passé ou dans le futur, on dans les deux à la fois. Par là, elle se trouvait être l'origine, ou le terme, ou même l'origine et le terme d'une certaine évolution qui, par une généralisation chère aux métaphysiciens, devient universelle [FN: § 2330-4] . Naturellement, Platon, qui sait tout, connaît aussi la durée exacte des périodes de retour. « Pour les générations divines, la révolution est comprise en un nombre parfait ». Pour les hommes, les indications de Platon sont tellement obscures qu'aucun des commentateurs modernes n'a pu y voir goutte. Les anciens étaient plus heureux [FN: § 2330-5), mais ils ne nous ont point fait part de leurs lumières. Nous ignorons donc quel est ce nombre, et c'est là un grand malheur ; en revanche, d'autres auteurs nous ont fait connaître des nombres analogues et tout aussi certains.
Aristote qui, au moins dans la Politique, fait beaucoup moins que Platon usage de la métaphysique, beaucoup plus de la méthode expérimentale, blâme la théorie de Platon, mais il faut reconnaître que ses critiques ne sont pas toujours fondées, car elles portent parfois plutôt sur la forme que sur le fond. Polybe est un des historiens anciens qui, dans ses recherches, se rapproche le plus de la réalité expérimentale ; c'est un digne précurseur de Machiavel. De prime abord, on est donc étonné de voir qu'il fasse sienne la théorie de Platon, au point de la transcrire pour expliquer les transformations du gouvernement des cités [FN: § 2330-6] ; mais il se peut qu'il ait cru reproduire ainsi des faits d'expérience, et que son erreur consiste principalement en une généralisation hâtive, qui l'a entraîné hors de la réalité. Lorsqu'il veut comparer les différentes formes des républiques, il exclut celle de Platon, reconnaissant son caractère purement imaginaire. Dans le traité De la production et de la destruction des choses attribué à Aristote, on trouve la conception d'une transformation continuelle des choses, et, précisant cette notion, on ajoute que la transformation, lorsqu'elle est nécessaire, doit se faire en cercle (II, 11, 7) ; ce qui revient à une généralisation de la théorie de Platon.
Bon nombre d'auteurs ont travaillé sur ce fonds commun, en partie expérimental, des oscillations ininterrompues. G. B. Vico a une théorie, dite des retours (ricorsi) , qui, principalement métaphysique, dépasse presque autant que la théorie de Platon les bornes de la réalité. Il avoue d'ailleurs que la conclusion de son ouvrage est en parfait accord avec celle du philosophe grec [FN: § 2330-7). Il conserve encore de nos jours des admirateurs, et il en aura probablement tant que durera le grand courant métaphysique qui traverse les siècles.
La Théorie des périodes politiques de G. Ferrari paraît nous conduire en plein domaine expérimental ; malheureusement cette apparence est en grande partie trompeuse. L'auteur traite un peu trop arbitrairement les faits, et leur donne souvent une portée qu'ils n'ont pas. Son principal défaut, qui est d'ailleurs habituel chez d'autres auteurs en des cas analogues, est de vouloir soumettre les faits à des règles inflexibles, d'une précision illusoire. En d'autres termes, il veut donner des formes immuables et arrêtées aux ondulations, qui sont essentiellement variables et de formes diverses. Attiré par le mirage de ce but, il imagine des phénomènes en dehors de la réalité, tels que les « générations pensantes », dont la durée moyenne est d'à peu près 30 ans, et les « périodes politiques » qui, se composant de quatre générations pensantes, durent à peu près 125 ans. Les métaphysiciens méprisent les faits (§ 821) ; Ferrari rend du moins hommage aux faits en tâchant de les faire rentrer dans les cadres qu'il a tracés. Ainsi que d'autres auteurs, il a pour cela la grande ressource des exceptions (§ 1689-1). Il attribue deux vies pensantes à certains hommes, tels que Voltaire, Gœthe, Aristophane, Sophocle, Rossini, etc. ; il admet des retards et des accélérations des générations pensantes et des périodes politiques ; il trouve chez les différentes nations des « traductions » des périodes, note leur « vitesse comparée », et, en somme, détruit en partie lui-même les fondements de sa théorie [FN: § 2330-8). Il a pourtant, en comparaison des métaphysiciens, le grand mérite de s'exprimer clairement et au-dessous de détails d'une précision illusoire et de développements arbitraires, on trouve des considérations qui, de même que celles de la théorie de Draper (§ 2341-1), se rapprochent de la réalité expérimentale. Ce sont là des cas analogues aux nombreux autres que nous avons déjà vus (§ 252, 253, 2214), en lesquels on retrouve une vision des faits, sous les voiles de la métaphysique et d'une pseudo-expérience.
§ 2331. Habituellement, les petites oscillations ne paraissent pas être dépendantes ; ce sont des manifestations peu durables dont il est trop malaisé, impossible même, de découvrir les uniformités. La dépendance des grandes oscillations se voit plus facilement : ce sont des manifestations durables, dont on réussit parfois à connaître les lois (uniformités), soit pour un phénomène considéré séparément des autres, soit pour les phénomènes considérés en l'état de mutuelle dépendance. Depuis longtemps déjà, on a eu l'idée de ces uniformités ; d'ailleurs cette idée est souvent demeurée indistincte, et a été exprimée d'une manière très imparfaite. Quand, par exemple, on remarque la correspondance existant entre la richesse d'un pays et les mœurs de ce pays, on ne fait autre chose que de remarquer l'uniformité de mutuelle dépendance des oscillations ; mais, habituellement, on dépasse l'expérience, et l'on divague dans le domaine de l'éthique.
On commet d'habitude plusieurs erreurs dans l'étude des uniformités indiquées. On peut diviser ces erreurs en deux classes : (A) erreurs qui naissent du fait que l'on ne tient pas compte de la forme ondulatoire des phénomènes ; (B) erreurs qui naissent de l'interprétation donnée à cette forme ondulatoire.
§ 2332. (A-1.) Les ondulations sont l'indice de périodes du phénomène que l'on peut appeler ascendantes et descendantes. Si elles sont un peu longues, ceux qui vivent au temps d'une de ces oscillations ont facilement l'opinion que le mouvement doit continuer indéfiniment dans la direction qu'ils observent, ou du moins aboutir à un état stationnaire, sans mouvement contraire subséquent (§ 2392, 2319).
§ 2333. (A-2.) L'erreur précédente s'atténue sans disparaître, lorsqu'on admet une ligne moyenne autour de laquelle oseille le phénomène, mais que l'on croit que cette ligne moyenne coïncide avec celle d'une des périodes ascendantes du phénomène. Jamais, ou presque jamais, on ne la fait coïncider avec la ligne d'une période descendante. Nous exposerons plus loin un cas particulier du présent sujet et du précédent (2391 et sv.).
§ 2334. (B-1.) On sait que, dans le passé, le phénomène apparaît sous forme d'oscillations, mais on admet implicitement que le cours normal est celui, favorable à la société, d'un bien toujours croissant ; ou bien, comme concession extrême, qu'il est constant et ne décline jamais. Le cas d'un cours toujours plus défavorable est habituellement exclu. En général, les oscillations que l'on ne peut nier sont supposées anormales, accessoires, accidentelles ; chacune a une cause que l'on pourrait (§ 134) et que l'on devrait faire disparaître, ce qui ferait disparaître aussi l'oscillation. Les dérivations sous cette forme générale ne sont pas habituelles. Sous la forme suivante, elles sont au contraire très usitées. Il est aisé de connaître la cause de ce fait : elle réside simplement dans la tendance de l'homme à chercher son avantage et à fuir son désavantage.
§ 2335. (B-2.) On admet qu'il est possible de séparer les oscillations : qu'on peut conserver celles qui sont favorables, supprimer celles qui sont défavorables, en agissant sur leur cause. Presque tous les historiens admettent ce théorème, au moins implicitement, et se donnent beaucoup de mal pour nous enseigner comment les peuples auraient dû agir pour demeurer toujours dans des périodes favorables, et ne jamais passer à des périodes défavorables. Nombre d'économistes aussi savent et enseignent bénévolement comment on pourrait éviter les crises. Par ce nom ils désignent exclusivement la période descendante des oscillations [FN: § 2335-1] . Toutes ces dérivations sont fréquemment employées, quand on traite de la prospérité sociale (§ 2540 et sv.) ; elles sont chères à un très grand nombre d'auteurs, qui s'imaginent naïvement faire oeuvre scientifique, lorsqu'ils se livrent à des prêches moraux, humanitaires, patriotiques.
§ 2336. (B -3.) Uniquement pour mémoire, car nous avons dû en parler même trop, notons l'erreur consistant à transformer en rapports de cause à effet les rapports de mutuelle dépendance des phénomènes. Dans notre cas, on suppose que les oscillations d'un phénomène ont des causes propres, indépendantes des oscillations des autres phénomènes.
§ 2337. (B-4.) Précisément en négligeant la mutuelle dépendance, et en voulant trouver une cause aux oscillations d'un phénomène, on cherche cette cause dans la théologie, dans la métaphysique, ou dans des divagations qui n'ont d'expérimental que l'apparence. Les prophètes israélites trouvaient la cause des périodes descendantes de la prospérité d'Israël dans la colère de Dieu. Les Romains étaient persuadés que tout malheur qui frappait leur cité avait pour cause quelque transgression dans le culte des dieux ; il fallait la découvrir, puis offrir une compensation adéquate aux dieux, pour ramener la prospérité. Un très grand nombre d'historiens, même parmi les modernes, cherchent et trouvent des causes semblables dans la « corruption des mœurs », dans l'auri sacra fames, dans les transgressions aux règles de là morale, du droit, de l'humanitarisme, dans les péchés de l'oligarchie qui opprime le peuple, dans la trop grande inégalité des fortunes, dans le capitalisme, et ainsi de suite ; des dérivations semblables, il y en a pour tous les goûts [FN: § 2337-1] .
§ 2338. En réalité, les oscillations des diverses parties du phénomène social sont en rapport de mutuelle dépendance, à l'égal de ces parties même ; elles sont simplement des manifestations des changements de ces parties. Si l'on tient à se servir du terme fallacieux de cause, on peut dire que la période descendante est la cause de la période ascendante qui la suit, et vice-versa. Mais il faut entendre cela uniquement en ce sens que la période ascendante est indissolublement unie à la période descendante qui la précède, et vice-versa ; donc, en général : que les différentes périodes sont seulement des manifestations d'un seul et unique état de choses, et que l'observation nous les montre se succédant les unes aux autres, de telle sorte que suivre cette succession est une uniformité expérimentale [FN: § 2338-1] . Il existe divers genres de ces oscillations, selon le temps où elles se produisent. Ce temps peut être très court, court, long, très long. Ainsi que nous l'avons déjà remarqué (§ 2331), les oscillations très courtes sont habituellement accidentelles, en ce sens qu'elles manifestent des forces peu durables ; celles qui se produisent en un temps assez long manifestent habituellement, des forces assez durables. Étant donné que nous connaissons mal des temps très reculés, et vu l'impossibilité où nous sommes de prévoir l'avenir, les oscillations très longues peuvent perdre le caractère d'oscillation, et apparaître comme manifestant un cours qui se dirige toujours dans la même direction (§ 2392).
§ 2339. Revenons maintenant au problème particulier que nous nous sommes posé (§ 2329). Nous voyons que, pour le résoudre, nous devons appliquer notre attention aux forces agissant sur les diverses parties du phénomène social, entre lesquelles nous cherchons les rapports de mutuelle dépendance. Il convient de diviser ces forces en deux classes : 1° les forces qui naissent du contraste entre les théories et la réalité, de l'adaptation plus ou moins parfaite des premières à la seconde ; elles se manifestent dans les différences entre les sentiments et les résultats de l'expérience. Nous appellerons intrinsèque cet aspect du problème ; 2° les forces qui agissent de manière à modifier les sentiments ; elles proviennent des rapports dans lesquels se trouvent ces sentiments et d'autres faits, tels que l'état économique, l'état politique, la circulation des élites, etc. Nous appellerons extrinsèque cet aspect du problème (§ 2552).
§ 2340. 1° Aspect intrinsèque. Nous avons déjà commencé cette étude (§ 616 et sv., 1678 et sv.), que l'induction nous avait présentée ; maintenant nous la continuons. En un temps et pour les personnes dont les résidus de la persistance des agrégats (la chose A du § 616) ont diminué de force, tandis que ceux de l'instinct des combinaisons ont pris une nouvelle vigueur (tandis que la science expérimentale acquiert du crédit, disions-nous au § 616), les conclusions que l'on tire des premiers résidus paraissent en contradiction absolue avec la réalité, et l'on en conclut que ces résidus sont de « vieux préjugés », qu'on doit les remplacer par les résidus de l'instinct des combinaisons (§ 1679). On condamne inexorablement, au point de vue de la vérité expérimentale et à celui de l'utilité individuelle ou sociale, les actions non-logiques, auxquelles on veut substituer les actions logiques, qui devraient être dictées par la science expérimentale, mais qui, en réalité, sont souvent conseillées par une pseudo-science, et constituées par des dérivations de peu ou de point de valeur expérimentale. Habituellement, on exprime ce fait par la dérivation suivante ou par d'autres analogues : « La raison doit remplacer la foi, les préjugés ». On croit aussi que le sentiment exprimé par cette dérivation « démontre » que les résidus de la persistance des agrégats sont « faux », et ceux de l'instinct des combinaisons « vrais ». En un autre temps, où se produit un mouvement inverse, et où les résidus de la persistance des agrégats acquièrent une force nouvelle, tandis que décroît celle des instincts des combinaisons, on observe des phénomènes contraires (§ 1680). Les résidus de la persistance des agrégats qui sont affaiblis peuvent être utiles, indifférents, ou nuisibles à la société. Dans le premier cas, les dérivations de l'instinct des combinaisons, grâce auxquelles on repousse les résidus de la IIe classe, se trouvent en complète contradiction avec la pratique, car ils aboutiraient à donner à la société des formes qui ne lui conviennent pas, et qui pourraient même en provoquer la destruction. On sent cela par instinct plus qu'on ne le démontre par un raisonnement ; puis commence un mouvement en sens contraire à celui qui avait donné la prédominance aux résidus de la Ire classe : le pendule oscille dans la direction opposée, et l'on atteint un autre extrême. Parce que les conclusions tirées des résidus de la Ire classe sont parfois contredites par la réalité, on dit qu'elles le sont toujours, on les tient pour « fausses »; on étend aussi ce caractère aux principes même du raisonnement expérimental ; tandis que l'on ne tient pour « vrais », ou du moins pour « vérité supérieure », que les principes de la persistance des agrégats. Ces sentiments donnent naissance à un grand nombre de dérivations comme celles-ci : nous avons en nous des idées, des concepts qui dominent l'expérience ; l'« intuition » doit se substituer à la « raison » ; la « conscience doit revendiquer ses droits contre l'empirisme positiviste » ; « l'idéalisme doit remplacer l'empirisme, le positivisme, la science » ; cet idéalisme est seul la « vraie science ». On tient pour certain que, grâce à l'absolu, cette « vraie science » se rapproche de la réalité beaucoup plus que la science expérimentale, toujours contingente, et même qu'elle constitue la « réalité » ; que la science expérimentale, qui se confond avec la pseudo-science des dérivations des résidus de la Ire classe, est fallacieuse et nuisible. Autrefois, on avait ces opinions-là dans toutes les branches des connaissances humaines. Aujourd'hui, elles ont disparu, ou presque disparu des sciences physiques, dans lesquelles le dernier exemple remarquable fut celui de la Philosophie de la Nature, de Hegel ; mais elles persistent dans les sciences sociales. Elles furent éliminées des sciences physiques par le progrès de la science expérimentale, et parce qu'elles étaient inutiles. Elles persistent dans les sciences sociales, non seulement parce que l'étude expérimentale y est très imparfaite, mais surtout a cause de leur grande utilité sociale. En effet, il est de nombreux cas dans lesquels les conclusions tirées des résidus de la persistance des agrégats, obtenues grâce à l'« intuition », se rapprochent de la réalité plus que les conclusions tirées de l'instinct des combinaisons. Celles-ci constituent les dérivations de la pseudo-science, laquelle, en matière sociale, occupe la place de la science expérimentale. En outre, en de nombreux cas aussi, ces dérivations paraissent si nuisibles, que toute société qui ne veut pas tomber en décadence ou périr doit nécessairement les repousser. Mais les conséquences d'une prédominance exclusive des résidus de la IIe classe ne sont pas moins nuisibles, non seulement dans les arts et les sciences physiques, où cela est très évident, mais aussi en matière sociale, où il est facile de voir que, sans l'instinct des combinaisons et l'emploi du raisonnement expérimental, tout progrès est impossible. Par conséquent, il n'est pas possible de s'arrêter non plus à l'extrême où prédominent les résidus de la IIe classe. De rechef, une nouvelle oscillation se produit, qui nous ramène vers l'extrême où dominent les résidus de la Ire classe : ainsi le pendule continue indéfiniment à osciller.
§ 2341. On peut décrire ces mêmes phénomènes sous d'autres formes, qui en font ressortir des aspects remarquables. Nous arrêtant à la surface, nous pouvons dire que dans l'histoire on voit une époque de foi suivie d'une époque de scepticisme, à laquelle fait suite une autre époque de foi, et de nouveau, une autre époque de scepticisme, et ainsi de suite [FN: § 2341-1] (§ 1681). La description n'est pas mauvaise, mais les termes de foi et de scepticisme pourraient induire en erreur, si l'on voulait faire allusion à une religion spéciale, ou même à un groupe de religions. Pénétrant davantage dans la matière, nous pouvons dire que la société a pour fondement des persistances d'agrégats. Celles-ci se manifestent par des résidus qui, au point de vue logico-expérimental, sont faux et parfois manifestement absurdes. Par conséquent, lorsque le point de vue de l'utilité sociale prédomine, au moins en partie, les doctrines favorables aux sentiments de la persistance des agrégats sont acceptées d'instinct ou autrement. Quand prédomine, ne fût-ce qu'en petite partie, le point de vue logico-expérimental, ces doctrines sont repoussées, et sont remplacées par d'autres qui, en apparence, mais rarement en fait, concordent avec la science logico-expérimentale. Ainsi l'esprit des hommes oscille entre deux extrêmes, et comme il ne peut s'arrêter ni à l'un ni à l'autre, le mouvement continue indéfiniment. Il serait possible qu'il eût un terme, au moins pour une partie de l'élite intellectuelle, si les membres de celle-ci voulaient bien se persuader qu'une foi peut être utile à la société, quoique fausse ou absurde expérimentalement (§ 1683, 2002). Ceux qui observent seulement les phénomènes sociaux ou qui raisonnent de la foi d'autrui, et non de la leur propre, peuvent avoir cette opinion. En effet, nous en trouvons des traces chez les hommes de science ; nous la trouvons aussi, plus ou moins explicite, plus ou moins voilée, chez les hommes d'État guidés par l'empirisme. Mais le plus grand nombre des hommes, ceux qui ne sont ni exclusivement des hommes de science, ni des hommes d'État éminents, qui ne dirigent pas, mais sont dirigés, et qui surtout raisonnent de leur propre foi plus que de celle d'autrui, peuvent difficilement avoir cette opinion, soit à cause de leur ignorance, soit parce qu'il y a contradiction patente entre le fait d'avoir une foi qui pousse à une action énergique, et le fait de l'estimer absurde. Cela n'exclut absolument pas que le cas puisse parfois aussi se produire, mais il demeure très exceptionnel. Enfin, si nous voulons résumer en peu de mots les raisonnements exposés tout à l'heure, nous dirons que la « cause » de l'oscillation est non seulement le défaut de connaissances scientifiques, mais surtout le fait que l'on confond deux choses distinctes : l'utilité sociale d'une doctrine et son accord avec l'expérience. Il nous est arrivé plusieurs fois déjà de devoir relever combien grande est cette erreur et combien elle nuit à l'étude des uniformités des faits sociaux.
§ 2342. Le mouvement indiqué ne se produit pas pour les personnes soustraites à la considération de l'un des extrêmes. Un très grand nombre de personnes vivent satisfaites de leur foi, et ne se donnent nul souci de la faire concorder avec la science logico-expérimentale. D'autres, très peu nombreuses, vivent dans les nuages de la métaphysique ou de la pseudo-science, et ne se soucient pas des nécessités pratiques de la vie. Un grand nombre de personnes se trouvent dans des situations intermédiaires, et participent plus ou moins au mouvement oscillatoire.
§ 2343. 2° Aspect extrinsèque. Ces considérations ont un défaut qui pourrait devenir la source de graves erreurs. Elles induisent à supposer implicitement que, dans le choix des dérivations, les hommes se laissent guider par la logique ou par une pseudo-logique. C'est ce que l'on pourrait comprendre, quand nous disons qu'animés de certains sentiments, ils acceptent certaines dérivations comme une conséquence logique. Ce fait a lieu uniquement pour un petit nombre d'entre eux, tandis que le plus grand nombre est poussé directement par les sentiments à faire siens les résidus et les dérivations. L'aspect intrinsèque étudié tout à l'heure est important pour la théorie des doctrines, mais non pour la théorie des mouvements sociaux. Ceux-ci ne sont pas une conséquence de celles-là : c'est plutôt le contraire. Il faut donc mettre en rapport avec d'autres faits celui de l'alternance d'époques de foi et d'époques de scepticisme (§ 2336, 2337).
§ 2141. Commençons, comme d'habitude, par suivre la méthode inductive. Le phénomène que nous voulons maintenant étudier est semblable à celui des oscillations économiques (§ 2279 et sv.) ; on y observe des oscillations d'intensité diverse. Négligeons les plus petites ; arrêtons-nous aux plus grandes, et même à celles qui sont de beaucoup les plus grandes, afin d'avoir une idée grossièrement approximative des faits. Recherchons les oscillations des résidus dans l'ensemble de la population ; par conséquent, les oscillations dans la partie intellectuelle, des littérateurs, des philosophes, des pseudo-savants, des savants, n'ont que la valeur d'indices ; par elles-mêmes elles ne signifient rien ; il faut qu'elles soient largement acceptées par la population pour en indiquer les sentiments. Le fait des ouvrages d'un Lucien, qui apparaît comme une île de scepticisme au milieu d'un océan de croyances, a une valeur presque nulle, tandis que le fait des ouvrages d'un Voltaire, à cause du grand crédit dont ils jouirent, apparaît comme un continent de scepticisme, et mérite par conséquent d'être tenu pour un indice important. Tous ces moyens sont imparfaits, même plus imparfaits que ceux dont on peut se servir pour évaluer les oscillations économiques, lorsque des statistiques précises font défaut ; mais nous devons nous en contenter, puisque nous ne pouvons obtenir mieux, au moins pour le moment.
§ 2345. ATHÈNES. Si nous portons notre attention sur l'état d'Athènes, de la guerre médique à la bataille de Chéronée, nous avons tout d'abord une époque où, dans l'ensemble de la population, il existe en grande quantité des résidus de la persistance des agrégats, tandis que dans la classe gouvernante se trouvent à foison des résidus de l'instinct des combinaisons. Désignons par (1) l'époque de la bataille de Marathon [FN: § 2345-1] (490 av. J.-C.), et désignons par a b l'intensité des résidus de la persistance des agrégats, dans l'ensemble de la population.
Nous avons des faits remarquables, comme celui de la condamnation de Miltiade après l'expédition de Paros (489 av. J.-C.), qui nous montrent l'écart entre les résidus de la persistance des agrégats, chez la classe gouvernée et chez ses chefs. Ensuite, comme dit Aristote [FN: § 2345-2] , durant dix-sept années après la guerre médique, la constitution fut aux mains de l'Aréopage, c'est-à-dire qu'elle se désagrégea peu à peu. On arriva ainsi à la réforme d'Ephialte (460 av. J.-C.), laquelle dépouilla l'Aréopage de ses attributions constitutionnelles. Nous avons un excellent indice du mouvement intellectuel de ce temps dans l'Orestie d'Eschyle (458 av. J.-C.). Il est impossible de n'y pas voir clairement le reflet de la lutte entre ceux qui restaient fidèles aux résidus de la persistance des agrégats, et ceux qui y substituaient les résidus des combinaisons [FN: § 2345-3] . Les premiers furent complètement vaincus. Par conséquent, le point (2) correspondant à 458 av. J.-C. doit se trouver sur une partie fortement descendante de la courbe [FN: § 2345-4] . Mais celle-ci descendait encore plus pour les gouvernants. Périclès se soustrayait aux « préjugés » populaires [FN: § 2345-5] , et préparait la puissance d'Alcibiade. Ensuite il se produisit une petite réaction, et les sceptiques amis de Périclès furent persécutés. Anaxagore dut s'en aller d'Athènes [FN: § 2345-6] (431 av. J.-C.). Au point (3) correspondant à cette époque, la courbe se redresse un peu, puis elle redescend ; nous en avons une preuve patente dans les trois comédies d'Aristophane : les Acharniens (425 av. J.-C.), les Chevaliers (424 av. J.-C.), les Nuées (423 av. J.-C.). Ces comédies, à l'instar de l’Orestie, nous font voir la lutte entre les partisans et les destructeurs des persistances d'agrégats. Ce n'est pas seulement la différence entre la tragédie et la comédie qui est cause des manières différentes dont cette lutte apparaît dans l'Orestie et dans les trois comédies d'Aristophane, mais bien la grande différence entre l'intensité des résidus de la IIe classe chez le peuple, au temps de la trilogie d'Eschyle, et au temps des comédies mentionnées. Désormais la mythologie est vaincue, et la lutte se donne dans le domaine de la métaphysique et de la politique [FN: § 2345-7] . Nous assignerons donc un point (4) à l'année 424 av. J.-C. Il correspondra à une nouvelle descente de la courbe. Ce mouvement continue jusqu'au fait de Mélos (416 av. J.-C.) indiqué par (5), et qui doit être certainement voisin d'un minimum, autant pour les gouvernés que pour les gouvernants. On n'avait jamais disserté plus cyniquement [FN: § 2345-8), laissant de côté toute conception religieuse, morale, de justice. Ajoutons que c'était le temps où Alcibiade était maître d'Athènes. Dans la suite, on a une très petite réaction, lorsque Alcibiade est accusé d'avoir profané les mystères (415 av. J.-C.). On a une plus grande réaction au temps du procès de Socrate [FN: § 2345-9] (339 av. J.-C.), que nous désignons par (6). Plus tard, nous n'avons pas d'indice qui montre de grands changements dans le peuple, jusqu'à la bataille de Chéronée (338 av. J.-C.), que nous désignons par (7), bataille qui met fin à l'indépendance d'Athènes, et en confond l'histoire avec celle du reste de la Grèce, jusqu'à la conquête romaine.
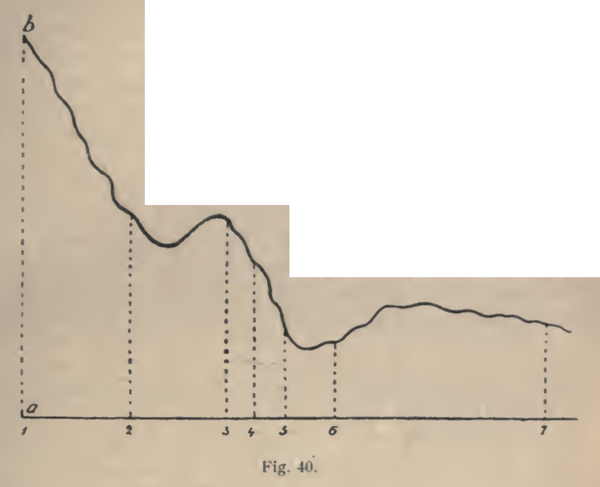
Figure 40
§ 2346. Pour la classe intellectuelle, la descente continue ; elle est le plus remarquable au temps que l'on a nommé celui des sophistes. Comme c'est l'habitude pour d'autres termes semblables, celui-ci est si indéterminé qu'on n'en connaît pas la signification précise. Avec les années, il a peu à peu pris le sens de personne qui fausse les raisonnements en vue d'un but personnel, ainsi il a reçu une forte teinte éthique. Comme nous ne traitons pas ici d'éthique, il ne peut pas nous servir. Il ne nous importe vraiment pas du tout de distinguer les gens qui se faisaient payer pour donner des leçons de raisonnement, de ceux qui les donnaient gratis. Il nous importe, au contraire, de distinguer les gens qui visaient à saper les persistances d'agrégats, à substituer les actions logiques aux actions non-logiques, à déifier la Raison, des gens qui défendaient ces persistances d'agrégats, étaient favorables à la tradition, aux actions non-logiques, ne sacrifiaient pas à la déesse Raison. Uniquement pour nous entendre, nous appellerons A les premiers, B les seconds.
§ 2347. Plusieurs auteurs opposent Socrate aux sophistes ; d'autres le rangent parmi ceux-ci. On ne peut trancher cette controverse, si d'abord on ne définit ce terme de sophiste. Ici nous ne voulons pas nous en occuper. Mais pour nous, il est certain que Socrate et Platon aussi doivent être rangés dans la catégorie A, puisque tous deux visent à saper les persistances d'agrégats existant à Athènes, et à y substituer des produits de leur raisonnement. Les moyens employés peuvent être différents de ceux de Protagoras, de Gorgias, de Prodicos et d'autres ; la fin, consciemment ou non, est la même.
§ 2348. Habituellement, les auteurs s'indignent et se plaignent parce que, dans les Nuées, Aristophane nomme Socrate. Ils peuvent avoir raison au point de vue éthique ; ils ont tort au point de vue logico-expérimental des doctrines, et à celui de l'utilité sociale. Il est bien vrai que Socrate, comme le dit Aristophane, et que Platon surtout, visaient à détrôner le Zeus de la tradition mythologique, pour donner le pouvoir aux Nuées de leur métaphysique. Le démon de Socrate est pour le moins cousin de la déesse Raison, et frère de la « conscience » de nos protestants libéraux. Quant à Platon, il croit à l'omnipotence de la déesse Raison, au point de s'en remettre à elle seule pour créer de toutes pièces une république d'hommes en chair et en os. Au point de vue de l'utilité sociale, il est manifeste que de cette façon on ébranle les fondements des actions non-logiques sur lesquelles repose la société. Ce ne sont pas les doctrines indiquées qui peuvent produire cet effet ; au contraire, elles sont un effet concomitant de celui de la désagrégation sociale. C'est pourquoi la condamnation de Socrate fut inutile, et par conséquent stupide, perverse, criminelle, comme le furent et continuent à l'être les condamnations de gens qui manifestent des opinions tenues pour hérétiques par leurs contemporains. Mais nous avons déjà suffisamment parlé de tout cela (§ 2196 et passim) ; il n'est pas nécessaire de nous y arrêter plus longtemps.
§ 2349. À première vue, il paraît y avoir une très grande différence entre un athée, tel qu'il apparaît dans une tragédie de Critias [FN: § 2349-1], et un homme religieux, tel que semble l'être Platon. Au point de vue de l'éthique, cela peut être, mais non à celui de l'utilité sociale, à laquelle importent surtout certains caractères communs chez le Sisyphe de Critias et le Socrate de la République de Platon. Aucun des deux n'accepte les dieux de la tradition : ils les façonnent à leur manière, ils trahissent les persistances d'agrégats en les transformant. Sisyphe dit qu'il « lui semble qu'à l'origine il a existé un homme avisé et sage », lequel imagina les dieux pour contenir les hommes dans le devoir. Mais précisément cet homme sage est aussi le Socrate de la République, lequel, s'il ne crée pas de toutes pièces les dieux, façonne d'autre part à sa manière ceux de la tradition, exactement dans le même but que le législateur de Sisyphe, c'est-à-dire pour rendre les hommes meilleurs. Ce procédé est à relever, parce qu'il est général. Nos modernistes ont tendance à s'en servir ; les protestants libéraux en usent nettement, en façonnant à leur manière le Christ de la tradition, et en le transformant en un produit de leur imagination. Il y a là un cas particulier du phénomène indiqué comme aspect intrinsèque (§ 2340). Lorsque, dans l'esprit de certains intellectuels, la conception traditionnelle de certaines persistances d'agrégats heurte une autre conception que leur pseudo-science estime meilleure pour l'utilité sociale, ils suivent l'une des deux voies qui aboutissent au même but. En d'autres termes, ou bien ils déclarent entièrement fausses et vaines les persistances d'agrégats traditionnelles, ou bien ils les modifient, les transforment, les façonnent à leur manière ; et ils ne s'aperçoivent pas que, de la sorte, ils les détruisent ; car les manifestations qu'ils estiment être accessoires sont au contraire essentielles pour les persistances d'agrégats, et les supprimer revient à vouloir faire vivre un homme à qui l'on a enlevé le corps. Les dieux d'Homère, auxquels s'en prend Platon, ont été vivants dans l'esprit de millions et de millions d'hommes. Le dieu de Platon n'a jamais été vivant : il est demeuré le fantôme littéraire d'un petit nombre de songe-creux.
§ 2350. Les variations dans l'intensité des résidus de la Ire et de la IIe classe ne semblent pas avoir de rapport avec le régime démocratique ou le régime aristocratique [FN: § 2350-1]. Dans l'aristocratie, nous trouvons un Nicias, chez lequel prédominent les résidus de la IIe classe, un Périclès, chez lequel prédominent les résidus de la Ire classe, un Alcibiade, où ces derniers se trouvent presque seuls, et Alcibiade ressemble à nos ploutocrates démagogues contemporains. Le régime des Trente tyrans fut indulgent envers Socrate, auquel il se contenta d'adresser une verte admonestation, tandis que le régime démocratique le condamna à boire la ciguë.
§ 2351. Les variations indiquées ne semblent pas non plus avoir de rapports avec l'état de la richesse ; car, si l'affaiblissement des résidus de la IIe classe se produit lorsque Athènes est riche, les réactions ont lieu aussi quand elle continue à être riche. Enfin, lorsqu'elle devient pauvre, on ne voit pas que les résidus de la IIe classe reprennent beaucoup de vigueur. Au temps de la conquête de la Grèce par les Romains, Athènes n'est pas revenue à l'état où elle était au temps de Marathon. Les variations mentionnées semblent bien avoir quelque rapport avec le rapide accroissement de la richesse, que l'on voit uni à un affaiblissement des résidus de la IIe classe, ainsi qu'à la réaction subséquente [FN: § 2351-1] ; mais ce pourrait être une simple coïncidence : il faut chercher d'autres faits avant de rien conclure à ce sujet.
§ 2352. Les variations indiquées sont concomitantes avec celles que nous avons vu se produire suivant l'aspect intrinsèque (§ 2340 et sv.); mais nous ne pouvons pas dire dans quel rapport elles se trouvent entre elles. Il est probable qu'il y a plusieurs de ces rapports. Peut-être un Anaxagore, un Socrate, un Platon, ont-ils été poussés par des causes de l'aspect intrinsèque ; mais il est très peu probable que ces causes aient agi sur un Critias ou sur un Alcibiade, pour ne pas parler des Athéniens qui discutaient avec les Méliens (§ 2345-8).
§ 2353. ROME. Il ne nous est pas donné de connaître avec précision quel fut l'état de Rome avant la seconde guerre punique. Des faits innombrables démontrent qu'il faut faire peu de cas des déclamations des auteurs sur le « bon vieux temps ». Il y a eu probablement alors des vices à Rome, comme il y en eut ensuite ; seulement ils étaient moins connus, parce qu'ils sévissaient sur une scène moins apparente, entre des limites plus restreintes, et que les littérateurs manquaient pour nous en conserver le souvenir. Les légendes nous font voir aussi des vices, sans qu'on puisse savoir quel rapport ils avaient avec la réalité historique.
§ 2354. Il est certain qu'au IIe siècle avant J.-C., deux faits concomitants se produisent à Rome : un accroissement très rapide de la prospérité économique, et une décroissance des résidus de persistance des agrégats dans le peuple, mais beaucoup plus dans les classes élevées [FN: § 2354-1] (§ 2545 et sv.). Cette action est suivie d'une réaction, comme à Athènes, ainsi qu'il apparaît en d'autres phénomènes semblables que nous étudierons. Les différences résident principalement dans la nature et dans l'intensité de la réaction. L'action et la réaction apparaissent donc unies, et c'est leur ensemble qu'il faut mettre en rapport avec les variations de la richesse (§ 2351-1) et avec les variations de la circulation des élites.
§ 2355. Les auteurs ont vu les faits ; mais, entraînés comme d'habitude par la manie des considérations éthiques, ils n'ont pu comprendre dans quel rapport ces faits se trouvaient (§ 2539 et sv.). Il y a plusieurs principes éthiques dont les historiens font grand usage, sans s'être jamais donné la peine de les vérifier par les faits. L'un de ces principes est que la richesse engendre la corruption des mœurs. Il suffit de jeter un coup d'œil autour de soi pour voir que la riche Angleterre n'est pas plus corrompue que des provinces russes misérables, et que les mœurs du peuple piémontais aisé ne sont pas pires que celle du peuple misérable de la Sardaigne, ou d'un autre peuple semblable des provinces méridionales. Si l'on voulait établir une comparaison pour le peuple italien, à diverses époques, qui oserait affirmer que les mœurs de Milan ou de Venise sont actuellement pires qu'elles n'étaient il y a un siècle ? Pourtant, la richesse de ces villes s'est énormément accrue. On trouve un autre principe en paraphrasant le mot de Pline : Latifundia perdidere Italiam (§ 2557). L'accroissement de l'inégalité des richesses est présumé on ne le démontre pas, parce qu'on ne peut le démontrer. On croit le rendre évident en citant des exemples de citoyens très riches ; mais cela ne suffit pas, parce qu'il faut encore savoir si la richesse des autres classes sociales ne s'est pas accrue dans les mêmes proportions. De nombreux faits montrent que ce cas est au moins possible. En outre, nous manquons entièrement de preuves établissant qu'un pays ayant des citoyens très riches soit nécessairement en décadence. Après les guerres napoléoniennes, nous trouvons en Angleterre en même temps de vastes latifundia des lords et une prospérité très grande. Aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, les trusts correspondent précisément aux latifundia romains, et se trouvent unis à une prospérité telle qu'on n'en a encore jamais vu. Négligeons le capitalisme qui, expliquant tout (§ 1890), explique aussi la décadence de Rome et d'autres pays. Pour certains auteurs, le régime démocratique explique la décadence d'Athènes ; et pour d'autres, le régime aristocratique celle de Rome.
§ 2356. Duruy prend occasion de la transformation de la société romaine, après les guerres puniques, pour faire un peu de morale (§ 2558). Il dit : [FN: § 2356-1] « (p. 224) ...Nous dirons, avec la sagesse des nations, que la richesse qui n'est pas le fruit du travail et de toutes les vertus qui y tiennent ne profite pas à ses possesseurs ; que la fortune mal acquise s'en va comme elle est venue, en laissant derrière elle beaucoup de ruines morales ; et nous ajouterons avec l'expérience des économistes [FN: § 2356-2] , que l'or est comme l'eau d'un fleuve : s'il inonde subitement, il dévaste ; (p. 225) s'il arrive par mille canaux où il circule lentement, il porte partout la vie [FN: § 2356-3) ». Donc, mes chers enfants, pour conclure une si belle parabole, à laquelle il ne manque que d'être mise en vers ou en musique, soyez bons, vertueux, et travaillez ; ainsi, vous vivrez heureux. Mais ne lisez pas l'histoire, parce que vous auriez de la peine à eu faire correspondre les faits avec ces affirmations. Voici, par exemple, Corinthe, où la richesse était certainement beaucoup plus le fruit du travail, beaucoup moins celui de la conquête, qu'elle ne le fut à Rome. Pourtant elle fut vaincue et saccagée par les Romains. Si la richesse « qui n'est pas le fruit du travail... ne profite pas à ses possesseurs », c'est le contraire qui aurait dû se produire. S'il est vrai que « la fortune mal acquise s'en va comme elle est venue », et que la richesse des Romains fut « mal acquise », comment se fait-il qu'ils en jouirent si longtemps encore après l'époque pour laquelle Duruy fait ses observations ? et qu'ils n'en furent dépouillés que par les barbares, lesquels n'acquéraient certainement pas la richesse par le travail, mais bien par la conquête et les pillages ?
§ 2357. Il faut donc ôter tous ces voiles dont les historiens enveloppent leurs récits, et s'efforcer de parvenir jusqu'aux faits eux-mêmes. Ce faisant, on ne peut nier les deux faits relevés au § 2354, et qui sont semblables à d'autres, observés déjà pour Athènes. Comme nous en trouverons encore d'autres semblables, nous devrons rechercher si, au lieu de simples coïncidences, il peut y avoir un rapport de mutuelle dépendance.
§ 2358. À Rome comme à Athènes (§ 2345 et sv.), plusieurs réactions se produisirent contre l'affaiblissement de la persistance des agrégats. Elles changèrent momentanément la direction générale du mouvement. Celle qui eut lieu à Rome, au temps de Caton le Censeur, fut remarquable. Elle fut de courte durée, et bientôt le mouvement reprit sa marche générale.
§ 2359. Une circonstance spéciale rend difficile l'étude du phénomène à Rome, depuis le temps de la conquête de la Grèce jusqu'à la fin de la République : c'est l'influence intellectuelle de la Grèce sur la classe cultivée romaine, qui nous empêche de séparer d'une manière sûre des imitations de la littérature, de la philosophie, de la science grecques le produit spontané des esprits latins. Par exemple, si nous ne connaissions que le poème de Lucrèce, nous ne saurions quelle valeur lui attribuer comme indice des conceptions de la classe cultivée romaine. Mais ce doute se dissipe grâce au fait que nous connaissons le De natura deorum et le De divinatione de Cicéron, et à cause d'un grand nombre d'autres faits littéraires et historiques. Tous ces faits nous induisent à conclure que, vers la fin de la République, plusieurs persistances d'agrégats s'étaient beaucoup affaiblies dans la classe cultivée de Rome.
§ 2360. Elles s'étaient beaucoup moins affaiblies dans la classe populaire [FN: § 2360-1]. C'est là un phénomène général dont on possède de nombreux exemples. En outre, cette classe populaire elle-même se transformait par l'adjonction d'éléments étrangers, spécialement d'éléments orientaux, qui apportaient à Rome leurs propres habitudes intellectuelles. Nous trouvons là l'une des plus grandes causes de la différence de l'évolution intellectuelle à Athènes et à Rome.
§ 2361. Le minimum de la persistance des agrégats dans la classe cultivée romaine, et peut-être aussi dans le peuple, semble avoir été atteint au temps qui sépare Horace de Pline le Naturaliste ; mais nous n'en avons aucune preuve. Ensuite commence un mouvement général ascendant [FN: § 2361-1] , présentant des ondulations de détail, et qui durera jusqu'au moyen âge.
§ 2362. Dans les classes supérieures, au temps d'Hadrien, il se produisit une réaction, dans le sens d'un accroissement des instincts des combinaisons, ou, si l'on préfère, avec une tendance opposée à l'accroissement des persistances d'agrégats. Ce fut lorsque les sophistes grecs acquirent, pour peu de temps, un grand crédit à Rome. Cette réaction se poursuivit au début du règne de Marc Aurèle. Cette invasion de l'art sophistique n'est semblable qu'en petite partie à celle qu'on observe à Athènes (§ 2346 et sv.), surtout parce qu'à Rome elle se limita à un petit nombre d'intellectuels (§ 1535). Il manqua un Socrate pour la faire descendre dans le peuple, ou, pour mieux dire, il manqua au peuple les dispositions à l'accepter. La plèbe cosmopolite de Rome, en ce temps-là, n'avait rien de commun, en fait d'intelligence et de culture, avec le peuple athénien du temps de Socrate.
§ 2363. Ensuite, le mouvement général de renforcement des persistances d'agrégats s'accéléra. Chez les auteurs païens, c'est-à-dire chez les personnes qui demeurent le plus attachées aux conceptions traditionnelles des races gréco-latines, il est beaucoup plus lent que chez les auteurs chrétiens, lesquels acceptent les rêveries des religions orientales. Jusque dans Macrobe, qui vivait au Ve siècle, il y a beaucoup plus de bon sens, un sentiment de la réalité bien plus grand, que chez Tertullien, qui vivait au IIIe siècle, que chez Saint Augustin, qui vivait au IVe siècle, et que chez d'autres semblables auteurs.
§ 2364. Déjà chez Polybe, et davantage au temps de Pline et de Strabon, on voit que les gens cultivés avaient quelque idée de la possibilité d'un état intermédiaire, ainsi que nous l'avons indiqué au § 2341. À ce point de vue, les auteurs de ce temps se rapprochaient beaucoup plus de la réalité expérimentale qu'un grand nombre de nos auteurs contemporains, qui vont à l'un ou à l'autre extrême, où il n'est pas possible de s'arrêter. Il se peut qu'une certaine, intuition, même en partie erronée, de la possibilité d'un état intermédiaire, ait exercé une influence dont l'effet fut de laisser quelques auteurs païens dans une certaine indifférence, à l'égard des fables des religions orientales qui envahissaient l'Empire romain. Ils ne croyaient pas qu'elles pussent parvenir jusqu'aux classes intellectuellement supérieures, et peut-être ne se seraient-ils pas trompés, si ces classes avaient subsisté telles qu'ils les connaissaient ; mais elles déclinèrent rapidement. Ce ne furent pas les superstitions orientales qui s'élevèrent au niveau des classes supérieures : ce furent celles-ci qui s'abaissèrent au niveau de celles-là.
§ 2365. La cause principale d'un tel phénomène doit être recherchée dans la circulation des élites, qui sera étudiée plus loin (§ 2544 et sv.). Supposons qu'après le règne d'Hadrien Rome ait continué à s'enrichir, comme elle s'enrichissait à la fin de la République et au commencement de l'Empire, et que, comme alors, les classes dirigeantes fassent demeurées ouvertes à ceux qui possédaient en abondance des instincts des combinaisons, et de ce fait gagnaient des fortunes ; alors les élites auraient pu se maintenir au-dessus de l'état dans lequel les persistances d'agrégats prédominent de beaucoup. Mais, au contraire, l'Empire allait s'appauvrissant, la circulation des élites s'arrêtait, l'instinct des combinaisons se manifestait par des intrigues dont le but était d'obtenir les faveurs de l'empereur ou d'autres personnages puissants. Par conséquent, il se produisait un mouvement tout à fait contraire à celui qu'on observe vers la fin de la République et au commencement de l'Empire. L'étude des deux mouvements opposés conduit ainsi à une conclusion unique.
§ 2366. En Occident, après les invasions barbares, il y a peut-être encore une lueur de science dans le clergé ; mais il est certain qu'elle disparaît entièrement dans le reste de la population, qui finit par ne plus même savoir écrire. Nous ne pouvons pas savoir quand le maximum de cette misère intellectuelle fut atteint, parce que les documents nous font défaut. Au temps de Grégoire de Tours (VIe siècle), l'ignorance semble vraiment considérable [FN: § 2366-1] . Selon le mouvement ondulatoire habituel, nous avons une petite oscillation, dans le sens d'un accroissement des connaissances intellectuelles, au temps de Charlemagne ; puis le mouvement général de descente reprend.
§ 2367. Mais voici que, vers la fin du XIe et le commencement du XIIe siècle, une petite renaissance intellectuelle se produit dans les classes cultivées, ainsi qu'un intense mouvement d'action et de réaction, en ce qui concerne les persistances d'agrégats, dans certaines populations. Le mouvement intellectuel donne naissance à la philosophie Scholastique [FN: § 2367-1]. Il fait son apparition dans le clergé, car le clergé était alors la seule classe cultivée. Il est provoqué par les forces que nous avons appris à connaître en considérant l'aspect intrinsèque (§ 2340). Dans la population, le mouvement se divise en deux : 1° un lent affaiblissement des sentiments religieux; 2° une violente réaction, qui renforce ces sentiments. Le premier mouvement se produit encore surtout dans le clergé, pas dans la partie intellectuelle, mais bien dans celle qui appartenait à la classe gouvernante. C'est là un cas particulier du phénomène général de l'affaiblissement des persistances d'agrégats dans les élites ou dans les aristocraties. Le second mouvement se produit surtout dans la classe gouvernée et la moins cultivée. C'est aussi un cas particulier du phénomène général, dans lequel on voit partir du peuple la réaction en faveur des persistances d'agrégats.
§ 2368. Le nominalisme et le réalisme sont deux théories métaphysiques, par conséquent indéfinies au sens expérimental. Si l'on part d'un concept indéfini, on peut tirer des conséquences diverses, suivant la voie que l'on sait. Si nous prenons garde au fait qu'en attribuant l' « existence » aux individus seuls, le nominalisme semblait vouloir envisager exclusivement les entités expérimentales, et si nous nous engageons dans la voie qui s'ouvre ainsi devant nous, nous pouvons considérer la doctrine logico-expérimentale comme l'extrême du nominalisme, dont on a fait disparaître les accessoires métaphysiques (§ 64). Mais, du noyau, indéfini au point de vue expérimental, du nominalisme, d'autres voies s'ouvrent à nous. Saint Anselme nous en indique une, lorsqu'à propos des nominalistes il dit qu'il y a des dialecticiens hérétiques qui « estiment que les substances universelles ne sont que souffle de voix » [FN: § 2358-1] , ce qu'on peut entendre dans ce sens qu'il ne faut tenir aucun compte des abstractions, ni des persistances d'agrégats qu'elles expriment. Si nous continuons dans cette voie, nous atteindrons l'extrême où les résidus de ces persistances sont considérés comme de « vieux préjugés » (§ 616, 2340), que l'homme raisonnable ne doit tenir que pour de vaines fables.
§ 2369. De même, en partant du réalisme indéfini, on peut, mais plus difficilement, arriver à la considération des actions non-logiques, ce qui nous rapprocherait de la réalité ; et d'autre part l'on peut très facilement atteindre l'extrême où l'on substitue la métaphysique à l'expérience, et où l'on crée des entités imaginaires, en transformant en réalités les abstractions et les allégories (§ 1651).
§ 2370. Les secondes des voies indiquées, aussi bien pour le nominalisme que pour le réalisme, sont celles qui se rapprochent le plus des conséquences pratiques que les gens tiraient de ces doctrines. C'est pourquoi, en examinant les faits sous cet aspect, nous pouvons dire que la dispute entre le nominalisme et le réalisme met en opposition les deux extrêmes indiqués au § 2340. Quand dominent les persistances d'agrégats, les espèces et les genres acquièrent l'« existence » métaphysique, et l'on a la solution réaliste. Mais celle-ci vient donner contre les écueils de l'expérience. Alors on nie l' « existence » métaphysique des espèces et des genres : on dit que seul l' « individu » existe, et l'on a la solution nominaliste. Une solution intermédiaire qui, si elle n'était pas entièrement métaphysique, pourrait nous rapprocher de la position qui se trouve entre les extrêmes des oscillations, est celle du « conceptualisme », qui reconnaît l' « existence » de l'espèce et du genre, sous forme de concepts.
§ 2371. Victor Cousin [FN: § 2371-1] affirme que le conceptualisme d'Abélard est un simple nominalisme. Il se peut qu'il ait raison dans le domaine de la métaphysique, où nous ne voulons pas entrer. Nous ne nous soucions pas plus de discuter sur l' « existence » du genre, de l'espèce, de l'individu, que nous ne songeons à discuter sur les belles formes du sphinx de Thèbes. Les métaphysiciens – bien heureux sont-ils ! – savent ce que veut dire ce terme : exister. Nous ne le savons pas, et n'avons pu l'apprendre d'eux, parce que nous n'entendons rien à leurs discours, et parce que nous ne sommes pas parvenu à trouver un juge de leurs interminables controverses (§ 1651). Laissons donc entièrement de côté ces genres de recherches, et bornons-nous à celles où l'on a pour juge l'expérience.
§ 2372. Au point de vue expérimental, la solution du conceptualisme contient un peu plus – à la vérité pas beaucoup plus – de parties réelles que le nominalisme, mais beaucoup plus que le réalisme. V. Cousin dit : « (p. CLXXX) ...examinons le conceptualisme en lui-même, et nous reconnaîtrons aisément que ce n'est pas autre chose qu'un nominalisme plus sage [que peut bien être une théorie plus sage qu'une autre ?] et plus conséquent. D'abord, le nominalisme renferme nécessairement le conceptualisme. Abélard argumente ainsi contre son ancien maître [Roxelin] : Si les universaux ne sont que des mots, ils ne sont rien du tout ; car les mots ne sont rien ; mais les universaux sont quelque chose : ce sont des conceptions ». Roxelin aurait très bien pu répondre : « Qui a jamais songé à nier cela ? Assurément, quand la bouche prononce un mot, l'esprit y attache un sens, et ce sens qu'il y attache est une conception de l'esprit. Je suis donc conceptualiste comme vous. Mais vous, pourquoi n'êtes-vous pas nominaliste comme moi ? Dire que les universaux ne sont que des conceptions de l'esprit, c'est dire implicitement qu'ils ne sont que des mots ; car, dans mon langage, les mots sont les opposés des choses [voilà précisément son erreur ; les mots manifestent aussi des états psychiques qui sont des choses pour qui les observe de l'extérieur [FN: § 2372-1]]. et, n'admettant pas que les universaux soient des choses, j'ai dû en faire des mots. Je n'ai rien voulu dire de plus ; rejetant le réalisme, j'ai conclu au nominalisme, en sous-entendant le conceptualisme ». C'est possible ; mais, par malheur, ce qu'il sous-entendait était tout aussi important que ce qu'il exprimait.
§ 2373. En effet, si au lieu de rester dans les régions nébuleuses de la métaphysique, V. Cousin avait daigné descendre dans le domaine expérimental, il aurait vu qu'il ne s'agit pas seulement de savoir si les universaux ou, en général, les abstractions sont ou non autre chose que des mots, mais qu'il s'agit d'une question de bien plus grande importance : de savoir à quels états psychiques correspondent ces mots, et surtout s'ils manifestent des persistances d'agrégats plus ou moins puissantes, ou bien de simples jeux de la fantaisie. La socratité, dont les scholastiques nous disent que Socrate est une manifestation, n'est qu'un mot, comme la justice, sur laquelle on disserte depuis si longtemps, sans avoir jamais pu la définir ; mais le premier de ces mots correspond à une abstraction métaphysique qui n'a jamais présenté la moindre importance pour l'organisation sociale, tandis que le second correspond à une très forte persistance d'agrégats, qui est un fondement solide des sociétés humaines. Un Romain moderne nomme Bacchus, en s'exclamant : « Per Bacco ! » tout comme le nommait un croyant de l'antiquité. Dans les deux cas, Bacchus n'est qu'un mot ; mais il manifeste des concepts ou des sentiments essentiellement différents. Donc, nous nous rapprochons de la réalité, en ne nous arrêtant pas aux mots, et en recherchant le concept. Si Roxelin a voulu qu'il n'y ait que des choses et des paroles, il s'est en cela éloigné de la réalité ; s'il n'a fait que s'exprimer de la sorte, on en peut conclure seulement que cette expression est erronée. Le conceptualisme a bien fait de commencer au moins par la rectifier, mais il a eu le tort de s'arrêter au début de la voie dans laquelle il s'engageait, et de ne pas pousser plus loin l'analyse, en séparant les « concepts » et en en recherchant par l'expérience la nature et les caractères, pour les classifier.
§ 2374. Le mouvement intellectuel dont nous venons de parler appartient à la classe dont fait partie le mouvement des sophistes en Grèce et d'autres semblables. Il naît d'un besoin de recherches qui accroît la force de l'instinct des combinaisons, et qui n'est éprouvé que par un nombre restreint d'individus.
§ 2375. Parallèle, mais bien distinct, est le mouvement qui affaiblit la force de la persistance des agrégats dans la partie la moins intellectuelle de la classe gouvernante. À ce moment-là, il se manifeste sous une forme spéciale. Le désir des biens matériels et des jouissances sensuelles est presque constant. Il peut être réprimé par des sentiments religieux puissants ; aussi sa prédominance est-elle un indice de l'affaiblissement de ces sentiments et des persistances d'agrégats auxquels ils correspondent. On observe précisément ce fait au temps dont nous parlons : le clergé est devenu presque tout entier concubinaire, dissolu, cupide, simoniaque.
§ 2376. Nous avons sur ce fait des renseignements directs, mais encore plus de renseignements indirects, dans les reproches amers que les réformateurs adressent au clergé. Par conséquent, il se produit ce fait singulier que l'action de l'affaiblissement de la persistance des agrégats, dans une partie de la classe gouvernante, nous est surtout connue par la réaction qu'elle a provoquée dans la partie gouvernée.
§ 2377. Ces mouvements d'action et de réaction sont remarquables dans le midi de la France (cathares, vaudois), dans le nord de l'Italie [FN: § 2377-1] (les arnaudistes à Brescia, les patarins à Milan), précisément au moment où la richesse s'accroissait dans ces régions plus rapidement que dans d'autres du monde catholique. Voilà donc un nouveau cas dans lequel se trouvent unies les variations de la prospérité économique avec celles des résidus des combinaisons, par opposition aux résidus de la persistance des agrégats (§ 2351 [FN: § 2377-2] ). Au fur et à mesure que nous trouvons ainsi de nouveaux cas d'union semblable, il devient de moins en moins probable qu'elle est due au hasard seul, et toujours plus probable qu'elle révèle un état de mutuelle dépendance.
§ 2378. La cour de Rome prit des dispositions différentes dans les trois cas rappelés ; elle réprima les cathares et les arnaudistes, et s'allia, ne fût-ce que pour peu de temps, avec les patarins. Sous cette différence apparente, il y a une unité de but, qui était d'utiliser les résidus existants pour maintenir son pouvoir. L'archevêque de Milan voulait traiter d'égal à égal avec le pape, et peut-être visait-il à se rendre indépendant de lui. Il était avantageux d'utiliser la force des patarins pour rendre vains ses efforts. Arnaud de Brescia et les cathares faisaient directement la guerre au pape ; celui-ci devait par conséquent les combattre, en défendant en Provence, à Brescia, à Rome, les mœurs du clergé qu'il réprimait à Milan.
§ 2379. Pour combattre le clergé milanais, le pape Nicolas II fait approuver par le Concile de Rome, en l'an 1059, un canon qui interdit aux laïques d'entendre la messe d'un prêtre qu'ils savent être concubinaire, ce qui fait dépendre de la chasteté du prêtre la validité de la fonction religieuse [FN: § 2379-1]. Mais cette même doctrine est ensuite condamnée par l'Église chez les vaudois. On sait que par les dérivations on démontre également bien le pour et le contre. De même, aujourd'hui, bon nombre de députés socialistes s'élèvent contre le « capitalisme », pour entrer dans les bonnes grâces des électeurs, tandis qu'ils défendent les ploutocrates capitalistes, pour jouir de leurs faveurs.
§ 2380. Les réformateurs avaient besoin d'un vernis de dérivations pour manifester leurs sentiments, et l'on sait qu'on trouve toujours très facilement ce vernis. Il semble que les cathares avaient recours aux dérivations du manichéisme ; ils auraient pu également bien employer celles de n'importe quelle autre secte hérétique ; et si la papauté avait été manichéenne, ils auraient pu recourir à des dérivations contraires au manichéisme.
§ 2381. Plus remarquable encore est le cas d'Arnaud de Brescia, qui fut, dit-on, disciple d'Abélard [FN: § 2381-1]. Bien loin d être favorables aux réformateurs, qui voulaient accroître la force des persistances d'agrégats religieux, les théories du nominalisme leur étaient contraires. Mais les dérivations ont si peu d'importance qu'elles peuvent servir parfois à manifester des résidus auxquels elles semblent devoir être contraires. De même, les théories marxistes ne sont nullement favorables à la ploutocratie qui règne aujourd'hui ; pourtant elles servent parfois à la défendre.
§ 2382. La réaction religieuse des albigeois fut domptée par l'Église romaine, mais y provoqua une autre réaction religieuse. C'est là, sous différentes formes, un phénomène général ; nous le voyons se reproduire au temps de la Réforme et à celui de la Révolution française.
§ 2383. La Réforme nous montre d'une manière très nette les caractères que nous avons déjà vus en d'autres oscillations semblables. Tout d'abord, sous l'aspect intrinsèque, la Renaissance est en partie une réaction de la réalité expérimentale contre les préjugés religieux et moraux ; et si elle prend la forme d'un retour à l'antiquité païenne, c'est là une simple apparence, qui n'ajoute rien d'essentiel au fond, parfaitement semblable en cela au retour des réformateurs à l'Écriture Sainte. C'est une erreur très grave de croire que la Réforme ait profité le moins du monde à la liberté de pensée. Au contraire, elle y a nui grandement, et a arrêté tout à fait l'Église romaine dans la voie qu'elle parcourait vers la tolérance et la liberté ; les Églises réformées et l'Église romaine peuvent aller de pair au point de vue du contenu scientifique de leurs doctrines ; elles sont bien distinctes des humanistes, qui, au contraire, se rapprochaient plus de la réalité expérimentale, bien qu'ils en fassent encore très éloignés. Mais le mouvement humaniste, qui s'étendait jusqu'aux cardinaux, fut entièrement arrêté par la Réforme et par la réaction consécutive de l'Église catholique.
§ 2384. Sous l'aspect extrinsèque, la Renaissance se manifeste en un temps de prospérité économique. Nous avons là-dessus une infinité de témoignages [FN: § 2384-1]. C'est aussi un temps de forte augmentation des prix, par suite de l'affluence des métaux précieux provenant d'Amérique. Les anciennes institutions ne tiennent plus ; tout semble devoir se rénover : le monde moderne naît. Une réaction religieuse se produit, et, comme d'habitude, elle vient du peuple. Les chefs de celui-ci se souciaient peu de la religion, sinon comme d'un moyen de gouverner. Le peuple la met au premier plan de ses préoccupations ; il veut l'imposer de diverses manières, et en fait le but d'un grand nombre de ses œuvres. En somme, c'est là une des réactions habituelles dans lesquelles les résidus de la IIe classe refoulent ceux de la Ire.
§ 2385. Mais dans le cas où subsistent les conditions économiques grâce auxquelles les résidus de la Ire classe se renforcent, ceux-ci regagnent peu à peu du terrain. De nouveau, la « raison » recommence à désagréger l'édifice de la « superstition ». Dans les classes supérieures de la société, cet édifice tombe en ruines vers la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre [FN: § 2385-1] un peu plus tôt qu'en France, environ un demi-siècle ; et alors on put observer les mêmes phénomènes qu'au début du XVIe siècle. Deux cents ans suffirent pour accomplir cette oeuvre. Les « philosophes » du XVIIIe siècle sont les héritiers des humanistes. Comme eux ils inclinent au paganisme. On a ainsi l'une des nombreuses formes que peut prendre la lutte des résidus de la Ire classe contre ceux de la IIe classe, lorsque ceux-ci sont défendus par la religion chrétienne. Le contraire pourrait arriver, – et peut-être est-il arrivé en partie à l'origine de la religion chrétienne, – si la lutte avait lieu dans une société païenne.
§ 2386. La fin du XVIIIe siècle est un temps de prospérité économique. Nous sommes à l'aube des transformations modernes de l'agriculture, du commerce, de l'industrie. Cette circonstance favorisait, comme d'habitude, la prédominance des résidus de la Ire classe, et cette prospérité était à son tour favorisée par cette prédominance. La marée de la prospérité économique monta tout d'abord en Angleterre ; c'est pourquoi ce fut d'abord dans ce pays que redescendit la courbe de la proportion entre les résidus de la IIe classe et ceux de la Ire. Ce fut aussi pour cela que la réaction s'y produisit en premier lieu, et que la courbe se releva, à cause du mouvement ondulatoire qui est propre à cette courbe, même quand les conditions économiques demeurent presque constantes [FN: § 2386-1]. De la sorte, action et réaction anticipèrent en Angleterre sur les mouvements correspondants en France. L'action avait revêtu des formes semblables dans les deux pays : des formes « philosophiques ». La réaction, égale en somme, prit des formes diverses, surtout chrétienne en Angleterre et démocratique en France. La Révolution française fut une réaction religieuse analogue, sous une autre forme, à la réaction religieuse en Angleterre, et analogue aussi à la réaction religieuse de la Réforme. Mais la forme changea bientôt : de démocratique et humanitaire, au début de la Révolution, elle devint patriotique et guerrière sous Napoléon, et catholique sous Louis XVIII. Le point le plus élevé de la courbe de la proportion entre les résidus de la IIe et ceux de la première classe était atteint, dans toute l'Europe, peu après 1815, et la forme était presque partout chrétienne.
§ 2387. Mais ces mouvements sont essentiellement ondulatoires ; par conséquent, on eut de nouveau un mouvement descendant de la courbe. Il fut rapide, parce qu'il correspondait à une nouvelle ondulation rapide et puissante de prospérité économique : la production économique se transformait ; la grande industrie, les grands commerces, la finance internationale naissaient. Les résidus de la Ire classe recommencèrent peu à peu à dominer, et les positivistes, les libres-penseurs, les intellectuels du XIXe siècle reprennent leur œuvre habituelle, désagrégeant l'édifice des « préjugés », et se montrant les héritiers des philosophes du XVIIIe siècle. Ils ne combattent pas au nom du paganisme, comme combattaient les humanistes, ni au nom du sens commun, comme faisaient les philosophes du XVIIIe siècle, mais ils élèvent le drapeau de la sainte Science. Le maximum d'intensité du mouvement dont ils sont l'expression est atteint entre 1860 et 1870. Ensuite, ce mouvement s'affaiblit et, dans la première décade du XXe siècle, commence une réaction en faveur des résidus de la IIe classe.
§ 2388. Au mouvement général se superposent, comme d'habitude, des ondulations secondaires. Il faut faire attention de ne pas confondre celles-ci avec celui-là. Cette conclusion est facile pour les ondulations qui apparaissent à nos yeux, et qui, par leur proximité, acquièrent une importance très supérieure à celle qu'elles ont, quand on considère le mouvement général pour une longue période (§ 2394).
§ 2389. Parmi ces ondulations secondaires, remarquable est celle qui suivit la guerre de 1870 et qui, bien que déterminée surtout par les circonstances dans lesquelles se trouvaient les sociétés européennes, est due cependant en petite partie à l'action du prince de Bismarck. Celui-ci contribua, bien qu'involontairement, à combattre par le Kulturkampf les résidus de la IIe classe, et fit durer par conséquent la prédominance des résidus de la Ire classe. Pour obtenir des effets momentanés, il protégea les vieux catholiques, sans prendre garde que de la sorte il portait un coup aux principes de la politique impériale. Plus tard, il se ravisa, et fit la paix avec la curie romaine. En cela, l'empereur Guillaume II se montra plus avisé. Il comprit fort bien que les conflits affaiblissant les résidus de la IIe classe n'étaient nullement avantageux à l'Empire. En outre, le prince de Bismarck, toujours pour les besoins momentanés de sa politique, favorisa la République anticléricale en France ; ce qui eut aussi pour effet de faire durer la prédominance des résidus de la Ire classe. D'autre part, par aversion pour le libéralisme bourgeois, dont il avait souvent eu à se plaindre, il donna le suffrage universel à l'empire allemand [FN: § 2389-1] . Il favorisa ainsi le parti socialiste ; ce qui renforça certains résidus de la IIe classe. D'autres résidus augmentèrent d'intensité, grâce à la constitution du parti catholique dit du centre, et à la diffusion de l'antisémitisme.
§ 2390. Actuellement, la prospérité des résidus de la IIe classe semble principalement destinée à renforcer le patriotisme sous diverses formes, par exemple celles du nationalisme et de l'impérialisme. Le socialisme fortifie aussi d'autres résidus, qui entrent en conflit avec les précédents. Mais maintenant, en 1914, il est en train de décliner vers des combinaisons politiques, et subit l'invasion de résidus de la Ire classe. C'est pourquoi il résiste mal au nationalisme ou à l'impérialisme. On voit même un grand nombre de socialistes changer la forme de leur foi, et s'associer, sous différents prétextes, aux nationalistes et aux impérialistes. Subsidiairement, nous voyons aujourd'hui refleurir diverses religions, depuis les religions chrétiennes jusqu'à la religion sexuelle et à celle de l'anti-alcoolisme ; alors que la métaphysique refleurit aussi, et que l'on voit revenir en honneur des billevesées qui semblaient, il y a un demi-siècle, ne pouvoir acquérir aucun crédit. Jusqu'à quand continuera, et jusqu'où ira l'oscillation que nous voyons commencer maintenant ? Il ne nous est pas donné de le prévoir ; mais les faits observés dans le passé nous permettent d'affirmer qu'elle aboutira à une nouvelle oscillation en sens contraire.
§ 2391. Si l'on considère d'un peu haut tous ces phénomènes qui se produisent ainsi régulièrement, et se renouvellent depuis un passé reculé jusqu'à nos jours, il est impossible de ne pas admettre l'idée que les oscillations observées sont la règle, et qu'elles ne sont pas près de cesser. Ce qui se passera dans un très lointain avenir nous est inconnu ; mais il est très probable que le cours des événements, déjà si long, n'est pas sur le point de changer dans un avenir prochain [FN: § 2391-1] .
§ 2392. Il n'est nullement démontré que ces oscillations se produisent autour d'une ligne ab, correspondant à une proportion constante entre les résidus de la IIe classe et ceux de la 1re classe, plutôt qu'autour d'une ligne m p, indiquant que cette proportion va diminuant. Au contraire, de très nombreux faits nous induisent à croire que cette dernière ligne m p représente le cours général et moyen du phénomène. Nous avons vu que les classes des résidus changent lentement, mais qu'elles ne sont pas constantes. Par conséquent, le cours indiqué par la ligne m p n'est nullement contraire aux propriétés des résidus. D'autre part, si l'on compare l'état de nos sociétés à celui des sociétés gréco-romaines, il paraît aussitôt évident qu'en de nombreuses branches de l'activité humaine, telles que les arts, les sciences et la production économique, les résidus de la Ire classe et les déductions de la science logico-expérimentale ont certainement refoulé les résidus de la IIe classe. Dans l'activité politique et sociale, le fait apparaît avec moins de clarté. Peut-être aussi cet effet est-il très faible ? Mais ce n'est là qu'une partie de l'activité humaine, et si l'on considère cette activité dans son ensemble, on peut conclure en toute sécurité que les résidus de la Ire classe et les déductions de la science logico-expérimentale ont accru le domaine dans lequel s'exerce leur influence, et que c'est même à cela, en grande partie, qu'on doit la diversité des caractères de nos sociétés, comparées aux anciennes sociétés de la Grèce et de Rome.
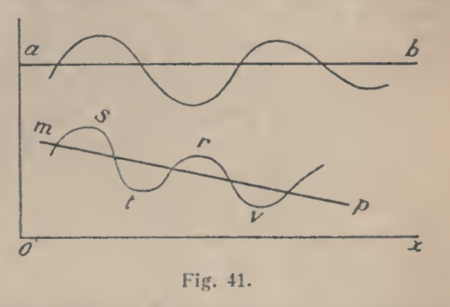
Figure 41
§ 2393. Par conséquent, en somme, l'opinion qui attribue une part toujours plus grande à la « raison » dans l'activité humaine, n'est pas erronée ; elle est au contraire d'accord avec les faits. Mais cette proposition est indéfinie comme toutes celles que la littérature substitue aux théorèmes de la science ; elle donne facilement lieu à plusieurs erreurs, parmi lesquelles les suivantes sont à remarquer.
§ 2394. 1° Cette proposition peut se rapporter uniquement à l'ensemble social ; elle a une valeur très différente pour les diverses parties de cet ensemble, et c'est une erreur que d'étendre à l'activité politique et sociale les caractères que l'on a observés dans les arts, dans les sciences, dans la production économique. 2° Elle représente un cours moyen, et c'est une erreur que de la confondre avec le cours réel s t r v Les hommes sont frappés surtout par les faits qu'ils ont sous les yeux. Il suit de là que les personnes qui se trouvent, par exemple, sur le segment descendant s t de la courbe, s'imaginent qu'il correspond au cours moyen, que le reste de la courbe continuera indéfiniment à descendre comme le segment s t, qu'il ne se redressera jamais plus. En d'autres termes, elles ne prévoient pas qu'on observera le segment ascendant t r. Vice-versa, les personnes qui se trouvent sur ce segment ascendant t r ne prévoient pas le segment descendant r v. Cela arrive plus rarement, soit parce que le cours général et moyen de la courbe m p est contraire à cette opinion et favorable à la première, soit, et c'est maintenant la courbe la plus puissante, parce que la seconde opinion se heurte à la théologie du Progrès, tandis que la première concorde avec elle. 3° On commet une erreur du même genre, mais atténuée, en attribuant à la courbe moyenne un cours voisin de celui de l'ondulation qu'on a sous les yeux. Ainsi, celui qui se trouve sur le segment descendant r v est induit à croire que la courbe moyenne descend beaucoup plus rapidement que ce n'est le cas en réalité. 4° Enfin, il y a l'erreur habituelle consistant à donner une forme absolue au phénomène contingent de l'expérience. De cette façon naissent des théologies et des métaphysiques de la régression, de l'immobilité, du progrès : on vante, on exalte, on magnifie la sagesse des ancêtres, l'âge d'or placé dans le passé ; ou bien la sereine immutabilité des dogmes d'une religion, d'une morale, d'une constitution politique et sociale ; ou bien encore le saint Progrès, les bienfaits de l'« évolution », l'âge d'or placé dans l'avenir. Presque tous les auteurs des siècles passés tenaient pour assuré que les hommes, leurs contemporains, étaient physiquement des nains, en comparaison des hommes géants de temps plus reculés. Aujourd'hui, bon nombre d'auteurs substituent le moral au physique, et intervertissent les termes : ils tiennent pour assuré que les hommes, nos contemporains, sont moralement des nains, en comparaison des hommes moralement géants qui vivront en des temps futurs, quand le loup aura fait amitié avec l'agneau, et qu'il y aura « un peu plus de justice » dans le monde.
De la sorte, les segments expérimentaux s t r v.... des ondulations se transforment en segments imaginaires, étrangement déformés ; quelquefois, ils finissent par avoir peu ou rien de commun avec la réalité. Ces segments imaginaires sont principalement déterminés, au moins en général, par les segments s t r auxquels ils correspondent. Nous avons précisément fait l'étude de ce rapport, en considérant ce que nous avons appelé l'aspect extrinsèque (§ 2343 et sv.) ; mais les théories représentées par ces segments imaginaires agissent aussi et réagissent mutuellement. Nous l'avons remarqué en considérant ce que nous avons appelé l'aspect intrinsèque (§ 2340 et sv.).
§ 2395. Les erreurs logico-expérimentales relevées tout à l'heure peuvent parfois être utiles à la société ; mais ici, nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons longuement exposé sur ce sujet. Nous limitant donc à la correspondance entre la théorie et les faits, nous voyons que l'étude scientifique des phénomènes a précisément pour but d'éviter ces erreurs, et de substituer aux visions de l'imagination les résultats de l'expérience. Les unes et les autres peuvent parfois avoir une partie commune ; mais quiconque veut acquérir meilleure et plus ample connaissance des phénomènes naturels, et se soustraire au danger d'être induit en erreur, ne peut se fier qu'aux résultats de l'expérience, toujours corrigés et recorrigés par de nouvelles observations.
§ 2396. L'ENSEMBLE SOCIAL. Nous sommes maintenant arrivés à une conception générale de l'ensemble social, non seulement en un état statique, mais aussi en un état dynamique ; non seulement par rapport aux forces qui agissent effectivement sur cet ensemble social, mais aussi par rapport à l'apparence que présentent ces forces, à la manière plus ou moins déformée dont elles sont vues. Ajoutons quelques considérations sur ces forces, par rapport à une étude logico-expérimentale, telle que nous avons essayé de l'accomplir.
§ 2397. L'étude logico-expérimentale met seulement en rapport des faits avec d'autres faits. Si l'on procède à cette étude directement, en décrivant uniquement les faits que l'on observe ensemble, on a l'empirisme pur. Il peut servir à découvrir des uniformités, si, par l'observation ou par l'expérience, on réussit à séparer deux seules catégories de faits, que l'on met ainsi en rapport. Mais sitôt que les catégories sont nombreuses et que les effets s'enchevêtrent, il devient bien difficile, et souvent impossible, de trouver des uniformités par l'empirisme seul. Il faut trouver moyen de démêler l'enchevêtrement ainsi constitué. En certains cas, on peut effectuer cette opération matériellement par l'expérience. En d'autres cas, l'expérience n'est pas possible, ou bien elle ne réussit pas à démêler l'enchevêtrement, et alors il faut essayer, de nouveau essayer diverses hypothèses d'abstraction, qui servent à dénouer idéalement ce que l'on ne peut dénouer matériellement. Parmi ces hypothèses, on acceptera seulement celle qui donnera des résultats concordant avec l'observation. Le procédé par lequel on a trouvé cette hypothèse peut être même absurde ; cela importe peu ou point, car elle tire toute sa valeur, non pas du procédé par lequel elle a été trouvée, mais des vérifications subséquentes.
§ 2398. Mais si elle a été déduite par abstraction de certains faits, A, B, P, on a ainsi déjà commencé la vérification, puisque, déduite de ces faits, elle les a certainement pour résultats ; il reste uniquement à voir si elle a aussi pour résultats les faits Q, R, V, non encore considérés (§ 2078-1).
§ 2399. En suivant la méthode déductive, nous aurions donc pu présenter, dès le début, les résidus et les dérivations comme de simples hypothèses, sans dire d'où nous les avions tirées, puis montrer que ces hypothèses avaient des résultats concordant avec les faits. Au contraire, en suivant la méthode inductive, nous avons tiré résidus et dérivations d'un très grand nombre de faits. Ainsi, pour ces faits, la vérification a été effectuée dès ce moment ; il nous est resté uniquement à l'accomplir pour d'autres faits qui, alors, n'avaient pas été considérés. Nous avons fait et continuons à faire cette vérification. Donc, en conclusion, ce sont les faits que nous avons présentés et que nous mettons en rapport.
§ 2400. Cette méthode n'a rien de spécial ; elle est au contraire générale dans toutes les sciences. Souvent, une hypothèse y est utilisée un certain temps, et fait progresser la science ; puis elle est remplacée par une autre, qui remplit une fonction analogue, et qui, de même, cède la place à une autre encore, et ainsi de suite. Quelquefois, une hypothèse peut durer très longtemps ; c'est le cas de la gravitation universelle.
Les sciences logico-expérimentales sont constituées par un ensemble de théories analogues à des êtres vivants, qui naissent, vivent et meurent, les nouveaux remplaçant les anciens, tandis que la collectivité seule subsiste (§ 52). La durée de la vie est inégale pour les théories, tout comme pour les êtres vivants, et ce ne sont pas toujours celles dont la vie est la plus longue qui sont les plus utiles au développement de la science. La foi et la métaphysique espèrent atteindre un état définitif, éternel ; la science sait qu'elle ne peut arriver qu'à des états provisoires, transitoires [FN: § 2400-1] ; chaque théorie accomplit son œuvre, et il n'y a rien à lui demander de plus [FN: § 2400-2).
Si une telle succession de doctrines est déterminée en grande partie par une seule force, il peut arriver que les états successifs des doctrines se rapprochent de plus en plus d'une certaine limite : que la courbe de ces états ait une asymptote (§ 2392). C'est ce qui a lieu pour les sciences logico-expérimentales. La force, sinon unique du moins principale, qui agit actuellement sur ces sciences, est la recherche de la correspondance des théories avec l'expérience ; les théories se rapprochent donc de plus en plus de la réalité expérimentale, tandis qu'autrefois d'autres forces entraient en jeu et empêchaient cet effet de se produire. Les doctrines économiques et sociales demeurent encore soumises à des forces analogues, et par conséquent continuent à s'écarter parfois notablement de la réalité expérimentale, l'existence même d'une asymptote de leurs oscillations étant douteuse.
Si la succession des doctrines est déterminée par un grand nombre de forces, dont l'intensité est à peu près du même ordre de grandeur, le mouvement révélé par cette succession peut être tellement compliqué qu'il nous devienne impossible d'en donner une expression générale. Mais si ces forces, sans se réduire à une seule, sont du moins en petit nombre, il est des cas où nous pouvons découvrir une telle expression. On peut, par exemple, reconnaître des mouvements oscillatoires autour d'une certaine position, soit qu'ils tendent à un équilibre en cette position, soit qu'ils se continuent indéfiniment sans manifester clairement aucune tendance de ce genre. Ce sont des mouvements d'une telle nature que nous avons vus se produire sous l'empire de deux forces principales, qui sont la correspondance avec la réalité expérimentale et l'utilité sociale (§ 1683, 2329, 2391).
Ce n'est que par une première approximation qu'on peut réduire à deux les très nombreuses forces qui agissent dans les cas concrets. Si, pour pousser plus loin l'étude des phénomènes, nous mettons en ligne de compte de nouvelles forces, en les ajoutant aux deux principales que nous avons considérées, nous trouverons des mouvements de plus en plus compliqués et difficiles à étudier (§ 2339, 2388). Ici, nous avons pu faire quelques pas dans cette voie (§ 2343 et sv.), mais les obstacles dont elle est hérissée ne nous ont pas permis de nous y avancer autant que nous l'aurions désiré.
Si nous avions suivi la voie déductive, l'exposé que nous venons de faire aurait dû trouver sa place au commencement de l'ouvrage ; mais alors, privé des développements donnés dans le cours de l'ouvrage, il aurait pu être entendu en un sens différent de celui qu'il a réellement, ou même n'être pas compris. La voie déductive permet de fixer ce sens et de bien le faire comprendre ; et la théorie générale, ne venant qu'après l'étude des cas particuliers, est convenablement expliquée par ceux-ci.
§ 2401. La découverte que fit Kepler, trouvant que Mars parcourait une ellipse dont un des foyers coïncidait avec le centre du soleil, était purement empirique ; elle ne décrivait les phénomènes que sommairement. En ce cas, grâce à l'imperfection des observations (§ 540-1] ), on avait pu séparer le mouvement d'une planète, par rapport au soleil, des mouvements des autres planètes. Si les observations avaient été plus parfaites, ou n'aurait pas pu le faire ; Kepler n'aurait pas trouvé une ellipse, et c'eût été un grave obstacle aux progrès de l'astronomie Ici, deux cas sont à considérer.
§ 2402. 1° Pour notre système solaire, on aurait pu surmonter cet obstacle sans grande difficulté. Un savant aurait observé que si la courbe parcourue par Mars n'était pas une ellipse, elle ne s'en écartait d'ailleurs pas beaucoup. Il aurait pu faire l'hypothèse que si l'on considérait le soleil et Mars séparément des autres planètes, la courbe devait être une ellipse, et que si elle ne l'était pas, c'était parce que le soleil et Mars n'étaient pas séparés des autres planètes.
§ 2403. 2° Beaucoup plus grave, peut-être insurmontable aurait été l'obstacle si, au lieu de notre système solaire, où l'astre central a une masse énormément plus grande que celle de ses satellites, il se fût agi d'un système d'astres et de planètes à masses peu différentes.
§ 2404. Parfois, mais par malheur trop rarement, les faits mis en rapport par la statistique peuvent être assimilés à ceux du premier cas, rappelé tout à l'heure. En d'autres termes, par l'interpolation, on peut trouver une certaine courbe hypothétique, dont on peut supposer que la courbe réelle est déduite en faisant intervenir des perturbations. Mais beaucoup plus souvent, il faut assimiler les faits de l'économie, et encore plus ceux de la sociologie, à ceux du 2e, cas.
§ 2405. Newton fit une hypothèse, dite de la gravitation universelle, dans laquelle, si l'on suppose le soleil immobile et une planète qui tourne autour, il en résulte une courbe du genre de celle que trouva Kepler, c'est-à-dire une ellipse.
§ 2406. Cette hypothèse a un mérite singulier qu'on trouve rarement en d'autres hypothèses analogues : c'est qu'on peut renverser le rapport entre l'hypothèse et les faits. Autrement dit, si l'on suppose qu'une planète parcourt une ellipse autour du soleil immobile, il en résulte une loi d'attraction qui est précisément celle de Newton. Au contraire, en général, spécialement en économie et en sociologie, une hypothèse peut bien avoir certains faits pour résultat, mais de ces faits, on peut tirer un grand nombre d'autres hypothèses.
§ 2407. L'hypothèse de Newton a encore un autre très grand mérite : c'est que, jusqu'à maintenant du moins, appliquée à l'ensemble du soleil et de toutes ses planètes, elle a suffi à expliquer toutes les perturbations observées dans les mouvements des corps célestes. Si cela n'était pas arrivé, l'hypothèse de Newton aurait pu subsister, mais on aurait dû y en ajouter d'autres ; par exemple, que l'attraction réciproque des planètes était différente de celle des planètes et du soleil. Il est inutile d'ajouter qu'en économie ni en sociologie nous n'avons d'hypothèses simples aussi fécondes que celle de Newton.
§ 2408. Il est donc indispensable, tant en économie politique qu'en sociologie, de considérer un grand nombre d'éléments des phénomènes complexes que l'observation nous révèle directement [FN: § 2408-1]. Ce que nous pouvons dire de plus simple, en économie, c'est que l'équilibre résulte de l'opposition entre les goûts et les obstacles. Mais cette simplicité n'est qu'apparente, car il faut ensuite tenir compte de la grande diversité des goûts et des obstacles. On trouve une complication beaucoup plus grande en sociologie où, aux actions logiques, seules considérées par l'économie, il faut ajouter les actions non-logiques, et au raisonnement logique, les dérivations (§ 99).
§ 2409. On ne peut pas déduire les lois dites de l'offre et de la demande, des statistiques des quantités d'une marchandise produite ou présentée sur le marché et des prix de cette marchandise. Lorsque les économistes ont dit que si l'offre croît, le prix diminue, ils ont exprimé la loi d'un phénomène idéal, qu'on observe rarement parmi les phénomènes concrets. C'est une illusion de croire que nous nous rapprochons davantage de la réalité en partant des lois de l'offre et de la demande, plutôt que de l'utilité des premiers économistes, de la marginal utility, de la rareté, de l'ophélimité d'économistes postérieurs, pour constituer les théories de l'économie [FN: § 2409-1]. De toute façon, on recourt à des abstractions, et l'on ne peut faire autrement. Théoriquement, on peut partir de n'importe laquelle de ces considérations ou d'autres quelconques ; mais dans les différents cas, il faut prendre des précautions qu'oublient un grand nombre d'auteurs, qui dissertent d'économie politique sans en savoir un traître mot. Toujours au point de vue théorique, il faut prendre garde que les consommations de marchandises ne sont pas indépendantes [FN: § 2409-2), comme le supposèrent plusieurs des auteurs qui constituèrent l'économie pure (§ 2404-3] ). Il ne faut pas négliger non plus de considérer les mouvements ondulatoires des phénomènes économiques, ni un très grand nombre d'autres circonstances, par exemple celle de la spéculation, qui change la forme des phénomènes, forme que nous avons dû supposer d'abord plus simple, pour faciliter notre étude.
§ 2410. Ces considérations s'appliquent a fortiori à la sociologie. On ne peut déduire directement que peu ou rien de la simple description des phénomènes. En ce sens, l'adage : « l'histoire ne se répète jamais » est très vrai. Il faut décomposer ces phénomènes concrets en d'autres phénomènes, idéaux, plus simples, et s'efforcer d'obtenir ainsi quelque chose de plus constant que le phénomène réel, très compliqué et variable [FN: § 2410-1]. Ici, nous avons cherché ces éléments moins variables, plus constants, dans les résidus et les dérivations. On pourrait également chercher ailleurs. Cela importe moins que de prendre garde qu'en ces recherches il ne s'introduise des éléments et des formes qui éloignent de la réalité objective. Il est tout aussi certain que « l'histoire ne se répète jamais » identiquement, qu'il est certain qu'elle « se répète toujours » en certaines parties que nous pouvons dire principales. D'un côté, il serait vain et absurde, au-delà de toute expression, de supposer qu'il peut y avoir, dans l'histoire, des événements qui reproduisent identiquement ceux de la guerre du Péloponnèse, qui en soient la copie exacte. Mais d'un autre côté, l'histoire nous montre que la guerre provoquée par la rivalité d'Athènes et de Sparte n'est qu'un terme d'une série infinie de guerres analogues suscitées par des causes analogues ; qu'il y en a des quantités infinies de semblables, au moins en partie, depuis les guerres que provoqua la rivalité de Carthage et de Rome, jusqu'à d'autres que l'on voit en tout temps, jusqu'à notre époque. Dans la Politique, V, 3, 7, Aristote dit : « Enfin, il faut que l'on sache clairement que ceux qui ont été cause de puissance pour la cité], donnent naissance à des troubles, que ce soient de simples particuliers, des magistrats, des tribus, ou en somme une partie quelconque du peuple ». Il décrivait ainsi la partie principale d'un très grand nombre de faits à lui connus, et il en prévoyait un très grand nombre d'autres qui se produisirent après lui ; ainsi parmi ceux qui se rapprochent le plus de nous, les faits de Cromwell et de Napoléon Ier. La partie principale de ces événements est précisément donnée par les sentiments (résidus), qui varièrent très peu depuis le temps d'Aristote jusqu'au nôtre. On en peut dire autant d'un grand nombre de maximes de Machiavel, qui conservent de nos jours la valeur qu'elles eurent de son temps. Les classes des résidus varient peu et lentement. C'est pourquoi on peut les ranger parmi les éléments qui déterminent la partie constante, presque constante, ou du moins peu variable des phénomènes. Les différents genres d'une classe de résidus varient bien davantage et plus promptement que la classe elle-même. Aussi faut-il se tenir sur ses gardes en les rangeant parmi les éléments qui déterminent la partie peu variable des phénomènes. Les dérivations varient énormément et vite ; c'est pourquoi on les range en général seulement parmi les éléments qui déterminent les parties subordonnées, variables, et habituellement négligeables des phénomènes. De ce que nous venons d'exposer, on tire aussi la cause d'un fait auquel nous avons dû souvent faire allusion ; c'est que pour la recherche des uniformités sociologiques, les détails trop menus, les faits trop nombreux, peuvent nuire au lieu d'être utiles [FN: § 2410-2] ; car celui qui s'arrête à toutes les moindres circonstances des faits s'égare facilement comme dans une épaisse forêt. Il est empêché d'attribuer des indices convenables aux divers éléments ; il intervertit les rôles de ceux qui sont principaux et de ceux qui sont secondaires, de ceux qui sont presque constants et de ceux qui sont très variables, et il finit par composer un ouvrage littéraire dépourvu de toute valeur scientifique.
§ 2411. Dans les sciences sociales, il faut surtout se tenir sur ses gardes contre l'intromission des sentiments de l'auteur, lequel incline à rechercher, non pas simplement ce qui existe, mais ce qui devrait exister pour concorder avec ses sentiments religieux, moraux, patriotiques, humanitaires ou autres [FN: § 2411-1]. La recherche des uniformités expérimentales est en elle-même un but. Quand on a trouvé ces uniformités, elles peuvent servir à d'autres buts ; mais confondre ces deux recherches porte un grave préjudice à toutes les deux. En tout cas, c'est un obstacle très grave et souvent insurmontable pour la découverte des uniformités expérimentales. Tant que les sciences naturelles rencontrèrent de semblables obstacles, elles progressèrent peu ou point. C'est seulement quand ces obstacles diminuèrent, puis disparurent, que les sciences naturelles accomplirent le merveilleux progrès qu'elles nous présentent aujourd'hui. Si donc nous voulons ramener les sciences sociales au type des sciences naturelles, il faut que nous procédions dans les premières comme dans les secondes, en réduisant les phénomènes concrets très compliqués à des phénomènes théoriques beaucoup plus simples, en nous laissant guider dans cette opération exclusivement par l'intention de découvrir des uniformités expérimentales, et en jugeant leur efficacité uniquement par les vérifications expérimentales que nous pouvons faire. Un très grand nombre de ces vérifications ont déjà été exposées ici pour des cas particuliers. Maintenant nous en ajouterons quelques autres pour des cas plus généraux.
[1601]
Chapitre XIII↩
L’équilibre social dans l’histoire
§ 2413. Bien souvent, nous avons été amenés à reconnaître que l'un des facteurs principaux, pour la détermination de l'équilibre social, était la proportion existant, chez les individus, entre les résidus de la Ire classe et ceux de la IIe Dans une première approximation, on peut considérer cette proportion à trois points de vue, en établissant la comparaison : 1° entre des populations en général, de pays différents, ou bien entre des populations en général, du même pays, mais en des temps différents ; 2° entre des classes sociales, et surtout entre la classe gouvernante et la classe gouvernée ; 3° par rapport à la circulation des élites d'une population.
§ 2414. Avant d'aller plus loin, il faut prendre garde à deux erreurs. La première consisterait à considérer la proportion des résidus comme la cause, et les phénomènes sociaux comme l'effet. Nous avons trop souvent noté cette erreur de substituer les rapports de cause à effet aux rapports de mutuelle dépendance, pour qu'il soit nécessaire d'y revenir.
§ 2415. La seconde erreur consisterait à considérer comme unique, dans les rapports de mutuelle dépendance, la condition d’une certaine proportion de résidus, et pis encore de confondre une semblable condition, fût-elle nécessaire, avec une condition nécessaire et suffisante. En outre, afin d'abréger, nous parlons uniquement des résidus de la Ire et de la IIe classe, pour avoir une première approximation du phénomène ; mais il faut évidemment tenir compte des autres résidus. Pourtant, plusieurs résidus de la sociabilité, de l'intégrité personnelle, etc., ont leurs correspondants dans les persistances d'agrégats ; par conséquent, on en tient compte indirectement lorsqu'on évalue les résidus de la IIe classe. Afin de mieux comprendre ce fait, examinons des phénomènes analogues. Pour avoir une abondante moisson de blé, il faut qu'il se trouve dans le terroir une certaine proportion de phosphore et d'azote assimilables. Mais il est évident que cela ne suffit pas, et, sans parler d'un grand nombre d'autres conditions indispensables, il faut aussi tenir compte des circonstances météorologiques. Si celles-ci sont favorables, une terre contenant en proportions convenables du phosphore et de l'azote peut donner un rendement inférieur à celui d'une autre terre qui ne présente pas ces proportions, mais pour laquelle les circonstances météorologiques sont plus favorables. Pourtant, à la longue, il s'établit une certaine compensation entre les années où les circonstances météorologiques sont défavorables et celles où elles sont favorables. En moyenne, le rendement supérieur provient de la terre qui possède en proportions convenables du phosphore et de l'azote. C'est pourquoi l'analyse chimique des terres est loin d'être inutile. Elle est au contraire le fondement de l'agriculture moderne.
Autre exemple. La proposition qui met en rapport la proportion des résidus des différentes classes avec d'autres phénomènes sociaux, est analogue à celle qui met en rapport, dans une armée moderne, la proportion de l'artillerie et des autres armes avec la probabilité de remporter la victoire. D'abord, cette condition n'est pas unique ; il y en a beaucoup d'autres, entre autres que l'armée soit ravitaillée en vivres et en munitions. Ensuite, si cette condition peut être, dans certains cas, nécessaire, elle n'est jamais suffisante. Il ne suffit pas que l'artillerie et les autres armes soient en proportion convenable : il faut encore savoir s'en servir. Enfin, de la même façon qu'il faut tenir compte d'autres résidus à part ceux de la Ire et de la IIe classe, il faut aussi s'assurer que l'artillerie dispose des chevaux nécessaires, qu'elle a de bons officiers, sous-officiers et soldats, des munitions en quantité suffisante, etc. Il ne suffit pas que dans les classes gouvernantes il existe en proportion convenable des résidus de la Ire et de la IIe classe : il faut encore qu'ils soient convenablement mis en valeur. Il est évident, par exemple, que si l'instinct des combinaisons se manifeste par des opérations magiques au lieu d'être employé à des opérations économiques ou guerrières, il ne servira à rien du tout ; et si on le perd en intrigues, de salon [FN: § 2415-1] , au lieu de l'appliquer à des mesures politiques, il servira vraiment à peu de chose. Enfin, si les persistances d'agrégats dégénèrent en sentiments ascétiques, humanitaires et autres semblables, leurs effets pourront être comparés à ceux d'une artillerie dont les canons seraient en bois. Mais lorsque, dans une armée, on a employé les différentes armes avec une habileté passable, par des moyens opportuns, à la longue, l'efficacité d'une proportion convenable de ces armes se manifeste ; et lorsque les résidus agissent de la manière la mieux adaptée à la prospérité sociale, à la longue l'efficacité d'une proportion semblable se manifeste. C'est précisément ce que nous avons l'intention de vérifier ici.
§ 2416. Considérons, en général, les populations de différents pays. Sur l'axe o z, portons les indices de la prospérité économique, militaire, politique de ces pays, et sur l'axe o x, les diverses proportions en lesquelles se trouvent, dans des pays, les résidus de la Ire classe et ceux de la IIe, auxquels on pourra aussi ajouter des résidus d'autres classes. Il ne nous sera pas difficile de trouver des pays p où cette proportion soit petite, c'est-à-dire où il existe peu de résidus de la Ire classe, en comparaison de ceux de la IIe. Nous trouverons aussi des pays q où, au contraire, les résidus de la Ire classe prédominent fortement sur ceux de la IIe. Enfin, nous aurons d'autres pays r, où l'on aura une proportion intermédiaire o r. En de très nombreux cas, nous observerons que les indices de la prospérité p a, q d sont moindres que les indices r b. Nous en conclurons que la courbe des indices de prospérité a très probablement un maximum en s c, pour une proportion o s que nous ne pouvons pas fixer avec précision, mais que du moins nous savons être intermédiaire entre o p et o q.
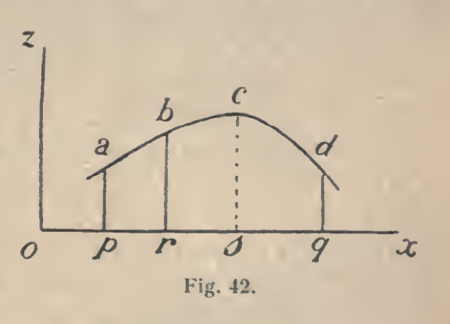
Figure 42
§ 2417. Si, au lieu de comparer différents pays, nous comparons les divers états successifs d'un même pays, nous ne pouvons pas déduire grand'chose des proportions existant entre les résidus de la Ire classe et ceux de la IIe, parce que, dans l'ensemble de la population, les résidus varient lentement. Par conséquent, les effets de diverses proportions peuvent être masqués par d'autres phénomènes plus variables. Mais si nous prêtons attention à la proportion des résidus dans la classe gouvernante, comme cette proportion varie parfois assez rapidement, nous pourrons en distinguer les effets de ceux d'autres phénomènes. Pourtant cette variation étant étroitement liée à celle de la circulation des élites, très souvent on ne pourra connaître que les effets d'ensemble, sans qu'il soit possible de bien distinguer la part qui revient à chacune de ces deux causes.
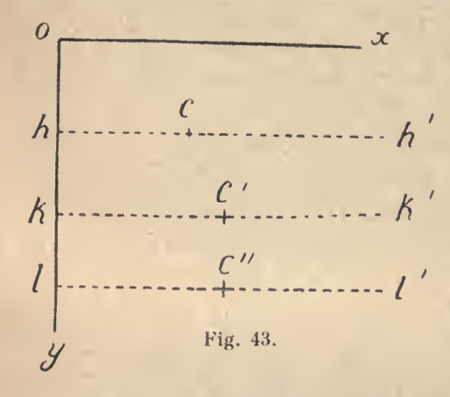
Figure 43
§ 2418. En outre, l'indice de l'utilité sociale ne dépend pas seulement de la proportion des différentes catégories de résidus dans la classe gouvernante, mais aussi de cette proportion dans la classe gouvernée. Il faut par conséquent représenter le phénomène dans un espace à trois dimensions (fig. 43). Le plan x y, supposé horizontal, est celui de la figure; l'axe o z, supposé vertical, et qui par ce fait n'est pas indiqué sur la figure, sera celui des indices d'utilité. Sur le plan horizontal, l'axe o x sera celui de la proportion des catégories de résidus dans la classe gouvernante ; l'axe o y celui de la proportion dans la classe gouvernée. Supposons que nous fassions différentes sections verticales h h', k k', ll', parallèles au plan o x z (fig. 44). Dans chacune de ces sections, nous trouverons des points de maximum c, c', c" .… ; et en comparant les différents maxima s c, s' c', s" c", nous en trouverons un c" qui sera plus grand que les autres. Il nous indiquera par conséquent les proportions les plus convenables, dans la classe gouvernante et dans la classe gouvernée.
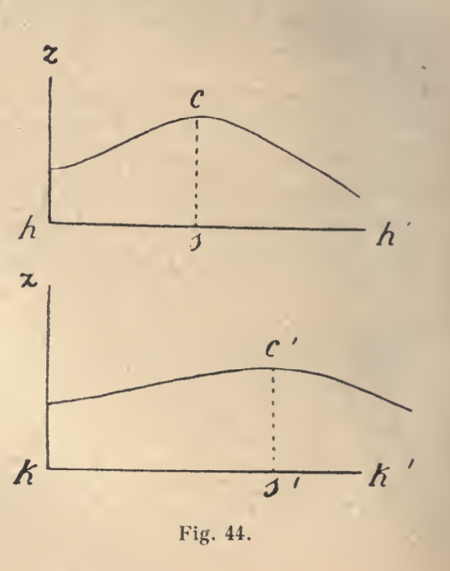
Figure 44
§2419. La Grèce antique fut un laboratoire d'expériences sociales et politiques, riche en observations très étendues. Dès que l'on porte son attention sur les phénomènes indiqués au §2416, les exemples de Sparte et d'Athènes viennent à l'esprit comme s'appliquant aux indices p a, q d, de la fig. 42. Les faits de la prédominance des résidus de la IIe classe à Sparte et de la prédominance de ceux de la Ire à Athènes sont trop connus pour que nous nous étendions sur ce sujet ; mais il sera bon d'ajouter quelques mots pour montrer que les deux extrêmes éloignèrent du maximum s c. Sparte n'admettait pas les innovations, parce que chez elle les résidus de la IIe classe étaient trop puissants. Athènes admettait immédiatement les innovations, mais elle ne savait pas en tirer le profit qu'elles comportaient, parce que, chez elle, les résidus de la Ire classe étaient trop puissants.
§ 2420. La principale utilité des sentiments de persistance des agrégats est de s'opposer efficacement à de nuisibles tendances de l'intérêt individuel et au déchaînement des passions [FN: § 2420-1] . Leur principal désavantage est de pousser à des actions qui sont une conséquence logique de ces sentiments, mais qui nuisent à la société. Pour remplir la première fonction, il faut que ces sentiments aient une force considérable. Quand celle-ci diminue beaucoup, ils ne peuvent plus résister à des intérêts puissants et à des passions violentes ; ils ne produisent que les seconds effets, qui sont nuisibles à la société.
§ 2421. C'est ce qu'on observe en divers cas à Athènes. Un exemple caractéristique est celui d'Alcibiade. Celui-ci sut persuader aux Athéniens, contre l'opinion du conservateur Nicias, d'entreprendre l'expédition de Sicile. Si les Athéniens avaient eu de forts sentiments de persistance des agrégats, ils auraient suivi l'opinion de Nicias, ou du moins se seraient contentés d'une faible expédition qui diminuât peu ou point leurs forces ; précisément comme le fit Sparte, lorsque, peu de temps après, persuadée à son tour par Alcibiade, elle n'envoya au secours de Syracuse que Gylippe avec les quelques galères qu'elle put obtenir de Corinthe. Au contraire, les Athéniens envoyèrent en Sicile une armée puissante, qui distrayait de la Grèce une partie très considérable de leurs forces. Passe encore s'ils avaient eu dans leurs résolutions assez de constance pour passer outre à tout incident qui pût entraver la grave et dangereuse entreprise. Mais, chez eux, les résidus de la IIe classe étaient trop faibles pour produire cette constance ; tandis qu'il en restait d'assez puissants pour imposer à Nicias, réputé honnête homme et religieux, de diriger l'entreprise avec Alcibiade, et pour rappeler ensuite ce dernier, au moment précis où son activité était le plus nécessaire en Sicile. Les Spartiates, eux aussi, voulurent plus tard se débarrasser d'Alcibiade ; mais ils le firent lorsqu'ils estimèrent, à tort peut-être, que son concours ne leur était plus nécessaire, et quand ils le soupçonnèrent de les avoir trahis. Comme on sait, lorsque la flotte était sur le point de quitter Athènes, un matin, on s'aperçut que les hermès placés dans les rues d'Athènes avaient été mutilés. La cité fut atterrée du terrible sacrilège. Elle manifestait ainsi des sentiments de persistance des agrégats, comme on en aurait observé dans d'autres cités helléniques [FN: § 2421-1] . Mais quelle que fût leur puissance, elle ne suffit pas à vaincre l'instinct des combinaisons, et le peuple athénien maintint au commandement de la flotte Alcibiade, sur lequel pesait l'accusation de ce sacrilège. Lui-même pourtant, en vue de ses desseins particuliers, réclamait à grands cris un jugement immédiat, et faisait observer « qu'il eût été plus sage de ne pas l'envoyer à la tête d'une si grande flotte, sous le coup d'une telle accusation, et avant qu'il s'en fût lavé [FN: § 2421-2] ». L'instinct des combinaisons l'emporta donc alors : on considérait exclusivement la grande valeur que l'on attribuait à la combinaison en vertu de laquelle Alcibiade dirigeait l'expédition. Si les Athéniens demeuraient fermes dans cette résolution, l'expédition pouvait peut-être bien tourner pour eux. Mais les voici qui changent tout à coup d'avis et, juste au moment où il était de toute utilité qu'Alcibiade demeurât en Sicile, ils envoient la trirème salaminienne pour le rappeler dans sa patrie, où il devait répondre de l'accusation de profanation des mystères d'Éleusis. La conséquence en fut qu'Alcibiade se réfugia à Sparte et, par ses conseils, amena la ruine d'Athènes [FN: § 2421-3] .
§ 2422. On observa quelque chose de semblable en France, au temps de l'affaire Dreyfus. À la profanation des mystères d'Éleusis, on substitua la profanation de la procédure de défense d'un accusé supposé innocent ; et cela parut être un prétexte suffisant pour désorganiser et affaiblir toutes les institutions de la défense nationale, pour nommer des officiers et des généraux, non en raison de leurs mérites militaires, mais à cause de leurs mérites dans une basse politique, pour confier le ministère de la guerre à un André et celui de la marine à un Pelletan. Si l'Allemagne avait alors fait la guerre à la France, comme Sparte fit la guerre à Athènes, elle pouvait causer un désastre non moins grand que ne fut pour Athènes celui de l'expédition de Syracuse [FN: § 2422-1] . À Athènes, les controverses au sujet de l'affaire des hermès et de celle de la profanation des mystères d'Éleusis, en France les controverses au sujet de l'affaire Dreyfus, étaient en grande partie des voiles et des prétextes dont on recouvrait certaines passions et certains intérêts. Mais s'ils avaient alors une valeur comme voiles et comme prétextes, c'était précisément parce que beaucoup de gens ne leur soupçonnaient pas cette qualité, mais les croyaient de sincères expressions de sentiments. Les gens qui les acceptaient étaient mus par des sentiments correspondant à certains résidus de la IIe classe.
§2423. C'eût été un moindre mal pour la France, si la puissance de la persistance des agrégats avait été assez grande pour lui interdire toute aventure dépendant de l'instinct des combinaisons. Mais, comme pour Athènes, cet instinct l'emporta à son tour, lorsque la France voulut établir sa domination sur le Maroc, oubliant, comme autrefois Athènes lorsqu'elle rappela Alcibiade, que la guerre ne se fait pas avec les bavardages des politiciens, les insanités des intellectuels [FN: § 2423-1], les combinaisons occultes des ploutocrates, mais bien avec le savoir-faire des généraux et la foi des armées. La France s'en tira alors, parce qu'il n'y avait pas en Allemagne un autre Bismarck qui jouât la partie qu'avait jouée déjà Philippe de Macédoine contre Athènes. Comme nous le verrons mieux plus loin (§ 2449 et sv., 2434), ces leçons ont peu ou point d'effet pour empêcher de commettre de semblables erreurs. C'est une nouvelle preuve de la nature non-logique des actions ainsi accomplies.
§2424. Pour revenir aux Athéniens, nous voyons qu'ils ne profitèrent nullement de la leçon du premier rappel d'Alcibiade, et qu'ils répétèrent la même erreur. Ayant abandonné Sparte, Alcibiade avait restauré la puissance athénienne d'une manière inespérée. Il n'y avait évidemment qu'à le laisser continuer ; mais son lieutenant Antiochus, désobéissant aux ordres formels d'Alcibiade, avait accepté la bataille navale contre Lysandre, et avait été défait. Ce fut là le prétexte qui servit aux ennemis d'Alcibiade pour obtenir, par les accusations habituelles d'offenses à la religion, qu’il fût destitué de son commandement. De la sorte, la ruine d'Athènes se prépara de nouveau. Il semble tout à fait évident que, dans cette cité, une certaine proportion entre les instincts des combinaisons et ceux de la persistance des agrégats faisait défaut. Suivant cette proportion, tandis que les premiers résidus poussaient aux aventures, les seconds, soutenus par la persévérance et la fermeté des résolutions, auraient mené à bonne fin les entreprises décidées.
§2425. À Sparte aussi, on observe un semblable défaut ; mais les termes sont intervertis. Certes, la persévérance et la fermeté dans les résolutions ne manquent pas ; c'est l'instinct des combinaisons qui manque, lui qui permet de tirer un parti profitable de ces forces. Si Alcibiade n'avait pas conseillé aux Spartiates de secourir Syracuse et d'occuper Décélie, Dieu sait combien de temps encore Athènes aurait pu résister, et si le sort n'aurait pas été contraire à Sparte. Mais une fois les combinaisons opportunes de Syracuse et de Décélie présentées aux Spartiates peu imaginatifs, ils surent accomplir ces entreprises avec persévérance, fermeté et clairvoyance.
§ 2426. Le fait raconté par Hérodote, au sujet d'Amopharétès, caractérise bien la mentalité spartiate [FN: § 2426-1] . À Platée, Amopharétès refusait d'opérer une manœuvre stratégique ordonnée par son chef Pausanias, parce qu'elle l'aurait éloigné des Barbares, ce qui était déshonorant pour un Spartiate.
§2427. Les phénomènes que nous sommes en train d'étudier apparaissent avec plus d'évidence dans l'art de la guerre, parce qu'en cette matière nous avons des indices certains : les victoires et les défaites sont, parmi les événements historiques, ceux qui nous sont le mieux connus. Déjà sans aller chercher bien loin, en parlant de la conduite d'Alcibiade à l'égard des Spartiates, nous avons trouvé un fait remarquable qui montre combien il est utile que l'instinct des combinaisons soit prédominant chez les chefs, et celui de la persistance des agrégats chez les subordonnés [FN: § 2427-1]. En somme, c'est précisément parce qu'Alcibiade eut pour exécuter ses combinaisons des hommes comme les Spartiates, qu'il put être utile à ces derniers, beaucoup plus qu'il ne fut utile à ses concitoyens athéniens. Cette observation nous amène à reconnaître que la première coopération est d'un genre plus efficace que la seconde, et plus efficace encore qu'une autre dans laquelle c'est un Nicias qui gouverne, et où ceux qui l'élisent et acceptent son gouvernement sont des hommes chez lesquels l'instinct des combinaisons est puissant. Nous allons voir de nouveaux et meilleurs exemples de tout cela.
§ 2428. À la bataille de Leuctres, la formation tactique des Spartiates était encore celle qu'ils employaient au temps des guerres médiques [FN: § 2428-1] , tandis que le progrès de la formation tactique des Athéniens était immense, au temps de Miltiade et à celui d’Iphicrate. Mais cela profitait peu à Athènes : les Spartiates ne savaient pas innover ; les Athéniens ne pouvaient pas se servir des innovations qu'ils imaginaient facilement, parce que chez eux la persévérance et la fermeté de résolution, qui sont indispensables pour cueillir le fruit de la victoire, faisaient entièrement défaut. Avec Sparte, Athènes était dans un rapport en partie analogue à celui où nous voyons ensuite Pyrrhus et Annibal avec Rome. Mais l'analogie cesse, si nous portons notre attention sur Sparte ; car les Romains apprirent l'art de la guerre de Pyrrhus et d'Annibal, et surent bientôt tirer parti des connaissances acquises, tandis que Sparte n'apprit rien d’Iphicrate, de Chabrias, ni d'autres adversaires de talent.
§ 2429. Il était donc facile de prévoir que Sparte comme Athènes auraient été vaincues, si elles étaient entrées en conflit avec un peuple chez lequel se seraient unis la possibilité des innovations et le pouvoir de s'en servir. C'est précisément ce qui arrive lorsque prédominent chez les chefs les résidus de la Ire classe, et chez la classe gouvernée les résidus de la IIe classe. Le fait se vérifia pour Thèbes, au temps d'Épaminondas, puis pour la Macédoine, au temps du roi Philippe et d'Alexandre-le-Grand [FN: § 2429-2] (fig. 45). Dans ces deux pays, les innovations de l'art de la guerre furent accueillies favorablement. Elles portèrent des fruits parce qu'elles furent appliquées par des chefs qui possédaient à un haut degré l'instinct des combinaisons, et qui commandaient à des peuples auxquels la persistance des agrégats donnait de la fermeté dans leurs résolutions ; et cela mieux pour la Macédoine que pour Thèbes, parce que, précisément à cause de l'intensité différente des résidus de la IIe classe, les Macédoniens demeuraient plus fidèles à leurs chefs que les Thébains.
§2430. Le fait de la puissance thébaine, qui naquit et disparut dans une courte période, est remarquable en ce qu'il dura précisément le temps pendant lequel les conditions indiquées au § 2429 subsistèrent. Lorsque, par la mort de Pélopidas ou d'Épaminondas, la première de ces conditions vint à disparaître, la puissance de Thèbes s'évanouit. Il sera donc bon que nous examinions quelque peu les circonstances particulières de ce fait.
§ 2431. La naissance de la puissance thébaine fut absolument imprévue. Lorsque à l'assemblée réunie à Sparte la paix fut conclue entre tous les états de la Grèce moins Thèbes, en constatant cette exclusion des Thébains [FN: § 2431-1] , nous dit Xénophon, « les Athéniens eurent l'opinion que, ainsi qu'on le disait, il était à prévoir que les Thébains étaient décimés ; de leur côté, les Thébains eux-mêmes se retirèrent entièrement découragés ». Après cela, sitôt que les Spartiates, conduits par leur roi Cléombrote, envahirent la Béotie, les habitants furent frappés de terreur et craignirent que leur cité ne fût tout-à-fait détruite [FN: § 2431-2] . Cela était parfaitement raisonnable, si l'on considère la grande force de l'armée que commandait Cléombrote et la réputation de Sparte, jusqu'alors invincible à la guerre.
§ 2432. Le peuple thébain fut favorisé par des préjugés correspondant aux résidus de la IIe classe : « À cause de la gloire des ancêtres, datant des temps héroïques, la cité des Thébains était pleine de courage et aspirait à accomplir de grandes choses [FN: § 2432-1] ». Jusque là pourtant Thèbes allait de pair avec Sparte, pleine elle aussi, de la gloire des ancêtres. Les Thébains [FN: § 2432-2] « avaient aussi des chefs extrêmement courageux, trois d'entre eux surtout : Épaminondas, Gorgias et Pélopidas ».
§ 2433. Épaminondas possédait à un haut degré le génie des combinaisons guerrières ; mais Cléombrote n'en était pas dépourvu, et il le prouva par son invasion de la Béotie [FN: § 2433-1] . Tandis que les Béotiens s'attendaient à le voir arriver par la route de la Phocide, il s'avança du côté des passages difficiles de Tisbé, atteignit Créüse et s'empara de cette ville ainsi que de douze trirèmes qui se trouvaient dans le port. La différence consistait en ce qu'à Sparte les innovations ne devaient pas sortir du cercle des institutions de Lacédémone, car la force des résidus de la IIe classe était si grande, chez les Spartiates, qu'en dehors de ce cercle, ils ne toléraient aucune innovation ; taudis qu'à Thèbes, les chefs pouvaient disposer de l'armée comme ils croyaient bon de le faire, car la force, ou si l'on veut aussi la nature des résidus de la IIe classe chez le peuple, ne s'y opposait pas.
§ 2434. Avant la bataille de Leuctres, des avertissements sérieux n'avaient pas manqué aux Spartiates pour les engager à modifier leurs formations tactiques. En 390 av. J.-C., l'Athénien Iphicrate avait détruit un corps de 600 hoplites spartiates, sous les murs de Corinthe, grâce à la savante formation qu'il avait su donner à ses peltastes (FN: § 2434-1). Mais l'inertie spartiate n'en fut nullement émue. Elle ne disparut pas, même après la terrible défaite de Leuctres. En revanche, Épaminondas, libre d'innover, changea entièrement l'ordre de bataille alors en usage, non seulement chez les Spartiates, mais aussi chez tous les autres peuples de la Grèce. Il fut le précurseur de Napoléon Ier, suivant lequel il faut s'efforcer d'être supérieur à l'ennemi, à un moment donné et sur un point donné. Les Grecs avaient l'habitude d'engager la bataille, autant que possible, sur tout le front de l'armée. Au contraire, Épaminondas rangea l'armée obliquement, de telle sorte que la gauche, avec le bataillon sacré en tête, comprenait les hoplites sur cinquante rangs de profondeur, ce qu'on n'avait alors jamais vu [FN: § 2434-2]. De cette façon, il attaquait avec une force irrésistible la droite spartiate, où se trouvaient le roi et les principaux chefs. La déroute de l'aile droite ennemie lui donnait une victoire complète. Les choses se passèrent comme le prévoyait le capitaine thébain. « Lorsqu’ils en vinrent aux mains, au début, comme on combattait vigoureusement des deux côtés, le combat était indécis. Ensuite, ceux qui étaient avec Épaminondas l'emportant, à cause de leur courage et de leur ordre très serré, un grand nombre de Péloponésiens furent tués ; car ils étaient incapables de tenir contre le violent assaut de ces soldats d'élite ; mais parmi ceux qui résistaient, les uns tombèrent, les autres furent blessés, recevant toutes leurs blessures par devant[FN: § 2434-3] ». Plus tard, à la bataille de Mantinée, Épaminondas employa de nouveau la tactique qu'il avait trouvée utile à Leuctres [FN: § 2434-4] , et les Lacédémoniens, nullement instruits par leur précédente défaite, continuèrent pour leur malheur à suivre l'ancienne tactique.
§2435. Les préjugés du peuple thébain lui furent utiles en lui donnant le courage de résister à Sparte. Ils furent sur le point de lui nuire à l'occasion de certains présages avant la bataille. Mais grâce à l'instinct des combinaisons d'Épaminondas, et à sa sagesse, les funestes présages se changèrent en heureux présages, auxquels Épaminondas en ajouta artificieusement d'autres excellents. C'est pourquoi, en conclusion, au lieu que sa foi aux présages lui causât quelque préjudice, le peuple thébain en retira grand profit.
§ 2436. En sortant de Thèbes, l'armée rencontra un crieur public qui conduisait un esclave aveugle [FN: § 2436-1] , et qui criait qu'on ne devait pas le laisser sortir de Thèbes. On considéra ces paroles comme un mauvais augure pour la sortie de l'armée. Mais aussitôt Épaminondas récita un vers d'Homère, qui dit que le meilleur augure est de défendre sa patrie. Un augure pire encore se manifesta : « Le secrétaire de camp allait portant une pique à laquelle était suspendue une bandelette, et publiant par l'armée les ordres des capitaines. Il arriva qu'un coup de vent ayant soufflé, la bandelette se détacha de la pique, et alla tomber sur le cippe d'une tombe, lieu où des Spartiates et des Péloponésiens, conduits par Agésilas, avaient précédemment été ensevelis. De nouveau les plus vieux se mirent à supplier qu'on n'allât pas plus avant, puisque les dieux s'y opposaient d'une manière évidente [FN: § 2436-2] ». Diodore ajoute qu'Épaminondas passa outre, dédaignant ces présages [FN: § 2436-3] . Mais la suite, racontée par Diodore lui-même, rend plus croyable ce que raconte Frontin, à savoir que, par une ingénieuse explication, Épaminondas tourna le présage en sa faveur [FN: § 2436-4] (§ 2439). En outre, il sut imaginer les présages de toutes pièces, et tirer ainsi avantage de la superstition de ses soldats. Il en imagina autant qu'on en pouvait vraiment désirer. Un contemporain d'Épaminondas, Xénophon [FN: § 2436-5] , qui put certainement s'entretenir avec ceux qui étaient présents à la bataille de Leuctres, raconte comment les Thébains acquirent confiance dans le succès, grâce à un oracle suivant lequel les Lacédémoniens devaient être défaits dans le lieu [Leuctres] où deux jeunes filles, violées par certains Lacédémoniens, s'étaient donné la mort (§ 1952). En outre, à Thèbes, les temples des dieux s'étaient ouverts spontanément, et les prêtresses déclarèrent que les dieux promettaient victoire. Ce n'est pas tout. On dit aussi que les vases du temple d'Héraclès avaient été dispersés ; ce qui signifiait qu'Héraclès était parti pour combattre. Bien que pieux et crédule, Xénophon ajoute [FN: § 2436-6] : « Pourtant d'aucuns disent que toutes ces choses étaient artifices des capitaines [FN: § 2436-7] ».
§ 2437. Diodore, qui tirait probablement ses renseignements des écrits aujourd'hui perdus d'Éphore, dévoile clairement l'artifice [FN: § 2437-1] , et raconte plusieurs détails. D'après lui [FN: § 2437-2] , Épaminondas fit dire par certains voyageurs arrivés de Thèbes que les armes suspendues dans le temple d'Héraclès avaient disparu ; ce qui faisait croire que les anciens héros les avaient prises pour venir combattre aux côtés des Béotiens. Un autre voyageur, revenant de l'antre de Trophônios, dit que Zeus-roi lui avait ordonné de prescrire aux Thébains, victorieux à Leuctres, d'instituer des jeux publics en l'honneur de Zeus-roi. « (1) Cette habileté [d'Épaminondas] fut secondée par le Spartiate Léandre, exilé de Lacédémone, et qui combattait alors avec les Thébains ; car, appelé dans l'assemblée, il affirma qu'il existait un antique oracle pour les Spartiates, suivant lequel ils perdraient l'hégémonie lorsqu'ils auraient été vaincus à Leuctres par les Thébains. (2) Il vint aussi vers Épaminondas certains indigènes, interprètes d'oracles, disant que, près du sépulcre des filles de Leuctres et de Skédazos, un très grave désastre devait frapper les Lacédémoniens, pour la raison suivante. (3) Leuctres était l'homme dont la plaine avait tiré son nom. Sa fille et celle d'un certain Skédazos, toutes deux vierges, furent violées par les délégués Lacédémoniens. Elles ne purent supporter l'ignominieuse injure, et, ayant prononcé des imprécations contre le pays qui avait envoyé les odieux délégués, elles s'ôtèrent la vie de leurs propres mains [FN: § 2437-3] ». Ce n'est pas encore tout. Plutarque raconte (voir : § 2437-4) comment Pélopidas eut un songe opportun qui lui prescrivait d'immoler une vierge rousse aux jeunes filles violées par les Spartiates. Après des discussions et des opérations capables de frapper l'esprit des soldats, on reconnut que la vierge rousse était une jument, et on la sacrifia.
§2438. Pélopidas et son ami Épaminondas étaient de fins connaisseurs de l'esprit humain. Si Pélopidas avait appris en songe qu'il fallait immoler sans autre une jument, son songe aurait frappé beaucoup moins l'esprit des soldats que l'angoisse d'un terrible sacrifice humain, heureusement évité par une ingénieuse interprétation. Les Romains, plus frustes que les Grecs, et peut-être frappés d'une plus grande terreur, recoururent, en des circonstances analogues, au sacrifice humain, sans substitution (§ 758).
§ 2439. La science des combinaisons d'Épaminondas, de Pélopidas, et peut-être d'autres chefs thébains, avait fait ses preuves, unie à une certaine force de permanence des agrégats chez les gouvernants thébains [FN: § 2439-1]. On vit de meilleurs résultats encore avec un plus grand écart entre les gouvernants et les gouvernés, dans le cas de Philippe de Macédoine et de ses sujets.
§ 2440. De même, au temps des guerres médiques, la science des combinaisons de Thémistocle avait fait ses preuves, unie à une certaine force de persistance des agrégats chez les Athéniens, lorsqu'il les engagea à abandonner leur cité et à se réfugier à Salamine. Avec un rapport inverse de ces résidus, l'épreuve fut mauvaise pour la combinaison par laquelle Nicias, chef des Athéniens, poussé par la force de la persistance des agrégats qui existait en lui, accorda créance aux oracles, et provoqua ainsi la ruine complète de l'armée qu'on lui avait confiée [FN: § 2440-1]. Les cas rappelés plus haut nous montrent par conséquent que les oracles sont utiles s'ils sont employés pour persuader les gouvernés, par des gouvernants qui n'y ont peut-être pas foi, et qu'ils sont nuisibles, s'ils sont tenus pour vrais par des gouvernants qui les considèrent comme un but, et non comme un moyen de persuasion. Si l'on veut généraliser cette proposition, et par conséquent l'étendre à des temps où n'existent pas des oracles, il faut substituer à ce terme d'oracle celui de persistance des agrégats (§ 2455). Ajoutons qu'il est avantageux que cette proposition soit ignorée des gens qu'on veut persuader, l'artifice devant être dissimulé pour être pleinement efficace. Mais, dans ce but, il est peu ou point nuisible qu'elle soit connue d'un nombre restreint de savants, l'expérience journalière montrant que les gens continuent à avoir foi en des assertions qui sont nettement contredites par les résultats connus de la science logico-expérimentale.
§ 2441. Philippe de Macédoine vécut dans sa jeunesse à Thèbes, et apprit d'Épaminondas l'art de la guerre [FN: § 2441-1] . S'il avait été citoyen de Sparte ou d'Athènes, il n'aurait pas pu faire grand'chose. Mais il eut à diriger un peuple chez lequel les préjugés étaient assez forts pour assurer l'obéissance au roi, et pas assez pour résister aux changements qu'il voulait introduire. La monarchie des rois macédoniens n'était pas absolue ; mais elle était beaucoup plus puissante que celle des rois spartiates. Si Épaminondas n'avait pas été tué à Mantinée, et avait encore vécu plusieurs années, il aurait peut-être pu s'opposer heureusement à la puissance naissante de Philippe. C'est là le rôle du hasard dans les événements humains. Il est certaines
§ 2442. À un autre extrême, Athènes eut en ce temps des généraux éminents. Elle ne sut ni les conserver ni s'en servir. Timothée et Iphicrate ne semblent avoir été en rien inférieurs à Philippe ; mais ils avaient le malheur d'avoir à faire avec le peuple athénien, entiché de nouveautés et de procès, incapable de cette sérieuse discipline que donne la persistance des agrégats. Un procès éloigna en même temps Timothée et Iphicrate, et laissa Athènes sans défense contre la puissance naissante et formidable de la Macédoine [FN: § 2442-1].
§2443. Là où les sentiments de la persistance des agrégats n'ont pas une grande force, les hommes cèdent facilement à l'impulsion présente, sans trop se soucier de l'avenir. Facilement entraînés par un appétit désordonné, ils oublient les grands intérêts de la collectivité. Les Macédoniens obéissaient en toutes choses à Philippe, puis à Alexandre. Les Thébains suivaient les prescriptions d'Épaminondas, mais lui intentèrent un procès, qu'il gagna d'ailleurs. Les Athéniens ne respectaient pas beaucoup leurs généraux ; ils les tracassaient, leur intentaient des procès, les condamnaient, se privaient d'eux par leur propre faute. Les leçons du passé ne profitaient pas à l'avenir, car les sentiments des agrégats ne duraient pas.
§2444. On observe des phénomènes analogues en comparant l'Allemagne à la France, depuis le temps du second Empire à nos jours (§ 2469 et sv.). Le premier de ces pays ressemble en quelque sorte à la Macédoine ou à Thèbes ; le second à Athènes. La force de la persistance des agrégats supplée au défaut de connaissances logico-expérimentales, en vertu desquelles les citoyens pourraient comprendre que l'utilité indirecte de l'individu est sacrifiée, quand on sacrifie au-delà d'une certaine limite l'utilité de la collectivité. Les citoyens qui préparent la défaite de Coronée, ou ceux qui préparent la capitulation de Sedan, provoquent leur propre dommage individuel.
§2445. Souvent on étudie ces phénomènes exclusivement par rapport à la forme démocratique, oligarchique, monarchique du gouvernement. Certaines personnes ont voulu rejeter la faute de tous les maux d'Athènes sur la démocratie athénienne. D'autres, au contraire, ont voulu innocenter celle-ci de ses péchés. On ne peut certes nier que les formes de gouvernement exercent une influence sur le phénomène social ; mais il faut observer d'abord qu'elles sont, au moins en partie, une conséquence de la mentalité des habitants, laquelle est de ce fait une cause beaucoup plus importante des phénomènes sociaux ; ensuite que, sous les mêmes formes de gouvernement, il peut se produire des phénomènes entièrement différents ; ce qui montre clairement l'existence de causes plus puissantes qui prévalent sur ces formes.
§2446. La forme monarchique a permis à Philippe de Macédoine, complètement défait par Onomarque, de conserver néanmoins le pouvoir et de prendre ensuite sa revanche. S'il avait été un général de la République athénienne, il aurait probablement été condamné à mort ; ce qui aurait pu empêcher la puissance macédonienne de naître. S'il avait été un général de la République thébaine, il aurait été destitué, comme il arriva à Épaminondas, et c'eût été encore un très grave dommage pour la Macédoine. On serait induit à conclure de là que, par la stabilité qu'elle donne au commandement, la forme monarchique est favorable à la prospérité du pays. Cela est vrai en de nombreux cas ; mais pas en d'autres. La stabilité est utile si le chef est bon, comme un Épaminondas ou un Philippe ; il n'y a là-dessus aucun doute. Elle est utile aussi si le chef est médiocre, parce que le dommage du changement peut dépasser de beaucoup l'utilité d'ôter le commandement à qui est peu capable ; mais elle est certainement nuisible si elle conserve le pouvoir à un chef absolument mauvais, comme furent un grand nombre d'empereurs romains [FN: § 2446-1]. En outre, on observera que la conduite des Athéniens et des Thébains n'était nullement une conséquence nécessaire de la forme républicaine, car celle-ci existait aussi à Rome, lorsque après la défaite de Cannes, tous les ordres de l'État allèrent à la rencontre du consul vaincu pour le remercier de n'avoir pas désespéré des destins de Rome [FN: § 2446-2] . Il n'est pas du tout démontré que toutes les républiques doivent prêter attention à des hommes tels qu'un Cléon d'Athènes, un Ménéclide de Thèbes, ou un Caillaux de la république française contemporaine.
§ 2447. Parlant de l'état de la Prusse avant la bataille de Iéna, von der Goltz dit [FN: § 2447-1] : « “ (p. 396) En France, l'autorité civile donne toujours la main à l'armée, tandis qu'en Allemagne, l'esprit qui domine, aussi bien dans le gouvernement que dans le peuple, est de mettre toujours des obstacles dans le chemin de l'autorité militaire „ [Maintenant les termes sont intervertis : ce qu'on disait de l'Allemagne s'applique à la France, et vice-versa]. Tel était le résumé de l'opinion de Sharnhorst, et il ajoutait : “C'est pourquoi on a dit, non sans raison : Les Français, avec un gouvernement républicain, sont régis monarchiquement, tandis que les puissances alliées, avec un gouvernement monarchique, sont régies comme si elles étaient en république ” ».
§2448. Lorsque les gouvernants eurent les sentiments manifestés par l'affaire Dreyfus, la République française négligea grandement la défense nationale. Mais l'Empire l'avait négligée à peu près tout autant. En revanche, la République conservatrice, après 1871, l'avait mise au premier plan de ses préoccupations. Il est donc impossible de trouver en ce cas un rapport entre la forme du gouvernement et les mesures prises pour la défense nationale.
§2449. Comme nous l'avons dit souvent déjà, les faits du passé et ceux du présent se prêtent un mutuel appui dans la recherche des uniformités sociales. Les faits du présent, plus connus dans leurs détails, nous permettent de mieux comprendre ceux du passé. Les faits du passé, lorsqu'ils ressemblent à ceux du présent, sous certains rapports, servent à préparer l'induction qui donnera à ces rapports la valeur d'uniformités.
§ 2450. Par exemple, si l'on veut bien comprendre ce qui se passait dans l'Athènes antique, on doit considérer ce qui est arrivé en France depuis le temps du ministère Waldeck-Rousseau. Les désastres français de la guerre de 1870 eurent des causes puissantes dans le fait que les considérations politiques étaient substituées aux considérations militaires. Politiques furent les motifs de la marche sur Sedan ; politiques, les motifs de l'inaction de Bazaine à Metz. Il semblerait qu'un peuple qui a reçu ces terribles leçons devrait désormais bannir la politique des questions militaires. Au contraire, voici Waldeck-Rousseau, qui peut aller de pair avec les pires démagogues athéniens, occupé à désorganiser toute l'armée pour des raisons politiques [FN: § 2450-1]. Afin d’accomplir l'œuvre néfaste à son pays, il fait mettre au ministère de la guerre le général André. Celui-ci employait son temps en basses intrigues politiques, négligeant entièrement la défense nationale, à tel point que, lorsqu'en 1905 on craignit la guerre avec l'Allemagne, il fallut d'urgence pourvoir au strict nécessaire pour la défense de la frontière du nord-est, que le général André avait volontairement négligée, dans le but de complaire à ses complices politiciens.
§ 2451. Ce n'est pas tout. En France comme à Athènes, les mêmes erreurs se reproduisirent, parce que si les causes subsistent, les effets subsistent aussi. En 1911, une nouvelle menace de guerre fit voir aux gouvernants français que le général Michel, auquel on avait confié le commandement suprême pour des raisons politiques, aurait été incapable de l'exercer [FN: § 2451-1] . Son mérite était principalement sa complaisance envers les politiciens. Un colonel Picquart avait été nommé général pour services rendus dans le procès Dreyfus. Aux manœuvres de 1910, il paraît qu'il ne fut pas très brillant. Afin de ne pas dire cela, ce qui eût déplu aux politiciens, le général Michel, contrairement à l'usage jusqu'alors suivi, ne fit pas immédiatement la critique des manœuvres, gagna du temps, et la fit ensuite aussi atténuée que possible.
§ 2452. Lorsque, sous la menace d'une guerre, on dut remplacer le général Michel par un autre, chacun reconnaissait qu'en fait de mérites militaires, on devait faire appel au général Pau. Mais, pour assumer le commandement, ce général posait comme condition qu'il aurait une part prépondérante à la nomination des généraux de corps, et que ceux-ci seraient choisis uniquement pour leurs mérites militaires, sans considérer les protections des politiciens. Cette condition ne put être acceptée par le gouvernement, qui chercha un autre commandant, plus souple à la politique [FN: § 2452-1].
§ 2453. Qu'on veuille lire maintenant ce qu'Isocrate écrit des causes qui provoquèrent la condamnation de Timothée, à Athènes, et l'on verra que ce sont là des causes et des effets constants. Isocrate rapporte qu'il avertit Timothée : « Tu vois la mentalité de la foule, comme elle recherche le plaisir, et préfère par conséquent ceux qui recherchent ses bonnes grâces, plutôt que ceux qui agissent bien ; ceux qui la trompent aimablement et gentiment, plutôt que ceux qui lui sont utiles gravement et avec autorité [FN: § 2453-1] ». Il continue et lui conseille d'agir de manière à se concilier la bienveillance des politiciens. Timothée répondit que ces conseils étaient sages, mais qu'il ne pouvait changer son tempérament et se ravaler au niveau de ceux qui ne supportent pas des hommes de qualités supérieures aux leurs. En somme, il ne savait pas se résigner au « culte de l'incompétence », dont Faguet a aujourd'hui si bien parlé.
§ 2454. On trouve des observations semblables à celles d'Isocrate chez beaucoup d'auteurs. Elles affectent souvent la forme inutile et fausse de prédications morales, ou celle, tout aussi inutile et fausse, d'accusations contre certaines formes de gouvernement (§ 2261). Ce n'était pas – comme certains le prétendent – le régime démocratique d'Athènes qui était la cause des vices indiqués plus haut. Régime et vices étaient une conséquence des sentiments des Athéniens et de toutes les circonstances qui les entouraient [FN: § 2454-1]. Les comparaisons établies entre divers peuples ou divers temps et circonstances dans lesquels on considère un même peuple, servent à mettre en lumière les effets des forces permanentes, en les séparant des effets des forces contingentes. Les principaux de ces derniers effets sont ceux qui dépendent du tempérament des hommes auxquels la fortune donne le pouvoir dans l'État [FN: § 2454-2] . C'est pourquoi nous avons exposé un peu longuement le cas de la France, qui nous fournit trois exemples très remarquables. Tout d'abord, c'est l'Empire qui néglige la défense nationale, qui n'ose pas imposer au pays les sacrifices qu'elle eût nécessités. Ensuite, c'est la République qui, aussitôt après la guerre de 1870, impose ces sacrifices, que le pays accepte allègrement. Enfin, c'est la République, après 1900, qui n'ose pas, qui ne peut pas imposer des sacrifices au pays. Si l'on veut comparer cette République-là uniquement à la République conservatrice antérieure, on peut rejeter la faute sur l’extension de la démocratie. Mais cette déduction ne se soutient plus, si l'on étend la comparaison à l'Empire qui, sans être démocratique, a agi comme la République démocratique. De même, si l'on ne compare que l'Empire et la République conservatrice, on peut, comme beaucoup l'ont fait, rejeter la faute des désastres de la guerre exclusivement sur le pouvoir personnel de l'empereur. Mais cette conclusion ne peut subsister si l'on établit la comparaison entre l'Empire et la République démocratique, dans laquelle il n'est pas question du pouvoir personnel de l'empereur, tandis que subsiste l'insuffisance de préparation qui amena la défaite de 1870. Au contraire, les phénomènes s'expliquent très facilement si l'on prête attention à la force des résidus de la IIe classe. Là où ces résidus sont puissants et maintenus tels par un gouvernement avisé, qui sait s'en servir, la population accepte volontiers le fardeau de la préparation à la guerre. Là où ils sont, au contraire, faibles ou affaiblis par un gouvernement qui s'occupe seulement de certains intérêts matériels sans jeter un regard vers l'avenir, la population refuse le fardeau de la défense nationale [FN: § 2454-3]. Si l'on étudie attentivement l'histoire, on voit que les avertissements de quitter la mauvaise voie ont bien rarement fait défaut aux peuples qui s'acheminaient à la défaite et à la ruine ; et peu nombreux, très peu nombreux furent les gouvernements assez imprévoyants pour ne pas entrevoir la débâcle. Donc la force nécessaire à pousser les peuples à pourvoir à leur défense existait ; mais elle agissait plus ou moins efficacement selon son intensité. Celle-ci dépendait surtout de l'intensité des résidus de la IIe classe chez les gouvernants, et rencontrait une résistance plus ou moins grande, suivant que, chez les gouvernés, l'intensité de ces mêmes résidus était plus ou moins grande. Le peuple romain vainquit les peuples grec et carthaginois, surtout parce qu'il possédait plus intenses les sentiments de persistance des agrégats, connus sous le nom d'amour de la patrie, et d'autres sentiments qui soutiennent et renforcent celui-là. Cependant, ces gouvernants possédaient en abondance des résidus de la Ie classe, grâce auxquels ils pouvaient utiliser convenablement les résidus de la IIe classe qui existaient chez les gouvernés.
§ 2455. Même si l'on considère des collectivités restreintes ou un petit nombre d'hommes, on voit l'utilité de certaines combinaisons des résidus de la Ie classe et de ceux de la IIe. Par exemple, c'est peut-être l'union de Bismarck avec Guillaume Ier qui leur a permis d'accomplir de grandes choses. Une anecdote bien connue, racontée par Bismarck, nous montre clairement comment les « préjugés » (persistance des agrégats) de Guillaume Ier sauvèrent la monarchie prussienne. En 1862, le conflit entre le roi de Prusse et son parlement était devenu aigu. Le roi revenait découragé, de Baden à Berlin, et Bismarck alla à sa rencontre pour le persuader ; il dit [FN: § 2455-1] : « (p. 358) Encore sous l'impression de l'entrevue avec sa femme, il était visiblement déprimé, et lorsque je lui demandai la permission de lui exposer ce qui s'était passé pendant son absence, il m'interrompit en disant : “ Je prévois parfaitement comment tout cela finira. Là-bas, place de l'Opéra, sous mes fenêtres, on vous coupera la tête à vous, et un peu plus tard, à moi ”. Je devinai, comme cela me fut plus tard confirmé par des témoins, que pendant les huit jours de son séjour à Baden on l'avait travaillé avec des variations sur le thème Polignac, Strafford, Louis XVI. Lorsqu'il se tut, je répondis ce simple mot : “ Et après, Sire? ” – “ Eh bien, après, mais nous serons morts ! ” répliqua le roi. “ Oui, repris-je, après nous serons morts, mais il nous faut bien mourir tôt on tard, et pouvons-nous périr d'une manière plus digne ?... (p. 359) Votre Majesté est dans la nécessité de lutter. Vous ne pouvez pas capituler, vous devez vous opposer à la violence qui vous est faite, dût votre personne être en danger ”. Plus je parlais dans ce sens, plus le roi s'animait et entrait d'esprit dans le rôle de l'officier combattant pour la monarchie et la patrie. [Persistance des agrégats. – Résidus de la IIe classe.] Devant les dangers “ extérieurs ” et personnels, sur le champ de bataille comme dans un attentat, il était d'une intrépidité rare et qui chez lui était naturelle... Il offrait, développé au plus haut degré, le type idéal de l'officier prussien : dans le service, il marche à une mort certaine, sans regrets, sans crainte, avec le simple mot : “ Oui, mon, commandant ” ; par contre, quand il doit agir sous sa propre responsabilité, il redoute les critiques de son supérieur et du monde plus que la mort [absence des résidus de la première classe. Mais Bismarck avait ce qui manquait à Guillaume Ier.] ... Maintenant..., l'effet de notre conversation dans le (p. 360) compartiment mal éclairé fut qu'il envisagea le rôle que lui créait la situation plutôt au point de vue de l'officier. Il redevenait avant tout militaire et envisageait sa situation comme étant celle d'un officier chargé de défendre jusqu'à la mort le poste qui lui est assigné, advienne que pourra ». Si Charles X, Louis-Philippe, Mac Mahon, en France, avaient pensé et agi de la sorte, ils n'auraient pas si facilement perdu le pouvoir.
§2456. En 1859, la guerre d'Italie avait montré, d'une part aux gouvernants de la Prusse, d'autre part à ceux de la France, l'urgente nécessité de perfectionner leur organisation militaire. Des deux côtés l'on s'y mit, mais avec des résultats bien différents. Le roi Guillaume avait, dans son État, un pouvoir beaucoup moins grand, et rencontrait une opposition beaucoup plus forte que Napoléon III en France. Pourtant, Guillaume atteignit pleinement son but et Napoléon ne réussit pas. Pourquoi ? Tout en soutenant la thèse erronée d'après laquelle la France était parfaitement préparée à la guerre, en 1870, Émile Ollivier admet, en contradiction avec sa propre thèse, que la préparation ne put être achevée ni en 1860, ni en 1867 (§ 2461).
§ 2457. Nous avons déjà cité (§ 1975-3) ce qu'il dit au sujet de la préparation après 1860, et nous avons examiné ses deux affirmations concernant la corrélation existant entre les bonnes œuvres et la félicité. Voyons maintenant les faits qu'il rapporte à propos des résidus de la Ie et de la IIe classe, chez les gouvernants et les gouvernés. Bien que différents en apparence, en somme, les deux aspects concordent en grande partie, car l'adoption des principes éthiques employés par Ollivier dépend précisément de ces résidus de la IIe classe, lesquels peuvent être nuisibles ou avantageux, suivant qu'ils existent surtout chez les gouvernants ou surtout chez les gouvernés.
§ 2458. Napoléon III apparaît dans l'histoire sous deux aspects principaux : celui du chef inconscient d'une coterie de spéculateurs (§ 2463-1, 24651) qui s'en servirent comme d'un instrument, et celui d'un brave et digne homme chez lequel prédominaient les résidus de la IIe classe [FN: § 2458-1] (§ 1975). Ce ne fut pas pour lui un petit avantage que son gouvernement commençât et se continuât dans une période de prospérité économique croissante (§ 2302).
§ 2459. L'idée maîtresse de l'histoire d'Ollivier consiste à opposer un souverain brave, honnête, moral (Napoléon III) à un autre, méchant, pervers, cruel (Guillaume Ier). L'auteur est tellement pénétré de la conception éthique, qu'il ne s'aperçoit pas que ses louanges constituent les pires accusations qu'on puisse porter contre le souverain qu'il veut défendre, et qui finit par apparaître imprévoyant et incapable. S'il a été tel que le dépeint Ollivier, il s'est montré peut-être un parfait honnête homme, mais certainement aussi un non moins parfait imbécile (§ 1975). S'il ne comprenait pas quels événements se préparaient en Allemagne, c'est qu'il ne comprenait vraiment rien. On se prend à rire en songeant à ce rêveur, qui suppose que la « suprématie morale » peut exister sans la suprématie de la force. Si plus tard, lorsqu'il se rencontra avec Bismarck, Napoléon lui avait demandé ce qu'il pensait de cette stupéfiante conception, Bismarck aurait eu un moment de véritable gaieté.
§2460. Mais quelles qu'aient été les causes d'inertie de l'empereur, l'explication donnée par Ollivier pourrait être bonne, et nous devons l'examiner. Tout ce que nous connaissons de la mentalité de ce rêveur humanitaire que fut Napoléon III, montre qu'il y a un peu de vrai dans la cause alléguée par Ollivier. Mais on ne peut la considérer comme unique ni même comme principale, car, lorsqu'elle vint à disparaître, le même effet se manifesta encore.
§ 2461. Ollivier lui-même nous en donne la preuve. En 1867, tout le monde prévoit la possibilité d'une guerre [FN: § 2461-1] . Le rêve puéril de la « suprématie morale » semblait s'être évanoui, et Napoléon III institua [FN: § 2461-2] « une (p. 318) Haute commission composée des personnages éminents de son gouvernement dans tous les ordres, et la chargea de rechercher ce qu'il y aurait à faire pour mettre nos forces nationales en situation d'assurer la défense du territoire et le maintien de notre influence politique ». Le maréchal Niel prépara un projet de loi pour renforcer l'armée. Le Corps Législatif nomma une commission opposée aux sacrifices qu'on demandait au pays. L'empereur résista et fit même menacer de dissolution le Corps Législatif. Mais la commission tint bon. « (p. 347) L'Empereur pensa d'abord à relever le défi qu'on lui jetait et à recommencer en France la lutte du roi Guillaume contre son Parlement. Rouher déploya à l'en détourner autant de véhémence qu'il en avait mis à intimider la Commission... Le maréchal Niel fléchit à son tour... „ Il eût mieux valu obtenir davantage, mais ce qu'on aurait serait suffisant. “ Et sans même prendre les ordres de (p. 348) l'Empereur, il entra en pourparlers avec la Commission et lui concéda que toute la classe ne serait pas incorporée, et qu'un contingent annuel serait fixé par la Chambre. L’Empereur fut douloureusement surpris de cette concession de son ministre. Quand on vint la lui apprendre, il laissa tomber sa tête entre ses mains et demeura quelques instants accablé. Abandonné par tous, il n'avait plus qu'à se résigner lui aussi [FN: § 2461-3] ».
§ 2462. Ici nous sommes sur la voie de l'explication réelle. Guillaume Ier était entouré d'hommes tels que Roon, Moltke, Bismarck. Napoléon était entouré d'hommes tels que Randon, Niel, Rouher. Ce n'est pas tout. Il faut élargir encore le cercle des gouvernants. En Prusse, une monarchie héréditaire s'appuie sur une noblesse fidèle : les résidus de la IIe classe prédominent. En France, un aventurier couronné s'appuie sur une coterie de spéculateurs et de jouisseurs : les résidus de la le classe prédominent.
§2463. En France, les gens de l'opposition démocratique ne valaient pas mieux que les partisans de l'autorité impériale. Sous des formes différentes, une seule conception apparaissait : « Nous voulons nous enrichir, jouir ; nous ne voulons pas faire de sacrifices [FN: § 2463-1] ». Ici, nous voyons de nouveau les effets de la faiblesse des résidus de la IIe classe, qui sont parmi les forces les plus capables de déterminer les hommes au sacrifice. De nouveau, nous constatons ce défaut lorsqu'un gouvernement radical-socialiste accorda à ses fidèles la réduction à deux ans du service militaire ; puis quand, en 1913, une forte opposition se manifesta contre le projet de le ramener à trois ans ; ce qui était absolument indispensable en présence de l'accroissement formidable de l'armée allemande ; et quand, enfin, le ministre Barthou fut renversé au cri de : « À bas la loi des trois ans ! », loi que le ministre Vaillant eut du moins le courage de promulguer, tout en faisant le contraire de ce qu'il disait.
§ 2464. Sans beaucoup de succès, le maréchal Niel suppliait les élus de la majorité de faire quelque sacrifice pour l'armée. Il disait : « [FN: § 2464-1] (p. 565) Si vous me faites exagérer le nombre des hommes en congé, nous aurons des régiments sans effectifs suffisants, les officiers découragés, les sergents et les caporaux partis. Le système nouveau paraîtra détestable, vous l'aurez fait échouer alors qu'il doit triompher ».
§ 2465. La Prusse offre un tout autre spectacle. Stoffel en fut frappé. Il avertit, mais en vain, son gouvernement de se tenir sur ses gardes. En France, l'armée était soumise à la finance [FN: § 2465-1], en Prusse la finance à l'armée. Non pas que les résistances fissent défaut en Prusse ; elles y furent, au contraire, très vives, mais purent être vaincues grâce aux traditions et aux préjugés d'une population jusqu'alors très peu industrielle, peu commerçante, peu spéculatrice. Entre la Prusse et la France, avant 1870, des rapports analogues à ceux qui existaient entre la Macédoine et Athènes, aux temps de Philippe, ne font pas défaut. « (p. 101) Les personnes des plus riches familles, tous les noms illustres servent comme officiers, endurent les travaux et les exigences de la vie militaire, prêchent d'exemple, et, à la vue d'un tel spectacle, non seulement on se sent pris d’estime pour ce peuple sérieux et rude, mais on en vient presque à redouter la force que donnent à son armée de pareilles institutions ». Et en note : « J'ai déjà dit qu'en Prusse tous les honneurs, tous les avantages, toutes les faveurs sont pour l'armée ou ceux qui ont servi. Celui qui pour une cause quelconque n'a pas été soldat n'arrive à aucun emploi ; dans les villes et les campagnes, il est l'objet des sarcasmes de ses concitoyens [FN: § 2465-2] ». Au contraire, en France, même après la terrible leçon de 1870, l'armée demeure subordonnée aux politiciens. De même que Machiavel prenait la partie pour le tout en parlant de la religion là où il faut entendre les résidus de la IIe classe, de même Stoffel parle de la morale, là où nous devons entendre ces mêmes résidus. « (p. 103) Je dois encore signaler une qualité qui caractérise tout particulièrement la nation prussienne, et (p. 104) qui contribue à accroître la valeur morale de son armée : c'est le sentiment du devoir. Il est développé à un tel degré dans toutes les classes du pays, qu'on ne cesse de s'en étonner quand on étudie le peuple prussien. N'ayant pas à rechercher ici les causes de ce fait, je me borne à le citer. La preuve la plus remarquable de cet attachement au devoir est fournie par le personnel des employés de tout grade des diverses administrations de la monarchie : payés avec une parcimonie vraiment surprenante, chargés de famille le plus souvent, les hommes qui composent ce personnel travaillent tout le jour avec un zèle infatigable, sans se plaindre, ou sans paraître ambitionner une position plus aisée. “ Nous nous gardons bien d'y toucher, me disait ces jours derniers M. de Bismarck ; cette bureaucratie travailleuse et mal payée nous fait le meilleur de notre besogne et constitue une de nos principales forces” ». On observait quelque chose de semblable au Piémont avant 1859, et ce ne fut pas la dernière cause des succès de ce pays.
§ 2466. Mais tout cela est impossible là où les résidus de la Ire classe prédominent grandement, où la spéculation, l'industrie, la banque, le commerce accaparent tous les hommes intelligents et travailleurs. Avant 1870, la Prusse était pauvre et forte. Aujourd'hui, elle est certainement plus riche ; mais il se peut aussi qu'elle soit plus faible, si, dans la classe gouvernée, l'augmentation de la persistance des agrégats, manifestée par le pangermanisme et par d'autres phénomènes analogues, n'a pas compensé l'augmentation de l'instinct des combinaisons ; et vice-versa si, dans la classe gouvernante, elle l'a plus que compensée [FN: § 2466-1]. Quant à la France, elle ressemble aujourd'hui à ce qu'elle était avant 1870. Si les résidus de la Ire classe ne s'y sont pas accrus, il est certain qu'ils n'ont pas diminué. Mais les résidus de la IIe classe se sont aussi accrus chez les gouvernés. Ils se manifestent par la nouvelle efflorescence de la religion de la métaphysique, et par l'intensification du nationalisme. Nous demeurons par conséquent dans le doute au sujet du sens suivant lequel peut avoir varié la proportion entre les résidus de la IIe classe et ceux de la Ire.
§ 2467. Prenons garde d'ailleurs qu'il s'agit toujours de plus ou de moins dans la proportion entre la persistance des agrégats et l'instinct des combinaisons, non seulement dans la classe gouvernée, mais aussi dans la classe gouvernante, et que le maximum de pouvoir politique et militaire ne se trouve ni à l'un des extrêmes ni à l'autre. Par exemple, avant 1866, le Hanovre s'était complètement endormi, et, satisfait de son état de tranquillité, il ne se préparait nullement aux éventualités qui pouvaient surgir. Dans un de ses discours, Bismarck disait à ce propos [FN: § 2467-1] : « M. le député de Vincke a prétendu avec une apparence de raison que les Hanovriens, comme le dit le proverbe français, avaient mangé leur pain blanc le premier, qu'ils n'avaient eu pendant longtemps nul souci de la défense du pays, et que, s'ils eussent agi comme ils le devaient, ils n'auraient pas fait ces économies. Certes, Messieurs, une mauvaise organisation de la défense nationale porte en soi son châtiment. Pour avoir négligé cette défense le Hanovre a perdu son autonomie, et le même sort attend tous les États qui négligeront leur défense ; c'est ainsi que cela se paye ».
§2468. L'exemple du Hanovre nous enseigne que la cause des différences observées en 1870, entre la France et la Prusse, n'est pas la différence existant entre les races latines et germaniques. Il y a plus. La même Prusse fut vaincue dans la campagne de Iéna pour des causes analogues, au moins en partie, à celles qui provoquèrent la défaite de la France en 1870.
§ 2469. Écoutons ce que dit von der Goltz [FN: § 2469-1] , et nous verrons qu'en nombre de passages, il suffit d'intervertir les termes Prusse et France, pour avoir une description des événements de 1870 : « (p. 306) ...dans ces campagnes [du Rhin] la Prusse n'avait mis sur pied qu'une partie de ses forces, parce que, comme dit Clausewitz, “ elle voulait observer les règles d'une sage prudence ”. Elle se consolait en pensant que si elle voulait mettre en jeu tous ses moyens dans une campagne sérieuse, elle triompherait facilement de la France nouvelle ». Avant 1870, la France avait les informations de Stoffel, et les négligea. Avant Iéna, le gouvernement prussien eut de semblables informations, et les négligea également. « (325) Les relations avec les armées françaises ont donc toujours existé ; on ne manqua jamais d'occasions d'étudier ces armées, pas plus que de rapports officiels sur leur manière d'être. Le ministre von Alvensleben s'était prononcé, dès le 12 mai 1798, dans un mémoire très remarquable, sur la situation de la Prusse. “ Pour combattre avec avantage les Français, il faut adopter leurs coutumes et leurs méthodes, sans lesquelles nous serons toujours dans un état d'infériorité. Pour se procurer ces ressources, il faut, comme en France, piller tout le pays avant de commencer. Pour se procurer des recrues, il faut mettre en réquisition toutes les provinces... “ Alvensleben n'ignorait pas ce que la mesure proposée avait de radical. Il craignait même que son adoption n'amenât une révolution, et ne trouvait malheureuse ment, comme moyen terme, que de recommander l'alliance avec la France » [FN: § 2469-2] .
§ 2470. Au lieu de Napoléon, mettez Bismarck, au lieu de la Prusse, mettez la France, et vous aurez, décrits par von der Goltz, les faits diplomatiques qui précédèrent la guerre de 1870. « (p. 337) Napoléon avait complètement joué la Prusse. Mais ce ne furent pas seulement les hommes d'État qui se laissèrent tromper : il y eut dans la nation beaucoup de gens qui prirent pour argent comptant l'assurance donnée, en août 1806, par le Journal de Paris : “ La France et la Prusse sont liées par la plus étroite amitié. ” Ce qui nous surprend le plus, c'est que dans ces jours où le danger d'une guerre était de tous les instants, on philosophait en Allemagne, non seulement sur l'abolition des armées permanentes, mais aussi sur la possibilité de la paix universelle, qu'on regardait comme prochaine. “ Jamais, par le concours des circonstances, une époque n'a été plus propice pour réaliser cette grande idée, qui fera le bonheur de l'humanité, ” déclarait un savant dans les nouvelles de Berlin, du 9 mai 1805... (p. 338) L'erreur des diplomates fut par suite l'erreur de beaucoup d'autres. Plus le danger augmentait, plus les esprits s'endormaient avec confiance dans la sécurité ». Exactement comme la France [FN: § 2470-1] , lorsqu'à la veille de la guerre de 1870, ses politiciens se rendaient aux congrès de la Paix pour proclamer la paix universelle ; ou quand, à la veille du coup d'Agadir, leurs successeurs répétaient les mêmes sottises (§ 2454-2).
§ 2471. Le crédit qu'acquièrent à de certains moments les dérivations humanitaires est d'habitude un signe de l'affaiblissement des résidus de la IIe et de la Ve classe, qui tendent à la conservation de l'individu et de la collectivité. Les beaux parleurs s'imaginent que leurs déclamations peuvent être substituées aux sentiments et aux actes qui maintiennent l'équilibre social et politique.
§ 2472. Continuons à voir chez notre auteur comment les mêmes causes produisent les mêmes effets. De même que la France en 1866, « (p. 339) pendant l'année 1805, la Prusse eut, pour agir, une occasion telle qu'il ne s'en était pas présenté de plus favorable depuis 1740... (p. 340) Il n'y avait qu'un pas à faire. Comme on jugerait différemment aujourd'hui cette armée tant conspuée pour sa défaite d'Iéna et d'Auerstaedt, si la politique avait fait ce pas... (p. 341) Tandis que l'opinion publique se réjouissait du maintien de la paix, tandis que les esprits éclairés considéraient la politique d'hésitation comme la plus haute sagesse... (p. 375) La pensée dominante des deux hommes d'État dirigeants, Hardenberg et Haugwitz, qui croyaient tirer un profit de la grande crise sans tirer l'épée [semblablement Napoléon III, en 1866] était une chimère incompréhensible, étant donné la manière de faire de Napoléon [de Bismarck]. Chercher à obtenir une part du butin, sans avoir la résolution formelle de la conquérir sur l'adversaire, n'est ni honorable ni prudent. “ Une politique qui pêche volontiers en eau trouble, est dangereuse ; elle n'est bonne que lorsqu'elle est intimement liée à beaucoup d'audace et de force, car il n'est pas de puissance qui nous permettra de la jouer impunément si nous ne lui inspirons de la crainte ” [c'est exactement ce que dit Machiavel, et ce que Napoléon III oublia en 1866 (§ 1075-3). Donc, lorsque, le 24 janvier 1806, la majeure partie de l'armée fut mise sur le pied de paix alors que Napoléon maintenait, dans l'Allemagne du Sud, ses forces sur le pied de guerre, la Prusse se livra à la merci de l'ennemi, qu'elle venait d'aigrir et de rendre défiant par le bruit de ses armes. Puis, au mois d'août 1806, elle se décida à faire la guerre, alors qu'il était impossible de se dissimuler les desseins de Napoléon [de Bismarck en 1870.] Cette résolution fut dictée par la crainte d'une attaque et put être justifiée comme un acte de désespoir. Mais le moment était complètement défavorable [exactement comme pour la France, en 1870]... Après des fautes si graves, il était difficile de compter sur une guerre heureuse... (p. 377) Cette politique, cette direction supérieure, la composition malheureuse du quartier général, l'infériorité numérique des troupes, furent les principales causes extérieures de la catastrophe ». On peut répéter les mêmes choses de la France en 1870. Il est inutile qu'Ollivier tente de rejeter la faute sur les généraux. Ils ont peut-être agi mal, très mal ; mais s'ils avaient été sous les ordres d'un Moltke et d'un Guillaume Ier, s'ils s'étaient trouvés dans d'autres conditions politiques, ils auraient agi aussi bien que leurs adversaires.
§ 2473. Bon nombre de personnes croient que l'humanitarisme est un produit de la démocratie. Elles se trompent : il peut exister dans un État monarchique ou aristocratique, aussi bien que dans un État républicain ou démocratique. Il ne faut pas confondre la démocratie de fait avec la démocratie idéale des humanitaires, de même qu'il ne faut pas
§ 2174. Continuons à écouter notre auteur : (p. 391) L'armée était anxieusement surveillée afin de l'empêcher de donner des signes de mécontentement. Quelque tranquille qu'on fût en Prusse, et bien que la confiance dans l'armée ne fût nullement ébranlée, les classes dirigeantes n'étaient pas exemptes d'une secrète peur de révolution ». Donc, dans la Prusse monarchique semi-féodale de 1800, il se produisait les mêmes phénomènes que dans la France républicaine, démocratique, de 1900. Ce qui suit confirme cette déduction. « (p. 391) Möllendorf ne cessait de recommander aux postes et aux sentinelles, lorsqu'il s'agissait de dissiper les rassemblements, et en général dans le cas où ils avaient à rétablir l'ordre, d'agir toujours avec patience et ménagement et de n'avoir recours à une rigueur modérée que lorsque les moyens de conciliation étaient impuissants [FN: § 2174-1] . On ne devait pas exciter les bourgeois à des offenses par paroles ou actions, ou à la résistance, ni même leur en fournir l'occasion. Il était absolument défendu de maltraiter un tapageur arrêté ; on devait au contraire le traiter convenablement ». Ce sont là des dogmes de nos humanitaires modernes. « (p. 392) Funk raconte en outre ce qui suit dans son journal (p. 393) “ La Saxe avait joui de près de trente années de paix et d'une administration dans laquelle l'élément militaire était tenu à l'écart presque partout. Les baillis et bourgmestres regardaient fièrement, du haut de leur grandeur, les officiers supérieurs, certains que ceux-ci, en cas de conflits, seraient condamnés par toutes les instances ”. Ce qui est dit ici pour la Saxe s'applique également à la Prusse, bien qu'à un degré moindre ». C'est ce qui se passait, en 1913, en France et en Italie, avant la guerre de Libye.
§ 2475. L'auteur cite une poésie de 1807, où il est dit : « (p. 401) “Jadis la plus grande gloire d'un héros consistait à mourir en combattant pour la patrie et son roi. Mais depuis que le monde et les hommes cultivent la civilisation et la philosophie, on appelle combattre jusqu'à la mort « organiser l'assassinat ”. De sorte que la civilisation nous amène à ménager même le sang de l'ennemi ». C'est exactement ce que disent aujourd'hui nos humanitaires. L'auteur conclut : « (p. 401) Il est donc incontestable que l'esprit de l'époque fut la principale cause de la faiblesse intérieure de l'armée prussienne ».
§ 2476. Il est important de remarquer que cette conclusion d'un homme pratique concorde parfaitement avec celle de notre théorie, laquelle fait dépendre les phénomènes sociaux surtout des sentiments (résidus). L'exemple rappelé plus haut fait voir une fois de plus que les dommages sont semblables, malgré la diversité des peuples, lorsqu'il y a un excès de résidus de la Ie classe (la Prusse en 1800, la France en 1870). En s'éloignant, d'un côté ou de l'autre, de la proportion qui correspond au maximum d'utilité, on trouve également des États qui subissent des dommages pour cette cause.
§2477. Après l'équilibre des nations, voyons l'équilibre des divers états sociaux. Autrement dit, étudions des exemples de la circulation des élites. Il convient de commencer par une étude de mouvements virtuels, en recherchant comment la classe gouvernante peut se défendre, par l'élimination des individus capables de la déposséder (§ 2192, 1838). Les moyens d'éliminer les individus possédant des qualités supérieures et capables de nuire à la domination de la classe gouvernante sont succinctement les suivants.
§ 2478. 1° La mort. C'est le moyen le plus sûr, mais aussi le plus préjudiciable pour l'élite. Aucune race, aussi bien d'hommes que d'animaux, ne peut supporter longtemps un tel triage et la destruction de ses meilleurs individus. Ce moyen fut très en usage dans les familles régnantes, surtout en Orient. Celui qui montait sur le trône faisait disparaître ceux de ses proches qui auraient pu prétendre au pouvoir. L'aristocratie vénitienne fit aussi assez souvent usage de la mort pour prévenir ou réprimer les desseins de ceux qui voulaient changer les institutions de l'État, ou simplement pour éliminer le citoyen devenu trop influent par sa force, ses vertus ou son génie.
§2479. 2° Les persécutions qui ne vont pas jusqu'à la peine capitale : la prison, la ruine financière, l'éloignement des fonctions publiques. Le moyen est très peu efficace. On a ainsi des martyrs, souvent beaucoup plus dangereux que si on les avait laissés tranquilles. Ce moyen profite peu ou point à la classe gouvernante ; mais il n'est pas très nuisible à l'élite, considérée dans l'ensemble de la classe gouvernante et de la classe gouvernée. Parfois même il peut être avantageux, parce que, dans cette dernière classe, la persécution exalte les qualités d'énergie et de caractère, lesquelles souvent font précisément défaut dans les élites qui vieillissent ; et la partie persécutée peut finir par prendre la place de la classe gouvernante.
§ 2480. L'effet noté plus haut dans les conflits entre deux parties de l'élite est un cas particulier d'un effet beaucoup plus général, qu'on observe très souvent dans les conflits entre la classe gouvernante et la classe gouvernée. On peut dire que la résistance de la classe gouvernante est efficace uniquement si celle-ci est disposée à la pousser à l'extrême, sans tergiversations, en usant de la force et des armes, lorsque c'est nécessaire [FN: § 2480-1] ; autrement non seulement elle est inefficace, mais encore elle peut être utile, parfois très utile aux adversaires. Le meilleur exemple est celui de la révolution française de 1789, dans laquelle la résistance du pouvoir royal durait tant qu'elle était utile pour accroître la force des adversaires, et cessait précisément lorsqu'elle aurait pu les vaincre. On trouve d'autres exemples moins importants dans d'autres révolutions, en France ou ailleurs. On en trouve aussi lors des petits bouleversements qui ont lieu de temps en temps dans les pays civilisés. En 1913 et en 1914, le gouvernement anglais, par son procédé de mettre en prison les suffragettes et de les remettre en liberté aussitôt qu'il leur plaisait de jeûner [FN: § 2480-2] , a résolu le problème de trouver une forme de résistance présentant le minimum d'efficacité en faveur du gouvernement, le maximum en faveur de ses adversaires. En Italie, les « grèves générales » et les émeutes plus ou moins révolutionnaires qui troublent la paix du pays sont dues en grande partie à ce que le gouvernement résiste à ses adversaires juste assez pour exciter leur colère [FN: § 2480-3], assurer leur union, provoquer leur insurrection, et qu'il s'arrête au point précis où il pourrait la réprimer [FN: § 2480-4]. Si le gouvernement suit cette voie, ce n'est pas par ignorance, mais parce que, à l'instar de tous les gouvernements de presque tous les pays civilisés de notre temps, le fait qu'il représente les « spéculateurs » lui ferme toute autre voie. Les « spéculateurs » veulent surtout la tranquillité, qui leur permet d'effectuer des opérations lucratives. Ils sont disposés à acheter à tout prix cette tranquillité. Ils se préoccupent du présent, se soucient peu de l'avenir [FN: § 2480-5] , et sacrifient sans le moindre scrupule leurs défenseurs à la colère de leurs adversaires. Le gouvernement punit certains de ses employés, dont la seule faute est d'avoir obéi aux ordres qu'ils ont reçus. Il envoie des soldats s'opposer aux révoltés, avec l'ordre de ne pas faire usage de leurs armes [FN: § 2480-6], cherchant ainsi à sauver la chèvre de l'ordre et le chou de la tolérance envers les adversaires les moins acharnés [FN: § 2480-7] .
De la sorte, les spéculateurs ont pu et pourront encore prolonger leur domination. Mais, ainsi qu'il arrive très souvent dans les faits sociaux, les mêmes mesures, utiles dans un certain sens, pendant un certain temps, finissent par agir en sens contraire et par provoquer la ruine des gouvernements qui s'y fient. C'est ce qui est arrivé pour un grand nombre d'aristocraties. S'il vient un jour où le gouvernement des « spéculateurs », au lieu d'être utile, soit nuisible aux sociétés, on pourra dire alors qu'il a été utile aux sociétés que les « spéculateurs » aient persisté à prendre des mesures qui devaient causer leur ruine. Sous cet aspect, l'humanitarisme actuel peut, en fin de compte, être utile à la société. Il jouerait un rôle analogue à celui de certaines maladies qui, en détruisant des organismes affaiblis, dégénérés, en débarrassent certaines collectivités d'être vivants, et par conséquent leur sont utiles.
§ 2481. 3° L'exil, l'ostracisme. Ils sont assez efficaces. Dans les temps modernes, l'exil est peut-être l'unique peine pour délits politiques procurant plus d'avantages que de désavantages à ceux qui l'emploient pour défendre le pouvoir. L'ostracisme athénien ne procura ni grands avantages ni grands désavantages. Ces moyens nuisent peu ou point au développement des qualités de l'élite.
§ 2482. 4° L'appel de la classe gouvernante, à condition de la servir, de tout individu qui pourrait lui devenir dangereux. Il faut prendre garde à la restriction : « à condition de la servir ». Si on la supprimait, on aurait simplement la description de la circulation des élites ; circulation qui se produit précisément quand des éléments étrangers à l'élite viennent à en faire partie, y apportant leurs opinions, leurs caractères, leurs vertus, leurs préjugés. Mais si, au contraire, ces personnes changent leur manière d'être, et d'ennemis deviennent alliés et serviteurs, on a un cas entièrement différent, dans lequel la circulation fait défaut.
§2483. Ce moyen fut employé très souvent et chez un grand nombre de peuples. Aujourd'hui, c'est à peu près le seul qu'emploie la ploutocratie démagogique qui règne dans nos sociétés ; et il s'est montré très efficace pour en maintenir le pouvoir. Il nuit à l'élite, parce qu'il a pour effet d'exagérer encore plus les instincts et les penchants qui, chez elle, sont déjà excessifs. En outre, avec la corruption qui l'accompagne toujours, il déprime fortement les caractères, et ouvre la voie à qui saura et voudra user de la violence pour secouer le joug de la classe dominante.
§ 2484. Par exemple, les gouvernants qui possèdent en abondance des résidus de la IIe classe, et qui manquent de ceux de la Ie classe, auraient besoin d'avoir de nouveaux éléments chez lesquels ces proportions seraient renversées. Ces éléments seraient fournis par la circulation naturelle. Mais si, au contraire, la classe gouvernante s'ouvre uniquement à ceux qui veulent bien être semblables à ses membres, et qui vont même plus loin, animés par l'ardeur des néophytes, elle accroît la prédominance déjà nuisible de certains résidus, et s'achemine ainsi à sa propre ruine. Vice versa, supposons une classe qui, à l'instar de notre ploutocratie, soit profondément dépourvue des résidus de la IIe classe, et possède en abondance des résidus de la Ie. Elle aurait besoin d'acquérir des éléments pauvres en résidus de la Ie classe et riches en résidus de la IIe. Au contraire, si elle s'ouvre seulement aux gens qui trahissent leur foi et leur conscience, pour se procurer les avantages dont la ploutocratie est généreuse envers qui se met à son service, cette classe acquiert des éléments dont elle ne retire aucun avantage, pour se fournir de ce qui lui fait le plus besoin. Elle prive, il est vrai, ses adversaires de certains chefs, ce qui lui est très utile. Mais elle n'acquiert rien de bon pour accroître sa propre force. Tant qu'elle pourra user de ruse et de corruption, elle aura probablement toujours la victoire ; mais elle tombera très facilement si la violence et la force interviennent [FN: § 2484-1] . Il s'est passé quelque chose de semblable lors de la décadence de l'Empire romain.
§2483. Lorsque dans un pays, les classes qui, pour un motif quelconque, étaient demeurées longtemps séparées, se mélangent tout à coup, ou plus généralement quand la circulation des élites acquiert brusquement une intensité notable après avoir été stagnante, on observe presque toujours une augmentation considérable dans la prospérité intellectuelle, économique, politique du pays. C'est ainsi que les époques de transition entre un régime oligarchique et un régime quelque peu démocratique, sont très souvent des époques de prospérité. Comme exemples très remarquables, on peut citer Athènes au temps de Périclès, la Rome républicaine après les conquêtes de la plèbe, la France après la Révolution de 1789. Mais d'autres exemples ne manquent pas non plus : l'Angleterre au temps de Cromwell, l'Allemagne au temps de la Réforme, l'Italie après 1859, l'Allemagne après la guerre de 1870.
§ 2486. Si ce phénomène avait pour cause la différence du régime, il devrait persister tant que le nouveau régime subsiste ; mais ce n'est pas le cas. Il dure un certain temps, et puis change. L'Athènes de Périclès ne tarde pas à décliner, tandis que le régime devient toujours plus démocratique. La prospérité de la Rome des Scipion dure plus longtemps ; mais la décadence est manifeste vers la fin de la République. La prospérité revient pour quelque temps avec le régime impérial, lequel s'achemine bientôt à la décadence. La France de la République et de Napoléon Ie, devient la France de Charles X et de Louis-Philippe. Pour obtenir une image du phénomène, on peut supposer deux substances chimiques séparées, qui unies produisent une effervescence. Cette effervescence se produit sitôt que cesse la séparation ; mais elle ne peut durer indéfiniment.
§ 2487. Après ce que nous avons exposé, l'explication de ce fait est aisée (fig. 46). Dans la période de temps a b, la circulation des élites diminue, et la prospérité descend de l'indice a m à l'indice b n, parce que la classe gouvernante décline. Dans le court espace de temps b c, il se produit une révolution ou un autre événement quelconque, qui active la circulation des élites, et l'indice de la prospérité monte brusquement de b n à c p. Mais ensuite l'élite décline de nouveau, et l'indice diminue de c p à d q.
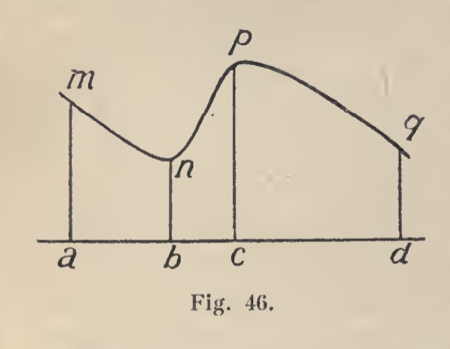 |
| figure 46 |
§ 2488. La diminution comme l'augmentation de la circulation peut porter sur la quantité comme sur la qualité. À Athènes, les deux faits étaient simultanés, car les citoyens athéniens constituaient une caste fermée ou presque fermée, à laquelle les métèques n'avaient pas accès. Pour faire partie de la classe gouvernante, les mérites de guerre comptaient peu. À Rome, après quelques générations, les affranchis venaient alimenter la classe des citoyens ingénus. Mais, vers la fin de la République, les intrigues et la corruption étaient la source principale du pouvoir. Avec l'Empire, des qualités meilleures donnèrent de nouveau accès à la classe gouvernante ; mais de nouveau se manifesta une nouvelle et plus grave décadence. La ploutocratie moderne ne met aucun obstacle à la circulation, au point de vue du nombre. C'est pourquoi la prospérité qu'elle provoque dure plus longtemps. Mais elle exclut la force et l'énergie de caractère des qualités qui donnent accès à la classe gouvernante. Ce sera probablement l'une des causes pour lesquelles la courbe actuelle p q r de la prospérité (fig. 47), qui pour le moment croît selon le segment p q, pourra décroître à l'avenir suivant le segment s r.
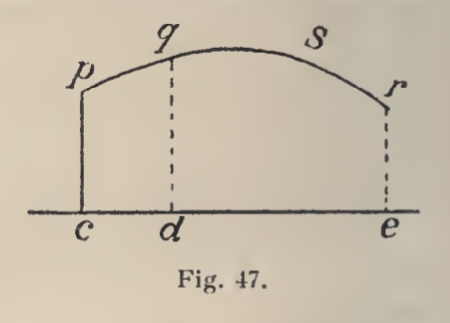
Figure 47
§2489. Après ces quelques aperçus théoriques, passons à l'examen d'exemples concrets. À Sparte, dans l'antiquité, et à Venise, dans les temps modernes, nous avons des exemples d'aristocraties fermées ou semi-fermées. Ils nous montrent la décadence de ces aristocraties, et confirment d'autre part que l'usage de la force est capable, malgré la décadence, d'assurer la domination de ces aristocraties sur les classes inférieures de la population. Ils démentent ainsi l'affirmation des « moralistes » qui prétendent que les classes supérieures se maintiennent uniquement parce qu'elles font le bien de leurs sujets. Il serait utile aux sujets qu'il en fût ainsi ; mais malheureusement cela n'est pas.
§2190. Aux beaux temps de Sparte, sa population se divisait en trois classes : les Spartiates, qui étaient la classe gouvernante, les périèques, qui étaient une classe libre, mais sujette de la classe dominante, les ilotes, qui étaient des serfs attachés à la glèbe. On ne peut déterminer avec précision les premières dates de la chronologie spartiate ; mais on ne s'éloignera peut-être pas de la vérité en remontant jusqu'à 750 av. J.-C. Depuis ce temps, avec une fortune variable, la domination de l'oligarchie spartiate dura jusqu'en l'an 227 av. J.-C., où Cléomène III détruisit les éphores. Ainsi l'oligarchie domina pendant cinq siècles. Les moyens qui lui permirent d'y arriver ont quelques points de ressemblance avec les moyens dont se servit l'oligarchie vénitienne. Un pouvoir occulte et terrible prévenait et réprimait chez la classe inférieure toute tentative, même seulement supposée, d'améliorer son sort.
§ 2491. On a beaucoup discuté sur la [mot grec], qui, suivant Plutarque, aurait été une véritable chasse aux ilotes [FN: § 2491-1] . Cette opinion semble aujourd'hui abandonnée [FN: § 2491-2] ; mais les auteurs même les plus bienveillants envers les Spartiates admettent que la krupteia était dure et cruelle pour les ilotes. Des faits indéniables font mieux voir la cruauté spartiate. Par exemple, celui que raconte Thucydide, et qui se produisit au temps ou les Athéniens occupaient Pylos [FN: § 2491-3] .
§ 2492. Ce n'est certes pas à dire que les Spartiates conservaient leur pouvoir parce qu'ils ne rencontraient pas de résistance. Aristote remarque avec justesse : « Souvent les pénestes thessaliens causèrent des dommages aux Thessaliens, comme aussi les ilotes aux Lacédémoniens ; car ils épient toute occasion de tirer parti des désastres (Pol. II, 6, 2) ». L'aristocratie spartiate demeura la maîtresse parce qu'elle était plus forte que ses sujets ; et seule la guerre avec d'autres États put briser son pouvoir. Les Messéniens furent délivrés, non par leur propre énergie, mais par la victoire des Thébains à Leuctres. Aristote remarque encore très judicieusement que les Crétois n'eurent pas à souffrir de l'hostilité de leurs esclaves, car, bien que les différents États de l'île de Crète se fissent la guerre, ils s'abstenaient de favoriser la rébellion des esclaves, parce qu'ils en possédaient tous du même genre (Pol. II, 6, 3).
§ 2493. Au contraire, là où la force des maîtres disparaissait, les esclaves renversaient l'ordre des choses et prenaient la place des maîtres. Dans l'île de Chio, il paraît que l'équilibre était instable ; c'est pourquoi tantôt les uns, tantôt les autres dominaient. Vers l'an 412 av. J.-C., les Athéniens, en guerre avec l'aristocratie qui dominait à Chio, envahirent l'île et causèrent de graves désastres : « C'est pourquoi les esclaves de Chio, qui étaient nombreux et s'étaient accrus d'une manière exorbitante pour une seule cité, si ce n'est celle des Lacédémoniens, étaient difficiles à ramener au devoir dans leurs méfaits. La plupart désertaient aussitôt que l'armée athénienne leur semblait avoir pris une position solide en construisant ses fortifications ; et comme ils connaissaient très bien la campagne, ils causaient de très grands dommages [FN: § 2493-1] ». L'occupation de Pylos par les Athéniens eut un effet semblable à l'égard des ilotes spartiates ; de même aussi l'occupation de Décélie par les Spartiates, à l'égard des esclaves athéniens. Notons que les Athéniens traitaient les esclaves avec une grande bienveillance, qui paraît même excessive à l'auteur anonyme de la République athénienne. Au temps d'un certain Nymphodore, les esclaves de Chio s'enfuirent dans les montagnes, s'y défendirent et attaquèrent tour à tour avec tant de succès, que leurs maîtres durent pactiser avec eux, jusqu'à ce que, grâce à la trahison, le chef de ces esclaves fugitifs eût été tué [FN: § 2493-2] . Plus tard, Mithridate réduisit en servitude les gens de Chio, et les soumit à leurs propres esclaves [FN: § 2493-3] . Là-dessus, les moralistes imaginèrent que ce fut une juste punition, parce que les gens de Chio avaient, les premiers, introduit l'usage d'acheter des esclaves.
§ 2494. Très général est le phénomène des aristocraties qui, d'abord ouvertes, finissent par se fermer ou par s'efforcer de se fermer. Nous l'observons aussi chez les Spartiates. Aristote rapporte comme une tradition [FN: § 2494-1] que, pour parer au danger du dépeuplement de l'État par les longues guerres, les premiers rois de Sparte avaient accordé le droit de cité à des étrangers. Mais Éphore, cité par Strabon, est tout à fait affirmatif. Il dit que « tous les habitants voisins des Spartiates se soumirent, à condition de leur être égaux et de participer au droit de cité et de commandement [FN: § 2494-2] ».
§ 2495. D'ailleurs, l'accès à la classe privilégiée fut bientôt fermé. Hérodote dit que seul Thésamène et son frère Hégias reçurent le droit de cité spartiate [FN: § 2495-1] . Nous avons donc dans l'aristocratie spartiate un type de classe fermée, ou pour mieux dire, semi-fermée, car aucune classe ne réussit longtemps à s'enfermer d'une manière absolue [FN: § 2495-2]. Elle demeura en cet état jusqu'au temps de Cléomène III. Une tentative de réforme avait été faite vers l'an 242 av. J.-C. par Agis IV ; mais elle échoua, et l'oligarchie eut encore assez de vigueur pour conserver le pouvoir [FN: § 2495-3] .
§ 2496. L'accès de la classe privilégiée était fermé, mais non pas la sortie : les meilleurs éléments du reste de la population ne pouvaient s'élever à cette classe ; mais les éléments inférieurs en étaient chassés. Il ne suffisait pas d'être d'origine spartiate pour prendre rang dans la classe dominante dite des égaux, des ![]() . Il fallait encore remplir strictement les devoirs difficiles et rigoureux de cette classe. Parlant de cette législation comme étant de Lycurgue, Xénophon dit clairement [FN: § 2496-1] : « Si quelqu'un négligeait de bien accomplir les choses voulues par la loi, il [Lycurgue] prescrivit qu'il ne devait plus être parmi les égaux ».
. Il fallait encore remplir strictement les devoirs difficiles et rigoureux de cette classe. Parlant de cette législation comme étant de Lycurgue, Xénophon dit clairement [FN: § 2496-1] : « Si quelqu'un négligeait de bien accomplir les choses voulues par la loi, il [Lycurgue] prescrivit qu'il ne devait plus être parmi les égaux ».
§2497. Parmi ces conditions exigées par la loi, il y avait celle de prendre part aux repas communs en payant son écot. Quiconque en était empêché par la pauvreté était déchu de la classe des égaux [FN: § 2497-1]. De la sorte, ceux qui manquaient d'énergie guerrière ou civile, et ceux qui ne savaient pas conserver leur patrimoine étaient exclus de la classe gouvernante. Donc, en somme, étaient exclus la plupart des éléments décadents. Cette circonstance était très favorable à la conservation du pouvoir par l'oligarchie ; elle a été probablement une des causes principales de sa durée. Une circonstance défavorable était l'exclusion de tout nouvel élément, de telle sorte que non seulement le nombre de la classe gouvernante allait toujours en diminuant – de 10 000 à 2000, dit-on – mais encore qu'il ne se complétait pas par de nouveaux et de meilleurs éléments.
§ 2498. Pourtant, et voici une nouvelle circonstance favorable, le besoin d'éléments nouveaux était moindre que dans d'autres cas, parce que ces besoins nouveaux n'étaient pas nécessaires pour renforcer les résidus de la IIe classe chez les gouvernants. Le mode d'éducation de ceux-ci, la discipline militaire en temps de paix, l'aversion pour la littérature, la philosophie et les arts libéraux ou manuels, d'autre part les guerres continuelles, supprimaient un grand nombre des causes pour lesquelles, chez les aristocraties en décadence, les résidus de la IIe classe diminuent, tandis que ceux de la Ire augmentent. L'humanitarisme, gangrène des aristocraties qui se meurent, ne trouvait pas place chez les Spartiates, même quand ils furent déchus de leurs vertus antiques. Il suffit de rappeler l'usage de fustiger jusqu'au sang les jeunes garçons devant l'autel d'Artémis Orthia. Il durait encore au temps de Pausanias. On a beaucoup discuté sur l’origine de cet usage. Cette origine, comme tant d'autres, importe peu ou point à la sociologie. Il importe au contraire de savoir de quels sentiments cet usage était l'indice. Nous avons vu déjà (§ 1190 et sv.) que des sentiments d'ascétisme y jouaient un rôle considérable. Ces sentiments sont l'hypertrophie de sentiments du sacrifice de l'individu à la collectivité. Le fait que cet usage barbare a duré si longtemps est aussi un indice manifeste de l'absence des sentiments humanitaires chez les Spartiates, et même de la simple pitié ; celle-ci n'aurait pas permis que l'usage pût durer si longtemps, quelle que fût son origine. En outre, il y a l'indice d'une singulière puissance de la persistance des agrégats [FN: § 2498-1] (résidus de la IIe classe).
§ 2499. D'autre part, le manque d'instinct des combinaisons (résidus de la Ire classe) était une circonstance défavorable à l'aristocratie spartiate, même dans son unique genre d'activité, celui de la guerre, et surtout en politique. Dans cette dernière, la légèreté et la mobilité athéniennes d'une part, la gravité et la lourdeur spartiates d'autre part, paraissent avoir eu pour conséquence des désavantages assez semblables.
§ 2500. À Venise, nous avons un autre exemple d'aristocratie fermée. Jusqu'en l'an 1296, l'accès en était libre. Ce furent des temps de grande prospérité pour Venise. De 1296 à 1319 s'accomplit le changement qui aboutit à la serrata del consiglio maggiore, et qui ferme l'accès de la classe gouvernante [FN: § 2500-1]. Elle resta fermée pendant plus de quatre siècles. En l'an 1775, on décréta que le Livre d'or resterait ouvert pendant vingt ans, et qu'on y pourrait inscrire jusqu'à quarante nobles de terre ferme ; mais il ne semble pas que ces nobles firent grand honneur à cette avance.
§2501. La classe gouvernante vénitienne n'était pas réduite en nombre comme la classe gouvernante spartiate ; mais la décadence du caractère et de l'énergie y était extrême. Cette divergence provient surtout de la différence d'activité des deux aristocraties : civile pour celle de Venise, guerrière pour celle de Sparte. À Venise, l'énergie du caractère était un motif de mise à l'écart, et les inquisiteurs d'État extirpaient avec grand soin toute plante qui croissait trop vigoureuse. À Sparte, seul demeurait parmi les égaux celui qui avait assez d'énergie et de vigueur pour supporter le poids de la discipline militaire. À Venise, la qualité de patricien était indélébile, et restait acquise même au citoyen déchu. À Sparte, par une élimination naturelle, le citoyen déchu était exclu des ![]() . Des deux causes qui faisaient obstacle aux circulations des élites, l'une, le manque de nouveaux éléments, était commune à Venise et à Sparte ; l'autre, le manque d'élimination des éléments décadents, avait une influence plus grande à Venise qu'à Sparte.
. Des deux causes qui faisaient obstacle aux circulations des élites, l'une, le manque de nouveaux éléments, était commune à Venise et à Sparte ; l'autre, le manque d'élimination des éléments décadents, avait une influence plus grande à Venise qu'à Sparte.
§ 2502. L'usage de la force pour maintenir le pouvoir était commun aux deux aristocraties. Ce fut la cause principale de leur longue durée. Elles tombèrent toutes deux, non par suite de transformations intérieures, mais par l'effet d'une force extérieure plus grande [FN: § 2502-1] . La classe gouvernante vénitienne savait que le peuple ne peut rien par lui-même s'il n'est dirigé par des éléments de la classe gouvernante ; c'est pourquoi elle visait principalement à empêcher la survenance de ces éléments. L'efficacité d'une telle organisation est prouvée par la longue durée de cette aristocratie, lors même qu'elle perdit toute vigueur autre que celle, conservée par la tradition, de frapper à temps tout individu qui pût devenir le chef de bouleversements futurs. La classe gouvernante spartiate ne négligeait pas ce moyen de gouverner. En plusieurs cas, les éphores se montrèrent à la hauteur des inquisiteurs d'État à Venise. Mais, soit en raison de l'activité guerrière de Sparte, soit pour d'autres causes, leur action était beaucoup moins efficace que celle des inquisiteurs vénitiens. C'est pourquoi Sparte, plus que Venise, eut des chefs de mérite. Les Spartiates furent vaincus non par manque de valeur, mais par défaut de science stratégique. Au contraire, au temps de la décadence, les deux choses avaient fait défaut aux Vénitiens.
§ 2503. Sparte aurait eu besoin d'appeler dans l'élite des hommes possédant à un haut degré l'instinct des combinaisons (résidus de la Ire classe). Venise aurait eu au contraire besoin d'appeler dans sa classe gouvernante des hommes possédant à un haut degré des instincts de la persistance des agrégats (résidus de la IIe classe). Nous ne savons pas si Sparte possédait dans son peuple les éléments qu'il fallait à sa classe gouvernante. Venise les avait certainement. Parlant du temps où la République était sur le point de disparaître, Malamani observe très justement [FN: § 2503-1] : « (p. 122) D'ailleurs, au milieu de cette orgie, à ce banquet funèbre païen auquel participait une grande partie de l'aristocratie vénitienne, la classe du menu peuple, qui tient plus que toute autre à ses traditions, conservait presque entièrement encore la rigide candeur des mœurs antiques... Rarement la corruption entrait dans les masures des ouvriers. Ils vivaient entre eux, formaient une société à part, avec ses mœurs, avec ses lois. Sous des formes rudes, ils conservaient vivant le culte de la famille... »
§2504. Venise fit preuve d'endurance dans l'infortune ; elle manqua d'ardeur dans le succès. On répète sur tous les tons que la ruine de Venise résulta de la découverte de l'Amérique et du Cap de Bonne-Espérance, qui dévia le commerce dont Venise était primitivement l'intermédiaire. Mais quand ces découvertes eurent lieu, Venise était la première puissance maritime du monde. Pourquoi donc n'aurait-elle pas pu faire des conquêtes en Amérique, aux Indes orientales, aux îles de la Sonde, comme en firent les Espagnols, les Portugais, les Hollandais, les Français, et même les Danois ? Aucun obstacle ne s'y opposait, excepté la pusillanimité du patriciat vénitien, qui, s'il avait été rajeuni par des éléments populaires, aurait peut-être eu plus d'ardeur et de désir de nouveauté.
§ 2505. À la victoire de Lépante, le rôle principal fut joué par les galères vénitiennes, dont la puissante artillerie n'avait pas sa pareille [FN: § 2505-1]. L'instinct des combinaisons ne manquait donc pas non plus à Venise ; c'était l'énergie d'en tirer parti qui faisait défaut. Après la victoire de Salamine, la disproportion entre la puissance d'Athènes et celle du Grand Roi était plus grande que la disproportion, après la victoire de Lépante, entre la puissance de Venise et celle du Sultan. Mais les Athéniens firent preuve d'ardeur : leur flotte parcourut les mers, chassant les Perses. Au contraire, les prudents Vénitiens, après Lépante, se retirèrent à Corfou, et par leur inaction perdirent tout le fruit de la victoire, qui demeura parfaitement inutile. Les dernières années de la République furent celles d'une extrême décadence et d'une grande misère. Venise n'avait plus aucune puissance, même sur mer [FN: § 2505-2] .
§ 2506. L'aristocratie spartiate conserva dans les revers sa renommée méritée de force de caractère. Dans l'aristocratie vénitienne, la tyrannie cauteleuse des inquisiteurs d'État éteignit jusqu'aux sentiments d'intégrité personnelle. Quand l'aristocratie vénitienne en était encore à ses origines et avait une plus grande vigueur, elle produisit un Marino Faliero ; et si la conjuration que tenta ce personnage en compagnie d'un homme du peuple énergique avait réussi, peut-être l'aristocratie vénitienne aurait-elle eu une fin plus honorable. Mais on ne peut affirmer que le peuple et la bourgeoisie eussent été plus heureux, et non plus malheureux, exposés qu'ils auraient été aux maux habituels des bouleversements politiques et sociaux, et saisis par la tourmente des révolutions. À cause de l'origine différente des classes gouvernantes, tandis qu'à Sparte le préjugé religieux était très fort, à Venise il était moins fort qu'en d'autres états contemporains. En 1309, les Vénitiens se laissèrent excommunier par le Saint-Siège pour lui avoir enlevé Ferrare. Plus tard, le 25 mai 1483, le pape Sixte IV lança de nouveau l'excommunication contre la République vénitienne [FN: § 2506-1]. Le Conseil des Dix fit la sourde oreille, ordonna aux ecclésiastiques de continuer à administrer les sacrements, comme s'il n'y avait pas eu d'excommunication, et fut parfaitement obéi. La bulle du pape Jules II contre les Vénitiens n'eut pas un meilleur sort : ils furent vaincus par les armes temporelles de la ligue de Cambrai, et non par les armes spirituelles de l'Église [FN: § 2506-2] . Par son monitoire du 17 avril 1606, Paul V menace d'excommunication le doge et le Sénat si, dans les vingt-quatre jours, ils n'ont pas accordé satisfaction aux demandes du pape [FN: § 2506-3] « (p. 1109) et si, trois autres jours après les vingt-quatre, le doge et le Sénat persistent, il soumet à l'interdit tout le territoire, en sorte qu'on ne puisse célébrer de messes ni d'Offices divins... Lors de la publication du Monitoire à Rome, on commença, à Venise, par avoir recours à l'aide divine... On commanda ensuite à tous les prélats ecclésiastiques de ne faire publier ni laisser afficher en aucun lieu le Monitoire ; et même, quiconque en possédait une copie devait, sous peine de mort, la présenter aux magistrats, à Venise, et aux Recteurs, dans l'État... C'est pourquoi, tenant pour nul le Monitoire, on pensa uniquement protester par des lettres imprimées qui devaient être affichées dans des lieux publics... (p. 1110). Parmi les ordres religieux, partirent de Venise, ceux des jésuites, des capucins, des théatins, des réformés de Saint-François... aucun autre Ordre ne partit. Les Offices divins se célébrèrent exactement comme d'habitude; la ville et le peuple demeurèrent tout à fait tranquilles, par la volonté et par la prévoyance du Sénat, sans une goutte de sang versé ni la mort de personne ». On obtint cela parce que, ni dans le clergé ni dans le peuple, il n'y avait de fanatisme [FN: § 2506-4] ; ce qui permettait au gouvernement de se faire obéir dans sa controverse avec le Pape. Venise ne favorisa aucun schisme, aucune hérésie ; elle se préoccupait des intérêts temporels, et se souciait peu ou point de théologie. Là peut être intervenue la clairvoyance de l'État, cherchant à ôter tout prétexte d'offense à la Cour de Rome [FN: § 2506-5] ; mais il n'y avait certainement pas peu d'indifférence religieuse et de pauvreté en résidus de la IIme classe.
§2507. L'exemple de Venise est excellent, parce qu'il fait bien comprendre comment se composent les forces sociales. Il montre qu'il faut les considérer quantitativement et non pas seulement qualitativement, en outre, que les diverses espèces d'utilités sont hétérogènes.
L'usage du gouvernement vénitien de confier à des étrangers le commandement des armées de terre ferme, à l'exclusion des patriciens nationaux, fut cause, à la fois de faiblesse militaire pour la République, et de force pour les institutions civiles, qui échappèrent au danger d'être détruites par quelque capitaine victorieux. La pauvreté des résidus de la IIme classe, en comparaison de ceux de la Ire, assura pour nombre de générations, pour nombre de siècles, une vie heureuse aux Vénitiens. Ce bonheur contrasta avec les angoisses, les ruines, les carnages qui accablaient les malheureux habitants des pays où, grâce à l'abondance des résidus de la IIme classe, le fanatisme opprimait les hommes. Mais cette pauvreté fut aussi, du moins en partie, cause de la chute de la République vénitienne. Ici, une question se pose. Est-il bon ou non d'acheter le bonheur de nombre de siècles, d'un très grand nombre de générations, par la perte de l'indépendance de l'État ? On ne voit pas comment y répondre, car la comparaison porte sur deux utilités hétérogènes. Un problème analogue se pose en tout temps, pour presque chaque pays. On le résout dans un sens ou dans l'autre, suivant la valeur que le sentiment attribue à l'utilité présente et à l'utilité future, à l'utilité des hommes vivants et à celle de ceux qui viendront après eux, à l'utilité des individus et à celle de la nation. On peut se demander s'il ne serait pas possible d'éviter l'un et l'autre extrême, et de suivre une voie intermédiaire qui conciliât l'utilité des générations présentes avec celle des générations futures ? Cette nouvelle question n'est pas plus facile à trancher que la précédente. Tout d'abord, il faut remarquer que les difficultés de la comparaison entre les utilités hétérogènes du présent et celles de l'avenir sont atténuées, il est vrai, mais non supprimées ; car, pour tracer la voie intermédiaire, il sera tout de même nécessaire de comparer ces utilités, et suivant que le sentiment fera préférer l'une ou l'autre, la voie intermédiaire se dirigera davantage d'un côté ou de l'autre. Ensuite, il faut prendre garde au fait que la nouvelle question nous transporte dans le domaine difficile des mouvements virtuels, et que, pour y répondre, il est nécessaire de résoudre d'abord le problème ardu de la possibilité (§ 134) de supprimer certaines liaisons, et d'en ajouter certaines autres. Toutes ces difficultés échappent généralement aux personnes qui traitent de matières sociales ou politiques, parce qu'elles résolvent les problèmes, non au moyen de l'expérience, mais avec leur sentiment et celui d'autres personnes qui sont de leur avis. C'est pourquoi leurs raisonnements ont peu ou rien de commun avec la science logico-expérimentale. Ce sont des dérivations qui se rapprochent de simples manifestations de sentiments, de théories métaphysiques, théologiques. Comme telles, elles ont leur place parmi les dérivations que nous avons déjà étudiées d'une manière générale. Elles en suivent les oscillations; elles en ont les avantages et les défauts, sous l'aspect extrinsèque de l'utilité sociale. Pourtant leurs oscillations, semblables en cela à celles de la morale, sont beaucoup moins amples que celles de simples théories. En effet, les considérations de l'utilité sociale les empêchent de s'écarter trop de l'extrême où l'on prêche le sacrifice de ses intérêts à ceux d'autrui, de l'individu à la collectivité, des générations présentes à celles de l'avenir. Elles manifestent presque toujours des sentiments de sociabilité (résidus de la Vme classe), beaucoup plus intenses que ceux dont l'auteur est réellement animé, ou qu'ont ceux qui les approuvent. Elles sont en quelque sorte un vêtement qu'il est bienséant d'endosser.
§2508. À Athènes, on peut envisager de deux façons les classes gouvernantes. Nous avons d'abord les citoyens athéniens, qui forment une classe gouvernante par rapport aux esclaves, aux métèques et aux sujets des territoires sur lesquels s'étend la domination athénienne. Puis dans cette même classe, nous avons une nouvelle division et une élite qui gouverne.
§ 2509. La première classe, celle des citoyens athéniens, demeura fermée autant que possible. Afin d'être moins nombreux à profiter de l'argent extorqué à leurs alliés, les Athéniens décrétèrent, sur la proposition de Périclès, en 451 av. J.-C., que seuls seraient citoyens athéniens ceux qui étaient nés de père et de mère athéniens [FN: § 2509-1] . D'une façon générale, dans les beaux temps de la République, le peuple se montra très peu disposé à accorder le droit de cité [FN: § 2509-2] .
§2510. Ces obstacles à la circulation des élites disparaissaient, par le fait qu'il y eut irrégulièrement de brusques admissions d'un grand nombre de citoyens. Pourtant elles ne correspondaient nullement aux choix qu'opère ordinairement la circulation des élites.
§ 2511. Après la chute des Pisistratides, Clisthène donna le droit de cité à un grand nombre de gens, probablement afin de renforcer le parti plébéien dont il était le chef [FN: § 2511-1] . Il n'est nullement certain que ces gens fussent des éléments de choix. Chassés de leur cité, les habitants de Platée, et plus tard les esclaves qui avaient combattu à la bataille des Arginuses, obtinrent le droit de cité réduit. En conclusion, il n'y eut jamais de circulation proprement dite.
§ 2512. Au contraire, dans la classe des citoyens athéniens, il se constitue, depuis le temps de Solon, une classe gouvernante avec circulation libre. L'Aréopage accueillait ce qu'il y avait de meilleur dans la population [FN: § 2512-1] . Comme en d'autres temps le sénat de Rome et la Chambre des lords anglais, il constituait une aristocratie de magistrats. Aristote dit clairement que, lorsque après la bataille de Salamine les Athéniens rendirent à l'Aréopage son ancien pouvoir, ils jouirent d'un excellent gouvernement [FN: §2512-2] .
§ 2513. Grote lui-même, qui admire tant la démocratie athénienne, reconnaît qu'on observe la plus grande prospérité au début de la guerre du Péloponèse [FN: § 2513-1], et sans avoir la moindre idée de notre théorie, il note qu'avant ce temps-là les arts, les lettres et la philosophie n'étaient pas encore florissants (indice de défaut des résidus de la Ie classe) ; postérieurement, « bien que les manifestations intellectuelles d'Athènes subsistent dans toute leur vigueur et même avec une force accrue », l'énergie des citoyens est beaucoup plus faible (prédominance des résidus de la Ie classe sur ceux de la IIe, qui peu à peu font défaut). C'est là un cas remarquable, dans lequel le maximum de prospérité est donné par une certaine proportion entre les résidus de la Ie classe et ceux de la IIe, de sorte qu'un excès des uns est aussi nuisible qu'un excès des autres.
§ 2514. Un autre exemple remarquable est celui des Albigeois. L'enveloppe de leurs sentiments, c'est-à-dire la doctrine, semble être une branche du manichéisme. On put remarquer des doctrines analogues en divers pays, mais le phénomène social acquit de l'intensité surtout dans ceux qui prospéraient économiquement : en Italie, où l'on vit plusieurs hérésies, tempérées par le scepticisme national ; dans les Flandres, et de la façon la plus remarquable, dans le Midi de la France. Au XIIe siècle, ces régions étaient plus prospères matériellement et intellectuellement que d'autres pays. Elles s'étaient enrichies, et leur littérature, antérieure à la littérature italienne, est la première de nos littératures en langue vulgaire. Le contraste avec le Nord de la France, pauvre, ignorant, grossier, est très grand. Dans le Midi, les résidus de la Ie classe dominaient [FN: § 2514-1] ; dans le Nord, ceux de la IIe classe étaient de beaucoup les principaux.
Paris, avec son université, était une exception. Ainsi qu'il arrive très souvent en des cas semblables, dans le Midi on observait, d'une part un certain manque de religion, d'autre part un certain fanatisme religieux. D'un côté, mœurs extrêmement faciles, de l'autre, rigueur excessive. Dans les cours d'amour, on raisonnait aimablement de l'amour sexuel ; dans les réunions des hérétiques, on le condamnait sans miséricorde.
§ 2515. Schmidt décrit bien l'état du Midi de la France [FN: § 2515-1] au XIIe siècle. Cet état est semblable à celui que l'on observe de nouveau au temps de la Renaissance en Italie et en d'autres pays économiquement prospères. Il ne manque pas de témoignages de la sagacité des Provençaux au XIIe siècle. Raoul de Caen a tout un chapitre où il décrit l'ingéniosité des Provençaux à la croisade [FN: § 2s515-2] , lesquels avaient l'esprit plus subtil que les « Français », mais étaient aussi moins courageux. C'est pourquoi on disait : « Les Français pour les combats, les Provençaux pour les vivres ». Il raconte comment ils frappaient un cheval ou un mulet, par dessous, dans les intestins, de telle sorte qu'on ne voyait pas la blessure. L'animal mourait. Les bons Français étaient stupéfaits d'un tel accident et disaient : « Éloignons-nous : sans doute le démon a soufflé sur cet animal ». Alors, « semblables aux corbeaux, les Provençaux entouraient le cadavre, le découpaient en morceaux, et chacun en emportait un, soit pour le manger, soit pour le vendre au marché ».
§ 2516. Voir dans la guerre des Albigeois une simple guerre de religion, c'est se mettre hors de la réalité. Quiconque étudie les dérivations admettra facilement que la doctrine des Cathares était une espèce de manichéisme, admettant deux principes : un bon et un mauvais. Mais les croisés qui vinrent du Nord conquérir les florissantes et riches contrées du Midi de la France se souciaient peu ou point qu'il y eût un, deux ou plusieurs principes. Il est même assez probable qu'ils étaient incapables de comprendre ce qu'on voulait dire par ces raisonnements bizarres. Ils se souciaient davantage de l'or, des belles femmes, des terres fertiles dont ils entreprenaient la conquête [FN: § 2516-1] ; et comme toujours, celui qui possédait des richesses et ne savait pas les défendre, se les voyait ravir par celui qui était pauvre, mais avait de l'énergie pour combattre et pour vaincre.
§ 2517. De même, parmi les nobles du Midi qui étaient favorables à l'hérésie des Albigeois, il s'est peut-être trouvé aussi des gens qui étaient mus par de belles considérations théologiques ; mais beaucoup avaient des raisons plus matérielles et plus tangibles [FN: § 2517-1] . Un phénomène semblable eut lieu au temps de la Réforme, et nombre de princes allemands se soucièrent bien plus de s'approprier les biens du clergé que de l'interprétation des Saintes Écritures. Pour eux, la meilleure interprétation était celle qui mettait le plus facilement en leur pouvoir les biens qu'ils convoitaient.
§ 2518. Comme d'habitude, le vulgaire était entraîné par l'envie que lui inspirait la vie aisée des classes supérieures. Ce sentiment était bien plus puissant que n'importe quelle subtile théorie théologique. Nous en trouvons des traces chez beaucoup d'auteurs ; entre autres chez Etienne de Bourbon [FN: § 2518-1] qui, pour avoir jugé comme inquisiteur les Albigeois, connaissait parfaitement leurs idées. Ainsi qu'il arrive habituellement aussi, une vague d'ascétisme et de religiosité montait des classes inférieures et menaçait de bouleverser la société entière.
§ 2519. Les prélats du Midi vivaient dans le luxe, aimaient la culture et la vie séculière [FN: § 2519-1]. Peu à peu, ils perdaient l'intolérance des prélats barbares qui, pauvres, ignorants et fanatiques, imposaient cruellement leur domination, ainsi qu'il arrive toujours en des cas semblables. Des faits analogues eurent lieu au XVIe siècle, dans la lutte entre le fanatisme de la Réforme et la culture d'un Léon X. Au point de vue d'une certaine éthique, les mauvaises mœurs du clergé constituaient alors une aggravation des conditions de la vie ordinaire. Au point de vue de la liberté intellectuelle, de la tolérance, d'une vie agréable, du progrès des arts, elles constituaient une amélioration [FN: § 2519-2] . Une somme immense de souffrances eût été épargnée à l'humanité si les marées de religiosité n'avaient pas submergé ces terres promises (§ 2707).
§ 2520. Nous savons déjà par un très grand nombre de faits que les dérivations ont peu d'importance pour les conséquences logiques qu'on en peut tirer. Elles en ont au contraire beaucoup pour les résidus dont elles sont l'indice, pour les sentiments qu'elles expriment. C'est sous cet aspect que nous devons considérer l'humanitarisme et l'ascétisme des Cathares [FN: § 2520-1]. Comme théorie, ils n'ont pas d'importance ; comme indice des sentiments de ceux qui acceptaient cet humanitarisme et cet ascétisme, ils servent à expliquer pourquoi les guerriers énergiques du Nord vainquirent les peuples lâches du Midi. De même, les déclamations d'un Tolstoï, qui va prêchant qu'on ne doit pas résister au mal et d'autres semblables sottises, n'ont pas la moindre importance comme théories. Elles en ont, comme indice de l'état d'esprit des gens qui les admirent, et nous font ainsi connaître l'une des causes de la défaite des Russes dans leur guerre contre le Japon. « (p. 88) Et à l'égal des richesses, il [le Cathare] condamne les honneurs et la puissance, pour laquelle s'acharne la vaine ambition des hommes, n'épargnant pas les guerres sanguinaires ou les artifices frauduleux pour la conquérir. Mais la guerre est une œuvre violente, que les adeptes du méchant démon peuvent désirer et imposer dans leur fureur, mais non certes les douces créatures du Dieu bon, lesquelles, au contraire, la condamnent toujours, même quand elle est provoquée par les autres ou faite pour se défendre*. Et non moins que la guerre, ils condamnent le meurtre de son prochain, au point de refuser même aux pouvoirs publics le droit de mettre à mort les citoyens qui violent la loi. Au milieu d'une société cruelle et violente, ces hérétiques prêchaient l'abolition de la pendaison ** [FN: § 2521-2] ». C'est pourquoi ils furent détruits par le fer et par le feu. Il ne pouvait en être autrement.
§ 2521. Quand une société s'affaiblit par défaut de résidus de la IIe classe, par humanitarisme, parce que l'énergie qui emploie la force fait défaut, il arrive souvent qu'une réaction se produit, ne fût-ce que dans une petite partie de cette société. Mais il est remarquable qu'au lieu de tendre à accroître les résidus qui donneraient le plus de force à la société, comme il devrait arriver si c'était une réaction logique, cette réaction se manifeste principalement par un accroissement de force de certains résidus qui sont peu ou point utiles à la conservation sociale. Elle démontre ainsi son origine non-logique. Parmi les résidus qu'on voit ainsi se fortifier, il y a presque toujours ceux de la religion sexuelle, qui est précisément la moins utile à la société ; on peut même dire qu'elle est tout à fait inutile. Cela s'explique aisément si l'on considère que ces résidus existent avec une assez grande intensité chez presque tous les hommes, et que leur accroissement ou leur diminution peuvent, en de nombreux cas, servir de thermomètre pour juger de l'intensité d'autres classes de résidus, parmi lesquels se trouvent ceux qui sont utiles à la société. Il arrive aussi que ceux qui veulent recouvrir d'un vernis logique les actions non-logiques prennent l'indice pour la chose, et s'imaginent qu'en agissant sur la religion sexuelle, ils agiront aussi sur les résidus auxquels elle peut servir d'indice. Cette erreur, dont les hommes sont coutumiers, pour d'autres religions encore que pour la religion sexuelle, est semblable à celle de l'individu qui s'imaginerait pouvoir produire en hiver la chaleur de l'été en ajoutant du mercure à son thermomètre, de manière à lui faire marquer les degrés de chaleur désirés.
§ 2522. L'affaiblissement des sentiments non-logiques qui sont utiles à la conservation sociale provoqua, au temps des Cathares, une réaction extraordinaire d'ascétisme sexuel [FN: § 2522-1] ; au temps de la Renaissance, des réactions semblables, dont on trouve un type dans l'œuvre de Savonarola ; de notre temps, des réactions encore plus absurdes, dont nous avons parlé souvent déjà. Elles furent et sont toujours toutes, non seulement inutiles, mais encore nuisibles, parce qu'en donnant une certaine satisfaction aux instincts de conservation sociale, elles empêchent que ces instincts ne s'appliquent dans le seul sens où ils seraient efficaces : à renforcer les résidus de la IIe classe qui sont à la base de la société, et l'énergie belliqueuse qui la conserve.
§ 2523. Ce n'est pas par mauvaises mœurs, mais par manque de foi et de courage que les comtes de Toulouse furent détruits. Que l'on compare le scepticisme de Raymond VI et de son fils Raymond VII avec le fanatisme avisé de Simon de Montfort. En 1213, les Provençaux et les Aragonais assiégeaient Muret. Simon partit avec son armée pour secourir cette forteresse. Il avait beaucoup moins de gens que ses ennemis, mais la foi et le courage le soutenaient. Il ne tint pas compte des conseils de ceux qui voulaient le dissuader de livrer bataille, il engagea le combat [FN: § 2523-1] et vainquit. Il termina sa vie en brave au siège de Toulouse, frappé d'une pierre à la tête et percé de plusieurs flèches.
§ 2524. Ces pauvres comtes de Toulouse ne surent jamais se décider à suivre une voie. De temps en temps, ils essayaient de résister, puis perdaient courage et se livraient pieds et poings liés à leurs ennemis, en demandant humblement pardon au pape et au roi [FN: § 2524-1]. Ils ne comprirent jamais que, pour vaincre, il faut être disposé à mourir les armes à la main. Ils furent ainsi les dignes précurseurs de ce pauvre homme de Louis XVI de France qui, lui aussi, au lieu de combattre, se jeta dans les bras de ses ennemis, et leur livra ses amis, de même que les comtes de Toulouse livrèrent leurs fidèles sujets à l'Inquisition. La force des armes décide qui doit être sauvé, qui doit périr, qui doit être le maître, qui doit être l'esclave. Depuis longtemps déjà Tyrtée l'avait chanté [FN: § 2524-1] .
§2525. Les habitants du Midi de la France furent vaincus par les soldats du Nord, pour la même raison qui donna la victoire aux Macédoniens sur les Athéniens, ou aux Romains sur les Carthaginois : parce que le rapport entre les instincts conservateurs et ceux des combinaisons était trop faible.
§ 2526. Il faut prendre garde à la contingence du contact et de l'usage de la force, entre des peuples possédant des proportions différentes de ces résidus de la IIe et de la Ie classe. Si, pour un motif quelconque, on ne fait pas usage de la force, le peuple où la proportion de ces résidus est très différente de celle qui assure le maximum de puissance dans les luttes, ne tombe pas sous la domination du peuple où cette proportion se rapproche davantage du maximum. Il en est de même pour les diverses classes sociales. La position d'équilibre est différente suivant que l'usage de la force joue un rôle plus ou moins grand.
§ 2527. Si l'on compare aujourd'hui les populations du Midi et celles du Nord de la France, on constate quelque chose d'analogue à ce qui se passait, au temps de la guerre des Albigeois, touchant la proportion entre les résidus de la Ie et ceux de la IIe classe [FN: § 2527-1]. Nous disons quelque chose d'analogue et non d'identique. Comme aujourd'hui l'usage de la force n'intervient pas entre ces deux fractions d'une même unité politique, nous devons prévoir que le phénomène sera inverse de celui qu'on put observer aux temps de la guerre des Albigeois, et que ce sera le Midi, où les résidus de la Ie classe l'emportent de beaucoup sur les autres, qui dominera sur le Nord, où ce sont, au contraire, les résidus de la IIe classe qui l'emportent. C'est exactement ce qui se passe. On a remarqué plusieurs fois que la plupart des ministres et des politiciens qui gouvernent aujourd'hui la France sont du Midi. Là où la ruse agit le plus, les résidus de la Ie classe ont une valeur qui diminue beaucoup là où la force agit davantage. C'est le contraire qui a lieu pour les résidus de la IIe classe.
§ 2528. En revanche, la Chine, presque soustraite durant un grand nombre d'années à la pression de la force extérieure, put subsister avec une très faible proportion de résidus de la le classe. Maintenant, poussée par l'exemple du Japon, elle se met à innover, c'est-à-dire à accroître les résidus de la Ie classe (§ 2550).
§ 2529. L'exemple des Italiens, au temps de la Renaissance, est plus remarquable encore que celui des Albigeois. Déjà à la fin du moyen âge, l'Italie est tellement supérieure aux autres pays de l'Europe, dans toutes les branches de l'activité humaine, qu'il est inconcevable qu'elle n'ait pas restauré l'empire romain, et que, au contraire, elle ait pu subir de nouvelles invasions barbares. En fait de richesse, l'Italie dépassait tout autre pays. Ses banquiers prêtaient aux particuliers et aux souverains, et les noms de Lombard Street et de Boulevard des Italiens sont de nos jours les témoins fossiles d'un temps qui n'est plus. La littérature, les arts, les sciences florissaient en Italie, alors qu'ailleurs ils étaient encore dans l'enfance. Les Italiens parcouraient le globe terrestre. Un Marco Paolo visitait des régions asiatiques inconnues ; un Colomb découvrait l'Amérique; un Améric Vespuce lui donnait son nom. La diplomatie vénitienne était la première du monde ; dans la politique pratique, un Laurent de Médicis, dans la politique théorique, un Machiavel, n'avaient pas leurs égaux.
§ 2530. Mais peut-être les Italiens ne se distinguaient-ils que dans les arts civils ? Point du tout. Dans les arts militaires aussi, ils faisaient preuve de mérites [FN: § 2530-1] . François Ier et Charles-Quint se disputaient un Andrea Doria, pour commander leurs flottes. Pierre Strozzi était fait maréchal de France. Léon et Philippe Strozzi servirent honorablement dans les armées françaises. Les condottieri ont eu peut-être beaucoup de vices, mais ils n'en donnèrent pas moins de grands capitaines.
§2531. Pourquoi donc, avec tant de circonstances favorables, l'Italie fut-elle conquise, au lieu de faire elle-même des conquêtes ? On a bientôt fait de répondre : parce qu'elle était divisée. Mais pourquoi était-elle divisée ? La France et l'Espagne étaient aussi divisées ; elles s'étaient pourtant constituées en unités. Pourquoi cela n'était-il pas arrivé en Italie aussi ? Pour les mêmes raisons que celles qui donnèrent d'autre part à l'Italie tant d'avantages au point de vue de la richesse, de la prospérité intellectuelle, d'un art politique et militaire habile ; parce que chez elle l'instinct des combinaisons l'emportait de beaucoup en importance sur l'instinct de la persistance des agrégats [FN: § 2531-1] . D'autres pays, où la proportion existant entre ces instincts s'écartait moins de celle qui assure le maximum de puissance, devaient nécessairement vaincre et envahir l'Italie, s'ils entraient en lutte avec elle ; il en avait précisément été ainsi pour Rome à l'égard de la Grèce.
§ 2532. Les maux qui venaient à l'Italie d'un défaut de l'instinct de la persistance des agrégats furent, au moins en partie, aperçus par Machiavel, lequel, semblable à un aigle, plane au dessus de la multitude des historiens éthiques (§ 1975). À la vérité, il parle de la religion, mais par ce terme il entend une religion quelconque. Ce fait, avec celui de considérer les religions indépendamment d'une vérité intrinsèque possible, de leur contenu théologique, – ainsi que l'avaient déjà fait Polybe, Strabon et d'autres – montre clairement que Machiavel avait en vue les instincts que ces religions manifestent, c'est-à-dire les résidus de la IIme classe. Seulement, ainsi que font tous les autres auteurs, il s'exprime comme si les actions des hommes étaient toutes logiques et une conséquence des résidus qui existent chez ces hommes. Mais, dans ce cas, cela n'infirme pas le fond du raisonnement, car, que ce soient les dérivations qui agissent directement, ou bien que ce soit l'indice de l'influence des résidus dont elles proviennent, les conclusions demeurent intactes. De même, nous ne pouvons pas faire un grief à Machiavel de ce qu'il accepte les légendes de Rome, légendes que l'on croyait alors de l'histoire ; et cela n'enlève rien à la force de son raisonnement, car enfin, ce qu'il dit de Romulus, il l'entend d'institutions militaires, et ce qu'il dit de Numa, il l'entend d'institutions religieuses et d'autres analogues.
§ 2533. Dans ses Discours (I, 11), il écrit : (Trad. Périès) « Lorsqu'on examine l'esprit de l'histoire romaine, on reconnaît combien la religion servait pour commander les armées, ramener la concorde parmi le peuple, veiller à la sûreté des bons, et faire rougir les méchants de leur infamie. De sorte que s'il fallait décider à qui Rome eut de plus grandes obligations, ou à Romulus, ou à Numa [si l'on devait décider si la grandeur de Rome provenait plutôt des institutions militaires ou des sentiments exprimés par les discours religieux], je crois que ce dernier obtiendrait la préférence. Dans les États où la religion est toute-puissante, on peut facilement introduire l'esprit militaire, au lieu que chez un peuple guerrier, mais irréligieux, il est difficile de faire pénétrer la religion... aussi est-il hors de doute que le législateur qui voudrait à l'époque actuelle fonder un État trouverait moins d'obstacles parmi les habitants grossiers des montagnes, où la civilisation est encore inconnue [où abondent les résidus de la IIe classe et où ceux de la Ie sont rares], que parmi ces peuples des villes, dont les mœurs sont déjà corrompues [dérivation morale habituelle] ».
§2534. Plus loin (I, 12) : « Les princes et les républiques qui veulent empêcher l'État de se corrompre, doivent surtout y maintenir sans altération les cérémonies de la religion et le respect qu'elles inspirent ». On remarquera que Machiavel parle des cérémonies, et non des dogmes. On remarquera aussi que, nominalement chrétien, il parle de la religion des Gentils. Nous sommes vraiment très près d'une théorie des résidus de la IIme classe.
§ 2535. Mais Machiavel s'explique encore plus clairement (I, 12) : « Que les chefs d'une république ou d'une monarchie maintiennent donc les fondements de la religion nationale [les dérivations importent peu ; les résidus importent beaucoup]. En suivant cette conduite, il leur sera facile d'entretenir dans l'État les sentiments religieux [entendez : une juste proportion des résidus de la IIe classe], l'union et les bonnes mœurs. Ils doivent en outre favoriser et accroître tout ce qui pourrait propager ces sentiments, fût-il même question de ce qu'ils regarderaient comme une erreur ». Voilà pourquoi Machiavel raisonne ici en homme de science et non en fanatique.
§2536. Il dit ensuite de l'Italie (I, 12) : « Et comme quelques personnes prétendent que le bonheur de l'Italie dépend de l'Église de Rome, j'alléguerai contre cette Église plusieurs raisons qui s'offrent à mon esprit, et parmi lesquelles il en est deux surtout extrêmement graves, auxquelles, selon moi, il n'y a pas d'objection. D'abord, les exemples coupables de la cour de Rome ont éteint, dans cette contrée, toute dévotion et toute religion, ce qui entraîne à sa suite une foule d'inconvénients et de désordres ; et comme partout où règne la religion on doit croire à l'existence du bien, de même où elle a disparu, on doit supposer la présence du mal. C'est donc à l'Église et aux prêtres que nous autres Italiens, nous avons cette première obligation d'être sans religion et sans mœurs ; mais nous leur en avons une bien plus grande encore, qui est la source de notre ruine ; c'est que l'Église a toujours entretenu et entretient incessamment la division dans cette malheureuse contrée ».
§ 2337. Ici, Machiavel s'arrête à la surface des choses. Il est vrai que la papauté entretient l'Italie divisée ; mais pourquoi les Italiens tolèrent-ils cela ? Pourquoi ont-ils rappelé la papauté, qui était allée à Avignon, et ne l'y ont-ils pas laissée, ou ne se sont-ils pas opposés à ce qu'elle revienne leur nuire ? Certainement pas à cause d'une religion qu'ils n'avaient pas, mais parce que la présence de la papauté à Rome favorisait certaines de leurs combinaisons ; parce que chez eux les résidus de la Ire classe l'emportaient sur ceux de la IIme.
§ 2538. La réforme en Allemagne fut une réaction d'hommes chez lesquels prédominaient les résidus de la IIme classe, contre des hommes chez lesquels prédominaient les résidus de la Ire classe ; une réaction de la force et de la religiosité germanique contre l’ingéniosité, la ruse, le rationalisme italien. Les premiers vainquirent, parce que la force entra enjeu. Si la force n'était pas entrée en jeu, les seconds pouvaient vaincre. Si l'empire germanique du moyen âge avait duré, englobant l'Italie, peut-être les Italiens de notre temps gouverneraient-ils cet empire, comme les Français du Midi gouvernent la France ?
§2539. ROME. Pour étudier l'évolution sociale à Rome, il faut, comme d'habitude, la rechercher sous les dérivations qui la masquent dans l'histoire. Tout d'abord, il faut écarter les dérivations éthiques, qui non seulement apparaissent dans cette histoire et en d'autres, mais qui nous poursuivent jusque dans la vie journalière. Nous avons déjà parlé longuement de ce sujet. Il n'est pas nécessaire d'y revenir (§ 2161 et sv.). Ensuite, il faut se tenir sur ses gardes contre les dérivations religieuses. Elles apparaissent nettement, par exemple chez Bossuet, et sont plus ou moins voilées chez un grand nombre d'autres auteurs chrétiens, qui ne peuvent parler de l'histoire romaine sans avoir l'esprit encombré de comparaisons de la morale et des mœurs chrétiennes avec la morale et les mœurs païennes. Un grand nombre d'auteurs modernes ne se soucient plus de la théologie chrétienne ; mais nous n'y gagnons pas grand'chose, parce qu'elle est remplacée par d'autres théologies, démocratiques, humanitaires ou autres semblables. Négligeons la théologie sexuelle, dont nous avons déjà longuement traité. Si elle fait écrire beaucoup d'absurdités, elle n'est toutefois pas coupable de graves erreurs en histoire romaine.
§ 2540. Nous retrouvons dans ce cas particulier les erreurs relevées déjà d'une manière générale (§ 2331 et sv.). Toutes ces dérivations ont une cause commune : c'est que nous regardons les événements à travers des verres colorés par nos sentiments. Un petit nombre d'auteurs, qui s'efforcent d'être impartiaux et qui y réussissent tant bien que mal, usent de verres légèrement colorés. La plupart usent de verres fortement colorés. Parfois ils le font volontairement pour certains vernis, parmi lesquels les vernis religieux mentionnés tout à l'heure et celui du patriotisme. Ce dernier ne devrait même jamais faire défaut, selon certains auteurs allemands et leurs imitateurs d'autres pays. En outre, ces auteurs confondent habituellement l'histoire avec la description de l'évolution d'une de leurs belles entités métaphysiques, à laquelle ils ont donné le nom d'État. Née et débutante à Rome, elle ne devint parfaite – est-il nécessaire de le dire – que dans l'Empire allemand moderne. Un autre vernis que l'on n'aperçoit pas, bien qu'il fasse rarement défaut, est celui qui provient de la conviction implicite que tout « mal » dont l'histoire nous donne connaissance aurait pu être évité grâce à des mesures judicieuses (§ 2334, 2335). De la sorte, nous nous rapprochons de l'opinion d'après laquelle la société humaine devrait, par vertu propre, être prospère, heureuse, parfaite, si ce cours normal n'était pas troublé par des causes accidentelles qu'il est possible d'éviter (§ 134). Cette opinion est semblable à celle qui trouve la cause des infortunes humaines dans le péché originel ; mais elle est moins logique, parce que, le péché originel se perpétuant, on comprend aisément que les maux dont il est la cause se perpétuent. Au contraire, si tous les maux de la société proviennent de causes qu'il est possible (§ 134) d'éviter, on ne comprend pas que parmi les très nombreuses sociétés dont nous connaissons l'histoire, il ne s'en soit pas trouvé au moins une qui présente une prospérité continue. De même, on pourrait dire que s'il est possible de rendre l'homme immortel, il est plus qu'étrange que les hommes dont nous avons eu connaissance jusqu'à présent aient été tous mortels. En réalité, l'état normal de la prospérité des sociétés humaines est celui d'une courbe ondulée. Celui d'une ligne qui représenterait un état de prospérité toujours constante ou toujours croissante ou toujours décroissante, serait anormal, tellement anormal qu'on ne l'a jamais constaté (§ 2338).
§ 2541. Quand, par exemple, les historiens mentionnés considèrent la décadence de la République romaine, ils admettent comme un axiome qu'elle doit avoir eu une cause, qu'il reste seulement à trouver dans les mesures prises par les hommes de ce temps, et qui doit être essentiellement différente de la cause de la prospérité de la République, ces états de choses contraires devant nécessairement avoir des causes contraires. Il ne leur vient pas à l'esprit que des états de choses dont l'un succède à l'autre peuvent, bien que contraires, avoir une cause commune, une même origine (§ 2338). De même, si l'on veut faire usage de ce terme de cause, celui qui considère l'individu peut dire que la vie est la cause de la mort, puisqu'elle en est certainement suivie ; et qui considère l'espèce peut dire que la mort est la cause de la vie, car tant que subsiste l'espèce, la mort de certains individus est suivie par la vie d'autres individus. De même que la naissance peut être appelée la cause ou l'origine commune, tant de la vie que de la mort, certains faits peuvent être appelés cause ou origine commune, d'abord de la prospérité, puis de la décadence d'une société humaine, et vice versa. Cette observation ne vise nullement à affirmer que ce soit le cas pour tous les faits, mais seulement qu'il peut en être ainsi pour quelques-uns. Elle a pour unique but de faire ressortir qu'il faut laisser de côté toute solution axiomatique du problème, et s'en tenir uniquement aux études expérimentales (§ 2331 et sv.).
§ 2542. Une autre erreur dont nous devons nous garder consiste à envisager comme simples des faits extrêmement compliqués. Sous une forme générale, cette erreur est souvent dissimulée par des dérivations de personnifications, grâce auxquelles nous avons la tendance de considérer comme une seule personne ayant des intérêts et des sentiments simples, un ensemble de personnes possédant des intérêts et des sentiments divers, parfois même opposés (§ 2254, 2328-1). Par exemple, nous traitons de la manière d'agir de Rome ou de la Macédoine. Nous ne commettons aucune erreur si, par ces noms, nous indiquons seulement la résultante des diverses forces qui existaient dans ces pays. L'erreur commence lorsque, oubliant cette diversité de forces, nous supposons à Rome ou à la Macédoine une volonté unique, comme il en existe une chez un individu. Nous savons qu'à Rome, en l'an 200 av. J.-C., certains Romains voulaient la guerre contre la Macédoine, et que d'autres ne la voulaient pas (§ 2556). Pourvu que nous n'ayons pas l'intention d'exprimer autre chose que ce fait, nous pouvons dire qu'alors Rome ne voulut pas faire la guerre à la Macédoine. Si nous voulons faire allusion, au moins en gros, aux forces composant la résultante, nous ajouterons que le Sénat proposa cette guerre, et que le Peuple la repoussa. En continuant de la sorte, on peut mentionner d'autres forces composantes, mais il serait impossible d'exclure d'une façon absolue toute manière analogue de s'exprimer, sans tomber dans une pédanterie ridicule, insupportable. Il n'y a aucune erreur tant que l'on fixe soit attention uniquement sur les choses désignées par ces noms. L'erreur commence avec la personnification de ces choses ; elle croît avec cette personnification, et atteint le comble quand celle-ci est complète. Rome n'avait pas une volonté unique à l'égard de la guerre contre la Macédoine, comme un individu particulier aurait pu en avoir une. Le Sénat n'avait pas non plus cette volonté unique, ni les spéculateurs qui étaient poussés à cette guerre, ni divers partis qu'on pourrait nommer dans leur collectivité. Au fur et à mesure que, partant de l'ensemble Rome, nous multiplions le nombre des parties, nous nous rapprochons de la réalité, sans jamais pouvoir l'atteindre tout à fait. Ce sont diverses approximations. Il est indispensable de les employer ; elles ne peuvent induire en erreur, pourvu qu'on les tienne pour telles, et qu'on n'aille pas au delà de ce qu'elles peuvent exprimer. Il faut aussi prendre garde que l'on commet une erreur analogue lorsqu'on suppose, fût-ce implicitement, qu'un même nom désigne, à divers moments, une même chose. Par exemple, les noms Sénat et Peuple subsistent dans l'histoire romaine, tandis que les choses qu'ils désignent changent entièrement. Cette erreur, commise autrefois par quelques historiens, a été maintenant corrigée par d'autres. Elle est beaucoup moins à craindre, parce qu'elle est moins insidieuse que la première dont nous avons fait mention. Celle-ci continue à dominer dans une infinité d'ouvrages contemporains, où l'on parle de l'Italie, de la France, de l'Angleterre, etc., comme si c'étaient de simples personnes.
§ 2543. Mais ici apparaissent deux écueils dont on pourrait bien dire : Incidit in Scyllam, cupiens vitare Charybdim. Il n'y a pas encore un siècle, on tendait à écrire l'histoire sans se soucier des détails, excepté d'anecdotes plus ou moins romantiques, auxquelles on accordait une large place. Aujourd'hui, on tend au contraire à recueillir le plus menu détail, et à disserter sans fin sur des sujets ne présentant aucune importance. Cela est utile pour préparer des matériaux, mais non pour les mettre en œuvre. Ce travail ressemble à celui de l'ouvrier qui taille des pierres, non à celui de l'architecte qui construit. Celui qui se livre à la recherche d'uniformités doit entreprendre l'étude des détails, grands ou menus, cela comme un moyen, non comme un but. Il faut ensuite qu'il abandonne l'espoir de pouvoir achever d'un coup la théorie qu'il édifie, et qu'il se persuade bien que seules les approximations successives pourront le rapprocher du terme désiré. On trace d'abord les lignes principales des phénomènes, puis l'on s'attache aux lignes secondaires, et ainsi de suite, selon la perpétuelle évolution de la science.
§ 2544. Toutes ces lignes sont idéales ; nous les obtenons par abstraction, c'est-à-dire que nous recherchons certains éléments principaux du phénomène concret. Celui-ci porte un seul nom, bien que composé de plusieurs éléments. De même, nous nommons argile un composé de plusieurs corps chimiques, et terre végétale un composé d'un nombre encore plus grand de ces corps. C'est à quoi ne prirent pas garde les auteurs qui dissertèrent si longuement de la lutte entre la « liberté républicaine » et le « despotisme impérial » à Rome, ni ceux qui, dans les anciens conflits entre les patriciens et les plébéiens, virent une lutte entre l'aristocratie et la plèbe, tandis qu'aujourd'hui on sait fort bien que c'étaient des luttes entre deux aristocraties. En des temps moins reculés, les luttes entre les sénateurs et les chevaliers ne sont point un phénomène simple, ainsi que tant de gens se l'imaginent. Pour preuve, il suffirait de remarquer que sénateurs et chevaliers, poussés par une communauté d'intérêts, tombaient d'accord lorsqu'ils s'opposaient aux lois agraires.
Ces lignes ne sont pas des lignes géométriques ; pas plus d'ailleurs que ne le sont les lignes qui séparent de la terre ferme les eaux de l'Océan. Il n'y a que la présomptueuse ignorance pour exiger une rigueur qui n'appartient pas à la science du concret. Les termes de cette science doivent correspondre à la réalité, mais cela n'a lieu qu'en de certaines limites [FN: § 1] . On ne peut définir rigoureusement la terre végétale, l'argile, ni dire quel est le nombre exact d'années, de jours, d'heures, etc., qui séparent de la jeunesse l'âge mûr ; ce qui n'empêche pas la science expérimentale de faire usage de ces termes, sous la réserve des approximations qu'ils comportent. La rigueur du raisonnement est atteinte par la considération de cette approximation. Du reste, même les mathématiques sont obligées de suivre cette voie pour faire usage des nombres dits irrationnels.
§2545. Cherchons donc à nous faire, en gros, une première idée des phénomènes. Nous avons précédemment reconnu que, dans les phénomènes sociaux, la façon dont les hommes obtiennent le nécessaire pour vivre, l'aisance, la richesse, les honneurs, le pouvoir, est d'une grande importance, tant pour les intérêts que pour les sentiments, et que, sous cet aspect, il convient, dans une première approximation, de diviser ces phénomènes en deux catégories (§ 2233). Voyons si, en suivant cette voie, nous trouverons quelque uniformité. Si oui, nous continuerons, sinon, nous ferons demi-tour.
§2546. Pour étudier des éléments différents, il faut commencer par les classer. Dans la circulation des élites à Rome, nous devons prendre en considération les éléments suivants :
(A). Les règles du passage d'une classe à une autre.
(A-1). Les règles légales du passage d'une classe à une autre. Dans les temps primitifs de l'histoire, il existe de graves obstacles légaux à la circulation. Les luttes entre les plébéiens et les patriciens tendent à les supprimer. Ils disparaissent pour les citoyens, et sont atténués pour les affranchis ; puis, vers la fin de l'Empire, les classes fermées ou presque fermées apparaissent de nouveau.
(A-2). Les mouvements effectifs du passage d'une classe à une autre. Ils dépendent surtout de la facilité de s'enrichir de diverses manières. Ils sont grands vers la fin de la République et le commencement de l'Empire.
(B). Les qualités de caractère de la nouvelle élite.
(B-1). Au point de vue ethnique [FN: § 2546-1] . D'abord, les nouveaux éléments sont : romains, latins, italiens. L'élite se renouvelle sans changer de caractère ethnique. En dernier lieu, viennent surtout les Orientaux. Le caractère de l'élite change entièrement. De même, il faut considérer les proportions, différentes au cours de l'histoire, et d'après lesquelles les habitants de la ville et ceux de la campagne concourent au gouvernement de l'État. Belot a probablement donné une importance trop grande à ces proportions ; mais ses observations conservent une part de vérité. D'un autre côté, il a pris l'indice pour la chose. Le fait matériel d'habiter la ville ou la campagne importe moins que les différents sentiments, les différents intérêts que cet indice représente. C'est pourquoi nous devrons porter principalement notre attention sur ces sentiments, sur ces intérêts.
(B-2). Au point de vue des résidus de la Ire et de la IIe classe. Quand l'élite se renouvelle en partie par les nouveaux riches, quand les préoccupations agricoles cèdent la place aux préoccupations financières ou commerciales, les résidus de la Ire classe s'accroissent dans la partie qui gouverne l'État ; ceux de la IIe classe diminuent. De la sorte, à Rome, on arrive, vers la fin de la République, à un État où la caste dominante est riche en résidus de la Ire classe, pauvre en résidus de la IIe ; tandis que, dans la caste dominée, surtout chez les hommes qui vivent loin de la ville, les résidus de la IIme classe abondent. Avec l'Empire commence un mouvement en sens contraire, à l'égard de la caste dominante, qui s'enrichit de résidus de la IIme classe, si bien qu'elle finit par égaler en cela la caste dominée.
(B-3). Au point de vue des rapports entre l'aptitude à employer la force, et l'usage qu'on en fait. À l'origine, on ne distingue pas le citoyen du soldat ; l'élite est homogène à ce point de vue : elle peut et sait user de la force. Puis, peu à peu, la qualité de citoyen se sépare de celle de soldat ; l'élite se divise en deux, la partie la plus petite domine surtout par la force ; la plus grande ne peut ni ne sait plus user de la force.
§ 2547. Les phénomènes se succèdent en se modifiant petit à petit avec le temps ; mais pour les décrire, nous sommes contraints par la nécessité d'en former des groupes, de séparer et de disjoindre ce qui est uni et continu. Cédant donc à cette nécessité, considérons les espaces de temps suivants. Nous leur donnons des limites nettes, uniquement pour faciliter l'exposé, comme on ferait pour la jeunesse, l'âge mûr, la vieillesse, dans la vie humaine, qui passe en changeant par degrés (§ 2544) : I. Du temps de la seconde guerre punique à la fin de la République. – II. Du principat d'Auguste au temps des Antonins. – III. Des Antonins à Gallien.
Il ne faut jamais oublier la mutuelle dépendance des différentes parties de l'état social, c'est-à-dire des éléments (a), (b), (c), (d), indiqués au § 2206. Ailleurs [FN: § 2547-1] , nous avons longuement traité de l'évolution des organisations économiques, ce qui nous permet de nous borner ici à de courts aperçus en cette matière, et de nous attacher davantage aux autres éléments.
§2548. Du temps de la seconde guerre punique à la fin de la République. Laissons de côté les temps antérieurs, parce que leur histoire est incertaine, et plus encore leur chronologie. Dans l'espace de temps indiqué ici, la puissance politique, militaire et financière de Rome s'accroît et atteint son maximum, comme aussi les manifestations de l'intelligence (§ 2354 et sv.); la liberté économique est assez grande.
(A-1). Les obstacles légaux à la circulation de l'élite, d'abord considérables, se réduisent à rien pour les citoyens [FN: § 2548-1] . Les campagnards et les citadins tendent à l'égalité. Les descendants au second degré – exceptionnellement aussi au premier degré – des affranchis obtiennent l'ingénuité et peuvent entrer dans l'élite.
(A-2). Effectivement, la guerre, le commerce, enfin le recouvrement des impôts [FN: § 2548-2] , font surgir de nombreuses sources de richesses. La circulation est intense, sans être pourtant trop hâtive [FN: § 2548-3], au moins en général. Une règle, qui d'ailleurs souffre diverses exceptions selon les temps, et qui persistera jusqu'à la chute de l'Empire, veut qu'une famille ne puisse s'élever dans les couches sociales que peu à peu. D'esclave, un homme devient affranchi ; ses descendants au second degré sont ingénus. S'ils obtiennent des magistratures, ils peuvent entrer dans l'ordre équestre. Ensuite, leurs descendants peuvent acquérir la
nobilitas. Toujours si l'on observe la règle, le même homme ne peut obtenir les magistratures que dans un ordre déterminé. Le mouvement général, d'abord lent, devient intense vers la fin de la République, qui marque un temps d'anarchie, où l'on observe peu les règles.
(B-1). Toute ou presque toute l'élite est composée d'éléments indigènes. Toutefois, vers la fin de la République, de grands changements soudains se produisent chez les citoyens et dans l'élite [FN: § 2548-4]. Enfin, on sait que la guerre sociale se termina avec l'admission au droit de cité romain d'une partie des citoyens des cités italiques.
(B-2) Quelques-uns des nouveaux citoyens étaient vraisemblablement des paysans, et ont apporté dans le peuple romain des résidus de la IIme classe ; mais le plus grand nombre étaient probablement des gens avisés, riches en résidus de la Ire classe ; car, seuls ces individus savaient se tirer des circonstances difficiles du temps, et obtenir des puissants les droits de cité. Il faut faire une observation analogue pour les esclaves qui obtenaient la liberté. Une comparaison établie par Denys d'Halicarnasse [FN: § 2548-5] , entre les affranchis anciens et ceux de son temps, montre que ces derniers possédaient des résidus de la Ire classe en plus grande abondance que les premiers. Ces résidus s'accroissaient aussi, en comparaison de ceux de la IIme classe, dans la caste gouvernante, qui recevait une quantité toujours plus grande de « spéculateurs ». Il faut distinguer le mouvement qui apporte de nouveaux citoyens de celui qui modifie l'élite. Dans celle-ci même, il faut distinguer différentes parties. Les soldats n'y manquent pas encore ; ce sont eux qui, après quelques tentatives infructueuses, constitueront l'Empire. Les « spéculateurs » forment la plus grande partie de l'élite. Ils se tournent toujours du côté d'où souffle un vent favorable ; ils intriguent au forum et achètent les votes aux comices, tant que cela peut leur profiter ; ils se révoltent avec la plus grande facilité et favorisent les militaires, s'ils peuvent en retirer quelque avantage. Nous les trouvons surtout parmi les chevaliers, mais il y en a aussi dans les autres classes. Enfin, il est une catégorie de gens timorés, souvent honnêtes, qui croient en l'efficacité des lois contre les armes, qui perdent toujours plus leur énergie [FN: § 2548-6] et creusent leur propre fosse. Dans l'histoire, on voit apparaître ces gens surtout parmi les sénateurs, chez lesquels on trouve d'ailleurs aussi des « spéculateurs » (§ 2542). Nous avons déjà remarqué d'une façon générale (§ 2338) que ce sont les mêmes causes qui provoquent d'abord la prospérité, puis la décadence. À la naissance d'un enfant, on peut prévoir à peu près ce qu'il sera physiquement quand il sera vieux ; de même, on peut prévoir, lorsqu'on connaît les circonstances, quel sera le développement d'aristocraties comme celles de Sparte ou de Venise, de peuples qui se séparent des autres, comme celui d'Athènes ou aussi de Chine, de peuples chez lesquels des conquêtes et des spéculations fournissent les nouveaux éléments de la classe dominante, comme ce fut le cas pour le peuple romain. Quelques mots de Florus [FN: §2548-7] donnent la synthèse du phénomène à la fin de la République. Ils nous décrivent les maux auxquels aboutit l'évolution de la ploutocratie. Mais précédemment, plutôt que des maux, il en était résulté un bien pour Rome. Polybe le vit ; il connut Rome, précisément lorsque les causes qui firent ensuite tomber l'État en décadence faisaient sa puissance et sa prospérité. Il fut frappé du fait que toute la population visait à des entreprises économiques et financières. Sous des formes quelque peu différentes, le phénomène était au fond en grande partie semblable à celui qu'on observe aujourd'hui chez les peuples civilisés. Polybe s'arrête surtout (VI, 17) aux travaux affermés par les censeurs ; entre autres les perceptions d'impôts. Il remarque que tout le peuple y prend part « (VI, 17, 4). Les uns afferment pour eux-mêmes, auprès des censeurs ; d'autres s'associent avec les premiers ; d'autres se portent caution ; d'autres engagent leurs biens pour ces cautions ». Voilà qu'est né ce qu'on appellera un jour la ploutocratie. Tant qu'elle est faible, elle demeure soumise ; quand elle sera forte, elle dominera. En attendant, entre ces deux états, elle donnera à Rome puissance et prospérité. Les hommes qu'a vus Polybe exploitaient, et leurs descendants exploiteront encore plus les conquêtes de Rome [FN: § 2548-8] et tous les pays du bassin de la Méditerranée, même ceux que la domination romaine n'atteignait pas encore. On pourra plus ou moins leur appliquer à eux tous les paroles de Cicéron au sujet des Gaules [FN: § 2548-9] : « La Gaule est pleine de négociants, pleine de citoyens romains. Aucun Gaulois ne tient un négoce sans un citoyen romain. Il ne circule pas non plus une pièce de monnaie dans les Gaules sans qu'elle soit sur les registres des citoyens romains ». La prospérité économique et financière fut alors vraiment très grande. Elle ressemble, toutes proportions gardées, à la prospérité des peuples civilisés modernes au début du XXme siècle. Alors comme aujourd'hui, les prix montaient et le luxe croissait [FN: § 2548-10] . Il est évident que de tels et de si graves intérêts de la classe nombreuse des « spéculateurs » constituaient une force assez puissante pour avoir la haute main dans l'État, si elle n'était pas contenue par une autre force égale ou à peu près (§ 2087 et sv.). Au temps de Polybe, la ruse suffisait encore. Cet auteur remarque (VI, 17, 5) que tous les travaux affermés par les censeurs dépendent du Sénat : « (6) et vraiment les cas sont nombreux où le Sénat peut causer de grands dommages, ou au contraire favoriser ceux qui ont affermé les recettes et les entreprises publiques [FN: § 2548-11] ». Voilà que nous apercevons une nouvelle force. Nuisible ou profitable, elle devra être prise en considération par la ploutocratie, dont les opérations seront alors plus profitables que nuisibles à la République, et de beaucoup. En même temps, l'obstacle une fois surmonté, la corruption et la violence auront le champ libre, jusqu'à ce que surgisse une autre force plus grande, celle des armes, qui les refoulera. Celui qui peut être très utile ou très nuisible à autrui se trouve nécessairement exposé à la corruption ou à la violence d'autrui. On observe ce fait en tout temps (§ 2261-1). Le présent et le passé s'expliquent mutuellement. Un corps qui, comme le Sénat romain, a tant de pouvoir, est aussi exposé à la rivalité de ceux qui veulent le déposséder et acquérir pour eux-mêmes ce pouvoir. En outre, celui qui dépend de ce corps ou des rivaux de ce corps, s'aperçoit tôt ou tard qu'il vaudrait mieux ne dépendre de personne, et tâche de dominer. On pouvait donc bien prévoir que le Sénat ne serait pas laissé en possession pacifique du pouvoir, et que la corruption et la violence changeraient de forme suivant qui détiendrait ce pouvoir, tandis qu'elles s'accroîtraient en même temps que les profits qu'on attendait ou qu'on obtenait d'elles. Polybe eut aussi l'occasion d'observer l'un des moyens par lesquels le Sénat maintenait son pouvoir : le privilège qu'il avait de juger les causes privées et les causes publiques. On pouvait donc aisément prévoir que la lutte s'engagerait à propos de ce privilège. On sait assez qu'il en fut effectivement ainsi.
(B-3). L'élite est encore en grande partie une classe guerrière mais la séparation entre les fonctions militaires et les fonctions civiles commence déjà [FN: § 2548-12]. En outre, l'armée, qui était primitivement composée surtout de citoyens propriétaires, et dans laquelle les résidus de la IIme classe étaient par conséquent puissants, tend à devenir en partie un ramassis de mercenaires, donc d'hommes qui sont l'instrument et l'auxiliaire des chefs chez lesquels abondent les résidus de la Ire classe [FN: § 2548-13].
§ 2549. II Du principat d'Auguste au temps des Antonins. Nous sommes toujours près du maximum observé dans la période précédente, mais la décadence commence. Au gouvernement par la ruse s'est substitué le gouvernement par la force. Il n'est plus nécessaire de corrompre les comices, car, rendus impuissants, ils ne tardent pas à disparaître entièrement. À la violence dans les comices succédera bientôt celle des prétoriens. Mais, sous Auguste et Tibère, les prétoriens sont encore soumis à l'empereur : ils constituent un moyen de gouverner, ils ne dominent pas. Les « spéculateurs » sont tenus en bride ; ils peuvent faire beaucoup de bien et peu de mal. C'est une période analogue à celle qu'on observa quand ils étaient tenus en bride par l'autorité du Sénat, par l'influence des citoyens campagnards. Mais, de même que cette organisation gouvernementale devait donner un temps de prospérité, puis un temps de décadence, ainsi la nouvelle organisation gouvernementale devait provoquer des phénomènes analogues ; et de même que la période précédente avait montré le bon et le mauvais côté d'un gouvernement qui a pour moyen principal la ruse (résidus de la Ire classe), la nouvelle période montrera le bon et le mauvais côté d'un gouvernement qui s'appuie principalement sur la force (résidus de la IIme classe.
(A-1). La tendance à la cristallisation commence [FN: § 2549-1]. On a une noblesse qui tend à se fermer : un ordo senatorius et un ordo equester [FN: § 2549-2] . Ces phénomènes sont en état de mutuelle dépendance avec l'augmentation des résidus de la IIme classe. Le nombre des citoyens augmente ; les fils des affranchis obtiennent l'ingénuité. Il est naturel qu'au fur et à mesure de la dégradation du droit de cité, ce droit soit accordé avec une libéralité toujours plus grande.
(A-2). Sous le Haut Empire, le commerce et l'industrie continuent à jouir de la liberté qu'ils avaient eue sous la République [FN: § 2549-3] . Ils offrent toujours le moyen de s'enrichir à un grand nombre de gens [FN: § 2549-4] . Ils absorbent même une partie des énergies qu'on dépensait précédemment dans les brigues des comices. De même, aujourd'hui, les occupations économiques absorbent, en Allemagne, au moins une petite partie des énergies qui, dans d'autres pays, sont dépensées en brigues politiques. La circulation effective de l'élite est toujours considérable [FN: § 2549-5] .
(B-1). L'invasion d'éléments étrangers, déjà commencée à la fin de la République, croît en intensité, non seulement parmi les citoyens, mais aussi dans l'élite, et appauvrit toujours plus de vieux sang romain ou même seulement italien [FN: § 2549-6] (§ 2546-1) le peuple et ses chefs, qui continuent à se dire Romains. Ces étrangers apportent en grande abondance des résidus de la IIme classe. Le vieux chêne romain dépérit ; une petite plante naît, qui grandira ensuite avec l'invasion des religions orientales, le culte de Mithra, le triomphe du christianisme.
(B-2). La manière dont les esclaves obtiennent la liberté ne change pas beaucoup. Par conséquent, un choix d'hommes possédant certains résidus de la Ire classe continue à exister ; mais ce choix se fait dans une collectivité où les résidus de la IIme classe sont puissants. Si l'on choisit les hommes de plus haute taille dans un peuple de nains, on a des hommes plus petits que si on les choisit dans un peuple normal, et beaucoup plus petits que si on les choisit dans un peuple de géants. Ces considérations s'appliquent à l'élite. On y entre surtout par les artifices de la « spéculation » et par la faveur des empereurs [FN: § 2549-7] . Ce fait tend à y accroître les résidus de la Ire classe. Mais l'origine ethnique y oppose de nombreux résidus de la IIme classe. Par conséquent, dans l'ensemble, d'abord la proportion des résidus change peu, il y a une certaine égalité entre le présent et le passé ; puis, petit à petit, les résidus de la IIme classe l'emportent. La classe gouvernante devient une classe de fonctionnaires [FN: § 549-82] , présentant l'étroitesse d'idées propre à ces personnes.
(B-3). La séparation entre les fonctions civiles et les fonctions militaires s'accentue [FN: § 2549-9] ; et ces fonctions tendent à se séparer complètement [FN: § 2549-10]. La classe militaire domine par l'Empereur. Elle constitue une force brutale, non une élite. La classe gouvernementale prend un caractère toujours plus civil. Elle ne peut pas, elle ne veut pas, elle ne sait pas faire usage de la force.
§ 2550. III. Des Antonins à Gallien. La grande prédominance des résidus de la persistance des agrégats manifeste toujours plus ses effets. La décadence politique, militaire, financière, intellectuelle de Rome, devient toujours plus grande. Les institutions économiques et sociales deviennent toujours plus rigides. Les barbares vont envahir l'empire.
(A-1). La cristallisation des sociétés croît et s'achève. Alexandre Sévère ferme les corporations des arts et métiers. Le décurionat devient une obligation onéreuse (§ 2607-2). La société romaine s'achemine à une société de caste [FN: § 2550-1].
(A-2). La circulation effective devient toujours moindre. L'institution de nombreuses corporations fermées, l'appauvrissement de l'Empire tarissent les sources des nouveaux éléments pour l'élite. Celle-ci ne reçoit plus qu'un petit nombre de « spéculateurs » et de favoris des empereurs. La division en castes est encore plus effective que légale.
(B-1). Désormais, l'élite se compose en grande partie d'éléments étrangers. Les empereurs eux-mêmes sont étrangers.
(B-2). Les « spéculateurs » et d'autres éléments semblables deviennent insuffisants pour renouveler l'élite ; aussi les résidus de la Ire classe y diminuent-ils, tandis que les résidus de la IIme classe s'y accroissent d'une manière démesurée, parce que les quelques éléments nouveaux sont surtout des Orientaux et des Barbares superstitieux.
(B-3). La séparation entre l'élite civile et les fonctions militaires est complète. Désormais l'élite est composée d'un ramassis de gens veules, mûrs pour être conquis par les Barbares [FN: § 2550-2].
§ 2551. Tous ces caractères vont en s'accentuant [FN: § 2551-1] jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident. Alors les Barbares brisent la cristallisation de la société. C'est le principal bienfait dont la nouvelle société leur est redevable. Du reste, encore plus superstitieux que les peuples qu'ils conquièrent, ils augmentent les résidus de la IIme classe, là où ils étaient déjà en quantité surabondante. Par conséquent, à ce point de vue, ils précipitent la ruine de la société. Mais grâce à leur ignorance, ils brisent la machine des institutions impériales, qu'ils auraient cependant voulu conserver, mais qu'ils sont incapables de faire fonctionner. Ils déposent ainsi la semence qui produira une nouvelle civilisation. En effet, avec le temps, çà et là apparaissent des points où, dans un état de mutuelle dépendance, se développent les résidus de la Ire classe et l'activité commerciale (§ 2609). C'est d'une manière semblable qu'en d'autres temps Athènes, Rome et d'autres antiques cités grecques et italiques avaient pris naissance. La diversité des circonstances donne une forme différente aux phénomènes; mais sous cette forme transparaît paraît un fond qui est semblable. Dans le pays où, comme en Provence et en Italie, le commerce, les arts, les industries, permettent aux « spéculateurs » de s'enrichir et d'entrer dans l'élite de la population, en y apportant des résidus de la Ire classe dont cette élite manquait grandement, la prospérité politique, militaire, financière, intellectuelle, reparaît : nous sommes au temps des Communes.
§ 2552. Il faut prendre garde au cours général de semblables phénomènes : celui d'une courbe ondulée dont nous avons vu déjà de nombreux exemples [FN: § 2552-1] . Les considérations représentées aux § 2330 à 2339 s'appliquent au présent cas. Comme d'habitude, nous avons à examiner les théories ou dérivations (c) (§ 2205) et les faits correspondants (a), (b), (d). Appelons (s) l'ensemble de ces faits, uniquement pour nous entendre. Nous avons déjà étudié (§ 2203 et sv.) le phénomène général de la mutuelle dépendance de ces éléments (a), (b), (c), (d) et les cycles qu'on y observe. Maintenant nous allons considérer le phénomène particulier des ondulations qui se produisent au cours du temps, dans ces éléments, et les rapports de mutuelle dépendance que ces ondulations présentent.
L'étude des états successifs de l'organisation économique et de l'organisation sociale conduit à examiner les oscillations successives des catégories (b) et (d), auxquelles on peut ajouter, si l'on veut, les oscillations des sentiments (a), que nous savons d'ailleurs ne pas atteindre une ampleur considérable, si ce n'est dans des temps assez longs. Avec cette restriction, nous pouvons dire que nous considérons les oscillations de l'ensemble (s). Les conceptions des états de (s) et des théories (c) qui y correspondent apparaissent plus ou moins indistinctement sous les termes de « libre échange » ou de « protectionnisme », d'« individualisme » ou d'« étatisme », employés dans le langage vulgaire. Les deux premiers termes ont un sens quelque peu précis ; à la rigueur, on peut les employer dans un raisonnement scientifique (§ 2544). Les deux derniers sont indéfinis, analogues à ceux de « religion », de « morale », etc. Pour pouvoir s'en servir, il faut au moins avoir une lointaine idée de ce qu'ils signifient. D'abord, il est nécessaire de séparer les faits des théories. Si l'on croit que toutes les actions sont logiques, et si, voulant inventer la réalité, on s'imagine que les théories, les dérivations, déterminent les actions de l'homme, on peut sans grave inconvénient confondre les théories et les faits, et ne pas distinguer entre les théories (c) de l'« individualisme » et de l'« étatisme » d'une part, et les faits (a), (b), (d), auxquels ils correspondent d'autre part. Il n'en est pas ainsi pour celui qui connaît le rôle important des actions non-logiques dans les phénomènes sociaux. Il ne lui est pas permis, s'il veut raisonner avec tant soit peu de rigueur expérimentale, de confondre (c) avec l'ensemble (a), (b), (d), que nous désignons par (s). Nous avons séparé (c) de (s) ; mais cela ne suffit pas. À la rigueur, nous pouvons savoir si une théorie (c) est « individualiste » ou « étatiste », de même que nous pouvons savoir si une autre théorie se rapproche plus du nominalisme que du réalisme ; mais il est beaucoup plus difficile de savoir à quels faits (s) correspondent les faits dits de l'« individualisme » ou de l'« étatisme ». Vouloir obtenir en cela de la précision est aussi inutile que de vouloir définir rigoureusement les termes « religion », « morale », « droit », etc. Il convient donc de suivre une autre voie pour classer les états (s). Nous pouvons obtenir quelque rigueur en portant notre attention sur la force des liaisons qui règlent les actions de l'individu. Si cette liaison est faible, nous nous rapprochons de l'état appelé « individualiste » ; si elle est forte, nous nous rapprochons de l'état dit « étatiste ». Il faut ensuite séparer les liaisons économiques qui appartiennent à (b), des liaisons de la circulation des élites, qui appartiennent à (d). Les liaisons de ces deux catégories peuvent être faibles, comme vers la fin de la République romaine et au commencement de l'Empire. Elles peuvent être fortes chez toutes les deux, comme au temps de la grande décadence de l'Empire. Les liaisons de première catégorie peuvent être faibles et celles de la seconde fortes, comme aux temps qui suivirent les invasions barbares. Enfin, les liaisons de la première catégorie peuvent être fortes et celles de la seconde très faibles, comme dans l'état auquel s'acheminent nos sociétés. D'une manière analogue à ce que nous avons fait au § 2339, nous distinguons un aspect intrinsèque et un aspect extrinsèque, tant pour les oscillations des dérivations (c) que pour celles des faits sociaux (s). On obtient le premier aspect, si l'on sépare (c) et (s), et en considérant pour chacune de ces catégories l'action d'une période ascendante sur la période descendante qui la suit, puis de celle-ci sur la période ascendante qui vient après, et ainsi de suite. On obtient le second aspect, en unissant (c) avec (s), et en considérant les actions mutuelles de ces deux catégories. Nous avons donc à étudier les aspects suivants :
- (I) Aspect intrinsèque :
- (I-α). Dérivations (c) ;
- (1-β). Ensemble des faits sociaux (s).
- (II). Aspect extrinsèque :
- (II-α). Action de (c) sur (s) ;
- (II-β). Action de (s) sur (c) ;
- (II-γ). Action des différentes parties de (c) ; (II-δ). Action des différentes parties de (s).
Nous n'avons pas à nous occuper ici spécialement de cette dernière catégorie, car elle fait partie de l'étude générale que nous sommes en train d'accomplir sur les formes des sociétés. Voyons les autres.
§ 2553. (I-α). Aspect intrinsèque des dérivations. Jusqu'à présent, presque tous les auteurs de théories, en matière sociale, ont été mus surtout par la foi en quelque idéal. Par conséquent, ils ont accepté uniquement les faits qui paraissaient concorder avec cet idéal, et ne se sont guère souciés des faits contraires. Lors même que ces théories ont un vernis expérimental, elles tendent à la métaphysique. On peut ranger les dérivations de l'« individualisme » et de l'« étatisme » dans le même genre que le nominalisme et le « réalisme » ; et, bien que les analogies soient beaucoup moins frappantes, les dérivations du « libre échange » et du « protectionnisme » ne s'écartent pas trop de ce genre. Donc, en cela, le cas que nous étudions maintenant est semblable à celui dont il est question aux § 2340 et sv. ; mais entre les deux cas, il y a toutefois une différence notable. Elle consiste en ce qu'actuellement la discordance entre la théorie et la réalité a peu ou point d'influence pratique. Ainsi disparaît la cause qui agissait pour déterminer la succession des périodes, dans le cas du
§2340. Ce fait a lieu parce que dans les matières touchant aux sciences naturelles, il est difficile, presque impossible, d'éviter le contraste entre les dérivations et la réalité expérimentale, tandis que cela est très facile dans les matières touchant les « sciences » sociales. Dans celles-ci, on juge les théories suivant leur accord avec les sentiments ou avec les intérêts, plutôt que d'après leur accord avec la réalité expérimentale. Nous pouvons donc conclure que, dans le présent cas, l'aspect intrinsèque de (c) est peu important.
(I-β) Aspect intrinsèque de l'ensemble des faits sociaux. Contrairement au précédent, cet aspect est très important. Une période d'« individualisme » (dans laquelle les liaisons sont faibles) prépare une période d'« étatisme » (dans laquelle les liaisons sont fortes ») et vice-versa. Dans la première période, l'initiative privée prépare les matériaux dont les institutions rigides de l'État se serviront durant la seconde ; et pendant celle-ci, les inconvénients croissants de la cristallisation sociale préparent la décadence (§ 2607 et sv.), que seule l'apparition nouvelle de la souplesse et de la liberté d'action des particuliers peut changer en progrès (§ 2551). L'expérience nous montre que les oscillations peuvent être d'ampleur et de durée différentes ; mais elle ne nous fait connaître aucun peuple civilisé chez lequel on n'observe pas de ces oscillations. Il est donc peu probable, du moins pour aujourd'hui, qu'il puisse y avoir un état social où elles disparaissent entièrement.
Une société dans laquelle les personnes abondamment douées de résidus de la Ie classe ont toute liberté d'action, apparaît comme désordonnée ; en outre, une partie de la richesse est certainement dilapidée en efforts stériles. Par conséquent, quand la cristallisation commence, la société paraît non seulement mieux organisée, mais aussi plus prospère. La cristallisation de la société romaine, sous le Bas Empire, ne fut pas seulement imposée par le gouvernement : elle fut aussi voulue par la population elle-même, qui y voyait une amélioration de ses conditions. Le fait d'attacher définitivement le colon au sol, l'artisan à son métier, le décurion à la curie, non seulement profitait au gouvernement qui établissait ainsi dans la société une organisation meilleure et plus avantageuse pour lui-même, mais encore, il plaisait aux jurisconsultes, aux intellectuels, qui admiraient un si bel ordre. Elle était désirée, voulue par les propriétaires qui entretenaient les colons, par les corporations qui s'assuraient le concours des gens qui, plus avisés et plus habiles, auraient pu porter ailleurs leurs richesses, par les citoyens qui exploitaient les décurions. On comprend mieux le phénomène en observant les faits contemporains qui sont en partie semblables. La prospérité de nos contrées est, – ne fût-ce qu'en partie – le fruit de la liberté d'action des éléments, au point de vue économique et social, durant une partie du XIXe siècle. Maintenant la cristallisation commence, exactement comme dans l'Empire romain. Elle est voulue par les populations et, en de nombreux cas, paraît accroître la prospérité [FN: § 2553-1]. Sans doute nous sommes loin encore d'un état où l'ouvrier est définitivement attaché à son métier ; mais les syndicats ouvriers, les restrictions imposées à la circulation entre un État et un autre, nous mettent sur cette voie. Les États-Unis d'Amérique, constitués par l'émigration, et qui doivent à l'émigration leur prospérité actuelle, s'efforcent maintenant par tous les moyens de repousser les émigrants. D'autres pays, comme l'Australie, en font autant. Les syndicats ouvriers cherchent à interdire le travail aux gens qui ne sont pas syndiqués. D'autre part, ils sont bien loin de consentir à accepter tout le monde. Les gouvernements et les communes interviennent chaque jour davantage dans les affaires économiques. Ils y sont poussés par la volonté des populations, et souvent avec un avantage apparent pour celles-ci. En Italie, la loi sur la « municipalisation » des services publics était voulue par la population, si bien que le gouvernement l'accorda, tout en l'utilisant comme une arme électorale. Déjà surgissent d'autres analogies qui apparaîtront peut-être davantage dans la suite [FN: §2553-2] . Le pouvoir impérial de la décadence romaine donnait la chasse aux curiales, pour les ramener à leurs onéreuses fonctions (§ 2607) ; le pouvoir de la ploutocratie démocratique de nos sociétés ne donne pas encore la chasse aux personnes aisées, mais bien à leur argent. Pour se soustraire à des charges exorbitantes, les contribuables envoient leur argent à l'étranger, et le gouvernement dont ils dépendent s'indigne et s'efforce de les punir par différents moyens. C'est pourquoi des accords que l'on peut bien appeler une complicité d'exploiteurs, ont été conclus entre les gouvernements de la ploutocratie démocratique, en France et en Angleterre. Le premier de ces gouvernements a voulu obtenir, mais pour le moment en vain, que le gouvernement suisse l'aidât à donner la chasse aux contribuables. Il y a, dans nos sociétés, une propension à faire voter les impôts par la grande majorité, qui ne les paie pas, et à en faire retomber le poids sur une petite minorité. À l'égard des exploiteurs, il y a certainement une grande différence entre cet état de choses et celui de l'Empire romain, où le pouvoir impérial fixait l'impôt que devaient payer les gens aisés ; mais la différence est beaucoup moindre pour les exploités, auxquels il importe vraiment peu que leur argent aille aux auxiliaires de l'empereur ou aux ploutocrates démagogues. Bien plus, à vrai dire, les légions d'un Alexandre Sévère, qui était pourtant si généreux envers ses soldats, coûtaient beaucoup moins que les électeurs du parti d'un Lloyd George [FN: § 2553-3], sans compter que les premiers défendaient au moins leur pays, tandis que les seconds ne défendent que leurs propres jouissances.
En conclusion, il est facile de voir que nous nous mouvons sur une courbe semblable à celle qu'à déjà parcourue la société romaine après la fondation de l'Empire, et qui, après avoir présenté une période de prospérité, se prolongea jusqu'à la décadence. L'histoire ne se répète jamais, et il n'est pas du tout probable, à moins que l’on ne croie au « péril jaune », que la période future et nouvelle de prospérité provienne d'une autre invasion barbare. Il serait moins improbable qu'elle résultât d'une révolution intérieure, laquelle donnerait le pouvoir aux individus qui possèdent en abondance des résidus de IIe classe, et qui savent, qui peuvent, qui veulent faire usage de la force. Mais ces éventualités lointaines et incertaines sont dans le domaine de la fantaisie, plus que dans celui de la science expérimentale.
(II-α) Aspect intrinsèque. Action de (c) sur (s). Cette action n'est pas exclue, mais elle est habituellement peu importante. Il faut surtout remarquer que (c), après avoir tiré son origine de (s), réagit sur ces phénomènes et les accentue : expression d'un état d'esprit, il lui donne plus d'intensité et de vigueur ; manifestation partielle des sentiments de l'intégrité (Ve classe), il les concilie avec les sentiments de la sociabilité (IVe classe) ; voile d'intérêts, il les recouvre et les dissimule à la vue des gens qui ne le sont pas ; théorie dissimulatrice de faits brutaux, il les « justifie », en les conciliant avec la « morale » existant dans la société, et, d'une façon générale, avec les persistances d'agrégats (IIe classe) qui s'y trouvent ; en outre, il satisfait le besoin que les hommes éprouvent d'« expliquer » les phénomènes (résidus I-epsilon), et de cette façon il les distrait de recherches expérimentales qui pourraient servir à apporter quelque modification en (s), fût-elle très petite ; fiction agréable, il satisfait le désir et apaise l'envie des gens qui cherchent à oublier, dans les régions de l'idéal et de la fantaisie, les misères et les laideurs de la réalité, et enlève aux organisations existantes des adversaires militants, contribuant ainsi à maintenir (s) sans trop de changements [FN: § 2553-4] .
(II-β) Aspect extrinsèque. Action de (s) sur (c). On peut voir facilement que les oscillations des dérivations (c) qui constituent les théories du « libre échange » ou du « protectionnisme », et celles des dérivations qui constituent les théories de l'« individualisme » ou de l'« étatisme » suivent de près les oscillations de l'ensemble (s). Cela conduit à dire que les oscillations de (c) correspondent à celles de (s) parce qu'elles en résultent, plutôt que celles de (s) ne résultent de celles de (c). Les théories favorables au libre échange apparaissent lorsque la circulation des élites et les intérêts sont favorisés par le libre-échange [FN: § 2553-5] . Il en est de même pour les théories du protectionnisme. On peut répéter cela pour les théories de l'« individualisme » et de l'« étatisme » (§ 2208 et sv.). Les oscillations de l'ensemble (s) sont donc le phénomène principal. En somme, l'importance des oscillations de (c) consiste presque entièrement en ce qu'elles nous donnent l'image des oscillations de (s).
(II-γ) Aspect extrinsèque. Action des différentes parties de (c). L'usage des raisonnements logico-expérimentaux de l'empirisme, de la pratique, de la science, agit, sinon beaucoup, du moins quelque peu sur les dérivations employées en matière sociale, soit à l'égard des individus, soit à l'égard des collectivités. Dans ses considérations sur les matières sociales, le naturaliste Aristote se rapproche plus de la réalité que le métaphysicien Platon. Machiavel s'en rapproche considérablement, parce qu'il est habitué aux raisonnements de la politique empirique. Pour le même motif, Bismarck ne s'en écarte pas trop, et pour un motif contraire, le rêveur humanitaire qui s'appela Napoléon III s'en écarta beaucoup. À l'égard des collectivités, les théories économiques d'Adam Smith et de J. B. Say se rapprochent de la réalité expérimentale beaucoup plus que tout ce qu'on avait écrit jusqu'alors, mais ne l'atteignent pourtant pas tout à fait. Elles apparaissent au moment où le progrès des sciences naturelles est rapide et très grand. Vice versa, les divagations de l'école historique, les négations puériles de l'existence des lois (uniformités) des sciences sociales apparaissent là où un mysticisme étatiste, un patriotisme morbide empêchent tout contact entre les sciences naturelles qui ont progressé et la littérature qui usurpe le nom de sciences sociales.
§ 2554. Jusqu'ici, nous avons tracé les lignes principales de l'évolution, à Rome, de l'ensemble (s), constitué par les sentiments, par les intérêts, par la circulation des élites, en négligeant un grand nombre de détails qui nous auraient masqué la vue synthétique de l'ensemble. Il convient maintenant d'envisager au moins une partie de ces détails, afin d'acquérir une connaissance plus complète et plus précise du phénomène.
L'origine du sénat romain est obscure. Nous n'avons pas à nous arrêter sur ce sujet. Il se peut que, conformément à la tradition, la nomination des sénateurs appartînt au roi, puis aux consuls. Aux temps historiques, la nomination est confiée aux censeurs (vers l'an 442 de Rome). Lorsqu'ils établissent le cens, ils confirment les sénateurs déjà inscrits et nomment les nouveaux. En fait, l'arbitraire ne jouait pas un grand rôle, car certains magistrats étaient régulièrement inscrits comme sénateurs, au cens qui suivait le terme de leur magistrature. Le nombre de ces magistrats alla toujours croissant aussi longtemps que dura la République. Tant que le Sénat prit une grande part au gouvernement de l'État, c'est-à-dire à peu près jusqu'au temps de Marius et de Sulla, la classe gouvernante put, avec une certaine approximation, être représentée par la classe sénatoriale. Le fait que les fonctions militaires étaient jusqu'alors unies aux fonctions civiles, parmi lesquelles les fonctions judiciaires n'étaient pas les dernières, l'obtention des magistratures par l'élection populaire, la gratuité des magistratures, les us et coutumes, tout cela faisait que cette classe était composée de gens possédant des aptitudes militaires, une certaine intelligence, la pratique de l'administration, la connaissance du droit, et n'ignorait pas les combinaisons par lesquelles on obtenait la faveur populaire ; en outre, elle était passablement aisée ou même riche. Il devait donc s'y trouver une certaine proportion des résidus de l'instinct des combinaisons et de la persistance des agrégats. Cette classe était en grande partie analogue à celle de l'Aréopage à Athènes, ou à celle de la Chambre des Lords, ou de la Chambre des Communes en Angleterre, au temps des guerres contre Napoléon Ier. Si l'on prête attention au fait qu'au-dessous, il y avait une classe gouvernée, chez laquelle les résidus de la persistance des agrégats étaient puissants, tandis que ceux de l'instinct des combinaisons se trouvaient en quantité suffisante pour suivre les propositions de la classe gouvernante, on comprend facilement que le maximum de prospérité fût atteint précisément dans la période qui va de la seconde guerre punique à la conquête de la Grèce et de l'Asie.
§2555. Les éléments de la richesse et de la spéculation semblent n'avoir jamais manqué à Rome, depuis l'origine des temps historiques. Ils ont peut-être indirectement servi à provoquer l'ascension dans la classe gouvernante, au moins des descendants des nouveaux riches. Mais directement, de ce fait, ils n'eurent pas un grand pouvoir jusqu'à la conquête des opulentes régions grecques et asiatiques.
§2556. Il est remarquable qu'en l'an 200 avant J.-C. le peuple rejeta la proposition de déclarer la guerre au roi de Macédoine. Tite-Live dit que « (XXXI, 6) fatigués d'une guerre longue et difficile, les hommes firent cela spontanément, poussés par la répugnance pour les fatigues et les dangers. En outre, Q. Bebius, tribun de la plèbe, suivant l'antique procédé d'accuser les patriciens, leur reprochait de faire naître les guerres les unes des autres, afin que la plèbe ne pût jamais jouir de la paix ». Sous ces mots, il est facile de découvrir l'éternel conflit entre les deux classes de citoyens indiquées au § 2235 : entre la classe caractérisée par un revenu presque fixe, et celle qui est caractérisée par un revenu très variable. Les petits propriétaires romains étaient ruinés par la guerre, s'ils ne prenaient pas part aux spéculations qu'elle provoquait. Au contraire, ceux qui dépouillaient les provinces et spéculaient, s'enrichissaient. Entre les uns et les autres se produisait le conflit que Tite-Live raconte comme s'il avait eu lieu entre le Sénat et le peuple (§ 2542). Lui-même nous en donne la preuve. Lorsque, en l'an 171 avant J.-C., on proposa la troisième guerre de Macédoine, il y avait, pour la rejeter, des motifs encore plus graves que ceux indiqués plus haut. Pourtant le peuple accepta sans opposition, et les hommes accouraient s'enrôler volontairement parmi les soldats, « parce qu'ils voyaient que ceux qui avaient pris part à la première guerre de Macédoine ou à celle contre Antiochus en Asie, s'étaient enrichis [FN: § 2556-1] ».
§ 2557. Ainsi se transformait peu à peu la nature de la population romaine. Le nombre et la puissance de ceux auxquels les pillages de la guerre et les spéculations procuraient un revenu variable croissaient d'une façon démesurée. La plèbe citadine leur prêtait son appui, grâce à l'intérêt commun que ces deux classes avaient à maintenir une telle organisation. En effet, la seconde participait aux entreprises de la première directement, ou en vendant ses suffrages [FN: § 2557-1] , ou d'une autre façon. De même, une partie de la plèbe campagnarde, abandonnant ses champs, trouvait dans les armes un métier lucratif. D'autre part, la multitude croissante des clients ne manquait pas non plus d'offrir son appui. Ensuite, il y avait lutte entre ces différentes classes pour le partage du butin. En attendant, cette partie de la plèbe campagnarde qui vivait du travail de la terre, allait en diminuant. Ce ne sont pas les latifundia qui perdirent l'Italie, mais bien cet ensemble de faits dont les latifundia même provinrent en partie (§ 2355). Les guerres de la conquête romaine produisaient alors le même effet que, de nos jours, la rapide expansion de l'industrie et l'exploitation des pays neufs en Amérique, en Asie, en Afrique. Dans nos contrées, le nombre et la puissance des « spéculateurs » se sont beaucoup accrus et s'accroissent toujours. Le peuple citadin leur prête son appui, grâce à l'intérêt commun que ces deux collectivités ont à maintenir l'organisation actuelle de ploutocratie démagogique. En effet, la seconde participe aux entreprises de la première, directement ou indirectement par des intrigues politiques. De même, une partie de la plèbe urbaine, abandonnant ses champs, accourt vers les villes, où l'attirent un meilleur salaire et un travail plus facile. Il faut y ajouter de nombreux bourgeois, tels que les avocats, les notaires, les ingénieurs, les médecins, etc., qui font payer grassement leur concours par les « spéculateurs », auxquels l'argent coûte si peu ; ces spéculateurs font preuve de la munificence des anciens patrons envers leurs clients. Ensuite, il y a quelquefois lutte par les grèves ou autrement entre ces différentes classes, pour le partage du butin. En attendant, on se plaint toujours plus de l'abandon des campagnes, et l'on restreint la surface occupée par la petite propriété. Si l'esclavage et le colonat existaient, les latifundia augmenteraient. On sait assez que bien loin de s'opposer à un tel mouvement, la plèbe socialiste l'invoque et se montre hostile de différentes manières à la petite propriété, et plus encore au métayage. En Romagne, non seulement des grèves, mais aussi des conflits armés se produisent pour changer l'organisation de la propriété, et l'acheminer vers un état dans lequel il ne resterait que des propriétaires et des mercenaires ; état analogue à celui des latifundia. Les « spéculateurs » qui dominent dans la Rome moderne, à l'instar de ceux qui dominaient dans la Rome de la fin de la République, ne font rien, de même qu'ils ne faisaient rien alors, pour s'opposer à cette transformation. Au contraire, comme ils y aidaient alors, ils y aident aujourd'hui, lorsqu'ils ont besoin des suffrages de la plèbe. Ce phénomène contemporain nous permet de mieux comprendre celui de la Rome ancienne. Il nous montre que les latifundia furent en de nombreux cas une conséquence de faits dont on les a crus la cause, et mieux encore qu'ils furent dans un état de mutuelle dépendance avec ces faits.
§2558. Les auteurs éthiques se sont escrimés à disserter sur la « corruption » qui fut la « conséquence » de l'augmentation de la richesse à Rome. Ils ont répété avec une infinité de variantes ce que disait déjà Diodore de Sicile [FN: § 2558-1] . L'un s'en prend à la richesse en général ; l'autre seulement à la richesse produite par le « crime » de la guerre et des extorsions qui en furent la conséquence. D'une manière générale, les déclamations sur la pauvreté vertueuse du passé, opposée à la richesse vicieuse du présent, recouvrent le fait d'un changement dans la proportion existant entre les individus qui possèdent une rente presque fixe, chez lesquels prédominent les résidus de la IIe classe, et les individus possédant des revenus très variables, et chez lesquels prédominent les résidus de la Ire classe.
§ 2559. D'autres auteurs accusèrent la concentration de la richesse § 2355) ; d'autres, les latifundia (§ 2557) ; d'autres, le « capitalisme (§ 1890) ; d'autres, la perversité de l'« aristocratie » romaine, qui opprimait et anémiait le bon peuple ; d'autres, l'esclavage, « honte » de ces temps ; d'autres encore s'en prirent aux défauts de la constitution politique de Rome. Certains prétendent que si cette constitution avait été plus démocratique, si elle avait eu un parlement pour représenter les peuples sujets – si elle s'était rapprochée davantage de la constitution parfaite de l'empire allemand, disent certains autres – elle aurait certainement assuré une prospérité très longue, peut-être éternelle, à la puissance romaine. Ces ouvrages peuvent être agréables, comme les romans historiques de Dumas, mais ils s'écartent beaucoup de la réalité.
§ 2560. Les faits sont si puissants qu'ils transparaissent à travers les dérivations dont les auteurs les recouvrent (§ 2356). Voici, par exemple, Duruy qui écrit [FN: § 2560-1] : « (p. 283) Un siècle de guerres, de pillage et de corruption [simplement la transformation produite par les nouvelles sources de richesse ; un segment du cycle (b) (d)-(d) (b) (§ 2321)] avait dévoré la classe des petits propriétaires [comment dévoré ? Ils avaient simplement changé d'occupation : de la classe des personnes à revenu presque fixe, ils avaient passé dans celle des « spéculateurs » ou des auxiliaires de ceux-ci] à qui Rome avait dû sa force et sa liberté ». Il devait dire que cette prospérité était due à une proportion favorable entre cette classe et l'autre, où prédominaient les résidus de l'instinct des combinaisons, et qu'elle avait disparu lorsque la proportion était devenue défavorable. Il est remarquable que, sans trop de recherches, on puisse déduire cela de ce qu'il dit lui-même un peu plus haut. « (p. 282) Les prodiges étaient toujours aussi nombreux, aussi bizarres, c'est-à-dire le peuple et les soldats aussi grossiers, aussi crédules [prédominance des résidus de la persistance des agrégats]. Les généraux voulaient des temples, mais, comme Sempronius Gracchus, pour y graver le récit de leurs exploits ou y peindre leurs victoires. Ils immolaient avant l'action de nombreuses victimes, mais pour contraindre, comme Paul Émile, l'impatience des soldats et attendre le moment propice. Ils observaient gravement le ciel avant et durant la tenue des comices, mais pour se réserver le moyen de dissoudre l'assemblée, obnuntiatio, si les votes semblaient devoir contrarier les desseins du Sénat ».
§ 2561. Puis il dit très bien : « (p. 293) Ainsi chaque jour les besoins croissaient, et chaque jour aussi, du moins pour le pauvre, qui avait les périls, mais non les profits durables de la conquête, les moyens de les satisfaire diminuaient ». De la sorte, ceux que Duruy appelle les pauvres, et qui étaient en réalité des individus de la classe à revenus presque fixes, étaient chassés par force dans la classe des « spéculateurs » ou de leurs auxiliaires. On peut constater le même phénomène à l'époque actuelle. Les parvenus et les gains subits eurent à Rome des effets semblables à ceux qu'ils ont eus chez tous les peuples et en tous les temps [FN: § 2561-1]. Deloume se rapproche beaucoup de la vérité au sujet du phénomène qui se produisait après la conquête de la région méditerranéenne et peu de temps avant la fin de la République [FN: § 2561-2]. C'est une époque qui présente plusieurs analogies avec le temps présent. La comparaison avec l'Angleterre, que Deloume fait sienne, suivant en cela Guizot, est parfaitement conforme à la vérité ; il est remarquable qu'elle se soutienne jusqu'à présent. Ce furent les squires, les petits propriétaires fonciers, qui sauvèrent le pays, au temps des guerres napoléoniennes. Ensuite, la part qu'ils prenaient au gouvernement alla toujours en diminuant, tandis qu'augmentait et que continue à augmenter la part des « spéculateurs ». On sait assez qu'aujourd'hui (en 1913) le ministre Asquith a, dans sa majorité, bon nombre de ces « spéculateurs » millionnaires, qui sont parmi les plus fervents admirateurs des invectives de son parti contre les « riches ». Leur lutte avec les lords correspond à celle qui eut lieu à Rome vers la fin de la République, entre les chevaliers et les sénateurs.
§ 2562. La conquête de la région méditerranéenne procura aux vainqueurs une source de gros profits pour qui possédait à un haut degré l'art des combinaisons. Avec de l'argent largement dépensé à Rome, on acquérait le droit d'exploiter des provinces, de se récupérer de ses frais et au-delà [FN: § 2562-1] ; c'était une spéculation, précisément comme celle des gens de notre temps qui s'enrichissent grâce aux droits protecteurs qu'ils achètent des électeurs et des législateurs.
§2563. Les phénomènes de ce temps et ceux d'aujourd'hui sont semblables en de nombreux points ; pourtant ils présentent une différence très importante, qui explique, au moins en partie, le caractère que présenta la constitution de l'Empire romain. La différence consiste en ce que les auxiliaires des « spéculateurs » étaient alors en partie civils et en partie militaires ; tandis qu'aujourd'hui ces auxiliaires sont presque exclusivement civils. La partie militaire, à Rome, finit par se tourner contre les spéculateurs.
§2564. Beaucoup de gens ne trouvaient pas accès aux sources de gain mentionnées plus haut, et manquaient des aptitudes nécessaires à ces combinaisons ; mais l'énergie, le courage, les résidus de la persistance des agrégats ne leur faisaient pas défaut. Ces gens se mirent au service de chefs ingénieux, hardis, fortunés, pour un temps plus ou moins long, et formèrent les armées de Marius, de Sulla, de César, d'Antoine, d'Octave. Si l'on ne prête attention qu'aux agriculteurs, on voit alors diminuer la classe moyenne à Rome. Mais aux agriculteurs manquants se substituent les soldats de métier, et aux races italiques les races grecque et orientales.
§2565. Nous avons remarqué plusieurs fois que le point faible du gouvernement des « spéculateurs » gît dans leur défaut de courage et dans leur manque d'aptitudes à savoir faire usage de la force. Ces gouvernements sont donc habituellement détruits par les gens qui savent employer la force, que ce soient des ennemis intérieurs ou des étrangers : ils succombent à la suite de guerres civiles ou extérieures. En ce qui concerne les révolutions intérieures, on remarquera que la catastrophe finale est souvent précédée de tentatives de révoltes, tentatives qui sont réprimées et qui échouent.
§ 2566. Si l'on se laisse guider exclusivement par les conceptions des actions logiques, on est entraîné à juger séparément ces tentatives, à rechercher la cause et les effets de chacune. Habituellement on trouve la cause dans les souffrances de la classe sujette. Comme ces souffrances ne font jamais défaut, et qu'elles diffèrent seulement d'intensité, cette cause ne fait jamais défaut non plus. Si l'on pouvait établir cette proposition : que les tentatives de révolution sont d'autant plus fréquentes et ont une probabilité de victoire d'autant plus grande que les souffrances sont plus grandes [FN: § 2566-1], la cause trouvée aurait de la valeur, en considération de l'intensité de ces souffrances. Mais en réalité il n'en est pas ainsi. Depuis les temps les plus anciens, on a observé que les révoltes ont souvent lieu quand les conditions du peuple se sont améliorées. C'était même une maxime de gouvernements anciens que les peuples sont d'autant moins dociles qu'ils sont plus aisés [FN: § 2566-2] . Cela est peut-être vrai jusqu'à un certain point, mais non au-delà. Une théorie contraire voudrait que la classe gouvernante ne puisse assurer son pouvoir qu'en faisant le bien de la classe gouvernée. Là encore, il y a une part, mais seulement une part de vérité. Les personnes qui acceptent cette théorie sont entraînées, peut-être à leur insu, par le fait qu'elles ont accepté l'une des solutions affirmatives indiquées aux § 1902 et sv., par le désir de montrer que celui qui fait le bien obtient nécessairement la récompense de ses œuvres, ou par l'intention de faire que cela ait lieu à l'avenir, s'il n'en a pas toujours été ainsi dans le passé [FN: § 2566-3].
§2567. En ce qui concerne les effets des tentatives de révolte, beaucoup de gens proclament sans autre que toute révolte vaincue et réprimée est désavantageuse ou du moins inutile à la classe sujette. Ils auraient raison si l'on pouvait envisager le fait séparément des autres et comme une action logique, car personne ne pourra nier qu'il est désavantageux ou du moins inutile de s'exposer à une défaite. Mais en réalité la question se présente différemment. Ces tentatives malheureuses de révoltes doivent être considérées comme des manifestations d'une force qui, d'abord inférieure à celle qui la tient en échec, finit par la vaincre, lorsque se produit la catastrophe finale. Il se peut que ces tentatives affaiblissent cette force ou qu'elles n'agissent pas dans une mesure notable ; mais il se peut aussi qu'elles en accroissent l'intensité ; cela dépendra des circonstances. Il se peut enfin – et c'est ce qui arrive très souvent – que les tentatives de révolte soient une conséquence de l'intensité de la force qu'elles manifestent. En ce cas on ne saurait vouloir que, d'une part l'intensité de cette force aille en croissant, et que, d'autre part, les tentatives qui la manifestent fassent défaut.
§2568. On observe fréquemment que la catastrophe se produit, non parce que la force manifestée par les tentatives de révolte croît, au point de l'emporter sur les forces qui maintenaient l'équilibre social, mais parce que cette force, en croissant, modifie l'action d'autres forces, et surtout de celles de l'armée. Soit parce que l'armée cesse de s'opposer aux éléments révolutionnaires, soit parce qu'elle se ligue avec eux, ou encore parce qu'elle s'y superpose, elle détermine le changement de l'organisation sociale. Celui-ci est de la sorte, non pas directement, mais indirectement un effet de la force qui se manifeste par les tentatives de révolte ; mais il n'en est pas moins dépendant de cette force.
§ 2569. Les personnes qui jugent les tentatives de révolte d'après les règles de la légalité, du droit, de l'équité, de l'éthique, de la religion, raisonnent plus mal encore que celles qui prennent en considération uniquement des actions logiques. Nous avons déjà parlé longuement de dérivations analogues (§ 2147-18-, 2181 et sv.). Il nous reste à ajouter quelques considérations touchant le cas spécial examiné tout à l'heure.
§ 2570. Quant à la légalité, il est évident qu'on y attente, non seulement par tout acte révolutionnaire, ou par tout coup d'État, mais aussi par tout autre acte qui prépare le bouleversement de l'organisation existante. Il est donc parfaitement inutile de disputer là-dessus. C'est pourtant ce qu'on fait, du côté de ceux qui défendent, aussi bien que du côté de ceux qui veulent changer une certaine organisation sociale. Ceux qui la défendent cherchent à se servir des sentiments qui représentent comme « coupable » tout acte contraire à la légalité. Aussi ne comprennent-ils pas, ou feignent-ils de ne pas comprendre, que c'est précisément cette légalité qu'on veut changer. Ceux qui veulent attaquer l'organisation sociale cherchent pour la détruire, à se servir des forces mêmes qui naissent de cette organisation. Aussi s'efforcent-ils de démontrer, même contre toute évidence, que des actes tendant à la révolte sont « légaux », et que par conséquent ils ne peuvent ni ne doivent être réprimés par les personnes qui défendent cette organisation [FN: § 2570-1] .
§2571. Quant aux principes du droit, de l'équité, de l'éthique, de la religion, on les invoque parce qu'on ne sait que trouver d'autre, lorsqu'on ne veut pas demeurer dans le domaine logico-expérimental, et parce qu'ils ont le grand avantage de se prêter à la démonstration de tout ce qu'on désire. Les principes des religions, excepté ceux de la toute puissante religion démocratique, sont aujourd'hui tombés en désuétude. Restent les principes du droit, de l'équité, de l'éthique, qui sont vivaces. On y a recours pour juger non seulement les conflits d'ordre intérieur, mais aussi ceux d'ordre international.
§2572. Les principes juridiques peuvent être quelque peu et même très précis ; ils peuvent donc donner des conclusions concordant avec la réalité, ou du moins ne s'en écartant pas trop (§ 1772 et sv.), s'ils sont employés dans les contestations entre simples particuliers, dans les sociétés où ils sont généralement acceptés, et dont ils manifestent par conséquent des sentiments communs. Cette condition disparaît lorsqu'une partie de la population s'insurge contre l'autre. L'accord de ces principes avec la réalité disparaît donc aussi, et l'on ne peut plus les utiliser, si l'on ne veut pas leur donner une valeur absolue qui échappe au domaine expérimental. Des considérations analogues s'appliquent à leur usage dans les conflits internationaux. Ils peuvent donner des conclusions qui ne soient pas en contradiction avec la réalité, s'ils sont employés entre nations qui y consentent, et dont ils manifestent des sentiments communs. Mais cette propriété disparaît si ce consentement et cette communauté de sentiments font défaut. La précision fait aussi défaut aux principes éthiques, et les personnes qui les emploient dans les cas examinés tout à l'heure recherchent uniquement les rapports des faits avec leurs sentiments, et non pas les rapports des faits entre eux, les uniformités expérimentales. Mais la première opération est beaucoup plus facile à effectuer que la seconde et produit des ouvrages plus facilement compris du vulgaire. C'est pourquoi elle est généralement en usage.
§ 2573. L'histoire de la décadence de la République romaine offre plusieurs exemples de tentatives parties d'en bas ou d'en haut pour renverser les institutions légales. Nous ne nous étendrons quelque peu que sur une seule de ces tentatives, parce qu'elle présente quelques analogies avec les mouvements révolutionnaires, anarchistes et autres de notre temps. La conjuration de Catilina est restée célèbre dans l'histoire. Le récit qu'en fait Salluste apparaît comme une amplification ridicule qu'on pourrait à grand peine tolérer dans un drame populaire. L'auteur commence par déclamer contre la soif de l'or, l'avarice ; puis il s'en prend à l'ambition, et nous apprend qu'elle s'écarte moins de la vertu que l'avarice. Ensuite, il pleure sur la perte de la vertu, s'élève contre les mauvaises mœurs. Enfin, il veut bien se rappeler qu'il s'est proposé de nous parler de la conjuration de Catilina, et, après ce bel exorde, il montre d'une manière lumineuse quelles furent les causes de ces maux. « Dans une ville aussi grande que corrompue, Catilina groupait autour de lui, presque comme une garde, – ce qui lui était facile – un ramassis de toutes les infamies et de toutes les scélératesses » [FN: § 2573-1] .
§2574. Heureusement, nous avons d'autres récits, parmi lesquels celui d'Appien. Comme il est plus sobre, il semble se rapprocher davantage de la réalité des faits. Que Catilina fût un individu peu recommandable, c'est ce que disent tous les auteurs, et cela paraît très probable. Mais il semble aussi que cet homme peu honnête n'avait pas d'aptitudes pour les ingénieuses machinations qui procuraient la richesse et le pouvoir à d'autres gens qui n'étaient pas plus honnêtes que lui. En revanche, il avait le courage qui empêche de se résigner à l'oppression. Autour de lui se groupèrent des hommes qui lui étaient semblables. Si nous voulons les tenir tous pour des malfaiteurs, ce qui serait peut-être d'une sévérité excessive, nous dirons que leur conflit avec la classe gouvernante était la lutte des brigands contre les escrocs. Cela explique pourquoi César avait envers les premiers cette bienveillance que l'on témoigne habituellement à ceux qui luttent contre des gens que l'on méprise encore davantage ; ou plutôt, cela explique pourquoi César, qui se souciait peu de l'honnêteté des moyens, pourvu qu'il atteignît son but, méditait dès lors de se servir des brigands qui employaient la force afin d'abattre les escrocs, et pour demeurer lui seul maître des richesses du monde romain.
§ 2575. Appien nous dit que Catilina demanda le consulat et ne l'obtint pas. C'est-à-dire qu'il essaya de lutter par la ruse, et qu'il fut vaincu parce qu'il n'était pas apte à ce genre d'entreprises. « Après cela, il s'abstint entièrement de participer à la vie publique [c'est ainsi que font les intransigeants antiparlementaires de notre temps, pour des motifs analogues], parce qu'elle ne menait à la monarchie, ni promptement, ni sûrement, mais qu'elle était pleine de rixes et de haines [FN: § 2575-1] ». Ce n’est pas la tête brûlée que Salluste voudrait nous faire voir. Cicéron lui-même nous raconte que la tombe de Catilina était ornée de fleurs, et qu'on y rendait des honneurs funèbres [FN: § 2575-2] .
§ 2576. Les moralistes qui veulent faire de l'histoire un roman croient devoir ou condamner ou absoudre Catilina. Ceux qui le condamnent voient en lui un ennemi de la patrie ; ceux qui l'absolvent le tiennent pour un ami du « peuple », désireux de secouer le joug de l’« oligarchie ». Il ne manque pas non plus de gens qui suivent la voie intermédiaire, et déclarent juste le but visé par Catilina, pervers les moyens auxquels il eut recours [FN: § 2576-1] .
Les faits sont beaucoup plus compliqués que ces élucubrations poétiques. Catilina semble avoir été un ambitieux dépourvu de scrupules, semblable en cela à Marius, à Sulla, à Crassus, à Pompée, à César, à Octave et à un grand nombre d'autres citoyens qui assurément n'avaient pas une vertu bien rigide. Il cherchait sa voie, et, comme il arrive d'habitude, il la trouva dans le sens de la moindre résistance. S'il avait été plus habile en fait de menées politiques, il les aurait employées avec succès ; il s'y essaya, ne réussit pas, et vit que ce n'était pas son affaire. Il avait un tempérament courageux, fier, intrépide, prompt à faire usage de la force, et peut-être comprit-il, sans en avoir clairement conscience, que là était sa voie ; et il la suivit.
§ 2577. Il aurait pu être un de ces innombrables et obscurs rebelles dont l'histoire s'occupe à peine. Mais le hasard voulut qu'un grand nombre d'autres individus se trouvassent dans son cas. Ils s'y trouvaient à cause de la prédominance des « spéculateurs » dans la classe gouvernante. De la sorte, le phénomène prit de plus amples proportions et fut accentué davantage par l'histoire. Les anciens soldats de Sulla se joignirent à Catilina. Précisément en raison de leur origine, ils étaient accoutumés à la violence et sans expérience des machinations subtiles des politiciens [FN: § 2577-1] . D'autres partisans vinrent à lui ; c'étaient des hommes ruinés, endettés, et qui voulaient, par la violence, obtenir un meilleur sort. Il s'est probablement trouvé parmi eux cette lie sociale qui monte à la surface dans toutes les révolutions ; mais le fait que des hommes comme César furent suspectés d'être des leurs montre qu'il y avait aussi des gens d'autre sorte [FN: § 2577-2] : il y avait ceux que les spéculateurs-politiciens avaient vaincus, et qui désiraient ardemment une lutte où l'on vaincrait par la force plus que par la ruse, par une volonté tenace plus que par une souple ingéniosité [FN: § 2577-2] .
§ 2578. Ce qu'il y avait chez eux de volonté tenace et de force, on le voit dans le fait que, le Sénat ayant promis l'impunité et deux cents sesterces à ceux qui auraient fait des révélations sur la conjuration, personne ne trahit. On le voit mieux encore par la façon dont ils tombèrent à la bataille de Fésules : tous frappés par devant, et le plus grand nombre couvrant de leur cadavre le poste où, vivants, ils avaient combattu [FN: § 2578-1] .
§ 2579. Salluste leur fait dire qu'ils avaient pris les armes, non contre la patrie, mais pour se défendre des usuriers qui avaient privé beaucoup de gens de leur patrie, tous de l'honneur et de leur patrimoine [FN: § 2579-1] . D'autre part, c'étaient précisément les « spéculateurs », c'est-à-dire les chevaliers, qui défendaient Cicéron, gardaient le Sénat, et menaçaient à main armée César supposé complice de Catilina [FN: § 2579-2]
§2380. En ce temps-là à Rome, comme de nos jours dans toute l'Europe, l'accroissement de la richesse avait renchéri la vie. C'est pourquoi ceux qui voulaient se contenter de leur fortune héréditaire étaient bientôt au-dessous de leurs affaires, s'endettaient, se ruinaient. Seuls se tiraient d'affaire, et même s'enrichissaient souvent, ceux qui demandaient à la politique et à la spéculation de nouveaux gains. Plus lâches que les Romains, les vaincus modernes se résignent en partie. Plus fiers que les modernes, les vaincus romains, avant de se résigner, voulaient tenter le sort des armes, qui souvent rompent les filets lâches, bien qu'ingénieux, de la ruse.
§ 2581. Plutarque dit : « Toute l'Étrurie se soulevait déjà en révolte, ainsi qu'une grande partie de la Gaule cisalpine ; et Rome courait le plus grand danger d'un changement complet, à cause de l'inégalité qui y régnait entre les fortunes [c'est l'erreur habituelle répétée par les modernes, qui attribue à l'inégalité des effets qui découlent d'autres causes] ; tandis que les personnages qui étaient le plus en vue, par leur gloire ou l'élévation de leur esprit, s'étaient appauvris par leurs folles dépenses en théâtres, en banquets, en intrigues de magistratures et en édifices [c'était les gens inhabiles aux ruses de la politique ; les habiles se récupéraient largement de ces dépenses en exploitant les provinces, ou bien s'enrichissaient par les spéculations, comme Crassus] ; et par conséquent les richesses accumulées étaient tout entières entre les mains d'hommes ignobles et abjects [d'habiles politiciens, de gens possédant presque exclusivement les résidus des combinaisons] ; et quiconque eût osé, eût été capable de renverser la république, qui d’elle-même était déjà infirme [FN: § 2581-1] ». C'est-à-dire quiconque eût osé opposer la force à cette ruse pouvait espérer la victoire. Elle échappa à Catilina, sourit quelque temps à César, fut définitive pour Auguste.
§ 2582. Napoléon dit que [FN: § 2582-1] « Cicéron croyait avoir détruit tout un parti ; il se trompait : Cicéron n'avait fait que déjouer une conspiration et dégager une grande cause [pour l'auteur, c'est celle de la « démocratie » contre l'oligarchie] des imprudents qui la compromettaient ; la mort illégale des conjurés réhabilita leur mémoire... » Ainsi nous retombons dans le roman moral. L'erreur de Cicéron, comme dit Napoléon III, aurait été de ne pas respecter la légalité ! César et Auguste la respectèrent en vérité ! [FN: § 2582-2] Si l'on veut absolument parler de l'erreur de Cicéron, ou la trouvera plutôt dans l'absurde croyance que l'éloquence et, si l'on veut, la raison et le bon droit pouvaient se substituer à la force.
§ 2583. La conjuration de Catilina ne fut que l'une des nombreuses tentatives de rébellion qui précédèrent la catastrophe finale, un incident dans les guerres civiles qui marquèrent la fin de la République, et qui furent en partie des luttes entre gens chez lesquels prédominaient les résidus de la Ire classe et gens chez lesquels prédominaient les résidus de la IIe classe. Ceux-ci triomphèrent avec Auguste qui, après la victoire, entreprit, mais en vain, de restaurer la religion, la morale, les mœurs des anciens temps. Avec le rôle donné à l'élément militaire, l'Empire romain acquit de la stabilité, du moins pour quelque temps.
§2584. La victoire qui constitua l'Empire ne fut d'ailleurs pas exclusivement celle de la force, puisque César et Auguste y ajoutèrent la ruse dans une large mesure, et que César ne manqua pas d'être fortement appuyé par la ploutocratie. On remarquera qu'alors comme aujourd'hui cette ploutocratie se met toujours du côté qui lui paraît présenter le plus de chances de succès. En France, elle encensa Napoléon III, auteur du coup d'État ; puis, après 1870, elle eut Thiers pour idole ; aujourd'hui (en 1912) elle se prosterne devant les radicaux-socialistes. Pourvu qu'elle y gagne, elle se soucie peu du pavillon qui couvre la marchandise. Vers la fin de la République, la spéculation qui exploitait les provinces et s'enrichissait de leurs impôts était prédominante. Mais une spéculation semblable à celle de l'époque moderne ne faisait pas défaut ; elle s'appliquait à la production économique et donnait la main aux machinations de la politique [FN: § 2584-1]. L’Empire romain diminua ce lien, et, pour son bonheur, il eut une spéculation surtout économique.
§ 2585. Cette spéculation faisait monter dans les classes supérieures les gens qui s'enrichissaient [FN: § 2585-1] . Ainsi, dans la classe gouvernante montaient des éléments apportant l'instinct des combinaisons ; mais ils y arrivaient lentement, de telle sorte que l'instinct des combinaisons avait le temps de s'associer à la permanence des agrégats. L'organisation de l'Empire était celle de classes distinctes et séparées, dans lesquelles on entrait par hérédité et aussi par circulation, en montant dans une classe supérieure, en descendant dans une classe inférieure. Mais, à part des exceptions dues en grande partie à la faveur impériale, l'ascension n'était pas brusque ; elle était graduelle, et telle que, pour monter très haut, il fallait plusieurs générations [FN: § 2585-2]. Tant que, en fait comme en droit, l'enrichissement éleva à la classe supérieure, tant que la classe à laquelle les nouveaux riches arrivaient ainsi joua vraiment un rôle, si petit fût-il, dans le gouvernement, et tant qu'elle ne fut pas seulement une classe honorifique, l'Empire fut économiquement prospère, bien que les vertus guerrières de la classe dominante allassent en diminuant. Le maximum de prospérité fut atteint au début, quand la classe civile produisait la richesse, et que la classe militaire maintenait l'ordre à l'intérieur et à l'extérieur [FN: § 2585-3]. L'Empire déclina ensuite parce que sur ses frontières il n'y avait plus de peuples riches à exploiter par les armes, et parce qu'à l'intérieur la cristallisation des institutions économiques, le progrès de l'organisation, après une courte période de prospérité, aboutissait, comme d'habitude, à la décadence économique. La production était grande, pour le motif rappelé (§ 2553) qu'elle croit et s'améliore lorsque la cristallisation de la société commence, après une période dans laquelle cette société était dissolue. Les frais pour conserver la stabilité à l'intérieur et pour défendre les frontières de l'Empire étaient minimes, en tout cas inférieurs aux folles dépenses de la ploutocratie démagogique, dans les dernières années de la République. Sous Tibère, la solde des prétoriens qui assurent et conservent le gouvernement [FN: § 2585-4] n'est rien en comparaison des dépenses que faisaient les politiciens, vers la fin de la République, pour acheter du peuple le pouvoir (§ 2562). Mais par une évolution naturelle, cette organisation devait se changer en celle de la décadence de l'Empire (§ 2541). La période ascendante était fermement liée à la période descendante (§ 2338). La prospérité première de cet organisme se changea peu à peu dans la décadence de la sénilité. La cristallisation de la société continuant à croître, faisait diminuer la production (§ 2607 et sv.), tandis qu'augmentait la dilapidation de la richesse. La puissance militaire se superposant toujours plus à la puissance civile, et changeant de manière d'agir et de caractère, rendait le gouvernement instable, alors que primitivement elle lui avait donné la stabilité ; elle substituait l'insolence à l'obéissance dont précédemment elle faisait preuve envers ses chefs. Elle exploitait ainsi à son profit l'organisation sociale, provoquant un gaspillage de richesse (§ 2608), et enfin la faiblesse et la destruction de la force même des troupes (§ 2606).
§2586. L'Empire se fonda principalement sur l'armée ; mais ce ne fut pas d'elle que sortit la plus grande partie de la classe gouvernante. Les légions faisaient facilement un empereur, mais ne donnaient pas beaucoup d'administrateurs ; elles en donnaient peu ; aussi n'étaient-elles pas une source abondante du renouvellement de l'élite. La classe gouvernante devenait toujours plus une classe d'employés, avec les qualités et les défauts inhérents à ces fonctions ; de plus en plus l'énergie guerrière y disparaissait.
§ 2587. À ce point de vue, le fait qui se produisit après la mort d'Aurélien est très connu [FN: § 2587-1]. Les légions demandaient un empereur au Sénat. Le Sénat ne voulait pas le donner. Les légions insistaient. Ainsi, l'Empire demeura six mois sans empereur. Finalement le Sénat, presque contraint, nomma un empereur. Qui ? Peut-être un capitaine, ou tout au moins un homme énergique ? Loin de là : un vieillard de soixante-quinze ans. Là se manifeste le défaut d'instinct des combinaisons politiques chez les légions, et le défaut d'énergie guerrière chez le Sénat. Le premier défaut pouvait être compensé par le hasard qui faisait tomber le choix des légions sur un empereur doué de cet instinct des combinaisons politiques. Le second défaut n'avait pas de remède. Il fut en partie la cause premièrement de la destruction de l'élite, ensuite de celle de l'Empire.
§2588. Ce qu'on nous raconte de l'élection de Tacite nous montre qu'en ce temps déjà sévissait la maladie de l'humanitarisme, qui a recommencé de nos jours à sévir dans nos contrées.
§2589. Mus par des préjugés éthiques contre la richesse, contre le luxe, contre le « capital », la plupart des auteurs ne s'attachent qu'à ces circonstances, dans l'histoire de Rome ; tandis que pour l'équilibre social, la modification des sentiments (résidus) de la classe gouvernante est beaucoup plus importante.
§ 2590. Dans les premiers temps de l'Empire, les indices de ta circulation des élites ne manquent pas. S'ils ne sont pas aussi nombreux que nous le voudrions, il faut en rechercher la cause dans les préjugés qui faisaient estimer le récit de ces faits peu convenable à la dignité de l'histoire. C'est pourquoi nous n'avons de renseignements sur cette circulation que par hasard [FN: § 2590-1] . Tel fut le cas pour ce Rufus dont parle Tacite. D'ailleurs ces indices suffisent à nous faire connaître le phénomène. En attendant, déjà à propos de ce Rufus, apparaissent clairement les caractères de lâcheté ingénieuse de la nouvelle élite. On les retrouve en d'autres exemples. « Sur l'origine de Rufus, que certains disent fils d'un gladiateur, je ne dirai pas ce qui n'est pas, et j'ai honte de la vérité. Fait citoyen, il s'aboucha avec le questeur de l'Afrique. Se trouvant à Adrumète tout seul sous les portiques, à midi, une femme surhumaine humaine lui apparut et lui dit : „ Rufus, tu seras vice-consul “. Persuadé par cet oracle, il revint à Rome, et grâce à l'argent de ses amis et à sa vive intelligence, il devint questeur ; puis, à l'égal des nobles, préteur, grâce au vote du prince Tibère, qui dit, pour couvrir son humble origine : „ Rufus me parait être né de lui-même “. Il vécut longtemps, fut odieusement adulateur envers ses supérieurs, arrogant avec ses inférieurs, désagréable avec ses égaux. Il obtint l'imperium consulaire, les honneurs du triomphe et finalement l'Afrique, où il mourut ; et l'augure se réalisa [FN: § 2590-2] ».
§ 2591. Dans sa satire des mœurs, Pétrone décrit un type imaginaire, mais qui avait certainement son correspondant dans la réalité ; et si l'on élimine la partie pornographique, et que l'on substitue d'autres luxes à celui de la bonne chère, ce type est tout à fait semblable au type moderne de certains milliardaires exotiques. Voyez donc comment Trimalcion acquiert son immense patrimoine [FN: § 2591-1] . Il charge de vin cinq navires pour les envoyer à Rome. Ils font naufrage ; mais lui ne se décourage pas. Il charge de nouveaux navires, plus grands, plus forts, plus heureux que les premiers. Il y met du vin, du lard, des fèves, des parfums de Capoue, des esclaves. Ainsi, en une seule fois, il gagna dix millions de sesterces. Il continua à faire le commerce, toujours avec succès ; il finit par se contenter de prêter de l'argent aux affranchis. Il voulait même se retirer entièrement des affaires, mais il en fut dissuadé par un astrologue. Ne croirait-on pas entendre parler l'un de nos ploutocrates, lorsque, s'adressant aux convives, Trimalcion s'écrie : « Croyez-moi : aie un as, tu vaudras un as ; sois riche, tu seras estimé. C'est ainsi que votre ami, qui fut grenouille, est aujourd'hui roi [FN: §2591-2] ». Il veut parler philosophie et belles lettres [FN: § 2591-3] , mais s'y connaît à peu près autant que nos parvenus, qui croient tout savoir parce qu'ils ont gagné de l'argent. Trimalcion montre à ses invités les joyaux de sa femme, et veut qu'ils en sachent le poids exact [FN: § 2591-4] . Bon nombre de nos riches parvenus modernes agissent de même.
§ 2592. Mais la femme de Trimalcion est, au point de vue économique, très supérieure aux femmes de notre ploutocratie. Lorsqu'elles sont riches, ou seulement dans une certaine aisance, elles dédaignent de s'occuper de leur maison, et sont de simples objets de luxe, fort coûteux. Au contraire, la bonne Fortunata s'occupe avec grand soin de l'économie domestique [FN: § 2592-1] . Elle avait donné ses joyaux à son mari ruiné [FN: § 2592-2] , bien différente en cela de nombreuses femmes de notre ploutocratie, qui auraient incontinent demandé le divorce contre l'homme qui ne pouvait plus entretenir leur luxe.
§ 2593. Trimalcion n'est pas le seul enrichi. Voici le sévir Abinna [FN: § 2593-1], sculpteur ou tailleur de pierre, qui fait cadeau à sa femme de joyaux coûteux. Voici l'avocat (causidicus) Philéron [FN: § 2593-2] qui, de la misère s'est élevé à une grande richesse. Plusieurs affranchis, anciens compagnons de servitude de Trimalcion, sont aussi enrichis [FN: § 2593-3] . Ainsi, le commerce avec Trimalcion, l'industrie avec Abinna, la science avec Philéron, donnent les nouveaux riches. On rit d'eux ; mais ce rire même prouve leur existence. Martial se moque d'un cordonnier qui avait donné à Bologne un spectacle de gladiateurs [FN: § 2593-4], et un drapier qui avait fait de même à Modène.
§ 2394. Juvénal attaque aussi dans ses satires les riches parvenus. Même si l'on fait la part large à la fantaisie poétique qui agrandit les objets, il n'est pas croyable que les récits de Juvénal fussent en pleine contradiction avec ce que chacun savait et pouvait voir à Rome. Il cite son barbier, qui s'est considérablement enrichi [FN: § 2594-1]. Le fait particulier peut n'être pas vrai ; le type l'est certainement.
§ 2595. L'invasion des étrangers à Rome est bien notée aussi par Juvénal (FN: § 2595-1). « Celui qui vint un jour dans cette ville les pieds blanchis de gypse ne cède pas le pas au tribun sacré ». Juvénal dit des Grecs venus à Rome (III, 92-93) : « Nous aussi nous pouvons louer ainsi, mais eux persuadent ». Plus loin : « (119-120) Il n'y a place pour aucun Romain là où règne un Protogène, un Diphilus ou un Erimarque ». - « (130-131) Ce fils d'origine libre fait humblement sa cour à un esclave enrichi ». - « (60-66) (FN: § 2595-2). Je ne puis supporter, Quirites, cette ville grecque, si peu qu'il s'y trouve de lie achéenne. Il y a longtemps déjà que l'Oronte syrien versa dans le Tibre sa langue et ses mœurs... » Il pouvait ajouter : sa religion. Le mal, dont l'existence doit certainement avoir un fondement de vérité, prend des proportions gigantesques, lorsque Juvénal dit, à propos des places des chevaliers au théâtre : « (153-158) Qu'il sorte, dit-il, s'il a quelque pudeur et qu'il s'en aille des degrés équestres, celui qui n'a pas le cens légal ; et qu'ici prennent place les fils des entremetteurs, nés dans quelque lupanar. Que le fils d'un crieur public bien connu applaudisse ici parmi les élégants fils de gladiateurs, et parmi ceux d'un maître des gladiateurs (FN: § 2595-3) ».
§2596. Il devait aussi y avoir un grand nombre d'hommes sortis de rien, dans une société qui n'estimait pas sotte et absurde la satire où l'on écrivait : « (III, 29-39) Retirons-nous de la patrie. Qu'ils y restent ceux auxquels il est facile de prendre à forfait les travaux d'un édifice, ou de curer un fleuve, un port, un cloaque, de porter au bûcher un cadavre, et de vendre aux enchères un esclave. Ces gens-là, naguère joueurs de corne, habitués perpétuels des arènes provinciales, connus pour sonner de la trompe, donnent aujourd'hui des spectacles de gladiateurs, et pour se rendre populaires, lorsque le vulgaire tourne en bas le pouce, ils tuent qui l'on veut. Ensuite, sortis de là, ils louent les latrines publiques. Et pourquoi pas ? Puisqu'ils sont de ceux que la Fortune élève d'un humble à un haut état, chaque fois qu'elle veut jouer ? »
§ 2597. La faveur impériale tirait du néant certains affranchis et les portait aux plus grands honneurs [FN: § 2597-1]. Claude se laissait gouverner par eux. Mais leur nombre fut toujours restreint, et la plupart progressaient par leurs mérites, dans les administrations impériales ou privées [FN: § 2597-2] . Sénèque parle de la richesse des affranchis [FN: § 2597-3] , et Tacite nous les montre envahissant toute la classe gouvernante, malgré la résistance des citoyens ingénus [FN: § 2597-4] . Sous le principat de Néron, on parla au Sénat des fraudes des affranchis « qui traitaient à égalité avec leurs maîtres », et l'on voulait les réprimer. « On alléguait, d'un autre côté, « qu'il fallait punir les fautes des particuliers, sans attaquer les droits d'un corps très étendu ; que ce corps servait à recruter les tribus, les décuries, les cohortes même de la ville ; qu'on en tirait des officiers, des magistrats et des pontifes ; que beaucoup de chevaliers, que plusieurs sénateurs n'avaient pas une autre origine ; qu'en faisant des affranchis une classe à part, on manifesterait la disette des citoyens libres de naissance »... Néron écrivit au Sénat d'examiner séparément les plaintes des patrons contre chaque affranchi, sans toucher aux droits du corps. Peu de temps après, Pâris, affranchi de Domitia, déclaré faussement citoyen, fut enlevé à sa maîtresse, non sans honte pour le prince, qui fit prononcer par jugement que Pâris était né de parents libres [FN: § 2597-5] ». Néron protégeait les parvenus. Suétone nous le montre désireux de gouverner uniquement avec eux [FB: § 2597-6].
§ 2598. D'autre part, la guerre et l'appauvrissement épuisaient le patriciat. Dion Cassius observe que, pour entretenir les sacrifices, Auguste dut créer de nouveaux patriciens, en remplacement du grand nombre de ceux qui avaient disparu dans les guerres civiles [FN: § 2598-1] . Tacite rappelle aussi les nombreux parvenus qui, des municipes, des colonies et aussi des provinces, passèrent au Sénat [FN: § 2598-2] . Il raconte de même que, malgré l'opposition des sénateurs, Claude y fit entrer les Gaulois [FN: § 2598-3] . Et voilà de nouveau que Vespasien doit restaurer l'ordre sénatorial défaillant en nombre et en qualité [FN: § 2598-4] .
§ 2599. La circulation apparaît d'une façon parfaitement claire. Cela n'arrivait pas seulement à Rome entre la classe inférieure et la classe supérieure. Mais de tout l'Empire, et même des contrées situées au-delà des frontières, les esclaves affluaient à Rome. Parmi eux, ceux qui possédaient une plus grande abondance de résidus de la Ire classe étaient Grecs ou Orientaux, acquéraient facilement la liberté. Leurs descendants, toujours grâce à la prédominance des résidus de la Ire classe, s'enrichissaient, montaient dans la hiérarchie sociale, devenaient chevaliers et sénateurs. De la sorte, le sang latin et le sang italique étaient éliminés de la classe gouvernante. Celle-ci, pour de nombreux motifs, dont l'origine servile et la lâcheté asiatique n'étaient peut-être pas les derniers, devenait toujours plus étrangère à l'usage des armes.
§ 2600. Elle y était poussée même par les empereurs, à cause de la crainte qu'ils avaient d'elle. Dion Cassius déjà fait allusion à cette idée, dans le discours, probablement inventé, qu'il met dans la bouche de Mécène, pour conseiller Auguste sur la forme du gouvernement [FN: § 2600-1] . Ensuite, les empereurs y veillèrent avec soin, jusqu'à ce qu'enfin Gallien en vint à interdire aux sénateurs d'aller dans le camp de l'armée. Sévère avait déjà supprimé l'usage de tirer les prétoriens de l'Italie, de l'Espagne, de la Macédoine et de la Norique [FN: § 2600-2] . Il les avait fait venir de toutes les parties de l'Empire, même des plus barbares [FN: § 2600-3] .
§2601. On peut représenter l'évolution à peu près comme suit. Sous la République, obligation effective du service militaire pour les membres de l'élite. Dans les premiers temps de l'Empire, obligation toute formelle, mais sans que le service effectif fût interdit. Ensuite, absence de service effectif.
§ 2602. Pline le Jeune nous donne un exemple de ce qu'était le service militaire des jeunes chevaliers dans le temps de transition [FN: § 2602-1]. Tandis qu'il faisait son service militaire, il s'occupait de comptabilité. D'autre part, il loue Trajan d'avoir fait un service militaire effectif. Claude « institua un genre fictif de troupes, appelé surnuméraire, qui servit de titre aux absents » [FN: § 2602-2] .
§ 2603. Auguste interdit aux sénateurs de s'éloigner de l'Italie sans sa permission, exception faite de la Sicile et de la Gaule Narbonnaise, « parce que les hommes y étaient désarmés et pacifiques. » [FN: § 2603-1] Il était interdit aux sénateurs de mettre le pied en Égypte [FN: § 2603-2] , et cela était si important qu'il s'y ajouta aussi des sanctions religieuses [FN: § 2603-2] . Selon Borghesi, sous Alexandre Sévère, ou selon Kuhn, sous Aurélien, le gouvernement des provinces fut divisé en deux. C'est-à-dire qu'il y eut un praeses pour l'administration civile et un dux pour l'administration militaire.
§ 2604. La séparation toujours croissante entre la classe militaire et la classe civile rendait celle-ci toujours plus lâche et plus incapable de se défendre à main armée. Quand Septime Sévère traversa l'Italie avec ses légions, les villes furent frappées de terreur, « car, en Italie, les hommes étaient depuis longtemps étrangers aux armes et à la guerre ; ils ne s'entendaient qu'à la paix et à l'agriculture » [FN: § 2604-1] . De la sorte, on avait un indice de la faiblesse ou de l'absence de résistance qu'ils auraient ensuite opposée aux invasions barbares.
§ 2605. Cependant, au temps de Gallien, le danger grave et imminent d'une invasion barbare parut réveiller pour très peu de temps la valeur de la population. « L'empereur Gallien se trouvant au-delà des Alpes, occupé à la guerre contre les Germains, le Sénat romain, voyant le danger extrême, arma autant de soldats qu'il y en avait dans la ville, et donna des armes aux hommes les plus vigoureux du peuple, rassemblant de la sorte une armée plus grande que celle des Barbares, qui, craignant d'en venir aux mains, s'éloignèrent de Rome... » [FN: § 2605-1] . Mais l'oligarchie militaire qui exploitait l'empire se mit bientôt à l'abri, et Gallien, par crainte que le pouvoir ne passât aux optimates, interdit au Sénat d'avoir des troupes, et même de venir à l'armée [FN: § 2605-2]. Alexandre Sévère disait : « Les soldats ont leur fonction, tout comme les littérateurs. C'est pourquoi chacun doit s'occuper de ce qu'il connaît » [FN: § 2605-3] . Arrius Menander (Dig., XLIX, 16, I) nous dit : « Se faire soldat est, de la part de celui qui n'en a pas le droit, un crime grave, lequel est rendu plus grand, comme d'autres délits, par le rang et par la dignité de l'armée ».
§ 2606. Ainsi, l'armée de l'Empire finit par être un ramassis de propres à rien, et il fallut recourir aux Barbares pour avoir des soldats, ce qui était proprement installer l'ennemi chez soi. Végèce décrit bien le phénomène : « Le temps n'améliora jamais une armée où l'on négligea le choix des recrues. Nous le savons par notre usage et notre expérience. De là proviennent les défaites que les ennemis nous infligèrent partout. On doit les imputer à la grande négligence et à l'incurie que, par suite d'une longue paix, on met dans le choix des soldats ; au fait que les meilleurs citoyens (honestiores) recherchent les fonctions civiles ; au fait que, par la faveur ou par la fraude des recruteurs, on accepte dans l'armée de la part des propriétaires qui doivent les fournir, des hommes tels que leurs patrons les dédaignent » [FN: § 2606-1] .
§2607. La société romaine se cristallisait. Toutes sortes d'obstacles s'opposaient à la circulation légale aussi bien qu'effective des élites. Si de temps à autre la faveur impériale surmontait ces obstacles pour un individu en particulier, il entrait souvent dans la classe gouvernante des hommes peu dignes d'y être. Donnant probablement une forme légale à ce qui existait déjà en partie, Alexandre Sévère institua des corporations d'arts et métiers [FN: § 2607-1]. Cette organisation s'accrut ensuite et prospéra, se rapprochant de celle qu'on voudrait instaurer aujourd'hui avec les syndicats obligatoires [FN: § 2607-2] . Peu à peu, l'artisan est attaché à son métier, l'agriculteur à la glèbe, l'augustalis à sa corporation [FN: § 2607-3], le décurion à la curie. Tous s'efforçaient de se délier et de fuir ; mais le gouvernement donnait la chasse aux fugitifs, et si la faveur de l'empereur ou des grands ne les sauvait pas, ils étaient ramenés aux fonctions auxquelles eux et leurs descendants devaient pour toujours rester attachés.
§ 2608. La production de la richesse diminue et le gaspillage en augmente à cause des nombreuses charges imposées aux riches. D'autre part, les hautes classes n'étaient plus les classes gouvernantes, et le fait d'y appartenir donnait plus d'honneurs que de pouvoir. Les empereurs étaient nommés par une troupe grossière, corrompue, dépourvue de tout sens politique. Il manquait des révolutions non-militaires, civiles, qui auraient mélangé les classes, produit une nouvelle circulation des élites, et élevé des hommes abondamment pourvus de résidus de la Ie classe. Avec beaucoup de raison, Montesquieu compare l'Empire romain de la décadence à la régence d'Alger, en son temps. Mais il faut ajouter qu'Alger n'avait pas une bureaucratie qui, à l'instar de la bureaucratie romaine de la décadence, tarit toute source d'activité et d'initiative individuelle. La société romaine déclinait économiquement et intellectuellement, tandis qu'elle subissait les dégâts d'une caste militaire imbécile et d'une bureaucratie vile et superstitieuse.
§ 2609. En Occident, l'invasion barbare vint briser cette société cristallisée (§ 2551 et sv.), à laquelle, avec l'anarchie, elle apporta aussi une certaine espèce de souplesse et de liberté. Celui qui passe sans autres des corporations de la fin de l'Empire romain, c'est-à-dire d'un état de liaisons très fortes ma (fig. 48), aux corporations du moyen âge, c'est-à-dire à un autre état de liaisons, fortes aussi, pc, suit une ligne ac qui ne coïncide pas avec la ligne réelle abc, et il néglige un minimum de liaisons nb, qu'on atteignit avec l'anarchie qui suivit les invasions barbares [FN: § 2609-1] . La confusion que l'on fait entre l'état réel et l'état légal d'un pays contribue à entretenir cette erreur. Là où la loi n'accorde pas explicitement la liberté, on suppose que celle-ci n'existe pas et ne peut exister, tandis qu'au contraire elle peut fort bien être la conséquence, soit de l'absence des lois, soit – et c'est le cas le plus fréquent – du fait qu'elles ne sont pas exécutées, ou qu'elles sont mal exécutées. De même, la cristallisation d'un pays est souvent moindre qu'il ne ressort de l'examen des lois, parce que celles-ci ne représentent que très en gros l'état réel. La corruption des officiers publics est aussi, en de nombreux cas, un remède efficace à l'oppression des lois qu'autrement on ne pourrait supporter.
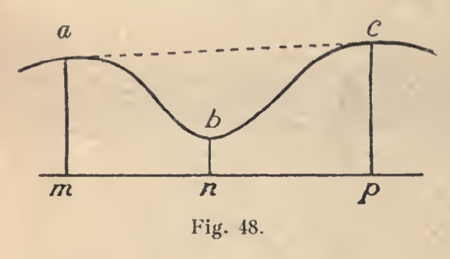
Figure 48
§ 2610. Dans l'Empire romain d'Orient, l'état de cristallisation subsista, alors qu'il avait été brisé dans celui d'Occident ; et l'on put observer les effets de l'organisation poussée à l'extrême [FN: § 2610-1]. Une anecdote conservée jusqu'à nos jours peut nous donner un aperçu pittoresque de ce qu'on pouvait observer au temps d'Attila. Priscus, qui accompagnait Maximin, envoyé en ambassade par Théodose à Attila, rencontra, dans le camp des Huns, un Grec alors riche chez les Scythes. Cet individu lui raconta comment, fait prisonnier de guerre, et échu comme part de butin à Onégèse, le premier des Scythes après Attila, il recouvra la liberté et acquit de la fortune. « Ensuite, ayant combattu avec valeur contre les Romains et contre la nation des Acatires, et ayant donné à son maître barbare le butin qu'il avait fait à la guerre, il obtint la liberté, suivant la loi des Scythes. Il épousa une femme barbare. Il en eut des enfants, et, devenu le commensal d'Onégèse, il lui semblait mener alors une vie plus agréable qu'avant ; car ceux qui se trouvent chez les Scythes ont, après la guerre, une vie tranquille. Chacun jouit de ses biens, et n'est molesté en aucune façon par qui que ce soit. Au contraire, ceux qui sont chez les Romains sont facilement tués à la guerre, car ils doivent remettre en d'autres l'espoir de leur salut, puisque les tyrans ne leur permettent pas de faire usage des armes. Et à ceux qui en font usage, l'incapacité des chefs est pernicieuse : ils dirigent mal la guerre. D'ailleurs, en temps de paix, les charges sont plus accablantes que les maux en temps de guerre, à cause de la très dure exaction des impôts et des vexations des malfaiteurs, car les lois ne sont pas égales pour tout le monde. Si quelque violateur de la loi est un riche, son délit n'encourt aucune peine ; si c'est un pauvre, ignorant des roueries, on lui applique la peine prévue par la loi, à moins qu'il ne meure avant que le jugement soit rendu, étant donnés la longue durée du procès et le grand gaspillage des fortunes. Il y a, en effet, une manière absolument inique d'obtenir par marchandage ce qui ressortit à la loi ; et de vrai aucun tribunal ne mettra un frein aux injustices subies, si l'on ne donne pas de l'argent aux juges et aux chanceliers » [FN: § 2610-2]. Priscus répond et tresse des couronnes au gouvernement romain. Il est remarquable que l'ambassade dont il faisait partie démontrait précisément la lâcheté et la corruption de ce gouvernement. Maximin était un honnête homme, une de ces personnes dont en tout temps les gouvernements se servent pour masquer leurs actions mauvaises et malhonnêtes (§ 2268, 2300) ; mais il était accompagné par Edécon et Bigilas, qui devaient ourdir la trame pour assassiner Attila [FN: § 2610-3] . Le gouvernement impérial savait organiser toute chose, même l'assassinat. Pourtant, cette fois, cela ne lui réussit pas. Attila eut vent de la machination, et envoya des ambassadeurs qui admonestèrent l'empereur par de fières paroles. Attila rappelait que Théodose, en lui payant tribut, s'était fait son esclave ; et il ajoutait : « Il n'agit donc pas justement celui qui tend des embûches, tel un esclave malfaisant, à celui qui est meilleur que lui, et dont la fortune a fait son maître » [FN: § 2610-4] .
§ 2611. Une seule anecdote suffira, parmi l'infinité qu'on pourrait citer, pour montrer comment on s'élevait à la classe gouvernante, là où régnait l’organisation byzantine. Synésios, qui vivait environ un siècle avant le temps auquel se rapporte l'anecdote précédente, écrit à son frère [FN: § 2611-1] : « L'entremetteur Chilon n'est vraisemblablement pas inconnu à beaucoup de gens, étant donné son art très célèbre ; car la comédienne Andromaque, la plus belle des femmes qui brillèrent de notre temps, fut de sa troupe. Après avoir passé sa jeunesse à un si beau métier, parvenu à l'âge mûr, il estima qu'il convenait à son état précédent de s'illustrer dans l'armée. Il vint donc, il y a peu de temps, ayant obtenu de l'empereur le commandement des terribles Marcomans. Puisqu'ils étaient précédemment des soldats très braves, maintenant qu'on leur a donné un si célèbre général, il semble qu'ils nous feront assister à de grands et nobles exploits ». Comment ce Chilon obtint-il la faveur impériale ? Par l'entremise de certains Jean et Antiochus, qui paraissent également n'avoir pas valu grand'chose. Avec de semblables façons de constituer la classe gouvernante, on comprend aisément que peu à peu les provinces de l'Empire furent perdues, et finalement la capitale elle-même. Il faut remarquer que le phénomène n'est pas spécial à la bureaucratie byzantine : il est général et apparaît presque toujours à l'âge sénile des bureaucraties. On l'observa et on l'observe encore en Chine, en Russie et en d'autres pays. De la sorte, l'organisation sociale commence par amener la prospérité, et finit par provoquer la ruine [FN: § 2611-2] (§ 2585).
§2612. Ainsi que nous l'avons relevé plusieurs fois et naguère encore (§ 2553), les ondulations des dérivations suivent celles des faits. C'est pourquoi, lorsqu'il y a environ un siècle on était dans la période ascendante de la liberté, on blâmait les institutions cristallisées et restrictives de l'Empire byzantin. Aujourd'hui que nous sommes dans la période descendante de la liberté, ascendante de l'organisation, on admire et on loue ces institutions ; on proclame que les peuples européens doivent une grande reconnaissance à l'Empire byzantin, qui les a sauvés de l'invasion musulmane ; et l'on oublie que les vaillants soldats de l'Europe occidentale surent vaincre et chasser seuls à mainte reprise Arabes et Turcs, et qu'avant les peuples asiatiques, ils se rendirent aisément maîtres de Constantinople. Byzance nous fait voir où peut atteindre la courbe que nos sociétés sont en train de parcourir. Quiconque admire cet avenir est nécessairement amené à admirer aussi ce passé, et vice-versa.